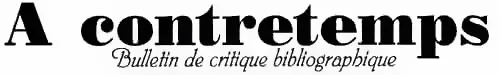23.02.2026 à 11:15
Revenir du Rojava
■ Libre FLOT ANTICIPER LE BRUIT SEC DES VERROUS Les éditions du bout de la ville, 2025, 96 p. On va la jouer franco : on connaît les Ariégeois animant Les éditions du bout de la ville. On pourrait même dire qu'on les kiffe. Si on les kiffe c'est parce qu'on a bossé avec eux une paire d'années sur un bouquin promis à une sortie imminente. Une meuf, trois gars, quatre tronches remplies de choses précieuses : capacité d'écoute, pertinence, ténacité, gentillesse, souffle littéraire – on n'est (…)
- Recensions et études critiquesTexte intégral (2560 mots)

■ Libre FLOT
ANTICIPER LE BRUIT SEC DES VERROUS
Les éditions du bout de la ville, 2025, 96 p.
On va la jouer franco : on connaît les Ariégeois animant Les éditions du bout de la ville. On pourrait même dire qu'on les kiffe. Si on les kiffe c'est parce qu'on a bossé avec eux une paire d'années sur un bouquin promis à une sortie imminente. Une meuf, trois gars, quatre tronches remplies de choses précieuses : capacité d'écoute, pertinence, ténacité, gentillesse, souffle littéraire – on n'est pas là pour écrire des tracts –, intelligence politique – on n'est pas là pour radoter les éternels poncifs. Récit, essai, fiction : tout est question de féconde hybridation et la parole n'est jamais autant précieuse que quand elle monte des rangs de la plèbe.
Les éditions du bout de la ville ont leur marotte mais pas que : la condition paysanne, le fléau atomique, la question carcérale. Récemment, ils ont publié, signé Moben et préfacé par Jacky Durand, Mange ta peine : les recettes du prisonnier à l'isolement. Tout est dans le titre. Incarcéré à la taule de Moulins-Yzeure (Allier), l'auteur a été puni par la pénitentiaire pour avoir coécrit… un livre de cuisine, puis transféré au sein du quartier de lutte contre la « criminalité organisée » de Condé-sur-Sarthe (Orne). En zonzon, même la tambouille peut servir de prétexte punitif. En zonzon, l'absurde n'a pas de limite et Kafka peut aller se rhabiller.
Il en va ainsi du texte de Libre Flot, Anticiper le bruit sec des verrous. Libre Flot est le pseudo de Florian. Dans une vie antérieure, Florian était un punk itinérant. À trente-trois ans, il est devenu combattant en rejoignant le Rojava, et plus précisément les rangs des YPG, tenaces Unités de protection du peuple kurde. Entre 2013 et 2018, environ deux mille Occidentaux auraient ainsi eu la même démarche. Autant de volontaires internationalistes formant une vraie tour de Babel : de l'ancien bidasse versé dans le mercenariat au militant de gauche radicale séduit par le projet fédéraliste, féministe et écologique du Rojava. Inutile de préciser dans quelle catégorie se range Libre Flot.
On va encore la jouer franco : on n'aurait peut-être jamais lu Anticiper le bruit sec des verrous si on n'avait pas connu l'équipe du bout de la ville. La raison n'est pas bien claire, mais elle est peut-être à chercher du côté d'un obscur sentiment de culpabilité ou de gêne face à la détermination et au courage de ces internationalistes du XXIe siècle quittant soudain le confort de leur foyer pour aller risquer leur peau dans la poudrière syrienne en se confrontant aux djihados de Daesh (État islamique). Face à la pusillanime déferlante postmoderne, même issu d'une minorité de volontaires, un tel engagement aurait dû inspirer plus d'un essayiste en mal d'utopie. À des milliers de kilomètres de nos démocraties avachies et autocentrées, quelque chose se rééquilibrait : le nerf cru d'un idéal, les corps mis en danger dans un jeu de solidarité sans frontière ni filet. La guerre contre les « islamo-fascistes », nouvelle incarnation du bigotisme martial et despotique, un patriarcat de couillards à kalache.
Ce faisant, les volontaires internationalistes ranimaient, quatre-vingts ans plus tard, la flamme ardente des Brigades de 1936 – sans leur matrice stalinienne, ce qui n'est pas rien. En 2017, certains – dont Libre Flot – participèrent à la libération de Raqqa, capitale autoproclamée de l'État islamique. Soutenu un temps par la coalition internationale, on crut un temps que les YPG allaient pouvoir consolider les bases de leur confédéralisme démocratique. C'était mal connaître ces « alliés » qui, globalement, ne s'intéressaient aux Kurdes que tant qu'ils pouvaient fournir des troupes au sol contre les kamikazes de Daesh ; c'était mal mesurer, de même, la détermination du pouvoir turc à les éradiquer. Plus tard, ce sera mal saisir le nouveau régime syrien et la volonté de son nouveau taulier, Ahmed al-Charaa, ancien cadre du Front al-Nosra, de purger la nouvelle « République arabe syrienne » en effaçant de sa carte le rêve émancipateur du Rojava.
Torture blanche
Mais lâchons la sinistre géopolitique et revenons à Libre Flot.
En mars 2017, le trentenaire part donc pour le Rojava. Il revient en France trois mois après la libération de Raqqa, soit en janvier 2018. Libre Flot a beau ne pas s'attendre à recevoir une médaille de sa patrie-des-droits-de-l'Homme reconnaissante, il est loin de se douter que son engagement contre les authentiques terroristes de Daesh va faire de lui un suspect aux yeux de la Sécurité intérieure. « À leur retour dans leur pays d'origine, explique Pierre E. Guérinet dans l'avant-propos au livre, bien qu'ils aient combattu Daesh aux côtés d'une coalition internationale qui comprend alors la France, les volontaires internationalistes se trouvent dans le viseur des services de renseignement. Ils sont considérés comme des “revenants”, au même titre que les personnes qui avaient rejoint les troupes islamo-fascistes de Daesh. Pour la DGSI (Direction générale de la Sécurité intérieure), le scénario est simple : Libre Flot aurait l'intention d'utiliser, sur le territoire français, des connaissances militaires acquises au Rojava. »
Dix ans après l'affaire et le fiasco de « Tarnac », la flicaille antiterroriste nous ressort l'inépuisable menace anarcho-autonome tendance ultra-gauche. Pour nourrir le récit flicardier, il faut un groupe et un projet sanguinaire, ils seront fabriqués artificiellement ; il faut surtout un leader charismatique : ce sera Libre Flot. Tant il est vrai qu'une caboche à képi ne peut imaginer ses « ennemis » que sous la forme pyramidale d'une entité fortement hiérarchisée – celles et ceux qui ont tenu les ronds-points en savent quelque chose.
C'est donc parti pour plusieurs mois de surveillance. Début 2020, la DGSI transmet son rapport à charge au parquet national antiterroriste. S'ensuit une enquête préliminaire et l'arrestation, le 8 décembre, de neuf personnes par les mastards du RAID (Recherche, assistance, intervention, dissuasion). Direction les bureaux de la DGSI à Levallois-Perret. Sous les néons du Renseignement, Libre Flot est cuisiné : qu'est-il vraiment allé foutre au Rojava ? Quel est son camp politique ? Que pense-t-il de Macron, d'Erdogan ? Une fois les interrogatoires terminés, il est placé à l'isolement au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy. Une détention provisoire qui durera seize mois.
Anticiper le bruit sec des verrous débute par une lettre que le détenu envoie à l'émission de radio L'Envolée. La claque arrive, on ne s'en remet pas. Tournant les pages on comprend qu'il y a pire que la guerre contre Daesh, il y a la solitude dans une cage, le cerveau qui part en miettes, le corps qui se dérobe, la lucidité qui s'effiloche sous le dépeçage patient d'une effroyable « torture blanche ».
Datée du 3 juin 2021, la première lettre de Libre Flot commence ainsi : « Pour moi qui ai vécu la majeure partie de ma vie de manière collective, j'avais pourtant récemment accepté les bienfaits de courtes périodes de solitude. En disant cela, j'ai comme un arrière-goût âpre dans la bouche tant mes semblables me manquent. Ce sentiment n'est pourtant pas justifié, mais provient de l'amalgame dont, dans ce contexte, j'ai du mal à me séparer, entre solitude et régime d'isolement. Il m'est pourtant simple de constater que l'isolement est à la solitude ce que la lobotomie est à la méditation. »
Ses lettres vont ainsi, s'échelonnant, jusqu'à la dernière datée du 27 mars 2022. Libre Flot les termine souvent par la formule « Salutations & Respects », avec majuscules et pluriel parce que, même dans une cage éclairée H24, la déférence s'impose. De même que l'écriture inclusive qui rassemble dans le grand bestiaire humain les « surveillant.es » et les « gardien.nes ». Libre Flot a un défaut : il ne peut s'empêcher d'« empathiser ». À l'isolement, son rapport à l'altérité étant limité, il empathise avec les matons. Empathie ne veut pas dire sympathie, on précise parce que ce n'est jamais clair cette affaire. L'empathie, c'est grosso modo la capacité de chacun à pouvoir se mettre dans la tête de quelqu'un d'autre. Celle d'un promoteur d'acétamipride ou d'un danseur de zumba, par exemple. Matant les matons, Libre Flot s'interroge sur « leurs parcours de vie », « ce qui les a amené.es là, à maintenir des êtres vivants enfermés ». Questions sans réponse. Il n'y a pas de vocation maton. La taule, on s'y retrouve comme derrière un bureau à la Sécurité sociale : parce qu'il faut bien croûter et que, traversant la rue, un job peut vous amener à pointer derrière un mur d'enceinte haut de six mètres flanqué de miradors.
Le punk n'est pas qu'une musique bourrine avec trois accords. C'est aussi une tenue morale où le véganisme tient une place conséquente. Libre Flot a beau être enfermé avec lui-même, il a des principes auxquels il ne compte pas déroger. On peut supputer que cet échafaudage axiologique n'a pas été pour rien dans sa capacité à résister à l'enfer de l'enfermement. De barbaque il ne mangera pas. Ses lettres témoignent de son combat pour que son régime alimentaire soit respecté. Car tout est bataille et infernale tracasserie en prison : soigner une rage dentaire, soulager des douleurs articulaires, consulter un psy. Libre Flot a beau jouer le jeu du détenu modèle, les mois passent et rien ne se passe. Rien pour desserrer l'étau de ses conditions de détention. Il s'astreint à des leçons quotidiennes de kurde mais sent bien que ses capacités cognitives dévissent. Les jours se dupliquent et le temps n'est plus qu'un plâtre où tout s'empêtre et se rigidifie. « Le plus pernicieux dans l'isolement est de rendre le réel irréel. » Le monde extérieur n'a plus de substance, les événements plus d'effectivité. « La seule réalité (pathétique), c'est cette cellule, ces livres, ces salles des spores (hihi), cette douche, cette “pseudo-promenade” individuelle. » L'enfermé ironise, preuve qu'au fond de lui ça tient encore. Bientôt il trouvera un mot-valise pour désigner la promenade : « opprimenade ». Pas mal, mec !
« Amis de chez Daesh »
Plus d'une année passe et bientôt ça ne tient plus. Ou bien juste à un fil. Le 27 février 2022, Libre Flot écrit pour annoncer son intention imminente de ne plus s'alimenter. Foutu pour foutu autant y aller franco. « Cela fait plus de quatorze mois que je comprends que ce sont mes opinions politiques et ma participation aux forces kurdes des YPG dans la lutte contre Daesh qu'on essaie de criminaliser ». Quant au juge d'instruction, il « se permet la pire des insultes en se référant aux barbares de l'État islamique comme étant “[ses] amis de chez Daesh” ». Un crachat à la gueule que Libre Flot ne peut supporter. On le comprend. Contre l'État islamique, il s'est battu à Raqqa où avaient été planifiés les attentats du 13 novembre. On devrait le fêter en héro, on le traite en terroro. Pour la justice bourgeoise, un anar révolutionnaire ou un islamo décapiteur, c'est la même lie qui sape sa mainmise sur le corps social ; alors on les fourre dans un même sac d'opprobre et Dieu reconnaîtra les siens.
– 17e jour de grève de la faim. RAS.
La pénitentiaire laisse faire. Officiellement, elle n'a pas le droit de forcer un détenu à se nourrir. Affaibli, Libre Flot continue à empathiser et témoigne de la perte de raison de ses voisins : « Je les entends changer au cours des mois qui passent, j'en entends certains perdre pied, si ce n'est sombrer dans la folie. »
En fin de lettre, il supplie : « Sortez-moi de ce tombeau ! »
– 23e jour de grève de la faim. RAS.
Libre Flot adresse une lettre aux volontaires internationalistes tentés d'aller défendre l'Ukraine. Il les met en garde : aujourd'hui on vous encense, mais à votre retour « vous serez sûrement épié.es et surveillé.es, toute votre vie pourra être redessinée, réécrite, réinterprétée, et de simples blagues pourront devenir des éléments à charge lorsque ces institutions auront décidé de vous instrumentaliser pour répondre aux besoins de leur agenda politique. »
– 30e jour de grève de la fain. RAS.
Dernière lettre. « Pfff ! Hier c'était rude. Aucune énergie. Même lire était au-delà de mes forces ».
– 37e jour de grève de la faim.
Il pèse 45 kilos, le poids d'une liberté conditionnelle à venir.
Après les lettres, Anticiper le bruit sec des verrous offre un temps d'entretien. L'occasion, pour le lecteur, de s'approprier le parcours de Florian. Les squats punks, Sivens, la jungle de Calais où il file un coup de main à « l'école du chemin des dunes ». C'est là qu'il rencontre ses premiers Kurdes : des minots venus du Başûr, le Kurdistan irakien. Puis viendra le temps de la gamberge, assis sur le toit de son camion. « Je ne sais pas ce que c'est une guerre. C'est un choix difficile qui m'interroge sur mes convictions, mes capacités. (…) Je repense à toutes les belles phrases que j'ai pu entendre ou que j'ai pu moi-même dire pendant des années, du genre : “Si j'avais vécu en 1936, j'aurais rejoint les anarchistes espa-gnol.es” ».
Plus qu'un trésor, la filiation historique est une force. Elle met des mots sur nos engagements. Les arrime au passé, les tend au-dessus du présent vers des futurs soudain possibles. On a beau en savoir la visée précaire, l'impulsion est là qui soudain commande. Mieux vaut un saut dans le vide qu'un surplace en camisole.
Salutations & Respects, Florian, fallait y aller ; fallait tenir et revenir. Raconter. Les anarchistes espagnols auraient été fiers de toi.
Sébastien NAVARRO
19.02.2026 à 18:58
Les collaborateurs
Donc ils ont eu une éducation. Ils sont allés aux écoles – enfin à Sciences-Po, ou en école de journalisme. Donc on leur a enseigné. Donc, ils ont appris. Ils ont appris l'Histoire. L'ont régurgitée – dans des copies, puis dans des articles, dans des discussions mondaines. Ils ont vu des documentaires – sur Arte. Des films. Sur la montée. Sur ce qui s'est passé, les processus à l'œuvre, les accélérations. À quoi les processus ont conduit. Ils ont été invités – et ont invité – à « méditer ». (…)
- OdradekTexte intégral (3404 mots)

Donc ils ont eu une éducation. Ils sont allés aux écoles – enfin à Sciences-Po, ou en école de journalisme. Donc on leur a enseigné. Donc, ils ont appris. Ils ont appris l'Histoire. L'ont régurgitée – dans des copies, puis dans des articles, dans des discussions mondaines. Ils ont vu des documentaires – sur Arte. Des films. Sur la montée. Sur ce qui s'est passé, les processus à l'œuvre, les accélérations. À quoi les processus ont conduit. Ils ont été invités – et ont invité – à « méditer ». Comment tout ça avait bien pu se passer. Au milieu de quelle inconscience, de quelle passivité, de quelles faillites, politiques, intellectuelles, morales. Après quoi, ils ont solennellement juré que « plus jamais ». Donc ils savent. Normalement.
Et puis voilà que tout se reproduit – mais comme à la parade. Il n'y a même pas à faire effort de généralisation ou de conceptualisation. Tout est à nouveau sous leurs yeux : l'enchaînement. À l'identique ou presque. Il n'y a qu'à regarder, et puis à qualifier. Mais rien. Non, non, il ne se passe rien – enfin rien de remarquable. En tout cas ici. Ailleurs, ah oui, c'est différent. Aux États-Unis, par exemple. C'est très différent, les États-Unis. Selon la règle la plus éprouvée du journalisme national, quand c'est « loin », on peut y voir – attention : ne pas utiliser pour Israël. À propos des États-Unis, par exemple, il est même autorisé maintenant de s'adonner au frisson de dire « fascisme ». En France ? Montée, enchaînement ? Franchement, non, on ne voit pas. Rien. RN, oui – quand même, on lit les sondages. Mais parfaitement républicain ; fascisme, non.
Inverser
À tout prendre, et dans la situation où nous sommes, « rien » serait de très loin préférable. Car, il n'y a pas « rien » : il y a l'inversion. Le problème politique en France n'est pas l'inexorable montée du fascisme, il est le bloc de la gauche antifasciste. Qui, à la limite, suggère-t-on mezza voce, pourrait bien être le « vrai fascisme ». Il n'est donc pas exact que « tout se reproduit » à l'identique. Le deuxième fascisme historique a cette particularité de nier absolument être un fascisme et d'en réserver l'infamie à ses opposants. À cet égard, une vidéo déjà ancienne a tout dit – c'est une parodie, mais elle est du dernier sérieux. On y voit un officier SS, apostrophé par un passant qui le traite de nazi, réagir outré et sarcastique : « Et pourquoi pas d'extrême droite pendant que vous y êtes ; voilà quand on est à court d'argument, on ressort la polémique nazie ; et notre Führer, je suppose que c'est aussi un nazi », etc. Tel est très exactement l'état réel du débat aujourd'hui. Un reportage de France Info se clôt sur l'évocation des « fleurs pour Quentin ».
Il suffirait pourtant de trois minutes de vidéo pour faire connaître la nature des groupes auxquels ce malheureux appartenait. Nous aurons plutôt le « choriste et philosophe », ou l'« étudiant en mathématiques », ça varie, en tout cas une figure de sagesse, de modération et d'empathie chrétienne. Mais ce à quoi il était réellement affilié, les hordes noires, les parades aux flambeaux, les bannières à croix celtiques, les bras tendus, le défilé néonazi auquel il participa le 10 mai dernier par exemple – c'est-à-dire toutes les manifestations d'authentique fascisme aimablement autorisées par Darmanin-Retailleau-Nunez – cela, les médias ne le montreront pas. Ils ne montreront pas non plus les vidéos, pourtant largement disponibles, des milices fascistes à l'œuvre, manches de pioche à la main, dans les rues d'Angers, de Rennes, de Lyon et d'ailleurs. Ils ne diront pas ce que devient la vie nocturne, dans des bars, des boîtes ou des librairies, quand une descente peut avoir lieu à tout instant. Ils ne montreront pas la photo de Retailleau en agréable compagnie du « Jarl », notoire chef de milice, illustration pourtant parfaite de ce que c'est qu'un arc fasciste. Ils n'égrèneront pas la liste de tous les tués de l'extrême droite – il est vrai qu'ils ont tous des noms à consonances bien trop peu chrétiennes, et puis personne alors n'en avait pas parlé. Ils ne diront pas les compassions différentielles de Macron qui prend quasiment le deuil pour un militant fasciste mais ne dit rien pour les meurtres commis par des militants fascistes – occasions pourtant nombreuses.
Bref, ils ne diront pas que s'il y a un antifascisme, c'est peut-être parce qu'en premier lieu, il y a un fascisme – parce qu'on ne peut logiquement pas précéder ce contre quoi on se définit. Et que, lorsque la société est abandonnée à des milices, tolérées par tout l'appareil d'État, depuis les bas-fonds de sa police jusqu'aux sommets de l'administration et du gouvernement, préfets et ministres, ignorées par les médias qui, eux, auraient le pouvoir de faire naître une réprobation sociale à l'échelle du pays, alors, oui, quand plus rien ne dissuade les milices, il n'est pas étonnant que certains n'aient plus envie de subir, forment le projet de se défendre – accessoirement de défendre les autres –, s'en donnent les moyens. Et il n'est pas étonnant non plus que se passe ce qui doit prévisiblement se passer quand la désertion d'un État complice ne laisse plus que la possibilité des face-à-face violents. Auxquels il appartiendrait normalement à la police de s'opposer – mais tout le monde sait désormais de quel côté est la police. Tout le monde, sauf les médias.
La montée fasciste ôtée du paysage, il ne reste qu'un incompréhensible « antifascisme », une absurde aberration, une violence pure et sans cause. Alors, franchissant d'un coup dix crans dans le mensonge, on peut titrer « LFI, le nouvel ennemi », comme France-Info, la radio publique d'extrême droite, dont on a ici retiré le « ? » parce qu'on n'est pas obligé de valider tous les degrés de l'hypocrisie. Ou bien, comme Sandrine Cassini, « LFI mise en cause par la droite et l'extrême droite », quand il est assez évident que le titre véritable devrait être « LFI mise en cause par Le Monde ». Il va falloir se souvenir de ce week-end de février 2026, parce qu'il restera sans le moindre doute possible comme un moment historique. Non pas que ce qui s'y est passé soit absolument inédit – la négation de la course au fascisme sous Macron, l'accablement de l'unique formation politique réellement d'opposition (puisque le RN ne propose que des intensifications de ce qui se fait déjà, et pour le reste un parfait statu quo). Non pas donc que tout soit inédit, mais que tout y a été porté à ce genre de degré extraordinaire où les variations quantitatives font des différences qualitatives. La bascule dans ce que, par commodité, on appelle la trumpisation, c'est-à-dire une manière hors norme de mentir, de déformer et de fabriquer, a saisi l'entièreté du paysage politique et médiatique, et cette bascule est totale.
Falsifier
Il n'est pas du tout adventice que cet événement suive de quelques jours à peine les propos de Nunez soutenant que les « contrôles au faciès n'existent pas », alors qu'ils ont été documentés par la Cour de cassation, la Cour européenne des droits de l'homme et le Conseil d'État. Et plus encore, l'ahurissante sortie du ministre des Affaires étrangères, exigeant la démission de Francesca Albanese sur la base de propos qu'elle n'a simplement pas tenus. L'une et l'autre déclaration survenues sans qu'aucun média n'en relève la gravité exceptionnelle, se contentant (dans le meilleur des cas) de rendre compte pour solde de tout compte. Un système médiatique normalement « sain » est une instance de rectification, et même de dénonciation pour indécence de ces falsifications. Or le système contemporain est devenu lui-même un agent de la corruption intellectuelle contre laquelle il est censé lutter, désormais tout occupé à ne pas dire ce qui est, quand il ne travaille pas à dire que ce qui est est le contraire de ce qui est. Aussi la presse de « fact-checking », en croisade, d'après ses propres prétentions, contre la post-vérité, a-t-elle elle-même tourné – retournement voué à lui rester pour toujours incompréhensible – en formidable machine à post-vérité. Il n'y a pas de fascisme, et l'antifascisme est un fascisme ; la FI est la violence même en politique et les milices réellement meurtrières n'existent pas ; les mots de la FI tuent mais pas ceux du Grand Remplacement, d'ailleurs « À bas le voile » n'a pas valu un clapotis de scandale à Retailleau ; la FI est l'antisémitisme reconstitué, quoique ceci ne puisse être documenté par la moindre procédure, mais la boue épaisse qui recouvre tout au RN – candidats ordinaires, groupes de messagerie, connexions miliciennes – est tenue pour non avenue, puisque le RN soutient Israël.
Israël, et son génocide. Voilà peut-être le lieu princeps – et symptomatique – de la bascule politique et médiatique. Le génocide à Gaza y fait l'objet de la même négation que la montée fasciste à l'intérieur, pour donner lieu à une alliance qui défie l'entendement, la logique et l'Histoire : le sionisme dans sa variante génocidaire (pas seulement) et le bloc aggloméré de défense de l'ordre bourgeois, depuis le PS jusqu'à l'extrême droite la plus antisémite. Avec pour unique ciment la haine de la FI. Il est vrai que seule dans le champ institutionnel à dénoncer le génocide et seule de gauche, elle se désignait à tous. Viendra-t-il à un média de s'interroger sur ce monde parallèle devenu le nôtre, dans lequel, par exemple, le fils d'un chasseur de nazis en appelle à « des grandes rafles » ? S'étonnera-t-on que, dans ce renversement des pôles magnétiques, le mensonge extrême règne en maître.
Et ceci jusque dans les cénacles bien élevés, celui de C politique, par exemple, équivalent dominical sur France 5 de la machine à sédation quotidienne C ce soir. Jean-Yves Camus, supposément un universitaire, y délire, car il n'y a pas d'autre mot, que Rima Hassan a qualifié tous les juifs de « génocidaires ». Aussitôt enchaîné d'une autre falsification qui lui fait dire que « du Jourdain à la mer » signifie expulsion des juifs – quand elle a systématiquement dit le contraire. Et pas un mot de reprise de Thomas Snegaroff, pas un mouvement d'interruption sèche et nette devant la fabrication à l'état pur. On préférera passer à autre chose – par exemple (au hasard) terminer avec la FI. Dont l'animateur note pour la formalité qu'elle n'est a priori nullement impliquée dans le drame de Lyon, mais ne tient pas moins à lui consacrer un bon dernier quart d'heure, qui donnera abondance d'occasions d'insinuer… qu'un peu quand même.
Sans surprise, on pouvait compter sur Macron pour offrir une synthèse parfaite : LFI / extrême-gauche / arc républicain (hors de) / antisémite – à l'aimable invitation de Frédéric Haziza, camelot de Radio J, à qui le journalisme est aussi étranger que le harcèlement sexuel est familier. En tout cas, on n'en attendait pas moins de celui par qui tout sera arrivé, et dont le système médiatique se sera acharné à nier que tout sera arrivé par lui. Pétain (grand soldat), Maurras (référence), Zemmour (consolation téléphonique), Valeurs Actuelles (entretien), mais aussi : violences policières déchaînées, impunité garantie, menées législatives ahurissantes (interdiction de filmer la police, présomption de légitime défense), racisme autorisé des expressions ministérielles, police idéologique à l'université, surveillance des réseaux sociaux sous couleur de protection de la jeunesse, répression ou interdiction des manifestations de soutien à la Palestine – effondrement général des libertés et droits fondamentaux, rétrogradation de la France au rang de « démocratie empêchée » (Civicus->https://monitor.civicus.org/globalfindings_2025/] ou de « démocratie défectueuse » (The Economist. Et enfin, et surtout : l'obsession, documentée, de livrer le pouvoir au RN, au prix, s'il le faut, de s'assoir sur le résultat électoral, comme en 2024. Car, dans la presse française, on se prépare déjà à s'inquiéter avec délice de ce que Trump pourrait faire des midterms, sans jamais rappeler que, piétiner les élections, chez nous, c'est déjà fait. Dans un silence total.
Collaborer
Le génocide à Gaza aura été le premier lieu de la trumpisation, mais tout sera venu s'y accrocher, et notamment « la violence » – de la seule FI, bien sûr. De la même manière qu'il n'y a pas d'antifascisme sans un fascisme qui le précède, il n'y a pas de violence qui monte de la société sans une violence qui lui a d'abord été faite – elle n'aura pas manqué depuis trois décennies, mais singulièrement sous la dernière, celle du macronisme. Plaise au ciel qu'il se soit trouvé une formation politique d'importance comme la FI pour capter cette violence réactionnelle, pour l'exprimer, mais en la mettant en forme, en lui donnant une élaboration, c'est-à-dire en transmutant la colère en conflictualité réglée – et que serait-elle advenue sinon, quels débouchés ne se serait-elle pas donnés ? On en finirait presque par rêver d'une insurrection en bonne et due forme, façon Gilets jaunes redux mais sous stéroïdes, qui viendrait chercher la bourgeoisie de pouvoir jusque chez elle pour lui enseigner de première main la différence entre vraie violence et conflictualité politique. Mais la bourgeoisie ne tolère même plus la simple conflictualité, et la seule opposition de gauche qu'elle est capable d'envisager, c'est la droite – Hollande, Glucksmann, Cazeneuve, qui on veut mais la droite. En vérité, elle n'est plus en état de comprendre quoi que ce soit, et n'est plus menée que par l'unique désir de préserver son ordre – dont elle voit au moins que le RN ne lui ferait rien risquer. Et ce désir fanatique s'est emparé avec furie de toutes ses têtes, politiques et médiatiques, raison pour quoi il n'est nul besoin, comme disait Bourdieu, de l'hypothèse d'un chef d'orchestre pour penser cette orchestration. Car c'en est une. En réalité c'est même une campagne.
On peut, et on doit, qualifier de campagne une entreprise aussi générale, aussi cohérente et aussi violente d'élimination d'une formation politique, la seule de gauche dans le paysage institutionnel électoral. Benjamin Duhamel, face à Manuel Bompard, peut bien battre de ses petits bras, trépigner qu'« on en a parlé » – des connexions du RN et du GUD, par exemple responsable du meurtre d'Aramburu. La vérité est que non, ils n'en ont pas parlé – pas comme ils parlent, dans une explosion de jouissance, de ce qui s'est passé à Lyon, pas comme ils somment à comparaître la FI, et la FI seulement. Car il y a belle lurette que le RN ne comparaît plus. Des transfuges de médias d'extrême droite sont devenus chroniqueurs du service public, jusqu'à France 5, à France Info surtout, devenue par excellence la radio de la collaboration. On y accroche quotidiennement les deux négationnismes, celui du crime contre l'humanité là-bas, celui de la montée fasciste ici, désormais profondément solidaires. Et dont le nouage ne s'exprime jamais si bien que dans ce topos inepte, mais repris partout, de « l'arc républicain », de qui y entre et de qui en sort –, il restera sans doute comme le fétiche de cette classe imbécile qui n'a même pas pour elle la grandeur particulière du cynisme : elle y croit dur comme fer. En réalité, elle restera comme le fait d'armes canonique des collaborateurs.
On en était à écrire, à propos de Quentin Deranque, que nous sommes à deux doigts de l'hommage national ou de la marche blanche, quand est tombée l'annonce de la minute de silence à l'Assemblée nationale. Un militant de l'extrême droite la plus violente. Honoré à l'Assemblée. Il fallait un dessinateur politique de génie comme Fred Sochard pour produire immédiatement l'antidote. « Et pour les victimes de crimes racistes ? », demande un personnage. « Des années de silence, ça vous suffit pas ? », répond Yaël Braun-Pivet.
Mais tout de même. Une classe entière, minoritaire, nuisible, radicalisée dans la défense fanatique de ses privilèges, prête à tout, installe littéralement l'extrême droite, quand elle ne l'appelle pas de ses vœux, niant bien sûr avoir la moindre intention de cette sorte, n'en faisant pas moins tout ce qui est nécessaire. L'extrême droite, ça n'est pas grave. Après tout, nous avons déjà bien dégagé la piste, bien préparé le terrain, nous sommes déjà racistes, libérés de l'État de droit et des élections, militants de toutes les autorisations policières, peu inquiets des milices – ne rendons-nous pas un bel hommage à l'un des leurs ? Non, ce qui est grave, ce sont « les autres », leurs impôts, leur passion pour les Arabes, ici et à Gaza, leurs objections au capitalisme, leur pénible tropisme pour les dominés, leur défaut de sympathie pour les puissants – pour nous, quoi. Mais nous ferons tout ce qu'il faut. Nous avons appris, mais en fait non, nous avons tout oublié : de l'Histoire – nous nous sentons beaucoup plus légers. Alors nous distordrons, nous fabriquerons, nous falsifierons, nous inverserons – pour tout dire, nous ne nous voyons pas beaucoup de limites, un peu comme Epstein (c'était un trait d'humour). Nous n'aurons même pas l'impression de mentir car à force d'intoxiquer le public, nous nous sommes auto-intoxiqués et, maintenant, nous croyons à tout ce que nous disons. C'est l'âme claire et d'un mouvement très libre que nous collaborons. Donc non, nous n'avons rien appris de l'Histoire. C'est notre manière d'y entrer !
Frédéric LORDON
18 février 2026
« La pompe à phynance », blog hébergé par Le Monde diplomatique
Illustration : Odilon Redon.
16.02.2026 à 08:24
Digression sur l'ombre qui gagne
Un de ces tristes matins d'hiver, Raoul , un vieux copain, m'appela aux aurores, me tirant brutalement d'une nuit insomniaque et comateuse. Le bougre, à 7 h du mat, souhaitait prendre de mes nouvelles, mais surtout confronter nos points de vue sur l'état désastreux d'un monde dont ses dirigeants sont en train de rouvrir toutes les vannes du refoulé d'un temps – les années 1930 – qu'à tort on a longtemps relégué au musée de l'histoire ancienne. De fait, j'avais prévu de dormir un chouïa de (…)
- Digressions...Texte intégral (2889 mots)

Un de ces tristes matins d'hiver, Raoul [1], un vieux copain, m'appela aux aurores, me tirant brutalement d'une nuit insomniaque et comateuse. Le bougre, à 7 h du mat, souhaitait prendre de mes nouvelles, mais surtout confronter nos points de vue sur l'état désastreux d'un monde dont ses dirigeants sont en train de rouvrir toutes les vannes du refoulé d'un temps – les années 1930 – qu'à tort on a longtemps relégué au musée de l'histoire ancienne. De fait, j'avais prévu de dormir un chouïa de plus pour récupérer un peu d'allant. « On dit 11 h au rade de la Bastoche que tu connais », a annoncé impérativement Raoul ! Et quand il dit, il dit, Raoul. On ne discute pas. D'autant que c'est un homme doté d'un don de conversation inégalable et que, malgré son presque grand-âge – quatre-vingt piges passées –, il lui en faut beaucoup pour succomber à l'accablement. Du moins le croyais-je. Mais là, dès que nous fûmes réunis, j'ai vite compris que, quelque part, sa superbe et sa cuirasse avaient cédé devant les avanies que le destin autoritaire, voire postfasciste, du monde nous infligeait jour après jour. D'entrée, ses premiers mots laissaient, en effet, peu de doute sur son état moral : « Je ne sais pas si tu l'as remarqué, compagnon, mais l'ombre gagne partout. » Dans sa bouche, ce constat ravageur relevait d'un appel. La mécanique ironique habituelle qui huilait depuis toujours son très spécial usage de la dialectique s'était visiblement enrayée.
– Ça commence bien, dis-je.
– Mais tout atteste que ça finira très mal ! ponctua Raoul, sérieux comme un pape gagné à l'humour noir.

Le premier round fut d'élucidation. Aux dires de l'ami, qui connaissait très bien les États-Unis – où il s'était rendu souvent et où, dans les années 1970, il s'était lié d'amitié avec Murray Bookchin –, le second mandat de Trump, dont il suivait assidûment, et sur tous supports, les « dingueries », sonnait comme une alarme dont la puissance se faisait chaque jour plus stridente.
– Le postfascisme, c'est cela, précisément cela : un étalage permanent de la force brute, une ignorance crasse de l'histoire, un mépris insolent de toute règle et la toute-puissance d'une “intelligence” artificielle mise au service d'une cause abjecte.
Je le laissai parler, étonné de l'usage que lui, plutôt technophobe, fit, ce matin-là, de son téléphone portable où il avait stocké quantité d'images, captées sur les réseaux asociaux, des abominations commises par la police-milice anti-immigration de l'agence ICE [2], dont celles, visibles sur divers angles, des exécutions gratuites, à Minneapolis (Minnesota), le 7 janvier dernier, de Renée Nicole Good, une mère de famille de 37 ans, et celle, le 26 janvier, d'Alex Pretti, un infirmier en réanimation, âgé lui-aussi de 37 ans, abattu alors qu'il était venu filmer les probables exactions des agents de l'US Customs and Border Protection (USBP), une agence relevant, comme l'ICE, du département de la Sécurité intérieure étatsunien. À chaque clic, le visage de Raoul se crispait.
– Ce sont des fascistes, compagnon, de purs fascistes des temps archaïquement postmodernes que nous vivons ; cette gangrène, tu le sais autant que moi, peut s'étendre comme un brasier. Toutes les digues sont en train de sauter.
– Mais tu ne penses pas – ai-je tenté, pour le sortir de la pression affective que visiblement il ressentait – que, d'une certaine manière, ce que recherche Trump et sa bande, c'est à nous terroriser en nous enfermant dans nos affects, et ce faisant en nous désarmant. J'ai toujours, pour ce qui me concerne, la faiblesse de penser que notre meilleure arme, c'est précisément de penser sérieusement le monde tel qu'il va en nous entraînant vers le chaos, mais aussi de réfléchir collectivement à la meilleure manière de résister à cette fuite en avant vers le pire.
– Tu as raison, amigo. On se connaît depuis belle lurette : un presque demi-siècle, tu te rends compte… Chaque fois que nous avons été confrontés à des situations concrètes, on les a d'abord pensées, analysées. Mais chaque fois, nos affects étaient au cœur de nos impulsions. Ils n'enferment pas, compagnon, les affects, ils disent un état d'âme, ils mobilisent d'abord le corps. La tête vient après, quand elle vient penser l'affect et l'objectiver. La grande différence entre le temps dont nous parlons – celui d'avant la grande défaite de la pensée – et de notre présent de catastrophes répétées, c'est le rythme effréné de prolifération de la barbarie. On ne peut suivre ses effets qu'en spectateur accablé, mais désireux de n'en pas perdre une miette. Debord avait raison : « Le spectacle est le discours ininterrompu que l'ordre présent tient sur lui-même, son monologue élogieux » [3]. Quand des monstres comme Trump, Poutine, Netanyahu, tant d'autres le dominent, les médiocres qui le promeuvent sont, non seulement, complices du crime, mais porte-voix du néant éthique qui les habite. Donc pensons, si tu y tiens, mais sans chasser nos affects.

Bien sûr, la balle était dans mon camp. Je savais Raoul assez habile pour rétablir l'équilibre en la renvoyant à son interlocuteur quand il se sentait déstabilisé par un défaut de faiblesse.
– Nous serons d'accord, j'en suis sûr, pour nous entendre sur le fait que l'affect est au cœur de toute démarche de pensée qui, elle, s'arrime à le dépasser pour le rendre opérationnel. Car il ne suffit pas d'haïr les monstres susnommés pour les contrarier. Il faut comprendre les motivations et les réflexes prédateurs qui fondent leurs actes criminels. Les États-Unis et leurs alliés, l'Occident plus généralement, sont en train de subir un choc de réalité. De fait, Big Brother, sa pièce maîtresse, n'existe plus que comme souvenir d'une surpuissance. Son déclin prolongé est avéré et, probablement, irréversible. Économiquement, il a perdu tous ses atouts au profit de la Chine, qui est en train de gagner – et dans les grandes largeurs – la guerre économique inter-capitaliste. C'est elle qui alimente le marché de ses marchandises. L'industrie américaine est tombée à un niveau tellement bas que son relèvement semble impossible. D'où son désir – assurément fou – de se réinventer comme Néo-empire interventionniste et guerrier alors que, depuis presque quarante ans, toutes ses aventures militaires se sont soldées par des échecs cuisants. Le parallèle est ici évident avec la chute de l'Union soviétique, en 1991, qui intégra son déclin en se débarrassant d'un communisme largement inexistant et en ralliant le monde dit libre, mais sans cesser de se penser comme État opérant, conquérant et despotique. Dans le cas russe, Poutine, pur produit kagébiste, remonta avec succès la mécanique nationale-populiste pour maintenir la Russie dans le concert des puissants. Sa sale guerre contre l'Ukraine fut sa manière de confirmer sa capacité de nuisance. Dans le cas américain, Trump et la bande de dangereux illuminés qui l'entourent s'ingénient à fomenter des opérations guerrières assez grotesques, comme celle du Venezuela, dont le seul but serait de mettre la main sur sa copieuse réserve de mauvais pétrole, aventure dont le seul effet, à ce jour, est, semble-t-il, d'avoir capturé à la mafieuse, parfaitement illégalement en tout cas, Maduro et son épouse.
Quant à ses prétentions sur une conquête du Groenland, elles sont d'autant plus grotesques que les States disposent déjà, et depuis 1951, non seulement d'une base militaire opérationnelle en territoire groenlandais, celle de Pituffik (ex-Thulé), mais aussi d'un accord d'extension possible de son périmètre signé à la même date avec le Danemark – devenu de facto protectorat américain. Quant au sort des Groenlandais depuis que les Yankees s'y sont installés, tout le monde s'en fout. Et pourtant, il en dit beaucoup de la folie d'un monde qui couve depuis longtemps : déplacements massifs de populations attachées à leur territoire, expérimentations douteuses comme cette tentative de construction sous la glace d'une base de lancement de missiles et d'un dépôt d'armes chimiques que le réchauffement climatique pourrait ramener à la surface, accumulation de déchets toxiques en tout genre. De quoi donc est fait le soudain intérêt de Trump pour un territoire déjà placé (encore de facto) sous son contrôle ? De rien. D'un coup de tête, d'un bluff, d'une lubie. Ou, possiblement, d'une vague promesse qu'il aurait faite à son pote transhumaniste nazi Elon Musk, patron de SpaceX, de lui offrir de la place pour la construction d'infrastructures servant ses sordides intérêts commerciaux. C'est ainsi qu'il faut probablement saisir ce mafieux qui préside aujourd'hui aux destinées d'un pays hébété par ces outrances. La culture de Trump, c'est le business, cette idée pathologiquement criminogène qui prône que tout s'achète et tout se vend, même les consciences, doublée dans son cas d'un prolongement qui fait sa marque, à savoir que le viol – des âmes, des esprits, des corps, des territoires – reste l'arme du fort, la preuve même de sa puissance. C'est ce type odieux au-delà du raisonnable qui a remporté l'élection américaine de 2025 avec 49,8 % des suffrages, mais un petit 1,5 % de différence avec sa peu brillante rivale démocrate.

Raoul m'avait écouté sans m'interrompre, mais en manifestant quelques moments de doute. Ses mimiques en attestaient.
– Je t'accorde un avantage. C'est ta capacité à transcender l'affect que nous partageons en une vision globale et indéniablement pensée d'une situation où Trump ne serait, in fine, pour la classe dominante d'un Empire en voie d'effondrement, que le parangon du type qui osera tout, même le pire, surtout le pire, pour la sauver d'un naufrage à venir.
– C'est une manière de me comprendre, mais un peu biaisée. Au-delà de Trump et des États-Unis, nous assistons depuis longtemps déjà à une médiocratisation générale du monde. Sa caractéristique, c'est de toucher toutes les classes. Si une ombre gagne, l'ami, c'est celle-là, et elle se propage désormais à grande vitesse. L' « enseignement de l'ignorance », si justement analysé en son temps par Jean-Claude Michéa [4], a largement produit ses effets dans l'effondrement culturel et éthique d'un monde qui produit – à la chaîne, dirais-je – des femmes et des hommes de pouvoir d'une médiocrité affligeante. Pour nous, de Sarkozy à Macron en passant par Hollande, le compte y est. Michéa y voyait l'effet d'un « déclin régulier de l'intelligence critique, c'est-à-dire de cette aptitude fondamentale de l'homme à comprendre à la fois dans quel monde il est amené à vivre et à partir de quelles conditions la révolte contre ce monde est une nécessité morale [5]. » Pour ma part, j'aurais évité de qualifier de « morale » cette impérative « nécessité ». Car, sans repères temporels, sans connaissances minimales de l'histoire des anciens temps, l'horreur que provoquent des images comme celles des crimes gratuits de Minneapolis, est certes constatable par n'importe quel humain non déshumanisé, mais elle ne l'affecte que moralement sans qu'il en tire forcément une leçon sur la portée politique de ces crimes gratuits commandités par une puissance en voie de fascisation absolue. Ce que je veux dire par-là, c'est que cela fait longtemps que l'indignation ne suffit plus. Il faut l'inscrire dans l'Histoire, à sa place et selon ses capacités. En cessant d'en être le spectateur affligé mais impuissant. Notre rôle, compagnon, au vu de ce qu'on a vécu, c'est de faire en sorte que cette jeunesse qui bouge et se mobilise ne soit pas simplement affectée par tant d'inhumanité, mais transforme ses affects en actes de résistance. C'est, de mon point de vue, ce qui se passe précisément à Minneapolis et dans bien des villes des États-Unis. On y voit se constituer un mouvement massif et pluriel de résistance active et organisée à l'ignoble. Une résistance qui, si elle s'élargit, se structure et tient, face à la répression de l'ICE, dans le soutien sans faille aux immigrés traqués par le fascisme trumpien, aura tracé la route à suivre partout ailleurs. Les temps que nous vivons, ai-je tendance à penser, sont trop durs pour se laisser aller au seul désespoir des défaites annoncées. Il convient de s'armer pour les comprendre et les retourner en victoires. Tu ne crois pas, Raoul ?
En guise d'approbation, l'ami leva son verre et entonna L'Internationale.
Oui, il ne dépend que de nous que les mauvais jours finissent !
Freddy GOMEZ
[1] Voir « Digression sur les boomers »
[2] Immigration and Customs Enforcement, agence fédérale américaine chargée de l'application des lois sur l'immigration et les douanes, fut officiellement créée par l'administration Bush le 1er mars 2003, dans le cadre d'une vaste réorganisation gouvernementale consécutive aux attentats du 11 septembre 2001. Le retour de Trump à la Maison Blanche, en janvier 2025, marque un tournant majeur pour l'ICE, dont les moyens financiers ont spectaculairement augmenté.
[3] Guy Debord, La Société du spectacle, thèse 24, Buchet-Chastel, 1967.
[4] Jean-Claude Michéa, L'Enseignement de l'ignorance et ses conditions modernes, 1999, Climats.
[5] Op. cit., p. 15.