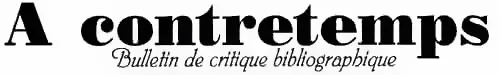17.09.2025 à 08:04
Bilan d'étape
Bien sûr, il y eut du monde partout en France. Bien sûr, la jeunesse était au rendez-vous. Bien sûr, il y eut des grévistes en nombre relativement important. Bien sûr, au soir de cette journée du 10 septembre 2025, il y avait des motifs de se réjouir. Ou de se rassurer. Même si, il faut bien en convenir, sur bien des visages on pouvait lire un sentiment de déception. Loin de nous l'idée de contester le caractère massif de la mobilisation, et ce malgré les annonces du psychopathe de (…)
- OdradekTexte intégral (678 mots)

Bien sûr, il y eut du monde partout en France. Bien sûr, la jeunesse était au rendez-vous. Bien sûr, il y eut des grévistes en nombre relativement important. Bien sûr, au soir de cette journée du 10 septembre 2025, il y avait des motifs de se réjouir. Ou de se rassurer. Même si, il faut bien en convenir, sur bien des visages on pouvait lire un sentiment de déception.
Loin de nous l'idée de contester le caractère massif de la mobilisation, et ce malgré les annonces du psychopathe de l'Intérieur qui annonça la veille que 80 000 flics seraient sur le pied de guerre et visiblement prêts à en découdre. Et ils l'étaient, dopés à la haine du rouge, jouissant de leurs méfaits, calculant leurs putains de primes. Une meute, une vraie, celle-là. En face, des cortèges certes combatifs mais peu préparés, comme égarés parfois, sans vraie stratégie. Les points de blocage s'en sont ressentis. Pour l'essentiel, ils ont été vite débloqués, en tout cas inexistants sur la durée.
L'appel à « tout bloquer » nous avait été présenté, par les journaleux mais pas seulement, comme un retour des Gilets jaunes sur la scène offensive, ce qui annonçait un mouvement social prometteur. Mais il faut bien reconnaître que, si des Gilets jaunes étaient bien là, ils n'ont pas fait le plein, ce qui, entre nous, ne devrait étonner personne tant ils en ont pris plein la gueule, en 2018-2019, sans obtenir de réel soutien, à quelques rares exceptions près, des syndicalistes et des gauchistes. Ce sont là des blessures qui laissent des traces.
Au bout du compte, si la journée du 10 fut un succès en nombre, elle n'ouvrit aucun espace à une perpétuation, sous une forme ou sous une autre, des actions de réappropriation d'espaces et de blocage de lieux stratégiques. En clair, elle se termina dans un flou étrange. Comme une manifestation syndicale quand l'heure est venue de rentrer au bercail. On sait, cela dit, qu'ici et là, nombreuses furent les très vivantes assemblées générales qui se réunirent, que des contacts à la base ont été pris pour radicaliser, tant que faire se peut, le mouvement syndical de grève (générale ?) du 18 septembre et les actions qui la ponctueront. On verra bien, car là encore le nombre ne suffira pas, même s'il est majestueux.
Le pouvoir, ou ce qu'il en reste, n'est pas tranquille, ça se sent. Il en faudra plus, cela dit, beaucoup plus, pour qu'il se sente menacé, voire cerné. C'est ce mouvement insaisissable qu'il faut construire ou renforcer. D'où l'importance d'un saut qualitatif dans l'action. On sait que bien des bases syndicales, et au-delà, en ressentent la nécessité. Reste à s'en donner les moyens en faisant preuve d'imagination et d'irrespect. Le vieux mouvement ouvrier en avait à revendre. Il suffit de se reporter à ses belles heures pour en remplir sa besace à idées. Et de les remettre au goût du jour. Dans le même esprit de résistance déterminée.
Freddy GOMEZ
15.09.2025 à 10:29
Curée vers l'or
■ Nicolas ROUILLÉ L'OR ET L'ARSENIC Historie orale d'une vallée minière Anacharsis, 2024, 318 p. Fabriquer un bouquin avec des témoignages est une prise de risque. Les gens se confient ; sur un bloc ou via un dictaphone, leur voix est captée, voire capturée ; plus tard l'auteur devra s'adonner à l'exercice fastidieux de la retranscription. Mais le plus dur reste à venir : trahir la voix pour mieux la restituer, car rarement le témoignage est reproduit in extenso. Dans son passage à l'écrit, (…)
- Recensions et études critiquesTexte intégral (2783 mots)

■ Nicolas ROUILLÉ
L'OR ET L'ARSENIC
Historie orale d'une vallée minière
Anacharsis, 2024, 318 p.
Fabriquer un bouquin avec des témoignages est une prise de risque. Les gens se confient ; sur un bloc ou via un dictaphone, leur voix est captée, voire capturée ; plus tard l'auteur devra s'adonner à l'exercice fastidieux de la retranscription. Mais le plus dur reste à venir : trahir la voix pour mieux la restituer, car rarement le témoignage est reproduit in extenso. Dans son passage à l'écrit, la matière orale subit une véritable transformation. J'ai appris à faire sur le tas, lors de ma collaboration avec le mensuel de critique sociale CQFD. Au début je n'osais pas toucher aux mots de mes interlocuteurs. De quel droit aurais-je modifié leur expression ? Et puis on m'a fait comprendre que ça ne fonctionnait pas comme ça. L'entretien est un matériau brut destiné à étayer un argumentaire. Il faut le sabrer, le découper en morceaux modulables, reformuler parfois. L'art du journaliste/écrivain – son éthique – consiste à travailler la susdite matière sans l'altérer, avec comme unique boussole celle de ne pas trahir la pensée du causeur. Autant dire que l'exercice est casse-gueule.
Fin 2019, la sortie de Panchot, mon premier bouquin [1], fut cuisante. Sur un socle fictionnel, une myriade d'entretiens (notamment avec des historiens) constituait l'ossature conflictuelle du bouquin. Une poignée d'interviewés encolérés me reprochèrent de ne pas avoir fait valider leurs propos [2]. Faut dire que certains d'entre eux s'étaient exprimés avec un franc-parler qui avait fait mon miel. J'ai toujours aimé ça la provoc, les gros mots, les coups de sang. La langue de bois passée à la cognée. Mes contempteurs étaient d'un tout autre avis. Ils tenaient à maîtriser leur expression, réflexe tout à fait compréhensible. Mais le mal était fait, le bouquin circulait et révélait, en creux, que l'histoire n'avait rien d'une discipline apaisée.
Mais il y eut pire : un historien me reprocha vertement d'avoir fait paraître son témoignage sans son accord explicite. Il avait en partie raison, notre échange étant resté dans un flou jamais éclairci. Moralement, je m'effondrai et compris qu'à force de brouiller les frontières entre fiction et récit, j'avais « déréalisé » mon bonhomme pour les besoins de l'histoire que je tenais à raconter. Les menaces de procès s'accumulèrent et je passai mon premier Noël sous anxiolytiques. Les semaines s'écoulèrent, tout se tassa. Des années plus tard, la faute morale demeure ; tache sur le plastron d'un plumitif provincial. Abordant L'Or et l'Arsenic de Nicolas Rouillé, je repensais à cet épisode douloureux ; à ceci près que chez Rouillé, les témoignages ne sont pas là pour faire gazer un auteur mais pour s'y substituer. L'Or et l'Arsenic, joliment sous-titré « Histoire orale d'une vallée minière », est pur dialogue – ou plutôt purs dialogues. À rebours des Narcisse de la chose romanesque, Rouillé s'est éclipsé dans les coulisses de son œuvre. Souffleur ? Surtout pas. Plutôt humble porte-voix. Un choix qui l'honore.
« Des truands, des gardes-chiourmes et des putes ! »
Au-dessus de Carcassonne, dans ce département de l'Aude sinistré cet été par un mégafeu, se niche la vallée de l'Orbiel – du nom de la rivière qui la traverse. Entre les villages de Lastours, Villanière et Salsigne furent exploitées la plus grande mine d'or d'Europe et la plus grande mine d'arsenic du monde. Voilà pour le palmarès hors norme d'un département plutôt connu pour son héritage cathare, son pinard et son 37,2° le matin. Après plus d'un siècle d'activité, l'extraction minière cesse en 2004. L'affaire aurait pu en rester là et s'inscrire dans le récit de l'irrésistible déclin industriel français. Mais en 2018, suite à de sévères inondations, des tonnes de matières issues de l'activité minière (arsenic, plomb, aluminium, etc.) filent dans la nature et accouchent d'une contamination des sols et des cours d'eau alarmante. Affolées, des familles de riverains font analyser les cheveux de leurs mouflets. 58 bambins sont reconnus surexposés à l'arsenic. Échantillon non exhaustif. Humant le scandale et le sensationnel à peu de frais, la presse déboule et déclare que sous ses faux airs de carte postale, la vallée de l'Orbiel est une cuvette chimique. Le fait div' provoque des émois, l'Agence régionale de santé (ARS) multiplie les rapports, l'État est condamné à réparer le « préjudice écologique constaté ». Si la situation est catastrophique, elle est surtout documentée et commentée. C'est beau une démocratie sanitaire qui fonctionne.
Quand Nicolas Rouillé débarque dans la vallée, ce n'est pas pour se lancer dans un micro-trottoir racoleur. Il vient de publier Timika, western papou, fiction polareuse qui se déroule en Papouasie occidentale sur fond de sauvage exploitation aurifère. Résidant à Toulouse, Rouillé est tombé de haut en découvrant le passé minier du département voisin de l'Aude. Il décroche son premier entretien avec un ancien délégué mineur. Qui sera le début d'une longue série. Au final, entre novembre 2020 et mai 2023, il s'entretient avec 140 personnes, parmi lesquelles des métallos du site industriel (où étaient traités les minerais), des anciens mineurs, des historiens, un préfet, des riverains, des ingénieurs, un orpailleur, une apicultrice, un chasseur, un paysan-boulanger, etc. À l'arrivée, 200 heures d'enregistrement qu'il a fallu restituer sous la forme digeste et dynamique d'un livre. Le résultat est tout simplement épatant. L'Or et l'Arsenic est, à part quelques propos liminaires de l'auteur, un dispositif choral où ça cause du début à la fin. Avec cette idée de raconter une vallée paysanne soudain dynamitée par la fièvre extractiviste. Dans ce canevas logorrhéique, les propos se complètent, se choquent, se relativisent, se contredisent. Bref, ça cause comme au café du coin, le BAC + 4 avec son vocabulaire compassé, l'ouvrier avec sa jactance imagée. Bien évidemment, c'est le parler « populaire » qui enfièvre la lecture. Exemple : en 1992, les Australiens mettent la main sur la mine d'or :
– « Qu'est-ce que c'est un Australien ? C'est un type qui a réussi à faire disparaître globalement tout ce qui était natif de cette putain d'île.
– Ils sont un peu cow-boys, au début ils nous prenaient pour des kangourous !
– À l'origine, c'est des truands, des gardes-chiourmes et des putes ! Tu parles d'une population !
– Ce sont les meilleurs pour l'or, avec les Canadiens et les Russes. Vous les retrouvez partout dans le monde, ils ont la compétence technique.
– Ils étaient venus faire du fric, pas pour rester. (…)
– Ils étaient venus un peu en colonialistes, en disant : “On va vous montrer ce qu'on sait faire”.
– Ils se sont conduits comme les Français en Afrique. Ils venaient en colons. C'est malheureusement la mentalité dans les mines. »
Internationale du macabre
Nicolas Rouillé a peut-être un blaze prédestiné, en tout cas il a senti le filon. Non seulement il s'est effacé de son texte mais il fait causer les témoins sans préciser leur identité. Seul un tiret annonce une nouvelle voix et au lecteur de deviner qui cause. En résulte une lecture dynamique, vivante où les paroles se répondent en écho, formant à l'arrivée un puzzle instable – à l'image de cette terre de l'Orbiel soudain industrialisée, peuplée, communautarisée, soudée et arrimée au topos ouvriériste mais aussi défoncée, creusée, explosée, noyée, gazée puis finalement stérilisée sous l'égide du progrès. En débarquant dans la vallée, Rouillé sait que l'histoire finit mal mais il n'est pas là pour faire la leçon, ni dire au lecteur quoi penser. Si les faits ne parlent pas suffisamment d'eux-mêmes alors ça sera aux premiers concernés de raconter leur condition passée et présente entre déni, fierté, colère, fatigue, lucidité et relativisme déculpabilisant. Une des forces de L'Or et l'Arsenic est de nous permettre de toucher du doigt cette communauté qui fut tissée autour de la mine. C'est que le mineur d'or jouit d'une réputation ambivalente par rapport à l'aura zolienne du mineur de charbon. « Il y a le côté doré des choses, le merveilleux, la couleur du soleil, la bijouterie, la beauté. (…) Mais l'or évoque aussi la cupidité, ça évoque des magouilles, l'appât de l'or, résume Pierre-Christian, historien des sciences et des techniques. Et puis quand on regarde comment il est extrait, là ça commence à devenir dérangeant. Il ne faut pas nier les pollutions au mercure, les accidents qu'il y a eu avec le cyanure, notamment en Roumanie. »
Qu'importe puisque les mineurs de Salsigne se voyaient comme une petite aristocratie ouvrière mieux payée que les fonctionnaires de la ville. Des intrépides, durs au mal, solidaires. Tout autour s'organisait la cité ouvrière avec ses baraques, ses bars, ses grèves, ses fêtes de Sainte-Barbe, patronne (non pas des hipsters, mais des mineurs) ; un monde hiérarchisé avec ses autochtones, ses immigrés et sa chefferie plus ou moins lointaine. Sans oublier le boucan récurrent de la dynamite, la guerre au paysage avec ces chevalements à gueule d'interminable potence et ses béances sans fond. La mine est une dialectique difficile à dépasser : à la fois escarre terrestre et cœur de vie économique. Entre les pages dialoguées, le livre propose une série d'autoportraits où des gens de tous horizons (Paulette la sténodactylo, Yves le mécano croate, Peter le banquier anglais, Fabienne la secrétaire de la sécu minière, etc.) se racontent en quelques lignes. D'origine kabyle, Lachemi est de la troisième génération d'hommes de sa famille à ramper dans les boyaux de Salsigne. Dans un élan lucide, il résume le calcul racial de la mine : « Et pourquoi ils prenaient des Kabyles ? Parce que c'étaient des bosseurs et qu'ils fermaient leur gueule ! »
Les mineurs ? Un boulot éreintant où le corps se compresse en lombric et les poumons empoussiérés se défont en silicose. La règle du jeu est connue. Chercheuse en santé publique et en santé au travail, Annie résume le deal : « Mieux vaut un travail et un cancer à la clé, mais dans longtemps, que pas de travail du tout. ». Une gueule noire fait les comptes : « J'en ai connu un, deux, trois qui sont morts. Éboulement tous les trois. Un Polonais, un Algérien et un Espagnol. C'est la destinée de chacun. » Internationale du macabre.
Midas juché sur ses lingots
On finit par la toucher du doigt cette infernale aliénation. En régime capitaliste, les mineurs sont des travailleurs aliénés comme les autres. Stigmate retourné, la fierté ouvrière est cette ressource morale qui permet de tenir dans une vie du pire. Après avoir rampé dans la nuit des boyaux, on se redresse et on bombe le torse. La dignité est d'abord affaire de tenue et de vertèbres à la verticale. « Prolétaire » est une condition objectivable et une métaphysique aux angles vaseux. Les valeureux se sont construits une éthique ; faut bien vivre putain – quitte à en crever. Tout le monde sait que l'arsenic fout de l'eczéma et bouffe les cloisons nasales mais qui savait qu'en pleine guerre du Vietnam des tonnes de ce poison sorties de Salsigne filaient dans les usines amerloques pour fabriquer l'agent orange ?
Inusable antienne : on ne mord pas la main qui vous nourrit. Même si la main en question appartient à un Midas juché sur ses lingots.
– « Moi, de toute façon, je peux rien dire contre la mine. Rien du tout ! Au contraire, je peux en dire que du bien, parce que la mine elle a fait du bien à tout le monde. Quand elle a fermé, il y en a beaucoup qui ont pleuré, dans l'Aude.
– La mine, je le dis clairement, elle m'a fait bouffer donc je ne cracherai pas dans la soupe. Je n'étais pas obligé d'y aller. Je pense qu'on a travaillé correctement, la direction n'était pas malsaine, il y avait un syndicat qui était important et les gens pouvaient travailler dans de bonnes conditions. Bon, après, c'est une mine. C'est sûr que j'aime la nature, vous voyez où je vis. Il faut trouver le juste équilibre. »
Le juste équilibre. Pourquoi pas la mine équitable ou écoresponsable tant qu'on y est ? Et puis bientôt des smartphones en fibre végétale et la Tour Eiffel en pisé. Tous résilients, tous biodégradables, tous recyclés. En attendant ce futur vertueux, quand la mine de Salsigne a fermé, la préfectance n'a rien trouvé de mieux que de projeter la construction d'un centre d'enfouissement d'ordures ménagères sur le domaine de Lassac. Face à une bronca générale et à une procédure judiciaire révélant les magouilles habituelles, les mercenaires de l'État ont dû renoncer à leur idée de faire de l'Orbiel un dépotoir définitif. Un indigène autant énervé qu'inspiré commente : « La vallée de l'Orbiel, c'est la pute du département ! J'ai entendu ça à une réunion pour Lassac. J'avais trouvé l'image pas mal, parce qu'après la pollution de la mine avoir le toupet de vouloir y déposer les ordures ménagères de tout le département… c'est vraiment la pute : maintenant qu'elle a été souillée, allons-y gaiement ! C'est l'éjaculation de tous les Audois sur la vallée ! J'avais trouvé l'image crue mais vraie : une vieille pute de l'ère primaire avec sa rivière. »
Plaisir de la provoc, des gros mots, des coups de sang, disais-je plus haut. Langue de bois passée à la cognée. Ça soulage et ça maintient les nerfs à vif. Car qui sait d'où viendra la prochaine fumisterie ?
Récemment le cours de l'or a dépassé son niveau record de 3 500 dollars l'once. Salsigne, telle un phénix, prête à renaître de ses cendres contaminées ? La question se pose : « Au fond de la mine, on a un potentiel de vingt ans d'exploitation. Seulement c'est toujours pareil, c'est une question financière. »
Gageons que les saccageurs sauront trouver l'oseille.
Sébastien NAVARRO
10.09.2025 à 09:46
De l'huile sur le feu
L'État est un bon gestionnaire. Il dilapide l'argent qu'il extorque aux salariés, et quand les caisses sont vides, il les maltraite davantage. Les maigres compensations des services publics ne l'intéressent plus. Ce qui compte, c'est gorger les propriétaires d'argent public, de gaver cette classe qui, au lieu de payer des impôts, les captent sous forme de contrats d'État ou d'« aides aux entreprises ». Aucun gouvernement ne s'embarrasse plus d'acheter la paix sociale. Il faut que la phynance (…)
- OdradekTexte intégral (540 mots)

L'État est un bon gestionnaire. Il dilapide l'argent qu'il extorque aux salariés, et quand les caisses sont vides, il les maltraite davantage. Les maigres compensations des services publics ne l'intéressent plus. Ce qui compte, c'est gorger les propriétaires d'argent public, de gaver cette classe qui, au lieu de payer des impôts, les captent sous forme de contrats d'État ou d'« aides aux entreprises ». Aucun gouvernement ne s'embarrasse plus d'acheter la paix sociale. Il faut que la phynance publique devienne richesse privée, et voilà tout.
De là tous les déficits qui, par un étrange retournement des lois économiques, permettent au débiteur qu'est l'État de saigner davantage ses véritables créanciers. Ceux qui vivent de son argent accusent la population de vivre au-dessus de ses moyens. Il faut bien que quelqu'un paie la vaisselle de l'Élysée, les garden-parties, le faste du pouvoir, les intérêts des banques et, pourquoi pas, une guerre à venir.
Si la masse des travailleurs se révolte, l'État doit avoir de quoi faire rentrer dans le rang la plèbe pour qu'elle charbonne et consomme, crache à nouveau ses impôts. Magie de l'aliénation : c'est encore son argent qui lui revient, sous forme de matraque, gaz et grenade, et qui sert à payer les porcs qui la passe à tabac.
Toutes ces dépenses, tous ces efforts de l'État ne servent finalement qu'un but : entretenir la dynamique économique d'un capitalisme mourant qui, en plus de nous voler notre vie, est en train de tout détruire. Il faudrait qu'on lui sacrifie encore deux jours par an de notre existence, sans même être payés, qu'on le laisse accaparer l'eau des nappes phréatiques, polluer les champs, courtiser les incendies et les épidémies. La France des honnêtes gens peut être fière de trimer et de payer ses taxes : elle nourrit ses empoisonneurs, qui rient au nez des cancéreux.
Un pouvoir si cynique, si fascisant, capable de violer des élections qu'il a lui-même convoquées et de rester sourd à des manifestations massives, ne se combat pas à coups de pétition.
Les Gilets jaunes l'avaient compris.
Le 10 septembre est l'occasion de leur rendre hommage – et peut-être de faire mieux.
GROUPE LUDDITE INTERNATIONAL
10 septembre 2025.
08.09.2025 à 10:39
Plaidoyer pour un révisionnisme de guerre
■ Avec cette recension de Pierre Souyri , nous inaugurons une nouvelle sous-rubrique – « Pages d'hier ». Ces textes pourront indifféremment prendre leur place dans les rubriques « Recensions et études critiques » ou « Spanish Cockpit » au vu des thématiques qu'elles aborderont. Il s'agira, pour nous, de puiser aux archives de quelques « grandes plumes » pour redonner un peu de lumière à des traces de l'ancien temps qui n'ont rien perdu de leur pertinence. Cet article a été originellement (…)
- Pages d'hierTexte intégral (2294 mots)
■ Avec cette recension de Pierre Souyri [1], nous inaugurons une nouvelle sous-rubrique – « Pages d'hier ». Ces textes pourront indifféremment prendre leur place dans les rubriques « Recensions et études critiques » ou « Spanish Cockpit » au vu des thématiques qu'elles aborderont. Il s'agira, pour nous, de puiser aux archives de quelques « grandes plumes » pour redonner un peu de lumière à des traces de l'ancien temps qui n'ont rien perdu de leur pertinence. Cet article a été originellement publié, sous le titre « Un plaidoyer pour l'anarchisme espagnol », dans la revue Les Annales : économies, sociétés, civilisation, 25e année, n° 2, 1970, pp. 402-404. À propos de l'ouvrage de César Lorenzo dont il est question ici, nous renvoyons à la recension critique que nous lui avons consacrée, à l'occasion de sa réédition très augmentée, en 2006, sous le titre Le Mouvement anarchiste en Espagne : pouvoir et révolution sociale [2]. Bonne lecture et bonne reprise ! – À contretemps.

■ César M. LORENZO
LES ANARCHISTES ESPAGNOLS ET LE POUVOIR
(1868-1969)
Le Seuil, collection Esprit, 1969, 430 p.

L'histoire de l'anarchisme espagnol est encore mal connue en France : articles, brochures, mémoires de militants, polémiques sur ce qui se passa au cours de la guerre civile de 1936 se comptent par centaines, mais il n'existait pas encore, en langue française, à l'exception du livre de D. Guérin, d'ouvrage s'efforçant de donner une vue d'ensemble de la question.
Le livre de César M. Lorenzo, qui a utilisé une importante documentation, comble partiellement cette lacune, encore qu'on ne puisse pas le considérer tout à fait comme une étude historique : il s'agit d'un livre engagé, qui prend souvent la forme d'un plaidoyer en faveur des fractions de l'anarchisme qui, au cours de la guerre civile, s'engageront dans une politique de participation ministérielle au côté des autres formations antifascistes.
Pour С. M. Lorenzo, les organisations anarchistes abordaient 1936 dans un état dramatique d'impréparation aux tâches révolutionnaires qui allaient leur échoir. Imbus de vues utopiques davantage empruntées à Malatesta et aux théoriciens de l'« acratisme » qu'à Bakounine, enfermés dans un véritable fétichisme de l'idée pure et de l'apolitisme, ignorant à peu près tout des questions économiques et militaires, inconscients des problèmes internationaux, les anarchistes nourrissaient trop souvent leurs rêves de mythes simples : le communisme libertaire était conçu comme un âge d'or qui naîtrait d'un seul coup, d'une action directe et violente détruisant les institutions maléfiques. Des tentatives avaient pourtant été faites pour donner au mouvement des conceptions plus réalistes. Mais ni le « possibilisme » libertaire de Salvador Segui, ni l'« anarcho-bolchevisme » de García Oliver, ni les propositions faites par Angel Pestaña pour faire accepter l'idée d'un parti syndicaliste, n'étaient parvenus à triompher de l'intransigeance sectaire de la FAI (Fédération anarchiste ibérique), qui se claquemurait dans son univers de rêves.
Encore faudrait-il reconnaître que ces rêveurs avaient suscité et entretenu, dans le prolétariat et dans une partie de la paysannerie, un sens de l'action directe et une tradition de l'héroïsme dans le combat de rue qui ne furent pas sans efficacité en juillet 1936. Si les militants de la CNT (Confédération nationale du travail) et de la FAI, au lieu d'être animés par le mépris le plus total pour les ruses de l'action politicienne, avaient été, dès longtemps, intégrés à des organisations ayant l'habitude de la manœuvre, de la négociation et du compromis, auraient-ils eu l'audace de s'opposer, sans délai et presque sans armes, à la révolte des troupes franquistes, puis d'entamer, de leur propre initiative, en Catalogne et en Aragon, une des révolutions les plus radicales du siècle ? Mais il est aussi vrai que l'état d'esprit des libertaires constitua parfois un handicap pour la révolution. Non pas qu'il faille imputer à l'anarchisme toute la responsabilité du formidable émiettement des pouvoirs et des centres de décision qui se produisit après le 19 juillet 1936 et se traduisit par une foule d'initiatives locales, désordonnées, abusives et parfois meurtrières – la lutte contre les fascistes aboutit çà et là à des tueries aveugles et, plus rarement, à des actes de pillages. Cette situation résultait avant tout de l'écroulement soudain de toutes les autorités et, à travers cette « chaotisation » de la vie sociale, s'opérait aussi l'affirmation d'un nouveau pouvoir révolutionnaire issu de l'action des ouvriers et des paysans. Les anarchistes ne furent pas que des désorganisateurs : ces fanatiques de l'idée libertaire furent très vite amenés à exercer des pouvoirs de police, à organiser des tribunaux, à discipliner rudement les colonnes qui partaient pour le front et à user de la force pour imposer les décisions les plus urgentes. En Catalogne et en Aragon, surtout, ce furent souvent les patrouilles de contrôle de la CNT qui mirent un terme aux exécutions sommaires et entreprirent de faire respecter un ordre fort rigoureux au nom des comités qui se mirent rapidement à l'ouvrage pour permettre à l'économie collectivisée de fonctionner.
Il reste que les principes de l'anarchisme supportèrent mal d'être confrontés avec les exigences de la pratique révolutionnaire. Les militants de la CNT et de la FAI durent souvent, pour agir, ruser avec leur propre idéologie et se dissimuler à eux-mêmes le sens effectif de leur action : en Aragon, la CNT devint, en dépit de tout ce qu'elle aurait voulu être, une sorte de parti unique exerçant vigoureusement la dictature révolutionnaire. Les impératifs de la lutte provoquèrent ainsi une dissociation entre l'idée et la pratique effective et, dès lors, les voies étaient ouvertes pour que l'anarchisme s'achemine par étapes, au nom du réalisme, vers une révision de ses propres principes.
Les anarchistes qui prétendaient se situer à gauche de tous les courants révolutionnaires s'orientèrent, non pas vers la formation d'un pouvoir s'appuyant sur les divers organismes de démocratie directe mis en place par les ouvriers et les paysans en juillet 1936, mais vers la participation ministérielle au gouvernement bourgeois. Dès le 27 septembre, en dépit des réticences de militants qui, comme García Oliver, s'étaient prononcés pour l'établissement d'une dictature révolutionnaire, les hommes de la CNT participent au gouvernement catalan. Le 4 novembre 1936, ils entrent au gouvernement de Madrid.
С. M. Lorenzo expose longuement leurs justifications telles qu'elles ont été, dès l'été 1936, formulées par des leaders « révisionnistes » comme Horacio Martínez. Les forces libertaires, qui ne se sont puissamment développées qu'en Catalogne et en Aragon, n'ont pas la possibilité de triompher, sans une deuxième guerre civile, des autres forces antifascistes hostiles à l'accomplissement, elle, d'une révolution sociale. Parviendrait- d'ailleurs, à s'imposer à l'intérieur de l'Espagne antifranquiste, que la révolution libertaire se trouverait de toute manière dans l'impasse : l'Europe capitaliste tout entière, qu'elle soit fasciste ou démocratique, agirait pour l'étouffer et la briser. Il ne reste aux anarchistes d'autre possibilité que de renoncer à l'impossible pour se consacrer entièrement à la lutte antifasciste.
Cependant, à l'automne 1936, les anarchistes ne sont pas encore, comme on le dira plus tard, « prêts à renoncer à tout, sauf à la victoire » sur le fascisme. Il est vrai qu'ils font alors valoir qu'en entrant au gouvernement et en s'incorporant aux divers rouages de l'appareil d'État, ils fourniront – bien mieux que les politiciens républicains et socialistes qui, après avoir participé aux pires opérations de répression contre les travailleurs dans les années 1930, n'ont cessé depuis juillet 1936 d'hésiter et de tergiverser – une direction résolue et efficace dans la lutte contre le franquisme. Mais surtout ils prétendent qu'en devenant eux-mêmes des représentants des pouvoirs publics, ils parviendront à paralyser les tentatives de réaction, qui déjà se dessinent contre les collectivisations, et à sauvegarder l'essentiel des conquêtes sociales de juillet 1936. Les journaux anarchistes vont alors jusqu'à prétendre que l'État est devenu une « force neutre » et qu'il sera possible d'utiliser sa puissance pour consolider le socialisme naissant. Le révisionnisme anarchiste aboutit à des conceptions qui paraissent largement apparentées à celles des marxistes réformistes.
En fait, ministres et fonctionnaires anarchistes ne sauveront à peu près rien. En Catalogne et en Aragon, les couches petites-bourgeoises, épaulées par les communistes et par l'Union générale du travail (UGT, syndicat socialiste), qui servira souvent d'élément organisateur aux petits propriétaires, reconstituent leurs forces et l'État bourgeois, à demi désagrégé par la révolution de juillet 1936, reprend de la vigueur. Dès les premiers mois de 1937, des collisions parfois sanglantes se produisent entre les militants de la CNT et les forces bourgeoises et communistes. Le 2 mai 1937, dans les rues de Barcelone, c'est l'affrontement armé opposant les communistes et leurs alliés bourgeois aux hommes de la CNT et du Parti ouvrier d'unification marxiste (POUM). Mais, redoutant une désorganisation des défenses antifascistes, les dirigeants anarchistes s'inclinent. Dès lors, les exigences de la bourgeoisie et des communistes se font sans cesse plus pressantes et, en août 1937, les divisions communistes et catalanistes écrasent les « collectivités ». Emprisonnés, destitués de leurs commandements et de leurs pouvoirs, les anarchistes sont mis au pas. Il est vrai que, en dépit des violences et des mesures de toutes sortes qui cherchent à les étouffer, les « collectivités » tiennent bon et même parfois se reconstituent. Mais, en tant que mouvement révolutionnaire, l'anarchisme est brisé. Ce sont désormais les éléments les plus conciliateurs qui détiennent le contrôle de ce qu'il reste des organisations libertaires, dont le glissement vers le réformisme se précise.
En mai 1938, la CNT donne son accord pour que soit garanties les « propriétés légitimement acquises » ; en août, elle entre, de concert avec les représentants de l'UGT, du patronat et du gouvernement, dans un Conseil du travail qui aura pour fonction d'arbitrer les conflits entre employeurs et ouvriers ; en décembre, elle se résigne à une restauration du catholicisme. Le syndicalisme anarchiste, qui, depuis 1937, s'est d'ailleurs réorganisé dans un sens centraliste et autoritaire, a perdu sa spécificité. Dominée par une bureaucratie qui a tout accepté pour pouvoir s'intégrer à l'État, elle n'est plus qu'une force d'appoint que républicains et socialistes utilisent désormais contre leurs alliés communistes devenus trop envahissants : ainsi, ce sont des troupes constituées par des militants de la CNT qui exécuteront, contre Negrín et les communistes, la tentative de coup d'État de mars 1939 en vue de mettre un terme à une guerre jugée perdue.
Les querelles, les déchirements, les scissions qui, après 1939, seront le lot des anarchistes contraints à l'émigration – C. M. Lorenzo en retrace longuement les péripéties – ne modifieront plus guère le visage d'un mouvement qui, hormis quelques groupuscules marginaux, continue à apparaître singulièrement assagi.
Pierre SOUYRI
[1] Sur Pierre Souyri, nous renvoyons à la notice que lui a consacrée « le Maitron », dictionnaire en ligne
28.08.2025 à 12:20
Reprendre, dit-on…
Il faut reprendre puisque l'heure est à la rentrée. À la rentrée de quoi, on ne sait pas. D'une perpétuation du même, la merde ambiante qui nous colle aux basques, le génocide à Gaza qui ne cesse pas, la généralisation de la misère sociale, le désastre écologique aux effets permanents – qu'on a ressentis au plus profond de soi, au cours de nos pérégrinations estivales dans un Sud calciné ? D'une motion de censure qui, certes, ne ferait de mal à personne en renvoyant l'aveugle de Bétharram, (…)
- OdradekTexte intégral (2209 mots)

Il faut reprendre puisque l'heure est à la rentrée. À la rentrée de quoi, on ne sait pas. D'une perpétuation du même, la merde ambiante qui nous colle aux basques, le génocide à Gaza qui ne cesse pas, la généralisation de la misère sociale, le désastre écologique aux effets permanents – qu'on a ressentis au plus profond de soi, au cours de nos pérégrinations estivales dans un Sud calciné ? D'une motion de censure qui, certes, ne ferait de mal à personne en renvoyant l'aveugle de Bétharram, Premier Rien de ce gouvernement du néant, dans les poubelles de l'Histoire ? D'une hypothétique dissolution de l'Assemblée nationale ? Ou, plus enthousiasmant, d'un blocage du pays, comme semble l'indiquer une voix aux échos multiples et persistants portée, cet été, sur un ton de « retour des Gilets jaunes », par les réseaux dits sociaux ?
Pour sûr, cette hypothèse, apparemment contagieuse, aurait l'avantage d'ouvrir, de nouveau, l'espoir d'une perspective apartidaire offensive dans un paysage politique assez largement verrouillé. Petit rappel : d'un côté, un pouvoir macronien chancelant allié à la droite la plus sinistre qui soit – celle des Retailleau, Darmanin et consorts – qui a fini par devenir sa propre caricature : un corps de petits marquis d'Ancien Régime vivant de ses rapines et coups tordus sur le dos d'un peuple surtaxé, essoré, maltraité, calomnié et réprimé. De l'autre, une « gauche » dite raisonnable, c'est-à-dire sans substance et prête à toutes les compromissions, qui, après avoir pourtant eu l'occasion, à deux reprises – grâce à La France insoumise – de sortir de son impuissance, a démontré qu'elle était incapable de revenir, même minimalement, à des principes, préférant se noyer d'elle-même dans sa propre vase sociale-libérale. Qu'elle y reste ! Enfin, un Rassemblement national, en crise interne à la suite de la décision d'inéligibilité appliquée, en mars dernier et pour cinq ans, à sa cheftaine – en appel –, dont le principal fait d'armes, depuis le hold-up électoral macronien de l'été dernier, aura été de servir systématiquement de bouée de sauvetage à ce régime agonisant.

Tout atteste, dans les profondeurs du pays, d'un double mouvement : d'une part, un découragement profond devant l'ampleur de l'effort que suppose aujourd'hui la mise en branle d'une révolte sociale de grande ampleur contre un ordre policier surarmé et dépourvu de tous scrupules moraux ; de l'autre, largement partagée et contradictoirement exprimée, une colère – logique, froide, désespérée – qu'aucun mot ne peut traduire, mais qui est prête à exploser d'une manière ou d'une autre à la moindre étincelle. Les Gilets jaunes de 2018 étaient partis à l'assaut des Champs-Élysées convaincus qu'ils avaient la capacité d'aller chercher Macron chez lui. Il y avait, chez eux, disons, une certaine ingénuité, mais surtout la conviction qu'ils étaient dans leur droit et que leur cause était juste. Et elle l'était, contre tous les attentistes des avant-gardes d'arrière-garde qui, au mieux, prirent leur temps pour constater, ou pas, qu'un peuple – le peuple – s'était mis en mouvement en s'auto-organisant et sans demander l'avis de personne. Sept ans plus tard, ce qui semble se rejouer, ce qui du moins en prend les apparences, c'est, au crépuscule de ce pouvoir détesté, de ce système à bout de course, dans un monde lui-même fini, non pas un retour du même, mais un pari sur l'intelligence stratégique : tout bloquer, en élargissant le champ de l'action au maximum de compétences pour ce faire.
Déjà les Gilets jaunes de 2018 s'étaient préoccupés d'élargir leurs bases, sans y parvenir vraiment au vu des infamies à haute dose qu'avaient déversées sur eux la caste médiatique, l' « intellectualité » de plateau et bien des « contre-pouvoirs » – notamment liés à la gauche institutionnelle ou à la sphère syndicale. Ce qu'ils parvinrent à faire plus tard, à force de constance, en direction des quartiers populaires des grandes villes notamment. De même, la connivence combattante qu'ils parvinrent à établir, en matière de guérilla urbaine, avec des groupes proches de l'autonomie active, le plus souvent qualifiés par facilité de Black Blocs, attestait d'une capacité évidente de repositionnement tactique en fonction des possibilités qu'offrait l'extension réelle du domaine de la lutte.

Depuis 2018, tout a changé. En pire souvent – une répression policière de haute intensité a laissé beaucoup de monde sur le carreau et instauré un vrai climat de terreur à l'idée de devoir affronter les miliciens de l'Ordre bourgeois en manifestation, ces tueurs assermentés largement couverts par leurs instances et, au-delà, par les commis du mensonge déconcertant que sont devenus les journalistes-flics des médias dominants. Mais, en parallèle, les esprits, en sept ans, se sont aussi modifiés pour le meilleur, car les défaites accumulées – notamment celle du grand mouvement social de 2023 contre la réforme des retraites – ont indiscutablement fait bouger les lignes et les formes d'action. Pas assez sans doute, mais suffisamment pour que l'idée de converger vers des dispositifs d'action originaux, offensifs et partagés, l'ait emporté dans bien des têtes. Si le processus est lent, il s'est construit autour de l'idée de ciblage et d'action directe. Avec quelques succès majeurs, comme le soutien aux blocages actifs des raffineries et aux actions d'auto-réduction des « robins des bois » de l'Énergie, en 2023. Ce qui est né là, c'est indiscutablement une forme de réappropriation à la base de très anciennes formes de luttes dites « sauvages » – c'est-à-dire auto-organisées et libres de toute médiation d'appareil – du mouvement ouvrier des origines, celui d'avant sa domestication.
Dans une claire approche gilet-jaunée, l'appel « Bloquons tout le 10 septembre ! » s'inscrit dans une perspective de confrontation au long cours, offensivement unitaire, libre de toute tutelle et où l'imagination, l'invention, le mouvement devront être au cœur de l'action et la nourrir. Avec pour principale perspective d'épuiser l'ennemi, de le harceler furtivement de toutes parts, de faire apparaître au grand jour le rejet dont il est l'objet. Dans ce dispositif de soulèvement, le budget thatchérien de Bayrou sert – comme, en 2018, le rejet de l'injustissime « taxe carbone » – de point d'accroche à la mobilisation. Et qui pourrait être contre, en vérité, quand tout un chacun sait que l'adoption d'un tel budget antisocial contribuerait automatiquement à accélérer le processus infini de dégradation des conditions de vie des plus pauvres en instaurant le travailler plus pour gagner moins, en gelant drastiquement les prestations sociales et en faisant main basse, au passage, sur deux jours fériés.
Ce qui semble se tisser, dans les profondeurs imaginaires de ce mouvement en gestation, c'est une réappropriation collective des nombreuse colères sociales souterraines qui traversent le pays et qui, isolées, sont incapables, d'elles-mêmes et par elles-mêmes, de se généraliser en s'unifiant et finissent, les unes après les autres , par s'étioler dans le ressentiment, cette matrice du pire qui mène fatalement au pire : la fragmentation, le racisme, le complotisme, la haine de tous et toutes contre toutes et tous. En cela, cet « appel », dont personne ne sait vraiment d'où il vient, est remarquablement salutaire. Parce qu'il remet l'histoire sur ses pieds en rappelant à qui voudra l'entendre qu'il n'est nul autre sauveur suprême que le peuple lui-même, coalisé et agissant, veillant scrupuleusement à ne jamais être dépossédé de ses propres luttes pour l'auto-émancipation.

La condition de la réussite de ce mouvement relève d'une sorte de pari fou dont personne, à ce jour, ne peut prédire s'il sera gagnant ou perdant. Car les conditions de sa réussite, et de sa persistance, sont intrinsèquement liées à ses capacités à brasser large, non pas seulement pour occuper les rues, mais pour agir partout où l'occasion se présentera. Il suppose donc une capacité interne, collectivement assumée et si possible sans culte de l'étiquette à dépasser, sans les nier, les habitus, les cultures, les savoir-faire militants que tout un chacun, et c'est bien normal, tient à défendre et à cultiver. Les Gilets jaunes ont démontré, en leur temps, sur ce point – et chacun s'en souvient ou devrait s'en souvenir – une élasticité de tous les instants. Comme s'ils découvraient d'un coup, et bien plus rapidement que les militants professionnels enfermés dans leurs certitudes, que tout mouvement social d'ampleur auto-organisé est d'abord une agora et une terre d'accueil ouverte à la découverte des êtres qui, prédestinés ou pas, s'y retrouvent et s'y sentent bien. Quelle différence y a-t-il au fond, dans le désastre qui nous accable et nous détruit collectivement, entre un syndicaliste de base, militant de terrain, acquis à son organisation, mais contrarié, au mieux, par ses faiblesses, ses hésitations ou ses capitulations et un Gilet jaune, révolté sans parti, lassé de devoir constater, lutte après lutte, que tout est là pour que l'unité, la fusion opèrent dans la convergence combattante et active d'un peuple qui n'en peut plus. Qu'est-ce qui les sépare quand l'action commune, décidée en commun et votée en assemblée, est applicable dans l'instant et sans attente d'approbation d'aucun appareil de légitimation ? Rien. C'est ce mouvement dans le mouvement qui, s'il prend – en jaune, en rouge, en noir ou en tricolore version Enragés – fera la différence. Et c'est pour cela que, même sans manifester la moindre hostilité pour ceux qui voudront l'accompagner politiquement, il faudra qu'il défende avec force et constance son autonomie de fonctionnement et ses capacités décisionnaires assembléistes.

Bien sûr, personne n'est devin. Personne ne peut savoir ce que donnera cet « appel à tout bloquer à partir du 10 septembre ». On peut même douter qu'il donne quelque chose. Mais le doute ne doit pas être, comme en 2018, matière à déserter par avance un combat essentiel au prétexte, facile, que ce mouvement serait impur ou confus. Ce coup-là, on nous l'a déjà fait quand, vaillants mais isolés, les Gilets jaunes de la première vague appelaient à l'aide et que rares furent finalement les soutiens venus des bases syndicales. L'heure est désormais à la convergence, la vraie, celle qui permettrait tous les dépassements. Ce que craint le pouvoir, c'est précisément cela, ce qui, venant de partout et de nulle part, pourrait faire masse commune dans un mouvement suffisamment désidentifié pour n'être identifiable et corruptible par personne. On ne sait si c'est la recette pour vaincre, mais on croit savoir que, hors celle-là, toutes les autres tentatives, même massives, ont échoué à faire plier ce pouvoir malfaisant et sa police.

« Face aux malheurs qui affligent le monde, écrivit Noam Chomsky, broyer du noir ne sert à rien. Il faut être à l'affût des possibles. »
Et les saisir, ajouterai-je, comme une main qui se tend et qui, de geste en geste, pourrait faire chaîne humaine de résistance à l'abjection.
Freddy GOMEZ