21.01.2026 à 12:24
À Londres, les villes nouvelles sont intra-urbaines

Texte intégral (4116 mots)
Non pas le Périphérique mais la North Circular, non pas Clichy-Batignolles mais Brent Cross Town (BXT). Ce nouveau noyau urbain au sein de la métropole londonienne s’inscrit dans le modèle de morphologie urbaine polycentrique. Visite. Chronique d’Outre-Manche.

Visualisation aérienne de Brent Cross Town depuis le sud, montrant les constructions actuelles en couleur et les futurs blocs en transparence @Related Argent
Londres ne possède pas de périphérique urbain comme Paris mais un demi périphérique appelé North Circular, qui décrit un arc de cercle traversant zones industrielles, infrastructures et banlieues tentaculaires du XXe siècle. Sur un tronçon d’autoroute à huit voies entre deux échangeurs à plusieurs niveaux, il longe le centre commercial Brent Cross, le troisième plus grand de Londres. Au sud cependant, une surprise est en train d’émerger : un îlot de sérénité urbaine, neutre en carbone, baptisé Brent Cross Town (BXT).
Il faudra peut-être vingt ans pour mener à bien le projet BXT, qui prévoit 6 700 logements, 30 000 m² de bureaux pour 25 000 employés et 20 hectares d’espaces verts et de terrains de sport. Par son ampleur et son ambition, BXT s’apparente à la réponse londonienne à Clichy-Batignolles à Paris (XVIIe arrondissement) : un écoquartier aux fonctions mixtes, un développement axé sur les transports en commun (TOD) qui concrétise ce que Carlos Moreno appelait en 2016 la « ville du quart d’heure ». À ce jour, seul un huitième environ de BXT est en construction, mais les premiers résidents ont déjà emménagé dans les immeubles achevés et le premier immeuble de bureaux affiche déjà presque complet.
Les promoteurs sont Related Argent, une société née en 2015 de la fusion des sociétés new-yorkaise Related et londonienne Argent. Related est surtout connue pour Hudson Yards, un quartier varié mais étrangement propre, inséré sur Midtown West Side, à Manhattan, avec ses gratte-ciel futuristes aux façades de verre vertigineuses (dont deux de plus de 300 mètres de haut), ses espaces publics piétonniers, son immense salle de spectacle modulable et l’attraction spectaculaire, mais controversée, « Vessel », une structure de 46 mètres de haut conçue par Thomas Heatherwick. Argent est quant à elle surtout connue pour la rénovation du quartier londonien de Kings Cross Central, qui étend des infrastructures du XIXe siècle réhabilitées (dont la transformation des anciens dépôts de charbon par Heatherwick) avec de nouveaux bureaux (dont le siège européen de Google) et un quartier résidentiel. Kings Cross est reconnu comme un modèle de rénovation urbaine et d’aménagement du territoire.
Lorsque l’architecte Bill Dunster a fondé l’agence Zedfactory en 1999 et conçu BedZED, un éco-village de banlieue comprenant 100 logements achevé en 2002, il a marqué une étape importante dans la transition de Londres vers la neutralité carbone. BXT est bien plus qu’un simple « village » : son envergure et la mixité de ses bureaux, logements et commerces en font une véritable « ville écologique », où les loisirs de plein air font partie intégrante du mode de vie. Morwenna Hall, directrice générale et directrice des opérations de Related Argent, souligne leur « engagement en faveur du développement durable, de la santé et du bien-être, concrétisé par la mise en place d’un “Indice de bien-être” permettant de suivre l’évolution du bien-être de la communauté tout au long du cycle de vie du projet ».
Le projet BXT trouve son origine dans la volonté d’expansion du centre commercial, à laquelle Bob Allies, associé fondateur du cabinet d’architectes Allies and Morrison, se souvient s’être opposé en 1999, estimant que le site sud devait être aménagé en premier. « Il y avait là une zone industrielle discrète, une grande usine de recyclage (désormais) relocalisée, et de nombreuses voies de garage », explique Allies. « L’ensemble du secteur était complètement isolé et plutôt morne ». Le cabinet allait par la suite élaborer le plan directeur de ce qui est aujourd’hui BXT. Mais la création d’une véritable ville, et non d’un simple lotissement résidentiel, n’était réaliste qu’avec la construction d’une nouvelle gare à l’est du site. Bob Allies se souvient : « Lorsque nous avons commencé le projet, je me rappelle avoir dessiné la gare et les gens me disaient : “Oh, ne soyez pas ridicule” ».

Hall de la gare Brent Cross West. Photo @ H.W.
C’est de la nouvelle gare de Brent Cross West que j’ai entamé ma mission pour constater l’avancement du projet BXT. Les trains rejoignent King’s Cross, au cœur de Londres, en 12 minutes et desservent directement deux aéroports internationaux. En levant les yeux vers un échangeur autoroutier depuis la gare, on aperçoit les colonnes multicolores, hautes de 21 mètres, qui entourent le poste de transformation électrique de la nouvelle ville (conçu par IF-DO et Arup, 2025), et qui a fait l’objet d’une étude de cas dans un rapport du Forum économique mondial (World Economic Forum). Sur le site adjacent, la construction d’une centrale énergétique entièrement électrique de 30 MW, qui alimentera le réseau de chauffage urbain de BXT, débute en 2026.
La station elle-même est une conception de shedkm et Studio Egret West, avec un hall spacieux de 13 mètres de haut en bois massif. À l’extérieur, au-delà des palissades, on aperçoit divers immeubles de moyenne hauteur qui émergent au cœur de BXT. Un chemin sinueux qui les traverse mène au parc Claremont, conçu par Townshend Landscape Architects et regorgeant de plantations à la biodiversité riche, d’une aire de jeux animée par les enfants et d’une structure de jeu fantastique (réalisée par Root and Erect) qui pourrait figurer dans un conte de fées.

Claremont Park et nouveaux immeubles d’appartements @H.W
Le parc s’étend à l’est, au pied d’une falaise de nouveaux immeubles résidentiels orthogonaux de hauteur moyenne comme d’énormes boîtes aux façades de briques, aux grilles de fenêtres régulières et aux balcons en acier en porte-à-faux. Ce style urbain est courant dans les nouveaux projets londoniens – Bob Allies souligne que « nous respectons tous les directives du maire en matière de logement et les mêmes réglementations en matière de construction » – et bien qu’il rappelle l’architecture vernaculaire londonienne en briques, il pourrait tout aussi bien se trouver en Scandinavie ou aux Pays-Bas. Bob Allies affirme : « Nous savons que les bâtiments orthogonaux peuvent créer de très belles villes » et « j’ai toujours tenu à ce que les bâtiments donnant sur le nouveau parc forment un mur continu ». Deux immeubles d’appartements conçus par les architectes Maccreanor Lavington sont déjà occupés. Ces derniers expliquent que le Delamarre s’inspire des immeubles de type « mansal block » londoniens du XIXe siècle (on y retrouve les baies vitrées mais pas les ornements). Les appartements affichent des prix (exorbitants) conformes au marché londonien mais, derrière, le solide immeuble Conductor House (conçu en collaboration avec Whittham Cox) abrite 120 logements abordables et accueille des résidents des logements sociaux des années 1960 récemment démolis du Whitfield Estate.
Un centre d’accueil primé par le RIBA se trouve au fond du parc. Cette structure en bois de trois étages, conçue par Moxon Architects, présente des murs en gabions au rez-de-chaussée, un bardage en zinc à l’étage et du mélèze au sommet. À l’intérieur, se trouvent un espace d’exposition lumineux et un café. L’entrée du centre d’accueil donne sur un immeuble d’après-guerre abritant des commerces, sur Claremont Way. « AFG » fonctionne toujours comme une petite épicerie indépendante, un modèle menacé dans les villes britanniques. Autrefois indispensable au quartier de Whitfield Estate, AFG a désormais de nouveaux voisins : une pizzeria branchée et un torréfacteur. La banale rangée de boutiques a acquis une touche urbaine moderne grâce à une peinture bleue et une fresque botanique vibrante, « Cattleya », d’Annu Kilpeläinenn, sur le mur du fond. Malheureusement, ce joyau psychogéographique inattendu, qui connaît aujourd’hui une seconde vie prometteuse, risque fort de disparaître au profit d’un complexe commercial et de loisirs beaucoup plus imposant. Mais les plans changent, et comme le souligne Bob Allies, « une chose que nous avons apprise avec Argent grâce à l’expérience de King’s Cross, c’est… d’essayer de conserver les bâtiments existants autant que possible. On peut donner vie à un bâtiment existant d’une manière totalement différente ».

Claremont Way en 2008 et 2025, juste avant la démolition des logements sociaux Whitfield (gauche) et le relogement de ses résidents dans Conductor House (3ème bâtiment à droit) @Google Street View
Traversant les imposants immeubles d’appartements déjà construits, je suis arrivé à Neighbourhood Square. Il est dominé par la tour Fusion élancée de 24 étages (la plus haute de Brent Cross Town), composante du complexe en forme de L (Glenn Howells Architects), qui accueille des étudiants quelle que soit leur école ou université. La fontaine vert fluo de 4,3 m de haut, conçue par Studio Neon, évoque les fontaines des places européennes. Morwenna Hall, la directrice générale de Related Argent, souligne que « l’art continuera de jouer un rôle clé dans l’identité de Brent Cross Town à mesure que le quartier se développe ».
Plus de 50 nouveaux commerces, restaurants et cafés devraient ouvrir leurs portes, et Neighbourhood Square est appelé à devenir le cœur urbain de la communauté de Brent Cross Town. Copper Square, relié par une rue commerçante et situé à l’ouest, près de la gare, sera le centre commercial névralgique du quartier. Le premier immeuble est construit : le 3 Copper Square, un bâtiment de 14 étages presque cubique conçu par shedkm, avec une structure hybride en bois massif et béton. Six étages sont déjà occupés par l’Université Sheffield Hallam. Le prochain bâtiment livré sera le 2 Copper Square (Bennets Associates), un immeuble de neuf étages de couleur verte, entièrement construit en bois massif et agrémenté de terrasses végétalisées.
Le développement de BXT va se poursuivre de manière significative, s’étendant sur toute la longueur de la rocade nord, entre les échangeurs. Une passerelle verte enjambera cette rocade et reliera le centre commercial, actuellement accessible uniquement par d’étroits ponts débouchant sur des parkings ou par des routes sans trottoirs. Un vaste parc sportif arboré, baptisé Clitterhouse Park et conçu par Gustafon Porter Bowman, prolongera BXT vers le sud. Ce parc est essentiel à la vision de Morwenna Hall, qui souhaite faire de BXT « un quartier où le bien-être et la pratique du sport et des loisirs sont primordiaux ».

Neighbourhood Square, avec la tour Fusion (Glenn Howells Architects) et la fontaine verte (Studio NEON) @H.W
Qu’en est-il des habitants des banlieues qui découvrent soudainement une nouvelle ville devant chez eux ? Une vaste consultation a été menée et les riverains semblent avoir été conquis. Selon Bob Allies, ce succès s’explique par « l’amélioration de leur cadre de vie, la création d’une nouvelle gare, la connexion avec le centre commercial, l’amélioration des services de bus et un investissement important dans l’aménagement paysager ».
En tant que nouveau noyau urbain au sein de la métropole londonienne, BXT s’inscrit dans le modèle de morphologie urbaine polycentrique des grandes villes identifié en 1945 par les géographes Harris et Ullman de Chicago. Londres compte déjà de nombreux pôles où se concentrent des usages mixtes en périphérie, allant de Canary Wharf, apparu dans les années 1990, aux villes et anciens villages ruraux engloutis par l’expansion londonienne.

3 Copper Square (conçu par shedkm) et 2 Copper Square (par Bennets Associates)
Les villes sont généralement des îlots urbains enclavés dans la campagne, à l’instar des 32 « villes nouvelles » britanniques construites après la Seconde Guerre mondiale, certaines pour désengorger Londres. L’automne dernier, le Groupe de travail sur les villes nouvelles (NTT) a recommandé la construction de 12 nouvelles « villes nouvelles » à faible émission de carbone en Angleterre afin de fournir des logements, de stimuler la croissance économique et de faciliter l’accès aux transports. Certaines sont situées en zone urbaine, mais cinq occupent des espaces ruraux vierges. C’est regrettable, car nous devrions préserver, voire renaturaliser, nos campagnes, et non les détruire. Ce sont les banlieues dépendantes de l’automobile, et pas seulement les friches industrielles, qui doivent être ciblées et densifiées, et le Royaume-Uni doit accélérer le processus. Les plans de BXT sont antérieurs à ceux de NTT, mais ils répondent parfaitement à ses objectifs. Et cette « ville nouvelle » intra-urbaine est déjà en train de devenir réalité.
Tout ce dont BXT a besoin, c’est d’un élément modeste pour préserver la mémoire du passé. Espérons que la vieille galerie marchande de Claremont Way ne soit pas démolie.
Herbert Wright pour Chroniques d’architecture le 21/01/2026
À Londres, les villes nouvelles sont intra-urbaines
21.01.2026 à 11:24
Désespérance techno sud-américaine : les "Reminiscencias" de Binary Algorithms
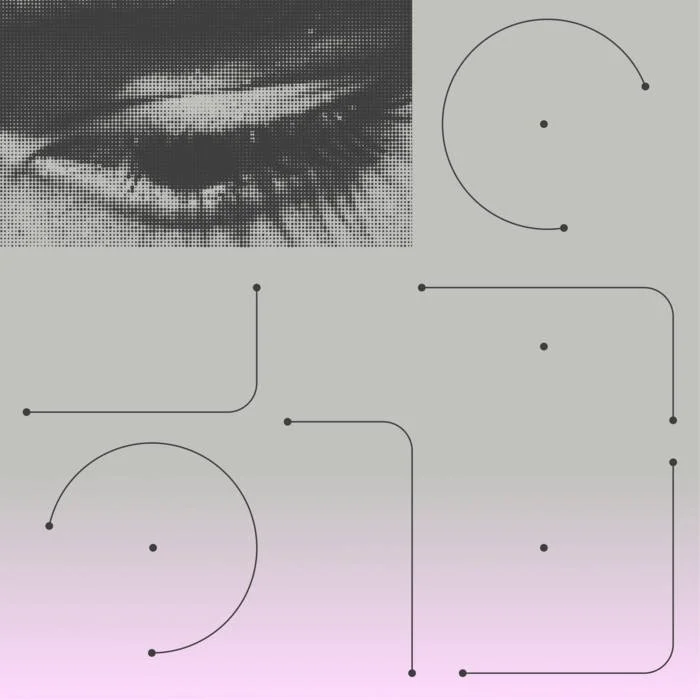
Texte intégral (895 mots)
Conçu entre 2023 et 2025, le premier album studio de Binary Algorithms dépeint une histoire de décadence et de désespoir, où se rencontrent la périphérie latino-américaine, le désespoir de l'absence d'amour et la tragédie de la résistance dans les pays du Sud. Mêlant IDM, dub-techno et électro à des influences UK bass et ambient, Binary Algorithms retrace également la dichotomie des identités « latines », si souvent réduites au « tropical ».
Néanmoins, Reminiscencias ne se limite pas à un seul fil conducteur. Il s'agit d'une cartographie intime des lieux vécus et abandonnés, où se croisent mémoire personnelle et histoire collective. Des coins de rue marqués par l'absence, des pièces à demi éclairées où des voix résonnaient autrefois, des trajets en bus à travers des banlieues tentaculaires, le bourdonnement lointain des marchés s'estompant dans un silence de béton. Les sons qui entourent Andrés – des routes rurales aux bourdonnements sourds de la circulation sur les autoroutes fissurées – se mêlent à des fragments de souvenirs : rencontres fugaces, lettres jamais envoyées, poids des mots non dits. Ces espaces sont imprégnés d'histoires de résilience et de perte, dont l'écho dépasse largement leurs limites physiques.

Chaque composition évolue entre des structures rythmiques abrasives, des passages atmosphériques expansifs et une conception sonore raffinée, évoquant la tension entre résilience et effondrement, nostalgie et futurs qui ne se sont jamais réalisés, utopies promises et vérité impitoyable. Dans cette convergence, le LP devient à la fois un document et une réflexion — un paysage sonore façonné par le temps, la perte et les espaces laissés entre eux.
Et si la comprenette vous fait encore défaut, pensez Trump, pensez Maduro et surtout la guignol de service :Maria Corina Machado, la même affidée qui a refilé son prix à l’agent orange… Plus clair comme ça ?
Jean-Pierre Simard, le 21/01/2026
Binary Algorithms - Reminiscencias - Furatena
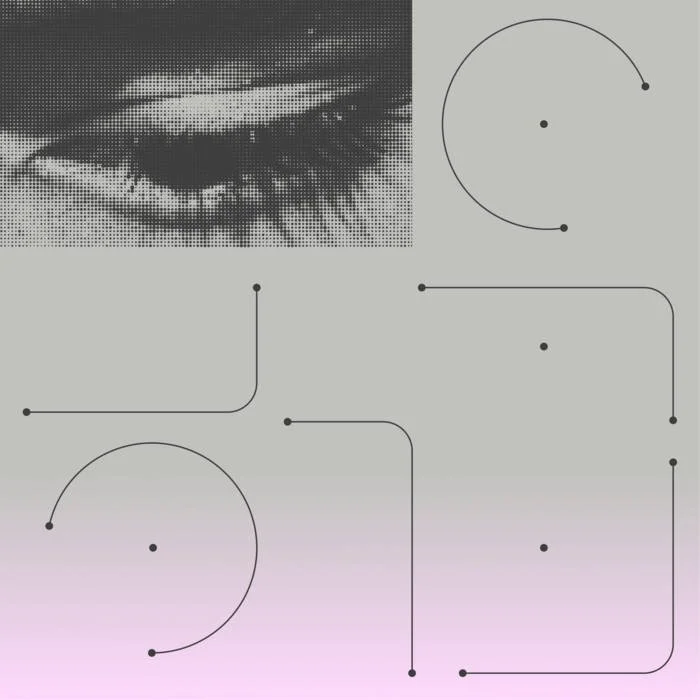
21.01.2026 à 10:55
“Décharge”, de Séverine : après la dévoration

Texte intégral (1029 mots)
Décharge, le nouveau texte de la poétesse Séverine, parle d'un corps perdu au pays des ogres et des ogresses, un corps asservi tantôt en poupée auscultable, tantôt en animal de laboratoire, coupé du monde par le silence, un silence devenu bourbier.

Coincée entre les larmes folles de la mère et les doigts intrusifs du père, le corps de l'enfant a devoir de confession, comme s'il fallait la purger d'une parole dont elle est par ailleurs interdite. Objet de convoitise autant que de dégradation, le corps ici marqué ne connaît du verbe soigner qu'une foule d'antonymes.
Comment, quand on appartient désormais à ce que l'auteure appelle "la horde des désaxées", se reconstruire? Le terme lui-même – reconstruction – semble ridicule alors qu'il s'agit de ruines, d'annihilation. Alors que l'enfant s'est vu spoliée d'enfance pour être sacrée terrain d'expérimentation. Alors que son entourage s'est décrété strangulatoire. Pourtant, contre ce passé piétiné, il faut se dresser, ou plutôt faire que la langue se dresse, qu'elle fore le mur blanc de silence derrière lequel s'abritent les prédateurs:
"Là encore, le présent est imprononçable, le lieu détruit insaisissable, cette part de toi, de la fumée. Tu ne te rends pas compte de ce que tu vis. Tu perds ton étanchéité, tu avales à l'aveugle des pulsions infernale, à grosses goulées. On ne donnerait pas cher de ta mémoire qui se laisse tatouer.
La force de Décharge consiste à tissser au moins trois lignes de langage, celle du souvenir à jamais déformant qui refuse le simple récit, celle du constat de dépossession du corps qui bat en brèche l'analyse et celle de l'intime comme expérience enfin révélée. En confrontant et alternant ces lignes vibratiles, l'auteure veille à ce que son texte survive à l'anéantissement qu'une telle parole pourrait générer, tant la violence de ce qui est, par tranchants fragments, dit, prend le risque de nous sidérer. Page après page, les non-dits cèdent, les monstres sont désignés, les peurs affrontées ; la douleur prend en charge les aveux et le sang de la vérité peut de nouveau couler à ciel ouvert; l'explicite surgit comme un fer rouge du magma indicible.
"Un souvenir, c'est âpre à exhumer, le retour stroboscopique du refoulé, son avancée une milliseconde par jour, son imperceptible gain en durée. La séquence enfouie peine tellement à se dérouler, mais finit par atteindre ta ligne d'arrivée […]"
Un viol n'est pas un récit, il n'obéit pas aux lois de la narration ordinaire, et quand il est répété, perpétré sous mille formes, nié dans sa réalité, adoubé par la famille, il semble qu'il lui soit impossible d'entrer dans le langage, voire interdit, tant la chasse est à jamais gardée par les "déserteurs les petits-chefs les bâtards". En détruisant le sujet et en en faisant un objet, le bourreau condamne sa proie au néant du langage. Qui ne parle que forcée ne parle pas. Qui doit se taire sous peine d'être davantage exclu n'a plus que les mots pour briser le bouclier des tabous. Pourtant, avec Décharge, Séverine brise, éclate, déplie, retourne, assèche, bouscule – se sauve – au double sens: fuite et salut s'épaulant tant bien que mal. Naître expose, écrit-elle vers la fin. Or c'est là le grand pari de ce texte: exposer plus que témoigner. Mettre à nu le déjà-décharné. Offrir aux cris une cadence. Faire de la vérité une force neuve. "Trouver une clairière", ainsi qu'il est espéré.
Claro, le 21/01/2026
Séverine, Décharge, éd. Lanskine
