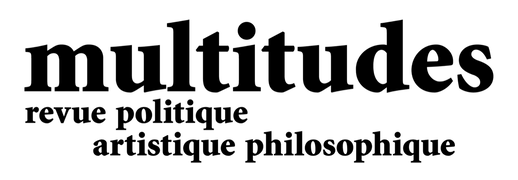25.09.2025 à 11:28
Communs Les paradoxes du /des commun(s)
Communs
Les paradoxes du /des commun(s)
Et si l’on réécrivait l’histoire des communs en complémentant l’étymologie du munus, qui lie par le devoir d’une charge, avec celle du mitra, qui libère par le don sans attente de retour ?
Commons
The Paradoxes of the Common(s)
What if we rewrote the history of the commons by supplementing the etymology of munus, which binds through the duty of a charge, with that of mitra, which liberates through giving without expecting any return?
L’article Communs <br>Les paradoxes du /des commun(s) est apparu en premier sur multitudes.
Texte intégral (3027 mots)
Qu’avons-nous en commun ? Avec qui, ou avec quoi ? Le commun, est-ce quelque chose que l’on « a » ou que l’on « est » ? Est-il un objet, un bien, un espace partagé – ou bien notre manière d’habiter le monde, de s’y rapporter ensemble ? Ce que nous considérons comme le plus propre et le plus intime, à commencer par nos noms propres et nos affects, n’est-il pas déjà façonné par un monde partagé, par une trame sociale antérieure à toute subjectivité individuelle ? Le commun est-il déjà donné ou se construit-il ? A-t-il besoin d’une loi, d’une institution, ou d’une action pour exister, d’un « oui » aux arrivants et aux étrangers, ou bien s’impose-t-il, de manière archi-politique, dans notre simple être-ensemble ? Faut-il le mettre en commun pour qu’il advienne ? Et qu’est-ce qui fonde alors cette mise en commun : une action collective, un contrat, un devoir éthique, l’amitié ou une condition ontologique ? Qu’en est-il de son rapport avec ses proches dérivés : communauté, communication, communisme ? Et dans des acceptions si larges que peut prendre le commun, que désigne-t-il encore ?
Une renaissance polysémique et une ambivalence constitutive
C’est précisément cette polysémie, cette fluctuation féconde, du terme « commun » que la revue Multitudes a interrogée à sa façon dès ses débuts à travers différents registres métaphysique, écologique, esthétique, numérique et politique. Si le mot semble irriguer tous les grands concepts du politique, on observe pourtant, dès les années 1990, une tentative de le renouveler, de le redéfinir ou d’en faire une boussole critique face aux mutations contemporaines du capital et à l’érosion du social.
Le concept de « multitude », tel que théorisé par Michael Hardt et Antonio Negri, s’inscrit dans la profusion conceptuelle de l’époque post-communiste visant à renouveler notre appareil théorique hérité du vieux marxisme, à la hauteur des transformations du monde globalisé. Il n’en est pas moins une déclinaison du commun ou, inversement, le commun peut être saisi comme une modalité d’expression de la multitude : un ensemble non déterminé et ouvert d’associations possibles, une composition hétérogène de singularités qui se relient, se délient, se reconfigurent autrement, dans un mouvement rhizomatique producteur de commun.
Si la réflexion sur le commun remonte à la pensée politique antique – celle de la cité grecque – c’est bien à partir des années 1990 qu’un regain d’intérêt s’opère, stimulé par plusieurs dynamiques majeures. En premier lieu, la montée en puissance de l’idéologie propriétaire a contribué à la privatisation progressive des communs : terres, eaux, forêt, savoirs, infrastructures, espace numérique, santé, espace urbain, éducation et services publics. Face à cette dépossession généralisée, le commun se présente alors comme le point d’ancrage d’une contre-offensive théorique et politique.
La renaissance de la réflexion sur le commun s’inscrit aussi dans l’ère post-communiste. La chute du communisme réel a conduit toute une génération de philosophes – Jean-Luc Nancy, Giorgio Agamben, Roberto Esposito, entre autres – à réhabiliter le commun, ou plutôt à sauver le commun du communisme, à travers une pensée renouvelée de la communauté définie comme au-delà ou en deçà des projets politiques.
À cette dynamique historique s’ajoute un enjeu plus vital encore : la prise de conscience croissante de la crise écologique. Celle-ci a mis en lumière non seulement la nature terrestre
de l’humain et sa fragilité vis-à-vis des conditions matérielles de son existence, mais aussi le caractère inévitablement commun de son destin. La pandémie de Covid-19, à cet égard, n’était qu’un épisode, qui a dévoilé brutalement le commun biologique, ou plutôt la communauté des êtres vivants, dans toute son ampleur mondialisée et avec tous les liens imprévisibles qu’elle engendre.
Enfin, le développement d’internet a révélé une nouvelle forme de commun : celui de la connaissance partagée, de l’intelligence collective, des infrastructures numériques. Si les plateformes ont massivement mis des « enclosures1 » sur ces ressources depuis les années 2000, l’émergence des logiques open source, des creative commons, des logiciels libres et des licences ouvertes a montré qu’un autre usage du numérique reste possible.
Il ne s’agit pas ici seulement du flou disciplinaire qui entoure la notion de commun, mais bien de son ambivalence constitutive, qui impose, à chaque tentative de renouvellement conceptuel, une vigilance critique pour ne pas glisser vers le comme-un, cette forme d’unification qui efface la pluralité au sein du commun2. Autrement dit, le commun comporte un risque inhérent : celui de son retournement en une essence figée, une chose, une identité close, bref, une réification, dont le communautarisme est une des conséquences.
C’est que le commun est à double tranchant : il peut ouvrir les possibles, ouvrir l’avenir, mais il peut aussi devenir le vecteur de nouvelles clôtures, de frontières rigides qui annulent les devenirs. Il inclut autant qu’il exclut : il ne « revient » à personne et peut pourtant devenir le propre d’un collectif particulier.
L’inquiétante étrangeté des « communs »
Pour ne pas sombrer dans de telles impasses, il est essentiel de penser le commun à partir de ses tensions internes. Cela signifie accueillir ses apories, assumer ses divisions constitutives, et reconnaître la nécessité de se rapporter à son dehors – à ce qui lui échappe : l’inassimilable, l’incommunicable, le non-commun. Appréhender le commun à partir de cette ambivalence – cette mobilité qui le rend insaisissable – a des implications majeures dans chacun des domaines où il est théorisé et mis en œuvre. Nous ne pourrons ici qu’en esquisser quelques figures.
L’une des veines que la revue Multitudes a explorées est celle des « communs », entendu au sens large comme non seulement les ressources naturelles et les biens communs, mais aussi comme tout ce qui se produit socialement, y compris le travail social lui-même. La production est devenue « commune3 », et c’est la coopération sociale qui est productrice de la valeur.
Dans ce prolongement, le capitalisme cognitif, développé par Yann Moulier Boutang, met l’accent sur le travail immatériel, l’intelligence collective, la circulation du savoir, les biens communs informationnels et le travail de coordination des cerveaux réunis en réseaux au moyen d’ordinateurs qui font à leur tour l’objet de la capture par le capitalisme des plateformes dont l’Intelligence artificielle est une des avatars les plus récents. À partir d’une inspiration proudhonienne de la « force collective » comme source véritable de la valeur, il s’agit de proposer alors toute une série de stratégies de réappropriation des communs, notamment à travers l’idée du revenu contributif qui sert à redistribuer la richesse socialement produite entre les travailleurs cognitifs.
Mais ces thèses, aussi fécondes soient-elles, occultent souvent le travail non-productif ou ce qui échappe à toute valeur-travail. Georges Bataille l’appelait la dépense improductive qui part en fumée et ne laisse personne et aucune instance la mesurer et la capturer. Sous cet angle, le commun se perd, il se dissipe. Il est difficile à saisir car fait de multiples associations imprévisibles et hétérogènes, incalculables, et inappropriables. Un tel commun ne peut advenir qu’en entretenant une tension constante avec ce qui résiste à toute opération économique. Il est ce paradoxe du Heim (foyer, patrie, maison) hanté par l’Unheimlichkeit (l’inquiétante étrangeté).
Ce prisme suppose d’aborder le commun à partir de ses marges inutiles, à travers ceux et celles qui ne contribuent (apparemment) d’aucune manière à la production de la richesse collective, les désœuvrés, les fous sans intelligence exploitable, les assistés, les migrants qui ne compensent aucun manque démographique dans les sociétés européennes vieillissantes, les étrangers inassimilables, les indomesticables, ceux et celles qui nous « remplacent » mais qui ne nous ressemblent pas, et qui ne servent même pas de miroir à la lutte pour la reconnaissance des Européens, ceux et celles qui ne parlent pas notre langue, les parasites, les nuisibles, les virus, les populations offlines, les langues et les idiomes non-numérisés et non-codifiables, enfin, tous ces êtres ou formes de vie qui ne « servent » à rien et ne peuvent être intégrés dans aucun foyer, et pourtant interrogent l’énigme du commun qui est aussi le lieu de résistance à toute forme de capture.
C’est aussi à un « reste » non-productif que renvoie, d’une manière très différente, la notion de « communs négatifs4 ». Ces communs négatifs désignent des infrastructures de grande échelle dont dépendent nos modes de vie mais qui ravagent nos milieux de vies futures, telles que les centrales à charbon, les déchets miniers ou radioactifs, et en général les héritages indésirables du progrès industriel dont personne ne veut.
Cependant, le terme « négatif » est mobilisé ici à contre-courant de ses significations chargées dans l’histoire de la philosophie. Car, pour ne s’appuyer que sur Hegel, le négatif est la condition de possibilité du commun. Sans ce travail du négatif, le commun risquerait de se refermer sur lui-même et de sombrer dans une immanence mortelle.
En ce sens, comme l’a affirmé Bruno Latour dans le numéro 45 de la revue, « il n’y a pas de monde commun » donné d’avance. Le commun n’émerge qu’à travers des ruptures, des discontinuités, des cassures – c’est-à-dire à travers un rapport conflictuel avec ce qui est donné. Il ne peut jamais être totalement institué, capturé ou fixé. C’est pourquoi toute gouvernance des communs doit prendre en compte leur ingouvernabilité intrinsèque. Le négatif devient affirmatif et producteur du ou des commun(s). C’est à partir de l’inappropriable qu’il est possible de se réapproprier le ou les commun(s). C’est cet excès qui fait que, dès que l’on a l’impression de réaliser ou de capturer le commun dans une institution ou dans un dispositif politique ou économique quelconque, il se dérobe et s’échappe vers un ailleurs lointain.
Le munus divisé
Ce paradoxe est déjà inscrit dans l’étymologie. Le terme latin munus, à la racine de « commun » (co-munus), renvoie à une charge partagée, à un échange originaire, à un système de dons et de contre-dons qui lie chaque individu aux autres. Il suppose une dette, un devoir, un engagement réciproque.
Mais cette logique du munus se complique lorsqu’on la met en regard de sa racine indo-européenne, mei, qui est à l’origine d’un terme important, mitra. Or mitra signifie « amitié », « alliance », « contrat », mais sans contenir l’idée de dette ou de contrepartie. Mitra désigne un don radical, hors calcul, comme celui du soleil – une des significations du terme indo-européen – qui donne sans jamais recevoir et n’attend rien en contrepartie5.
Dès lors, il s’agit peut-être de penser le commun entre ces deux régimes : entre le munus, qui lie par le devoir, et le mitra, qui libère par le don sans attente. Entre l’obligation partagée et la gratuité radicale. C’est dans cette tension – entre calcul et excès, entre institution et fuite, entre dette et donation pure – que le commun peut trouver sa puissance la plus radicale.
1Voir le texte de Yann Moulier Boutang, « De quoi l’intelligence artificielle est-elle le nom ? » Multitudes no 96 (2024).
2Voir à ce sujet le dossier : Du commun au comme-un, Multitudes no 45 (2011).
3Voir le texte de Judith Revel et d’Antonio Negri, « Inventer le commun des hommes », Multitudes no 31 (2007).
4Voir la Majeure Communs négatifs, Multitudes no 93 (2023).
5Voir Robert Turcan, Mithra et le Mithraisme, Paris, Belles Lettres, 1993.
L’article Communs <br>Les paradoxes du /des commun(s) est apparu en premier sur multitudes.
25.09.2025 à 11:26
Cosmo-finance La Sphère comme geste spéculatif
Cosmo-finance
La Sphère comme geste spéculatif
Et si le soutien aux arts par la médiation d’une blockchain portait en puissance une proposition cosmo-financière esquissant une alternative à la valorisation capitaliste ?
Cosmo-finance
The Sphere as a Speculative Gesture
What if support for the arts through the mediation of a blockchain were to give rise to a cosmo-financial proposal outlining an alternative to capitalist valuation?
L’article Cosmo-finance <br>La Sphère comme geste spéculatif est apparu en premier sur multitudes.
Texte intégral (4303 mots)
Ils collectent aussi bien des expériences et des rêves que des plans pour l’avenir. La capacité de collecter des plans pour l’avenir est une responsabilité intéressante, qui ne touche guère le collectionneur traditionnel (conservateur ou historien), mais qui devient incontournable pour le collectionneur d’art de l’immatériel.
Live Forever ! Collecting Live Art
Une machine à faire des avances de monde
La Sphère (thesphere.as) est un projet de recherche-création web 3.01 qui explore de nouvelles écologies de financement afin de créer un commun régénératif pour le cirque et les arts vivants. Inspiré par les récentes innovations dans le domaine des technologies comptables distribués (ou blockchains) et des économies contributives Peer-to-Peer orientées-commun, La Sphère vise à redistribuer les risques et les opportunités de faire de l’art en facilitant l’implication créative des « publics investis » (invested audience), des artistes, des collectionneurs et d’autres parties prenantes potentielles à différentes étapes du processus artistique et curatorial. Le projet a obtenu un financement Creative Europe entre 2020 et 2023, ainsi qu’une petite bourse de la galerie Serpentine (Londres) en 2024 pour le développement du Anarchiving Game2, où chacun est invité à créer des fragments reflétant l’évolution du projet.
La Sphère est un commun numérique ; une interface cryptoéconomique ; une (an)archive orientée-process pour les arts vivants ; un espace d’échanges et de développement mutuellement transformateur entre processus artistiques et pratiques alternatives d’organisation et de financement. Au bout du compte, nous en avons eu assez d’écrire d’interminables demandes de subventions et de travailler pour des peanuts. Nous avons donc décidé, avec beaucoup, beaucoup d’autres personnes, de réécrire les codes du capital et d’aborder autrement le problème du soutien aux arts.
Comment pouvons-nous tirer parti de nos capacités à risquer et spéculer ensemble pour créer de nouvelles compositions collectives métastables au-delà de ce qui est jugé possible – ou simplement finançable ? Nous développons un prototype de DAO (organisation autonome décentralisée) ancrée dans la réalité de la communauté circassienne afin d’explorer de nouvelles manières d’être créatif ensemble qui soient économiquement viables. Cette rencontre et ce travail autour de l’élaboration de nouvelles infrastructures techno-sociales sont fondamentaux – c’est quelque chose que Geert Lovink, fondateur du MoneyLab, définit comme stacktivisme, c’est-à-dire une forme d’activisme qui cherche à intervenir au niveau de la conception des protocoles qui régissent notre vie numérique.
« Le stacktivisme est, par définition, de nature abstraite et conceptuelle, sachant que le code est le pouvoir et que le pouvoir est le code. […] les stacktivistes se chargent de créer les liens manquants : ils sont les partageurs de mèmes, les connecteurs d’idées, les compagnons de route interculturels, les metteurs en réseau polydisciplinaires. L’instauration de nouveaux protocoles d’interaction numérique reste un acte de décision commune3. »
Ainsi donc, La Sphère prend forme en développant différentes techniques collectives qui cherchent à résister à l’habituel nivellement des valeurs contre l’horizon de la simple viabilité économique. La Sphère, c’est un peu comme une machine à faire des avances, avec toute l’ambiguïté érotico-financière que cette expression recèle ; et à les transformer en propositions de monde (en anglais, on dirait worlding, faire monde). Dans la foulée du cri de guerre alter-financier et stacktiviste de Geert Lovink, une chose est sûre : le temps où l’on se contentait de dénoncer la précarité dans le monde des arts est révolu. C’est l’heure de l’expérimentation cosmo-financière !
L’art précursif de la confiance
Ce texte est une tentative de partager quelques coordonnées et perspectives aspirationnelles-conspirationnelles constitutives de la Sphère. Pour le dire dans l’ethos ludiquement poétique et circassien du projet, l’idée est de prendre la Sphère par le milieu de son pool tourbillonnant de liquidité – une forme conceptuelle d’amorçage de liquidité (liquidity bootstrapping), si l’on peut dire. Comment rendre compte de la possibilité de former un quantum initial de confiance précursive, comme dirait William James ?
Quand je pense à l’aventure cryptoéconomique conviviale de la Sphère et à la chorégraphie de valeur que nous avons mise en mouvement, je me souviens d’une activité préférée de mes étés d’enfance : la création d’un tourbillon avec amis et famille dans la piscine hors-terre de notre arrière-cour de banlieue. Le protocole est simple : tout le monde commence à bouger dans la même direction, lentement au début, puis de plus en plus vite à mesure que le courant devient plus fort, emportant nos corps flottants dans une irrésistible procession estivale.
J’aime cette image primitive d’un tourbillon collectif parce qu’elle suggère efficacement comment nous nous constituons comme attracteur futurial. Les arts du spectacle font ressentir d’une manière particulière comment nous faisons l’expérience de notre métastabilité partagée, comment nous parvenons collectivement à engendrer des modes de générosité spéculative même dans les moments les plus précaires. La communauté du cirque est en effet liée par une économie corporelle : c’est une conspiration à ciel ouvert, flottante et tournoyante, qui cultive les flux vivants de telle manière qu’ils apparaissent à chacun comme une forme d’abondance partagée. Ou comme le dit Randy Martin, théoricien à la fois de la finance et de la danse, « cette réévaluation permet au risque d’être considéré comme une récompense en soi, car il se voit attribuer une valeur immédiate par l’ensemble créatif 4 ».
Contre la mystique managériale
The Sphere peut être lue comme une réponse singulière à la fameuse question de l’organisation. Les injonctions volontaristes à « mieux s’organiser » résonnent avec anxiété et triomphalisme entre le discours des consultants en entreprise et ceux des milieux sociaux progressistes. Combien de fois avons-nous éprouvé ce sentiment intime, presque impalpable mais bien réel, de détérioration et d’appauvrissement de notre vitalité relationnelle après un énième appel à « s’organiser » ? Combien de fois encore pouvons-nous nous permettre d’être traités de manière pseudo-professionnelle comme désorganisés ou insuffisamment organisés par les différents défenseurs de la gouvernance généralisée et de la mystique managériale5 ?
Et pourtant, nous devons nous organiser. Dans un monde qui s’oriente vers une fragmentation sociale accrue, la manière dont nous créons de nouveaux modes de coordination techno-sociaux est en effet devenue cruciale. Le défi, comme l’a souligné Yves Citton, consiste à terraformer de nouveaux passages métamorphiques entre la micro-échelle de la présence collective et la macro-échelle des agrégations médiatiques, afin de trouver des points de levier comparables au phénomène du leveraging financier6.
Les processus de co-apprentissage activés en notre sein représentent une force structurante qui façonne notre entreprise collective et la connecte à de multiples dehors. Ce processus de cosmo-localisation collective autour d’un matter of concern articulé entre art et finance est symbolisé par le syntagme « The Sphere as ». Le syntagme signale une attention particulière à la pluralité de modes d’adresse qui nous constitue (il coïncide d’ailleurs avec notre adresse web, thesphere.as).
Dans toute sa simplicité, la conjonction as (« en tant que ») fonctionne comme un opérateur comparatif-machinique qui facilite la navigation entre la variété des perspectives et des revendications (claims) prospectives concernant The Sphere et émises par celle-ci. Ce modulateur de mise en rapport est particulièrement important lorsqu’il est considéré dans une perspective cosmo-financière, c’est-à-dire une perspective qui s’intéresse à la communication des hétérogénéités en tant que telles, sans les réduire indûment les unes aux autres.
La plus-value des assemblages machiniques de perspectives
La conjonction « en tant que » nous amène au cœur du défi de repenser la valeur face à l’équivalence générale de toutes choses précipitée par les marchés. Contre l’idée hayekienne, redoutablement opérationnelle, du marché comme processeur omnipotent d’informations, qui traduit chaque élément de connaissance en prix, il est important de garder à l’esprit la leçon deleuzo-guattarienne de l’Anti-Œdipe concernant la plus-value de code. En gros, ils nous disent que la plus-value générée par les assemblages machiniques de perspectives n’est pas principalement économique : elle est d’abord comptabilisée de manière extra-économique par le biais de l’ontogenèse différentielle.7 Cela revient en dernière instance à quelque chose comme la condition même de la possibilité d’une rencontre entre des écologies encodant différentes façons de jouer sa peau (an encounter between differential ecologies with encoded skin in the game). En opérant sous la prémisse différentielle de « la sphère en tant que », nous espérons qu’à chaque étape du processus, nous apprendrons ensemble à résister à l’aplatissement habituel des valeurs face à l’horizon de la viabilité économique, en adoptant de manière ludique des approches frontales pour naviguer dans l’inconscient positif – le back-end financier – de la vie sociale.
La question de l’organisation numérique et des protocoles d’interaction qui y sont associés évolue ainsi imperceptiblement vers un art d’apprécier et d’évaluer les incorporations différentielles de valeurs. Dans la pratique, cela nécessite un art consistant à concilier différentes perspectives de manière à intensifier le processus dans son ensemble, transformant les contradictions apparentes en contrastes génératifs. Brian Massumi résume cette pratique sous le terme de « politique esthétique », s’appuyant sur la conception de Whitehead selon laquelle ce qui détermine l’intensité d’une expérience (artistique) est la capacité à maintenir ensemble les contrastes dans une inclusion mutuelle8.
Vers une finance décentralisée, expressive, basée sur la blockchain
Ce qui est défini ici comme un champ de compossibilités concerne directement le domaine financier. La logique extractive actuelle de la finance est intimement liée à la monétisation en tant que mécanisme par lequel les valeurs sociales, culturelles, économiques et écologiques sont rendues commensurables entre elles, aplatissant les valeurs hétérogènes en formation sur la seule unité de compte acceptée comme monnaie légale – la monnaie fiduciaire – selon le principe de rareté qui lui est inhérent. Mais la finance s’intéresse aussi essentiellement à « l’avenir » : c’est un art de coordonner le futur et ses possibilités émergentes à travers la conception d’attracteurs et la distribution des flux de désir. Martijn Konings décrit en termes de leviers (leveraging) cet art financier qui consiste à définir et à concevoir des attracteurs pour façonner l’avenir :
« L’effet de levier est la manière dont nous cherchons à donner à nos projections fictives une qualité performative qui se réalise d’elle-même […] l’effet de levier implique l’effort de se positionner comme le point focal de la logique interactive de la spéculation, comme un attracteur dans le domaine social9 ».
Cette compréhension de l’aspect performatif et spéculatif de la capture de valeur et de la logique pragmatique de levier qui lui est associée est cruciale si nous voulons aborder les questions financières avec une poétique étrange (weird) de l’expérimentation. Le pouvoir futurant d’une finance décentralisée, expressive et basée sur la blockchain suppose que nous allions au-delà de la critique habituelle du capitalisme comme imposant l’équivalence généralisée de toutes choses. Cela est d’autant plus nécessaire que, malgré sa pertinence face à la gamification néolibérale et antagoniste des relations sociales, la critique traditionnelle du capitalisme ne rend pas compte de la créativité synthétique de la finance contemporaine.
Dans son dernier ouvrage, Robert Meister affirme à propos de la fonction des « options » dans les dynamiques financières que :
« l’optionalité consiste à synchroniser des temporalités hétérogènes, à indexer des discours culturels hétérogènes, à tokeniser les taux de changement relatifs au sein et entre des systèmes hétérogènes d’évaluation et de classement – la liste est longue. Ces formes d’hétérogénéité n’ont plus besoin d’être réduites à un équivalent général si la liquidité peut être ajoutée grâce à des options qui permettent d’indexer leurs changements sur ceux d’autres domaines de valeur disparates10. »
Cette description de la manière dont différents systèmes hétérogènes d’évaluation se rapportent les uns aux autres de manière dérivée, remettant en question les modes habituels de financiarisation, dépasse la portée du projet The Sphere en tant que tel. Pourtant, en mettant l’accent sur les temporalités multiples inhérentes aux pratiques d’optionalité et d’indexation, Meister indique la voie d’une compréhension véritablement écologique de la finance et de son pouvoir polyrythmique et génératif ; ou inversement, vers une compréhension financière de la multiplicité inhérente à une écologie des pratiques qui pointe résolument vers ce que j’aime caractériser comme « une proposition cosmo-financière ».
La cosmopolitique met l’accent sur l’appartenance aux devenirs de communautés plus qu’humaines, sur les manières dont elles s’harmonisent et réagissent à leur milieu associé. La proposition cosmo-financière élargit cette perspective en mettant en avant des processus de découverte de valeur qui ne se limitent pas à la logique du marché, ainsi qu’en proposant de nouvelles façons d’envisager la tension créatrice entre le qualitatif et le quantitatif. En fin de compte, la proposition cosmo-financière vise à explorer les expressions sociales hétérogènes et les (in)formalisations de notre endettement mutuel, afin de favoriser des individuations collectives différentielles qui résistent à l’aplatissement actuel des valeurs sociales, culturelles et écologiques.
1Cet article résulte d’une traduction partielle du texte d’Erik Bordeleau, « The Sphere As Speculative Gesture. On the Precursive Art of Imagineering Cosmo-Financial Flows », Weird Economies, 12 June 2021, https://weirdeconomies.com/contributions/the-sphere-as-speculative-gesture
3Geert Lovink, Stuck on the Platform, Amsterdam, Vali, 2022, chapitre 8.
4Randy Martin, « A Precarious Dance, a Derivative Sociality », The Drama Review 56:4 (T216), NYU/MIT, Winter 2012, p. 68.
5Pour une analyse du syntagme « mieux organisés », voir mon article « Comme une tempête tropicale : Exfolier la forme-valeur » in François Lemieux and Edith Brunette (eds.), Aller à, faire avec, passer pareil, Montréal, Galerie Leonard & Bina Ellen Art Gallery, 2021, p. 165-180.
6Voir l’entrée Effets de levier ici même.
7Pour une lecture plus détaillée de ce concept central de L’Anti-Œdipe, voir mon article « We Too Have a Code: Cryptoeconomics and the Question of Programmability », in Oliver Leistert and Isabella Kohlhuber (eds), Hamburg Maschine Revisited: Artistic and Critical Investigations in our Digital Condition, ADOCS, Hamburg, 2022.
8Voir Brian Massumi, « Réévaluer la valeur pour sortir du capitalisme », Multitudes no 71, 2018, p. 80-91.
9Martijn Konings, Capital and Time: For a New Critique of Liberal Reason, Stanford University Press, 2018, p. 13-14.
10Robert Meister, Justice Is an Option. A Democratic Theory of Finance for the 21st century, University of Chicago Press, 2021, p. 198.
L’article Cosmo-finance <br>La Sphère comme geste spéculatif est apparu en premier sur multitudes.
25.09.2025 à 11:24
Déborder
Déborder
Et si c’était à partir des bords que nous pourrions au mieux réenvisager notre situation historique sans sombrer dans les passions tristes ?
Disboarding
What if it were from the bords that we could best rethink our historical situation without sinking into sad passions?
L’article Déborder est apparu en premier sur multitudes.
Texte intégral (3380 mots)
Deux points, c’est tout
Notre planète abrite deux points géographiques où celleux qui craignent le vertige ne devraient jamais tenter de se rendre.
Ces points occupent une surface minuscule – tellement petite qu’elle se réduit à rien. En fait, ils ne disposent pas de la moindre étendue. Bien qu’ils existent et soient matérialisés, ils n’ont pourtant ni longueur, ni largeur, ni profondeur.
Ces deux points ne possèdent aucune longitude. Ils ne sont donc situés dans aucun fuseau horaire particulier : on peut y choisir l’heure qu’il est à tout moment de la journée ou de la nuit. C’est vous qui décidez.
Ces deux points que réunit l’axe de rotation de la Terre sont le pôle Nord et le pôle Sud.
Ils sont les deux seuls endroits où l’on peut accompagner la rotation de la Terre – mais il faut alors tourner sur soi-même, très lentement, en 24 heures.
Le pôle Nord géographique est le point le plus septentrional de la planète. Situé à 90° de latitude nord, rien n’est plus au nord. Quand vous êtes là, où que vous portiez le regard, c’est le sud. Vous tournez sur vous-même et, pendant 360°, tout ce que vous voyez est le sud.
Diamétralement opposé, situé à 90° de latitude sud, le pôle Sud est le point le plus austral de la surface terrestre. Là, si vous répétez l’exercice de tourner sur vous-même, vous ne verrez que le nord. À l’infini.
Ces deux points ne connaissent pas de bord.
Tout le reste (ou presque) semble doté de bords1.
Qu’est-ce qu’un bord ?
Le bord est à la fois une zone matérielle et un objet de pensée. C’est là où les choses sont censées commencer et finir – pas seulement les choses mais aussi les êtres, les abstractions, les idées, les concepts, les territoires. Tout.
Pourtant, alors qu’elle semble concerner à la fois le réel et l’interprétation du réel par tous les modes de connaissance possibles élaborés avec le temps, cette notion reste un inexploré de la philosophie. Personne, jusqu’alors, n’a pensé faire du bord un concept.
En fait, le bord dissuade potentiellement le concept puisqu’il en est la condition de possibilité. Formuler un concept, c’est, tel un géomètre, arpenter et piqueter un territoire : créer un concept, c’est tracer des bords.
Ainsi, penser le bord suppose pour la pensée de se retourner sur ce qui, en grande partie, la conditionne.
Nous avons un bord. Du moins le pensons-nous.
Ce bord, celui de notre corps, est spatial – notre peau, sa limite externe, le matérialise ; il est aussi temporel – nous sommes enfermés par ces deux bords extrêmes que sont la naissance et la mort.
Nous localisons ces deux dimensions comme si elles étaient nettes et précises, « claires et distinctes », comme si la peau était bien une surface isolante, une enveloppe qui délimite précisément là où commence et où finit notre corps, et comme si la naissance et la mort étaient des instants nettement isolables. Malgré le flou qui entoure ces notions, l’état civil assigne pourtant un lieu et un moment (heures et minutes) à la naissance et à la mort. De même que le statut du corps est légalement défini.
Ainsi, en très grande partie, le bord a à voir avec le juridique : c’est la loi – une fiction – qui institue une coupure dans l’ordre des choses, créant de cette façon des bords pour leur donner consistance. Le concret est très largement défini par l’abstrait.
En réalité, le bord est presque toujours de l’ordre du « comme si2 ».
Désir de bord
Nous avons un bord. Du moins l’espérons-nous.
Il y a un désir de bord. Comme pour sentir que l’on peut s’appuyer sur un seuil stable, matériel et permanent. L’idée que tout a un bord est formulée pour se rassurer. Pour ne pas être affronté au vide, à l’abîme, au vertige du néant. Le bord, c’est ce qui permet de toucher.
Le sans-bord, c’est la figure terrifiante de l’intouchable, de l’illimité, du non cernable, du démesuré, de l’irreprésentable, de l’infiniment divers. C’est ce qui nous fait sentir que notre rapport au réel s’opère sur le mode du rétrécissement. Pour nous grandir, nous rétrécissons tout.
Et lorsqu’un objet de pensée ou un élément du réel échappe à l’établissement de bordures – il faudrait peut-être mieux dire : au « bordurage » ou à la « borduration » – comme la notion d’infini, celle de Dieu, certaines figures décrites par la topologie ou certains modèles cosmologiques d’un univers à la fois infini et sans bord, nous nous raccrochons au bord pour nous réfugier dans quelque chose que nous pouvons appréhender.
Le bord vient nous border, comme une figure maternelle ou paternelle bienveillante le ferait dans notre lit d’enfant pour que, rassurés, nous puissions nous laisser glisser dans le sommeil. Le bord, c’est ce qui permet de fermer les yeux sur l’ouverture effrayante du réel, et ainsi avoir moins peur.
C’est pour cela que les objets sont rassurants : ils nous donnent l’illusion de pouvoir nous raccrocher à des bords. Saisir un objet, c’est avoir sensitivement la certitude de toucher un bord. Comme trouver quelque chose de stable dans l’immensité de l’instabilité et de l’impermanence des choses et des états de chose. Comme s’accrocher désespérément à son siège lorsque l’avion en perdition pique vers le sol.
Le propre du bord
Nous restons accrochés aux bords.
À titre d’exemple parmi tant d’autres : la montée des nationalismes, de l’illibéralisme, de la pensée d’extrême-droite et des démarches identitaires, qui visent en substance à (r)établir des bords pour endiguer un sentiment de dilution et d’effacement des limites, témoigne sans aucun doute de ce recours à une notion toujours pensée comme une protection salvatrice – alors qu’elle pourrait seulement se révéler être une limitation de potentialités d’évolution.
Des bords continuent de cerner les aires de propriété de toutes choses, de tout état, de toute idée : qu’est-ce qu’un brevet après tout, par exemple, si ce n’est un bord posé autour d’une idée ou d’un dispositif pour en garantir et en assurer la propriété ? De façon significative, le terme « propriété » présente en français le double sens de « possession » et de « qualité propre » : il est emprunté au latin juridique proprietas, « caractère propre ; droit de possession, chose possédée », lui-même dérivé de proprius, « qui appartient en propre, caractéristique3 ».
On crée des bords aussi bien pour donner des propriétés à ce qui est que pour rendre possible la propriété sur ce qui est – et c’est sans doute la même chose. Ainsi, la notion de bord favorise une rencontre entre l’être et l’avoir : une propriété, c’est ce que quelque chose ou quelqu’un possède en propre – à la fois ce qu’il est et ce qu’il a.
Une vie sans bord ?
À une époque qui vise à fabriquer toujours plus de bords (ce que permet de façon démultipliée l’utilisation malavisée de l’immense puissance des technologies issues du numérique), on peut tenter d’ébaucher une vie sans bords, dont l’un des aspects serait une théorie politique compatible avec le régime général d’inséparation4.
Parler d’une vie « sans bords », c’est proposer que le verre soit rempli plus haut que les bords ; c’est vouloir que ça déborde – c’est aspirer à une vie littéralement débordante. Il ne s’agit ici ni d’une nouvelle formulation anarchiste (même si ce n’est pas incompatible), ni d’une actualisation de la proposition soixante-huitarde de « jouir sans entraves » (qui a depuis longtemps montré ses contradictions dans la fusion avec le marketing et la consommation).
Ce débord est une tentative pour faire advenir – d’abord en nous, dans l’émotion et dans la pensée, avant que ce soit dans la réalité matérielle sociale et économique –, une autre approche de la réalité, une autre vision du monde. Et de quoi avons-nous le plus besoin aujourd’hui, si ce n’est de nouvelles visions du monde ?
Vivre et respirer sans bord, c’est ne pas vouloir toujours plus pour tenter de désirer mieux. C’est ne plus accepter d’occuper le lieu de l’individu, c’est-à-dire s’extirper du fantasme de la propriété de soi. C’est ne plus vouloir de soi comme un territoire dont on serait le propriétaire, et desserrer le carcan de soi comme territorialité à rentabiliser. C’est s’ex-proprier en cessant de concevoir ce que l’on est à l’image de l’individualisme possessif, c’est-à-dire comme un topos clôturé (borné ?) à exploiter.
Pour Spinoza, « chaque chose, selon sa puissance d’être, s’efforce de persévérer dans son être5. » Et cet effort est l’essence même de cette chose : « l’effort (conatus) par lequel chaque chose s’efforce de persévérer dans son être n’est rien en dehors de l’essence actuelle de cette chose6 ». Ainsi, tant que nous nous pensons comme les propriétaires terriens de notre propre existence, nous ne pouvons faire autrement que « persévérer dans notre être » tout au long de la vie, animés de l’idée principale d’augmenter notre surface d’exploitation. Fondée sur l’idée de bord et de son extension en théorie illimitée, cette conception de ce que serait un idéal de vie à accomplir montre ses limites, et, dévoilant sa vanité parce qu’elle vise à l’impossible – la surface d’exploitation gagnée n’est jamais suffisante, c’est un système sans principe d’arrêt –, ne peut engendrer que frustration et amertume. Il s’agit d’essayer de rompre avec cette passion triste, peut-être la plus pernicieuse de toutes les passions tristes jamais engendrées.
Il s’agit, là où chacun se sent de plus en plus enserré par des bords multiples – allant des réseaux sociaux à la solastalgie en passant par la surveillance généralisée – de se donner de l’air.
Juste un peu d’air, là où tout a l’air d’être devenu irrespirable.
1Ces pages sont extraites du manuscrit du Livre de bord à paraître.
2Voir à ce propos la Majeure Frontières/Lisières dans le no 97 de Multitudes (2024).
3Voir à ce propos la Majeure Propriétés/communs dans le no 41 de Multitudes (2010).
4Voir le dossier Inséparation, modes d’emploi dans le no 72 de Multitudes (2018).
5Spinoza, Éthique, III, proposition VI.
6Spinoza, Éthique, III, proposition VII.
L’article Déborder est apparu en premier sur multitudes.