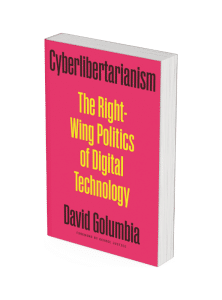
À propos du livre de David Golumbia, Cyberlibertarianism: The Right-Wing Politics of Digital Technology, University of Minnesota Press, 2024
L’alliance entre Donald Trump et la Silicon Valley a suscité depuis le début de l’année 2025 une abondante production intellectuelle, qui cherche à expliquer ce qui est d’abord apparu à de nombreux commentateurs comme un retournement improbable. Comment une industrie longtemps réputée libérale et progressiste a-t-elle pu se ranger aussi rapidement et massivement derrière un dirigeant autoritaire et xénophobe ? Passé l’étonnement initial, plusieurs auteurs ont montré que, par-delà ses apparences libertaires, le monde de la Tech était traversé de longue date par des tendances explicitement réactionnaires. Plus rares sont ceux qui se sont demandé si, dans son rapport aux technologies numériques, une partie de la gauche américaine n’avait pas, elle aussi, légitimé l’approche de la Tech aujourd’hui privilégiée par le pouvoir trumpiste, autour de la déréglementation du secteur et du développement à tout crin de l’intelligence artificielle. C’est une hypothèse de ce genre, quelque peu provocatrice, que le dernier livre de David Golumbia, Cyberlibertarianism. The Right-Wing Politics of Digital Technology, nous invite à examiner
Qu’est-ce que le cyberlibertarianisme ?
Cyberlibertarianism est un ouvrage posthume. David Golumbia, qui était professeur à la Virginia Commonwealth University, est mort d’un cancer foudroyant en septembre 2023 peu après avoir remis le texte à son éditeur. C’est aussi un livre bilan, qui reprend en un peu plus de 400 pages les analyses développées par l’auteur sur une période d’une quinzaine d’années. Durant celles-ci, il est souvent apparu comme un universitaire à contre-courant, naviguant entre les disciplines et n’hésitant pas à remettre en cause la doxa académique, dès lors qu’il était question des technologies numériques et de leur potentiel émancipateur.
« Au sens le plus strict, le cyberlibertarianisme est la conviction que les technologies numériques sont, ou devraient être, soustraites au contrôle des gouvernements démocratiques »
David Golumbia
Bien qu’il n’ait pas forgé le terme, apparu pour la première fois sous la plume de Langdon Winner dans un article de 1997cyberlibertarianisme. Il ne s’agit pas, selon lui, d’un mouvement unifié ou d’un parti politique. Ce n’est pas non plus une idéologie parfaitement articulée, systématique et cohérente. Le cyberlibertarianisme ne doit donc pas être compris comme la stricte application à la sphère numérique du libertarianisme, en tant que théorie politique d’un État minimalThe Politics of Bitcoin, définissait comme « un ensemble de formules et des croyances associées à la diffusion des technologies numériques
Derrière ces formulations quelque peu obscures, il faut comprendre que le cyberlibertarianisme caractérise un certain type de rapport politique aux technologies numériques. « Au sens le plus strict, écrit D. Golumbia, le cyberlibertarianisme est la conviction que les technologies numériques sont, ou devraient être, soustraites au contrôle des gouvernements démocratiques » (p. xxi). Cette conviction découle, pour celles et ceux qui la partagent, de l’idée selon laquelle l’informatique et Internet auraient des vertus émancipatrices. Plus précisément, les cyberlibertariens appréhendent les structures sociales, politiques et économiques héritées comme des « barrières » (p. 4), comme des obstacles aux libertés individuelles et aux capacités collectives d’auto-organisation. Or ils considèrent les technologies numériques comme une force érodant ces structures oppressives. Dès lors, brider ou encadrer par la loi le déploiement de ces technologies équivaudrait à empêcher ou à retarder de nombreuses transformations sociales bénéfiques.
Tout l’ouvrage de D. Golumbia est écrit pour documenter la diffusion de cette vision et pour la réfuter. Selon l’auteur, l’influence du cyberlibertarianisme aide à comprendre le hiatus entre les promesses de démocratisation régulièrement associées aux technologies numériques et le recul de fait des institutions et des pratiques démocratiques depuis la diffusion de l’Internet grand public. Tout en usant, voire en abusant, d’une rhétorique pro-démocratie, les cyberlibertariens ont en effet amoindri « le pouvoir des gouvernements démocratiques de choisir les technologies qui correspondent à leur vision d’une société équilibrée » (xxiii). En refusant toute réglementation des technologies numériques et toute limite posée à leur développement, ils ont attaqué, selon Golumbia, le principe même de la souveraineté démocratique.
L’intérêt de la notion de cyberlibertarianisme est qu’elle transcende les clivages partisans habituels. En tant que rapport politique aux technologies numériques, le cyberlibertarianisme « n’imprègne pas uniquement les écrits de figures ouvertement à droite comme Eric Raymond, Paul Graham ou Peter Thiel, mais aussi de certains qui se réclament de la gauche et du centre […] » (p. 4). Dans le contexte américain, qui est celui où se déploie l’analyse de l’auteur, le cyberlibertarianisme renvoie à un bouquet de convictions partagées par de nombreux acteurs sociaux, dans la Silicon Valley et au-delà, au sein des entreprises comme dans le monde universitaire, chez des sympathisants du parti Démocrate comme du parti Républicain. Parmi ces différents protagonistes, D. Golumbia s’intéresse peu à ceux dont on parle en général le plus : les grands entrepreneurs de la Silicon Valley. Il se concentre sur d’autres producteurs de discours : blogueurs, essayistes, membres de think tanks, journalistes, universitaires, militants. Deux groupes d’acteurs retiennent particulièrement son attention. D’un côté, les penseurs et essayistes libertariens, qui gravitent depuis des années autour du monde de la Tech. De l’autre, les militants des libertés numériques, qui occupent a priori une position plus oppositionnelle par rapport aux grandes entreprises technologiques. Présentons ces deux groupes, avant de préciser en quoi le cyberlibertarianisme les rassemble.
Les individus souverains contre la démocratie
D. Golumbia soutient que « malgré sa réputation actuelle (surtout parmi les conservateurs) d’être “ progressiste ”, la Silicon Valley et la culture informatique en général sont issues de la droite » (p. 57). De fait, William Shockley, le pionnier de l’industrie des semi-conducteurs, fut un ardent défenseur de l’eugénisme et de théories racistes. Plus généralement, la Silicon Valley est depuis longtemps opposée à la réglementation de ses activités, hostile aux organisations syndicales et pour partie traversée d’idéologies réactionnaires, en matière de genre par exemple
Cyberlibertarianism s’intéresse surtout à la diffusion dans le monde de la Tech, au cours des années 1990, de certaines conceptions centrées sur la défense des libertés économiques. Il cite notamment l’essai de 1994 « Cyberspace and the American Dream: A Magna Carta for the Knowledge Age », écrit par le futurologue Alvin Toffler, la journaliste Esther Dyson, l’ancien conseiller scientifique de Reagan George Keyworth et l’investisseur George Gilder ; un texte souvent considéré comme la feuille de route de la dérégulation des télécoms et de l’informatique aux États-Unis.
D. Golumbia revient aussi sur l’influence d’un ouvrage publié en 1997 par l’investisseur en capital-risque James Dale Davidson et le journaliste William Rees-Mogg : The Sovereign Individual. Les auteurs y louent l’émergence d’une élite mondiale d’« individus souverains », que les technologies numériques aideraient à se dégager du carcan de l’État-nation. Derrière la valorisation typiquement libertarienne des libertés économiques au détriment des libertés politiques, D. Golumbia décèle une théorie « proto-fasciste », qui défend la capacité des ultrariches « à acheter le fait de se soustraire à la politique démocratique » (p. 353). À l’instar d’autres auteurs comme Quinn Slobodian, D. Golumbia montre ici la porosité entre les idées libertariennes, traditionnellement inscrites dans l’orbite du libéralisme politique, et des conceptions authentiquement autoritaires et antidémocratiques. Il souligne en outre l’influence durable au sein de la Silicon Valley de The Sovereign Individual, un ouvrage
Cyberlibertarianism analyse enfin les écrits d’intellectuels comme Nick Land et Curtis Yarvin, que l’accès aux responsabilités de D. Trump et J.D. Vance a récemment placés sous les projecteurs médiatiques, dans la mesure où ils ont été crédités d’une influence idéologique importante sur le nouveau pouvoir états-unienThe Sovereign Individual, amalgamant les visions transhumanistes d’une humanité radicalement transformée par les technologies, avec l’hostilité à l’État des libertariens et des anarcho-capitalistes.
Lire aussi « Quand le capitalisme fait sécession » d’Haud Guéguen, à propos du livre de Quinn Slobodian, Crack-Up Capitalism, avril 2024.
Les libertés numériques contre la démocratie ?
L’apport le plus original des analyses de D. Golumbia ne concerne pas, à mon sens, ces penseurs d’extrême droite, mais d’autres acteurs que l’on associe souvent à la défense des libertés numériques. Il s’agit d’organisations de protection des libertés civiles comme l’Electronic Frontier Foundation (EFF), de lanceurs d’alerte comme Julian Assange et Edward Snowden, de militants défendant le logiciel libre ou le chiffrement, de projets collaboratifs comme Wikipédia, ou encore d’universitaires comme Yochai Benkler et Daphne Keller. Ces différents acteurs ont en commun de revendiquer une fidélité aux grands principes du libéralisme politique, ce qui les situe a priori bien loin des tendances proto-fascistes que D. Golumbia repère à juste titre chez des essayistes comme Curtis Yarvin. L’auteur juge pourtant les défenseurs des libertés numériques avec une grande sévérité.
Il souligne tout d’abord le manque d’indépendance de nombre d’entre eux vis-à-vis des grands acteurs de la Tech, dont ils dépendent financièrement — c’est le cas par exemple de l’EFF et de centres académiques comme le Media Lab du MIT, l’Internet Observatory de Stanford ou le Berkman Center de Harvard, historiquement liés à l’industrie. Il insiste en outre sur le fait que « même ceux qui n’ont aucun intérêt apparent aux profits des entreprises — tels que les développeurs de logiciels libres, divers autres “ hackers ” et les responsables de projets à but non lucratif comme Wikipédia — ont souvent beaucoup à gagner à la prolifération des industries numériques » (p. 53). Il s’arrête également sur plusieurs mobilisations en faveur des libertés numériques, afin de démontrer qu’elles auraient bénéficié à la Silicon Valley
Son argument général consiste donc à dire qu’il existe une affinité profonde entre des essayistes d’extrême droite et les militants des libertés numériques : le rejet de la réglementation des technologies.
L’essentiel de l’argumentation de D. Golumbia se situe néanmoins sur le plan des idées. Il soutient que les croyances fondamentales des défenseurs des libertés numériques — la force émancipatrice des technologies, de l’« ouverture » et de la « décentralisation » — les auraient poussés à embrasser « les objectifs des militants de droite et d’extrême droite hostiles au gouvernement » (p. 283). Ces acteurs, en apparence progressistes, seraient des activistes de droite s’ignorant comme tels. Leur vision du monde serait fondamentalement antidémocratique, en ce qu’elle remettrait en cause la possibilité d’encadrer par la loi l’essor des technologies numériques. Selon D. Golumbia, les défenseurs de la liberté d’expression en ligne, du droit au chiffrement, voire de la protection des données personnelles, remettraient en cause la capacité d’un pouvoir démocratiquement élu à réglementer les usages de l’informatique et d’Internet.
Il critique par exemple l’incohérence de certains activistes luttant contre la surveillance publique et privée (comme les développeurs du projet Tor), qui revendiquent une légitimité indépendante de « l’infrastructure juridique des États-Unis ou d’un quelconque autre pays » (p. 261). Il s’élève aussi contre la manière dont la liberté d’expression a pu être instrumentalisée pour empêcher la régulation par la puissance publique des espaces en ligne et des réseaux sociaux commerciaux. Son argument général consiste donc à dire qu’entre les discours explicitement antidémocratiques des essayistes d’extrême droite et les luttes censément prodémocratiques des militants des libertés numériques, il existe par-delà les apparences une affinité profonde : le rejet de la réglementation des technologies.
Alisdare Hickson, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
D. Golumbia dénonce enfin ce qu’il présente comme un aveuglement de nombreux penseurs et militants de gauche, relativement à des courants ou à des personnalités souvent considérés avec bienveillance, voire admiration. Un exemple qui revient à plusieurs reprises est celui des cypherpunks, qui défendent depuis le début des années 1990 le droit au chiffrement pour tous. Selon D. Golumbia, cette cause s’inscrirait en fait au sein d’un programme politique objectivement d’extrême droite, où figurent en bonne place des idées comme la supériorité des solutions technologiques sur les solutions juridiques, le refus de l’impôt et le contournement des lois (p. 111). D. Golumbia livre également des jugements particulièrement sévères sur des figures de premier plan comme le fondateur de Wikileaks Julian Assange et le lanceur d’alerte Edward Snowden, qui révéla en 2013 l’étendue de la surveillance pratiquée par la National Security Agency (NSA). Le premier est décrit comme « un provocateur politique proto-nazi dont l’antisémitisme, le racisme anti-Noirs, le déni du changement climatique, la misogynie, la haine de la démocratie et le soutien à des régimes politiques autoritaires […], y compris ses efforts pour tromper l’opinion publique lors de l’élection présidentielle américaine de 2016, ne parviennent pas à pénétrer l’esprit d’observateurs, qui considèrent que son utilisation des outils numériques et son attitude anti-establishment demeurent efficaces » (p. 116). Quant à E. Snowden, D. Golumbia estime qu’« il est difficile d’accorder du crédit à l’affirmation selon laquelle la principale chose qui l’intéressait était de défendre les libertés civiles », et non de « nuire le plus possible au gouvernement démocratique » états-unien (p. 125).
Convergences et (manque de) nuances
La thèse la plus forte du livre de D. Golumbia est donc celle d’une convergence idéologique et politique, autour des préceptes cyberlibertariens, d’une constellation d’acteurs que l’on tendrait spontanément à situer en différents endroits du champ politique. Les cyberlibertariens de toute obédience partageraient une même hostilité à la réglementation démocratique des technologies numériques dans le cadre de l’État-nation. La thèse est stimulante, à la fois scientifiquement et politiquement, mais l’argumentation qui la soutient n’est pas dénuée de faiblesses.
La question du rapport entre démocratie et défense des libertés numériques est en effet plus complexe que ne le suggère Golumbia.
La première tient à l’empressement, voire à la légèreté, avec laquelle un grand nombre d’acteurs sont caractérisés comme « fascistes », « proto-fascistes » ou « proto-nazis ». Si D. Golumbia est convaincant lorsqu’il montre, parfois avec finesse, comment des prises de position en apparence progressistes ont pu favoriser l’essor d’acteurs qui ne l’étaient pas, il l’est moins lorsqu’il traite indistinctement les uns et les autres de fascistes. Les passages consacrés à des figures ambivalentes comme J. Assange ou E. Snowden apparaissent ainsi manichéens et on regrette parfois que l’auteur favorise certains amalgames. À lire Cyberlibertarianism, peu de choses distinguent ceux qui tiennent des discours d’extrême droite et ceux qui refusent d’interdire les discours d’extrême droite au nom d’une conception maximaliste de la liberté d’expression ; ou ceux qui se livrent à des activités violentes et ceux qui développent des outils de chiffrement ou d’anonymisation pouvant être utilisés pour coordonner des activités violentes. Dire que ces distinctions n’ont aucune importance représente, me semble-t-il, une pente dangereuse. On peut s’opposer vigoureusement à la vision absolutiste de la liberté d’expression, qui a conduit de nombreux cyberlibertariens à une attitude excessivement tolérante vis-à-vis des discours de haine en ligne, sans pour autant assimiler les défenseurs (états-uniens) des libertés civiles à des proto-nazis.
De manière plus générale, il est regrettable que D. Golumbia n’essaie à aucun moment de faire des typologies d’acteurs, ou a minima de mettre au jour certaines différences significatives entre les différents protagonistes du cyberlibertarianisme. Cela confère à l’ouvrage une partie de sa charge polémique, mais finit par affaiblir son propos. En effet, les raisons qui expliquent l’hostilité à la réglementation par l’État de la sphère numérique ne sont pas les mêmes pour tous. Chez certains, les arguments anti-régulation dérivent du primat des libertés économiques sur les libertés politiques. L’objectif poursuivi est alors que les entreprises et les acteurs financiers de la Silicon Valley soient immunisés contre tout obstacle réglementaire (respect de la vie privée, législations antitrust, droit environnemental, etc.) et exigence redistributive (fiscalité). C’est aujourd’hui très précisément l’agenda politique des grands acteurs de la Silicon Valley — et ce qui explique pourquoi ils ont tant fait pour s’attirer les bonnes grâces du pouvoir trumpiste.
Les arguments qui ont historiquement été ceux des militants des libertés numériques peuvent difficilement être rabattus sur ce schéma. Pour le dire de manière simple, ces acteurs militants ont cherché à faire prévaloir des libertés technologiques, plus que des libertés économiques. Ce qui explique leur opposition à nombre de réglementations n’est pas le maintien des conditions d’une maximisation des profits économiques pour quelques-uns, mais la défense des conditions d’un déploiement émancipateur des technologies numériques pour tous. C’est du reste ce que souligne D. Golumbia lui-même, lorsqu’il écrit que « les utopistes numériques exigent que “ nous ” reconnaissions leur “ droit humain ” aux ordinateurs, aux téléphones portables et à un internet “ libre et ouvert ” » (p. 272). Cette phrase indique bien que le positionnement d’acteurs militants comme l’EFF (dont l’un des slogans est « digital rights are human rights ») repose sur l’assimilation entre accès aux technologies numériques et droits fondamentaux. D. Golumbia a donc raison de souligner que ce positionnement adopté par les militants des libertés numériques a pu favoriser les desseins des franges les plus libertariennes de la Silicon Valley, en érigeant des obstacles à la réglementation et au contrôle des technologies. Il est en revanche simplificateur de faire comme si les raisonnements et les valeurs impliquées étaient les mêmes chez ces différents groupes d’acteurs.
Cela conduit à souligner une autre faiblesse de l’ouvrage : la théorie de la démocratie qui lui est sous-jacente. Bien qu’il ne clarifie jamais ce point, D. Golumbia semble considérer que la démocratie se réduit au vote et à la mise en application des lois par les États, dans le cadre des institutions représentatives propres aux démocraties parlementaires contemporaines. On ne trouve dans l’ouvrage aucune prise en considération ni des échelles de décision infra-étatiques, ni des contre-pouvoirs que la société civile peut opposer à l’État, ni des actions de désobéissance civile auxquelles certaines théories démocratiques accordent une place déterminante. Ainsi, bien que D. Golumbia dénonce à raison l’inconséquence de certains discours « pro-démocratie » tenus par les défenseurs des libertés numériques, sa propre approche de la souveraineté démocratique paraît parfois à la fois limitative et faiblement argumentée. Cela le conduit à considérer comme « anti-démocratiques » des pratiques et des discours cyberlibertariens, auxquels il serait en fait possible de conférer une certaine légitimité et importance démocratique.
La question du rapport entre démocratie et défense des libertés numériques est en effet plus complexe que ne le suggère D. Golumbia. Le propre des mouvements de défense des libertés numériques a été de ressaisir dans le vocabulaire classique du libéralisme politique des pratiques technologiques : le fait de pouvoir se connecter librement à Internet dans sa globalité, d’accéder au code source des logiciels ou de chiffrer ses communications de bout en bout. Certaines possibilités technologiques en sont ainsi venues à être considérées comme métapolitiques, c’est-à-dire comme des conditions pour l’exercice de la démocratie et, par voie de conséquence, comme devant être soustraites au champ de la décision démocratique elle-même. Cela a produit un effet de fermeture, bien perçu par D. Golumbia. Comment contester le déploiement de certaines technologies quand celles-ci sont présentées comme le nouveau socle de l’espace public démocratique ? Comment mettre en balance le développement du numérique avec d’autres finalités sociales et environnementales que ce développement menace, lorsque l’accès à ces technologies est posé comme une liberté fondamentale ?
L’ouvrage de D. Golumbia montre bien ce qui a été perdu à ne pas poser de telles questions. Il néglige cependant le fait que les libertés numériques, dans une société devenue de facto indissociable de l’informatique, représentent aussi des moyens pour la société civile de résister à l’État. Or, la capacité des individus et des collectifs à se protéger contre certaines dérives autoritaires du pouvoir ne peut pas être considérée comme superfétatoire en démocratie — particulièrement dans le contexte actuel.
La gauche et le numérique
Le livre de D. Golumbia interroge finalement le rapport de la gauche démocratique, sociale et écologiste au numérique. Cette question est abordée brièvement dans l’épilogue. L’auteur y critique la « prolifération » (p. 401) de ces technologies. Il défend la nécessité de les réglementer plus fermement, voire d’abolir certaines d’entre elles, comme les grands réseaux sociaux commerciaux et les outils qui permettent la collecte et le traitement de données biométriques. Ces propositions ne sont guère éloignées de celles défendues par certains universitaires et intellectuels, à l’origine de la renaissance aux États-Unis d’un courant néo-luddite
Qu’en est-il en France ? Les analyses développées dans Cyberlibertarianism y sont en partie transposables. La France a, elle aussi, ses essayistes cyberlibertariens et réactionnaires, comme Laurent Alexandre, dont les accointances avec l’extrême droite ont été documentéesMultitudes, qui a contribué dès le début des années 2000 à familiariser un public extérieur au champ informatique à des questions comme le logiciel libre, le chiffrement des communications et les communs numériques. Historiquement animée par des représentants du courant post-opéraïste, Multitudes a été un espace intellectuel où ont convergé rejet de l’État-nation et enthousiasme pour le numérique. Il en a résulté des analyses, qui ont souvent insisté sur l’importance des technologies pour renverser les structures sociales oppressives.Multitudes, Yves Citton, suggérait récemment que le succès de Trump tenait à l’incapacité de la gauche « à entendre la proposition d’un accélérationnisme progressiste
Pour qui a lu Cyberlibertarianism, de tels propos rappellent les illusions critiquées par D. Golumbia. L’idée selon laquelle un « accélérationnisme progressiste » serait la meilleure manière de lutter contre l’accélérationnisme réactionnaire de D. Trump et de la Silicon Valley néglige le fait que les finalités politiques ne peuvent être dissociées des moyens technologiques. À l’heure où les États-Unis sont lancés dans une folle fuite en avant en matière d’IA (une dynamique qui mêle investissements colossaux dans de nouvelles infrastructures, dérégulation totale du secteur et volonté d’accaparement de ressources stratégiques partout dans le monde), la gauche sociale et écologiste ne peut plus soutenir que cette accélération serait susceptible de servir les objectifs qui sont les siens. La dynamique technologique en cours est indissociable de la concentration du pouvoir du capital, du recul de la démocratie, de la destruction des solidarités, de l’aggravation du réchauffement climatique et de l’effondrement de la biodiversité. Les accélérationnistes, qu’ils soient de droite ou de gauche, évoquent les différentes facettes du cyberlibertarianisme. Ils ont en commun une foi irraisonnée dans le progrès technique et une réticence à réguler par la loi le déploiement des technologies numériques. Rompre avec ces dogmes paraît aujourd’hui pour le moins nécessaire. Cela ne nous dit pas, en revanche, que faire des usages et des infrastructures légués par trente années d’enthousiasme transpartisan pour Internet, et que préserver des luttes pour les libertés numériques qui ont rythmé cette histoire.
Photographie de couverture – Wendelin Jacober, CC0, via Wikimedia Commons
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci ❤️ !
Soutenir la revue Terrestres