ACCÈS LIBRE
05.09.2025 à 10:38
La Palestine, l’impérialisme et la catastrophe climatique
Penser ensemble Gaza et le climat ? Oui, car tout se tient comme le défend ici Hamza Hamouchene, qui retrace l’écocide au long cours derrière le génocide en cours. Après la destruction de l’agriculture et l’accaparement de l’eau, les projets énergétiques d’Israël jettent une lumière crue sur l’impérialisme extractiviste à l’œuvre dans la logique coloniale.
L’article La Palestine, l’impérialisme et la catastrophe climatique est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (13420 mots)
Cet article est basé sur un chapitre du livre collectif Rising for Palestine : Africans in Solidarity for Decolonisation and Liberation (« Se soulever pour la Palestine : les Africain·es solidaires de la décolonisation et de la libération »), édité par Raouf Farah et Suraya Dadoo, à paraître aux éditions Pluto Press début 2026.
À première vue, il peut sembler inapproprié, voire déplacé, d’aborder les enjeux climatiques et écologiques alors qu’un génocide se déroule actuellement à Gaza. Mais il ne s’agit pas seulement d’un génocide ; on assiste également à un écocide, voire à ce que certain·es décrivent comme un holocide, c’est-à-dire l’anéantissement délibéré d’un tissu social et écologique dans son intégralité. La bande de Gaza est jonchée de plus de 40 millions de tonnes de débris et de matériaux dangereux, qui recouvrent pour la plupart des restes de corps humains. Au début de l’année 2024, une grande partie des terres agricoles de Gaza était déjà ravagée, après que les vergers, les serres et les cultures de subsistance ont été anéantis par les bombardements incessants. Les oliveraies et les fermes ne sont plus qu’un tas de terre et de poussière, les munitions et les toxines contaminent les sols et les eaux souterraines, tandis que l’eau de mer au large de Gaza est saturée d’eaux usées et de déchets, après qu’Israël a coupé l’alimentation en électricité et détruit les stations d’épuration.
Saisir l’ampleur de la dévastation écologique que génère le génocide commis par Israël permet de mettre en évidence les nombreuses interconnexions entre la crise climatique et écologique et la lutte pour la libération de la Palestine. Il ne peut y avoir de véritable justice climatique à l’échelle mondiale sans la libération du peuple palestinien, de même que cette lutte de libération est intrinsèquement liée à la survie de la terre et de l’humanité.
Les propos qui vont suivre cherchent à démontrer que la destruction des écosystèmes opérée par Israël est en lien direct avec la violence coloniale que l’État hébreu déploie en Palestine, et qui a atteint son paroxysme avec le génocide en cours. Nous cherchons ici à démontrer que les dommages environnementaux ont constitué, dès le départ, un aspect essentiel du système de domination coloniale sioniste, et comment ces dégradations ont constitué un outil pour contrôler et anéantir. Par la suite, la présente analyse abordera des enjeux cruciaux tels que la vulnérabilité climatique disproportionnée imposée aux Palestinien·nes, le déploiement par Israël de stratégies d’éco-blanchiment et d’éco-normalisation pour camoufler sa stratégie d’occupation et d’apartheid, ainsi que l’écocide en cours à Gaza et la place d’Israël dans le régime du capitalisme fossile mondial. Enfin, nous évoquerons la résistance du peuple palestinien à travers des pratiques enracinées dans le respect de la terre et des cultures, qui promeuvent non seulement un rejet de la domination mais également une conception particulière de la justice environnementale, ancrée dans les luttes de libération.
Orientalisme environnemental
Israël a toujours décrit la Palestine d’avant 1948 comme un territoire vide et désertique, contrastant avec l’oasis florissante promise par la création de l’État d’Israël. Ce discours environnemental raciste dépeint les peuples autochtones de Palestine comme des sauvages qui négligent, voire détruisent les terres sur lesquelles ces populations vivent depuis des millénaires. Cette perspective environnementale n’est pas nouvelle, ni même propre au colonialisme israélien. En invoquant le concept d’« orientalisme environnemental », la géographe Diana K. Davis souligne que dans l’imaginaire anglo-européen du 19ᵉ siècle, les milieux naturels dans le monde arabe ont souvent été représentés comme « dégradés d’une certaine façon », ce qui impliquait la nécessité d’une intervention pour les améliorer, les restaurer, les normaliser et les réparer1.
L’idéologie sioniste de la Rédemption de la terre se reflète dans le discours construit autour des projets de boisement menés par le Fonds national juif (FNJ), une organisation parapublique israélienne. Le FNJ a cherché à recouvrir les vestiges matériels et symboliques des 86 villages palestiniens détruits lors de la Nakba en ayant recours au boisement2. Sous couvert de politiques de conservation, l’organisation a instrumentalisé la plantation d’arbres pour dissimuler la réalité des déplacements massifs de populations liés à la colonisation, du nettoyage ethnique, de la destruction de l’environnement et de la dépossession, tout en créant de nouveaux paysages destinés à remplacer les paysages autochtones.
La chercheuse Ghada Sasa décrypte avec brio ces pratiques éco-coloniales, qu’elle décrit comme relevant d’un colonialisme « vert », c’est-à-dire l’appropriation par Israël de concepts environnementalistes pour éliminer la population palestinienne autochtone et accaparer ses ressources. Elle décrit comment l’État hébreu utilise les classifications et appellations de préservation de l’environnement (parcs nationaux, forêts et réserves naturelles) pour justifier l’accaparement des terres et empêcher le retour des réfugié·es palestinien·nes, dans le but de vider la Palestine de son essence historique pour judaïser et européaniser son territoire, en effaçant l’identité palestinienne et en éliminant la résistance à l’oppression coloniale. Ces pratiques servent également à « écologiser » l’image de l’État d’Israël dans un contexte d’apartheid3.
Qu’il s’agisse de campagnes de boisement ou de l’accaparement des ressources en eau, les atteintes aux milieux naturels commises par Israël en Palestine illustrent comment la relation à la nature s’inscrit dans une logique coloniale plus vaste.
L’eau fait partie des ressources qu’Israël accapare en Palestine. Peu après la création de l’État d’Israël en 1948, le FNJ a asséché le lac Hula et les zones humides environnantes dans le nord de la Palestine historique4, au prétexte que cela était nécessaire pour agrandir les surfaces agricoles. Or, non seulement le projet n’a pas permis de dégager des terres agricoles « productives » pour les colons juif·ves européen·nes nouvellement arrivé·es, mais cela a également causé des dommages environnementaux considérables, en décimant des espèces végétales et animales essentielles4 et en polluant les eaux se déversant dans la mer de Galilée (lac de Tibériade), ce qui a eu un impact sur la qualité de l’eau du fleuve Jourdain en aval5. À peu près à la même période, la compagnie nationale des eaux israélienne Mekorot a commencé à détourner les eaux du Jourdain vers les colonies et les villes côtières israéliennes, ainsi que vers les colonies juives installées dans le désert du Naqab (Néguev)6. À la suite de l’occupation par Israël de la Cisjordanie et de la bande de Gaza en 1967, le pompage des eaux du Jourdain s’est intensifié. Aujourd’hui, le fleuve n’est plus qu’un ruisseau pollué par les déchets et les eaux usées, en particulier sa section en aval7.

Qu’il s’agisse de campagnes de boisement ou de l’accaparement des ressources en eau, les atteintes aux milieux naturels commises par Israël en Palestine illustrent comment la relation à la nature s’inscrit dans une logique coloniale plus vaste. Le colonialisme de peuplement est une forme de domination qui vient violemment perturber les relations des peuples avec leur environnement, en ce qu’il « fragilise stratégiquement la survivance collective des communautés autochtones sur leurs terres8 ». Vu sous cet angle, le colonialisme de peuplement s’apparente à une domination écologique, car il efface les relations essentielles qu’entretiennent les peuples autochtones avec leurs milieux naturels pour imposer des modèles écologiques coloniaux. Comme le fait remarquer Kyle Whyte, « les populations de colons s’efforcent de créer leurs propres écosystèmes en éradiquant les écosystèmes autochtones, ce qui exige souvent d’introduire d’autres ressources et d’autres êtres vivants9 ». À cet égard, la chercheuse Shourideh Molavi affirme elle aussi que la violence coloniale est « avant tout une violence écologique », une tentative de remplacer un écosystème par un autre. Ce point de vue est partagé par l’architecte Eyal Weizman, qui soutient que « l’environnement constitue l’un des instruments du racisme colonial, sur lequel on s’appuie pour accaparer les terres, renforcer les lignes de siège et perpétuer la violence10 ». Weizman observe qu’en Palestine, « la Nakba revêt également une dimension environnementale moins connue, à savoir le bouleversement global de l’environnement, de la météo, des sols ; la perturbation du climat local, de la végétation et de l’atmosphère. La Nakba est un processus de changement climatique imposé par la colonisation.10 »
Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Prise de terre et Terre promise : sur l’État colonial d’Israël » d’Ali Zniber, août 2024.
La crise climatique en Palestine
Dans ce contexte où l’État israélien est responsable de la dégradation des milieux naturels en Palestine, la population palestinienne est aujourd’hui confrontée à l’intensification de la crise climatique à l’échelle mondiale. D’ici la fin du siècle, les précipitations annuelles dans la région pourraient diminuer de 30 % par rapport à la période 1961-199011. Le groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) prévoit une augmentation des températures de 2,2 à 5,1 °C, ce qui entraînera des perturbations climatiques aux effets potentiellement catastrophiques, notamment une accélération de la désertification12. L’agriculture, qui constitue la clé de voûte de l’économie palestinienne, s’en trouvera profondément impactée. Le raccourcissement des saisons de croissance des cultures et l’augmentation des besoins en eau entraîneront une hausse des prix des denrées alimentaires, ce qui constitue une menace pour la sécurité alimentaire.
La vulnérabilité de la population palestinienne face au changement climatique doit être comprise dans le contexte de la violence coloniale qu’elle subit depuis un siècle : occupation, apartheid, dépossessions, déplacements de populations, oppression systémique et génocide. Comme l’a souligné Zena Agha13, ces violences exercées sur le temps long expliquent pourquoi les conséquences de la crise climatique affecteront, et affectent déjà les populations israélienne et palestinienne des Territoires palestiniens occupés (TPO) de manière profondément asymétrique. Ainsi, tandis que l’occupation continue d’empêcher les Palestinien·nes d’accéder aux ressources et de développer des infrastructures et des stratégies d’adaptation, Israël fait partie des pays les moins vulnérables au changement climatique dans la région, et des mieux préparés pour y faire face. Ainsi, en accaparant, pillant et en exerçant un contrôle sur la plupart des ressources disponibles en Palestine, des terres à l’eau en passant par l’énergie, Israël est en mesure de développer des technologies susceptibles d’atténuer certains des effets du changement climatique, aux dépens des travailleur·euses palestinien·nes et avec le soutien actif des puissances impérialistes. Pour résumer, les capacités d’adaptation au changement climatique sont profondément asymétriques entre Israël et la Palestine, et ces capacités sont déterminées en fonction de la race, de la religion, du statut juridique et des hiérarchies coloniales. On parle alors d’apartheid climatique, ou éco-apartheid14.
La vulnérabilité de la population palestinienne face au changement climatique doit être comprise dans le contexte de la violence coloniale qu’elle subit depuis un siècle : occupation, apartheid, dépossessions, déplacements de populations, oppression systémique et génocide.
La question de l’accès à l’eau illustre parfaitement cette situation profondément inégalitaire. Contrairement aux pays voisins, la région située entre le fleuve Jourdain et la mer Méditerranée ne souffre pas de pénuries d’eau. Pourtant, les populations palestiniennes de Cisjordanie et de Gaza sont affectées de manière chronique par une crise de l’accès à l’eau, en raison de la primauté donnée aux populations juives imposée par l’occupation, et de l’apartheid pratiqué autour des infrastructures hydrauliques. Depuis le début de l’occupation de la Cisjordanie en 1967, l’État d’Israël a monopolisé les sources d’eau douce, une pratique légitimée par les accords d’Oslo II en 1995, qui ont accordé à Israël le contrôle d’environ 80 % des ressources en eau présentes sur le territoire cisjordanien. Alors qu’Israël a perfectionné ses technologies de gestion des eaux et généralisé l’accès à l’eau de part et d’autre de la « Ligne verte », il devient de plus en plus difficile pour les Palestinien·nes d’accéder aux ressources en eau en raison de l’apartheid, de l’accaparement des terres et des dépossessions. En effet, l’État hébreu contrôle les sources d’eau douce, impose des quotas d’approvisionnement stricts à la population palestinienne, interdit tous les projets d’aménagement, tels que la création de puits, et a détruit à de nombreuses reprises des infrastructures d’approvisionnement en eau mises en place par les Palestinien·nes. En conséquence, la population juive israélienne installée entre le Jourdain et la Méditerranée dispose d’abondantes ressources en eau, grâce à l’accaparement et aux technologies de dessalement de l’eau de mer, tandis que la population palestinienne est confrontée à des pénuries chroniques qui s’aggraveront sous l’effet du changement climatique.

Les disparités sont frappantes : la consommation quotidienne d’eau par habitant·e en Israël était de 247 litres en 2020, soit plus de trois fois les 82,4 litres dont dispose quotidiennement chaque Palestinien·ne de Cisjordanie15. Dans les territoires occupés, 600 000 colons israélien·nes illégaux utilisent six fois plus d’eau que les 3 millions de Palestinien·nes. En outre, dans les colonies israéliennes illégales sont consommés jusqu’à 700 litres d’eau par personne et par jour, notamment pour entretenir des équipements de luxe comme les piscines et les gazons, tandis que certaines communautés palestiniennes, qui ne sont pas rattachées au réseau de distribution d’eau, survivent avec à peine 26 litres par personne et par jour. Ceci est proche de la moyenne dans les zones sinistrées et bien moins que la quantité d’eau suffisante pour les besoins personnels et domestiques, soit entre 50 et 100 litres d’eau par personne et par jour, préconisés par les Nations Unies et l’OMS16. En 2015, seuls 50,9 % des ménages cisjordaniens bénéficiaient d’un accès quotidien à l’eau, tandis qu’en 2020, l’ONG israélienne B’Tselem estimait que seulement 36 % des Palestinien·nes de Cisjordanie jouissaient d’un accès à l’eau stable tout au long de l’année, avec un approvisionnement en eau disponible moins de 10 jours par mois pour 47 % d’entre elles et eux.
Dans les territoires occupés, 600 000 colons israélien·nes illégaux utilisent six fois plus d’eau que les 3 millions de Palestinien·nes.
La situation est pire encore à Gaza. Même avant le génocide actuel, seuls 30 % des ménages disposaient d’un accès quotidien à l’eau, un chiffre qui a fortement chuté depuis le début de l’offensive israélienne17. L’État d’Israël ne se contente pas de bloquer l’approvisionnement en eau propre et en quantité suffisante dans l’enclave de Gaza, il empêche également la construction ou la réparation d’infrastructures de gestion des eaux en bloquant l’acheminement des matériaux nécessaires. Les conséquences sont dramatiques : avant le début du génocide, 90 à 95 % de l’eau à Gaza était impropre à la consommation et inutilisable pour l’irrigation18. La pollution de l’eau était à l’origine de plus de 26 % des maladies signalées et constituait l’une des premières causes de mortalité infantile, responsable de plus de 12 % des décès d’enfants gazaouis19. En février 2025, alors que la violence génocidaire se poursuit et que la famine s’aggrave, Oxfam estimait l’eau disponible à Gaza à 5,7 litres d’eau par jour et par personne20.
Dans un tel contexte de restrictions de l’accès à l’eau, les impacts du changement climatique sur la qualité et la disponibilité de l’eau seront dévastateurs, en particulier à Gaza.
Éco-normalisation et greenwashing à l’ère des énergies renouvelables
Face à l’escalade des tensions liées à l’eau, à l’environnement et au climat auxquelles sont confronté·es les Palestinien·nes, Israël se présente pourtant comme le champion des technologies vertes, du dessalement d’eau de mer et des projets d’énergie renouvelable, déployés en Palestine occupée et ailleurs. En se targuant d’être un pays développé et engagé pour le climat au milieu d’un Moyen-Orient aride et régressif, l’État hébreu utilise son image « écolo » pour justifier sa politique coloniale de dépossession, blanchir son régime de colonisation et d’apartheid et pour occulter les crimes de guerre commis contre le peuple palestinien. Les accords d’Abraham signés avec les Émirats arabes unis (EAU), Bahreïn, le Maroc et le Soudan en 2020 ont permis de renforcer cette image, de même que d’autres accords conclus pour la mise en œuvre conjointe de projets environnementaux autour des énergies renouvelables, de l’agro-industrie et de l’eau. Il s’agit d’une manifestation de l’éco-normalisation, qui consiste à utiliser une forme d’« écologisme » pour blanchir et normaliser les oppressions et injustices environnementales engendrées dans le monde arabe et ailleurs21.
Officialisée en décembre 2020, la normalisation des relations entre le Maroc et Israël est issue d’un accord entre deux puissances occupantes et facilité par leur protecteur impérial (les États-Unis, sous la houlette de Donald Trump), par lequel Israël et les États-Unis ont également reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Depuis lors, les investissements et les accords réalisés par Israël au Maroc se sont multipliés, en particulier dans les secteurs de l’agroalimentaire et des énergies renouvelables.
Le 8 novembre 2022, lors de la COP 27 organisée à Charm el-Cheikh, la Jordanie et Israël ont signé un protocole d’accord sous l’égide des Émirats arabes unis, afin de poursuivre une étude de faisabilité pour deux projets interconnectés, nommés Prosperity Blue et Prosperity Green, qui constituent les deux pôles du projet global Prosperity. En vertu de cet accord, la Jordanie achètera 200 millions de mètres cubes d’eau par an à une station israélienne de dessalement d’eau de mer située sur la côte méditerranéenne, dans le cadre du projet Prosperity Blue. Cette station sera alimentée par une centrale solaire de 600 mégawatts (MW) installée en Jordanie (projet Prosperity Green), qui sera construite par Masdar, une entreprise publique émiratie spécialisée dans les énergies renouvelables. La rhétorique philanthropique déployée autour du projet Prosperity Blue masque la réalité du pillage des ressources en eau en Palestine orchestré par Israël depuis des dizaines d’années, comme nous l’avons vu plus haut, et permet à l’État hébreu de nier sa responsabilité dans les pénuries d’eau qui touchent toute la région, tout en se présentant comme un agent de la protection de l’environnement et de la maîtrise des technologies liées à l’eau. L’entreprise Mekorot, actrice majeure des activités de dessalement d’eau de mer en Israël, se positionne comme un leader mondial dans ce domaine, en partie grâce à la propagande israélienne d’éco-blanchiment. Les bénéfices générés par l’entreprise financent à la fois ses propres opérations, ainsi que l’apartheid de l’eau exercé par le gouvernement israélien à l’égard de la population palestinienne.

En août 2022, la Jordanie a rejoint le Maroc, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, l’Égypte, Bahreïn et Oman en signant un autre protocole d’accord avec deux entreprises israéliennes de production d’énergie, Enlight Green Energy (ENLT) et NewMed Energy, afin de mettre en œuvre des projets d’énergie renouvelable dans toute la région, notamment dans les domaines de l’énergie solaire, de l’énergie éolienne et du stockage de l’énergie. Ces initiatives renforcent l’image d’Israël en tant que plaque tournante de l’innovation en matière d’énergies renouvelables, tout en lui permettant de poursuivre son projet de colonisation et d’étendre son influence géopolitique dans la région. L’objectif est d’intégrer Israël aux sphères énergético-économiques du monde arabe en lui conférant une position dominante, et en créant de nouvelles dépendances qui renforcent la dynamique de normalisation et présentent l’État hébreu comme un partenaire indispensable. Face à l’aggravation des crises écologique et climatique, les pays qui dépendent de l’énergie, de l’eau ou des technologies contrôlées par Israël pourraient en venir à considérer que la lutte de libération des Palestinien·nes passe au second plan, cherchant avant tout à sécuriser leur propre accès à ces ressources.
Plutôt que de considérer le monde arabe comme un ensemble homogène, il est essentiel d’identifier les hiérarchies et les inégalités internes qui la structurent. La région du Golfe fonctionne comme une force semi-périphérique, voire sous-impérialiste.
L’implication d’entreprises des pays du Golfe, telles que la société saoudienne ACWA Power et l’émiratie Masdar dans ces projets coloniaux met en évidence une caractéristique structurelle majeure du monde arabe. Plutôt que de considérer la région comme un ensemble homogène, il est essentiel d’identifier les hiérarchies et les inégalités internes qui la structurent. La région du Golfe fonctionne comme une force semi-périphérique, voire sous-impérialiste. Non seulement les pays du Golfe sont nettement plus riches que leurs voisins, mais ils participent également à la capture et la ponction de la plus-value à l’échelle régionale, reproduisant ainsi les dynamiques d’extraction, de marginalisation et d’accumulation par dépossession qui caractérisent les relations entre les centres impériaux et leurs périphéries.
Croisade contre la nature et écocide à Gaza
Les crimes horribles qu’Israël commet actuellement contre la population et les milieux naturels à Gaza sont le prolongement d’une offensive de longue date qui continue de s’intensifier, comme le souligne Shourideh C. Molavi dans son livre Environmental Warfare in Gaza. En rejetant l’idée que l’environnement ne serait que le décor inerte du conflit, Molavi montre comment les pratiques coloniales de l’État d’Israël instrumentalisent les composantes environnementales pour mener une guerre militaire à l’intérieur, et autour de la bande de Gaza10. Dans cette guerre, la destruction des zones résidentielles va de pair avec la dévastation des espaces agricoles à Gaza.
En ravageant des terres, en imposant aux agriculteur·trices palestinien·nes des restrictions sur les types et la taille des cultures autorisées, et en éradiquant pratiquement toutes les oliveraies et les plantations traditionnelles d’agrumes, Israël déploie à Gaza une violence d’ordre écologique. Outre les incursions et les massacres à répétition, les bulldozers israéliens traversent régulièrement la bande de Gaza pour décimer les cultures et détruire les serres agricoles. Comme cela a été documenté par le groupe de recherche londonien Forensic Architecture, l’État hébreu a petit à petit étendu la superficie de son no-man’s land militarisé, dite « zone tampon », le long de la frontière orientale de Gaza.
Depuis 2014, Israël a également recours à un arsenal chimique pour pulvériser régulièrement des herbicides toxiques au moyen d’avions pulvérisateurs qui détruisent les plantations agricoles palestiniennes sur de vastes portions de territoire dans l’enclave de Gaza22. Le ministère palestinien de l’agriculture estime qu’entre 2014 et 2018, les pulvérisations aériennes d’herbicides ont endommagé plus de 13 kilomètres carrés de terres agricoles à Gaza23. Mais les impacts de ces produits chimiques ne se limitent pas aux cultures ; en effet, l’ONG palestinienne de défense des droits humains Al-Mezan a averti que le bétail consommant des plantes contaminées chimiquement pourrait représenter un danger pour la santé humaine via la chaîne alimentaire24.
À Gaza, les colonisateur·trices sont engagé·es depuis longtemps dans un processus de désertification en transformant des terres agricoles autrefois fertiles en un espace aride et désolé, amputé de sa végétation.
Avant même le début du génocide, ces pratiques avaient ravagé des parcelles entières de terres arables, privant les agriculteur·trices gazaoui·es de leurs moyens de subsistance tout en offrant à l’armée israélienne une meilleure visibilité pour cibler à distance et mener des attaques meurtrières25. En conséquence, et contrairement aux vastes cultures irriguées de fraises, de melons, d’herbes aromatiques et de choux qui prospèrent dans les colonies israéliennes avoisinantes, les terres agricoles de Gaza semblent stériles et sans vie, non pas par nature mais à dessein. Au lieu de « faire fleurir le désert », les colonisateur·trices sont engagé·es dans un processus de désertification en transformant des terres agricoles autrefois fertiles en un espace aride et désolé, amputé de sa végétation.
C’est dans ce contexte de reconfiguration brutale du paysage biopolitique de Gaza (et de la Palestine historique dans son ensemble) par la colonisation qu’a eu lieu l’attaque du Hamas du 7 octobre. Depuis, les crimes commis par Israël à Gaza peuvent désormais être qualifiés d’écocide. L’étendue des dommages sur le territoire n’a pas encore été documentée, et les statistiques sont rapidement dépassées à mesure que l’État hébreu perpétue le génocide. On peut néanmoins citer ici quelques faits établis.

Comme le montre le groupe de recherche Forensic Architecture, dont les analyses s’appuient sur des images satellite, depuis le mois d’octobre 2023, les forces israéliennes ont systématiquement pris pour cible des vergers et des serres, dans une volonté délibérée de commettre un écocide et d’aggraver la famine catastrophique qui sévit actuellement à Gaza, et qui s’inscrit dans une stratégie plus large consistant à priver la population palestinienne des ressources dont elle a besoin pour survivre25. En mars 2024, environ 40 % des terres de Gaza utilisées pour la production agro-alimentaire avaient été ravagées, tandis que près d’un tiers des serres avaient été détruites, un chiffre qui s’élève à 90 % dans le nord et environ 40 % autour de la ville de Khan Younis25, au sud de la bande de Gaza. En outre, l’analyse des images satellite transmises au journal The Guardian en mars 2024 montre qu’à cette date, près de la moitié de la couverture arborée et des terres agricoles de Gaza avaient été anéanties, notamment par l’usage illégal de phosphore blanc. Comme le décrit un article du Guardian, les oliveraies et les fermes ont été réduites à des tas de poussière, les munitions et les toxines contaminent les sols et les eaux souterraines, et l’air est pollué par la fumée et les particules toxiques26. Il est très probable que la situation se soit considérablement aggravée depuis la rédaction de ces articles.
La rupture de l’approvisionnement en eau constitue l’une des facettes les plus meurtrières de l’écocide perpétré par Israël à Gaza. Avant même le début du génocide, environ 95 % des ressources en eau de l’unique nappe phréatique de Gaza étaient contaminées et impropres à la consommation ou à l’irrigation, conséquence du blocus inhumain et des attaques régulières commises par Israël pour empêcher la création et la réparation d’infrastructures de gestion des eaux et d’usines de dessalement. Depuis octobre 2023, les installations et les infrastructures hydrauliques à Gaza ont été totalement détruites, ce qui a entraîné une rupture de l’approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées. Cette situation provoque de nombreux cas de déshydratation et des maladies, comme la typhoïde.
Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « En Palestine, « l’huile qu’on attend un an, les soldats la jettent en un instant » » par le Forum palestinien d’agroécologie, février 2025.
Outre les destructions directes causées par les attaques militaires, le manque de combustible a contraint les habitant·es de Gaza à abattre des arbres pour pouvoir cuisiner ou se chauffer, ce qui vient aggraver la raréfaction des arbres dont souffre actuellement le territoire. En parallèle, même les sols qui subsistent sont menacés par les bombardements israéliens et les destructions. Selon le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), bombarder des zones peuplées de manière intensive génère une contamination des sols et des eaux souterraines sur le long terme, à cause de l’afflux de munitions et parce que les bâtiments effondrés libèrent des substances dangereuses telles que l’amiante, des produits chimiques industriels et du carburant dans l’air, les sols et les eaux souterraines27. En juillet 2024, le PNUE estimait que les bombardements avaient généré plus de 40 millions de tonnes de débris et de substances nocives, recouvrant pour la plupart des restes humains. Il faudra 15 ans pour déblayer les décombres de Gaza, pour un coût qui pourrait s’élever à plus de 600 millions de dollars28.
L’écocide perpétré par Israël à Gaza s’étend jusqu’à la mer et au-delà, la côte méditerranéenne étant désormais saturée d’eaux usées et de déchets. Après qu’Israël a coupé l’approvisionnement en carburant de Gaza après le 7 octobre, les coupures d’électricité ont empêché le pompage des eaux usées vers les stations d’épuration, et 100 000 mètres cubes par jour d’eaux usées ont été déversés dans la Méditerranée. Outre la destruction des infrastructures sanitaires, les attaques contre les hôpitaux et le personnel de santé, et les restrictions sévères imposées à l’entrée de fournitures médicales sur le territoire, cette situation a créé les conditions « parfaites » propices à l’apparition de maladies infectieuses, telles que le choléra, et à la résurgence de maladies autrefois éradiquées par la vaccination, comme la polio29.
La longue liste des destructions décrites dans les paragraphes précédents ont conduit de nombreux expert·es et observateur·trices à affirmer que les attaques répétées d’Israël contre les écosystèmes à Gaza ont rendu le territoire invivable.
« Le génocide et les actes barbares perpétrés contre le peuple palestinien sont ce qui attend ceux qui fuient les Suds à cause de la crise climatique… Ce dont nous sommes témoins à Gaza est une répétition du spectacle de l’avenir. »
Gustavo Petro, président de la Colombie
La Palestine contre l’impérialisme américain et le capitalisme fossile mondial
Lors de la COP 28, sommet sur le climat qui s’est tenu à Dubaï en décembre 2023, le président colombien Gustavo Petro a déclaré que « Le génocide et les actes barbares perpétrés contre le peuple palestinien sont ce qui attend ceux qui fuient les Suds à cause de la crise climatique… Ce dont nous sommes témoins à Gaza est une répétition du spectacle de l’avenir.30 » Comme le dit si bien le président colombien, le génocide à Gaza est un avertissement de ce qui nous attend si nous ne nous organisons pas et ne résistons pas. L’empire et ses classes dirigeantes sont prêts à sacrifier des millions de personnes noires, basanées et blanches de la classe ouvrière pour garantir l’accumulation du capital et perpétuer leur domination. Cela se reflète clairement dans le refus de ces élites, lors de la COP 29 à Bakou, de s’engager en faveur de l’action climatique tout en continuant à financer le génocide à Gaza, de même que dans l’apartheid autour de l’accès aux vaccins lors de la pandémie de COVID-19.
Cela révèle également comment la guerre et les complexes militaro-industriels alimentent la crise climatique. En effet, l’armée américaine est l’institution qui émet le plus de CO2 au monde31. Pour ce qui est de la guerre génocidaire à Gaza, les émissions générées par l’État d’Israël ont dépassé, en deux mois seulement, les émissions annuelles de carbone d’une vingtaine des pays les plus vulnérables au changement climatique, et sont causées en grande partie par les vols cargo de l’armée américaine et la fabrication d’armes32. Les États-Unis ne se contentent pas de faciliter un génocide, ils contribuent également activement à l’écocide commis en Palestine.

Mais le lien entre la première puissance mondiale et ce qui se passe en Palestine est encore plus profond. La lutte pour la libération des Palestinien·nes est indissociable de la résistance contre le capitalisme fossile et l’impérialisme américain. La Palestine est située au cœur du Moyen-Orient, une région qui occupe une place centrale dans l’économie capitaliste mondiale, non seulement en raison des flux commerciaux et financiers qu’elle concentre, mais aussi car celle-ci constitue le noyau du système mondial des combustibles fossiles, assurant environ 35 % de la production de pétrole à l’échelle mondiale33. En parallèle, Israël cherche à devenir une plaque tournante régionale de la production d’énergie, notamment grâce aux gisements de gaz comme les champs de Tamar et Leviathan en Méditerranée, pour lesquels le pays a accordé de nouvelles licences d’exploration gazière, quelques semaines seulement après le début de sa guerre génocidaire à Gaza.
L’hégémonie américaine au Moyen-Orient, et ses effets sur le système du capitalisme fossile mondial, repose sur deux piliers : l’État d’Israël et les monarchies du Golfe. Le premier, décrit par l’ancien secrétaire d’État américain Alexander Haig comme « le plus grand porte-avions américain au monde, impossible à couler », représente le point d’ancrage de l’empire américain dans la région en participant au contrôle des ressources en combustibles fossiles, ce qui ouvre la voie à l’innovation en matière de technologies de surveillance et d’armement. Son intégration dans l’économie de la région s’opère par le biais de secteurs tels que l’agro-industrie, les énergies et la désalinisation. Pour renforcer leur domination, les États-Unis et leurs alliés s’emploient activement à normaliser la position d’Israël dans la région. Ce processus a débuté avec les accords de Camp David de 1978 et le traité de paix signé entre Israël et la Jordanie en 1994, suivis par les accords d’Abraham conclus en 2020 avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc. Avant le 7 octobre, la normalisation des relations entre Israël et l’Arabie saoudite était imminente, dans le cadre d’un accord conçu sous l’égide des États-Unis qui aurait anéanti la cause palestinienne. Les actions de la résistance palestinienne ont perturbé ces plans.
La libération de la Palestine doit être un enjeu central des luttes en faveur de l’environnement et de la justice climatique à l’échelle mondiale.
Tout cela démontre que la libération du peuple palestinien ne relève pas simplement d’une question de morale ou de droits humains ; il s’agit aussi d’une confrontation directe avec l’impérialisme américain et le système du capitalisme fossile. C’est pourquoi la libération de la Palestine doit être un enjeu central des luttes en faveur de l’environnement et de la justice climatique à l’échelle mondiale. Cela implique de s’opposer à la normalisation d’Israël et de soutenir le mouvement Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS), notamment dans le domaine des technologies vertes et des énergies renouvelables. Il ne peut y avoir de justice climatique sans démanteler la colonie sioniste d’Israël et renverser les régimes réactionnaires des pays du Golfe. La Palestine est en première ligne sur le front international contre le colonialisme, l’impérialisme, le capitalisme fossile et la suprématie blanche. C’est pourquoi les mouvements pour la justice climatique et les organisations antiracistes et anti-impérialistes doivent soutenir la lutte de libération, et défendre le droit des Palestinien·nes à résister par tous les moyens nécessaires.
Résistance et éco-soumoud
Face au cataclysme qu’elle subit, la population palestinienne continue de résister et de nous inspirer jour après jour par son soumoud (détermination, fermeté). Ce terme a de multiples significations. La chercheuse et militante palestinienne Manal Shqair le définit comme un ensemble de pratiques quotidiennes de résistance et d’adaptation aux difficultés de la vie quotidienne sous la domination coloniale imposée par Israël34. Le terme fait également référence à la persistance du peuple palestinien à demeurer sur ses terres, et à préserver son identité et sa culture face à la dépossession et aux discours qui présentent les colons juif·ves comme la seule population légitime de la région34.
Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Démembrer et pulvériser les corps : sur la guerre d’anéantissement à Gaza » de Suzanne Beth, janvier 2025.
En introduisant le concept d’éco-soumoud, qui renvoie aux actes quotidiens de ténacité des Palestinien·nes qui emploient des moyens écologiques ancrés dans la terre afin de maintenir un lien profond avec celle-ci, les travaux de Manal Shqair nous permettent d’approfondir notre compréhension de la persévérance du peuple palestinien. Cette notion englobe les savoirs autochtones, les valeurs culturelles et les pratiques quotidiennes que les Palestinien·nes mettent en œuvre pour résister à la rupture violente de leur lien avec la terre. L’éco-soumoud repose sur l’idée que les seules réponses viables aux crises écologique et climatique sont celles qui soutiennent la quête de justice, de souveraineté et d’autodétermination du peuple palestinien, en mettant fin au régime israélien d’occupation et d’apartheid qui, en tant que colonie de peuplement, doit être démantelé. La pratique de l’éco-soumoud est ancrée dans la foi qu’il est possible de vaincre le colonialisme israélien, et véhicule l’aspiration inébranlable des populations colonisées à être elles-mêmes maîtresses de leur destin.
La résistance héroïque dont font preuve les Palestinien·nes, qui s’exprime à travers la notion d’éco-soumoud et par un profond attachement à la terre, est une source d’inspiration pour les mouvements progressistes du monde entier, en lutte pour un monde plus juste face à des désastres qui s’accumulent. Pour conclure ce chapitre, on peut citer l’écomarxiste Andreas Malm, qui établit un parallèle poignant entre la résistance du peuple palestinien et la lutte contre le réchauffement climatique :
« Qu’est-ce que le front climatique peut apprendre de la résistance palestinienne ? Que même lorsque la catastrophe est intégrale, implacable et ininterrompue, nous continuons à résister. Même lorsqu’il est trop tard, lorsque tout a été perdu, lorsque les terres ont été saccagées, nous sortons des décombres et nous nous battons. Nous ne cédons pas, nous ne nous rendons pas, nous n’abandonnons pas, car les Palestinien·nes ne meurent pas. Les Palestinien·nes ne seront jamais vaincu·es. Une armée puissante est perdante si elle ne gagne pas, mais une armée de résistance faible est gagnante tant qu’elle ne perd pas. J’espère que la guerre en cours à Gaza se terminera avec une résistance intacte, ce qui serait une victoire. La pérennité de la résistance palestinienne serait en soi une victoire, car nous continuerons à nous battre, quels que soient les désastres que vous déversez sur nous. C’est une source d’inspiration pour le front de lutte contre le changement climatique. En cela, les Palestinien·nes ne se battent pas seulement pour eux-mêmes. Ils et elles se battent pour l’humanité toute entière, pour l’idée d’une humanité qui résiste aux catastrophes, quelle qu’en soient les formes, et qui continue à se battre malgré la supériorité écrasante de ses adversaires. Je pense qu’il y a toutes sortes de raisons d’être solidaire de la résistance palestinienne, pour son propre bien, mais aussi pour le nôtre.35 »
La tâche qui nous attend est très difficile mais, pour répondre à l’appel formulé par Frantz Fanon, nous devons, dans une relative obscurité, découvrir notre mission, la remplir et ne pas la trahir36.
Illustration principale : ©Fourate Chahal El Rekaby.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
Notes
- Davis, D.K. « Imperialism, orientalism, and the environment in the Middle East : history, policy, power and practice », dans Davis et Edmund Burke (eds.), Environmental Imaginaries of the Middle East and North Africa, Athènes (Ohio), Ohio University Press, 2011.
- Galai, Y. « Narratives of redemption : “The international meaning of afforestation in the Israeli Negev” », International Political Sociology 11, n° 3 : 273-291, 2017.
- Sasa, G. « Oppressive pines : Uprooting Israeli green colonialism and implanting Palestinian A’wna », Politics, 43(2), 219-235, 2022.
- « Rehabilitation of the Hula Valley », Water for Israel, KKL-JNF.
- Zeitoun, M. et Dajani, M. « Israel is hoarding the Jordan River – it’s time to share it », The Conversation, 19 décembre 2019.
- Grassroots Palestinian Anti-Apartheid Wall Campaign (2025), « Weaponizing Water For Israel’s Genocide, Apartheid and Ethnic Cleansing ».
- Amnesty International, « L’occupation de l’eau », 2017.
- Molavi, S. C. Environmental Warfare in Gaza : Colonial Violence and New Landscapes of Resistance, Londres, Pluto, 2024.
- Whyte, K. « Settler Colonialism, Ecology, and Environmental Injustice », Environment and Society, 9, 1 (septembre) : 135, 2018.
- Molavi, op. cit.
- Tippmann, R. et Baroni, L. « ClimaSouth Technical Paper N.2. The Economics of Climate Change in Palestine », 2017.
- Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Programme d’assistance au peuple palestinien, Stratégie d’adaptation au changement climatique et programme d’action pour l’Autorité palestinienne, 2010.
- Agha, Z. « Climate Change, the Occupation, and a Vulnerable Palestine », Al-Shabaka, 26 mars 2019.
- Dajani, M. « Challenging Israel’s Climate Apartheid in Palestine », Al-Shabaka, 30 janvier 2022.
- B’Tselem, « Parched : Israel’s policy of water deprivation in the West Bank », mai 2023.
- Voir la page des Nations Unies relative à l’accès à l’eau.
- The Applied Research Institute – Jérusalem (ARIJ), « Water resource allocations in the Occupied Palestinian Territory : Responding to Israeli claims », juin 2012.
- Lazarou, E. « L’eau et le conflit israélo-palestinien », Service de recherche parlementaire européen, 2016. https://www.europarl.europa.eu/
- Kubovich, Y. « Polluted Water Leading Cause of Child Mortality in Gaza, Study Finds », Haaretz, 16 octobre 2018.
- « Moins de 7 % des niveaux d’eau d’avant-guerre sont disponibles à Rafah et dans le nord de Gaza, aggravant une catastrophe sanitaire », Oxfam France, février 2025.
- Cette partie s’inspire dans une large mesure des travaux de Manal Shqair. Pour aller plus loin, voir Shqair, M. « L’éco-normalisation israélo-arabe : Écoblanchiment des colonies de peuplement en Palestine et dans le Jawlan », Transnational Institute, 2023.
- Forensic Architecture, « Herbicidal warfare in Gaza », 19 juillet 2019.
- Gisha, « Closing In : Life and Death in Gaza’s Access Restricted Areas », 2019.
- Al Mezan Center for Human Rights, « Effects of Aerial Spraying on farmlands in the Gaza Strip », 2018 (document pdf).
- Forensic Architecture, « A Cartography of Genocide : Israel’s Conduct in Gaza since October 2023 », 25 octobre 2024.
- Ahmed, K., Gayle, D. et Mousa, A. « « Ecocide in Gaza » : does scale of environmental destruction amount to a war crime ? », The Guardian, 29 mars 2024.
- Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), « Environmental legacy of Explosive weapons in Populated Areas », 5 novembre 2021.
- Al Jazeera, « Clearing Gaza rubble could take 15 years, UN agency says », 15 juillet 2024.
- Ahmed, op. Cit
- Gouvernement de Colombie, « President Petro : The unleashing of genocide and barbarism on the Palestinian people is what awaits the exodus of the peoples of the South unleashed by the climate crisis », 1er décembre 2023.
- Mallinder, L. « “Elephant in the room” : The US military’s devastating carbon footprint », Al Jazeera, 12 décembre 2023.
- Neimark, B., Bigger, P., Otu-Larbi, F., et Larbi, R., « A Multitemporal Snapshot of Greenhouse Gas Emissions from the Israel-Gaza Conflict », 5 janvier 2024.
- BP, BP Statistical Review of World Energy 2022, 71st Edition, 2022 (document pdf).
- Shqair, op. cit. ; Johansson, A. et Vinthagen, S. Conceptualizing Everyday Resistance : A Transdisciplinary Approach, New York, Routledge, 2020 : 149-152.
- Extrait d’une conférence donnée par Andreas Malm à l’Université de Stockholm le 7 décembre 2023, intitulée « On Palestinian and Other Resistance In Times of Catastrophe ».
- Fanon, F. Les damnés de la terre, Éditions Maspero, Paris, 1961.
L’article La Palestine, l’impérialisme et la catastrophe climatique est apparu en premier sur Terrestres.
03.09.2025 à 11:58
Pour une écologie de la libération : antiracisme et écologie politique
Alors que la possibilité du fascisme prend corps à grande vitesse, il ne s’agit plus de convaincre, mais d’organiser le camp de l’émancipation, observe Fatima Ouassak dans ce texte incisif, qui ouvre le livre collectif « Terres et liberté ». Elle appelle à assumer la radicalité et à construire un front commun écologiste et antiraciste : l’écologie de la libération.
L’article Pour une écologie de la libération : antiracisme et écologie politique est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (4502 mots)
Ce texte est l’introduction par Fatima Ouassak du livre collectif qu’elle a coordonné : Terres et Liberté. Manifeste antiraciste pour une écologie de la libération, paru en mai 2025 aux éditions Les Liens qui Libèrent. L’ouvrage est la première parution de la collection « Écologies de la libération », que dirige Fatima Ouassak.
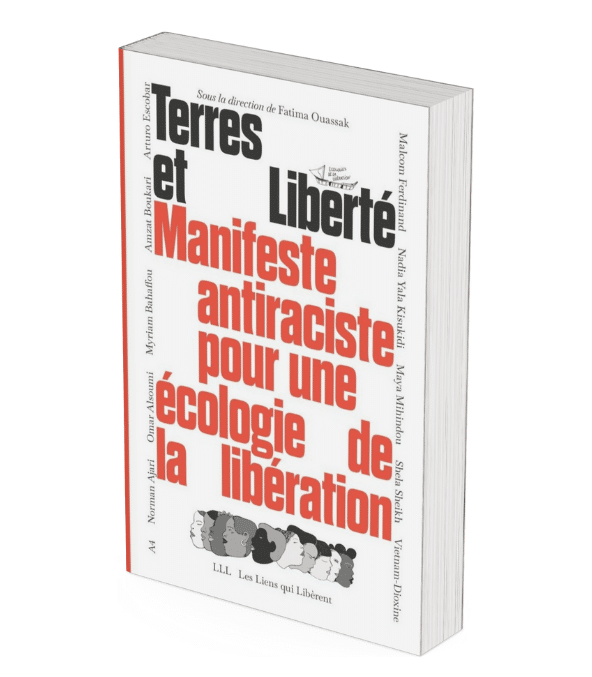
« Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir, ou la trahir. »
Frantz Fanon, Les Damnés de la terre, 1961
Nous vivons à l’aube d’un basculement historique en Occident. Mille bruits de fond le laissent entendre : l’idée même de changement structurel — vers plus de justice — rendu nécessaire par l’urgence climatique est abandonnée par les grandes puissances mondiales, et le fascisme allié au néolibéralisme gagne partout du terrain. L’horizon s’obscurcit d’une possible gestion fasciste de l’urgence climatique : plus question de partager l’eau, l’air, la terre, la possibilité de vivre bien, de vivre tout court, avec celleux décrété·es indignes d’appartenir à l’humanité. Cette possibilité du fascisme prend corps — l’air de rien — très vite.
Dans le même temps — pour partie en réaction — grandit dans le camp de l’émancipation une exigence radicale de justice : la domination des un·es sur les autres n’est plus supportable. Cette exigence est le fruit d’une prise de conscience collective : celle de militant·es, d’intellectuel·les, de syndicalistes, de paysan·nes, d’avocat·tes, d’artistes, d’éditeur·ices, de journalistes engagé·es qui partagent l’ambition de construire un front commun contre ce qui ravage le monde.
En France, ce souffle radical pointe son nez aux portes de l’écologie politique. Le terrain est favorable : depuis une dizaine d’années se tisse un début d’alliance entre luttes écologistes et antiracistes, et on voit arriver une production théorique d’une écologie décoloniale. Un travail qui s’est ancré dans des luttes locales pour les soutenir et s’en inspirer, et qui a mené, en 2020, à un mot d’ordre partagé entre écologistes et antiracistes : « On veut respirer ! ».
La question est stratégique. La lutte continue, nous sommes d’accord. Mais avec qui ? Pour quoi faire ? S’agit-il de monter en radicalité dans une course contre la montre face au grand capital acoquiné avec l’extrême droite et d’adopter une stratégie révolutionnaire ? S’agit-il au contraire d’arrondir les angles pour freiner le train qui risque de tous·tes nous précipiter dans le ravin et de se ranger derrière une stratégie de repli ? Foncer et faire feu de tout bois ? Ou se terrer et se protéger des vents mauvais ? Nous considérons ici qu’il faut en écologie, comme en tout, résister corps et âme au fascisme. Face aux possibles basculements mortifères, nous n’avons plus le temps de prendre des pincettes en faisant le dos rond.
Va donc pour la course contre la montre et le feu
Partant de là, remplir notre mission, c’est assumer notre radicalité, la revendiquer. Cela risque de provoquer des controverses ? Tant mieux, vive la controverse ! Cela risque de cliver ? Encore heureux : il ne s’agit pas de convaincre les partisan·nes de la suprématie blanche de rejoindre le camp de l’émancipation. Il s’agit d’organiser le camp de l’émancipation, où nous sommes suffisamment nombreux·ses, et de construire des maquis — physiques, intellectuels et culturels. Remplir notre mission, c’est, malgré les critiques que nous pouvons lui adresser, ne pas rompre avec le champ de l’écologie. Le rapport critique à l’écologie ne doit pas viser à nous en débarrasser, mais au contraire à nous l’approprier. Répondre à notre mission, c’est aussi, dans un contexte d’extrême-droitisation des champs politique et médiatique, refuser de mettre la question raciale sous le tapis. Alors que l’antiracisme est diabolisé et que la défense de la liberté de circuler est taxée de haute trahison, du courage, il en faut. Mais personne n’a dit que notre mission était facile.
Depuis, nous sommes nombreux·ses à avoir découvert la mission de notre génération : travailler à un projet écologiste où l’égale dignité humaine est à la fois le centre et l’horizon. Reste à savoir si nous nous apprêtons à la remplir ou à la trahir. Voilà très précisément où nous en sommes aujourd’hui.
Il s’agit d’analyser précisément la singularité coloniale, islamophobe et anti-migrant·es du fascisme qui se répand aujourd’hui en Europe. Et comprendre que tout se tient : ce qui ravage la Terre ravage les populations non blanches, ce qui ravage les populations non blanches ravage la Terre.
Terres et Liberté est le premier point de ralliement que nous proposons, entre écologie et antiracisme. À l’heure où, en France, la terre se soulève aussi bien pour empêcher l’accaparement de l’eau au profit de quelques-un·es que pour dénoncer le meurtre d’un adolescent tué par la police, à l’heure où ce qui agite en silence les populations non blanches concerne l’enterrement des parents, quelle est la terre où reposer en paix ? Ici ou là-bas ? C’est une question derrière laquelle se cachent mille autres. Quelle est la terre où se reposer et vivre en paix ? Celle où faire grandir ses enfants ? Ces questionnements sont à la fois singuliers et universels. La terre ne concerne pas seulement les conditions de subsistance. Elle est aussi affaire de dignité car la libération de la terre est une condition à l’émancipation de celleux qui l’habitent.
C’est précisément cet enjeu que nous cherchons ici à explorer. Terres au pluriel car toutes ne se valent pas : elles sont souvent traitées comme le sont leurs habitant·es. Et Liberté au singulier pour rappeler que personne n’est libre si tout le monde ne l’est pas. Premier ouvrage de la collection « Écologies de la libération », Terres et Liberté vise à introduire les principaux enjeux, sujets de débat, champs d’action et luttes menées, dans une perspective croisée écologiste et antiraciste.
Une conviction nous anime : si nous y travaillons sérieusement, l’antiracisme peut devenir le nouveau souffle de l’écologie politique, et l’enrichir de joies militantes, de savoirs académiques, d’espérance, et d’une histoire pleine de détermination à vivre libres.
Terres au pluriel car toutes ne se valent pas : elles sont souvent traitées comme le sont leurs habitant·es. Et Liberté au singulier pour rappeler que personne n’est libre si tout le monde ne l’est pas.
Le maquis où il est désormais possible de verser dans un pot commun les héritages antiracistes et les héritages écologistes, c’est l’écologie de la libération. La pensée de Frantz Fanon, celle de Maria Lugones, la vision politique d’Abdelkrim El Khattabi, celle de Thomas Sankara, la libération de l’Algérie malgré cent trente-deux ans de destruction, la lutte pour protéger la terre guyanaise, la résistance en Kanaky, la résilience en Palestine… forment ce maquis où l’on peut résister pour contrer « l’écologie des frontières » mobilisée par les dirigeant·es d’extrême droite. Et où renouveler nos imaginaires, préciser nos horizons idéologiques, dans le détail. Qu’entendons-nous exactement par « racisme environnemental », « écocide », « extractivisme », « effondrement » et « fin du monde », « habiter colonial », « réparation », « justice climatique », « éthique du soin », « rhizome », « libération animale », « ancrage territorial »… ? Autant de définitions nécessaires pour déployer des outils d’émancipation.
L’écologie de la libération, c’est notre réponse à l’urgence que constituent les conséquences du dérèglement climatique et la montée en puissance des fascismes alliés au néolibéralisme en France et en Europe. C’est l’ensemble des grilles d’analyse, projets politiques et mouvements sociaux qui visent à libérer les animaux humains et non humains d’un système d’exploitation et de domination : les grilles d’analyse permettent de comprendre les ravages écologiques sur les êtres et les terres produits par la combinaison de systèmes d’oppression patriarcale, capitaliste et coloniale ; les projets politiques ouvrent des horizons écologistes à la fois anticapitalistes et anticolonialistes ; les mouvements sociaux se composent de collectifs d’habitant·es, d’associations culturelles, de tiers-lieux, d’entreprises, de syndicats, qui luttent contre le système responsable du dérèglement climatique et ses conséquences, avec au centre, les enjeux d’égale dignité humaine. Tout notre travail ici consiste à donner de la voix et du coffre à cette écologie de la libération. Se saisir des impensés et des angles morts de l’écologie politique — suprématie blanche et occidentale, rapports de domination coloniale et racisme environnemental entre autres — pour développer de nouveaux outils critiques. Une manière d’ouvrir un véritable espace antiraciste, et de participer ainsi aux ruptures et au renouvellement nécessaires dans l’écologie, en France et en Europe. La mission de notre génération est de travailler à un front commun écologiste, radicalement antiraciste. Travaillons-y vite, partout, nombreux·ses.
Image d’accueil : « Bush Babies » de Njideka Akunyili Crosby, 2017. Wikiart.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
L’article Pour une écologie de la libération : antiracisme et écologie politique est apparu en premier sur Terrestres.
25.07.2025 à 09:28
Les résidents de la mer : rencontres dans les estrans
Connaissez-vous You le phoque, Zafar le dauphin ou les orques du clan Gladis ? Dans son livre “Des vies océaniques”, l’anthropologue Fabien Clouette raconte de singuliers destins d’animaux marins qui ont surgi un jour dans la vie des humains, captivant la presse et le public. Et faisant chavirer dans la foulée les frontières entre sauvage et société.
L’article Les résidents de la mer : rencontres dans les estrans est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (7419 mots)
À propos du livre de Fabien Clouette Des vies océaniques. Quand des animaux et des humains se rencontrent, Le Seuil, collection « La couleur des idées », 2025.

Saviez-vous qu’il est bien plus courant d’apercevoir un dauphin en rade de Brest qu’un loup sur le Vercors ? Malgré la sophistication croissante des techniques et des savoirs scientifiques sur l’océan, le monde marin conserve l’image d’un univers énigmatique, indompté et hors d’atteinte. L’anthropologue breton Fabien Clouette invite les lecteurs et lectrices à voyager sur les estrans, zones de plages et de mers, à la rencontre de « vies océaniques » singulières et bien souvent controversées. L’auteur part du constat méconnu que les estrans constituent le milieu où les rencontres avec le sauvage sont les plus fréquentes pour les sociétés humaines.
Alors que l’engouement pour les rencontres animales et le vivant a fait couler beaucoup d’encre et suscité de nombreux ouvrages autant littéraires qu’académiques, peu d’écrits avaient jusqu’alors renouvelé nos réflexions sur les charismatiques rorquals, orques, phoques ou dauphins. Sources de multiples conflits à travers l’histoire ancienne ou récente, qu’on pense à la chasse aux baleines ou à la consommation de leur viande, ces grands mammifères marins continuent d’occuper une place de choix dans l’imaginaire des sociétés humaines et de ce qu’est le sauvage.
Malgré l’effondrement de la biodiversité marine métropolitaine et les menaces systémiques portées aux habitats marins, ces animaux semblent, paradoxalement, de plus en plus visibles le long de nos côtes. La biodiversité et les milieux marins sont pourtant en danger, et ce depuis des dizaines d’années1, comme les organisations environnementales et les diplomates l’ont répété tout au long de la 3e conférence onusienne dédiée à l’Océan qui s’est tenue à Nice en juin dernier2. La surpêche, les pollutions multiples et la destruction des habitats causées par l’extractivisme et l’exploitation des ressources se combine à des dégradations biologiques et climatiques des milieux (le réchauffement de la température des eaux, leur acidification, la désoxygénation, et l’élévation du niveau de la mer). Au cours du 20e siècle, 30% de la superficie des herbiers marins qui offrent nourriture et nurserie à la faune marine ont par exemple été détruits, une destruction comparable à une déforestation massive et invisible. Un tiers des mammifères marins seraient menacés à l’échelle de la planète.
Néanmoins, au large de l’Atlantique, des phoques, orques ou dauphins s’approchent de plus en plus régulièrement des estrans. Une partie d’entre eux viennent y mourir, après des collisions avec des navires ou emmêlés dans des filets de pêche3. Ils suscitent tour à tour crainte face aux dégâts qu’ils causent aux équipements des pêcheurs ou plaisanciers, méfiance vis-à-vis des zoonoses qu’ils peuvent charrier sur le rivage, joie à les apercevoir et en reconnaître certains, attraction lorsqu’ils deviennent des mascottes, excitation à collecter du savoir à leur propos, tristesse lorsqu’ils s’échouent sur le rivage ou colère lorsque les humains se disputent à propos de la meilleure façon de les sauver.
Au cours du 20e siècle, 30% de la superficie des herbiers marins qui offrent nourriture et nurserie à la faune marine ont été détruits, une destruction comparable à une déforestation massive et invisible.
C’est en explorant ces registres émotionnels variés que Fabien Clouette cherche à comprendre ce que des rencontres marines particulières disent plus largement de nos rapports contemporains aux animaux. Pour cela, son livre adopte une construction littéraire audacieuse, en mêlant des formes d’écriture variées qui tiennent à la fois de l’essai scientifique et éthique, du roman policier, de l’écopoétique et de la biographie animale. Ce mélange permet de questionner la manière dont se fabriquent des récits autour de rencontres répétées avec des animaux qui deviennent célèbres par leurs contacts réguliers avec des humains, parfois malgré eux.

L’historien Eric Baratay est l’un des premiers à avoir tenté l’écriture de récits des vies sociales d’animaux passés à la postérité. Son livre, paru en 20174, s’appuyait principalement sur les ressentis et perceptions de bêtes compagnes, comme Modestine, l’ânesse maltraitée de Stevenson devenue célèbre par la littérature ou Bummer et Lazaru, chiens errants à San Francisco dans les années 1860 promus par la presse locale. Ces biographies zoocentrées permettent de prendre la mesure des vies animales et de leurs expériences au monde. F. Clouette adopte un point de vue plus anthropocentré que celui d’E. Baratay pour s’interroger, plutôt que sur les vies et ressentis animaux, sur les sensibilités humaines qui se déploient au contact d’animaux marins. L’anthropologue cherche à comprendre pourquoi et comment ces animaux ont été singularisés par des microsociétés le long de l’Atlantique (plaisanciers, surfeurs, véliplanchistes…).
Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Aux sens larges : comment l’éthologie agrandit le monde » de Thibault De Meyer et Vinciane Despret, mai 2025.
Quatre biographies animales sont mises en scène dans quatre chapitres pour rendre compte de leur trajectoires anthropo-zoologiques : le phoque You, qui surfe avec les Girondins et se repose sur les plages au milieu des baigneurs ; le dauphin Zafar, solitaire mais friand d’interactions avec les coques des bateaux du Morbihan avant de filer, libre et curieux, jusqu’au port d’Amsterdam ; le rorqual Kalon qui s’échoue à plusieurs reprises en baie de Douarnenez malgré les interventions des scientifiques ou militants ; et enfin les « terribles » orques du clan Gladis qui coulent des voiliers dans la péninsule ibérique.
En plus de retracer la vie de ces quatre animaux et de ceux et celles qui les ont entourés, ce livre peut être lu comme un roman policier avec tous les ingrédients qui composent ce genre et qui permettent de s’attacher aux personnages animaux qui traversent le livre : du suspense pour retrouver You au-delà de la Bretagne ; une série noire d’échouages de baleine ; des péripéties diplomatiques dans la vie de Zafar ; une capture de phoque qui se transforme en captivité et mise à l’isolement et qui peut être qualifiée de détention provisoire ; des autopsies répétées sur les dauphins ; une enquête sur les causes de la mort de Kalon ; ou encore un décryptage de scènes (criminelles) pour rechercher le ou la coupable du naufrage d’un bateau.
Ce livre peut être lu comme un roman policier avec tous les ingrédients qui composent ce genre : du suspense pour retrouver You au-delà de la Bretagne ; une série noire d’échouages de baleine ; des autopsies répétées sur les dauphins…
Par ce style, l’auteur fait naître une palette d’émotions chez les lecteurs et lectrices : amusement, frisson, crainte ou attachement, émotions qui s’apparentent à celles qui ont motivé toutes les actions collectives mises en œuvre par les sociétés littorales envers ces animaux devenus célèbres : pages Facebook, pétitions, articles de presse, recours juridiques, vidéos, photos et posts sur les réseaux sociaux construisent certains attachements à ces animaux. Même après leur mort, leur mémoire est célébrée.
Si le sauvage peut être assimilé à une vie anonyme, à l’inverse, les animaux racontés par Fabien Clouette sont ceux qui ont cherché le contact avec l’humain, pour des raisons inconnues. Une première façon de les sortir de l’anonymat est de les reconnaître par leur peau et faciès (nageoires, traits sur la peau, cicatrices…) et de les nommer. Plus de numéros ou codes scientifiques abscons tels que « A-005 » mais des prénoms : Marissa, Zafar, Randy, You, Gladis… pour mieux s’y attacher, les apprivoiser, ou pour – selon les militant·es de Sea Shepherd – mieux sensibiliser et émouvoir le grand public à leur cause.

Pourquoi et comment ces animaux solitaires font-ils société avec les humains sur l’estran ? Et surtout, sont-ils toujours sauvages ? La réflexion centrale de l’ouvrage se tisse autour des façons d’appréhender le sauvage par ceux ou celles qui rencontrent ces drôles d’animaux et les formes de domestication qui se déroulent – processus régulièrement discutées en sciences sociales en raison de la construction historique du partage sauvage/domestique, ses fonctions et ses flous5. Le phoque You, très apprécié à son stade juvénile lorsqu’il titille les surfeurs, devient de plus en plus encombrant une fois adulte, fait peur, embête les plaisanciers, gêne les touristes voire les blesse. Lorsque les touristes reviennent en nombre, il créé des conflits d’usage sur les plages si prisées du littoral de Gironde. Sa présence devient alors un problème à régler pour les autorités. Capturé, il est envoyé en Bretagne. Il rejoint des colonies de phoques à Molène, se mêle à ses congénères mais… revient en Gironde. Les scientifiques et les plongeurs le reconnaissent, par sa bague et ses traits, mais surtout par son comportement singulier, qui « provoque » le contact avec les humains.
Si You cherche quant à lui à jouer, que recherchent les orques du détroit de Gibraltar dans leur contact rapproché avec les bateaux ? Une forme de vengeance conduisant à couler les bateaux des riches plaisanciers ? Le dauphin cherche-t-il du plaisir sexuel auprès des véliplanchistes ? Y a-t-il des cultures animales qui se transmettent ? Peut-on appliquer une théorie psychologisante à un individu précis ? Quelle est l’origine de cette drôle de familiarité avec l’humain ? Un caractère peu farouche ? Un traumatisme d’enfance ? Une tentative de domestication par des forces militaires ? Un apprivoisement incongru ? Sans chercher à trancher ces questions, l’auteur montre la gamme des registres explicatifs possibles, tout autant par les scientifiques et spécialistes que par des amateurs éclairés. Fabien Clouette ne hiérarchise ni ne tranche les controverses. Il nous invite plutôt à déplacer notre regard pour comprendre ce qui dévie, ce qui (nous) embarrasse dans ces biographies animales. Les quatre animaux mascottes deviennent en effet tous, à un moment de l’histoire, gênants : par leur odeur (de décomposition), leur force destructrice des bateaux, leurs virus qui pourraient contaminer les humains, leur présence dans un port. Ils dérangent surtout car ils n’agissent pas « normalement », selon les canons de leur espèce. Par leur comportement trop proche de l’humain, ils deviennent catégorisés comme déviants. La notion sociologique de déviance, source de nombreux travaux6, est ainsi appliquée par l’auteur au règne animal pour explorer les discours à leur propos7. Le jugement moral, la non-conformité aux normes imprègnent les paroles des scientifiques rencontrés par F. Clouette : l’animal présente une anomalie, ne correspond pas ou plus aux critères établis par la science ou aux espérances.
Quelle est l’origine de cette drôle de familiarité avec l’humain ? Un caractère peu farouche ? Un traumatisme d’enfance ? Une tentative de domestication par des forces militaires ?
Ces animaux à la fois sociaux et solitaires défient les classifications établies, brouillant les contours des espèces, des inventaires, des territoires. Un dauphin peut-il vivre dans un port ? Un phoque peut-il rester solitaire ou va-t-il forcément rejoindre une colonie ? L’auteur s’attarde par exemple sur les essais de réensauvagement d’animaux marins, tentatives bien souvent infructueuses qui, comme les bassins de sauvetage, brouillent les frontières entre nature et culture, sauvage et domestiqué. Ces quatre exemples poussent à reconsidérer les savoirs naturalistes, tant profanes que scientifiques. Ils s’inscrivent dans des débats contemporains en écologie : faut-il penser l’animal en tant qu’individu, avec son histoire et ses affects, ou comme membre d’une population, sujet d’un raisonnement statistique ou écologique ? Face à ces comportements jugés atypiques, le scientifique reconnaît parfois son ignorance et explore un large éventail d’hypothèses, naviguant entre validation empirique, savoirs locaux et mythologies populaires.
En plongeant le regard sur des animaux singuliers, on en oublierait une vision plus large, englobant un socioécosystème et des relations inter-espèces dynamiques, si essentielles à préserver.

Le livre balaye, à petites touches, une multitude d’enjeux contemporains liés à notre rapport au vivant marin dans un contexte de bouleversements écologiques, économiques et technologiques croissants.On y découvre comment leslimites thermiques des espèces marines évoluent face au réchauffement de l’océan, entraînant des comportements nouveaux, des déplacements inédits. Pollutions sonores, plastiques, destruction de de la diversité, concurrence des routes animales et plaisancières… Les paysages maritimes s’abîment et sont soumis à des destructions environnementales aussi, voire plus, dramatiques que sur terre. Ainsi, les échouages de dauphins sur les côtes françaises, d’un béluga dans la Seine ou des corps de rorquals sur les plages deviennent symboles d’un déséquilibre à la fois visible et bouleversant. Les comportements du clan des Gladis, orques femelles matriarches, permettent de décaler le propos genré du livre, au-delà des héros – forcément masculins. Elles sont connues pour avoir multiplié, entre l’été 2020 et le début de l’année 2024, les attaques sur les voiliers. Sur environ 800 événements recensés, plus de 300 navires plus ou moins luxueux ont été endommagés, et certains ont même sombré. S’agit-il des prémices d’une internationale anticapitaliste marine ? L’auteur se refuse à adopter une lecture en termes d’alliance politique avec le vivant, notion théorisée par Antoine Chopot et Léna Balaud, qu’il considère désincarnée et éloignée du terrain8. Ces révoltées racontent pour lui une autre histoire, plus compliquée. Ces orques, dont la longévité peut atteindre 90 ans, ont été témoins de profondes transformations de leur environnement : raréfaction du thon, augmentation du trafic maritime… Leur propre corps porte les marques de ces bouleversements, entre cicatrices de filets de pêche et impacts liés à des collisions avec des navires.
Les réflexions de Fabien Clouette s’inscrivent dans un contexte de pression croissante sur les littoraux, fortement aménagés pour le tourisme, tout en étant soumis à des politiques de conservation toujours plus visibles, grignotant le territoire des travailleurs de la mer. La protection croissante des mers (via la création de parcs marins ou d’aires marines protégées) ne conduit toutefois pas à une remise en question de l’exploitation des ressources marines. Cette dynamique ambivalente – que Charles Stépanoff qualifie d’« exploitection »9 – est ici pleinement illustrée à travers les formes de coprésence entre humains et non-humains. L’animal solitaire, longtemps perçu comme une nuisance, peut désormais contribuer à « l’attractivité du territoire » littorale et donc à son exploitation accrue.

Si bien que la question se pose : faut-il sauver les animaux en péril ? Mais surtout, comment ? Les actions autour des mammifères marins ont pour caractéristiques de combiner recherche, science participative, observation (notamment whalewatching, l’observation des baleines) aux ressorts économiques et touristiques et réseaux de bénévoles pour les échouages. Même la muséographie entre en jeu, dans sa manière de représenter, de conserver et de transmettre les ossements des mammifères et ces histoires marines adossées. Tout ceci montre la large gamme de registres avec lesquels les « sauveurs de baleine, phoque ou dauphin » doivent composer, non sans frictions.
Malgré leur singularité, les vies animales relatées laissent entrevoir la fascination de notre société pour une partie du monde océanique. Les phoques, dauphins, baleines ou orques sont des symboles culturels qui mobilisent des affects et des registres d’actions variés. Pourtant, de nombreuses autres vies océaniques sont aussi – voir bien plus – en danger mais restent méconnues, absentes du récit, et nous laissent indifférents. Le livre de Fabien Clouette offre, en somme, un regard sensible et critique sur les multiples lignes de contact – et surtout de fractures – entre les humains et le monde marin.
Photo d’ouverture : Samuel Arkwright sur Unsplash.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
Notes
- L’ouvrage de la biologiste Rachel Carson Sous le vent de la mer (Under the Sea Wind) est paru en 1941 aux États-Unis. Une traduction en français (de Pierre de Lanux, révisée par Clément Amézieux) est parue en 2024 chez Wildproject.
- Pour des comptes-rendus ethnographiques, voir le projet collectif ODIPE (Ocean diplomacy ethnography).
- Voir la BD On a mangé la mer. Une enquête au cœur de la crise de la pêche en France, de Maxime de Lisle et Olivier Martin, Futuropolis, 2025.
- Éric Baratay, Biographies animales. Des vies retrouvées, Seuil, coll. « L’Univers historique », 2017, 304 p.
- Frederic Keck, « Domestiquer et apprivoiser les animaux : comment hériter de cette longue histoire ? », Terrestres, mars 2025 ; Charles Stépanoff, Attachements. Enquête sur nos liens au-delà de l’humain, La Découverte, 2024.
- Howard Becker, Outsiders : études de sociologie de la déviance, Métailié, 1985.
- Comme l’ont fait d’autres auteurs avant Fabien Clouette, par exemple pour traiter du cas de la « vache stérile », analysé par Albert Malfatto (« Nommer l’animal déviant. Le cas de la vache stérile en domaine occitan », Géolinguistique, 2016) ; ou du loup par Sophie Bobbé, L’ours et le loup. Essai d’anthropologie symbolique, Éd. de la MSH/INRA, 2002.
- Voir l’entretien donné à Médiapart par l’auteur : « Mammifères marins : des rencontres de chair et de symboles », mars 2025.
- Charles Stépanoff, L’animal et la mort : chasses, modernité et crise du sauvage, La Découverte, 2024.
L’article Les résidents de la mer : rencontres dans les estrans est apparu en premier sur Terrestres.
22.07.2025 à 11:31
En finir avec l’« architecture-as-usual »
Qu’est-ce que l’écologie pour l’architecture ? Pour l’heure : un argument de vente. À partir d’un chantier ordinaire, Mathias Rollot oppose les promesses vertes à ce que serait une architecture véritablement écologique, frugale et conviviale. Contre la tentation de l’"architecture-as-usual", il appelle à réparer, détourner, dé-projeter.
L’article En finir avec l’« architecture-as-usual » est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (10323 mots)
On entend (un peu) parler d’écologie en architecture. Mais que cela recouvre-t-il au juste, et que se passe-t-il lorsqu’on essaie de transformer l’écologie en système d’évaluation de l’architecture ? Il faudrait pour cela s’entendre précisément sur la chose. S’accorder, tout d’abord, sur le fait qu’il y a, non pas une, mais des écologies, fondées sur des systèmes de valeurs différents, qui ne se valent pas et qui souvent s’affrontent. Puis, considérer la myriade de discussions qu’il faudrait pouvoir ouvrir sur le sujet et qui tardent à venir dans les communautés concernées (autant que dans la société tout entière). Enfin, regarder avec ces outils et avec honnêteté nos théories, pratiques et pédagogies architecturales ; tenter de les percevoir depuis des perspectives écocentrées multiples, avec pour principale finalité l’habitabilité de la zone critique terrestre pour toustes1.
En guise de contribution à ce chantier important, cet article aborde la question de l’évaluation écologique de l’architecture. La possibilité d’évaluer la pertinence écologique réelle d’une opération, c’est ce que peut-être personne ne fait très explicitement, mais ce que beaucoup font implicitement lorsqu’ils et elles discutent des bonnes pratiques, de leurs méthodes concrètes et de leurs choix éthiques, de leurs valeurs et « engagements » écologiques en architecture : ils et elles disent par là ce qu’ils pensent être le mieux à faire – à savoir, en creux, ce qui serait plus écologique. Mais au-delà du simple bilan carbone, du respect de la règlementation ou de l’obtention de labels (dont la valeur pourrait aussi faire l’objet de longues discussions), comment peut-on sérieusement estimer qu’un édifice est « écologique » ou ne l’est « pas », voire qu’un édifice est « plus écologique » qu’un autre ? La question posée ici est celle de savoir ce qu’il faut prendre en compte pour engager une telle argumentation, autant que l’interrogation plus générale de savoir si, oui ou non, une telle démonstration est seulement possible.
En engageant ce propos, je n’entends bien sûr nullement affirmer que tout édifice a la même valeur environnementale. Loin de là ! Mon intention est d’une part d’alerter sur l’incomplétude systématique et profonde des propos environnementaux en architecture, qui se réduisent trop souvent à des déclarations d’intention ou à de simples « calculs » – comme si les questions écologiques pouvaient être mises en équations avec réponse définitive à la clé. D’autre part, il s’agit de mettre en lumière l’absurdité de l’argument courant de la « compensation » (qui veut par exemple qu’un peu de biodiversité ferait pardonner trop de béton armé) et les différentes stratégies de dissimulation ou de greenwashing qui en découlent trop souvent. J’essaierai, enfin, de montrer en quoi ce prétendu « argument » relève de l’impensé, et de dire à quel point cet impensé me semble permis par un profond vide social contemporain en matière de lieux de débats, critiques et honnêtes, en architecture. Autrement dit : nous n’aurions pas, collectivement, des discours si pauvres et erronés, si lâches et mensongers, si nous avions plus de lieux et de moments, plus d’espaces et de modalités de pensée sincère, solidaire et (auto-)critique de l’architecture. L’historique espace compétitif orchestré par le capitalisme néolibéral semble avoir été encore amplifié par le récent développement de la vie numérique généralisée et ses effets atomisants et déterritorialisants. Nous ne devons pas juste retrouver la Terre et le terrestre, mais aussi l’espace politique convivial capable de faire de nos corps des éléments liés d’un même monde (co-)habité. Quelle « architecture écologique » sans cela ?
Bullshit ordinaire
La réglementation thermique, installée à la suite du choc pétrolier de 1973, progresse d’année en année : d’une limitation à 225 kWh/M2/an en 1974, elle finit à 50kWh/m2/an en 2012, avant de se transformer encore en « Réglementation Environnementale » en 2020. Mais, malgré leur montée en complexité, ces réglementations restent encore largement centrées sur l’unique question de la consommation énergétique. Quels bâtiments exemplaires en termes écologiques ces cinquante années d’exigences progressives produisent-elles aujourd’hui ? Puisque toutes les architectures contemporaines courantes doivent s’y conformer par obligation règlementaire, il n’y a donc qu’à ouvrir les yeux sur les dernières livraisons ordinaires, ici et là, dans nos quotidiens.
À l’heure où s’écrivent ces lignes, j’ai sous les yeux un chantier. Depuis mon balcon, je vois une construction entièrement en béton armé, du polystyrène, des bâches plastiques et de la colle, des tapis de mousse, des tubes et des rouleaux plastiques. L’entreprise Icade, qui dit mettre « au cœur de son modèle d’affaires les enjeux climatiques et la préservation de la biodiversité pour réinventer l’immobilier et contribuer à une ville plus durable »2, construit ici des logements qu’on peut qualifier à bon droit de « standardisés ». Cela, si ce n’est dans leur intérêt économique, mais aussi au service de la croissance économique et du développement (« durable », s’entend) de la ville, du département, de la région et du pays. Tout le monde en profitera sûrement par ruissellement ! La scène m’interroge : qui fait donc les labels et les réglementations environnementales en architecture, et au service de qui, de quoi ? Sur les panneaux de façade interdisant l’accès au chantier, de grandes publicités orchestrent un mariage sans gêne entre capitalisme et environnementalisme : « Une respiration végétale avec un jardin intérieur en cœur d’îlot » / « Idéal pour investir » ; « Votre 2 pièces à partir de 281 000€ parking inclus » / « des matériaux respectueux de l’environnement pour une construction éco-responsable » ; « Loi Pinel – LMNP » / « l’ensemble du projet privilégie les essences locales dans le respect de la biodiversité ». On peut visiblement écrire n’importe quoi pour promouvoir son projet publiquement. Qui ira se plaindre ? La scène est aussi banale qu’ancienne. Plus personne n’y prête même attention.

Qui fait donc les labels et les réglementations environnementales en architecture, et au service de qui, de quoi ?
Et puis, de toute façon, qui blâmer pour cela ? La graphiste qui a composé les panneaux à grand renforts de slogans stéréotypés, sur demande de sa cheffe ? Ou bien son chef – lui qui, sans y croire lui-même, a lu dans une étude marketing que mettre le mot biodiversité sur un panneau augmenterait de 50% l’impact du message chez l’observateur·ice ? On pourrait aussi penser à l’architecte cheffe de projet, qui a dû transmettre les arguments architecturaux à utiliser pour la com’, quand il lui restait quelques minutes de libre entre toutes les injonctions à la rentabilité et les réglementations contradictoires et intenables avec lesquelles elle a tenté de composer tout du long du projet. Et bien d’autres encore. La seule chose qui est certaine, c’est que ça n’est en aucun cas la responsabilité des ouvriers qui y travaillent pour peu, manipulant à longueur de journée ces isolants de polystyrène, colles, plastiques et autres mousses chimiques au profit d’autres qu’eux. Au-delà de la dialectique sociale du projet et du chantier, des matériaux et de la communication, il est intéressant de questionner la stratégie intellectuelle et le monde habité révélés par ce tableau. Ce monde dans lequel l’écologie semble être un argument de vente ; dans lequel les déclarations environnementales peuvent être multipliées sans garanties et sans risques ; dans lequel « éco-matériaux », « biodiversité », « jardin intérieur », « local » et « végétal » forment un champ lexical cohérent et inquestionné, magique. Certes, la problématique écologique se trouve ici élargie hors du champ énergétique, mais pour quels résultats concrets ?
De Mathias Rollot, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Face à la bataille de l’eau, l’hypothèse biorégionaliste », avril 2023.
Sur la compensation de tout par n’importe quoi
Il est bien difficile de comprendre quel est le rapport réel entre ces éléments à connotation « écologique », et comment l’architecte et l’architecture pourraient bien mélanger tous ces ingrédients pour en faire une soupe un tant soit peu digeste. Un gain – même démontrable – en biodiversité peut-il « compenser » le bilan carbone désastreux d’une opération ? Inversement, le fait de construire en bio- et géo-sourcé, de façon frugale : cela peut-il suffire à éviter de bon droit l’importance des problématiques de faunes, de flores, d’hydrologie et de sols engagées par toute construction ? Et que pourrait bien remplacer ou excuser l’engagement territorial, la construction avec les filières locales, avec les « artisan·es du coin » (et encore faut-il préciser lesquels) et les savoir-faire historiques d’une région : est-ce une raison valable pour passer outre les bilans carbones, la compromission avec le grand capital, ou l’imperméabilisation massive des sols ? Ce qui interrogé là n’est autre que la manière dont, bien trop souvent, les discours contemporains placent dans la même équation, des matières et arguments écologiques qui n’ont que très peu à voir les uns avec les autres. Comme si tout pouvait servir « d’équivalence écologique » à n’importe quoi, et qui plus est sur de simples bases déclaratives.
Ce mélange des genres donne à l’actualité des débats un caractère tout à fait « délirant » – au sens premier du terme : il s’agit d’une forme de délire collectif, un imaginaire onirique, qui ne touche plus terre. « Hyperréel », aurait probablement dit Jean Baudrillard3. Dans ce voyage irrationnel, les systèmes d’évaluations et les systèmes de valeurs, les échelles et les sujets s’échangent et s’hybrident, se floutent et s’inversent à tout moment. On fait dans « l’échange symbolique », tout en restant persuadé·es d’être dans la rationalité et la concrétude – voire dans « l’engagement ». Consciemment et sans vergogne pour les uns, involontairement et sans s’en rendre compte pour les autres. Les architectes qui défendent un sujet pour en nier un autre le font-ils de bonne foi ? Il est assez facile de tout faire pour accueillir des chauves-souris et moineaux en façade en Europe, tout en contribuant activement à détruire les forêts primaires d’Indonésie avec une construction en bois exotique.
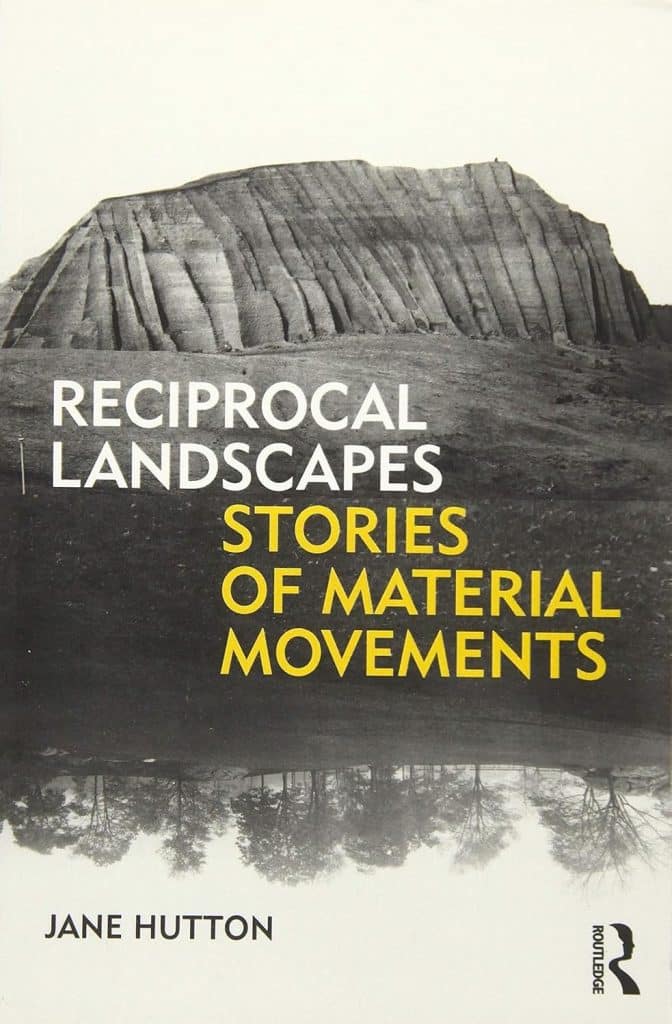
La question qui doit être posée à tout édifice est d’abord la suivante : écologiquement, géographiquement et socialement parlant, où est-ce que se concrétisent les impacts écologiques d’un bâtiment ? Autrement dit, l’impact écologique est-il à mesurer là où le bâtiment est construit, ou bien se mesure-t-il aussi dans les « paysages réciproques »4 impactés par sa construction, la transformation de ses matières et l’acheminement de ses matériaux ? Se mesure-t-il à l’échelle locale, pour les espèces qu’il déplace ou favorise, ou bien à l’échelle planétaire, pour le réchauffement global et l’effondrement des espèces auquel la construction du bâtiment contribue à sa manière ? D’ailleurs, quel édifice pourrait avoir autre chose que des impacts locaux, trans-locaux ET globaux à la fois ? L’enjeu est de limiter tous ces impacts à toutes ces échelles, au mieux, et non d’utiliser l’un de ces sujets comme faire-valoir pour masquer le score désastreux des autres. L’enjeu est de tendre au mieux vers le bilan (le plus) global (possible) de la construction.
Il est assez facile de tout faire pour accueillir des chauves-souris et moineaux en façade en Europe, tout en contribuant activement à détruire les forêts primaires d’Indonésie avec une construction en bois exotique.
Mais c’est une évidence : personne ne possède toutes les clés pour maîtriser les différentes parties du problème. Il ne suffirait pas d’être écologue-ingénieur-hydrologue-urbaniste-géochimiste-climatologue-architecte-forestier-paysagiste pour bien comprendre toutes les données du problème posé par de telles équations environnementales. Il faudrait aussi avoir accès à toutes les données factuelles – et donc à des systèmes de mesures multiples, coûteux, voire impossibles – pour pouvoir poser les questions sur la base d’études sérieuses du réel. Et encore, quand bien même tout cela serait possible, il faudrait encore pouvoir transmettre les résultats de son enquête à d’autres, en des termes compréhensibles par toustes. Et enfin, il faudrait aussi pouvoir prendre en compte ce fait, absolument central, que la question écologique n’est jamais résolue en amont de la construction.
L’écologie dépend aussi, pour une très large part, des usages conscients et inconscients des usager·es ; des politiques et des réglementations urbaines changeantes ; des programmes qui y prennent place et qui évoluent à chaque décennie ; de la maintenance effective et de l’adaptabilité potentielle ; de la déconstruction possible et de la déconstruction concrète ; et encore, des modes et des esthétiques qui passent, et qui poussent à démolir le construit encore solide mais désuet d’avant-hier. L’écologie de l’architecture est aussi fonction des déplacements invisibles dans les écosystèmes souterrains et aériens que la construction orchestre ; des perturbations complexes dans les cycles de l’eau à l’échelle du bassin-versant ; ou encore de l’agentivité non-humaine à toute échelle – du pigeon aux surmulots, des tremblements de terre aux canicules. C’est tout cela aussi qui devrait être pris en compte pour quantifier l’impact et l’utilité, la nuisance et la pertinence écologique d’une construction. A minima.
Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Pour un Conseil Diplomatique des Bassins-Versants », avril 2024.
Face à l’impossible quantification, « leur écologie et la nôtre »5
À bien des égards, il est donc légitime d’affirmer que l’écologie de l’architecture ne pourra jamais être pleinement démontrée, parfaitement quantifiée, solidement défendue sur tous les plans à la fois. Nous ne pourrons jamais entièrement démontrer par une équation, de façon ferme et définitivement qu’un bâtiment est « écologique » ou ne l’est « pas ». En suivant, il semble évident qu’on ne peut pas sérieusement mettre dans le même calcul « d’équivalence écologique » tout un melting-pot de choses hétérogène et irréductibles les unes aux autres (béton, papillon, inondation ?) sans un minimum de recul critique, de précautions, voire de second degré ! Le principe de « compensation écologique » pose déjà de sérieux problèmes théoriques et pratiques6, ne serait-ce que quand on cherche « simplement » à compenser des sols par d’autres sols7. Les pratiques de « compensation carbone » posent non moins de problèmes alors qu’elles devraient « simplement » placer en équivalence des « tonnes de CO2 » produites avec d’autres évitées ou absorbées8. Comment imaginer compenser du béton armé par des papillons, de l’imperméabilisation par de la terre crue, du capitalisme par de la participation ? Entre résignation et compétition9, malhonnêteté et stupidité, voilà un débat tout à fait analogue à celui que nous retrouvons dans les discussions ordinaires, où se mélangent consommation de viande rouge, avion, jardinage et engagement associatif, si bien que rapidement on ne distingue plus ni critères d’évaluation, ni modalités de comparaison claire, ni finalité écologique bien identifiée.
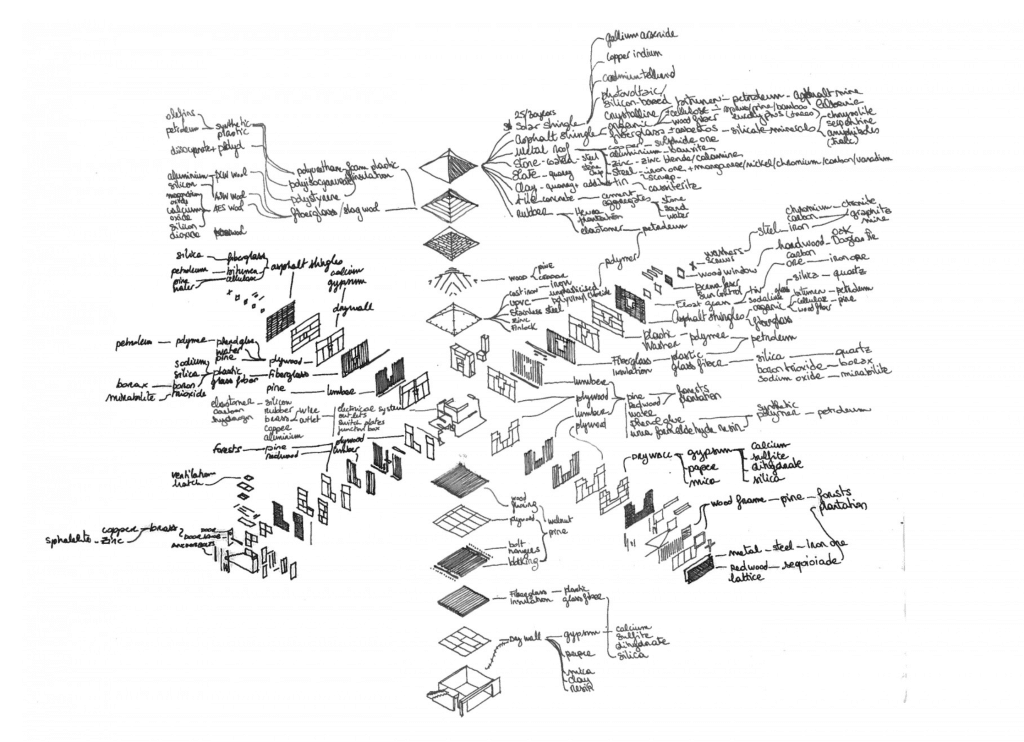
Dans les deux cas, la seule issue viable est évidente : c’est celle de la frugalité ; c’est la décroissance ; c’est le déchet qui n’est pas généré et l’énergie qui n’est pas consommée ; c’est le produit qui n’est pas produit ; c’est même éventuellement l’édifice qui n’est pas édifié – n’en déplaise à celleux qui voudraient aussi faire taire le nécessaire débat sur la construction neuve elle-même10. Oui, dans la difficulté qui nous occupe, l’action la plus écologique est encore celle que l’on n’entreprend pas.
La seule issue viable est évidente : c’est la décroissance ; c’est le déchet qui n’est pas généré et l’énergie qui n’est pas consommée ; c’est le produit qui n’est pas produit ; c’est même éventuellement l’édifice qui n’est pas édifié.
Et s’il faut vraiment construire, rénover, transformer et déconstruire, alors on pourrait raisonnablement se tourner vers les voies qui ne laissent que peu de doute sur leur nocivité moindre : celle de « bâtir avec ce qui reste »11, celle de « faire mieux avec moins »12, celle du « dé-projet » comme il existe du « dé-design »13, celle du décolonial14 ou encore celle de la « décroissance conviviale, de la sobriété énergétique et du low-tech pour l’architecture »15. Ceux et celles qui voudront comprendre ces termes les comprendront sans difficulté. L’architecture non-extractive sera toujours plus pertinente que l’architecture du spectacle écologique. Elle n’en est pas moins esthétique ou exigeante ; elle n’en est pas moins porteuse d’un projet de société commun, joyeux et créatif – tout au contraire ! La sobriété ne s’oppose qu’à l’ébriété. Bâtissons avec les milieux, quand c’est nécessaire, collectivement et magnifiquement, libéré·es de l’économie et de l’idéologie de la croissance et de l’extractivisme néocolonial. Bâtissons ensemble des établissements plus qu’humains raisonnables, qui tiennent réellement dans les limites planétaires. Réparons, détournons, revendiquons le droit à des structures collectives qu’on puisse comprendre et dont on puisse toustes prendre soin en autonomie. A minima, il faudra pour cela se libérer des héritages problématiques de la discipline architecturale ; se défaire des mauvaises habitudes du bâtir-as-usual ; et encore appliquer un principe d’honnêteté strictement simple, consistant à « faire ce qu’on dit et dire ce que l’on fait ».

La tentation de l’architecture-as-usual
Tout cela étant avancé, et quelle que soit l’écologie choisie pour poursuivre : pourquoi peut-on observer aujourd’hui tant de tentatives de compensation voire d’invisibilisation, tant d’actions visant à masquer par recouvrement une action X par un fait Y ? De quoi est-ce le signe, de quoi est-ce le garant, et que pensons-nous réussir en faisant cela ? Si ce n’est, peut-être, poursuivre tout simplement le business-as-usual. Ou plutôt, puisque la critique du « business » est un peu facile et puisque beaucoup ne s’y reconnaissent pas, l’architecture-as-usual ! Combinée à la pédagogie-de-l’architecture-as-usual16 et la recherche-en-architecture-as-usual17, la pratique-as-usual est un signal qu’on aurait tort de prendre à la légère. C’est le signe d’un monde qui ne veut pas mourir autant que la preuve que des agents sont toujours à son service ; c’est la marque d’un comme-si-de-rien-n’était qui ne s’assume même pas forcément, mais signe pour autant la collaboration, la compromission effective avec la destruction à l’œuvre. Oui, il y a bien une destruction « plus qu’involontaire » du Système-Terre ; oui, il y a bien des systèmes et des personnes pour l’orchestrer, et bon nombre de « collabos » pour la mettre en œuvre. L’architecture-as-usual est non moins une de leurs signatures que le greenwashing qui l’accompagne de plus en plus fréquemment.
Il faut aussi reconnaître que « l’injonction sociale au vert » est un fait réel. À mesure qu’elle devient plus pressante et plus légitime, l’architecture-as-usual est poussée à perpétuer l’illusion d’une position engagée ; le greenwashing (volontaire) et le greenwishing (involontaire) sont les conditions de possibilité de sa survie18. Tant et si bien qu’il serait salutaire d’aborder collectivement la « tentation du greenwashing » qui se pose légitimement à chaque image de synthèse produite pour gagner un concours, à chaque oral pour défendre sa posture et ses édifices. On pourrait, on devrait choisir de critiquer et de s’auto-critiquer, solidairement et confraternellement pour y faire face. On devrait aborder ce sujet avec d’autres disciplines et d’autres visions du monde, en dialogue par exemple avec des pensées comme celles de Fatima Ouassak, qui a mille fois raison de souligner les manières dont « le projet écologique majoritaire » est aujourd’hui, en France, un projet de « maintien de l’ordre social actuel » : « il exprime une inquiétude face au changement (on veut que nos enfants aient la même vie que nous) et une aspiration à la vie d’avant » – avec toutes les parts coloniales et racistes que cela inclut, structurellement19. Question rhétorique : quel rôle joue le faux discours écologiste de l’architecture-as-usual dans ce contexte conservateur ? Quels types de « colonialisme vert », de « capitalisme-colonial », de domination métropolitaine ou de purification ethnique cristallise-t-elle sous couverts de façades végétalisées, de toitures plantées ou d’espaces publics végétalisés-apaisés ?
Il serait salutaire d’aborder collectivement la « tentation du greenwashing » qui se pose légitimement à chaque image de synthèse produite pour gagner un concours, à chaque oral pour défendre sa posture et ses édifices.
On devrait donc débattre sérieusement de l’actualité de la profession et de ses compromissions, et inventer ensemble des manières d’y répondre, sur la base du problème intelligemment et honnêtement posé. Pour l’heure, hélas, la question semble plutôt osciller entre honte, gêne et mauvaises blagues en privé. Tandis que, dans les espaces publics de débat de l’architecture, on en est encore au stade du tabou, voire du refoulé collectif. En lieu et place des échanges stimulants que nous pourrions avoir, on assiste plus généralement à un silence gêné ou à une malhonnêteté crasse. La confusion entre solidarité et corporatisme, le système de médiatisation architecturale en vase clos et le repli « autonomiste » sur la discipline20 semblent avoir eu raison de la possibilité de confronter des milieux de l’architecture contemporain à l’aune des enjeux de notre époque. La critique n’est plus. Mais, après tout, a-t-elle vraiment déjà eu lieu ?21

Dans ces lignes, j’ai tenté de mettre en lumière la double et paradoxale nécessité et impossibilité de cerner entièrement la question de l’écologie en architecture ; d’en visualiser parfaitement tous les contours. Ce faisant, j’ai souhaité donner des raisons de se méfier de quiconque pourrait bien se prévaloir à des fins communicationnelles de quoi que ce soit à ce sujet – qui plus est lorsque cela est fait au moyen de compensations grossières entre des entités qui n’ayant aucune équivalence écologique. En appui sur les conclusions et les horizons dessinés par d’autres que moi, j’ai proposé de suivre les voies « les moins nocives » que nous ayons à notre portée. J’ai voulu mettre en lumière tant la nuisance des postures occultantes – ces voies qui tendent à occulter un sujet en le masquant sous un autre –, que les voies qui occultent la situation écologique tout court.
En guise de conclusion, j’invite à mûrir les sages conclusions de Stella Baruk, dont les travaux rappellent la fréquence des envies de déduire « l’âge du capitaine » sur la base du nombre de moutons et de chèvres présents à bord22. J’entends par là que si les calculs écologiques de l’architecture sont à la fois truffés de « malentendus » et d’« autres entendus » que ceux attendus, alors toutes nos équations sont tout simplement fausses. Nous devons faire preuve de vigilance et d’intelligence collective. Cela ne pourra avoir lieu sans, tout d’abord, un peu d’honnêteté intellectuelle, un peu de modestie et des outils incontournables du dialogue, de la pensée critique et du débat de fond. Pour avancer ensemble sur le sujet. Il faudra du courage, pour autant que cela supposera, a minima, la volonté collective de dépasser le corporatisme sclérosant en place dans les communautés de l’architecture.
Photographie d’ouverture : Mathias Rollot.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
Notes
- Tous mes remerciements à Philippe Simay pour toutes les stimulantes réflexions que nous avons eues ces derniers mois, qui ont beaucoup nourri ces lignes. Et tous mes remerciements à Nils Le Bot, Emeline Curien, Sophie Gosselin, Jeanne Etelain et Martin Paquot pour leurs retours sur des premières versions de l’article et leurs riches suggestions pour l’améliorer. Merci enfin à Emilie Letouzey qui a édité ce texte et m’a accompagné avec beaucoup de bienveillance dans les dernières étapes avant publication. Cela étant dit, les faiblesses du texte – puisqu’il y en a toujours – n’engagent évidemment que moi.
- Voir son site Internet : https://www.icade.fr/groupe
- Jean Baudrillard, Simulacres et Simulation, Galilée, 1981 ; Jean Baudrillard, Pourquoi tout n’a-t-il pas déjà disparu ?, L’Herne, 2007.
- Jane Hutton, Reciprocal Landscapes : Stories of Material Movements, Routledge, 2019.
- Écho au titre de l’anthologie d’écologie politique consacrée à André Gorz (Seuil, 2020).
- « Potentiellement intéressante, la compensation présente néanmoins de multiples difficultés théoriques et pratiques. Nombre d’études réalisées ces dernières années mettent en doute l’efficacité de la compensation, pointent le flou qui entoure son évaluation et les effets pervers qu’elle peut entraîner. De plus, on observe chez les acteurs de la compensation des pratiques contestables tant sur le plan technique qu’éthique, ce qui rend le système de la compensation encore plus problématique et controversé. Le bilan de la compensation est ainsi très mitigé. ». Adriana Blache, Frédéric Boone et Étienne-Pascal Journet, « Compensation. Notre impact sur la biosphère peut-il être l’objet d’un jeu comptable ? », dans Aurélien Berlan, Guillaume Carbou et Laure Teulières, Greenwashing. Manuel pour dépolluer le débat public, Seuil, 2022, p. 62.
- Magali Weissgerber, Samuel Roturier, Romain Julliard, Fanny Guillet, « Biodiversity offsetting : Certainty of the net loss but uncertainty of the net gain », Biological Conservation, vol. 237, septembre 2019, pp. 200-208. Pour une littérature plus accessible sur le sujet, voir plutôt Marie Astier, « Grands projets destructeurs : l’esbroufe de la « compensation écologique » », Reporterre, 2019.
- Voir notamment Stéphane Foucart, « Les bénéfices climatiques de la “compensation carbone” sont au mieux exagérés, au pire imaginaires », Le Monde, 29 janvier 2023 ; Alice Valliergue, Compensation carbone. La fabrique d’un marché contesté, Sorbonne Université Presses, 2021 ; Augustin Fragnière, La compensation carbone : illusion ou solution ?, PUF, 2009.
- À la lecture de ces lignes, un confrère commente : « Je ferais l’hypothèse de l’aliénation, d’un mélange subtil entre : une cohabitation morbide et résignée des individus avec le spectacle désolant de l’hégémonie capitaliste ; une anxiété de réussite-survie dans un système qui broie les derniers de cordée ; et un renoncement intellectuel face à une société qui ne mobilise plus la raison (science) et l’éthique pour gouverner. ».
- Charlotte Malterre-Barthes, A moratorium on new construction, Steinberg Press, 2025.
- Philippe Simay, Bâtir avec ce qui reste, Terre Urbaine, 2024.
- Philippe Madec, Mieux avec moins, Terre Urbaine, 2021.
- « Dé-designer », appel à contributions de la Revue Azimuts – Design Art Recherche.
- Mathias Rollot, « Onze pistes vers une métamorphose décoloniale de l’architecture », AA’, 2025.
- Solène Marry (dir.), Architectures low-tech. Sobriété et résilience, Parenthèses/Ademe, 2025 ; Mireille Roddier, « Degrowth, Energy Sobriety, Low-Tech : Towards an Architecture of Conviviality », Places Journal, 2024.
- Mathias Rollot, « Pourquoi enseigner l’alternatif ? », AMC, 2024.
- Mathias Rollot, « Urgence écologique : quel impératif éthique pour la recherche architecturale ? » (document pdf), dans Emeline Curien, Cécile Fries-Paiola (dir.), Humains, non-humains et crise environnementale, Rencontres interdisciplinaires Mutations 02, ENSA Nancy,mars 2021 ; Mathias Rollot, « Pourquoi chercher ? » (document pdf), La Recherche architecturale, éditions de l’Espérou, 2019, pp. 263-300.
- Sur le greenwashing et le « greenwishing » en architecture, voir l’introduction du livre Charlotte Malterre-Barthes (éd.), « On Architecture and Greenwashing », The Political Economy of Space Vol. 01, Hatje Cantz, 2024.
- Fatima Ouassak, Pour une écologie pirate. Et nous serons libres, La Découverte, 2023, pp. 24-25.
- Mathias Rollot, Décoloniser l’architecture, Le Passager Clandestin, 2024.
- Très intéressante est, à cet égard, la contribution d’Hélène Jannière au récent ouvrage collectif La Critique à l’œuvre. En appui sur les discours de Pierre Joly (1925-1992), l’historienne montre bien à quel point les années 1960 pouvaient déjà souffrir d’une « absence de critique » architecturale, de « discussions restées intérieures à la discipline » et plus globalement d’un « entre-soi » appauvrissant pour l’architecture, pour les architectes et pour la société elle-même. Hélène Jannière, « à la recherche de l’opinion publique : polémiques françaises sur la critique, 1958-1969 », dans Denis Bilodeau, Louis Martin, La Critique à l’œuvre. Fragments d’un discours architectural, éditions de la Villette, 2025, pp. 20-42, p. 21.
- Stella Baruk, L’Age du capitaine. De l’erreur en mathématiques, Seuil, 1998.
L’article En finir avec l’« architecture-as-usual » est apparu en premier sur Terrestres.
19.07.2025 à 11:27
Depuis le delta du Pô, regarder en face la crise climatique
De l'assèchement à la submersion, il n'y a souvent qu'une brève parenthèse. Dans ce texte mosaïque, un collectif de chercheurs et d'écrivains italiens enquête sur la manière dont le changement climatique et la montée du niveau de la mer bouleverse un territoire, le Delta du Pô, dont l'histoire récente est intimement liée à la gestion industrielle de ses eaux.
L’article Depuis le delta du Pô, regarder en face la crise climatique est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (12375 mots)
Ce texte a été distribué pour la première fois, sous la forme d’une brochure le 31 octobre 2024, à la Factory Grisù de Ferrare, lors de la première présentation du roman Gli uomini pesce par Wu Ming 1 (Einaudi, 2024). La diffusion du document s’est poursuivie en novembre, à l’occasion d’autres événements dans la Basso Ferrarese1, dans la Polésine et au nord de Bologne. Il a été publié pour la première fois en ligne sur le site Giap et nous espérons qu’il voyagera, qu’il provoquera des discussions et qu’il sollicitera des commentaires dans d’autres territoires.
Il a été écrit par un groupe informel et pluridisciplinaire et il est le premier fruit de deux années de discussions, de lectures partagées et surtout d’errances dans les territoires décrits ici.
Bonne lecture, bonnes déambulations.
Ce texte a été écrit par Sandro Abruzzese (enseignant et écrivain) ; Marco Belli (enseignant, écrivain et photographe, directeur artistique de l’Elba Book Festival) ; Davide Carnevale (enseignant-chercheur en anthropologie visuelle, Université de Ferrare) ; Cassandra Fontana (chercheuse en études urbaines, Université de Florence) ; Sergio Fortini (architecte-urbaniste, cofondateur de Metropoli di Paesaggio) ; Marco Manfredi (comédien, vagabond, spécialiste des relations entre cinéma, récits et territoire) ; Michele Nani (historien, chercheur au CNR — Ferrare) ; Giuseppe Scandurra (anthropologue, Université de Ferrare) et Wu Ming 1 (écrivain et essayiste, originaire du Basso Ferrarese).
La présente traduction de l’italien a été réalisée par Michele Nani et Niccolò Mignemi.

Carte du delta du Pô, réalisée par les auteur·es. Pour visualiser la situation de l’Italie nord-orientale en 2100 avec la mer Adriatique plus élevée d’un mètre par rapport au niveau actuel, voir le projet interactif élaboré par l’artiste Alex Tingle depuis 2006.
On raconte qu’au siècle dernier, dans les mines de charbon de diverses régions du monde, face au danger du grisou et en l’absence de systèmes de ventilation, les mineurs emportaient avec eux un canari en cage. Beaucoup plus petit et donc plus sensible au gaz, le canari commençait à agoniser bien avant que les mineurs ne ressentent les effets de ce qu’ils inhalaient. Lorsque l’oiseau commençait à suffoquer, c’était le signe qu’il fallait évacuer la mine.
D’où la métaphore bien connue du « canari dans la mine », également utilisée par le météorologue Luca Mercalli lors d’une conférence donnée il y a quelques années dans un centre du Basso Ferrarese2. Le Delta est le canari, c’est-à-dire la zone la plus exposée, celle qu’il faut regarder pour mieux comprendre les effets du changement climatique.
Dans le Delta
1. Par Delta du Pô, on entend ici…
Par Delta du Pô, nous entendons le delta historique, ou Delta grande, c’est-à-dire l’espace géographique façonné au fil des siècles par les crues et les débordements du fleuve et par le déplacement progressif de son bras principal vers le nord.
Le Delta grande est un ensemble de lits où le fleuve coule encore, d’autres — souvent invisibles à l’œil nu — qu’il a abandonnés et d’autres encore qui sont devenus artificiels, c’est-à-dire transformés en canaux, comme ce fut le cas pour la branche du Pô de Volano.
Le Delta grande n’a pas de frontières nettes, mais il comprend certainement la partie orientale de la zone de la Polésine de Rovigo, la partie orientale de la province de Ferrare et une partie du territoire de Ravenne. Le long de la côte, il s’étend de la limite nord de la municipalité de Rosolina — le dernier tronçon du fleuve Adige — à la limite sud de la municipalité de Cervia. Près d’un million de personnes vivent dans cette zone, en ne comptant que les résidents.
Le Delta est une région géo-historique, géo-économique et géo-culturelle aux caractéristiques propres. Il se distingue par la présence de zones humides résiduelles — qui ont échappé aux travaux d’assèchement et drainage — ainsi que par des risques hydrauliques propres et par sa morphologie de plaine ininterrompue, différente du reste de l’Italie, pays composé en grande partie de montagnes et de collines3.
2. Des impasses communes
Les territoires du Delta ont des histoires et des problèmes similaires. Ils ont également en commun d’avoir emprunté des voies sans issue, d’avoir misé sur des modèles de développement local qu’il convient aujourd’hui de repenser : le tourisme balnéaire de masse, une certaine agriculture intensive, un certain développement industriel. Certains modèles se sont avérés depuis longtemps des échecs, et les territoires les ont payés par l’émigration et le dépeuplement ; d’autres ont généré des retombées économiques pendant quelques décennies, mais se révèlent aujourd’hui insoutenables, voire catastrophiques.
C’est le cas de la basse vallée du Pô qui, à partir du XIXe siècle, est passée de zone humide à une vaste étendue de terres cultivables. Un processus qui ne peut jamais être considéré comme achevé, mais reste ouvert et toujours réversible, ce qui rend la zone du Delta particulièrement fragile à divers égards, aussi bien environnementaux que sociaux.
3. Dans la terre de la bonifica
Nous avons grandi, nous nous sommes installés ou nous travaillons aujourd’hui sur des terres transformées par la bonifica4. Nous avons vécu ou nous sommes passés tous les jours devant les stations de drainage et les autres technologies de gestion des eaux, mais pendant longtemps nous n’y avons pas prêté attention, pendant longtemps nous avons tenu pour acquise cette utilisation des terres, ce complexe « territoire-machine », pour citer la géographe Federica Letizia Cavallo5.
Cette terre, la partie émergée, le paysage de la basse plaine, était pour nous une évidence alors que nous vivions dans une parenthèse entre des terres qui ont été submergées et qui, mutatis mutandis, le seront à nouveau.

4. Les parenthèses s’ouvrent et se referment
En rapportant chaque durée à celle de notre vie, nous percevons comme anciens des phénomènes qui, en fait, ne se sont manifestés que récemment, peut-être peu avant notre naissance. Pour les mêmes raisons, nous tenons ces phénomènes comme acquis et percevons les processus dont ils dépendent comme achevés, définitifs, alors qu’ils sont toujours en cours et plus ouverts que jamais.
Depuis le siècle dernier, l’idée d’une temporalité unique et linéaire a été remise en cause dans tous les domaines de la connaissance. Elle ne survit que dans l’idée de développement qui anime les politiques économiques. Mais les temporalités sont multiples, les parenthèses s’ouvrent et se referment, elles se situent à l’intérieur ou à côté d’autres parenthèses. L’histoire du monde est une coprésence de temporalités.
5. On ne comprend pas vraiment la bonifica si…
On ne comprend pas vraiment la bonifica, dans ses différentes phases, et l’héritage qu’elle nous a laissé, si nous ne tenons pas compte de ses contradictions internes, de la façon dont elle s’est imposée, des résistances qu’elle a dû abattre et de celles qui l’ont arrêtée au fur et à mesure que la situation et les sensibilités évoluaient.
Dans les discours actuels sur la bonifica, une erreur de raisonnement connue sous le nom de biais des survivants opère : pour évaluer une situation, on ne considère que les éléments résultants d’un processus de sélection ; cependant, ces éléments ne véhiculent pas nécessairement plus d’informations par rapport à ceux qui n’ont pas survécu. Ce qui a été occulté, et qui est resté longtemps en dehors de la représentation dominante, il est aussi bien un objet de recherche historique et un vecteur de savoir. Une fois sorties de l’oubli, ces histoires nous parlent, enrichissent notre connaissance et notre capacité de transformer le réel.
Au XIXe siècle, le Delta et, plus en général, la partie nord-orientale de l’Italie connurent une résistance populaire à la bonifica qui effaçait brutalement les biens communaux, les droits collectifs et les économies locales, en faisant éclater les communautés. Grâce à l’historien Piero Brunello, nous connaissons désormais les luttes contre la bonifica – menées entre 1853 et 1861 – dans les valli6 de Cona et de Cavarzere, deux communes aujourd’hui situées dans la ville métropolitaine de Venise7. Nous pouvons également citer l’opposition d’une partie de la population de Massa Fiscaglia, dans le territoire du Basso Ferrarese, à la bonifica de la valle Volta, une lutte menée par tous les moyens et qui a duré de 1874 à 18808.
D’autres batailles, conduites cette fois-ci par des associations de protection de l’environnement et du territoire comme Italia Nostra, furent menées exactement cent ans plus tard, au milieu des années 1970, dans le Delta de Ferrare, lorsqu’il apparut distinctement que l’Ente Delta Padano9 était en mode pilote automatique, avec l’intention d’assécher toutes les zones humides encore existantes, en premier lieu les valli de Comacchio, au nom de modèles de développement qui commençaient à montrer des signes d’essoufflement. Le changement de perception et la prise de conscience fut un facteur déterminant, au point que la dernière vague prévue de bonifica n’eut finalement pas lieu10.
6. Des connaissances « augmentées »
Cette connaissance « augmentée » s’enrichit de ce qui n’était pas connu à l’époque et qui est aujourd’hui un fait acquis : les zones humides font partie des écosystèmes qui stockent le mieux le dioxyde de carbone : un marais en séquestre cinq fois plus qu’une forêt. Les zones humides ne couvrent que 1% de la surface de la planète, mais elles captent cinq-cents fois plus de CO2 que les océans11.
Rétrospectivement, l’assèchement des marais et des valli dolci et salse12 a contribué à accélérer le réchauffement climatique. Cette prise de conscience, parmi tant d’autres aujourd’hui indispensables, suggère la nécessité d’étudier les expériences de restauration des zones humides dans le territoire du Delta du Pô comme ailleurs dans le monde, afin de façonner les pratiques d’intervention futures.
Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Inondations et barrages dans la Vallée de la Vesdre : l’aménagement du territoire en question » de Marie Pirard, juin 2023.
7. Une autre parenthèse : vivre sur le littoral
La « littoralisation » de la population, un phénomène qui s’est surtout produit au XXe siècle, est également une parenthèse. Aujourd’hui, nous constatons que le niveau de la mer monte, et sa montée est un problème car le phénomène touche aussi les agglomérations, parfois densément peuplées. Il fut un temps où, à l’exception de quelques villes portuaires, les côtes étaient vierges de toute présence humaine : à l’époque, nous n’aurions pas remarqué la montée, alors qu’aujourd’hui cette parenthèse des côtes peuplées risque de prendre fin de manière catastrophique.

8. Poubellocène
Nous devons à l’historien de l’environnement Marco Armiero le concept de poubellocène13, pour signifier non seulement l’ère de l’immense accumulation d’ordures, mais aussi l’ère centrée sur les déchets, comprise comme des relations d’exclusion, au sein desquelles certaines communautés et localités sont désignées comme susceptibles d’être sacrifiées. Sur ces communautés sont déversés, souvent littéralement, les « coûts externes » du développement, c’est-à-dire la pollution, les résidus toxiques, les marchandises qui ont atteint la fin de leur cycle de vie et deviennent des déchets.
Par sa nature et sa situation, le Delta est aujourd’hui l’avant-dernier réceptacle — le dernier étant la mer Adriatique — des coûts externes du développement dans la plaine du Pô. Il l’est matériellement, parce que le Pô et d’autres cours d’eau rejoignent la mer remplis de pollutions industrielles et agro-industrielles, et culturellement, parce qu’il est l’expression d’une Italie mineure et subalterne.
Dans l’histoire de l’Italie, les pouvoirs publics ont essayé de faire de la plaine du Pô la zone industrielle par excellence. Pour atteindre ces résultats, des millions de personnes ont été poussées à émigrer, d’abord des zones internes du Nord lui-même, puis du Mezzogiorno, exacerbant les déséquilibres déjà existants entre le Nord et le Sud de l’Italie, enfin depuis l’Europe de l’Est et le Sud du monde.
Aujourd’hui, le territoire paie pour ces choix et doit faire face à des politiques économiques qui l’ont dévasté et à des concentrations méphitiques de particules. La plaine du Pô est de loin la zone la plus polluée d’Europe occidentale et l’une des plus polluées de tout le continent14. C’est la zone qui compte le plus grand nombre de décès prématurés causés par des concentrations excessives d’ozone, de NO2 (dioxyde d’azote) et de PM2,5 (particules)15. C’est de loin la zone la plus bétonnée du pays16.

Le Basso Ferrarese
9. Une focalisation territoriale précise
Une focalisation territoriale précise est nécessaire pour penser et agir dans un lieu donné. En même temps, cet effort centripète n’a de sens que s’il a aussi des effets centrifuges. Il s’agit de commencer par le Basso Ferrarese et, en même temps, élargir le champ d’action à l’ensemble du Delta du Pô et au-delà.
Le Basso Ferrarese va du chef-lieu de la province à la mer et se situe entre deux fleuves : le Pô au nord et le Reno au sud. Le Pô et le Reno sont des frontières ouvertes : revenons à la conception des fleuves tels qu’ils étaient autrefois : des lieux de passage et d’échange.
10. Le territoire avec les sols les moins artificialisés
La grande anomalie du Basso Ferrarese, une anomalie qui peut aujourd’hui être tournée à son avantage, est que pour diverses raisons — non pas du fait des vertus de ses administrateurs, mais de dynamiques historiques complexes — il est resté le territoire avec les sols les moins artificialisés de toute la plaine du Pô, exception faite bien sûr de la blessure des Lidi, ce littoral marqué par la présence d’établissements balnéaires, où la spéculation immobilière a commencé dans les années 1960 et s’est accélérée à partir des années 1980.
11. « Rien à voir » ?
Celui du Basso Ferrarese est un paysage en large partie « aménagé », construit par la bonifica. À un premier regard, il peut paraître parfaitement plat et vide, dépourvu de tout signe particulier, de ce que le géographe Eugenio Turri appelait des « iconèmes17 ».
« Il n’y a rien à voir », tel est le cliché que nous entendons renverser grâce à nos pérégrinations car c’est au fil des regards que ce territoire surprend, se révélant plein de détails, marqué par des lignes, subtilement entaillé par des dénivelés (berges, bassins de valli asséchées, anciens lits de fleuves), des réalités cachées et des « zones d’incertitude ». Et les iconèmes sont nombreux, à partir des artefacts de la bonifica jusqu’aux maisons abandonnées dont la province est aujourd’hui remplie.
En outre, les espaces naturels et protégés couvrent 13 % du territoire de la province. Ils sont pour la plupart des zones humides qui ont survécu à la fièvre du drainage.
Mais il ne faut pas oublier non plus certains interstices le long du grand fleuve, des interzones sans juridiction où l’on ne sait pas ce qui se trame, des lieux où des communautés inattendues s’arrêtent et s’installent.
12. Dépaysements
L’émigration, la raréfaction sociale qui en résulte et la perte de sens de l’habiter ont créé une sens de dépaysement. En un mot, celles et ceux qui vivent dans ces landes ne connaissent plus le territoire. Il est nécessaire de le re-connaître car, même sans en être pleinement conscient, on se sent dépossédé.
Pour réfléchir à l’organisation politique et sensible autour des fleuves, vous pouvez lire aussi dans Terrestres le texte collectif « Pour un Conseil Diplomatique des Bassins-Versants », avril 2024.
Territoires en marge, territoires inexprimés
13. Sans voix
Le Delta du Pô est un territoire marginal, un territoire inexprimé. Les territoires en marge sont des espaces subalternes — économiquement, socialement, culturellement — au monde urbain et aux imaginaires métropolitains, à une seule et unique idée de la modernité. Subalternes, donc incapables — reprenons ici une catégorie du sociologue Franco Cassano — d’être des sujets de pensée. Ces territoires ont du mal à trouver leur propre voix malgré leurs spécificités et leurs particularités, au point que leur avenir reste inexprimé.
Dans ces régions, les dysfonctionnements de la modernité ne trouvent pas leur explication dans des raisons structurelles, mais plutôt dans des stéréotypes et des préjugés. Il en résulte des complexes d’infériorité et des pulsions à l’émulation : des villes et de la civilisation technologique, on emprunte l’amour du pouvoir et de tous les signes de « réussite ». Des zones de prospérité économique, on tire des modèles prétendument « exportables » : l’histoire des Lidi Ferraresi, reproduction maladroite et tardive d’un modèle de tourisme à fort impact environnemental, en est un exemple18.
Faute de pouvoir répondre à l’imaginaire médiatique, à une représentation unidimensionnelle du monde et aux attentes des jeunes générations, les territoires en marge sont frappés par le dépeuplement, l’abandon, les dépressions, l’anomie. Ils subissent des processus et des projets d’en haut et troquent la chimère de l’emploi contre la pollution, contre les grands chantiers, éventuellement contre le fait de devenir un dépôt pour les déchets dangereux. En Italie, les territoires marginaux se trouvent dans les Apennins, dans les Alpes, sur les îles, le long des frontières, dans les basses terres déprimées.
14. L’attente perpétuelle de pseudo-solutions
Dans la crise climatique, les territoires en marge se trouvent ébranlés et abasourdis. Ils subissent les conséquences immédiates de cette crise, alors que leur situation de départ est déjà défavorisée. Ils sont victimes de modèles hétéronymes. Influencés par de lourdes interdépendances, ils ne peuvent pas s’exprimer en tant que sujets capables d’une pensée autonome. Ils n’ont droit qu’à attendre des solutions venues de l’extérieur, toujours pensées comme des techno-raccommodages.

Ce qui arrive
15. Le retour de la mer
Toute la côte occidentale de la Haute Adriatique et les plaines de son arrière-pays sont des territoires en équilibre face à l’aggravation de la crise climatique. Un nombre croissant d’études confirment qu’au cours du XXIe siècle, l’élévation du niveau de la mer Adriatique (eustatisme) — combinée à l’affaissement de la surface terrestre et à d’autres phénomènes en cours — dévastera toute la région, des Marches jusqu’au golfe de Trieste.
16. Les barrages et le vénitiano-centrisme
Pendant des décennies, le discours public national s’est concentré sur Venise, un lieu emblématique en matière de montée des eaux.
Certains espèrent qu’avec les barrages mobiles du MOSE (Modulo Sperimentale Elettromeccanico), le problème sera en grande partie résolu. Mais les prémisses même de cette approche sont biaisées par ce qu’Evgeny Morozov appelle le « solutionnisme technologique », avec la suppression des symptômes sans diagnostiquer le mal, c’est-à-dire l’illusion que les effets peuvent être atténués sans intervenir sur les causes19.
En outre, le débat sur le MOSE a toujours été « Venise-centré », comme si la lagune de Venise ne faisait pas partie d’un système beaucoup plus vaste de zones humides et de territoires en équilibre entre la terre et l’eau. Au contraire, si Venise a une valeur, c’est en tant que synecdoque, en tant que partie d’un tout. Au nord et au sud de la ville, sur plus de trois cents kilomètres de littoral, le territoire risque de subir le même sort. La différence est qu’il court ce risque dans le silence et l’inconscience générale. Et à quoi va servir le MOSE si l’eau entre et se répand tout autour ?
17. Au-delà du chiffre rond
Les estimations vont de +80 à +140 centimètres de montée de la mer Adriatique d’ici 210020. Des cartes topographiques ad hoc montrent la situation hypothétique cette année-là : le littoral actuel a disparu, l’eau a pénétré dans l’arrière-pays, elle a même gagné — dans certaines régions, comme les provinces de Ferrare et de Rovigo (la Polésine) — des dizaines de kilomètres21.
Le chiffre rond de 2100 contribue à produire un instantané, au sens multiple du terme : une secousse soudaine, un pas en avant rapide dans la perception du problème et un instantané d’un moment dans le temps qui permet une vue d’ensemble ; dans le même temps, il détourne l’attention du fait que ces processus sont déjà en cours et se poursuivront même après cette date.
18. Les conséquences
Abandon des agglomérations côtières et de l’arrière-pays proche. Migrations climatiques vers d’autres régions d’Italie ou vers l’étranger. Perte de milliers d’hectares de terres agricoles. Perte de nappes d’eau potable. Destruction des écosystèmes d’eau douce et des zones naturelles et protégées, telles que les deux parcs régionaux du Delta du Pô, la lagune de Venise, les lagunes de Marano et de Grado, etc. Un changement climatique radical.
19. Il ne s’agit pas seulement d’eau
Il est important de garder à l’esprit qu’on ne parle pas d’« eau », mais de boues toxiques et contaminées. Le littoral de l’Adriatique-nord est densément urbanisé et industrialisé. Avec la montée des eaux, la mer pénètrerait dans des zones bâties, elle ferait donc voler en éclats les égouts, elle entraînerait des déchets, des produits chimiques, des carburants, des plastiques de toute sorte, des carcasses d’animaux, comme elle l’a déjà fait en 2023 et en 2024. Ce que l’on a vu à Conselice, bourg de la Romagne submergé pendant des semaines par la boue chargée de toutes sortes de poisons et de cocktails bactériologiques, sera amplifié de plusieurs ordres de grandeur.
La crue la plus impétueuse d’un cours d’eau des Apennins n’est rien comparée à la masse d’eau d’une mer : non seulement la pollution de l’Adriatique augmenterait de façon exponentielle, mais elle créerait des « grands Conselice », de vastes zones « amphibies » emprisonnées dans la boue, dont les miasmes se propageraient sur plusieurs kilomètres alentour.
20. En attendant…
C’est le scénario envisagé en l’absence totale d’action. En attendant, la montée des eaux est déjà en cours et considérée, dans une large mesure, comme inéluctable. Elle est déjà en train de se produire.

Ce qui se passe déjà
21. Les avant-gardes de l’avancée de la mer
Biseau salé, orages de plus en plus intenses et tempêtes de mer sont les signes avant-coureurs de la mer qui avance, et les manifestations de la crise climatique elle-même.
I. Biseau salé : en période de sécheresse, les rivières s’affaiblissent, la mer remonte les cours d’eau et les remplit de sel, avec de graves répercussions sur les écosystèmes, l’agriculture et les nappes d’eau potable.
II. Tempêtes, souvent de type downburst, fréquemment confondues avec les tornades. Leur intensité et leur fréquence accrues sont un symptôme du nouveau climat. L’Adriatique devient plus chaude : au cours de l’été 2024, elle a atteint plusieurs fois 30°C. Cela augmente l’évaporation et l’humidité dans l’atmosphère. Lorsque des courants plus froids arrivent, leur impact sur l’air chaud et humide libère de grandes quantités d’énergie et provoque de violentes précipitations. C’est ce que les médias italiens appellent les bombe d’acqua (bombes d’eau).
III. Affaissement et érosion des côtes : alors que le sol continue de s’affaisser en raison d’une combinaison de causes naturelles et anthropiques, l’artificialisation des sols et l’impact du tourisme intensif érodent le littoral, qui est de plus en plus vulnérable aux tempêtes de mer et à d’autres événements « extrêmes », qui en réalité sont désormais récurrents et font partie d’une nouvelle « normalité ».
22. Les « infos » sont un problème
Les médias « décomposent » la crise climatique en unités isolées, en épisodes distincts appelés « nouvelles » mais bénéficiant d’une attention et d’un accent inégal. Par exemple, la sécheresse et les bombe d’acqua sont des moments d’un même phénomène, appelé whiplash effect ou effet coup de fouet, mais la première attire moins l’attention que les secondes.
La sécheresse menace notre avenir de manière différée, des reportages lui sont consacrés avec des images de rivières asséchées, mais elle ne crève pas l’écran, surtout en ville, loin des lieux de production de la nourriture et des écosystèmes en souffrance. Tant que l’eau sort du robinet à la maison, le problème n’est pas suffisamment perçu.
Les tempêtes et les inondations, en revanche, nous touchent immédiatement et directement. Leurs effets sont visibles et tangibles, de sorte que leur couverture médiatique met en avant la dimension choquante, émotionnelle, sensationnaliste et généralement déconnectée de la sécheresse. Cette séparation nous empêche de saisir le lien intime entre les deux phénomènes et la totalité du processus.

23. Il ne faut pas défendre le territoire tel qu’il est aujourd’hui
Il n’est pas possible de faire face à ce qui se profile en prolongeant les mêmes logiques du présent. Ces logiques ont engendré la catastrophe, en s’appuyant sur des expédients éphémères et des escamotages technologiques. La crise climatique n’est pas un problème d’inadéquation technologique momentanée : c’est une crise sociale, le résultat d’un modèle socio-économique erroné, l’accumulation des contradictions dans le mode de production actuel.
La logique du raccommodage, du solutionnisme technologique pour défendre l’existant est totalement inadaptée.
La réponse la plus simple et la plus rapide à ce qui se profile sera d’installer des barrages et des vannes mobiles dans le style du MOSE, d’augmenter et de rendre plus puissantes les stations de pompage etc.
Tout cela vise à défendre le territoire tel qu’il est aujourd’hui. Mais « tel qu’il est aujourd’hui » est justement une partie du problème. Ce que nous dit la crise climatique, c’est que le territoire doit être radicalement repensé et transformé.
Une « fédération » de territoires inexprimés serait le sujet le plus qualifié pour une telle refonte, capable de dessiner une ligne d’horizon plausible pour intervenir.
24. L’inconscience
Dans les territoires qui subiront l’avancée de l’Adriatique d’ici 2100, la prise de conscience de la situation va de minime à inexistante. L’inadéquation des connaissances et de la perception face à la catastrophe climatique n’est certainement pas un problème uniquement local : il est planétaire. Mais dans les zones qui nous occupent, il présente des caractéristiques particulières.
25. Quatre mises au point
Nous sommes en train de raisonner et de formuler des hypothèses sur les modes d’intervention, en alternant quatre échelles différentes.
Territoires en marge → Zone nord-adriatique → Delta du Pô → Basso Ferrarese
Le Delta comme lieu d’expérimentation au cœur de la crise climatique (Notes)
26. Quand le Delta était une cause à défendre
Au début des années 1950, une nouvelle génération d’intellectuels et d’artistes de Ferrare et d’ailleurs décida de s’occuper du Delta et d’en faire un enjeu majeur dans le débat national. Ces personnalités firent du Delta leur « question méridionale22 ». En voyageant vers l’est, ils découvrirent leur « Sud », un territoire marginal situé à quelques dizaines de kilomètres de leur ville.
De cette mobilisation culturelle et politique, il demeure d’actualité l’intention de transformer la perception d’un territoire « en marge » en un lieu central d’analyse, de changement et de revanche sociale.
27. Soixante-dix ans plus tard
Soixante-dix ans plus tard, il est à nouveau nécessaire de remettre le delta du Pô au cœur des débats. Les conditions ont changé radicalement et nous en sommes conscients : dans les années 1950, derrière les intellectuels du Delta, il y avaient des partis de gauche, des forces syndicales et d’autres sujets collectifs proches du mouvement ouvrier et de la grande force représentée par la masse des braccianti. Derrière nous, à l’heure actuelle, il n’y a rien de comparable. Mais cela ne peut pas être un alibi.
28. Miser sur les spécificités du territoire : réinonder, naturaliser
Aujourd’hui, contrairement à hier, il ne s’agit certainement pas d’invoquer la bonifica. Au contraire, il faut aller à l’encontre de ce modèle : le territoire bénéficierait grandement — en termes de biodiversité, de capture de CO2, d’inauguration de différents modèles socio-environnementaux — d’un réalignement progressif et d’une renaturalisation contrôlée au moins dans les zones asséchées au cours de la seconde moitié du XXe siècle, comme les valli du Mezzano. Bien entendu, ces terres devraient d’abord devenir propriété publique ; ensuite, leur transformation devrait s’inspirer de la deuxième acception du verbe bonificare : « ramener un territoire fortement pollué à des conditions d’équilibre naturel » (Dictionnaire De Mauro de la langue italienne).
29. Décimenter, restaurer
Il est tout aussi urgent de décimenter le littoral afin d’éviter le scénario décrit au point 19. Dans les zones libérées du béton, les écosystèmes antérieurs devraient être restaurés autant que possible, ce qui signifie libérer les rares dunes qui subsistent de la pression de l’urbanisation et les reconstituer là où elles ont été rasées. C’est l’une des meilleures défenses contre la montée de la mer Adriatique.
Certains demandent : « Qu’en sera-t-il de l’économie des Lidi ? ». On peut leur répondre que les emplois dans le secteur du tourisme intensif — souvent précaires, surexploités, sous-payés, au noir — seront remplacés par de nouveaux emplois moins frustrants, ceux générés par un grand projet de réhabilitation et de réaménagement écologique du territoire, suivis d’un travail permanent d’entretien des écosystèmes : des activités en accord avec les caractéristiques spécifiques de ces lieux.
30. Ce ne sont que quelques exemples
Ce ne sont que quelques exemples de la manière dont on peut tirer parti des spécificités du territoire, de sa conformation et de son histoire, voire de sa fragilité, pour en faire un formidable lieu d’expérimentation au cœur de la crise climatique, même en termes d’aménagement du territoire.
31. Pas besoin d’escamotages
Cela n’a rien à voir avec le solutionnisme technologique. Ce que nous préfigurons, ce ne sont pas des « coup de génie », mais des solutions ouvertes, lentes, non orientées vers le profit. Surtout, elles partent de l’identification des causes sociales et politiques de la crise et se détournent des modèles suivis jusqu’à présent.

32. Rapports de force
C’est une question de rapports de force. C’est précisément parce qu’ils se heurtent à l’existant que ces scénarios peuvent paraître inacceptables à la grande majorité des administrateurs et, surtout, aux dirigeants de nombreuses associations professionnelles. Il faut cependant rappeler que toutes les réformes sociales, même les plus banales aujourd’hui (école de masse ? retraites ? suffrage universel ?), sont nées de propositions à première vue subversives et utopiques.
33. Prolonger
Ces propositions, calibrées sur la partie émilienne-romagnole du Delta, peuvent être étendues, en les remodelant, à l’ensemble du Delta et à toute la zone nord-adriatique.
Cette façon de formuler les problèmes et de préfigurer des solutions peut être utile à celles et ceux qui agissent dans d’autres territoires en marge et non exprimés, en Italie et ailleurs dans le monde.
34. Faire pleuvoir à l’envers
Par une lutte consciente, les territoires en marge peuvent nous rendre une partie de ce que nous avons perdu : environnement, écologie des relations, durabilité des modes de vie. Dans un monde où tout nous tombe dessus d’en haut, agir dans les territoires en marge signifie la possibilité, pour citer le regretté écrivain, journaliste et activiste Luca Rastello, de faire pleuvoir à l’envers23. Ainsi, par exemple, le monde conçu comme une maison commune conduit à s’opposer à l’exclusion, la connaissance comme forme de participation à l’imposition technocratique, le soin de l’humain et de son environnement à la négligence néolibérale.
35. Un long voyage
Ce document se voudrait le premier étape d’un long parcours, à la fois multidisciplinaire et interstitiel, lancé pour générer des doutes avant même d’apporter des réponses, conscients qu’il n’est pas facile, d’un point de vue émotionnel, d’accepter l’urgence d’un changement aussi délicat qu’inéluctable.
Les modes de vie, les dynamiques de travail et les relations sociales sont destinés à se transformer : les communautés — à commencer par les plus marginales en apparence, qui sont en réalité des avant-postes conflictuels décisifs — doivent alors revendiquent leur centralité dans le processus pour gouverner et orienter l’inévitable changement de paradigme. Elles doivent endosser une responsabilité sociale et culturelle, fondement d’une société qui veut se penser comme « civile ».

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
Notes
- Partie orientale de la province de Ferrare, située dans le territoire du Delta du Pô.
- Mercalli a donné une conférence dans le cadre de la 71e édition de la Fiera di Migliarino, en septembre 2018. On trouve également une référence au « canari d’alarme » dans Canzone della nocività de Paolo Ciarchi et Dario Fo, pour le spectacle Ordine ! Per DIo,ooo.ooo.ooo (1972).
- Les données de l’institut national de la statistique (ISTAT) sur les zones altimétriques, provenant des bureaux provinciaux de l’Agenzia del territorio (sur la base des plans cadastraux), indiquent que les collines et les montagnes occupent respectivement 42% et 35% du territoire, pour un total de 77% (ISTAT, Annuario statistico italiano, 2023, « Territorio », chapitre 1, p. 8).
- Le terme italien bonifica désigne ici l’assèchement des terres marécageuses (bonifica delle paludi), mais il signifie plus largement l’amélioration, la mise en valeur des sols pour les activités humaines (NDLR).
- Federica Letizia Cavallo, Terre, acque, macchine. Geografie della bonifica in Italia tra Ottocento Novecento, Diabasis, 2011.
- Dans le contexte de la plaine orientale du Pô, le terme italien valle (ou valli, au pluriel) ne désigne pas une vallée de montagne mais plutôt une « dépression marécageuse située près du delta d’un fleuve ou d’une lagune » (Grande dizionario della lingua italiana, v. 21, p. 640).
- Piero Brunello, Ribelli, questuanti e banditi: Proteste contadine in Veneto e in Friuli 1814-1866, Cierre edizioni, 2011 [1e éd. 1981].
- Alessandro Roveri, Dal sindacalismo rivoluzionario al fascismo. Capitalismo agrario e socialismo nel Ferrarese, 1870-1920, La Nuova Italia, 1972.
- Organisme créé sous le contrôle du ministère de l’Agriculture et des Forêts pour mettre en œuvre, dans le territoire du delta du Pô, la loi de 1950 qu’en Italie on appelle traditionnellement de « réforme agraire ».
- Aucune publication monographique sur cet épisode n’existe encore. Voir Giorgio Bassani, « Il litorale emiliano-romagnolo : Problemi e prospettive », Bollettino di Italia Nostra, XII, 75-76, septembre-octobre 1970, Associazione Italia Nostra, Rome, p. 27-29. Republié dans Giorgio Bassani, Italia da salvare. Gli anni della Presidenza di Italia nostra (1965-1980), Feltrinelli, 2018; Piero Dagradi et Bruno Menegatti, Ricerche geografiche sulle pianure orientali dell’Emilia Romagna, Pàtron, 1979.
- Données issues de : R. J. M. Temmink, L. P. M. Lamers, C. Angelini, T. J. Bouma, C. Fritz, J. Van De Koppel, R. Lexmond, M. Rietkerk, B. R. Silliman, H. Joosten et T. Van Der Heide, « Recovering wetland biogeomorphic feedbacks to restore the world’s biotic carbon hotspots », Science, 376(6593), eabn1479, 2022.
- Les valli se distinguaient par la qualité de leurs eaux : dans les dolci (douces), on cultivait le roseau ; dans les salse (salées, plutôt saumâtres et légèrement salées), on pratiquait la pisciculture.
- Marco Armiero, Poubellocène. Chroniques de l’ère des déchets, Lux Éditeur, 2024 (traduit depuis l’édition anglaise de 2021).
- Matthew Taylor et Pamela Duncan, « Revealed : almost everyone in Europe is breathing toxic air », The Guardian, 20 septembre 2023. « Eastern Europe is significantly worse than western Europe, apart from Italy, where more than a third of those living in the Po valley and surrounding areas in the north of the country breath air that is four times the WHO figure for the most dangerous airborne particulates ».
- Selon le rapport 2023 de l’Agence européenne pour l’environnement, environ 46 800 décès causés par les particules PM2,5 ont été enregistrés en Italie en 2021, dont 14 000 dans la seule plaine du Pô (89 pour cent mille habitants).
- La plaine du Pô s’étend précisément à l’intérieur des frontières administratives des quatre régions italiennes — la Lombardie, la Vénétie, le Piémont et l’Émilie-Romagne — les plus bétonnées d’après les rapports annuels de l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale sur l’artificialisation des sols.
- Eugenio Turri, Semiologia del paesaggio italiano (1e éd), Marsilio, 2014. Voir aussi son article dans l’ouvrage collectif Mimmo Jodice et Eugenio Turri (dir.), Gli iconemi. Storia e memoria del paesaggio, Electa, 2001.
- Carlo Cencini, « Il litorale ferrarese : dai Lidi al Parco del Delta », in Forme del territorio e modelli culturali in Emilia-Romagna : per una nuova geografia regionale, Lo Scarabeo, 1994.
- Evgeny Morozov, Pour tout résoudre, cliquez ici. L’aberration du solutionnisme technologique, FYP Éditions, Limoges, 2014.
- F. Antonioli et al., « Sea-level rise and potential drowning of the Italian coastal plains : Flooding risk scenarios for 2100 », Quaternary Science Reviews, 158, 2017, p. 29-43.
- Il convient de rappeler que 44 % de la province de Ferrare se trouve en dessous du niveau de la mer.
- Voir la notice Wikipédia pour une présentation générale de la place de la question méridionale dans l’histoire italienne.
- Luca Rastello, Piove all’insù, Bollati Boringheri, 2017.
L’article Depuis le delta du Pô, regarder en face la crise climatique est apparu en premier sur Terrestres.
