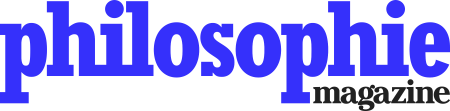27.11.2025 à 17:00
La “théorie des climats” chez Montesquieu, c’est quoi ?
L’endroit où nous vivons détermine-t-il la manière dont nous vivons et souhaitons être gouvernés ? C’est la question au cœur de la « théorie des climats », thèse célèbre de Montesquieu dans son livre De l’esprit des lois. L’éclairage de Nicolas Tenaillon, professeur de philosophie et auteur.
[CTA2]
Inspirée par les Anciens mais formulée de manière systématique par le baron de Montesquieu dans De l’esprit des lois (1748), la théorie des climats soutient que les latitudes exercent sur les peuples une si forte influence qu’elles déterminent en partie leurs mœurs et les formes de gouvernement qui leur conviennent. Est-ce à dire qu’une fatalité géographique décide de ce qu’est une bonne politique ? Pour ce fin représentant de la philosophie des Lumières qu’était Montesquieu la réponse n’est pas si simple…
“Écorcher un Moscovite pour lui donner du sentiment” ?
C’est dans les chapitres XIV à XVIII de De l’esprit des lois, consacrés à l’influence des facteurs naturels sur les lois et les comportements humains, que Montesquieu développe sa théorie des climats. Bien qu’il s’inscrive dans une certaine tradition philosophique, son objet n’est pas de reprendre les observations d’Aristote sur le courage des peuples qui habitent les pays froids, ni celles des médecins antiques Hippocrate et Galien sur l’influence de l’humidité sur les nerfs. Montesquieu tire plutôt des lois générales relatives au lien qui unit d’abord la topographie à la sociologie – dont Montesquieu est l’un des précurseurs –, puis la sociologie à la politique. Il l’explique dans « l’idée générale » qui préside à son analyse.
“S’il est vrai que le caractère de l’esprit et les passions du cœur soient extrêmement différents dans les divers climats, les lois doivent être relatives et à la différence de ces passions et à la différence de ces caractères.”
Montesquieu, De l’esprit des lois
Autrement dit, on ne saurait comprendre la diversité des mœurs sans la référer à la diversité des conditions naturelles d’existence des humains. Et ce serait être un bien mauvais législateur que d’ignorer ce que le climat a fait des peuples et ce qu’il continuera à produire sur eux. Prenons ici un exemple soulevé par Montesquieu : sous les latitudes très froides, les corps deviennent moins sensibles, si bien qu’il faudrait, écrit-il, « écorcher un Moscovite pour lui donner du sentiment ». Or, sous ces mêmes latitudes glacées, le travail est particulièrement pénible. Donc on ne doit pas s’étonner, d’après le philosophe, que ce soit à coups de knout qu’on ait contraint les serfs de Russie à travailler et que cet empire froid et immense ait été dirigé par des tsars tyranniques. Non pas que Montesquieu, adversaire de l’esclavage, approuve cette pratique cruelle. Le climat ne fait pas tout. Mais du moins explique-t-il cet état de fait : « Dans tout ceci je ne justifie pas les usages, mais j’en rends les raisons. »
Légiférer contre vents et marées
Cependant, tenir compte du climat ne signifie pas s’y soumettre. C’est seulement chez les « sauvages » que « la nature et le climat dominent presque seuls », écrit Montesquieu, avec le langage qui caractérise son temps. Ailleurs, d’autres facteurs interviennent, comme « les manières » en Chine ou « les maximes de gouvernement et les mœurs anciennes » à Rome.
➤ Cet article est exceptionnellement proposé en accès libre. Pour lire tous les textes publiés chaque jour sur philomag.com, avoir un accès illimité au mensuel et soutenir une rédaction 100% indépendante, abonnez-vous ! Retrouvez toutes nos offres ici.
Pour bien légiférer, il importe donc de relativiser cette influence. Aux yeux de Montesquieu, « les mauvais législateurs sont ceux qui ont favorisé les vices du climat, les bons sont ceux qui s’y sont opposés ». Le penseur et magistrat déplore ainsi que dans certains pays chauds, on ait davantage préféré valoriser la religion que le travail productif (« en Asie, le nombre de derviches ou moines augmente avec la chaleur du climat »), au risque de fragiliser la puissance de certains États.
“C’est ainsi qu’un air pur est quelquefois nuisible à ceux qui ont vécu dans un pays marécageux”
Mais jusqu’à quel point peut-on empêcher la mauvaise influence du climat de déterminer défavorablement les mœurs et les lois ? Libéral, admirateur de l’Angleterre, Montesquieu n’en soutient pas moins que certains pays ne pourraient se satisfaire d’une monarchie parlementaire et a fortiori d’une législation républicaine. N’hésitant pas à écrire que « la liberté même a paru insupportable à des peuples qui n’étaient pas accoutumés à en jouir », il propose, pour le faire comprendre, une image saisissante : « C’est ainsi qu’un air pur est quelquefois nuisible à ceux qui ont vécu dans un pays marécageux. »
On mesure ici toute la nuance de la pensée de Montesquieu, même s’il est vrai qu’elle n’échappe pas au défaut d’ethnocentrisme. Le climat n'explique pas tout mais il n’est jamais une donnée négligeable, même pour les peuples les plus avancés, en l’occurrence ceux qui vivent sous des latitudes tempérées comme les Européens. Aussi ces derniers seraient-ils bien avisés de reconnaître que leurs idées progressistes ne sont peut-être pas partout exportables.
Des critiques en pleines Lumières
Et l’on comprend pourquoi la théorie des climats a pu être contestée par d’autres philosophes des Lumières. Denis Diderot, supervisant l’article « Climat » (1752) de l’Encyclopédie, admettait certes que « le climat influe, sans doute, sur la constitution du corps », mais il précisait d’emblée qu’il ne « détermine point nécessairement les mœurs ». De son côté, Condorcet, révolutionnaire et abolitionniste convaincu, affirmait dans ses Réflexions sur l’esclavage des nègres (1781) que « ce n’est ni au climat, ni au terrain, ni à la constitution physique, ni à l’esprit national qu’il faut attribuer la paresse de certains peuples ; c’est aux mauvaises lois qui les gouvernent ».
Un retour en grâce à l’heure du dérèglement climatique ?
La théorie des climats de Montesquieu a ceci de dérangeant qu’elle tend à limiter la capacité des humains à s’affranchir de leur condition naturelle pour s’accorder sur des principes communs de justice. Mais en soutenant que « l’empire des climats est le premier tous les empires », Montesquieu ne voulait-il pas seulement dire que pour le sociologue comme pour le politique, le climat doit être une donnée de base ? Et que cette cause première, plus différenciante que déterminante, est trop souvent ignorée, alors qu’elle explique pourtant la conduite de bien des peuples et qu’elle oblige le législateur à adapter ses convictions à la réalité du terrain ?
Produit d’une pensée anti-utopique, mais moins conservatrice qu’il n’y paraît, la théorie des climats est considérée aujourd’hui comme scientifiquement et anthropologiquement dépassée. Elle n’a toutefois rien perdu de sa pertinence philosophique car elle nous interroge, nous humains du XXIe siècle, de manière inédite : ne doit-on pas craindre que le dérèglement climatique bouscule aussi nos repères politiques ?

27.11.2025 à 12:00
Clara Degiovanni : “Exhumer la part vertueuse qui gît dans chacun de nos vices”
Agacement et hypocrisie. Tels étaient les deux vices à l’étude pour clore le cycle « Que faire de nos vices ? » dans l’émission Avec philosophie, sur France Culture, en partenariat avec Philosophie magazine. Notre journaliste Clara Degiovanni a analysé pourquoi l’agacement était « la politesse du colérique », soulignant une idée plus générale, qui anime notre nouveau hors-série : « Il faut chercher à exhumer la part vertueuse qui gît dans chacun de nos vices. »

27.11.2025 à 06:00
Qui sommes-nous à l'intérieur de moi ? Réponses (multiples) de Pierre Bayard dans son essai "Je sommes plusieurs”
Après s'être demandé s'il était possible de parler des livres qu’on n’a pas lus, Pierre Bayard propose une nouvelle et stimulante expérience de pensée dans son nouveau livre Je sommes plusieurs (Éditions de Minuit) : et si nous étions habités par une multiplicité de personnalités cohabitant dans un même corps ? Un déboulonnage salvateur de l'identité que vous présente Martin Legros dans notre nouveau numéro.