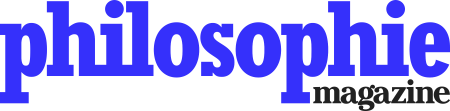26.11.2025 à 21:00
Pourquoi est-il si difficile de garder un secret ?
« Il y a quelques jours, j’ai signé un NDA. Un non-disclosure agreement. Bref, en français, un “accord de non-divulgation”, de confidentialité.
[CTA1]
Je me suis évidemment emporté : je ne peux absolument pas vous en dire davantage, du moins quant à l’objet de cet accord. Le simple fait de dire que je suis dépositaire d’un secret, n’est-ce pas déjà un peu le divulguer ? Peut-être, dans certains cas.
La foire aux vanités
Pourquoi évoqué-je, alors, cette petite aventure contractuelle ? Il y a, je suppose, une évidente vanité, dans cette manière de dire sans dire. L’on se sent privilégié d’appartenir à un petit cercle d’initiés en possession d’une information qui pourrait en intéresser quelques autres. L’information elle-même n’a rien d’un scoop, mais le simple fait qu’elle relève d’un régime restrictif, exclusif, lui confère une certaine aura, qui nourrit cette jouissance mesquine propre à l’asymétrie affichée du savoir – le plaisir vétilleux d’être envié. Le contenu du secret doit demeurer insu, pour conserver sa valeur ; en revanche, l’existence du secret, l’“il y a un secret”, sera proférée sans vergogne.
➤ Vous lisez actuellement la Lettre de la rédaction de Philosophie magazine. Pour la recevoir directement dans votre boîte mail, abonnez-vous ! Cette newsletter est quotidienne et gratuite.
D’un autre côté, une part de moi désire ardemment ébruiter ce contenu que l’on me commande de garder pour moi. La transgression a un attrait délicieux. L’envie de désobéir à l’injonction de garder le silence est, bien souvent, tempérée par les conséquences douloureuses qu’occasionnerait la trahison de l’engagement de se taire sur la personne qui s’est confiée. En l’occurrence, dévoiler ce dont je me retrouve le gardien ne léserait guère qui que ce soit, sinon moi-même – cause convaincante, assurément, pour rester mutique, qui ne supprime pas pour autant, voire rehausse le désir de dire.
Le paradoxe du dévoilement
En général, je ne suis pas très bon pour garder des secrets. Je divulgue fréquemment, malgré moi, les informations dont j’ai du mal à comprendre pourquoi elles devraient rester dans l’ombre. L’exhortation à me taire n’y change rien, au contraire. Je préserve d’autant mieux une confidence que l’on ne m’intime pas de la dissimuler. Il va de soi que certains aveux doivent demeurer dans le royaume du silence. La précision impérieuse de “ne pas partager” est, en général, superflue. Elle me semble souvent constituer une invitation paradoxale au dévoilement. Si une part du confessé rechigne à s’épancher, une autre le pousse irrésistiblement à se livrer. La révélation à un petit groupe d’intimes évite surtout la pénible annonce publique. Le secret, de bouche à oreille, essaimera lentement. L’information déliée de la personne dont elle émane, nimbée d’un halo d’ambiguïté qui la maintient en vérité et rumeur, sera sue, mais furtivement. Sa clandestinité interdit d’en faire en sujet de discussion.
Divulguant mes propres secrets, j’ai bien conscience qu’ils échapperont à la clôture élective dans laquelle j’ai voulu les installer. Le secret communiqué, ne serait-ce qu’à une personne, n’est plus qu’un demi-secret. Si je voulais vraiment qu’un événement, un sentiment, une épreuve restent ignorés, je ne les emprisonnerais pas entre les murs infrangibles de ma conscience – dans ce coi “dialogue entre moi et moi-même”, ce “deux-en-un” de la solitude, comme le dit Hannah Arendt. Les secrets ne finissent-ils pas pourtant, un jour, par s’évader – avec notre bénédiction – de ce domaine privé ? Ainsi que l’écrit Vladimir Jankélévitch dans L’Ironie ou la Bonne Conscience (1950), “un secret qu’on est vraiment seul à détenir, un tel secret rendrait malades les plus robustes, et on peut même se demander s’il existe une conscience assez intrépide pour supporter ce tête-à-tête, sans en mourir”.
Confidence pour confidence
Je ne peux pas parler pour tout le monde, évidemment ; mais, en ce qui me concerne, je ne suis pas avare de confidences. Si je garde des choses pour moi, ce n’est pas que je craigne qu’elles ne s’éventent, mais parce qu’elles me semblent insignifiantes, sans intérêt. Je conserve pour moi mes hésitations, mes états d’âme incertains, dont je me voudrais d’accabler autrui. Cependant, pour le reste, je suis assez transparent. Je dis l’essentiel – même si je ne dis pas tout à tout le monde. J’aurais bien du mal à vivre une expérience significative sans la réinscrire dans le tissu discursif, la trame de l’échange qui donne sens aux choses.
Partagerais-je, alors, ce secret que j’ai contractuellement accepté de respecter ? Sans doute pas. Je ne tiens vraiment pas à finir devant les tribunaux. J’attendrai patiemment que l’exigence de confidentialité tombe d’elle-même dans les limbes de la caducité. Il n’y a pas d’urgence à partager ses petits secrets. Certaines révélations libératrices sont d’autant plus exquises qu’elles ont été longtemps réprimées. »

26.11.2025 à 17:00
Agacement, irritabilité… Ces affects sont-ils en train de nous intoxiquer ?
Les études sont catégoriques : nous sommes de plus en plus agacés. L’agacement, affect pourtant discret, ne serait-il pas en train de nous ronger de l’intérieur ? Peut-on le contrer voire l’abolir ?
[CTA2]
Les réseaux sociaux : une machine à énerver
Nos nerfs sont de plus en plus à vifs. C’est en tout cas ce que les chiffres tendent à montrer. 43% des Français estiment que leur niveau de stress a augmenté ces trois dernières années, et 33% affirment ressentir au quotidien de la nervosité, selon un sondage OpinionWay réalisé pour la Fondation Ramsay Santé, en 2025.
En cause notamment, l’intensification exponentielle de l’usage des réseaux sociaux. Une autre étude publiée cette année montre que les usagers quotidiens de TikTok voient leur irritation augmenter significativement : de 1,69 point sur 30 sur TikTok ; 1,40 pour Facebook ; 0,69 pour Instagram ; et 0,67 pour Twitter. Bref : les réseaux sociaux nous irritent, nous agacent – nous font tourner en bourrique.
Un affect “de surface”
Comme le montrent les critères d’analyse de l’irritabilité, l’agacement ne crée pas forcément de grande éruption de colère, ni de crise de nerfs. Ce sentiment est peu étudié car il est plutôt discret. Il est un état de nervosité latent : un genre de « pré-colère » qui bouillonne, voire macère, mais n’explose pas vraiment. Sartre évoque ce bouillonnement discret dans La Nausée (1938), à travers le personnage de Roquentin qui raconte comment un simple « poulet froid » le met en rogne :
“J’aurais, pour un rien, roué de coups […] la serveuse. […] Mais je ne serais pas entré tout entier dans le jeu. Ma rage se démenait à la surface et pendant un moment, j’eus l’impression pénible d’être un bloc de glace enveloppé de feu, une omelette-surprise”
Jean-Paul Sartre, La Nausée (1938)
Cette rage absurde et démesurée est typique du fonctionnement de l’agacement, qui tend à se focaliser sur des détails apparemment infimes : un bruit de bouche ou de mastication (un dégoût qui porte le nom de misophonie), la lenteur d’un piéton sur le trottoir peuvent parfois nous mettre dans tous nos états. Sachant que le motif est dérisoire, on garde cette colère en soi. C’est de cette retenue que naît l’agacement, qui s’apparente, en somme, à la politesse du colérique.
Retrouvez Clara Degiovanni jeudi 27 novembre à 10h dans l'émission Avec philosophie sur France Culture, dont Philosophie magazine est partenaire ! Notre hors-série vous attend également en kiosque.
L’agacement a donc des vertus. Il est cette pudeur, ce respect, qui nous oblige à ne pas nous laisser aller à la rage pour un oui ou pour un non. Au lieu de proférer une insulte, l’agacé lève les yeux au ciel. À défaut de crier, il émet un discret claquement de langue. En un sens, l’agacement est un rempart à la violence, une planche de salut. En créant un genre de statu quo certes hostile mais non violent, il nous permet d’éviter le chaos d’une guerre de tous contre tous. Il ne nous rend pas sympathique, mais permet à tout le moins de maintenir un semblant de civilité dans l’espace public comme dans la vie privée.
Un acide corrosif
Mais cette retenue coûte. Comme le précise Sartre dans son Esquisse d’une théorie des émotions (1939), la colère bruyamment exprimée a une fonction : elle permet de « se satisfaire symboliquement », de « rompre un état de tension insupportable ». Or, lors de l’agacement, la tension se maintient. Il n’y a pas d’évasion possible. Tout en ayant l’air de perdre patience, l’agacé tient bon. Mais petit à petit, cet état de tension anime l’intégralité de son rapport au monde.
“L’agacement est cette pudeur, ce respect, qui nous oblige à ne pas nous laisser aller à la rage pour un oui ou pour un non”
Il suffit d’avoir été agacé une première fois pour avoir l’impression que le monde entier conspire à nous nuire. On se lève le matin avec une machine à café défaillante avant de pester dans les embouteillages, jusqu’à manquer de perdre ses nerfs face à la montagne de soucis qui s’accumule au travail. L’univers entier se trouve en quelque sorte coloré par l’agacement. « Si [le sujet qui cherche la solution d’un problème] échoue dans ses essais, s’il irrite, son irritation même est encore une façon dont le monde lui apparaît », explique Sartre. Cette façon de percevoir le monde est, de plus, contagieuse. Une personne agacée est souvent agaçante ! Il suffit d’arriver dans une rame de métro en heure de pointe, de se retrouver face aux mines renfrognées et aux airs excédés pour se sentir soi-même agacé.
L’agacement, peut-être plus que la colère, fonctionne comme un poison. Le mot lui-même vient du latin acidare, qui renvoie à l’acidité. Celui qui s’agace s’acidifie lui-même. Il se ronge littéralement de l’intérieur. La colère est rentrée, tournée vers soi-même. Un état de nervosité dirigée contre soi qui n’est pas sans conséquence : l’irritabilité crée de nombreux problèmes de santé, à commencer par des difficultés liées au sommeil, qui concernent 59% des Français, selon l’Observatoire du stress.
Un affect citadin ?
L’agacement est d’autant plus dangereux qu’il peut passer inaperçu. Incrusté dans notre vie quotidienne, dans nos routines, il est tellement partout qu’on y prête plus attention. L’agacement est devenu un mode de vie, qui caractérise notamment la vie urbaine dans la grande métropole aux rythmes frénétiques. Bouchons, rythmes effrénés, promiscuité des voisins de terrasses : la grande ville est nerveusement épuisante. C’est déjà ce qu’affirmait le sociologue Georg Simmel (1858-1918), qui pointait la difficulté de vivre dans un environnement marqué par une perpétuelle « intensification de la stimulation nerveuse » dans Les Grandes Villes et la vie de l’esprit (ouvrage reprenant une conférence tenue en 1902). Ces stimulations sont d’autant plus difficiles à vivre qu’elles se répètent à l’identique, tous les jours. Le citadin réagit en s’agaçant. Il crispe la mâchoire et rentre les épaules : cet affect devient son costume, sa barrière protectrice.
“Il n’y a peut-être pas de manifestation psychique aussi inconditionnellement réservée à la grande ville que l’attitude blasée”
L’irritation permanente va de pair avec un autre affect éminemment urbain : l’indifférence. Comme le précise Simmel, « il n’y a peut-être pas de manifestation psychique aussi inconditionnellement réservée à la grande ville que l’attitude blasée ». Les stimulations nerveuses auxquelles le citadin s’expose sont si constantes qu’il n’y prête plus attention. Ainsi se retrouve-t-il à ignorer du regard les SDF qui font la mendicité sur le trottoir ou dans le métro, ou à baisser les yeux quand une personne se fait agresser.
L’insoutenable irritabilité de l’être
S’il permet l’explosion de colère, l’agacement peut devenir aussi une forme de violence symbolique. À force d’être excédé par tout ce qui nous entoure, on devient aigri, désagréable, incapable d’accepter la vie telle qu’elle va, avec son bruit, ses tourments et ses soubresauts. Habitués à ce que tout aille vite, on ne supporte plus la lenteur. On s’impatience en face d’une personne âgée qui peine à avancer sur le trottoir, et on rabroue les enfants trop bruyants dans le train.
Mais alors, peut-on vraiment vaincre l’agacement ? À bien des égards, la tentative semble vaine. Les enfants continueront d’être des enfants, et il y aura toujours une personne pour marcher trop lentement devant nous. Aucune technique, aussi élaborée soit-elle, ne pourra abolir l’irritation. Si l’agacement est si difficile à combattre, c’est peut-être parce qu’il fait partie de notre condition humaine. Cet affect est le symptôme de notre fragilité, de notre vulnérabilité, mais aussi de notre ouverture au monde. Nous sommes des êtres traversés par le dehors. Loin d’être de purs esprits, nous avons un corps qui nous rend littéralement « à fleur de peau » – et parfois au bord de la crise de nerfs.

26.11.2025 à 13:30
“Je me désencombre du désir de tout contrôler” : ce que signifie “se préparer à la mort” pour la philosophe Nathalie Sarthou-Lajus
Dans notre nouveau numéro à retrouver chez votre marchand de journaux, six penseurs exposent ce que signifie pour eux se « préparer à la mort ». Nous vous proposons de découvrir le témoignage de la philosophe Nathalie Sarthou-Lajus, autrice, entre autres, de Sauver nos vies (Albin Michel, 2016) et de Vertige de la dépendance (Bayard, 2021).