15.12.2025 à 11:41
Quand le management a fait des États-Unis une superpuissance
Texte intégral (3245 mots)

Une étude internationale, impliquant des chercheurs français, états-uniens et brésiliens, a mis au jour une histoire méconnue. Des années 1920 aux années 1960, le management a contribué à faire des États-Unis la puissance hégémonique que l’on connaît aujourd’hui. Son « momentum » : la Seconde Guerre mondiale. Ses armes : les managers formés dans les grandes écoles, les outils d’aide à la décision et la technostructure de l’État fédéral.
Explorer des archives, c’est évoluer dans un monde à la fois silencieux et étrange vu d’aujourd’hui. Comme l’explique l’historienne Arlette Farge dans son livre le Goût de l’archive (1989), le travail de terrain des historiens est souvent ingrat, fastidieux, voire ennuyeux. Puis au fil de recoupements, à la lumière d’une pièce en particulier, quelque chose de surprenant se passe parfois. Un déclic reconfigurant un ensemble d’idées.
C’est exactement ce qui est arrivé dans le cadre d’un projet sur l’histoire du management états-unien (HIMO) débuté en 2017, impliquant une douzaine de chercheurs français, états-uniens et brésiliens.
Notre idée ? Comprendre le lien entre l’histoire des modes d’organisation managériaux du travail et les épisodes de guerre aux États-Unis. D’abord orientée vers le XXe siècle, la période d’étude a été resserrée des années 1920 à la fin des années 1960, avec comme tournant la Seconde Guerre mondiale.
Du taylorisme au management
Au début de notre recherche en 2017, nous nous sommes demandé ce qui guidait cette métamorphose du management des années 1920 aux années 1960.
Au commencement était le taylorisme. On attribue à l’ingénieur américain Frederick Winslow Taylor (1856-1915) l’invention d’une nouvelle organisation scientifique du travail dans The Principles of Scientific Management. Ce one best way devient la norme. Au cœur de cette division du travail, la mutation des rôles des contremaîtres est essentielle.
Leur fonction est d’abord de s’assurer à la fois de la présence des ouvriers et du respect des gestes prescrits par les dirigeants. Avec le management, une révolution copernicienne est en marche. Les contremaîtres sont progressivement remplacés par les techniques de management elles-mêmes. Le contrôle se fait à distance, et devient de l’autocontrôle. Des outils et des systèmes d’information sont développés ou généralisés, comme les pointeuses. Peu à peu, toutes ces informations sont connectées à des réseaux… qui dessinent ce qui deviendra des réseaux informatiques. L’objectif : suivre l’activité en temps réel et créer des rapports à même d’aider les managers dans leur prise de décision.
Outils de gestion de projet
C’est ce que la philosophie nomme le représentationnalisme. Le monde devient représentable, et s’il est représentable, il est contrôlable. Sur un temps long, de nombreux outils de gestion de projet sont créés comme :
le diagramme de Gantt, formalisé et diffusé dans les années 1910 par l’ingénieur du même nom, afin de visualiser dans le temps les diverses tâches ;
le Program Evaluation and Review Technic (PERT), élaboré dans les années d’après-guerre pour analyser et représenter les tâches impliquées ;
ou les Key Performance Indicators (KPI), des indicateurs utilisés pour l’aide à la décision.
Nombre de ces techniques ou standards de management ont une genèse américaine comme l’ont montré notamment les travaux de Locke et Spender, Clegg, Djelic ou D’Iribarne. Des années 1910 aux années 1950, une importance croissante est accordée à la visualisation des situations.
À lire aussi : Les origines néolibérales de la mondialisation : retour sur l’émergence d’un ordre géopolitique aujourd’hui menacé
Notre intuition d’une obsession pour la représentation s’est affinée avec l’exploration d’archives liées aux réseaux du management, de l’Academy of Management, l’American Management Association, et la Society for Advancement of Management.
Management de l’armée
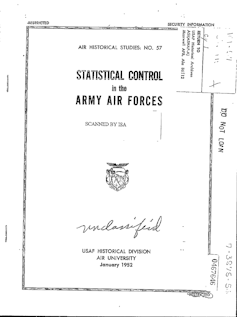
Dans son introduction de la conférence de l’Academy of Management de 1938, l’économiste Harlow Person, acteur clé de la Taylor Society, revient sur le rôle joué par la visualisation. Concrètement, une mission d’amélioration des processus administratifs est réalisée pour l’armée américaine durant la Première Guerre mondiale. L’organisation scientifique du travail déploie plus que jamais ses outils au-delà des chiffres et du texte.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’obsession pour la représentation est au cœur de la stratégie militaire des États-Unis, en synergie vraisemblablement avec le management. Par exemple, la carte d’état-major doit représenter la situation la plus fidèle possible au champ de bataille. Chaque drapeau, chaque figurine représentant un bataillon ami ou ennemi, doit suivre fidèlement les mouvements de chacun lors du combat. Toutes les pièces évoluant en temps réel permettent au généralissime de prendre les meilleures décisions possibles.
Mise en place d’une technostructure par Franklin Roosevelt
Un président des États-Unis incarne cette rupture managériale dans la sphère politique : Franklin Roosevelt. Secrétaire assistant à la Navy dans sa jeunesse, il assimile l’importance des techniques d’organisation dans les arsenaux maritimes de Philadelphie et New York, pour la plupart mis en œuvre par les disciples de Frederick Winslow Taylor.
Après la crise de 1929, la mise en place de politiques centralisées de relance a pour conséquence organisationnelle d’installer une technostructure. Plus que jamais, il faut contrôler et réguler l’économie. Un véritable État fédéral prend naissance avec la mobilisation industrielle initiée dès 1940.
Lorsque le New Deal est mis en place, Franklin Roosevelt comprend que le management peut lui permettre de changer le rapport de force entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif. Progressivement, il oppose la rationalité de l’appareil fédéral et son efficience à la logique plus bureaucratique incarnée par le Congrès. Concrètement, les effectifs de la Maison Blanche passent de quelques dizaines de fonctionnaires avant la Seconde Guerre mondiale à plus de 200 000 en 1943.
Le président des États-Unis dispose désormais de l’appareil nécessaire pour devenir « l’Arsenal de la démocratie », à savoir l’appareil productif des Alliés. Cette transformation contribue à faire des États-Unis la première puissance militaire mondiale au sortir de la Seconde Guerre mondiale, alors qu’elle n’était que 19e avant son commencement.
Standardisation mondiale par le management
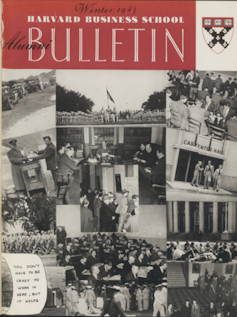
Au-delà d’une obsession nouvelle pour la représentation tant organisationnelle que politique, la seconde dimension mise en lumière par cette recherche sur l’histoire du management est plus inattendue. Elle porte sur la mise en place d’une véritable géopolitique états-unienne par le management. Notre travail sur archive a permis de mieux comprendre la genèse de cette hégémonie américaine.
La standardisation des formations au management, en particulier par des institutions telles que la Havard Business School, a contribué subtilement à cette géopolitique américaine. Tout le développement de la connaissance managériale se joue sur le sol des États-Unis et l’espace symbolique qu’il étend sur le reste du monde, du MBA aux publications académiques, dont les classements placent aujourd’hui systématiquement les revues états-uniennes au sommet de leur Olympe.

Il en va de même pour le monde des cabinets de conseil en management de l’après-guerre, dominé par des structures américaines, en particulier pour la stratégie. En 1933, le Glass-Steagall Act impose aux banques la séparation des activités de dépôt de celles d’interventions sur les marchés financiers et de façon connexe, et leur interdit d’auditer et de conseiller leurs clients. Cela ouvre un espace de marché : celui du conseil externe en management, bientôt dopé par la mobilisation industrielle puis la croissance d’après-guerre.
Des cabinets se développent comme celui fondé par James McKinsey en 1926, professeur de comptabilité à l’université de Chicago. Son intuition : les entreprises souffrent d’un déficit de management pour surmonter la Grande Dépression et croître après la Seconde Guerre mondiale. De nombreux cabinets suivent cette tendance comme le Boston Consulting Group créé en 1963.
Près de 500 000 blessés industriels
Un des points les plus frappants de notre recherche est la conséquence du management sur le corps pendant le momentum de la Seconde Guerre mondiale. Plus de 86 000 citoyens des États-Unis meurent dans les usines entre 1941 et 1945, 100 000 sont handicapés sévères et plus de 500 000 sont blessés au travail.
Une partie de nos archives sur le Brooklyn Navy Yard de New York l’illustre tristement. Dans le silence, chacun et chacune acceptent une expérience de travail impossible en considérant que leur fils, leur maris, leurs neveux, leurs amis au combat vivaient des situations certainement bien pires. Le management se fait alors patriote, américain et… mortifère.

Au final, les managers ont continué à taire une évidence tellement visible qu’on ne la questionne que trop peu : celle de l’américanité de ce qui est également devenu « nos » modes d’organisation. Au service d’une géopolitique américaine par le management.
Le projet de recherche HIMO (History of Instittutional Management & Organization) mentionné dans cet article a reçu des financements du PSL Seed Fund, de QLife et des bourses de mobilité de DRM.
14.12.2025 à 11:47
Football : 30 ans après l’arrêt Bosman, quel bilan pour le marché des transferts ?
Texte intégral (2890 mots)
Le Belge Jean-Marc Bosman, joueur modeste des années 1990, restera peut-être dans l’histoire comme le footballeur qui aura eu le plus grand impact sur son sport. En effet, l’arrêt portant son nom, adopté il y a exactement trente ans, a permis aux joueurs en fin de contrat de rejoindre un autre club sans l’exigence d’une indemnité de transfert. Il a également mis fin à la règle qui prévalait jusqu’alors de trois étrangers maximum par équipe, ouvrant la voie à une aspiration des joueurs du monde entier vers les clubs les plus riches.
« Toi, avec ton arrêt, tu vas rester dans l’histoire, comme Bic ou Coca-Cola », avait dit Michel Platini à Jean-Marc Bosman en 1995. Platini n’avait sans doute pas tort.
Les faits remontent à 1990. Le contrat de travail de Bosman, footballeur professionnel du Royal Football Club (RFC) de Liège (Belgique), arrive à échéance le 30 juin. Son club lui propose un nouveau contrat, mais avec un salaire nettement inférieur. Bosman refuse et est placé sur la liste des transferts. Conformément aux règles de l’Union européenne des associations de football (UEFA) en vigueur à l’époque, le transfert d’un joueur, même en fin de contrat, s’effectue en contrepartie d’une indemnité versée par le club acheteur au club vendeur. Autrement dit, pour acquérir Bosman, le nouveau club devra verser une indemnité de transfert au RFC.
En juillet, l’Union sportive du littoral de Dunkerque (USL) en France est intéressée. Mais le club belge, craignant l’insolvabilité de l’USL, bloque l’opération. Bosman se retrouve sans employeur. Pis, il continue d’appartenir à son ancien club, lequel maintient ses droits de transfert. Par ailleurs, en vertu de la règle des quotas – trois étrangers maximum par équipe –, il est difficile pour le joueur de rejoindre un club dans un autre État de la Communauté européenne.
S’estimant lésé, Bosman saisit les tribunaux belges. L’affaire est par la suite portée devant la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE).
Coup de tonnerre : le 15 décembre 1995, la CJCE tranche en faveur de Bosman.
Décision de la CJCE
La Cour précise que le sport professionnel, comme toute activité économique au sein de la Communauté européenne, est soumis au droit communautaire. Elle considère dès lors que toute disposition restreignant la liberté de mouvement des footballeurs professionnels ressortissants de la Communauté européenne est contraire à l’article 48 du Traité de Rome, lequel prévoit la libre concurrence et la liberté de circulation des travailleurs entre les États membres.
La CJCE reprend ses jurisprudences antérieures (arrêts Walrawe et Koch en 1974 et Doña en 1976) et déclare que les règles de quotas fondées sur la nationalité des joueurs ressortissants communautaires constituent des entraves au marché commun.
En outre, la Cour va plus loin dans son jugement et estime que les indemnités de transfert pour les joueurs en fin de contrat (encore appliquées par certains clubs européens en 1995) sont contraires au droit communautaire.
Enjeux et impacts de l’arrêt Bosman
Le socle de cette décision a été la standardisation ou plutôt l’universalité des règles sportives au niveau de l’UEFA (54 fédérations) et de la Fédération Internationale de Football Association, FIFA (211 fédérations), qui ont dû s’aligner sur la jurisprudence Bosman.
Ainsi, cet arrêt de la CJCE a conduit les instances du football à réformer le système des transferts (Réformes dites « Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs », (RSTJ) 2001, 2005, 2017-2022). Conséquemment, l’arrêt Bosman a drastiquement accentué la libéralisation du marché des transferts.
Cela s’est traduit par la suppression des obstacles à la libre circulation des sportifs. Les joueurs en fin de contrat sont devenus libres de rejoindre un autre club sans que celui-ci soit tenu de verser une indemnité de transfert à leur ancien club. Fin de l’ « esclavage » sportif ! Fin également du « régime de quotas » pour les joueurs ressortissants communautaires au sein des effectifs dans les clubs européens !
De facto, il y a eu une augmentation du nombre de joueurs étrangers communautaires, désormais illimité pour les joueurs des pays de l’Union européenne (UE). C’est le cas également pour les joueurs de l’Espace économique européen et pour ceux issus des pays ayant un accord d’association ou de coopération avec l’UE à la suite des arrêts Malaja dans le basket en 2002, Kolpak dans le handball en 2003 et Simutenkov dans le football en 2005. Il en est de même, depuis l’accord de Cotonou en 2000 (remplacé par l’accord de Samoa en 2023), pour les détenteurs des nationalités de 47 pays d’Afrique, 15 pays des Caraïbes et 15 pays du Pacifique. En France, le nombre de joueurs considérés comme « extra-communautaires » est limité à quatre.
Par ailleurs, comme le souligne Vincent Chaudel, co-fondateur de l’Observatoire du Sport Business, l’arrêt Bosman a inversé le rapport de force entre joueurs et clubs. L’inflation des salaires, qui avait commencé dans les années 1980, s’est accélérée dès les premières années après cet arrêt, puis de manière exponentielle chez les superstars par la suite.
Selon le magazine Forbes, les cinq footballeurs les mieux rémunérés en 2024 étaient Cristiano Ronaldo (environ 262,4 millions d’euros), Lionel Messi (environ 124,3 millions d’euros), Neymar (environ 101,3 millions d’euros), Karim Benzema (environ 95,8 millions d’euros) et Kylian Mbappé (environ 82,9 millions d’euros). L’écart salarial entre les footballeurs et les footballeuses reste néanmoins encore béant.
À lire aussi : Equal play, equal pay : des « inégalités » de genre dans le football
L’arrêt Bosman a aussi fortement impacté la spéculation de la valeur marchande des superstars et des jeunes talents.
À lire aussi : À qui profite le foot ?
Au-delà, cet arrêt s’est matérialisé par l’extension de la libre circulation des joueurs formés localement dans un État membre de l’UE, au nom de la compatibilité avec les règles de libre circulation des personnes ; cette mesure a ensuite été étendue à d’autres disciplines sportives.
Une autre particularité concerne le prolongement de la jurisprudence Bosman aux amateurs et aux dirigeants sportifs.
Enfin, il est important de rappeler que si l’arrêt Bosman a permis à de nombreux acteurs du football (joueurs, agents, clubs, investisseurs, etc.) de s’enrichir, ce fut loin d’être le cas pour Jean-Marc Bosman lui-même. Dans un livre autobiographique poignant, Mon combat pour la liberté, récemment publié, l’ancien joueur raconte son combat judiciaire de cinq ans, ainsi que sa longue traversée du désert (trahisons, difficultés financières, dépressions, etc.) après la décision de la CJCE.
Perspectives : du 15 décembre 1995 au 15 décembre 2025, 30 ans de libéralisation
L’arrêt Bosman a dérégulé, explosé et exposé le marché des transferts. Le récent article de la Fifa consacré au marché estival de 2025 en témoigne : cet été-là, 9,76 milliards de dollars d’indemnités de transfert ont été versés dans le football masculin et 12,3 millions de dollars dans le football féminin.
Ainsi, l’arrêt a ouvert la voie à une libéralisation inédite des opérations, conduisant parfois à des montages financiers particulièrement complexes.
À lire aussi : Football financiarisé : l’Olympique lyonnais, symptôme d’un modèle de multipropriété en crise
Au-delà de l’explosion des indemnités de transfert, l’arrêt Bosman a creusé les inégalités entre les clubs, tant au niveau national qu’européen. Pendant que les clubs les moins riches servent de pépinières pour former les futurs talents, les clubs les plus riches déboursent des sommes astronomiques pour acquérir les meilleurs footballeurs : Neymar, 222 millions d’euros ; Mbappé, 180 millions d’euros ; Ousmane Dembelé et Alexander Isak, 148 millions d’euros ; Philippe Coutinho, 135 millions d’euros, etc. Cela se traduit par l’ultra-domination des gros clubs dans les championnats européens avec le risque d’un « déclin général de l’équilibre compétitif dans le football européen » selon l’Observatoire du football CIES.
Enfin, avec la libéralisation du marché des transferts, des réseaux internationaux se tissent – et par la même occasion s’enrichissent – pour dénicher les futures « poules aux œufs d’or ». L’Amérique du Sud, l’Afrique (notamment depuis l’accord Cotonou) et l’Europe de l’Est sont devenues les principaux exportateurs des footballeurs (certains partent à un âge très précoce à l’étranger et se retrouvent loin de leur famille) vers les clubs d’Europe de l’Ouest.
Pour conclure, il serait souhaitable de réguler le marché, d’assainir l’écosystème et d’apaiser les ardeurs. L’arrêt Diarra (qualifié de « Bosman 2.0 ») de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) – anciennement la CJCE – le 4 octobre 2024 est une avancée dans ce sens. Bien que la Cour n’ait pas remis en cause tout le système des transferts, elle a enjoint la FIFA à modifier sa réglementation afin que les footballeurs ne soient plus sous le joug de leur club en cas de rupture unilatérale de leur contrat.
Les joueurs doivent pouvoir y mettre un terme sans craindre de devoir verser une indemnité « disproportionnée » à leur club, et sans que le nouveau club désireux de les recruter soit tenu de verser solidairement et conjointement cette indemnité en cas de rupture sans « juste cause ». Dans l’urgence, un cadre réglementaire provisoire relatif au RSTJ a été adopté par la FIFA en décembre 2024 – jugé pour autant non conforme à la décision de la CJUE.
Le monde du football a besoin d’une transformation systémique où le plafonnement des coûts de transfert, mais aussi la gestion vertueuse des clubs et des institutions, l’encadrement et l’égalité des salaires homme-femme, la prise en compte du bien-être psychologique des acteurs, etc. constitueraient un socle fort pour un renouveau du marché des transferts et de l’industrie du football dans sa globalité.
Mieux, l’industrie du football ne doit plus constituer un mobile pour creuser les écarts et les disparités sociales et sociétales.
Annexe : 11 dates et événements clés
1891 : J. P. Campbell de Liverpool est le premier agent à faire la promotion de joueurs auprès des clubs par des publicités via la presse.
1905 : William McGregor, ancien président du club d’Aston Villa et fondateur de la ligue anglaise déclare, en une formule visionnaire pour l’époque, « Football is big business ».
1930 : la première Coupe du Monde de football a lieu en Uruguay.
1932 : la mise en place du premier championnat professionnel de football en France avec des dirigeants employeurs et des joueurs salariés sans aucun pouvoir ainsi que l’établissement du contrat à vie des footballeurs, liés à leur club jusqu’à l’âge de 35 ans.
1961 : le salaire minimum des joueurs de football est supprimé. Cette décision a pour effet d’équilibrer le pouvoir de négociation entre joueurs et clubs.
Entre 1960 et 1964 : les salaires des joueurs de la première division française évoluent drastiquement (augmentation de 61 % par rapport à ceux des années 1950).
1963 : la Haute Cour de Justice anglaise dispose, dans l’affaire Georges Eastham, que le système de « conservation et transfert » est illégal.
1969 : la mise en place du contrat de travail à durée librement déterminée.
1973 : l’adoption de la Charte du football professionnel.
1991 : la première Coupe du monde de football féminin se déroule en Chine.
1995 : l’arrêt Bosman de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) du 15 décembre 1995 crée un véritable bouleversement dans le système de transfert des joueurs au sein de l’UE – anciennement la Communauté européenne.
Moustapha Kamara a reçu une Bourse de recherche Havelange de la FIFA.
Allane Madanamoothoo et Daouda Coulibaly ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.
11.12.2025 à 16:16
L’internationale trumpiste : la Stratégie de sécurité nationale 2025 comme manifeste idéologique
Texte intégral (2441 mots)
L’administration Trump vient de rendre publique sa Stratégie de sécurité nationale. Charge virulente contre l’Europe, affirmation de l’exceptionnalisme des États-Unis, présentation du président actuel en héros affrontant au nom de son pays des périls mortels pour la civilisation occidentale : bien plus qu’un simple ensemble de grandes lignes, il s’agit d’une véritable proclamation idéologique.
La Stratégie de sécurité nationale (National Security Strategy, NSS) est normalement un document technocratique, non contraignant juridiquement, que chaque président des États-Unis doit, durant son mandat, adresser au Congrès pour guider la politique étrangère du pays.
La version publiée par l’administration Trump en 2025 (ici en français) ressemble pourtant moins à un texte d’État qu’à un manifeste idéologique MAGA (Make America Great Again) qui s’adresse tout autant à sa base qu’au reste du monde, à commencer par les alliés européens de Washington, accusés de trahir la « vraie » démocratie. Pour la première fois, et contrairement à la NSS du premier mandat Trump publiée en 2017, la sécurité nationale y est définie presque exclusivement à partir des obsessions trumpistes : immigration, guerre culturelle, nationalisme.
Les trois principales articulations du texte
La NSS 2025 rompt complètement avec la tradition libérale de la démocratie constitutionnelle (respect des droits fondamentaux, primauté de l’État de droit, pluralisme) et avec sa traduction internationale — la promotion de la démocratie dans le cadre d’un ordre multilatéral fondé sur des règles. Elle réécrit l’histoire depuis la fin de la guerre froide, construit un ennemi composite (immigration, élites « globalistes », Europe) et détourne le vocabulaire de la liberté et de la démocratie au service d’un exceptionnalisme ethno-populiste.
Ce document présente une grande narration en trois actes.
Acte I : La trahison des élites.
C’est le récit de l’échec des politiques menées par les États-Unis depuis 1991, imputées à l’hubris d’élites qui auraient voulu l’hégémonie globale. Elles auraient mené des « guerres sans fin », mis en place un « prétendu libre-échange » et soumis le pays à des institutions supranationales, au prix de l’industrie américaine, de la classe moyenne, de la souveraineté nationale et de la cohésion culturelle. Ce premier acte souligne enfin l’incapacité à renouveler un récit national crédible après la fin de la guerre froide : c’est sur ce vide narratif que Trump construit son propre récit.
Acte II : Le déclin.
Le déclin des États-Unis tel que vu par l’administration Trump est à la fois économique, moral, géopolitique et démographique. Il se manifeste par la désindustrialisation, les guerres ratées, ou encore par la crise des frontières avec le Mexique. Il fait écho au « carnage américain » que l’actuel président avait dénoncé lors de son premier discours d’investiture, en 2017. L’ennemi est ici décrit comme à la fois intérieur et extérieur : l’immigration, présentée comme une « invasion » liée aux cartels, mais aussi les institutions internationales et les élites de politique étrangère, américaines comme européennes. Tous sont intégrés dans un même schéma conflictuel, celui d’une guerre globale que l’administration Trump serait prête à mener contre ceux qui menaceraient souveraineté, culture et prospérité américaines.
Acte III : Le sauveur.
La NSS présente le locataire de la Maison Blanche comme un leader providentiel, comme le « président de la Paix » qui corrige la trahison des élites. Trump y apparaît comme un « redresseur », héros (ou anti-héros) qui aurait, en moins d’un an, « réglé huit conflits violents ». Il incarnerait une nation retrouvée, prête à connaître un « nouvel âge d’or ». On retrouve ici un schéma narratif typiquement américain, issu de la tradition religieuse de la jérémiade : un prêche qui commence par dénoncer les fautes et la décadence, puis propose un retour aux sources pour « sauver » la communauté. L’historien Sacvan Bercovitch a montré que ce type de récit est au cœur du mythe national américain. Un texte qui devrait être techno-bureaucratique se transforme ainsi en récit de chute et de rédemption.
L’exceptionnalisme américain à la sauce Trump
À y regarder de près, la NSS 2025 foisonne de tropes propres aux grands mythes américains. Il s’agit de « mythifier » la rupture avec des décennies de politique étrangère en présentant la politique conduite par l’administration Trump comme un retour aux origines.
Le texte invoque Dieu et les « droits naturels » comme fondement de la souveraineté, de la liberté, de la famille traditionnelle, voire de la fermeture des frontières. Il convoque la Déclaration d’indépendance et les « pères fondateurs des États-Unis » pour justifier un non-interventionnisme sélectif. Il se réclame aussi de « l’esprit pionnier de l’Amérique » pour expliquer la « domination économique constante » et la « supériorité militaire » de Washington.
Si le mot exceptionalism n’apparaît pas (pas plus que la formule « indispensable nation »), la NSS 2025 est saturée de formulations reprenant l’idée d’une nation unique dans le monde : hyper-superlatifs sur la puissance économique et militaire, rôle central de l’Amérique comme pilier de l’ordre monétaire, technologique et stratégique. Il s’agit d’abord d’un exceptionnalisme de puissance : le texte détaille longuement la domination économique, énergétique, militaire et financière des États-Unis, puis en déduit leur supériorité morale. Si l’Amérique est « la plus grande nation de l’histoire » et « le berceau de la liberté », c’est d’abord parce qu’elle est la plus forte. La vertu n’est plus une exigence qui pourrait limiter l’usage de la puissance ; elle est au contraire validée par cette puissance.
Dans ce schéma, les élites — y compris européennes — qui affaiblissent la capacité américaine en matière d’énergie, d’industrie ou de frontières ne commettent pas seulement une erreur stratégique, mais une faute morale. Ce n’est plus l’exceptionnalisme libéral classique de la diffusion de la démocratie, mais une forme d’exceptionnalisme moral souverainiste : l’Amérique se pense comme principale gardienne de la « vraie » liberté, contre ses adversaires mais aussi contre certains de ses alliés.
Là où les stratégies précédentes mettaient en avant la défense d’un « ordre international libéral », la NSS 2025 décrit surtout un pays victime, exploité par ses alliés, corseté par des institutions hostiles : l’exceptionnalisme devient le récit d’une surpuissance assiégée plutôt que d’une démocratie exemplaire. Derrière cette exaltation de la « grandeur » américaine, la NSS 2025 ressemble davantage à un plan d’affaires, conçu pour servir les intérêts des grandes industries — et, au passage, ceux de Trump lui-même. Ici, ce n’est pas le profit qui se conforme à la morale, c’est la morale qui se met au service du profit.
Une vision très particulière de la doctrine Monroe
De même, le texte propose une version mythifiée de la doctrine Monroe (1823) en se présentant comme un « retour » à la vocation historique des États-Unis : protéger l’hémisphère occidental des ingérences extérieures. Mais ce recours au passé sert à construire une nouvelle doctrine, celui d’un « corollaire Trump » — en écho au « corollaire Roosevelt » : l’Amérique n’y défend plus seulement l’indépendance politique de ses voisins, elle transforme la région en chasse gardée géo-économique et migratoire, prolongement direct de sa frontière sud et vitrine de sa puissance industrielle.
À lire aussi : États-Unis/Venezuela : la guerre ou le deal ?
Sous couvert de renouer avec Monroe, le texte légitime une version trumpiste du leadership régional, où le contrôle des flux (capitaux, infrastructures, populations) devient le cœur de la mission américaine. Là encore, le projet quasi impérialiste de Trump est présenté comme l’extension logique d’une tradition américaine, plutôt que comme une rupture.
La NSS 2025 assume au contraire une ingérence politique explicite en Europe, promettant de s’opposer aux « restrictions antidémocratiques » imposées par les élites européennes (qu’il s’agisse, selon Washington, de régulations visant les plates-formes américaines de réseaux sociaux, de limitations de la liberté d’expression ou de contraintes pesant sur les partis souverainistes) et de peser sur leurs choix énergétiques, migratoires ou sécuritaires. Autrement dit, Washington invoque Monroe pour sanctuariser son hémisphère, tout en s’arrogeant le droit d’intervenir dans la vie politique et normative européenne — ce qui revient à revendiquer pour soi ce que la doctrine refuse aux autres.
Dans la NSS 2025, l’Europe est omniprésente — citée une cinquantaine de fois, soit deux fois plus que la Chine et cinq fois plus que la Russie —, décrite comme le théâtre central d’une crise à la fois politique, démographique et civilisationnelle. Le texte oppose systématiquement les « élites » européennes à leurs peuples, accusant les premières d’imposer, par la régulation, l’intégration européenne et l’ouverture migratoire, une forme d’« effacement civilisationnel » qui reprend, sans le dire, la logique du « grand remplacement » de Renaud Camus, théorie complotiste d’extrême droite largement documentée.
À lire aussi : L’Europe vue par J. D. Vance : un continent à la dérive que seul un virage vers l’extrême droite pourrait sauver
L’administration Trump s’y arroge un droit d’ingérence idéologique inédit : elle promet de défendre les « vraies » libertés des citoyens européens contre Bruxelles, les cours et les gouvernements, tout en soutenant implicitement les partis d’extrême droite ethno-nationalistes qui se posent en porte-voix de peuples trahis. L’Union européenne est dépeinte comme une machine normative étouffante, dont les règles climatiques, économiques ou sociétales affaibliraient la souveraineté des nations et leur vitalité démographique. Ce faisant, le sens même des mots « démocratie » et « liberté » est inversé : ce ne sont plus les institutions libérales et les traités qui garantissent ces valeurs, mais leur contestation au nom d’un peuple soi-disant homogène et menacé, que Washington prétend désormais protéger jusque sur le sol européen.
La Russie, quant à elle, apparaît moins comme ennemi existentiel que comme puissance perturbatrice dont la guerre en Ukraine accélère surtout le déclin européen. La NSS 2025 insiste sur la nécessité d’une cessation rapide des hostilités et de la mise en place d’un nouvel équilibre stratégique, afin de favoriser les affaires. La Chine est le seul véritable rival systémique, surtout économique et technologique. La rivalité militaire (Taïwan, mer de Chine) est bien présente, mais toujours pensée à partir de l’enjeu clé : empêcher Pékin de transformer sa puissance industrielle en hégémonie régionale et globale.
Le Moyen-Orient n’est plus central : grâce à l’indépendance énergétique, Washington cherche à transférer la charge de la sécurité à ses alliés régionaux, en se réservant un rôle de faiseur de deals face à un Iran affaibli. L’Afrique, enfin, est envisagée comme un terrain de reconquête géo-économique face à la Chine, où l’on privilégie les partenariats commerciaux et énergétiques avec quelques États jugés « fiables », plutôt qu’une politique d’aide ou d’interventions lourdes.
Un texte qui ne fait pas consensus
Malgré la cohérence apparente et le ton très péremptoire de cette doctrine, le camp MAGA reste traversé de fortes divisions sur la politique étrangère, entre isolationnistes « America First » hostiles à toute projection de puissance coûteuse et faucons qui veulent continuer à utiliser la supériorité militaire américaine pour imposer des rapports de force favorables.
Surtout, les sondages (ici, ici, ou ici) montrent que, si une partie de l’électorat républicain adhère à la rhétorique de fermeté (frontières, Chine, rejet des élites), l’opinion américaine dans son ensemble demeure majoritairement attachée à la démocratie libérale, aux contre-pouvoirs et aux alliances traditionnelles. Les Américains souhaitent moins de guerres sans fin, mais ils ne plébiscitent ni un repli illibéral ni une remise en cause frontale des institutions qui structurent l’ordre international depuis 1945.
Jérôme Viala-Gaudefroy ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
