12.01.2026 à 12:01
Rihanna, Selena Gomez, Kylie Jenner : pourquoi la beauté est le nouvel eldorado des stars
Texte intégral (2033 mots)

Rihanna, Selena Gomez ou Kylie Jenner, ces dernières années les marques dans le secteur des cosmétiques créées ou co-fondées par des stars se sont multipliées. Mais pourquoi cet engouement particulier pour la beauté ?
Fenty Beauty, LolaVie, Blake Brown, Rare Beauty, Kylie Cosmetics, Rhode Skin ou Goop Beauty sont des marques de beauté et de soins capillaires qui ont toutes un point commun : celui d’avoir été lancées par une célébrité, comme Rihanna, Jennifer Aniston, Blake Lively, Selena Gomez, Kylie Jenner, Hailey Rhode Bieber et Gwyneth Paltrow.
Le personal branding, cette stratégie qui transforme le « moi » en image de marque unique que l’on peut valoriser sur la scène médiatique notamment, est d’autant plus pertinente dans le secteur des cosmétiques.
Alors pourquoi un tel engouement dans ce secteur et de ses consommateurs ?
Effet lipstick
Le marché des cosmétiques aurait générer en 2025 un chiffre d’affaires de 677 milliards de dollars, soit 574 milliards d’euros.
L’intérêt des célébrités pour la beauté n’est pas seulement une question d’image, il est également dicté par une logique économique. Les stars ont rapidement compris qu’en lançant leur propre marque, leur notoriété permettrait de réduire la lenteur de ce processus et d’amorcer une monétisation rapide de leur entreprise. La célébrité agit comme un puissant catalyseur marketing.
Historiquement, le secteur des cosmétiques est résilient aux crises, ce que les chercheurs nomment « effet lipstick ». Ce dernier explique comment les consommateurs, en période de crises économiques, réduisent les dépenses importantes, telles que l’achat de voiture ou les voyages, pour s’offrir des produits de luxe abordables, comme un rouge à lèvres.
Cette stabilité du marché de la beauté garantit un revenu sûr pour les marques de stars. Il offre des marges brutes élevées et peut encore croître de 100 milliards selon le patron de L’Oréal, Nicolas Hieronimus.
Le coût de production étant faible par rapport au prix de vente, et l’absence des contraintes logistiques, comme les collections de saisons, permettent un faible coût d’entrée et une gestion des stocks simplifiée.
Transférer les attributs positifs de la star
La célébrité qui endosse une marque est définie comme un individu jouissant d’une forte reconnaissance publique qui appose son image sur une marque par le biais d’un contrat publicitaire. Cette approche vise à transférer les attributs positifs de la star vers la marque, facilitant l’identification du message par le consommateur.
Depuis une dizaine d’années, ce qu’on appelle le self-branding for entrepreneurial prend une nouvelle ampleur avec l’avènement des réseaux sociaux. La célébrité devient cheffe d’entreprise et créée sa propre marque. La star n’est plus une simple ambassadrice : elle devient actionnaire, co-fondatrice ou propriétaire d’une marque.
C’est le cas de la comédienne Jennifer Aniston avec sa marque de soins capillaires LolaVie. L’actrice ne se contente pas de poser pour sa marque mais partage elle-même des vidéos de shooting sur les réseaux sociaux. Elle se met en scène en utilisant les produits et va jusqu’à poster des vidéos d’elle coiffant sa meilleure amie, l’actrice Courtney Cox, ou encore son petit ami Jim Curtis.
Jennifer Aniston fait preuve d’authenticité en exposant son intimité et en prenant à contre-pied l’image distante et éloignée de la réalité que peut avoir une célébrité. Elle renforce cette idée en utilisant l’humour dans son spot publicitaire « No Gimmicks » (« Pas d’artifices »).
Contre la beauté toxique
Le succès des marques de beauté fondées par des célébrités s’explique par la disruption stratégique mise en place. Des marques, comme Fenty Beauty, ont été pionnières en prouvant que l’inclusion ethnique avec plus de 40 teintes de fonds de teint proposées n’était pas un simple geste éthique mais une stratégie économique gagnante. « Fenty Beauty est une marque à 360 degrés qui s’adresse autant à une Coréenne qu’à une Irlandaise ou à une Afro-Américaine », décrypte Lionel Durand, patron de l’entreprise Black Up.
Dans la foulée, la marque Rare Beauty a élargi cette notion à l’inclusion émotionnelle, utilisant l’authenticité du discours de sa fondatrice concernant la santé mentale pour rejeter les normes de beauté toxiques. Selena Gomez n’ayant jamais caché sa bipolarité a choisi pour sa marque le slogan « Love Your Rare » (« Aimez votre rareté ») et a créé sa fondation Rare Impact Fund consacrée à cette thématique. Elle capitalise sur une communauté fidèle et engagée, là où d’autres marques valorisent essentiellement la perfection en termes de beauté.
Ces stars utilisent leurs réseaux sociaux comme laboratoires narratifs où elles construisent la crédibilité de leur marque à travers des récits personnels simples, de travail et de passion. Les produits de beauté ont un avantage : ils sont désirables et mobilisent l’attention surtout s’ils sont mis en avant par une célébrité.
Les vidéos Instagram ou TikTok à l’ère du marketing de contenu permettent aux célébrités d’échanger et d’atteindre rapidement leur public. Leurs produits deviennent une extension d’elles-mêmes, des objets identitaires au même titre que la mode ou la musique. La marque bio Goop, de Gwyneth Paltrow, est une ode à son lifestyle. Sur la plateforme TikTok, elle vend ses créations comme des produits skincare, de maquillage ou une ligne de vêtements. L’actrice a développé un empire autour de la mouvance New Age.
Marqueur social
Les marques des célébrités deviennent un marqueur social, une manière de prolonger l’univers de la star dans le quotidien des consommateurs. En 2025, on assiste à la continuité de cette tendance. L’année aura été marquée par des extensions de gammes pour Rhode et Rare Beauty, mais aussi par de nouveaux lancements de marques comme les parfums de Bella Hadid, Orebella, ou la gamme de soins Dua, de Dua Lipa.
Le succès de la marque continue de reposer sur la capacité de la célébrité-entrepreneure à projeter une authenticité perçue et une implication réelle. En face, se trouve un consommateur certes sensible aux réseaux sociaux, mais qui peut s’avérer résistant à certaines manœuvres marketing.
Si la célébrité paraît opportuniste ou déconnectée du produit, la légitimité s’effondre. Tel fut le cas pour Meghan Markle au moment du lancement de sa marque lifestyle, As Ever, de produits alimentaires, bougies et vins. Les critiques ont fusé, l’accusant de peu de professionnalisme, de capitaliser uniquement sur sa notoriété et sur son statut de duchesse de Sussex.
Des marques à durée limitée ?
Les produits de beauté ne sont qu’un exemple de la diversification entrepreneuriale des célébrités. Nombreuses sont les stars qui se tournent vers des marchés où le capital image est essentiel et où le taux de renouvellement des produits est élevé.
C’est le cas du secteur de l’alcool qui offre une marge élevée et une connexion directe avec les fans. L’actrice Cameron Diaz a co-fondé une marque de vin bio et vegan qu’elle a nommé Avaline. Le rappeur Jay Z possède sa maison de champagne, Armand de Brignac.
Le phénomène de la célébrité-entrepreneure révèle une nouvelle dynamique, celle de la marque personnelle. Dès lors, la question qui se pose n’est plus la performance initiale mais la vision stratégique à long terme. Cette hyper-accélération du succès, rendue possible essentiellement par la notoriété, leur permet-elle de devenir des marques à part entière, et non de simples prolongements de la célébrité ?
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
12.01.2026 à 12:01
Faut-il, comme EDF, interdire toute consommation d’alcool dans le monde professionnel ?
Texte intégral (1833 mots)
EDF a indiqué interdire la consommation d’alcool sur le lieu de travail et dans les repas d’affaires. Cette décision est-elle compatible avec la liberté individuelle ? Peut-elle ou doit-elle s’appliquer dans d’autres entreprises, notamment au nom de la lutte contre les addictions et de la garantie de la sécurité du personnel ?
Dès ce mois de janvier, les salariés d’EDF n’ont plus le droit de consommer d’alcool au travail ni lors d’événements organisés par leur employeur à l’extérieur.
Cette mesure, encadrée par l’article R4228-20 du Code du travail, questionne l’équilibre entre prévention des risques (addictions, comportements inappropriés, accidents du travail), libertés individuelles et préservation des rites qui constituent la culture d’entreprise.
Cette décision très médiatisée intervient dans un contexte où la prévention des risques professionnels et des accidents du travail est au centre du débat public.
Cette décision s’inscrit dans un cadre réglementaire existant et une jurisprudence constante. Cette décision n’a donc rien de bien surprenant.
Protéger la santé et la sécurité
L’organisation d’événements festifs ponctue la vie de l’entreprise. Ces moments supposés conviviaux à l’initiative de l’employeur, du comité social et économique (CSE) ou de certains salariés, contribuent à produire une meilleure cohésion des équipes et au maintien de la culture d’entreprise.
Parfois, l’alcool s’invite dans ces temps collectifs, à l’intersection de la vie professionnelle et personnelle… Il ne suffit pas que la réunion ait lieu en dehors de l’entreprise pour exonérer l’employeur de toute responsabilité. S’il en est à l’initiative, celle-ci reste sous sa responsabilité. La consommation d’alcool sur le lieu de travail comporte cependant de nombreux risques et, à ce titre, est très fortement encadrée en France.
Ainsi, l’article R4228-20 du Code du travail précise qu’« aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail ». Si la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur, en application de l’article L. 4121-1 du Code du travail doit en restreindre l’usage. Cet article dispose que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».
L’employeur est soumis non pas à une obligation de résultat mais à une obligation de moyens renforcés (Cour de cassation, chambre sociale, 25 novembre 2015, no 14-24.444, Air France).
Règlement intérieur ou note de service ?
L’employeur peut aussi le prévoir dans le règlement intérieur – obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés. En effet, ce document fixe les règles de la vie en entreprise et notamment celles relatives à la discipline, la nature et l’échelle des sanctions. À défaut, l’employeur peut l’indiquer par l’intermédiaire d’une note de service reprenant les mesures prises pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d’accident.
Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d’une limitation voire d’une interdiction de consommation d’alcool, doivent être proportionnées au but recherché. Ainsi, l’employeur, en vertu de son pouvoir de direction, peut donc purement et simplement interdire la consommation d’alcool au sein de l’entreprise en invoquant cette obligation de sécurité. Cela lui permet de répondre à l’obligation de moyens renforcés.
Une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement peut alors être prononcée à l’encontre des collaborateurs en cas de non-respect, si elle prévue dans le règlement intérieur.
À titre d’exemple, une clause d’un règlement intérieur précise :
« L’introduction, la distribution et/ou la consommation de toute boisson alcoolisée sur le lieu de travail (bureaux, chantiers…) sont interdites, à l’exception des dispositions prévues par l’article R. 4228-20 du Code du travail et uniquement lors des repas en dehors du temps de travail. Cette consommation devra l’être dans des quantités raisonnables de manière à ne pas altérer les capacités à occuper son emploi et/ou à être en mesure de conduire un véhicule, notamment pour regagner son domicile. L’introduction, la distribution et la consommation de produits stupéfiants dans les locaux de travail sont en outre strictement interdits. »
Le danger des pratiques addictives
Par ailleurs, l’employeur – qui est tenu d’identifier et de répertorier les risques dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) – doit tenir compte des pratiques potentiellement addictives (consommation d’alcool mais aussi de drogues). En effet, les pratiques addictives concernent de nombreux salariés, quels que soient le secteur d’activité ou la catégorie socioprofessionnelle.
Ces consommations, occasionnelles ou répétées, comportent des risques pour la santé et la sécurité des salariés. Il est donc nécessaire d’inscrire le risque lié aux pratiques addictives dans ce document unique (article R. 4121-1 du Code du travail).
Ce document est tenu à la disposition des salariés, des anciens salariés, des membres du comité social et économique, du médecin du travail, de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et des agents des Carsat (article R4121-4 du Code du travail).
Interdire en préservant les libertés individuelles
En cas de consommation abusive d’alcool, le salarié pourrait avoir un accident dans l’entreprise ou en rentrant chez lui après un repas d’entreprise par exemple. L’employeur engagerait alors sa responsabilité dans le cadre de l’obligation de sécurité et pourrait être condamné. On pense par exemple à un accident automobile pour un commercial. De son côté, le salarié pourrait également être reconnu responsable.
Ainsi, le 10 avril 2024 (RG no 21/06884), la Cour d’appel de Rennes a statué sur la réalité d’un accident du travail dont l’origine était la consommation d’alcool par un salarié au temps et au lieu du travail. Un chauffeur alcoolisé chargeait un engin de chantier qui a basculé sur lui ; accident des suites duquel il est malheureusement décédé. À noter que les restrictions relatives à l’alcool sont par ailleurs souvent accompagnées de restrictions relatives aux stupéfiants.
Comment contrôler ?
Ainsi, le cadre légal dont relèvent les conduites addictives en entreprise est complexe, car il doit concilier l’obligation de sécurité avec le respect des droits fondamentaux de l’employé (article L.1121-1 du Code du travail).
L’employeur peut ainsi recourir au contrôle de l’alcoolémie sous réserve du respect de certaines dispositions. Le contrôle par éthylotest ne doit pas être systématique. Il doit être justifié par des raisons de sécurité et ne doit concerner que les salariés dont les fonctions sont de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger. Ainsi, la liste des postes pour lesquels un dépistage est possible doit être prévue dans le réglement intérieur.
La restriction doit cependant être proportionnée au but recherché et doit permettre de protéger les intérêts légitimes de l’entreprise. Par exemple, dans un entrepôt où travaillent des caristes (conducteurs de petits véhicules de manutention), il est légitime d’interdire complètement l’alcool, dont la consommation pourrait altérer les réflexes des salariés et produire des accidents. L’usage de substances psychoactives sur le lieu de travail, ou avant la prise de poste, augmente le risque d’accidents du travail, d’erreurs humaines et de comportements inadaptés, notamment dans les secteurs nécessitant de la vigilance ou la manipulation de machines.
Dégradation du climat social
Les conduites addictives peuvent également dégrader le climat social en entreprise. Elles peuvent générer des tensions entre collègues, créer des situations de conflit ou d’incompréhension, et altérer la cohésion des équipes, impacter négativement la productivité et la qualité du travail, augmenter l’absentéisme et les retards, causer des soucis de santé et de gestion des aptitudes.
Au-delà de la dimension juridique liée aux risques humains et de contentieux, la consommation d’alcool ou de drogues est également un enjeu managérial. En effet, la stigmatisation des personnes concernées et le tabou entourant la consommation de substances addictives peuvent freiner la détection et la prise en charge des situations à risques, conduisant à une marginalisation des salariés concernés. Les managers et les services RH doivent apprendre à détecter les signaux faibles. Le recours à la médecine du travail est également indispensable. Information et formations sont importantes dans une stratégie de prévention.
Caroline Diard ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
11.01.2026 à 15:44
L’avenir de l’impression 3D passera par les matériaux
Texte intégral (2079 mots)
Qu’il s’agisse de pièces de fusée, d’automobile, de pont ou même d’aliments, la fabrication additive (FA) redéfinit complètement le champ des possibles dans de très nombreux domaines d’activités. Elle offre des perspectives prometteuses en matière de matériaux, mais elle pose également des défis techniques, économiques et environnementaux qui nécessitent une maturation et une adaptation des procédés en lien avec les matériaux utilisés.
Plus connu sous la dénomination « impression 3D », ce procédé met en œuvre des polymères (plastiques) ou des alliages métalliques pour fabriquer des objets du quotidien. Les imprimantes 3D polymères sont accessibles au grand public pour quelques centaines d’euros. Elles permettent notamment de fabriquer des pièces prototypes (d’où le nom prototypage rapide), des coques de téléphone, des pièces de rechange, des prothèses, des bijoux, des jouets, des objets de décorations ou des maquettes. En ce qui concerne les métaux, les machines d’impression sont beaucoup plus chères (quelques centaines de milliers d’euros). On trouve des applications telles que des implants médicaux, des pièces aérospatiales/automobiles, de l’outillage industriel, des bijoux de luxe. On peut également trouver ce principe de fabrication dans le domaine du BTP avec des « imprimantes » qui mettent en œuvre du béton pour fabriquer des maisons, des bâtiments ou tout type de structure en génie civil.
Mais, comme toute nouveauté, le procédé suscite autant d’espoir qu’il ne réserve de surprises (bonnes ou mauvaises) à celles et ceux qui souhaitent utiliser ce nouveau moyen de fabrication.
D’un point de vue technique, l’impression 3D consiste, couche après couche, à durcir (polymériser) une résine liquide ou à venir déposer de la matière (plastique ou métallique) de manière précise et contrôlée (en ajustant les paramètres tels que la température, la vitesse d’impression, le taux de remplissage, l’orientation de l’objet) pour répondre à certaines contraintes de géométrie, poids, optimisation des propriétés mécaniques ou physiques.
La microstructure d’une pièce imprimée en 3D (polymère ou métal) désigne l’organisation interne de sa matière à une échelle microscopique, influencée par le procédé d’impression. La complexité de la géométrie, les dimensions, le prix vont conditionner le choix de la technologie d’impression et des matériaux associés.
Une révolution dans de nombreux domaines industriels
Qu’elle soit alternative ou complémentaire des techniques conventionnelles par enlèvement de matière ou par déformation, la FA révolutionne de nombreux domaines industriels. De la réalisation de pièces monolithiques (en une seule étape de fabrication, sans assemblage) à forte valeur ajoutée à la fonctionnalisation (conférer à la pièce certaines propriétés locales en changeant les paramètres d’impression au besoin), en passant par le prototypage rapide (valider la conception d’une pièce prototype de manière itérative), les possibilités sont multiples. On peut citer notamment des prothèses de hanche en titane adaptées à l’anatomie de chaque patient, des injecteurs de fusée à géométrie complexe et fabriquées en une seule pièce, des moules optimisés avec canaux de refroidissement sur mesure, des bijoux en métaux précieux avec des designs impossibles à obtenir avec des moyens d’usinage conventionnels.
La chaîne de valeurs de la FA – qui définit l’ensemble des étapes de réalisation d’une pièce de l’approvisionnement en matière première, à la conception, aux conditions de mise en œuvre, à la fabrication, au coût énergétique, à la reprise d’usinage, aux opérations de parachèvement, à la qualification de la santé matière, à la caractérisation des propriétés physiques, au recyclage – est cependant plus complexe et potentiellement plus onéreuse. La technicité, oui, mais pas à n’importe quel prix ! Outre les moyens de fabrication spécifiques sur lesquels elle repose, elle nécessite des règles de conception fondamentalement différentes car elle impose de nouvelles contraintes techniques. De la Conception Assistée par Ordinateur, au choix matériau, au programme machine et à l’industrialisation, il faut ainsi redéfinir complètement la manière de penser du cahier des charges à la maintenance des produits issus de la FA.
Des enjeux majeurs pour les matériaux
Un des points fondamentaux du développement de ces nouveaux procédés réside dans la compréhension du lien entre les paramètres de fabrication des pièces (temps d’impression, puissance du laser, vitesse de déplacement de la tête d’impression, dimensions, environnement de travail – sous atmosphère contrôlée ou non), leur santé matière (présence de porosités ou de défauts parfois liés à un manque de fusion/gazéification locaux de la matière) et leurs propriétés physiques (conductivité thermique ou électrique, propriétés mécaniques, densité). Autrement dit, il est nécessaire de fiabiliser les procédés et optimiser les propriétés finales de la pièce en étant capable de contrôler des paramètres de fabrication, lesquels vont beaucoup dépendre des matériaux mis en œuvre. Ainsi, la FA présente des enjeux majeurs pour les matériaux, qu’ils soient techniques, économiques ou environnementaux.
Tout d’abord, les procédés de FA nécessitent de développer, en amont, des matériaux adaptés (filaments, poudres) aux spécificités des procédés (fusion laser, dépôt de matière fondue, alimentation en matière des têtes d’impression), lesquels vont imposer des contraintes en termes de prix, toxicité et recyclabilité. En effet, les poudres métalliques ou polymères spécifiques (de type thermoplastique) dédiées à la fabrication additive restent souvent plus coûteuses que les matériaux conventionnels, d’un facteur 10 environ.
Néanmoins, malgré le coût plus élevé des matériaux et des procédés, l’impression 3D réduit les déchets (pas de copeaux comme en usinage), permet de fabriquer des pièces dont la géométrie est optimisée (allègement des structures) et élimine le besoin de moules coûteux pour les petites séries, ce qui peut compenser l’écart de coût pour des pièces à forte valeur ajoutée. Ainsi, la réduction des coûts est un enjeu clé pour une adoption plus large. De plus, l’approvisionnement en matière première peut être limité, ce qui ralentit le développement des applications industrielles.
La FA permet également de faire de l’hybridation en associant différents types de matériaux lors de l’impression (en utilisant plusieurs têtes d’impression) afin d’obtenir des pièces composites dont les propriétés mécaniques, électriques ou thermiques sont spécifiques. Par exemple, dans l’industrie aérospatiale ou l’automobile, l’impression 3D de pièces comme des moules d’injection ou des échangeurs thermiques avec des canaux de refroidissement complexes intégrés – lesquels sont impossibles à réaliser par usinage classique – permettent d’optimiser la dissipation thermique, améliorant l’efficacité et la longévité de la pièce.
Les procédés de FA permettent également d’imprimer des structures arborescentes (bio-mimétisme) obtenues via des outils d’optimisation topologique qui est une méthode de conception avancée qui utilise des algorithmes pour déterminer la forme optimale d’une structure en fonction de contraintes spécifiques, telles que la résistance, le poids, ou la distribution des efforts. La spécificité de l’impression 3D réside aussi dans la possibilité de produire des structures complexes de type treillis ou architecturées pour fonctionnaliser le matériau (propriétés mécaniques sur mesure, réduction de la masse, diminution des coûts de fabrication, isolation thermique, acoustique, absorption des chocs ou des vibrations).
Fusion de matière
Quand les pièces sont imprimées, il existe – selon le procédé de fabrication – des opérations dites de parachèvement qui consistent à finaliser les pièces. Cela inclut l’usinage des supports de conformage (qui sont comme des échafaudages qui supportent la pièce lors de la fabrication couche par couche), la reprise d’usinage des surfaces (ou polissage) pour améliorer l’état de surface (quand cela est possible) en raison de la rugosité importante des pièces brutes. On peut également réaliser des traitements thermiques pour homogénéiser la microstructure (pièces métalliques) ou de compression à chaud pour limiter le taux de porosités (un des inconvénients majeurs de l’impression 3D). Ces opérations sont fondamentales, car la rugosité de surface et le taux de porosités sont les caractéristiques les plus critiques du point de vue du comportement mécanique. Par ailleurs, quand il s’agit de procédés à base de poudres, il est nécessaire de dépoudrer les pièces pour évacuer le surplus de matière, lequel peut nuire au fonctionnement en service de la pièce ainsi fabriquée.
Par nature, la majorité des procédés de FA impliquent la fusion de matière (plastique ou métallique), ce qui va se traduire par des échauffements localisés et des différences de température très importants au sein de la pièce. Ces gradients thermiques vont conditionner la microstructure, la présence de contraintes internes (en lien avec la microstructure), la santé (présence de défauts), l’anisotropie (les propriétés ne sont pas les mêmes dans toutes les directions) et l’hétérogénéité (les propriétés ne sont pas les mêmes en tout point) des pièces. La fiabilité des pièces imprimées va donc beaucoup dépendre de ces caractéristiques.
En amont, il est alors important d’étudier les interactions entre procédés-microstructure et propriétés mécaniques pour différents types de matériaux. C’est l’objet de nos travaux de recherche menés à l’INSA Rouen Normandie. Pour les polymères, l’impression 3D par dépôt de filament fondu (FFF) présente une porosité intrinsèque qui réduit la résistance à la rupture. En utilisant des procédés tels que le laser shock peening (LSP), un traitement mécanique in situ appliqué à certaines couches pendant l’impression, on peut alors faire de la fonctionnalisation en réduisant localement la porosité et en créant des barrières ralentissant la propagation des fissures, améliorant ainsi la ténacité des matériaux (la résistance à la fissuration du matériau). De manière similaire, pour les alliages métalliques obtenus par Fusion sur Lit de Poudre, en jouant sur les paramètres de fabrication (puissance et vitesse de déplacement du laser notamment), il est possible d’ajuster localement les propriétés du matériau pour moduler sa ténacité ou sa capacité à se déformer plastiquement.*
Aussi, il est nécessaire de caractériser précisément – en aval de la fabrication – les propriétés (thermiques, électriques, mécaniques) des pièces en accord avec les normes de certification propres aux différents domaines d’activité (médical, aéronautique, aérospatiale, automobile, agro-alimentaire).
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
11.01.2026 à 15:42
Groenland : rester avec les Inuit polaires
Texte intégral (2848 mots)
En juin 1951, l’explorateur Jean Malaurie voit surgir de la toundra une immense base militaire américaine, bâtie dans le secret le plus total. Ce choc marque pour lui le début d’un basculement irréversible pour les sociétés inuit. Aujourd’hui, alors que le Groenland redevient un enjeu stratégique mondial, l’histoire semble se répéter. Rester avec les Inuit polaires, c’est refuser de parler de territoires en oubliant ceux qui les habitent.
Le 16 juin 1951, l’explorateur français Jean Malaurie progresse en traîneaux à chiens sur la côte nord-ouest du Groenland. Il est parti seul, sur un coup de tête, avec un maigre pécule du CNRS, officiellement pour travailler sur les paysages périglaciaires. En réalité, cette rencontre avec des peuples dont la relation au monde était d’une autre nature allait forger un destin singulier.
Ce jour-là, après de longs mois d’isolement parmi les Inuit, au moment critique du dégel, Malaurie avance avec quelques chasseurs. Il est épuisé, sale, amaigri. L’un des Inuit lui touche l’épaule : « Takou, regarde » Un épais nuage jaune monte au ciel. À la longue-vue, Malaurie croit d’abord à un mirage : « une cité de hangars et de tentes, de tôles et d’aluminium, éblouissante au soleil dans la fumée et la poussière […] Il y a trois mois, la vallée était calme et vide d’hommes. J’avais planté ma tente, un jour clair de l’été dernier, dans une toundra fleurie et virginale. »
Le souffle de cette ville nouvelle, écrira-t-il, « ne nous lâchera plus ». Les excavatrices tentaculaires raclent la terre, les camions vomissent les gravats à la mer, les avions virevoltent. Malaurie est projeté de l’âge de pierre à l’âge de l’atome. Il vient de découvrir la base secrète américaine de Thulé, nom de code Operation Blue Jay. L’un des projets de construction militaire les plus massifs et les plus rapides de l’histoire des États-Unis.

Sous ce nom anodin se cache une logistique pharaonique. Les États-Unis redoutent une attaque nucléaire soviétique par la route polaire. En un seul été, quelque 120 navires et 12 000 hommes sont mobilisés dans une baie qui n’avait connu jusque-là que le glissement silencieux des kayaks. Le Groenland ne comptait alors qu’environ 23 000 habitants. En 104 jours, sur un sol gelé en permanence, surgit une cité technologique capable d’accueillir les bombardiers géants B-36, porteurs d’ogives nucléaires. À plus de 1 200 kilomètres au nord du cercle polaire, dans un secret presque total, les États-Unis font surgir l’une des plus grandes bases militaires jamais construites hors de leur territoire continental. Un accord de défense est signé avec le Danemark au printemps 1951, mais l’Operation Blue Jay est déjà engagée : la décision américaine a été prise dès 1950.
L’annexion de l’univers Inuit
Malaurie comprend aussitôt que la démesure de l’opération signe, de fait, une annexion de l’univers Inuit. Un monde fondé sur la vitesse, la machine, l’accumulation vient de pénétrer brutalement, aveuglément, un espace réglé par la tradition, le cycle, la chasse et l’attente.
Le geai bleu est un oiseau bruyant, agressif, extrêmement territorial. La base de Thulé se situe à mi-chemin entre Washington et Moscou par la route polaire. À l’heure des missiles hypersoniques intercontinentaux, hier soviétiques, aujourd’hui russes, c’est cette même géographie qui fonde encore l’argument du « besoin impérieux » invoqué par Donald Trump dans son désir d’annexion du Groenland.

Le résultat immédiat le plus tragique de l’Opération Blue Jay ne fut pas militaire, mais humain. En 1953, pour sécuriser le périmètre de la base et de ses radars, les autorités décidèrent de déplacer l’ensemble de la population inughuit locale vers Qaanaaq, à une centaine de kilomètres plus au nord. Le déplacement fut rapide, contraint, sans consultation, brisant le lien organique entre ce peuple et ses territoires de chasse ancestraux. Un “peuple racine” déraciné pour faire place à une piste d’aviation.
C’est sur ce moment de bascule foudroyante que Malaurie situe l’effondrement des sociétés traditionnelles inuit, où la chasse n’est pas une technique de survie mais un principe organisateur du monde social. L’univers inuit est une économie du sens, faite de relations, de gestes et de transmissions, qui donnent à chacun reconnaissance, rôle et place. Cette cohérence intime, qui fait la force de ces sociétés, les rend aussi extrêmement vulnérables lorsqu’un système extérieur en détruit soudainement les fondements territoriaux et symboliques.
Conséquences de l’effondrement des structures traditionnelles
Aujourd’hui, la société groenlandaise est largement sédentarisée et urbanisée. Plus du tiers des 56 500 habitants vit à Nuuk, la capitale, et la quasi-totalité de la population réside désormais dans des villes et localités côtières sédentarisées. L’habitat reflète cette transition brutale. Dans les grandes villes, une part importante de la population occupe des immeubles collectifs en béton, construits pour beaucoup dans les années 1960 et 1970, souvent vétustes et suroccupées. L’économie repose largement sur une pêche industrielle tournée vers l’exportation. La chasse et la pêche de subsistance persistent. Fusils modernes, GPS, motoneiges, connexions satellitaires accompagnent désormais les gestes anciens. La chasse demeure un repère identitaire, mais elle ne structure plus ni l’économie ni la transmission.
Les conséquences humaines de cette rupture sont massives. Le Groenland présente aujourd’hui l’un des taux de suicide les plus élevés au monde, en particulier chez les jeunes hommes inuit. Les indicateurs sociaux contemporains du Groenland - taux de suicide, alcoolisme, violences intrafamiliales – sont largement documentés. De nombreux travaux les relient à la rapidité des transformations sociales, à la sédentarisation et à la rupture des transmissions traditionnelles.

Revenons à Thulé. L’immense projet secret engagé au début des années 1950 n’avait rien de provisoire. Radars, pistes, tours radio, hôpital : Thulé devient une ville stratégique totale. Pour Malaurie, l’homme du harpon est condamné. Non par une faute morale, mais par une collision de systèmes. Il met en garde contre une européanisation qui ne serait qu’une civilisation de tôle émaillée, matériellement confortable, humainement appauvrie. Le danger n’est pas dans l’irruption de la modernité, mais dans l’avènement, sans transition, d’une modernité sans intériorité, opérant sur des terres habitées comme si elles étaient vierges, répétant, à cinq siècles d’écart, l’histoire coloniale des Amériques.
Espaces et contaminations radioactives
Le 21 janvier 1968, cette logique atteint un point de non-retour. Un bombardier B-52G de l’US Air Force, engagé dans une mission permanente d’alerte nucléaire du dispositif Chrome Dome, s’écrase sur la banquise à une dizaine de kilomètres de Thulé. Il transporte quatre bombes thermonucléaires. Les explosifs conventionnels des bombes nucléaires, destinés à amorcer la réaction, détonnent à l’impact. Il n’y a pas d’explosion nucléaire, mais la déflagration disperse sur une vaste zone du plutonium, de l’uranium, de l’americium et du tritium.
Dans les jours qui suivent, Washington et Copenhague lancent Project Crested Ice, une vaste opération de récupération et de décontamination avant la fonte printanière. Environ 1 500 travailleurs danois sont mobilisés pour racler la glace et collecter la neige contaminée. Plusieurs décennies plus tard, nombre d’entre eux engageront des procédures judiciaires, affirmant avoir travaillé sans information ni protection adéquates. Ces contentieux se prolongeront jusqu’en 2018-2019, débouchant sur des indemnisations politiques limitées, sans reconnaissance juridique de responsabilité. Aucune enquête épidémiologique exhaustive ne sera jamais menée auprès des populations inuit locales.
Aujourd’hui rebaptisée Pituffik Space Base, l’ancienne base de Thulé est l’un des nœuds stratégiques majeurs du dispositif militaire américain. Intégrée à la US Space Force, elle joue un rôle central dans l’alerte antimissile et la surveillance spatiale en Arctique, sous un régime de sécurité maximale. Elle n’est pas un vestige de la guerre froide, mais un pivot actif de la géopolitique contemporaine.
Dans Les Derniers Rois de Thulé, Malaurie montre que les peuples racine n’ont jamais de place possible au cœur des considérations stratégiques occidentales. Face aux grandes manœuvres du monde, l’existence des Inuit y devient aussi périphérique que celle des phoques ou des papillons.
Les déclarations de Donald Trump ne font pas surgir un monde nouveau. Elles visent à généraliser au Groenland un système en place depuis soixante-quinze ans. Mais la position d’un homme ne saurait nous exonérer de nos responsabilités collectives. Entendre aujourd’hui que le Groenland « appartient » au Danemark et dépend de l’OTAN, sans même évoquer les Inuit, revient à répéter un vieux geste colonial : concevoir les territoires en y effaçant ceux qui l’habitent.
Les Inuit demeurent invisibles et inaudibles. Nos sociétés continuent de se représenter comme des adultes face à des populations indigènes infantilisées. Leur savoir, leurs valeurs, leurs manières sont relégués au rang de variables secondaires. La différence n’entre pas dans les catégories à partir desquelles nos sociétés savent agir.
À la suite de Jean Malaurie, mes recherches abordent l’humain par ses marges. Qu’il s’agisse des sociétés de chasseurs-cueilleurs ou de ce qu’il reste de Néandertal, lorsqu’on le déshabille de nos projections, l’Autre demeure toujours l’angle mort de notre regard. Nous ne savons pas voir comment s’effondrent des mondes entiers lorsque la différence cesse d’être pensable.
Malaurie concluait son premier chapitre sur Thulé par ces mots :
« Rien n’aura été prévu pour imaginer l’avenir avec hauteur. »
Il faut redouter par-dessus tout non la disparition brutale d’un peuple, mais sa relégation silencieuse, et radicale, dans un monde qui parle de lui sans jamais le regarder ni l’entendre.
Ludovic Slimak ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
11.01.2026 à 15:41
Quand les IA cadrent l’information et façonnent notre vision du monde
Texte intégral (1938 mots)

Les grands modèles de langage façonnent notre perception de l’information, au-delà de l’exactitude ou inexactitude des faits présentés. Dans cette optique, comprendre et corriger les biais de l’intelligence artificielle est crucial pour préserver une information fiable et équilibrée.
La décision de Meta de mettre fin à son programme de fact-checking aux États-Unis a suscité une vague de critiques dans les milieux de la technologie et des médias (NDT : En France, le programme est maintenu). En jeu, les conséquences d’une pareille décision en termes de confiance et de fiabilité du paysage informationnel numérique, en particulier lorsque des plates-formes guidées par le seul profit sont en grande partie laissées à elles-mêmes pour se réguler.
Ce que ce débat a largement négligé, toutefois, c’est qu’aujourd’hui les grands modèles de langage d’intelligence artificielle (IA) sont de plus en plus utilisés pour rédiger des résumés d’actualité, des titres et des contenus qui captent votre attention bien avant que les mécanismes traditionnels de modération des contenus puissent intervenir.
Le problème ne se limite pas à des cas évidents de désinformation ou de contenus préjudiciables qui passeraient entre les mailles du filet en l’absence de modération. Ce qui se joue dans l’ombre, c’est comment des informations factuellement justes peuvent être sélectionnées, présentées et valorisées de façon à orienter la perception du public.
En générant les informations que les chatbots et assistants virtuels présentent à leurs utilisateurs, les grands modèles de langage (LLM) influencent progressivement la manière dont les individus se forgent une opinion. Ces modèles sont désormais également intégrés aux sites d’information, aux plates-formes de réseaux sociaux et aux services de recherche, devenant ainsi la principale porte d’accès à l’information.
Des études montrent que ces grands modèles de langage font bien plus que simplement transmettre de l’information. Leurs réponses peuvent mettre subtilement en avant certains points de vue tout en en minimisant d’autres, souvent à l’insu des utilisateurs.
Biais de communication
Mon collègue, l’informaticien Stefan Schmid, et moi-même, chercheur en droit et politiques des technologies, montrons dans un article à paraître dans la revue Communications of the ACM que les grands modèles de langage présentent un biais de communication. Nous constatons qu’ils peuvent avoir tendance à mettre en avant certaines perspectives tout en en omettant ou en atténuant d’autres. Un tel biais est susceptible d’influencer la manière dont les utilisateurs pensent ou ressentent les choses, indépendamment du fait que l’information présentée soit vraie ou fausse.
Les recherches empiriques menées ces dernières années ont permis de constituer des jeux de données de référence qui mettent en relation les productions des modèles avec les positions des partis avant et pendant les élections. Elles révèlent des variations dans la manière dont les grands modèles de langage actuels traitent ces contenus publics. Le simple choix de la persona (l’identité fictive implicitement assignée au modèle) ou du contexte dans la requête suffit à faire glisser subtilement les modèles actuels vers certaines positions, sans que la justesse factuelle des informations soit remise en cause.
Ces glissements révèlent l’émergence d’une forme de pilotage fondée sur la persona : la tendance d’un modèle à aligner son ton et ses priorités sur ce qu’il perçoit comme les attentes de l’utilisateur. Ainsi, lorsqu’un utilisateur se présente comme militant écologiste et un autre comme chef d’entreprise, un modèle peut répondre à une même question sur une nouvelle loi climatique en mettant l’accent sur des préoccupations différentes, tout en restant factuellement exact dans les deux cas. Les critiques pourront par exemple porter, pour l’un, sur le fait que la loi n’aille pas assez loin dans la promotion des bénéfices environnementaux, et pour l’autre, sur les contraintes réglementaires et les coûts de mise en conformité qu’elle impose.
Un tel alignement peut facilement être interprété comme une forme de flatterie. Ce phénomène est appelé « sycophancy » (NDT : Si en français, le sycophante est un délateur, en anglais il désigne un flatteur fourbe), les modèles disant en pratique aux utilisateurs ce qu’ils ont envie d’entendre. Mais si la « sycophancy » est un symptôme de l’interaction entre l’utilisateur et le modèle, le biais de communication est plus profond encore. Il reflète des déséquilibres dans la conception et le développement de ces systèmes, dans les jeux de données dont ils sont issus et dans les incitations qui orientent leur perfectionnement. Lorsqu’une poignée de développeurs dominent le marché des grands modèles de langage et que leurs systèmes présentent systématiquement certains points de vue sous un jour plus favorable que d’autres, de légères différences de comportement peuvent se transformer, à grande échelle, en distorsions significatives de la communication publique.
Ce que la régulation peut – et ne peut pas – faire
Les sociétés contemporaines s’appuient de plus en plus sur les grands modèles de langage comme interface principale entre les individus et l’information. Partout dans le monde, les gouvernements ont lancé des politiques pour répondre aux préoccupations liées aux biais de l’IA. L’Union européenne, par exemple, avec l’AI Act et le règlement européen sur les services numériques, cherche à imposer davantage de transparence et de responsabilité. Mais aucun de ces textes n’est conçu pour traiter la question plus subtile du biais de communication dans les réponses produites par l’IA.
Les partisans de la régulation de l’IA invoquent souvent l’objectif d’une IA neutre, mais une neutralité véritable est le plus souvent hors d’atteinte. Les systèmes d’IA reflètent les biais inscrits dans leurs données, leur entraînement et leur conception, et les tentatives pour réguler ces biais aboutissent fréquemment à remplacer une forme de biais par une autre.
Et le biais de communication ne se limite pas à l’exactitude : il concerne la production et le cadrage des contenus. Imaginons que l’on interroge un système d’IA sur un texte législatif controversé. La réponse du modèle est façonnée non seulement par les faits, mais aussi par la manière dont ces faits sont présentés, par les sources mises en avant, ainsi que par le ton et le point de vue adoptés.
Cela signifie que la racine du problème des biais ne réside pas seulement dans la correction de données d’entraînement biaisées ou de sorties déséquilibrées, mais aussi dans les structures de marché qui orientent la conception des technologies. Lorsque seuls quelques grands modèles de langage (LLM) contrôlent l’accès à l’information, le risque de biais de communication s’accroît. Une atténuation efficace des biais suppose donc de préserver la concurrence, de renforcer la responsabilité portée par les utilisateurs et tout en restant ouvert aux différentes conceptions et offres de LLM du côté du régulateur.
La plupart des réglementations actuelles visent soit à interdire des contenus préjudiciables après le déploiement des technologies, soit à contraindre les entreprises à réaliser des audits avant leur mise sur le marché. Notre analyse montre que si les contrôles en amont et la supervision a posteriori peuvent permettre d’identifier les erreurs les plus manifestes, ils sont souvent moins efficaces pour traiter les biais de communication subtils qui émergent au fil des interactions avec les utilisateurs.
Aller au-delà de la régulation de l’IA
Il est tentant de croire que la régulation peut éliminer l’ensemble des biais des systèmes d’IA. Dans certains cas, ces politiques peuvent être utiles, mais elles échouent le plus souvent à traiter un problème plus profond : les incitations qui déterminent les technologies chargées de communiquer l’information au public.
Nos travaux montrent qu’une solution plus durable réside dans le renforcement de la concurrence, de la transparence et d’une participation effective des utilisateurs, afin de permettre aux citoyens de jouer un rôle actif dans la manière dont les entreprises conçoivent, testent et déploient les grands modèles de langage.
Ces orientations sont essentielles car, in fine, l’IA n’influencera pas seulement les informations que nous recherchons et l’actualité que nous consommons au quotidien : elle jouera aussi un rôle déterminant dans la façon dont nous imaginons la société de demain.
Adrian Kuenzler ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
11.01.2026 à 15:41
Après l’abattage de milliers de chevaux sauvages, le parc australien du Kosciuszko retrouve peu à peu ses paysages
Texte intégral (3521 mots)

Dans le parc national du Kosciuszko, la diminution de la population de brumbies, les chevaux sauvages, ouvre une chance de restauration pour les écosystèmes fragiles du massif. Celles et ceux qui parcourent le parc au quotidien en voient déjà les premiers effets.
Dans le parc national du Kosciuszko, en pleines Alpes australiennes, le paysage évolue lentement. Des zones de végétation, autrefois rasées par les chevaux, repoussent. Les berges de ruisseaux, longtemps érodées, paraissent moins tassées sur les bords. Les visiteurs croisent aussi moins de chevaux immobiles sur les routes, ce qui représentait un réel danger pour la circulation.
En 2023, en effet, la Nouvelle-Galles du Sud a autorisé l’abattage aérien de chevaux sauvages dans le parc national du Kosciuszko. Et fin novembre, le gouvernement a adopté un projet de loi abrogeant le texte qui reconnaissait aux brumbies ou chevaux sauvages un « statut patrimonial » dans le parc (NDT : ces chevaux, arrivés d’Angleterre avec les premiers colons ont été au centre d’une bataille culturelle culturelle ces dernières années).
Ce changement a supprimé les protections juridiques dont bénéficiaient les chevaux dans le parc, qui les distinguaient des autres espèces introduites comme les cerfs, les porcs, les renards et les lapins. Désormais, ils sont traités en Australie de la même manière que les autres espèces invasives, rétablissant une cohérence dans la gestion de leur impact sur les paysages.
La dernière enquête estime qu’environ 3 000 chevaux subsistent dans le parc national du Kosciuszko, contre quelque 17 000 il y a un an. Plus de 9 000 chevaux ont été abattus depuis 2021.
Le plan de gestion actuellement en vigueur prévoit de conserver 3 000 de ces chevaux, un compromis entre protection des écosystèmes et sauvegarde de la valeur patrimoniale de ces animaux. Il doit s’appliquer jusqu’à la mi-2027.
Quels sont les effets environnementaux de la réduction du nombre de chevaux à Kosciuszko ? Et à quoi le parc pourrait-il ressembler à l’avenir ?

Les dégâts
Depuis des décennies, les chevaux sauvages constituent une source majeure de dégradations écologiques dans les paysages alpins du Kosciuszko. Leur impact dans ces milieux d’altitude fragiles s’est particulièrement accru au cours de la dernière décennie, période pendant laquelle leur population a augmenté de manière incontrôlée.
Des études empiriques et des analyses d’images satellites montrent que les brumbies réduisent la couverture végétale, dégradent la structure des sols et endommagent les berges des cours d’eau, les tourbières et les marais alpins – des sols riches en carbone formés sur des dizaines de milliers d’années.
Une partie de ces dégâts résulte de leur alimentation, fondée sur des graminées et des plantes herbacées alpines à croissance lente. Un cheval consomme généralement l’équivalent de 2 % de sa masse corporelle par jour, soit environ 8 kilogrammes quotidiens. À titre de comparaison, le plus grand herbivore indigène des hauts plateaux, le kangourou gris de l’Est, consomme environ 600 grammes par jour, c’est 13 fois moins.
Mais l’essentiel des dégâts est causé par leurs sabots. Les chevaux sauvages parcourent jusqu’à 50 kilomètres par jour, et leurs sabots durs écrasent les couches de mousses à sphaignes, compactant en profondeur les sols tourbeux. Ces plantes et ces sols fonctionnent normalement comme des éponges à restitution lente, stockant l’eau de fonte des neiges et alimentant les cours d’eau tout au long de l’été. Et contrairement aux wombats, aux kangourous et à d’autres espèces indigènes, les chevaux sauvages se déplacent en file indienne, traçant de profonds sentiers qui quadrillent les prairies alpines et les assèchent.
Ces transformations affectent l’ensemble de l’écosystème. Les scinques alpins, les rats à dents larges, les grenouilles corroboree, les phalangers pygmées des montagnes et les poissons indigènes dépendent tous d’une végétation dense, de tapis de mousse intacts ou de cours d’eau exempts de sédiments – soit précisément les éléments que les chevaux dégradent.

Les cours d’eau ont été particulièrement touchés. Les Alpes australiennes fournissent près d’un tiers des eaux de surface qui alimentent le bassin Murray-Darling (NDT : le plus vaste bassin hydrographique d’Australie), mais le piétinement des chevaux le long des cours d’eau trouble des rivières jusque-là limpides et déstabilise les apports lents et réguliers dont dépendent ces bassins versants.
Ces impacts ne se limitent pas au parc. Ces dernières années, de nombreux chevaux ont gagné des zones voisines, notamment des forêts domaniales, où leurs perturbations s’ajoutent aux effets de l’exploitation forestière commerciale et mettent en danger les visiteurs et les campeurs.
Si l’attention s’est surtout concentrée sur les effets des brumbies au Kosciuszko et, plus largement, dans les écosystèmes alpins, près d’un demi-million de chevaux sauvages affectent les paysages à l’échelle de toute l’Australie, les forêts tropicales claires et les zones semi-arides étant les plus durement touchées.

Ce que nous avons observé jusqu’à présent
Nous avons passé beaucoup de temps dans le parc au cours de l’année écoulée et avons commencé à remarquer de petits changements dans les hauts plateaux, cohérents avec ce que l’on pourrait attendre du programme de contrôle des animaux sauvages.
Nous voyons moins de chevaux lors de nos journées sur le terrain. Dans les zones régulièrement piétinées, de petites poches de végétation réapparaissent sur les surfaces dénudées. Même certaines berges, érodées de longue date, paraissent plus souples sur les bords.
Ces observations restent strictement anecdotiques et ne constituent pas des preuves formelles. Mais elles suggèrent un paysage qui commence à se « réoxygéner » à mesure que la pression diminue. Il y a aussi un aspect sécuritaire. Quiconque circule sur les routes alpines connaît la surprise, au sortir d’un virage dans les eucalyptus, de se retrouver nez à nez avec un cheval, voire un troupeau, sur le bitume. Moins de chevaux signifie moins de ces rencontres dangereuses pour les chercheurs, le personnel des parcs nationaux et les visiteurs.
Le retour progressif
Avec beaucoup moins de chevaux dans les hauts plateaux, la pression commence à diminuer. À mesure que le piétinement diminue, les tourbières et les marais devraient commencer à se régénérer et à retenir l’eau plus longtemps. Les tapis de mousse repousseront et d’autres plantes productrices de tourbe pourront s’implanter à nouveau dans des sols qui ne sont plus constamment compactés et surpâturés.
Moins de pâturage signifie également que les herbes alpines, les carex et les graminées des neiges retrouveront de l’espace pour se développer. Les sols nus vont se stabiliser, les berges des cours d’eau se rétablir et les lits des ruisseaux commencer à se dégager.

Ces améliorations se répercutent sur l’ensemble de l’écosystème : des sols plus stables et une végétation plus dense créent un habitat plus favorable aux grenouilles, aux scinques, aux petits mammifères et aux invertébrés qui dépendent d’environnements alpins frais, humides et structurés.
La récupération prendra du temps – des décennies, et non des mois. Des études empiriques à long terme seront indispensables pour suivre les changements et identifier les zones du parc où des efforts de restauration ciblés seront nécessaires pour accélérer le rétablissement.
Enfin, une vraie chance
Rien de tout cela ne se produira en un claquement de doigts. Les écosystèmes alpins se régénèrent lentement, et des décennies de dégâts ne peuvent pas être effacées du jour au lendemain. Les courtes saisons de croissance font que les plantes repoussent progressivement, et non par à-coups. De nombreuses pentes et berges de ruisseaux portent encore les cicatrices du pâturage bovin plus de 60 ans après le départ du bétail. Les perturbations perdurent ici pendant des générations.
La diminution du nombre de chevaux n’est qu’un début, mais c’est une étape essentielle. Et désormais – avec moins de chevaux sur le terrain et la suppression des barrières légales – le parc du Kosciuszko dispose enfin d’une voie réaliste vers la restauration. La prochaine décennie déterminera combien de son fragile patrimoine alpin pourra finalement être retrouvé.

David M. Watson reçoit des financements de recherche du gouvernement fédéral (via l’ARC, le DAFF, le DCCEEW) et siège aux conseils d’administration du Holbrook Landcare Network et des Great Eastern Ranges. Il a exercé deux mandats au sein du Comité scientifique des espèces menacées de la Nouvelle-Galles du Sud, avant de démissionner lorsque la Wild Horse Heritage Act est entrée en vigueur en juin 2018.
Patrick Finnerty est actuellement directeur pour les carrières émergentes en écologie à l’Ecological Society of Australia, coordinateur des jeunes chercheurs à l’Australasian Wildlife Management Society, et membre du conseil de la Royal Zoological Society of NSW. Il reçoit des financements de l’Australian Research Council.
11.01.2026 à 15:40
Cinq pistes pour éviter les clichés sur l’apprentissage et aider les élèves à progresser
Texte intégral (2351 mots)
C’est pour apprendre que les élèves se rendent chaque jour en classe. Mais savent-ils bien toujours ce que cela signifie réellement ? Les fausses croyances sur la manière dont on acquiert des connaissances sont nombreuses, et elles peuvent compliquer la tâche des enfants et des adolescents. Quelques pistes pour les aider à réajuster leurs méthodes de travail et augmenter leurs chances de réussite.
Au cours de mes années d’enseignement des sciences au collège, au lycée et à l’université, j’ai constaté que certains de mes élèves résistaient à l’exercice de ce que les pédagogues appellent la pensée de haut niveau, incluant l’analyse, la pensée créative et critique, et la résolution de problèmes.
Par exemple, lorsque je leur ai demandé de tirer des conclusions à partir de données ou de mettre au point un protocole pour tester une idée, certains élèves ont répondu : « Pourquoi ne nous dites-vous pas quoi faire ? » ou « N’est-ce pas le rôle de l’enseignant que de nous donner les bonnes réponses ? »
En d’autres termes, mes élèves avaient développé une forte idée préconçue selon laquelle le savoir provient de l’autorité. Après enquête, mes collègues et moi-même avons conclu que ces croyances sur l’apprentissage influençaient leur approche de nos cours, et donc ce qu’ils étaient capables d’apprendre.
Tous les élèves arrivent en classe avec des croyances diverses sur ce que signifie apprendre. Dans le domaine de l’éducation, la croyance la plus recherchée est peut-être ce que nous appelons avoir un état d’esprit de croissance. Les élèves ayant un état d’esprit de croissance croient qu’ils peuvent s’améliorer et continuer à apprendre. En revanche, les élèves ayant un état d’esprit fixe ont du mal à croire qu’ils peuvent approfondir leurs connaissances sur le sujet qu’ils étudient. Lorsque les élèves disent « Je suis nul en maths », ils font preuve d’un état d’esprit fixe.
À lire aussi : À l’école, ce que les élèves pensent de leur intelligence influence leurs résultats
En tant qu’enseignants, nous essayons non seulement d’aider les élèves à comprendre le sujet traité, mais nous cherchons également à leur inculquer des croyances justes sur l’apprentissage afin que rien ne vienne entraver leur capacité à assimiler de nouvelles informations.
Outre l’état d’esprit de croissance, je soutiens que cinq autres croyances sont particulièrement importantes à promouvoir dans les salles de classe afin d’aider les élèves à mieux apprendre et à mieux se préparer au monde moderne.
Apprendre, c’est comprendre
Certains élèves et enseignants assimilent l’apprentissage à la mémorisation.
Si la mémorisation joue un rôle dans l’apprentissage, l’apprentissage approfondi repose quant à lui sur la compréhension. Les élèves ont tout intérêt à reconnaître que l’apprentissage consiste à expliquer et à relier des concepts entre eux pour leur donner un sens.
Se concentrer trop sur la mémorisation peut masquer des lacunes.

Par exemple, je travaillais un jour avec un élève de maternelle qui m’a fièrement montré qu’il savait réciter les chiffres de 1 à 20. Je lui ai alors demandé de compter les crayons sur le bureau. L’élève n’a pas compris ma demande. Il n’avait pas fait le lien entre ces nouveaux mots et le concept des chiffres.
Pour aider les élèves à reconnaître l’importance de la compréhension dans l’apprentissage, les enseignants et les parents peuvent leur poser des questions telles que « Pourquoi est-il préférable de relier une nouvelle idée à une ancienne idée plutôt que d’essayer simplement de mémoriser la réponse ? » ou « Pourquoi une explication est-elle plus utile qu’une simple réponse ? »
Apprendre est un défi
La conviction des élèves selon laquelle l’apprentissage s’apparente à la mémorisation peut refléter une croyance connexe selon laquelle la connaissance est simple et l’apprentissage devrait être facile.
Au contraire, les éducateurs veulent que les élèves acceptent la complexité et les défis qu’elle comporte. En se confrontant aux nuances et à la complexité, les élèves fournissent l’effort mental nécessaire pour former et renforcer de nouvelles connexions dans leur pensée.
Lorsque les élèves pensent que les connaissances sont simples et que l’apprentissage devrait être facile, leur engagement dans la réflexion de haut niveau, nécessaire pour appréhender la complexité et les nuances, en pâtit.
Pour aider les élèves en difficulté à saisir une idée complexe, les enseignants et les parents peuvent leur poser des questions qui les aident à comprendre pourquoi l’apprentissage est complexe et nécessite des efforts.
Apprendre prend du temps
Lorsque les élèves pensent que l’apprentissage est simple et facile, les enseignants ne devraient pas s’étonner qu’ils pensent également que l’apprentissage doit être rapide.
Au contraire, les élèves doivent comprendre que l’apprentissage approfondi prend du temps. Si les élèves pensent que l’apprentissage est rapide, ils sont moins enclins à rechercher des défis, à explorer les nuances ou à réfléchir et à établir des liens entre les idées. Malheureusement, de nombreux programmes scolaires condensent tellement d’objectifs d’apprentissage en un laps de temps très court que la croyance en un apprentissage rapide est subtilement renforcée.
Si les enseignants peuvent faire preuve de créativité dans l’utilisation du matériel pédagogique et consacrer plus de temps à inciter les élèves à explorer la complexité et à établir des liens, le simple fait de passer plus de temps sur un concept peut ne pas suffire à changer les convictions des élèves en matière d’apprentissage.

Pour aider les élèves à changer leur façon de penser, je leur demande de discuter de questions telles que « Pourquoi pensez-vous que la compréhension de concepts complexes prend autant de temps ? » ou « Pourquoi une seule leçon ne suffirait-elle pas pour couvrir ce concept ? » Grâce à ces questions, mes collègues et moi avons constaté que les élèves commencent à reconnaître que l’apprentissage approfondi est lent et prend du temps.
L’apprentissage est un processus continu
Les étudiants doivent également comprendre que l’apprentissage n’a pas de fin.
Malheureusement, beaucoup d’étudiants considèrent l’apprentissage comme une destination plutôt que comme un processus continu. Or, comme la connaissance comporte un degré inhérent d’incertitude et qu’un apprentissage accru révèle souvent une complexité accrue, l’apprentissage doit être continu.
Pour aider les élèves à s’interroger sur cette conviction, les enseignants et les parents pourraient leur poser les questions suivantes : « Comment pensez-vous que vos connaissances ont évolué au fil du temps ? » et « Comment pensez-vous que votre apprentissage va évoluer à l’avenir ? »
L’apprentissage ne se fait pas uniquement auprès des enseignants
Je me souviens qu’un lycéen m’avait dit : « Les enseignants sont censés nous donner les réponses pour que nous sachions quoi écrire à l’examen. »
Cet élève avait apparemment compris les « règles du jeu » et n’était pas content lorsque son professeur essayait de l’inciter à réfléchir de manière plus approfondie. Il s’accrochait à un modèle d’apprentissage par transmission, reposant sur des figures d’autorité.
Au contraire, les élèves doivent comprendre que l’apprentissage provient de nombreuses sources, notamment de leurs expériences, de leurs pairs et de leur propre réflexion, autant que de figures d’autorité.
Même si les enseignants et les parents peuvent hésiter à remettre en cause leur propre autorité, ils rendent un mauvais service aux élèves lorsqu’ils ne les préparent pas à remettre en question les figures d’autorité et à aller au-delà.
Pour aider les élèves à changer leur façon de penser, les enseignants peuvent leur demander de réfléchir à la question suivante : « Pourquoi le fait d’apprendre à partir de sources multiples peut-il vous aider à mieux comprendre la complexité et les nuances d’un concept ? »
Changer nos croyances sur l’apprentissage
Souvent, les enseignants et les parents pensent que les occasions de faire appel à un raisonnement de haut niveau suffisent à aider leurs élèves à développer de meilleures croyances concernant l’apprentissage.
Mais de telles croyances nécessitent une attention explicite et doivent être prévues dans les cours. Pour ce faire, il convient de poser des questions ciblant des croyances spécifiques, telles que celles mentionnées dans la chacune des sections précédentes.
Les conversations que j’ai pu avoir par ce biais avec les élèves étaient très intéressantes. De plus, aider les enfants à développer des croyances plus solides sur l’apprentissage est peut-être la chose la plus importante que les enseignants puissent faire pour les préparer à l’avenir.
Jerrid Kruse a reçu des financements de la National Science Foundation, du NASA Iowa Space Grant Consortium et de la William G. Stowe Foundation.
10.01.2026 à 17:25
Où vivent les plus riches ? Ce que la géographie des hauts revenus dit des fractures françaises
Texte intégral (2894 mots)
Des centres urbains, où se concentrent les hauts revenus, aux territoires périphériques, où ils disparaissent, la carte des foyers les plus aisés de France raconte une histoire singulière des inégalités. En retraçant leur répartition géographique depuis 1960, une nouvelle étude éclaire les conséquences spatiales des transformations structurelles de l’économie française, et les tensions sociales et politiques qu’elles continuent d’alimenter.
Réduire les écarts entre territoires est un objectif récurrent des politiques publiques, en France comme en Europe. L’Union européenne (UE) en a fait un principe fondateur, inscrit à l’article 174 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) :
« Afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de l’Union, celle-ci vise à réduire les écarts entre les niveaux de développement des diverses régions. »
Pourtant, cet objectif est aujourd’hui plus que jamais mis à l’épreuve. En France, comme ailleurs, les dernières décennies ont vu s’accentuer un sentiment de fracture territoriale : d’un côté, quelques grandes métropoles concentrent les emplois qualifiés, les sièges d’entreprises, les services de haut niveau ; de l’autre, de vastes espaces voient leurs activités industrielles décliner, leurs jeunes partir et leurs revenus stagner.
Ces déséquilibres économiques ne sont pas sans conséquence sociale ou politique, comme les dernières années l’ont montré avec force. Des ronds-points des « gilets jaunes » aux cartes électorales où se lit la progression de l’abstention ou du vote pour les partis extrêmes, la colère sociale a souvent une géographie. Là où les opportunités économiques se raréfient, les perspectives se referment, le sentiment d’injustice s’installe, et une question fondamentale émerge : que devient une société lorsque les perspectives de réussite se concentrent exclusivement dans quelques territoires ?
Un indicateur plus fin pour comprendre ces enjeux
Comprendre ces enjeux suppose d’abord de bien les mesurer. Or, les indicateurs couramment utilisés dans la littérature économique tendent à masquer la réalité des disparités territoriales. On analyse souvent le développement d’une région à l’aune du produit intérieur brut par habitant ou du revenu moyen, sans tenir compte des différences de structures sociales : ici, une forte proportion de ménages aisés et modestes ; là, une population plus homogène, composée de classes moyennes. Ainsi, la répartition des revenus constitue un élément central pour comprendre les dynamiques locales.
À lire aussi : Combien l’employeur doit-il payer pour attirer des cadres en dehors des zones urbaines ?
Dans un article à paraître dans le Journal of Economic Geography, nous avons voulu dépasser ces limites en construisant une base de données inédite retraçant la répartition des foyers fiscaux appartenant aux 10 % et aux 1 % les plus aisés dans les départements de France hexagonale depuis 1960. Ce travail, rendu possible par une collecte de longue haleine dans les archives du ministère des finances, offre pour la première fois la possibilité d’observer sur plus d’un demi-siècle la géographie des hauts revenus en France et les transformations qu’elle révèle.
À partir de ces données, nous proposons un indicateur simple mais riche de sens : la part des très hauts revenus (Top 1 %) et des hauts revenus (Top 10 % moins Top 1 %) dans la population locale. On peut interpréter ces indicateurs comme la probabilité, pour un individu, d’appartenir aux ménages aisés selon le territoire où il vit.
Cette approche offre un regard nouveau sur les fractures territoriales contemporaines. Là où les opportunités économiques s’amenuisent, les plus qualifiés, les plus ambitieux, les plus mobiles partent ailleurs, laissant derrière eux des territoires appauvris en capital humain et en perspectives. Ces départs nourrissent à leur tour un sentiment de déclassement collectif, l’impression diffuse que « le progrès se passe ailleurs ».
Les cartes de la figure 1 retracent plus de soixante ans d’histoire sociale du territoire français. Elles montrent, pour trois dates clés (1960, 1990 et 2019), la part des ménages appartenant aux très hauts revenus (à gauche) et aux hauts revenus (à droite). Si les foyers fiscaux aisés étaient répartis uniformément, ces parts seraient respectivement de 1 % et de 9 % dans tous les départements : ce sont les zones blanches sur les cartes. Dans la réalité, ce n’est pas le cas : les nuances d’orange et de rouge signalent donc une surreprésentation locale, les teintes de bleu une sous-représentation. Il faut enfin rappeler que la géographie administrative de l’Île-de-France est passée de trois départements au début des années 1960 à huit aujourd’hui.
L’importance de la ligne Caen-Annecy dans les années 1960
En 1960, la France des très hauts revenus est très largement structurée par une ligne Caen-Annecy. Au sud, la part des foyers aux très hauts revenus dans la population locale est faible, souvent moins de 0,5 % (nous l’estimons par exemple à 0,1 % en Lozère). Seules quelques zones urbaines ou industrielles (Rhône, Haute-Garonne, Isère, Haute-Savoie) se distinguent légèrement. Au nord, la présence des foyers les plus aisés s’intensifie, notamment en région parisienne, où la part atteint 2,6 % dans le département de la Seine et 1,6 % en Seine-et-Oise, ou dans le département du Nord.
Trente ans plus tard, la ligne Caen–Annecy a perdu son sens. Les départements où les très hauts revenus sont rares se concentrent près du Massif central (0,4 % en Lozère). Un second pôle où se concentrent les foyers aux très hauts revenus s’est formé à la frontière suisse (Ain, Savoie, Haute-Savoie), tandis que la Côte d’Azur, les métropoles du Sud-Ouest (Toulouse, Bordeaux) et quelques villes du centre (Dijon, Tours) gagnent en attractivité. On observe une forte polarisation en Île-de-France : les très hauts revenus sont très présents à Paris, dans les Hauts-de-Seine et dans les Yvelines, mais très peu nombreux en Seine-Saint-Denis.
Une nouvelle géographie aujourd’hui
En 2019, la rupture est manifeste. Les très hauts revenus sont absents dans la plupart des départements de la « diagonale du vide », tandis que la France des très hauts revenus se réduit à quelques pôles métropolitains (Bordeaux, Nantes, Toulouse, Marseille, Dijon, Strasbourg, Nice) qui conservent des parts proches de 1 % et à la frontière suisse où elle est de 2 % en Haute-Savoie. En Île-de-France, la polarisation atteint des sommets : la part des très hauts revenus est seulement de 0,4 % en Seine-Saint-Denis, mais de 4,5 % à Paris, 4,2 % dans les Hauts-de-Seine, et 2,8 % dans les Yvelines.
Les cartes des hauts revenus (hors Top 1 %) confirment ces dynamiques. En 1960, les foyers aisés sont déjà concentrés autour de Paris et du Rhône tandis que la Bretagne, le Sud-Ouest et le Massif central en comptent peu (moins de 3 % en Aveyron ou en Haute-Loire). En 1990, cette géographie change. La frontière suisse, la Côte d’Azur et plusieurs métropoles régionales rejoignent le groupe des départements surreprésentés. En 2019, les écarts s’accentuent encore, mais la logique reste la même : une sous-représentation persistante dans le centre du pays, et une forte surreprésentation des ménages aisés en région parisienne et près de la frontière suisse. La part de ces foyers est maximale dans les Hauts-de-Seine et dans les Yvelines, où elle atteint 18 %.
Figure 1 : Proportion des très hauts revenus et des hauts revenus dans la population locale en 1960, en 1990 et en 2019.
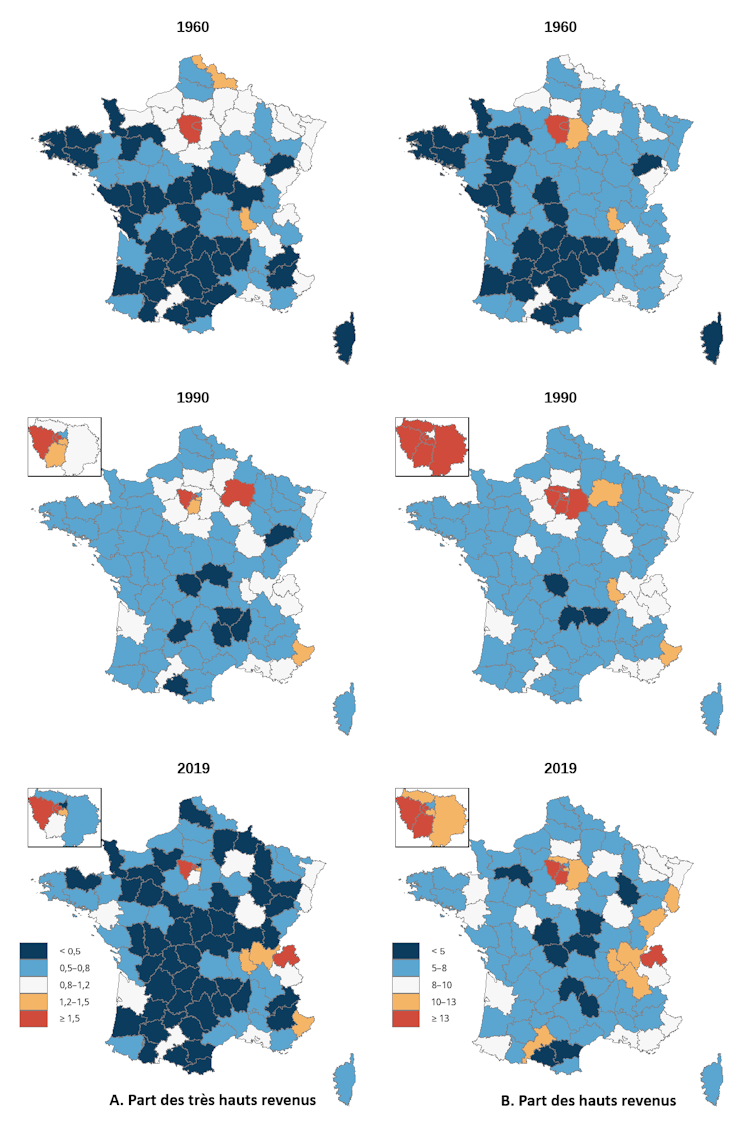
Notes : On définit la part des très hauts revenus comme la proportion de ménages faisant partie des 1 % de ménages aux plus hauts revenus (respectivement 10 % de ménages aux plus hauts revenus moins les 1 % aux plus hauts revenus) tels que définis en France hexagonale.
Des trajectoires divergentes depuis la fin des années 1990
Ces transformations géographiques détaillées peuvent se résumer en un indicateur unique : l’indice de Theil, couramment utilisé pour mesurer les inégalités économiques. Nous l’avons calculé pour chaque année à partir de la part des foyers appartenant aux très hauts revenus ou aux hauts revenus dans chaque département (en vert et en orange sur la figure 2), en conservant une classification départementale stable sur toute la période. Cet indicateur permet de mesurer si ces parts se sont rapprochées ou, au contraire, éloignées au fil du temps. Pour faciliter la comparaison entre les deux courbes, les valeurs ont été normalisées à 1 en 1962.
Le résultat est frappant : après quarante ans de convergence, les écarts territoriaux se sont de nouveau creusés depuis la fin des années 1990. En vingt ans, la concentration géographique des très hauts revenus a triplé, retrouvant son niveau du début de la période. C’est bien le signe d’un retour marqué des inégalités régionales, tirées par le haut de la distribution des revenus.
Figure 2 : Évolution des inégalités d’opportunités économiques régionales entre 1960 et 2019.
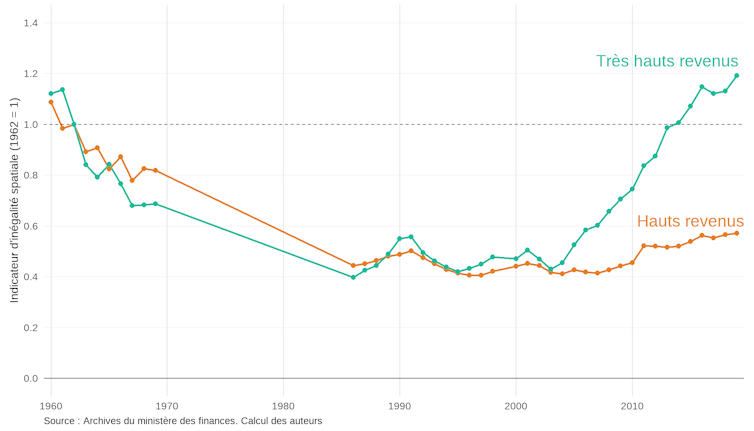
L’impact de la désindustrialisation
Nous avons cherché à comprendre pourquoi ces opportunités économiques régionales de faire partie des ménages aux très hauts revenus ont d’abord convergé, avant de diverger à nouveau fortement. Deux transformations majeures permettent d’en comprendre la logique.
Dans les années 1960, la présence de très hauts revenus s’expliquait avant tout par la concentration d’activités industrielles, elles-mêmes très inégalement réparties sur le territoire national au profit des régions du Nord-Est. Puis, entre 1960 et 1990, les structures productives régionales se sont progressivement rapprochées : les territoires longtemps agricoles se sont industrialisés tandis que les grandes régions manufacturières perdaient peu à peu leur avantage relatif. Ce mouvement de rééquilibrage a favorisé une réduction des différences régionales d’opportunités économiques.
À lire aussi : 12 métropoles et le désert français… ou une « métropole France » ?
Enfin, à partir des années 1990, la désindustrialisation s’est généralisée à l’ensemble du pays tout en s’accompagnant d’une montée en puissance des services à haute valeur ajoutée. Ce sont eux qui expliquent alors où se trouvent les opportunités économiques de faire partie des ménages aux très hauts revenus. Or, ces activités se trouvent majoritairement dans les grandes métropoles, où elles bénéficient de la présence d’emplois qualifiés, d’infrastructures performantes et de politiques publiques volontaristes, comme l’illustre l’écosystème scientifique et technologique développé sur le plateau de Saclay (Essonne) depuis une quinzaine d’années. On retrouve cette logique dans la région frontalière de Genève, où la concentration d’emplois hautement qualifiés dans les services financiers explique en partie la surreprésentation de ménages à très hauts revenus dans les départements de la Haute-Savoie et de l’Ain.
Une économie polarisée et des territoires « laissés pour compte »
Pour finir, nous défendons l’idée selon laquelle les inégalités territoriales ne tiendraient pas seulement à des écarts de revenus par habitant entre régions, mais à la manière dont les revenus les plus élevés se répartissent dans l’espace.
Depuis les années 2000, les opportunités économiques se concentrent dans un tout petit nombre de territoires, reflet d’une économie de plus en plus polarisée autour de quelques métropoles et de leurs bassins d’emplois qualifiés. En France, comme ailleurs, les transformations structurelles ont progressivement creusé l’écart entre des régions gagnantes, insérées dans l’économie de la connaissance, et d’autres qui peinent à en profiter.
Ce phénomène s’inscrit dans une dynamique plus large, documentée dans la littérature internationale sous le concept de left-behind places. Ces territoires « laissés pour compte » se retrouvent déconnectés des pôles de croissance et des réseaux de pouvoir économique, et expriment à intervalles réguliers le sentiment d’abandon qui les ronge. Réduire ces écarts ne relève donc pas d’un enjeu d’efficacité économique, mais d’un impératif démocratique.
Aujourd’hui, la question reste entière : comment faire en sorte que la transition vers une économie fondée sur les savoirs, les services et l’innovation ne creuse pas davantage les fractures entre territoires ? En retraçant cette histoire sur plus d’un demi-siècle, nos travaux rappellent que la géographie des hauts revenus est mouvante, et ne saurait se passer de volontarisme politique.
Hippolyte d’Albis a reçu des financements de l'ANR et de la Commission européenne.
Aurélie Sotura et Florian Bonnet ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.
10.01.2026 à 17:08
Maduro-Trump : la bataille pour imposer un récit légitime
Texte intégral (2140 mots)
L’arrestation de Nicolas Maduro révèle que la légitimité politique contemporaine se construit moins par le droit ou la force que par la capacité à imposer un récit et une vision du monde.
L’arrestation du président vénézuélien Nicolas Maduro à la suite d’une opération états-unienne constitue un événement géopolitique d’ampleur. Mais elle dépasse le cadre diplomatique : elle s’est immédiatement transformée en crise informationnelle.
En quelques heures, plusieurs récits concurrents ont émergé : opération de justice internationale pour certains, violation flagrante du droit international pour d’autres, coup de force impérialiste ou acte nécessaire pour libérer un peuple. Dans cet entrelacs de discours, une bataille bien plus décisive s’est ouverte : celle du récit légitime et de la construction d’un sens partagé.
Les crises contemporaines ne se jouent plus seulement dans les arènes politiques, ou militaires. Elles se construisent désormais dans l’espace de l’information, là où se forment les perceptions, les émotions collectives et, in fine, les lectures du réel. Ce que met à nu l’affaire Maduro, c’est la centralité du narratif dans la production de légitimité politique à l’échelle mondiale.
Dans ce type de crise, la question n’est pas seulement que s’est-il passé ? mais comment devons-nous comprendre ce qui s’est passé ? et surtout, qui a la légitimité pour dire la vérité des événements ?
Un événement politique devenu immédiatement un événement informationnel
Dès l’annonce de l’arrestation, trois dynamiques se mettent en place simultanément.
Tout d’abord, une production institutionnelle du sens où gouvernements, chancelleries, organisations internationales émettent des positions, chacune arrimée à un cadre de légitimation (sécurité, souveraineté, droit, ordre international).
Ensuite, les médias ne se limitent pas à nommer l’événement : ils le scénarisent. Par le choix des images, des angles et des séquences narratives, ils transforment un fait politique en récit intelligible, assignant des rôles, des responsabilités et des émotions. Cette mise en scène médiatique contribue à stabiliser temporairement un sens partagé, participant ainsi à la construction de la légitimité.
Enfin, c’est une explosion numérique où circulent simultanément informations fiables, interprétations partisanes, contenus émotionnels et désinformation. Cette couche numérique loin d’être simplement périphérique structure la manière dont une large part du monde se représente les faits.
Ainsi, ce que nous observons n’est pas seulement la confrontation d’États, mais la confrontation de récits visant à imposer une lecture dominante de la réalité. La lutte ne porte plus uniquement sur ce qui s’est passé, mais sur la manière dont il convient de l’interpréter, de l’évaluer et de l’inscrire dans une mémoire collective.
Une guerre de narratifs : trois grands cadres concurrents
Un narratif états-unien sur l’ordre, la sécurité et la légitimité morale
Le discours états-unien mobilise une stratégie classique de sécurisation, en présentant Nicolas Maduro non plus comme un chef d’État souverain, mais comme un « indicted drug trafficker » (« trafiquant de drogue inculpé ») et leader d’un « vicious terrorist organization » (« organisation terroriste violente ») – le Cartel de los Soles –, fusionnant ainsi régime politique et entreprise criminelle transnationale.
Ce déplacement symbolique joue un rôle d’ampleur en reconstruisant une opération militaro-judiciaire potentiellement illégitime au regard du droit international (capture extraterritoriale, frappes ciblées) en action de maintien de l’ordre mondial, moralement justifiable au nom de la lutte contre le narcotrafic et la menace sécuritaire pour les États-Unis.
La rhétorique mobilise trois registres : le registre pénal avec la lutte contre le crime, la corruption ou le narcotrafic, un registre éthique avec la protection des peuples et la restauration d’une justice prétendument universelle, enfin un registre sécuritaire nourrit par l’argumentaire principal de stabilisation d’une région présentée comme dangereuse.
On retrouve ici ce que les chercheurs appellent l’« agenda setting » : en choisissant les mots et les thèmes dominants du débat (crime, menace, protection), le pouvoir politique influence directement la manière dont l’opinion publique perçoit l’événement. Le politologue américain Joseph Nye, professeur en relations internationales à Harvard, définit ce soft power comme la capacité d’un État à influencer les autres, non pas seulement par la force mais en façonnant leurs préférences grâce à l’attraction, à la crédibilité et à la perception de légitimité.
Un narratif contraire sur la souveraineté, le droit, et d’alerte sur l’ordre international
En face, un contre-récit s’est immédiatement imposé. Pour de nombreux États et observateurs, cette opération constitue une atteinte grave à la souveraineté et crée un précédent dangereux pour l’ordre international. Ce discours s’appuie sur le droit international, notamment l’article 2 (4) de la Charte des Nations unies, qui interdit le recours à la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance d’un État. Il dénonce une action unilatérale qui contourne les règles collectives et menace l’équilibre du système multilatéral.
Ce narratif ne vise pas tant à défendre Maduro qu’à défendre l’idée qu’un monde où un État peut arrêter un autre chef d’État selon ses propres critères serait profondément instable.
Il relève d’une rhétorique d’alerte : ce qui se produit au Venezuela pourrait devenir une norme globale, avec des échos immédiats dans d’autres débats sensibles – comme celui concernant des dirigeants tels que le président Poutine déjà visés par des procédures internationales.
Le narratif numérique par l’émotion, la polarisation et la fabrication du doute
Un troisième narratif se déploie sur les réseaux sociaux selon des logiques d’amplifications émotionnelles (diffusion d’images générées par IA montrant Maduro en pyjama et fausses informations visant son prédécesseur Hugo Chavez), de circulation accélérée et de simplification extrême. Il en résulte une fragmentation cognitive qui produit des réalités parallèles.
Les sciences de l’information et de la communication montrent que, à l’ère numérique, l’enjeu dépasse la seule désinformation. Il s’agit d’une concurrence des régimes de vérité où ne prime plus uniquement ce qui est vrai, mais ce qui est crédible, ce qui raisonne émotionnellement et ce qui s’aligne avec une vision préexistante du monde.
La construction d’un récit politique n’est jamais improvisée. Elle repose sur quelques mécanismes clés :
saturer l’espace public pour imposer un récit dominant ;
choisir les mots qui cadrent l’événement et orientent sa lecture ;
moraliser le discours en opposant « bien » et « mal » ;
aligner communication et gestes symboliques pour renforcer la crédibilité ;
exploiter l’économie de l’attention propre aux plateformes numériques.
L’objectif n’est pas seulement d’informer mais de rendre une lecture du réel évidente et acceptable pour le plus grand nombre.
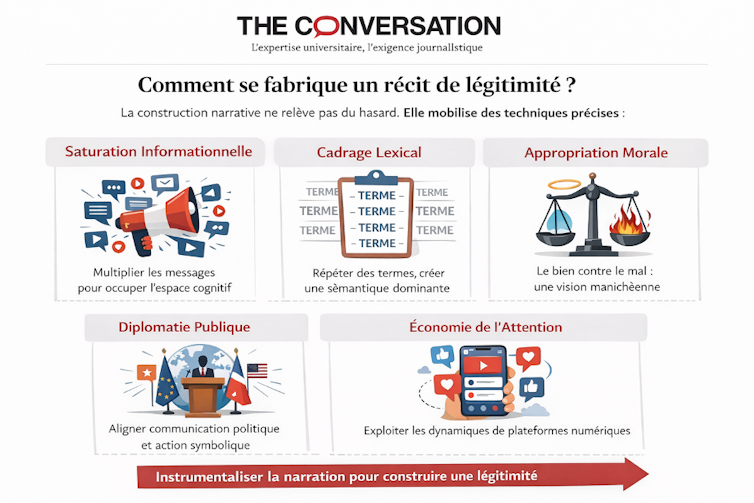
Ce que révèle cet événement
Trois enseignements majeurs se dégagent. Premièrement, l’effritement des cadres de référence communs. Le monde n’interprète plus les événements à partir d’un socle partagé. Les publics, les États et les institutions lisent la réalité selon des référentiels distincts. Ce qui renforce la conflictualité informationnelle.
Deuxièmement, la montée en puissance de la guerre cognitive est frappante. L’affaire Maduro illustre l’information warfare, c’est-à-dire l’usage stratégique de l’information pour influencer perceptions et décisions. Dans ce cadre, l’essor de l’IA agentique, fondée sur des systèmes d’IA autonomes et adaptatifs (par le biais d’agents), permet de produire et d’ajuster des narratifs ciblés à grande échelle. Combinées à la messagerie personnalisée, ces techniques orientent comportements et alliances, sans confrontation militaire directe. La bataille se joue désormais dans l’espace cognitif plus que sur le terrain physique.
Pour terminer, la centralité stratégique du narratif est construite. Aujourd’hui, gouverner, c’est raconter, c’est produire un récit qui donne sens, qui justifie, légitime et inscrit l’action politique dans une cohérence. Les États qui ne maîtrisent pas cette dimension sont désormais structurellement désavantagés.
L’arrestation du président Nicolas Maduro ouvre un débat juridique et politique immense. Mais elle montre surtout une transformation profonde de nos sociétés ; la légitimité ne repose plus seulement sur les normes ou la force. Elle se fabrique dans la capacité à imposer une vision du réel.
À l’heure où la confiance dans les institutions recule, où la circulation de l’information s’accélère et où les arènes numériques fragmentent nos représentations, la question centrale devient : qui raconte le monde ? Et surtout, quelles histoires sommes-nous prêts à croire ?
Fabrice Lollia ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
10.01.2026 à 09:35
Malbouffe et désertification – quelles recettes pour repenser l’attractivité des centres-villes ?
Texte intégral (1688 mots)
Les enseignes de restauration rapide sont-elles la cause ou la conséquence de la désertification de certains centres-villes ? Comment expliquer ce phénomène ? Faut-il lutter contre ? Et comment s’y prendre ?
Nice-Matin rappelait dans son édition du 9 octobre 2025 que la France rurale voyait disparaître ses commerces alimentaires à un rythme alarmant. Ce sont près de 62 % des communes qui ne disposeraient d’aucune boulangerie, épicerie ni de bar. En 1980, on n’en dénombrait que 25 % dans la même situation. En quarante ans, ce phénomène a plus que doublé, illustrant la désertification progressive des campagnes françaises. Dans le même temps, la grande majorité des villes a vu le tissu de commerces de proximité évoluer drastiquement.
Le Parisien (2021) rapportait par exemple qu’à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), on comptait 18 fast-food pour 12 pharmacies. À l’inverse, à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), on recense 18 pharmacies, six fast food ou sandwicheries auxquels s’ajoutent plusieurs bars à salade « premium ». Dans des villes de moindre taille, hors d’Île-de-France, l’équation se vérifie aussi. À Annonay (Ardèche), l’une des communes les plus touchées par la désertification commerciale, on recense aujourd’hui 13 enseignes de tacos, kebabs, burgers et pizzas à emporter, pour sept pharmacies, soit pratiquement le double. Même population, région différente : à Vire (Calvados), ce sont cinq enseignes pour sept pharmacies.
La comparaison entre le nombre de lieux de restauration rapide et le nombre de pharmacie permet de mieux appréhender l’âge moyen d’une population. En effet, plus la population est vieillissante, moins elle serait portée vers des offres comme le fast-food.
À lire aussi : Redynamiser les centres-villes par le commerce, c’est possible !
Des liens entre malbouffe et désertification
Certains travaux en urbanisme et en santé publique indiquent ainsi qu’il existe des liens indirects (mais réels) entre l’implantation d’enseignes de malbouffe (fast-food), la désertification des centres-villes (fermeture de commerces, baisse de diversité commerciale, L’aggravation des risques de santé et l’attractivité – ou le manque d’attractivité – pour certaines nouvelles populations. De façon synthétique, ces études montrent :
qu’il existe une association robuste entre l’exposition à la restauration rapide et des comportements alimentaires pouvant amener à de l’obésité …
qu’une surreprésentation des enseignes de malbouffe dans certains quartiers fragilisés est identifiée ;
que l’augmentation de la vacance commerciale va de pair avec une moindre diversité d’offre (plus d’enseignes standardisées, moins de commerces indépendants), contribuant à une image de dévitalisation.
Pouvoir capter facilement les flux
Pour comprendre ces mouvements, il faut mentionner que les enseignes de restauration rapide s’installent généralement dans des contextes précis, comme le suggère un travail en cours que nous menons avec la Métropole Rouen Normandie. On parle notamment de villes (ou des centres-villes) où les loyers sont abordables et où de nombreux espaces vacants existent (centres-villes en déclin ou friches commerciales). Ensuite, elles cherchent des lieux où les flux de passage sont faciles à capter, et ce même si le tissu commercial traditionnel faiblit. Enfin, elles s’épanouissent dans des contextes avec une faible concurrence locale, les commerces indépendants fermant. On peut donc voir dans leur présence comme un symptôme de la fragilisation commerciale, même s’ils n’en sont peut-être pas la cause principale.
Ensuite, il faut comprendre le phénomène de désertification. Rappelons tout d’abord qu’il n’a, malheureusement, rien de nouveau. La loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, se voulait un dispositif pour contrer ce phénomène. L’enveloppe d’un million d’euros débloquée l’année suivante pour financer les stratégies de développement urbain a bien montré son insuffisance. Les principaux acteurs se renvoyant la responsabilité de cette désertification.
Moins de diversité commerciale
Cette désertification se manifeste donc principalement par la fermeture de commerces indépendants. Ces fermetures entraînant naturellement une baisse de diversité dans l’offre (alimentaire, services, équipements…) qui va accélérer la disparition d’espaces de sociabilité.
Les principales causes de ces phénomènes sont connues. Elles ont été encore mises en avant dans le « Rapport de la mission sur l’avenir du commerce de proximité dans les centres-villes et les quartiers prioritaires de la politique de la ville » d’octobre 2025 :
Tout d’abord la croissance des zones commerciales périphériques. De plus en plus nombreuses et censées attirer plus de monde, elles ont l’effet inverse du point de vue de l’attractivité des consommateurs dans les centres-villes. Certes, ils vont consommer plus, mais en dehors des zones où les commerçants-artisans se trouvent.
Deuxièmement, les mairies se tournent vers d’autres modèles en transformant les locaux en logements ou bureaux.
Enfin, la montée constante de l’e-commerce. Autant il peut être un moteur de changement positif (les études du cercap.fr notamment montrent l’impact fort de la numérisation sur la performance et pérennité des commerçants-artisans), autant il agit aussi comme un concurrent important des commerces traditionnels.
Un cercle vicieux ?
Dans ce contexte, les chaînes de fast-food prospèrent car elles ont des modèles économiques standardisés et très résilients, capables d’absorber des fluctuations de clientèle. Ceci explique donc à terme leur plus grande présence dans les centres-villes. Et cette surreprésentation a un lien naturel sur l’attractivité.
En effet, l’image d’un centre-ville saturé de fast-food peut avoir un réel effet négatif pour certaines populations. Les classes moyennes et supérieures recherchent souvent dans leur centre-ville une offre locale, des circuits courts, des cafés indépendants, voire un marché alimentaire de qualité. Un centre-ville dominé par des franchises de fast-food peut ainsi être perçu comme peu authentique, peu qualitatif, ou en déclin.
Qui vit là ?
Mais il se peut aussi que l’effet soit plus neutre, voire positif pour d’autres publics. De manière un peu simplifiée, les étudiants, les jeunes actifs à faible revenu ou les populations précaires y voient eux des prix abordables, des horaires d’ouverture larges et une offre alimentaire à bas coût. Le fast-food peut donc contribuer à attirer ou stabiliser ces populations. En ce sens, l’impact sur l’attractivité dépend fortement du profil socio-économique des habitants potentiels d’une ville ou d’un centre-ville.
Autrement dit, les fast-food ne sont pas généralement la cause originelle de la désertification, mais ils s’y insèrent, y prospèrent, et peuvent amplifier ses effets. Ainsi, un cercle vicieux, observé dans de nombreuses villes moyennes, peut-être présenté :
les commerces traditionnels partent ou ferment,
la diversité diminue, ce qui génère une perte d’attrait du centre-ville,
les enseignes plus standardisées s’installent,
le centre-ville voit son image détériorée,
l’attractivité des ménages plus aisés se réduit,
le déclin commercial se poursuit.
Loin d’être l’unique cause du phénomène, l’installation de fast-food constitue un marqueur et parfois un accélérateur de cette dynamique.
Nouvelle dynamique
En tant que chercheurs, il est important d’étudier s’il est possible de changer la donne et de créer une nouvelle dynamique. Une approche plus vertueuse pourrait ainsi voir le jour en commençant par exemple à repenser la circulation des centres-villes en y redonnant une place principale aux piétons. Une approche hybride avec une augmentation de l’offre de stationnements en périphérie et une piétonnisation de l’hyper centre-ville paraît intéressante.
Ensuite, réinvestir sur les marchés alimentaires comme premier vecteur d’attractivité. De plus, relancer un soutien clair aux commerces indépendants (qui ne peuvent profiter de la force des réseaux des franchisés) est essentiel. Enfin, il est possible d’imaginer la mise en place d’une vraie politique de régulation de l’occupation commerciale, où les fast-foods deviennent simplement une composante parmi d’autres et ne nuisent plus à l’attractivité de l’ensemble.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
09.01.2026 à 16:49
Le raid de Donald Trump sur le Venezuela laisse présager un nouveau partage du monde entre les grandes puissances
Texte intégral (2166 mots)

Donald Trump a célébré la nouvelle année en marquant son territoire et en ouvrant la porte à un nouveau partage du monde entre Washington, Moscou et Pékin. L’Europe, tétanisée, prend acte par son silence approbateur de la mort du droit international.
Donald Trump et les hauts responsables de son administration ont salué l’opération « Détermination absolue » – le raid sur Caracas et la capture et l’enlèvement du président vénézuélien Nicolas Maduro, le 3 janvier 2026 – comme un succès militaire exceptionnel. On peut tout aussi aisément affirmer qu’il s’agit d’une violation flagrante et éhontée du droit international, qui marque une nouvelle érosion de ce qui reste de l’ordre international.
Mais la tentation pour la Maison Blanche est désormais de crier victoire et de passer rapidement à d’autres cibles, alors que le monde est encore sous le choc de l’audace dont a fait preuve le président américain en kidnappant un dirigeant étranger en exercice. Les populations et les dirigeants de Cuba (depuis longtemps une obsession pour le secrétaire d’État de Trump Marco Rubio), de Colombie (le plus grand fournisseur de cocaïne des États-Unis) et du Mexique (la principale voie d’entrée du fentanyl aux États-Unis) ont des raisons de s’inquiéter sérieusement pour leur avenir dans un monde trumpien.
Il en va de même pour les Groenlandais, en particulier à la lumière des commentaires de Trump ce week-end selon lesquels les États-Unis « ont besoin du Groenland du point de vue de leur sécurité nationale ». Sans parler du tweet alarmant de Katie Miller, influente membre du mouvement MAGA et épouse de Stephen Miller, l’influent chef de cabinet adjoint de Trump, montrant une carte du Groenland aux couleurs du drapeau américain.
Et ce n’est pas la réaction timide de la plupart des responsables européens qui freinera le président américain dans son élan. Celle-ci est extrêmement déconcertante, car elle révèle que les plus ardents défenseurs du droit international semblent avoir renoncé à prétendre qu’il a encore de l’importance.
La cheffe de la politique étrangère de l’Union européenne (UE), Kaja Kallas a été la première à réagir, avec un message qui commençait par souligner le manque de légitimité de Maduro en tant que président et se terminait par l’expression de sa préoccupation pour les citoyens européens au Venezuela. Elle a du bout des lèvres réussi à ajouter que « les principes du droit international et de la charte des Nations unies doivent être respectés ». Cette dernière partie apparaissait comme une réflexion après coup, ce qui était probablement le cas.
La déclaration commune ultérieure de 26 États membres de l’UE (soit tous les États membres sauf la Hongrie) était tout aussi équivoque et ne condamnait pas explicitement la violation du droit international par Washington.
Le premier ministre britannique Keir Starmer a pour sa part axé sa déclaration sur le fait que « le Royaume-Uni soutient depuis longtemps une transition au Venezuela », qu’il « considère Maduro comme un président illégitime » et qu’il « ne versera pas de larmes sur la fin de son régime ». Avant de conclure en exprimant son souhait d’une « transition sûre et pacifique vers un gouvernement légitime qui reflète la volonté du peuple vénézuélien », l’ancien avocat spécialisé dans les droits humains a brièvement réitéré son « soutien au droit international ».
Le chancelier allemand Friedrich Merz remporte toutefois la palme. Tout en faisant des commentaires similaires sur le défaut de légitimité de Maduro et l’importance d’une transition au Venezuela, il a finalement souligné que l’évaluation juridique de l’opération américaine était complexe et que l’Allemagne « prendrait son temps » pour le faire.
Le point de vue de Moscou et Pékin
Alors que l’Amérique latine était partagée entre enthousiasme et inquiétude, les condamnations les plus virulentes sont venues de Moscou et de Pékin.
Le président russe Vladimir Poutine avait manifesté son soutien à Maduro dès le début du mois de décembre. Dans une déclaration publiée le 3 janvier, le ministère russe des affaires étrangères se contentait initialement d’apporter son soutien aux efforts visant à résoudre la crise « par le dialogue ». Dans des communiqués de presse ultérieurs, la Russie a adopté une position plus ferme, exigeant que Washington « libère le président légitimement élu d’un pays souverain ainsi que son épouse ».
La Chine a également exprimé son inquiétude quant à l’opération américaine, la qualifiant de « violation flagrante du droit international ». Un porte-parole du ministère des affaires étrangères a exhorté Washington à « garantir la sécurité personnelle du président Nicolas Maduro et de son épouse, à les libérer immédiatement, à cesser de renverser le gouvernement du Venezuela et à résoudre les problèmes par le dialogue et la négociation ».
La position de Moscou, en particulier, est bien sûr profondément hypocrite. Certes condamner l’opération américaine comme étant une « violation inacceptable de la souveraineté d’un État indépendant » est peut-être justifié. Mais cela n’est guère crédible au vu de la guerre que Moscou mène depuis dix ans contre l’Ukraine, qui s’est traduite par l’occupation illégale et l’annexion de près de 20 % du territoire ukrainien.
La Chine, quant à elle, peut désormais avoir le beurre et l’argent du beurre à Taïwan, qui, contrairement au Venezuela, n’est pas largement reconnu comme un État souverain et indépendant. Le changement de régime apparaissant de nouveau à l’ordre du jour international comme une entreprise politique légitime, il ne reste plus grand-chose, du point de vue de Pékin, qui pourrait s’opposer à la réunification, si nécessaire par la force.
Les actions de Trump contre le Venezuela n’ont peut-être pas accéléré les plans chinois de réunification par la force, mais elles n’ont guère contribué à les dissuader. Cet épisode va probablement encourager la Chine à montrer plus d’assurance en mer de Chine méridionale.
Le partage du monde
Tout cela laisse présager un nouveau glissement progressif des intérêts des grandes puissances américaine, chinoise et russe, qui souhaitent disposer de sphères d’influence dans lesquelles elles peuvent agir à leur guise. Car si la Chine et la Russie ne peuvent pas faire grand-chose pour leur allié Maduro, désormais destitué, c’est aussi parce qu’il n’existe aucun moyen simple de délimiter où commence une sphère d’influence et où finit une autre.
La perspective d’un partage du monde entre Washington, Moscou et Pékin explique aussi l’absence d’indignation européenne face à l’opération menée par Trump contre le Venezuela. Elle témoigne de sa prise de conscience que l’ère de l’ordre international libre et démocratique est bel et bien révolue. L’Europe n’est pas en position d’adopter une posture qui lui ferait risquer d’être abandonnée par Trump et assignée à la sphère d’influence de Poutine.
Au contraire, les dirigeants européens feront tout leur possible pour passer sous silence leurs divergences avec les États-Unis et tenteront de tirer parti d’une remarque presque anodine faite par Trump à la fin de sa conférence de presse samedi 3 janvier, selon laquelle il n’est « pas fan » de Poutine.
Ce qui importe désormais pour l’Europe, ce ne sont plus les subtilités des règles internationales. Il s’agit dorénavant de garder les États-Unis et leur président imprévisible de son côté, dans l’espoir de pouvoir défendre l’Ukraine et de dissuader la Russie de commettre de nouvelles agressions.
Ces efforts pour accommoder le président américain ne fonctionneront que dans une certaine mesure. La décision de Trump de réaffirmer son ambition d’annexer le Groenland, dont il convoite les vastes ressources minérales essentielles, s’inscrit dans sa vision d’une domination absolue dans l’hémisphère occidental.
Cette renaissance de la doctrine Monroe vieille de deux siècles (rebaptisée par Trump « doctrine Donroe ») a été exposée dans la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine en décembre 2025. Elle ne s’arrête clairement pas au changement de régime au Venezuela.
La stratégie vise à « rétablir les conditions d’une stabilité stratégique sur le continent eurasien » ou à « atténuer le risque de conflit entre la Russie et les États européens ». Mais déstabiliser davantage l’alliance transatlantique en menaçant l’intégrité territoriale du Danemark au sujet du Groenland et en abandonnant peut-être l’Europe et l’Ukraine aux desseins impériaux du Kremlin risque d’avoir l’effet inverse.
De même, si l’incursion au Venezuela encourage les revendications territoriales chinoises en mer de Chine méridionale et éventuellement une action contre Taïwan, elle ne permettra guère d’atteindre l’objectif américain, énoncé dans la stratégie de sécurité nationale, qui consiste à prévenir une confrontation militaire avec son rival géopolitique le plus important.
À l’instar des autres tentatives de changement de régime menées par les États-Unis depuis la fin de la guerre froide, l’action américaine au Venezuela risque d’être une initiative qui isolera le pays et se retournera contre lui. Elle marque le retour de la loi de la jungle, pour laquelle les États-Unis, et une grande partie du reste du monde, finiront par payer un lourd tribut.
La traduction en français de cet article a été assurée par le site Justice Info.
Stefan Wolff a bénéficié par le passé de subventions du Conseil britannique de recherche sur l'environnement naturel, de l'Institut américain pour la paix, du Conseil britannique de recherche économique et sociale, de la British Academy, du programme « Science pour la paix » de l'OTAN, des programmes-cadres 6 et 7 et Horizon 2020 de l'UE, ainsi que du programme Jean Monnet de l'UE. Il est administrateur et trésorier honoraire de la Political Studies Association du Royaume-Uni et chercheur principal au Foreign Policy Centre de Londres.
09.01.2026 à 16:45
Manger sain et durable avec la règle des 4V
Texte intégral (3094 mots)
Manger végétal, vrai et varié et consommer plus de produits issus d’une agriculture régénérant le vivant. Ces quatre objectifs permettent de concilier une alimentation bénéfique pour notre santé comme pour celle des écosystèmes.
Faire ses courses ressemble souvent à un casse-tête. On souhaiterait trouver des produits bon pour la santé, si possible ne venant pas du bout du monde, pas ultratransformés ni cultivés avec force pesticides et engrais chimiques, tout en étant à un prix abordable.
Mais ces enjeux peuvent parfois entrer en contradiction : des produits considérés comme sains ne sont pas toujours issus d’une agriculture de qualité, et inversement. En outre, de bons produits pour la santé et l’environnement ne permettent pas nécessairement d’avoir un régime alimentaire équilibré.
Alors comment sortir de ces dilemmes et aiguiller le consommateur ?

Nous proposons la règle simple des 4V, qui tient compte des modes de production agricoles et de la composition de l’assiette en invitant à une alimentation vraie, végétale, variée et régénérant le vivant.
La règle des 4V
Manger vrai permet de fait de réduire le risque de nombreuses maladies chroniques (obésité, cancers, diabète de type 2, dépression, maladies cardiovasculaires…). Par précaution, cela consiste à limiter les aliments ultratransformés à 10-15 % des apports caloriques quotidiens, au lieu de 34 % actuellement en moyenne ; soit déjà les diviser par deux au minimum.
Manger plus végétal est également meilleur pour la santé. Cela permet aussi une réduction importante de plusieurs impacts environnementaux : réduction de l’empreinte carbone de notre alimentation, car moins d’émissions de gaz à effet de serre (GES) en agriculture ; moindre consommation de ressources (terres, énergie, eau).
Réduire la production et la consommation de produits animaux permet aussi d’abaisser les émissions d’azote réactif qui polluent l’air, les sols et les nappes phréatiques et produisent du protoxyde d’azote (N₂O), un puissant gaz à effet de serre. Ce deuxième V permet ainsi de diviser par deux les émissions de GES et d’azote dans l’environnement.
Outre la réduction de notre consommation de protéines qui excède en moyenne de 40 % les recommandations, il est proposé de ramener la part des protéines animales à moins de 50 % de l’apport protéique, au lieu de 65 % actuellement. Au final, cela revient à diviser par deux la consommation de viande et un peu celle des produits laitiers, notamment le fromage. L’augmentation de la consommation de protéines végétales provient alors surtout des légumineuses. La végétalisation de l’assiette passe aussi par une consommation accrue de fruits et de légumes peu transformés, de céréales complètes et de fruits à coque.
À lire aussi : Les légumineuses : bonnes pour notre santé et celle de la planète
Manger varié est un atout pour la santé, notamment pour l’équilibre nutritionnel afin d’éviter les déficiences. Cela suppose de diversifier fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses et fruits à coque qui sont une source importante de fibres, minéraux, vitamines, oligo-éléments, anti-oxydants et autres phytonutriments bioactifs protecteurs.
Pour cela, il faudrait idéalement consommer de tous les groupes d’aliments tout en variant dans chaque groupe : par exemple, blé, maïs et riz complets pour les céréales. Manger les différents morceaux de viande – en particulier des bovins (par exemple des entrecôtes et pas seulement du steak haché) – est aussi important pour ne pas déstabiliser les filières.
Manger des produits issus d’une agriculture régénérant le vivant permet d’améliorer la densité nutritionnelle des aliments, de réduire l’empreinte environnementale de l’assiette, notamment pour les émissions de GES et d’azote, et aussi d’augmenter les services fournis à la société (séquestration de carbone, épuration de l’eau…).
La regénération du vivant désigne l’ensemble des actions visant à restaurer ou renouveler la fertilité des sols, les cycles de l’eau et de l’azote, la diversité des espèces et la résilience face aux changements climatiques, tout en consommant avec parcimonie les ressources non renouvelables (le gaz qui sert à fabriquer les engrais, le phosphore…). Ainsi, au-delà de la production de nourriture, l’agriculture régénératrice vise à fournir des services à la société, tels que la séquestration du carbone dans les sols, l’augmentation de la densité nutritionnelle des produits.
Manger des produits issus d’une agriculture régénérant le vivant consisterait par exemple à choisir 50 % de produits ayant un bon score environnemental alors que les modes de production contribuant à la régénération du vivant ne dépassent pas 25 % de l’offre.
Types d’agriculture contribuant à la régénération du vivant
L’agriculture conventionnelle, qui vise l’intensification durable en utilisant les technologies pour réduire ses impacts, ne peut cependant pas régénérer le vivant, car elle porte toujours sur des systèmes simplifiés avec un nombre limité de cultures, des sols souvent pauvres en matières organiques, peu d’infrastructures écologiques et de très grandes parcelles.
Cependant, caractériser les modes de culture et d’élevage pour leurs impacts négatifs, mais aussi pour les services qu’ils rendent (séquestration du carbone, densité nutritionnelle des produits) permet d’aller au-delà de la dichotomie usuelle bio/conventionnel.
Les pratiques associées à la régénération du vivant reposent sur la diversification des cultures et des modes d’alimentation des animaux. Elles permettraient de réduire les émissions de GES de 15 % environ, et aussi de séquestrer entre 15 et 20 % des émissions de GES de l’agriculture. Elles permettraient aussi de réduire de moitié insecticides et fongicides. En revanche, une réduction forte de l’utilisation des herbicides est plus difficile et nécessite de combiner plusieurs mesures sans forcément exclure un travail du sol occasionnel.
L’élevage est critiqué, car il introduit une compétition entre feed (nourrir les animaux) et food (nourrir les humains). Cette compétition est bien plus faible pour les vaches, qui mangent de l’herbe, que pour les porcs et les volailles, qui sont nourris avec des graines. Elle est aussi d’autant plus faible que les élevages sont autonomes pour l’énergie et les protéines. Des exemples d’élevage contribuant à la régénération du vivant sont les élevages herbagers et biologiques, dont l’alimentation provient surtout des prairies, ainsi que les élevages Bleu Blanc Cœur pour lesquels l’ajout de lin, graine riche en oméga-3, dans la ration des animaux, a des effets positifs sur leur santé, la nôtre et la planète puisqu’il y a une réduction des émissions de GES en comparaison à des élevages courants.
Il s’agit d’agricultures agroécologiques, telles que l’agriculture biologique, l’agriculture de conservation des sols, s’il y a une réduction effective des pesticides, voire l’agroforesterie.
À lire aussi : Les sept familles de l’agriculture durable
Des initiatives sont en cours pour évaluer l’impact environnemental des produits agricoles et alimentaires. Elles permettent de qualifier les modes de culture et d’élevage en termes d’impacts sur le climat, la biodiversité, en mobilisant la base de données Agribalyse. Elles tiennent compte aussi des services fournis comme la séquestration du carbone, la contribution à la pollinisation des cultures, comme le montre la recherche scientifique.
À ce jour, deux initiatives diffèrent par la manière de prendre en compte les services et de quantifier les impacts. La méthode à retenir dépendra de leur validation scientifique et opérationnelle.
Des bienfaits conjugués
Suivre ces 4V permet de pallier les failles de notre système alimentaire tant pour la santé que pour l’environnement. L’alimentation de type occidental est de fait un facteur de risque important pour le développement de la plupart des maladies chroniques non transmissibles. Les facteurs qui en sont à l’origine sont nombreux : excès de consommation d’aliments ultratransformés, de viandes transformées, de gras/sel/sucres ajoutés, de glucides rapides, manque de fibres, d’oméga-3, d’anti-oxydants, et une exposition trop importante aux résidus de pesticides. Ces maladies sont en augmentation dans de nombreux pays, y compris en France.
Par ailleurs, les modes de production en agriculture sont très dépendants des intrants de synthèse (énergie, engrais, pesticides) dont les excès dégradent la qualité des sols, de l’eau, de l’air, la biodiversité ainsi que la densité nutritionnelle en certains micronutriments.
Nous sommes parvenus à un point où nos modes d’alimentation ainsi que les modes de production agricole qui leur sont associés génèrent des coûts cachés estimés à 170 milliards d’euros pour la France. La nécessité de refonder notre système alimentaire est maintenant reconnue par les politiques publiques.
Un cercle vertueux bon pour la santé et l’environnement
Manger varié encourage la diversification des cultures et le soutien aux filières correspondantes. Il en est de même pour manger vrai, car les industriels qui fabriquent des aliments ultratransformés n’ont pas besoin d’une diversité de cultures dans un territoire. Dit autrement, moins on mange vrai, moins on stimule l’agriculture contribuant à régénérer le vivant. Manger varié est également meilleur pour la santé mais aussi pour le vivant.
Par ailleurs, les pratiques agricoles régénératives permettent généralement d’avoir des produits de plus grande densité nutritionnelle. Même si le mode de production de l’agriculture biologique émet souvent plus de GES par kilo de produit que le mode conventionnel, il suffit de consommer un peu moins de viande pour compenser cet effet.
La règle des 4V (Figure 2) permet donc d’embarquer tous les acteurs du système alimentaire, du champ à l’assiette, ainsi que les acteurs de la santé. Ainsi, adhérer simultanément à vrai, végétal, varié a récemment été associé à une réduction de 27 % du risque de cancer colorectal.
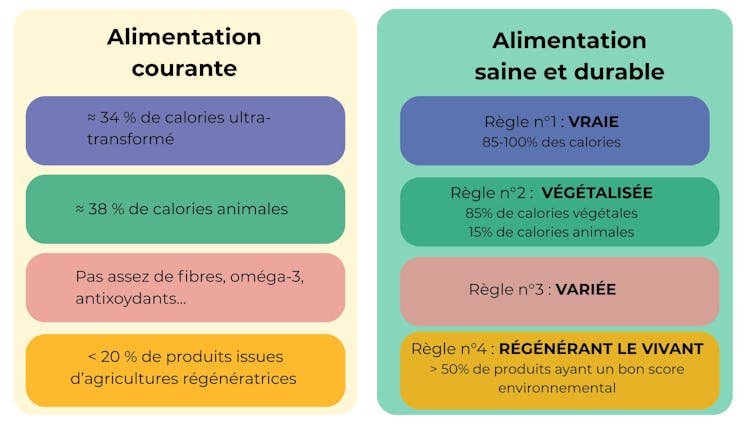
Quant au concept de régénération du vivant, il demeure parlant pour tous les maillons de la chaîne. Vivant, varié et végétal s’adressent aux agriculteurs ; vrai concerne les transformateurs et, in fine, le distributeur qui peut offrir ou non du 4V aux consommateurs. Cette règle des 4V permet ainsi de sensibiliser les acteurs du système alimentaire et les consommateurs aux facteurs à l’origine des coûts cachés de l’alimentation, tant pour la santé que l’environnement.
Enfin, un tel indicateur qualitatif et holistique est facile d’appropriation par le plus grand nombre, notamment les consommateurs, tout en constituant un outil d’éducation et de sensibilisation au concept « Une seule santé » pour l’alimentation, comblant le fossé entre sachants et non-sachants.
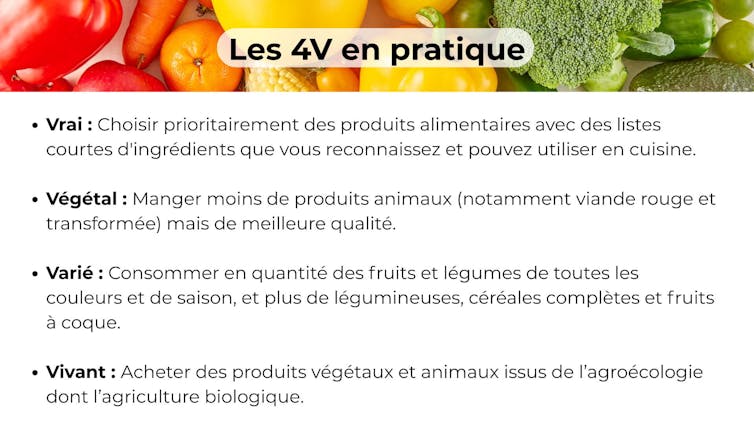
Anthony Fardet est membre des comités scientifiques/experts de MiamNutrition, The Regenerative Society Foundation, Centre européen d'excellence ERASME Jean Monnet pour la durabilité, Projet Alimentaire Territorial Grand Clermont-PNR Livradois Forez et l'Association Alimentation Durable. Il a été membre du comité scientifique de Siga entre 2017 et 2022.
Michel Duru est membre du conseil scientifique de PADV (Pour une Agriculture Du Vivant)
09.01.2026 à 11:41
« Cloud Dancer » : la couleur Pantone de l’année révèle les risques d’une esthétique du retrait
Texte intégral (2247 mots)

En désignant « Cloud Dancer » comme couleur de l’année 2026, le Pantone Color Institute consacre une nuance de blanc présentée comme aérienne, apaisante et propice à la concentration. Mais que révèle vraiment ce choix sur notre époque, au-delà du discours marketé ?
Depuis 2000, Le Pantone Color Institute fait la pluie et le beau temps dans le monde de la mode et du design en déclarant chaque année quelle couleur est « tendance ». Le discours officiel de la marque inscrit la couleur de 2026, « Cloud Dancer » dans un récit de transition collective : nous vivrions dans un monde saturé d’images et d’informations, épuisé émotionnellement, en quête de simplicité, de clarté et de reconnexion. Face à une « cacophonie » globale, « Cloud Dancer » représenterait une pause, un retrait, un silence visuel permettant de respirer.
Ce récit, en apparence consensuel, mérite pourtant d’être interrogé, car le blanc n’est jamais une absence de sens : il est historiquement, culturellement et politiquement chargé.
« Cloud Dancer » n’est donc pas une pause chromatique innocente, mais s’inscrit dans un régime esthétique du retrait, dans lequel l’effacement, la neutralisation et la pacification visuelle sont présentés comme des réponses souhaitables aux tensions. En érigeant le calme et le neutre en horizon désirable, Pantone ne suspend pas le monde : il requalifie des conflits politiques et sociaux en troubles sensoriels appelant des réponses individuelles et commerciales.
Chromophobie et hiérarchisation des couleurs
L’histoire occidentale de la couleur est traversée par une méfiance persistante que l’artiste britannique David Batchelor a qualifiée de « chromophobie ». Celle-ci désigne l’ensemble des discours qui dévalorisent la couleur, la reléguant au décoratif, au superficiel ou au suspect, tandis que la vérité, la profondeur et la raison seraient du côté de la forme, de la ligne ou de la structure.
Cette hiérarchisation est profondément située : historiquement, la couleur est associée au corps, aux émotions, à l’ornement et au féminin, tandis que le dessin, le noir ou le blanc sont valorisés comme rationnels, sérieux et maîtrisés. Comme l’a expliqué l’historienne de l’art Jacqueline Lichtenstein, dès le XVIIᵉ siècle, les débats artistiques opposent ainsi une peinture du dessin, jugée intellectuelle, à une peinture de la couleur, soupçonnée de séduire l’œil sans nourrir l’esprit.
Cette logique déborde largement le champ artistique pour structurer des rapports de pouvoir plus vastes : la couleur est assignée aux femmes et aux peuples racisés et colonisés, tandis que la sobriété chromatique devient un marqueur de civilisation, de maîtrise et de légitimité. La couleur fonctionne ainsi comme un opérateur de hiérarchisation sociale, où ce qui est coloré est minoré au profit d’un idéal de neutralité présenté comme universel.
Pour autant, la couleur ne disparaît pas : elle est omniprésente mais rendue invisible sur le plan critique. La chromophobie ne supprime pas la couleur mais la neutralise.
Dans ce système, le blanc occupe une position stratégique : perçu comme non-couleur alors qu’il est bien une couleur à part entière, il organise l’espace visuel tout en donnant l’illusion de la neutralité. Le présenter comme vide ou apaisant revient à masquer son rôle actif dans la production des normes visuelles et sociales.
Pantone et la fabrique industrielle du consensus visuel
C’est dans ce cadre que s’inscrit l’action de Pantone, qui n’est pas un simple observateur des tendances. Par ses nuanciers, ses rapports prospectifs et surtout sa « couleur de l’année », il fournit une infrastructure chromatique globale aux industries de la mode, du design, de l’architecture, du marketing ou de la tech. La prévision des tendances couleur constitue aujourd’hui un marché de plusieurs millions de dollars, fondé sur l’idée que la couleur serait l’expression visible de l’« esprit du temps », capable de condenser l’humeur d’une époque en une teinte.
La couleur de l’année fonctionne comme un dispositif performatif : une fois annoncée, elle est immédiatement reprise, déclinée et normalisée, et devient tendance parce qu’elle a été désignée comme telle. Or cette croyance repose sur des bases scientifiques fragiles et l’exactitude de ces prévisions est rarement évaluée. La force du système tient moins à sa capacité prédictive qu’à sa capacité à produire un consensus culturel et industriel et des effets d’influence en cascade. Les effets de cette logique ont déjà été observés avec la tendance Millennial Pink, popularisée à l’échelle mondiale après sa consécration par Pantone en 2016.
Avec « Cloud Dancer », Pantone ne met pas en avant une couleur singulière, mais le neutre lui-même comme solution esthétique. Cette promesse masque une réalité bien documentée : le neutre est déjà dominant. La prépondérance du blanc, du noir et du gris dans les objets industriels – notamment dans l’automobile – et la progression continue des tons neutres dans les objets du quotidien témoignent d’un monde déjà largement décoloré. Présenter le blanc comme réponse apaisante ne suspend donc pas le monde : cela reconduit un ordre visuel hégémonique fondé sur l’effacement.
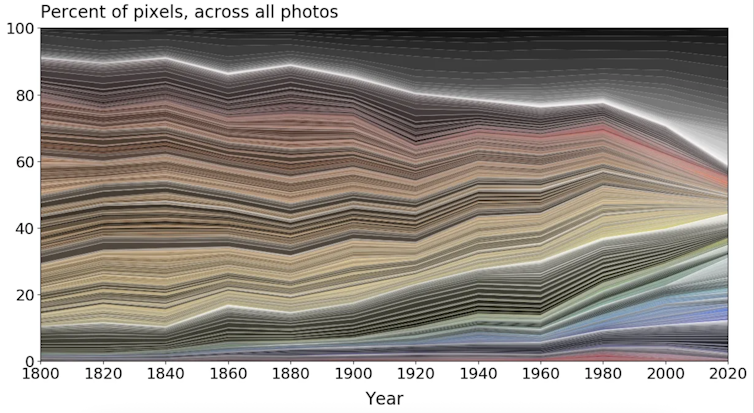
Blanc, blanchité et pouvoir
Bien qu’il soit une couleur à part entière, le blanc est fréquemment perçu comme une absence : page vierge, mur neutre, toile disponible. Cette perception est pourtant historiquement construite : l’historien Michel Pastoureau a montré que, depuis l’Antiquité, le blanc est associé à la lumière, au sacré et à l’ordre, puis le christianisme en a renforcé la charge morale en en faisant la couleur de la pureté et de l’innocence. À l’époque moderne, ces valeurs se déplacent : le blanc devient fond, norme, évidence, présenté comme universel et rationnel.
Cette naturalisation se cristallise dans le mythe de la Grèce blanche : en interprétant comme originellement immaculées des statues dont la polychromie avait disparu, l’Europe moderne a fabriqué l’image d’une civilisation fondatrice blanche, abstraite et supérieure, opposée à des cultures perçues comme colorées ou excessives. Loin d’un simple contresens archéologique, ce récit constitue un socle idéologique durable, articulant blancheur, civilisation et légitimité.
Le blanc fonctionne ainsi comme un opérateur de hiérarchisation raciale, dans lequel la blanchité ne renvoie pas seulement à une couleur de peau, mais à un régime social et culturel qui se présente comme universel, neutre et apolitique, tout en structurant silencieusement les rapports de pouvoir fondés sur la race. En s’imposant comme norme invisible, elle définit ce qui apparaît comme pur, rationnel et légitime, et relègue la différence du côté du trouble ou de la déviance.
« Cloud Dancer » face au monde contemporain
Dans un contexte marqué par la montée des extrêmes droites à l’échelle mondiale, le choix de « Cloud Dancer » ne relève pas d’un simple bien-être visuel. Il s’inscrit dans des esthétiques contemporaines de retrait, dont les figures les plus visibles sont l’esthétique de la « clean girl » qui valorise une féminité lisse, disciplinée et faussement naturelle, et l’esthétique « quiet luxury », qui prône une richesse discrète fondée sur la neutralité et l’effacement des signes de distinction.
Dans cette perspective, « Cloud Dancer » apparaît moins comme une couleur que comme une politique visuelle du retrait. Le blanc n’y agit pas comme un fond apaisant, mais comme une norme culturelle naturalisée, historiquement liée à la blanchité : il valorise lisibilité et ordre tout en produisant une dépersonnalisation des corps et des subjectivités. Cette neutralité impose un idéal de maîtrise où les différences ne sont acceptables qu’à condition d’être discrètes et non conflictuelles.
Ce régime visuel pourrait entrer en résonance avec certaines logiques fascisantes contemporaines, non par adhésion idéologique directe, mais par affinité formelle : refus du conflit visible, idéalisation de la pureté, valorisation de l’ordre, pacification des tensions. Sans faire de Pantone un acteur politique au sens strict, l’élévation du calme et de la neutralité en valeurs esthétiques dominantes contribuerait alors, de manière diffuse, à des modes de gouvernement des conflits où la conflictualité serait atténuée, déplacée ou rendue illisible. Dans cette perspective, le calme ne s’opposerait pas nécessairement à la violence des pouvoirs fascisants, mais en constituerait l’un des régimes esthétiques possibles, en amont ou en accompagnement de formes plus explicites de contrainte.
Rose K. Bideaux ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
08.01.2026 à 17:21
Loi de finances spéciale : une entorse à la Constitution ?
Texte intégral (2006 mots)
Une nouvelle loi de finances spéciale a été adoptée par le Parlement, le 23 décembre 2025. Or ce choix politique est contestable d’un point de vue juridique. En cas de blocage dans l’examen du budget, la Constitution prévoit un recours à l’article 49-3 ou une mise en œuvre du budget par ordonnances. On ne peut appeler à la défense de l’État de droit face à des dérives autoritaires et contourner la Constitution quand il s’agit d’adopter le budget.
L’adoption du budget est un moment crucial, car elle conditionne le financement de l’action publique pour l’année suivante. Dans une démocratie représentative, il appartient en principe au Parlement d’adopter chaque année le budget, que le gouvernement est ensuite autorisé à exécuter.
En France, la Constitution encadre strictement cette procédure afin d’éviter toute paralysie de l’État. Les délais d’examen sont volontairement contraints (40 jours pour l’Assemblée nationale, 20 jours pour le Sénat) et, en cas de blocage, le gouvernement peut soit recourir à l’article 49 alinéa 3, soit mettre en œuvre le budget par ordonnances si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de 70 jours. Tout est donc fait pour éviter un « shutdown » à l’américaine, même si, formellement, ce dernier ne peut être catégoriquement exclu en cas de rejet définitif du Parlement d’une loi de finances, y compris spéciale.
Or, depuis la dissolution de 2024, une Assemblée nationale profondément divisée empêche l’adoption du budget avant le 31 décembre. Pour assurer la continuité de l’État, une loi de finances spéciale en 2024 avait déjà été adoptée, en attendant l’adoption tardive de la loi de finances en février 2025. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, une nouvelle loi de finances spéciale a été adoptée pour 2025.
Cette solution est souvent présentée comme un mal nécessaire. La loi de finances spéciale a d’ailleurs été adoptée à l’unanimité (avec des abstentions) par l’Assemblée nationale en 2024 et en 2025. Pourtant, cette nécessité n’est pas juridique. Aucun texte juridique n’oblige le gouvernement à déposer une loi de finances spéciale. Au contraire, un respect scrupuleux de la Constitution plaiderait plutôt en faveur du recours aux ordonnances, expressément prévues pour ce type de situation. Si cette option est écartée, ce n’est donc pas pour des raisons juridiques mais pour des raisons politiques.
Derrière ce débat technique se cache une question simple : peut-on, au nom de la recherche d’un consensus politique au sein du Parlement, s’affranchir de la Constitution ?
Une loi de finances spéciale… spéciale
La Constitution prévoit qu’une loi spéciale n’est possible que si le projet de loi de finances n’a pas été déposé « en temps utile » (article 47 alinéa 4 de la Constitution).
Qu’est-ce qu’un dépôt en « temps utile » ? On peut raisonnablement avancer que le projet sera déposé en temps utile lorsqu’il laissera 70 jours au Parlement pour examiner le texte (et, éventuellement, 8 jours au juge constitutionnel pour rendre sa décision), soit le délai au bout duquel le gouvernement pourra mettre en vigueur le projet de loi de finances par ordonnances.
Depuis que le gouvernement a déposé le projet le 14 octobre 2025 à l’Assemblée, le délai de 70 jours court jusqu’au 23 décembre, auquel s’ajoutent 8 jours pour le Conseil constitutionnel, portant la date limite au 31 décembre. Ainsi, le gouvernement a déposé le projet de loi de finances en temps utile. Notons que, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances précédent, le délai de 70 jours avait même été atteint avant le 23 décembre.
Dès lors, les lois de finances spéciales depuis la dissolution de 2024 ne correspondent à aucune hypothèse prévue par la Constitution. Il s’agit de lois de finances sui generis, autrement dit de lois de finances spéciales… spéciales.
Un remède constitutionnel ou un pouvoir inconstitutionnel ?
Ni la Constitution ni les règles budgétaires ne prévoient formellement l’existence de ces lois de finances spéciales adoptées par le Parlement. La question est donc simple : sur quoi le gouvernement fonde-t-il sa compétence pour déposer ces textes ? L’enjeu est important : le principe même d’un État de droit repose sur la nécessité que les gouvernants exercent un pouvoir prévu par le droit, notamment par une Constitution.
La réponse tient à un précédent ancien, datant de 1979. Cette année-là, le Conseil constitutionnel avait admis, de manière exceptionnelle, une loi de finances sui generis après avoir censuré la loi de finances initiale, le 24 décembre, pour un vice de forme. L’État se retrouvait alors sans budget à quelques jours du 1er janvier. Face à cette urgence extrême, le Conseil constitutionnel avait validé une loi de finances spéciale, non prévue par les textes en vigueur, au nom d’un impératif supérieur : garantir la continuité de la vie nationale.
C’est ce précédent que le gouvernement invoque aujourd’hui, comme il l’avait déjà fait pour la loi de finances spéciale de 2024. Au regard des enjeux en présence (lever l’impôt et garantir le fonctionnement des services publics pour maintenir une vie nationale), le Conseil constitutionnel pourrait ne pas s’opposer au raisonnement du gouvernement en cas d’éventuelle saisine de l’opposition.
On notera que le précédent de 1979 était plus facilement transposable à la configuration de 2024 qu’à celle de 2025. En 2024, le renversement du gouvernement Barnier était une circonstance empêchant l’adoption du budget avant le 1er janvier.
En 2025, à la différence de 2024, il n’y a aucune circonstance exceptionnelle empêchant matériellement le Parlement de se prononcer sur le budget. La loi de finances spéciales 2025 était simplement justifiée par le probable rejet du projet de loi de finances. Le gouvernement adopte ainsi une lecture extensive du précédent jurisprudentiel de 1979 en affirmant dans l’exposé des motifs de la loi de finances spéciale 2025 qu’il lui appartient « de déposer un projet de loi spéciale lorsqu’il apparaît qu’une loi de finances ne pourra pas être promulguée avant le début du prochain exercice budgétaire »). Ce n’est pas ce que le Conseil constitutionnel a dit dans sa décision de 1979. D’un instrument exceptionnel, la loi de finances spéciale est transformée en pratique courante. Le gouvernement fragilise indiscutablement l’équilibre constitutionnel.
L’exclusion de l’ordonnance budgétaire : compromis politique et détournement de la Constitution
Cet équilibre est d’autant plus fragilisé que le gouvernement écarte une solution pourtant expressément prévue par la Constitution : le recours à l’ordonnance prévu à l’article 47 alinéa 3. Ce mécanisme, conçu dès 1958, permet au gouvernement de mettre en vigueur lui-même le projet de loi de finances si le Parlement ne s’est pas prononcé dans le délai de 70 jours. Cet outil s’inscrit pleinement dans la logique d’un parlementarisme rationalisé, qui garantit avant tout la continuité de l’action gouvernementale.
Certes, le recours à cette ordonnance est une faculté et non une obligation pour le gouvernement. En outre, la procédure est brutale à l’encontre d’un régime parlementaire dès lors qu’elle écarte le Parlement de l’adoption du budget. Pour autant, cette procédure a été prévue en 1958 précisément pour cela en présence d’un Parlement miné par des désaccords partisans. Si l’instabilité au Parlement était telle qu’elle entraînerait de manière certaine le rejet définitif de tout texte financier (y compris une loi de finances spéciale), l’ordonnance serait-elle toujours aussi décriée alors qu’elle serait le seul et unique moyen d’éviter un shutdown ?
En recourant à des lois de finances spéciales juridiquement fragiles et en écartant des ordonnances politiquement contestées mais juridiquement solides, le gouvernement fait primer le consensus politique sur l’autorité de la Constitution. Serait-ce la peur d’une crise politique en général ou celle plus particulière d’être renversé par l’Assemblée nationale en représailles d’un recours aux ordonnances ? On ne peut malheureusement exclure ces considérations opportunistes, qui contribuent à une défiance à l’égard de la vie publique.
Opportunisme ou pas, le débat sur la loi de finances spéciale ne se résume pas à une querelle de juristes. Il révèle une tension plus profonde entre les accommodements de la pratique des acteurs politiques et le respect de l’autorité de la Constitution.
Rappelons, de ce point de vue, que la Constitution est un tout. Elle garantit le respect des droits et libertés, mais encadre également le fonctionnement des pouvoirs publics et, par conséquent, les conditions d’adoption du budget. On ne peut appeler à la préservation, voire au renforcement, de l’autorité de la Constitution quand il s’agit de défendre l’État de droit face à des dérives autoritaires, et, en même temps, contourner la Constitution quand il s’agit d’adopter le budget. Derrière le vernis de la technique juridique se profile une conception alarmante que les gouvernants peuvent avoir de la Constitution.
Respecter le Parlement est une exigence démocratique. Mais affaiblir la Constitution au nom de cet objectif revient à fragiliser l’ensemble de l’édifice institutionnel. À vouloir trop éviter le choc politique, on pourrait provoquer une secousse constitutionnelle durable.
Jeremy Martinez ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
08.01.2026 à 17:19
L’intervention des États-Unis au Venezuela au prisme du droit international
Texte intégral (1897 mots)
Bombarder un pays étranger sans mandat de l’ONU, capturer son dirigeant et proclamer qu’on va dorénavant diriger le pays en question : tout cela contrevient à de nombreuses normes du droit international détaillées dans la Charte de l’ONU et dans les Conventions de Genève.
L’Opération « Absolute Resolve » qui a impliqué le déploiement d’une force aéronavale sans précédent dans les Caraïbes depuis la crise des missiles de Cuba en 1962 illustre la détermination du président Trump à capturer le président Nicolas Maduro et son épouse, en exécution d’un mandat d’arrêt de la justice américaine pour « narco-terrorisme ». Au-delà de la méthode et des raisons invoquées pour la justifier, il s’agit d’une intervention armée sur le territoire d’un État étranger sans fondement juridique, autrement dit une agression. C’est une nouvelle manifestation d’un interventionnisme décomplexé depuis l’adoption de la Doctrine Monroe il y a deux siècles.
Celle-ci, énoncée par le président James Monroe en 1823, visait à dissuader les puissances européennes d’intervenir dans l’hémisphère occidental, considéré comme chasse gardée des États-Unis. Elle s’est traduite notamment par le soutien aux républicains mexicains pour mettre fin à l’éphémère royaume de Maximilien voulu par Napoléon III (1861-1867), ainsi que l’appui aux indépendantistes cubains au prix d’une guerre hispano-américaine (1898) à l’issue de laquelle l’île de Porto Rico a été annexée par les États-Unis et Cuba est devenue formellement indépendante.
La Doctrine Monroe version Trump (« Trump Corollary » dans la Stratégie de sécurité nationale 2025) est désormais définie comme visant à restaurer la prééminence de Washington dans son arrière-cour en s’assurant qu’aucun rival extérieur ne soit en mesure d’y déployer des forces ou de contrôler des ressources vitales dans la région. Une allusion à peine voilée à la Chine dont l’activisme économique dans la région et singulièrement au Venezuela (qui intéresse avant tout Pékin pour son pétrole) est perçu comme une menace pour cette prééminence.
Un précédent : Panama, 1989
« Absolute Resolve » ressemble par son modus operandi à l’opération « Just Cause » décidée par le président George W. Bush en 1989 pour capturer et traduire devant un tribunal américain le dirigeant du Panama, Manuel Noriega, sous la même inculpation de trafic de drogue.
L’Assemblée générale des Nations unies avait qualifié cette intervention à Panama de « violation flagrante du droit international, de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de Panama » (Résolution 44/240 du 29 décembre 1989).
Une différence réside dans le fait que le général Manuel Noriega – un dictateur responsable d’exécutions extrajudiciaires et de tortures – fut un allié de Washington, mais qui avait fini par s’avérer encombrant. A contrario, Nicolas Maduro — qui est également considéré par de nombreux États et ONG comme un dirigeant autoritaire — incarne une gauche révolutionnaire que Washington n’a cessé de combattre depuis la guerre froide.
Une violation manifeste de la Charte des Nations unies
L’intervention armée sur le territoire vénézuélien constitue sans discussion une violation de la Charte des Nations unies. Celle-ci dispose que « les membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toutes autres manières incompatibles avec les buts des Nations unies » (article 2, § 4).
Les exceptions compatibles avec un recours à la force se limitent à la légitime défense ou à une action conforme à une décision du Conseil de sécurité. Dans cette circonstance, les États-Unis ne peuvent se prévaloir ni d’une action en légitime défense ni d’un mandat du Conseil de sécurité.
La Cour internationale de Justice avait relevé que le non-recours à la force relevait d’un principe essentiel et fondamental du droit international (arrêt du 27 juin 1986, qui concernait déjà une confrontation entre les États-Unis et un pays des Amériques, en l’occurrence le Nicaragua).
L’interdiction de l’emploi de la force peut être déduite d’une autre disposition de la Charte (Article 2, § 7) invitant les États à recourir au règlement pacifique des différends (chapitre 6), ce qui manifestement n’a pas été mis en œuvre ici.
Ces principes ont pour finalité de préserver la stabilité de l’ordre international et de prévenir le règne de la loi de la jungle dans les relations internationales. Or, faut-il le rappeler, dans la mesure où ils ont adhéré à la Charte des Nations unies, dont ils furent les rédacteurs en 1945, les États-Unis sont tenus d’en respecter et appliquer les dispositions.
Le « regime change » n’a pas de fondement en droit international
Le président Trump a justifié son intervention armée contre un président qu’il considère comme « illégitime » par l’accusation selon lequel Nicolas Maduro se serait livré, des années durant, au « narco-terrorisme ». La méthode utilisée, l’enlèvement d’un chef d’État en exercice, est doublement contraire au droit international : d’une part, en raison de l’immunité attachée à la fonction présidentielle (ce que semble ignorer l’application extra-territoriale de la justice américaine) ; d’autre part parce que la Charte, dans son art. 2, § 7, stipule clairement la non-ingérence dans les affaires intérieures des États.
Le principe de souveraineté n’autorise pas un État à intervenir militairement sur le territoire d’un autre État en vue d’en changer le système politique, quand bien même le régime de Nicolas Maduro s’est rendu coupable de fraude électorale et de graves violations des droits humains à l’égard de l’opposition, qui font l’objet d’une enquête conduite par la Cour pénale internationale pour crimes contre l’humanité.
Il reste que l’emploi de la force armée n’est pas la méthode la plus appropriée pour promouvoir les droits de l’homme dans un autre pays. Il existe des mécanismes internationaux compétents dans ce domaine (ONU, CPI) qui devraient pouvoir poursuivre leurs missions d’enquête sur les crimes présumés commis par au Venezuela.
Les Conventions de Genève applicables
Le droit applicable à l’intervention armée à Caracas est le droit des conflits armés encadrant la conduite des opérations militaires et la protection des biens et des personnes, même si les États-Unis nient être en guerre contre le Venezuela.
Les Conventions de Genève s’appliquent s’agissant d’un conflit armé international même si l’une des parties ne reconnaît pas l’état de guerre (art. 2 commun des Conventions).
Dès son arrestation, Nicolas Maduro peut se prévaloir de la protection de la 3ᵉ Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre. En outre, la brièveté de l’opération militaire américaine n’exclut pas l’application de la 4ᵉ Convention de Genève si des victimes civiles sont à déplorer ou des biens civils ciblés.
D’autre part, Donald Trump a déclaré vouloir « diriger le pays jusqu’à ce que nous puissions assurer une transition sûre, appropriée et judicieuse ». Cela peut être un motif d’inquiétude si un projet d’occupation est envisagé (la Charte des Nations unies le proscrit si l’occupation découle d’un recours à la force illicite). Cela dit, un tel scénario semble improbable compte tenu de l’expérience des fiascos en Afghanistan et en Irak, des réactions internationales majoritairement hostiles à l’intervention militaire, ainsi que de la montée des critiques au sein même de sa base MAGA, à qui Trump avait promis avant son élection de mettre fin aux guerres extérieures.
L’intervention armée et l’arrestation d’un chef d’État étranger en vue de le juger par un tribunal états-unien sont un message sans ambiguïté adressé par le président Trump à la communauté internationale : son pays n’hésitera pas à faire prévaloir le droit de la force sur la force du droit. Le droit international doit impérativement prévaloir comme contrat social liant les nations pour prévenir le chaos ou « l’homme est un loup pour l’homme » pour reprendre la formule de Thomas Hobbes.
Abdelwahab Biad ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
08.01.2026 à 17:19
Dermatose nodulaire contagieuse : les vétérinaires victimes d’une épidémie de désinformation
Texte intégral (2448 mots)
Arrivée en France en juin 2025, la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a rapidement fait l’objet de mesures sanitaires qui ont permis d’éradiquer le virus dans certaines régions. Mais la crise agricole qui a suivi a vu émerger une contestation inédite, nourrie par des fausses informations et des remises en cause du rôle des vétérinaires. Dans ce texte, la profession appelle à un « droit de véto » contre la désinformation.
La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a atteint la France en Savoie le 29 juin 2025 à la suite de l’introduction d’un bovin infecté venant d’Italie. La France métropolitaine étant alors indemne de la DNC, la réglementation européenne prévue (dépeuplement total, vaccination d’urgence au sein des zones réglementées (ZR) – instaurées par arrêté préfectoral, limitation des mouvements des bovins…] a été mise en place, ce qui a permis d’éliminer le virus dans la région dès le 21 août.
Les contaminations ultérieures qui ont suivi en France, notamment en Occitanie, sont en réalité le résultat de déplacements illicites de bovins contagieux à partir de la zone réglementée couvrant une partie de l’Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie (zone vaccinale II sur la carte ci-dessous).
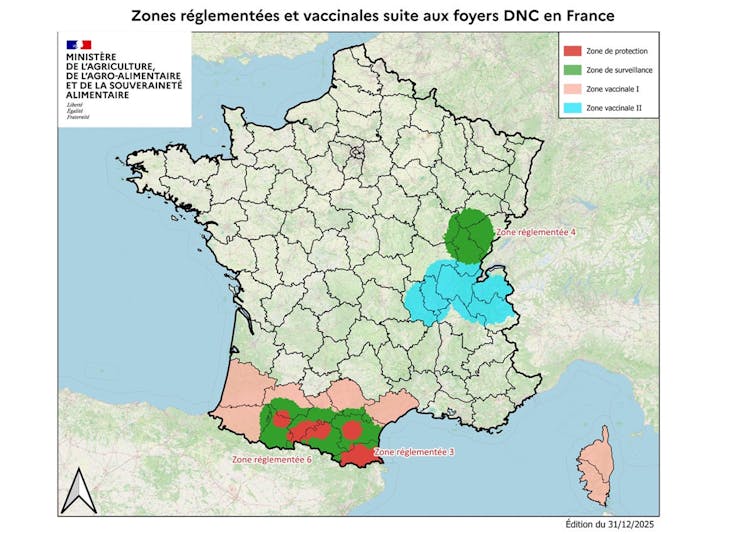
La forte médiatisation de la DNC associée aux dénonciations de « hold-up politique » par certains éleveurs rappelle de précédentes crises sanitaires (vache folle, grippe aviaire, Covid-19…). Mais à l’époque, la parole des « sachants » n’avait pas été remise en cause dans les mêmes proportions qu’aujourd’hui. Des membres de la profession vétérinaire font l’objet d’insultes, voire de menaces gravissimes, dans certains cas même de menaces de mort.
Cette situation est non seulement surprenante, mais également choquante. Les vétérinaires ont toujours été associés et solidaires avec les éleveurs. Dans le même temps, de fausses informations au sujet de la DNC se propagent dans l’espace médiatique.
À lire aussi : Dermatose nodulaire : comprendre les raisons de la mobilisation agricole
Un déferlement inédit de « fake news »
Parmi les fausses informations que des experts autoproclamés (parmi lesquels on a pu retrouver tant des personnes ayant endossé une posture « antivax » lors de la pandémie de Covid-19 que des scientifiques ou cliniciens méconnaissant la DNC) ont diffusées, non seulement sur les réseaux sociaux mais également dans les médias :
- « La maladie peut être traitée par des antibiotiques/par l’ivermectine. »
C’est faux. Les antibiotiques ou les antiparasitaires tels que l’ivermectine ne sont pas actifs sur une maladie virale comme la DNC, causée par un Capripoxvirus (Lumpy skin disease virus).
- « L’Espagne et l’Italie n’ont pas appliqué le dépeuplement total. »
C’est faux. Les autres pays européens confrontés à la DNC, comme l’Espagne et l’Italie, appliquent eux aussi la stratégie d’abattage de tous les bovins présents dans un foyer confirmé de DNC, comme le confirme le ministère de l’agriculture.
- « La Suisse pratique l’abattage partiel. »
Il n’y a pour l’instant pas eu de cas de DNC confirmé en Suisse, donc pas d’abattage.
- « Il est inadmissible d’abattre tout un troupeau lorsqu’il y a seulement un animal malade. »
Si un seul animal présente des lésions cutanées, il y a de fortes chances qu’au moins 50 % des animaux soient infectés dans le troupeau. En effet, il est difficile de connaître précisément la date d’infection du bovin. Si celle-ci est antérieure à l’acquisition de la protection vaccinale, alors plusieurs animaux sont potentiellement infectés au sein du troupeau, ce que les tests sanguins ne permettent pas de détecter.
- « Il faut avoir un troupeau témoin pour surveiller l’évolution de la maladie dans un foyer infecté. »
Ce troupeau « témoin » a existé dès le 6e foyer de DNC déclaré le 7 juillet en France, du fait du recours d’un jeune éleveur de Savoie refusant le dépeuplement de son troupeau. Treize jours plus tard, le recours a été refusé et d’autres cas de DNC se sont déclarés dans son élevage. La forte contagiosité de la DNC pourrait en partie expliquer le grand nombre de foyers de DNC déclarés deux semaines plus tard dans les élevages voisins.
- La DNC relève de la catégorie A du droit européen, comme la fièvre aphteuse, or « pour la fièvre aphteuse, de nouveaux textes préconisent l’abattage partiel ».
C’est faux. La catégorie A correspond en médecine vétérinaire à une maladie soumise une réglementation sanitaire très stricte lorsqu’il s’agit d’une maladie hautement contagieuse émergent dans un pays indemne. Les conséquences économiques et sanitaires justifient une éradication immédiate dès son apparition.
- « Le vaccin n’est pas efficace car certains bovins vaccinés ont présenté la maladie malgré tout »
La vaccination en urgence n’est pas une vaccinothérapie. Elle nécessite au moins trois semaines pour installer une protection immunitaire. Elle a pu être réalisée chez des animaux déjà infectés avant ou peu après l’injection vaccinale.
- « La désinsectisation de l’élevage est la méthode la plus efficace pour éviter la contamination ».
Ce sont certes des insectes hématophages qui sont les vecteurs de la DNC, mais les traitements insecticides ne sont jamais efficaces à 100 %. Il n’existe pas de mesure parfaite permettant d’éradiquer tous les insectes d’un élevage.
- « 70 vétérinaires ont été radiés de l’Ordre des vétérinaires pour avoir refusé l’abattage du troupeau de l’Ariège ».
C’est faux. Le conseil national de l’ordre des vétérinaires confirme qu’aucun vétérinaire n’a été radié pour avoir refusé un abattage.
- « Le vaccin est dangereux pour les animaux et l’humain ».
C’est faux, le vaccin est un vaccin dit « vivant atténué » qui ne présente aucun danger ni pour les animaux ni pour l’humain. De plus, la DNC n’est pas une zoonose (maladie animale transmissible à l’humain et réciproquement), mais une épizootie.
- « Il y a encore des cas de DNC en Savoie ».
Dans cette zone désormais considérée comme indemne de la DNC, il peut s’agir de la pseudo dermatose nodulaire contagieuse (PDNC), due à un herpèsvirus qui évolue très rapidement (en 3 semaines) vers la guérison.
- « La fédération des vétérinaires européens (FVE) préconise plutôt la vaccination que l’abattage dans la DNC ».
C’est faux : la note de la FVE de novembre 2025 présente une revue générale sur le bénéfice des vaccinations en médecine vétérinaire sans remettre en cause la réglementation européenne concernant les maladies classées dans la catégorie A comme la DNC.
- « L’EFSA (European Food Safety Autority) avait préconisé un abattage partiel en 2016 lors des premiers foyers de DNC en Europe ».
Cette recommandation de l’EFSA en 2016 correspondait à une évaluation mathématique des moyens à mettre en œuvre dans les pays où la DNC était déjà installée (virus endémique), en l’occurrence les Balkans. Elle ne s’applique pas pour les pays indemnes de DNC soumis à la réglementation européenne, comme c’est le cas en France.
- « Lors de l’épizootie de DNC observée dans l’île de La Réunion en 1991-1992, il n’y a pas eu de dépeuplement total ».
La flambée de DNC sur l’île de la Réunion a été la conséquence de l’importation de zébus malgaches. Le contexte sur cette île qui n’exportait pas de bovins était toutefois différent de la situation actuelle de la DNC en France métropolitaine. Il y a d’abord eu un retard considérable de plusieurs mois pour identifier formellement la maladie. Le premier vaccin, qui était celui utilisé pour la variole ovine, était peu efficace pour les 18 000 bovins vaccinés (sur les 21 000 bovins recensés sur l’île). La vaccination avec le vaccin bovin sud-africain, bien plus efficace, a été réalisée avec un an de retard. Au total, 511 exploitations ont été atteintes avec 10 % de mortalité.
Les conditions de la sortie de crise
En France, la situation est actuellement sous contrôle dans le Sud-Est, mais elle est encore évolutive en Occitanie, où de rares cas peuvent encore apparaître à la fin de cette épizootie. Ce sera le cas de bovins en incubation, car voisins d’un foyer déclaré et dont l’immunité vaccinale n’est pas encore installée pour le protéger.
Deux autres risques ne peuvent pas être évalués pour prédire la fin de cette épizootie de DNC :
un déplacement illicite à partir des ZR actuelles d’animaux apparemment sains, mais qui sont de véritables « bombes virales » à retardement ;
la non-déclaration d’un cas de suspicion de DNC par un éleveur (comme un représentant syndical a osé le recommander), alors qu’il convient d’éviter la contamination des élevages voisins.
La principale revendication des agriculteurs, répétée inlassablement dans les médias, est un abattage partiel lors de DNC. Elle témoigne d’une méconnaissance de cette maladie. En effet, on l’a vu plus haut, ce serait mettre en danger les troupeaux indemnes et par-delà, tout le cheptel bovin français. Nous espérons qu’il n’y aura plus de foyers de DNC à partir de mi-janvier 2026, comme ce fut le cas dans les Savoie après la vaccination.
La profession vétérinaire a toujours été proche des agriculteurs. Rappelons que les premières écoles vétérinaires au monde ont été créées en France au XVIIIe siècle pour « lutter contre les maladies des bestiaux ». Ainsi, en unissant nos forces nous avons pu éradiquer de la surface de la Terre en 2001 une autre maladie virale : la peste bovine.
Jean-Yves Gauchot est docteur vétérinaire et président de la Féderation des syndicats vétérinaires de France
Jeanne Brugère-Picoux ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
08.01.2026 à 17:13
En quoi le cas du Louvre questionne-t-il la sécurité des musées ?
Texte intégral (1992 mots)

Le cambriolage du Louvre en 2025 n’a pas seulement été spectaculaire. Il rappelle également que, malgré la sophistication croissante des dispositifs numériques, la sécurité des musées reste avant tout une affaire humaine. Alors, comment sécuriser les œuvres tout en les rendant accessibles au plus grand nombre ?
En octobre 2025, le Louvre a été victime d’un cambriolage spectaculaire. De nuit, les voleurs ont pénétré dans le musée grâce à un simple monte-charge, déjouant un dispositif de sécurité pourtant hautement technologique, pour emporter l’équivalent de 88 millions d’euros de bijoux.
Ce contraste illustre un paradoxe contemporain : à mesure que la sécurité se renforce technologiquement, ses vulnérabilités deviennent de plus en plus humaines et organisationnelles. Le Louvre n’est ici qu’un symbole d’un enjeu plus large : comment protéger la culture sans en altérer l’essence ni l’accessibilité ?
Les musées, acteurs méconnus de la sécurité mondiale
Le cambriolage du Louvre n’a fait que révéler un problème plus profond. Un prérapport de la Cour des comptes de 2025 pointe un retard préoccupant dans la sécurisation du musée : 60 % des salles de l’aile Sully et 75 % de celles de l’aile Richelieu ne sont pas couvertes par la vidéosurveillance. De plus, en quinze ans, le Louvre a perdu plus de 200 postes de sécurité, alors que sa fréquentation a augmenté de moitié. Les budgets consacrés à la sûreté, soient à peine 2 millions d’euros sur 17 millions prévus pour la maintenance, traduisent une érosion structurelle des moyens humains.
Selon les lignes directrices du Conseil international des musées, la sécurité muséale repose sur trois piliers. D’abord, la prévention, qui s’appuie notamment sur le contrôle d’accès, la gestion des flux et l’évaluation des risques. Ensuite, la protection, mise en œuvre par la vidéosurveillance, la détection d’intrusion et les protocoles d’urgence. Enfin la préservation, qui vise à assurer la continuité des activités et la sauvegarde des collections en cas de crise.
Mais dans les faits, ces principes se heurtent à la réalité des contraintes budgétaires et des architectures muséales modernes, pensées comme des espaces ouverts, transparents et très accessibles, mais structurellement difficiles à sécuriser.
Les musées français ont déjà connu plusieurs cambriolages spectaculaires. En 2010, cinq toiles de maître (Picasso, Matisse, Modigliani, Braque et Léger) ont été dérobées au musée d’Art moderne de la Ville de Paris. En 2024, le musée Cognac-Jay a été victime d’un braquage d’une grande violence en plein jour pour un butin estimé à un million d’euros. Ces affaires rappellent que les musées, loin d’être des forteresses, sont des espaces vulnérables par nature, pris entre accessibilité, visibilité et protection. Le Louvre incarne une crise organisationnelle plus large où la sûreté peine à suivre l’évolution du risque contemporain.
Le musée, nouveau maillon du système sécuritaire
Longtemps, la sécurité des musées s’est pensée de manière verticale, centrée sur quelques responsables et des protocoles stricts. Or, ce modèle hiérarchique ne répond plus à la complexité des menaces actuelles.
La sûreté muséale repose désormais sur une circulation horizontale de l’information, c’est-à-dire partagée entre tous les acteurs et mobilisant conservateurs, agents, médiateurs et visiteurs dans une vigilance partagée. Cela prend la forme d’un musée où chacun a un rôle clair dans la prévention, où l’information circule rapidement, où les équipes coopèrent et où la sécurité repose autant sur l’humain que sur la technologie.
Les risques, quant à eux, dépassent largement les frontières nationales : vol d’œuvres destinées au marché noir, cyberattaques paralysant les bases de données patrimoniales et, dans une moindre mesure, activisme climatique ciblant les symboles culturels. La protection du patrimoine devient ainsi un enjeu global impliquant États, entreprises et institutions culturelles.
Au Royaume-Uni, les musées sont désormais intégrés aux politiques antiterroristes, illustrant un processus de sécurisation du secteur. En Suède, des travaux montrent que la déficience de moyens visant à la protection muséale entraîne une perte d’efficacité, dans la mesure où la posture adoptée est plus défensive que proactive.
Protéger le patrimoine, une façon de faire société
Mais cette logique de soupçon transforme la nature même du musée. D’espace de liberté et de transmission, il tend à devenir un lieu de contrôle et de traçabilité. Pourtant, dans un monde traversé par les crises, le rôle du musée s’élargit. Il ne s’agit plus seulement de conserver des œuvres, mais de préserver la mémoire et la cohésion des sociétés.
Comme le souligne Marie Elisabeth Christensen, chercheuse spécialisée dans la protection du patrimoine en contexte de crise et les enjeux de sécurisation du patrimoine culturel, la protection du patrimoine relève du champ de la sécurité humaine. Ses travaux montrent comment, dans des zones de conflits comme Palmyre en Syrie, la sauvegarde d’un site ou d’une œuvre devient un acte de résilience collective, c’est-à-dire une manière, pour une communauté frappée par la violence et la rupture, de préserver ses repères, de maintenir une continuité symbolique et de recréer du lien social, contribuant ainsi à la stabilisation des sociétés.
Cependant, cette transformation demeure profondément inégale. Les grands musées européens et américains disposent des moyens et de la visibilité nécessaires pour assumer ce rôle tandis qu’au Sud, de nombreuses institutions restent fragmentées, marginalisées et subissent le manque de coordination au niveau international. Cette disparité révèle une gouvernance patrimoniale encore inachevée, dépendante d’agendas politiques plus que d’une stratégie mondiale de solidarité culturelle.
La protection du patrimoine devrait être pleinement intégrée aux politiques humanitaires internationales, au même titre que la santé ou l’éducation. Car protéger une œuvre, c’est aussi protéger la mémoire, les valeurs et l’avenir d’une société.
Le piège du technosolutionnisme
Face aux menaces qui pèsent sur les lieux culturels, la tentation est forte de répondre par une surenchère technologique. Après chaque incident, la même conclusion s’impose : il aurait fallu davantage de caméras, de capteurs ou d’outils de surveillance. Reconnaissance faciale, analyse comportementale, biométrie… autant de dispositifs souvent présentés comme des réponses évidentes. Les dispositifs se multiplient, nourrissant l’idée que le risque pourrait être entièrement maîtrisé par le calcul.
Ce réflexe, qualifié de technosolutionnisme, repose pourtant sur une illusion, celle d’une technologie capable de neutraliser l’incertitude. Or, comme l’ont montré des travaux en sciences sociales, la technologie ne se contente pas de « faire mieux fonctionner » les choses : elle change la façon dont les personnes se font confiance, la manière dont le pouvoir s’exerce et la répartition des responsabilités. Autrement dit, même avec les outils les plus sophistiqués, le risque reste profondément humain. La sécurité muséale relève donc avant tout d’un système social de coordination, de compétences humaines et de confiance, bien plus que d’un simple empilement de technologies.
La rapporteuse spéciale de l’ONU pour les droits culturels alertait déjà sur ce point : vouloir protéger les œuvres à tout prix peut conduire à fragiliser la liberté culturelle elle-même. La sécurité du patrimoine ne peut se limiter aux objets. Elle doit intégrer les personnes, les usages et les pratiques culturelles qui leur donnent sens.
Protéger sans enfermer
Contre la fascination technologique, une approche de complémentarité s’impose. Les outils peuvent aider, mais ils ne remplacent ni l’attention ni le discernement humain. La caméra détecte, mais c’est le regard formé qui interprète et qualifie la menace. Les agents de sécurité muséale sont aujourd’hui des médiateurs de confiance. Ils incarnent une forme de présence discrète mais essentielle qui relie le public à l’institution. Dans un monde saturé de dispositifs, c’est cette dimension humaine qui garantit la cohérence entre sécurité et culture.
La chercheuse norvégienne Siv Rebekka Runhovde souligne, à propos des vols d’œuvres du peintre Edvard Munch, le dilemme permanent entre accessibilité et sécurité. Trop d’ouverture fragilise le patrimoine, mais trop de fermeture étouffe la culture. Une sursécurisation altère la qualité de l’expérience et la confiance du public. La sécurité la plus efficace réside dans celle qui protège sans enfermer, rendant possible la rencontre entre œuvre et regards.
La sécurité muséale n’est pas seulement un ensemble de dispositifs, c’est également un acte de communication. Elle exprime la manière dont une société choisit de gérer et de protéger ce qu’elle estime essentiel et de négocier les frontières entre liberté et contrôle. Protéger la culture ne se réduit pas à empêcher le vol. C’est aussi défendre la possibilité de la rencontre humaine à l’ère numérique.
Fabrice Lollia ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
08.01.2026 à 17:03
Syrie : comment les petites entreprises ont survécu à la guerre en bâtissant une économie parallèle
Texte intégral (1811 mots)

Même lorsqu’un pays est en guerre, que les institutions s’effondrent, que les groupes armés sèment la terreur, les entreprises de moins de 250 salariés jouent un rôle essentiel pour maintenir une activité économique minimale. Explication avec l’exemple syrien.
Pendant la guerre en Syrie, certaines petites entreprises ont dû payer des taxes au régime, négocier leur passage avec des groupes armés d’opposition, respecter les règles économiques de l’Organisation de l’État islamique, et s’appuyer sur des réseaux au Liban, en Irak ou en Jordanie.
Cette expérience met en lumière une réalité souvent négligée : lorsque l’État s’effondre, les acteurs économiques les plus modestes empêchent la société de s’arrêter complètement.
Contrairement à l’idée d’un pays économiquement à l’arrêt, la Syrie a vu émerger une économie parallèle, portée principalement par des petites et moyennes entreprises (PME) – de moins de 250 personnes et avec un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions de livres syriennes (SYP). Si cette économie n’était pas reconnue par les institutions officielles, elle était suffisamment organisée pour assurer la survie quotidienne de millions de Syriens et Syriennes.
Quand l’État disparaît, le marché se fragmente
À partir de 2012, la Syrie cesse de fonctionner comme un espace économique unifié. Le territoire se fragmente entre plusieurs autorités concurrentes : le régime syrien, différents groupes d’opposition armée, l’État islamique, les autorités kurdes et, en arrière-plan, les pays voisins. Dans ce contexte, le marché national se désagrège avec des routes coupées, des banques à l’arrêt et des contrats sans valeur juridique.
Selon la Banque mondiale, plus de la moitié des infrastructures économiques ont été détruites ou gravement endommagées.
Pourtant, les petites entreprises, comme les ateliers, les commerces, les transports ou les productions alimentaires, ont continué de fonctionner. Leur taille réduite et leur fort ancrage local leur ont permis de s’adapter à un environnement instable. Dans les contextes de conflit, ces entreprises jouent un rôle essentiel pour maintenir une activité économique minimale et aider les ménages à continuer de vivre.
Régime syrien, groupes d’opposition armés et État islamique
Pour survivre, ces petites et moyennes entreprises syriennes ont dû accepter une règle simple : travailler avec toutes les autorités en place, quelles qu’elles soient.
Avec le régime syrien
Dans les zones contrôlées alors par le régime de Bachar Al-Assad, les entreprises devaient obtenir des autorisations informelles, payer des taxes non officielles ou passer par des intermédiaires proches du pouvoir pour poursuivre leurs activités.
Ces pratiques, y compris des versements de pots-de-vin, symbolisent les défis auxquels font face ces petites et moyennes entreprises.
À lire aussi : La Syrie en transition... mais quelle transition ?
Avec les groupes d’opposition
Dans d’autres régions, les entreprises devaient payer des rétributions pour sécuriser leurs convois, négocier l’accès aux routes ou accepter des contrôles locaux afin d’éviter pillages et blocages. Dans les zones tenues par des groupes rebelles, cela passait parfois par des interactions économiques directes avec ces forces armées.
Dans les zones non contrôlées par l’État central, ces arrangements deviennent des conditions de fait pour maintenir une activité commerciale. Les acteurs économiques doivent payer des frais de passage imposés par des groupes armés.
Avec l’État islamique
Dans les zones contrôlées par l’État islamique, les règles économiques étaient strictes. L’organisation imposait des taxes obligatoires aux commerces et aux activités de production, contrôlait la circulation des marchandises et appliquait des sanctions sévères en cas de non-respect. Refuser de coopérer signifiait le plus souvent la perte de l’activité, voire des représailles.
Des analyses montrent que ce système de taxation et de contrôle économique constituait l’un des piliers du mode de gouvernance mis en place par l’État islamique dans les territoires syriens qu’il contrôlait.
Les pays voisins, prolongement de l’économie syrienne
Privées d’un système bancaire fonctionnel, de nombreuses petites entreprises syriennes se sont tournées vers les pays voisins.
Le Liban est devenu un point central pour les transferts financiers informels, la Jordanie, un espace d’approvisionnement relativement stable, et l’Irak un corridor essentiel pour le transport de marchandises. Dans ce contexte, les frontières ont cessé d’être de simples lignes de séparation pour devenir des espaces clés de l’économie syrienne.
La diaspora syrienne a joué un rôle central dans ces échanges, en finançant des activités locales et en sécurisant les transactions lorsque les institutions officielles faisaient défaut.
Une économie parallèle fondée sur la confiance
Cette économie n’était pas légale au sens strict, mais elle reposait sur des règles claires.
Lorsque les institutions disparaissent, la confiance ne s’évanouit pas, elle se déplace. Elle s’ancre dans la famille, les réseaux locaux, la réputation et la parole donnée. Les accords se concluent alors sans contrat écrit et, paradoxalement, ils sont respectés, car la survie collective en dépend.
De nombreux travaux sur les économies de guerre et les contextes de fragilité montrent que ces systèmes informels peuvent, dans certaines situations, s’avérer plus fiables que des institutions affaiblies ou absentes.
S’adapter en permanence pour ne pas disparaître
Faute de pouvoir investir ou planifier à long terme, les petites entreprises syriennes ont privilégié la réparation plutôt que le remplacement, l’utilisation d’un même atelier pour produire différents biens, le changement de fournisseurs ou d’itinéraires du jour au lendemain et la limitation de leurs stocks pour réduire les pertes en cas de rupture.
Privées d’accès au crédit, aux marchés extérieurs et à des infrastructures fiables, les entreprises syriennes ont ajusté leurs activités pour continuer à fonctionner.
Chaque décision devenait un calcul permanent du risque : quel trajet est le moins dangereux ? Qui faut-il payer pour passer ? Quelle perte peut être absorbée sans mettre l’entreprise en faillite ?
Réduire la dépendance à l’aide humanitaire
Cette économie parallèle a permis l’accès à des biens essentiels, contribué à la survie de millions de familles et maintenu un minimum d’activité économique dans un pays en guerre. En limitant l’effondrement total des circuits d’échange, elle a réduit, dans certains territoires, la dépendance exclusive à l’aide humanitaire.
Les organisations humanitaires elles-mêmes ont dû composer avec ces réseaux informels pour atteindre les populations et acheminer biens et services de première nécessité.
Un héritage difficile à intégrer
Aujourd’hui, une question centrale se pose : comment reconstruire une économie officielle sans fragiliser les mécanismes qui ont permis à la société de tenir pendant la guerre ?
Car les petites et moyennes entreprises syriennes abordent les institutions avec prudence, tout en restant dépendantes de relations régionales construites pendant le conflit. Réintégrer ces entreprises dans un cadre légal sans rompre ces équilibres constitue l’un des défis majeurs de la reconstruction économique de la Syrie.
Ancrées dans les communautés locales, ces entreprises jouent un rôle social majeur. Elles maintiennent des formes de solidarité économique, offrent des opportunités d’emploi aux femmes et aux jeunes et contribuent, dans certains secteurs, à la préservation d’activités artisanales et agricoles.
Au-delà du cas syrien, cette trajectoire rappelle que, dans les crises extrêmes, la résilience des sociétés repose souvent sur des acteurs invisibles : les petites entreprises, capables de faire tenir l’économie quand tout le reste vacille.
Mohamad Fadl Harake ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
08.01.2026 à 11:45
La marche, premier mode de déplacement en France : ce que disent vraiment les statistiques de mobilité
Texte intégral (2744 mots)
Les statistiques de mobilité orientent les politiques publiques. Or en France, la manière de les présenter, héritée des années du tout automobile, minore la part de la marche, ce qui pénalise le développement des mobilités actives. Et si on s’inspirait des approches statistiques déjà déployées ailleurs, par exemple en Suisse, pour mieux comptabiliser le temps passé à marcher ?
Les statistiques ne sont jamais neutres : elles sont le reflet de choix politiques répondant à un contexte historique spécifique. La manière de présenter les résultats des enquêtes statistiques sur la mobilité des personnes en France, qui a déjà 50 ans, n’échappe pas à cette règle. Elle conduit à sous-estimer fortement les déplacements à pied, au risque de continuer à favoriser des politiques en faveur des modes de déplacement motorisés.
Il est grand temps de réformer cet usage, comme l’a fait la Suisse il y a déjà 30 ans, si l’on souhaite redonner aujourd’hui davantage de place aux mobilités actives, tant pour des raisons sociales, économiques qu’environnementales.
Pour rappel, la marche est le mode de déplacement le plus inclusif, le plus démocratique et le moins nuisible à l’environnement, et pas seulement dans le cœur des grandes villes.
À lire aussi : Atteindre les objectifs climatiques améliorera aussi la santé publique
Ce que disent les statistiques sur la mobilité
En France, depuis la standardisation des enquêtes sur la mobilité des personnes en 1976, les déplacements sont généralement présentés sous forme de « parts modales ». Il s’agit des parts, sur l’ensemble des déplacements comptabilisés, réalisées avec chaque mode de déplacement : voiture, deux-roues motorisé, transports collectifs, vélo, marche…
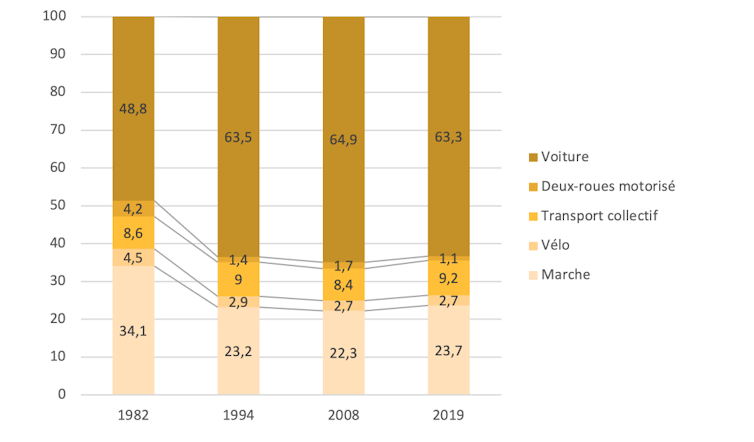
Dans les présentations classiques des données recueillies, la part modale de la marche apparaît très inférieure à celle de la voiture. Pourtant, quand on regarde l’autre grande source statistique que représentent les enquêtes sur la mobilité réalisées dans les grandes villes, les déplacements à pied dominent dans les centres-villes, et parfois également dans les banlieues denses de la proche périphérie. Mais partout ailleurs, c’est largement le contraire et le triomphe de la voiture apparaît ainsi incontestable.

En conséquence, pour qui découvre ces statistiques ainsi présentées , dans la plupart des territoires, il paraît nécessaire de s’occuper en priorité des voitures, de leur accorder davantage de place pour circuler et stationner, même si cela doit se faire au détriment des espaces publics, des trottoirs, des places publiques et autres terre-pleins.
Ce qu’oublient de préciser ces représentations
Examinons ces chiffres de plus près. En réalité, ce qu'on nomme habituellement la « part modale de la marche » ne concerne que la « marche exclusive », c’est-à-dire les déplacements entièrement faits à pied, par les résidents, sur l’espace public et hors du temps de travail.
Par convention, on oublie ainsi :
la marche intermodale, c’est-à-dire les déplacements à pied pour rejoindre ou quitter un transport public ou une place de stationnement pour voiture, vélo ou deux-roues motorisé,
la marche effectuée dans des espaces privés ouverts au public, comme les centres commerciaux ou les gares,
la promenade ou la randonnée,
la marche pendant le travail, y compris quand elle est effectuée sur l’espace public, qui est pourtant très importante dans certaines professions,
la marche au domicile pour effectuer toutes sortes d’activités : du ménage au jardinage, en passant par le bricolage, etc.,
enfin, la marche réalisée par les visiteurs (touristes et autres non-résidents) du territoire.
À lire aussi : Mobilité : et si on remettait le piéton au milieu du village ?
Comment expliquer une approche si restrictive ?
Les conventions statistiques sur la mobilité ont été élaborées dans les années 1960-1970 à l’époque du « tout automobile », puis des premiers efforts réalisés pour relancer les transports publics. Dans ce contexte, il fallait avant tout prévoir et dimensionner la voirie pour absorber un trafic motorisé fortement croissant, les piétons étant très peu considérés et les cyclistes censés disparaître.
Par convention dans les enquêtes sur la mobilité, un déplacement, c’est une personne qui va d’un lieu d'origine à un lieu de destination, avec un ou plusieurs modes et pour un motif particulier. Les modes sont hiérarchisés avec priorité aux plus lourds : d’abord les transports publics, puis la voiture, puis les deux-roues et enfin la marche.
Autrement dit, si une personne se rend à pied à un arrêt de bus, prend le bus, puis termine son trajet à pied, le déplacement est considéré comme ayant été fait en transport public et la part de marche est tout simplement ignorée. Dans cette approche, la marche devient un « résidu » statistique, c’est-à-dire ce qui reste une fois qu’on a pris en compte tous les autres modes de déplacement. Pourtant, les usagers des transports publics passent environ la moitié de leur temps à pied à marcher ou à attendre.
À lire aussi : Réduire l’empreinte carbone des transports : Quand les progrès techniques ne suffisent pas
Ces pays qui comptabilisent les déplacements différemment
Or, cette représentation des statistiques de déplacement en France est loin d’être la seule possible.
En Suisse par exemple, depuis une réforme des statistiques de la mobilité introduite en 1994, les résultats des enquêtes de mobilité sont présentés sous trois angles différents : les distances parcourues, le temps de trajet et le nombre d’étapes.
Par étape, on entend ici les segments d’un déplacement effectués à l’aide d’un seul mode de transport. Un déplacement en transport public, par exemple, compte le plus souvent une première étape à pied, puis une deuxième en transport public et une troisième à nouveau à pied : on parle de marche intermodale.
Ainsi, en 2021, en ne tenant compte que de la marche exclusive et de la marche intermodale, les Suisses ont passé chaque jour plus de temps à pied qu’en voiture.
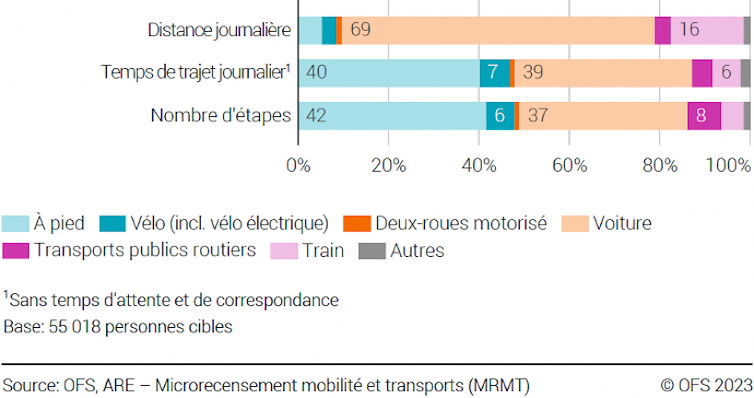
Ailleurs, on réfléchit aussi à d’autres manières de présenter les résultats des enquêtes sur la mobilité, comme en Belgique ou au Royaume-Uni.
En réalité, 100 % de nos déplacements intègrent au moins une part de marche, même minimale lorsqu’il s’agit par exemple de simplement sortir de sa voiture sur le parking de son lieu de travail. La marche est à l'origine de toutes les autres formes de mobilité et les autres modes ne sont que des « relais du piéton ». Parce que nous sommes des bipèdes, la marche est évidemment notre premier mode de déplacement.
Vers une nouvelle approche en France ?
La France peut-elle changer sa façon de présenter les statistiques de mobilité, dans le sillage de ce que propose la Suisse ?
Pour prendre conscience de l’importance journalière de la marche, il convient de l’aborder en temps de déplacement total à pied. Une récente étude de l’Ademe révèle que nous passons chaque jour une heure et douze minutes à pied, soit beaucoup plus que la durée moyenne passée en voiture chaque jour, qui est de 37 minutes.
Ces résultats montrent aussi que la prise en compte de la marche intermodale augmente de 75 % la durée de la seule marche exclusive (dite « déplacements locaux intégralement à pied » dans le graphique ci-après). En tenant compte de tous les temps consacrés à se déplacer, la marche est sans conteste le premier mode de déplacement, loin devant la voiture.
Cette étude repose sur l’utilisation de deux enquêtes existantes mais sous-exploitées (l’enquête mobilité des personnes et l’enquête emploi du temps des Français) et en adoptant plusieurs hypothèses prudentes.
En quelques centaines de milliers d’années d’évolution humaine, la bipédie s’est hautement perfectionnée. Elle a permis de libérer nos mains, nous a rendus très endurants à la course et a contribué à développer notre cerveau. Puis, en 150 ans seulement avec l’avènement du transport motorisé, la marche utilitaire quotidienne s’est effondrée.
Pourtant, de par notre constitution, marcher régulièrement est essentiel pour rester en bonne santé, pour bien grandir, vivre mieux et bien vieillir. C’est un enjeu de santé publique. C’est pourquoi, il convient de réaliser des espaces publics confortables, de libérer les trottoirs du stationnement sauvage et autres obstacles, de ménager des traversées piétonnes sécurisées et de calmer la circulation automobile, sa vitesse et son volume. Pour appuyer de telles politiques, encore faudrait-il revoir notre manière de représenter la marche dans les résultats des enquêtes de mobilité.
Frédéric Héran est membre du conseil d’administration de l'association et groupe de réflexion Rue de l’Avenir
08.01.2026 à 11:45
Peut-on encourager le covoiturage avec des subventions locales ?
Texte intégral (1743 mots)

Le covoiturage est souvent perçu comme une des façons les plus simples de baisser les émissions de gaz à effet de serre des transports. Si le premier bilan des subventions locales visant à généraliser cette pratique est encourageant, il masque en vérité plusieurs aspects.
Face à l’urgence climatique et aux embouteillages chroniques des métropoles françaises, les pouvoirs publics cherchent des solutions pour réduire l’usage de la voiture individuelle. Les automobiles des particuliers sont la principale source des émissions de gaz à effet de serre du transport en France. Elles sont également émettrices de particules fines qui dégradent la qualité de l’air et augmentent les risques de maladies respiratoires et cardiovasculaires.
Face à cette réalité, le covoiturage est une piste qui suscite beaucoup d’espoir, car elle ne nécessite pas d’infrastructures lourdes supplémentaires, s’appuyant sur des ressources existantes de véhicules et de conducteurs. Parmi les solutions incitatives, les aides financières locales au covoiturage, notamment via des plateformes numériques, se développent depuis 2019. Mais ces subventions encouragent-elles vraiment plus de covoiturage ? Et quels sont les gains environnementaux dus à ces subventions ?
Des résultats probants, mais variables selon les territoires
La loi d’orientation des mobilités (LOM), promulguée en 2019, autorise les autorités organisatrices de mobilité à verser une incitation financière aux conducteurs et passagers d’un trajet en covoiturage. Le versement de cette subvention s’effectue principalement via des plateformes numériques qui organisent le covoiturage. La subvention moyenne pour un déplacement en covoiturage de 22 kilomètres s’élève à 1,60 euros.
Pour voir si ce levier est efficace, un jeu de données est précieux : celui du registre de preuve de covoiturage. Il centralise les données de trajets transmises par les plateformes partenaires. Notre étude récente utilise ces données pour mesurer la pratique du covoiturage organisé via plateforme dans 1 123 collectivités locales françaises entre 2019 et 2024.
Elle révèle que ce levier est effectivement puissant. En moyenne, l’introduction d’une subvention locale attribuée pour chaque déplacement augmente d’environ 5 trajets mensuels le nombre de trajets de covoiturage à courte distance (inférieurs à 80 kilomètres) sur plateforme pour 1 000 habitants concernés. Chaque euro de subvention supplémentaire par déplacement génère près de 4 trajets mensuels additionnels par 1 000 habitants. Autrement dit, les finances publiques locales, investies dans ce type d’incitation, produisent un effet tangible et mesurable sur le terrain.
Ce résultat masque cependant une forte diversité. L’effet des subventions est nettement plus marqué dans les zones urbaines denses et peuplées. À l’inverse, dans les territoires peu denses et ruraux, la subvention n’a quasiment aucun effet, traduisant les difficultés du covoiturage à s’implanter sans une masse critique d’usagers. Cette disparité met en lumière le rôle central des effets de réseau propres aux plateformes numériques : plus il y a d’utilisateurs, plus elles deviennent utiles, ce qui amplifie l’impact des subventions.
D’autres réalités doivent également être soulevées pour comprendre l’efficacité ou non de ces subventions, notamment du point de vue environnemental.
L’effet d’aubaine : inciter ceux qui viendraient de toute façon
L’effet d’aubaine se produit lorsque des utilisateurs auraient covoituré via la plateforme même en l’absence de toute subvention. Par exemple, un salarié habitué à organiser son covoiturage quotidien sur une application continue simplement à le faire, mais touche désormais une prime financière.
Ici, la dépense publique n’a donc pas changé son choix ni augmenté le nombre total de trajets partagés, ce qui dilue l’efficacité de la politique.
L’effet d’opportunité : attirer les covoitureurs informels sans créer de nouveaux trajets
L’effet d’opportunité correspond lui aux covoitureurs qui, sans subvention, auraient continué à partager leurs trajets en dehors des plateformes numériques (par exemple via le bouche-à-oreille ou des groupes privés). Lorsque la subvention est instaurée, ils transfèrent leur pratique sur la plateforme pour bénéficier des aides. Ainsi, le volume de trajets enregistrés croit artificiellement, sans que la part réelle du covoiturage dans la mobilité globale n’augmente. Par exemple, deux voisins qui organisaient ensemble leur trajet en voiture hors plateforme rejoignent l’application pour percevoir la prime, sans modification de leur habitude de déplacement. Une enquête du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) montre qu’un tiers des nouveaux covoitureurs attirés par les dispositifs d’incitation financière covoituraient déjà avant la mise en place de l’incitation.
Le report modal : comprendre d’où viennent les nouveaux passagers
Le facteur le plus décisif concerne cependant les sources du report modal : il s’agit d’identifier le mode de transport qu’un passager du covoiturage aurait utilisé si la subvention n’existait pas. Contrairement à l’idée reçue, une grande partie des nouveaux passagers du covoiturage issu de la subvention ne sont pas d’anciens automobilistes solo, mais d’anciens usagers du transport collectif (bus, train) ou parfois des modes actifs (comme le vélo ou la marche).
Prenons l’exemple d’une passagère qui renonce au TER pour un trajet covoituré subventionné : cela ne retire pas une voiture de la circulation, et les bénéfices pour la réduction des émissions sont nettement moindres que si elle avait quitté la voiture solo.
D’après l’enquête nationale sur le covoiturage pilotée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), 35 % des passagers du covoiturage courte distance via plateforme faisaient le déplacement en transports en commun avant de pratiquer le covoiturage, 11 % utilisaient un mode actif et 10 % ne faisaient pas ce trajet. Ce constat est valable tant pour le covoiturage court que longue distance, freinant fortement l’effet net de la politique sur les émissions de gaz à effet de serre.
Combien coûte réellement la tonne de CO₂ évitée ?
Pour obtenir une mesure de l’impact net des subventions, il est donc indispensable de corriger les chiffres bruts du nombre de trajets en tenant compte de ces trois effets. Selon notre étude, ces phénomènes expliquent qu’entre un tiers et la moitié de l’augmentation observée n’est pas associée à une réelle réduction de l’autosolisme ou des émissions.
Une manière de mesurer l’efficacité d’une politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et de la comparer à d’autres politiques, est de calculer le montant nécessaire pour éviter l’émission d’une tonne de CO2. Dans le cas du covoiturage, chaque tonne de CO2 évitée coûte à la collectivité entre 1 000 et 1 300 euros en subventions.
Ce chiffre se situe dans la fourchette haute des instruments de politique climatique en Europe, ce qui dénote une efficacité très relative. À titre de comparaison, le dispositif d’encouragement de l’adoption de la motorisation électrique a un coût pour les finances publiques de l’ordre de 600 euros par tonne de CO₂ évitée.
Vers une stratégie de long terme, ciblée et combinée
Ces résultats montrent bien la nécessité de concevoir des politiques qui ciblent précisément les changements de comportement les plus à même de réduire les émissions de CO2. Ces politiques seront d’autant plus efficaces qu’elles convainquent des autosolistes d’abandonner leur voiture pour covoiturer en tant que passager. Pour cela, des stratégies combinées seront nécessaires : incitations financières, infrastructures adaptées comme les voies réservées, développement de l’intermodalité…
Enfin, l’effet des subventions croissant dans le temps et le développement de la pratique du covoiturage invitent à une vision de long terme, loin des mesures ponctuelles d’effet d’annonce.
Guillaume Monchambert est membre du conseil scientifique de la Société des Grands Projets (SGP). Il a reçu des financements de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (Projet Covoit’AURA) et de la BPI (projet Mobipart). Il a effectué des activités de conseil pour SNCF Réseau et SNCF Voyageurs.
08.01.2026 à 11:37
Does running wear out the bodies of professionals and amateurs alike?
Texte intégral (1935 mots)
Running counts among today’s most popular sports. Sometimes the race is on even before the competition itself has started, as tickets for events sell out within hours. In France, this has got people talking about a “race for the runner’s bib”.
So, while running enjoys the reputation of a wholesome sport, the reality is that some of us feel stress at the simple prospect of donning a bib, while even a greater number of us face exhaustion upon completing a race such as a marathon or trail. So, what exactly is the toll of the sport on our bodies, and does our status as an amateur or a pro make a difference?
Working it out like a pro
It’d be easy to place professional and amateur runners in two separate boxes. Indeed, pros train hard–up to three times a day ahead of certain races. Life at those times is austere, punctuated by meals, runs and sleep, leaving little room for improvisation. And while you might think that the countless events around the world might dilute some of the demand for them, competition in such a universal sport is in fact fierce and professional runners need to push their bodies to the limit to get better at it.
High-level careers are often brief, lasting five or six years. Stories such as that of Eliud Kipchoge, the first man to run a marathon in under two hours (under non-certifiable conditions), sixteen years after becoming world champion in the 5,000 metres on the track, remain exceptions.
The significant mechanical stress inherent in the sport weighs on the muscles, tendons and skeleton. There are times when rest periods are short and it’s increasingly common to see athletes injuring themselves during competitions on live television, a surefire sign of physical and mental exhaustion. Some might consider these factors to be fairly typical: after all, these are top-level athletes.
Similarities between professionals and amateurs
But are world champs, next-door champs and ordinary runners really that different? Considering the tip of the iceberg of this question, the answer seems obvious: they don’t run at the same speed and therefore don’t spend the same time exerting themselves. But what about the submerged part: the pre-race prep, training, the individuals’ investment and self-sacrifice? When you want to break a record–your own record–don’t you give 100% of yourself, both physically and mentally?
Let’s consider the figures for the Paris Marathon in 2025: 56,950 registered for the race, 55,499 finishers. The mass event spells the same challenge for all: 42,195 km (around 26 mi) for the fifty or so athletes who might be considered elite and all the others who have to juggle it with their professional and family lives.
In truth, regardless of your level or speed, there are many similarities in how you prepare for a marathon, with identical training loads. Marathon training typically lasts ten to twelve weeks and includes essential elements such as “long runs”, a training session of around thirty kilometres recommended once a week.
No one escapes it. And there’s a whole range of science-based books on running, designed to guide the general public.
However, as training takes its toll on both body and morale, the risk of injury rises.
Trail or marathon prepping: increased risk of injury for amateurs
In fact, we most often see stress-related injuries among amateurs.
A high-level athlete doesn’t need to see a sports doctor. Why is that? Because they have built their careers over many years and have specific genetic characteristics that allow them to take on heavy training loads. They follow a specific programme that includes dietary measures, recovery phases and processes.
Professional athletes benefit from much better general and medical support than novice or amateur runners who, whether for individual or collective challenges, embark on projects such as marathons or trail running. This is how a runner like Christelle Daunay, after fifteen years of practice and modest beginnings at the national level, patiently built herself up to win the European Marathon Championships in Zurich in 2014.

When physical stress takes its toll on professionals
The issue of physical stress has been raised for a long time. In the 1990s, it was already reported that simply running for 45 minutes rather than 30 minutes a day could double the frequency of injuries. Going from three to five weekly sessions had similar effects.
Christelle Daunay was no exception. She suffered a stress-related fracture in 2018, which prevented her from defending her title as European marathon champion in 2014. It should be noted that a “stress fracture” is a bone injury, similar to a crack, which can be caused by running long distances.
When ultra-trail puts body and mind to the test
The recent development of trail running (i.e. running in the great outdoors) only reinforces these concerns, with not just the wilderness but “ultra” aspect appealing to many.
The extreme sport has its own particularities. Due to the irregular terrain, its practice requires different joint and muscle movements and therefore greater concentration than road running. Add to that the effort’s duration, ranging from a few hours to a full day or more, the issues of nutrition, effort management, and muscle damage that sets in over time, and it’s easy to understand why these events lead to mental and physical fatigue, not only during the event itself, but also in the long term.
The conditions of running-related physical wear depend on many factors and vary from person to person. For example, on whether you jog to hit a speed or mileage goal.
Wearing out the body at a given moment to increase its resistance… to wear and tear
Whatever the focus, people often engage in specific training programmes, with physical and physiological progress relying on the human body’s remarkable adaptive capacity.
Note the paradox here: one of the principles of training is to stimulate the body, to “wear it out” at a given moment in time in order to trigger the physiological processes that will lead to improved capabilities, the fight against fatigue… and, ultimately, increased resistance to physical stress.
This fundamental process is the basis of physical rehabilitation/recovery programmes, which are increasingly used in physiopathological contexts, for example to treat peripheral artery disease or obesity.
However, at its most intense, training can require mental commitment, resistance to weariness, and a strong will to continue the effort over time despite fatigue.
Stress can therefore also be mental. This is perhaps the major difference between amateurs and professionals, who have no choice but to put their bodies under severe strain in order to progress in the high-level hierarchy.
Pros or amateurs, the importance of good coaching
Seeking to push their physical and mental limits can lead any runner to feel “worn out”. All these factors highlight the importance of being well supervised and advised (by coaches, in clubs, etc.) in order to train with a certain progression, both in terms of quantity and intensity, and to adapt one’s lifestyle.
No technical equipment is needed to run – an advantage which allows you to ideally experience your own body, provided you’re aware of races’ risks and limitations. And rest assured, if you still don’t enjoy this sport, there are plenty of other options available so you can find something that suits you and enjoy the health benefits of physical activity. What’s important is to keep moving.
Extract from What I Talk About When I Talk About Running by Haruki Murakami:
“Human beings naturally continue doing things they like, and they don’t continue what they don’t like. That’s why I’ve never recommended running to others. It doesn’t suit everybody. Similarly, not everyone can become a novelist.”
Benoît Holzerny, a health-promoting sports coach, and Cédric Thomas, a top athlete trainer (including the 2014 European marathon champion, Christelle Daunay), contributed to writing this article.
Sylvain Durand ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
08.01.2026 à 08:47
Les États-Unis arraisonnent un navire battant pavillon russe : que dit le droit de la mer ?
Texte intégral (1620 mots)
Les États-Unis affirment avoir agi dans le respect du droit international. La Russie dénonce une violation manifeste du droit de la mer. Entre accusations et contre-accusations, l’arraisonnement d’un navire battant pavillon russe soulève un point de droit de la mer inédit.
Les relations entre les États-Unis et la Russie ont connu un nouvel accroc après que les garde-côtes américains ont abordé un navire naviguant dans les eaux islandaises, affirmant qu’il violait les sanctions visant le Venezuela. L’incident a immédiatement donné lieu à des accusations et des contre-accusations entre les États-Unis et la Russie.
Washington a affirmé avoir agi correctement, exécutant un mandat délivré par un tribunal fédéral américain. De leur côté, des responsables russes ont déclaré, selon l’agence de presse russe Tass, que cet arraisonnement constituait une violation manifeste du droit de la mer, affirmant qu’« aucun État n’a le droit d’employer la force contre des navires dûment enregistrés dans les juridictions d’autres États ». Le communiqué précisait que le Bella-1 – récemment rebaptisé Marinera – avait reçu une autorisation temporaire de naviguer sous pavillon russe, le 24 décembre.

Contrairement à l’enlèvement spectaculaire du président vénézuélien Nicolas Maduro de son palais de Caracas, le 3 janvier, une opération que les États-Unis ne semblent même pas tenter de justifier en droit international, l’interception du Marinera/Bella-1 paraît soulever un point inédit du droit de la mer, susceptible d’offrir au moins une certaine marge à Washington pour se présenter comme étant du côté du droit.
Avant l’enlèvement de Maduro, les États-Unis semblaient choisir avec un certain soin les navires transportant du pétrole vénézuélien qu’ils prenaient pour cibles. Il s’agissait soit de navires sans nationalité, soit de navires soupçonnés d’arborer un faux pavillon, ce qui ne leur confère aucune protection au titre de l’article 92 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), laquelle constitue également la règle de droit international coutumier, applicable aux États non parties comme les États-Unis.
Les navires sans nationalité sont vulnérables
Se trouver sans nationalité, ou adopter une conduite qui offre aux navires de guerre en haute mer un fondement valable pour traiter un bâtiment comme tel, est une position à haut risque que tout navire a tout intérêt à éviter. En effet, un navire sans nationalité n’a, par définition, aucun État sous le pavillon duquel il est enregistré pour faire valoir à son profit la juridiction exclusive et protectrice qui s’exerce en haute mer.
La CNUDM prévoit par ailleurs qu’un navire qui navigue sous les pavillons de deux États ou plus et qui les change en fonction des circonstances, « ne peut se prévaloir d’aucune des nationalités en question à l’égard de tout autre État ». Cela signifie qu’il peut être juridiquement considéré comme sans nationalité.
Ainsi, jusqu’au changement de pavillon signalé le 31 décembre, non seulement les États-Unis mais n’importe quel État étaient en droit de considérer le Marinera/Bella-1 comme un navire sans nationalité. Cela le rendait vulnérable à une interception en haute mer et à l’exercice, à son encontre, de la compétence répressive interne de l’État dont relevait le navire de guerre ou le bâtiment des garde-côtes procédant à l’interception.
La situation juridique demeure toutefois incertaine. La question pourrait être de savoir si les États-Unis poursuivaient déjà le Marinera/Bella-1 au moment où celui-ci a changé de pavillon. Si tel était le cas, Washington pourrait être fondé à ne pas tenir compte de la réimmatriculation.
La CNUDM prévoit ce qu’elle appelle le « droit de poursuite » (hot pursuit). Elle précise que « le droit de poursuite cesse dès que le navire poursuivi entre dans la mer territoriale de son propre État ou d’un État tiers ». Aucun autre cas de cessation de ce droit n’étant mentionné – y compris l’hypothèse où le navire cesserait d’être sans nationalité –, cela laisse aux États-Unis la possibilité de soutenir qu’ils poursuivaient déjà le Marinera/Bella-1 et qu’ils n’étaient donc pas tenus de mettre fin à cette poursuite.
VOUS POUVEZ COURIR, MAIS VOUS NE POUVEZ PAS VOUS CACHER 🔥
Lors d’opérations menées avant l’aube ce matin, les garde-côtes américains ont arraisonné deux pétroliers de la « flotte fantôme » dans l’océan Atlantique Nord et dans les eaux internationales près des Caraïbes. Les deux navires avaient soit fait escale récemment au Venezuela, soit s’y rendaient.
Mais cet argument reste fragile, car rien ne permet d’affirmer avec certitude qu’il s’agissait d’une véritable « hot pursuit ». En droit de la mer, cette notion s’applique à des poursuites engagées depuis l’une des zones maritimes de l’État concerné – et non en haute mer.
Accusations et contre-accusations
Jusqu’à présent, le ministère russe des transports a affirmé que l’action des États-Unis contrevenait à la règle énoncée à l’article 92. La Russie soutient que le changement d’immatriculation est intervenu dès le 24 décembre. Face à cet argument, les États-Unis pourraient faire valoir que ce n’est qu’au moment où le pavillon russe a été peint sur la coque du navire – ce qui aurait eu lieu le 31 décembre – que l’article 92 pouvait être invoqué à leur encontre.
Article qui précise également qu’« un navire ne peut changer de pavillon au cours d’un voyage ou lors d’une escale, sauf en cas de transfert réel de propriété ou de changement d’immatriculation ». Cette disposition est souvent mal comprise et interprétée comme interdisant purement et simplement tout changement de pavillon en cours de route — comme cela semble avoir été le cas ici. Une lecture plus attentive montre toutefois que ce n’est pas exact : ce que la règle interdit, c’est un changement de pavillon sans changement d’immatriculation correspondant.
Mais ce n’est pas la situation ici. À supposer qu’il y ait bien eu une immatriculation effective en Russie, c’est cet élément qui fait foi. Le fait de peindre un pavillon sur la coque faute d’en disposer physiquement n’en est qu’un indice matériel.
Le changement de pavillon en cours de poursuite constitue un point inédit du droit international de la mer, dans la mesure où aucun précédent connu n’existe. En l’absence de réponse juridique claire, la manière dont cet incident se réglera est susceptible de faire jurisprudence. Il faudra donc entendre les argumentaires juridiques concurrents des États-Unis et de la Russie pour déterminer lequel se révèle le plus convaincant.
Andrew Serdy ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
07.01.2026 à 18:03
La « défense avancée » d’Israël au Proche-Orient
Texte intégral (2875 mots)
En dépit des accords de cessez-le-feu conclus avec le Liban et à Gaza, et des discussions en cours avec la Syrie sur les contours d’un accord de sécurité, Israël poursuit une politique dite de « défense avancée » qui fait peu de cas de la souveraineté de ses voisins. Au nom de l’impératif de la sanctuarisation de son territoire, Tel-Aviv continue de redéfinir les frontières, d’étendre sa profondeur stratégique et d’asseoir son contrôle sur son voisinage. Cette politique se heurte toutefois de plus en plus aux intérêts de puissances régionales, comme la Turquie ou l’Arabie saoudite.
Depuis deux ans, l’accumulation de succès tactiques conduit Tel-Aviv à opter pour une politique impériale qui se poursuit en dépit des différents processus de négociations en cours. Au Liban, à Gaza, en Syrie, cette politique ne va pas sans susciter de tensions avec les grands acteurs de la région.
Détruire le Hezbollah… ou détruire le Liban ?
Au Liban, la guerre d’attrition visant à détruire les capacités militaires du Hezbollah – organisation libanaise alliée de l’Iran – et à décapiter sa chaîne de commandement a abouti à l’accord de cessez-le-feu du 27 novembre 2024.
Le dossier libanais est perçu par Israël comme le point de départ de la stratégie de restructuration du Moyen-Orient. Bien que le texte de l’accord ne prévoie que la cessation des hostilités et le retrait des forces militaires du Hezbollah et de ses armes du sud de la rivière Litani en échange d’un retrait israélien des cinq positions stratégiques qu’il occupe au Sud-Liban, la lettre complémentaire (side letter) adressée par Washington à Tel-Aviv donne un blanc-seing à la partie israélienne pour « répondre aux menaces » et « agir à tout moment contre les violations commises dans le sud du Liban ». En d’autres termes, les garanties offertes par les États-Unis permettent à Israël de mener des actions militaires préemptives sans être inquiété pour cela.
Entre novembre 2024 et novembre 2025, la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) a recensé plus de dix mille violations du cessez-le-feu par Israël. La partie israélienne considère que l’engagement diplomatique avec l’État libanais demeure distinct de ses attaques militaires contre le Hezbollah, qu’elle qualifie de groupe terroriste. De surcroît, l’État libanais, qui n’a cessé d’appeler, sans succès, à l’action de la communauté internationale pour faire cesser les attaques quasi quotidiennes contre sa souveraineté et son intégrité territoriale, s’est vu imposer, sous la pression de Washington, un calendrier pour désarmer le Hezbollah, au risque de mettre en péril la stabilité interne, dans un contexte marqué par une grande fragilité de ses institutions.
Ainsi, l’armée libanaise est censée avoir achevé le démantèlement de toutes les infrastructures du Hezbollah et le désarmement total du groupe dans de zone située au sud du Litani, à environ 30 km de la frontière avec Israël ; mais la partie israélienne réclame désormais la mise en application de la phase deux, à savoir la restauration du monopole exclusif de l’État sur les armes. Toutefois, comme le rappellent les universitaires Joseph Daher, Sami Zoughaib et Sami Atallah dans une publication du 20 novembre dernier :
« […] La véritable souveraineté se transmet rarement par une simple signature. Elle repose sur trois fondements interdépendants : un monopole crédible de la force par l’État, des institutions fonctionnelles et solvables, et une légitimité suffisamment large pour lier les communautés à l’État. Le Liban manque de ces trois éléments. Au contraire, la coercition extérieure dicte la politique, transformant l’État d’acteur souverain en instrument. »
La Syrie dans le viseur
En Syrie, tout en poursuivant les négociations autour d’un accord de sécurité, Israël mène des actions qui fragilisent l’État syrien et favorisent la fragmentation du territoire.
Au lendemain de la chute du régime d’Assad – événement dans lequel Israël se félicite d’avoir joué un rôle majeur grâce à sa guerre d’attrition visant à affaiblir les groupes pro-iraniens –, l’aviation israélienne a conduit des frappes préemptives massives, estimant avoir détruit de 70 % à 80 % des capacités militaires syriennes. Entre décembre 2024 et juillet 2025, plus de 800 attaques aériennes israéliennes contre la Syrie auraient été dénombrées.
À ce jour, l’intransigeance israélienne en matière d’exigences sécuritaires continue de faire obstacle à la conclusion d’un accord avec la Syrie. Tel-Aviv, qui a élargi son occupation au Golan en s’emparant de 600 kilomètres carrés sur le territoire syrien, en violation de l’accord de désengagement de 1974, réclame le droit d’intervenir militairement dans le sud syrien et de conduire des frappes sous le prétexte de préserver sa sécurité et sa stabilité.
Le projet d’accord de sécurité, qui reporte la question de la restitution du Golan (occupé par Israël depuis 1967), comporte d’autres exigences drastiques comme l’élargissement de la zone tampon de deux kilomètres côté Syrie et la mise en place d’une zone démilitarisée dans le Sud, qui constitueraient un précédent dangereux. En dépit de sa volonté plusieurs fois réitérée de conclure un accord de sécurité pour apaiser les tensions avec Israël, le président syrien Ahmed al-Charaa se montre réticent à l’idée d’une zone tampon qui transformerait la région en un espace de danger « aux conséquences inconnues ».
Israël dispose déjà d’une totale liberté d’action en Syrie comme l’illustre parfaitement sa gestion de la province de Quneitra, où les habitants font face à des incursions quotidiennes, à des contrôles et arrestations arbitraires, à la confiscation de leurs logements et de leurs biens, sans que l’armée syrienne ne les protège.
Tout en adoptant une posture maximaliste dans les négociations, Israël cherche à exploiter les minorités druze et kurde comme vecteur de déstabilisation, renouant ainsi avec la stratégie de l’expert du ministère israélien des affaires étrangères Oded Yinon développée dans les années 1980. Yinon considérait le monde arabe comme un maillon faible de l’ordre international. Les États étaient « un château de cartes temporaire » construit par la France et le Royaume-Uni dans les années 1920, qui ont divisé arbitrairement la région en dix-neuf États, « tous composés de combinaisons de minorités et de groupes ethniques hostiles les uns aux autres ». Dès lors, selon lui, ces États étant artificiels, il convient de les démembrer et de recomposer des entités sur des bases confessionnelles.
Cette approche est prégnante chez certains membres du gouvernement Nétanyahou. L’actuel ministre des affaires étrangères Gideon Saar a co-écrit en octobre 2015 avec un colonel de l’armée israélienne un article intitulé « Farewell to Syria » dans lequel il affirmait :
« Toute stratégie élaborée dans le but de mettre fin à la guerre civile en Syrie et de façonner son avenir doit partir d’un postulat clair : la Syrie, effondrée et divisée, ne peut être reconstituée. Il est donc nécessaire de se concentrer sur l’identification d’alternatives pratiques à l’État syrien. […] Un règlement coordonné et ordonné visant à séparer les forces entre la majorité sunnite et les minorités vivant sur le sol syrien […] offre le meilleur potentiel de stabilité. […] Tout accord de paix en Syrie doit reposer sur la garantie de l’existence de ces communautés au sein d’entités étatiques qui leur sont propres. »
Aussitôt après sa nomination à la tête de la diplomatie israélienne, Gideon Saar a annoncé qu’Israël devait se tourner vers les Kurdes, les Druzes et les autres minorités en Syrie et au Liban. Israël a, d’un côté, cherché à instrumentaliser la question druze, comme on l’a vu lors des affrontements intercommunautaires de mai dernier quand les Israéliens, en invoquant la défense des minorités, ont lancé une vague de bombardements massifs en Syrie et continuent de se présenter comme les protecteurs de cette communauté.
À lire aussi : Les violences inter-communautaires en Syrie et l’avenir de la transition
D’un autre côté, la partie israélienne a tenté de renforcer ses liens avec les Forces démocratiques syriennes (dominées par les Kurdes de la branche syrienne du PKK), engagées dans un processus d’unification pour placer les institutions civiles et militaires du nord-est de la Syrie (Rojava), sous le contrôle de l’État.
Après une interview accordée début décembre 2025 au Jerusalem Post par le commandant en chef des FDS, Mazloum Abdi, des révélations du Washington Post ont fait état des liens qu’entretiendraient les FDS avec Israël. Selon le quotidien américain, « des personnalités druzes liées aux services de sécurité israéliens ont acheminé des fonds vers des militants druzes à Soueïda via les FDS quelques mois avant la chute du régime d’Assad ».
Bien que les FDS démentent ces accusations – également nourries par différentes déclarations de Mazloum Abdi (« Si Israël peut empêcher les attaques contre nous et mettre fin au massacre de notre peuple, nous nous en réjouissons et nous lui en sommes reconnaissants ») –, les révélations du Washington Post renforcent l’argument de la Turquie selon lequel les FDS seraient inféodées à Israël, ce qui implique que leur intégration dans l’État syrien doit nécessairement entraîner leur désarmement et la dissolution de leur commandement.
Le mécontentement de la Turquie…
Depuis plusieurs mois, les actions israéliennes en Syrie heurtent les intérêts de la Turquie et suscitent des tensions croissantes avec Ankara. En effet, la Turquie, qui est l’un des principaux parrains d’Ahmed al-Charaa et qui a largement œuvré à sa normalisation, souhaite stabiliser un pays sur lequel elle entend exercer une forte influence.
L’accumulation des tensions a conduit Ankara à déployer des radars turcs à l’intérieur du territoire syrien, ce qui entraverait la liberté d’action d’Israël. La Turquie envisagerait également d’installer une base militaire.
De son côté, Israël a renforcé son partenariat sécuritaire et énergétique avec la Grèce et avec Chypre, opposées à la Turquie sur la question du zonage maritime en Méditerranée orientale. Dans un contexte où Athènes et Nicosie voient en Tel-Aviv un contrepoids aux ambitions de la Turquie, une hypothétique convergence entre Ankara et Téhéran pourrait se dessiner dans les semaines à venir.
Enfin, un autre signe supplémentaire de l’exacerbation des contradictions entre Israël et la Turquie est perceptible dans le refus israélien d’une participation turque à une « force de stabilisation internationale » à Gaza prévue dans le cadre du plan Trump pour la paix publié le 29 septembre 2025.
Ce plan ne constituerait, pour reprendre les termes d’une analyse récente publiée par le média Orient XXI, qu’une étape supplémentaire dans la réalisation du projet hégémonique israélien au Moyen-Orient « en rendant notamment obsolètes les frontières traditionnelles et en garantissant à Israël une liberté de mouvement pour frapper qui il veut, quand il veut et où il veut […] ». Il comporte plusieurs objectifs comme « exploiter davantage les fonds du Golfe pour financer le Conseil de la paix qui serait présidé par Donald Trump et préparer le plan de développement économique de Trump pour Gaza ; […] l’élimination de toute forme de résistance dans les territoires occupés ; la liquidation de la cause palestinienne et le déplacement forcé de la population ; […] normaliser la présence d’Israël dans la région et ses relations avec tous les pays arabes, en particulier l’Arabie saoudite ».
En offrant les mêmes garanties à Israël que dans le cadre libanais, les Américains consacreraient sa liberté d’action sur le territoire gazaoui aux côtés de la force de stabilisation internationale et lui permettraient donc de continuer à contrôler Gaza en évitant le coût d’une occupation permanente.
Par ailleurs, les États-Unis – qui superviseraient le Conseil de la paix et seraient donc en charge de la surveillance du comité de gouvernance temporaire de Gaza et du développement de la bande en coopération avec les pays du Golfe pour financer les projets et maintenir l’illusion d’une légitimité politique – pourraient également tenter, par ce biais, de renforcer les relations entre Israël et l’Arabie saoudite tout en enterrant la question palestinienne.
… et de l’Arabie saoudite
Toutefois, ce dernier pari ne tient pas compte de la déconnexion croissante des intérêts entre Tel-Aviv et Riyad. L’Arabie saoudite ne souscrit pas à l’approche israélienne de la « défense avancée » sous-tendue par une stratégie de restructuration du Moyen-Orient. Elle voit dans l’usage de sa supériorité militaire une menace pour ses propres intérêts et sa politique souveraine. Durant la guerre des douze jours contre l’Iran, Riyad s’est distanciée des actions israéliennes et s’est vigoureusement opposée à l’utilisation de son territoire et de son espace aérien par l’aviation américaine et israélienne pour frapper l’Iran.
Par ailleurs, en Syrie, elle converge avec la Turquie dans sa volonté de stabiliser le pays et veut exorciser le risque d’un effondrement qui sèmerait le chaos dans la région. Sur ce point, l’administration Trump est sur la même ligne que la Turquie et l’Arabie saoudite, tout en cherchant à offrir les meilleures garanties de sécurité possible à Israël, qui demeure étroitement tributaire de l’assistance financière, militaire des États-Unis, ainsi que de leur soutien diplomatique.
Terminons par ce constat du journaliste et écrivain américain Roger Cohen dans un article du New York Times le 30 novembre dernier après un séjour en Israël et au Liban : « Je n’ai trouvé que peu de signes indiquant que la puissance israélienne, telle qu’elle est actuellement déployée, permettra d’assurer un avenir plus pacifique à long terme pour Israël et la région. »
Lina Kennouche ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
07.01.2026 à 17:58
François Mitterrand, impossible héros de la gauche ?
Texte intégral (2974 mots)
François Mitterrand disparaissait il y a trente ans, le 8 janvier 1996. Premier président de gauche sous la Vᵉ République (de 1981 à 1995), il reste omniprésent dans l’imaginaire français, comme en témoignent de nombreux films ou livres qui lui sont régulièrement consacrés. Malgré d’importantes réformes (abolition de la peine de mort, retraite à 60 ans, RMI…), son legs politique est complexe à assumer à gauche, le parcours de l’homme étant entaché de zones sombres (Vichy, le colonialisme) et d’un soupçon permanent d’insincérité ou de trahison des idéaux qui l’ont porté au pouvoir (rupture avec le capitalisme). Quels sont les apports récents de la recherche à ce sujet ?
En 2016, le centenaire de la naissance de François Mitterrand et les vingt ans de sa disparition avaient donné lieu à de nombreuses commémorations et publications. Dix ans plus tard, de nouvelles recherches ont revisité l’histoire mitterrandienne en s’appuyant notamment sur des sources inédites publiées, à l’image des Lettres à Anne et du Journal pour Anne (2016), ou déposées en archives. Outre sa place croissante dans la littérature scientifique, François Mitterrand s’est aussi installé dans le paysage fictionnel français, dans le Promeneur du Champ-de-Mars (2005), les Saveurs du palais (2012), l’Inconnu de la Grande Arche (2025), dans les séries Bardot (2023) et Tapie (2023), ou, actuellement dans Mitterrand confidentiel, diffusée sur France 2. À travers ces récits, auxquels s’ajoutent des témoignages comme le documentaire écrit par sa fille Mazarine, François Mitterrand, une autre vie possible (2025) , cette figure de la politique française du second vingtième siècle peuple toujours puissamment les imaginaires de nos contemporains. Si sa biographie est désormais bien connue, son héritage, sans cesse réinterrogé, demeure marqué par une forte charge polémique et émotionnelle qui fait obstacle à une héroïsation partisane.
En effet, dans le panthéon de la gauche socialiste, on compte Jean Jaurès (1859-1914), Léon Blum (1872-1950), et, de manière moins évidente, François Mitterrand. Jean Jaurès est célébré comme le grand pacifiste internationaliste, le socialiste républicain, le défenseur des ouvriers de Carmaux. Léon Blum, c’est le choix de l’exercice du pouvoir en démocratie, le Front populaire et ses conquêtes, le combat contre l’antisémitisme et contre Vichy. François Mitterrand est le socialiste qui a le plus longtemps exercé le pouvoir en France : quatorze ans à l’Elysée. Mais la complexité de son parcours l’empêche d’incarner le héros de gauche « idéal ». S’il a longtemps œuvré à contrôler le récit de son parcours, la fin de son dernier septennat et de sa vie est marquée par des révélations tant privées (sa maladie, sa fille cachée) que politiques – notamment la publication d’Une jeunesse française, par Pierre Péan, en 1994, qui révèle à beaucoup son passé durant la Seconde Guerre mondiale.
Trois dossiers principaux – la Seconde Guerre mondiale, la politique (néo)coloniale de la France en Afrique et le rapport au capitalisme – font, selon nous, obstacle à un rapport apaisé de la gauche à François Mitterrand.
Mitterrand et la Seconde Guerre mondiale
Le premier sujet problématique concerne les rôles que François Mitterrand joua durant la période vichyste : la photographie prise avec Pétain le 15 octobre 1942, sa décoration de la francisque en avril 1943, sa relation avec René Bousquet notamment agitent encore régulièrement la sphère éditoriale et médiatique, alors même que l’essentiel des faits est connu de longue date.

Né dans la bourgeoisie charentaise en 1916, François Mitterrand s’engage, étudiant, en politique dans la droite ultraconservatrice de la ligue des Croix-de-Feu du colonel de La Rocque. Mobilisé en 1940, fait prisonnier, il s’évade d’Allemagne, trouve un emploi par ses réseaux familiaux dans l’administration de Vichy, adhère à la Révolution nationale sans être antisémite. Puis il entre progressivement en résistance en 1943 par patriotisme anti-allemand et bascule totalement dans la Résistance en novembre 1943. À la Libération, il s’ancre progressivement et définitivement à gauche.
Beaucoup de ces éléments étaient connus de ses contemporains. L’historienne Noëlline Castagnez a montré que, dès les années 1950, les bancs de droite de l’Assemblée nationale bruissent de l’insulte « francisque Mitterrand » et que durant la campagne présidentielle de 1965, c’est de Gaulle lui-même qui choisit de ne pas se servir de cet élément pour ne pas affaiblir le mythe de la France résistante ou la Ve République. À côté des réécritures ou « recompositions » de Mitterrand lui-même, l’histoire des oublis et (re)découvertes de son passage par Vichy est donc aussi celle des arbitrages de ses alliés et adversaires.
Le choc de la publication d’Une jeunesse française, du journaliste Pierre Péan, en 1994, sera particulièrement fort pour les jeunes socialistes, percevant leur parti comme un rempart homogène contre l’extrême droite depuis les années 1930, élevés dans le mythe résistancialiste selon le terme d’Henry Rousso, et découvrant progressivement, comme l’opinion, l’existence de « vichysto-résistants ».
Ce passé mitterrandien est toujours entouré d’un halo sulfureux, car certains y voient le « péché originel » d’un homme dont le parcours militant est perçu comme insincère, structuré seulement par son ambition.
Mitterrand et le colonialisme
Le rôle de François Mitterrand dans la politique coloniale puis néocoloniale française est un deuxième obstacle mémoriel majeur à la pleine revendication de son héritage à gauche. Cet aspect de sa vie politique a, en effet, fait l’objet d’une percée historiographique et éditoriale dans les années 2024-2025 (avec les travaux d’Anne-Laure Ollivier et Frédéric Turpin, de Thomas Deltombe, de Pascal Blanchard et Nicolas Bancel). Si, à l’issue de ces travaux, de réelles nouveautés ont été mises en lumière, à l’image d’un récit de voyage en Afrique subsaharienne tenu par Mitterrand entre janvier et février 1950, et que nous avons édité, l’essentiel était connu pour qui s’intéressait à la question.
À lire aussi : François Mitterrand, à l’origine du déclin de l’influence postcoloniale de la France en Afrique ?
François Mitterrand avait notamment été ministre de la France d’outre-mer en 1950 et ministre de l’intérieur en 1954, c’est à ce titre qu’il déclare que « l’Algérie, c’est la France », formule alors plutôt consensuelle parmi les forces de gouvernement (et non slogan des ultras de l’Algérie française), puis garde des Sceaux en 1956-1957. Sa dureté à ce poste a notamment été mise en lumière par Benjamin Stora et François Malye en 2010.
L’actualité éditoriale mitterrandienne à ce sujet s’explique par la vivacité des questions mémorielles postcoloniales et par les avancées historiennes sur le rôle la France en Afrique, et notamment la remise en 2021 du rapport de la Commission Duclert sur « La France, le Rwanda et le génocide des Tutsi (1990-1994) ». Ministre colonial de 1950, leader d’un parti anticolonial en 1971, président du discours tiers-mondiste dit de Cancún en 1981 et chef d’État en responsabilité au moment du génocide des Tutsis en 1994 : le parcours de François Mitterrand peut être réduit par des militants déçus ou par des opposants à celui d’un homme fondamentalement de droite passé de colonial à néocolonial.
Les historiens, eux, tentent de contextualiser chacune de ces séquences et en soulignent les continuités de manière plus fine : en 1950, dans un monde politique où la décolonisation est une option très marginale, même à gauche, Mitterrand est un colonial réformiste et progressiste. Comme nous l’avons montré en 1971, il endosse assez peu le programme tiers-mondiste du PS, porté par des experts issus de la gauche chrétienne qui n’ont jamais totalement eu son attention. Ses grilles de lecture et alliances forgées à l’époque coloniale perdurent alors discrètement, sans que ce soit un sujet pour la majorité de l'électorat de gauche : le rapport des candidats au passé colonial français ne fut pas un enjeu de la campagne présidentielle de 1981.
Mitterrand et le capitalisme
Un troisième dossier nourrit négativement son bilan et alimente à gauche son procès en traîtrise : c’est celui de l’absence de rupture avec le capitalisme. C’est en effet sur cette idée forte, centrale dans la doctrine socialiste, qu’il conquiert la tête du PS, proclamant à la tribune du congrès d’Épinay en 1971 : « Celui qui n’accepte pas la rupture […] avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. »
Or à cette promesse, qui contribue à l’union de la gauche (1972-1977) et porte l’espoir et le vote de beaucoup à gauche en mai 1981, répond l’annonce très dramatisée du « tournant de la rigueur », le 21 mars 1983. À cette date, le franc est dévalué pour la troisième fois par les socialistes et maintenu dans le système monétaire européen (SME). Ce choix mitterrandien est vécu par certains comme celui de la raison et de l’Europe. Pour d’autres, il signe, par-delà le refus d’une « autre politique » monétaire, la fin du volontarisme social et économique socialiste, le triomphe « des marchés » et celui de l’Europe libérale. L’adoption du traité de Maastricht par référendum à une courte majorité, en septembre 1992, en dépit du fort engagement personnel de François Mitterrand, confirme cette prééminence européenne et libérale du cap présidentiel pour les déçus de 1983. Si la réalité économique et la chronologie de ce « tournant » ont été relativisées par les historiens, à l’instar de Frédéric Bozo qui dans un ouvrage récent revient sur cette « névrose nationale », ce moment reste particulièrement douloureux dans l’histoire de la gauche.
Si le bilan mitterrandien existe, par-delà 1983, (on songe par exemple à la création du revenu minimum d’insertion en 1988), le traumatisme ressenti à l’annonce du « tournant » introduit de fait une fracture qui sépare, d’une part, les grandes mesures de 1981-1982 (on citera pêle-mêle l’abolition de la peine de mort, les nationalisations, la 5ᵉ semaine de congés payés, la semaine de 39 heures, la décentralisation, la retraite à 60 ans, la réforme de l’audiovisuel, les lois Auroux) et, d’autre part, la rigueur, les cohabitations et un second septennat plus marquant sur le plan diplomatique qu’intérieur. À un temps « socialiste » s’opposerait ainsi un temps plus « gaullo-mitterrandiste », qui l’éloigne de la filiation de Jaurès et de Blum.
Le troisième président préféré des Français
En 2026, la peur du retour au pouvoir de l’extrême droite, la polarisation par celle-ci du débat public sur les questions postcoloniales, migratoires et identitaires, l’aggravation continue des crises économiques, politiques, européennes sont des enjeux face auxquels l’héritage mitterrandien ne semble pas le plus univoque et efficace pour la gauche et les socialistes contemporains. La dynamique d’« union de la gauche » qui a porté Mitterrand au pouvoir, au détriment de ses partenaires, n’offre pas non plus de modèle réactivable, au contraire du plus lointain et aussi plus fantasmé « front populaire ».
En 2021, un sondage Ifop classait François Mitterrand troisième président de la République préféré des Français. En tête du classement, de Gaulle, héros national et seul président à avoir fondé une famille politique se revendiquant de manière pérenne de son héritage. En second, le gaulliste Jacques Chirac, qu’une vague de nostalgie avait érigé dès les années 2010 en icône « swag » (stylé, cool), et dont la disparition en 2019 avait suscité une forte émotion. François Mitterrand arrivait cependant largement en tête parmi les sympathisants de gauche.
À l’image de la panthéonisation en 2025 de Robert Badinter, son ami et ministre, qui consacre une part de l’héritage socialiste et humaniste de 1981, on peut ainsi supposer que la mémoire militante, comme la mémoire nationale, continuera à exercer sur le bilan mitterrandien ce « droit d’inventaire » – revendiqué par Lionel Jospin dès 1995 et par François Hollande en 2009 – en sélectionnant ce qui peut, aujourd’hui encore, être rassembleur.
Judith Bonnin est l’autrice, avec Pierre-Emmanuel Guigo, de Mitterrand, à paraître le 13 janvier 2026 aux PUF_.
Judith Bonnin est experte pour la Fondation Jean-Jaurès, qui a financé la publication de sa thèse. Elle est membre du conseil scientifique de l'Institut François Mitterrand.
07.01.2026 à 17:58
Pourquoi reconstruisons-nous les monuments « à l’identique » ?
Texte intégral (2041 mots)

En 2019, la reconstruction de la charpente de Notre-Dame de Paris « à l’identique » des matériaux d’origine et de leur mise œuvre a été présentée comme une nécessité technique, historique et parfois même mystique. Or ce type d’attitude, relativement récente, mérite d’être interrogée en tant que fait culturel qui interroge le rapport de nos sociétés à leur histoire.
Fort de la mission qui lui avait été confiée par l’État dans les années 1830, le service des Monuments historiques fut pendant près de cent cinquante ans l’unique garant du patrimoine national.
Confronté aux dévastations de la Grande Guerre, il mit en place une doctrine de reconstruction des édifices ou parties d’édifices détruits qui fut reprise après la Seconde Guerre mondiale et se maintint inchangée jusqu’au milieu des années 1990. Il ne s’agissait pas de refaire les monuments « à l’identique » de ce qu’ils étaient avant la catastrophe, mais de leur redonner leur apparence originelle tout en les améliorant d’un triple point de vue, technique, archéologique et artistique.
Les charpentes furent par exemple reconstruites en béton armé pour des raisons d’économie, de facilité d’entretien et de résistance au feu. Le matériau pouvait aussi être utilisé pour renforcer des structures instables ou remplacer à moindre coût les maçonneries traditionnelles. À Rouen, la grande voûte en bois de la salle des procureurs du palais de justice, incendiée en mars 1944, fut reconstituée dans son apparence grâce à un voile mince de béton armé supportant à la fois un lambris de bois intérieur et la couverture extérieure en ardoises épaisses. La modification concernait l’ensemble de la structure de l’édifice : du fait de la poussée de la nouvelle voûte, trois fois plus lourde que l’ancienne, il fallut renforcer les fondations en sous-œuvre et forer l’épaisseur des murs pour y installer des tirants métalliques reliant la voûte, le plancher intermédiaire en béton et les fondations.
Retrouver un état de « référence »
Sur le plan archéologique, il était courant de supprimer des éléments considérés comme non pertinents, en particulier ceux du XIXᵉ siècle, une période dévalorisée de l’histoire de l’art. Le but était de retrouver un état de référence, souvent le plus ancien connu. Par exemple pour la reconstruction de l’église de Carignan (Ardennes) détruite en 1940, l’architecte en chef Yves-Marie Froidevaux choisit de revenir à l’état de 1681 en remplaçant la tour-porche du XIXe en pierre par un clocher en charpente de style classique.
Politiques de création
Enfin, la dernière amélioration concernait le domaine de la création. Si les éléments décoratifs répétitifs (corniches, garde-corps, décor géométrique ou végétal, modénature étaient refaits tels qu’ils étaient avant la catastrophe, ce n’était généralement pas le cas des éléments artistiques uniques, tels que tympans sculptés, chapiteaux, vitraux, mobilier. Leur remplacement était alors une occasion de faire appel à des créateurs contemporains.
Lors de la première reconstruction, des commandes furent passées auprès des artistes au cas par cas pour remplacer les éléments mobiliers détruits. Lors de la seconde, le service des Monuments historiques vit dans les destructions une opportunité de développer une politique de création dans les monuments anciens, en particulier dans le domaine du vitrail. L’intervention n’était pas uniquement réparatrice : les objets et vitraux du XIXe siècle, considérés comme inappropriés, étaient souvent supprimés, qu’ils soient endommagés ou non, au profit de créations neuves. La commande reposait sur une conception corporatiste : l’objectif était de créer une classe d’artisans spécialisés dans l’intervention en milieu patrimonial. Ce n’est qu’en 1955 que les commandes commencèrent à s’ouvrir à des artistes qui n’étaient pas aussi des maîtres-verriers, comme Jacques Villon (à Metz) ou Marc Chagall (à Reims).
Les dernières interventions sur les monuments endommagés par la seconde guerre mondiale datent du milieu des années 1980. À Rouen, la flèche de la tour Saint-Romain de la cathédrale fut reconstruite en 1984 avec une charpente en béton armé.
Incontestée, la reconstruction-amélioration s’appliquait à toutes sortes d’interventions, post-catastrophe ou non : la reconstitution des combles du Parlement de Bretagne à Rennes après l’incendie de 1994, la remise en état d’usage du château de Falaise (Calvados) à partir de 1997 ou de celui de Suscinio (Morbihan).
Nouvelles pratiques de reconstruction
Mais le milieu des années 1990 fut aussi celui de l’émergence de nouvelles pratiques de (re)construction, en dehors du champ d’action du service des Monuments historiques. Les interventions s’inspiraient des méthodes de l’archéologie expérimentale qui cherchait, par la reproduction du geste créateur, à mieux comprendre les artefacts originaux. À Saint-Sylvain-d’Anjou, une association initiée par le maire de la commune restitua un château à motte en bois de l’an mil à quelques du site originel afin de l’ouvrir à la visite. À Rochefort la reconstruction de la frégate l’Hermione débuta en 1992 avec un double objectif. Il s’agissait non seulement de refaire un objet à valeur mémorielle et patrimoniale, mais aussi de mettre en scène sa fabrication dans le cadre d’un chantier immersif ouvert au public.
La construction du château (imaginaire) de Guédelon qui débuta en 1997 reposait sur la même stratégie, mais avec une exigence supplémentaire dans le domaine de l’archéologie de la matière et du geste. Il s’agissait de retrouver les savoir-faire et les matériaux correspondant à la période de référence qui avait été choisie. Les interférences avec le présent étaient évacuées pour la science mais aussi pour le spectacle, avec par exemple des ouvriers vêtus de costumes médiévaux.
Le patrimoine-spectacle existait déjà : le premier son et lumière avait eu lieu à Chambord en 1950 avec un succès planétaire et de multiples avatars au fil du temps comme celui du Puy-du-Fou. Guédelon y ajoutait une dimension scientifique et son succès témoignait de la profondeur des attentes du public, qui n’était pas seulement consommateur de divertissement.
Les actuels chantiers de la charpente de la cathédrale de Paris et de la flèche de l’abbatiale de Saint-Denis sont dans la continuité de ce renversement des pratiques engagé dans les années 1990. La triple amélioration qui caractérisait les reconstructions suivant les deux guerre mondiales s’est évaporée. Dévalorisées, les techniques modernes sont considérées comme inappropriées au moment même où leur utilisation plus que centenaire aurait pu en démontrer la pertinence économique et structurelle.
Quant à l’amélioration créative, elle paraît désormais anachronique comme le montre le procès intenté à l’encontre de l’insertion de vitraux contemporains à Notre-Dame de Paris voulue par le président de la République. Appliquant les leçons de Rochefort et Guédelon, les deux chantiers parisiens convoquent science et spectacle. Il s’agit tout autant de retrouver l’apparence ancienne que de s’assurer du geste et de la matière ancienne, sous le regard du public qui est invité à suivre l’avancement des travaux, sur site (à Saint-Denis) ou en différé (à Paris) par médias interposés. Enfin l’équilibre économique est assuré de la même manière, par les dons et les recettes du chantier-spectacle.
La reconstruction de tout ou partie du patrimoine disparu a-t-elle trouvé un nouveau départ ? Le patrimoine-spectacle, qui est aussi patrimoine-science a trouvé son public, mais il ne s’applique qu’à des édifices iconiques de l’histoire nationale. Peut-être marque-t-il la fin de cette expansion patrimoniale dénoncée par les experts dans les années 1990, de l’historienne Françoise Choay, qui y voyait le signe d’un « narcissisme collectif », au directeur de l’architecture et du patrimoine François Barré qui s’inquiétait de l’abus patrimonial. Quoiqu’il en soit, le patrimoine-spectacle-et-science peut dès maintenant être érigé en emblème du champ culturel patrimonial des années 2020.
Cet article est publié dans le cadre de la série « Regards croisés : culture, recherche et société », publiée avec le soutien de la Délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle du ministère de la culture.
Patrice Gourbin ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
07.01.2026 à 17:56
Microcapteurs pour suivre la qualité de l’air : gadgets ou véritables outils de suivi ?
Texte intégral (2994 mots)
Le suivi de la qualité de l’air s’est grandement démocratisé grâce à l’essor de microcapteurs électroniques accessibles à tout un chacun. Ces dispositifs sont-ils performants, et à quelles conditions peuvent-ils fournir une information utilisable ? État des lieux.
La pollution de l’air extérieur peut être liée au trafic routier, au chauffage au bois, aux activités industrielles ou encore aux feux de forêt et aux éruptions volcaniques. La diversité des particules qui en résulte illustre bien la nature diffuse et mobile de cette pollution. Celle-ci a des conséquences graves en termes d'effets sur la santé, allant des troubles respiratoires immédiats à des maladies chroniques incurables.
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la pollution de l’air, tous polluants confondus, est responsable de 7,4 millions de décès par an dans le monde dont 4,2 millions liés à l’air extérieur et 3,2 millions à l’air intérieur. En France, le fardeau sanitaire des particules fines entraînerait à lui seul 40 000 décès chaque année, et est associés à un coût socio-économique estimé à 13 milliards d’euros.
Aujourd’hui, suivre la qualité de l’air auquel chacun est exposé n’a jamais été aussi simple. En quelques clics, il devient possible d’acheter des microcapteurs, d’accéder à des cartes en ligne ou de télécharger des applications mobiles fournissant un accès à ces données en temps réel. Tout comme la météo guide le choix de prendre un parapluie, cet accès offre aujourd’hui aux citoyens et aux décideurs un outil pratique pour orienter leurs actions.
Pourtant, derrière cette démocratisation, se pose la question de la performance de ces microcapteurs opto-électroniques. S’agit-il vraiment de sentinelles de confiance ? Faisons le point.
À lire aussi : Le potentiel oxydant : un nouvel indice pour mesurer la pollution atmosphérique
Des microcapteurs dans l’air du temps
Commençons par rappeler comment est menée la surveillance réglementaire de la qualité de l’air en France. Elle est coordonnée par le Laboratoire central de surveillance de la qualité de l’air (LCSQA) et mise en œuvre au niveau régional par les associations agréées pour la surveillance de la qualité de l’air (AASQA). Les données, librement accessibles grâce au site régional des AASQA, sont produites selon des protocoles normés afin de s’assurer qu’elles soient comparables d’une station de mesure à l’autre et d’une région à l’autre.

Toutefois, le nombre de stations de mesure mises en place résulte d’un compromis entre couverture géographique et coûts. La modélisation, basée sur les modèles Chimere ou Sirane par exemple, permet d’extrapoler la qualité de l’air sur un territoire donné, mais elle reste dépendante de la qualité et du nombre des mesures locales.
Afin de renforcer la couverture sans augmenter les coûts, la directive européenne, dont la réglementation française découle, autorise les réseaux de surveillance réglementaire à procéder à des mesures indicatives, pour lesquelles les exigences de qualité sont plus souples. Ce cadre favorise l’intégration des microcapteurs de 10 à 100 fois moins coûteux que les équipements utilisés pour les stations de référence, tant à l'achat qu’en fonctionnement.
Ce marché a le vent en poupe. En 2023, il pesait plus de 6 milliards d’euros, marché qui pourrait s’élever en 2032 à 13,5 milliards. En 2022, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) dénombrait 60 000 références produits disponibles sur les plateformes de vente en ligne.
On y retrouve donc des microcapteurs à bas coût prêts à l’emploi capables de collecter et de transmettre les données en temps réel. Le prix des composants se limite à quelques dizaines d’euros, tandis que le coût total du dispositif varie d’environ une centaine à plusieurs milliers d’euros selon les fonctionnalités.
Une mesure facile, mais une interprétation parfois délicate
Que valent ces différents types de microcapteurs ? Pour le savoir, il faut d’abord définir ce que l’on souhaite mesurer lorsqu’on parle de particules fines. Loin d’être un mélange défini, les particules dans l’air forment un ensemble hétérogène et variable par leur forme, leur taille et leur état.
Trois catégories se distinguent :
les hydrométéores (pluie, neige, brouillard),
les aérosols (suie, poussières, embruns, composés organiques…)
et les bioaérosols (pollens, bactéries, virus, spores…).
Par convention, la matière particulaire en suspension (ou Particulate Matter, PM) est décrite en fonction de la taille de ses constituants, dans lesquels les hydrométéores doivent être exempts. Ainsi, par convention, les particules grossières PM10, les particules fines PM2,5 et les particules ultrafines PM0,1 représentent respectivement des ensembles hétérogènes de taille inférieure ou égale à 10, 2,5 et 0,1 micromètre (µm).
Plus les particules sont petites, plus elles sont susceptibles de pénétrer profondément dans les voies respiratoires. Les PM1,0 peuvent être également suivies par des microcapteurs et des équipements de référence, mais elles ne font pas l’objet d’une réglementation spécifique ni ne sont associées à des seuils sanitaires!
À lire aussi : Freinage et particules fines : une pollution routière oubliée des évolutions réglementaires ?
Or, les microcapteurs bas coût pour le suivi des particules, dont la mesure est basée sur leur comptage grâce à un principe optique, sont sensibles aux conditions environnementales et aux caractéristiques des particules, ce qui fragilise les performances. Leur fonctionnement repose sur la diffusion de la lumière par le passage d’une particule à travers un faisceau laser. Il s’agit du même principe qui rend visible un rayon lumineux dans la fumée. L’intensité détectée dans une direction donnée dépend de la taille, de la forme, de la composition et de l’orientation des particules.
Il faut également noter que ces microcapteurs sont calibrés avec des particules de polystyrène, loin de refléter l’hétérogénéité réelle de la pollution de l’air extérieur. S’ajoutent à cela leur encrassement et leur vieillissement, qui dégradent les performances dans le temps. L’interprétation des données exige donc une connaissance fine de ces limites.
Des données précieuses… mais sous conditions
Pour autant, les microcapteurs ne sont pas à exclure. En effet, en cas d’épisode de pollution, ils détectent les mêmes tendances que les stations réglementaires, justifiant leur usage pour des mesures indicatives.
Pour s’y retrouver, les organismes pour la surveillance de la qualité de l’air ont mené des évaluations en confrontant les microcapteurs aux équipements réglementaires. Accessibles en ligne, les résultats du challenge Airlab (Airparif, France) et de l’AQ-SPEC (South Coast AQMD, États-Unis) révèlent des corrélations satisfaisantes entre microcapteurs et ces équipements pour les PM1,0 et PM2,5. En revanche, elles sont moins bonnes pour les PM10 , car la conception des microcapteurs et le principe de la mesure ne permettent pas de bien les détecter.
Ces microcapteurs peuvent être achetés autant par des citoyens, des collectivités, des industriels, des associations ou des chercheurs. Tous ces acteurs peuvent publier leurs données sur des cartes interactives, ou y contribuer ponctuellement.
Il existe des cartes qui affichent les mesures de leurs propres microcapteurs, comme des projets associatifs et locaux tels que OpenSenseMap, Sensor.community ou SmartCitizen, ainsi que systèmes commerciaux déployés à plus grande échelle tels que AirCasting, AirGradient, Atmotube, ou Purple Air.
D’autres services, comme le World Air Quality Index ou IQAir, agrègent les données autant de microcapteurs que des réseaux réglementaires.
Contrairement aux cartes des AASQA, qui sont comparables entre elles grâce à des protocoles stricts, chaque plateforme adopte sa propre présentation.
Il est donc essentiel de bien comprendre l’information affichée : les points de mesure peuvent fournir une information visuelle qui représente une concentration (Atmotube par exemple) ou un indice de qualité de l’air (IQAir par exemple) avec un jeu de couleurs propre aux plate-formes comme des données chiffrées sans repère pour interpréter la donnée (OpenSenseMap par exemple). De plus, selon les plateformes, une même carte peut afficher tout un ensemble d’indicateurs de pollution de l’air, pas seulement ceux liés à un polluant spécifique comme les particules.

Par ailleurs, peu de plateformes précisent si les mesures sont faites en intérieur, en extérieur, en mobilité ou en point fixe. De plus, une donnée en temps réel et une donnée moyennée sur une période donnée ne sont pas comparables. De ce fait, pour une même zone géographique, la qualité de l’air affichée peut varier d’une plateforme à l’autre, selon l’emplacement de la mesure, l’indicateur utilisé et la période considérée. En France, les données des AASQA restent la référence pour une information de confiance.
Les microcapteurs n’en restent pas moins des sentinelles utilisables sous réserve d’une excellente maîtrise de leurs limites. L’utilisation individuelle de microcapteurs par le grand public peut être encadrée par un protocole rigoureux pour assurer la qualité des données et accompagner leur interprétation. Le projet d’OpenRadiation, qui porte sur la mesure de la radioactivité, en est un exemple : lorsqu’une mesure faite par l’utilisateur d’un microcapteur apparaît inhabituelle sur la carte, un gestionnaire contacte alors ce contributeur pour comprendre l’origine de cette déviation. La cartographie de la qualité de l'air s'appuie sur une plus grande quantité de microcapteurs, ce qui rend plus difficile un suivi individualisé. Néanmoins, une validation des données à l’instar de ce qui est réalisé pour le suivi réglementaire pourrait être envisagée à l’aide d’un traitement adapté, avec un filtrage par exemple.
Ainsi, comme en témoignent la Captothèque (Atmo Auvergne-Rhône-Alpes) ou Ambassad’air (Rennes), programmes de sciences participatives basés sur la mesure citoyenne de la qualité de l’air, les microcapteurs peuvent non seulement fournir des indications, mais aussi contribuer à l’engagement citoyen pour l’observation environnementale.
À lire aussi : Ces citoyens qui mesurent la radioactivité de leur environnement
Marie Bellugue Duclos a reçu des financements du CNRS pour sa thèse. Elle utilise des micro-capteurs pour ses recherches.
Denis Machon a reçu des financements du CNRS et de l'ANR (France), du CRSNG (Canada) et du FRQ (Québec).
Michael Canva a reçu des financements du CNRS et de l’ANR (France), du CRSNG (Canada) et du FRQ (Québec).
07.01.2026 à 17:54
Pourquoi la procrastination n’a rien à voir avec la paresse – et comment la surmonter
Texte intégral (1610 mots)
Procrastiner ne veut pas dire que l’on manque de force de caractère. Cela tient plutôt à la capacité de notre cerveau à gérer le stress et à un manque de flexibilité. La bonne nouvelle, c’est que la souplesse nécessaire pour la surmonter peut s’acquérir.
La plupart d’entre nous ont déjà vécu cette situation : une échéance approche, la tâche est parfaitement réalisable, mais, au lieu de nous y mettre, nous nous sentons soudainement obligés de ranger un tiroir ou de réorganiser les applications sur notre téléphone. La procrastination peut sembler irrationnelle, vue de l’extérieur, mais il est difficile d’y résister quand on y est soi-même confronté. Bien qu’elle soit souvent considérée comme un manque de discipline, des recherches montrent qu’elle est bien plus liée à la flexibilité (ou à la rigidité) avec laquelle notre cerveau réagit à l’inconfort et à l’incertitude.
En d’autres termes, la procrastination n’est pas un problème de gestion du temps, mais un problème de régulation des émotions. Les gens ne retardent pas les choses parce qu’ils manquent de compétences de planification, mais parce que leur cerveau cherche à échapper à un état intérieur émotionnel difficile. Lorsque je demande à mes étudiants pourquoi ils procrastinent, leurs réponses sont étonnamment similaires : « Je ne sais pas par où commencer », « Je me sens perdu », « Je suis anxieux », « Je me sens dépassé ». Aucun d’entre eux ne dit « Je m’en fiche » : la procrastination vient généralement du fait que l’on se soucie trop des choses.
Surtout, le phénomène d’évitement empêche le cerveau de se rendre compte d’une réalité importante : commencer une action est souvent gratifiant. Le premier pas, aussi petit soit-il, suffit à libérer de la dopamine. Cela aide à augmenter la motivation après – et non, avant – avoir commencé. Mais lorsque nous évitons de nous confronter à la tâche en question, nous ne ressentons jamais ce signal de récompense, et elle va continuer à nous sembler tout aussi intimidante le lendemain.
Flexibilité cognitive
La flexibilité cognitive est la capacité à actualiser ses attentes lorsque les circonstances changent, à modifier sa stratégie et à s’affranchir des schémas inefficaces. C’est un élément fondamental de l’apprentissage : le cerveau fait des prédictions, reçoit de nouvelles informations et s’adapte en conséquence.
Imaginez que vous attendiez un bus coincé dans les embouteillages. Une personne flexible changera rapidement d’itinéraire pour emprunter la ligne de métro qui, si elle correspond habituellement à un trajet plus long, permettra désormais d’aller plus vite. Une personne rigide continuera d’attendre, non pas parce qu’elle ignore qu’il existe une alternative, mais parce que changer d’itinéraire lui semble difficile ou « injustifié », et que son esprit reste figé sur son choix initial.
Je constate clairement ce schéma dans mes recherches sur le trouble obsessionnel compulsif (TOC). Bien que très différent de la procrastination, ce phénomène implique une difficulté à s’écarter d’une prédiction initiale, en particulier lorsqu’il y a incertitude ou risque d’erreur. Lorsque le cerveau ne parvient pas à actualiser ses informations, il reste focalisé sur une idée.
Les étudiants d’aujourd’hui sont confrontés à une véritable tempête. Les téléphones et les réseaux sociaux réduisent leur capacité d’attention. Le perfectionnisme amplifie l’autocritique. Et l’anxiété atteint des niveaux records dans les universités britanniques. Conjugués, ces facteurs affaiblissent la capacité du cerveau à s’adapter, ce qui est précisément la capacité nécessaire pour entreprendre une tâche difficile.
Du point de vue des neurosciences, la procrastination représente un bras de fer entre deux systèmes. D’un côté agissent des mécanismes de défense, activés lorsqu’une tâche semble incertaine, difficile ou évaluative. Cela donne lieu à des pensées telles que « Et si c’était terrible ? », « Et si j’échouais ? » De l’autre intervient le système de récompense, activé par tout ce qui procure un sentiment de bien-être immédiat (faire défiler son fil d’actualité, ranger, envoyer des messages à ses amis).
Lorsque les mécanismes de défense dominent, il peut être impossible de se mettre au travail. Pour les esprits rigides, en particulier, le cerveau a du mal à revenir sur sa prédiction initiale selon laquelle la tâche constitue un danger ou s’avère insurmontable. L’évitement devient alors la seule option possible, et le petit soulagement qui est alors ressenti incite le cerveau à répéter ce comportement.
En effet, des recherches montrent que la procrastination est essentiellement un remède à court terme pour améliorer l’humeur : une échappatoire rapide à un malaise, qui génère elle-même davantage de stress par la suite.
Il y a une génération, procrastiner exigeait de la créativité. Il fallait trouver des distractions. Aujourd’hui, ce sont elles qui vous trouvent. Les réseaux sociaux sont conçus pour déclencher une recherche de nouveauté stimulée par la dopamine. Pour quelqu’un qui est déjà anxieux ou surchargé, le téléphone devient une échappatoire omniprésente. Comme l’a dit un étudiant : « Il est plus facile de ne pas faire le travail. » Non pas parce que le travail n’a pas d’importance, mais parce que l’alternative qui lui est proposée offre une récompense instantanée.
La flexibilité peut se travailler
Alors, comment éviter la procrastination ? Il ne s’agit pas de devenir plus discipliné, mais plutôt de renforcer les systèmes cérébraux qui vous permettent de vous mettre au travail. Voici quelques moyens d’y parvenir.
Décomposez les tâches
Divisez le travail en unités concrètes et gérables : rédigez un titre, rédigez quelques points clés ou lisez une page. Cela réduit la menace perçue d’une tâche importante et sans contours bien définis, et cela procure au cerveau de petites récompenses régulières sous forme de dopamine à chaque étape franchie.
Misez sur les micro-changements
Les micro-changements sont de minuscules actions initiatrices : ouvrir le document, poser vos notes sur le bureau. Ils ne réduisent pas la tâche elle-même, mais ils interrompent l’état de « blocage » et incitent doucement le cerveau à se mettre en mouvement.
Changez de perspective
Recadrez la tâche comme si vous conseilliez quelqu’un d’autre : « Que dirais-je raisonnablement à un ami dans cette situation ? » Cela assouplit la pensée rigide et axée sur la menace et aide le cerveau à générer des interprétations alternatives plus souples.
Développez votre tolérance émotionnelle
Le malaise lié au démarrage atteint rapidement son apogée, puis diminue. Se le rappeler peut rendre l’évitement moins irrésistible.
Accordez-vous des récompenses immédiates
Associez la tâche à quelque chose d’agréable (de la musique, une boisson chaude ou le fait de travailler avec d’autres personnes) afin que la première étape soit moins pénible et plus gratifiante.
Ensemble, ces stratégies renforcent la forme de flexibilité cognitive la plus pertinente pour affronter la procrastination : la capacité à passer de l’évitement à l’action lorsqu’une tâche semble inconfortable. D’autres formes de flexibilité cognitive (telles que le changement de règle ou la flexibilité motrice) peuvent également être améliorées, mais grâce à différents types d’entraînement.
Si vous vous reconnaissez dans les étudiants qui se disent « anxieux », « dépassés » ou « ne sachant pas par où commencer », cela ne signifie pas que vous êtes paresseux. Cela signifie simplement que votre cerveau a du mal à changer d’état. La procrastination en dit beaucoup moins sur la volonté que sur la façon dont notre esprit gère l’incertitude et l’inconfort.
Et ce qui est encourageant, c’est que la procrastination n’est pas immuable. La flexibilité s’améliore avec la pratique. Chaque fois que vous faites un pas, même minime, comme ouvrir le fichier ou écrire la première ligne, vous ne vous contentez pas de progresser dans la tâche. Vous montrez à votre cerveau que commencer est faisable, supportable et souvent gratifiant.
Au fil du temps, ces petits changements s’accumulent pour produire quelque chose de puissant : un esprit capable de se diriger vers ce qui compte, plutôt que de fuir l’inconfort.
Annemieke Apergis-Schoute a reçu un financement du Wellcome Trust pour ses précédentes recherches sur les TOC.
07.01.2026 à 15:01
Le Groenland, le Danemark et l’UE au défi de l’ordre trumpien : la doctrine Monroe en marche
Texte intégral (2673 mots)
Alors que l’attaque sur le Venezuela vient de confirmer la détermination des États-Unis à user de la force pour contrôler l’ensemble du continent américain, au détriment du droit international, l’avenir du Groenland, également dans la ligne de mire de Washington, requiert une attention accrue de la part de l’Europe.
« L’attaque contre le Venezuela est l’exemple effrayant d’un scénario où la politique de puissance prend le dessus. Nous ne savons pas encore ce qui se passe et où nous allons. Mais nous devrons tous réfléchir à notre vision du monde et prendre position. » Ce message posté sur LinkedIn (en danois) par la ministre groenlandaise de l’économie, du commerce, des minéraux et de la justice Najaa Nathanielsen traduit bien l’inquiétude qui règne à Nuuk, et qui s’est encore amplifiée depuis les événements du 3 janvier 2026 à Caracas. De son côté, la première ministre danoise Mette Frederiksen s’est alarmée :
« Si les États-Unis choisissent d’attaquer militairement un autre pays de l’Otan, alors c’est la fin de tout. »
Les menaces états-uniennes sur le Groenland, exprimées dès le retour au pouvoir de Donald Trump il y a un an, se sont nettement intensifiées au cours de ces dernières semaines, notamment avec la nomination, le 22 décembre 2025, d’un « envoyé spécial pour le Groenland » en la personne du gouverneur de Louisiane Jeff Landry. Celui-ci décrit ouvertement sa mission comme étant l’annexion du Groenland aux États-Unis (« make Greenland a part of the U.S. »).
La nomination témoigne, sans surprise, de la ténacité du président états-unien en ce qui concerne son projet d’annexion du territoire danois. L’accent mis par Donald Trump et par Jeff Landry sur l’histoire de la Louisiane, vendue par la France en 1803 aux États-Unis, dont elle représentait alors plus de 22 % de la surface, reflète – là aussi sans surprise – la logique transactionnelle de la politique promue par l’administration Trump, une logique de marché qui s’immisce sans complexe dans le domaine de la sécurité internationale.
Mais le Groenland est-il réellement, pour les États-Unis, une affaire de « sécurité nationale et internationale » qui justifierait son annexion ? Et si non, quelles sont les ambitions réelles de Washington ?
Créer la division entre le Groenland et le Danemark
Coutumier des fausses allégations, Donald Trump conteste de nouveau la souveraineté danoise sur le Groenland : « [Il y a trois cents ans], nous aussi étions là, avec des bateaux, j’en suis sûr. » Or la souveraineté danoise sur le Groenland ne fait aucun doute. Elle a été statuée par la Cour permanente de justice internationale en 1931 et officiellement reconnue par les États-Unis en 1951. Aucun changement sur le statut de l’île ne peut se faire sans l’accord du Danemark, conformément à l’accord de 2009 entre le Danemark et le Groenland sur l’autonomie du territoire groenlandais.
Lorsque, le 7 janvier 2025, Mette Frederiksen répond à la proposition américaine d’achat du Groenland que l’avenir de l’île appartient aux Groenlandais, la réponse ménage le Groenland mais elle est incomplète. Le Groenland est toujours danois, et un vote du Parlement danois, le Folketing, est notamment requis pour une éventuelle accession à l’indépendance. Donald Trump joue à dessein de l’histoire coloniale entre le Danemark et le Groenland pour écarter un acteur clé de la situation – qui plus est, État membre de l’Union européenne.
De même, il est faux de prétendre que le gouvernement danois n’a engagé aucune dépense pour la défense du Groenland, comme le Trump l’affirme. Certes, jusqu’à récemment, la participation danoise était modeste (présence du Joint Arctic Command à Nuuk, de patrouilleurs et frégates et de la patrouille en traîneau à chiens Sirius couvrant la côte nord du Groenland). « Nous pouvons faire plus dans le cadre qui existe aujourd’hui », assurait en 2025 le ministre danois des affaires étrangères Lars Løkke Rasmussen. Deux programmes de défense ont été approuvés en 2025 par le Danemark pour un montant total avoisinant 6 milliards d’euros, et Copenhague a également approuvé une commande de 16 avions de combat américains F35 : la bonne volonté danoise ne suffit pas visiblement à calmer les ardeurs conquérantes de Washington.
La guerre de récits engagée par les États-Unis en soutien du projet d’annexion du Groenland n’est pas anodine. Elle cherche à ancrer dans les esprits le doute sur la légitimité de la souveraineté du Danemark et, en jouant sur son passé colonial, à créer la division entre le Groenland et le Danemark. Un autre aspect du discours de Washington est la surestimation de la menace militaire russe et chinoise au Groenland.
Des risques surdimensionnés pour justifier l’annexion du Groenland
Sur le plan de la sécurité, Donald Trump a, à plusieurs reprises, mentionné la présence de navires militaires russes et chinois autour du Groenland. Il s’agit d’une contre-vérité : les navires en question ont été repérés au large des côtes de l’Alaska.
La projection de puissance de la marine russe dans la zone d’étranglement GIUK (zone maritime entre le Groenland, l’Islande et le Royaume-Uni) est problématique et motive notamment les opérations Northern Viking de l’Otan. Elle est également redoutée au Groenland en ce qui concerne les infrastructures critiques (notamment les câbles sous-marins de télécommunications). Les risques en matière de sécurité ne sont donc pas nuls, d’autant que la Chine renforce sa puissance militaire dans le monde et, notamment, sa capacité en porte-avions.
Pour autant, s’il est important d’exercer un contrôle du territoire groenlandais, il n’y a pas de risque militaire significatif immédiat pour le Groenland qui justifierait son annexion par les États-Unis. Le risque est volontairement exagéré par Donald Trump afin de légitimer l’appropriation du Groenland, à laquelle le Groenland et le Danemark s’opposent.
Au-delà de la rhétorique et des fausses allégations, répétées à l’envi, les menaces de Washington sont à prendre au sérieux, car elles s’accompagnent de mesures concrètes et plus discrètes.
Dans leur rapport annuel de 2025, les services de renseignement danois ont, pour la première fois, fait état d’inquiétudes concernant les États-Unis. Le Danemark, historiquement l’un des plus atlantistes des pays européens, prend ses distances avec Washington.
Un expansionnisme au service d’intérêts bien pensés
En réalité, l’administration Trump est moins concernée par les questions de sécurité (même s’il s’agit de son argument officiel) que par un expansionnisme réactivant la doctrine Monroe, qui revendique un contrôle américain exclusif de l’« hémisphère occidental ». La nouvelle stratégie nationale de sécurité des États-Unis remet clairement au goût du jour cette doctrine (« Nous appliquerons un “corollaire Trump” à la doctrine Monroe », y est-il indiqué).
Cet expansionnisme de circonstance à l’approche des élections de mi-mandat promet de frapper fort. Annexer le Groenland est sans doute plus flatteur pour les ambitions du locataire de la Maison Blanche que renforcer des partenariats de défense pour des besoins non avérés, d’autant qu’il a clairement affirmé que les Européens devraient, dans le futur, assurer leur sécurité eux-mêmes.
Or, si la stratégie nationale de sécurité de 2025 peut très bien être « la plus longue note de suicide de l’histoire des États-Unis », pour reprendre les termes de l’historienne Anne Applebaum, elle n’en représente pas moins un danger immédiat pour l’Europe où, dans un renversement surréel, la démocratie et le supranationalisme sont non seulement décrits par l’administration Trump comme des menaces, mais plus encore comme des périls plus dangereux que les régimes autoritaires de la Russie ou de la Chine.
Contrairement aux affirmations de Trump, qui prétend que les États-Unis ne sont pas intéressés par les richesses minérales de l’île (« Nous avons tellement de sites pour les minéraux, le pétrole et tout le reste »), les investissements américains se développent au Groenland. Ronald Lauder, l’héritier milliardaire d’Estée Lauder qui aurait été le premier à avoir suggéré à Donald Trump l’idée d’« acheter » le Groenland, a pris des participations dans des entreprises groenlandaises et a manifesté son intérêt pour la construction d’une centrale hydroélectrique sur le plus grand lac du Groenland, Tasersiaq, afin d’alimenter en énergie une fonderie d’aluminium.
Des responsables de l’administration Trump seraient en pourparlers pour que le gouvernement états-unien prenne une participation dans l’entreprise américaine privée Critical Metals Corp, qui détient l’un des plus grands projets d’exploitation de terres rares au Groenland, Tanbreez. Cette opération donnerait aux États-Unis un accès direct à l’extraction de terres rares au Groenland, alors que la Chine détient le quasi-monopole mondial de leur extraction et raffinement.
Enfin, des rétorsions économiques visant des industries danoises ont déjà été mises en place : des contrats pour cinq projets éoliens offshore sur la côte est des États-Unis ont été suspendus, dont deux sont développés par la société danoise Ørsted.
Une réponse groenlandaise, danoise et européenne
Il est donc urgent d’adopter des mesures groenlandaises, danoises mais aussi européennes. Le premier ministre du Groenland Jens-Frederik Nielsen a clairement exprimé à Strasbourg, le 8 octobre 2025 devant le Parlement européen, son ouverture à une coopération plus approfondie avec l’UE :
« Nous avons besoin de coopération et de partenariats avec des pays et des institutions qui partagent nos valeurs. »
Le 6 janvier 2026, dans un message posté sur son compte Facebook, il remercie plusieurs États européens de leur soutien face aux menaces de Washington : les dirigeants de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, de la Pologne, de l’Espagne, mais aussi du Royaume-Uni, ont déclaré qu’« il revient au Danemark et au Groenland, et à eux seuls, de décider des questions concernant le Danemark et le Groenland », et que « la sécurité dans l’Arctique doit donc être assurée collectivement, en coopération avec les alliés de l’Otan, y compris les États-Unis. »
Trois points sont donc saillants. Premièrement, sur le plan narratif, l’affirmation de la souveraineté du Danemark sur le Groenland ne se fait pas au détriment de l’autodétermination du peuple groenlandais, mais elle protège pour l’instant le Groenland d’une OPA américaine sur un territoire qui a bien, selon le droit danois, et en conformité avec le droit international, la capacité de décider de son futur selon les termes de l’accord d’autonomie de 2009.
Deuxièmement, sur le plan économique, une interdépendance trop forte avec les États-Unis peut déboucher sur une vulnérabilité politique et mettre en péril la démocratie au Groenland. Les Groenlandais ont déjà adopté des mesures claires de protection : le Parlement (Inatsisartut) a notamment voté en urgence en février 2025 une loi sur le financement des partis politiques, qui interdit les dons étrangers ou anonymes aux partis et aux candidats, et qui plafonne les contributions privées à l’échelle locale. Le Parlement examine en ce moment un projet de loi sur le filtrage des investissements directs étrangers visant à permettre aux autorités d’examiner, d’approuver, de conditionner ou de bloquer les investissements étrangers susceptibles de constituer une menace pour la sécurité nationale ou l’ordre public. L’UE s’est dotée d’un instrument similaire en 2019.
Troisièmement, en matière de sécurité, il est essentiel de penser une coopération européenne au bénéfice du Groenland et en accord avec le Danemark, une coopération qui peut dans un premier temps prendre la forme d’un dialogue stratégique régulier sur la sécurité et la résilience dans l’Arctique entre l’UE, le Groenland et le Danemark – et ce, sans attendre les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis.
Ce dialogue stratégique aurait pu commencer dès le début de l’année 2025. Mais les menaces de Washington n’ont pas été prises au sérieux, et un retard considérable a été pris. Il n’est pas sûr que la proposition des pays européens d’une réponse dans le cadre de l’Otan soit suffisante pour convaincre les États-Unis de renoncer à la force pour annexer le Groenland. Il est donc urgent de comprendre que l’UE doit avoir le courage de repenser sa relation avec les États-Unis, et de se penser et de s’affirmer sans détour comme puissance.
Cécile Pelaudeix ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
07.01.2026 à 11:49
Éditer le génome pour soigner : où en sont les thérapies issues de CRISPR et ses dérivés ?
Texte intégral (1679 mots)
Ce qui ressemblait hier encore à de la science-fiction est désormais une réalité clinique : l’édition du génome humain avec CRISPR-Cas9 commence à guérir des maladies jusque-là incurables. Mais où en est réellement cette révolution annoncée ? Entre premiers succès cliniques, limites techniques et questions éthiques persistantes, les thérapies issues de CRISPR dessinent un paysage où promesses et prudence sont désormais indissociables.
Nous assistons à une nette montée des espoirs pour des maladies rares, souvent « orphelines ». Par exemple, un nourrisson atteint d’un déficit métabolique rare (une maladie génétique dans laquelle une enzyme ou une voie métabolique essentielle ne fonctionne pas correctement) dû à une mutation sur le gène CPS1, a reçu en 2025 un traitement « sur mesure » utilisant la technique d’édition de base (base editing), avec des résultats biologiques encourageants.
Aujourd’hui, l’édition génique n’est plus une hypothèse lointaine, mais donne des résultats concrets et change déjà la vie de certains patients. Pour comprendre ce qui est en train de se jouer, il faut revenir sur les progrès fulgurants de ces dernières années, des premiers essais pionniers aux versions de plus en plus sophistiquées de l’édition génomique.
Développée en 2012 grâce à l’association d’une endonucléase, Cas9, et de petits ARN guides (sgRNA), cette méthode d’édition ciblée du génome a bouleversé la biologie moderne, au point de valoir à ses inventrices le prix Nobel de chimie en 2020. Depuis son invention, le CRISPR-Cas9 classique est largement utilisé dans les laboratoires, dont le nôtre, pour créer des modèles cellulaires de maladies, fabriquer des cellules qui s’illuminent sous certaines conditions ou réagissent à des signaux précis, et explorer le rôle de gènes jusqu’ici mystérieux.
Un premier système extraordinaire mais imparfait
Côté clinique, l’utilisation de CRISPR-Cas9 a ouvert des possibilités thérapeutiques inédites : modifier précisément un gène, l’inactiver ou en corriger une version défectueuse, le tout avec une simplicité et une rapidité jusqu’alors inimaginables. Mais cette puissance s’accompagnait alors de limites importantes : une précision parfois imparfaite, avec des coupures hors-cible difficiles à anticiper (des modifications accidentelles de l’ADN réalisées à des endroits non prévus du génome), une efficacité variable selon les cellules, et l’impossibilité d’effectuer des modifications plus fines sans induire de cassure double brin (une rupture affectant les deux brins d’ADN à un site génomique spécifique) potentiellement délétère.
Ces limites tiennent en grande partie au recours obligatoire aux cassures double brin et à la réparation par homologie (mode de réparation de l’ADN dans lequel la cellule s’aide d’une séquence d’ADN modèle très similaire – ou fournie par le chercheur – pour réparer une cassure double brin), un mécanisme peu fiable et inégal selon les types cellulaires. Mais la véritable rupture est apparue à partir de 2016 avec l’invention des éditeurs de base (base editors), des versions ingénieusement modifiées de CRISPR capables de changer une seule lettre de l’ADN sans provoquer de cassure double brin. Pour la première fois, il devenait possible de réécrire le génome avec une précision quasi chirurgicale, ouvrant la voie à des corrections plus sûres et plus fines que celles permises par Cas9 classique. Cependant, les base editors restaient limités : ils permettaient d’effectuer certaines substitutions de bases, mais étaient incapables de réaliser des insertions ou des modifications plus complexes du génome.
Ces limitations des base editors ont été en partie levées avec l’arrivée de leurs successeurs, les prime editors, en 2019 : ces nouvelles machines moléculaires permettent non seulement de substituer des bases, mais aussi d’insérer ou de supprimer de courtes séquences (jusqu’à plusieurs kilobases), le tout sans provoquer de cassure double brin, offrant ainsi un contrôle beaucoup plus fin sur le génome. Cette technique a été utilisée avec succès pour créer en laboratoire des modèles cellulaires et animaux de maladies génétiques, et des plantes transgéniques. Cependant, en pratique, son efficacité restait trop faible pour des traitements humains, et le résultat dépendait du système de réparation de la cellule, souvent inactif ou aléatoire. Mais en six ans, la technique a gagné en précision et polyvalence, et les études chez l’animal ont confirmé à la fois son efficacité et la réduction des effets hors-cible. Résultat : en 2025, six ans après son invention, le prime editing fait enfin son entrée en clinique, un moment que beaucoup de médecins décrivent comme un véritable tournant pour la médecine.
Des traitements sur le marché
Dès 2019, de premiers essais cliniques avec le système CRISPR-Cas9 classique (le médicament Casgevy) avaient été réalisés sur des patients atteints de β-thalassémie et drépanocytose, deux maladies génétiques de l’hémoglobine, via la correction ex vivo et la réinjection des cellules modifiées au patient. Les premiers résultats étaient prometteurs : certains patients avaient vu leur production de globules rouges anormaux corrigée de manière durable, avec une amélioration significative de leurs symptômes, après une unique injection. Le traitement Casgevy a d’ailleurs été approuvé en Europe en 2024, pour un coût d’environ 2 millions d’euros par patient.
Plus récemment, en 2025 un bébé atteint d’une mutation du gène CPS1 a été guéri grâce à l’édition de base, la version moins invasive et plus sûre de CRISPR-Cas9, mais qui reste limitée aux substitutions ponctuelles et ne permet pas toutes les modifications (pas d’insertion de séquences longues). Mais aujourd’hui, le prime editing lève les deux grands verrous du CRISPR-Cas9 classique – la nécessité de casser l’ADN et la dépendance à des mécanismes de réparation inefficaces – ouvrant la voie à une édition plus sûre, plus précise et applicable à un spectre beaucoup plus large de maladies.
Il n’est plus limité à de simples conversions ponctuelles, mais permet pour la première fois de remplacer ou restaurer un gène complet, de façon précise et contrôlée. L’année 2025 marque le premier succès clinique d’une telle thérapie – une étape historique pour l’édition génomique. En effet, le 19 mai 2025 la société Prime Medicine fondée par David Liu, inventeur du prime editing, a annoncé la première administration humaine de sa thérapie, destinée à un jeune patient atteint de granulomatose chronique, une maladie immunitaire rare liée à une mutation de l’ADN. Les premiers résultats biologiques de ce « CRISPR ultrapuissant » se sont révélés très prometteurs, ouvrant une nouvelle ère pour l’édition génomique. Il faudra toutefois patienter encore quelques mois avant de mesurer réellement le succès du prime editing : les premiers essais cliniques restent très récents et le manque de recul ne permet pas encore d’en tirer des conclusions définitives, notamment en termes de sécurité – l’absence d’effets secondaires – et de stabilité à long terme.
Ces stratégies d’édition du génome s’inscrivent pleinement dans le mouvement de la médecine personnalisée, où chaque traitement est conçu sur mesure pour un patient donné, en fonction de sa mutation spécifique – un véritable médicament « pour lui seul ». Pour la suite, des sociétés annoncent déjà vouloir continuer l’aventure avec des stratégies consistant à administrer directement les traitements dans le corps, sans passer par la modification in vitro de cellules prélevées chez le patient – une procédure complexe et onéreuse.
D’un prototype de laboratoire, on est donc passés en un temps record à une technologie polyvalente, et on entre désormais dans l’ère de la médecine personnalisée même pour des pathologies très rares. Le champ d’application s’élargit : on ne se contente plus des pathologies sanguines – des essais et projets explorent des maladies métaboliques, des infections chroniques (ex. thérapies pour hépatite B) ou des maladies héréditaires rares. De nouvelles avancées viennent constamment enrichir le potentiel de CRISPR, élargissant sans cesse ses possibilités. Tous les types de maladies ne sont pas encore éligibles : les pathologies monogéniques (mutation simple, bien identifiée) sont les plus adaptées. Pour des maladies multifactorielles, complexes, ou dépendant de l’environnement, l’édition reste beaucoup moins directe. De plus, certaines cibles (cellules non accessibles, tissus spécifiques, traitement in vivo) restent techniquement très difficiles. C’est également un défi économique, tant les traitements de médecine personnalisée restent extrêmement coûteux.
Carole Arnold a reçu des financements de l'INSERM, la Région Grand-Est, le FEDER et l'ANR.
07.01.2026 à 11:49
Que sont les xénobots, ces robots biologiques qui bouleversent les frontières entre vivant et machine ?
Texte intégral (2918 mots)
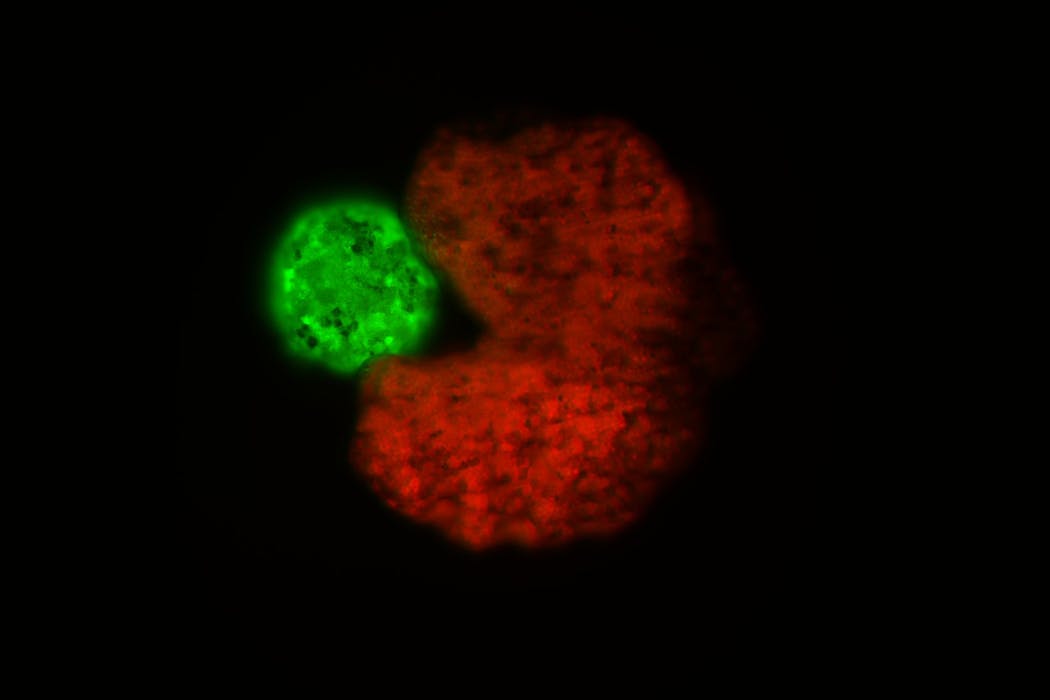
Les xénobots attirent aujourd’hui l’attention. Cette nouvelle catégorie de « robots vivants », fabriqués à partir de cellules d’amphibien et conçus grâce à des algorithmes, est capable de se déplacer, de se réparer et même, dans certaines expériences, de se reproduire en assemblant de nouveaux agrégats cellulaires. Ces entités questionnent la frontière entre machine et organisme. Des études récentes détaillent mieux leur fonctionnement moléculaire et ravivent les débats éthiques sur le contrôle de ces formes de vie programmables.
Les xénobots sont des entités biologiques artificielles entièrement composées de cellules vivantes issues d’embryons de xénope (Xenopus laevis), un amphibien africain. Prélevées sur des embryons de stade précoce, ces cellules sont encore indifférenciées : elles ne se sont pas encore spécialisées pour devenir des cellules de peau ou du foie par exemple. Elles sont cependant déjà « programmées » naturellement pour devenir des cellules qui tapissent les surfaces internes et externes du corps (peau, parois des organes, vaisseaux) ou des cellules contractiles du muscle cardiaque. Les contractions de ces cellules cardiaques agissent comme de minuscules moteurs, générant une propulsion, qui permet aux xénobots de se déplacer dans un milieu aquatique.
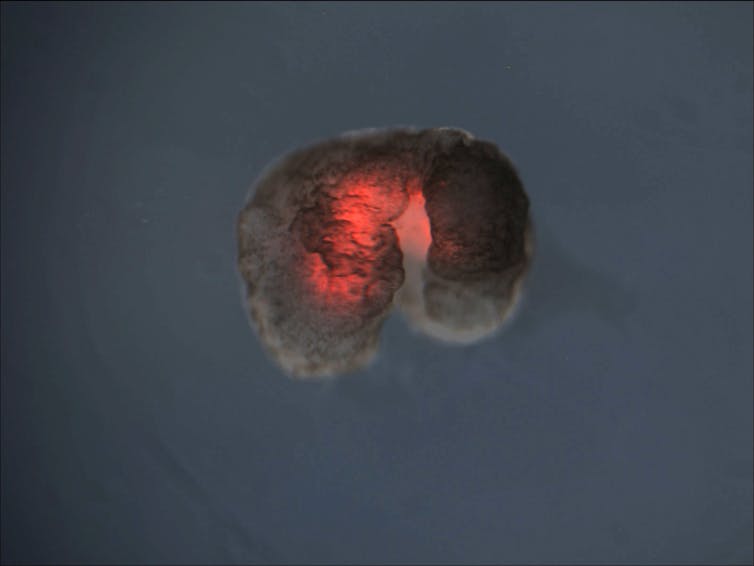
Pour fabriquer un xénobot, on isole et on assemble manuellement des groupes de cellules, comme des « briques biologiques ». À l’issue de cette phase de microchirurgie et d’organisation tridimensionnelle, les xénobots sont des entités de moins d’un millimètre de morphologies variables selon la fonction recherchée. Ils ne disposent d’aucun système nerveux ni organe sensoriel. Leur comportement est uniquement dicté par leur forme et leur composition cellulaire, toutes deux déterminées lors de leur création via des techniques de bio-ingénierie.
Bien qu’ils soient constitués uniquement de cellules vivantes, on parle de robots biologiques ou biobots, car ils obéissent à des tâches prédéfinies par l’humain : déplacement, coopération en essaim, transport d’objets, voire contrôle et assemblage d’autres xénobots à partir de cellules libres présentes autour d’eux (on parle d’autoréplication). Le terme « robot » prend ici un sens élargi, fondé sur la capacité à accomplir une tâche, en l’occurrence programmée par la forme et non par un logiciel interne.
Des robots biologiques conçus avec de l’IA
Avant de fabriquer un xénobot en laboratoire, des programmes d’intelligence artificielle (IA) sont utilisés pour tester virtuellement et simuler des milliers de formes et d’agencements cellulaires. Des algorithmes calculent quelles combinaisons fonctionneraient le mieux pour atteindre l’objectif fixé par le cahier des charges : par exemple, maximiser la vitesse de déplacement, transporter une charge ou induire de l’autoréplication.
Le lien entre l’intelligence artificielle et les cellules n’existe que lors de l’étape théorique de la conception. L’IA sert exclusivement à prédire et à optimiser la forme la plus adéquate, qui sera ensuite réalisée par microchirurgie et assemblage par des humains. Elle ne fournit aucun processus cognitif embarqué dans le xénobot, qui n’est donc pas contrôlé par une IA et ne possède aucune autonomie décisionnelle, contrairement à d’autres types de robots en développement.
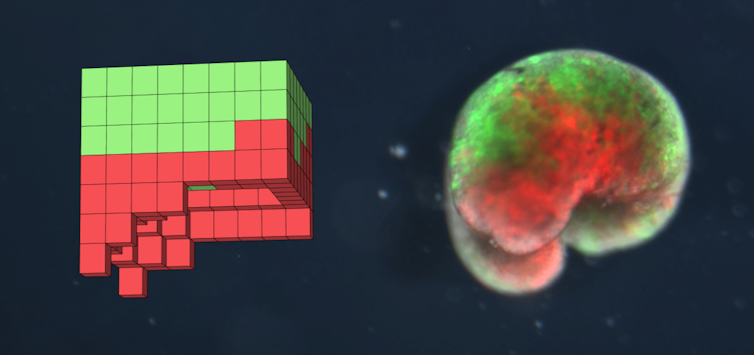
Les xénobots ont d’abord été conçus sous forme de sphères, de triangles ou de pyramides, des géométries simples choisies pour être faciles à construire, afin d’étudier de manière contrôlée la manière dont la forme et la disposition des cellules influencent le mouvement.
La forme en croissant, dite Pac-Man, a été identifiée par intelligence artificielle comme la plus performante pour s’autorépliquer. La réplication est cependant limitée à trois ou quatre générations en laboratoire et les xénobots se dégradent après environ dix jours, limitant leurs applications à plus long terme.
Quelles applications pour les xénobots ?
Toutes les applications envisagées demeurent pour l’instant expérimentales. Certaines fonctions (locomotion, agrégation de particules, autoréparation, réplication limitée) ont été démontrées in vitro, ce qui constitue des preuves de concept. En revanche, les usages proposés en médecine ou pour l’environnement restent pour l’instant des hypothèses extrapolées à partir de ces expériences et de modèles informatiques, sans validation chez l’animal.
Dans le domaine environnemental, grâce à leur petite taille, leur forte biodégradabilité et leur capacité à fonctionner en essaim, les xénobots pourraient être utilisés pour concentrer des microparticules ou des polluants en un même endroit, avant une étape de récupération ou de traitement adaptée, les xénobots eux-mêmes se dégradant ensuite sans laisser de trace biologique.
Des versions plus complexes de xénobots pourraient être utilisées comme marqueurs visuels de modifications dans un environnement. Un tel xénobot, exposé à un certain type de polluant, subirait un changement de structure et de couleur. Cette propriété permettrait en quelque sorte de lire ce que le xénobot a rencontré dans son environnement, à l’image d’un capteur lumineux. Cette application n’a cependant pas encore été démontrée expérimentalement.
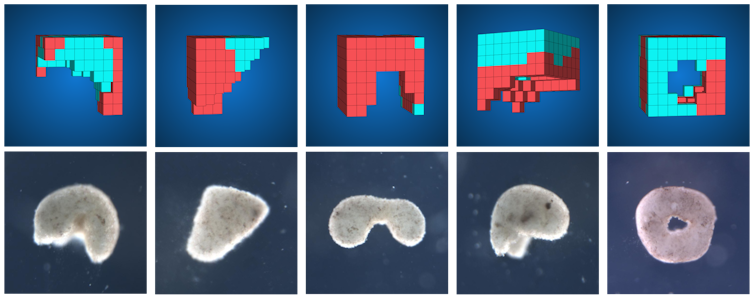
Dans le domaine médical, les xénobots pourraient être utilisés, tout comme d’autres microrobots, pour transporter localement des molécules thérapeutiques autour de cellules cibles, en réduisant ainsi la toxicité sur les tissus sains. La possibilité que les xénobots puissent servir à la livraison de molécules, comme des anticancéreux, reste cependant une extrapolation à partir d’expériences in vitro préliminaires sur d’autres microrobots.
Enfin, la recherche fondamentale pourrait bénéficier de l’existence de ces objets. L’organisation cellulaire des xénobots, hors du contexte embryonnaire, offre un modèle pour explorer la plasticité cellulaire ou tissulaire, la coordination cellulaire collective et l’auto-organisation, domaines clés pour comprendre l’évolution d’entités vivantes.
Des propriétés inattendues
Au-delà des tâches programmées, des propriétés remarquables ont été identifiées expérimentalement. Par exemple, des xénobots exposés à des vibrations sonores modifient significativement leur comportement moteur, passant d’une rotation à un déplacement linéaire rapide, une réaction absente chez les embryons de xénope au même stade.
En regroupant des cellules selon des architectures originales, les xénobots obligeraient ces cellules à reprogrammer en partie leur activité génétique : des analyses des gènes activés par ces cellules montrent l’activation de voies de stress, de réparation tissulaire ou de remodelage, qui ne sont pas utilisées de la même façon dans l’embryon intact.
De plus, dans ces expériences, plusieurs xénobots sectionnés se réparent spontanément et retrouvent un mouvement coordonné, ce qui suggère une communication à courte distance entre cellules, probablement via des signaux bioélectriques et chimiques, alors qu’aucun nerf n’est présent. Ces comportements illustrent une forte plasticité cellulaire, dont l’ampleur varie selon la manière dont les tissus ont été assemblés et les conditions de culture employées.
Derrière les promesses, des enjeux éthiques majeurs
Les promesses d’applications médicales ou environnementales ne doivent pas occulter l’ambiguïté de statut de ces entités, ni organismes naturels ni machines traditionnelles. Les xénobots sont des assemblages cellulaires conçus par l’humain appuyé par des systèmes d’intelligence artificielle. Leur déploiement reste, aujourd’hui, de l’ordre de l’hypothèse.
Plusieurs risques sont discutés par les bioéthiciens. Écologique d’abord, en cas d’acquisition par les xénobots d’une capacité de survie ou de réplication inattendue dans l’environnement. Sanitaire ensuite, en cas d’utilisation chez l’humain sans maîtrise complète de leur comportement à long terme. Un risque de détournement enfin, par exemple pour la libération ciblée d’agents toxiques.
À lire aussi : Xénobots, biobots : doit-on avoir peur des « robots vivants » ?
À cela s’ajoutent des enjeux plus symboliques : brouiller davantage la frontière entre vivant et non-vivant pourrait fragiliser certains cadres juridiques de protection du vivant, d’où les appels à un cadre réglementaire international spécifique à ces biorobots. Les promesses d’applications médicales ou dans le domaine de l’environnement ne doivent pas occulter l’ambiguïté de statut de ces entités, qui exigent une réflexion éthique et un cadre réglementaire international.
L’extension de l’utilisation de ces outils biologiques à des cellules humaines ne devra se réaliser que dans un cadre strictement contrôlé et sous supervision d’un comité éthique pluridisciplinaire. Plusieurs travaux dans ce domaine recommandent déjà des évaluations systématiques des risques (écologiques, sanitaires et de détournement), une transparence des protocoles et une implication du public dans les décisions de déploiement.
Il a été proposé de créer des instances spécifiques à cette technologie, chargées de vérifier la biodégradabilité, la limitation de la réplication, la traçabilité des essais et le respect de la dignité du vivant. Dans ce contexte, l’usage éventuel de xénobots ou d’organismes similaires dérivés de cellules humaines devrait s’inscrire dans un cadre réglementaire international inspiré de ces recommandations, avec des garde-fous comparables à ceux mis en place pour les organismes génétiquement modifiés (OGM) ou les thérapies géniques.
Jean-François Bodart ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
07.01.2026 à 11:49
D’où venons-nous ? Un voyage de 4 milliards d’années jusqu’à l’origine de nos cellules
Texte intégral (4270 mots)
Entrée à l’Académie des sciences en janvier 2025, Purificación López García s’intéresse à l’origine et aux grandes diversifications du vivant sur Terre. Elle étudie la diversité, l’écologie et l’évolution des microorganismes des trois domaines du vivant (archées, bactéries, eucaryotes). Avec David Moreira, elle a émis une hypothèse novatrice pour expliquer l’origine de la cellule eucaryote, celle dont sont composés les plantes, les animaux et les champignons, entre autres. Elle est directrice de recherche au CNRS depuis 2007 au sein de l’unité Écologie- Société-Évolution de l’Université Paris-Saclay et a été récompensée de la médaille d’argent du CNRS en 2017. Elle a raconté son parcours et ses découvertes à Benoît Tonson, chef de rubrique Science et Technologie.
The Conversation : Vous vous intéressez à l’origine du vivant. Vivant, que l’on classifie en trois grands domaines : les eucaryotes, des organismes dont les cellules ont un noyau, comme les humains ou les plantes par exemple ; les bactéries, qui ne possèdent pas de noyau, et un troisième, sans doute le moins connu, les archées. Pouvez-vous nous les présenter ?
Purificación López García : Ce domaine du vivant a été mis en évidence par Carl Woese à la fin des années 1970. Quand j’ai commencé mes études, à la fin des années 1980, cette découverte ne faisait pas consensus, il y avait encore beaucoup de résistance de la part de certains biologistes à accepter un troisième domaine du vivant. Ils pensaient qu’il s’agissait tout simplement de bactéries. En effet, comme les bactéries, les archées sont unicellulaires et n’ont pas de noyau. Il a fallu étudier leurs gènes et leurs génomes pour montrer que les archées et les bactéries étaient très différentes entre elles et même que les archées étaient plus proches des eucaryotes que des bactéries au niveau de leur biologie moléculaire.
Comment Carl Woese a-t-il pu classifier le vivant dans ces trois domaines ?
P. L. G. : On est donc à la fin des années 1970. C’est l’époque où commence à se développer la phylogénie moléculaire. L’idée fondatrice de cette discipline est qu’il est possible d’extraire des informations évolutives à partir des gènes et des protéines codées dans le génome de tous les êtres vivants. Certains gènes sont conservés chez tous les organismes parce qu’ils codent des ARN ou des protéines dont la fonction est essentielle à la cellule. Toutefois, la séquence en acides nucléiques (les lettres qui composent l’ADN : A, T, C et G ; U à la place de T dans l’ARN) et donc celle des acides aminés des protéines qu’ils codent (des combinaisons de 20 lettres) va varier. En comparant ces séquences, on peut déterminer si un organisme est plus ou moins proche d’un autre et classifier l’ensemble des organismes en fonction de leur degré de parenté évolutive.
Carl Woese est le premier à utiliser cette approche pour classifier l’ensemble du vivant : de la bactérie à l’éléphant, en passant par les champignons… Il va s’intéresser dans un premier temps non pas à l’ADN mais à l’ARN et, plus précisément, à l’ARN ribosomique. Le ribosome est la structure qui assure la traduction de l’ARN en protéines. On peut considérer que cette structure est la plus conservée dans tout le vivant : elle est présente dans toutes les cellules.
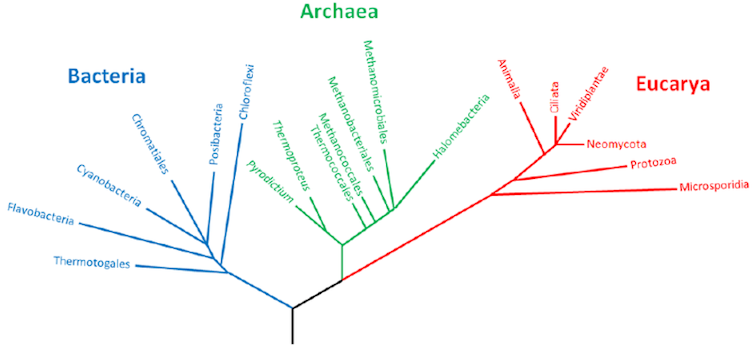
Avec ses comparaisons des séquences d’ARN ribosomiques, Woese montre deux choses : que l’on peut établir un arbre universel du vivant en utilisant des séquences moléculaire et qu’un groupe de séquences d’organismes considérés comme de bactéries « un peu bizarres », souvent associées à des milieux extrêmes, forment une clade (un groupe d’organismes) bien à part. En étudiant leur biologie moléculaire et, plus tard, leurs génomes, les archées s’avéreront en réalité beaucoup plus proches des eucaryotes, tout en ayant des caractéristiques propres, comme la composition unique des lipides de leurs membranes.
Aujourd’hui, avec les progrès des méthodes moléculaires, cette classification en trois grands domaines reste d’actualité et est acceptée par l’ensemble de la communauté scientifique. On se rend compte aussi que la plupart de la biodiversité sur Terre est microbienne.
Vous vous êtes intéressée à ces trois grands domaines au fur et à mesure de votre carrière…
P. L. G. : Depuis toute petite, j’ai toujours été intéressée par la biologie. En démarrant mes études universitaires, les questions liées à l’évolution du vivant m’ont tout de suite attirée. Au départ, je pensais étudier la biologie des animaux, puis j’ai découvert la botanique et enfin le monde microbien, qui m’a complètement fascinée. Toutes les formes de vie m’intéressaient, et c’est sûrement l’une des raisons pour lesquelles je me suis orientée vers la biologie marine pendant mon master. Je pouvais travailler sur un écosystème complet pour étudier à la fois les microorganismes du plancton, mais aussi les algues et les animaux marins.
Puis, pendant ma thèse, je me suis spécialisée dans le monde microbien et plus précisément dans les archées halophiles (celles qui vivent dans des milieux très concentrés en sels). Les archées m’ont tout de suite fascinée parce que, à l’époque, on les connaissait comme des organismes qui habitaient des environnements extrêmes, très chauds, très salés, très acides. Donc, c’était des organismes qui vivaient aux limites du vivant. Les étudier, cela permet de comprendre jusqu’où peut aller la vie, comment elle peut évoluer pour coloniser tous les milieux, même les plus inhospitaliers.
Cette quête de l’évolution que j’avais toujours à l’esprit a davantage été nourrie par des études sur les archées hyperthermophiles lors de mon postdoctorat, à une époque où une partie de la communauté scientifique pensait que la vie aurait pu apparaître à proximité de sources hydrothermales sous-marines. J’ai orienté mes recherches vers l’origine et l’évolution précoce de la vie : comment est-ce que la vie est apparue et s’est diversifiée ? Comment les trois domaines du vivant ont-ils évolué ?
Pour répondre à ces questions, vous avez monté votre propre laboratoire. Avec quelle vision ?
P. L. G. : Après un bref retour en Espagne, où j’ai commencé à étudier la diversité microbienne dans le plancton océanique profond, j’ai monté une petite équipe de recherche à l’Université Paris-Sud. Nous nous sommes vraiment donné la liberté d’explorer la diversité du vivant avec les outils moléculaires disponibles, mais en adoptant une approche globale, qui prend en compte les trois domaines du vivant. Traditionnellement, les chercheurs se spécialisent : certains travaillent sur les procaryotes – archées ou bactéries –, d’autres sur les eucaryotes. Les deux mondes se croisent rarement, même si cela commence à changer.
Cette séparation crée presque deux cultures scientifiques différentes, avec leurs concepts, leurs références et même leurs langages. Pourtant, dans les communautés naturelles, cette frontière n’existe pas : les organismes interagissent en permanence. Ils échangent, collaborent, entrent en symbiose mutualiste ou, au contraire, s’engagent dans des relations de parasitisme ou de compétition.
Nous avons décidé de travailler simultanément sur les procaryotes et les eucaryotes, en nous appuyant d’abord sur l’exploration de la diversité. Cette étape est essentielle, car elle constitue la base qui permet ensuite de poser des questions d’écologie et d’évolution.
L’écologie s’intéresse aux relations entre organismes dans un écosystème donné. Mais mes interrogations les plus profondes restent largement des questions d’évolution. Et l’écologie est indispensable pour comprendre ces processus évolutifs : elle détermine les forces sélectives et les interactions quotidiennes qui façonnent les trajectoires évolutives, en favorisant certaines tendances plutôt que d’autres. Pour moi, les deux dimensions – écologique et évolutive – sont intimement liées, surtout dans le monde microbien.
Sur quels terrains avez-vous travaillé ?
P. L. G. : Pour approfondir ces questions, j’ai commencé à travailler dans des environnements extrêmes, des lacs de cratère mexicains au lac Baïkal en Sibérie, du désert de l’Atacama et l’Altiplano dans les Andes à la dépression du Danakil en Éthiopie, et en m’intéressant en particulier aux tapis microbiens. À mes yeux, ces écosystèmes microbiens sont les véritables forêts du passé. Ce type de systèmes a dominé la planète pendant l’essentiel de son histoire.

La vie sur Terre est apparue il y a environ 4 milliards d’années, alors que notre planète en a environ 4,6. Les eucaryotes, eux, n’apparaissent qu’il y a environ 2 milliards d’années. Les animaux et les plantes ne se sont diversifiés qu’il y a environ 500 millions d’années : autant dire avant-hier à l’échelle de la planète.
Pendant toute la période qui précède l’émergence des organismes multicellulaires complexes, le monde était entièrement microbien. Les tapis microbiens, constitués de communautés denses et structurées, plus ou moins épaisses, formaient alors des écosystèmes très sophistiqués. Ils étaient, en quelque sorte, les grandes forêts primitives de la Terre.
Étudier aujourd’hui la diversité, les interactions et le métabolisme au sein de ces communautés – qui sont devenues plus rares car elles sont désormais en concurrence avec les plantes et les animaux – permet de remonter le fil de l’histoire évolutive. Ces systèmes nous renseignent sur les forces de sélection qui ont façonné la vie dans le passé ainsi que sur les types d’interactions qui ont existé au cours des premières étapes de l’évolution.
Certaines de ces interactions ont d’ailleurs conduit à des événements évolutifs majeurs, comme l’origine des eucaryotes, issue d’une symbiose entre procaryotes.
Comment ce que l’on observe aujourd’hui peut-il nous fournir des informations sur le passé alors que tout le vivant ne cesse d’évoluer ?
P. L. G. : On peut utiliser les communautés microbiennes actuelles comme des analogues de communautés passées. Les organismes ont évidemment évolué – ils ne sont plus les mêmes –, mais nous savons deux choses essentielles. D’abord, les fonctions centrales du métabolisme sont bien plus conservées que les organismes qui les portent. En quelque sorte, il existe un noyau de fonctions fondamentales. Par exemple, il n’existe que très peu de manières de fixer le CO₂ présent dans l’atmosphère. La plus connue est le cycle de Calvin associé à la photosynthèse oxygénique de cyanobactéries des algues et des plantes. Ce processus permet d’utiliser le carbone du CO₂ pour produire des molécules organiques plus ou moins complexes indispensables à tout organisme.
On connaît six ou sept grandes voies métaboliques de fixation du carbone inorganique, qui sont en réalité des variantes les unes des autres. La fixation du CO₂, c’est un processus absolument central pour tout écosystème. Certains organismes, dont les organismes photosynthétiques, fixent le carbone. Ce sont les producteurs primaires.
Ensuite vient toute la diversification d’organismes et des voies qui permettent de dégrader et d’utiliser cette matière organique produite par les fixateurs de carbone. Et là encore, ce sont majoritairement les microorganismes qui assurent ces fonctions. Sur Terre, ce sont eux qui pilotent les grands cycles biogéochimiques. Pas tellement les plantes ou les animaux. Ces cycles existaient avant notre arrivée sur la planète, et nous, animaux comme plantes, ne savons finalement pas faire grand-chose à côté de la diversité métabolique microbienne.
Les procaryotes – archées et bactéries – possèdent une diversité métabolique bien plus vaste que celle des animaux ou des végétaux. Prenez la photosynthèse : elle est héritée d’un certain type de bactéries que l’on appelle cyanobactéries. Ce sont elles, et elles seules, chez qui la photosynthèse oxygénique est apparue et a évolué (d’autres bactéries savent faire d’autres types de photosynthèse dites anoxygéniques). Et cette innovation a été déterminante pour notre planète : avant l’apparition des cyanobactéries, l’atmosphère ne contenait pas d’oxygène. L’oxygène atmosphérique actuel n’est rien d’autre que le résultat de l’accumulation d’un déchet de cette photosynthèse.
Les plantes et les algues eucaryotes, elles, n’ont fait qu’hériter de cette capacité grâce à l’absorption d’une ancienne cyanobactérie capable de faire la photosynthèse (on parle d’endosymbiose). Cet épisode a profondément marqué l’évolution des eucaryotes, puisqu’il a donné naissance à toutes les lignées photosynthétiques – algues et plantes.
À l’instar de la fixation du carbone lors de la photosynthèse, ces voies métaboliques centrales sont beaucoup plus conservées que les organismes qui les portent. Ces organismes, eux, évoluent en permanence, parfois très rapidement, pour s’adapter aux variations de température, de pression, aux prédateurs, aux virus… Pourtant, malgré ces changements, les fonctions métaboliques centrales restent préservées.
Et ça, on peut le mesurer. Lorsque l’on analyse la diversité microbienne dans une grande variété d’écosystèmes, on observe une diversité taxonomique très forte, avec des différences d’un site à l’autre. Mais quand on regarde les fonctions de ces communautés, de grands blocs de conservation apparaissent. En appliquant cette logique, on peut donc remonter vers le passé et identifier des fonctions qui étaient déjà conservées au tout début de la vie – des fonctions véritablement ancestrales. C’est un peu ça, l’idée sous-jacente.
Finalement, jusqu’où peut-on remonter ?
P. L. G. : On peut remonter jusqu’à un organisme disons « idéal » que l’on appelle le Last Universal Common Ancestor, ou LUCA – le dernier ancêtre commun universel des organismes unicellulaires. Mais on sait que cet organisme était déjà très complexe, ce qui implique qu’il a forcément été précédé d’organismes beaucoup plus simples.
On infère l’existence et les caractéristiques de cet ancêtre par comparaison : par la phylogénie moléculaire, par l’étude des contenus en gènes et des propriétés associées aux trois grands domaines du vivant. En réalité, je raisonne surtout en termes de deux grands domaines, puisque l’on sait aujourd’hui que les eucaryotes dérivent d’une symbiose impliquant archées et bactéries. Le dernier ancêtre commun, dans ce cadre, correspondrait donc au point de bifurcation entre les archées et les bactéries.
À partir de là, on peut établir des phylogénies, construire des arbres, et comparer les éléments conservés entre ces deux grands domaines procaryotes. On peut ainsi inférer le « dénominateur commun », celui qui devait être présent chez cet ancêtre, qui était probablement déjà assez complexe. Les estimations actuelles évoquent un génome comprenant peut-être entre 2 000 et 4 000 gènes.
Cela nous ramène à environ 4 milliards d’années. Vers 4,4 milliards d’années, on commence à voir apparaître des océans d’eau liquide et les tout premiers continents. C’est à partir de cette période que l’on peut vraiment imaginer le développement de la vie. On ne sait pas quand exactement, mais disons qu’autour de 4-4,2 milliards d’années, c’est plausible. Et on sait que, à 3,5 milliards d’années, on a déjà des fossiles divers de tapis microbiens primitifs (des stromatolites fossiles).
Et concernant notre groupe, les eucaryotes, comment sommes-nous apparus ?
P. L. G. : Nous avons proposé une hypothèse originale en 1998 : celle de la syntrophie. Pour bien la comprendre, il faut revenir un peu sur l’histoire des sciences, notamment dans les années 1960, quand Lynn Margulis, microbiologiste américaine, avance la théorie endosymbiotique. Elle propose alors que les chloroplastes des plantes et des algues – les organites qui permettent de réaliser la photosynthèse dans les cellules de plantes – dérivent d’anciennes bactéries, en particulier de cyanobactéries, qu’on appelait à l’époque « algues vert-bleu ». Et elle avance aussi que les mitochondries, l’organite eucaryote où se déroule la respiration et qui nous fournit notre énergie, proviennent elles aussi d’anciennes bactéries endosymbiotes – un endosymbiote étant un organisme qui vit à l’intérieur des cellules d’un autre.
Ces idées, qui avaient été déjà énoncées au début du vingtième siècle et que Margulis a fait revivre, ont été très débattues. Mais à la fin des années 1970, avec les premiers arbres phylogénétiques, on a pu démontrer que mitochondries et chloroplastes dérivent effectivement d’anciennes bactéries endosymbiotes : les cyanobactéries pour les chloroplastes, et un groupe que l’on appelait autrefois les « bactéries pourpres » pour les mitochondries.
L’hypothèse dominante, à cette époque, pour expliquer l’origine des eucaryotes, repose sur un scénario dans lequel un dernier ancêtre commun se diversifie en trois grands groupes ou domaines : les bactéries, les archées et les eucaryotes. Les archées sont alors vues comme le groupe-frère des eucaryotes, avec une biologie moléculaire et des protéines conservées qui se ressemblent beaucoup. Dans ce modèle, la lignée proto-eucaryote qui conduira aux eucaryotes et qui développe toutes les caractéristiques des eucaryotes, dont le noyau, acquiert assez tardivement la mitochondrie via l’endosymbiose d’une bactérie, ce qui lancerait la diversification des eucaryotes.
Sauf que, dans les années 1990, on commence à se rendre compte que tous les eucaryotes possèdent ou ont possédé des mitochondries. Certains groupes semblaient en être dépourvus, mais on découvre qu’ils les ont eues, que ces mitochondries ont parfois été extrêmement réduites ou ont transféré leurs gènes au noyau. Cela signifie que l’ancêtre de tous les eucaryotes avait déjà une mitochondrie. On n’a donc aucune preuve qu’une lignée « proto-eucaryote » sans mitochondrie ait jamais existé.
C’est dans ce contexte que de nouveaux modèles fondés sur la symbiose émergent. On savait déjà que les archées et les eucaryotes partageaient des similarités importantes en termes de protéines impliquées dans des processus informationnels (réplication de l’ADN, transcription, traduction de l’ARN aux protéines). Nous avons proposé un modèle impliquant trois partenaires : une bactérie hôte (appartenant aux deltaprotéobactéries), qui englobe une archée prise comme endosymbionte, cette archée devenant le futur noyau. Les gènes eucaryotes associés au noyau seraient ainsi d’origine archéenne.
Puis une seconde endosymbiose aurait eu lieu, avec l’acquisition d’une autre bactérie (une alphaprotéobactérie) : l’ancêtre de la mitochondrie, installée au sein de la bactérie hôte.
Toutefois, à l’époque, ces modèles fondés sur la symbiose n’étaient pas considérés très sérieusement. La donne a changé avec la découverte, il y a une dizaine d’années, d’un groupe particulier d’archées, appelées Asgard, qui partagent beaucoup de gènes avec les eucaryotes, qui sont en plus très similaires. Les arbres phylogénétiques faits avec des protéines très conservées placent les eucaryotes au sein de ces archées. Cela veut dire que les eucaryotes ont une origine symbiogénétique : ils dérivent d’une fusion symbiotique impliquant au minimum une archée (de type Asgard) et une alpha-protéobactérie, l’ancêtre de la mitochondrie. Mais la contribution d’autres bactéries, notamment des deltaprotéobactéries, des bactéries sulfato-réductrices avec lesquelles les archées Asgard établissent des symbioses syntrophiques dans l’environnement, n’est pas exclue.
Aujourd’hui, l’eucaryogénèse est un sujet étudié activement. La découverte des archées Asgard a renforcé la vraisemblance de ce type de modèle symbiogénétique. Des chercheurs qui considéraient ces idées comme trop spéculatives – parce qu’on ne pourra jamais avoir de preuve directe d’un événement datant d’il y a 2 milliards d’années – s’y intéressent désormais. Tous ceux qui travaillent sur la biologie cellulaire des eucaryotes se posent la question, parce qu’on peut aujourd’hui remplacer certaines protéines ou homologues eucaryotes par leurs variantes Asgard… et ça fonctionne.
Purificación López García ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
07.01.2026 à 11:39
Une proposition de loi veut supprimer l’obligation d’utiliser un cercueil et relancer le débat sur la liberté des funérailles
Texte intégral (1249 mots)
Une proposition de loi déposée à la toute fin 2025 entend rouvrir un débat ancien mais de plus en plus actuel : celui du choix réel des modalités de disposition du corps après la mort, au-delà du seul face-à-face entre inhumation et crémation.
L’actualité du droit funéraire est très vivante ces dernières années et cela n’est pas prêt de s’arrêter. Pour preuve, une proposition de loi a été déposée le 23 décembre 2025, proposition visant à rendre effective la liberté des funérailles à travers le développement d’alternatives à l’inhumation et à la crémation et s’inscrivant dans la lignée d’une proposition précédente visant à développer l’humusation, un sujet qui reste dans l’actualité depuis 2023 malgré une certaine instabilité politique.
Quel est l’objet de cette nouvelle proposition de loi ?
La proposition de loi no 2297 portée par le député LFI François Piquemal (4ᵉ circonscription de Haute-Garonne) vise « à rendre effective la liberté des funérailles ». Autrement dit, l’enjeu de ce texte n’est pas de promouvoir une alternative en particulier à l’inhumation et à la crémation mais d’offrir une plus grande marge de manœuvre aux citoyennes et citoyens français quant au choix de leurs funérailles. Pour rappel, il s’agit normalement d’une liberté déjà inscrite dans la loi de 1887 sur la liberté des funérailles mais qui est souvent interprétée comme une liberté « contrainte » puisque cantonnée au choix entre inhumation ou crémation avec obligation de recourir à un cercueil dans les deux cas.
Ainsi, le texte propose de renforcer cette liberté par une mesure forte : l’abrogation de l’obligation d’utiliser un cercueil au profit d’une liberté de choix de l’enveloppe mortuaire (article 2), suivie d’une invitation à la reconnaissance légale d’alternatives à l’inhumation et la crémation (la terramation, l’humusation et l’aquamation sont ainsi nommées dans l’article 3 de la proposition).
Là est la différence majeure entre cette proposition de loi et celle de 2023 citée en introduction : la liberté de choix de l’enveloppe mortuaire. Autant les alternatives à l’inhumation et à la crémation commencent à être connues, autant il s’agit là d’une mesure totalement inédite qui vient porter un coup à plus de 200 ans de tradition juridique, l’obligation légale d’utiliser un cercueil datant d’un arrêté du préfet de Paris de 1801 pour des raisons d’hygiène.
Enfin, là où cette nouvelle proposition de loi rejoint la précédente, c’est sur la technique légistique de l’expérimentation. Les deux propositions proposent de passer par la voie de l’expérimentation avec un délai plus crédible pour la nouvelle proposition (5 ans) contre 6 mois seulement dans celle de 2023.
Une proposition inspirée par l’actualité internationale du droit funéraire
Cette nouvelle proposition de loi n’est pas une initiative isolée. Cela commence à faire plusieurs années que nous entendons parler de reconnaissances légales d’alternatives à l’inhumation et à la crémation. C’est le cas notamment aux États-Unis, en Allemagne et peut-être bientôt en Suisse.
Ce mouvement de légalisation dans le monde témoigne d’une nouvelle sensibilité écologique et de l’aspiration de nos concitoyens à davantage de liberté dans l’organisation des funérailles.
La France n’est d’ailleurs pas le seul pays à réfléchir à l’abrogation de l’obligation légale d’utiliser un cercueil. En région bruxelloise (Belgique) il est ainsi permis depuis janvier 2019 de s’affranchir du cercueil au profit d’un linceul. On reconnait ici la théorie défendue par Alexandre Flückiger, légisticien, selon laquelle « le droit d’un État voisin est susceptible de déployer des effets d’ordre recommandationnel sur un territoire limitrophe. Le droit étranger déploie dans ce contexte un effet symbolique qui agirait sur les comportements au même titre qu’une recommandation très implicite. »
La situation en France
Enfin, en dehors de la proposition de loi, il est possible de trouver plusieurs indicateurs sur le sol français qui démontrent un vif intérêt pour une plus grande liberté des funérailles et pour l’abrogation de l’obligation légale du cercueil.
À défaut de pouvoir supprimer le cercueil, certains réfléchissent à le rendre plus vert. À Saint-Étienne, la jeune entreprise Pivert Funéraire a ainsi créé un modèle pour crémation fabriqué à partir de déchet des industries sylvicoles et oléicoles.
D’autres organisent des colloques académiques sur le sujet. C’est l’exemple du colloque récent « Cercueil(s) & droit(s) », qui s’est tenu à l’Université Toulouse Capitole, le 28 novembre 2025.
D’autres encore mènent des expériences effectives sur le déploiement d’alternatives à l’inhumation et la crémation. C’est l’exemple de l’expérimentation sur des brebis qui a lieu dans l’Essonne à travers le projet ANR F-Compost.
En somme, les acteurs de la recherche et des pompes funèbres préparent le terrain pour que des projets, comme celui porté par cette proposition de loi, puissent voir le jour. Si une réserve pouvait être émise il y a quelques années sur l’intérêt du Parlement pour ces questions, il est permis de penser qu’à plus de cent ans la loi sur la liberté des funérailles pourrait bientôt connaître une nouvelle vie…
Jordy Bony a travaillé avec le comité de recherche de l'association Humo Sapiens, pour une mort régénérative qui œuvre pour promouvoir et expérimenter la terramation en France.
06.01.2026 à 16:56
Quelle est la différence entre matière noire et antimatière ?
Texte intégral (2180 mots)

« Qu’est-ce que la matière noire et qu’est-ce que l’antimatière ? Sont-elles la même chose ou différentes ? » Cet article est issu de notre série pour les plus jeunes lecteurs, Curious Kids, et répond à la question de Namrata, 13 ans, Ghaziabad, Inde.

Imaginez un jeu vidéo d’aventure avec votre héros préféré comme personnage principal. Un autre personnage, son jumeau miroir, apparaît de temps en temps et fait exploser tout ce qu’il touche. Pour corser encore le tout, le jeu inclut une ruche mystérieuse peuplée de minions cachés à chaque coin, qui changent les règles du jeu sans jamais se montrer.
Si l’on considère ces personnages comme des types de matière, ce jeu vidéo représente en gros le fonctionnement de notre Univers.
Le héros est la matière ordinaire, c’est-à-dire tout ce que nous pouvons voir autour de nous. L’antimatière est le jumeau miroir explosif que les scientifiques arrivent à comprendre, mais plus difficilement à trouver. Et la matière noire représente les minions invisibles : elle est partout, mais nous ne pouvons pas la voir, et les scientifiques ignorent de quoi elle est faite.
Antimatière : le jumeau miroir
Toute la matière ordinaire autour de vous est constituée de blocs de base appelés atomes. Les atomes possèdent des particules chargées positivement appelées protons entourées de minuscules électrons chargés négativement.
On peut considérer l’antimatière comme le jumeau de la matière ordinaire, mais avec des charges opposées.
Toutes les particules, comme les protons et les électrons, ont des « frères et sœurs » d’antimatière. Les électrons ont des positrons, qui sont des anti-électrons, tandis que les protons ont des antiprotons. Les antiprotons et les positrons forment des atomes d’antimatière, ou anti-atomes. Ils ressemblent à des images miroirs, mais avec leurs charges électriques inversées. Quand la matière et l’antimatière se rencontrent, elles se détruisent mutuellement dans un éclair de lumière et d’énergie avant de disparaître.
Heureusement, l’antimatière est très rare dans notre Univers. Mais certains atomes de matière ordinaire, comme le potassium, peuvent se désintégrer et produire de l’antimatière. Par exemple, lorsque vous mangez une banane ou tout aliment riche en potassium, vous consommez de très petites quantités de ces atomes producteurs d’antimatière. Mais la quantité est trop faible pour avoir un effet sur votre santé.
L’antimatière a été découverte il y a presque cent ans. Aujourd’hui, les scientifiques peuvent créer, stocker et étudier l’antimatière en laboratoire. Ils en comprennent très bien les propriétés. Les médecins l’utilisent même pour les PET-Scan. Ils injectent de toutes petites quantités d’atomes producteurs d’antimatière dans le corps et, au fur et à mesure que ces atomes circulent, le scanner prend des images des éclairs de lumière produits par l’annihilation de l’antimatière et de la matière dans le corps. Ce processus permet aux médecins de voir ce qui se passe à l’intérieur du corps.
Les scientifiques ont également découvert qu’à la naissance de l’Univers, il y avait des quantités presque égales de matière et d’antimatière. Elles se sont rencontrées et annihilées. Heureusement, une très petite quantité de matière ordinaire a survécu pour former les étoiles, les planètes et nous tous.
Matière noire : les minions invisibles
La matière noire est beaucoup plus mystérieuse. Avez-vous déjà tourné très vite sur un tourniquet ? Si oui, vous savez combien il est difficile de rester dessus sans tomber, surtout si vous êtes seul sur le tourniquet.
Maintenant, imaginez qu’il y ait plein de minions invisibles sur ce tourniquet avec vous. Vous ne pouvez ni les voir ni les toucher, mais ils vous retiennent et vous empêchent de vous envoler quand il tourne à toute vitesse. Vous savez qu’ils sont là parce que le tourniquet est plus lourd et difficile à faire tourner qu’il n’y paraît. Les minions ne jouent pas et ne parlent à personne ; ils restent simplement là, ajoutant leur poids à l’ensemble.
Il y a environ cinquante ans, l’astronome Vera Rubin a découvert un mystère similaire dans les galaxies spirales. Elle a observé des galaxies en rotation, qui sont comme des tourniquets cosmiques, et a remarqué quelque chose d’étrange : les étoiles situées à l’extérieur de ces galaxies tournaient beaucoup plus vite qu’elles ne devraient. Elles auraient dû être projetées dans l’espace comme des étincelles d’un feu d’artifice. Mais ce n’était pas le cas.
C’était comme regarder des enfants tourner à une vitesse incroyable sur un tourniquet mais rester parfaitement en place.

La seule explication ? Il doit exister un océan de « choses » invisibles qui maintiennent tout en place grâce à leur gravité supplémentaire. Les scientifiques ont appelé cette matière mystérieuse « matière noire ».
Depuis, les astronomes ont observé des comportements étranges similaires dans tout l’Univers. Les galaxies au sein de grands amas se déplacent de manière inattendue. La lumière est plus courbée autour des galaxies qu’elle ne devrait l’être. Les galaxies restent bien plus solidaires que ce que la matière visible seule pourrait expliquer.
C’est comme si notre terrain de jeu cosmique avait des balançoires qui bougent toutes seules et des tape-culs qui basculent alors que personne n’est assis dessus.
La matière noire n’est pour l’instant qu’un nom provisoire, en attendant que les scientifiques découvrent ce que c’est réellement. Depuis cinquante ans, de nombreux chercheurs mènent des expériences pour détecter la matière noire ou la produire en laboratoire. Mais jusqu’à présent, ils sont restés bredouilles.
Nous ne savons pas ce qu’est la matière noire, mais elle est partout. Il pourrait s’agir de particules que les scientifiques n’ont pas encore découvertes ou de quelque chose de complètement inattendu. Mais les astronomes peuvent constater, en observant la vitesse de rotation des galaxies, qu’il y a environ cinq fois plus de matière noire que toute la matière ordinaire de l’Univers.
Dipangkar Dutta bénéficie d'un financement du ministère américain de l'Énergie et de la National Science Foundation.
06.01.2026 à 16:54
Pourquoi les femmes font-elles moins de vélo que les hommes ?
Texte intégral (2350 mots)

En France, comme dans la grande majorité des pays du globe, les femmes pédalent moins que les hommes. Comment l’expliquer ?
Selon une enquête de 2023, en France, 11 % des femmes adultes affirment ne pas savoir faire du vélo et 38 % déclarent une faible maîtrise, contre respectivement 5 % et 23 % des hommes. Elles ne sont que 25 % à en faire au moins une fois par semaine, contre 38 % des hommes. Et la tendance s’observe pour les principales formes d’usage.
De plus, les cyclistes hommes parcourent en moyenne des distances plus importantes. Malgré une féminisation progressive, les femmes ne représentent que 12,8 % des licencié·es de la fédération française de cyclisme et seulement 7 % des pratiquant·es en compétition. Plus clivée encore, l’activité professionnelle de livraison à vélo ne compte quasiment que des hommes.
Le recours au vélo à assistance électrique (VAE) est davantage paritaire (47 % de femmes). Toutefois l’accès à cette technologie est très inégalitaire entre les femmes. Les moins dotées en termes de revenu sont peu enclines à en bénéficier.
Par ailleurs, les femmes sont plus susceptibles de ne posséder aucun vélo ou d’utiliser un modèle d’entrée de gamme. Comme c’est le cas des groupes sociaux les plus pauvres, elles se déplacent davantage à pied et en transport en commun (TC). Les parts des différents modes de déplacement–marche, TC et vélo – sont respectivement de 25,8 %, 14 % et 1,5 % pour les femmes, contre 21,5 %, 11,2 % et 4 % pour les hommes.
Des socialisations corporelles, sportives et spatiales très genrées
Ces constats s’expliquent notamment par le fait que le vélo est une activité d’extérieur qui (en France) reste fortement associée à un sport masculin nécessitant des efforts intenses, à un mode de déplacement individuel dangereux, au tourisme, à l’aventure ainsi qu’à un objet mécanique autoréparable.
Or, à travers leur socialisation (ensemble des processus par lesquels la société façonne les individus), les femmes sont généralement moins incitées à investir l’espace public, à se déplacer seules, à s’aventurer, à s’adonner à des activités mécaniques, à fournir des efforts physiques intenses (d’autant plus en compétition) et à prendre des risques corporels.
Ce processus est particulièrement prégnant durant l’adolescence, période marquée par un durcissement des assignations de genre (injonctions à devenir une fille féminine ou un garçon masculin). Ce constat est d’autant plus préoccupant que la pratique du vélo pendant l’adolescence conditionne fortement la probabilité d’en refaire plus tard.
« En 4e, c’est là qu’elle s’est sentie plus, enfin, qu’elle est devenue une femme, une jeune femme quoi, enfin elle a eu ses trucs […] Et elle s’est sentie grande quoi ! Maquillage, tout ça, et c’est vrai que là, le vélo, elle en a plus trop fait, mais ses copines en faisaient plus de toute façon », Véronique, 42 ans, éducatrice petite enfance.
À l’âge adulte, les femmes sont davantage amenées à effectuer des chaînes de déplacement complexes (succession de trajets correspondant à différents motifs : travail, école, médecin, courses, etc.) découlant de leurs plus grandes responsabilités domestiques (notamment le transport d’enfants, de personnes âgées ou malades). Au même titre que les problèmes de santé ainsi que les changements de lieu de résidence ou d’emploi, l’arrivée d’enfant(s) les conduit plus souvent à arrêter le vélo que ce n’est le cas pour les hommes.
Leur usage du vélo est également plus souvent freiné par la peur de l’accident, la vitesse et le volume du trafic, les montées et longues distances, un manque de confiance en leurs capacités physiques, et la crainte de problèmes mécaniques. Elles sont aussi plus susceptibles de réduire ou d’abandonner leur pratique du vélo à la suite d’un accident ou d’une chute.
Des inégalités entre les femmes elles-mêmes
Par ailleurs, moins compétentes pour réparer leur vélo, moins en mesure de recourir à un ou une professionnel·le (en raison de moindres ressources économiques) et moins souvent équipées d’un vélo de remplacement, elles sont plus exposées à un abandon de pratique en cas d’avarie.
Ces freins concernent moins les femmes des classes dominantes vivant en milieu urbain dense, où les dimensions écologique, sanitaire et pratique du vélo sont particulièrement valorisées, et où les aménagements sont plus sécurisés, continus, directs, connectés et lisibles.
À l’inverse, les femmes de milieu populaire – notamment lorsqu’elles sont issues de cultures non occidentales dans lesquelles l’usage du vélo est l’apanage des hommes – sont fortement susceptibles de ne jamais avoir appris à faire du vélo ou d’avoir arrêté avant l’âge adulte. Elles sont davantage concernées par les tâches domestiques ainsi que par un manque de ressources financières, de modèles d’identification, de connaissances des bienfaits du vélo, et d’accès au réseau cyclable.
L’influence déterminante de l’environnement familial et des pairs
La dimension genrée des socialisations cyclistes repose sur toutes les instances et agents de socialisation, à commencer par l’environnement familial et ce, dès le plus jeune âge. Les filles sont moins incitées à sortir, à explorer, à se dépenser et à prendre des risques que les garçons. En particulier au moment de la puberté, elles se font plus souvent accompagner ou interdire de pratiquer. Elles sont davantage retenues dans la sphère domestique et dissuadées de se déplacer seules.
Cela est moins marqué dans les milieux fortement dotés en capital culturel, où les femmes sont généralement plus enclines à s’approprier le vélo comme un outil libérateur du sentiment de vulnérabilité dans l’espace public (parce que permettant d’aller plus vite qu’à pied et de ne pas se sentir confinées). Mais cette forme d’appropriation peut favoriser un sentiment de dépendance au vélo (perçu comme plus rassurant que la marche et les transports en commun) limitant en définitive leurs alternatives. Parce que les sociabilités demeurent très homosexuées (entre personnes du même sexe), l’influence des pairs tend aussi à favoriser la reproduction des inégalités de genre, notamment dans le cadre de pratiques sportives.
Le rôle majeur des institutions sportives et médiatiques
Le monde du sport de compétition joue également un rôle important dans la sexuation des socialisations cyclistes. La recherche en physiologie de l’exercice montre qu’en raison d’une meilleure résistance à la fatigue et d’une meilleure utilisation des graisses comme énergie, les femmes disposent d’avantages non négligeables pour les épreuves sportives d’ultra-endurance extrêmes (supérieures à 6 heures de course).
Pourtant, la non-confrontation directe entre femme(s) et homme(s) reste la norme des courses de cyclisme sur route les plus médiatisées, dont les distances règlementaires sont environ deux fois inférieures pour les femmes. Les institutions et les médias naturalisent ainsi une supposée incapacité des femmes à rivaliser avec les hommes, érigeant pour les filles des modèles infériorisés.
Les injonctions genrées véhiculées par les objets
L’influence des vélos n’est pas à négliger. Dès le plus jeune âge, ils constituent des supports de socialisation genrée. Ceux adressés aux filles sont davantage équipés d’éléments renvoyant aux tâches domestiques et à la fonction maternelle (béquille, panier, siège poupon, etc.). D’autres objets favorisent le clivage. Nombreuses sont les femmes qui évitent le vélo afin de préserver leur maquillage ou leur tenue féminine (robe, jupe, talons).
D’autres freins tiennent au port de vêtements religieux (hijab, niqab, etc.), à l’usage de protections hygiéniques ou encore à la croyance que la selle pourrait compromettre la virginité (en particulier chez les moins dotées en capital culturel).
Les inégalités d’accès à l’espace public
Si le vélo est essentiellement étudié, conçu, vendu, pratiqué, promu, enseigné et réparé par des hommes, il est aussi pratiqué dans des espaces notamment façonnés et occupés par des hommes. Or, comme la cour d’école, qui constitue un support clé des socialisations spatiales genrées durant l’enfance, l’espace public n’est pas neutre.
Quel que soit leur mode de déplacement, les femmes sont davantage confrontées au harcèlement et aux agressions sexuelles de rue. Les stratégies qu’elles adoptent (se vêtir d’une tenue moins « féminine », se faire accompagner, feindre d’être accompagnée, faire des détours, éviter certains horaires, se munir d’une arme, renoncer, etc.) augmentent leur charge mentale, limitent leurs opportunités et conduisent parfois à l’abandon définitif du vélo.
Le vélo n’est pas forcément libérateur
Soulignons enfin que l’adoption du vélo (de même que le recours à des outils ménagers ou à la voiture) n’est pas forcément libératrice pour les femmes. Lorsqu’il permet d’aller plus vite (notamment en milieu dense), le vélo devient souvent un outil d’optimisation du temps. Ainsi, il peut contribuer à intensifier le travail domestique des femmes. C’est le cas lorsque, au lieu d’être réinvesti en loisir, le temps gagné est consacré à de nouvelles tâches.
Ainsi, il ne suffit pas d’inciter les femmes à faire du vélo pour tendre vers plus d’égalité. Une politique vélo qui poursuivrait cet objectif devrait tenter d’agir conjointement sur l’ensemble des instances et agents de socialisation (famille, pairs, institutions, médias, rue, objets, religion, etc.). C’est l’ensemble de nos structures sociales qu’il faudrait repenser.
David Sayagh est l’auteur de Sociologie du vélo, aux éditions La Découverte, 2025.
David Sayagh ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
06.01.2026 à 16:54
Que retenir de la présidence malaisienne de l’Asean ?
Texte intégral (2256 mots)
Avec désormais 11 membres, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est a toujours l’ambition de jouer un rôle central en Asie du Sud-Est. La Malaisie, qui a exercé la présidence tournante de l’organisation en 2025, a profité de l’occasion pour se repositionner comme un acteur important dans la région et au-delà.
Cet article a été co-rédigé avec Colin Doridant, analyste des relations entre la France et l’Asie.
Ancienne colonie britannique, la Malaisie est l’un des rares États d’Asie du Sud-Est à être passé d’une stratégie d’alliance à une posture de non-alignement sur la scène internationale. Indépendante depuis 1957, sa politique étrangère est restée, dans un premier temps, étroitement liée aux garanties de sécurité britanniques à travers l’Anglo-Malayan Defence Agreement (1957-1971), puis les Five Power Defence Arrangements, un pacte défensif non contraignant réunissant le Royaume-Uni, la Malaisie et Singapour, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Le progressif retrait britannique, la reconnaissance de la République populaire de Chine (RPC) en 1974 ainsi que l’arrivée au pouvoir de Mahathir Mohamad – une figure politique majeure en Asie – ont posé les bases d’une politique étrangère plus autonome et tournée vers le continent asiatique.
En 2025, la Malaisie a cherché à exploiter sa présidence de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (Asean) pour affirmer son rôle sur la scène régionale et internationale. Une stratégie qui s’est révélée payante pour Kuala Lumpur, mais en demi-teinte pour l’Asean.
Une politique étrangère neutre mais proactive
Après avoir adhéré au mouvement des non-alignés en 1970 et réaffirmé son non-alignement dans son Livre Blanc de la défense de 2020, la Malaisie semble aujourd’hui poursuivre une politique étrangère d’équilibre stratégique dynamique entre Pékin et Washington, centrée autour de l’Asean dont elle a été l’un des cinq membres fondateurs en 1967 (l’organisation compte désormais 11 membres).
Si la Malaisie, publiquement, n’hésite pas à aller dans le sens de la RPC – comme l’a encore montré la visite d’État de Xi Jinping en avril –, elle a également fait du respect de sa souveraineté en mer de Chine méridionale une de ses priorités stratégiques face à Pékin.
Avec les États-Unis, la relation bilatérale est de plus en plus tendue – que ce soit à propos du conflit israélo-palestinien ou de la nomination du très controversé prochain ambassadeur des États-Unis en Malaisie. La coopération reste néanmoins résiliente, comme en témoigne la signature d’accords de défense et d’accès aux terres rares lors de la visite de Donald Trump en octobre 2025.
Dans les relations avec ses voisins, la Malaisie privilégie un pragmatisme discret en matière de gestion des litiges frontaliers, comme avec les Philippines sur l’État de Sabah ou avec l’Indonésie autour d’Ambalat en mer de Célèbes.
Vis-à-vis de Singapour, ancien membre de la fédération qui s’est détaché en 1965, les relations sont largement normalisées avec des initiatives comme l’ouverture prochaine du Johor Bahru–Singapore Rapid Transit System ou la formalisation en janvier 2025 de la Johor-Singapore Special Economic Zone qui illustrent une approche axée sur l’interdépendance économique, évitant les confrontations publiques.
La présidence de l’Asean 2025 : un succès politique pour Anwar Ibrahim et diplomatique pour la Malaisie
Dix ans après sa dernière présidence de l’Asean, la Malaisie reprenait en 2025 les rênes de l’organisation dans un climat interne et international bien différent de celui qui prévalait une décennie auparavant.
Premier ministre depuis novembre 2022, Anwar Ibrahim, ancien dauphin puis rival de Mahathir, assurait cette présidence de l’Asean, plateforme unique pour rétablir une position d’acteur régional clé. La présidence malaisienne de l’Asean s’est inscrite dans la continuité de sa politique étrangère, qui vise à promouvoir le multilatéralisme et faire de Kuala Lumpur une capitale diplomatique en Asie du Sud-Est. Une mission réussie, avec les visites de plus de 25 chefs d’État différents en Malaisie au cours de l’année 2025, dont celles de Recep Tayyip Erdoğan, de Xi Jinping, de Donald Trump ou encore l’organisation de la rencontre Rubio-Lavrov en juillet.
Autre facette de la diplomatie malaisienne en 2025 : une forte solidarité avec les peuples « opprimés », en particulier les Palestiniens, et une critique des « doubles standards » occidentaux. Les efforts d’Anwar pour concrétiser l’organisation du premier sommet « Asean-GCC-China » entre l’Asean, les six pays du Conseil de coopération du Golfe et la RPC, sont également à souligner. La Malaisie tente de se positionner comme un pont (bridging linchpin vision) entre les différentes régions et cultures, particulièrement entre le monde islamique, l’Occident, mais aussi le « Sud Global », le pays ayant obtenu le statut de partenaire des BRICS en 2024.
Une année 2025 où la Malaisie aura donc pu rayonner à l’international, à l’instar de son premier ministre qui prépare déjà les prochaines élections générales de février 2028.
Asean : des horizons incertains
Point d’orgue d’une année intense, le 47e sommet de l’Asean, organisé concomitamment avec d’autres réunions (Partenariat économique régional global, Sommet de l’Asie orientale) et en présence de Donald Trump, fut historique par l’adhésion d’un onzième membre : le Timor-Leste.
Néanmoins, sur les plans économique et diplomatique, les résultats ont été mitigés. En effet, si le renforcement de l’Asean Trade in Goods Agreement (ATIGA) et de l’Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) ont marqué des avancées vers plus d’intégration régionale, des critiques ont surtout été formulées à l’encontre des accords bilatéraux de réduction des tarifs douaniers signés par la Malaisie et le Cambodge avec les États-Unis. Ces derniers contiendraient des « clauses empoisonnées » visant à renforcer le commerce avec les États-Unis et à limiter celui avec la RPC. Des accords-cadres similaires ont été signés avec le Vietnam et la Thaïlande. Ces dispositions symbolisent les difficultés de l’Asean à s’adapter à la diplomatie économique trumpienne, qualifiée par certains de « diplomatie du cowboy ».
Sur le plan régional, c’est principalement le réveil du conflit larvé entre la Thaïlande et le Cambodge en mai 2025 qui a pesé sur la présidence malaisienne de l’Asean. Malgré des efforts – plus sino-malaisiens qu’états-uniens – qui ont mené à la conclusion lors du sommet de l’Asean de « l’accord de paix de Kuala Lumpur » entre les deux belligérants en octobre, les hostilités ont repris dès le mois de novembre.
En s’ajoutant à l’échec d’avancées concrètes sur le dossier birman et de la mer de Chine méridionale, la confrontation entre Bangkok et Phnom Penh n’a fait que souligner l’incapacité de l’Asean à régler les conflits régionaux. Un rappel supplémentaire de la complexité de ces défis persistants et des limites des mécanismes dont dispose l’Asean pour y faire face.
Les prochaines présidences de l’Asean – les Philippines en 2026, qui ont annoncé qu’elles feraient du Code de conduite en mer de Chine méridionale leur priorité, et Singapour en 2027, année des 60 ans de l’organisation et du prochain Congrès national du Parti communiste chinois – sont d’ores et déjà toutes deux sous pression face à l’accumulation des crises en Asie du Sud-Est.
Ces dynamiques auront des ramifications géopolitiques qui dépassent le seul cadre régional et offrent à des acteurs extérieurs, la France par exemple, des opportunités de coopération et d’influence dans la région.
Les perspectives françaises
Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie Indopacifique française, la Malaisie constitue aujourd’hui un partenaire important en Asie du Sud-Est.
Le pays accueille environ 300 filiales d’entreprises françaises représentant quelque 30 000 emplois. Mais c’est dans le domaine de la défense que la coopération s’est révélée la plus soutenue, la Malaisie s’imposant, dans la première décennie du XXIe siècle, comme le principal partenaire de défense de la France en Asie du Sud-Est (aux côtés de Singapour), notamment à travers la vente de matériel militaire (sous-marins Scorpène, avions A400M, hélicoptères H225). La coopération militaire se poursuit actuellement, qu’il s’agisse des déploiements français (missions CLEMENCEAU 25 et PEGASE), de l’exercice terrestre conjoint MALFRENCH DAGGERT, ou encore des escales et exercices navals réguliers.
La relation connut une certaine accalmie, marquée par des périodes de tensions. Ainsi, en 2018, le retrait de l’huile de palme de la liste des biocarburants bénéficiant d’une exonération fiscale en France fut interprété par la Malaisie comme une interdiction déguisée d’importation, fragilisant un secteur stratégique.
La visite officielle à Paris d’Anwar Ibrahim en juillet 2025 semblait indiquer « la relance » de la relation bilatérale pour reprendre les mots du président Emmanuel Macron. Mais le discours d’Anwar à la Sorbonne pouvait toutefois être perçu comme un avertissement adressé aux Européens, les invitant à recalibrer leurs relations avec l’Asie du Sud-Est et à mieux appréhender les sensibilités d’une région qui « a l’habitude d’être décrite, mais beaucoup moins celle d’être écoutée ».
Il pourrait être intéressant pour la France de renforcer son soutien à la gestion des crises en Asie du Sud-Est, dans la dynamique de la nomination en 2024 d’un envoyé spécial pour la Birmanie en appui des efforts internationaux. En effet, le contentieux territorial entre la Thaïlande et le Cambodge trouve son origine dans le découpage territorial de l’Indochine française et des traités franco-siamois de 1904 et 1907. Or, la reprise du conflit coïncide avec l’organisation en 2026 du XXe Sommet de la Francophonie qui se tiendra au Cambodge (la Thaïlande est également membre l’organisation avec le statut observateur) et auquel participera Emmanuel Macron.
Un déplacement français en Asie du Sud-Est qui ne devra pas, cette fois, oublier la Malaisie, comme le rappelait avec humour le premier ministre malaisien à son homologue français dans la cour de l’Élysée en juillet 2025 : « Avant que vous n’atteigniez le Cambodge pour le Sommet de la Francophonie, vous n’aurez aucune excuse de ne pas visiter la Malaisie. »
Paco Milhiet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
06.01.2026 à 16:53
Du sauveur à l’éboueur : comment les lycéens perçoivent leurs éco-délégués
Texte intégral (3207 mots)
Voilà cinq ans que les élèves du secondaire ont l’obligation d’élire des éco-délégués dans chaque classe. Dans les faits cependant, cette intention n’est pas toujours respectée, et les perceptions quant à leur rôle varient fortement d’un établissement à l’autre.
À quoi servent les éco-délégués ? « Je ne sais pas », « aucune idée », « on n’a pas d’infos », ont répondu la moitié des 380 lycéens interrogés au sujet de leur expérience de l’éducation au développement durable dans leur lycée. Pourtant, chaque établissement scolaire a l’obligation d’organiser l’élection d’au moins un éco-délégué par classe, et ce depuis 2020.
Considérés comme les « pivots du développement durable dans les établissements », l’État les exhorte à devenir les « acteurs du changement » au sein d’un « peuple de colibris », à travers la voix de Jean-Michel Blanquer, alors ministre de l’éducation nationale.
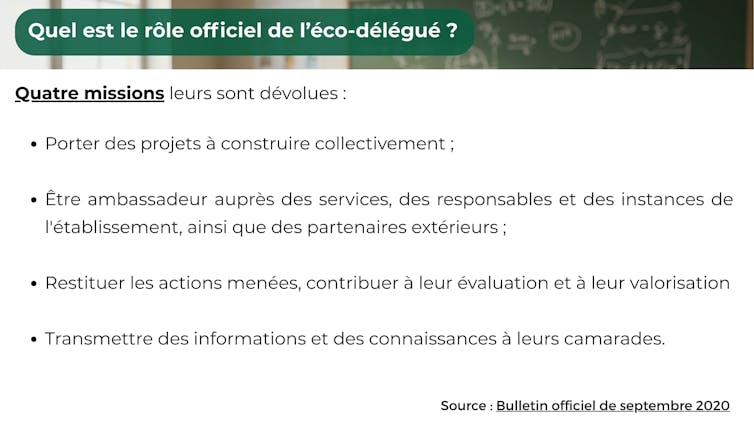
Cinq ans après cette mise en place obligatoire des éco-délégués, « la tension entre ces injonctions et les réalités du terrain » déjà évoquée en 2023 par les chercheuses Évelyne Bois, Aurélie Zwang et Mandarine Hugon, est toujours palpable.
À lire aussi : Être éco-délégués au collège ou au lycée : quels moyens d’action ?
Un bilan difficile à dresser en l’absence de données officielles
Le ministère de l’éducation nationale affiche certes l’ambition de 250 000 éco-délégués et promeut des ressources et dispositifs d’appui (guides pratiques, prix de l’action de l’éco-délégué, etc.). Cependant, aucun recensement officiel n’est disponible, ni à l’échelle de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), ni à celle des académies, ni même parfois à celle des établissements. Il est donc compliqué de savoir si chaque classe compte actuellement une ou un éco-délégué. Le travail de terrain nous permet toutefois de déceler que cette obligation n’est pas toujours suivie dans les faits.
Pour tenter de comprendre malgré tout le rôle effectif des éco-délégués, plusieurs ressources sont néanmoins disponibles :
une enquête menée en 2023-2024 en région Bretagne auprès d’établissements engagés dans des projets d’éducation au développement durable (EDD), relevant de l’éducation nationale ou de l’enseignement agricole, du secteur public ou privé, de la voie générale ou professionnelle.
les quelques travaux existants en science de l’éducation sur l’engagement des éco-délégués.
un discret et polémique rapport parlementaire portant sur l’animation des éco-délégués.
À la rencontre des éco-délégués
Des 380 répondants au questionnaire administré auprès de lycéens de Bretagne, 85 % indiquent la présence d’éco-délégués dans leur établissement, même au sein d’un lycée n’ayant pas encore mis en place le dispositif. Moins de 5 % déclarent être eux-mêmes éco-délégué au moment de l’enquête.
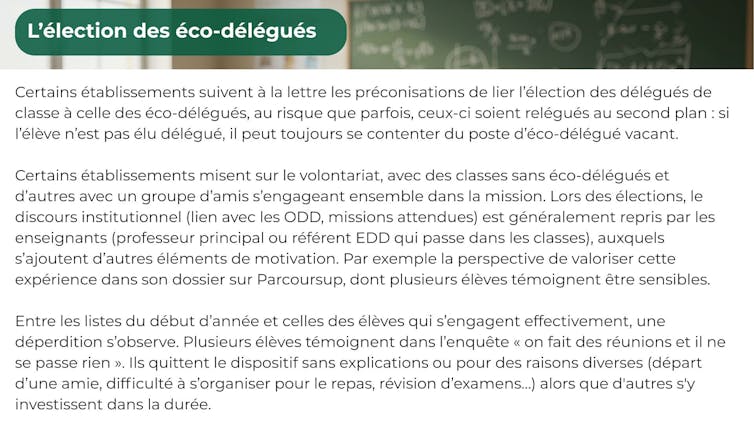
À la question « Quelles sont les activités menées par les éco-délégué·es ? », la réponse la plus fréquente (52 %) est donc « Je ne sais pas » ou sans réponse. La question étant ouverte, nous avons pu classer les réponses détaillées des 173 élèves ayant une idée des activités menées. Trois catégories d’acteurs peuvent alors se distinguer dans leurs perceptions du rôle des éco-délégués.
- Les « agents du changement » (30 %) : les éco-délégués sont avant tout perçus comme les prescripteurs des éco-gestes : ils « trouvent des activités sympas pour insister à ne pas polluer », note une lycéenne. Ils développent, souvent à l’aide de prestataires extérieurs, des nudges inspirés des théories du comportement, pour inciter à la préservation des ressources : une « affiche pour éteindre la lumière », un « autocollant qui se complète que lorsque l’on ferme la fenêtre », un « totem pour recycler le papier »… avec plus ou moins d’efficacité.
Ils peuvent aussi investir des espaces spécifiques, comme un potager, un jardin, un « club nature », ou contribuer à végétaliser la cour. Ils se réunissent souvent le midi, seul temps disponible pour les enseignants comme pour les élèves.
L’éco-délégué est parfois identifié comme l’ambassadeur dont on attend qu’il soit : celui qui « explique les actions et réfléchit à de nouvelles stratégies », qui « présente et propose les projets et motive les élèves », résument des enquêtés. Sa mission de sensibilisation peut progressivement consister à « s’interroger », « trouver des idées pour améliorer le monde pour plus tard », voire à « donner des cours aux camarades », énumèrent d’autres lycéens. Leurs actions « parfois petites mais qui font grandir le lycée » sont vues avec bienveillance. Ils contribuent à « améliorer la vie en communauté pour ne pas avoir à souffrir plus tard », assure une élève. Ils peuvent être perçus comme des innovateurs et apporter des solutions pour « sauver notre terre et l’améliorer », comme l’indique une éco-déléguée.
De façon très marginale, des actions en dehors de la sphère environnementale qui domine les discours sont parfois citées : comme de la sensibilisation sur le handicap, la mise en place de produits d’hygiène féminine ou des « boîtes à livres ».
« Les importuns inutiles » (5 %) : Pour certains, les éco-délégués ne font « rien », ou « pas grand-chose ». Leurs rencontres sont identifiées comme l’occasion de « rater les cours pour faire des réunions souvent inutiles » ou pour lesquelles « nous n’avons aucun retour », déplore un élève. Les élèves d’un lycée agricole public en zone rurale sont parmi ceux qui ont les mots les plus durs : les éco-délégués « nous cassent les oreilles » ou sont là « pour faire joli et apporter des idées qui n’aboutissent jamais ».
« Les opérateurs de tri » (13 %) : Les éco-délégués ramassent, trient, nettoient, compostent, luttent contre le gaspillage, construisent des poubelles, font des « clean walk » dans leurs lycées, dans leurs villes, sur les plages… Les déchets identifiés sont ceux qui sont visibles, comme le papier ou les mégots, alors que les déchets numériques qui ne cessent de croître ne sont pas mentionnés.
Agir sur les déchets demeure l’activité concrète la plus citée dans l’enquête : qu’elle soit l’unique action ou bien associée à d’autres, perçue de façon conforme aux attendus d’un éco-délégué « acteur du changement » ou de manière plus critique, comme chez ce lycéen qui ironise. « Ils ramassent les poubelles, on ne sait pas s’ils sont délégués ou éboueurs. »
Rappelons que la gestion des déchets dans un établissement scolaire public est une attribution des collectivités qui gèrent les bâtiments. Les projets des éco-délégués peuvent donc impliquer la collaboration d’agents de la collectivité qui sont rarement consultés et, au final, souvent dans l’incapacité de donner suite aux projets commencés, comme la création de composts abandonnés l’année suivante faute de personnel identifié pour les gérer. Il en est de même avec les actions des élèves autour des économies d’énergie dont la portée reste limitée face au défi que représente la rénovation énergétique des bâtiments scolaires, décidée à un tout autre niveau.
Sans remettre en cause l’importance de la gestion des déchets pour la cause écologique et sociale, nous pouvons cependant nous questionner sur l’intérêt d’en faire la mission principale des éco-délégués. Peu de réflexions sur l’origine de ces déchets (surconsommation, obsolescence programmée, mauvaise qualité, réglementation non respectée) ont été observées. Or, sans remise en cause du système à l’origine de la production de ces déchets, les éco-délégués risquent bien de n’occuper qu’une « fonction utilitariste au service des politiques libérales de croissance », pour reprendre les termes des chercheurs Jean-Marc Lange et Angela Barthes.
Un fort effet établissement
Le dispositif des éco-délégués peut également être perçu de manière très différente selon les contextes d’établissements. Dans l’enquête de terrain, les élèves de l’enseignement agricole considèrent les éco-délégués comme des « agents du changement » ou des « opérateurs du tri » dans une proportion supérieure aux attentes. Les élèves de l’éducation nationale suivant une voie de formation générale sont eux beaucoup plus que prévu à répondre ne pas savoir quelles sont les missions des éco-délégués.
Plus surprenant, les élèves d’un lycée pourtant labellisé « établissement en démarche de développement durable (E3D) » et ceux ayant participé à un projet régional sur les ODD (Objectifs de développement durable définis par les Nations unies) sont ceux qui affichent le plus haut pourcentage des « Je ne sais pas » (79 % et 70 %). À l’inverse, les élèves d’un lycée n’ayant pourtant pas encore organisé d’élections d’éco-délégués sont ceux qui les considèrent le plus comme « agents du changement » (49 %).
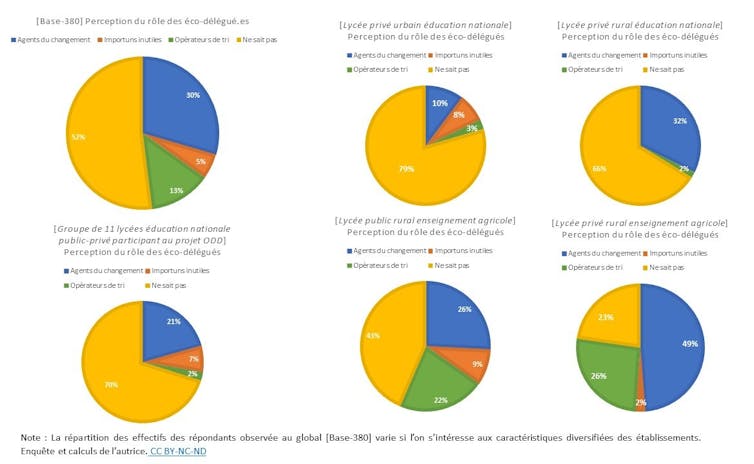
L’analyse du questionnaire indique par ailleurs que les perceptions des activités des éco-délégués ne varient pas significativement selon le genre, le niveau scolaire ni même selon le vécu scolaire : les élèves se déclarant en réussite ou en échec scolaire et les élèves déclarant avoir une expérience positive ou négative de leur scolarité ont des taux de réponse équivalents. Ainsi, l’effet établissement semble agir plus que le profil socio-scolaire des élèves sur leur perception du rôle de l’éco-délégué. Ces premiers résultats mériteraient cependant d’être consolidés à une échelle plus importante.
Enfin, qu’elle soit conforme aux prescriptions du ministère, restreinte aux déchets ou plus critique, la perception du rôle des éco-délégués se cantonne à la sphère écologique. Les systèmes politiques et économiques à l’origine de l’épuisement des ressources et de la surproduction de déchets ne sont quasiment jamais mentionnés. Cette dépolitisation de la question écologique, notamment dans un contexte scolaire, et « l’invisibilisation des enjeux sociaux » qui l’accompagne sont une tendance déjà bien repérée par les recherches en éducation, comme en témoigne le récent ouvrage d’Irène Pereira sur l’éco-pédagogie (2024).
Quant au profil socio-scolaire des éco-délégués, sans étude statistique nationale, difficile de dresser le portrait type. Le rapport parlementaire réalisé sur ce sujet par une députée de la majorité, dresse un panorama assez mitigé. Le dispositif des éco-délégué est accusé de renforcer les stéréotypes de genre en confiant les tâches du « care », et notamment du maintien de la propreté des lieux, aux filles plus qu’aux garçons. Constat déjà largement documenté en sociologie.
Si les éco-délégués perçoivent bien que l’on attend d’eux qu’ils soient force de propositions, ils sont pourtant dirigés, de manière explicite ou plus implicite, vers les actions déjà en cours ou impulsées par leurs encadrants, considérées comme réalisables et « allant dans le bon sens ». Un acteur du changement donc, mais dans les limites de l’acceptable.
Parmi les éco-délégués interrogés pendant l’enquête, certains s’épanouissent clairement dans leur mission, regrettent parfois qu’elle ne puisse pas s’étendre davantage ou se pérenniser d’une année sur l’autre ou d’un établissement à l’autre. Pour d’autres, elle est synonyme d’usure ou de déception, comme en témoigne cet éco-délégué élève de seconde (lycée privé, zone rurale) :
« C’est bien gentil de faire les petits gestes, mais un moment il va falloir faire les grands, et c’est pas le gouvernement qui s’en occupe. »
Tantôt colibris, tantôt ambassadeurs, tantôt sauveurs, tantôt éboueurs… les éco-délégués cumulent ainsi les casquettes sans véritables moyens pour agir, alors même que les défis auxquels ils sont censés répondre ne cessent de croître dramatiquement.
Certes, nous pouvons convenir que les cinq dernières années n’ont pas été de tout repos pour le milieu scolaire : crise sanitaire de la Covid et huit ministres de l’éducation nationale qui se sont succédé. Cependant, nous pouvons constater qu’après un engouement pour les enjeux de développement durable post-COP21, les moyens attribués au déploiement de l’éducation au développement durable peinent encore à être rassemblés à la hauteur des objectifs auxquels la France continue de s’engager, COP après COP.
À lire aussi : De COP en COP, une géopolitique de la procrastination climatique
Lise Trégloze a reçu une bourse de recherche doctorale de la région Bretagne (dispositif ARED).
06.01.2026 à 16:50
Comment promouvoir la durabilité grâce à des applications géolocalisées, sans pour autant inquiéter la vie privée des utilisateurs ?
Texte intégral (1023 mots)
En mettant en relation des inconnus autour du don, du partage et de la solidarité locale, les applications de géomatching apparaissent comme de puissants leviers des Objectifs de développement durable élaborés par l’ONU. Leur succès dépend pourtant d’un équilibre délicat entre impact sociétal, exposition des données personnelles et sentiment de sécurité.
Les 17 Objectifs de développement durable (ODD), élaborés par les Nations unies pour transformer le monde d’ici à 2030, nécessitent l’implication du plus grand nombre. Or, de nombreuses applications géolocalisées, fondées sur la mise en relation entre particuliers, offrent un potentiel considérable pour accélérer ce changement. Chaque ODD peut aujourd’hui s’appuyer sur des centaines d’initiatives de « géomatching ».
Pour l’ODD 1 (« pas de pauvreté »), par exemple, FallingFruit met à disposition des glaneurs plus de 4 039 ressources alimentaires distinctes, réparties sur près de deux millions de sites. GEEV permet de récupérer gratuitement des meubles près de chez soi, tandis qu’Olio facilite le partage des surplus alimentaires entre voisins grâce à une communauté de plus de 8 millions de membres.
Ces plates-formes génèrent des impacts concrets sur les trois piliers du développement durable :
Social : elles renforcent la solidarité locale et créent de nouveaux liens sociaux ;
Économique : elles réduisent la pauvreté et améliorent le quotidien de chacun ;
Environnemental : elles diminuent les déchets et prolongent la durée de vie des objets.
Une épineuse question de sécurité
Cependant, leur fonctionnement repose sur la divulgation de données personnelles, notamment la géolocalisation reconnue comme particulièrement sensible par la Commission européenne. Contrairement aux transactions classiques sur des plates-formes comme Leboncoin ou Vinted, les applications de géomatching impliquent souvent une rencontre physique, parfois au domicile d’un particulier.
Aller chez un inconnu ou accueillir un inconnu chez soi n’est pas anodin. La confiance que l’on peut accorder à une marque pour personnaliser des offres ne suffit plus : ici, les données doivent être partagées directement avec d’autres utilisateurs. Ce besoin de sécurité explique le succès d’applications comme Gensdeconfiance, fondées sur la recommandation entre membres.
Les risques perçus sont renforcés par le contexte : augmentation des violations de données, multiplication des infox, usurpations d’identité… Les internautes sont méfiants : 72 % se disent préoccupés par la traçabilité de leurs activités en ligne (enquête de l’Insee auprès des ménages sur les technologies de l’information et de la communication de 2021) surtout que les violations notifiées à la CNIL ont augmenté de 20 % en 2024. Ainsi 76 % ont limité ou renoncé, selon l’enquête Insee TIC de 2019, à une activité en ligne à cause de craintes sur la sécurité.
Une piste : la présence sociale
Face à ces inquiétudes, une piste prometteuse émerge : la présence sociale. Elle désigne la capacité d’une interface numérique à faire ressentir une présence humaine. En humanisant l’expérience, elle rassure et contrebalance partiellement le sentiment de sacrifice inhérent au partage de données personnelles. Elle donne à l’utilisateur l’impression d’intégrer une communauté active, plutôt que de confier ses informations à un espace impersonnel.
Concrètement, cette présence sociale peut être renforcée grâce à des indicateurs communautaires :
nombre de visites déjà effectuées chez un membre,
quantité de fruits glanés,
photos du lieu,
retours d’expérience visibles et authentifiés.
Plutôt que de mettre en avant les « meilleures ventes » comme le font de nombreuses plates-formes, le design de l’application pourrait valoriser les interactions réelles, les contributions et les preuves d’activité. Cela rendrait la communauté plus vivante, plus incarnée, et donc plus rassurante.
Le rôle ambivalent des algorithmes
Dans les applications de géomatching, la confiance ne repose pas uniquement sur des recommandations explicites, comme dans Gensdeconfiance, mais aussi sur cette impression de proximité humaine. Les algorithmes et l’IA ont un rôle ambivalent : ils peuvent enrichir cette présence (avec, par exemple, des agents conversationnels sociaux) ou au contraire nourrir la méfiance (en renforçant la crainte des faux avis ou des profils fictifs). L’enjeu est donc de concevoir des technologies qui servent la confiance, plutôt que de l’éroder.
Si ces conditions sont réunies, les applications de géomatching pourraient connaître une adoption bien plus large et contribuer véritablement à l’atteinte des 17 ODD. Alors, pourquoi ne pas commencer dès maintenant à explorer ces initiatives et à agir, à votre échelle, en faveur de la planète ?
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
06.01.2026 à 16:48
Ce que l’Athènes antique nous enseigne sur le débat – et la dissidence – à l’ère des réseaux sociaux
Texte intégral (1622 mots)

Dans l’Athènes antique, l’agora était un forum public où les citoyens pouvaient se réunir pour délibérer, débattre et prendre des décisions ensemble. Elle était régie par des principes sociaux profondément enracinés qui garantissaient des débats animés, inclusifs et sains.
Aujourd’hui, nos places publiques se sont déplacées en ligne vers les flux numériques et les forums des réseaux sociaux. Ces espaces sont pour la plupart dépourvus de règles et de codes communautaires. Ce sont plutôt des algorithmes qui décident quelles voix s’élèvent au-dessus du tumulte et lesquelles sont étouffées.
L’idée optimiste selon laquelle Internet serait un espace radicalement démocratique semble désormais un lointain souvenir. Nos conversations sont désormais façonnées par des systèmes opaques conçus pour maximiser l’engagement, et non la compréhension mutuelle. C’est la popularité algorithmique, et non l’exactitude ou la diversité des voix, qui détermine la portée des propos publiés en ligne.
Cela a créé un paradoxe. Nous jouissons d’une liberté d’expression sans précédent, mais notre discours est limité par des forces qui échappent à notre contrôle. Les voix fortes dominent. Les voix nuancées s’estompent. L’indignation se propage plus vite que la réflexion. Dans ce contexte, la participation égalitaire est pratiquement inaccessible, et s’exprimer honnêtement peut comporter un risque très réel.
Entre les marches de pierre d’Athènes et les écrans d’aujourd’hui, nous avons perdu quelque chose d’essentiel à notre vie démocratique et à notre dialogue : l’équilibre entre l’égalité de la parole et le courage de dire la vérité, même lorsque cela est dangereux. Deux anciens idéaux athéniens de liberté d’expression, l’isegoria et la parrhesia, peuvent nous aider à le retrouver.
Des idées anciennes qui nous guident encore aujourd’hui
À Athènes, l’isegoria désignait le droit de s’exprimer, mais elle ne se limitait pas à un simple droit. Elle représentait une responsabilité partagée, un engagement en faveur de l’équité et l’idée que la vie publique ne devait pas être gouvernée uniquement par les puissants.
Le terme parrhesia peut être défini comme l’audace ou la liberté d’expression. Là encore, il y a une nuance : la parrhesia n’est pas une franchise imprudente, mais un courage éthique. Elle désignait le devoir de dire la vérité, même lorsque celle-ci provoquait un malaise ou un danger.
Ces idéaux n’étaient pas des principes abstraits. Il s’agissait de pratiques civiques, apprises et renforcées par la participation. Les Athéniens comprenaient que le discours démocratique était à la fois un droit et une responsabilité, et que la qualité de la vie publique dépendait du caractère de ses citoyens.
La sphère numérique a changé le contexte, mais pas l’importance de ces vertus. L’accès seul ne suffit pas. Sans normes qui soutiennent l’égalité des voix et encouragent la vérité, la liberté d’expression devient vulnérable à la distorsion, à l’intimidation et à la manipulation.
L’émergence de contenus générés par l’intelligence artificielle (IA) intensifie ces pressions. Les citoyens doivent désormais naviguer non seulement parmi les voix humaines, mais aussi parmi celles produites par des machines qui brouillent les frontières entre crédibilité et intention.
Quand être entendu devient un privilège
Sur les plateformes contemporaines, la visibilité est répartie de manière inégale et souvent imprévisible. Les algorithmes ont tendance à amplifier les idées qui suscitent des émotions fortes, quelle que soit leur valeur. Les communautés déjà marginalisées peuvent se retrouver ignorées, tandis que celles qui prospèrent grâce à la provocation peuvent dominer la conversation.
Sur Internet, l’isegoria est remise en question d’une nouvelle manière. Peu de personnes en sont formellement exclues, mais beaucoup sont structurellement invisibles. Le droit de s’exprimer demeure, mais la possibilité d’être entendu est inégale.
Dans le même temps, la parrhesia devient plus précaire. S’exprimer avec honnêteté, en particulier sur des questions controversées, peut exposer les individus à du harcèlement, à des déformations ou à une atteinte à leur réputation. Le prix du courage a augmenté, tandis que les incitations à rester silencieux ou à se réfugier dans des chambres d’écho se sont multipliées.
À lire aussi : Social media can cause stress in real life – our 'digital thermometer' helps track it
Former des citoyens, pas des spectateurs
Les Athéniens avaient compris que les vertus démocratiques ne surgissent pas toutes seules. L’isegoria et la parrhesia se maintenaient grâce à des habitudes acquises au fil du temps : écouter était considéré comme un devoir civique, parler comme une responsabilité partagée, tout en reconnaissant que la vie publique dépendait de la personnalité de ses participants. À notre époque, c’est à travers l’éducation civique que les citoyens mettent en pratique les dispositions requises par le discours démocratique.
En transformant les salles de classe en agoras à petite échelle, les élèves peuvent apprendre à vivre la tension éthique entre l’égalité des voix et l’intégrité de la parole. Les activités qui invitent au dialogue partagé, à la prise de parole équitable et à l’attention portée aux voix les plus discrètes les aident à faire l’expérience de l’isegoria, non pas comme un droit abstrait, mais comme une pratique vécue de l’équité.
Dans la pratique, cela prend la forme de discussions et de débats au cours desquels les élèves doivent vérifier des informations, formuler et justifier des arguments, réviser leurs opinions publiquement ou débattre de manière respectueuse avec des arguments contraires. Toutes ces compétences cultivent le courage intellectuel associé à la parrhesia.
Il est important de noter que ces expériences ne dictent pas ce que les élèves doivent croire. Elles leur permettent plutôt de s’exercer à adopter des habitudes qui les rendent responsables de leurs convictions : la discipline de l’écoute, la volonté d’exposer ses arguments et la disposition à affiner sa position à la lumière de nouvelles connaissances. De telles pratiques rétablissent le sentiment que la participation démocratique n’est pas seulement liée à la liberté d’expression individuelle, mais relationnelle et construite grâce à un effort commun.
Ce que l’éducation civique offre en fin de compte, c’est de la pratique. Elle crée des agoras miniatures où les élèves s’entraînent aux compétences dont ils ont besoin en tant que citoyens : s’exprimer clairement, écouter généreusement, remettre en question les idées reçues et dialoguer avec ceux qui pensent différemment.
Ces habitudes contrebalancent les pressions du monde numérique. Elles ralentissent la conversation dans des espaces conçus pour la rapidité. Elles introduisent la réflexion dans des environnements conçus pour la réaction. Elles nous rappellent que le discours démocratique n’est pas une performance, mais une responsabilité partagée.
Retrouver l’esprit de l’agora
Le défi de notre époque n’est pas seulement technologique, mais aussi éducatif. Aucun algorithme ne peut enseigner la responsabilité, le courage ou l’équité. Ce sont des qualités qui s’acquièrent par l’expérience, la réflexion et la pratique. Les Athéniens l’avaient compris intuitivement, car leur démocratie reposait sur la capacité des citoyens ordinaires à apprendre à s’exprimer d’égal à égal et avec intégrité.
Nous sommes confrontés au même défi aujourd’hui. Si nous voulons des places publiques numériques qui soutiennent la vie démocratique, nous devons préparer les citoyens à les utiliser à bon escient. L’éducation civique n’est pas un enrichissement facultatif, c’est le terrain d’entraînement des habitudes qui soutiennent la liberté.
L’agora a peut-être changé de forme, mais son objectif demeure. Se parler et s’écouter d’égal à égal, avec honnêteté, courage et attention, reste au cœur de la démocratie. Et c’est quelque chose que nous pouvons enseigner.
Sara Kells ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
06.01.2026 à 15:32
Le Venezuela, un dominion des États-Unis ?
Texte intégral (2120 mots)
Dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026, les forces armées américaines ont lancé et conduit l’opération militaire massive « Absolute resolve » afin de kidnapper le président vénézuélien Nicolas Maduro au palais Miraflores, à Caracas. Dans la foulée, Donald Trump a annoncé que les États-Unis « dirigeraient » temporairement le Venezuela en attendant la prise de pouvoir d’un gouvernement favorable aux États-Unis (like minded). Pourtant, la vice-présidente Delcy Rodriguez, légalement au pouvoir depuis l’incarcération de Maduro, annonce désormais son intention d’assumer la direction de l’État. Quel destin se prépare pour le pays, entre interventionnisme trumpiste, sursaut nationaliste anti-impérialiste et protestations internationales ?
Une intervention militaire conduite sans base légale et au nom de la « sécurité des États-Unis » ; la destitution et l’emprisonnement du dictateur au pouvoir ; l’annonce de la future prise de contrôle du pays par les forces armées et les entreprises états-uniennes : tout cela rappelle l’opération contre l’Irak et Saddam Hussein de 2003.
Le parallèle avec l’opération irakienne – officiellement destinée à prévenir l’usage d’armes de destruction massive (demeurées introuvables) – est limité : cette fois, derrière le prétexte de la lutte contre le « narcoterrorisme », Donald Trump reconnaît sans ambages le rôle clé qu’occupent les ressources pétrolières dans les motivations profondes de cette opération. Ceux qui veulent y voir une défense de la démocratie en seront pour leurs frais : la promotion de la démocratie et la lutte contre les dictatures sont au centre des discours européens, mais pratiquement absents de ceux de l’équipe Trump.
En outre, l’invasion de 2003 visait à détruire l’État du parti Baas irakien ; or, ce n’est pas l’opposante Maria Corina Machado, prix Nobel de la paix 2025, qui est appelée à gouverner le Venezuela, mais la vice-présidente en exercice Delcy Rodriguez. La situation fait dès lors penser, à ce stade, à l’accaparement des ressources vénézuéliennes par une puissance extérieure, couplé à un lâchage interne de Maduro au sein du régime, quand bien même Rodriguez a exigé sa libération.
Par conséquent, la question cruciale n’est sans doute pas « qui gouverne », mais « comment gouverner après ».
Le Venezuela de Rodriguez, entre souveraineté limitée et nationalisme blessé
L’enlèvement de Nicolas Maduro n’empêche pas la Constitution vénézuélienne de 1999 de continuer de s’appliquer.
L’opération militaire conduite par les États-Unis destitue un des titulaires du pouvoir, mais ne transforme pas mécaniquement les structures politiques, sociales ou économiques du pays. Elle introduit en revanche une contrainte durable. Le nouveau régime doit gouverner sous le regard simultané d’une puissance extérieure tutélaire, qui a montré sa capacité d’intervention, et dont sa survie dépend aujourd’hui, et d’une société nationale très attentive aux signes d’autonomie ou de mise sous tutelle, et foncièrement divisée.

Cette tension place le pouvoir de Delcy Rodriguez dans une double contrainte : d’une part, éviter une nouvelle intervention en se conciliant la faveur de l’administration Trump ; d’autre part, satisfaire les aspirations de la population au respect d’une souveraineté mise à mal par l’ingérence américaine. En un mot, elle doit combiner survie face à Trump et rhétorique nationaliste compensatoire : elle a par exemple dénoncé la teneur « sioniste » (comprenez colonisatrice) de l’expédition américaine, qualifiée de « kidnapping » et de « barbarie » violant le droit international.
Si Rodriguez et son entourage optent pour un discours trop musclé et offensif à l’égard de Washington, cela offrira à Donald Trump un prétexte pour procéder à un changement de régime complet, ce qui supposerait une action et un investissement beaucoup plus conséquents. Le Venezuela vit donc dorénavant dans un régime de « souveraineté limitée », comme l’annonçait en décembre la nouvelle stratégie nationale de sécurité américaine.
À lire aussi : L’internationale trumpiste : la Stratégie de sécurité nationale 2025 comme manifeste idéologique
Dans ce contexte, trois destinées sont aujourd’hui ouvertes pour le pays.
Scénario 1, le chavisme sans Chavez ni Maduro : un Thermidor caribéen sous surveillance états-unienne
Premier scénario : une continuité réelle malgré une rupture affichée. Pour les élites bolivariennes, lâcher Maduro a peut-être été le prix à payer pour sauver l’État, restaurer une forme de rationalité, sortir le pays de l’isolement.
Les visages changent à peine, les uniformes pas encore. Durant les six premiers mois, les sanctions américaines pourraient être partiellement suspendues, les marchés pourraient réagir avec prudence, et les institutions seraient « normalisées » plutôt que transformées. Dans ce scénario, le nouveau pouvoir ne parle que de stabilité, jamais de refondation, et gouverne par décrets techniques sous la surveillance discrète des États-Unis, dont l’attention sera focalisée sur la possession des champs pétroliers.
Au bout d’un an, la démocratie revendiquée par les opposants au chavisme sera renvoyée à plus tard, et les structures du pouvoir resteront quasiment intactes. Comme lors du 9-Thermidor en 1794, les excès ont été liquidés, pas le système.
Scénario 2, la souveraineté limitée : un « moment Kadar » tropical
Tout commence par une fracture interne inattendue. Ni chaviste orthodoxe ni opposition traditionnelle, un nouveau centre de gravité politique émerge dans l’entre‑deux, porté par des acteurs fatigués des extrêmes et décidés à stabiliser le pays. Les différentes oppositions (MAGA-compatibles ou non) convergent et s’allient aux « chavistes modérés » (gouverneurs pragmatiques, militaires de second rang, technocrates issus du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV)
– la formation chaviste –, qui veulent éviter l’effondrement total) pour proposer au pays un régime de transition qui garantit une certaine souveraineté nationale. Dans les six premiers mois, un pacte social minimal est proposé, la coercition recule temporairement, et l’économie redémarre grâce à une série de mesures pragmatiques.
La surprise vient de la société elle‑même : la demande de « vie normale » devient dominante, affaiblissant (peut-être momentanément) la polarisation. Le pays semble entrer dans une phase de pacification inattendue, presque involontaire.
Mais au bout de quelques mois, probablement vers l’automne 2026, surgissent des troubles internes : grèves sectorielles, protestations corporatistes, tensions régionales. Rien de décisif pour la stabilité du régime, mais suffisamment pour rappeler que celui-ci reste fragile. Le pouvoir répond par une combinaison de concessions ciblées et de fermeté mesurée, évitant l’escalade tout en réaffirmant son autorité.
Ces turbulences, paradoxalement, renforcent le récit du compromis : le régime se présente comme le seul capable de contenir le chaos sans revenir à la répression systématique. Comme avec le pouvoir de Janos Kadar instauré en Hongrie après 1956 (à la suite de l’écrasement par l’URSS de l’insurrection de Budapest), ce n’est ni une victoire idéologique ni une défaite politique : c’est la fatigue historique qui gouverne, et la société accepte le compromis, faute de mieux.
Dans ce scénario, les États-Unis jouent un rôle bien plus important : ils soutiennent l’arrivée au pouvoir d’un dirigeant d’inspiration MAGA à Caracas, à l’instar des Soviétiques qui ont porté Janos Kadar à la tête de la Hongrie.
Scénario 3, une évolution à la cubaine pré-castriste : un dominion américain
Si la souveraineté reste intacte sur le papier, la capacité de négociation du pouvoir chaviste est déjà très entamée en ce début d’année 2026. Une fois installé le nouveau leadership, soutenu par Washington et aligné sur ses priorités, vient alors la phase de réouverture sous contrainte : levée conditionnelle des sanctions, retour des majors états-uniennes, accords d’exploitation conclus dans l’urgence. Les nouveaux contrats s’étendent sur des décennies, verrouillés par des clauses de stabilisation et une fiscalité avantageuse pour les intérêts des majors. Le pétrole demeure vénézuélien, mais la rente, elle, devient extraterritoriale, profitable aux milieux économiques des États-Unis.
La troisième phase consacre la captation de la valeur : technologies, assurances, transport et raffinage sont externalisés, les revenus rapatriés hors du pays, et l’État réduit à une fonction fiscale minimale. Le Venezuela produit beaucoup, capte peu et dépend désormais de flux qu’il ne contrôle plus.
Enfin, cette dépendance se normalise. Le récit dominant affirme que « c’est le prix de la stabilité » ; la souveraineté pétrolière est dépolitisée ; et les fractures sociales s’approfondissent. Le pillage n’est plus seulement visible : il est institutionnalisé.
En somme, le Venezuela subit le sort de Cuba entre l’adoption de l’amendement Platt (1901), qui officialisa le droit d’ingérence des États-Unis sur la République de Cuba, et la révolution castriste (1959) : il devient un dominion des États-Unis.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
06.01.2026 à 15:27
Denaturalization in the Trump era: When the State questions the citizenship of millions of Americans
Texte intégral (2438 mots)
It is recognised in US law that the government may not take away a naturalized person’s citizenship except in cases of fraud or error on a naturalization application. The Supreme Court has clearly established that unless citizenship was unlawfully procured, denaturalization is unconstitutional. However, a memo issued by the Department of Justice (DoJ) in June attempts to broaden the grounds for denaturalization, potentially putting over 24.5 million naturalized US citizens at risk.
The memo states that the current US administration has directed the DoJ’s Civil Division to “advance the administration’s policy objectives”, among which is “prioritizing denaturalization”. Under this directive, the division is to investigate individuals who either “illegally procured” or “conceal[ed] a material fact” in their naturalization applications. The text outlines 10 “categories” of priority cases, which include individuals who “pose a potential danger to national security”; who “engaged in various forms of financial fraud”, including fraud associated with the Medicaid and Medicare healthcare programmes; and “any other cases referred to the Civil Division that the Division determines to be sufficiently important to pursue”.
The memo could broaden the scope of grounds previously used for denaturalization and will likely face legal challenge. Since September, the DoJ has filed denaturalization complaints against individuals for reasons such as providing false testimony and concealing identity, and for other crimes. In November, following a DoJ complaint filed in August, a US judge revoked the citizenship of a naturalized individual who had pleaded guilty to conspiracy to commit health care fraud. President Donald Trump, in a recent post on Truth Social, reaffirmed his commitment to “denaturalize migrants who undermine domestic tranquillity” and further stated, on November 30, in response to a shooting in Washington, DC, “if I have the power to do it… I would denaturalize, absolutely”.**
The DoJ memo represents a departure from 50 years of US policy between 1967 and mid-June 2017 – nearly five months into Donald Trump’s first term as president. During this period, the practice of citizenship stripping was rare and used primarily in extreme cases, such as for war criminals. In contrast, between 1906 and 1967, the US denaturalized more citizens than any other democracy. Several news and academic sources have highlighted what some see as similar motivations behind the current administration’s directive and past initiatives. It is also important to note that the DoJ memo will afford a discretion that could be much wider than in the past.
Denaturalization in the 20th Century
The original purpose of denaturalization in the US, put into force by the Naturalization Act of 1906, was to wipe out so-called “disbelievers in organized government” from society. The early cases were against political dissidents – some self-described, and some alleged socialists, anarchists and radicals – and often included journalists or labour unionists. One notable case is that of Emma Goldman, the first person to be denaturalized for her political views. Goldman was an anarchist who eventually lost her citizenship due to her activism against US involvement in the First World War. Denaturalization for political views was linked to two provisions in naturalization law: the requirement that a person have “good moral character” and that applicants be “attached to the principles of the US Constitution.”
One of the largest citizenship-stripping campaigns started in the 1940s, after the Nationality Act of 1940 gave naturalization authority to the DoJ. Once more, the primary targets were those with so-called “subversive” beliefs, particularly those with any affiliations to the Communist Party or the German American Bund. After the government denaturalized more than 22,000 people, this particular wave was halted by the Supreme Court in 1943, which declared that a person could not be denaturalized without “clear, unequivocal, and convincing evidence” that they were planning for the violent overthrow of the government. This became a standard impossible to prove, and cases of denaturalization subsided. In 1967, the Court decided that denaturalization was altogether unconstitutional except in cases of fraud or error in a naturalization application, and since, there have been only a handful of cases per year.
The DoJ memo doesn’t refer to ideological views such as “communism” or “socialism”, although the policy manual for US Citizen and Immigration Services (USCIS) states that an individual may be denaturalized “if the person becomes a member of, or affiliated with, the Communist party”. However, the first priority in the memo mentions anyone who “[poses] a potential danger to national security”, which can be broadly interpreted.
Threatening comments
In July, Trump made comments that raised questions about whether the beliefs of some naturalized individuals may put them at risk. These comments were about New York City mayor-elect Zohran Mamdani and actor Rosie O’Donnell. After US Congressman Andy Ogles threatened Mamdani, then a mayoral candidate, with a denaturalization investigation for rap lyrics Mamdani wrote in 2017 that Ogles viewed as “publicly praising” individuals convicted of supporting the militant Palestinian group Hamas, Trump said “a lot of people are saying he’s here illegally” and “we’re going to look at everything”. And the president threatened the birthright citizenship of O’Donnell, who was born in New York, saying that she “is not in the best interests of our Great Country”. Because O’Donnell is a natural-born citizen, there is no provision in US law to revoke her citizenship unless she provides her explicit consent. It’s also worth noting that Trump said he would “take a look” into the question of deporting billionaire Elon Musk, who became a naturalized citizen in 2002, after the Tesla CEO criticised the spending bill that passed into law in early July.“
Threatening denaturalization for opinions or statements, that while perhaps controversial are peaceful, reaches much further than the historical standard of believing in the "violent takeover of government” used to start a denaturalization proceeding in the past. Such threats generate a climate of fear where certain individuals and groups may be scared to voice opinions out of the threat of ending up in a denaturalization trial.
The expanded notion of ‘fraudulent acquisition’
Since 1967, fraudulent acquisition of citizenship has been the exclusive justification for denaturalization. Up until recently, this has been interpreted as a nondisclosure of information on a naturalization application that would have impacted the outcome of the application.
There has been an increasing number of investigations of fraudulent acquisition since 2008, the year that saw “Operation Janus”. This Obama-era policy targeted individuals who had been sent a deportation letter as an immigrant but had subsequently naturalized using a different name. The main driver was the digitization of records and fingerprint testing, which made it easier to identify discrepancies. In 2016, Trump expanded the operation to allow USCIS to investigate over 700,000 cases, marking the first push to “revive denaturalization”.
As scholars have argued, identifying fraud or a mistake is not always clear cut. For example, the US naturalization form asks whether a person has ever committed a crime, but does not specify what is included in its definition of a crime. It is unknown whether a crime committed in another jurisdiction that is not a crime under US law would count. This could have implications for same-sex couples or trans persons who come from countries where their status is illegal – such as in Uganda.
The June DoJ memo further expands what is considered as fraud for denaturalization to include instances of “loan fraud” or “Medicaid/Medicare fraud.” These types of fraud would likely not have previously met the standard of “willful misrepresentation” or “concealing material fact” that would have impacted the outcome of the naturalization process, since they are not related to a person’s immigration history.
Looking at denaturalization through the lens of race
While the memo does not mention race or ethnicity, some lawyers and legal scholars are concerned that, read alongside other developments in the current administration’s management of immigration, it will disproportionately affect certain minority and low-income communities.
Historically, race has been an explicit factor in immigration and denaturalization. Up until 1952, US citizenship law stated that only “white persons, persons of African nativity or descent, and descendants of races indigenous to the Western hemisphere” could be naturalized. In the 1920s, more than 50 naturalized individuals of Indian origin had their citizenship revoked after the Supreme Court decided that people from India were not “white” in “the understanding of the common man”
The DoJ memo came nearly three months after the deportation of hundreds of Venezuelan men with tenuous or non-existent ties to gangs or drug cartels, and nearly two months before a Supreme Court decision that allowed Immigration and Customs Enforcement (ICE) agents to use racial profiling in immigration raids in Los Angeles.
Some human rights groups and journalists have compared ICE immigration enforcement to how the US “War on Drugs” fuelled the mass incarceration of certain low-income and minority groups. As Sarah Tosh, a professor at Rutgers University, wrote in 2021, “these processes draw from a long history of targeted drug enforcement that has served to scapegoat, punish, and exclude immigrants and native-born racial minorities”.
Repeat of history or something bigger?
Unlike some European countries, the US previously had strong safeguards against denaturalization since the Supreme Court’s 1967 ruling. Since the end of September, the government has filed at least thirteen denaturalization actions (exact numbers are not publicly available), 11 of these actions were filed and publicly disclosed between September 30 and January 20, 2025, the beginning of Trump’s second term.
The “One Big Beautiful Bill Act” that passed in July allocated more than $3 billion in additional funds to the DoJ to exercise the administration’s immigration priorities – such as hiring immigration judges, staffing, and investigations.
The expansion of the potential grounds for denaturalization, the upcoming Supreme Court review of birthright citizenship, and even Ohio Senator Bernie Moreno’s recently proposed legislation to ban dual citizenship mark the potential for some of the most fundamental shifts in US citizenship to date. While some have rightly made the connection between present and past denaturalization initiatives, it remains to be seen how the Justice Department will make use of the memo’s criteria for denaturalization during the rest of Trump’s mandate.
Ashley Mantha-Hollands ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
06.01.2026 à 15:01
Apprendre les maths autrement : les pistes de la recherche
Texte intégral (1634 mots)
Si les mathématiques sont unanimement considérées comme décisives dans notre société, elles suscitent nombre de craintes chez les élèves. Les rendre plus accessibles suppose donc de changer leur enseignement. Mais comment ? Le succès de situations « adidactiques » offre quelques pistes à la recherche. Explications.
Parus en décembre 2025, les résultats de la grande consultation nationale sur la place des mathématiques lancée par le CNRS montrent que beaucoup de Français se sentent peu à l’aise avec les mathématiques même s’ils reconnaissent l’importance de cette discipline pour la société. À la suite de cette consultation et des Assises des mathématiques de 2022, le CRNS a défini des orientations prioritaires, dont l’amélioration de l’inclusion. Mais comment rendre les mathématiques plus accessibles à tous ?
Les participants à la consultation de 2025 suggèrent notamment de « généraliser des méthodes d’enseignement variées, concrètes, ludiques et encourageantes, qui valorisent notamment le droit à l’erreur, tout au long de la scolarité ».
Dans ce sens, depuis plusieurs années, nous expérimentons dans des classes ordinaires (avec l’hétérogénéité des profils d’élèves qui les caractérisent !) des séquences de mathématiques inclusives. En quoi se distinguent-elles des modes d’enseignement classiques ? Et que nous apprennent leurs résultats ?
Mettre l’élève en situation de recherche
Ces séquences de maths inclusives s’appuient sur des situations à dimension adidactique, c’est-à-dire des situations qui intègrent des rétroactions de sorte que l’élève n’ait pas besoin que l’enseignant lui apporte des connaissances. C’est en interagissant avec la situation et en s’adaptant aux contraintes de celle-ci que l’élève construit de nouvelles connaissances. Il ne le fait pas en essayant de deviner les intentions didactiques de l’enseignant (c’est-à-dire en essayant de deviner ce que l’enseignant veut lui enseigner), d’où l’appellation « adidactique ».
Comme le dit le spécialiste de l’enseignement des maths Guy Brousseau, à l’origine de ce concept dans les années 1970-1980 :
« L’élève sait bien que le problème a été choisi pour lui faire acquérir une connaissance nouvelle, mais il doit savoir aussi que cette connaissance est entièrement justifiée par la logique interne de la situation et qu’il peut la construire sans faire appel à des raisons didactiques. »
Ces situations ont un potentiel identifié depuis longtemps et mis à l’épreuve dans les classes à grande échelle depuis 40 ans (surtout du premier degré, notamment dans l’école associée au Centre d’observation et de recherches sur l’enseignement). Ces travaux ont également donné lieu à des ressources pour les enseignants, par exemple la collection Ermel.
Dans le cadre de nos recherches, nous avons, par exemple, conçu et testé dans plusieurs écoles (REP+, milieu rural, milieu urbain…) une séquence en CM1-CM2 qui s’appuie sur la situation des napperons de Marie-Lise Peltier. Les élèves y ont à disposition une feuille de papier carrée, ils doivent reproduire un modèle de napperon en pliant et en découpant leur feuille. C’est la notion de symétrie axiale qui permet de découper un napperon conforme au modèle, et l’élève peut s’autovalider en comparant sa production au modèle donné.
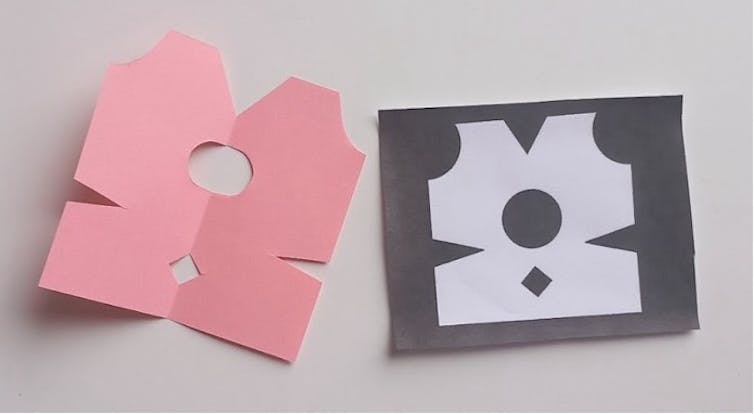
Mettre en œuvre une situation à dimension adidactique peut s’avérer complexe, car le rôle de l’enseignant diffère de ce dont il a l’habitude ; ici, il n’apporte pas directement les connaissances même s’il peut aider les élèves à résoudre la tâche.
De plus, les élèves peuvent élaborer des stratégies très diverses, ce qui peut les déstabiliser. Cependant, cette diversité constitue également une richesse du point de vue de l’inclusion, car chaque élève peut s’investir à la hauteur de ses moyens. Par ailleurs, ces situations permettent de stimuler l’engagement des élèves et les mettent dans une véritable activité de recherche, ce qui constitue le cœur des mathématiques.
Donner du sens aux notions mathématiques
À l’heure actuelle, ce type de situations est peu mis en œuvre, en particulier auprès des élèves en difficulté, car les enseignants ont plutôt tendance à penser qu’il faut découper les problèmes complexes en tâches les plus simples possibles pour s’assurer de la réussite des élèves. Cependant, la réalisation juxtaposée de tâches simples et isolées ne permet pas, souvent, de donner du sens aux notions mathématiques en jeu ni de motiver les élèves.
Dans l’exemple autour des napperons, nous avons constaté qu’en s’appuyant sur les rétroactions, mais aussi parfois sur leurs pairs et sur les conseils de l’enseignant, la majorité des élèves de CM1-CM2 que nous avons observés réussit à produire un napperon conforme au modèle, alors même que, parmi ces élèves, plusieurs avaient été signalés comme étant « en difficulté ».
Même les élèves n’étant pas arrivés à produire un napperon conforme dans le temps imparti se sont fortement engagés, comme en témoigne le nombre important de réalisations. Nous pouvons faire l’hypothèse que cette situation pourra constituer une situation de référence pour eux quand ils aborderont de nouveau la notion de symétrie axiale.
À lire aussi : Six façons de faire aimer les maths à votre enfant
Les aspects positifs et les défis que nous avons pu identifier dans notre recherche corroborent les résultats obtenus par d’autres chercheurs et chercheuses qui ont étudié la mise en œuvre de situations à dimension adidactique pour travailler diverses notions mathématiques, à différents niveaux scolaires, auprès de publics variés, notamment auprès d’élèves présentant une déficience intellectuelle ou un trouble dys, en France et au Québec.
Ainsi, même si ce concept n’est pas nouveau, l’appui sur les situations à dimension adidactique nous semble toujours une piste intéressante et actuelle pour penser l’enseignement des mathématiques pour tous. Cependant, il est nécessaire de donner aux enseignants les moyens de les mettre en œuvre de manière satisfaisante, par exemple en allégeant le nombre d’élèves par classe et en les accompagnant en formation initiale et continue.
Florence Peteers est porteuse de la Chaire Junior SHS RIEMa financée par la région Île-de-France et a reçu des financements du PIA3 100% IDT (inclusion, un défi, un territoire) porté par l’Université de Picardie Jules Verne.
Elann Lesnes a reçu reçu des financements du PIA3 100% IDT (inclusion, un défi, un territoire) porté par l’Université de Picardie Jules Verne.
