ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture
08.10.2025 à 16:27
Sharjah, une « ville ordinaire » dans le Golfe ?
Texte intégral (2935 mots)

Gratte-ciel le plus haut du monde, pistes de ski dans des centres commerciaux en plein désert… Les Émirats arabes unis sont connus pour leurs projets urbains hors norme et leur goût pour la démesure. Sharjah, troisième ville la plus peuplée du pays après Dubaï et Abu Dhabi, a opté pour un chemin différent.
Sharjah, avec ses presque deux millions d’habitants, est-elle un « anti-Dubaï », comme le suggère Marc Lavergne, l’un des rares géographes français à s’y être intéressé ?
Agglomérée à la capitale économique des Émirats arabes unis, mais séparée d’elle par une frontière administrative – Sharjah est l’un des sept émirats de la fédération des Émirats arabes unis, dirigé par Sultan bin Mohamed Al-Qasimi depuis 1972 – et surtout symbolique, elle semble en effet, selon Marc Lavergne, explorer une autre voie « qui ne s’exprime pas tant dans l’urbanisme, l’architecture ou la banalisation du luxe que dans les attitudes sociales, elles-mêmes encouragées par le souverain, en phase avec l’héritage culturel et social ainsi qu’avec la condition matérielle de son émirat ».
Cité portuaire et industrielle (sans pétrole), modeste aujourd’hui, mais capitale déchue d’un empire maritime hier (soit avant l’essor de Dubaï et d’Abu Dhabi au XXe siècle), Sharjah fait de la culture et de l’éducation les axes forts de sa politique depuis plusieurs décennies, c’est-à-dire bien avant l’implantation d’universités étrangères et de musées internationaux ailleurs dans le Golfe.
Les politiques urbaines qui s’appliquent aujourd’hui largement dans cette région, et qui visent à resserrer les liens communautaires et identitaires face au multiculturalisme et à la mondialisation, autour du développement de « musées-racines » ou de projets de Heritage villages dédiés aux histoires nationales, ne sont-elles pas aussi le fait d’une inspiration portée plus discrètement mais depuis plus longtemps par Sharjah ? La ville a par exemple organisé en mars 2025 la 22ᵉ édition des Heritage Days, un événement populaire qui vise à promouvoir ses traditions pré-pétrolières.
Les villes secondaires n’exercent-elles pas une influence propre sur les métropoles, à l’encontre des idées reçues relatives à un prétendu « modèle Dubaï », qui fonctionnerait comme une grille explicative de toutes les configurations urbaines de la région et qui se reproduirait à l’envi dans le Golfe et même au-delà, au fur et à mesure que s’étend le rayonnement de ses promoteurs et investisseurs et que se développe la ville-spectacle ?

Contre le « modèle Dubaï »
Mais sommes-nous, dans le cas de Sharjah, réellement dans l’anti-modèle, ou bien dans l’expression d’une modernisation prudente, marquée par un rapport ambivalent au modèle métropolitain de Dubaï ? Trois stratégies de singularisation sont à relever : une forme de conservatisme ; la mise en valeur de l’art ; et le renouveau institutionnel-urbain.
En premier lieu, l’attitude conservatrice se retrouve dans un respect des traditions islamiques plus marqué que dans les émirats voisins (nombre important de mosquées, fermeture de la plupart des restaurants pendant le ramadan, conservation du vendredi comme jour chômé, consommation d’alcool interdite), mais aussi dans la volonté des acteurs politiques locaux de protéger la ville des excès de la mondialisation, afin d’éviter qu’elle soit « noyée dans la culture globale », comme le craignait un conseiller de l’Émir interrogé en 2022 par l’auteur de ces lignes.
« Trop de globalisation » tend inévitablement vers la superficialité et la perte d’identité, d’après ce dernier, qui s’est dit inquiet de la tendance actuelle des Émirats consistant à vouloir faire tenir ensemble, dans un même projet de territoire national, « la culture, le patrimoine, l’entertainment et la modernité ». Il prônait alors une forme de patriotisme local ainsi que des « relations culturelles profondes », comme celles qu’a nouées l’Émirat de Sharjah avec le continent africain, via l’Africa Institute notamment. Là sont les clés pour que Sharjah demeure, selon ses vœux, « une ville arabo-islamique cosmopolite ».
En deuxième lieu, l’Émirat investit dans l’art et la culture depuis le début des années 1980, notamment à travers la Sharjah Art Foundation qui organise la Biennale d’art contemporain. À cet événement culturel majeur s’ajoutent la Foire internationale du livre organisée chaque année depuis 1982 et, depuis 2013, le Festival international du cinéma pour la jeunesse, ainsi que l’ouverture d’une douzaine de musées et galeries dans la ville qui participent à l’animation du secteur Heart of Sharjah. La Sharjah Art Foundation implique directement la famille régnante et est dirigée par Hoor Al-Qasimi, fille de l’Émir. Sharjah se positionne ainsi sur une scène mondialisée tout en attirant des flux d’acteurs et d’amateurs à fort capital culturel.
Sharjah laisse à Dubaï, arrivée plus tardivement sur le « marché de l’art » (Art Dubai Fair depuis 2007, inauguration du quartier artistique Alserkal Avenue dans d’anciens entrepôts industriels d’Al-Quoz en 2008), la partie strictement commerciale.
En troisième lieu, un renouveau institutionnel est à relever en matière d’urbanisme. Ce phénomène se manifeste notamment par l’augmentation de parts de marché acquises ces dernières années par l’entreprise publique Shurooq, fondée au début des années 2010 et dirigée par une autre fille de l’Émir, Bodour Al-Qasimi. À travers l’élargissement de son champ d’action, qui va désormais de la réhabilitation du centre-ville aux nouveaux projets de gated communities périurbaines, en passant par le développement d’espaces publics (parcs Al-Muntaza et Al-Rahmaniyah, promenades Al-Majaz et Qasba) et de resorts touristiques sur la côte Est de l’Émirat (grâce à ses exclaves Kalba et Khor Fakkan, Sharjah est le seul des sept Émirats de la Fédération à regarder à la fois le golfe Persique et le golfe d’Oman), Shurooq assume le redéploiement de l’État dans toutes les sphères de l’aménagement du territoire.
La montée en puissance de l’entreprise est justifiée, d’après une cadre dirigeante que nous avons interrogée en 2023, par la nécessité de réguler le secteur de l’immobilier, jusque-là aux mains d’acteurs privés, d’installer un intermédiaire entre la population et l’État pour toutes les questions d’aménagement et d’urbanisme, ou encore de renforcer les liens avec toutes les autres institutions publiques en charge du territoire. Shurooq cherche donc à se placer au cœur du système institutionnel, à incarner autant la vision de l’Émir – ne pas basculer dans le « tout-commercial » et « garder ses racines » ainsi que le souci du « bien commun » et de la « croissance progressive », dans les termes de la cadre dirigeante – que les besoins de la population.
La démolition de l’urbanisme moderniste passablement délabré, pourtant déjà bien engagée à Sharjah, au profit d’un « master plan romantique et authentique » promis généralement par les promoteurs, n’est ainsi « pas souhaitable » selon cette femme qui reconnaît un attachement de la population à ce patrimoine récent, ainsi que le déploiement d’une « vie organique » en ces lieux ; « tout ne peut pas être planifié », insiste-t-elle à rebours des « visions stratégiques » descendantes de l’aménagement s’appliquant en général dans le pays.
L’entreprise Shurooq est malgré tout amenée à faire des compromis en s’associant, sous la forme de joint-ventures, à des promoteurs privés performants des Émirats arabes unis (Eagles Hills pour le projet d’aménagement de l’île Maryam et Diamond pour le nouveau quartier Sharjah Sustainable City, par exemple). Mais alors que la responsable rencontrée reconnaissait que Shurooq pouvait manquer d’expertise à ses débuts, ce qui justifiait ces partenariats, elle estime que son entreprise est désormais pleinement compétente et légitime pour porter seule des projets urbains sur le territoire de l’Émirat, sans toutefois réprouver ces partenariats public/privé en cours.
Tournant immobilier
Cette triple stratégie, conservatrice, artistique et institutionnelle, a tendance à distinguer Sharjah du reste des villes émiriennes, et même parfois à susciter l’admiration de certains acteurs urbains du pays. Un fonctionnaire du Département des Municipalités et des Transports d’Abu Dhabi nous exprimait ainsi en 2023 son intérêt pour le modèle de développement de Sharjah, soutenu par un Émir « lumineux », où « tout n’est pas régi par l’argent ».
Mais cette distinction s’estompe sur d’autres aspects du développement actuel de Sharjah. Frontalière de Dubaï, elle constitue un débouché naturel de la poussée métropolitaine dubaïote. Alors que la ville a longtemps tiré ses revenus de l’hébergement des travailleurs expatriés (employés à Dubaï mais aussi sur le port industriel de Hamriyah situé entre Sharjah et Ajman), ressource « peu valorisante », elle peut désormais doper son économie immobilière, sur un segment à plus forte valeur ajoutée : en 2023, l’Émirat de Sharjah a connu un essor remarquable de ses activités immobilières. Le total des transactions a dépassé les 19 milliards de dirhams émiratis (AED) (soit 4,8 milliards d’euros environ), marquant une augmentation significative de 14,6 % par rapport à l’année précédente. Des investisseurs de 97 nationalités différentes ont en outre participé au marché immobilier de l’Émirat au cours de la même année.
Les citoyens émiriens, en particulier, ont investi 11,1 milliards d’AED (2,8 milliards d’euros) dans 15 857 propriétés.
Non seulement les derniers produits livrés à Sharjah ressemblent de plus en plus à ceux de Dubaï – le cas de Sharjah Sustainable City, duplication de Dubai Sustainable City par le promoteur Diamond (associé à Shurooq pour le cas de Sharjah), en est un bon exemple –, mais les promoteurs de Sharjah viennent aussi pénétrer l’espace dubaïote.
Ainsi, en mars 2022, les deux promoteurs privés Arada et Alef ont occupé l’entrée principale du mall de Dubaï Festival City avec des maquettes géantes et des petits espaces de vente. La clientèle de Sharjah, coutumière de ces lieux, est principalement visée et, avec elle, les investisseurs refroidis par la flambée des prix à Dubaï, ainsi que, de plus en plus, la clientèle internationale qui pourrait supporter un léger décentrement par rapport à l’axe Dubaï/Abu Dhabi à condition de pouvoir accéder à des produits immobiliers offrant les mêmes standards à des tarifs inférieurs.
C’est à cette dernière clientèle que s’adressait prioritairement la chargée de communication du projet Hayyan (Alef), une gated community en construction à l’extrême sud de Sharjah, rappelant aux clients du mall qu’elle interceptait la possibilité offerte par la loi émirienne de revendre un bien acheté sur plan avant livraison du projet. Son homologue d’Arada, quant à lui, vantait les mérites de la nouvelle centralité urbaine Aljada, dont le slogan est « The new downtown of Sharjah » (voir ci-dessous), auprès des étudiants de Sharjah à qui leurs parents pourraient offrir un appartement dans ce nouveau quartier situé à proximité de l’Université américaine de Sharjah, la première des institutions académiques fondées sur le modèle américain dans le Golfe, ouverte depuis 1997.
Ces logiques de développement immobilier qui s’imposent aujourd’hui à Sharjah sous l’effet de la proximité de Dubaï remettront-elles en question, à terme, les velléités de distinction de cette ville secondaire des Émirats arabes unis ayant fait le choix revendiqué de la modernité prudente ? Sharjah connaîtra-t-elle elle-même cet effet de mimétisme puis de saturation ?
Ces interrogations, suscitées par la rapidité de la poussée urbaine dans le nord du pays ainsi que par les rapports complexes entre les métropoles Abu Dhabi et Dubaï et les villes secondaires satellisées et parfois même inféodées, justifient de poursuivre l’investigation de Sharjah.
Seule la mise en perspective de toutes les échelles territoriales permettra d’éclairer le fonctionnement des systèmes urbains dans le Golfe et d’en mettre au jour les différenciations socio-spatiales, au-delà d’une apparente homogénéité dans l’application locale des normes de la mondialisation économique.
En raisonnant à la manière de Jennifer Robinson, qui incite à varier les référents géographiques de la recherche urbaine internationale, Sharjah incarnerait un certain « ordinaire » golfien – divers, connecté et même contesté – qui a trop peu retenu l’attention des chercheurs, dont l’une des missions est pourtant de combler le vide représentationnel et la faible historicité.
L’importance des rapports transnationaux « Sud-Sud » qui caractérisent la ville depuis sa formation ; les contradictions générées par la cohabitation des attitudes conservatrices et des volontés d’ouverture ; l’organicité de la vie urbaine dans des territoires quotidiens cosmopolites assez faiblement contrôlés apparus en marge d’un urbanisme par projet plus fortement encadré ; tout cela invite non seulement à désexceptionnaliser le Golfe urbain, mais aussi à voir en Sharjah un archétype possible de la confrontation des modernités urbaines contemporaines.
Ouvrage de Roman Stadnicki à paraître en 2026 : Au-delà de Dubaï. Projeter et produire la ville moderne dans le monde arabe, Éditions de l’Aube, collection « Bibliothèque des territoires ».
Roman Stadnicki a reçu des financements du programme ANR Spacepol : https://spacepol.hypotheses.org/.
08.10.2025 à 16:26
L’opinion israélienne face à Gaza : déni, consentement ou aveuglement ?
Texte intégral (3520 mots)
La majeure partie des Juifs israéliens paraît indifférente à l’égard des destructions colossales infligées par Tsahal aux Gazaouis, quand elle ne conteste pas en bloc le bilan humain avancé par les organisations internationales. Cinq principaux facteurs explicatifs permettent de mieux comprendre les ressorts de cette attitude.
L’interrogation court dans de nombreux médias, surtout européens : pourquoi l’opinion publique israélienne ne réagit-elle pas à la situation dramatique de Gaza, à la famine (internationalement reconnue depuis août 2025) et au massacre de dizaines de milliers de personnes, dont une grande majorité de civils fait qu’on ne prend plus guère la peine de réfuter en Israël mais qu’on justifie plutôt comme résultant d’une stratégie du Hamas consistant à s’abriter derrière la population gazaouie.
Cette question est délicate car elle touche non seulement à la critique du gouvernement ou de l’État, mais de la société israélienne même, à un moment où « Israël » (quoi qu’on désigne par le nom du pays) n’a jamais été autant critiqué, dans un débat hyperpolarisé. Les agissements de l’armée, du gouvernement, des colons, ont rendu pertinentes des analogies qui furent contestables, ou purement polémiques, comme « apartheid » bien sûr et, désormais, le terme « génocide », accepté de façon croissante tant par des historiens que par des juristes. Nous traiterons ici du cas d’Israël, mais il faut rappeler que les interrogations sur des opinions publiques confrontées à un massacre de masse perpétré par leur pays ont une longue histoire, qu’Israël vient aujourd’hui illustrer d’une façon particulière.
Dans la dernière semaine de juillet, selon le quotidien Maariv, 47 % des Israéliens considèrent l’affirmation selon laquelle Gaza est en proie à la famine comme un mensonge et le fruit de la propagande du Hamas ; 23 % reconnaissent la réalité de la famine et disent s’en soucier ; 18 % reconnaissent l’existence de la famine et disent ne pas s’en soucier ; et 12 % sont sans opinion. Selon l’Institut israélien pour la démocratie, 79 % des Israéliens juifs se disent peu ou pas troublés par les informations relatives à une famine à Gaza : mais y croient-ils ou pas ? La question est trop vague. Dans le même sondage, 79 % se disent persuadés qu’Israël fait des efforts substantiels pour atténuer les souffrances des Palestiniens, ce qui est aussi une façon de réduire la portée de ces souffrances, et du massacre. Ces chiffres ne concernent pas les citoyens palestiniens d’Israël, qui sont selon le même Institut, 86 % à se dire « troublés ou très troublés » par la catastrophe humanitaire à Gaza.
À lire aussi : Ce que masque l’expression « Arabes israéliens »
Ces sondages sont susceptibles d’interprétations diverses, mais ils montrent une société qui ne reconnaît que très partiellement la famine et y voit parfois une campagne de propagande du Hamas dont les médias étrangers sont perçus comme complices. Même s’ils reconnaissent la famine et le massacre, les Israéliens s’en déresponsabilisent de plusieurs façons. De surcroît, ils sont massivement partisans de ce qu’on appelle en hébreu le « transfert » des Gazaouis dans d’autres pays, c’est-à-dire d’un nettoyage ethnique.
De multiples facteurs permettent de comprendre la façon dont les Israéliens justifient de telles opinions et se dédouanent de toute culpabilité ou responsabilité pour le sort des Palestiniens – processus qu’un chercheur israélien analysa dès la seconde intifada (2000-2005). Certains de ces facteurs sont anciens mais ont été très amplifiés par le 7-Octobre. Ils sont plus ou moins spécifiques au pays.
Facteur 1 : le ralliement autour du drapeau
Le premier facteur, le ralliement autour du drapeau (Rally round the flag), n’est pas un phénomène propre à Israël ; en général, une guerre jugée comme étant juste confère un surcroît de légitimité et de popularité aux gouvernants, y compris parmi certains opposants ou indifférents. Étudié surtout aux États-Unis, ce ralliement génère ainsi des surcroîts de popularité remarquables autour de la figure du président.
En Israël, il s’est manifesté de façon puissante à deux moments.
D’abord, dans les mois qui suivent le 7-Octobre. Le soutien à la guerre est alors massif. Mais le cas israélien illustre aussi le caractère souvent peu durable de ce ralliement, qui a commencé à s’effriter, par paliers, lorsque la population comprend que le gouvernement donne la priorité à la poursuite de la guerre au détriment du retour des otages, ce qui est devenu tout à fait évident le 9 septembre 2025 avec le bombardement de Doha au Qatar, où siègent les négociateurs du Hamas.
À lire aussi : Israël peut-il invoquer la légitime défense pour justifier sa frappe au Qatar ?
L’autre moment est l’attaque de l’Iran par Israël, appuyé par les États-Unis (13-25 juin 2025). Quelles que soient les intentions déclarées (détruire Israël) et les capacités réelles de la République islamique, la diabolisation de ce régime – et de ses alliés (le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen), traités comme de purs agents aux ordres de Téhéran – est ancienne dans les médias israéliens, qui ici ont reflété le point de vue martelé par Nétanyahou de longue date.
La popularité du premier ministre a connu un pic quand Tsahal a bombardé l’Iran, et l’opposition à l’attaque est demeurée tout à fait marginale, y compris chez beaucoup d’opposants à la guerre à Gaza.
Enfin, ce ralliement autour du drapeau concerne aussi la fidélité à une armée encore dépendante des citoyens et des réservistes : les Israéliens sont ici pris au piège de leur fidélité à Tsahal, refusant de voir à quel point leur armée a été pénétrée par un courant national-religieux ouvertement xénophobe et annexionniste, voire génocidaire, processus déjà analysé il y a dix ans et qui s’est accéléré depuis. Il est difficile de renoncer à cette fidélité, qui a été, et demeure, un ciment d’une société très fragilisée.
À lire aussi : Les guerres d’Israël et la question de la morale
Facteur 2 : l’obsession victimaire
Le deuxième facteur est plus spécifique au pays : entretenue par l’appareil d’État, les médias et le système éducatif, l’obsession victimaire, autour de la mémoire de la Shoah, a été réveillée et renforcée par le 7-Octobre, vite devenu en Israël une date saillante qui n’a plus besoin que l’année soit précisée (comme le 11 Septembre aux États-Unis).
Depuis, les visages et noms des otages, rejoints par ceux des centaines de soldats tombés à Gaza, sont omniprésents dans l’espace public israélien, aussi bien analogique (sur les arbres des villes, les vitrines des magasins) que numérique.
La plupart des Israéliens (et des pro-Israéliens en dehors d’Israël) traitent le 7-Octobre comme le point de départ de la guerre, voire comme un commencement absolu, comme s’il n’y avait pas eu, avant, toutes les guerres avec Gaza, la longue occupation, le décompte macabre des blessés et morts palestiniens de longues années durant.
Les actes d’extrême violence perpétrés ce jour-là par le Hamas envers les civils, le nombre élevé de morts et la mise en évidence de la vulnérabilité de l’armée ont tétanisé l’opinion.
Facteur 3 : la droitisation de la société israélienne
En troisième lieu, le 7-Octobre et la guerre ont accéléré le processus de droitisation d’une société qui fut un temps (au moins pour une moitié), disposée à une paix fondée sur un compromis avec les Palestiniens après les accords d’Oslo de 1993, compromis auquel même l’armée se rallia.
Après l’échec du processus en 2000, et la deuxième intifada, s’est installée l’idée qu’« il n’y a pas de partenaire » pour la paix – mot d’Ehud Barak, alors premier ministre, massivement repris depuis.
Cela a préparé le terrain à une déresponsabilisation israélienne par rapport aux Palestiniens. Aujourd’hui encore, on peut se dire « de gauche », mais si les Palestiniens veulent la guerre, alors… De surcroît, le 7-Octobre entraîne aussi une relecture de l’histoire, ravive le trauma des anciens combattants, contribue à ternir un peu plus l’image des Palestiniens, voire à revaloriser celle des colons.
Facteur 4 : l’effacement et la diabolisation des Palestiniens dans les médias israéliens
Quatrième facteur : les médias israéliens jouent un rôle majeur dans l’invisibilisation des Palestiniens de Gaza en tant qu’êtres humains auxquels on pourrait s’identifier, et dans leur assimilation à des « terroristes », terme plus employé que jamais (même si ce fut déjà le cas lors de la guerre du Liban de 1982).
Les grands médias ignorent les crimes de guerre que des soldats eux-mêmes ont rapportés, ainsi que les bombardements massifs des populations et des infrastructures. Les journalistes israéliens « embarqués » auprès des militaires (embedded) ne décrivent la guerre que du point de vue des difficultés et souffrances des soldats.
Les victimes civiles palestiniennes sont largement effacées de l’actualité. Dans ce contexte, la famine devient un problème de « hasbara », de « diplomatie publique » mal conduite. La droite et l’extrême droite israéliennes dénoncent une « campagne de la faim » organisée, à base de fakes, avec la « complicité » de l’ONU. On parle d’un « Gazawood », d’images largement mises en scène – un processus de déni des images de souffrance qui remonte à la deuxième intifada, quand avait été forgé le terme « Pallywood ».
Depuis le 7-Octobre, l’usage même du mot de « palestinien » a reculé. Dans les nombreux discours prononcés lors des manifestations contre Nétanyahou, ou pour le retour des otages, on ne l’entend pratiquement pas. Dans des déclarations génocidaires, des responsables israéliens ont utilisé des formules comme « animaux humains » (Yoav Gallant, alors ministre de la défense) ou « monstres » (Nétanyahou). En janvier 2024, le ministre du patrimoine Amichai Eliyahu a proposé de lancer une bombe atomique sur Gaza et, en août 2024, Bezalel Smotrich, ministre des finances, a souhaité aux Gazouis de mourir de faim.
Fin juillet 2025, on a pu croire à un tournant, à une reconnaissance de l’humanité palestinienne souffrante, autour d’un reportage où la présentatrice vedette du pays, Yonit Levi, a évoqué une « responsabilité morale » de son pays et montré des photos d’enfants faméliques à la Une de médias occidentaux.
Le 23 juillet, Ron Ben Ishai, célèbre correspondant de guerre écrit : « Il y a des enfants qui ont faim à Gaza », mais en conclut qu’il faut seulement changer la méthode de distribution de nourriture par le Gaza Humanitarian Fund (GHF), fondation américaine mise en place avec l’aide des Israéliens, et que les humanitaires internationaux avaient dénoncée dès sa mise en place en mai. Comme on sait, chaque distribution s’est accompagnée de la mort de Palestiniens sous les balles de l’armée.
À l’été, des centaines de manifestants commencent à brandir des photos d’enfants de Gaza, morts ou affamés, soit lors de grands rassemblements, soit lors de manifestations modestes.
À lire aussi : Israël-Gaza : des associations israéliennes militant pour la paix offrent une lueur d’espoir
Mais la prise de conscience est demeurée modeste. Si la majorité des Israéliens veulent aujourd’hui la fin de la guerre, c’est avant tout parce qu’ils espèrent que celle-ci signifiera le retour des otages survivants.
Les véritables critiques de la guerre savent de longue date qu’ils ont plus de chance d’être entendus en dehors d’Israël qu’au-dedans, alors même que ce sont d’abord les Israéliens qu’ils voudraient atteindre. Bien avant le 7-Octobre, l’ONG « Breaking the Silence » (fondée en 2004), qui collectait des témoignages de soldats sur les exactions commises dans les territoires occupés, s’est retrouvée plus sollicitée et citée à l’extérieur d’Israël qu’à l’intérieur.
En juillet, deux ONG israéliennes – B’tselem, qui recense les violations des droits de l’homme dans les territoires, et Physicians for Human Rights – ont reconnu ce qu’ils ont appelé « notre génocide ». Cette formulation a eu beaucoup plus d’écho dans les grands médias européens et américains que dans les médias israéliens.
À lire aussi : Israël-Hamas : le mouvement pour la paix a-t-il été assassiné le 7 octobre ?
Facteur 5 : obsession de la critique extérieure
Cinquième facteur, ancien lui aussi : la société israélienne est plus que jamais obsédée par la critique extérieure. Les médias israéliens négligent les soutiens médiatique et politiques qu’Israël reçoit, surtout à droite ou à l’extrême droite, ou n’en parlent qu’au moment où ce soutien apparaît perdu, contribuant à accentuer un sentiment qui confine à la paranoïa.
Les incidents antisémites et/ou anti-israéliens sont couverts en détail. Le spectre est large. Sont dénoncés aussi bien des actes manifestement antisémites comme des agressions de Juifs à Milan en juillet ou à Montréal en août, que des appels au boycott d’institutions, d’artistes ou d’intellectuels israéliens. Ainsi, le refus de certains chercheurs français de participer, en septembre, à un colloque au Musée d’Art juif de Paris en raison de la présence d’universitaires israéliens dont la venue est financée par leurs institutions qui apparaissent comme partenaires de l’événement a fait beaucoup de bruit.
Enfin, la presse israélienne est à peu près seule à couvrir le mauvais accueil ou le refus de servir des touristes israéliens, et les Israéliens voyageant beaucoup… Haaretz, journal devenu radicalement critique de la guerre, et très singulier dans le paysage médiatique israélien, couvre lui aussi ces incidents ou agressions, dès le printemps 2024.
Si l’écart entre les couvertures israélienne et internationale du conflit a toujours été grand, il s’agit aujourd’hui d’un gouffre. Les Israéliens et la plupart des Occidentaux (sauf ceux qui ne s’informent qu’à la droite et l’extrême droite) ne vivent simplement pas dans le même monde.
Ce fossé pourra-t-il être comblé ? En tout état de cause, il faudra bien, le jour venu, rendre des comptes, comme le dit Sarit Michaeli, secrétaire générale de Beit Tselem, au terme de ce reportage « micro-trottoir » du Guardian à Tel-Aviv.
En dernier lieu, malgré son coût économique et moral, les élites de l’armée, ainsi que des partis et personnalités politiques prêts à s’allier à Nétanyahou, ont un intérêt à la poursuite de la guerre – ce qui est bien sûr aussi le cas du chef du gouvernement, qui fuit ses procès en cours et rêve de réélection, dans une course folle et criminelle. Dans la guerre, l’armée n’en finit pas de se laver de son aveuglement face aux préparatifs du 7-Octobre par le Hamas, et fait reculer l’établissement d’une véritable commission d’enquête sur le massacre, maintes fois réclamée.
L’impuissance des observateurs étrangers
Ralliement autour du drapeau et de l’uniforme, obsession victimaire, droitisation de la société, effacement du peuple attaqué réduit à un groupe de terroristes actuels ou potentiels, obsession de la critique extérieure, intérêt des élites à la poursuite de la guerre qui peut aussi unir, au moins un temps, une nation en crise : isolés et parfois conjugués, ces facteurs se sont retrouvés dans d’autres moments génocidaires.
Ce qui est singulier, c’est moins le processus lui-même que la croissante attention internationale qu’il reçoit. Bien connue des spécialistes du génocide, l’impuissance des « bystanders », y compris ceux qui s’indignent, n’en est que plus remarquable, et non moins tragique que l’aveuglement de l’opinion israélienne.
Jérome Bourdon ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
08.10.2025 à 12:02
La troublante actualité du nouvel album de Woody Guthrie, sorti 58 ans après sa mort
Texte intégral (2459 mots)
Sorti cet été, l’album posthume de Woody Guthrie, figure emblématique de la musique folk des années 1940-1960, résonne puissamment avec la situation actuelle des États-Unis : plusieurs des titres qu’il contient, consacrés à l’expulsion de migrants mexicains, à une justice raciste ou encore aux injustices économiques, auraient pu être écrits ces derniers mois…
Le 14 août est sorti Woody at Home, Vol.1 & 2, le nouvel album de Woody Guthrie (1912-1967), probablement l’artiste folk américain le plus influent, auteur de la célèbre « This Land Is Your Land » (1940), qui dans cet album est proposée avec de nouveaux vers.
L’album contient des chansons – certaines déjà connues, d’autres inédites – que Guthrie enregistra avec un magnétophone offert par Howie Richmond, son éditeur, entre 1951 et 1952 et qui sont désormais publiées grâce à une nouvelle technologie qui a permis d’en améliorer la qualité sonore.
« Deportee »
La parution de l’album a été précédée par celle du single « Deportee (Plane Wreck at Los Gatos) », une chanson dont on ne connaissait jusqu’ici que le texte, que Guthrie écrivit en référence à un épisode survenu le 28 janvier 1948, lorsqu’un avion transportant des travailleurs saisonniers mexicains, de retour au Mexique, s’écrasa dans le canyon de Los Gatos (Californie), provoquant la mort de tous les passagers.
Un choix qui n’est pas anodin, comme l’a expliqué Nora Guthrie – l’une des filles du folk singer, cofondatrice des Woody Guthrie Archives et longtemps conservatrice de l’héritage politico-artistique de son père – lors d’un entretien au Smithsonian Magazine, dans lequel elle a souligné combien le message de son père reste actuel, au vu des expulsions opérées par l’administration de Donald Trump et, plus généralement, de ses tendances autoritaires, un thème déjà présent dans « Biggest Thing That Man Has Ever Done », écrite pendant la guerre contre l’Allemagne nazie.
Tout cela montre la vitalité de Woody Guthrie aux États-Unis. On assiste à un processus constant d’actualisation et de redéfinition de la figure de Guthrie et de son héritage artistique, qui ne prend pas toujours en compte le radicalisme du chanteur, mais qui en accentue parfois le patriotisme.
Un exemple en est l’histoire de « This Land Is Your Land » : de la chanson existent des versions comportant des vers critiques de la propriété privée, et d’autres sans ces vers. Dans sa première version, « This Land » est devenue presque un hymne non officiel des États-Unis et, au fil des années, a été utilisée dans des contextes politiques différents, donnant parfois lieu à des appropriations et des réinterprétations politiques, comme en 1960, lorsqu’elle fut jouée à la convention républicaine qui investit Richard Nixon comme candidat à la présidence ou, en 1988, lorsque George H. W. Bush utilisa la même chanson pour sa campagne électorale.
Guthrie lut le compte rendu de la tragédie du 28 janvier 1948 dans un journal, horrifié de constater que les travailleurs n’étaient pas appelés par leur nom, mais par le terme péjoratif de « deportees ».
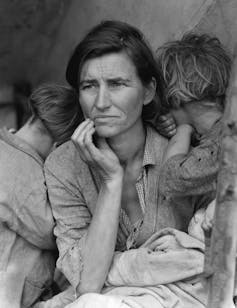
Dans leur histoire, Guthrie vit des parallèles avec les expériences vécues dans les années 1930 par les « Oakies », originaires de l’Oklahoma, appauvris par les tempêtes de sable (dust bowls) et par des années de crise socio-économique, qui se déplaçaient vers la Californie en quête d’un avenir meilleur. C’était un « Goin’ Down The Road », selon le titre d’une chanson de Guthrie, où ce « down » signifiait aussi la tristesse de devoir prendre la route, avec toutes les incertitudes et les difficultés qui s’annonçaient, parce qu’il n’y avait pas d’alternative – et, en effet, le titre complet se terminait par « Feeling Bad ».
Parmi les difficultés rencontrées par les Oakies et les Mexicains, il y avait aussi le racisme et la pauvreté face à l’abondance des champs de fruits, comme lorsque les Mexicains se retrouvaient à cueillir des fruits qui pourrissaient sur les arbres (« The crops are all in and the peaches are rotting ») pour des salaires qui leur permettaient à peine de survivre (« To pay all their money to wade back again »).
Et, en effet, dans « Deportee », d’où sont extraites ces deux citations, Guthrie demandait avec provocation :
« Is this the best way we can grow our big orchards ?
Is this the best way we can grow our good fruit ?
To fall like dry leaves to rot on my topsoil
And be called by no name except “deportees” ? »Est-ce la meilleure façon de cultiver nos grands vergers ?
Est-ce la meilleure façon de cultiver nos bons fruits ?
Tomber comme des feuilles mortes pour pourrir sur ma terre arable
Et n’être appelés que par le nom de « déportés » ?
Visions de l’Amérique et radicalisme
« We come with the dust and we go with the wind », chantait Guthrie dans « Pastures of Plenty » (1941, également présente dans Woody at Home), l’hymne qu’il écrivit pour les migrants du Sud-Ouest, dénonçant l’indifférence et l’invisibilité qui permettaient l’exploitation des travailleurs.
Guthrie, de cette manière, mesurait l’écart qui séparait la réalité du pays de la réalisation de ses promesses et de ses aspirations. Dans le langage politique des États-Unis, le terme « America » désigne la projection mythique, de rêve, de projet de vie qui entrelace l’histoire de l’individu avec celle de la Nation. En ce sens, pour Guthrie, les tragédies étaient aussi une question collective permettant de dénoncer la façon dont une minorité (les riches capitalistes) privait la majorité (les travailleurs) de ses droits et de son bien-être.
La vision politique de Guthrie devait beaucoup au fait qu’il avait grandi dans l’Oklahoma des années 1920 et 1930, où l’influence du populisme agraire de type jeffersonien – la vision d’une république agraire inspirée par Thomas Jefferson, fondée sur la possession équitable de la terre entre ses citoyens – restait très ancrée, et proche du Populist Party, un parti de la dernière décennie du XIXe siècle qui critiquait ceux qui gouvernaient les institutions et défendait les intérêts du monde agricole.
C’est également dans ce cadre qu’il faut situer le radicalisme guthrien qui prit forme dans les années 1930 et 1940, périodes où les discussions sur l’état de santé de la démocratie américaine étaient nombreuses et où le New Deal de Franklin Delano Roosevelt cherchait à revitaliser le concept de peuple, érodé par des années de crise économique et de profonds changements sociaux.
Guthrie apporta sa contribution en soutenant le Parti communiste et, à différentes étapes, le New Deal, dans la lignée du syndicat anarcho-communiste des Industrial Workers of the World (IWW) dont il avait repris l’idée selon laquelle la musique pouvait être un outil important de la militance. Dans le Parti, Guthrie voyait le ciment idéologique ; dans le syndicat, l’outil d’organisation des masses, car ce n’est qu’à travers l’union – un terme disposant d’un double sens dont Guthrie a joué à plusieurs reprises : syndicat et union des opprimés – qu’on parviendrait à un monde socialisant et syndicalisé.
« White America ? »
L’engagement de Guthrie visait également à surmonter les discriminations raciales. Ce n’était pas chose acquise pour le fils d’un homme que l’on dit avoir été membre du Ku Klux Klan et fervent anticommuniste, qui avait probablement participé à un lynchage en 1911.
D’ailleurs, le même Woody, à son arrivée en Californie dans la seconde moitié des années 1930, portait avec lui un héritage raciste que l’on retrouve dans certaines chansons comme dans la version raciste de « Run, Nigger Run », une chanson populaire dans le Sud que Guthrie chanta à la radio, dans le cadre de sa propre émission, en 1937. Après cela, Guthrie reçut une lettre d’une auditrice noire exprimant tout son ressentiment quant à l’utilisation du terme « nigger » par le chanteur. Guthrie fut tellement touché qu’il lut la lettre à la radio en s’excusant.
Il entreprit alors un processus de remise en question de lui-même et de ce qu’il croyait être les États-Unis, allant jusqu’à dénoncer la ségrégation et les distorsions du système judiciaire qui protégeaient les Blancs et emprisonnaient volontiers les Noirs. Ces thèmes se retrouvent dans « Buoy Bells from Trenton », également présente dans « Woody at Home », qui se réfère à l’affaire des Trenton Six : en 1948, six Noirs de Trenton (New Jersey) furent condamnés pour le meurtre d’un Blanc, par un jury composé uniquement de Blancs, malgré le témoignage de certaines personnes ayant vu d’autres individus sur les lieux du crime.
« Buoy Bells from Trenton » a probablement été incluse dans l’album pour la lecture qu’on peut en faire sur les abus de pouvoir et sur les « New Jim Crow », expression qui fait écho aux lois Jim Crow (fin XIXe–1965). Celles-ci imposaient dans les États du Sud la ségrégation raciale, légitimée par l’arrêt Plessy v. Ferguson (1896) de la Cour suprême, qui consacrait le principe « séparés mais égaux », avant d’être abolies par l’arrêt Brown v. Board of Education (1954), le Civil Rights Act (1964) et le Voting Rights Act (1965).
Popularisée par Michelle Alexander dans le livre The New Jim Crow (2010), la formule désigne le système contemporain de contrôle racial à travers les politiques pénales et l’incarcération de masse : en 2022, les Afro-Américains représentaient 32 % des détenus d’État et fédéraux condamnés, alors qu’ils ne constituent que 12 % de la population états-unienne, chiffre sur lequel plusieurs études récentes insistent. Cette chanson peut ainsi être relue, comme le suggère Nora Guthrie, comme une critique du racisme persistant, sous des formes institutionnelles mais aussi plus diffuses. Un exemple, là encore, de la vitalité de Guthrie et de la manière dont l’art ne s’arrête pas au moment de sa publication, mais devient un phénomène historique de long terme.
Daniele Curci ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
07.10.2025 à 16:25
Quand la rivalité entre Taïwan et la Chine s’invite dans le Pacifique
Texte intégral (2112 mots)
Le 54e Forum des îles du Pacifique, qui rassemble dix-huit États et territoires de cette zone – à savoir l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’essentiel de l’Océanie insulaire – a été le théâtre d’une nouvelle passe d’armes entre Pékin et Taipei. La République populaire de Chine y progresse, mais Taïwan parvient encore à y conserver des positions, trois de ces pays la reconnaissant officiellement (ce qui n’est le cas que de douze pays dans le monde au total).
Si la confrontation entre la Chine et les États-Unis se joue en mer de Chine méridionale, elle s’étend désormais jusque dans les petites îles du Pacifique, qui deviennent un baromètre des équilibres mondiaux entre coopération et confrontation.
Tandis que la pression militaire et stratégique exercée par la République populaire de Chine (RPC) s’intensifie autour de Taïwan (ou République de Chine), les autorités taïwanaises considèrent désormais l’année 2027 comme une échéance plausible pour une éventuelle invasion de l’île par Pékin. Une crainte partagée par Washington qui a estimé lors du Shangri-La Dialogue (mai 2025) que la Chine se prépare à « potentiellement utiliser la force militaire » et « s’entraîne tous les jours » en vue d’une invasion de Taïwan, avec une multiplication des manœuvres navales et aériennes autour de l’île.
Si ce face-à-face sino-américain se joue en mer de Chine méridionale, il a également des répercussions à plusieurs milliers de kilomètres de là, dans le Pacifique insulaire, où l’influence chinoise s’accentue depuis une quinzaine d’années. Pékin y mène une bataille plus discrète mais tout aussi stratégique : isoler diplomatiquement Taïwan et imposer sa « One-China Policy » (politique d’une seule Chine).

Le Forum des îles du Pacifique, théâtre des rivalités
Réuni à Honiara (Îles Salomon) du 8 au 12 septembre 2025, le 54ᵉ Forum des Îles du Pacifique (FIP), qui regroupe 18 pays et territoires de cette vaste région, a été marqué par une décision inédite : à l’initiative des îles Salomon, pays hôte et allié indéfectible de Pékin, l’ensemble des « partenaires du dialogue » – dont Taïwan, les États-Unis et la Chine – ont été exclus du sommet.
Depuis 1992, Taïwan bénéficie pourtant de ce statut qui lui permet de rencontrer ses alliés du Pacifique en marge des réunions annuelles du Forum. Ce droit est inscrit dans le « communiqué d’Honiara » adopté par les dirigeants du Pacifique en 1992. Un statut que Pékin s’emploie depuis plusieurs années à remettre en cause, comme en témoigne le Forum organisé aux Tonga en 2024 où une mention du partenariat avec Taïwan avait même été supprimée du communiqué final après l’intervention de l’ambassadeur chinois Qian Bo – un succès diplomatique pour Pékin.
Le sommet de 2025 marque donc une nouvelle étape : certes, l’exclusion prive Taïwan de visibilité, mais les dirigeants du Forum ont finalement réaffirmé la décision de 1992, confirmant le statu quo.
Ce compromis illustre l’équilibre précaire entre pressions extérieures et cohésion régionale. Dans une région où l’aide publique au développement est particulièrement nécessaire, cette décision d’exclure les principaux partenaires et bailleurs de fonds de la principale institution régionale interroge, car elle fragilise le multilatéralisme du Forum et le menace de scission.
Le Pacifique insulaire, dernier bastion de Taïwan ?
Depuis la résolution 2758 de l’ONU (1971), qui a attribué le siège de la Chine à la RPC, Taïwan a perdu la quasi-totalité de ses soutiens diplomatiques. De plus de 60 États qui le reconnaissaient à la fin des années 1960, puis une trentaine dans les années 1990, il n’en reste que 12 en 2025, dont trois dans le Pacifique : Tuvalu, les îles Marshall et Palau.
Les défections récentes – Îles Salomon et Kiribati en 2019, Nauru en 2024 – montrent l’efficacité de la stratégie chinoise, qui combine incitations économiques, rétorsions politiques et actions d’influence.
Le Pacifique reste cependant un espace singulier : il concentre encore 25 % des derniers soutiens mondiaux à Taïwan, malgré sa forte dépendance aux aides extérieures.
La montée en puissance de l’influence chinoise
Depuis les années 2010, la Chine s’impose comme un acteur économique et diplomatique incontournable dans le Pacifique, la consacrant comme une puissance régionale de premier plan et mettant au défi les puissances occidentales qui considéraient cette région comme leur traditionnel pré carré.
Ses Nouvelles Routes et ceinture de la soie (Belt and Road Initiative, BRI) se traduisent par des investissements massifs dans des infrastructures essentielles : routes, hôpitaux, stades, télécommunications. Ces projets, souvent financés par des prêts, renforcent la dépendance économique des petites îles, ouvrant à Pékin de nouveaux leviers d’influence.
Sur le plan géostratégique, la Chine trace ainsi une cartographie où elle s’ouvre de vastes sections de l’océan Pacifique et s’en sert comme de relais pour projeter sa puissance et sécuriser ses intérêts dans la région. L’accord de sécurité signé en 2022 avec les Îles Salomon – autorisant le déploiement de personnel de sécurité chinois et l’accès de navires de guerre – illustre justement la progression de cette stratégie. Un pas qui alarme l’Australie et les États-Unis, qui redoutent l’établissement d’une base militaire chinoise dans une zone stratégique proche de leurs côtes.
Le réveil occidental ?
Les puissances occidentales voient dans cette percée un défi à leur propre sphère d’influence et tentent de réinvestir la région du Pacifique Sud afin de contrer l’hégémonie chinoise. Sous la présidence de Joe Biden (2021-2025), les États-Unis ont relancé leur présence diplomatique, organisé des sommets avec les îles du Pacifique et multiplié les annonces d’aides via l’initiative Partners in the Blue Pacific.
L’Australie et la Nouvelle-Zélande renforcent leurs programmes de coopération, tandis que le Japon et la France accroissent leurs investissements.
Parallèlement, les dispositifs de sécurité se multiplient : pacte AUKUS (Australie, Royaume-Uni, États-Unis), stratégie indo-pacifique française, QUAD (Quadrilateral security dialogue) et partenariats bilatéraux visent à contenir l’expansion chinoise.
Le Pacifique insulaire, longtemps périphérique, s’apparente désormais à un espace central de rivalité géopolitique.
Les îles du Pacifque : entre risques et opportunité
Pour les petits États insulaires (PEI), cette compétition représente à la fois une menace et une opportunité.
Conscients de l’effet de levier dont ils disposent en jouant sur la concurrence entre les grandes puissances, ils tentent néanmoins de préserver leur marge d’autonomie. Leur stratégie, résumée par la formule « amis de tous, ennemis de personne », cherche à éviter la polarisation et à maintenir la coopération régionale malgré des risques graduels : instrumentalisation du Forum, perte d’unité entre États insulaires, et surtout militarisation croissante d’un océan que les pays de la région souhaitent… pacifique, comme l’affirme la Stratégie 2050 pour le Pacifique bleu adoptée en 2022.
L’avenir du statut de Taïwan dans le Pacifique illustre parfaitement cette tension. Si Pékin compte poursuivre ses efforts pour réduire à peau de chagrin les irréductibles soutiens diplomatiques de Taipei, la réaffirmation du partenariat de développement par le FIP en 2025 montre que les États insulaires tentent de maintenir le cadre régional existant.
Si pour l’heure, le Pacifique insulaire reste encore un bastion – au moins symbolique – pour Taïwan et un terrain d’affrontement stratégique pour la Chine et les puissances occidentales, le défi pour les PEI sera de continuer à tirer parti de cette rivalité sans y perdre leur unité ni leur souveraineté. Leur capacité à préserver un Pacifique réellement « bleu » – à la fois ouvert, stable et pacifique – sera le véritable test des prochaines années de leur diplomatie régionale face aux rivalités des grandes puissances.
Pierre-Christophe Pantz ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
07.10.2025 à 16:21
Reconstruire l’État après la guerre : quels défis pour le management public en contexte post-conflit ?
Texte intégral (2712 mots)
Après un conflit, une bataille se joue dans les instances gouvernementales. Administrations, écoles, hôpitaux, tribunaux : il est nécessaire de faire fonctionner à nouveau ces lieux où l’État redevient visible et utile. Offrir des services publics équitables et efficaces permet de rétablir la confiance auprès de la population, de prévenir les tensions futures et de consolider une paix durable. Mais comment allier inclusion politique et professionnalisation de l’administration sans exclure ou corrompre le processus ? Cet article explore, exemples à l’appui, les conditions d’un État solide après la guerre.
Au lendemain d’un conflit, la paix ne se gagne pas qu’avec des ponts et des routes. Elle se joue aux guichets : dans les ministères, les centres de santé, les écoles, les tribunaux… Une administration qui délivre, une légitimité qui se reconstruit, des services qui reviennent partout. Comment concilier inclusion politique et professionnalisation de l’État pour une paix durable ?
L’urgence de faire fonctionner l’État… sans sacrifier le long terme
Dans les États sortant de guerre, les caisses sont vides, les talents ont souvent fui, les procédures se sont délitées. Les bailleurs poussent à « livrer vite » des résultats visibles.
Or, les recherches sur les réformes administratives en sortie de conflit montrent que des arbitrages délicats doivent être faits entre rétablissement immédiat des services et consolidation institutionnelle sur la durée (stabiliser la paie, reconstruire les chaînes d’approvisionnement, reprofessionnaliser, etc.).
Les dispositifs parallèles pilotés par des projets internationaux peuvent accélérer la reprise, mais ils siphonnent parfois les compétences et fragilisent les administrations nationales si la passation vers le secteur public n’est pas anticipée.
Le dilemme technocratie–réconciliation
Qui doit tenir les rênes de l’administration rénovée ? Des technocrates indépendants, garants de l’efficacité, ou des représentants des ex-belligérants, garants de l’inclusion ? La plupart des pays naviguent entre ces pôles, avec des effets ambivalents.
En Irak, le système de partage des postes par quotas ethno-confessionnels, la muhasasa, mise en place en 2003, a garanti la représentation des grands groupes, mais il a aussi institutionnalisé le clientélisme et affaibli les incitations au mérite. Les grandes mobilisations de 2019 visaient explicitement ce mécanisme, accusé d’entretenir corruption et services défaillants.
À lire aussi : Vingt ans après l’invasion américaine, l’Irak peut-il enfin connaître une paix durable ?
Au Liban, les accords de Taëf de 1989 ont mis fin à la guerre civile en reconduisant une répartition confessionnelle du pouvoir. Cette formule a stabilisé la coexistence, mais elle a aussi fortement politisé l’administration et fragmenté les responsabilités, au prix de blocages répétés dans les politiques publiques.
À lire aussi : Le Liban a enfin un président. Et alors ?
En Bosnie-Herzégovine, l’architecture issue des accords de Dayton en 1995 a garanti l’équilibre entre peuples constitutifs – les Bosniaques, les Serbes et les Croates –, mais créé une gouvernance extrêmement complexe à plusieurs étages où les chevauchements de compétences freinent coordination et réformes. Le dispositif mis en place par les accords de Dayton prévoit en effet la présence d’un haut représentant pour la Bosnie-Herzégovine, chargé de superviser l’application civile de l’accord de paix. Les diagnostics récents évoquent des dysfonctionnements persistants et des tensions politiques récurrentes qui testent les limites du système.
À Chypre, la division institutionnelle perdure depuis la fin de la guerre en 1974 : deux administrations coexistent de part et d’autre de la ligne verte, une zone démilitarisée gérée par la Force des Nations unies chargée du maintien de la paix à Chypre (UNFICYP). Toute solution devra articuler bi-communauté et harmonisation administrative. Au sud – la République de Chypre, membre de l’UE depuis 2004 –, les évaluations européennes soulignent toujours un degré de corruption élevé et insistent sur la nécessité de renforcer la redevabilité (accountability) au sommet de l’État.
Légitimité : représenter, protéger, délivrer
Au vu des recherches et études de cas existantes, les recommandations suivantes peuvent être formulées à l’intention des acteurs dans la reconstruction des États sortant de guerre. La légitimité d’un État post-conflit tient à trois choses.
D’abord, représenter : garantir que chaque groupe se retrouve dans les institutions, y compris par des mécanismes transitoires (on peut penser aux quotas ou à l’intégration d’ex-combattants), bornés dans le temps et articulés à des critères professionnels.
Ensuite, protéger : sécurité publique, justice accessible, reconnaissance des victimes.
Enfin, délivrer : l’accès à l’eau, à la santé, à l’éducation et à l’électricité restaure plus vite la confiance que tout discours. C’est là que la « plomberie » administrative – budgets prévisibles, logistique, achats publics – fait la différence.
Professionnaliser sans aseptiser la politique
La professionnalisation est centrale, mais l’administration ne peut être « hors sol ». Des concours transparents, des parcours de carrière clairs, une formation continue ciblée sur les métiers critiques (par exemple les finances publiques, achats, santé, éducation, justice) permettent de remonter le niveau.
La fiabilisation de la rémunération des agents publics/fonctionnaires (identification, bancarisation, contrôle des doublons) et la structuration d’outils simples (fiches de poste, manuels de procédures, tableaux de bord publics) sécurisent les managers face aux pressions.
Ces chantiers techniques n’ont de sens que s’ils s’accompagnent d’une protection de l’intégrité (via la cartographie des risques, contrôles indépendants, sanctions effectives) et d’un dialogue régulier avec les autorités politiques pour calibrer le rythme des réformes.
Décentraliser, oui, mais avec moyens et redevabilité
Beaucoup de pays misent sur la décentralisation pour rapprocher l’État des citoyens et apaiser les tensions. Le résultat dépend de l’alignement entre compétences transférées, ressources et capacités locales.
Transférer sans financement ni personnels formés produit des coquilles vides ; à l’inverse, une dispersion extrême fige les inégalités territoriales. Les accords État–collectivités doivent préciser qui fait quoi, avec quel budget et comment on rend des comptes.
Services essentiels : des victoires visibles et équitables
La paix perçue se gagne souvent au guichet. Des « victoires rapides » comme la réouverture simultanée de toutes les écoles d’un district (à l’image de la Sierra Leone après la guerre civile – voir le projet de reconstruction scolaire post-conflit ou la réouverture après l’épidémie d’Ebola en 2015 (1,8 million d’élèves sont retournés en classe)), le rétablissement d’un paquet minimal de soins comprenant vaccinations, santé maternelle et médecine primaire (c’est-à-dire des soins de première ligne pour les problèmes courants, la prévention et l’orientation, comme les campagnes nationales de vaccination en Afghanistan ou d’autres interventions nationales) ou encore la sécurisation de l’état civil et de l’identité (mesure décisive au Rwanda après 1994) créent un effet de cliquet.
L’important est d’annoncer des critères d’allocation transparents, de publier des données de performance (par exemple délais d’attente, disponibilité des médicaments, taux de scolarisation) et d’assurer une présence de l’État sur l’ensemble du territoire, y compris dans les zones anciennement contrôlées par des groupes armés.
Le Liberia, par exemple, a tenté de réduire la corruption perçue en rendant publiques les listes de distribution de médicaments essentiels (via la coopération avec des bailleurs et ONG) ; Timor-Leste a recours à la publication des statistiques de scolarisation par district pour rendre visibles ses progrès ; la Colombie via le plan Colombia a aussi essayé d’intégrer des mesures de transparence dans ses programmes de sécurité et développement (avec des dispositifs de suivi pour limiter les abus) ; et dans les zones anciennement contrôlées par les FARC, des « points de services intégrés » (santé, état civil, justice mobile) ont été déployés pour restaurer rapidement la confiance dans les institutions (en complément des efforts de présence institutionnelle de l’État).
Composer avec les institutions « hybrides »
Dans de nombreuses sociétés, des autorités coutumières et religieuses, des comités de quartier ou des ONG enracinées continuent d’arbitrer la vie sociale. Les ignorer fragilise l’appropriation locale.
L’enjeu n’est pas de « folkloriser » la gouvernance, mais d’articuler formel et informel : par exemple, associer des médiateurs reconnus aux comités scolaires ou aux conseils de santé, tout en garantissant des procédures et des recours conformes à l’État de droit.
Plusieurs expériences offrent des points de repère : au Rwanda, les juridictions gacaca, inspirées des tribunaux coutumiers, ont permis de juger plus de deux millions de dossiers liés au génocide, tout en intégrant un encadrement légal.
En Somalie, certains programmes de santé ont fonctionné en partenariat avec les autorités religieuses et les comités de quartier pour assurer l’accès aux cliniques malgré l’absence d’État central.
En Afghanistan – avant le retour des talibans –, l’intégration des conseils locaux (shuras) dans la gestion des écoles communautaires a permis d’augmenter la scolarisation, surtout des filles.
Que peuvent faire les bailleurs ?
Les partenaires internationaux – ONU, Union européenne, agences bilatérales – sont d’un grand secours s’ils privilégient l’investissement dans la capacité de l’État, plutôt que des circuits parallèles, tels que les unités de gestion de projets ad hoc financées par les bailleurs et opérant en marge des ministères, le recours massif aux ONG internationales pour fournir directement les services publics (santé, éducation, eau), ou encore les flux financiers hors budget national (comme le paiement direct des salaires d’enseignants ou de soignants par des agences extérieures, au lieu de passer par les systèmes de paie de l’État).
La France, via l’AFD et l’INSP (ex-ENA) pour la formation des cadres, peut jouer un rôle utile à condition d’inscrire l’appui dans une co-construction avec les ministères.
Plus largement, l’expérience comparée plaide pour des programmes qui, dès le départ, planifient la maintenance, le financement récurrent et la transmission des compétences aux équipes locales.
Plus largement, l’expérience comparée plaide pour des programmes qui, dès le départ, planifient la maintenance, le financement récurrent et la transmission des compétences aux équipes locales. Un exemple souvent cité est celui du secteur de l’eau au Mozambique, où le National Rural Water Supply Program a intégré dès les années 2000 la formation de comités villageois et le financement de l’entretien des pompes à main : après transfert de compétences, plus de 80 % des points d’eau restaient fonctionnels plusieurs années après l’installation.
En guise de boussole
Rebâtir l’État après la guerre est un exercice d’équilibriste. Trop de compromis politiques paralysent l’action publique ; trop de purisme technocratique peut rallumer les griefs.
Les cas de l’Irak, du Liban, de la Bosnie-Herzégovine et de Chypre rappellent qu’on consolide la paix en même temps qu’on améliore l’efficacité : par une professionnalisation progressive, une inclusivité maîtrisée, des services qui fonctionnent partout sur le territoire et une lutte anticorruption crédible. La paix durable est moins un « événement » qu’une routine administrative qui tient, jour après jour.
Mohamad Fadl Harake ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
