12.01.2026 à 15:54
La bulle de l’IA n’a rien de nouveau : Karl Marx en a expliqué les mécanismes, il y a près de 150 ans
Texte intégral (2462 mots)

L’explosion des investissements dans l’intelligence artificielle révèle, comme l’avait décrit Marx, d’une difficulté structurelle du capitalisme à absorber ses propres excédents, au prix d’une financiarisation accrue et de fragilités économiques croissantes.
Lorsque Sam Altman, patron d’OpenAI, a déclaré plus tôt cette année à des journalistes à San Francisco que le secteur de l’intelligence artificielle (IA) était en train de former une bulle, le marché technologique états-unien a réagi presque instantanément. Combinée au fait que 95 % des projets pilotes en IA échouent, sa remarque a été perçue par les traders comme un signal d’alerte plus large. Même si Altman visait spécifiquement les start-ups non cotées plutôt que les grands groupes en Bourse, certains semblent y avoir vu une évaluation de l’ensemble du secteur.
Le milliardaire de la tech Peter Thiel (NDT : un proche de Donald Trump) a par exemple vendu ses actions Nvidia, tandis que l’investisseur américain Michael Burry – rendu célèbre par The Big Short – a parié des millions de dollars sur une baisse de la valeur de ce fabricant de puces mais également de l’éditeur américain de logiciels d’analyse data Palantir.
À lire aussi : Pourquoi la hausse du prix des mémoires vives informatiques est une menace pour l’économie européenne
Au fond, le propos d’Altman ne met pas seulement en lumière la fragilité de certaines sociétés, mais une tendance plus profonde qu’avait anticipée Karl Marx : le problème du capital excédentaire, qui ne parvient plus à trouver de débouchés rentables dans la production.
La théorie marxiste des crises
L’avenir de l’IA n’est pas en cause. Comme Internet après l’éclatement de la bulle de 2001, la technologie est appelée à durer. Ce qui pose question, en revanche, c’est la destination du capital une fois que les actions liées à l’IA ne fourniront plus les rendements spéculatifs promis ces dernières années.
Cette interrogation nous ramène directement à l’analyse marxienne des crises liées à la suraccumulation. Marx soutenait qu’une économie devient instable lorsque la masse de capital accumulé ne peut plus être réinvestie de manière rentable.
Les investissements technologiques masquent la faiblesse économique
Des années de taux d’intérêt bas et de liquidités abondantes durant la pandémie ont gonflé les bilans des entreprises. Une large part de ces liquidités s’est dirigée vers le secteur technologique, en se concentrant sur ce que l’on appelle les « Sept Magnifiques » – Amazon, Alphabet, Meta, Apple, Microsoft, Nvidia et Tesla. Sans ces entreprises, la performance des marchés serait négative.
Cela ne traduit pas un véritable dynamisme technologique ; c’est le signe d’un capital concentré dans une poignée d’actifs surévalués, fonctionnant comme de l’« argent jeté dans la circulation sans base matérielle dans la production », qui circule sans ancrage dans l’activité économique réelle.
La conséquence est qu’une part moindre de l’investissement atteint l’« économie réelle », ce qui alimente la stagnation économique et la crise du coût de la vie – deux phénomènes largement masqués par l’indicateur du PIB.
Comment l’IA est devenue le dernier palliatif
Le géographe de l’économie David Harvey prolonge l’intuition de Marx avec la notion de « spatio-temporal fix », qu’on pourrait traduire par « correctif spatio-temporel », qui désigne la manière dont le capital résout provisoirement la stagnation en repoussant l’investissement dans le temps ou en s’étendant vers de nouveaux territoires.
La suraccumulation produit des excédents de travail, de capacités productives et de capital financier, qui ne peuvent être absorbés sans pertes. Ces excédents sont alors redirigés vers des projets de long terme, ce qui repousse les crises vers de nouveaux espaces et ouvre de nouvelles possibilités d’extraction.
Le boom de l’IA fonctionne à la fois comme un correctif temporel et un correctif spatial. Sur le plan temporel, il offre aux investisseurs des droits sur une rentabilité future qui pourrait ne jamais se matérialiser – ce que Marx appelait le « capital fictif ». Il s’agit d’une richesse qui apparaît dans les bilans alors qu’elle repose peu sur l’économie réelle, ancrée dans la production de biens.
Sur le plan spatial, l’extension des centres de données, des sites de fabrication de puces et des zones d’extraction minière nécessite des investissements matériels considérables. Ces projets absorbent du capital tout en dépendant de nouveaux territoires, de nouveaux marchés du travail et de nouvelles frontières de ressources. Mais comme le suggère l’aveu de Sam Altman, et alors que les mesures protectionnistes du président américain Donald Trump compliquent le commerce mondial, ces débouchés atteignent leurs limites.
Le coût du capital spéculatif
Les conséquences de la suraccumulation dépassent largement le seul monde des entreprises et des investisseurs. Elles se vivent socialement, et non de manière abstraite. Marx expliquait qu’une surproduction de capital correspond à une surproduction des moyens de production et des biens de première nécessité qui ne peuvent être utilisés aux taux d’exploitation existants.
Autrement dit, l’affaiblissement du pouvoir d’achat – ironiquement accéléré par l’essor de l’IA – empêche le capital de se valoriser au rythme auquel il est produit. Lorsque la rentabilité recule, l’économie résout ce déséquilibre en détruisant les moyens de subsistance des travailleurs et des ménages dont les retraites sont liées aux marchés financiers.
L’histoire offre des exemples frappants. L’éclatement de la bulle Internet a ruiné de petits investisseurs et concentré le pouvoir entre les mains des entreprises survivantes. La crise financière de 2008 a chassé des millions de personnes de leur logement tandis que les institutions financières étaient sauvées. Aujourd’hui, de grands gestionnaires d’actifs se couvrent déjà contre de possibles turbulences. Vanguard, par exemple, a opéré un net déplacement vers les obligations.
La spéculation comme moteur de la croissance
La bulle de l’IA est avant tout le symptôme de pressions structurelles, plus que le simple produit d’une dynamique technologique. Au début du XXᵉ siècle, l’économiste marxiste Rosa Luxemburg s’interrogeait déjà sur l’origine de la demande sans cesse croissante nécessaire à la reproduction élargie du capital.
Sa réponse fait écho à celles de Marx et de Harvey : lorsque les débouchés productifs se raréfient, le capital se déplace soit vers l’extérieur, soit vers la spéculation. Les États-Unis optent de plus en plus pour cette seconde voie. Les dépenses des entreprises dans les infrastructures d’IA contribuent désormais davantage à la croissance du PIB que la consommation des ménages, une inversion sans précédent qui montre à quel point la croissance actuelle repose sur l’investissement spéculatif plutôt que sur l’expansion productive.
Cette dynamique tire vers le bas le taux de profit et, lorsque le flux spéculatif s’inversera, la contraction suivra.
Les droits de douane resserrent l’étau sur le capital
L’inflation financière s’est accentuée à mesure que les soupapes traditionnelles permettant au capital de s’orienter vers de nouveaux marchés physiques ou géographiques se sont refermées.
Les droits de douane, les contrôles à l’exportation sur les semi-conducteurs et les mesures commerciales de rétorsion ont réduit l’espace mondial disponible pour les relocalisations. Comme le capital ne peut plus facilement échapper aux pressions structurelles de l’économie intérieure, il se tourne de plus en plus vers des outils financiers qui repoussent les pertes en refinançant la dette ou en gonflant les prix des actifs – des mécanismes qui accroissent finalement la fragilité lorsque l’heure des comptes arrive.
Le président de la Réserve fédérale des États-Unis Jerome Powell s’est dit favorable à d’éventuelles baisses des taux d’intérêt, signe d’un retour vers le crédit bon marché. En rendant l’emprunt moins coûteux, ces baisses permettent au capital de masquer ses pertes et d’alimenter de nouveaux cycles spéculatifs.
Marx a formulé cette logique dans son analyse du capital porteur d’intérêt, où la finance crée des droits sur une production future « au-delà de ce qui peut être réalisé sous forme de marchandises ». Il en résulte que les ménages sont poussés à s’endetter au-delà de ce qu’ils peuvent réellement supporter, échangeant ainsi une crise de stagnation contre une crise du crédit à la consommation.
Bulles et risques sociaux
Si la bulle de l’IA éclate alors que les gouvernements disposent de peu de marges pour redéployer les investissements à l’international et que l’économie repose sur un crédit de plus en plus fragile, les conséquences pourraient être lourdes.
Le capital ne disparaîtra pas mais se concentrera davantage dans les marchés obligataires et les instruments de crédit, gonflés par une banque centrale américaine désireuse de baisser les taux d’intérêt. Cela n’évite pas la crise ; cela en déplace simplement le coût vers le bas de l’échelle sociale.
Les bulles ne sont pas des accidents mais des mécanismes récurrents d’absorption du capital excédentaire. Si le protectionnisme de Trump continue de fermer les débouchés spatiaux et que les correctifs temporels reposent sur un endettement toujours plus risqué, le système s’oriente vers un cycle d’inflation des actifs, d’effondrement, puis de nouvelle intervention de l’État.
L’IA survivra, mais la bulle spéculative qui l’entoure est le symptôme d’un problème structurel plus profond – dont le coût, une fois pleinement révélé, pèsera avant tout sur les classes populaires.
Elliot Goodell Ugalde ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
12.01.2026 à 15:53
La Terre du Milieu de Tolkien, un lieu imaginaire pour repenser notre rapport à la nature
Texte intégral (2841 mots)

L’écrivain anglais J. R. R. Tolkien (1892-1973) était un cartographe de l’imaginaire. Dans le Seigneur des anneaux (1954-1955), il invente un monde dans lequel la frontière entre humanité et animalité est floue. Ses cartes de la Terre du Milieu construisent la cohérence spatiale et la densité narrative de la quête de la Communauté de l’anneau. Montagnes, forêts, rivières y constituent tantôt des épreuves spatiales, tantôt des espaces protecteurs ou de refuge. La géographie y structure le récit et façonne la fiction.
Les mondes imaginaires sont performatifs. Ils se nourrissent du réel dans une projection fictionnelle tout en l’interrogeant. Le Seigneur des anneaux n’y fait pas exception, nous invitant à réfléchir à nos liens avec la nature, à reconnaître sa valeur intrinsèque et à dépasser une conception dualiste opposant nature et culture, ne lui accordant qu’une valeur d’usage ou de ressource, à nous engager dans une éthique environnementale.
En suivant la Communauté, métissée, sur les chemins, parfois de traverse, les menant vers le mont Destin, nous sommes confrontés à différentes manières d’habiter et de transformer la nature : utopies rurales, zones industrieuses, refuges écologiques et lieux symboliques où des choix engagent l’avenir du monde. La fiction devient un outil pour questionner le réel, interroger nos pratiques et réfléchir aux enjeux environnementaux contemporains dans une ère désormais anthropocénique.
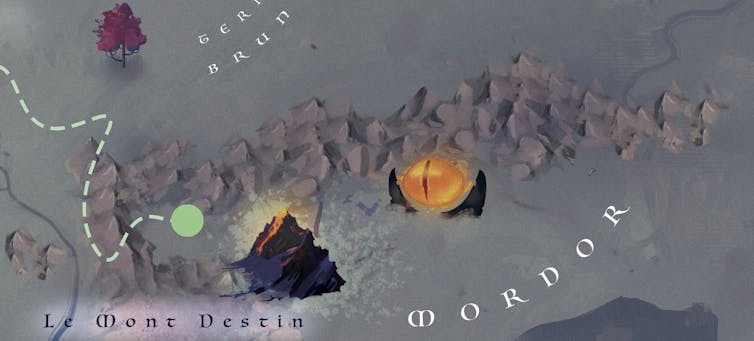
Habiter (avec) le monde : utopies rurales et résistance
La Comté repose sur un système agraire vivrier de polycultures fondé sur de petites exploitations familiales où le tabac réputé n’est que peu exporté. Les Hobbits vivent en autarcie et habitent littéralement une nature jardinée, dans des terriers. Le bocage, les prairies forment un maillage qui limite l’érosion et protège la biodiversité et organisent un territoire où nature et société coexistent harmonieusement. Cet idéal préindustriel s’éteint peu à peu dans le monde occidental moderne où une agriculture intensive et centralisée s’est imposée pour devenir norme sur un territoire remembré.

La forêt de Fangorn, elle, représente une nature qui résiste à la manière d’une zone à défendre (ZAD). Les Ents, gestionnaires du peuplement forestier, incarnent des arbres doués de parole, capables de révolte. Ils refusent la domination humaine fermant les sentiers d’accès avant de s’engager dans une guerre contre l’industrialisation menée par Saroumane en Isengard. Le chantier stoppé de l’autoroute A69 témoigne de la façon dont la nature peut parfois aujourd’hui par elle-même poser des limites aux projets d’aménagement voulus par l’humain.
La Lothlórien, enfin, symbolise une écotopie, un espace préservé du temps et des pressions humaines, où nature, société et spiritualité vivent en harmonie. La réserve intégrale de la forêt de la Massane, les forêts « sacrées » d’Afrique de l’Ouest ou celles du nord de la Grèce (massif du Pindes) font écho à cet idéal. Pensées comme des écosystèmes dont les dynamiques naturelles sont respectées et où l’intervention humaine contrôlée se fait discrète, elles permettent d’observer et de suivre les espèces, la régénération spontanée des habitats et leur résilience. Mais à l’image de la Lothlórien, un tel système de gestion reste spatialement rare, fragile. Il nécessite de construire la nature comme bien commun dont l’accès et l’usage sont acceptés par les communautés qui cohabitent avec ces espaces forestiers.

Ces trois types de territoires montrent qu’habiter le monde n’est pas simplement occuper, encore moins s’approprier, un espace de nature mais engager un dialogue avec lui, considérer qu’il a une valeur par lui-même, juste parce qu’il existe, et pas uniquement en tant que ressource. Il s’agit alors de cohabiter dans des interactions où chaque existant prend soin de l’autre.
Exploiter une nature ressource : de l’artificialisation à la destruction
La transformation des espaces de nature, comme le montre Tolkien, peut aussi répondre à une logique d’exploitation intensive, la nature offrant des ressources permettant d’asseoir la domination des humains sur la nature comme sur d’autres humains. Il ne s’agit plus d’envisager une cohabitation être humain/nature mais d’asservir la nature par la technique.
Isengard, le territoire de Saroumane au sud des monts Brumeux, contrôlé par la tour d’Orthanc, incarne la transformation radicale du milieu par et pour l’industrie ; une industrie dont la production d’Orques hybrides, sorte de transhumanisme appliqué à la sauvagerie, vise à renforcer le pouvoir de Saroumane et construire son armée pour prendre le contrôle d’autres territoires. La forêt est rasée, les fleuves détournés, le paysage mécanisé, dans l’unique but d’alimenter l’industrie. Les champs d’exploitation des schistes bitumineux en Amérique du Nord montrent à quel point l’exploitation de la nature peut détruire des paysages, polluer une nature qui devient impropre et dont les fonctions et services écosystémiques sont détruits).

La Moria, ancien royaume florissant du peuple Nain, est l’exemple de l’issue létale de la surexploitation d’une ressource naturelle. Si le mithril, minerai rare de très grande valeur a construit la puissance du royaume Nain, son exploitation sans cesse plus intense, vidant les profondeurs de la terre, va conduire à l’effondrement de la civilisation et à l’abandon de la Moria. Ce territoire minier en déshérence fait écho aux paysages des régions du Donbass par exemple, qui conservent aujourd’hui encore les traces visibles de décennies d’extraction charbonnière : galeries effondrées, sols instables et villes partiellement abandonnées.
Lieux de rupture et enjeux planétaires
On trouve enfin chez Tolkien une mise en scène d’espaces qui représentent des lieux de bascule pour l’intrigue et l’avenir du monde, en l’occurrence la Terre du Milieu.
Le « bourg-pont » de Bree, zone frontière matérialisée par une large rivière, marque la limite entre l’univers encore protégé, presque fermé, de la Comté et les territoires marchands de l’est, ouverts et instables. Mais Bree est aussi un carrefour dynamique, lieu d’échanges où circulent et se rencontrent des personnes, des biens et des récits. Un carrefour et une frontière où toutefois la tension et la surveillance de toutes les mobilités sont fortes.

Lieu de transition, symbolisant à la fois ouverture et fermeture territoriales, Bree est un point de bascule dans le récit où convergent et se confrontent des personnages clés de l’intrigue (les Hobbits, Aragorn, les cavaliers noirs de Sauron), les figures du Bien et du Mal autour desquelles vont se jouer l’avenir de la Terre du Milieu. Comme Bree, Calais est un point de friction entre un espace fermé (les frontières britanniques) et un espace ouvert où s’entremêlent société locale, logiques nationales et transnationales, mais où les circulations sont de plus en plus contrôlées.
Enfin, la montagne du Destin, volcan actif, incarne le lieu de rupture ultime, celui où le choix d’un individu, garder l’anneau pour lui seul dans un désir de pouvoir total ou accepter de le détruire, a des conséquences majeures pour toute la Terre du Milieu. Certains espaces jouent un rôle similaire sur notre terre. La fonte du permafrost sibérien ou de l’inlandsis antarctique pourrait libérer d’immenses quantités de carbone pour l’un, d’eau douce pour l’autre, accélérant le dérèglement climatique et la submersion de terres habitées.
Ces lieux où des actions localisées peuvent déclencher des effets systémiques globaux, au-delà de tout contrôle, concentrent ainsi des enjeux critiques, écologiques, géopolitiques ou symboliques.
La fiction constitue un puissant vecteur de réflexion quant à notre responsabilité collective dans la gestion de la nature, quant à nos choix éthiques et politiques dans la manière d’habiter la Terre en tant que bien commun et ainsi éviter d’atteindre un point de bascule qui sera celui d’un non-retour.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
12.01.2026 à 12:02
Le microcrédit, un outil financier qui peut coûter cher aux femmes
Texte intégral (1352 mots)

Grâce au microcrédit, les femmes gagnent une plus grande indépendance financière et un pouvoir décisionnel dans leur activité professionnelle. Corollaires à ce progrès : le surendettement, les violences conjugales et… le suicide. Quelles sont les solutions pour limiter ces effets délétères ?
Cinquante ans après le lancement du microcrédit au Bangladesh, les femmes représentent aujourd’hui 80 % des bénéficiaires, mais en profitent-elles réellement ?
Pression de groupe pouvant entraîner des suicides, spirale de surendettement ou encore manque de contrôle des femmes sur l’utilisation des prêts… autant de dérives qui peuvent accroître la vulnérabilité des emprunteuses.
Dans un état de l’art que nous avons publié récemment, nous regardons l’impact réel du microcrédit sur les femmes. Le résultat n’est pas totalement en leur faveur.
Notre état de l’art s’appuie sur des travaux menés principalement dans des pays en développement, incluant l’Asie du Sud, l’Océanie et l’Afrique subsaharienne.
La pression des pairs
Comment fonctionne le prêt solidaire, outil le plus utilisé en microfinance ?
De petits groupes, composés de cinq à dix individus, empruntent ensemble. Si l’un des membres manque une échéance, les autres doivent avancer son dû. La pression des pairs assure le remboursement du prêt, mais elle déplace la charge sociale sur le groupe.
Cette pression peut être plus ou moins bien supportée. En Andhra Pradesh, un État de l’Inde, le cumul de dettes et des méthodes de recouvrement oppressives ont entraîné une vague de suicides, causant près de 80 morts en 2010. Malgré les mesures de régulation mises en place par les gouvernements et les institutions du secteur, des cas de suicides continuent d’être signalés. Il demeure difficile d’estimer régulièrement le nombre de décès liés au microcrédit, faute de données.
Un surendettement à la clé
Le manque d’accompagnement et d’éducation financière des emprunteurs et emprunteuses peuvent eux mener à l’échec de l’emprunt. Force est de constater que beaucoup de microcrédits financent de petites activités sur des marchés déjà saturés, où la probabilité de dégager un profit est faible.
Concrètement, il s’agit souvent d’activités à faible barrière à l’entrée mais très concurrentielles : petit commerce (vente de nourriture, fruits et légumes, vêtements), kiosques et revente sur marché, petite restauration, couture, etc. Sur des marchés locaux où de nombreuses personnes proposent des produits et des services similaires, la demande est rapidement « partagée ». Les marges sont faibles et les revenus restent volatils, ce qui limite la capacité à rembourser.
Face à cette situation, l’emprunteuse peut devoir contracter un nouveau prêt, l’exposant à un risque de surendettement.
Il peut s’agir d’un renouvellement, ou top-up, auprès de la même institution, d’un second microcrédit auprès d’une autre institution, ou d’un prêt informel (tontine, famille ou autre prêteur particulier). Ces prêts sont souvent de petits montants mais à remboursements fréquents. Leur coût peut être élevé, une fois les intérêts inclus. Le surendettement survient souvent lorsque le nouveau prêt sert à rembourser le précédent plutôt qu’à financer une activité rentable.
Qui décide de l’usage du prêt ?
Si, comme mentionné préalablement, la majorité des microcrédits sont accordés aux femmes, ces dernières n’ont pas forcément la maîtrise de l’argent obtenu qui revient à un parent ou un conjoint. Cela s’explique par les rapports de pouvoir au sein du ménage et des normes sociales, qui font de l’homme le décisionnaire principal du couple, surtout lorsqu’il s’agit d’argent.
Ce décalage entre celle qui paie et celui qui décide peut générer des tensions au sein du ménage. Dans certains contextes, l’accès au microcrédit peut même aller jusqu’à engendrer une hausse de la violence conjugale. Par exemple, à partir d’un échantillon national au Bangladesh, soit 4 163 femmes mariées, les chercheurs Nadine Shaanta Murshid, Ayse Akincigil et Allison Zippay concluent qu’avoir un microcrédit pour les femmes avec un meilleur statut économique est associé à une probabilité de 9 % de plus de subir de la violence domestique.
Prêter autrement ?
Pour limiter ces effets, des solutions existent.
Passer de la garantie de groupe à la responsabilité individuelle réduit la pression des pairs sans hausse des défauts. Au lieu qu’un « groupe solidaire » de 5 à 10 femmes soit collectivement responsable, chaque emprunteuse signe un contrat individuel et n’est responsable que de sa propre échéance. Pourquoi cela peut fonctionner ? Parce que la pression sociale du groupe peut pousser à rembourser même quand le prêt n’est pas rentable.
Proposer des microformations très pratiques en « règles de pouce », comme une formation d’une heure et demie maximum sur les bases de la gestion financière, peut contribuer à rendre les investissements profitables et limiter le risque de surendettement. Elles peuvent porter sur des gestes très concrets de gestion : séparer l’argent du ménage et celui de l’activité, tenir un mini-carnet quotidien des entrées et des sorties ou apprendre à calculer simplement des coûts, des prix et des marges pour identifier ce qui est réellement rentable.
Gérer l’emprunt directement sur les comptes personnels des emprunteuses, notamment via les comptes mobile money, donne aux femmes une autonomie financière effective. Elles reçoivent, paient et épargnent elles-mêmes, tout en réduisant le risque d’appropriation des fonds par un homologue masculin. Le prêt est versé sur le wallet mobile de l’emprunteuse, puis les remboursements se font depuis ce même compte ; cela rend plus difficile la « capture » immédiate en liquide par le conjoint et crée une traçabilité/contrôle directe des flux (réception, paiements fournisseurs, remboursement).
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
