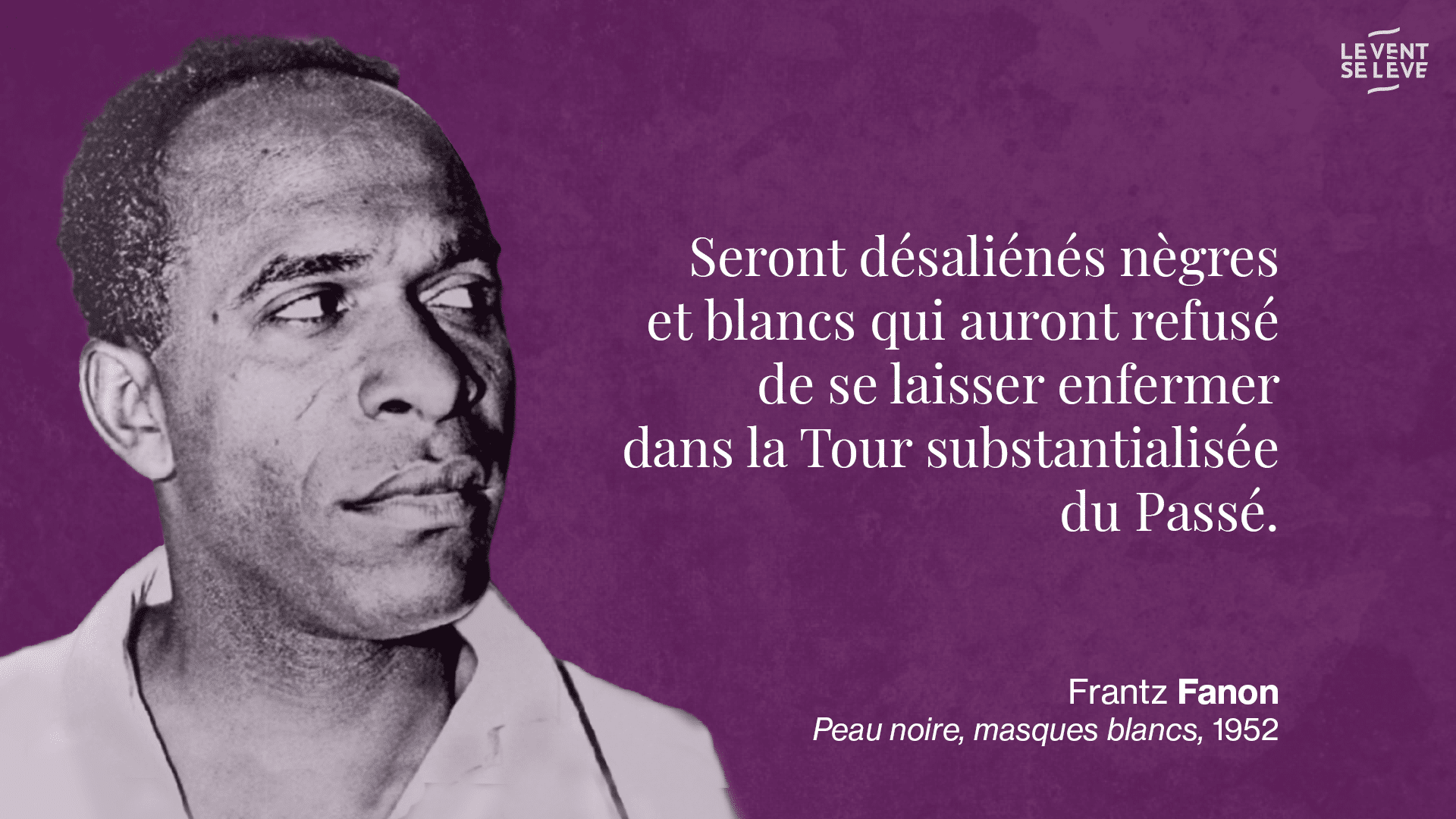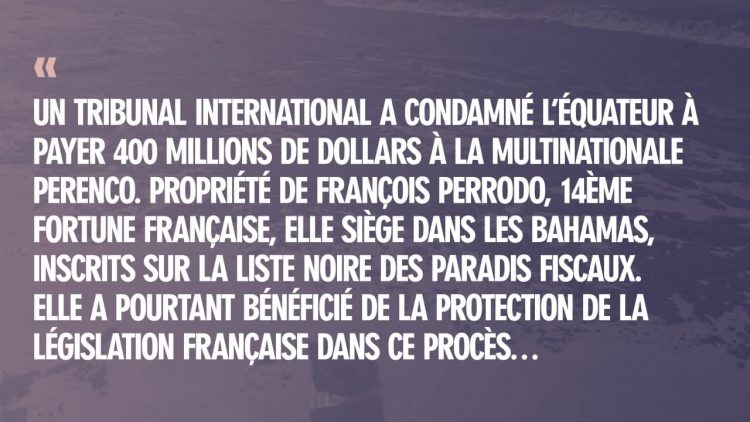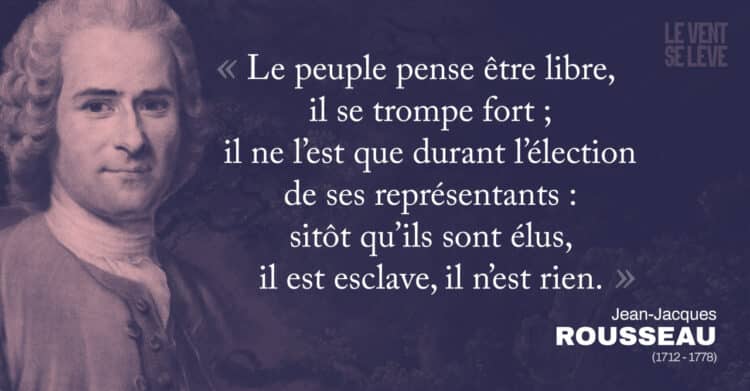Accès libre
05.05.2024 à 18:36
Pourquoi l’extrême-droite s’intéresse aux théories décoloniales
Miri Davidson
Texte intégral (2487 mots)
L’extrême droite veut décoloniser. En France, les intellectuels d’extrême droite ont pris l’habitude de désigner l’Europe comme la victime autochtone d’une « colonisation par les immigrés » orchestrée par les élites « mondialistes ». Renaud Camus, théoricien du « grand remplacement », a même fait l’éloge des grands noms de la littérature anticoloniale – « tous les textes majeurs de la lutte contre la colonisation s’appliquent remarquablement à la France, en particulier ceux de Frantz Fanon » – en affirmant que l’Europe a besoin de son FLN (le Front de Libération Nationale a libéré l’Algérie de l’occupation française, ndlr). Le cas de Renaud Camus n’a rien d’isolé : d’Alain de Benoist à Alexandre Douguine, les figures de l’ethno-nationalisme lisent avec attention les théoriciens décoloniaux. Et ils incorporent leurs thèses, non pour contester le système dominant, mais pour opposer un capitalisme « mondialiste », sans racines et parasitaire, à un capitalisme national, « enraciné » et industriel.
Article originellement publié dans la New Left Review sous le titre « Sea and Earth », traduit par Alexandra Knez pour LVSL.
On retrouve un style de raisonnement similaire chez les suprémacistes hindous qui recourent aux idées des théoriciens décoloniaux latino-américains pour présenter l’ethnonationalisme comme une forme de critique indigène radicale; l’avocat et écrivain Sai Deepak l’a fait avec tant de succès qu’il a réussi à persuader le théoricien du décolonialisme Walter Mignolo de composer un texte de soutien. Pendant ce temps, en Russie, Poutine revendique le rôle leader de la Russie dans un « mouvement anticolonial contre l’hégémonie unipolaire », tandis que son ministre des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, promet d’être « solidaire des demandes africaines dans leur volonté d’achever le processus de décolonisation ».
Le phénomène va bien au-delà des retournements de position habituels du discours réactionnaire. Une perspective décoloniale est ainsi défendue par les deux figures intellectuelles les plus en vue de la « nouvelle droite » européenne : Alain de Benoist et Alexandre Douguine. Dans le cas de de Benoist, il s’agit d’un changement majeur par rapport à ses allégeances colonialistes antérieures. Sensibilisé à la politique pendant la guerre d’Algérie, il a trouvé sa voie au sein des organisations de jeunes nationalistes blancs qui cherchaient à empêcher l’effondrement de l’empire français.
Après avoir loué la bravoure de l’OAS (l’Organisation de l’Armée Secrète était un groupe terroriste d’extrême-droite fermement opposé à l’indépendance algérienne, ndlr), il a consacré deux de ses premiers livres à la mise en œuvre du nationalisme blanc en Afrique du Sud et en Rhodésie, décrivant l’Afrique du Sud sous l’apartheid comme « le dernier bastion de l’Occident d’où nous venons ». Cependant, dans les années 1980, de Benoist a changé de cap. Après avoir adopté un imaginaire païen et abandonné les références explicites au nationalisme blanc, il a choisi d’orienter sa pensée vers la défense de la diversité culturelle.
Comme l’écrit Fanon, la décolonisation ne peut ni renoncer « au présent ni à l’avenir au profit d’un passé mystique », ni se fonder sur « les litanies stériles et le mimétisme nauséabond » d’une Europe avilie qui, à l’époque où il écrit, « oscille entre la désintégration atomique et spirituelle ».
Face aux assauts du multiculturalisme libéral et du consumérisme de masse, de Benoist soutient désormais que la nouvelle droite doit lutter pour défendre le « droit à la différence ». De là à revendiquer une parenté tardive avec le malheureux sort des nations du tiers-monde, il n’y a qu’un pas. « Sous l’égide des missionnaires, des armées et des marchands, l’occidentalisation de la planète a incarné un mouvement impérialiste nourri par le désir d’effacer toute altérité », écrivait-il avec Charles Champetier dans leur Manifeste pour une renaissance européenne (2012).
Les auteurs insistent sur le fait que la nouvelle droite « défend tous les groupes ethniques, et toutes les langues et cultures régionales menacés d’extinction » et « soutient les peuples qui luttent contre l’impérialisme occidental ». Aujourd’hui, la préservation des différences anthropologiques et le sentiment de fragilité des autochtones sont des thèmes récurrents dans l’extrême droite européenne. « Nous refusons de devenir les Indiens d’Europe », proclame le manifeste de Génération identitaire, un groupe de jeunes néofascistes.
Douguine, proche collaborateur d’Alain de Benoist, a intégré encore plus radicalement cet esprit décolonial dans sa vision du monde. Son système de pensée – qu’il appelle néo-eurasisme ou « quatrième théorie politique » – s’appuie sur une critique de l’eurocentrisme inspirée d’anthropologues tels que Lévi-Strauss. Selon lui, la Russie a beaucoup en commun avec le monde postcolonial : elle aussi est victime de la volonté d’assimilation inhérente au libéralisme occidental qui transforme un monde d’une grande diversité ontologique en une masse plate, homogène et départicularisée (on peut se reporter à la « matière humaine indifférenciée » de Renaud Camus ou à ce que Marine Le Pen a appelé « la bouillie sans saveur » du mondialisme).
Contrairement à ce programme universaliste, affirme Douguine, nous vivons dans un « plurivers » de civilisations distinctes, chacune évoluant à son propre rythme. « Il n’y a pas de processus historique unifié. Chaque peuple a son propre modèle historique qui évolue à un rythme différent et parfois dans des directions différentes ». Les parallèles avec l’école décoloniale de Mignolo et Anibal Quijano sont évidents. Chaque civilisation s’épanouit dans un cadre épistémologique unique, mais cette efflorescence a été freinée par « l’épistémè unitaire de la modernité » (les mots sont de Douguine, mais ils pourraient être de Mignolo).
La modernisation, l’occidentalisation et la colonisation sont « une série de synonymes » : chacune implique l’imposition d’un modèle de développement exogène à des civilisations plurielles. Le fait que les identités ethnonationales défendues par Douguine soient des artefacts de la production coloniale de la différence – les régimes raciaux par lesquels elle différencie, catégorise et organise l’exploitation et l’extraction – n’est pas envisagé. Pas plus d’ailleurs que le caractère moderne de nombreux mouvements anti-impérialistes qui cherchaient non pas à revenir à une culture traditionnelle, mais plutôt à refonder le système mondial. Comme l’écrit Fanon, la décolonisation ne peut ni renoncer « au présent ni à l’avenir au profit d’un passé mystique », ni se fonder sur « les litanies stériles et le mimétisme nauséabond » d’une Europe avilie qui, à l’époque où il écrit, « oscille entre la désintégration atomique et spirituelle ».
Douguine et de Benoist ne se laissent pas impressionner par de telles contradictions. « La quatrième théorie politique est devenue un slogan pour la décolonisation de la conscience politique », affirme Douguine, dont la première expression pratique est l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Il y perçoit une lutte longtemps attendue pour la réunification de l’Eurasie, ancien monde panslave dépecé par les visées occidentales, mais aussi la première étape de ce qu’il appelle le « grand réveil », une bataille millénaire pour renverser l’ordre mondial libéral et inaugurer un monde multipolaire.
Douguine entrevoit une coalition de mouvements à travers le monde pour participer à cette bataille : « Les manifestants américains seront une aile et les populistes européens seront l’autre aile. La Russie en général sera la troisième ; elle sera une entité angélique avec de nombreuses ailes – une aile chinoise, une aile islamique, une aile pakistanaise, une aile chiite, une aile africaine et une aile latino-américaine ». Mais la guerre en Ukraine n’est-elle pas une guerre impériale, ou une guerre d’ « impérialismes concurrents », comme l’a formulé Liz Fekete ? Douguine serait d’accord. L’invasion de l’Ukraine par la Russie est une étape clé de sa « renaissance impériale ».
Mais comment peut-on parler simultanément de renaissance impériale et de décolonisation ? Ici, Douguine et de Benoist puisent largement chez Carl Schmitt. Dans ses écrits sur la géopolitique, Schmitt identifie dans la « puissance navale » des empires maritimes anglo-américains un type particulier de domination impériale – dispersée, déterritorialisée, fluctuante et financière. La puissance navale fait naître un empire dispersé dépourvu de cohérence territoriale, et génère un cadre spatial et juridique qui considère la surface de la terre comme une simple série de voies de circulation.
Cet impérialisme génère également sa propre épistémologie : « Le mode de pensée juridique qui se rapporte à un empire mondial géographiquement incohérent et dispersé sur la terre tend par nature vers une argumentation universaliste », écrit Schmitt. Sous le couvert d’universaux abstraits tels que les droits de l’homme, cet imperium « se mêle de tout ». Il s’agit d’une « idéologie pan-interventionniste », écrit-il, « et tout ceci sous couvert d’humanitarisme ».
À l’imperium déterritorialisé, Schmitt oppose un impérialisme territorial – et légitime. Il s’appuie sur ses concepts de Grossraum et de Reich : un Grossraum peut être compris comme un bloc civilisationnel, tandis que le Reich en est le centre spirituel, logistique et moral. Comme l’écrit Schmitt, « chaque Reich a un Grossraum où son idée politique rayonne et qui ne doit pas être confronté à des interventions étrangères ». Si l’imperium correspond à une « conception scientifique vide, neutre, mathématique et naturelle de l’espace », le Grossraum implique une conception « concrète » inséparable du peuple particulier qui l’occupe.
Cette notion territoriale de l’espace, écrit Schmitt, « est incompréhensible pour l’esprit du Juif ». Comme le proclame de Benoist : « La distinction fondamentale entre la terre et la mer, les puissances terrestres et maritimes, qui définissent la distinction entre la politique et le commerce, le solide et le liquide, l’espace et le réseau, la frontière et le fleuve, va reprendre de l’importance. L’Europe doit cesser de dépendre de la puissance navale des États-Unis et être solidaire de la logique continentale de la terre ». La terre est colonisée par l’eau, les régions centrales par les villes portuaires, l’autorité souveraine par les flux de capitaux transnationaux.
Dans les écrits récents de Douguine et de Benoist, la « colonisation » est une pratique déterritorialisée méprisable, tandis que l’ « impérialisme » est réservé à une forme d’expansion territoriale plus noble.
Avec cette opposition entre l’imperium et le Grossraum, la pensée de Schmitt offre une perspective de réalignement significative : la construction d’un empire territorial devient compatible avec un certain sentiment anticolonial. Dans les écrits récents de Douguine et de Benoist, la « colonisation » est une pratique déterritorialisée méprisable, tandis que l’ « impérialisme » est réservé à une forme d’expansion territoriale plus noble. Le colonialisme en vient ainsi à signifier moins un phénomène de domination politique ou militaire qu’un « état d’asservissement intellectuel », pour reprendre les termes de Douguine, moins une question d’annexion territoriale qu’une forme d’assujettissement à des « modes de pensée coloniaux ».
C’est la « souveraineté » des esprits, des mots et des catégories qui est violée. Le colonialisme domine le monde en supprimant les identités : plus de femmes, seulement le « genre X » (pour reprendre la terminologie de Giorgia Meloni). Il est « ethnocidaire » par essence ; l’effacement culturel et le remplacement démographique sont ses principaux outils. Les colonisations militaires, administratives, politiques et impérialistes sont certes douloureuses pour les colonisés, nous dit Renaud Camus, mais elles ne sont rien à côté des colonisations démographiques qui touchent à l’être même des territoires conquis, transformant leurs âmes et leurs corps.
Avec cette nouvelle définition de la colonisation renvoyant à des schémas migratoires changeants (engendrés ni plus ni moins par la structure coloniale de l’économie mondiale), à des normes de genre en mutation et à une culture libérale homogénéisante, l’extrême droite se présente désormais comme la championne de la souveraineté populaire et de l’autodétermination des peuples. Elle peut également mettre en scène une lutte imaginaire contre les ravages du capital transnational. Pour ces théoriciens, décoloniser, c’est séparer un type de capitalisme d’un autre, une procédure bien établie au sein de la pensée d’extrême-droite.
Un capitalisme financier mondialiste, sans racines, parasitaire (pensé comme colonial) est distingué d’un capitalisme racial, national, industriel (pensé comme souverain, voire décolonial). Il va sans dire qu’une telle séparation est illusoire : les systèmes globaux d’accumulation du capital, avec leurs processus enchevêtrés de spéculation immatérielle et d’extraction de ressources, ne peuvent pas être découplés de cette manière. Mais séparer l’inséparable ne semble pas poser de problème à la pensée réactionnaire. En réalité, cette séparation apparaît même cruciale pour elle. En effet, une fois qu’une antinomie imaginaire a été construite, on peut en désavouer le côté détesté et, de cette manière, sembler maîtriser ses propres déchirures intérieures.
04.05.2024 à 17:51
CONFÉRENCE – JAURÈS ET LA SOCIALE, UNE THÉORIE SOCIALISTE ET ÉMANCIPATRICE DE L’ÉTAT
la Rédaction
Lire plus (331 mots)
De la gauche à l’extrême-droite, l’héritage de Jean Jaurès, père du socialisme français, est fréquemment revendiqué. Galvaudée, sa figure est alors érigée en autorité, celle de l’apôtre de la paix ou d’une gauche qui savait encore être patriote. Mais derrière ces images convenues, peu se réfèrent directement à son œuvre théorique, masquée par l’ombre portée de son action politique et par l’aura du martyr. Ainsi, la littérature sur la conception philosophique de l’État jaurésien est abondante, mais en général mal connue au-delà des cercles universitaires. C’est l’ambition de cette table-ronde que de rendre accessible à un public élargi la pensée de Jaurès sur une institution qui fait débat à gauche, l’État. En effet, au contraire de Marx et d’Engels qui prévoient le dépérissement de l’État, Jaurès en propose une lecture positive, qui fait de “l’État juste” un outil protecteur à partir duquel peut se réaliser un socialisme républicain. Pour Jaurès, la synthèse entre la tradition républicaine issue de la Révolution française et celle du mouvement ouvrier, la Sociale, doit aboutir à la réalisation d’une République démocratique, sociale et laïque, au cœur d’une théorie socialiste de l’émancipation.
➜ Pour discuter de la question, Le Vent Se Lève recevait le 18 novembre 2023 Gilles Candar, historien, président de la Société d’études jaurésiennes, Clothilde Combes, doctorante en droit public, spécialiste de l’État juste selon Jaurès et Hugo Rousselle-Nerini, historien du droit, spécialiste des droits sociaux.
03.05.2024 à 17:19
Transition énergétique : quand les multinationales rançonnent les États grâce aux traités internationaux
Jacobin Magazine
Texte intégral (2944 mots)
Dès l’indépendance des anciennes colonies européennes, les grandes entreprises extractivistes ont mis en œuvre des mécanismes pour y préserver leurs intérêts économiques. Depuis quelques décennies, ce processus touche aussi les pays européens qui tentent de réaliser leur transition énergétique. Le cas du Traité sur la Charte de l’Énergie, dont l’Union Européenne vient de sortir, constitue ici un cas d’école. Par Nick Dearden, traduit par Pierra Simon-Chaix et édité par William Bouchardon [1].
Alors que la lutte contre le changement climatique accuse un immense retard, un récent vote du Parlement Européen est venu apporter une petite lueur d’espoir. Le 24 avril dernier, celui-ci a en effet validé la sortie de l’Union européenne du traité sur la Charte de l’énergie (TCE), demandée par plusieurs pays-membres dont la France. Le Royaume-Uni pourrait bientôt suivre, le gouvernement conservateur ayant annoncé son futur retrait en février dernier.
Ce traité climaticide est un legs d’une autre époque. Sa rédaction remonte aux années 1990, à une période où il s’agissait de préserver les intérêts énergétiques occidentaux dans les pays de l’ex-Union soviétique. Le cœur de ce traité est un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États, via un tribunal d’arbitrage privé. Celui-ci permet aux sociétés et aux investisseurs transnationaux de poursuivre des gouvernements qui imposeraient des modifications réglementaires susceptibles d’attenter à leurs profits.
Cela fait à présent plusieurs décennies que sont inscrites des clauses relatives au mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États dans les accords de commerce et d’investissement. Ces dispositions demandées par les magnats du pétrole et les financiers voient le jour dès les années 1950 : à mesure que les pays du Sud global se libéraient des jougs coloniaux et que des gouvernements issus des mouvements de libération nationale y prenaient le pouvoir, les dirigeants de grandes entreprises occidentales s’inquiétaient de la protection de leurs intérêts économiques.
La nationalisation du pétrole iranien en 1953 a marqué une rupture. Si les États-Unis et le Royaume-Uni ont alors organisé un coup d’État pour renverser le gouvernement iranien, il devenait évident que cette méthode n’était pas viable à long terme. Il valait mieux créer une série d’obligations juridiques. De fait, selon les mécanismes de règlement des différends entre investisseurs et États, si un gouvernement s’approprie les actifs d’une entreprise étrangère, celle-ci a la possibilité de contourner le système judiciaire national et de se tourner directement vers l’arbitrage international. Ainsi, avec ce système fonctionnant dans l’opacité la plus totale, sans véritable juge chargé de peser les différents intérêts, sans possibilité de faire appel et avec tout le poids du droit international pour faire appliquer les verdicts, les entreprises ont instauré leur propre système judiciaire unilatéral.
Avec ce système fonctionnant dans l’opacité la plus totale, sans véritable juge chargé de peser les différents intérêts, sans possibilité de faire appel et avec tout le poids du droit international pour faire appliquer les verdicts, les entreprises ont instauré leur propre système judiciaire unilatéral.
Dans les années 1990, alors que l’Union soviétique s’effondre, les opportunités offertes aux entreprises occidentales sont légion, mais les sociétés se refusent à courir le risque que de nouveaux gouvernements puissent remettre en cause leur business. Le traité sur la charte de l’énergie a alors été conçu pour supprimer ce risque et enclencher des réglementations durablement favorables aux entreprises. Ce que les pays occidentaux n’ont alors pas réalisé, c’est qu’ils allaient à leur tour devenir la proie de ces tribunaux d’arbitrage.
Après le Sud global, l’Occident pris pour cible
À l’orée des années 2000, les entreprises se sont rendu compte que la menace la plus criante n’émanait pas de gouvernements souhaitant nationaliser leurs plateformes pétrolières, mais plutôt de mesures pour le climat, considérées à travers l’Europe comme une nécessité de plus en plus criante. Les juristes ont alors travaillé sans relâche pour multiplier les affaires susceptibles de relever du TCE.
Les procédures visant des pays souhaitant adopter des mesures environnementales ambitieuses et abandonner l’exploitation des énergies fossiles se sont rapidement multipliées. Des entreprises allemandes du secteur du charbon ont ainsi poursuivi les Pays-Bas, qui tentaient d’abandonner le charbon. La Slovénie a été poursuivie pour son interdiction de la fracturation hydraulique, une technique d’extraction du gaz de schiste désastreuse pour l’environnement et l’eau. Le Danemark fut quant à lui ciblé pour sa taxe sur les superprofits tirés du pétrole.
Et ce n’est pas tout : les entreprises n’engagent pas uniquement des poursuites pour récupérer l’argent déjà investi dans les projets. La plupart du temps, elles ont d’ailleurs déjà reçu des compensations pour les frais engagés. En réalité, les réclamations sont bien plus importantes et concernent des profits qu’elles auraient réalisés à l’avenir, et qui sont soi-disant perdus.
L’entreprise britannique Rockhopper a ainsi attaqué l’Italie lorsque des manifestations ont forcé le gouvernement à interdire l’exploitation pétrolière au niveau de la côte Adriatique, une zone que l’entreprise espérait exploiter. La compensation réclamée par Rockhopper s’est élevée à 350 millions de dollars, sept fois plus que l’investissement engagé pour la seule exploration, le gisement n’ayant jamais été mis en exploitation ! La société a par la suite annoncé qu’elle investissait dans un nouveau projet au large des îles Malouines, détenues par le Royaume-Uni. Ainsi, le traité sur la charte de l’énergie ne se contente pas de faire supporter le coût de l’action climatique du secteur privé au secteur public, il contribue activement à faire perdurer l’économie fossile.
Nombre de ces affaires s’apparentent à des tentatives de punition des gouvernements qui prennent des décisions en réaction à des manifestations et à des campagnes orchestrées contre des projets d’extraction impopulaires. Partout dans le monde, des affaires portées devant le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États visaient spécifiquement à reprocher aux gouvernements de ne pas avoir déployé suffisamment d’efforts pour réprimer les mouvements de protestation menaçant les intérêts de capitalistes étrangers.
Les militants du monde entier ont alors réalisé l’obstacle à la souveraineté populaire posé par le traité sur la charte de l’énergie. Des personnalités politiques de toutes obédiences ont appris avec étonnement l’existence du traité sur la charte de l’énergie et se sont horrifiées de la manière dont celui-ci empiète si fondamentalement sur la souveraineté. Des campagnes d’information et l’interpellation des élus sont parvenus à convaincre des gouvernements très divers, allant de la coalition de gauche en Espagne au parti très droitier Droit et Justice en Pologne, de sortir de ce pacte sur l’énergie.
Le traité sur la charte de l’énergie ne se contente pas de faire supporter le coût de l’action climatique du secteur privé au secteur public, il contribue activement à faire perdurer l’économie fossile.
En 2023, neuf pays, dont l’Italie, la France, l’Allemagne et les Pays-Bas, ont tous annoncé leur retrait du TCE. Pour eux, celui-ci constitue désormais un danger évident et imminent face à la nécessité impérative de réorienter leur économie en réalisant la transition énergétique, puisqu’il y ajoute des obstacles juridiques et contribue à siphonner l’argent nécessaire à un processus déjà ardu.
Un problème demeure néanmoins. Le traité sur la charte de l’énergie comporte une « clause de survie » indiquant que des recours judiciaires peuvent être lancés jusqu’à vingt ans après le départ d’un Etat. Une frénétique activité diplomatique a commencé dans l’Union européenne (UE) pour tenter d’abroger cette clause. Finalement, les gouvernements des États-membres se sont dit qu’ils avaient intérêt à quitter le traité ensemble, de façon coordonnée, afin de signer ensuite un accord empêchant les différents qui pourraient les opposer, ce qui permet à minima de limiter les risques.
La particularité du cas britannique
Une fois sorti de l’UE, le Royaume-Uni s’est mis à voir les choses sous un jour nouveau. Sa classe politique y reste convaincue des vertus du marché et souhaite faire du Brexit une opportunité pour signer de nouveaux traités de libre-échange avec le reste du monde, bien que peu aient vraiment abouti. Le gouvernement conservateur a même probablement voulu profiter de la sortie de l’UE du traité pour devenir le dernier bastion de protection des investisseurs en Europe et ainsi attirer davantage d’investissements. En annonçant son intention de « maximiser » l’exploitation des réserves d’énergie fossile de la mer du Nord en accordant de nouveaux permis, le Premier ministre britannique Rishi Sunak tente clairement de provoquer une guerre culturelle contre la gauche qui réclame la fin progressive des champs pétro-gaziers.
Quelle que soit sa détermination, la réalité finira par le rattraper. Depuis que Joe Biden est devenu le président des États-Unis, il est de plus en plus évident que le changement climatique appelle un plus grand interventionnisme de l’Etat dans l’économie. Une course est lancée entre les grandes puissances, abondée par l’argent public, en vue de construire les industries « vertes » de demain.
Sur ces questions, le Royaume-Uni est loin derrière. Alors qu’une partie du monde des affaires, majoritairement les entreprises d’énergies fossiles et une partie du secteur financier, soutient le traité sur la charte de l’énergie, une autre partie est en train de réaliser que le laissez-faire du gouvernement britannique risque de saper durablement leur compétitivité. Tandis que l’Union européenne commençait à sortir du traité sur la charte de l’énergie, les syndicats de l’industrie, une partie du monde des affaires et même quelques parlementaires conservateurs ont commencé à s’inquiéter à l’idée que le Royaume-Uni puisse se trouver confronté à des obstacles plus importants que ses voisins européens pour effectuer sa transition écologique. Des tensions ont commencé à se faire sentir au sein du gouvernement et son approche est graduellement passée d’un soutien inconditionnel (en 2023) à la reconnaissance que les coûts encourus à demeurer signataire du traité étaient tout simplement trop élevés (en février dernier).
Alors qu’une partie du monde des affaires, majoritairement les entreprises d’énergies fossiles et une partie du secteur financier, soutient le traité sur la charte de l’énergie, une autre partie est en train de réaliser que le laissez-faire du gouvernement britannique risque de saper durablement leur compétitivité.
Si le revirement du gouvernement doit beaucoup aux pressions du monde des affaires, cela ne remet aucunement en cause le rôle central joué par les pressions militantes. Ainsi, c’est uniquement grâce aux actions menées durant des dizaines d’années par le mouvement climat que l’action climatique est à présent considérée comme une nécessité. Si l’indispensable transformation économique est encore loin, le peuple a, sur ce sujet, vaincu les partisans de la mainmise du marché. Sans l’action de nombreux militants durant quatre ans, allant des franges les plus modérées au mouvement Extinction Rebellion (XR), l’UE et le Royaume-Uni seraient toujours signataires du TCE.
Une victoire qui pourrait en entraîner d’autres
Bien sûr, ces annonces récentes ne sont qu’une première étape, à savoir la suppression d’un obstacle structurel à la transition énergétique. Elle est cependant importante. Le retrait du Royaume-Uni pourrait bien sonner le glas du traité sur la charte de l’énergie dans son ensemble ; celui-ci est à présent considéré comme un mort-vivant et ne sera regretté que par ceux qui profitent de la destruction de la planète. Par contrecoup, cette annonce signifie aussi la suppression d’un élément certes mineur, mais prééminent, de notre économie néocoloniale abandonnée à la main invisible du marché.
Ceux qui ont le plus souffert du système de mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États vivent dans le Sud global. Dans de nombreux accords commerciaux, ce mécanisme est utilisé pour intimider et exploiter les pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. Le Honduras et la Colombie sont par exemple actuellement confrontés à des demandes d’indemnisations extravagantes, alors qu’ils se contentent d’essayer de protéger les intérêts de leurs citoyens face à un capital vorace.
Récemment, les multinationales ont commencé à recourir aux tribunaux d’arbitrage privés pour sécuriser l’accès à des minerais d’importance critique pour la transition écologique, afin de les extraire selon leurs propres conditions. Quelle que soit l’importance de ces métaux pour la transition écologique, il ne peut être accepté que ceux qui ont le moins participé au changement climatique soient maintenant victimes d’une nouvelle phase d’exploitation au nom de « l’économie verte ». Au contraire, ces États doivent pouvoir décider de quelle manière leurs ressources sont utilisées pour soutenir leur développement.
Du Pakistan à l’Afrique du Sud en passant par la Bolivie, de nombreux pays ont engagé des procédures de sortie de ces traités qui les assujettissent à la loi des multinationales occidentales. Récemment, le gouvernement de gauche du Honduras a ainsi annoncé son futur retrait du système de tribunaux d’arbitrage de la Banque mondiale, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. La victoire remportée contre le traité sur la charte de l’énergie aidera à mettre en lumière l’hypocrisie d’un Occident qui redécouvre peu à peu – bien que de manière très insuffisante – les vertus de la planification économique, tout en exigeant du reste du monde qu’il suive les règles du marché. Si l’ampleur de la tâche pour limiter le changement climatique est immense, ces combats auront au moins été une étape importante, permettant de lier les enjeux environnementaux à ceux de la souveraineté et de la planification économique.
Note :
[1] Article originellement publié par notre partenaire Jacobin sous le titre « The Global Laws That Help Corporations Block Climate Action »
02.05.2024 à 14:39
Non, un peuple souverain disposant du RIC n’est pas « dangereux »
Raul Magni-Berton
Texte intégral (2792 mots)
La France est-elle vraiment une démocratie ? La concentration des pouvoirs entre les mains du Président de la République, l’accumulation de lois passées par 49.3 et la représentativité limitée des parlementaires invitent en tout cas à poser la question. Face à ce constat, les gilets jaunes avaient porté une demande simple et pourtant révolutionnaire : l’instauration du référendum d’initiative citoyenne (RIC). A chaque fois que cette option est évoquée, elle suscite néanmoins des inquiétudes auprès d’une part de la population, qui craint une « tyrannie de la majorité » ou des décisions prises sous le coup de l’émotion et des fake news. Il suffit pourtant d’étudier les pays disposant du RIC pour réaliser que ces peurs sont infondées. Article de Raul Magni-Berton, politologue à l’Université catholique de Lille, originellement publié sur The Conversation France.
Depuis vingt ans, l’émergence de partis « populistes » questionne la place du peuple dans nos démocraties libérales. De l’extrême gauche à l’extrême droite, il est commun d’affirmer que « le peuple français n’est pas entendu » sur l’immigration, ou que le peuple français ne veut pas de la guerre, ou encore que les élites ont trahi le peuple. Selon certains observateurs, donner plus de souveraineté au peuple serait dangereux pour trois raisons. Sont-elles valables ?
Premièrement, l’argument de l’oppression des minorités par la tyrannie de la majorité remonte à Benjamin Constant. Celui-ci met en avant qu’une démocratie libérale doit protéger ses minorités, et que cela n’est pas possible si tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains du peuple, ou plutôt de sa majorité. Beaucoup d’opposants au suffrage universel avançaient cet argument, à l’instar de Sir Henry Sumner Maine pour qui réforme religieuse et tolérance pour les dissidents n’auraient pas vu le jour sous le suffrage universel. Si le suffrage universel n’est plus l’objet de critiques, cet argument est encore utilisé dans les débats sur l’extension des droits des citoyens.
Deuxièmement, la pleine souveraineté populaire conduirait à l’affaiblissement des contre-pouvoirs – notamment les juges et les autorités indépendantes. Ceux-ci devraient se plier à une législation volatile qui changerait au gré des caprices des émotions populaires. Cet argument, qui remonte à Montesquieu, est aussi régulièrement avancé aujourd’hui.
Enfin, les choix arbitraires d’une masse peu informée produiraient le plus souvent erreurs ou décisions contradictoires. Au XIXe siècle, c’était un argument courant. Gustave Flaubert, par exemple, affirmait que « Le peuple est un éternel mineur ». Cette crainte se retrouve aujourd’hui sous une forme plus raffinée : les masses seraient sujettes aux biais cognitifs et au manque d’information.
Ces trois dangers seraient incarnés par les partis populistes, dont l’exemple paradigmatique est le national-socialisme. Les nazis ont été élus par le peuple en Allemagne et Hitler a concentré le pouvoir dans ses mains en utilisant deux référendums. Ainsi, flatter le peuple créerait des monstres.
Le nazisme, un exemple trompeur ?
Premièrement, les nazis n’ont jamais bénéficié de la majorité des voix en Allemagne, mais du soutien de la majorité des députés qui leur ont donné les pleins pouvoirs. C’est donc plutôt le fonctionnement représentatif qui est ici en cause.
Deuxièmement, les référendums en 1933 et 1934 se sont tenus après la concentration du pouvoir entre les mains de Hitler. Les résultats – proches de 100 % de oui – furent largement influencés par des pratiques d’intimidation physique ou d’autres manipulations électorales.
Troisièmement, Hitler ne s’est jamais distingué par une rhétorique faisant du peuple le souverain. Dans Mein Kampf, il affirme que ses buts « ne sont compris que d’une très petite élite » et que « les grandes masses sont aveugles et stupides ». Selon lui, leur seule motivation stable est « l’émotion et la haine ».
La Suisse des années 1930, grande oubliée
Si en Allemagne la recherche du peuple souverain n’était pas prioritaire, dans la Suisse voisine elle était au cœur du système politique. Les citoyens suisses avaient le droit de modifier directement leur Constitution depuis presque un demi-siècle, par l’initiative populaire et le référendum obligatoire.
Ce pays est le seul territoire de langue germanique où, lors de la montée d’Hitler, les partis d’inspiration nazie étaient pratiquement inexistants. Avec sa démocratie directe, la Suisse a aboli la peine de mort au moment où fonctionnaient les chambres à gaz dans les pays voisins. Elle a reconnu comme langue nationale la langue romanche pourtant parlée par moins de 2 % de la population. La minorité romanche n’a pas été la seule à être privilégiée, puisque beaucoup de minorités recevaient alors asile dans ce pays, qui, contrairement à l’Allemagne, ne jurait que par le peuple souverain.
De fait, historiquement, la recherche de la souveraineté populaire a souvent été le moteur de l’établissement et de la perpétuation des régimes basés sur les contre-pouvoirs, les droits fondamentaux et la protection des minorités. Ainsi, à l’époque où les monarchies étaient largement majoritaires, les régimes représentatifs sont nés au nom de la souveraineté du peuple. Cela a été le cas aux États-Unis et en France, deux pays qui ont porté les premières Constitutions libérales à la fin du XVIIIe siècle. C’est aussi au nom du peuple souverain que le suffrage a été progressivement élargi en France.
Qu’est-ce que la souveraineté populaire ?
Que signifie donc exactement que le peuple est souverain ? Dans son acception la plus littérale, la souveraineté fait référence à une autorité suprême, qui peut modifier toutes les décisions, mais dont les décisions ne peuvent être modifiées par aucune autre autorité.
Dans les systèmes contemporains, cela correspond à la capacité à contrôler la constitution, qui est au sommet de la hiérarchie des normes. En ce sens, la souveraineté est populaire si le peuple peut directement réviser la Constitution. Cette configuration correspond à ce qu’on appelle la démocratie directe.
Le pouvoir populaire de réviser la Constitution se compose en deux aspects. Le premier consiste à pouvoir initier une révision. Si les systèmes représentatifs restreignent l’initiative aux représentants, les démocraties directes confèrent ce pouvoir à l’ensemble de leurs citoyens. Le deuxième pouvoir consiste à avoir un droit de veto sur la législation. Quand la démocratie est directe, le droit de veto est conféré au peuple directement (par référendum), et non à ses représentants. Aujourd’hui, les régimes qui reposent sur la souveraineté populaire sont la Suisse, l’Uruguay, une partie des États-Unis et quelques micro-États comme les îles Palaos ou le Liechtenstein.
Il est important de ne pas confondre des institutions de démocratie directe avec des pratiques plébiscitaires. Dans beaucoup de pays, les référendums existent, mais ne confèrent aux électeurs ni un droit d’initiative ni un droit de veto. Ils se limitent à la possibilité pour le pouvoir exécutif de consulter son peuple (comme c’est le cas en France). De ce fait, il s’agit souvent de simples questions, et non de lois rédigées. La formulation des questions est parfois manipulatoire. Par exemple, fin 2023, les Vénézuéliens devaient se prononcer sur la question ainsi formulée par leur président :
« Êtes-vous d’accord d’opposer, par toutes les voies juridiques, les revendications du Guyana à disposer unilatéralement, en toute illégalité et en violation de la loi internationale, de la zone maritime encore en arbitrage ? »
La démocratie directe est-elle dangereuse ?
Depuis plus de 100 ans que la Suisse, l’Oregon, le Colorado ou le Dakota du Nord fonctionnent ainsi, on peut constater que dans ces démocraties directes le respect des minorités, les droits fondamentaux, et l’indépendance des juges sont bien plus développés que dans la plupart des régimes représentatifs, dont la France. Leur économie connaît également d’excellents résultats, affichant un PIB par habitant parmi les plus élevés du monde (ce n’était pas le cas avant la mise en place de leur démocratie directe). De même, l’Uruguay caracole en tête de son continent dans les indicateurs de prospérité et de bonne gouvernance démocratique – dont l’indépendance des juges).
La stabilité et la durée de ces régimes sont aussi considérables. Aucun tournant illibéral n’est à enregistrer, sauf le coup d’État de 1973 en Uruguay que les Uruguayens n’ont pas causé. Au contraire, lorsqu’en 1980, la junte militaire a voulu réviser la Constitution et a soumi la proposition à référendum – comme la Constitution l’obligeait – les Uruguayens l’ont rejetée.
Pourquoi les peuples ne sont pas incompétents et dictatoriaux
Il y a au moins trois raisons pour expliquer que, quel que soit le niveau d’« incompétence » des électeurs, les démocraties directes fonctionnent très bien. Tout d’abord, contrairement à des majorités parlementaires, la majorité d’un peuple n’a pas la possibilité de contrôler l’action de l’exécutif ou des juges. En effet, la majorité d’un peuple n’est pas coordonnée ni structurée et, pour lancer une réforme par pétition et référendum, il lui faut environ trois ans. La séparation des pouvoirs apparaît donc plus solide sous une démocratie directe.
Deuxièmement, bien que les électeurs soient moins bien informés, la complexité des décisions qu’ils ont à prendre est moindre par rapport à leurs représentants. Le votant, lui, peut simplement voter pour défendre son intérêt personnel. L’idée est que, si tout le monde vote pour son propre intérêt, on parvient à un résultat qui, par définition, prend en compte l’intérêt de chacun. En revanche, on n’attend pas d’un représentant qu’il suive son intérêt. Il doit non seulement être altruiste mais aussi formidablement bien informé : il doit connaître l’intérêt de tous les représentés, ainsi que les conséquences de ses choix sur chacun d’entre eux. En fait, la démocratie directe demande beaucoup moins aux votants, et c’est leur nombre qui se charge de réduire l’impact de l’incompétence de chaque individu. Voilà pourquoi les décisions prises par référendum sont souvent raisonnables.
Troisièmement, les majorités populaires, contrairement aux majorités parlementaires, sont instables. Chaque individu se retrouve souvent membre d’une minorité dans certains référendums. Dès lors, un équilibre s’installe où les revendications minoritaires tendent à être acceptées si elles ne nuisent pas trop à la majorité.
Les craintes des systèmes qui donnent une place centrale à la législation directe par les citoyens diffèrent finalement peu de celles envers le suffrage universel. Elles se nourrissent d’une faible connaissance des équilibres qui se créent dans les États qui la pratiquent. Au XVIIIe siècle, la France a été le premier pays au monde à se doter d’une constitution moderne promouvant une pleine souveraineté populaire. Cette Constitution, suspendue pendant la terreur, fut ensuite remplacée par les constitutions napoléoniennes. Les Français redemandent depuis régulièrement le retour d’une forme de démocratie directe (révolution de 1848, « gilets jaunes »…) Peut-être ne faudrait-il pas avoir si peur de droits au fondement de l’histoire de notre pays et paisiblement appliqués chez certains de nos voisins ?
30.04.2024 à 17:33
Nicolas Dufrêne : « L’obsession de la dette va nous plonger dans une nouvelle décennie perdue »
William Bouchardon
Texte intégral (8088 mots)
Alors que l’Union européenne vient de réaffirmer son obsession austéritaire et que Bruno Le Maire multiplie les coupes budgétaires, la dette est redevenue un enjeu politique majeur. Pourtant, les services publics sont à l’agonie et la bifurcation écologique requiert d’immenses investissements. Comment sortir de cette quadrature du cercle ? Pour le haut-fonctionnaire Nicolas Dufrêne, directeur de l’Institut Rousseau et auteur de La dette au XXIème siècle. Comment s’en libérer, il est nécessaire de réinventer des mécanismes monétaires innovants permettant de créer de la monnaie sans dette pour financer des investissements d’intérêt général. Une forme « d’argent magique » qui a existé dans le passé et ne génère pas nécessairement de l’inflation, à condition que son usage soit bien ciblé. Entretien.
Le Vent Se Lève : En février, à peine deux mois après l’adoption du budget, le gouvernement a annoncé dix milliards d’euros de coupes budgétaires et un effort sans précédent pour revenir sous les 3% de déficit en 2027. Hormis la période du Covid, on a l’impression d’entendre ces mots d’ordre depuis 50 ans. Pourtant, la France n’est pas ruinée. Dès lors, faut-il vraiment voir la dette comme un problème majeur, une charge pour nos enfants dont il faut se débarrasser à tout prix ?
Nicolas Dufrêne : C’est en tout cas comme ça que la dette nous est présentée. En allemand par exemple, le mot « Schuld » signifie à la fois « dette » et « culpabilité ». On pense toujours qu’être endetté signifie être dans une situation de faiblesse et de dépendance, que c’est une forme de péché. Or, j’essaie d’expliquer dans mon livre que la monnaie et la dette sont les deux faces d’une même pièce : sans dette, pas de monnaie ! Une fois que l’on comprend ça, on peut changer de perspective, j’y reviendrai.
Dans tous les cas, il était évident que le « quoi qu’il en coûte » était une parenthèse forcée par les événements et que les libéraux austéritaires allaient tout faire pour la refermer au plus vite. Nous y sommes : s’engager à ramener son déficit en dessous des 3 % du PIB en 2027, ça veut dire 20 à 25 milliards d’euros de dépenses publiques en moins chaque année ! Ces 10 milliards de coupes budgétaires par décret sans repasser par le Parlement sont certes légaux au sens de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) mais peu respectueux du Parlement d’un point de vue démocratique.
LVSL : D’autant que le budget n’a même pas été voté, mais a été passé en force via l’article 49.3 de la Constitution…
N.D. : Exactement. Cette méthode s’inscrit dans une défiance forte à l’égard du Parlement, soupçonné de multiplier les dépenses. Plus largement, ce retour de l’austérité fait suite au rétablissement des règles budgétaires européennes dans une version qui, à mon sens, est plus dure que la précédente puisqu’elle vise à rendre les sanctions plus applicables et qu’elle ne fait aucune place dérogatoire aux investissements écologiques et sociaux.
Mais le plus grave est que cette parenthèse du « quoi qu’il en coûte » n’a pas conduit aux grands plans d’investissement dont nous avons besoin, mais seulement à subventionner des pertes et à maintenir un niveau d’activité standard pour que l’économie ne s’effondre pas. Or, nous voyons actuellement que tous les grands pays du monde mettent en place des plans de relance gigantesques ! Faut-il rappeler que la croissance du PIB de l’UE a décroché de 80 % par rapport aux États-Unis depuis 2007 en raison de l’austérité ?
Cette obsession de la dette va nous plonger dans une nouvelle décennie perdue où cohabiteront inaction climatique, reculs sociaux et atonie du développement économique. Cette politique est suicidaire et contre-productive car elle revient à réduire la masse monétaire et donc à rendre le poids des dettes encore plus lourd en proportion du revenu et de l’activité économique. Il suffit de regarder le bilan de l’austérité en Grèce pour voir que la réponse austéritaire échoue toujours.
Au passage, rappelons à quel point les discours catastrophistes sur la dette sont ridicules. En 2007, François Fillon (alors Premier ministre, ndlr) nous expliquait qu’il était à la tête d’un « État en quasi faillite » alors que la dette publique représentait 63 % du PIB. Or, nous avons atteint le double durant la pandémie tout en empruntant à taux zéro ! Il n’y a donc pas de lien entre un fort niveau d’endettement et une sanction par les marchés. Le taux d’intérêt est avant tout piloté par la banque centrale, quel que soit le niveau d’endettement, on ne le rappellera jamais assez.
« Les discours catastrophistes sur la dette n’ont qu’un but : faire culpabiliser les peuples et justifier tous les sacrifices en matière de services publics et d’aides sociales. »
Ces discours catastrophistes sur la dette n’ont qu’un but : faire culpabiliser les peuples et justifier tous les sacrifices en matière de services publics et d’aides sociales. C’est ce que dit Emmanuel Macron quand il se rend dans un hôpital et déclare qu’”il n’y a pas d’argent magique” à des soignants. Pour la santé, l’éducation, la transition écologique, on nous dit toujours qu’il n’y a pas d’argent. Par contre, pour les marchés financiers, on en trouve toujours.
LVSL : Oui, l’austérité est vouée à l’échec car elle détruit l’activité économique, ce qui empêche alors de rembourser la dette. Cependant, il faut quand même rappeler que la dette pose des défis. Puisque la dette est « roulée », c’est-à-dire que l’on réemprunte pour rembourser les dettes précédentes, nous sommes à la merci des taux d’intérêts. Ceux-ci étaient faibles voire nuls au milieu des années 2010, mais sont remontés depuis.
Or, vous le rappelez dans votre livre, il y a à peu près 2.000 milliards de dettes française à faire rouler d’ici 2027. Si le taux d’intérêt augmente de 2 % cela signifie 100 milliards de charges supplémentaires de la dette d’ici à 2030. C’est autant d’argent qui ira dans la poche des créanciers plutôt que dans des investissements nécessaires. Finalement, étant donné cette remontée des taux d’intérêt, ne faut-il pas considérer la dette comme un problème sérieux à traiter urgemment ?
N.D. : Oui, la dette est un problème sérieux qu’il faut traiter sérieusement. Mais l’austérité n’est justement pas une solution sérieuse puisqu’elle réduit la masse monétaire et empêche donc de rembourser les dettes préexistantes et de les diluer dans une activité économique plus importante. La politique monétaire de nos jours, c’est un peu la médecine du Moyen âge : on pratique la saignée sur un corps déjà affaibli ! On voit les résultats : l’Allemagne est en récession, la France et beaucoup de pays européens n’en sont pas loin. On est en train de tuer le malade pour éradiquer la maladie !
Cela étant rappelé, il est clair que nous allons vers une explosion de la charge de la dette. Elle a commencé : on était à 30 milliards d’euros il y a deux ans, nous sommes à 50 milliards aujourd’hui et Bercy prévoit déjà 70 à 75 milliards d’euros par an dans les prochaines années. Si les taux ne redescendent pas, nous pourrions nous retrouver dans une situation où on consacrerait près du quart du budget de l’État – hors Sécurité sociale – au remboursement de la dette. Ces niveaux ont déjà été atteints par le passé, par exemple à la fin du XIXe siècle ou dans les années 1920, mais ils posent évidemment problème car c’est autant de ressources en moins pour les services publics et les grands investissements, sans compter qu’ils alimentent une prospérité injustifiée du système bancaire.
Pour sortir de ce cercle vicieux, regardons d’où vient la hausse des taux d’intérêts : ce sont les banques centrales qui les ont augmentés en réaction à l’inflation. Cette décision découle d’une analyse monétariste selon laquelle l’inflation tire sa source de l’excès de monnaie. Or, l’inflation récente vient de trois phénomènes bien réels, mais qui sont des problèmes d’offre de biens et services et non de monnaie. D’abord, il y a la désorganisation de chaînes de production suite à la pandémie, notamment dans les semi-conducteurs, avec une demande qui a repris plus vite que l’offre, ce qui a créé de la rareté. Ensuite, il y a l’impact de la guerre en Ukraine, qui a fait monter les prix des hydrocarbures et des matières premières agricoles.
Enfin, il y a une bonne part de spéculation, qui a pu être accentuée par le quantitative easing (création monétaire via le rachat massif de dettes et de titres financiers, ndlr) des banques centrales : en créant un excès de liquidité dans la sphère financière, elles ont fourni aux marchés de quoi spéculer. Or, cela alimente un cercle vicieux, puisque tous les acteurs financiers mènent alors des stratégies défensives pour se couvrir contre la hausse des matières premières en en achetant davantage, ce qui peut a priori sembler contre-intuitif.
LVSL : Arrêtons nous sur le quantitative easing un instant. On entend beaucoup dans la presse ou sur internet des analyses monétaristes selon lesquelles c’est justement cette création monétaire massive depuis 10 ou 15 ans qui a causé la forte inflation récente. Puisque les taux d’intérêts étaient faibles et que les banques centrales rachetaient énormément d’actifs financiers pour éponger les dettes héritées de la crise de 2008, cela aurait conduit à une explosion des prix. Vous ne partagez pas cette analyse et parlez plutôt de « trou noir monétaire ». Pourriez-vous revenir là-dessus ?
N.D. : D’abord rappelons que cette idée d’un lien entre la croissance de la masse monétaire et l’inflation repose sur une très vieille histoire. A la Renaissance, lorsque les galions espagnols reviennent chargés d’or et d’argent du Nouveau Monde, les nobles espagnols n’utilisent pas cet afflux de métaux précieux pour développer leur économie mais pour acheter des produits de luxe aux marchands vénitiens et arabes. Jean Bodin, avec d’autres économistes que l’on nomme les mercantilistes, écrit que la hausse de la quantité de monnaie ne fait qu’augmenter les prix mais ne change pas les conditions de production et de travail, ce qui était vrai à l’époque mais n’a rien d’une fatalité. Cette théorie est pourtant devenue la base des préceptes monétaristes de Milton Friedman.
John Maynard Keynes démentira ce lien en expliquant qu’une augmentation de la masse monétaire est nécessaire pour augmenter la production, à condition de flécher cette création monétaire vers des investissements productifs. Sans révolution du crédit et sans augmentation forte de la masse monétaire, il n’y aurait pas eu de révolution industrielle. Il ne faut pas séparer la sphère monétaire et la sphère réelle : chacune a un effet d’entraînement sur l’autre. La réalité donne raison à Keynes. Par exemple, je montre dans mon livre que la masse monétaire M2 (somme des pièces et billets en circulation, des comptes courants, des dépôts sur livrets et des crédits à court terme, ndlr) a progressé de 143 % aux États-Unis entre 2007 et 2020, alors que les prix ne se sont accrus que de 19 % sur la même période. Pareil pour l’Europe avec des chiffres moins impressionnants, respectivement 60 % et 17 %. Si on suit la théorie monétariste, l’inflation aurait dû être bien plus forte.
Cela nous montre que ce qui compte, c’est l’usage de cette monnaie : si vous créez de la monnaie pour développer des activités productives, les prix n’augmentent pas vraiment, car les volumes produits suivent plus ou moins la hausse de la demande. Si en revanche vous créez de la monnaie pour acheter massivement des produits dont le taux de production est déjà à son maximum et que vous ne cherchez pas à élargir la production, alors vous aurez de l’inflation.
Avec le quantitative easing, un autre problème est apparu, que je qualifie de « trou noir monétaire » : la masse monétaire a explosé avec le quantitative easing, mais l’inflation comme la production ont très peu augmenté en comparaison. L’explication, c’est que depuis le tournant de la financiarisation des années 1980, l’essentiel de la monnaie, créée majoritairement par le crédit mais aussi, et de plus en plus, par les banques lorsqu’elles achètent des actifs, est aspirée par deux domaines spéculatifs : les marchés financiers et l’immobilier. Or, on constate justement que l’inflation dans ces domaines a été beaucoup plus forte que dans l’économie réelle.
« Le quantitative easing n’a pas ruisselé jusqu’à l’économie réelle. »
Ajoutons à cela un problème qui tient à la structuration même de notre système monétaire : la banque centrale ne peut agir qu’avec les acteurs qui disposent d’un compte dans ses livres, à savoir les banques commerciales. Toute politique monétaire conduite par la banque centrale passe donc nécessairement par le filtre des banques privées, ce qui réduit considérablement la possibilité pour la monnaie créée par la banque centrale d’atteindre l’économie réelle. Mais tout cela n’est qu’une convention humaine : rien n’oblige à ce que ce soit le seul mode d’organisation du système monétaire.
En tout cas, cela permet de comprendre pourquoi la création de dette, et donc de monnaie, s’est déconnectée de la croissance. Il faut de plus en plus de dette pour obtenir le même niveau de croissance car la dette vient financer des actifs spéculatifs. Prenons le cas de la bourse : seuls 2 % des opérations de bourse viennent financer de nouveaux fonds propres pour les entreprises, tout le reste est investi sur des titres déjà existants, dont les prix explosent. C’est la même chose dans l’immobilier, avec des flambées des prix dans les grandes villes et des bulles immobilières, comme celle qui a amené à la crise de 2008. Le quantitative easing n’a pas ruisselé jusqu’à l’économie réelle. C’est pour sortir de ce cercle vicieux que je propose dans mon livre des mécanismes de création monétaire ciblés – et sans dette, nous y reviendrons – qui servent véritablement l’économie réelle.
LVSL : Lorsqu’on parle du financement de l’État, on entend très souvent les décideurs politiques évoquer la nécessité de rassurer les marchés financiers pour qu’ils nous prêtent à des taux plus faibles. Pourtant, les marchés financiers raffolent des dettes étatiques, qui se vendent extrêmement facilement. Comment comprendre ce paradoxe ?
N.D. : Les titres de dette publique constituent l’actif sans risque, la brique de base dont les marchés financiers ont besoin pour fonctionner. Cela leur permet de se refinancer auprès de la banque centrale, de disposer de collatéraux (actifs mis en garantie pour réaliser des emprunts, ndlr) pour les échanges sur le marché interbancaire ou de proposer des produits financiers plus ou moins risqués à leurs clients.
Dès lors, oui, les marchés vivent de la dette publique. Lorsque l’État français émet de la dette publique, l’offre de financement par les marchés financiers est toujours six à sept fois supérieure à la demande de l’État. En théorie, la France pourrait donc s’endetter six fois plus et sa dette trouverait preneur !
Le piège, c’est que les marchés ont besoin d’une dette qui les rémunère bien, ils vont donc toujours chercher à obtenir les taux d’intérêt les plus hauts, comme on le voit en ce moment, soutenus par la banque centrale qui les rémunère grassement sous couvert de lutter contre l’inflation. D’où le fait qu’ils ont négocié des choses scandaleuses comme les obligations indexées sur l’inflation.
Cela pose un vrai problème démocratique, car les parlements n’ont pas leur mot à dire : quand le gouvernement présente le projet de loi de finance au Parlement, il lui donne le montant que l’Agence France Trésor prévoit d’emprunter pour l’année en cours et c’est tout. Les parlementaires ne peuvent pas changer ce chiffre, discuter de la durée de remboursement du titre ou du taux, ils n’ont aucun pouvoir. Avoir confié des questions aussi importantes à des agences indépendantes comme l’Agence France Trésor est d’autant plus problématique que l’on connaît le grand nombre de revolving doors entre le ministère des finances, l’Agence France Trésor et les spécialistes en valeur du Trésor, c’est-à-dire les grandes banques qui achètent la dette publique.
LVSL : Cela n’a pourtant pas toujours été le cas. Par le passé, l’État contrôlait bien plus étroitement ses conditions d’endettement, via le « circuit du Trésor »…
N.D. : Oui, les États se sont mis dans cette situation de leur plein gré. Pendant longtemps, nous disposions de mécanismes de circuit du Trésor et d’avances de la banque centrale à l’État qui permettraient de contenir la dette et la charge qu’elle représente. En résumé, le circuit du Trésor permettait à l’État de déterminer à quels taux et dans quels volumes l’État voulait se finançait auprès des banques privées comme publiques. Cela permettait de répondre à un double défi dans la France de l’après-guerre : trouver les immenses financements nécessaires à la reconstruction et maîtriser les conditions d’emprunt des États.

Ces mécanismes monétaires innovants ont été mis en place en 1945, alors que la dette représente 180 % du PIB et que la France est à reconstruire. Ce très fort endettement n’a pas empêché de faire des plans de relance gigantesques : le plan Monnet représente environ 80% du PIB de l’époque, c’est comme si on faisait un plan de relance de 2000 milliards d’euros aujourd’hui ! Au final, grâce à tous ces investissements productifs, la dette n’a cessé de baisser durant les Trente Glorieuses, elle représente à peine 20 % du PIB en 1974 alors même que l’État n’avait jamais autant investi ! Aujourd’hui c’est exactement l’inverse : la dette progresse alors que le taux d’investissement public ne cesse de chuter. Ce paradoxe doit nous interroger sur l’efficacité des politiques économiques recommandées par les thuriféraires de l’austérité et du financement par les marchés. Mais personne ne les met face à leurs contradictions.
Depuis les années 70, nous avons malheureusement supprimé tous ces mécanismes les uns après les autres, nous investissons de moins en moins et nous sommes de plus en plus endettés. Cependant, un circuit du Trésor tel qu’il existait à l’époque n’aurait pas grand intérêt aujourd’hui : comme je l’ai dit précédemment, l’Etat n’a plus de difficultés à se financer et la maîtrise des taux d’intérêts relève avant tout de la banque centrale, malheureusement indépendante du pouvoir politique. Un « circuit du trésor 2.0 » devrait donc nécessairement passer par un contrôle de la banque centrale et par des outils permettant d’injecter de la monnaie de manière ciblée.
LVSL : Vous proposez justement dans votre livre de rebâtir des mécanismes monétaires innovants pour financer l’État, en vous inspirant du circuit du Trésor et de la théorie monétaire moderne. Pouvez-vous nous présenter votre théorie d’une « monnaie émancipatrice » ?
N.D. : Le point de départ c’est ce que la dette et la monnaie sont les deux faces d’une même pièce. Quand on s’interroge sur la dette, qu’elle soit d’ailleurs publique ou privée, on ne peut pas faire l’impasse sur la question de la création monétaire qui est fondamentale. Le fait qu’on en parle jamais est justement symptomatique de notre manque de culture sur le sujet.
La création de monnaie par le crédit bancaire apparaît progressivement à partir de la Renaissance. C’est un progrès historique majeur : on passe d’une monnaie exogène à l’activité économique, c’est-à-dire dont la quantité est fixée par le volume de métaux précieux, à une monnaie endogène, répondant aux besoins de l’économie. Désormais, on crée de la monnaie sur la promesse de financer une activité qui générera un revenu futur et permettra de rembourser le crédit. Ce fut une grande avancée historique. Mais cela pose aujourd’hui un nouveau défi : la dette progresse plus vite que la création de richesse. En effet, la monnaie met un certain temps à être investie et à produire des richesses. En outre, une partie est thésaurisée (épargnée, ndlr) et une autre est utilisée pour spéculer. Résultat : on finit par avoir des problèmes d’insolvabilité.
Comment résoudre ce problème ? On l’a dit, l’austérité ne marche pas puisqu’elle consiste à réduire la masse monétaire alors que les dettes sont libellées de manière nominale. Ainsi, l’austérité ne fait qu’alourdir le poids des dettes. A l’inverse, créer plus de dettes peut diluer la dette existante, mais seulement si cela se traduit par de la création de richesses.
Le seul moyen de briser ce cercle vicieux est d’injecter de la monnaie qui ne soit pas attachée à une dette. Ce que je propose est un nouveau mode de création monétaire qui n’a pas vocation à remplacer le mode de création monétaire par le crédit mais à le compléter. En introduisant une monnaie libre de dette dans l’économie, on fait progresser la masse monétaire et la création de richesse plus vite que la dette ; c’est une arme de désendettement massif pour tous les acteurs, publics comme privés, et un moyen efficace de sortir de l’atonie économique qui nous ronge.
« Cette monnaie libre de dette n’est pas sans contrepartie. Elle doit financer des investissements d’intérêt général décidés démocratiquement. Cette création monétaire est particulièrement adaptée pour financer des activités nécessaires pour la transition écologique mais qui ne sont pas rentables et dont le marché se désintéresse. »
Mais attention : cette monnaie libre de dette n’est pas sans contrepartie. Elle doit financer des investissements d’intérêt général décidés démocratiquement. Cette création monétaire est particulièrement adaptée pour financer des activités nécessaires pour la transition écologique mais qui ne sont pas rentables et dont le marché se désintéresse. Je pense par exemple à la protection des puits de carbone comme les zones humides et les forêts. Je pense aussi à la rénovation énergétique des logements des ménages modestes qui n’est rentable pour eux qu’à très long terme. Enfin, cela peut aussi permettre de réaliser des investissements lourds en termes d’infrastructure, par exemple recréer un réseau de fret ferroviaire. Autrement dit, et contrairement aux caricatures qui en sont parfois faites, il ne s’agit pas d’une monnaie déconnectée de tout travail ou création de valeur. C’est tout l’inverse : cette création monétaire permettrait justement de libérer les énergies, de financer ce qui doit l’être, sans risquer l’effet « boomerang » qui consiste, depuis plus de 50 ans désormais, à faire suivre chaque plan de relance d’un plan d’austérité dans une politique de « stop and go » désastreuse et inefficace.
En outre, cette proposition revient à repenser en profondeur l’acte même de création monétaire, qui a été confié à des institutions bancaires privées lucratives qui ne créent de la monnaie que quand elles ont un intérêt à le faire. Il s’agit ainsi d’ajouter la possibilité de créer de la monnaie selon une logique d’intérêt général, pour compenser les failles du marché, ce qui créerait une brèche majeure dans le capitalisme financier tel qu’il s’est imposé aujourd’hui, notamment du fait de l’accaparement du pouvoir monétaire par la finance privée. Il s’agit ainsi de considérer la monnaie comme un bien commun. Bien sûr, cela implique de remettre la banque centrale sous contrôle démocratique, à minima via une supervision du Parlement, voire en récréant un « Parlement du crédit et de la monnaie » comme l’avait proposé le Conseil National de la Résistance dans son programme.
LVSL : Votre proposition est très prometteuse. Mais en créant de vastes quantités de monnaie, ne risque-t-on pas de générer une forte inflation et de déstabiliser l’économie ?
N.D. : Cette question est absolument fondamentale. Bien sûr, si cet argent est gaspillé et ne sert pas à augmenter la production, le risque d’un emballement de l’inflation est réel. Mais si cette forme de création monétaire est bien ciblée, elle peut au contraire contribuer à la baisse d’un certain nombre de prix. C’est particulièrement le cas étant donné la crise écologique, puisque notre inaction commence à générer des phénomènes inflationnistes.
Par exemple, aujourd’hui une grande part de l’inflation vient de l’importation d’hydrocarbures. Avec la monnaie libre de dette, nous pourrions investir massivement dans les énergies renouvelables, l’électrification des transports ou le stockage de l’électricité et donc limiter cette inflation importée. De même, les nouvelles réglementations environnementales pour les usines représentent de gros investissements pour les entreprises, qui rechignent à les faire et répercutent ces coûts sur leurs clients. L’État pourrait prendre en charge cette nécessaire reconversion de l’appareil productif.
« Presque tout le monde pourrait être gagnant, sauf les banques. »
Autre exemple : l’agriculture bio. Alors qu’elle protège les sols et l’eau, elle est très mal en point car ses produits sont trop chers. Or, le pouvoir d’achat est actuellement en baisse puisque les salaires ne suivent pas l’inflation, et la première victime en est l’agriculture biologique. Au lieu de nous tourner vers une agriculture productiviste dont les rendements vont diminuer à cause de la crise environnementale, nous pourrions ainsi garantir des tarifs de rachat pour les produits bio. Cela permettrait de subventionner les agriculteurs pour qu’ils se tournent vers le bio et de garantir des prix acceptables aux consommateurs.
De fait, presque tout le monde pourrait être gagnant, sauf les banques. Elles perdraient probablement des parts de marché vu qu’il existerait une autre forme de création monétaire, c’est pourquoi elles s’y opposent avec vigueur, en s’appuyant sur des économistes dévoués. Mais il n’est écrit nulle part que les banques privées doivent être ad vitam aeternam les seules dépositaires du pouvoir de création monétaire. La monnaie est une chose trop sérieuse pour la laisser uniquement à des institutions privées lucratives qui n’ont que faire, par nature, de l’intérêt général.
LVSL : Outre l’inflation, votre proposition interroge aussi quant à ses conséquences sur notre balance commerciale et la balance des paiements. Si nous injectons massivement des liquidités et que nous importons davantage, notre monnaie va se déprécier. Comment éviter ce scénario ?
N.D. : C’est justement pour cela que j’insiste sur le caractère ciblé de cette création monétaire supplémentaire : elle doit viser le développement de l’économie locale et nationale et la réduction de la dépendance aux importations. En réduisant nos dépendances extérieures, nous stabiliserons la valeur de notre monnaie.
Si on se libère du pétrole et du gaz, notre balance commerciale sera bien meilleure : la moitié des 100 milliards de déficit commercial en 2023 sont liés aux importations énergétiques ! De même, nous sommes un grand pays agricole, mais nous importons 50% de nos fruits et légumes, c’est délirant ! Si nous investissons pour une agroécologie visant l’indépendance alimentaire nationale, nous pourrions nous libérer d’une dépendance étrangère majeure. Non seulement notre monnaie ne serait pas affaiblie mais elle pourrait même être renforcée, en même temps que notre structure économique.
LVSL : Cela peut fonctionner pour un pays comme la France, mais qu’en est-il des pays en développement ? La confiance dans leur monnaie n’est-elle pas trop fragile pour envisager l’usage de ces mécanismes ?
N.D. : Pas nécessairement. Bien sûr, étant donné leur retard industriel, il y a un risque que ces injections monétaires se traduisent par un afflux de produits importés et un effondrement de la valeur de leur monnaie. Mais il est également possible que cela les aide à substituer certaines importations.
Par ailleurs, lorsque les pays en développement sont en difficulté pour équilibrer la valeur de leur monnaie et leur balance des paiements, le FMI (Fonds Monétaire International, ndlr) peut leur accorder des droits de tirages spéciaux (DTS). Cela a notamment été fait durant la pandémie. Ces DTS sont particulièrement intéressants, car il s’agit d’une création monétaire libre de dette, exactement comme je le propose. Mais ils demeurent sous-employés à l’heure actuelle.
LVSL : L’exemple des droits de tirages spéciaux du FMI est intéressant car il montre que votre proposition n’est pas utopique. Avez-vous d’autres exemples historiques de création monétaire libre de dette ?
N.D. : Oui. Je peux vous citer un exemple récent qui montre que « l’argent magique » existe bien pour certains : en 2023, quand la Banque Centrale Européenne a remonté ses taux d’intérêts, elle a dû rémunérer davantage les réserves déposées chez elle par les banques commerciales. Pour cela, elle a puisé dans ses réserves mais elle a aussi créé près de 143 milliards d’euros ex nihilo, c’est-à-dire à partir de rien. C’est une subvention gratuite aux grandes banques ! Si la BCE en est capable pour rémunérer les banques privées, elle peut aussi le faire pour financer la reconstruction écologique.

Dans le cas de la France des Trente Glorieuses, nous avions des mécanismes qui s’apparentent aussi à de la création monétaire libre de dette. La Banque de France faisait des avances remboursables à l’État, mais celui-ci n’avait aucune obligation de les rembourser : il pouvait différer le remboursement en augmentant le plafond en loi de finances. Comme les prêts étaient à taux zéro, l’État ne devait même pas rembourser d’intérêts, contrairement à la dette perpétuelle que proposent certains aujourd’hui. Je vous rappelle qu’à cette époque, le taux d’investissement public était de près de 8 % du PIB, contre moins de 2 % aujourd’hui.
Comme le décrit le chercheur Nathan Sperber pour l’Institut Rousseau (partenaire de LVSL, ndlr), la Chine a utilisé un système similaire au moment de la crise financière asiatique de 1998 pour éponger les pertes des banques nationales chinoises, dont les dettes étaient rachetées et annulées par la banque populaire de Chine. Cela a permis de désendetter en douceur l’économie chinoise en injectant une monnaie libre de dette qui devient permanente dans l’économie.
L’Allemagne nazie avait également créé un mécanisme de monnaie parallèle au Reichsmark pour relancer son économie écrasée par la crise de 1929 et les dettes héritées de la Première Guerre mondiale. Un génie de la finance nommé Hjalmar Schacht avait développé les bons MEFO (Metallurgische Forschungsgesellschaft, ndlr), créés de toute pièce par la banque centrale. L’État allemand utilisait ces bons pour passer des commandes publiques à l’industrie, qui pouvait ensuite les échanger contre des marks. La masse monétaire allemande progresse ainsi de plus de 20 % par an entre 1933 et 1938 ! C’est de cette façon que l’industrie et l’armée allemandes sont devenues aussi puissantes. Schacht se désolidarisera ensuite des nazis quand il comprend que son système monétaire ne sert plus qu’à des dépenses de guerre et pas à la population allemande. Il ne tient qu’à nous de réadapter ces outils pour la transition écologique. C’est un peu ce qu’avaient fait les économistes Michel Aglietta et Etienne Espagne en proposant un actif carbone qui pouvait être refinancé auprès de la banque centrale.
Citons aussi le fait que les banques commerciales peuvent utiliser leur pouvoir de création monétaire pour acheter des actifs financiers. Certes, il y a des limites car elles doivent respecter des exigences de fonds propres et de refinancement sur le marché interbancaire. Néanmoins elles abusent largement de cette possibilité. Au passage, cela prouve que ceux qui affirment que la monnaie sans dette ne peut exister, qu’elle serait une « illusion », ne connaissent pas l’histoire monétaire. Surtout, c’est un privilège gigantesque ! Pourquoi les autres acteurs en seraient-ils privés ?
LVSL : En 2021, vous avez fait partie des initiateurs de la campagne pour l’annulation des dettes publiques détenues par la Banque Centrale Européenne (BCE), qui possédait alors environ 25 % du stock de dettes des États de la zone euro. Plutôt qu’une annulation pure, vous proposiez que la BCE annule ces dettes en contrepartie d’investissements d’un montant équivalent. Pouvez-vous nous présenter votre proposition ?
N.D. : D’abord, je veux dire combien cette mesure est encore plus nécessaire aujourd’hui qu’elle ne l’était hier. Le stock de dettes détenu par la BCE via les banques centrales nationales ce qu’on appelle le SEBC (le Système Européen Banque Centrale) représente aujourd’hui 4.100 milliards d’euros puisque s’est ajouté, au quantitative easing classique, le PEPP (Le Pandemic Emergency Purchase Programme). Désormais, un tiers de la dette publique des États de la zone euro est détenu par la BCE.
On nous rétorquait à l’époque que notre proposition revenait à supprimer le principal (le stock de dette restant à rembourser, ndlr) mais que les banques centrales reversaient les intérêts aux États. C’est faux : les banques centrales ne leur reversent qu’une part de leurs profits sous forme de dividendes. Et quand elles font des pertes, comme cela est arrivé pour la première fois à la BCE dernièrement, elles ne reversent rien. Donc les États continuent à rembourser ces dettes et les intérêts qui vont avec à la BCE, comme ils font pour les créanciers privés. L’énorme différence, c’est que la BCE a le pouvoir de créer de la monnaie. Pourquoi rembourser une institution qui n’en a pas besoin ?
Certains ont alors agité la menace que la BCE ait des fonds propres négatifs si les dettes étatiques étaient annulées. Or, comme je l’explique dans le livre, des écritures comptables sont prévues dans le protocole numéro 4 du Système Européen Banque Centrale, annexé au Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) pour contourner ce problème. En résumé, la BCE peut créer de la monnaie pour compenser les pertes des banques centrales nationales. Notons par ailleurs que les banques centrales font aujourd’hui des pertes pour rémunérer les réserves bancaires !
On nous a aussi dit que notre proposition ne servait à rien car les Etats empruntaient à taux zéro. Sauf qu’on voit aujourd’hui que ce n’est plus le cas et on nous demande désormais de redoubler d’austérité. Pour toutes ces raisons, l’annulation des dettes, ou plutôt leur conversion en investissements, est encore plus nécessaire aujourd’hui.
Enfin, vous avez raison de préciser que nous ne demandions pas une simple annulation des dettes, mais aussi qu’en contrepartie, les États s’engagent à investir les mêmes sommes. Au final, cela aurait permis un plan de relance « gratuit », sans alourdissement de dette. Certes, les États auraient dû réemprunter sur les marchés (les statuts de la BCE lui empêchant de prêter directement aux États, comme le font toutes les autres banques centrales du monde, ndlr) mais ce n’est pas grave car la dette aurait été réduite de manière massive. Les marchés financiers auraient donc pu y trouver leur compte en récupérant quelques intérêts au passage s’ils avaient été intelligents ! Bien sûr, je ne proposais pas cela pour eux, mais pour réenclencher une dynamique économique positive en Europe, qui aurait ensuite généré des recettes publiques supplémentaires.
LVSL : Cette proposition avait été soutenue par de nombreuses personnalités, plutôt de gauche, mais aussi Alain Minc. Christine Lagarde, présidente de la BCE, avait été contrainte de se positionner sur le sujet. Bien que votre proposition n’ait pas abouti, quelle analyse tirez-vous de cette séquence ?
N.D. : Avant tout, c’est une terrible occasion manquée même s’il n’est pas trop tard, bien au contraire, pour y revenir ! Cette annulation ne mettrait en péril aucun acteur privé. Au contraire, elle aurait permis d’éviter de casser l’activité économique et d’augmenter les impôts, ce qui est bénéfique pour les entreprises ! Je ne comprends pas pourquoi les libéraux s’y sont opposé, sinon par dogmatisme ou par méconnaissance.
C’est d’ailleurs pour cela que le débat a transcendé les clivages habituels et que certains financiers ou hommes politiques de droite ont pu saluer la proposition. Je pense ici à Alain Minc ou à des financiers comme Matthieu Pigasse et Hubert Rodarie. Néanmoins, la proposition a été majoritairement portée par des personnalités politiques de gauche comme Manon Aubry (La France Insoumise) et Aurore Lalucq (Place Publique) au Parlement européen, mais aussi Arnaud Montebourg, Jean-Luc Mélenchon et d’autres.
« Le débat sur l’annulation des dettes étatiques détenues par la BCE a transcendé les clivages habituels. »
J’ai moins bien compris en revanche que nous nous fassions attaquer sur notre gauche par certains économistes atterrés dont j’avoue ne pas comprendre la position. Certes, cette opération, à elle seule, ne constitue pas le grand soir qui aurait permis de renverser le système capitaliste, mais cela permettrait d’améliorer la situation économique plutôt que de laisser le système s’effondrer, comme le souhaitaient certains dans une perspective accélérationniste. Oui, ce n’était pas la fin du capitalisme, mais un peu de pragmatisme ne fait pas de mal. Faut-il ne pas augmenter le SMIC parce que cela ne renverse pas le capitalisme et les rapports de domination salariaux ? En outre, pour la première fois, la « citadelle BCE » a vacillé sous l’effet d’une proposition à la fois directe, pragmatique et ciblée, à la place de grands discours abstraits. En témoigne la tournée médiatique entreprise par Christine Lagarde que je décris dans le livre. Mais au lieu de faire bloc, une frange d’économistes soi-disant de gauche s’y est opposée, pour le plus grand bonheur des monétaristes, pour des raisons qui ne tenaient pas la route.
D’autres n’ont tout simplement pas compris et c’est inquiétant. Pour eux, la dette n’est au fond jamais un problème et s’en préoccuper revient à faire le jeu des défenseurs de l’austérité. Certes, la dette publique est roulée constamment, mais nous devons tenir compte de la charge financière qu’elle représente via les intérêts : cela ne les dérange visiblement pas que la France ait payé plus de 2000 milliards d’euros d’intérêts aux marchés financiers depuis la fin des années 70. Sans compter que le poids de la dette est toujours un argument mobilisé pour ne pas investir, pour privatiser le patrimoine public, dont celui de l’Etat qui est d’ores et déjà négatif. Faire comme si la dette n’était jamais un problème n’est pas sérieux, c’est justement là-dessus que nous attaquent trop facilement les thuriféraires de l’austérité.
Plus largement, ce débat pose une question de philosophie économique, sur laquelle certains manquent cruellement d’imagination. Il n’y a aucune raison ontologique pour décider que la monnaie et la dette seront indissolublement liées et qu’on ne puisse pas créer de la monnaie sur d’autres critères. Les critères actuels sur lesquels est jugée la pertinence d’une émission monétaire via un crédit à rembourser, à savoir la rentabilité et la capacité de rembourser, ont été imposés par le système financier. Or, ils laissent de côté d’autres motifs liés à l’intérêt général qui pourraient justifier une création monétaire. Il est urgent de refaire de la monnaie un bien commun et d’imaginer d’autres modes de création monétaire. Pendant trop longtemps, les modèles économiques nous ont enseigné que les ressources naturelles étaient abondantes et la monnaie rare : c’est exactement l’inverse que nous devons penser aujourd’hui, en réinventant une macroéconomie de la dette et de la monnaie car penser l’une sans l’autre c’est comme chercher à faire de la physique sans tenir compte de la gravité.
29.04.2024 à 13:29
CONFÉRENCE – ÉLECTRICITÉ : DÉBRANCHER LE MARCHÉ (ANNE DEBRÉGEAS & GWENAËL PLAGNE)
la Rédaction
Lire plus (343 mots)
Après deux ans de forte hausse des prix de l’électricité (+40 % pour les particuliers, doublement en moyenne pour les entreprises et les administrations), la France et l’Union européenne sont en train de réformer le marché de cette source d’énergie indispensable. Au-delà des factures, c’est aussi le financement des investissements nécessaires pour le parc de production et l’avenir d’EDF qui sont en jeu. Or, la réforme en cours est bien moins rassurante que ce qu’annonce le gouvernement. Les prix continueront à fluctuer en fonction de la spéculation et le risque d’une plainte pour “concurrence déloyale” devant la Commission européenne n’est pas exclu. Par ailleurs, les menaces sur EDF restent nombreuses : projets risqués à l’étranger dont les coûts s’envolent, absence de souveraineté sur les turbines Arabelle rachetées à General Electric, concurrence des acteurs privés dans les énergies renouvelables… Alors que le gouvernement s’obstine à vouloir transformer ce bien public en un marché, syndicalistes et politiques se battent pour un vrai monopole public de l’énergie et des tarifs corrects pour tous les usagers. Une loi votée le 29 février à l’Assemblée nationale est un premier pas en ce sens. Après cette première victoire, comment transformer l’essai ?
➜ Pour comprendre ces enjeux, Le Vent Se Lève recevait le 11 mars dernier à la Bourse du Travail de Paris deux syndicalistes spécialistes de ces questions : Anne Debrégeas, syndicaliste SUD Energie et économiste spécialiste du marché de l’électricité et Gwenaël Plagne, syndicaliste FNME-CGT et secrétaire du CSE-C d’EDF. La conférence était animée par William Bouchardon, directeur de la rubrique économie.
26.04.2024 à 17:07
La conquête spatiale : ultime fantasme du capitalisme ?
R. Dan
Texte intégral (3625 mots)
L’avenir de l’humanité se trouverait à quelques millions de kilomètres, sur une planète inhabitable et aride. Le futur de l’industrie lourde et polluante se situerait dans l’espace. Ou bien encore, le tournant écologique passerait par un voyage touristique en orbite. Tels sont les fantasmes du secteur spatial, nourris par les grandes figures de « l’astrocapitalisme » (Elon Musk et autres magnats). Ils prospèrent au sein du New Space, ce slogan aux allures de nouvelle ère dans laquelle le secteur privé porterait désormais la conquête spatiale, en opposition aux agences publiques, accusées d’être politiques et bureaucratiques. Cette modalité de la « conquête spatiale », associant les rêves du marché à ceux de Prométhée, n’est ni anodine, ni le fruit du hasard : elle résulte d’une industrie et d’une idéologie spatiale cohérente dont Irénée Régnauld, chercheur associé à l’université de technologie de Compiègne, et Arnaud Saint-Martin, sociologue, retracent la construction dans Une histoire de la conquête spatiale, ouvrage dense et bienvenu paru en janvier 2024. Recension.
Aux origines militaires de l’exploration spatiale
Le programme militaire nazi serait-il le véritable acte de naissance des futures fusées ? C’est l’histoire que rappellent Irénée Régnauld et Arnaud Saint-Martin. Dans l’entre-deux-guerres, en Allemagne, les expériences de la Société pour la navigation spatiale, créée en 1927 par des passionnés rêvant de visiter les astres, suscitent en effet l’intérêt de la Wehrmacht et de la Luftwaffe en quête d’armes nouvelles. Plusieurs sont recrutés par l’armée et contribuent au développement des programmes balistiques du Troisième Reich, d’abord dans l’usine de Peenemünde avant de rejoindre l’usine-camp de Dora, à proximité des camps de Dora-Mittelbau et de Buchenwald. Les missiles Aggregat profiteront d’une main d’œuvre esclavagisée, puis d’un intérêt soutenu des hauts dignitaires nazis lorsque les armées allemandes commenceront à reculer sur les fronts de la Seconde Guerre mondiale.
Mais les « Wunderwaffen » [les « armes du miracle », selon le terme employé par la propagande nazie pour désigner des projets d’armes révolutionnaires censées sauver le régime, ndlr], dont font partie les Aggregat, ne parviendront pas à retourner la situation. Après la chute du régime, ces ingénieurs hautement convoités sont récupérés par les États-Unis, l’URSS ou encore la France. Ainsi, dans la patrie de l’Oncle Sam, Werhner Von Braun devient, par exemple, le maître d’œuvre de la conquête spatiale étatsunienne à partir de 1958, tandis que ses anciens collègues de Dora se retrouvent partout dans l’industrie spatiale nord-américaine.
Néanmoins, ces origines sont souvent balayées d’un revers de la main dans le récit hégémonique : les ingénieurs n’auraient eu d’autre choix que de travailler pour le Troisième Reich. Au pire, auraient-ils passé un terrible pacte faustien. En s’appuyant sur la recherche existante1, Irénée Régnauld et Arnaud Saint-Martin rappellent que les accointances nazies de plusieurs ingénieurs sont avérées et sont même connues du renseignement étatsunien, tandis que les conditions d’exploitation des travailleurs à Peenemünde et Dora ne pouvaient être ignorées de leurs maîtres d’œuvre.
Ces origines nazies sont-elles pour autant consubstantielles à la conquête spatiale ? Et ces dernières la marquent-elles aujourd’hui encore, aussi bien dans l’organisation du secteur que sur le plan idéologique ? À l’instar de l’historien Johann Chapoutot, soulignant combien l’idéologie nazie n’est pas un hapax mais s’avère bien inscrite dans l’histoire occidentale, les deux auteurs rappellent les liens étroits entre les capitalismes étatsunien et allemand – ce qui explique l’aisance avec laquelle les ingénieurs allemands se coulent dans l’industrie nord-américaine après la guerre. Tous ont baigné dans l’esprit du fordisme : le productivisme et la rationalisation du travail dominaient des deux côtés de l’Atlantique, aussi bien à Détroit qu’à Peenemünde. Pis encore, ils importent les méthodes organisationnelles héritées de leur expérience nazie, au point que Arnaud Saint-Martin et Irénée Régnauld défendent un « devenir Peenemünde » de la NASA, reposant notamment sur la logique « d’arsenal ».
« Doit-on dès lors parler d’un « devenir Peenemünde » de la NASA, ou faudrait-il plutôt inscrire Peenemünde, tout comme la NASA, dans la dynamique émergente des États technoscientifiques ? »
On peut toutefois s’interroger sur cette filiation : la Big Science, qui désigne le développement d’une science nécessitant des investissements très importants portés par les États, ne doit pas seulement aux programmes balistiques allemands. Le Projet Manhattan, programme militaire étatsunien qui accouche de la première bombe atomique en 1945, s’impose notamment comme l’un des plus grands projets technoscientifiques de cette période, sans nécessité de passer par la généalogie nazie. De même, les programmes militaires abondent durant cette période, sans mobiliser le travail des déportés en camps de concentration.
Doit-on dès lors parler d’un « devenir Peenemünde » de la NASA, ou faudrait-il plutôt inscrire Peenemünde, tout comme la NASA, dans la dynamique émergente des États technoscientifiques2 ? Cette proposition permettrait, en effet, d’inscrire la conquête spatiale dans des évolutions structurelles englobant le fonctionnement nazi, mais sans s’y limiter, car cette évolution concerne alors l’ensemble des États occidentaux. Le nazisme, de ce point de vue, ne constituerait pas l’essence de la conquête spatiale, mais bien plutôt une étape historique avérée, quoique contingente.
Si l’espace a toujours suscité l’intérêt du secteur militaire, c’est d’ailleurs davantage à des fins d’espionnage. C’est notamment l’esprit de la politique d’Open Skies, proposée initialement par l’administration Eisenhower, et poursuivie à travers les satellites d’espionnage, illustrant comment peuvent être associés à la fois technologie militaire et maintien de la paix. La pratique de l’espionnage par satellite devait permettre une connaissance mutuelle des arsenaux balistiques afin d’interrompre la course aux armements et d’organiser une forme d’inspection internationale à même de rassurer les superpuissances. Le consensus tacite et silencieux qui se noue entre Moscou et Washington autour d’un espionnage mutuel permit ainsi d’apaiser, au moins ponctuellement, les tensions au cours des années 1960.
Astrocapitalisme et New Space : le nouvel « âge d’or » de l’espace ?
Une situation qui connait néanmoins de profondes mutations ces dernières années : l’arsenalisation de l’espace est en marche, dans les faits et dans les esprits, et ouvre une nouvelle course aux armements. Les armes hypersoniques sont emblématiques de cette évolution, tandis que les États ne reculent plus devant la « publicité ostentatoire » des programmes spatiaux militaires, illustrée par la création de nouvelles branches au sein des armées, selon le politiste Guilhem Penent3. Autre aspect souvent délaissé que mettent également en lumière Irénée Régnauld et Arnaud Saint-Martin : l’installation conflictuelle des sites de lancement. À Kourou en Guyane pour le Centre national d’études spatiales (CNES) comme à Boca Chica en Floride avec SpaceX, ces installations sont imposées contre les populations locales selon des logiques qui rappellent les dynamiques coloniales.
En se concentrant sur SpaceX, Irénée Régnauld et Arnaud Saint-Martin soulignent par ailleurs avec ironie qu’Elon Musk, souvent associé à l’idéologie libertarienne, survit uniquement grâce à l’argent public, et participe avec assiduité à une guerre légale contre ses concurrents portant sur les appels d’offre de l’État. L’objectif est de « s’imposer comme prestataire de services des agences fédérales de l’espace ».
Une interdépendance qui tranche avec le récit des défenseurs de l’astrocapitalisme et du New Space, pour qui le secteur spatial connaitrait, un nouvel âge d’or fondé sur la croissance d’acteurs économiques issus du privé, capables d’innovations technologiques de rupture à moindre coût. Or, sans l’argent des contrats publics, les acteurs privés s’effondreraient. Le développement des activités commerciales dans l’espace répond ainsi à une volonté politique des États et de leurs agences spatiales, devenues imprésarios du New Space.
L’astrocapitalisme incarne, de ce point de vue, le « spatial fix » conceptualisé par le géographe David Harvey4 : « ce déplacement géographique du capital en vue d’assurer le maintien du taux de profit ». Un déplacement soutenu et orchestré par les États, qui commence néanmoins à inquiéter certains responsables scientifiques et politiques. Le secteur des télécommunications concentre les critiques : le développement de mégaconstellations de satellites en orbite basse, aux durées de vie limitées, pollue par exemple l’espace. Non seulement, les nuisances lumineuses ont suscité l’ire des observatoires astronomiques, mais la pollution atmosphérique des lancements commence à être mieux connue. Cela sans oublier les risques engendrés par la multiplication des débris et le danger d’une réaction en chaîne, répondant au nom de syndrome Kessler dans le vocabulaire spatial.
« L’astrocapitalisme incarne ainsi le « spatial fix » conceptualisé par le géographe David Harvey : “ce déplacement géographique du capital en vue d’assurer le maintien du taux de profit”. »
On peut toutefois s’interroger sur la pertinence du terme d’« astrocapitalisme », dans la mesure où la spécificité du secteur n’est en rien évidente. Ce capitalisme d’État, dans lequel les autorités politiques délèguent au privé, construisent un droit favorable à son développement, tout en orientant les stratégies de ces grandes entreprises vivant sur fonds publics, s’avère en effet conforme à l’esprit paradoxal du néolibéralisme. Ne gagnerait-on pas à mettre en lumière cette continuité au lieu d’entretenir une rhétorique d’exceptionnalisation du spatial, qui est le produit du récit hégémonique ?
Loin de supposer un tel projet de la part des deux auteurs, il nous apparaît néanmoins indispensable de souligner le risque de récupération d’une telle conceptualisation5. Par-delà la charge critique inhérente au dévoilement des logiques capitalistes d’un système politico-économique si soucieux d’éviter toute caractérisation idéologique, « l’astrocapitalisme » pourrait assurément servir les imaginaires technoscientifiques et extractivistes de l’espace et offrir un nom séduisant aux récits de fiction présentant de tels futurs. Pensons par exemple à The Expanse, œuvre littéraire portée sur les écrans, dans laquelle la ceinture principale d’astéroïdes est exploitée, qui semble être l’incarnation enthousiasmante d’un New Space, réalisant ses plus vertigineuses ambitions, et figurer les « prouesses » de l’astrocapitalisme.
Contre la cosmologie capitaliste : une critique à portée limitée
L’ouvrage d’Irénée Régnauld et Arnaud Saint-Martin se clôture par un inventaire des récits alternatifs à cet assaut capitaliste sur l’espace. Une partie qui se veut « excentrique », en rappelant par exemple l’intérêt pour les OVNIS, qui a d’ailleurs précédé la conquête spatiale à proprement parler. D’autres chemins sont également ouverts par les contre-cultures et les discours critiques de « l’âge d’or » des années 1960 : mouvements féministes, luttes pour les droits civiques ou encore culture hippie qui ont pu s’opposer à la NASA.
Une place est faite également à la diversité des cosmologies qui interroge l’unicité du regard sur l’espace : toutes les populations ne voient pas dans les corps célestes des entités mortes, libres d’appropriation, d’occupation ou encore d’extraction. Les corps célestes peuvent revêtir un caractère sacré tandis que d’autres savoirs que ceux issus de l’Occident leur prêtent des propriétés vivantes.
La portée de ces critiques fondées sur la diversité des cosmologies mérite toutefois d’être questionnée. Qu’une grande diversité de visions existe – et ce d’ailleurs au sein même des sociétés occidentales – est un fait digne d’être rappelé, comme l’ont fait les deux auteurs en s’appuyant sur une riche recherche en la matière, afin de déconstruire l’idéologie hégémonique à l’œuvre dans le secteur spatial. Or, pourquoi cette critique n’est-elle pas également menée lorsqu’il s’agit de récits situés dans des sociétés non-occidentales ? Les cosmologies des Zunis, des Hopis, des Pawnees ou des Inuits relèveraient-elles de sociétés homogènes, consensuelles et anhistoriques, dont la cosmologie ne relèverait d’aucun rapport de force ni d’intérêts divergents ? En somme, ne risque-t-on pas de reproduire le mythe du « bon sauvage » en considérant qu’une société disposerait d’une cosmologie unanimiste, dont la vertu serait telle qu’elle devrait être érigée en contre-modèle ?
« En somme, ne risque-t-on pas de reproduire le mythe du « bon sauvage » en considérant qu’une société disposerait d’une cosmologie unanimiste, dont la vertu serait telle qu’elle devrait être érigée en contre-modèle ? »
Cette considération pour l’intégration des cosmologies non-occidentales à la critique scientifique, au sens des sciences sociales, n’est pas un appel à déconsidérer la portée de l’argument : les programmes spatiaux portent bien en eux une certaine cosmologie dont on peut interroger la légitimité, d’autant plus lorsque les actions que cette cosmologie légitime conduisent à la négation de l’égale dignité des autres cosmologies. Cependant, cette critique pourrait sembler faible sur le plan de l’effectivité : elle relèverait d’une critique éthique ayant peu de poids face aux enjeux stratégiques du secteur spatial. D’autant plus que cette faiblesse n’est pas rattrapée par les organisations et réseaux portant la critique de la conquête spatiale sur un plan politique, dont « l’influence sur les décisions demeure (…) de l’ordre du symbolique et des relations publiques », selon les deux auteurs.
C’est la raison pour laquelle l’absence d’une certaine alternative nous semble préjudiciable : celle portée par les États du Tiers-Monde dans les années 1970, qui ambitionnaient la création d’une agence internationale pour l’espace à travers l’Accord sur la Lune de 1979, et plus généralement les ambitions internationalistes portées par ces États au cours des années 1960 et 1970, qui n’ont pas échoué partout. En effet, le chapitre quatre évoque les fonds marins comme l’une des cibles du spatial fix : or, ces fonds marins bénéficient du statut de patrimoine commun de l’humanité, ce qui a permis d’empêcher leur exploitation jusqu’à aujourd’hui en interposant une barrière juridique et politique aux ambitions portées par de grandes entreprises. Si la situation n’est évidemment pas idyllique – mais une telle situation, dans un monde de rapports de force, peut-elle exister ? –, elle a le mérite d’encadrer et de politiser la question de l’exploitation des fonds marins.
Une telle ambition était portée par l’Accord sur la Lune qui prévoyait de conférer aux ressources spatiales le statut de patrimoine commun de l’humanité. Malgré le soutien initial du Département d’Etat étatsunien, ce projet a été torpillé par les milieux industriels et l’association L-5 de O’Neill. L’attribution du statut de patrimoine commun de l’humanité aux fonds marins dans les eaux internationales servit alors de mise en garde et de contre-argument pour ces milieux nourris à l’idéologie spatiale. Leur campagne de lobbying fut un succès : Washington se retira de l’accord, conduisant à son échec.
Cette alternative nous semble mériter l’attention pour plusieurs raisons : elle bénéficie du précédent et de l’actualité des fonds marins, qui permet de soutenir sa faisabilité. Elle fut également portée par les États du Tiers-Monde dans les années 1970 et elle permet de rappeler les ambitions que ces États non-occidentaux prêtaient aux programmes spatiaux, tout en interrogeant le caractère purement occidental et colonial associé à la conquête spatiale. Enfin, elle se détache d’une critique essentiellement éthique, au profit d’un projet juridique et politique fondé sur de l’existant. Cela ne signifie en rien qu’il soit facile de l’obtenir politiquement : le statut des fonds marins comme l’Accord sur la Lune sont le fruit d’un contexte international radicalement différent, sur fond de Groupe des 776 et de Guerre froide. Qui plus est, les évolutions contemporaines du droit de l’espace consistent justement à faire table rase des faibles acquis encore présents dans le Traité de l’espace de 1967. D’où la nécessité d’œuvrer à reconstruire un rapport de force, en associant les héritages tiers-mondistes aux arguments contemporains.
La communauté scientifique a d’ailleurs elle-aussi un rôle à jouer dans ce revirement : l’expansion de l’œkoumène – l’ensemble des terres anthropisées –, portée par de nouvelles formes de colonialismes, exaspère les scientifiques attachés à l’approfondissement des connaissances spatiales, qui remettent en cause l’intérêt de la présence humaine en orbite7. La robotique serait moins chère et plus fiable sans cette dernière ; deux arguments majeurs dans un secteur peinant à attirer l’argent public, lorsqu’il s’agit de financer l’expansion du savoir, plutôt que celle du profit. À cela s’ajoutent les revendications de la communauté astronomique, qui mène un combat depuis plusieurs années contre les mégaconstellations de satellites.
C’est à ce titre que l’ouvrage d’Irénée Régnauld et Arnaud Saint-Martin peut également être utile. En constituant un riche condensé des dernières recherches en sciences humaines et sociales, il démontre la politisation inhérente à l’idéologie spatiale dominante et s’attache à la déconstruire avec soin dans ses dimensions historiques, culturelles, militaires, économiques et politiques8. Aux derniers fantasmes d’Elon Musk soutenus par la NASA, qui perpétuent un projet colonialiste et extractiviste en assurant que le salut de l’humanité se trouve sur Mars, il importe donc d’opposer un contre-projet qui permette, non pas de « fuir » le cataclysme terrestre, mais de l’éviter.
1. Voir Michael Neufeld, Von Braun: Dreamer of Space, Engineer of War, New York, Vintage Books, 2007.
2. Voir par exemple : Dominique Pestre (éd.), Le gouvernement des technosciences. Gouverner le progrès et ses dégâts depuis 1945, Paris, La Découverte, 2014.
3. Guilhem Penent, « La fin de la militarisation limitée de l’espace ? La France dans le contexte du retour des armes spatiales », Les Champs de Mars, vol. 30, n° 1, 2018.
4. David Harvey, Les Limites du capital, Paris, Editions Amsterdam, 2020.
5. Le secteur spatial a d’ailleurs suscité de nombreuses propositions conceptuelles : il en est ainsi de « l’astrofuturisme » de De Witt Douglas Kilgore (chercheur en études américaines), de « l’astropolitique » de Everett C. Dolman (professeur en stratégie militaire) ou encore de « l’astrosociologie » de Jim Pass (sociologue).
6. Coalition réunissant 77 pays en développement, créée en 1964 afin de défendre des politiques de développement à l’échelle internationale, avec une certaine influence à l’ONU dans les années 1970.
7. Voir par exemple Donald Goldsmith, Martin Rees, The End of Astronauts: Why Robots Are the Future of Exploration, Cambridge (Mass.), Belknap Press, 2022.
8. Voir notamment le chapitre deux, consacré à la fabrique de l’astroculture dominante.
25.04.2024 à 16:56
Portugal : un cinquantenaire de la révolution des Œillets au goût amer
Antoine Bourdon
Texte intégral (2367 mots)
Les législatives du 10 mars ont donné lieu à une percée historique du parti d’extrême-droite CHEGA (« Ça suffit ») avec l’entrée de 48 députés – sur 230 – au Palacio de Sao Bento. Cinquante après la révolution dite « des Œillets » du 25 avril, qui avait mis un terme à la dictature salazariste, ce résultat est un bouleversement politique majeur. Ne disait-on pas le Portugal, comme l’Espagne, immunisé contre l’extrême droite par son expérience dictatoriale récente ?
Victoire de Luis Montenegro : un arbre qui cache une forêt d’extrême-droite
Les élections législatives portugaises du 10 mars se sont déroulées dans un contexte inhabituel. Après avoir récolté la plus large majorité de l’histoire parlementaire du Portugal en 2022 – 120 sièges sur 230 -, le premier ministre Antonio Costa (Parti socialiste, centre-gauche) apparaissait comme le leader naturel de son camp et de son pays, à la tête d’un exécutif stable. Il démissionne pourtant en novembre 2023, pour cause de soupçons de corruption en lien avec l’attribution de permis d’exploitation de mines de lithium.
La justice portugaise a en effet ouvert des enquêtes contre le premier ministre et plusieurs membres de son gouvernement. Le président conservateur, Marcelo Rebelo de Sousa, choisit alors, plutôt que de nommer un nouveau premier ministre socialiste, de dissoudre l’Assemblée et de convoquer des élections anticipées. Certains analystes y ont vu une manœuvre pour favoriser la droite portugaise, l’Alliance démocratique, structurée autour du Parti social-démocrate (PSD), revigorée par les scandales visant le PS. Le général António Ramalho Eanes, premier président démocratiquement élu après la révolution de 1974, s’était notamment prononcé contre cette dissolution.
Le scrutin a été remporté d’une courte tête – 50 000 voix – par l’Alliance démocratique. Cependant, le fait majeur de cette élection consiste dans l’entrée au palais de Sao Bento de cinquante députés du parti d’extrême-droite CHEGA, mené par son chef André Ventura. Le parti s’est opportunément saisi du thème de la lutte contre la corruption pendant la campagne, au cri de Vamos limpar Portugal (« Nous allons nettoyer le Portugal »). Cette entrée fracassante, conjuguée à la majorité relative détenue par le nouveau premier ministre Luis Montenegro (PSD), a bouleversé les équilibres politiques portugais et dynamité l’exceptionnalisme supposé du pays.
En effet, malgré douze sièges obtenus aux précédentes élections, l’extrême-droite n’était jamais parvenue à s’imposer dans le paysage politique. De par sa nouvelle position, CHEGA a désormais acquis un pouvoir d’influence non négligeable au Parlement. En tant que telle, sa présence massive dans l’hémicycle a fait craindre un blocage institutionnel. En effet, avec 48 députés CHEGA, ni les partis de droite ni ceux de gauche n’étaient en mesure de former un gouvernement majoritaire.
Si CHEGA ne se revendique pas officiellement de l’héritage de Salazar, le parti se place dans sa continuité, notamment dans sa critique de la Constitution de 1976 – jugée « marxiste ».
Si Montenegro a exclu d’entrée de jeu tout accord politique avec CHEGA, le nouvel exécutif, formé le 2 avril dernier, devra faire face à ses coups de menton visant à recentrer le débat public autour de ses thèmes de prédilection : l’immigration, la famille et plus largement les enjeux identitaires. Sur le plan économique, l’AD et CHEGA devraient néanmoins former un tandem officieux, à en croire le programme du parti d’extrême-droite. Baisse de l’impôt sur les sociétés, réduction des « exigences de régulation » pour les entreprises, simplification du code du travail et « flexi-sécurisation », porte ouverte à la privatisation partielle d’entreprises privées, service communautaire pour les allocataires du chômage : le programme de CHEGA ne manque pas d’attraits pour l’AD.
Cinquante ans après la révolution des Œillets, des commémorations bousculées
Le 25 avril 1974 à minuit et vingt minutes, Grândola, vila morena retentit sur les ondes de Radio Renascença. La diffusion de cette chanson interdite par le pouvoir salazariste donne le coup d’envoi du renversement de la dictature par le Mouvement des forces armées (MFA). Les militaires rassemblés autour d’un programme dit des 3D – démocratisation, décolonisation, développement – mettent fin à près de quarante ans d’autocratie.
Comme le rappelle Yves Léonard, spécialiste de l’histoire du Portugal et professeur à Sciences Po : « Le déclencheur principal de la révolution sont les guerres coloniales calamiteuses que mène le Portugal depuis les années 1960. On dit de la guerre d’indépendance de la Guinée-Bissau que c’est le Vietnam du Portugal. La situation est tout aussi mauvaise en Angola ou au Mozambique. Le nombre très élevé de morts et la crise larvée entre l’État et l’Armée – rébellion du général Delgado en 1958, crise de Goa en 1961, décrets favorisant les miliciens en 1973 – provoque le soulèvement des officiers intermédiaires, qui souhaitent trouver des issues politiques aux guerres d’indépendance ».
Cette crise interne à l’Estado novo se conjugue à la contestation grandissante portée par la classe ouvrière, née du développement industriel et des délocalisations en péninsule ibérique des années 1960. Elle se mêle à la fronde des étudiants qui aspirent à plus de libertés publiques et dont certains fuient la conscription, notamment vers la France. L’effondrement du régime donne lieu au Processus révolutionnaire en cours (PREC), une période transitoire et agitée, marquée par une prédominance des socialistes et des communistes, qui aboutit à la Constitution de la République en 1976.
La révolution ne donne pourtant pas lieu à une épuration politique du salazarisme. Si aucune amnistie n’est prononcée, si certains dirigeants de la police politique sont bien jugés, nombre de cadres du régime, de propriétaires fonciers et de dirigeants d’entreprises se sont enfuis à l’étranger. Et l’administration de la toute jeune République, qui a besoin de fonctionnaires, recycle largement ceux de l’Estado novo.
Même si la Constitution interdit la reformation de groupes salazaristes, la révolution ne donne pas lieu à un inventaire des quarante années de gouvernement sous la devise « Dieu, Famille, Patrie ». Néanmoins, la droite libérale portugaise, menée par Francisco Sa Carneiro, est fondée sur l’opposition à la dictature – et le rassemblement de l’Alliance Démocratique en 1979 porte le même Carneiro au pouvoir. En ravivant le souvenir de cette personnalité charismatique et en rassemblant, 45 ans après, les mêmes partis qu’en 1979, Montenegro est parvenu au pouvoir malgré l’absence de dynamique électorale.
Si CHEGA ne se revendique pas officiellement de l’héritage de Salazar, le parti se place dans sa continuité, notamment dans sa critique de la Constitution de 1976 – jugée « marxiste ». « Plutôt que le 25 avril 1974, CHEGA préfère commémorer le 25 novembre 1975, la tentative de coup d’État qui met un terme au PREC et ouvre une période de stabilisation », détaille Yves Léonard. L’historien évoque le saudosisme (de saudade, la nostalgie douce-amère portugaise), qui prend la forme d’une exaltation du roman national et de la « grandeur » passée du pays – reposant notamment sur la domination coloniale1.
André Ventura mobilise également une rhétorique identitaire fondée sur des notions comme la « Portugalité », les « Portugais de bien » – ou encore « l’anti-Portugal », qui visait autrefois les ressortissants des anciennes colonies comme la Guinée, et cible actuellement davantage les populations musulmanes et tziganes. En matière économique, CHEGA se revendique d’un ultra-libéralisme qui s’éloigne partiellement de l’héritage salazariste, plutôt corporatiste – bien que, comme le note Yves Léonard, le régime de Salazar, lui-même professeur d’économie, a servi d’inspiration pour des penseurs libéraux comme Friedrich Hayek, Walter Lippmann ou Louis Baudin…
Depuis 2022, une commission d’historiens et d’historiennes, présidée par Maria Inacia Rezola, chercheuse experte de la question, est chargée de préparer les commémorations de la transition vers la démocratie. Davantage qu’une simple célébration de la révolution du 25 avril, ces cérémonies, qui s’étendront jusqu’en 2026, cherchent à faire revivre et connaître l’ensemble des étapes qui ont conduit à l’instauration du régime parlementaire. Un contexte qui, selon Yves Léonard, devrait pousser le CHEGA à jouer la carte « anti-système » dans l’hémicycle, face à un consensus qui s’étend de la gauche au centre-droit.
Le mythe de « l’immunité » à l’extrême-droite : un aveuglement continental
De nombreux commentateurs ont longtemps considéré le Portugal comme immunisé à l’extrême-droite. Comme pour l’Allemagne ou l’Espagne, on considérait que l’expérience dictatoriale devait le prémunir contre ses vieux démons. Pourtant, 25% des 18-34 ans ont voté CHEGA aux législatives du 10 mars dernier. Ce résultat s’explique bien par l’érosion du souvenir de la dictature ; mais à lui, seul, il ne permet pas de comprendre le succès viral de CHEGA – particulièrement d’André Ventura lui-même – sur les réseaux sociaux.
Avec une stratégie analogue à celle d’un Jordan Bardella en France ou d’un Santiago Abascal en Espagne, le dirigeant de l’extrême-droite portugaise s’est forgé une image de « rebelle » via des buzz retentissants. Ventura réalise ses meilleurs scores (environ 30% des voix) dans la région de l’Algarve, la plus au sud du pays. Selon Luis Serra Coelho, l’importante victoire dans cette région agricole tient à la fois au rejet des immigrés et aux problèmes majeurs de pauvreté et d’accès aux soins qui la touchent. Le rejet de l’immigration découle à la fois d’un racisme visant les ressortissants non-européens, mais aussi de présence importante de riches Européens du nord – touristes, immigrés et retraités. Ces derniers bénéficiaient jusqu’en octobre 2023 d’avantages fiscaux, qui ont participé à l’augmentation des prix de l’immobilier et contribué à la crise du logement. Entre 2017 et 2022, les loyers ont augmenté de 40 % en moyenne sur tout le territoire portugais2.
Une configuration qui n’est pas sans évoquer la montée en puissance du parti d’extrême droite Alternative für Deutschland (AfD) dans l’ex-Allemagne de l’Est. L’AfD a su capitaliser sur le chômage et la désindustrialisation ; la croyance en une dénazification éternelle de l’Allemagne a fait le reste. Un exemple qui témoigne, si besoin il était, que le passé dictatorial ne constitue pas un vaccin contre la résurgence du nationalisme.
L’issue passe par la reconstruction d’une culture démocratique, dont la montée de l’abstention atteste de l’érosion, depuis des années. Yves Léonard note « un rebond de participation aux législatives », mais ajoute que « la plupart des anciens abstentionnistes sont allés voter CHEGA. Il y a un vrai désenchantement et même une hostilité envers l’exercice démocratique. » Le parti d’extrême-droite devrait d’ailleurs consolider sa troisième place sur l’échiquier politique portugais aux élections européennes du 9 juin prochain. Et réussir, pour la première fois, à envoyer des eurodéputés à Strasbourg.
Notes :
1 Yves Léonard, « L’extrême droite de Chega au Portugal : entre normalisation et lutte pour l’hégémonie », Lusotopie 21, 2, 2022
2 « Rendas aumentaram mais de 40% em cinco anos », Rafaela Burd Relvas, 30 septembre 2022, Publico https://www.publico.pt/2022/09/30/economia/noticia/rendas-aumentaram-40-cinco-anos-2022312
24.04.2024 à 19:38
L’intelligence artificielle au cœur de la multiplication des victimes civiles à Gaza
Politicoboy
Texte intégral (3737 mots)
Le média israélien +972mag a révélé l’usage déterminant de deux programmes d’intelligence artificielle (IA) lors de la campagne de bombardement contre la bande de Gaza. Le premier, Lavender, sert à sélectionner des cibles en attribuant à chaque Gazaoui une probabilité qu’il soit affilié à la branche armée du Hamas. Le second, Where’s Daddy ? (« où est Papa ? »), permet de déterminer lorsque ces cibles rejoignent leur domicile. C’est seulement à ce moment qu’une personne intervient dans la chaîne décisionnelle : vingt secondes pour valider une frappe aérienne sur la résidence, le plus souvent avec des bombes non-guidées rasant des immeubles entiers. Pour un simple homme de main, jusqu’à vingt victimes collatérales étaient autorisées. Pour un commandant, plusieurs centaines. Une rupture avec le droit de la guerre et le principe de proportionnalité, aggravée par le fait que l’IA commet de nombreuses erreurs à tous les niveaux de la chaine décisionnelle. Retour sur les implications d’une enquête précise et détaillée.
« L’accent, dans cette opération, a été mis sur l’ampleur des dégâts, pas sur la précision des frappes » déclarait le 10 octobre 2023 le porte-parole de l’armée israélienne. Pour défendre le nombre inédit de victimes civiles causé par l’offensive contre Gaza en réponse à l’attaque terroriste du 7 octobre, le gouvernement israélien et ses nombreux relais ont répété que de telles pertes résultaient de l’emploi de bouclier humain par le Hamas. Cet argument vient de voler en éclat.
Dans une longue enquête, le média indépendant israélien +972mag détaille comment l’armée a utilisé l’intelligence artificielle pour cibler délibérément et massivement des civils. Ces révélations reposent six sources militaires israéliennes. +972mag a déjà été à l’origine de révélations majeures sur le conflit et l’auteur Yuval Abraham, basé à Jérusalem, est un journaliste travaillant fréquemment pour des médias américains. Les autorités israéliennes n’ont apporté qu’un démenti partiel reposant sur des affirmations contredites par des déclarations antérieures.
En plus des sources militaires, dont certaines assument pleinement l’usage de ces outils et ont perdu des proches dans l’attaque terroriste du 7 octobre, l’enquête cite trois éléments susceptibles de corroborer ses affirmations. D’abord un livre publié en 2021 par le responsable de l’unité de renseignement d’élite « Unit 8200 » qui détaille le concept du programme d’Intelligence artificielle incriminé et justifie son usage, comme l’avait déjà rapporté le quotidien israélien Haaretz.
Deuxièmement, une conférence tenue en 2023 à l’université de Tel-Aviv par des officiers du renseignement, où ils avaient détaillé, à l’aide de PowerPoint, le fonctionnement du programme. Enfin, l’enquête note que ses conclusions permettent d’expliquer le nombre important de familles entièrement tuées lors des premières semaines de bombardements et de confirmer les révélations de CNN qui affirmaient qu’une munition sur deux employée à Gaza était une dumb bomb (« bombe idiote » ou non-guidée). Ces différents éléments expliquent le crédit apporté à l’enquête par de nombreuses grandes rédactions occidentales – malgré son peu d’écho médiatique.
Lavender : comment bombarder des cibles à leur domicile
L’enquête de Yuval Abraham est divisée en six parties qui décrivent chaque étape menant au bombardement volontaire d’un nombre disproportionné de civils, ce qui constituerait un cas flagrant de crime de guerre. Tout commence par l’identification des cibles potentielles. Elle est effectuée par Lavender, un programme informatique fonctionnant à l’aide du deep learning [« apprentissage profond » : une intelligence artificielle évolutive, modifiant ses algorithmes en fonction des données qu’elle capte NDLR].
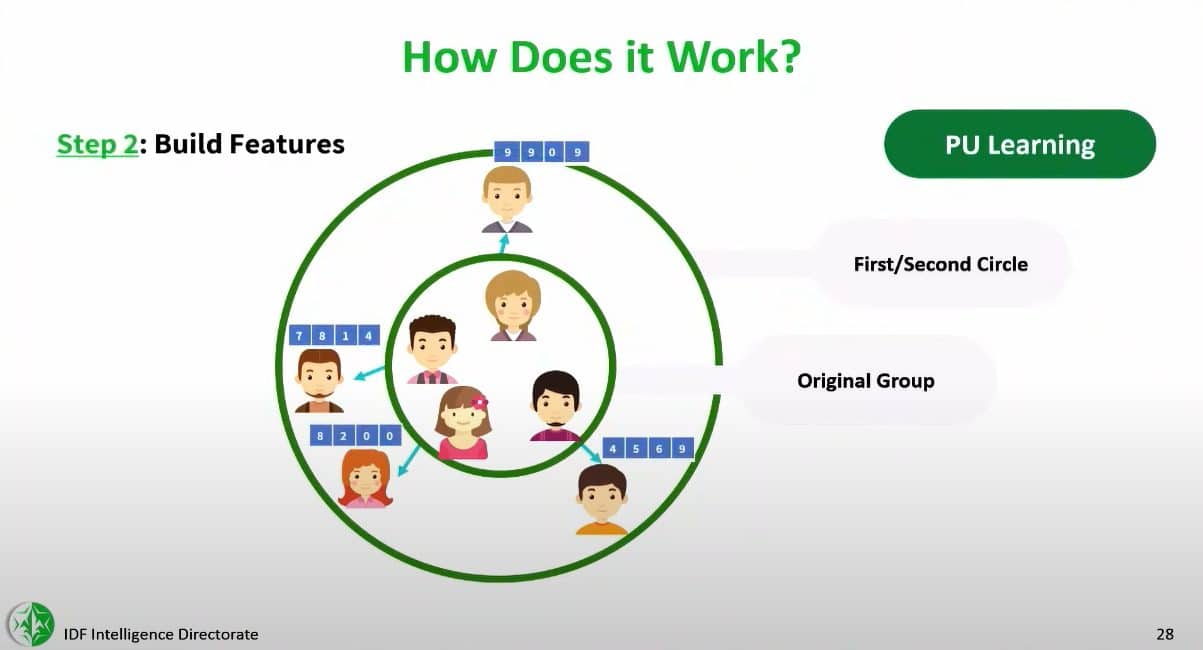
En entrée, le programme reçoit deux types de données : des très larges quantités d’information collectées sur les habitants de Gaza par le système de surveillance de masse du renseignement israélien et les éléments de profils-types de combattants du Hamas connus des services d’espionnage (quel type d’usage font-ils de leurs téléphones portables ? où se déplacent-ils ? avec qui interagissent-ils ? Etc).
Le programme a ensuite été entraîné à reconnaître les comportements et indices propres aux membres du Hamas pour les comparer à ceux collectés sur le reste de la population. Le simple fait d’être dans un groupe Whatsapp avec une personne suspecte est un motif incriminant, comme recevoir un paiement du Hamas, avoir appartenu à ce groupe par le passé ou posséder l’ancien appareil électronique d’un suspect.
L’algorithme attribue à chaque habitant de Gaza un score de 1 à 100 représentant sa probabilité d’être affilié à la branche armée du Hamas. Les services de renseignements déterminent ensuite un score minimal à atteindre pour être placé sur la kill list et devenir une cible. La limite d’âge de 17 ans ayant été supprimée, des enfants ont été ciblés, explique l’une des sources de l’enquête.
Comme pour tout programme d’intelligence artificielle de cette nature, les erreurs sont courantes. Dans au moins 10 % des cas, Lavender fiche des « innocents ». Parmi les causes fréquentes, l’enquête cite le fait d’avoir le même nom ou surnom qu’un membre de la branche armée du Hamas, ou d’interagir avec le mauvais téléphone portable. Une fois validée, la cible est placée sur l’agenda de bombardement de l’armée. Une seule intervention humaine a lieu avant d’autoriser la frappe : une vérification visant à confirmer que la cible est bien un homme (la branche armée du Hamas n’employant pas de femmes). Selon l’enquête, cette vérification prend vingt secondes tout au plus.
« Si une cible donne son téléphone à son fils, son frère ou juste un inconnu, cette personne sera bombardée dans sa maison avec toute sa famille. Ça arrive souvent. C’est comme cela qu’ont été commises les principales erreurs », selon une des sources cites par l’enquête.
L’étape suivante consiste à localiser la cible. C’est là qu’intervient un second programme d’intelligence artificielle, au nom quelque peu obscène : Where’s Daddy ? (« où est Papa ? »). Le programme utilise les différentes sources d’informations et données disponibles pour déclencher une alerte lorsque « Papa » est rentré chez lui. C’est uniquement à ce moment qu’une frappe aérienne est ordonnée. Il peut s’écouler de nombreuses heures entre l’ordre et l’exécution de la frappe. La cible a parfois quitté son logement lorsque le bâtiment est détruit, tuant les voisins et la famille sans supprimer le suspect.
La principale raison citée pour frapper les cibles à leur domicile, où aucune activité militaire n’a lieu, est qu’il est plus facile de les localiser dans leurs logements qu’à l’extérieur du domicile familial. Cela découle du fait que chaque Gazaoui possédait une adresse physique associée à son profil. Bien entendu, si l’adresse n’a pas été mise à jour ou que l’individu a déménagé, des « innocents » et leurs voisins périssent pour rien, précise une source citée par l’enquête.
Where’s Daddy ? : bombes non-guidées et dommages collatéraux assumés
L’armée israélienne dispose de différents types de bombes et munitions. Les missiles tirés depuis les drones sont capables d’une très haute précision et causent des dégâts limités, ce qui explique pourquoi ils sont en priorité utilisés contre des véhicules ou des piétons. Les bombes conventionnelles guidées permettent de cibler un appartement précis, dans un immeuble ou un étage particulier d’une maison. Les bombes non-guidées et « anti-bunker » d’une tonne, quant à elles, disposent d’un pouvoir de destruction largement supérieur. Au minimum, elles permettent de raser un bâtiment entier. Les plus grosses peuvent sévèrement endommager un pâté de maisons.
L’essentiel des cibles identifiées par Lavender étaient des simples militants ou combattants du Hamas sans responsabilités. Pour éviter de « gaspiller » des munitions précieuses et coûteuses sur de la « piétaille », ces cibles ont été systématiquement visées avec des bombes non-guidées. Ce qui signifie que pour tuer un membre présumé du Hamas, une maison ou un appartement entier est détruit, ensevelissant sous les décombres la famille et les voisins de la cible.
L’enquête révèle que l’armée acceptait de tuer entre dix et vingt « innocents » par membre présumé du Hamas. Pour les commandants, responsables et officiers, ce chiffre pouvait monter à plusieurs centaines. Ainsi, pour tuer Ayman Nofal, le commandant du bataillon de Gaza centre, un quartier entier a été détruit par plusieurs frappes simultanées (entre seize et dix-huit maisons rasées). Pas moins de trois cents pertes civiles avaient été autorisées.
Pour tuer Oussama Ben Laden, Yuval Abraham note que les États-Unis avaient fixé la limite à trente pertes civiles. En Afghanistan et en Irak, les dommages collatéraux autorisés pour supprimer un membre de base des organisations terroristes étaient « simplement de zéro ».
L’autre problème lié à cette tolérance inédite pour les pertes civiles et qu’elles sont souvent mal estimées. Les femmes et enfants ne faisant pas l’objet de traçage aussi précis, le nombre de victimes potentielles retenu avant d’autoriser une frappe s’est fréquemment révélé inférieur à la réalité. L’armée israélienne a ainsi pu valider des frappes censées tuer un membre du Hamas et quinze femmes et enfants avant de raser un immeuble où se trouvaient deux fois plus de civils. Par exemple, en partant du principe qu’un bâtiment situé dans une zone où des consignes d’évacuations avaient été données était vide ou à moitié vide, sans se donner la peine de vérifier. Et pour ces troupes de base, l’armée ne procédait à aucune vérification post-frappes pour évaluer les dégâts et confirmer la mort de la cible.
« Uniquement lorsque c’est un haut responsable du Hamas, on suit les procédures d’évaluation post-bombardement. Pour le reste on s’en fout. On reçoit un rapport de l’armée qui confirme si le bâtiment a été détruit, et c’est tout. Nous n’avons aucune idée du niveau des dégâts collatéraux, nous passons immédiatement à la cible suivante. L’objectif est de générer autant de cibles que possible aussi vite que possible. »
Source militaire israélienne citée par l’enquête de +972mag.
Après plusieurs semaines de bombardements intensifs, le tarissement des cibles potentielles a poussé les autorités israéliennes à abaisser le seuil à partir duquel le programme Lavender plaçait une personne sur la kill list. Cet algorithme a également été entraîné à partir des profils de simples fonctionnaires apparentés au Hamas mais ne faisant pas partie de la branche armée, ce qui a considérablement accru le risque pour tout civil gazaoui de se retrouver sur la liste, puisque les comportements suspects ne se limitaient plus à ceux des combattants et leurs soutiens directs.
Au paroxysme de la campagne de bombardement, qui aurait fait plus de 15 000 morts en quatre semaines, Lavender a placé plus de 37 000 personnes sur sa kill list.
Des implications multiples et préoccupantes
La lecture de l’enquête et les citations des sources dépeignent une profonde perte de repère des autorités et membres de l’armée israélienne, tout en témoignant d’une déshumanisation totale des Palestiniens. Un comble pour une guerre présentée comme un combat existentiel entre la civilisation et la barbarie.
Si l’on résume : un programme ayant recours à l’intelligence artificielle est chargé de générer des cibles sur la base de critères extrêmement vagues, en croisant des données collectées par un gigantesque système de surveillance de masse à la légalité douteuse. Selon ses propres critères contestés en interne, Lavender se trompait au moins une fois sur dix. Cela n’a pas empêché de transmettre la liste de personnes à éliminer à un second programme, Where’s Daddy ?, reposant lui aussi sur des données incomplètes et pas toujours à jour, pour déterminer quand une cible regagnait son domicile. Quelques heures plus tard, une bombe non-guidée d’une tonne était larguée sur la maison où la cible pouvait ne plus se trouver, tuant les habitants du dit immeuble sans distinction. Ces frappes étaient autorisées après un contrôle prenant moins de vingt secondes. Aucune vérification visant à confirmer l’étendue des pertes civiles ou la mort de la cible n’était ensuite menée.
Le choix de viser les combattants présumés du Hamas chez eux, au milieu de leurs familles et de leurs voisins plutôt que lorsqu’ils sont à l’extérieur de leur domicile – et occupés à des activités militaires -, fait voler en éclat l’idée que les pertes civils records seraient dues à l’emploi de boucliers humains par le Hamas. Bien au contraire : c’est l’armée israélienne qui attendait que ses cibles soient au milieu de civils pour les frapper avec des bombes non-guidées et surdimensionnées.
L’autre point sur lequel insiste Yuval Abraham est la contradiction dans l’approche de l’armée israélienne. Pour justifier l’emploi d’armes non-guidées, la quasi-absence de vérification de l’identité de la cible avant la frappe et l’absence d’évaluation de celle-ci après le bombardement, les militaires citent le manque d’intérêt stratégique de la cible. Les bombes guidées et le temps des officiers étaient trop précieux pour être gaspillé sur ce type de cibles à faible valeur militaire. Mais dans ce cas, comment justifier autant de dommages collatéraux sans violer le principe de proportionnalité situé au coeur de droit de la guerre ?
Les révélations posent des problèmes plus larges. La quasi-suppression du facteur humain dans la décision de tuer est généralement considérée comme une ligne rouge, avec laquelle l’État hébreu semble flirter dangereusement. Un élément d’autant plus inquiétant que le gouvernement israélien a déployé des robots en forme de chiens à Gaza et fait un usage massif de drones de combat. En parallèle, le complexe militaro-industriel israélien met en avant l’utilisation de ces outils technologiques sur le champ de bataille comme autant d’arguments de vente à l’international.
Enfin, les révélations de +972mag mentionnent l’emploi de donnée Whatsapp pour cibler des Palestiniens, certains pouvant être simplement pris pour cible pour s’être retrouvé dans un groupe Whatsapp avec un membre du Hamas. Dans le contexte des bombardements indiscriminés et du siège total imposé à Gaza, les groupes de voisins se retrouvant sur des boucles Whatsapp pour coordonner l’entraide ont certainement éclos un peu partout, aggravant le risque de se trouver dans le mauvais groupe au mauvais moment. Ce qui rend l’usage de ces données pour cibler des suspects encore plus problématique. Plus largement, cette enquête pose la question de la collaboration de Meta (ex-Facebook) avec le gouvernement israélien, que soutiennent activement les principaux dirigeants de l’entreprise, et qui ne semble manifestement pas préoccupée par la sécurité de ses clients.
L’intelligence artificielle à l’heure du « risque de génocide »
Le système décrit dans l’enquête de Yuval Abraham n’est plus utilisé à Gaza. Une des principales raisons citées par ce dernier est le fait qu’il n’est plus possible de lier un suspect à sa résidence, l’écrasante majorité des maisons ayant été détruites et leurs habitants transformés en réfugiés. Mais alors que les États-Unis viennent d’approuver une offensive sur Rafah contre la promesse qu’Israël ne réplique pas trop sévèrement contre l’Iran, Yuval Abraham craint que le système soit de nouveau déployé contre la seule ville encore debout, où se sont réfugiés plus d’un million de Palestiniens. Trois mois après l’arrêt de la Cour internationale de justice (CIJ), qui pointe un « risque de génocide » à Gaza, se dirige-t-on vers un crime majeur assisté par ordinateur ?
23.04.2024 à 20:57
« Totalitarisme » : les errements d’un concept
Enzo Traverso
Texte intégral (2760 mots)
Depuis plus d’un demi-siècle, les violences politiques sont comparées à l’aide du concept de totalitarisme, un des grands topos de l’histoire intellectuelle du XXe siècle1. Dans le cadre de la théorie et de la science politiques, qui s’occupent de la définition de la nature et des formes du pouvoir, en élaborant une typologie des régimes politiques, ce concept est aujourd’hui quasi unanimement accepté. Peu d’analystes oseraient contester l’émergence, au cours du XXe siècle, de systèmes de domination qui n’entrent pas dans les catégories traditionnelles – dictature, tyrannie, despotisme – élaborées par la pensée politique classique, depuis Aristote jusqu’à Weber. Par Enzo Traverso2.
Le Vent Se Lève vous convie à une conférence avec les historiens Johann Chapoutot et Sophie Wahnich le 26 avril à la Sorbonne, autour du thème « en finir avec le concept de totalitarisme » ? Cliquez ici pour réserver votre place.
La définition que Montesquieu fait du « despotisme » – un pouvoir absolu et arbitraire, sans loi, fondé sur la peur – s’adapte mal à ces régimes. Le XXe siècle a donné naissance à des pouvoirs caractérisés, selon la définition de Hannah Arendt, par une fusion inédite d’idéologie et de terreur, qui ont cherché à remodeler globalement la société par la violence. Dans le cadre de l’historiographie et de la sociologie politique, au contraire, l’idée de totalitarisme est loin de faire l’unanimité. Elle apparaît limitée, étroite, ambiguë, pour ne pas dire inutile si l’on veut saisir, au-delà des affinités superficielles des systèmes politiques « totalitaires », leur nature sociale, leur origine, leur genèse, leur dynamique globale, leurs aboutissements.
Selon sa définition classique – systématisée durant les années 1950 par Carl Friedrich et Zbigniew Brzezinski –, le totalitarisme suppose différents éléments corrélés et indissociables, également présents dans le nazisme et dans le communisme. Tout d’abord, la suppression de l’État de droit fondé sur la séparation des pouvoirs – donc la domination de l’exécutif – et l’élimination de la démocratie représentative, qui reconnaissent les libertés individuelles et collectives par une charte constitutionnelle. Deuxièmement, l’introduction de la censure et l’instauration du monopole étatique sur les moyens de communication afin d’imposer une idéologie officielle. Troisièmement, un parti unique dirigé par un chef charismatique, objet d’un culte presque religieux exercé par la masse de ses adeptes.
Les slogans sur les portails d’entrée des Goulags, visant à exalter le travail forcé, source « d’honneur et de gloire, de valeur et d’héroïsme », voire de « félicité », évoquent l’aphorisme célèbre d’Auschwitz : « le travail rend libre ». Mais l’analogie est trompeuse.
Quatrièmement, la violence comme forme de gouvernement, grâce à la mise en place d’un système concentrationnaire tendant à l’exclusion sinon à l’élimination des adversaires politiques et des groupes ou individus considérés comme étrangers à une communauté homogène sur les plans politique, national ou racial. Enfin, un fort interventionnisme étatique marqué par une planification autoritaire et centralisée de l’économie3.
Bien que l’on puisse facilement repérer l’ensemble de ces caractéristiques dans le nazisme et dans le communisme soviétique, force est de constater que cette définition est pour le moins statique et superficielle. Dans ses formes idéal-typiques, le totalitarisme est un modèle abstrait qui, souvent, correspond davantage aux fantaisies littéraires de George Orwell qu’au fonctionnement réel des régimes fascistes ou communistes. Un simple regard sur l’origine, l’évolution et le contenu social de ces régimes, révèle des différences très profondes quant à leur durée, leur idéologie et leur contenu social.
Leur durée : le nazisme a connu une radicalisation progressive pendant douze ans, jusqu’à sa chute finale ; l’URSS une succession d’étapes (révolutionnaire, autoritaire, totalitaire et post-totalitaire) étalées sur soixante-dix ans. Leur idéologie : le stalinisme revendiquait, radicalisait et caricaturait l’héritage des Lumières ; le nazisme créait une synthèse étonnante de scientisme et de Gegen-Aufklärung radicale. Leur contenu social : grâce à une révolution, le communisme a exproprié les anciennes élites dominantes et étatisé l’économie, alors que le régime hitlérien a préservé le système capitaliste. Bien qu’extrêmes l’une et l’autre, les violences totalitaires étaient aussi de natures différentes.
Celle du communisme soviétique a été essentiellement interne à la société qu’elle cherchait à soumettre, normaliser, discipliner, mais aussi à transformer et moderniser par des méthodes autoritaires, coercitives et criminelles. Les victimes du stalinisme ont presque toujours été des citoyens soviétiques. La violence du nazisme, au contraire, a été essentiellement projetée vers l’extérieur4. Après une première phase de « normalisation » répressive de la société allemande (Gleichschaltung), intense mais rapide, la violence nazie s’est déchaînée au cours de la guerre comme une vague de terreur rigoureusement codifiée.
Dirigée d’abord contre des groupes humains et sociaux exclus de la communauté du Volk (juifs, Tziganes, handicapés, homosexuels), elle s’est ensuite étendue aux populations slaves, aux prisonniers de guerre et aux déportés antifascistes (dont le traitement répondait à une hiérarchie raciale précise). Un analyste lucide comme Raymond Aron a clairement indiqué la différence entre le stalinisme et le nazisme : le premier a abouti au camp de travail, soit une forme de violence liée à un projet de transformation autoritaire de la société ; le second à la chambre à gaz, c’est-à-dire l’extermination comme finalité en soi, inscrite dans un dessein de purification raciale5.
Ils déployaient aussi deux modèles antinomiques de rationalité. D’une part, une rationalité des fins (moderniser la société) accompagnée par une irrationalité foncière des moyens employés (travail forcé, exploitation « militaro-féodale » de la paysannerie, etc.) ; d’autre part, une rationalité instrumentale poussée à l’extrême (l’extermination conçue selon les méthodes de la production industrielle) mise au service d’un but social complètement irrationnel (la domination du Volk germanique). Cette différence n’est pas marginale, mais elle échappe au concept de totalitarisme qui se limite à prendre en considération les analogies.
Dans les camps d’extermination nazis, les méthodes de production industrielle, les règles d’administration bureaucratique, la division du travail, les résultats de la science (le zyklon B) étaient utilisés dans le but d’éliminer un peuple considéré comme incompatible avec l’ordre « aryen ». Durant la guerre, la politique nazie d’extermination s’est révélée irrationnelle, même sur les plans économique et militaire, puisqu’elle a été réalisée grâce à la mobilisation de ressources humaines et de moyens matériels soustraits de fait à l’effort de guerre et en détruisant une partie de la force de travail présente dans les camps.
En URSS, en revanche, les déportés (zek) étaient « utilisés » et « consumés » par millions pour déboiser des régions, extraire des minerais, construire des voies ferrées et des lignes électriques, certaines fois pour créer de véritables centres urbains. Des procédés « barbares » et coercitifs, qui s’apparentaient souvent à des formes d’« extermination par le travail », étaient adoptés pour moderniser le pays et construire le socialisme. Selon Anne Applebaum, le paradoxe du stalinisme réside dans le fait que ce fut le Goulag qui « apporta la civilisation » en Sibérie. Pendant les années 1930, les camps soviétiques étaient devenus d’« authentiques colosses industriels » dans lesquels travaillaient deux millions de déportés6.
Dans l’Allemagne nazie, à l’opposé, les méthodes les plus avancées de la science, de la technique et de l’industrie étaient utilisées pour détruire des vies humaines7. Dans les KZ, à proprement parler, il ne s’agissait pas d’esclavage ayant une finalité économique, mais de « transformation du travail humain en travail de terreur », car « l’intensification du travail des détenus était uniquement un changement de degré dans la terreur »8. Dans le cas des camps d’extermination, la seule structure « productive » était celle du meurtre sérialisé.
Comme l’a montré Sonia Combe en comparant Serguiej Evstignev, le chef d’Ozerlag, un Goulag sibérien sur les rives du lac Baïkal, et Rudolf Hoess, le plus connu des commandants d’Auschwitz, leur travail n’était pas le même. Le premier devait « rééduquer » les détenus et, avant tout, construire une voie ferrée : la « trace ». À Ozerlag, la mort était la conséquence du climat et du travail forcé.
Hoess, quant à lui, calculait le « rendement » d’Auschwitz-Birkenau en tenant la comptabilité des juifs tués dans les chambres à gaz. Cela explique aussi la différence considérable entre les taux de mortalité de ces deux systèmes : dans le Goulag, il n’a jamais dépassé 20 %, en dépit du caractère massif de la déportation (18 millions de citoyens soviétiques entre 1929 et 1953), tandis que, dans les camps de concentration nazis, il était de 60 % et, dans les camps d’extermination, il était supérieur à 90 % (la plupart des rescapés sont revenus d’Auschwitz, qui était à la fois un camp de concentration et d’extermination)9.
Les slogans inscrits sur les portails d’entrée des Goulags, visant à exalter le travail forcé, source « d’honneur et de gloire, de valeur et d’héroïsme », sinon de « félicité » ou de « liberté », évoquent irrésistiblement l’aphorisme célèbre qui accueillait les déportés à Auschwitz : « le travail rend libre » (Arbeitmachtfrei), mais il s’agissait d’une analogie trompeuse. Dans leur grande majorité, les juifs déportés n’ont pas connu l’univers concentrationnaire, car ils ont été tués le jour même de leur arrivée aux camps grâce à un système d’extermination industrialisée fonctionnant comme une chaîne de production : évacuation des convois, sélection, confiscation des biens, spoliation, gazage, incinération.
Tout cela explique la grande méfiance que le concept de totalitarisme suscite au sein de l’histoire sociale. Les chercheurs qui ont essayé de comprendre le comportement d’une société au-delà de sa façade totalitaire ont été obligés d’aller outre les ressemblances extérieures entre communisme et nazisme. Bien qu’il n’ait pas toujours rejeté la notion de totalitarisme, ce travail d’analyse comparative l’a tout au moins problématisée, en indiquant ses limites10.
Notes :
1 Pour une synthèse, cf. Enzo Traverso (dir.), LeTotalitarisme. Le XXe siècle en débat, Seuil, Paris, 2001 ; Abbott Gleason, Totalitarianism. The Inner History of the Cold War, Oxford University Press, New York, 1995 ; et Wolfgang Wippermann, Totalitarismustheorien, Primus Verlag, Darmstadt, 1997.
2 Article issu de Enzo Traverso, L’histoire comme champ de bataille, Paris, la Découverte, 2012, publié sur LVSL avec l’autorisation de la maison d’édition et de l’auteur.
3 Carl Friedrich et Zbigniew Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy, Harvard University Press, Cambridge, 1956.
4 Cf. Ulrich Herbert, « Nazismo e stalinismo. Possibilità e limiti di un confronto », in Marcello FLORES (dir.), Nazismo, fascismo, comunismo. Totalitarismi a confronto, Bruno Mondadori, Milan, 1998, p. 37-66.
5 Raymond Aron, Démocratie et Totalitarisme, Gallimard, « Folio », Paris, 1965, p. 298-299, p. 61. Voir aussi, pour une comparaison entre les taux de mortalité des deux systèmes, Philippe Burrin, « Hitler et Stalin », Fascisme, nazisme, autoritarisme, Seuil, Paris 2000, p. 83, et Joël Kotek, Pierre Rigoulot, Il secolo dei campi. Concentramento, detenzione, sterminio : la tragedia del Novecento, Mondadori, Milan, 2001, p. 333-335.
6 Anne Applebaum, Gulag. A History, Doubleday, New York, 2003, ch. 5 [Goulag, Seuil, 2004].
7 Wolfgang Sofsky, L’Organisation de la terreur, Calmann-Lévy, Paris, 1995, p. 214.
8 Voir Sonia Combe, « Evstignev, roi d’Ozerlag », Ozerlag 1937-1964, Autrement, Paris, 1991, p. 214-227.
9 Cf. Anne Applebaum, Gulag, op. cit., p. 578-586. Voir aussi Nicolas WERTH, « Un État contre son peuple », in Stéphane Courtois (éd.), Le Livre noir du communisme. Crimes, terreur, répression, Robert Laffont, Paris, 1997, où il souligne la fonction productive essentielle des camps soviétiques, en ajoutant que « l’entrée au camp ne signifiait pas, en règle générale, un billet sans retour » (p. 228-229). Sur le taux de mortalité des KZ nazis, cf. Wolfgang Sofsky, L’Organisation de la terreur, op. cit., p. 61. Voir aussi, pour une comparaison entre les taux de mortalité des deux systèmes, Philippe Burrin, « Hitler et Stalin », Fascisme, nazisme, autoritarisme, Seuil, Paris 2000, p. 83, et Joël Kotek, Pierre Rigoulot, Il secolo dei campi. Concentramento, detenzione, sterminio : la tragedia del Novecento, Mondadori, Milan, 2001, p. 333-335.
10 Cf. Ian Kershaw, « Retour sur le totalitarisme. Le nazisme et le stalinisme dans une perspective comparative », in Enzo Traverso (dir.), Le Totalitarisme, op. cit., p. 845-871.
- GÉNÉRALISTES
- Basta
- Blast
- L'Autre Quotidien
- Alternatives Eco.
- La Croix
- Euronews
- Le Figaro
- France 24
- FTVI
- HuffPost
- L'Humanité
- LCP
- Le Media
- Le Monde
- Libération
- Mediapart
- La Tribune
- EUROPE
- Courrier Europe Centle
- Euractiv
- Toute l'Europe
- INTERNATIONAL
- Equaltimes
- CADTM
- Courrier International
- Global Voices
- Info Asie
- Inkyfada
- I.R.I.S
- Jeune Afrique
- Kurdistan au féminin
- N-Y Times
- Orient XXI
- Of AFP
- Rojava I.C
- OSINT / INVESTIGATION
- OFF Investigation
- OpenFacto°
- Bellingcat
- Disclose
- G.I.J.N
- MÉDIAS D'OPINION
- AOC
- Au Poste
- Cause Commune
- CrimethInc.
- Issues
- Les Jours
- Le Monde Moderne
- LVSL
- Marianne
- Médias Libres
- Quartier Général
- Rapports de force
- Reflets
- Rézo
- StreetPress
- OBSERVATOIRES
- Armements
- Acrimed
- Catastrophes naturelles
- Conspis
- Culture
- Extrême-droite
- Human Rights
- Inégalités
- Information
- Internet actu ✝
- Justice fiscale
- Liberté de création
- Multinationales
- Situationnisme
- Sondages
- Street-Médics
- Routes de la Soie
- Vrai ou Fake ?