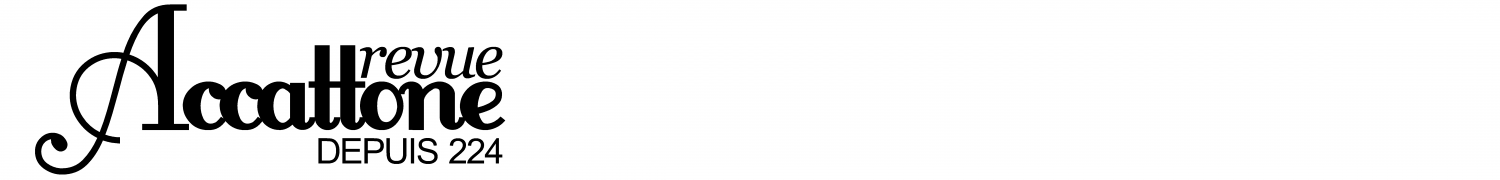13.12.2021 à 16:52
La valeur du Patriarche et la signification de l’État
Fabrizio Tribuzio-Bugatti

Texte intégral (2683 mots)

L’Automne du patriarche de Gabriel Garcia Marquez, plus connu pour Cent ans de solitude, est peut-être la quintessence de cette spécificité littéraire latino-américaine qu’est le roman du dictateur. Puisant dans les réalismes magiques et merveilleux qui caractérisent cette littérature, il use lui aussi de l’ambivalence entre ce qui relève ou non du réel et du surnaturel, du visible et de l’invisible, sans que la nature objective de ce qui serait merveilleux ou non ne soit problématique contrairement au fantastique. Dans le roman du dictateur, ce n’est pas tant la dictature que l’homme qui l’incarne qui est paré d’atours merveilleux, et c’est surtout vrai dans L’automne du patriarche. Dictateur des milliers d’années, qui a été, est et sera toujours là, le patriarche « entre 107 et 232 ans » semble être le firmament immobile qui recouvre sa patrie. Il n’est cependant pas un dictateur au sens exact du terme, ni décrit comme un authentique tyran par Marquez ; à la rigueur un despote au sens grec du terme, c’est-à-dire maître de maison, qui règne en père de famille à défaut d’avancer « en bon père de famille » comme la formule consacrée le veut. Néanmoins, le roman de Marquez est riche en enseignements sur la pratique du pouvoir, parce qu’il met en scène ses corollaires essentiels que sont la légitimité, la légalité, les notions de puissance et d’autorité. À la lecture, nous nous rendons compte qu’il n’est pas possible de qualifier le patriarche de dictateur, de tyran ou de despote véritable parce qu’il n’a pas de potestas, mais seulement l’auctoritas, pour reprendre des notions romaines. Dit autrement, il possède l’autorité, une autorité qui lui est propre, consubstantielle, en tant que patriarche justement, mais il n’a pas la puissance ; il ne légifère pas, gouverne avec un conseil des ministres et doit s’en accommoder, du moins jusqu’à un certain point.
C’est d’ailleurs par la légitimité du patriarche que l’analyse de son pouvoir pourrait être la plus judicieuse. Le roman nous le présente comme éternel, c’est-à-dire présent depuis toujours, comme hors du temps. La narration de Marquez accentue volontiers cette temporalité élastique du fait qu’il démarre son récit par la mort du patriarche en rendant les personnages découvrant son corps incapables de le reconnaître, « eût-il même été épargné par les charognards, étant donné qu’aucun d’entre nous ne l’avait jamais vu, et bien que son profil figurât sur l’avers et le revers des monnaies, les timbres-poste, les étiquettes des dépuratifs, les bandages herniaires et les scapulaires, […] nous n’ignorions pas que c’étaient là des copies de copies de portraits jugés déjà infidèles au temps de la comète, quand nos parents savaient qui il était pour avoir entendu leurs parents le leur raconter, comme précédemment les parents de leurs parents l’avaient raconté à leurs parents ». Nul ne semble donc se souvenir comment il a accédé au pouvoir, ni comment il s’y maintient indéfiniment. Pour réutiliser du vocabulaire latin, il semble faire l’objet d’une superstitio : « harcelé par une foule de lépreux, d’aveugles et de paralytiques qui le suppliaient de recevoir de ses mains le sel de la santé, et par des politiciens lettrés et des adulateurs sans vergogne qui le proclamaient grand chef des tremblements de terre, des éclipses, des années bissextiles et autres bévues de Dieu ». Si la légitimité répond à un système de croyance auquel il faut se conformer ou à une idée de justesse, aucun de ces critères ne semble être satisfait dans L’Automne du patriarche. La seule légitimité qui est connue, c’est celle qui découle de l’immuabilité même du patriarche, l’habitude, voire la résignation, des citoyens à le croire éternel. Marquez a peut-être, sans le vouloir ou sans le savoir, mis en exergue la notion d’auctoritas à travers son patriarche. Ce dernier tire sa légitimité non pas de la légalité, mais de son autorité, laquelle lui est reconnue non pas parce qu’il occupe un titre ou une fonction – qui ne fait qu’incidemment coïncider avec sa personne – mais justement parce qu’il est le patriarche. C’est en quelque sorte son double corps du roi. Cependant, il faut garder en mémoire que l’auctoritas est plus une fiction politique que juridique, elle n’a pas de définition arrêtée en droit et est toujours définie par ses composantes, ses effets ou ses pratiques mais jamais pour elle-même. Elle n’est pas une simple magistrature, comme nous l’avons dit ; le patriarche en dispose parce qu’elle lui est propre, donc unique et indivis. Il n’occupe pas tant une fonction qu’il se contente d’être lui-même, et c’est de cette immanence que procède l’auctoritas, au même titre par exemple que le Duce et le Führer ne pouvaient être d’autres personnes qu’elles-mêmes. Dans L’Automne du patriarche, l’État n’est ni une féodalité, ni la République romaine. Le patriarche dispose toutefois lui aussi d’un corps visible et d’un corps invisible que lui confèrent respectivement sa magistrature de chef d’État et son auctoritas, double corps qui est renforcé par le réalisme merveilleux de l’œuvre et du style employé par Marquez. Outre la superstitio dont il fait l’objet, son auctoritas le voile d’une aura mystique, au sens romain de religio. À défaut cependant de convoquer les auspices, il sait interpréter les augures : « une telle tranquillité s’effondra soudain dans le gallodrome d’un trou perdu alors qu’un coq assassin arrachait la tête de son adversaire et la dévorait à coups de bec devant un public grisé par le sang et une fanfare d’ivrognes qui célébraient l’horreur par des airs de fête, il fut le seul à surprendre le mauvais augure, il le sentit si claire et si imminent qu’il ordonna secrètement à son escorte d’arrêter l’un des musiciens, celui-là, celui qui joue du bombardon, en effet, on découvrit sur l’autre un fusil au canon limé et il avoua sous la torture qu’il pensait l’utiliser dans le remue-ménage de la sortie » ; est maître du temps ou tout comme : « retardez l’horloge, qu’elle ne sonne pas midi à midi mais à deux heures pour que la vie paraisse plus longue ». Marquez a subtilement mêlé superstitio et religio. Le folklore qui entoure le patriarche lui donne des allures magiques, mais outre cette dimension merveilleuse, il mène la vie auguste : ce qui relève du domaine privé et du domaine public se confondent. Le palais présidentiel en est la représentation parfaite, parce qu’il « ressemblait moins à une maison présidentielle qu’à un marché où il fallait se frayer un chemin parmi des ordonnances aux pieds nus qui déchargeaient des couffins de légumes et des cageots de volaille dans les couloirs en sautant par-dessus des commères avec leur enfants faméliques qui dormaient pelotonnées sur les marches dans l’attente du miracle de la charité officielle, il fallait éviter les eaux sales des concubines qui remplaçaient dans les vases les fleurs de la nuit par des fleurs du jour […], tout cela mêlé au chambard des fonctionnaires à vie qui trouvaient des poules en train de pondre dans les tiroirs de leurs bureaux, et au trafic des putains et des soldats dans les cabinets, au vacarme des oiseaux, aux bagarres des chiens errants au milieu des audiences, personne ne sachant qui était qui ni qui venait de la part de qui dans ce palais aux portes grandes ouvertes dont le désordre fantastique empêchait d’établir où était le gouvernement. » Tout bien, même numéraire, qui lui serait propre appartient en réalité à sa mère, mais cette dernière n’est pas totalement épargnée par la confusion entre ce qui est public et privé. Elle bénéficie des privilèges induits par son rapport maternel au patriarche sans même en avoir conscience, poursuivant sa vie de prolétaire malgré le personnel de maison à sa disposition.
Lors de la tentative de coup d’État, il apparaît au lecteur que le patriarche n’est pas le seul à commander, et donc qu’il ne détient pas la potestas, c’est-à-dire la puissance de légiférer ou de juger. Il doit collaborer avec un conseil ministériel qu’il surprend après l’échec de l’assassinat contre lui, « et vit, à travers la fumée, qu’il y avait là tous ceux qu’il avait voulu qu’il y eût, les libéraux qui avaient vendu la guerre fédérale, les conservateurs qui l’avaient achetée, les généraux du haut commandement, trois de ses ministres, l’archevêque primat et l’ambassadeur Shnontner, tous groupés pour le même leurre, invoquant l’union de tous contre le despotisme séculaire afin de se partager entre tous le butin de sa mort. » Ils sont présentés par Marquez comme suffisamment puissants pour empêcher le patriarche de gouverner comme le ferait un dictateur ou un tyran, laissant bel et bien entrevoir la distinction entre auctoritas et potestas. En les éliminant, il fait non seulement ressortir la pureté de la première, qui à la source de sa légitimité, contre la dimension légale de la potestas mais surtout la capacité de l’auctoritas à suspendre la potestas en cas d’état d’exception, bref, « est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle. » Preuve en est de la réaction desdits conseillers et autres politiciens lors de sa réapparition miraculeuse : « personne ne remarqua l’apparition du président sans sépulture lequel frappa un seul coup sur la table la paume de la main et cria ah ah et qui n’eut rien d’autre à faire car lorsqu’il releva la main la panique les avait déjà volatilisés. » À l’image d’Auguste, le patriarche était jusqu’à ce moment-là le primes inter pares, il l’emporte sur eux par l’auctoritas mais pas par la potestas à l’image du princeps : Post id tempus auctoritate omnibus praestiti, potestatis autem nihilo amplius habui quam ceteri qui mihi quoque in magistratu conlegae fuerunt (« À partir de ce moment, je l’ai emporté sur tous par l’auctoritas ; en revanche, je n’ai aucunement eu plus de potestas que tous ceux qui ont été mes collègues dans chaque magistrature »).
L’État est-il alors toujours l’État lorsque le patriarche élimine tous ses opposants ? Si, comme le disait Carl Schmitt, « L’homme politique d’envergure ne peut pas être contredit par une théorie, pas plus que cette dernière ne peut être prise en défaut par la portée, aussi importante soit-elle, de sa politique », le patriarche infirme ici l’idée d’une « harmonie préétablie et la coïncidence présumée entre droit et loi, justice et légalité, matière et procédure ». Il ne réduit pas l’État, mais refuse la réduction de l’État à la simple activité normative. L’auctoritas qu’il incarne lui permet de suspendre la potestas ou, autrement dit, l’État suspend le droit pour se conserver lui-même et, comme le souligne Agamben dans L’état d’exception, l’auctoritas est ce qui reste du droit lorsque le droit est suspendu. Cette suspension qui entraîne véritablement la dictature est symbolisée dans le roman par la saillie du patriarche tandis que les conjurés sont éliminés : « on a fini de s’emmerder, désormais, je vais commander seul ». En ajoutant « il faudra voir demain matin dès la première heure ce qui sert et ce qui ne sert pas dans ce chambardement », l’auctoritas est d’autant plus valorisée qu’ici est mise en exergue sa capacité de réactiver une potestas en sus de la suspendre lorsqu’est décidée la situation exceptionnelle : « je ne nomme plus de ministère, nom d’un bordel, rien qu’un bon ministre de la Santé, la seule chose qui soit nécessaire dans la vie ». Le patriarche abolit donc l’opposition aristotélicienne entre la délibération et l’exécution, entrant dans la définition que donne Machiavel de la dictature : « délibérer pour soi-même » et « faire toute chose sans aucune consultation ».
09.12.2021 à 16:55
Les Morticoles, ou la comédie hypocondriaque
Fabrizio Tribuzio-Bugatti

Texte intégral (1121 mots)

Léon Daudet fait peut-être partie de ces auteurs dont il serait de mauvais goût de s’intéresser aujourd’hui. Ardent polémiste membre de l’Action Française et duelliste, sa physionomie bonhomme ne donnait pas l’impression d’une personnalité aussi passionnée et peut-être exubérante du fils d’Alphonse Daudet. Pourtant, Les Morticoles est la seule œuvre de Léon Daudet continuellement rééditée depuis sa première publication en 1894. Écrite avant son engagement royaliste, l’écrivain est encore républicain à cette époque, quoi que plus modérément que le jour où il huait le général Boulanger.
La rédaction de cet ouvrage fut notamment motivé par la perte de son père, que Léon Daudet pensait liée à la déficience empathique du médecin de famille, pour lequel Alphonse Daudet relevait plus du spécimen médical qu’il fallait soigner à grands renforts de traitements aussi douteux que douloureux. Ce mépris affiché pour la vie humaine au profit d’une approche mécaniste de la vie alimente chez Léon Daudet un autre mépris, dont le roman fera office d’exutoire. Véritable dystopie où le lecteur suit l’errance d’un navire qui se retrouve près des côtes de l’île fictive des Morticoles, récupéré par une équipée qui brûle tous ses vêtements, lesquels sont substitués par des combinaisons à la texture étrange avant une mise en quarantaine. Le lecteur suit Félix Canelon, jeune homme de 17 ans qui s’était embarqué pour découvrir le monde. C’est par son biais que nous aurons un panorama complet de la société morticole, et par la même occasion le talent de Léon Daudet en tant qu’écrivain d’un genre de ce qui n’est pas encore appelé la Science-Fiction. Si sa définition peut être empruntée à Friedrich Jünger comme « le possible qui émerge dans le présent », Les Morticoles de Léon Daudet a pris une tournure des plus singulière depuis le début de la pandémie de Covid-19.
L’île des Morticoles n’est pas une démocratie, mais un régime hygiéniste où les médecins ont les pleins pouvoirs. Cette plénipotence est liée chez Daudet à l’évacuation de toute mystique, qu’elle soit politique comme religieuse. Les Morticoles ne croient en rien, sauf en leur nihilisme qui serait l’assurance de leur liberté : « Nous sommes des hommes libres ; nous ne croyons en aucun dieu. » Toute cette société se rabat donc sur la médecine et ses acteurs. Les riches bénéficient des traitements expérimentés sur les pauvres mais, plus avant, toute cette population est malade. Là où un individu normal voit en son compatriote un citoyen, le médecin ne voit que des patients. Tandis que le premier est responsable de lui-même, le second s’en remet toujours à un tiers pour son plus grand bien. De là une vision pervertie de la vie de la cité, puisque les médecins ne voient que des patients, il leur est impossible de les percevoir comme des individus responsables. « Hors nous, tout le monde est malade. Ceux qui le nient sont des simulateurs que nous traitons sévèrement, car ils constituent un danger public ». Comment telle chose est-elle rendue possible ? Tout simplement parce que « Les Morticoles sont des sortes de maniaques et d’hypocondriaques qui ont donné aux docteurs une absolue prééminence ».
Quelle différence entre cette île d’hypocondriaques et la France du XXIe siècle ? Notre pays est le premier consommateur d’antidépresseurs et panique devant un virus qui frappe une portion infinitésimale de la population. Le talent de Léon Daudet dans cette oeuvre est d’avoir confronté la sauvegarde biologique de la vie à la qualité de la vie, ou en des termes plus savants le bios à la zoé chez les Grecs. Léon Daudet adorerait sans doute — dans un cynisme exacerbé — voir la Morticolie s’insinuer en bas de chez nous, nous qui devons rédiger des attestations adressées à nous-mêmes pour sortir masqués parce que chez nous aussi, depuis un an, « La police est médicale, l’édilité aussi, aussi l’université, l’ensemble des pouvoirs publics, le gouvernement. » La faiblesse du citoyen, névrosé qui a peur de tout, délègue toute responsabilité à un être tout puissant qui prétendra s’occuper de lui. Cet être n’étant pas Dieu, voici notre patient tourmenté par celui qui prétend le soigner d’une maladie dont la gravité est accessoire, seule compte la prééminence du médecin, mandarin qui s’impose par son sabir latinisant auquel le quidam ne comprend rien mais se sent impressionné. Abandonnant son esprit critique, le citoyen se laisse maltraiter pourvu qu’il soit materner. Voilà donc la résultante de cette affaire : « le peuple est de malades, riches ou pauvres, de détraqués, de déments. Nous laissons circuler ceux dont l’affection ne présente nul danger. Quant aux autres, nous les cloîtrons dans des hôpitaux, hospices maisons de retraite et les étudions là à loisir. » Les moyens de l’État sont mis à contribution d’une hégémonie hygiéniste plus que sanitaire voulue par cette forme incongrue de biopolitique. La tyrannie en blouse blanche peut à loisir mettre à l’Index tout propos contraire au sien au nom de sa prétendue supériorité intellectuelle afin d’asseoir une vision du bonheur se trouverait dans une seringue.
06.12.2021 à 16:55
Cervantès, le goût de la poudre et des lettres
mathieulavarenne

Texte intégral (2398 mots)

Publié en deux parties en 1605 puis en 1615, le Don Quichotte de la Manche de Miguel de Cervantès est l’un des plus grands romans modernes. Milan Kundera le considère même comme l’acte de naissance de la modernité en littérature au même titre que le Discours de la méthode de René Descartes en philosophie.
Longtemps considéré comme un personnage purement burlesque, Don Quichotte n’est que récemment devenu une figure positive d’engagement, de courage héroïque ou de sincérité politique, au point que le sous-commandant Marcos, charismatique chef de file de la rébellion zapatiste au Mexique, en fait « le plus grand livre politique jamais écrit ». Quant à de Gaulle, voici ce qu’il confie à Malraux dans Les chênes qu’on abat, en un mélange d’humour et de sérieux : « Pourquoi les Espagnols ne m’aimeraient-ils pas ? Ils aiment Don Quichotte ». À travers cette identification au second degré, le Général laisse entendre combien son pragmatisme politique se teintait d’idéalisme, voire d’un certain mysticisme de la France, impossible à ranger dans la catégorie de la seule Realpolitik et de son cynisme opportuniste.
Le personnage de Don Quichotte est devenu une figure incontournable, comme un repère conceptuel auquel s’identifier ou tout au moins se comparer. Omniprésente dans la conscience populaire, l’œuvre est toutefois souvent méconnue de façon proportionnellement inverse à la notoriété de son titre et du nom de son héros, associé à celui de Sancho Panza son fidèle écuyer.
Comment l’hidalgo Alonso est-il devenu le chevalier Don Quichotte (et vice-versa) ? Comment le bachelier Carrasco se transforme-t-il en un chevalier aux miroirs, figure inversée du chevalier à la Triste Figure, afin d’aller le chercher à l’intérieur même de son monde, sorte de doublure idéologique du monde réel ? D’ailleurs, la frontière entre ledit réel et la fiction n’est pas si claire, Cervantès démultipliant lui-même les niveaux de lecture de son œuvre par une ingénierie littéraire fascinante. La raison et la folie peuvent-elles devenir complices ? Héros ou anti-héros, de quoi Don Quichotte est-il le nom ?
La joyeuse farce du « chevalier à la Triste Figure » est bien plus complexe et plus profonde qu’on peut le penser au premier abord, si l’on se contente d’une vague connaissance du bref épisode des moulins à vent rendu célèbre par l’iconographie. Ses figures sont multiples. À l’image de son auteur, dont la vie n’a jamais été un long fleuve tranquille et qui, à travers la littérature, avec à la fois une mordante ironie et un sens aigu de la nuance, produit une subtile philosophie de l’action.
UN HOMME D’ACTION
Miguel de Cervantès Saavedra (1547-1616) n’était pas un écrivain professionnel, dénomination qui n’avait d’ailleurs aucun sens en son temps, où un tel statut n’existait pas. Dès sa jeunesse, il s’est certes pris d’amour pour le théâtre et frotté à l’écriture – quelques poèmes de ses 20 ans ont traversé les âges –, mais ce n’est qu’anachroniquement et de façon posthume qu’il est devenu romancier, poète et dramaturge au sens où nous l’entendons aujourd’hui, en tant que principal représentant du Siècle d’Or espagnol, rangeant ainsi le père de Don Quichotte dans une de ces boîtes à idées pédagogiques qui séquencent, plus ou moins arbitrairement, et néanmoins utilement, l’histoire littéraire de l’humanité. Que Cervantès ait atteint le niveau universitaire durant sa formation, rien n’est moins sûr, mais celle-ci s’est surtout façonnée en plein air, incessamment enrichie par un esprit curieux de tout. Homme d’action plutôt que souris de bibliothèque, il était une intelligence en marche, très prosaïquement en quête d’aventures, comme le sera, mais d’une autre façon, son héros errant, dont on ne pourra faire si facilement son double littéraire. Afin d’y voir plus clair, commençons par suivre Cervantès lui-même dans ses pérégrinations on ne peut plus terrestres. Fuyant peut-être la justice espagnole suite à un duel qui aurait mal tourné, après avoir vécu à Cordoue, Séville puis Madrid, le jeune homme prend le chemin de l’Italie, où il vivra notamment à Rome et à Naples à une époque d’apogée culturelle pour ces colossales capitales de la Renaissance humaniste. Il décide alors d’embrasser la carrière des armes, engagé volontaire dans une compagnie militaire entre 1570 et 1574. Cervantès n’a pas été soldat par défaut.
Le 7 octobre 1571, le jeune soldat se retrouve notamment en prise avec la « bataille prodigieuse » de Lépante, au large du Péloponnèse — où la Sainte-Ligue, dominée par la puissante République maritime de Venise, marque un coup d’arrêt à l’expansionnisme ottoman du « Grand Turc » qui étendait alors ses rets jusqu’au Maghreb. Suite à cette bataille navale hors-norme que l’on compare parfois à la bataille d’Actium (en 31 avant notre ère, non loin de là, et qui voit la fin des guerres civiles romaines), Cervantès hérite d’un surnom qui le suivra durant toute sa vie : celui de « manchot de Lépante ». Blessé par trois coups d’arquebuse, deux à la poitrine, un autre à la main gauche, il perdra définitivement l’usage de cette dernière mais restera fier d’avoir subi ce stigmate au combat pour ce qu’il considérait comme une noble cause ayant pesé sur le destin de l’Europe, plutôt que de s’être bêtement estropié dans une stupide rixe de bistrot. Il ira jusqu’à affirmer que, s’il avait le choix, il préférerait perdre une nouvelle fois sa main plutôt que de ne pas participer à cette grande bataille (prologue du tome 1, dans la traduction d’Aline Schulman – 1997). Malgré son irrémédiable handicap, il retournera sous les drapeaux après une longue convalescence de plusieurs mois.
D’ESCLAVE À ALGER À LA CASE « PRISON »
En 1575, alors qu’il est sur le chemin du retour pour l’Espagne, son navire est arraisonné par des corsaires commandés par l’amiral de la flotte ottomane d’Afrique du Nord. Tout comme son frère Rodrigo, Miguel est fait prisonnier et emmené à Alger, connue alors comme la ville de la piraterie. Le hasard fait qu’il a sur lui une lettre de recommandation, ce qui le désigne comme captif de valeur, laissant espérer à ses ravisseurs une forte rançon. Cela lui épargnera probablement la torture, mais prolongera néanmoins sa captivité du fait des difficultés à rassembler la conséquente somme d’argent exigée. Malgré quatre tentatives d’évasion, dont il semble avoir toujours été la tête pensante, mais qui ont toutes achoppé du fait soit de l’imprudence, soit de la couardise, soit de la trahison d’un autre protagoniste de l’opération, Cervantès demeure ainsi en esclavage cinq années durant, accomplissant travaux de terrassement ou de jardinage pour de puissants Ottomans.
À partir de 1580, l’ancien soldat changera plusieurs fois de métier, exerçant alors les fonctions de commissaire aux vivres, de collecteur d’impôts, d’affairiste ou encore de camérier du pape (sorte de domestique attitré et à tout faire). Accusé à plusieurs reprises d’avoir détourné de la marchandise ou des fonds, mais ayant toujours nié ce qui lui était reproché, il se retrouve pas moins de quatre fois emprisonné.
La fertilité créatrice de la prison et de sa mélancolie solitaire est de notoriété publique, nombre d’œuvres littéraires ayant germé derrière les barreaux d’un cachot. Dans son Prologue, Cervantès présente ainsi son Don Quichotte comme « l’histoire d’un homme sec, rabougri, fantasque, plein d’étranges pensées que nul autre n’avait eues avant lui […], comme peut l’être ce qui a été engendré dans une prison, séjour les plus incommodes, où tout triste bruit a sa demeure ». On saisit ainsi combien l’œuvre cervantine exhale tout autant sinon plus l’odeur de la poudre à canon que celle du plomb de l’imprimerie.
LE BRAS ET L’ESPRIT
Ce n’est pas un hasard si l’une des plus célèbres citations de Cicéron fera mouche dans l’esprit de Cervantès : « cedant arma togae concedat laurea linguae », les armes cèdent à la toge, les lauriers [du général victorieux] à l’éloquence ; fameuse formule du consul-philosophe qui dut affronter la conjuration de Catilina, projet de coup d’État militaire contre la res publica, que Cicéron déjoua, secondé par la redoutée puissance de son art oratoire. Cette formule métaphorique, l’orateur romain la commentera notamment dans son plaidoyer Contre Pison : « Je n’ai pas dit « ma » toge, celle dont je suis revêtu, ni entendu par le mot d’armes le bouclier et l’épée d’un seul général, mais, parce que la toge est le symbole de la paix et du calme, les armes, au contraire, celui des troubles et de la guerre, j’ai voulu faire entendre, à la manière des poètes, que la guerre et les troubles doivent s’effacer devant la paix et le calme ». Remettant en cause la prédominance des seigneurs de la guerre dans la vie publique à Rome, tels César ou Pompée, Cicéron proposait de célébrer les victoires politiques de l’éloquence au même titre, sinon davantage, que les faits d’armes des stratèges militaires, à travers la pragmatique réconciliation de la philosophie et de la rhétorique. En écho assurément cicéronien, Cervantès met ainsi dans la bouche de son Don Quichotte : « Qu’on ne vienne pas dire devant moi que les lettres l’emportent sur les armes » parce que les « armes font appel à l’esprit tout autant que les lettres » (T. 1, chap. 37-38).
En effet, « l’homme de lettres » comme « l’homme de guerre » font tous deux travailler leur esprit, précise Cervantès qui, étant les deux, ressentait manifestement le besoin de contrebalancer les propos de Cicéron dans le sens d’une revalorisation intellectuelle du métier des armes. Plus tard, lorsque le personnage du Duc nommera l’écuyer Sancho gouverneur d’une illusoire île, il le préparera à assumer cette fonction : « vous serez vêtu à moitié en lettré, à moitié en capitaine car, dans cet archipel que je vous donne, on a autant besoin des lettres que des armes, et autant des armes que des lettres » (T. 2, chap. 32). Très probablement, les personnages cervantins se faisaient-il ici les porte-paroles de leur créateur. Une de ses nouvelles publiées en 1613, Le licencié de verre, voit son héros, un ancien fou ayant pourtant recouvré la raison mais encagé par l’opinion publique dans son précédent état de folie, faire le choix de l’engagement militaire afin de « tirer parti de la valeur de son bras, puisqu’il ne le pouvait plus de celle de son esprit », ainsi stérilisé par les préjugés, et « d’immortaliser par les armes une vie qu’il avait commencé par immortaliser par les lettres ». Ledit licencié laissera « à sa mort, le souvenir d’un soldat très avisé et très brave », figure inversée de Cervantès qui, ayant débuté par les armes, rêvera ultérieurement de s’immortaliser par les lettres.
Cervantès a beaucoup voyagé dans l’Europe de la renaissance et dans le pourtour méditerranéen. « Personne dans la littérature espagnole n’a avalé autant de kilomètres que lui, traversé autant de villages, ni si souvent dormi à la belle étoile », explique l’écrivain Andrés Trapiello, dans la biographie qu’il lui a consacrée, Les vies de Cervantès (1993) : « en lisant ses livres, nous avons la certitude qu’il a posé les pieds, quand ce n’était pas son âme, sur chaque centimètre carré dont il parle » (p. 161). C’est cette générosité cervantine tournée vers l’aventure, contre la résignation petite-bourgeoise, que le grand admirateur de Don Quichotte qu’était Jacques Brel trouvait si formidable : « Les gens prudents, les gens précautionneux ont plus d’avenir que de présent », disait-il lors d’une interview de 1968, « ils sont assis et ils se croient debout, c’est effrayant, cela me glace le sang » (documentaire Jacques Brel : Don Quichotte, sur le site de l’INA, 1968). Le Don Quichotte est une aventure, une aventure littéraire certes, mais à laquelle son auteur a donné l’épaisseur de la vie, parce qu’il faisait de sa propre vie un roman.
Mathieu Lavarenne.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Time [Fr]
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- L'Autre Quotidien
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- Gauche.Media
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview