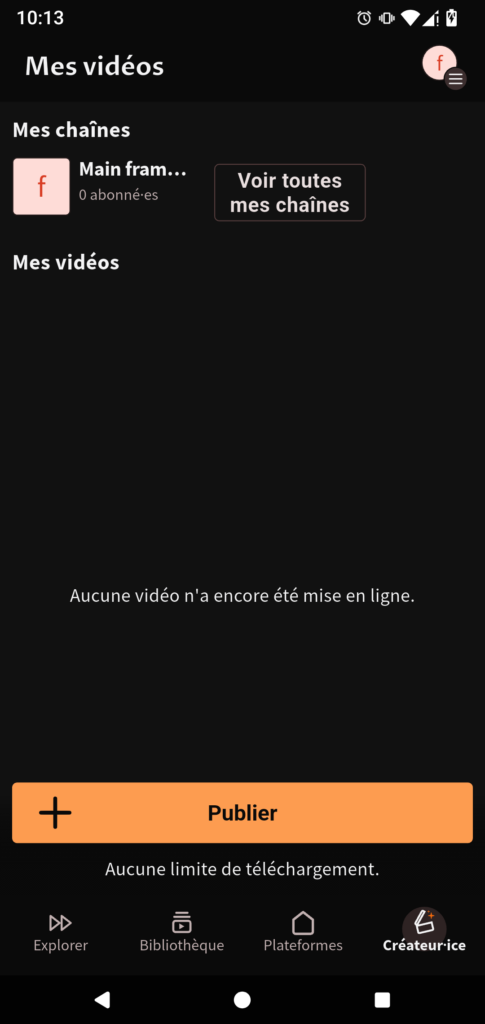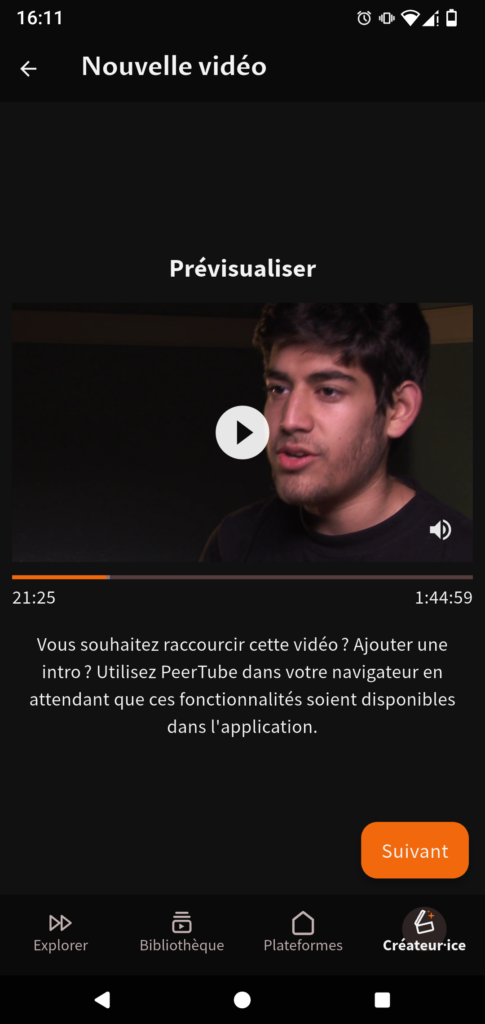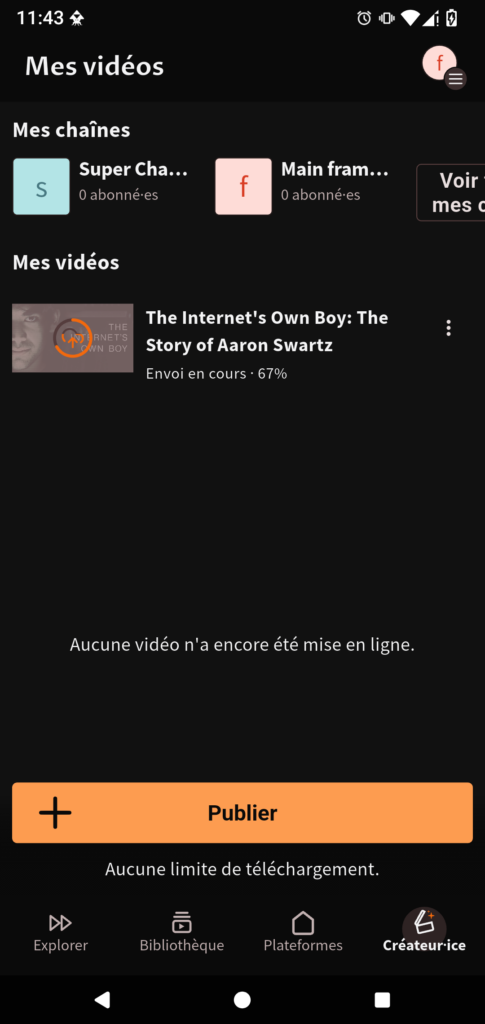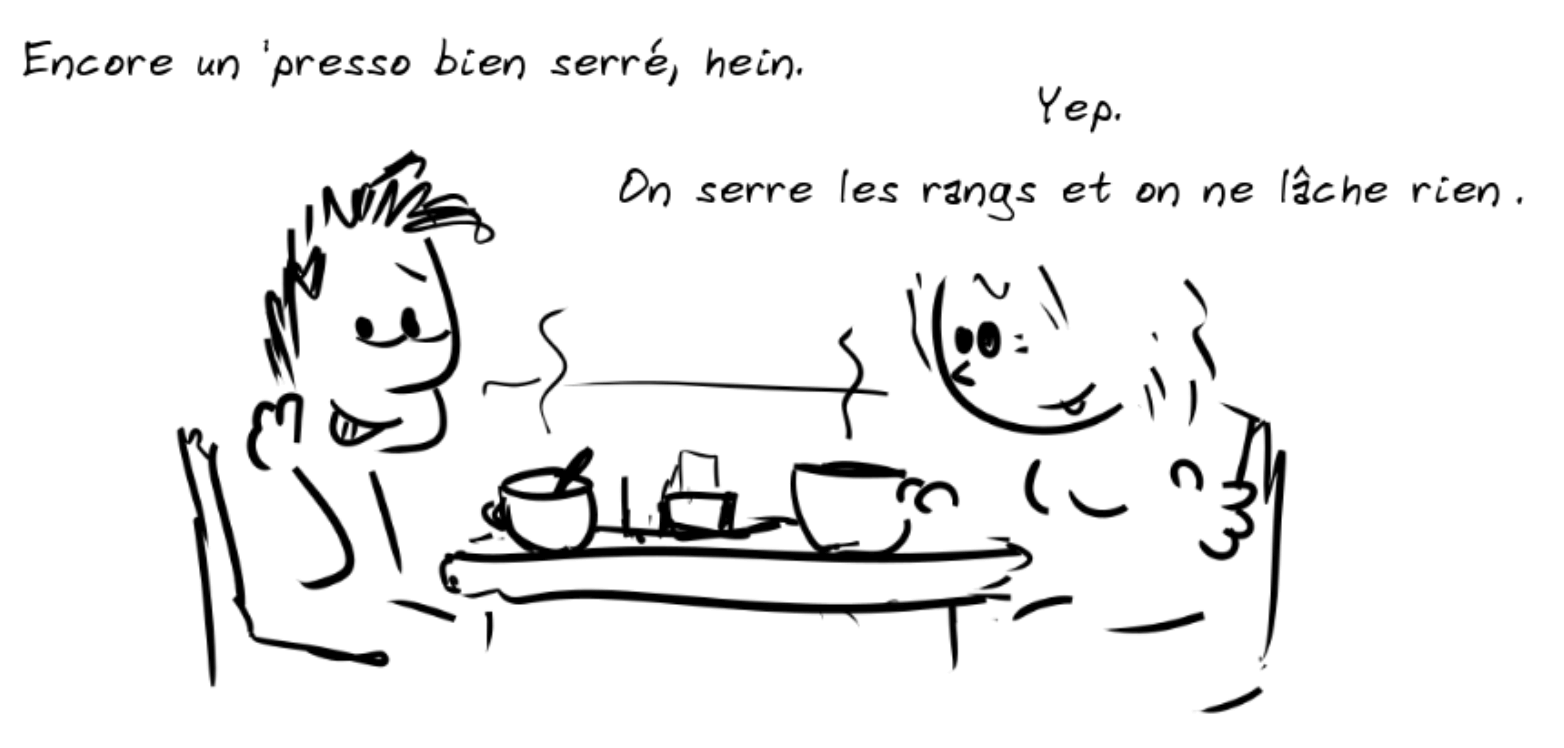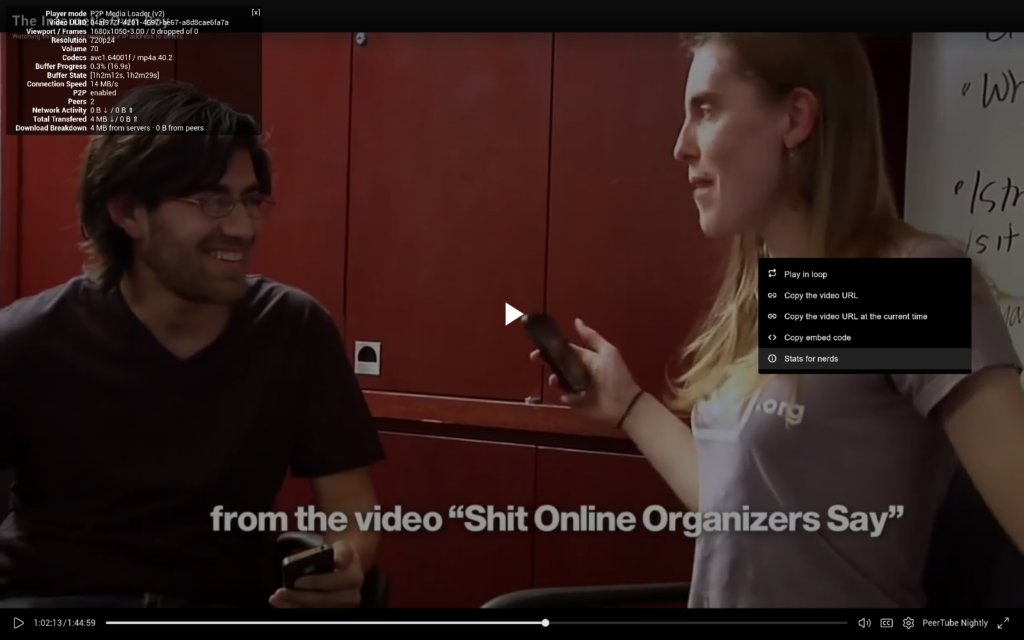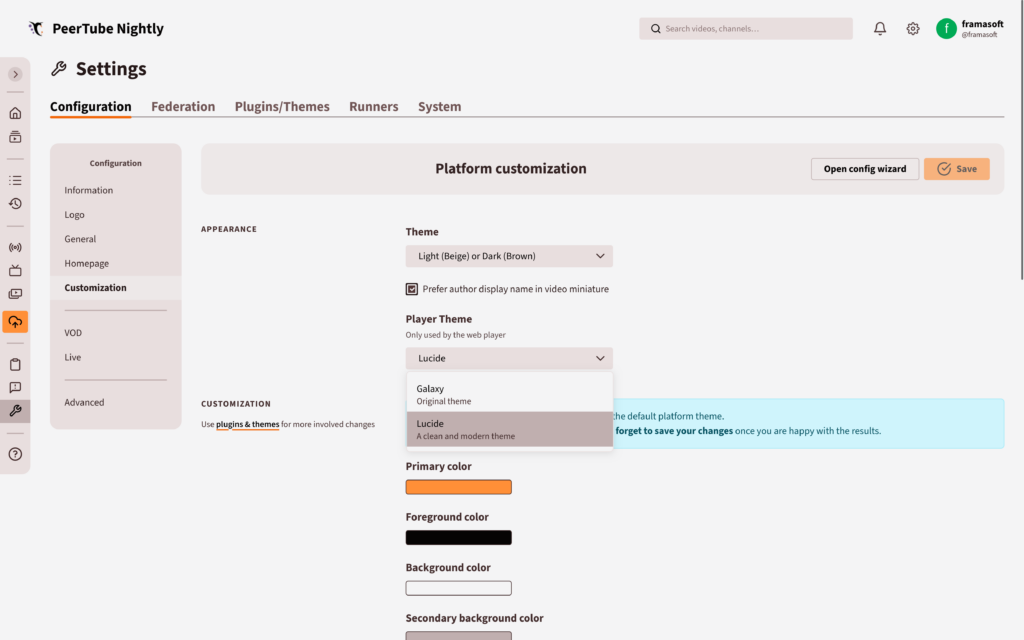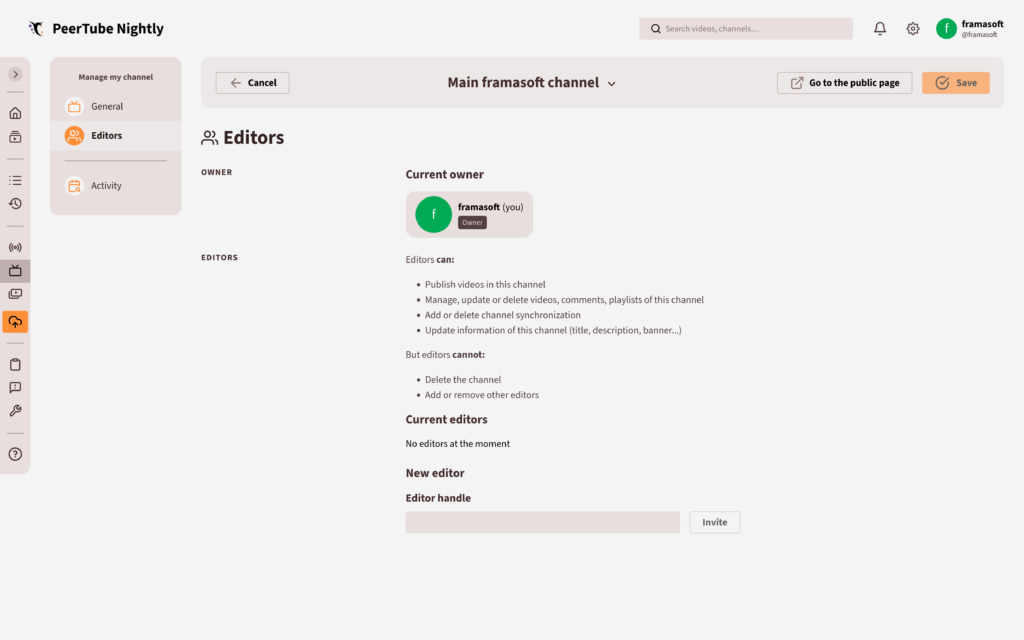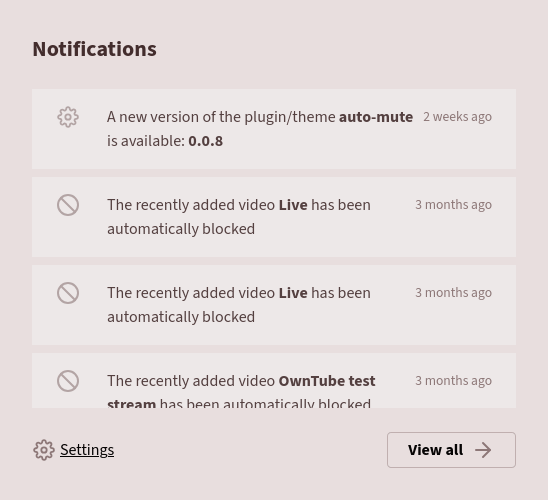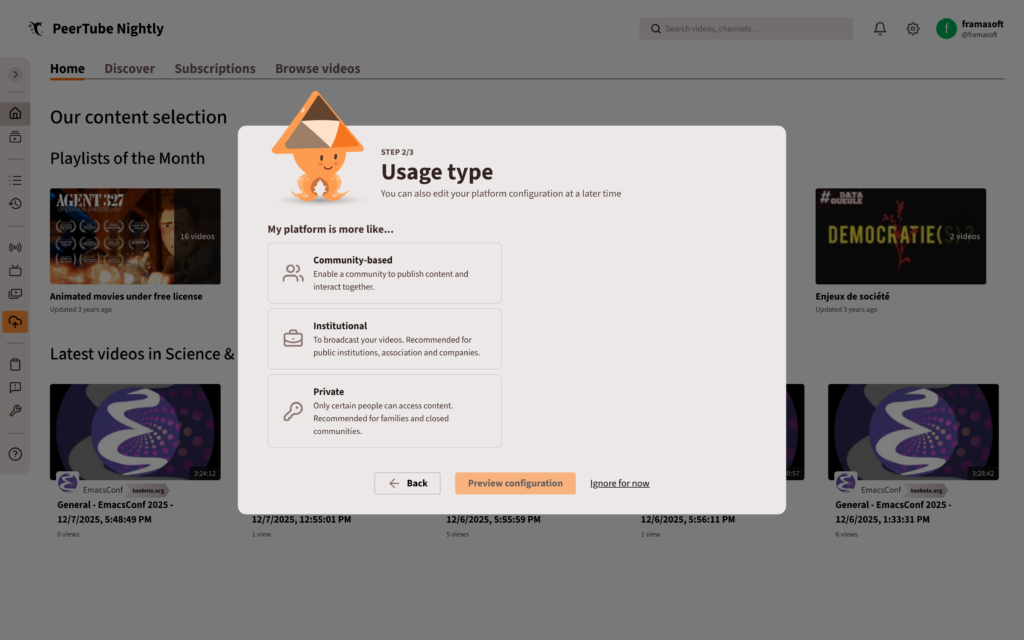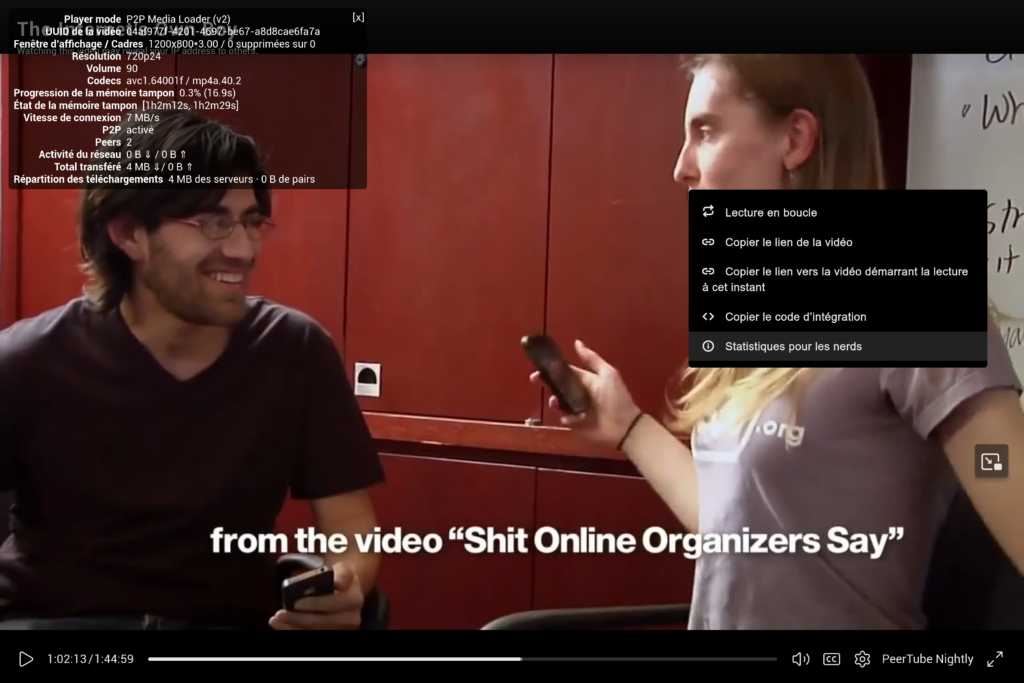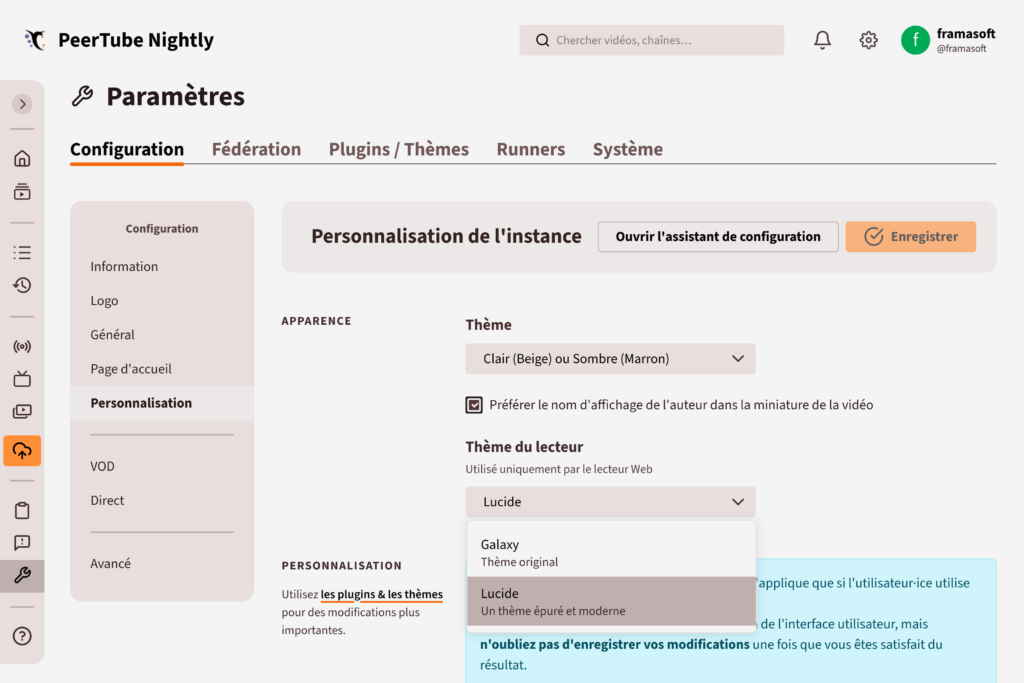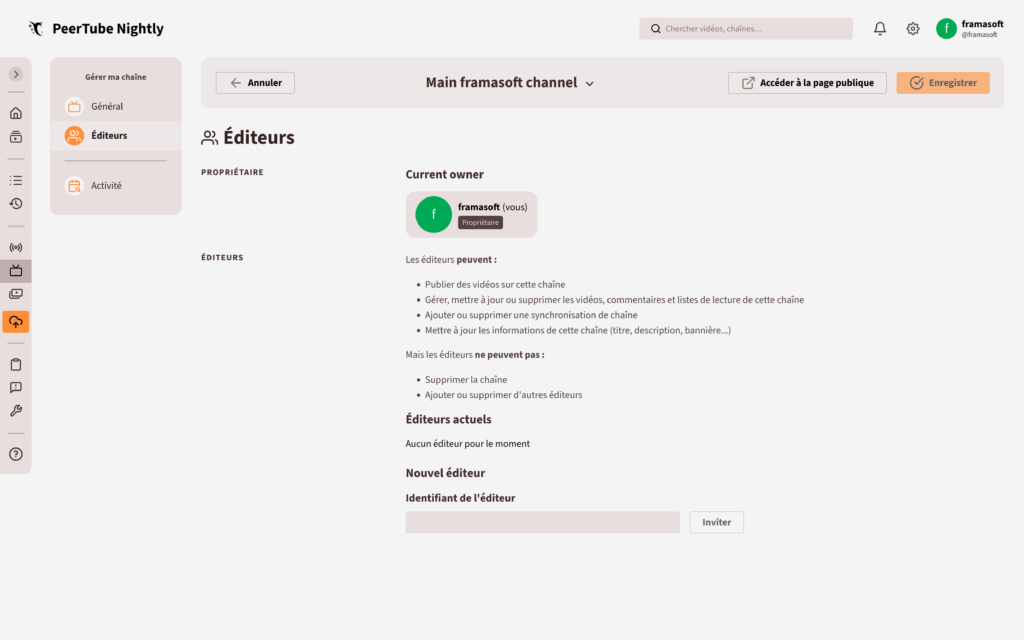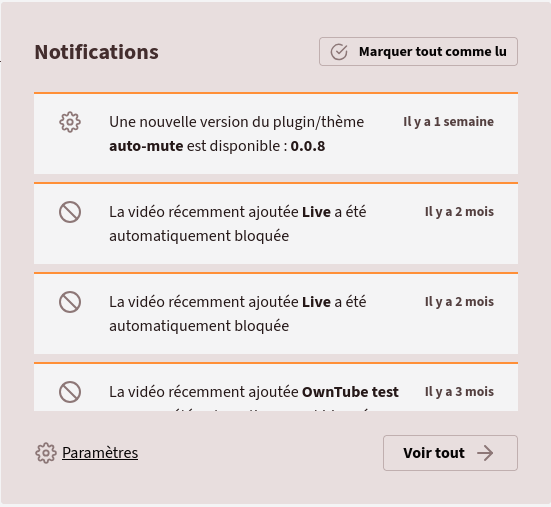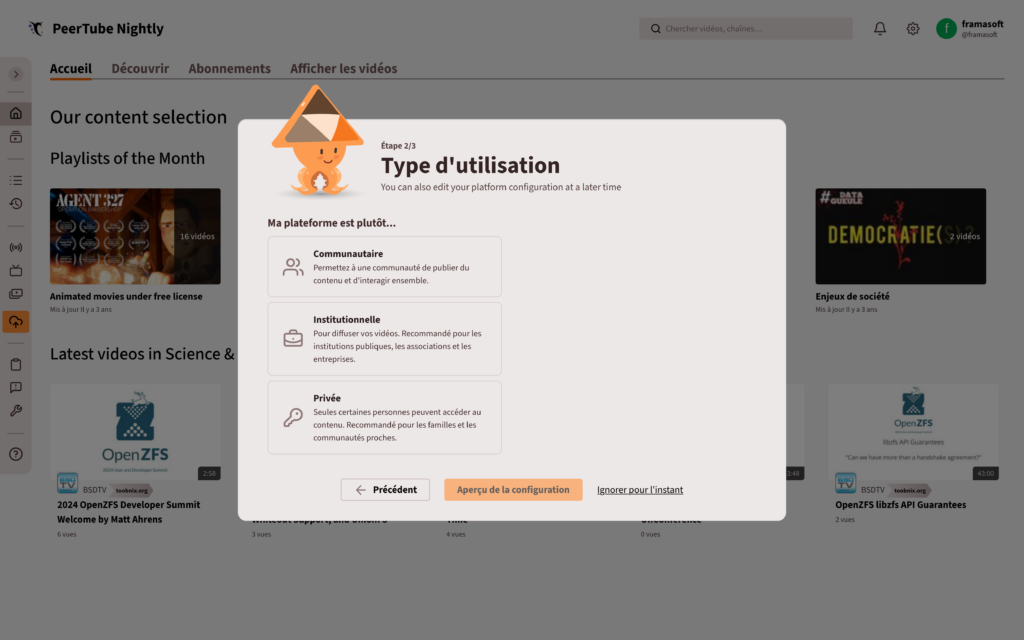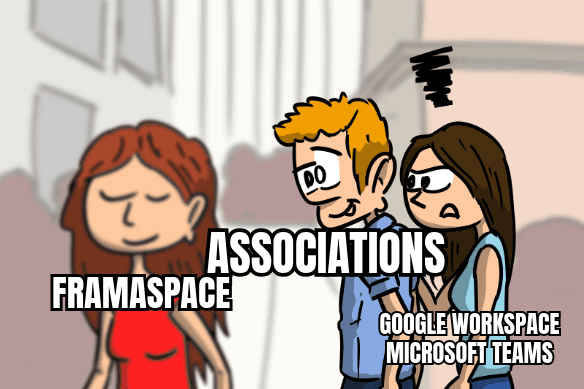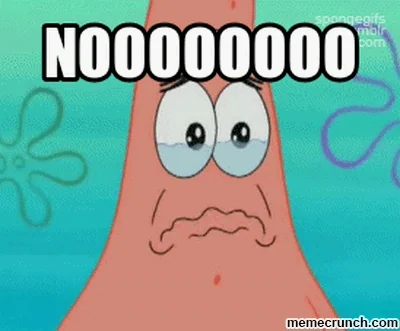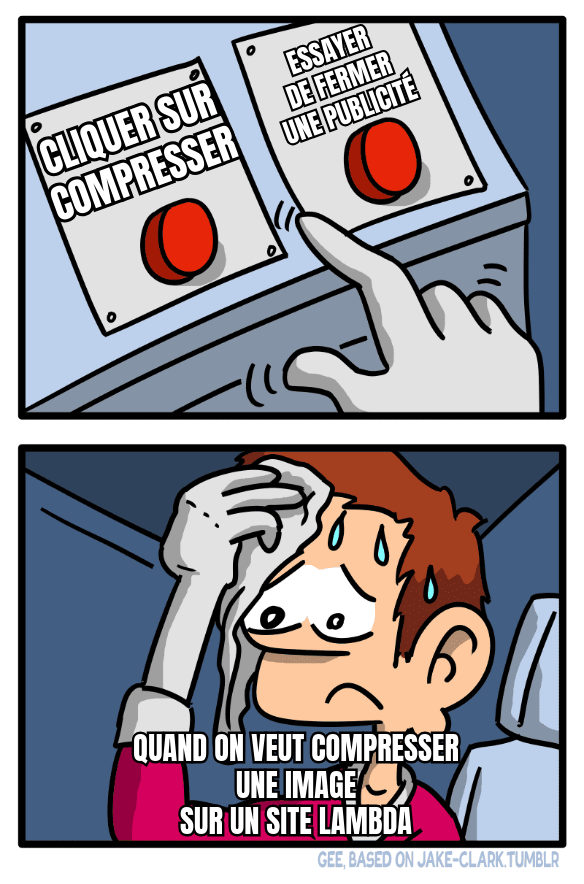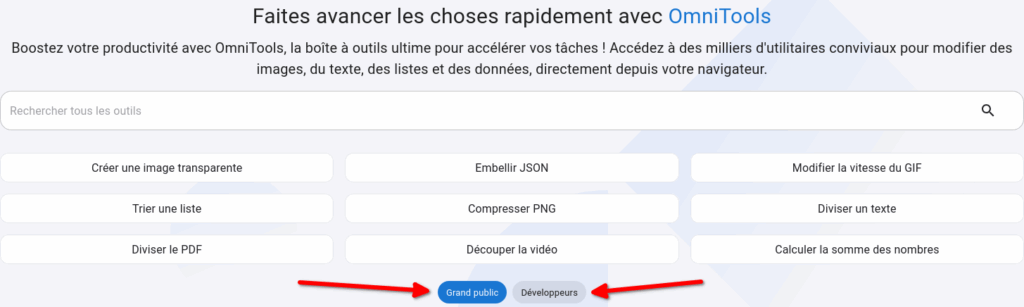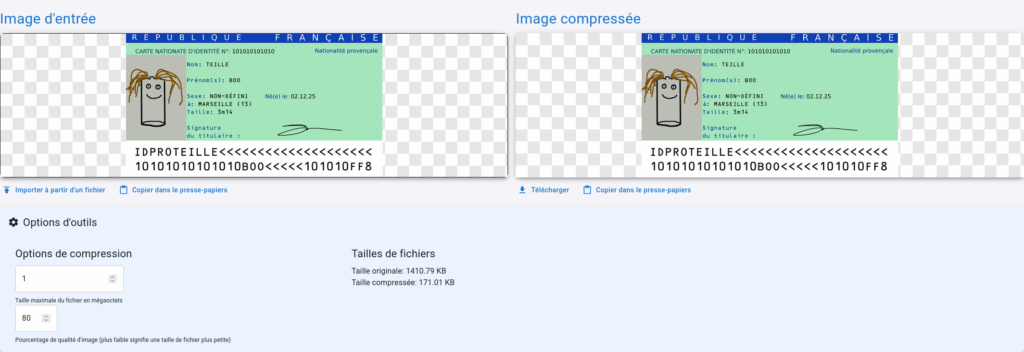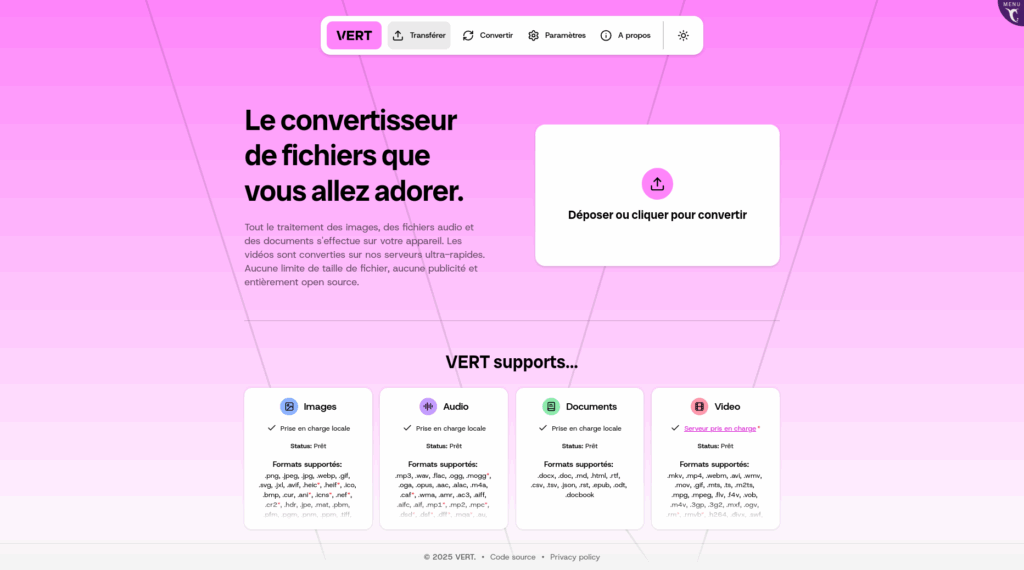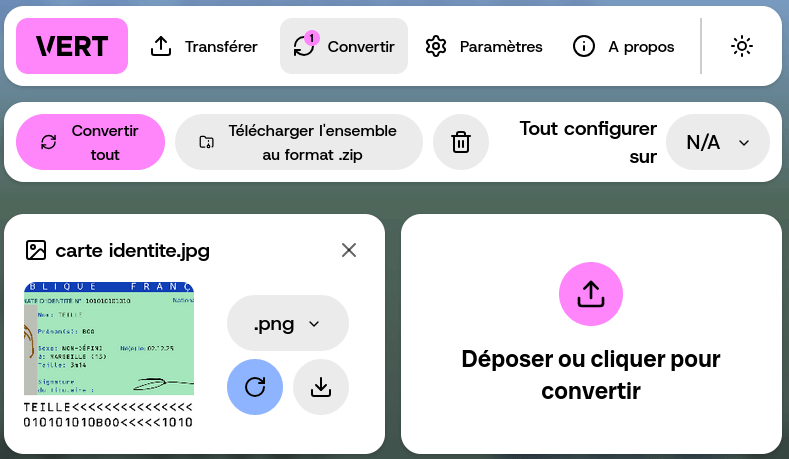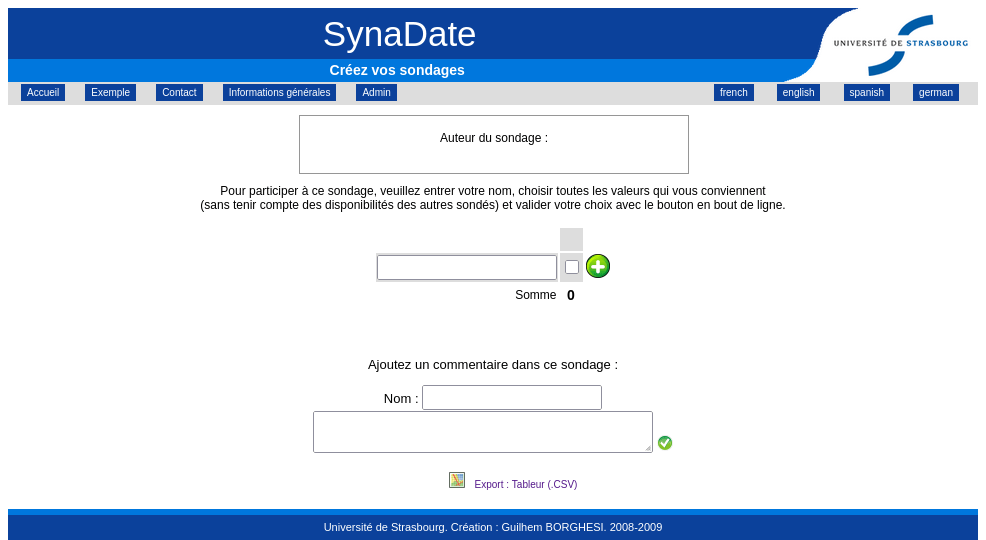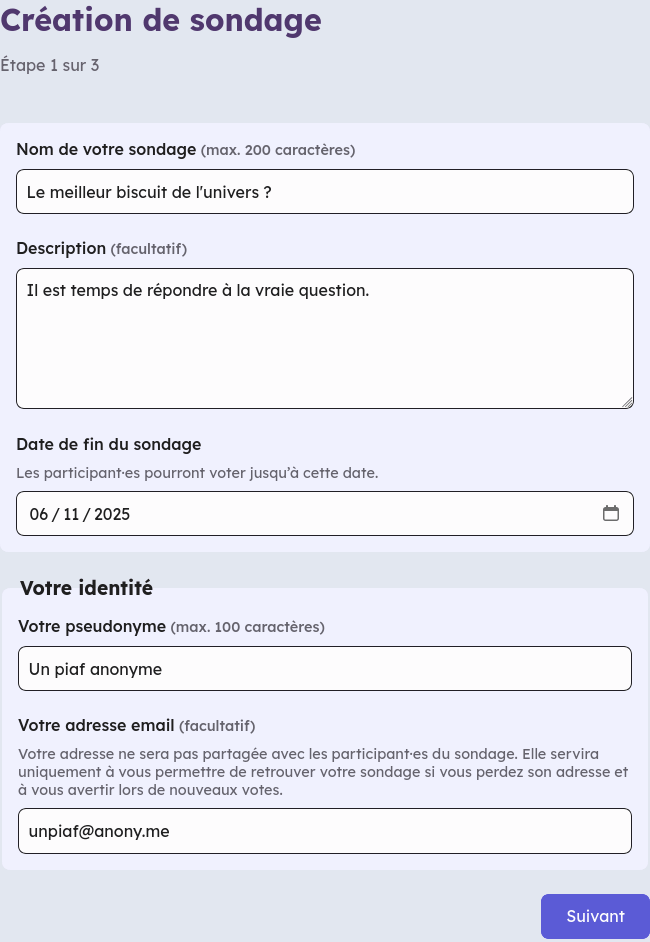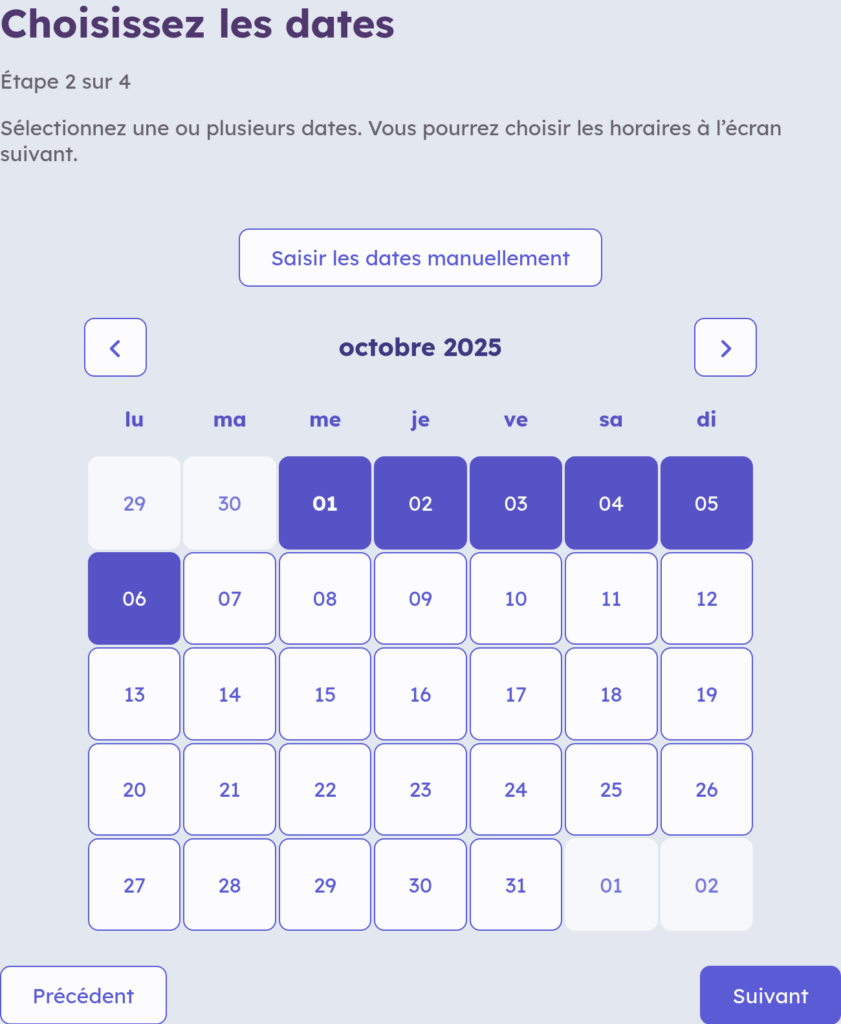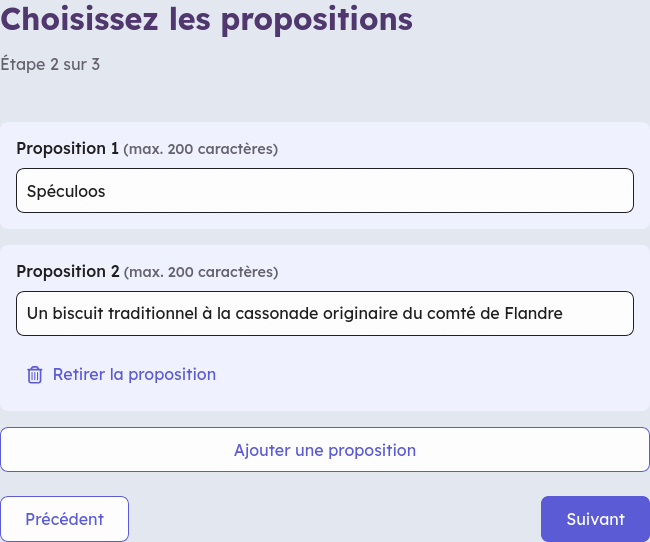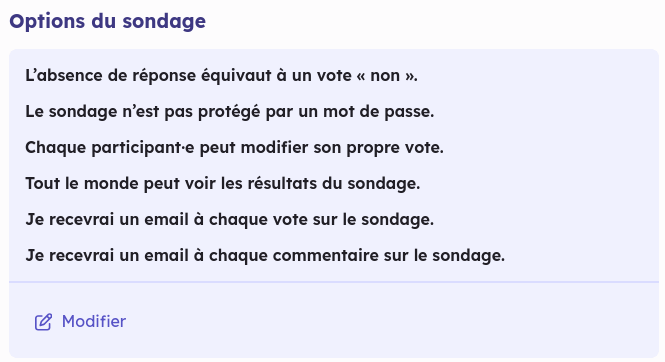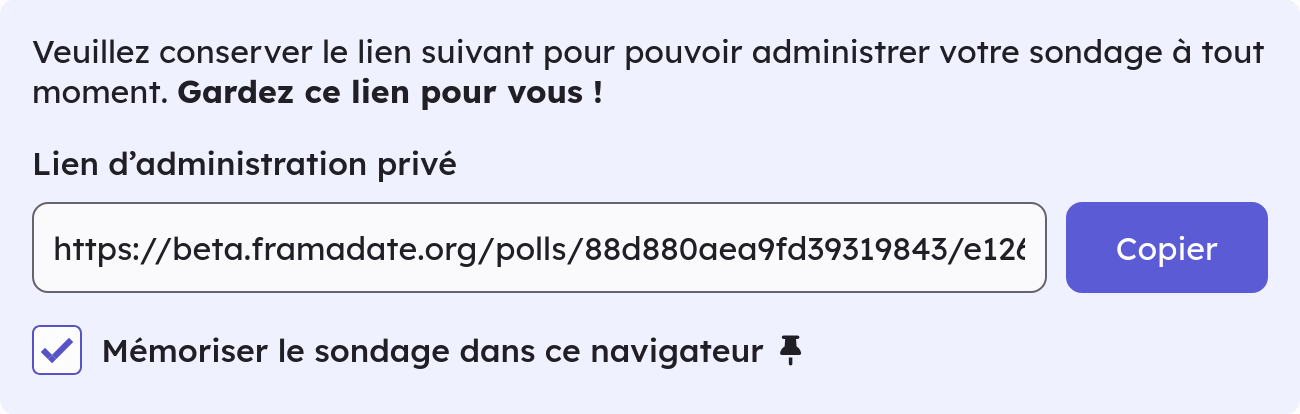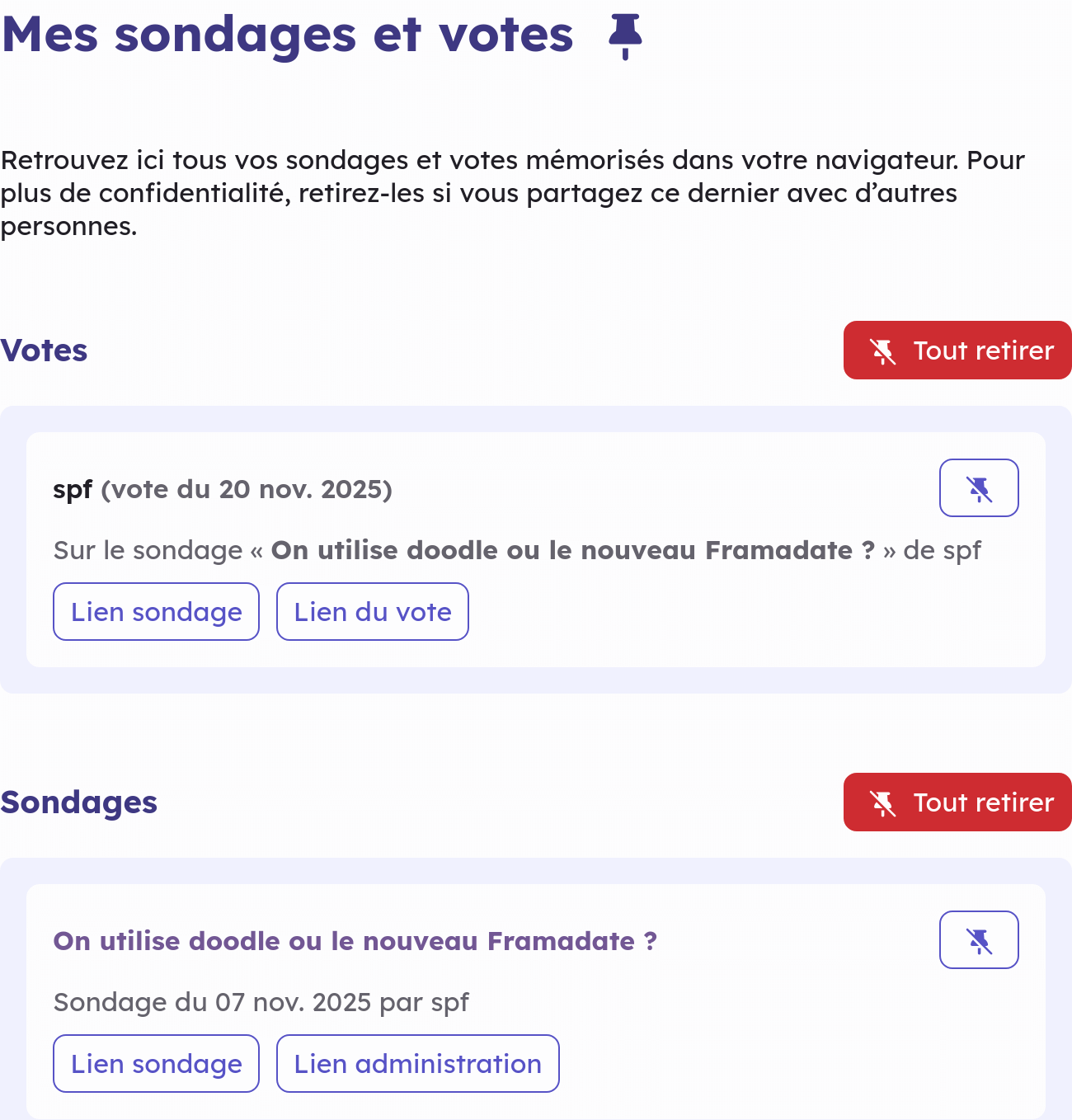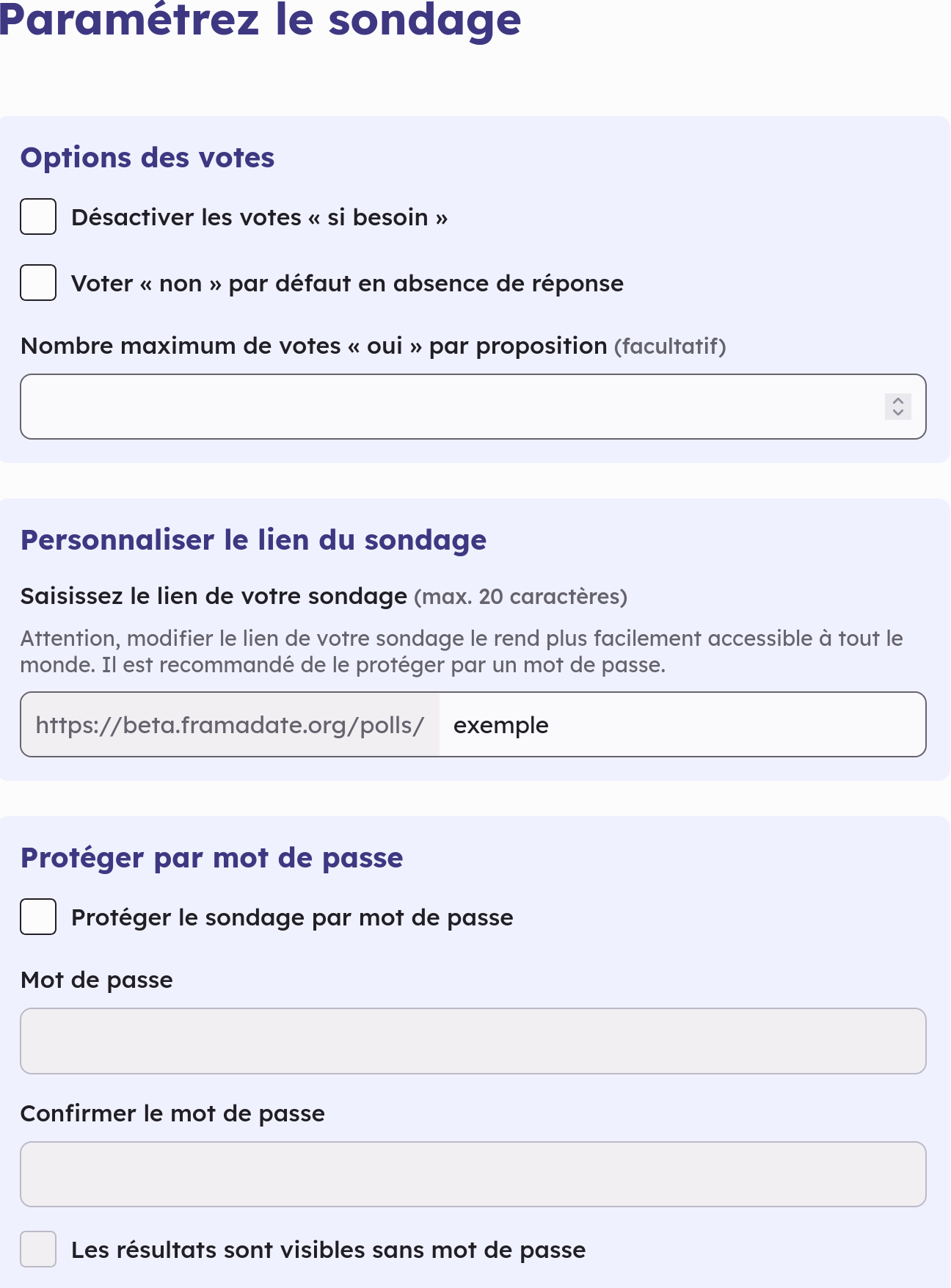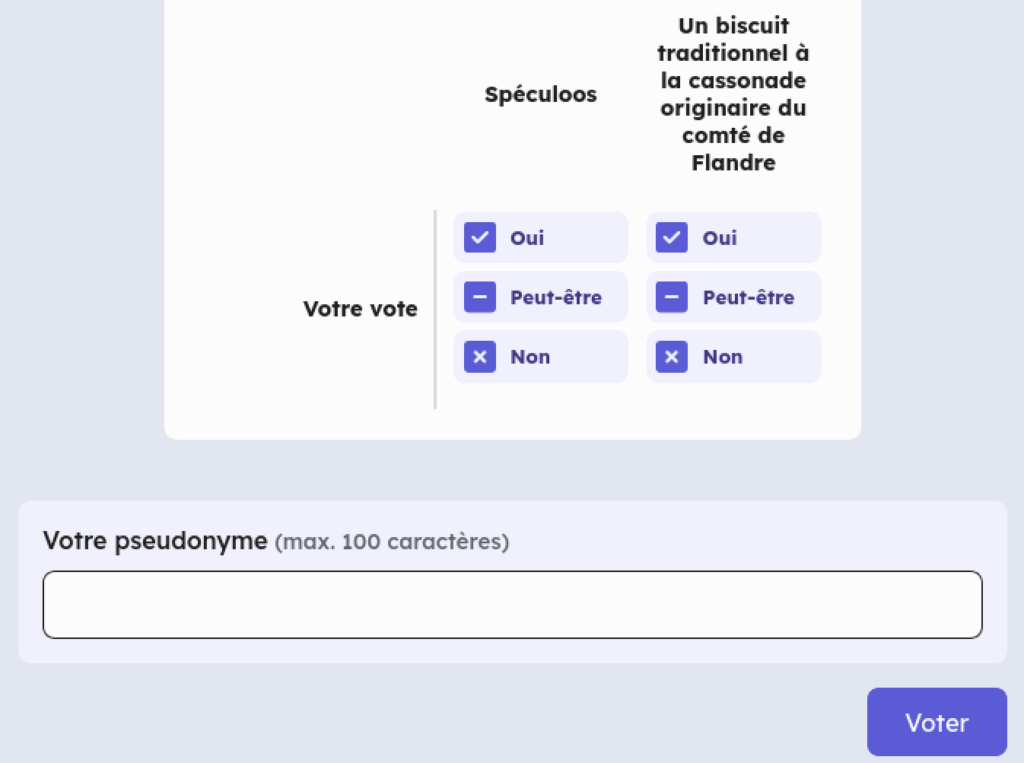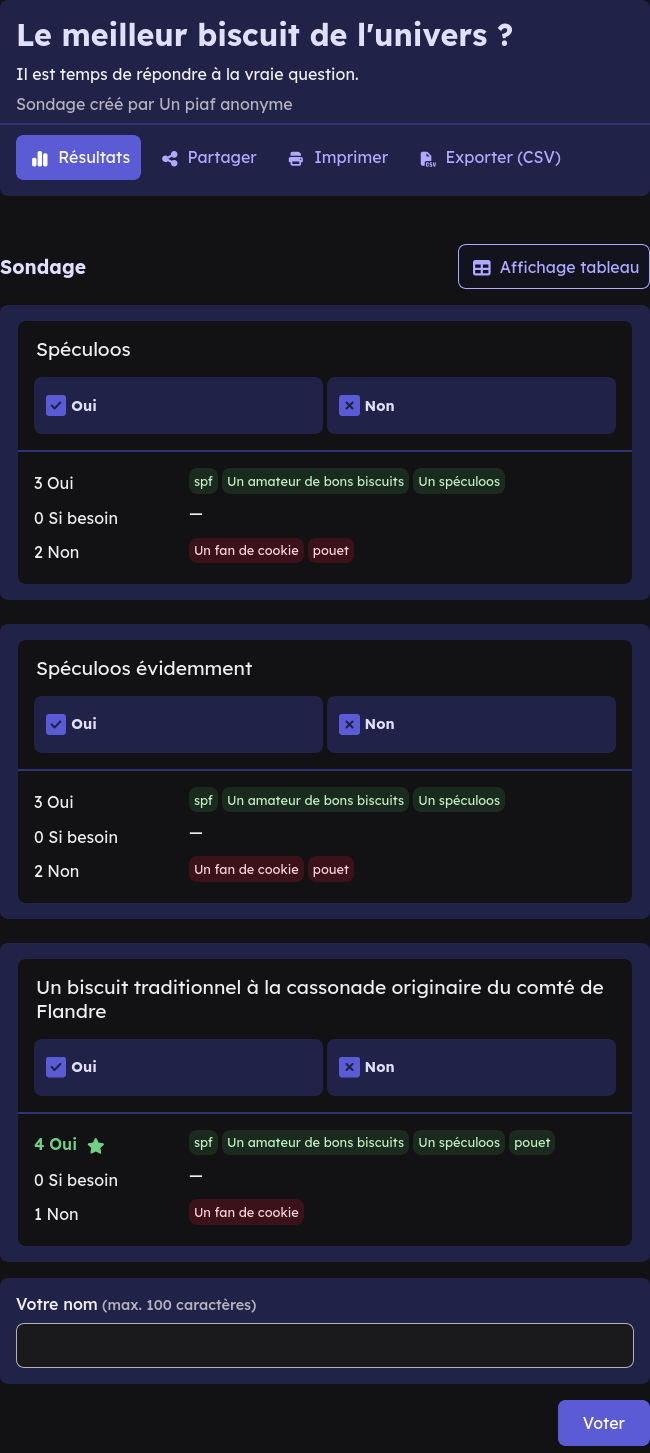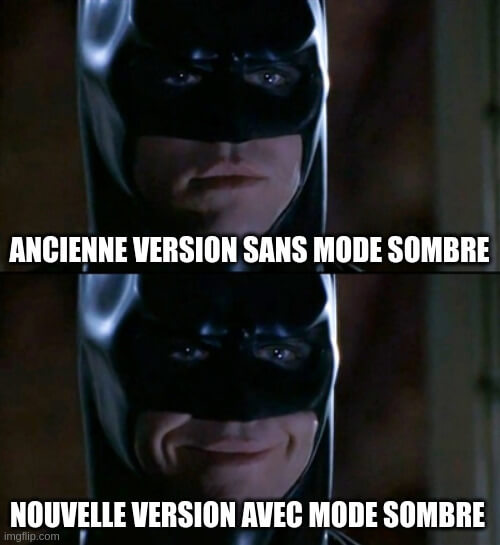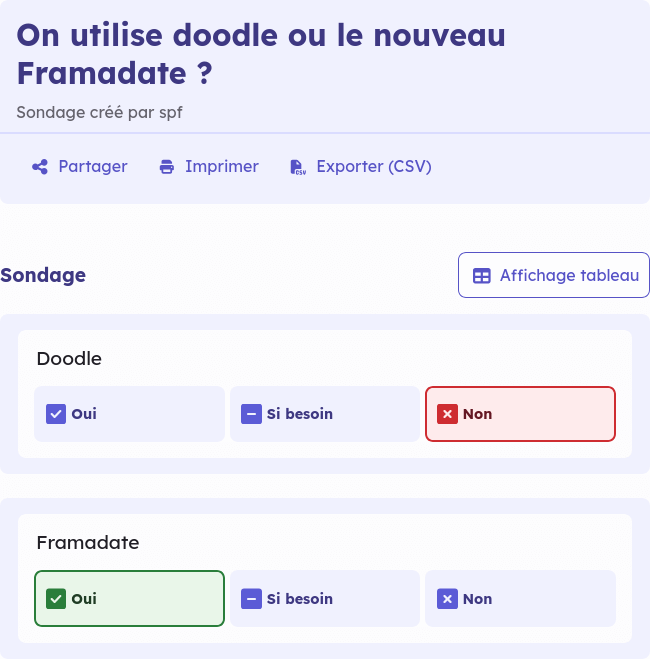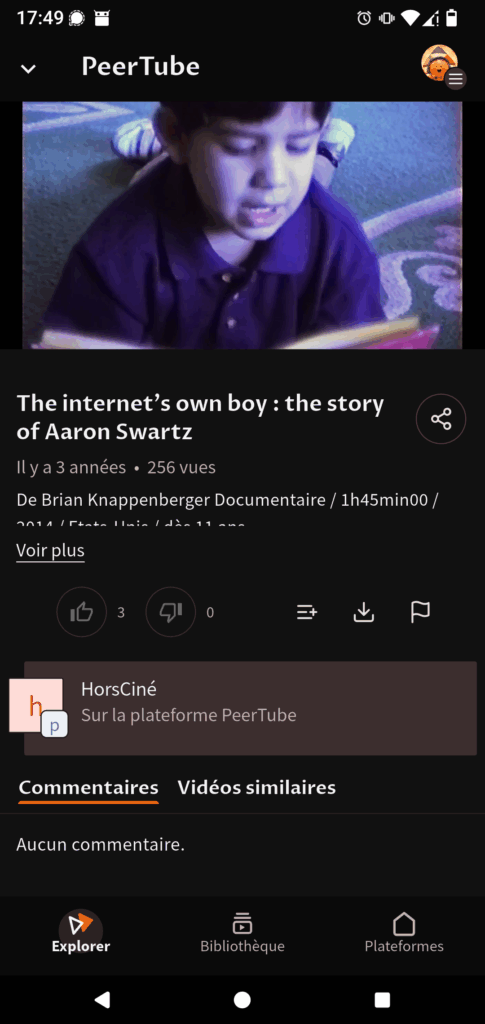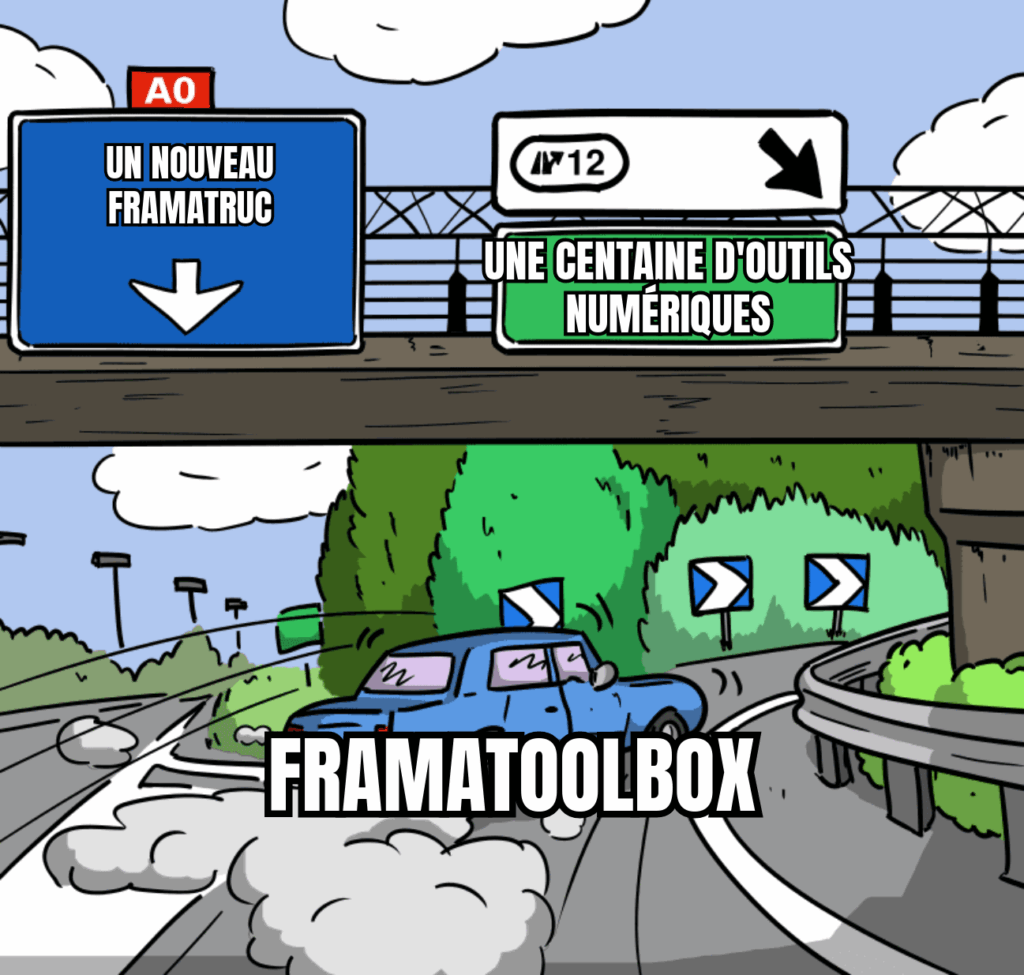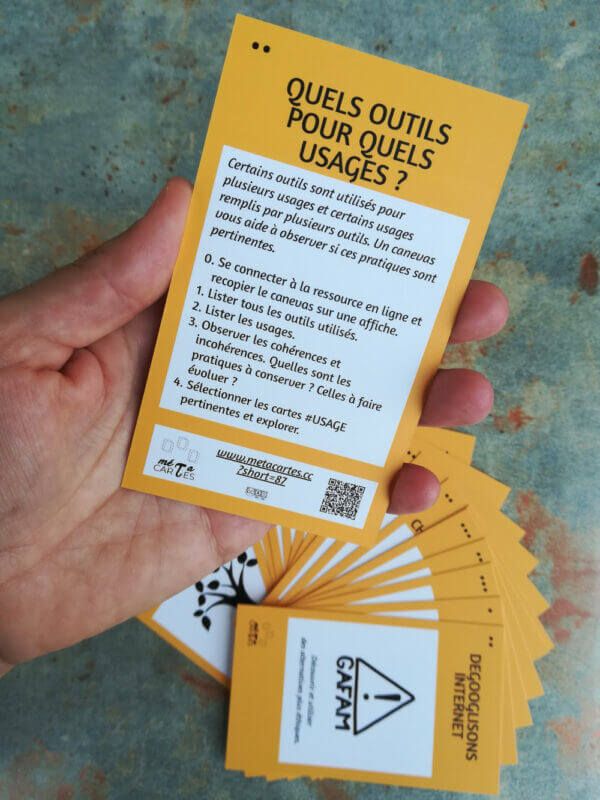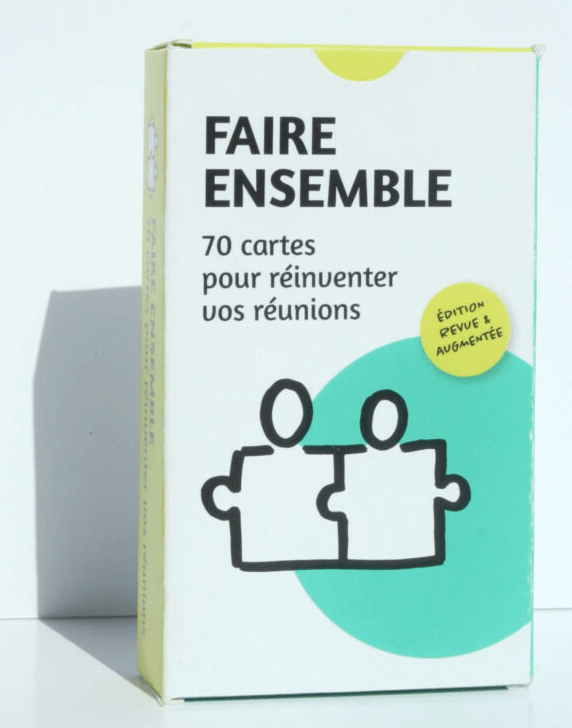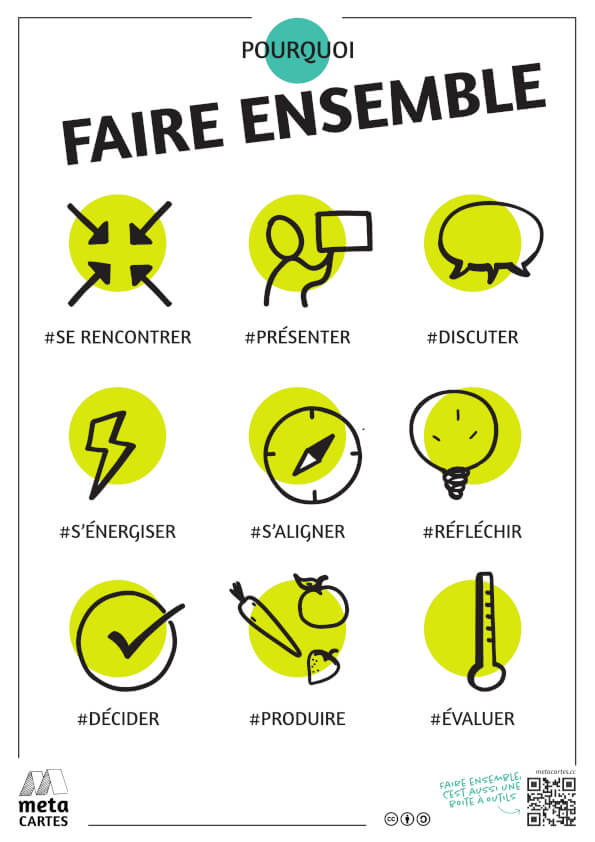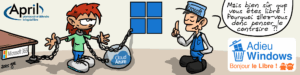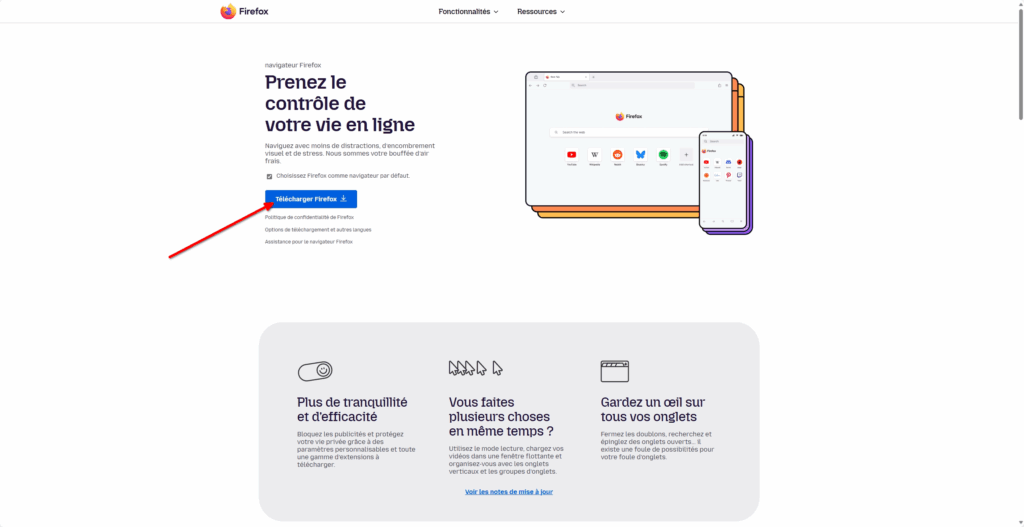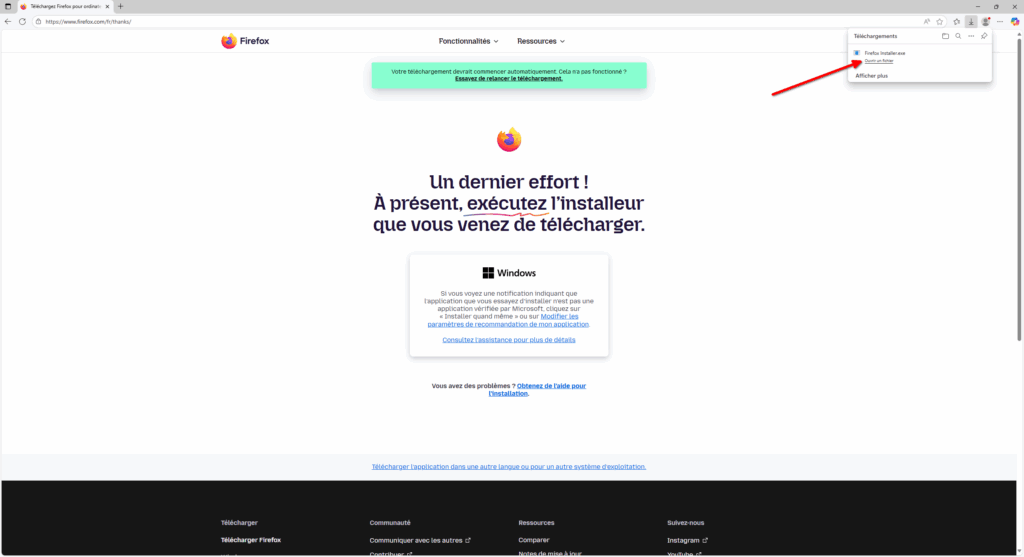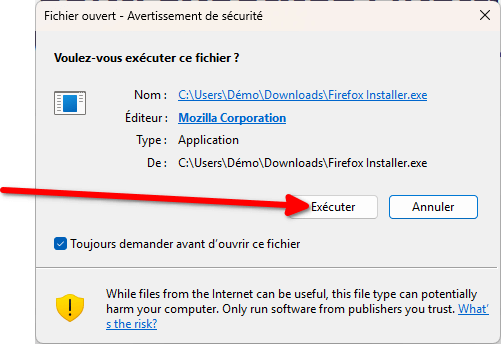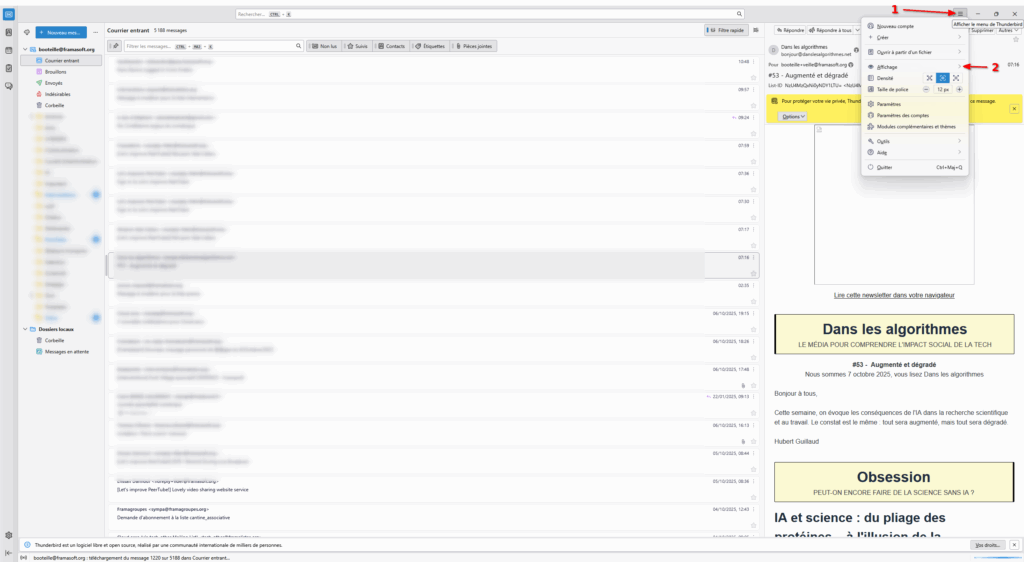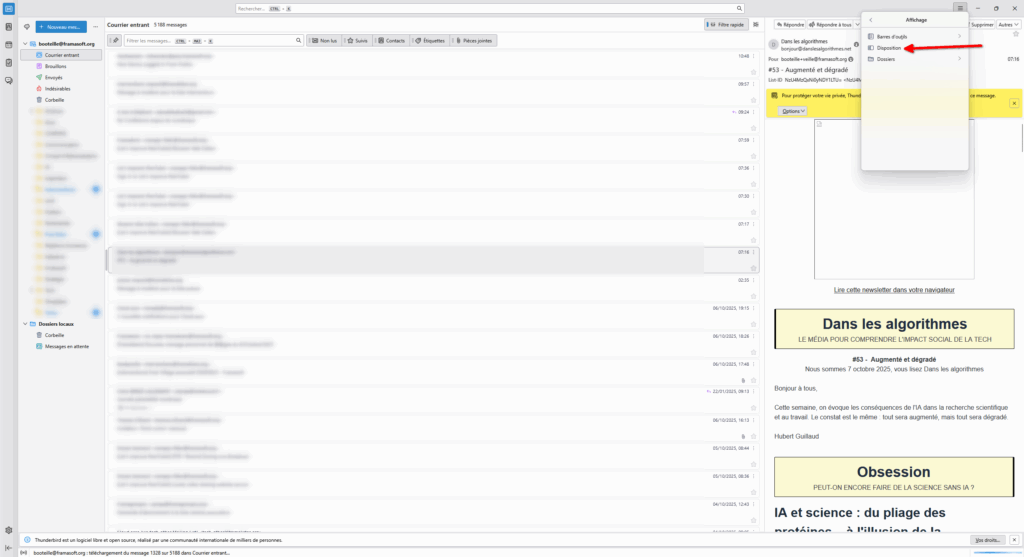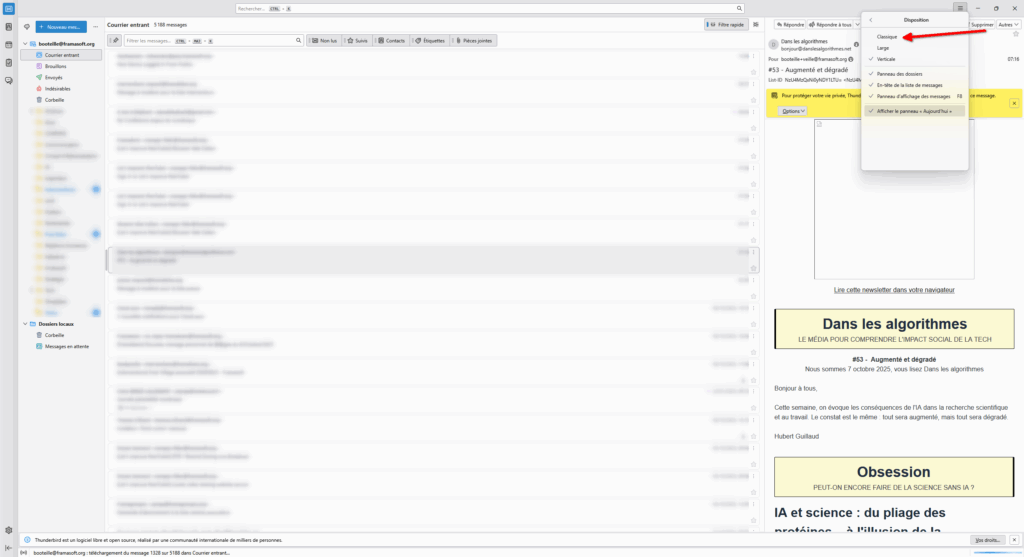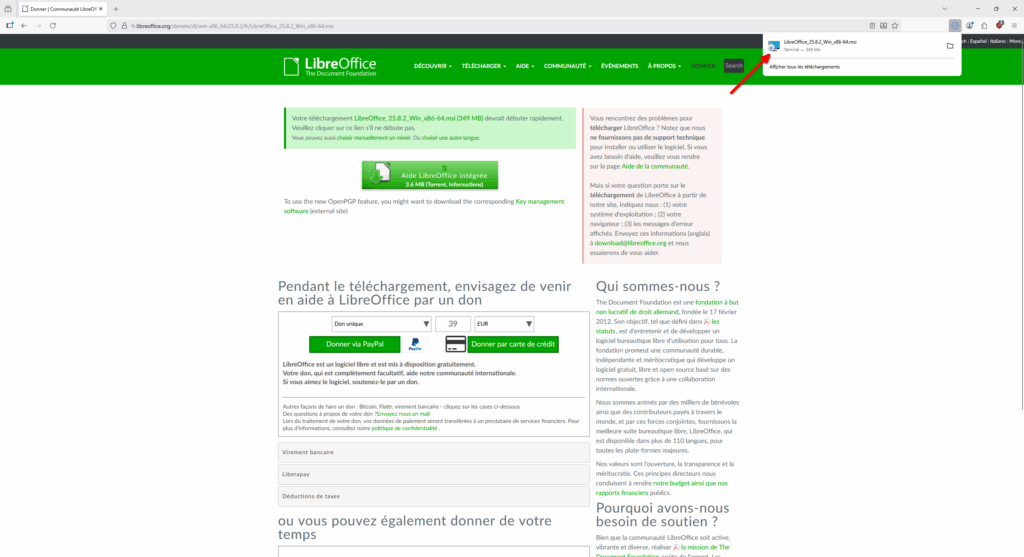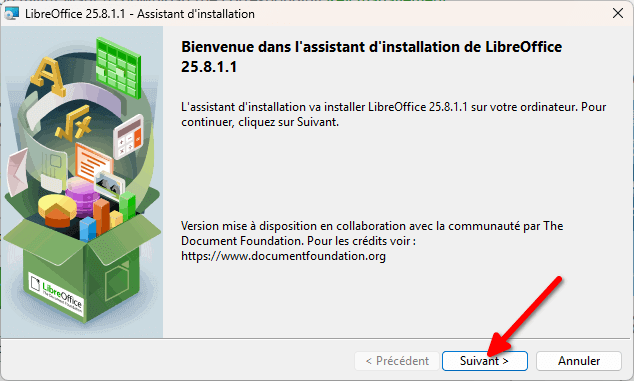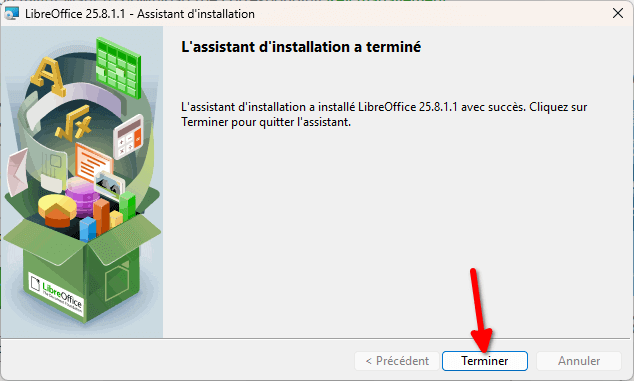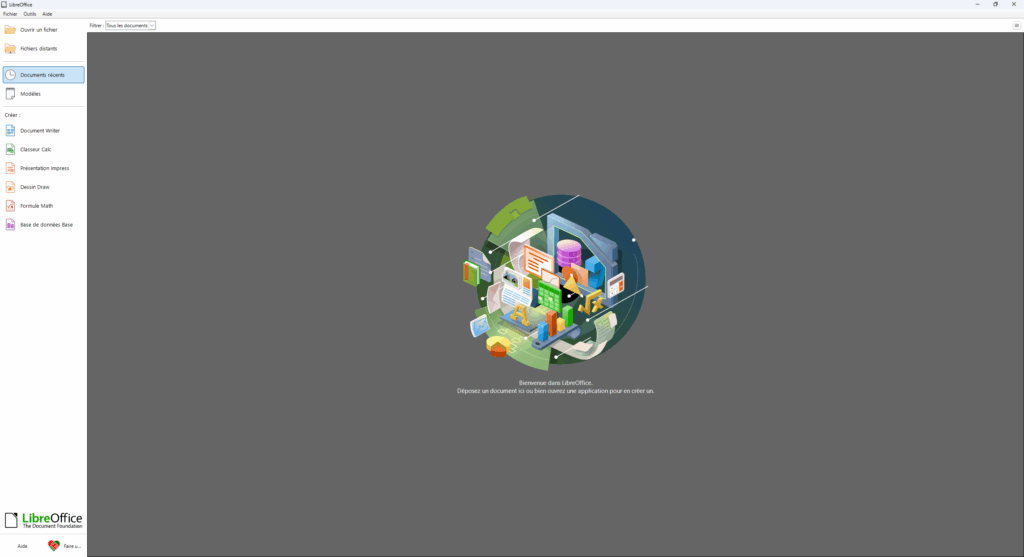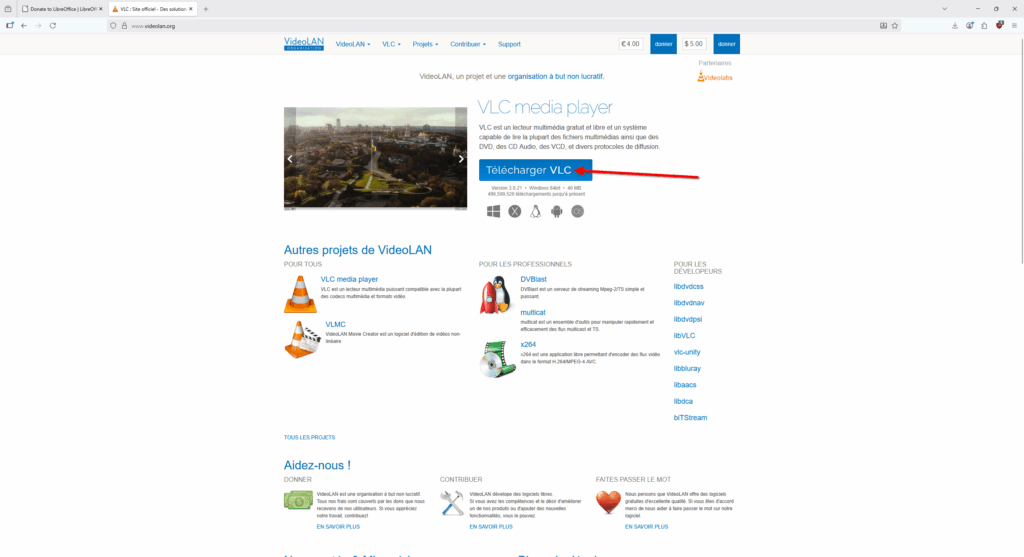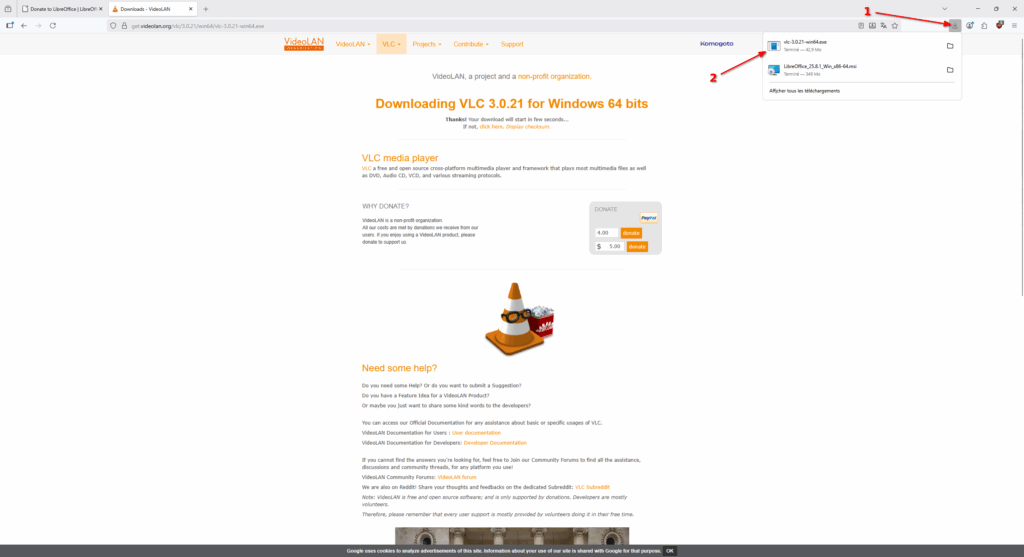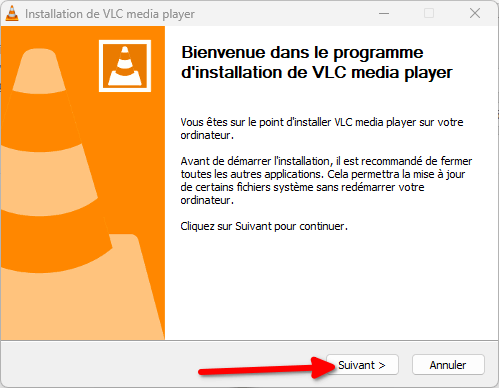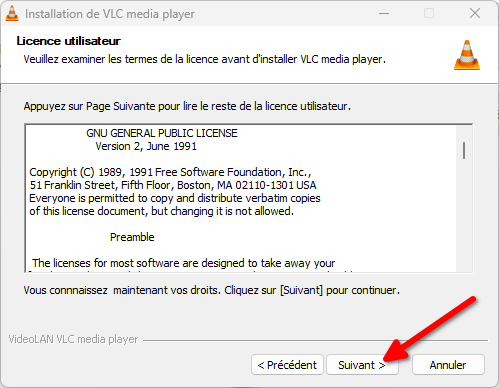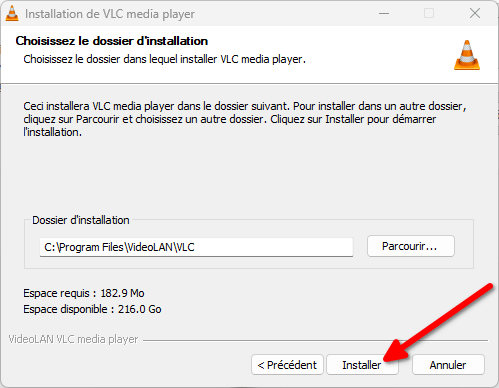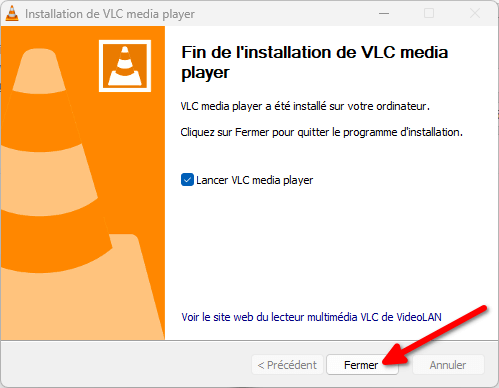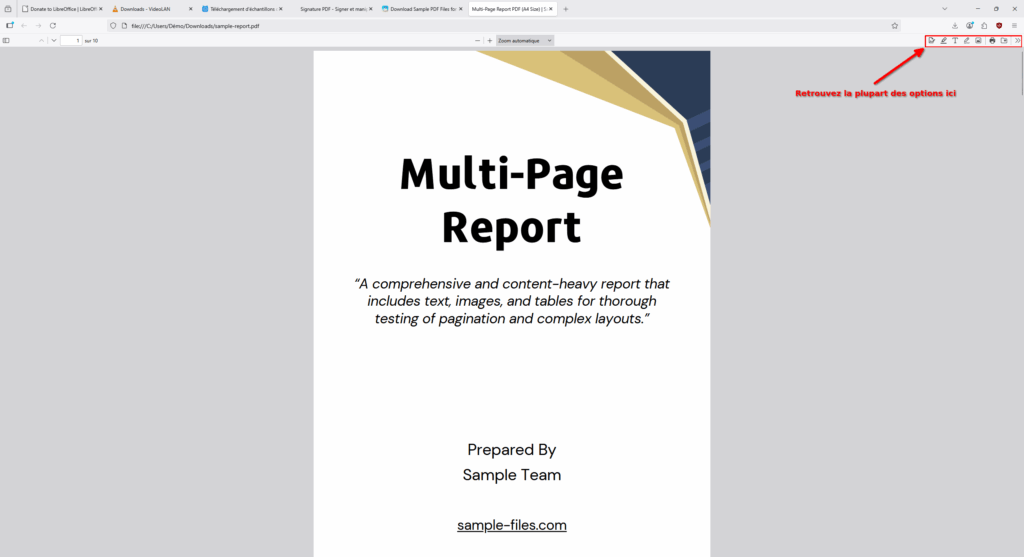16.12.2025 à 10:02
Publiez vos vidéos avec PeerTube sur mobile !
Framasoft
Texte intégral (4948 mots)
Publiez vos vidéos où que vous soyez

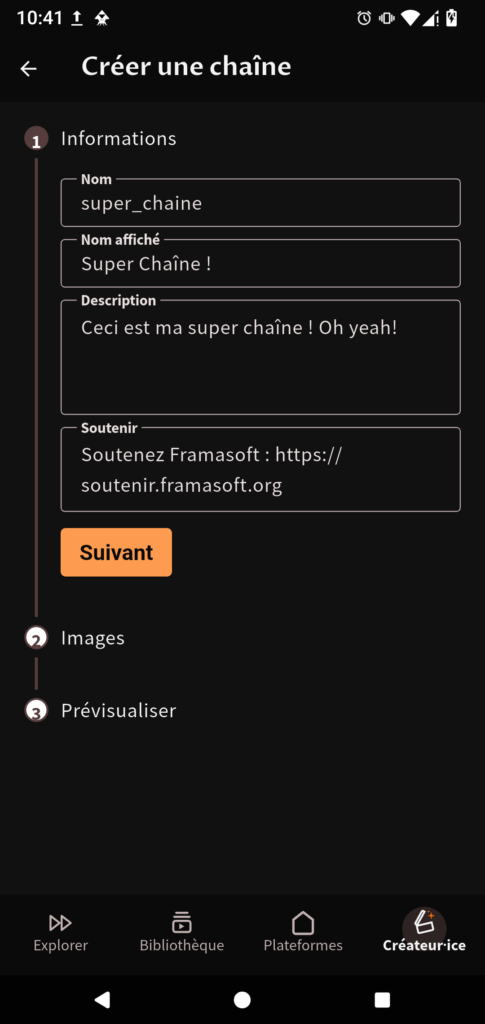
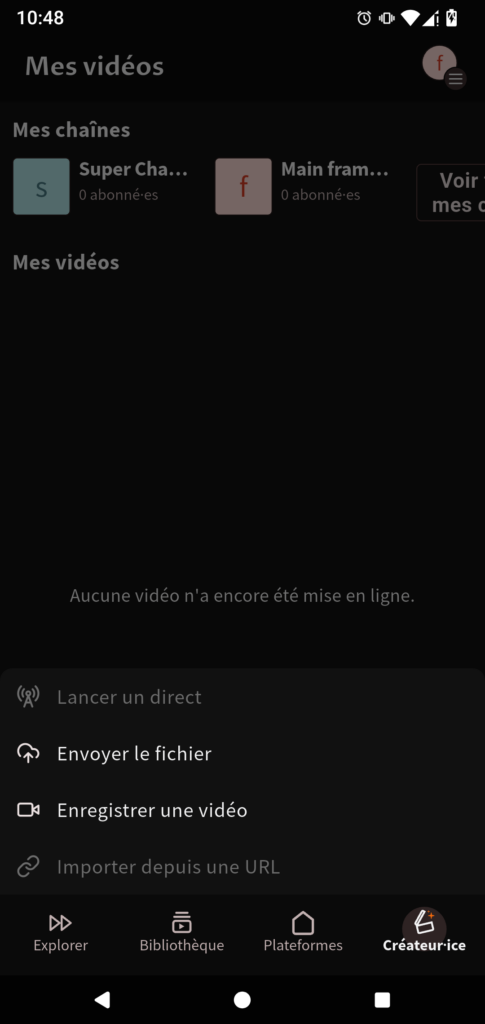
L’affichage du menu pour publier une vidéo. Seules les options « Envoyer le fichier » et « Enregistrer une vidéo » sont disponibles pour le moment.
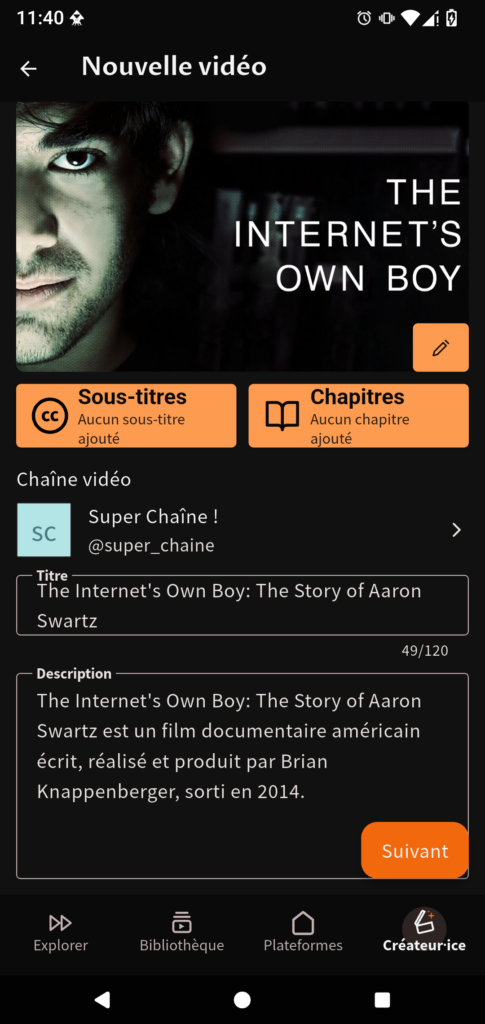
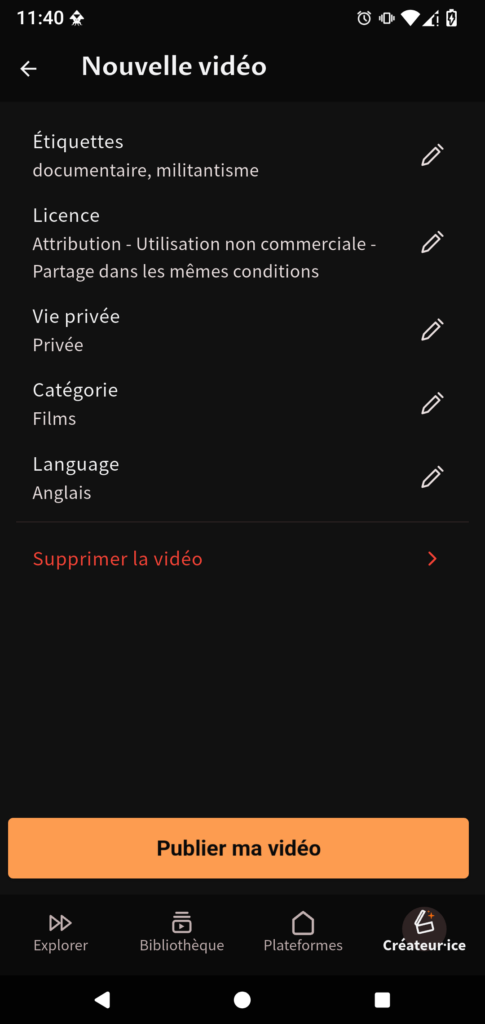
Télécharger l’application Soutenir Framasoft
Télécharger l’application Soutenir Framasoft
Télécharger l’application Soutenir Framasoft
Construisons la robustesse de PeerTube et Framasoft
Framasoft (et donc PeerTube) est financé par vos dons !
En soutenant notre modèle basé sur la solidarité, vous permettez non seulement à PeerTube un avenir serein, loin des logiques marchandes, mais aussi à Framasoft de fournir, gratuitement, 23 services alternatifs à ceux des géants du numérique à plus de 2 millions d’utilisateurices !
Pour y parvenir, nous avons besoin de récolter 250 000 € d’ici la fin de l’année.
Grâce à plus de 3000 personnes, nous avons déjà récolté près de 150 000 € ! 🥳
Contribuez à renforcer la robustesse de Framasoft en nous faisant un don (défiscalisé à 66 % pour les contribuables français·es) et en partageant le mot avec vos proches !
Ensemble, prouvons qu’il est possible de construire un numérique non-marchand, accessible à toustes !
Télécharger l’application Soutenir Framasoft
Les illustrations ont été conçue par David Revoy et sont sous licence CC-BY 4.0.
15.12.2025 à 07:42
Khrys’presso du lundi 15 décembre 2025
Khrys
Texte intégral (9837 mots)
Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour découvrir les informations que vous avez peut-être ratées la semaine dernière.
Tous les liens listés ci-dessous sont a priori accessibles librement. Si ce n’est pas le cas, pensez à activer votre bloqueur de javascript favori ou à passer en “mode lecture” (Firefox) ;-)
Brave New World
- Il n’y a jamais eu autant de milliardaires qu’en 2025, ne vous inquiétez pas pour eux (slate.fr)
- Justice climatique : le droit impuissant face à l’inaction des États (reporterre.net)
- Accord de Paris : dix ans plus tard, que reste-t-il du traité ? (reporterre.net)
- Australie : au moins onze morts après une fusillade en pleine fête juive sur une plage de Sydney (france24.com)
La police australienne demande au public d’éviter le secteur de la célèbre plage Bondi, à Sydney, où une fusillade a fait au moins 12 morts. Des centaines de personnes s’étaient rassemblées pour célébrer la fête juive de Hanoukka. L’un des tireurs présumés a été tué, le second a été blessé.
- L’Australie interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans : un modèle bientôt suivi par d’autres pays ? (theconversation.com)
- Les Japonais·es en faveur du mariage pour toustes, à contre-courant de leur gouvernement (ouest-france.fr)
- The Data Breach That Hit Two-Thirds of a Country (yro.slashdot.org)
Online retailer Coupang, often called South Korea’s Amazon, is dealing with the fallout from a breach that exposed the personal information of more than 33 million accounts – roughly two-thirds of the country’s population – after a former contractor allegedly used credentials that remained active months after his departure to access customer data through the company’s overseas servers.
- Comment Shenzhen est devenu l’atelier du monde (multinationales.org)
En 1980, en guise de premier acte de sa réouverture économique, la Chine inaugure la zone économique spéciale de Shenzhen, destinée à attirer les multinationales du monde entier. La ville deviendra la capitale de la mondialisation dans les années 1990, avec son côté obscur en termes d’exploitation des travailleurs, et le berceau de multinationales chinoises comme Huawei et BYD.
- New mapping reveals hidden mining boom in Laos that threatens the Mekong (news.mongabay.com)
Satellite analysis has identified 517 suspected riverbank mines in Laos, many likely illegal, with clusters along key Mekong tributaries, raising fears of widespread, unmonitored contamination.
- All of Russia’s Porsches Were Bricked By a Mysterious Satellite Outage (autoblog.com)
Hundreds of Porsches across Russia went dark due to factory security systems going offline, leading to speculation whether the failure was intentional.
- Nucléaire : le réacteur accidenté de Tchernobyl n’est plus confiné (reporterre.net) – voir aussi Chernobyl radiation shield has stopped working after Russian drone strikes, UN warns (politico.eu)
- « Zone démilitarisée » dans l’est de l’Ukraine, accord de paix avant Noël… Washington s’impatiente, Zelensky tente de peser sur les négociations (humanite.fr)

- They Droned Back (digitaldigging.org) Young journalists expose Russian-linked vessels circling off the Dutch and German coast
- Syrie. De la libération à la libéralisation (orientxxi.info)
Il y a un an, le 8 décembre 2024, le président syrien Bachar Al-Assad tombait, laissant place à une administration dirigée par Ahmed Al-Charaa. Malgré les incertitudes en termes de stabilité, une libéralisation est à l’œuvre. Elle bénéficie avant tout à la Turquie et aux monarchies du Golfe. De son côté, en l’absence de reconstruction concrète, la population n’a que peu de perspectives économiques.
- Les États-Unis et l’Arabie saoudite bloquent une publication phare de l’ONU sur l’environnement (reporterre.net)
- Le géant français de la banane mis en demeure au Cameroun (reporterre.net)
La Compagnie fruitière, géant français de la banane, fait l’objet d’une mise en demeure pour des atteintes présumées aux droits humains et à l’environnement dans sa filiale camerounaise des Plantations du Haut-Penja.
- Benin’s December 7 failed coup : Fact-checking online mis and disinformation (ghanafact.com)
The coup of December 7, 2025, in Benin failed, but conversations online during and after the incident showed a mix of anti-democratic rhetoric and the spread of false and harmful content. GhanaFact analyses the recirculation of old images and videos, misuse of AI and how official disclaimers helped control misinformation.
- « Tout ce qui se trouve dans l’eau va mourir » : en Algérie, les déchets de la production d’huile d’olive polluent les fleuves (reporterre.net)
- Italie : 500 000 personnes défilent contre le budget Giorgia Meloni (humanite.fr)
Un demi-million de personnes ont défilé dans les rues italiennes d’après la confédération syndicale, la CGIL pour s’opposer au projet budgétaire 2026. La coalition d’extrême droite dirigée par Giorgia Meloni a présenté des coupes drastiques avec 18 milliards de dépenses alors que les salaires stagnent et les prix ne cessent d’augmenter.
- Des pesticides autorisés de manière illimitée en Europe : 2300 scientifiques alertent (basta.media)
La Commission européenne va présenter le 16 décembre un projet de règlement visant à autoriser des pesticides de manière illimitée, contre un examen aujourd’hui tous les dix ou quinze ans. 2300 scientifiques alertent dans cette lettre ouverte.
- Parmi les dix pays les plus indépendants en matière d’énergie, sept sont européens (legrandcontinent.eu)
l’Islande est le pays le plus indépendant et le plus résilient sur le plan énergétique, près de 90 % de sa consommation provenant d’énergies renouvelables. Le pays est suivi par la Norvège, la Suisse et la Suède, qui présentent également une faible dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles — et sont ainsi parmi les moins exposés à des risques de pannes d’électricité majeures.
- After Years of Controversy, the EU’s Chat Control Nears Its Final Hurdle : What to Know (eff.org)
- Le marché européen représente environ un quart des revenus mondiaux des Big Tech (legrandcontinent.eu)
- Elon Musk’s X bans European Commission from making ads after €120m fine (bbc.com)
X has blocked the European Commission from making adverts on its platform – a move which comes a few days after it fined Elon Musk’s site €120m (£105m) over its blue tick badges.
Voir aussi The world needs social sovereignty (blog.joinmastodon.org)
Elon Musk’s X platform has blocked the European Commission from making advertisements, presumably in response to the €120 million fine for its misleading verification system and overall lack of transparency. We’re grateful to Elon Musk for proving once again why the world needs to log off corporate-owned, centrally-controlled social media platforms and log on to a better way of being online. The world needs an open social web through the fediverse and Mastodon.
- Les États-Unis de Trump actent leur divorce avec l’Europe (politis.fr)

- Donald Trump is pursuing regime change – in Europe (theguardian.com)
- L’administration Trump veut que les touristes exemptés de visas, dont les Français, fournissent l’historique de leurs réseaux sociaux. (lemonde.fr)
- Axon Tests Face Recognition on Body-Worn Cameras (eff.org)
- Kilmar Abrego Garcia, symbole de la chasse aux migrants de Donald Trump, libéré par la justice (humanite.fr)
Kilmar Abrego Garcia, un Salvadorien expulsé par erreur par l’administration du locataire de la Maison Blanche puis ramené aux États-Unis après des mois de guérilla judiciaire et de nouveau enfermé, a été relâché jeudi 11 décembre sur décision de justice.
- Palantir CEO Says Making War Crimes Constitutional Would Be Good for Business (gizmodo.com)
- “Domestic Terrorism” : Leaked DOJ Memo Targets “Anti-Americanism, Anti-Capitalism, Anti-Christianity” (democracynow.org)
- FBI Leader Crumbles During Basic Questions About Threat of “Antifa” (newrepublic.com)
Well, this sure sounds like a confession that antifa’s designation as a domestic terror group was based on nothing.
- Font Wars : Times New Roman vs. Calibri in U.S. Diplomacy (devdiscourse.com)
The U.S. State Department has reverted to using Times New Roman in official communications, reversing the previous administration’s choice of Calibri, which was promoted for accessibility. This decision aligns with conservative views rejecting diversity, equity, and inclusion initiatives as wasteful and contrary to merit-based principles.
- RFK Jr.’s health department is using religious freedom to strip transgender people of health care (advocate.com)
- Trump admin sues school for religious discrimination for punishing Christians who harassed trans kid (lgbtqnation.com)
- American Men Are Flocking To Get Breast Reduction Surgery—And Everyone’s Making The Same Powerful Point (comicsands.com)
it is celebrated when cisgender men pursue this surgery, but condemned when transgender people seek the same outcome.
- Over 250 people quarantined in South Carolina as measles outbreak rages (arstechnica.com)
16 cases are linked to a church, which followed exposures at four schools last week.
- Entre le Venezuela et les États-Unis, la situation ne fait qu’empirer (portail.basta.media)
Sous prétexte de lutte contre le narcotrafic, les États-Unis font depuis plusieurs semaines monter les tensions avec le Venezuela. Les médias indépendants internationaux se penchent sur cette confrontation hautement explosive.
- Le Brésil supprime l’impôt sur le revenu pour les classes moyennes et augmente en contrepartie la fiscalité des plus riches (bfmtv.com)
Les députés brésiliens ont validé la mesure phare du président Lula visant à exonérer les classes moyennes d’impôt sur le revenu. Elle sera financée par une hausse du taux d’impôt des plus riches qui sera multiplié par quatre.
- Au Chili aussi, on cherche à sortir l’agriculture des pesticides (basta.media)
Au Chili, l’agriculture est tournée vers l’exportation et la consommation de pesticides. Des mouvements agricoles et citoyens tentent d’inverser la tendance, alors que l’homme d’extrême droite José Antonio Kast pourrait devenir le prochain président.
- Perturbateurs endrocriniens : 12 substances au cœur d’une étude XXL (politis.fr)
- Scientists Thought Parkinson’s Was in Our Genes. It Might Be in the Water (wired.com)
Since the 1990s, the number of Americans with chronic disease has ballooned to more than 75 percent of adults, per the CDC. Autism, insulin resistance, and autoimmune diagnoses have reached epidemic proportions. The incidence of cancer in people under the age of 50 has hit an all-time high. If Parkinson’s disease is—as Ray Dorsey believes—a pandemic that’s being caused by our environment, it’s probably not the only one
Spécial IA
- La Chine mise sur l’explosion de la bulle IA aux États-Unis — comprendre le plan Yifu Lin (legrandcontinent.eu)
- Cheap and powerful AI campaigns target voters in India (restofworld.org)
The Bihar state election was awash with voice clones and synthetic videos that reached voters easily and spread misinformation.
- VPNs, ‘old man’ masks, and AI : The holes in the social media ban and their fixes (abc.net.au)
Leading facial age estimation tools were easily fooled by a $22 “old man” mask, a Guy Fawkes mask, and other cheap party costumes, researchers have found.
- En Angleterre, des dizaines de trains mis à l’arrêt à cause d’un hoax généré par IA (clubic.com)
- Un virus sur ChatGPT ! Des milliers de Mac déjà infectés (mac4ever.com)
- LA Unified School District forces unfiltered AI on kids (pivottoai.libsyn.com)
- Kindle’s New Gen AI-Powered “Ask This Book” Feature Raises Rights Concerns (writerbeware.blog)
Ask This Book is, in effect, “an in-book chatbot. You ask any question about the book, and a generative AI process provides you answers.”
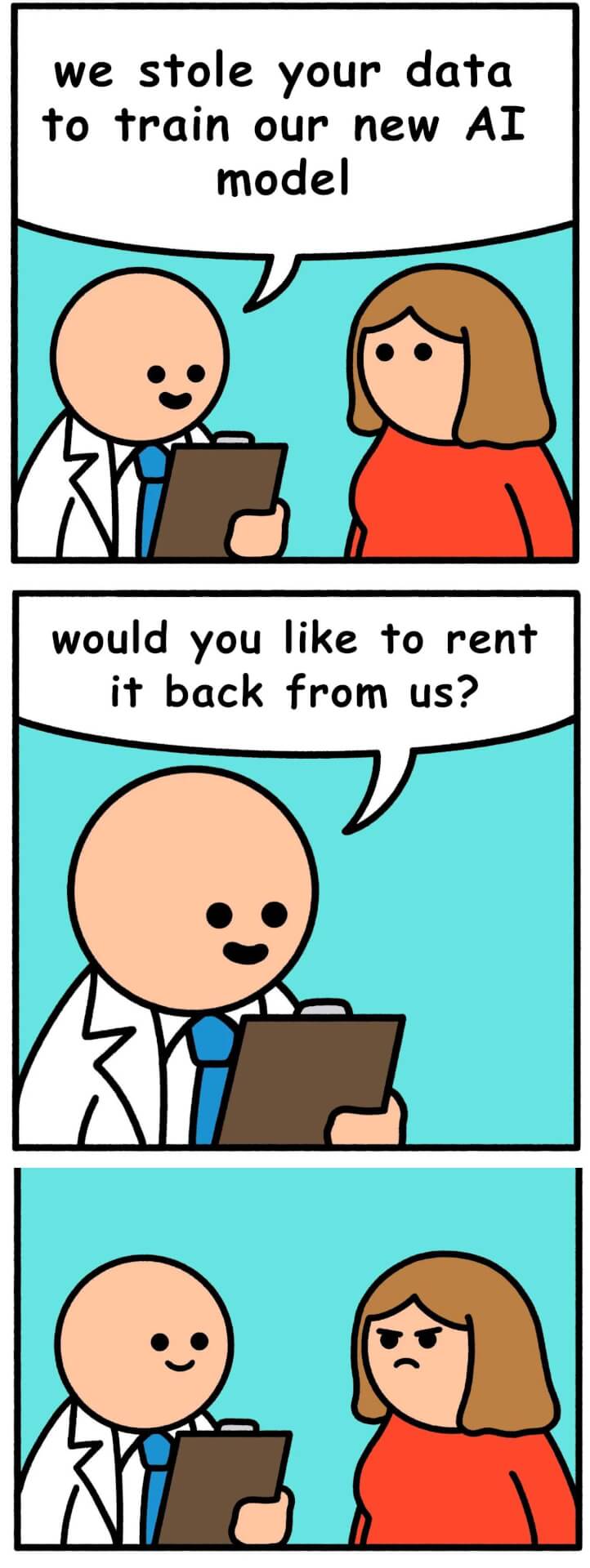
- Deep learning sur des photos d’enfants autistes : des articles scientifiques rétractés (next.ink)
Plusieurs recherches incluant l’entrainement de réseaux de neurones font l’objet d’une attention particulière […] En cause l’utilisation d’une base de données de photos posant des problèmes éthiques concernant le consentement des enfants ayant des troubles autistiques concernés. L’éditeur Springer Nature est en train de rétracter des dizaines d’articles scientifiques.
- OpenAI Staffer Quits, Alleging Company’s Economic Research Is Drifting Into AI Advocacy (wired.com)
OpenAI has allegedly become more guarded about publishing research that highlights the potentially negative impact that AI could have on the economy
- “Everyone is so panicked” : Entry-level tech workers describe the AI-fueled jobpocalypse (restofworld.org)
Engineering graduates face shrinking opportunities and rising pressure to upskill beyond their curriculum. […] Students at engineering colleges in India, China, Dubai, and Kenya are facing a “jobpocalypse” as artificial intelligence replaces humans in entry-level roles. Tasks once assigned to fresh graduates, such as debugging, testing, and routine software maintenance, are now increasingly automated.
- The Emotional Labor Behind AI Intimacy (data-workers.org)
My name is Michael Geoffrey Asia, and I wrote this testimony to tell the story of workers like me who found ourselves trapped in the hidden corners of the AI industry, where human emotion becomes data.
- Donald Trump signe un décret pour limiter les lois contre l’IA (huffingtonpost.fr)
Alors que la plupart des pays cherchent à réguler les pouvoirs de l’IA, le président américain, lui, agit à contre-courant, lui donnant toujours plus de libertés.
Voir aussi Fact Sheet : President Donald J. Trump Ensures a National Policy Framework for Artificial Intelligence (whitehouse.gov)
- Le magazine Time a désigné les “architectes de l’IA” comme les personnalités de l’année (france24.com)
Le magazine américain Time a révélé, jeudi, les personnalités de l’année 2025. Les “architectes” de l’intelligence artificielle (IA) ont été désignés, parmi lesquels le patron d’Open AI Sam Altman, celui de Nvidia Jensen Huang ou celui de xAI Elon Musk.
- OpenAI joins the Linux Foundation’s new Agentic AI Foundation and the open-source world sees smoke and mirrors (nerds.xyz)
- Mozilla’s Betrayal of Open Source : Google’s Gemini AI is Overwriting Volunteer Work on Support Mozilla (quippd.com)
Mozilla’s translation bot on Support Mozilla (that is currently overwriting user contributions is based on the closed source, copyright infringing LLM, Google Gemini. This is in spite of Mozilla claiming that they are at the forefront of open source AI, and belies their exhortations to choose to build open source AI and data sets.

- Vast Number of Windows Users Refusing to Upgrade After Microsoft’s Embrace of AI Slop (futurism.com)
the tech giant’s controversial attempts to shoehorn AI into every aspect of the software appear to have turned off a staggering number of users from upgrading. While it’s to be expected at this point that not everybody will have jumped at the opportunity to update their machine’s operating system, the sheer scale of that refusal is staggering.
- Animation vs intelligence artificielle : la pub “100 % française” qui cartonne à l’international (france24.com)
Une publicité de plus de deux minutes, réalisée par un studio d’animation français pour les fêtes de Noël, est devenue virale avec plus de 20 millions de vues mercredi. “Une centaine de personnes” a travaillé pendant un an sur cette production, un choix artistique largement salué, alors que de grandes marques misent sur l’intelligence artificielle pour leurs spots.
- Conseil de l’intelligence artificielle et du numérique : quelles priorités pour 2026 ? (agora.gouv.fr)
Alors que le CIANum est en train de définir son programme de travail pour l’année à venir, cette consultation vise à recueillir vos priorités et préoccupations sur le numérique et l’intelligence artificielle, afin de guider ses travaux.
- Policy on the use of Generative Artificial Intelligence for NLnet-funded projects (nlnet.nl)
Spécial Palestine et Israël
- Israel’s biggest defence company suspended by NATO amid corruption probe (ftm.eu)
- « La surveillance des Palestinien·nes en Europe est très répandue » (politis.fr)
En Europe, les Palestiniens sont de plus en plus ciblés par les surveillances numériques ou les fermetures de comptes bancaires. Layla Kattermann, responsable de la veille pour l’European Legal Support Center, revient sur ce standard européen de surveillance.
- Vente d’armes à Israël : l’État stoppe les livraisons de composants pour drones fabriqués par l’entreprise Sermat (disclose.ng)
- L’ENS de Lyon mise en demeure pour rompre ses partenariats avec les universités israéliennes complices du génocide (rebellyon.info)
L’ENS de Lyon est partenaire de plusieurs universités israéliennes complices du génocide : Urgence Palestine Lyon, l’association NIDAL et plusieurs syndicats et collectifs étudiants de l’ENS lancent une action en justice.
- Condamné à un an de prison avec sursis en première instance, le responsable de la CGT du Nord de retour au tribunal pour contester la criminalisation du soutien à la Palestine (humanite.fr)
- La fabrique d’un boycott : comment Israël a perdu le charbon colombien (terrestres.org)
Cet article est la version française et enrichie de « The Making of a Coal Boycott. Inside the campaign to break the toxic relationship between Colombian mining and Israeli militarism », une enquête parue dans la revue Jewish Currents en octobre 2025.
- Eurovision winner Nemo to return trophy in protest of Israel (bbc.com)
The 26-year-old Swiss singer said there was a “clear conflict” between Israel’s involvement in the competition and the ideals of “unity, inclusion and dignity” the contest says it stands for.
Spécial femmes dans le monde
- Narges Mohammadi, la prix Nobel de la paix 2023, a été violemment arrêtée en Iran (huffingtonpost.fr)
La journaliste iranienne de 53 ans est en opposition avec le régime des mollahs et elle a déjà passé de nombreuses années en prison pour des délits d’opinion.
- Dans le dossier Epstein, ce « préservatif Trump » ne va pas arranger le cas du président américain (huffingtonpost.fr)
Parmi ces 19 clichés, l’un montre un bol rempli de préservatifs fantaisistes avec une caricature du visage de Donald Trump. Il est inscrit juste au-dessus sur un écriteau : « préservatif Trump, 4,50 dollars ». Et chaque préservatif porte une image du visage du président américain avec le texte : « je suis ÉNOOOORME ! »

- How boys get sucked into the manosphere (stories.theconversation.com)
- On a revu la série “Drôles de dames”… et c’est un carnage (telerama.fr)
Notre journaliste s’est replongée avec appréhension dans la série de son enfance, disponible sur la plateforme de l’INA. Mise en scène sexiste, dialogues paternalistes et intrigues taillées pour ces messieurs : le verdict n’est pas bon.Non sans blague.
- L’invisibilisation des associations féministes sur Meta n’est pas un bug : c’est un choix politique (nouvelobs.com)
- Une moustache, un prénom masculin… et la visibilité explose sur LinkedIn ! (lesnouvellesnews.fr)
- ‘The patriarchy runs deep’ : women still getting a raw deal in the workplace as equality remains a dream (theguardian.com)
Women work longer and per hour earn a third of what men are paid, in figures that have changed little in 35 years, UN report shows
- Les femmes assument une grande partie des tâches domestiques, non rémunérées : Bogota a décidé de les aider (slate.fr)
Depuis 2020, la capitale colombienne a mis en place 25 centres pour épauler et soulager les personnes qui effectuent un travail invisible et gratuit, souvent sans s’en rendre compte. Des programmes d’aide à domicile ainsi que des formations sont également proposés.
- Lili Reinhart diagnostiquée de l’endométriose après des années d’errance : « je suis contente d’avoir écouté mon corps » (huffingtonpost.fr)
L’actrice de « Riverdale » a obtenu un diagnostic après des années d’errance médicale et d’avis contradictoires.
- Et si la masturbation pouvait réduire les effets indésirables de la ménopause ? (theconversation.com)
Une étude récente relayée dans le monde entier suggère que la masturbation pourrait atténuer certains symptômes désagréables chez les femmes en périménopause ou ménopause. Si cette attention médiatique peut surprendre, c’est sans doute parce que la masturbation reste peu évoquée, surtout chez les femmes plus âgées, et apparaît ici comme une stratégie inédite–voire audacieuse–de soulagement.
Spécial France
- Adoption du budget de la Sécurité sociale pour 2026 (projetarcadie.com) – voir aussi Les 8 mesures phares du budget de la Sécu 2026 (rapportsdeforce.fr)

- Le ministère de l’Intérieur victime d’une « attaque informatique » visant « un certain nombre de fichiers » (huffingtonpost.fr)
- Un bug informatique menace de bloquer le RER A et huit lignes de métro en 2038 (leparisien.fr)
Le tribunal administratif de Paris a condamné, jeudi 13 novembre, Alstom à réparer un défaut logiciel grave affectant le RER A, huit lignes de métro et six lignes de tramway. Sans correction, ces rames s’arrêteront le 19 janvier 2038.
- Les nouveaux dangers de la rue pour les malvoyants : “Je n’ai plus de plaisir à aller en ville. Je trouve qu’il y a de plus en plus d’obstacles” (france3-regions.franceinfo.fr)
- Paris-Tarbes, Paris-Berlin, Marseille-Rome… où en est le train de nuit en France ? (vert.eco)
Entre le retour du Paris-Berlin, la fin prématurée du Paris-Vienne et le renouvellement des lignes nationales, difficile de s’y retrouver lorsque l’on souhaite voyager en train de nuit.
- Nucléaire : la justice met un coup d’arrêt au projet de deux EPR2 au Bugey (reporterre.net)
Le tribunal a estimé que l’impact écologique n’avait pas été suffisamment pris en compte, notamment la présence de nombreuses espèces protégées et la proximité de la zone Natura 2000 de l’Isle Crémieux.
- Dermatose nodulaire contagieuse : l’abattage est « la seule solution » selon la ministre de l’Agriculture, la Confédération paysanne appelle à « des blocages partout en France » (humanite.fr)
- Le fermage, ce statut qui protège les paysan·nes des abus des propriétaires terriens (basta.media)
Limiter les pouvoirs absolus de la propriété privée, c’est possible en France pour les terres agricoles grâce au « fermage », un outil juridique mis en place il y a 80 ans, à la Libération.
Spécial femmes en France
- Endométriose : un appel à volontaires des personnes menstruées entre 18 et 45 ans, atteintes ou non d’endométriose, en région parisienne. (politis.fr)
- La Maison de Marthe et Marie, en croisade contre l’avortement (revueladeferlante.fr)
Sous couvert de « colocations solidaires », cette association fait du prosélytisme contre l’avortement. Financée par la galaxie catholique ultraconservatrice – dont le milliardaire d’extrême droite Pierre-Édouard Stérin – elle bénéficie aussi de fonds publics, à l’instar de ceux de la mairie de Paris, qui l’a subventionnée à hauteur de 700 000 euros pour la réhabilitation d’un monastère.
- Mêmes droits pour TOUTES les femmes vivant sur le territoire français ! (politis.fr)
Une tribune du Réseau des associations de femmes des quartiers populaires appelle à une loi-cadre intégrale protégeant toutes les femmes des violences sexistes et sexuelles […] nous constatons que les femmes étrangères en France vivent une quadruple peine
- Réouverture des maisons closes : Quand le RN sort le tapis rouge aux « pulsions sexuelles » des hommes à l’ère #metoo (humanite.fr)
- Brigitte Macron qualifie de « sales connes » des militantes qui ont interrompu un spectacle d’Ary Abittan (huffingtonpost.fr)
La Première dame a été filmée dans les coulisses des Folies Bergère à Paris, à la rencontre de l’humoriste dont le spectacle avait été perturbé la veille.
Voir aussi “S’il y a les sales connes, on va les foutre dehors !” : Brigitte Macron s’emporte contre des militantes féministes qui ont interrompu un spectacle d’Ary Abittan (franceinfo.fr)
Samedi soir, quatre militantes du collectif #NousToutes, portant des masques à l’effigie de l’acteur avec la mention “violeur”, ont interrompu son spectacle dans la salle parisienne des Folies Bergère, scandant “Abittan violeur”.
Et Brigitte Macron se savait filmée au spectacle d’Ary Abittan, l’agence de Mimi Marchand déplore une bourde (huffingtonpost.fr)
D’après Bestimage, agence dirigée par la reine des paparazzi, la vidéo dans laquelle la première dame insulte des militantes de « sales connes » a été diffusée par erreur.
- « Sales connes » : ce que révèle l’antiféminisme ordinaire de Brigitte Macron (frustrationmagazine.fr)
- #salesconnes devient le slogan de ces féministes après les propos de Brigitte Macron (huffingtonpost.fr)
La première dame avait qualifié de « sales connes » des militantes du collectif #NousToutes qui avaient interrompu samedi un spectacle d’Ary Abittan, accusé de viol.
Voir aussi “Sales connes” devient un cri de ralliement féministe qui répond à Brigitte Macron (france3-regions.franceinfo.fr)
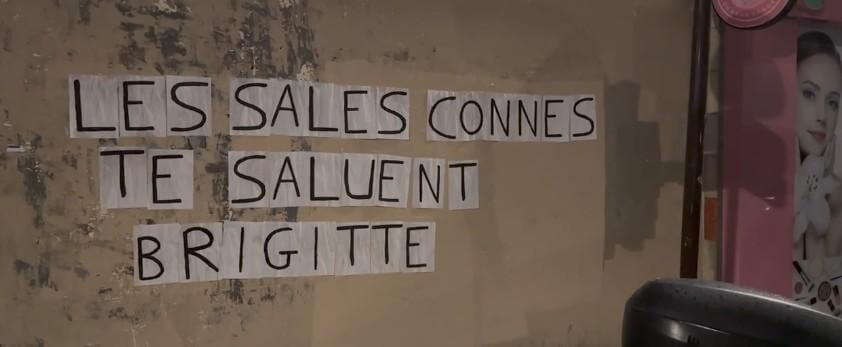
- « Blessée » par Brigitte Macron, la femme qui accuse Ary Abittan parle pour la première fois (huffingtonpost.fr)
« Entendre aujourd’hui des paroles blessantes prononcées par la Première dame, censée œuvrer pour la cause des femmes, me fait me sentir abandonnée et amplifie un traumatisme avec lequel je dois vivre chaque jour »
- Brigitte Macron visée par une plainte après ses propos sur les « sales connes » (huffingtonpost.fr)
L’association des Tricoteuses hystériques a annoncé porter plainte contre la femme du président après son insulte envers des militantes féministes.
- Brigitte Macron et les « sales connes » : Ary Abittan a-t-il été reconnu « non-coupable », comme l’affirme Julien Odoul ? (lessurligneurs.eu)
l’humoriste n’a pas été acquitté : il a bénéficié d’un non-lieu. Autrement dit, il reste présumé innocent, mais la justice ne s’est jamais prononcée sur son innocence ou sur sa culpabilité.
- Le « sales connes » qui cache la forêt (politis.fr)
L’insulte surmédiatisée de Brigitte Macron envers des militantes féministes doit nous indigner… Sans nous faire perdre de vue la stratégie d’inversion de la culpabilité mise en place par Ary Abittan.
- Le comédien Philippe Caubère mis en examen pour « proxénétisme » (huffingtonpost.fr)
Déjà concerné par des mises en examen pour « agression sexuelle », « viol » et « corruption de mineure », l’acteur français est désormais ciblé pour des faits de prostitution.
Spécial médias et pouvoir
- Appel aux ministres de la Justice et de l’Intérieur : respectez la liberté de la presse, renforcez le secret des sources (acrimed.org)
- Entre-soi et connivence : Sarkozy remercie ses soutiens médiatiques (acrimed.org)
Dans le petit monde politico-médiatique, il est une pratique que nul n’ignore : le renvoi d’ascenseur. Dans son livre commis au cours de sa brève détention, Nicolas Sarkozy salue ses plus fidèles soutiens médiatiques.
- Après des propos controversés de Nathalie Saint-Cricq, l’Arcom saisie par LFI et la Grande mosquée de Paris (huffingtonpost.fr)
LFI a annoncé à son tour saisir l’Arcom après que l’éditorialiste a fait un rapprochement entre l’antisémitisme et « la quête du vote musulman » sur « franceinfo ».
- Immigration et école : les relais médiatiques d’un think tank d’extrême droite (acrimed.org)
- Bad buzz, clashs et invités d’extrême droite : Le Crayon, les Cyril Hanouna du web ? (streetpress.com)
- Gros studio, locaux communs, flop… Sur YouTube, les fafs se professionnalisent (streetpress.com)
- Surproduction et concentration dans l’édition : la « bibliodiversité » en danger (journal-labreche.fr)
En 2024, les éditeurs ont publié 65 000 nouveaux titres, soit 12 000 de plus qu’en 2004. Une surproduction qui n’amène pas plus de diversité. Au contraire, la course aux ventes pousse à l’uniformisation et la concentration des éditeurs dans de grands groupes sature le marché. Jusqu’à mettre en péril la pluralité ?
Spécial emmerdeurs irresponsables gérant comme des pieds (et à la néolibérale)
- Dix ans après l’accord de Paris, peu de progrès et beaucoup de questions pour le CAC 40 (multinationales.org)
À l’occasion du dixième anniversaire de l’Accord de Paris sur le climat, l’Observatoire des multinationales dresse le bilan des progrès accomplis – ou non – par les groupes du CAC 40 en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Le chemin semble encore très long…
- Une nouvelle loi va-t-elle bientôt privatiser les barrages… ou les sauver ? (telerama.fr)
Une nouvelle loi devrait arriver bientôt à l’Assemblée nationale pour modifier le statut des barrages. Défendue par l’intersyndicale d’EDF, elle est critiquée en interne par des experts du secteur hydraulique. L’enjeu : leur éventuelle privatisation.
- Grandir à Mayotte : UNICEF alerte sur un territoire où l’enfance vacille après Chido (parallelesud.com)
Un an après le passage du cyclone Chido […] Mayotte peine encore à se relever. L’archipel, déjà fragilisé par la pauvreté, l’insécurité et des infrastructures sous-dimensionnées, a connu l’une des pires crises humanitaires de son histoire récente […] les enfants mahorais, qui représentent un habitant sur deux, sont les premières victimes d’un cumul de crises sans précédent.
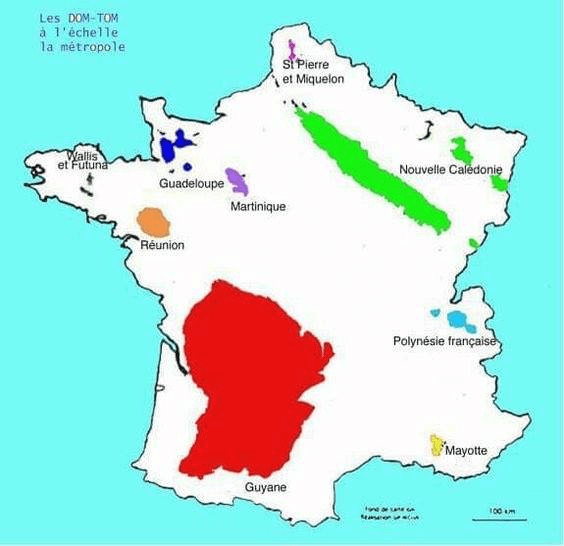
- Evars : contre la désinformation, des députés sensibilisés à l’éducation à la sexualité (basta.media)
L’éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité (Evars) est prévue dans la loi depuis 2001. Pourtant, ce n’est toujours pas appliqué. Alors, contre les préjugés, des associations tentent de former les parlementaires.
- Police : la gabegie du logiciel Scribe (politis.fr) – voir aussi Police : Le coût des défaillances d’un logiciel de rédaction de procès-verbaux estimé à 257 millions d’euros (20minutes.fr)
La Cour des comptes décrit un projet « au contenu mal défini », « des irrégularités comptables significatives » et conclut à un « préjudice financier significatif »
Spécial recul des droits et libertés, violences policières, montée de l’extrême-droite…
- Extrême droite : Alexandre Allégret-Pilot, le député de la vulgarité et du clash permanent (blast-info.fr)
Élu député du Gard en 2024, le ciottiste Alexandre Allégret-Pilot multiplie invectives, provocations et affabulations, parfois teintées de misogynie et de virilisme.
- D’abord interdit, un festival antifa finalement autorisé à Villeurbanne (liberation.fr)
Plusieurs soirées avaient été ciblées par un arrêté pour des risques de « troubles à l’ordre public » mais le tribunal administratif annulé cette décision, jeudi 11 novembre. […] L’interdiction de la préfecture était survenue après la diffusion de messages antipolice samedi soir à Lyon lors de la Fête des lumières, revendiqués localement par le mouvement écologiste des Soulèvements de la Terre, et au sujet desquels la préfète a saisi la justice. Le public avait pu lire sur la façade du musée des Beaux-Arts des messages lumineux qui disaient notamment « La police blesse et tue », « Non à l’Etat policier », « La violence policière est partout » ou encore « Sainte-Soline, ni oubli, ni pardon » et « On dégage le RN ».
- Un CRS tire deux balles en pleine rue à Nantes : encore un mensonge policier (contre-attaque.net)
La presse assurait que le CRS défendait sa vie face à un motard qui lui fonçait dessus, une vidéo prouve l’inverse.
- A69 : quand un commando nocturne de chefs d’entreprise et d’élus voulait intimider des anti-autoroute (reporterre.net)
cinq chefs d’entreprise, dont deux élus, un sous-traitant du concessionnaire et un de leurs camarades de rugby, tous favorables à l’A69, sont convoqués devant le tribunal correctionnel de Castres le 7 avril 2026 pour des faits de « dégradations en réunion », « divulgation d’informations personnelles » et « association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit ».
Voir aussi « Ce soir, prévoyez frontale et cagoule » : dans les rouages du commando pro-A69 (reporterre.net)
- Réaction à l’acte de vandalisme contre le siège national de la LPO par la coordination rurale (faunesauvage.fr)
Tags injurieux, dépôt de pneus ou de ballots de paille surmontés d’une tête de sanglier décapitée : nous dénonçons fermement des pratiques d’intimidation inacceptables et indignes. Si cette colère est compréhensible, elle se trompe d’adversaires. Les véritables responsables des difficultés des agriculteurs ne sont pas les associations de protection de la nature. Nous partageons la même exigence de préserver des sols vivants et une biodiversité indispensable à la production alimentaire ainsi qu’à la santé des écosystèmes.
- JO 2030 : Reporterre empêché d’organiser une conférence dans les Hautes-Alpes (reporterre.net)
Reporterre a été empêché par la mairie de Villar-Saint-Pancrace, dans la vallée de Briançon, d’y organiser une conférence sur les Jeux olympiques 2030. L’événement a dû être déplacé dans une autre ville des Hautes-Alpes.
- 6 ans, malade, à la rue : le juge condamne, l’OFII remet pourtant la famille à la rue (blogs.mediapart.fr)
- Au tribunal, les personnes aux troubles psy sont enfermées malgré l’obligation de soin (streetpress.com)
Spécial résistances
- Contre-fête des Lumières, pas de lumières pour l’extrême-droite (rebellyon.info)
Samedi 6 décembre au soir, une petite perturbation a pu être observée place des Terreaux à la fin de l’attraction prévue pour la fête des Lumières. Quand vient le moment d’indiquer la sortie de la place, un certain nombre de messages sont projetés à distance sur les grands murs du Musée des Beaux-arts.
- Des militants écologistes repeignent la place de l’Étoile en orange (reporterre.net)
Vendredi 12 décembre en fin de matinée, des militants des ONG Greenpeace, Action non-violente COP21 et Action Justice Climat ont repeint en orange les pavés de la place de l’Étoile, où se dresse l’Arc de Triomphe, au bout des Champs Élysées, à Paris. Une action symbolique visant à dénoncer le manque d’actions ambitieuses sur le climat, depuis les 10 ans de l’Accord de Paris, signé le 11 décembre 2015.
- Résister syndicalement à l’imposition des IA dans nos métiers (snes.edu)
L’année scolaire 2024-2025 a vu se déployer l’offensive du ministère pour introduire les IA dans l’Éducation nationale. La publication d’un « cadre d’usage des IA dans l’Éducation » s’apparente de fait à un plan de développement. D’autant que dans les nombreuses formations proposées ou imposées aux collègues ne sont quasiment jamais mis en avant les recommandations officielles appelant à renoncer aux IA
- Grève dans le champagne LVMH : « On ne s’interdit pas un mouvement plus ample » (rapportsdeforce.fr)
- “Des chiffres et des lettres” : virés par France 3, les ex-présentateurs gagnent aux prud’hommes (telerama.fr)
Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat, licenciés après quarante-sept et trente-six ans de CDD, réclamaient que leurs contrats soient requalifiés en CDI. Les prud’hommes ont tranché en leur faveur.
Spécial outils de résistance
Spécial GAFAM et cie
- How Google Maps quietly allocates survival across London’s restaurants – and how I built a dashboard to see through it (laurenleek.substack.com)
I wanted a dinner recommendation and got a research agenda instead. Using 13000+ restaurants, I rebuild its ratings with machine learning and map how algorithmic visibility actually distributes power.
- Google unveils plans to try again with smart glasses in 2026 (bbc.co.uk)
- Meta accused of banning LGBTQ+ accounts in one of its “biggest waves of censorship” ever (lgbtqnation.com)
Meta – the parent company of Instagram, Facebook, Threads, and WhatsApp – has reportedly disabled or shadow-banned the accounts of more than 50 abortion providers, queer organizations, and reproductive healthcare organizations around the world over the past few months.
- Plusieurs associations féministes s’insurgent de leur invisibilisation par Meta (next.ink)
- 20 Years of Digital Life, Gone in an Instant, thanks to Apple (hey.paris)
- Les autorités suisses recommandent d’éviter les applications SaaS, y compris Microsoft 365 (channelnews.fr)
L’autorité responsable de la protection des données en Suisse, Privatim, a publié le 18 novembre 2025 une résolution appelant les organismes publics suisses à éviter d’utiliser les solutions SaaS des hyperscalers internationaux tels que Microsoft, Google ou Amazon, pour des raisons de sécurité.
- L’ascension de Linux : le géant Windows est-il vraiment en danger ? (generation-nt.com)
Longtemps cantonné à une niche d’experts, Linux connaît une croissance spectaculaire sur les PC de bureau. Sa part de marché a triplé en quatre ans, largement alimentée par des utilisateurs fuyant un Windows jugé trop contraignant. Entre la fin du support de Windows 10 et l’essor du gaming, l’OS libre est devenu une alternative crédible pour des millions de personnes.
Les autres lectures de la semaine
- The Authoritarian Stack (authoritarian-stack.info)
How Tech Billionaires Are Building a Post-Democratic America — And Why Europe Is Next
- « Quand une démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet » (lareleveetlapeste.fr)
- À l’opposé du fascisme (inventif.fr)
- Pathologiser les révoltes (histoirescrepues.fr)
La drapétomanie n’est pas un fait médical : c’est une invention politique. Elle traduit la peur des propriétaires esclavagistes de voir leurs esclaves se révolter, et leur volonté de rationaliser l’esclavage sous couvert de science. En nommant la fuite « folie », on efface le sens politique de l’acte : la recherche de liberté. L’esclave qui s’échappe n’est plus un sujet résistant, mais un « malade » qu’il faut soigner ou punir.
- L’histoire de Heinz, ou pourquoi le ketchup est si sucré (multinationales.org)
Derrière le ketchup tel qu’on le connaît aujourd’hui, il y a un homme d’affaires de Pittsburgh, fils d’immigrés allemands, pionnier de l’industrie agroalimentaire : Henry Heinz.
- How Frank Gehry (RIP) and the Guggenheim Museum Bilbao Changed Architecture (openculture.com)
- John Brinkley, le médecin charlatan qui rendait les hommes chèvres (littéralement) (slate.fr)
Promettant de « rendre leur virilité » à ses patients impuissants, ce faux docteur et véritable escroc américain leur “greffait” des testicules de bouc, au début du XXe siècle, dans le Kansas.
- L’ADN du Moyen Âge (laviedesidees.fr)
La génétique s’invite dans les débats sur le haut Moyen Âge : en articulant données biologiques, archéologiques et historiques, elle renouvelle l’étude des migrations et des identités, loin des modèles raciaux et des récits figés d’origine des peuples européens.
- Dans l’Italie du XVIIIe siècle, les femmes s’insurgeaient contre le harcèlement sexiste et sexuel subi dans les confessionnaux (theconversation.com)
Blagues obscènes, questions intrusives, gestes déplacés : les archives inquisitoriales du Vatican montrent que le harcèlement sexuel au confessionnal était une réalité pour de nombreuses femmes dans l’Italie du XVIIIᵉ siècle – et que certaines ont osé le signaler.
- Dans le Haut-Karabagh défiguré, la quête d’un papillon au nom du père (revue21.fr)
- “The Matilda Effect” : How Pioneering Women Scientists Have Been Written Out of Science History (openculture.com)
Les BDs/graphiques/photos de la semaine
- Sales connes
- Héros
- Service
- Tableau périodique
- Couleurs
- Flights
- Incredible
- Dom-Tom
- Dossier partagé
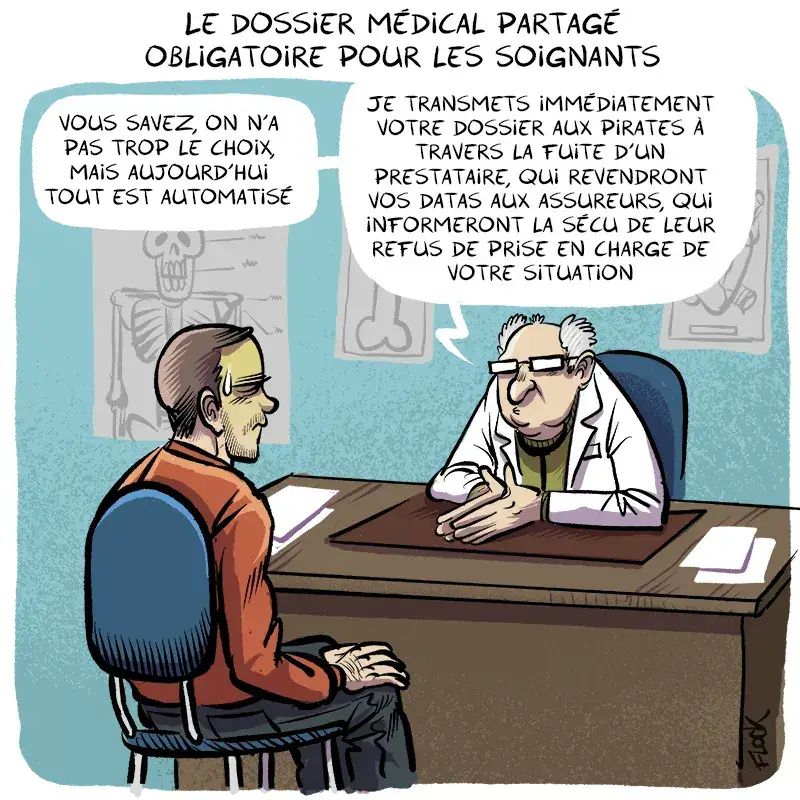
- Data
- Evolution
- Person of the year
- Mozilla
- Mental health
Les vidéos/podcasts de la semaine
- Saison VI • Episode 4 • Brésil : La COP30 est une mascarade (audioblog.arteradio.com)
- Comment gagner la bataille culturelle ? Le cas Mamdani (humanite.fr)
- Colonisation, voile, police, immigration… le programme d’Édouard Philippe (humanite.fr)
Le top 5 des pires questions de Jean-Michel Apathie et des pires réponses d’Édouard Philippe dans l’émission “objectif 2027” sur LCI.
- Louis Sarkozy chez Kaamelott (tube.fdn.fr)
- Université : quand les femmes forçaient ses portes (radiofrance.fr)
Conquérir l’Université, ce fut une double bataille dont les pionnières vont avoir ici toute leur place. D’abord celle des étudiantes forçant peu à peu les portes des amphithéâtres sous le regard étonné, inquiet ou goguenard de leurs camarades masculins et imposant leur talent et leur détermination pour arracher des diplômes longtemps interdits ou hors de portée. Mais aussi la lutte des femmes pour l’accession aux fonctions d’enseignement, à tous les niveaux, et non pas seulement subalternes.
Les trucs chouettes de la semaine
- 1,2 million d’utilisateurices : la France réussit le plus gros déploiement open source de l’histoire (goodtech.info)
- PeerTube v8 : gérez vos vidéos en équipe ! (framablog.org)
Nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie de la version 8 de PeerTube ! Dans cette version, parmi d’autres nouveautés, vous trouverez un nouveau design pour le lecteur vidéo, une amélioration de l’expérience pour importer des vidéos et la possibilité de partager la gestion d’une chaîne avec d’autres comptes.
- Hurray ! This German State Decides to Save €15 Million Each Year By Kicking Out Microsoft for Open Source (itsfoss.com)
Schleswig-Holstein’s migration to LibreOffice reaches 80 % completion, with a one-time €9 million investment on cards for 2026.
- Groundbreaking monolingual Irish dictionary launched (rte.ie)
A groundbreaking new monolingual dictionary by Foras na Gaeilge that provides people with a new way to understand, use and learn the Irish language, without relying on dictionaries in English or in other languages, has gone live.
- L’incroyable sens de l’orientation des pigeons enfin expliqué (humanite.fr)
Une étude confirme l’hypothèse ancienne selon laquelle le sens de l’orientation de ces oiseaux est logé dans leur oreille interne.
Retrouvez les revues de web précédentes dans la catégorie Libre Veille du Framablog.
Les articles, commentaires et autres images qui composent ces « Khrys’presso » n’engagent que moi (Khrys).
09.12.2025 à 10:08
PeerTube v8 : manage your videos with your team !
Framasoft
Texte intégral (3333 mots)
We’re thrilled to announce the release of PeerTube v8 !
This version features a redesigned video player, an improved experience for importing videos and the ability to share channel management with other accounts !
This new theme is named Lucide, in reference to the new icons used. It has been designed to be cleaner in order to better highlight the content.
Instead of bold, imposing icons, we opted for a more discreet style with finer lines on the buttons.
We also reworked the volume adjustment button to hide the volume state by default.
Finally, we moved the peer-to-peer information to the « Stats for nerds » menu, which is accessible by right-clicking on the player.
These few improvements breathe new life into PeerTube, giving it a more modern and professional look. They accomplish this by limiting the displayed information to what is strictly necessary. , as they say !
If you prefer the old theme, don’t worry, it’s still available ! You can choose the player theme at the platform, channel, or video level.
These changes are in line with all the design improvements we’ve made this year. With each update, PeerTube becomes more customizable, allowing you to create a video platform that reflects your personality !
Manage your channels as a team
Since PeerTube,’s inception, many have asked us to add the ability to collaboratively manage a channel. This is, by the way, one of the most requested feature on our platform dedicated to idea suggestions !
Although use cases can very, it is often a critical need for organizations where several people are responsible for uploading new videos.
We are therefore delighted to announce that the collaborative channel management is now possible with PeerTube !
Thanks to this new feature you can now designate other members of your platform as editors.
Thus, a channel editor will be able to publish new videos, update or delete videos, playlists and comments, as well as add or delete synchronizations and update channel information !
Please note that editors cannot add or remove other editors, or delete the channel.
Of course, as with each new major version, many other improvements have been made.
Some are invisible to the general public, such as ilfarpro’s contribution, which adds the ability to generate storyboards (you know, the thumbnails that display the different images from a video when you hover over the progress bar) through a remote runner instead of the PeerTube server.
Others, however, are much more visible !
For example, this is the case with the improvements made to the system for importing videos and channels from other platforms.
It is now possible to manually rerun a failed import. Also, in the case of a channel synchronization, PeerTube will try to run again a failed import after some time (at the next verification for synchronization, which interval, being 1h by default, is configurable by the platform’s admin).
Finally, information about the status of a video import is now available in the video management page.
Another new improvement is that we have redesigned the appearance of notifications to better match PeerTube’s overall theme !
A complete list of all changes made in this version is available in the dedicated changelog.
The year 2025 was marked by numerous advancements for the PeerTube project as a whole.
In total, we will have released four versions of PeerTube, all of which adhere to the guiding principle of making PeerTube easier for organizations to use.
Indeed, thanks to an NLnet grant, we were able to incorporate important features for this type of audience into the updates.
Keeping this in mind, we improved PeerTube’s design this year and made it easier to customize. Previous versions included the ability to translate PeerTube emails, a redesigned the « About » and « Video Management » pages, and an improved interface for easier batch batch action management (e.g. deleting videos) !
We also added — and this was the big feature in version 7.3 ! — a configuration wizard to help admins set up their platform according to their profile (institution, community, or individual).
Among other major improvements this year, we can also mention a new moderation tool that allows you to monitor certain words, making it much easier to track comments on your videos or platform !
Finally, thanks to a previous NLnet grant, but also because it was important to us : we completely redesigned the management of sensitive content.
We have long known that people’s sensitivity to a subject varies greatly and that the old system was too simplistic to truly meet the needs of video creators and their audiences.
That’s why we collaborated with La Coopérative des Internets to design system that is more complex (but not more complicated) yet more true to reality !
Institutional recognition and adoption
This recognition reinforces our confidence in the choices (both technical and political) we have made to ensure that PeerTube is a project that serves everyone.
When platforms like YouTube seem to continue to enshittify daily, more and more organizations (particularly medias outlets and institutions) are contacting us to make PeerTube their backup or even primary solution for hosting their videos.
We’re really proud to see that PeerTube truly meets the needs of all these organizations allowing them to create a video platform that they control and that respects their viewers.
First, regarding the mobile app, we aim to finalize the features promised during the crowdfunding campaign , including background video playback, live streaming, and TV apps.
If all goes well, background video playback should be available in early 2026 !
Regarding the PeerTube project as a whole, we would like to improve the experience for newcomers by reducing the effort required to find their first PeerTube platform !
The project is still in the planning stages and we still have a lot of work before it can happen. However, our ambitions could have a serious impact on the PeerTube ecosystem and we can’t wait to get started !
Early next year, we will publish the PeerTube project’s traditional roadmap. There, you will find more details about our vision for PeerTube in 2026. We are shaping this vision based on your ideas, so please feel free to share your suggestions on our dedicated platform !
To keep up with all our news (roadmap announcements, new projects, upcoming updates, etc.), you can subscribe to our social media channels and our newsletter.
PeerTube is developed by Framasoft, a french non-profit association raising awareness about digital issues. Framasoft is currently running a fundraising campaign to finance the year 2026.
At the time of writing, there are just over three weeks left to reach our goal of €250,000. However, we have only raised 24 % of this target so far.
So if you appreciate PeerTube and would like to support its development, please consider making a donation (66 % tax deductible for French residents) and help build a bright future for PeerTube !
The illustrations were created by David Revoy and are licensed under CC-BY 4.0.
09.12.2025 à 09:00
PeerTube v8 : gérez vos vidéos en équipe !
Framasoft
Texte intégral (4340 mots)
Pour la première fois depuis le développement de PeerTube, nous avons réalisé un nouveau thème pour le lecteur vidéo !
Gérez vos chaînes en équipe
Les illustrations ont été réalisées par David Revoy et sont sous licence CC-BY 4.0.
08.12.2025 à 07:42
Khrys’presso du lundi 8 décembre 2025
Khrys
Texte intégral (8444 mots)
Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour découvrir les informations que vous avez peut-être ratées la semaine dernière.
Tous les liens listés ci-dessous sont a priori accessibles librement. Si ce n’est pas le cas, pensez à activer votre bloqueur de javascript favori ou à passer en “mode lecture” (Firefox) ;-)
Brave New World
- In Myanmar, illicit rare-earth mining is taking a heavy toll (arstechnica.com)
Uncontrolled mining in areas of Myanmar ruled by powerful ethnic armies has boomed.
- India orders smartphone makers to preload state-owned cyber safety app (reuters.com)
- « Tout brûler jusqu’à la Manche » : face à l’Occident, la diplomatie russe appelle au sang (legrandcontinent.eu)
- The missile meant to strike fear in Russia’s enemies fails once again (arstechnica.com)
A Russian intercontinental ballistic missile (ICBM) fired from an underground silo on the country’s southern steppe Friday on a scheduled test to deliver a dummy warhead to a remote impact zone nearly 4,000 miles away. The missile didn’t even make it 4,000 feet.
- La Norvège taxe les ultra-riches, et ça marche ! (lareleveetlapeste.fr)
En 2023, 654 947 citoyen·nes étaient concerné·es par cette taxe, soit 12 % de la population. Elle a rapporté 2,5 milliards d’euros cette année-là.
- Une victoire « historique » : la Norvège repousse de 4 ans l’exploitation de ses fonds marins (reporterre.net)
- « Ils ont détruit notre mer » : en Syrie, les trous béants laissés par la guerre (reporterre.net)
En Syrie, la guerre n’a pas seulement frappé les villes et les bâtiments : elle a aussi ravagé la mer Méditerranée. Fonds marins appauvris, poissons rares… Les pêcheurs locaux se battent pour leur survie.
- Le Niger annonce vouloir porter plainte contre le géant français du nucléaire Orano (rfi.fr)
Dans un nouvel épisode dans les tensions entre le Niger et Orano, Niamey a annoncé mardi 2 décembre son intention de porter plainte contre le groupe français. Le ministre nigérien de la Justice a expliqué lors d’une conférence de presse que des éléments radioactifs ont été découverts à Madaoulela, dans le nord du pays. Le Niger et Orano s’opposent déjà depuis plusieurs mois autour de l’uranium de la Somaïr, nationalisée en juin dernier.
- « On jette les agriculteurices dans les bras de grands groupes internationaux » : l’Union européenne en passe d’autoriser la propagation de « nouveaux OGM » (humanite.fr)
- À Budapest, vivre sans toit, c’est défier la loi (alterechos.be)
Restriction des hébergements d’urgence, suppression des aides au logement, interdiction de dormir dehors… En Hongrie, plus de 5.000 personnes vivent dans la rue chaque soir. Face à cet abandon du gouvernement, l’association des avocats de rue « Utcajogász » combat cette injustice en leur offrant une assistance juridique en matière de logement.
- En Allemagne, une mobilisation massive contre l’extrême droite (politis.fr)
Près de 50 000 personnes venue de tout le pays se sont rassemblées ce week-end à Gießen pour empêcher le parti d’extrême droite Alternative für Deutschland (AfD) de reformer sa faction jeune, auto-dissoute huit mois plus tôt.
- Game Over pour Cryptomixer – Europol débranche violemment la machine à laver préférée des cybercriminels (gigawatts.fr)
- EU “Chat Control” Twist : Commissioner Sides with Parliament Over Governments (patrick-breyer.de)
While EU member state governments continue to push for mass scanning of private messages (at the discretion of providers), mandatory age verification for all users, and effective bans on communication apps for under-17s, the Parliament enters negotiations with a clear alternative model : Mandatory but targeted surveillance only where reasonable suspicion exists and with a judicial warrant, alongside a firm rejection of mandatory age checks and app lockouts for teenagers.
- UK pushes ahead with facial recognition expansion despite civil liberties backlash (theregister.com)
Plan would create statutory powers for police use of biometrics, prompting warnings of mass surveillance
- UK is running out of water – but data centres refuse to say how much they use (inews.co.uk)
- Le bipartisme c’est terminé : comment la vague populiste d’extrême droite balaye les « démocraties’’ occidentales (slate.fr)
Des États-Unis à la France en passant par l’Allemagne et les Pays-Bas, les partis d’extrême droite atteignent des niveaux historiques. Leur influence grandissante met sous pression les démocraties libérales, fragilisées par des crises institutionnelles à répétition.
- Second Texas university system to restrict race and gender course content (statesman.com)
- Grokipedia – Le monument de la connaissance rêvé par Elon Musk n’est qu’un immense naufrage numérique (gigawatts.fr)
- McDonald’s sales are slumping because people can’t afford fast-food (cbsnews.com)
- Coca-Cola, Nestlé… San Francisco poursuit 10 géants de la malbouffe (reporterre.net)
San Francisco, au nom de l’État de Californie, a engagé le 2 décembre une procédure judiciaire inédite contre dix géants de l’alimentation ultratransformée, parmi lesquels Coca-Cola, Nestlé et PepsiCo, les accusant d’avoir provoqué une « crise de santé publique ».
- Luigi Mangione est de retour devant la justice (huffingtonpost.fr)
Le jeune homme de 27 ans est attendu pour une audition préliminaire au tribunal de New York, il est poursuivi pour leur meurtre du PDG d’une compagnie d’assurances[…]L’objectif de ses avocats est clair : empêcher les procureurs d’utiliser certaines preuves que les procureurs disent accablantes pour l’Américain de 27 ans, qui a plaidé non coupable.
- Cette plainte du « New York Times » n’arrange pas le Pentagone déjà dans la tourmente (huffingtonpost.fr)
Le New York Times a annoncé ce jeudi 4 décembre avoir lancé une action en justice contre le Pentagone, pour avoir mis en œuvre une série de mesures restrictives à l’égard de la presse qu’il juge contraires à la Constitution.
- What Chicago’s fight against ICE can teach us all about how to resist oppression (theguardian.com)
Hannah Arendt discussed the term Gleichschaltung, roughly translatable as “coordination” or “synchronisation”. It came from the Nazi justice minister Franz Gürtner to mean, broadly, that all political, social, cultural and civic institutions had to fall in line with the totalitarian state. Such a thing can only be achieved with the complicity of everyone : the minute-by-minute decisions of people who will do anything, personally or professionally, to stay with the majority. […] only about 15 % of people resisted nazism. It wasn’t because they were fervent supporters, or even, at the outset, because they were scared, but because that’s where the herd was. […] Don’t wait until your government is so racist that it’s lifting people off ladders while they are trying to work, or seizing kids as they are trying to get to school, before you protest. Every time you hear aggressive xenophobia and racist insinuation from those in power and check in with how it polled before you say it’s disgusting, you are building the herd that will suffocate opposition when it matters.
- Colombia bans all new oil and mining projects in its Amazon (news.mongabay.com)
- The Rise of Chile’s Hard Right (jacobin.com)
The first round of voting in Chile’s general election in November saw the shocking rise of the far right and the collapse of the country’s new left. It’s a crushing but not total defeat for the movement helmed by President Gabriel Boric.
- Glyphosate : une étude favorable à l’herbicide enfin désavouée et dépubliée (reporterre.net)
Vingt-cinq ans après sa publication, l’étude a pourtant largement été citée par les défenseurs de l’herbicide le plus vendu au monde. « Cet article a eu une influence considérable sur les décisions réglementaires concernant le glyphosate et le Roundup pendant des décennies »
- Satellite megaconstellations will threaten space-based astronomy (nature.com)
- Le spyware d’État Predator peut maintenant exploiter l’affichage des pubs mobiles pour vous infecter sans clic (clubic.com)
- Les revenus des grandes entreprises de l’armement ont atteint leurs niveaux les plus élevés en 2024 (legrandcontinent.eu)
Spécial IA
- L’IA générative, « instrument de précision » pour la censure et la répression en Chine (next.ink)
- In comedy of errors, men accused of wiping gov databases turned to an AI tool (arstechnica.com)
Two sibling contractors convicted a decade ago for hacking into US State Department systems have once again been charged, this time for a comically hamfisted attempt to steal and destroy government records just minutes after being fired from their contractor jobs. Despite their brazen attempt to steal and destroy information from multiple government agencies, the men lacked knowledge of the database commands needed to cover up their alleged crimes. So they allegedly did what many amateurs do : turned to an AI chat tool.
- “Je suis horrifié” : l’IA de Google efface l’intégralité du disque D d’un utilisateur, le désastre du “vibe coding” (clubic.com)

- Syntax hacking : Researchers discover sentence structure can bypass AI safety rules (arstechnica.com)
Researchers from MIT, Northeastern University, and Meta recently released a paper suggesting that large language models (LLMs) similar to those that power ChatGPT may sometimes prioritize sentence structure over meaning when answering questions.
- Quand l’IA fait n’importe quoi, le cas du gratte-ciel et du trombone à coulisse (theconversation.com)
- ‘End-to-end encrypted’ smart toilet camera is not actually end-to-end encrypted (techcrunch.com)
The security researcher also pointed out that given Kohler can access customers’ data on its servers, it’s possible Kohler is using customers’ bowl pictures to train AI.
- OpenAI desperate to avoid explaining why it deleted pirated book datasets (arstechnica.com)
OpenAI may soon be forced to explain why it deleted a pair of controversial datasets composed of pirated books, and the stakes could not be higher.At the heart of a class-action lawsuit from authors alleging that ChatGPT was illegally trained on their works, OpenAI’s decision to delete the datasets could end up being a deciding factor that gives the authors the win.
Voir aussi OpenAI loses fight to keep ChatGPT logs secret in copyright case (reuters.com)
- OpenAI declares ‘code red’ as Google catches up in AI race (theverge.com)
Google’s own ‘code red’ response to ChatGPT has started paying off.
- Google’s toying with nonsense AI-made headlines on articles in the Discover feed (pcgamer.com)
With the power of AI, data centres the size of a kolkhoz can now write clickbait instead of underpaid journalists at struggling websites.
- Une start-up de 8 employés publie 3 000 podcasts par semaine, générés par IA (next.ink)
- AI is Destroying the University and Learning Itself (currentaffairs.org)
Students use AI to write papers, professors use AI to grade them, degrees become meaningless, and tech companies make fortunes. Welcome to the death of higher education.
- The hidden Kenyan workers training China’s AI models (restofworld.org)
An unemployment crisis has created fertile ground for companies to step in with opaque systems built on WhatsApp groups, middlemen, and bargain-basement wages.
- The Reverse Centaur’s Guide to Criticizing AI (pluralistic.net)
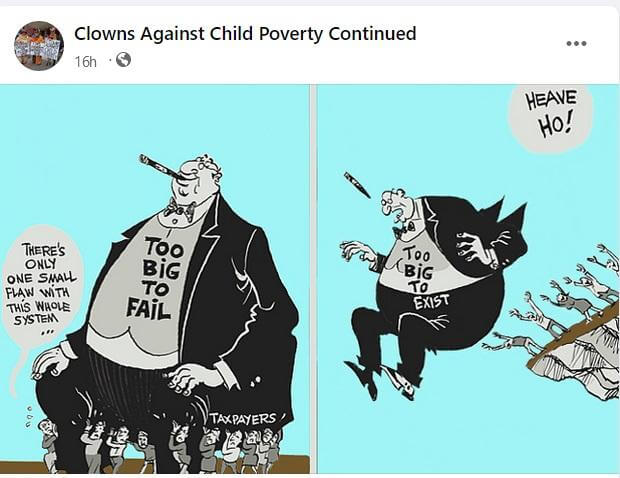
RIP
- Frank Gehry, architecte visionnaire et maître du déconstructivisme, est mort (france24.com)
L’architecte américano-canadien Frank Gehry, l’un des rares de sa profession à s’être hissé au rang de superstar à travers la planète, est mort vendredi à l’âge de 96 ans.
Spécial Palestine et Israël
- Le huitième front (monde-diplomatique.fr)
Israël a perdu les faveurs de l’opinion publique américaine (lire « Même les Américains se lassent d’Israël »). Conscient du péril, le premier ministre Benyamin Netanyahou a annoncé l’ouverture d’un « huitième front », la « bataille pour la vérité », afin de reconquérir les cœurs et les esprits […] Il a chargé la société Clock Tower X d’inonder les réseaux sociaux américains de contenus « calibrés pour la génération Z ». Cette agence doit également créer une myriade de pages Internet destinées à orienter les réponses de ChatGPT ou Grok. Des influenceurs, rémunérés jusqu’à 7 000 dollars par publication, complètent l’opération. Mais il faut aussi faire disparaître ce que les gens ne doivent plus voir. Tout est alors affaire d’algorithme. Concernant X, M. Netanyahou ne s’inquiète pas (« Elon [Musk] est un ami, nous allons lui parler »). Le problème viendrait surtout de TikTok.
- Marwan Barghouti : 200 célébrités demandent la libération du “Mandela palestinien” (france24.com)
Musicien·nes, acteurices, écrivain·es… plus de 200 célébrités ont signé mercredi une lettre ouverte pour soutenir la campagne de libération de Marwan Barghouti. Emprisonné depuis plus de 20 ans en Israël, cette figure du Fatah est considéré par beaucoup comme le possible dirigeant d’un futur État palestinien.
- Contre Benjamin Netanyahu, ces Israéliens manifestent à Tel Aviv avec des bananes (huffingtonpost.fr)
Le Premier ministre d’Israël a officiellement demandé une grâce présidentielle dans son procès pour corruption. Ses opposants dénoncent une « république bananière ».
- Eurovision : quatre pays se retirent face au maintien d’Israël, la France se félicite d’avoir « contribué à empêcher un boycott » (humanite.fr)
- La Via Campesina condamne fermement les attaques contre son organisation membre en Palestine et dénonce les arrestations arbitraires (viacampesina.org)
- La tech israélienne de l’eau accueillie en catimini dans le sud de la France (reporterre.net)
La goutte de trop. La rencontre organisée le 3 décembre entre des entreprises israéliennes de l’eau et des acteurs français du secteur ne passe pas. Dans une lettre ouverte au président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Renaud Muselier, une quinzaine de collectifs et associations engagés sur l’eau et le soutien à la Palestine demandent l’annulation de l’événement.
Spécial femmes dans le monde
- LinkedIn favoriserait les profils masculins (humanite.fr)
Plusieurs utilisatrices ont commencé, le mois dernier, à […] mettre à jour leur présentation et leurs publications en les masculinisant. Résultat : une audience et des interactions qui grimpent. L’une a vu sa visibilité augmenter de 244 %, d’autres ont constaté la montée en flèche des mentions j’aime, des commentaires et des partages. Les posts d’une journaliste de l’AFP ont enregistré des milliers de clics supplémentaires.
- Only three out of ten ambassadors from European Union countries are women (civio.es)
Finland is the only EU country with a female majority while at the other extreme, in Italy and Czechia, men dominate the diplomatic corps.
- Terreur, viols, meurtres… Le quotidien épouvantable des femmes qui migrent du Soudan vers le Soudan du Sud (theconversation.com)
- 6 décembre : voici pourquoi le Canada doit reconnaître le crime de féminicide (theconversation.com)
Cela fait 36 ans que le massacre de 14 jeunes femmes a eu lieu à l’École Polytechnique de Montréal. Un homme les a abattues parce qu’elles étaient des femmes.Qualifié d’acte « violent de misogynie » par le gouvernement fédéral, ce massacre n’a pourtant jamais été officiellement qualifié de féminicide au Canada, malgré sa reconnaissance mondiale.
- Woman Hailed as Hero for Smashing Man’s Meta Smart Glasses on Subway (futurism.com)
Spécial France
- France Télécom : condamné dans l’affaire des suicides, l’ancien patron Didier Lombard perd sa Légion d’honneur. (sudouest.fr)
- Piratage informatique : les données de 1,6 million de personnes “susceptibles d’être divulguées”, selon France Travail et l’Union nationale des missions locales (franceinfo.fr)
- Le CNRS s’émancipe du Web of Science (cnrs.fr)
À partir du 1er janvier 2026, le CNRS coupera l’accès à l’une des plus importantes bases bibliométriques commerciales : le Web of Science de Clarivate Analytics, ainsi que les Core Collection et Journal Citation Reports.
- Retraites, année blanche, congé maladie… La soirée qui a re-refaçonné le budget de la Sécu (huffingtonpost.fr)
Les député·es ont notamment rétabli la suspension de la réforme des retraites, annulée par les sénateurices quelques jours plus tôt.
- 1297 personnes sont mortes au travail en 2024 (basta.media)
L’Assurance maladie vient de publier les chiffres annuels des décès liés au travail. En 2024, 1297 personnes ont perdu la vie en raison de leur activité professionnelle. Un chiffre record. Les plus âgé·es sont plus touché·es.
- Remboursement des fauteuils roulants : promesse tenue (politis.fr)
Depuis le 1er décembre, la Sécurité sociale rembourse la totalité du coût du fauteuil roulant pour les personnes en situation de handicap. Une bonne nouvelle pour les 1,1 million de personnes qui utilisent un fauteuil roulant en France, et les 150 000 qui en achètent chaque année.
- À l’Assemblée, Mélenchon nie tout lien entre LFI et les islamistes et se fait professeur de laïcité (humanite.fr)
- L’édition 2026 du festival de BD d’Angoulême est officiellement annulée (france24.com)
L’édition 2026 du Festival international de BD d’Angoulême, qui devait se tenir fin janvier mais était plombée par le boycott des auteurices et la défection des éditeurices, est officiellement “annulée”, a affirmé lundi à l’AFP un des avocats de la société organisatrice 9e Art+.
- Bercy met de l’huile dans les rouages de l’implantation de datacenters en France (next.ink)
Build, baby, build
- La SNCF s’obstine à contourner le centre de la France (reporterre.net)
Avec sa nouvelle liaison Ouigo via l’Île-de-France, la SNCF prive une fois de plus le Massif central de connexion ferroviaire directe. Élus et associations réclament le retour d’une ligne traversant le centre de la France.
- Assurance habitation : le climat fait flamber les primes et fragilise les assurés, alerte l’UFC-Que Choisir (franceinfo.fr)
- L’eau minérale naturelle de Perrier est à nouveau inconsommable… (franceinfo.fr)
- Le plus petit des PFAS est omniprésent dans l’eau, confirme l’Anses (reporterre.net)
- La France a exporté 6 620 tonnes de pesticides interdits en 2024 (reporterre.net)
En 2024, la France a exporté 6 620 tonnes de pesticides interdits sur son territoire en raison de leur dangerosité pour la santé et l’environnement, révèle l’ONG suisse Public Eye dans une carte interactive publiée le 1er décembre.
La carte (publiceye.ch)
- Ce vigneron lutte contre les inondations grâce à l’agriculture bio sans labour (basta.media)
« Aujourd’hui, les agriculteurs nourrissent la plante et non pas le sol, alors que, quand vous nourrissez le sol, il y a suffisamment d’éléments à disposition des racines des plantes pour leur développement. Comme dans une forêt, vous avez des arbres qui fabriquent des tonnes de bois et pourtant il n’y a jamais eu besoin d’engrais chimiques ! »
- LGBTQIA+ : les agressions en forte progression depuis huit ans (stup.media)
- Éducation à la sexualité : l’État condamné pour 24 ans de manquements (politis.fr)
En France, l’éducation à la vie affective et sexuelle est inscrite dans la loi depuis 2001, organisée en trois séances par année scolaire. Dans la pratique, c’est loin d’être le cas. Face à ce manquement, le Planning familial, Sidaction et SOS Homophobie ont saisi la justice il y a deux ans et ont obtenu gain de cause le 2 décembre.
Spécial femmes en France
- Santé sexuelle : Sidaction s’alarme de la montée en puissance des discours masculinistes auprès des jeunes (publicsenat.fr)
31 % des 16-34 ans « se sentent plus puissants » quand ils ne portent pas de préservatif, 32 % pensent que les femmes doivent respecter leur refus d’en porter et 16 % voient dans ce mode de contraception « un signe de faiblesse ». Quant à la pratique répréhensible du « stealthing » (ndlr : retirer son préservatif sans prévenir son ou sa partenaire), 34 % des jeunes hommes adhérant aux théories masculinistes disent la cautionner. Et globalement, un homme sur dix (11 %), et un jeune de 25-34 ans sur cinq (18 %), déclarent comprendre ce retrait s’ils estiment que le préservatif a été imposé.
Voir aussi “C’est banalisé de le faire sans se protéger” : comment les lycéens sont incités “sur les réseaux sociaux” à des pratiques sexuelles risquées (franceinfo.fr)
- À Marseille, l’affaire de la femme tabassée par la police connaît un tournant, sept ans après les faits (huffingtonpost.fr)
Un policier a été mis en examen pour « violences aggravées » dans ce dossier longtemps ralenti par la culture du silence au sein des forces de l’ordre.
- Les réseaux français d’Epstein se découvrent (portail.basta.media)
- “En France, on peut faire 240 victimes et vivre sa vie tranquillement” : le calvaire de Sylvie, victime de soumission chimique par un haut fonctionnaire (france3-regions.franceinfo.fr)
Plus de 240 femmes accusent Christian Nègre, un haut fonctionnaire du ministère de la Culture, de les avoir droguées à leur insu lors d’entretiens d’embauche.
Spécial médias et pouvoir
- Face à Sophie Binet, Benjamin Duhamel se fait avocat de Bernard Arnault (acrimed.org)
Mardi 2 décembre, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet est l’invitée de 8h20 sur France Inter, pour la première fois depuis la rentrée. L’occasion d’entendre les revendications des travailleurs ? Ou, pour les deux intervieweurs, de se faire les porte-voix du grand patronat.
- Le 20h de Salamé : l’info en mode zapping (acrimed.org)
- Bardella, l’œuf et la peur (politis.fr)
En quelques jours, le président du RN a été aspergé de farine et a reçu un œuf. Pour certains commentateurs, nous serions entrés dans une ère de chaos où la démocratie vacille au rythme des projectiles de supermarché. Ce qui devrait plutôt les inquiéter est la violence d’une parole politique qui fragilise les minorités, les élus et l’État de droit.
- Qui a peur de CNews ? (politis.fr)
Face à un média clairement d’extrême droite, la frilosité de l’Arcom, le « gendarme de l’audiovisuel », intrigue et inquiète.
- « Complément d’enquête » sanctionné, CNews favorisée : quand l’Arcom sacrifie l’audiovisuel public au profit de l’extrême droite (humanite.fr)
Par deux fois, l’émission « Complément d’enquête » s’est vue réprimander ces derniers mois par le régulateur des médias malgré un travail d’investigation de taille. En pleine commission sur l’audiovisuel public, ces décisions de l’Arcom interrogent : brimer une telle offre journalistique, sans motif sérieux, donne des gages à l’extrême droite
- Pierre-Édouard Stérin entre au capital de Valeurs Actuelles et place déjà ses gens de confiance (humanite.fr)
Spécial emmerdeurs irresponsables gérant comme des pieds (et à la néolibérale)
- Emmanuel s’en va-t-en-guerre (blogs.mediapart.fr)
- Sur le budget de la Sécu, la Macronie rejoue la carte du catastrophisme surjoué (huffingtonpost.fr)
Comme l’an passé, une partie des troupes du président de la République alerte sur les risques de la non-adoption du texte avant le 31 décembre, quitte à exagérer.
- Le Conseil d’État enterre le droit de grève à Radio France (humanite.fr)
Le Conseil d’État vient de rejeter le recours des représentants du personnel et des syndicats contre un texte qui vise à limiter cette liberté fondamentale.
Spécial recul des droits et libertés, violences policières, montée de l’extrême-droite…
- Fâché contre « Fachorama », le ministre de l’Intérieur porte plainte contre l’éditeur du jeu (huffingtonpost.fr)
Libertalia a dévoilé un nouveau jeu de sept familles en association avec le collectif antifasciste La Horde.
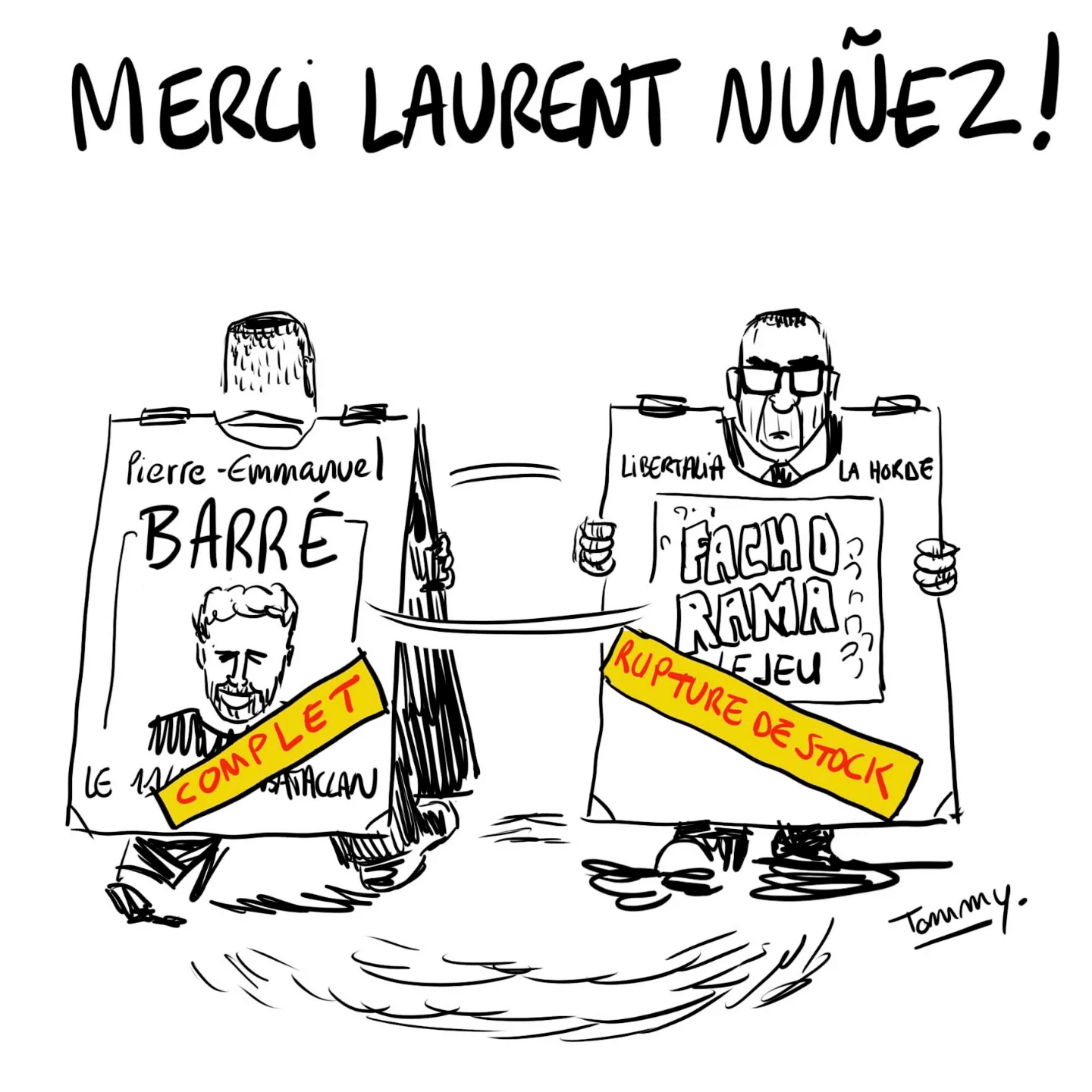
- Sophie Binet annonce sa mise en examen après avoir comparé des grands patrons menaçant de délocaliser à des “rats” qui “quittent le navire” (franceinfo.fr)
Fin janvier, elle avait réagi aux propos du patron du groupe LVMH, Bernard Arnault, qui estimait que le projet de surtaxe du gouvernement “poussait à la délocalisation”, en estimant que “ses propos sont à l’image du comportement des grands patrons aujourd’hui qui coulent le pays”, qui “n’en ont plus rien à faire de la France (…). Moi, j’ai envie de dire : les rats quittent le navire.”
- Loi Duplomb : un médecin convoqué à la gendarmerie pour un post Facebook, après la plainte d’une députée RN (reporterre.net)
Le 3 décembre, un médecin généraliste de Charente a été convoqué à la gendarmerie d’Angoulême en audition libre. Son tort ? Avoir dénoncé sur les réseaux sociaux « l’obscurantisme » de Caroline Colombier, députée Rassemblement national, en plein débat sur la loi Duplomb cet été.
- Menacé·es de prison pour l’organisation de manifestations à Sainte-Soline (basta.media)
Des porte-parole des Soulèvements de la terre, Bassines non merci, Solidaires et CGT comparaissent en appel ce 3 décembre. Des peines de prison avait été prononcées en première instance. Depuis, la bassine en cause a été déclarée illégale.
- Sur le plateau de Millevaches : des militant·es écolos sous surveillance (journal-labreche.fr)
- Gaz lacrymo et LBD pour avoir refusé d’abattre leurs vaches vaccinées contre la dermatose (basta.media)
175 gendarmes ont été déployés sur une ferme du Doubs où des agriculteurs et voisins s’étaient rassemblés pour empêcher l’abattage de 82 vaches. Une seule était atteinte de dermatose nodulaire contagieuse. L’enjeu pour l’État : préserver l’export.« On est traités pire que des terroristes juste parce qu’on veut défendre nos vaches. »
- Chronique du système policier : le taser, une arme dangereuse qui tue régulièrement, hooliganisme policier, racisme… (ricochets.cc)
- Des librairies indépendantes menacées et vandalisées (politis.fr)
Depuis plusieurs mois, des librairies indépendantes – à Paris comme en région – subissent vandalisme, menaces et cyberharcèlement […] par des « groupuscules ou individus se réclamant d’idéologies extrémistes », « motivés par le seul fait que certains livres sont vendus, présentés ou débattus avec leurs auteurs en librairie ».
- Jordan Bardella agressé lors d’une séance de dédicaces : le parquet requiert le placement du suspect en détention provisoire avant son procès (franceinfo.fr) – voir aussi « Quoi de n-œuf ? » : quand Jordan Bardella se moquait de l’œuf reçu par Emmanuel Macron (huffingtonpost.fr)
En 2017, celui qui était membre de l’équipe de campagne de Marine Le Pen ironisait sur l’agression subie par le candidat En Marche au salon de l’Agriculture.
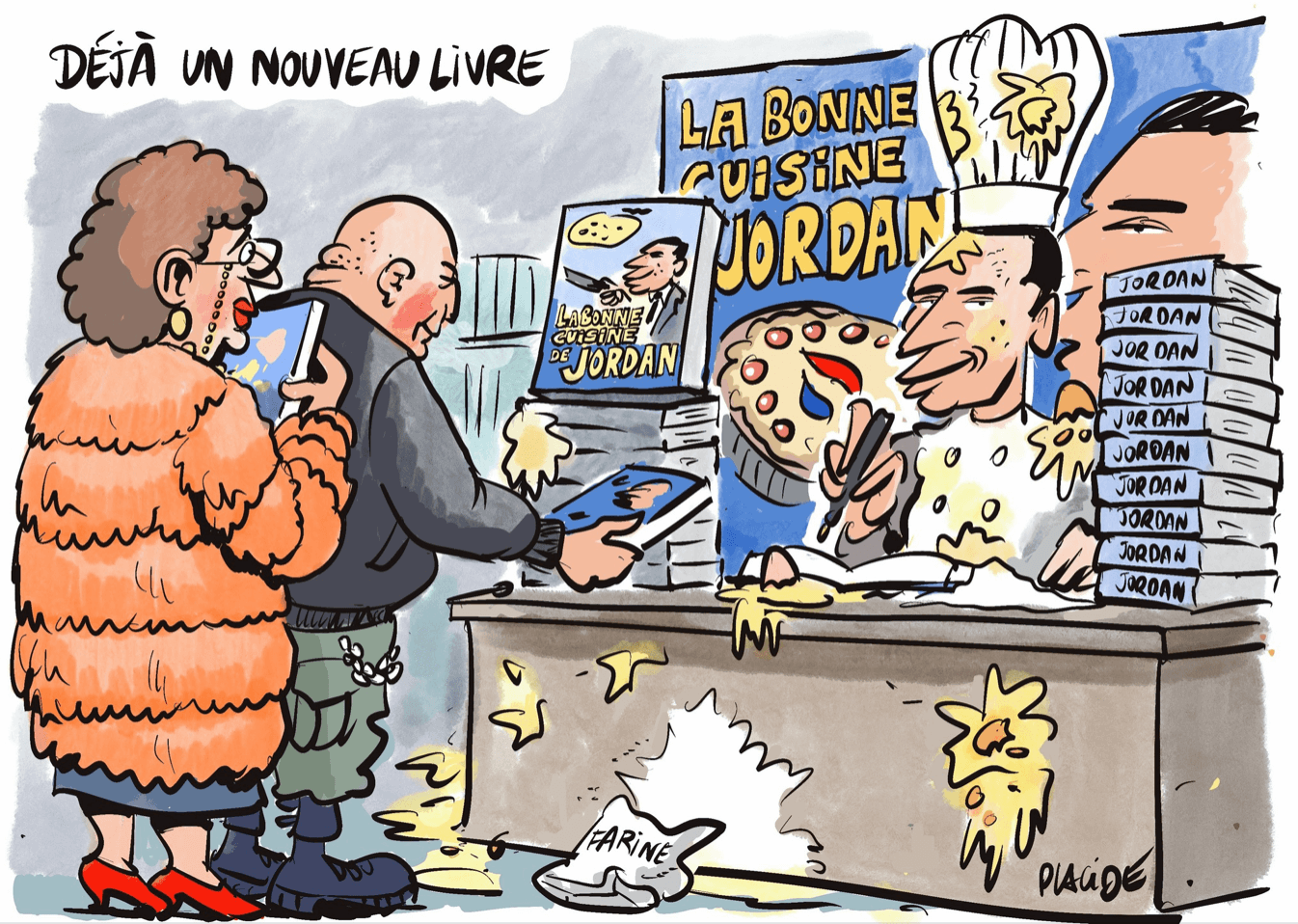
- Zemmour définitivement condamné pour ses propos sur les mineurs isolés (huffingtonpost.fr)
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’Éric Zemmour contre sa condamnation pour complicité d’injure publique et provocation à la haine après ses propos sur CNews en 2020.
- Derrière la Nuit du bien commun, l’ombre embarrassante de Stérin et toute une galaxie d’hommes d’affaires (multinationales.org)
Alors que son édition parisienne devrait se tenir ce jeudi 4 décembre, la Nuit du Bien commun tente de s’éloigner de son sulfureux fondateur Pierre-Édouard Stérin.
- À la frontière franco-britannique, la parade de l’extrême droite, entre associations inquiètes et forces de l’ordre passives (politis.fr)
Sur la plage de Gravelines, lieu de départ de small boats vers l’Angleterre, des militants d’extrême droite britannique se sont ajoutés vendredi 5 décembre matin aux forces de l’ordre et observateurs associatifs. Une action de propagande dans un contexte d’intimidations de l’extrême droite.
Spécial résistances
- “Non à la taxe Windows” : 20 organisations appellent à passer au logiciel libre (zdnet.fr)
- Mobilisations anti-Stérin : une « diagonale de la résistance » s’élargit face à l’extrême droite (basta.media)
Ce 4 décembre, plusieurs organisations appellent à un rassemblement devant les Folies Bergères, à Paris, où doit se tenir une Nuit du bien commun. Une mobilisation qui s’inscrit dans la continuité de nombreuses autres.
- Jordan Bardella au centre d’une plainte pour son média training financé par le Parlement européen (humanite.fr)
L’association AC ! ! Anti-Corruption a porté plainte auprès du parquet national financier (PNF), à propos d’une formation de relation avec les médias, qu’aurait suivi Jordan Bardella pour les élections présidentielles de 2022. Selon les informations du « Canard enchaîné », ce média training aurait été financé illégalement avec des subventions du Parlement européen.
- Collège de France : un colloque sur la Palestine annulé (ldh-france.org)
La LDH, le Syndicat national de l’enseignement supérieur (SNESUP) et la fédération syndicale unitaire (FSU) ont décidé de saisir le tribunal administratif de Paris d’un référé-liberté à l’encontre de cette décision attentatoire aux libertés académiques, au principe d’indépendance des enseignants-chercheurs, à la liberté d’expression collective des idées et des opinions et à la liberté de réunion. Le 12 novembre 2025, le juge des référés a rejeté la requête en jugeant que la décision litigieuse n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression, à la liberté de se réunir et à la liberté académique, de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures.
- Hennessy, Moët, Veuve Clicquot, Ruinart, Krug… Grève chez LVMH pour demander à Arnault de partager les richesses (humanite.fr)
Les branches M et H – champagne et cognac – de la multinationale de Bernard Arnault se sont mises en grève ce vendredi 5 décembre à l’appel de la CGT. La situation est d’autant plus conflictuelle que la santé financière de LVMH s’annonce excellente.
- La France attaquée en justice afin de prendre sa « part juste » aux efforts climatiques (reporterre.net)
- « À bas le service militaire, vive le service militerre » (reporterre.net)
Spécial outils de résistance
- “Oui, mais l’IAg….” Réponses à quelques arguments courants en faveur de l’intelligence artificielle générative (atecopol.hypotheses.org)
L’Atécopol lance un manifeste intitulé « Face à l’intelligence artificielle générative (IAg), l’objection de conscience » que vous pouvez lire et signer dans ce formulaire (framaforms.org) Le texte ci-dessous permet d’approfondir la réflexion au travers d’un ensemble d’éléments de réponse face aux arguments les plus communs circulant dans les institutions de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur et Recherche (et au-delà) pour légitimer la diffusion de l’IAg.
- Un outil interactif pour naviguer dans 80 ans de résolutions à l’ONU (portail.basta.media)
À l’occasion des 80 ans de l’Organisation des Nations unies, Le Monde diplomatique dévoile Résolutions !,une plateforme qui permet de parcourir huit décennies de décisions onusiennes et d’en comparer les votes, pour comprendre les mouvements qui ont façonné l’ordre international depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Le lien vers la plateforme (monde-diplomatique.fr)
- Pour la création d’un réseau national de journalistes spécialistes de l’extrême droite (ripostes.org) – voir aussi StreetPress lance ses formations citoyennes (ripostes.org)
Les municipales 2026 approchent et StreetPress lance ses formations citoyennes. Objectif : mieux connaître l’extrême droite pour mieux la combattre. La bataille s’organise dès maintenant en suivant les webinaires.
- Une carte inédite des « nouveaux apôtres de l’extrême droite », ces associations soutenues par Stérin (basta.media)
« Basta ! » publie en exclusivité une cartographie des associations financées par l’écosystème du milliardaire d’extrême droite Pierre-Édouard Stérin. Elle est réalisée par le collectif de journalistes Hors Cadre, en collaboration avec WeDoData.
Spécial GAFAM et cie
- ‘The Precedent Is Flint’ : How Oregon’s Data Center Boom Is Supercharging a Water Crisis (rollingstone.com)
Amazon has come to the state’s eastern farmland, worsening a water pollution problem that’s been linked to cancer and miscarriages
- IA : Meta signe un accord de partenariat avec plusieurs médias internationaux, dont « Le Monde » (lemonde.fr)
Le contrat encadre l’usage des contenus publiés par « Le Monde », « Télérama », le « Huffington Post » et « Le Nouvel Obs » dans les services d’IA développés par le groupe américain, propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp.
- Windows 11 force la main : des publicités intrusives arrivent… dans le clic droit (clubic.com)
Microsoft ne manque jamais d’humour quand il s’agit de l’expérience utilisateur sur son système d’exploitation fétiche. Alors que le géant de la technologie promettait de mettre de l’ordre dans ses menus, voilà qu’il y glisse de nouvelles publicités pour sa boutique d’applications directement sous le curseur de la souris.
- Bruxelles frappe fort – X écope d’une amende historique de 120 millions d’euros pour ses pratiques trompeuses (gigawatts.fr)- voir aussi Elon Musk estime que “l’Union européenne devrait être abolie”, après une amende infligée au réseau social X (franceinfo.fr)
Les autres lectures de la semaine
- Des marchands d’attention aux architectes de l’intention (danslesalgorithmes.net)
- Près de -30°C aux portes de Paris : retour sur la pire vague de froid de l’histoire moderne (meteo-paris.com)
- Tattoo ink moves through the body, killing immune cells and weakening vaccine response (latimes.com)
Scientists in Switzerland used a mouse model to trace what happens after tattooing. Pigments drained into nearby lymph nodes within minutes and continued to accumulate for two months, triggering immune-cell death and sustained inflammation. The ink also weakened the antibody response to Pfizer Inc. and BioNTech SE’s COVID vaccine when the shot was administered in tattooed skin. In contrast, the same inflammation appeared to boost responses to an inactivated flu vaccine.
- Islam : comment se fabrique l’inquiétude dans le débat public (theconversation.com)
- « Toute visibilité de la pratique religieuse de l’islam est vue comme une manifestation de l’islamisme » (orientxxi.info)
Olivier Roy, politiste et professeur à l’Institut universitaire européen de Florence, revient sur les bruyantes controverses qui ont suivi la publication, en novembre 2025, d’un sondage de l’Ifop sur la religiosité des musulmans de France. Il réfute plusieurs raccourcis et éclaire les raisons de la montée du discours islamophobe.
- Aimer sous contrat racial : lettre d’un homme noir queer (blogs.mediapart.fr)
- Le mythe de la femme métisse (politis.fr)
Il est déroutant pour les métis·ses d’être érigé·es en symbole de l’antiracisme et valorisé·es pour des caractéristiques physiques tout en faisant l’expérience quotidienne des inégalités raciales.
Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Les vidéos/podcasts de la semaine
- Visualiser avec des petites perles ce que sont vraiment les impôts de Bernard Arnault (tube.fdn.fr)
- Zapping : les médias sonnent le tocsin (acrimed.org)
- Extrême droite et climatoscepticisme : à quoi sert le GIEC ? (humanite.fr)
Les trucs chouettes de la semaine
- Valve’s FEX-Emu Support Shows a Better Way to Fund Open Source (itsfoss.com)
- One of the best gaming Linux OSes just shifted 1,000,000 GB of ISOs in a single month (xda-developers.com)
- Steam On Linux Use Easily Hits An All-Time High In November (phoronix.com)
- Framatoolbox, une boite à outils numérique pour les p’tits besoins du quotidien (framablog.org)
Nous l’annoncions il y a quelques semaines, nous avons ouvert quatre nouveaux services !La semaine dernière nous vous proposions de découvrir les coulisses du nouveau Framadate et aujourd’hui, nous souhaitons vous présenter le deuxième service de la liste : Framatoolbox.

- Social media de-imagined. Use your words ! (cyberspace.online)
- Man unexpectedly cured of HIV after stem cell transplant (newscientist.com)
A handful of people with HIV have been cured after receiving HIV-resistant stem cells – but a man who received non-resistant stem cells is also now HIV-free
- Strandbeest (strandbeest.com)
Theo Jansen is engaged in creating new forms of life : the so called strandbeests. Skeletons made from yellow plastic tube (Dutch electricity ipe) are able to walk and get their energy from the wind. They have evolved since their inception in 1990 and have been divided into 12 periods of evolution.
Retrouvez les revues de web précédentes dans la catégorie Libre Veille du Framablog.
Les articles, commentaires et autres images qui composent ces « Khrys’presso » n’engagent que moi (Khrys).
04.12.2025 à 10:30
Déjà 2 500 Framaspaces pour renforcer les structures qui changent le monde
Framasoft
Texte intégral (8330 mots)
Comme chaque année (2022, 2023, 2024), Framasoft fait le bilan de son projet de « cloud associatif et militant » : Framaspace.
- Framaspace : un cloud pour dégoogliser les assos
- Le cloud qui préfère les assos aux actionnaires
- 2025/26 : on étoffe, on améliore, on dégooglise
- Dans les coulisses
- Pour finir (et pour agir)
Framaspace : un cloud pour dégoogliser les assos
Depuis trois ans, Framasoft propose Framaspace, un service en ligne avec les caractéristiques suivantes :
- Un espace cloud de
40Go50Go et 50 utilisateur⋅ices maximum - Réservé aux associations et petits collectifs militants francophones
- basé sur le logiciel libre Nextcloud
- infogéré (c’est Framasoft qui se charge de la maintenance et des mises à jour)
- permettant de gérer
- des fichiers de tous types et de les partager
- des agendas, publics ou privés
- des contacts (synchronisés sur votre smartphone)
- des photos (partageables sous forme d’albums)
- des projets (méthode Kanban)
- de la documentation (en mode « wiki »)
- des visioconférences (jusqu’à une dizaine de personnes)
- des formulaires, publics ou privés
- des tableaux applicatifs (en mode « no-code »)
- des activités associatives et la gestion de leurs inscriptions
- des membres, et leurs éventuelles adhésions
- la comptabilité de la structure
- ou encore l’édition en ligne et à plusieurs de documents bureautiques (textes, feuilles de calculs, présentations, etc)
- le tout gratuitement (c’est Framasoft qui vous invite !)
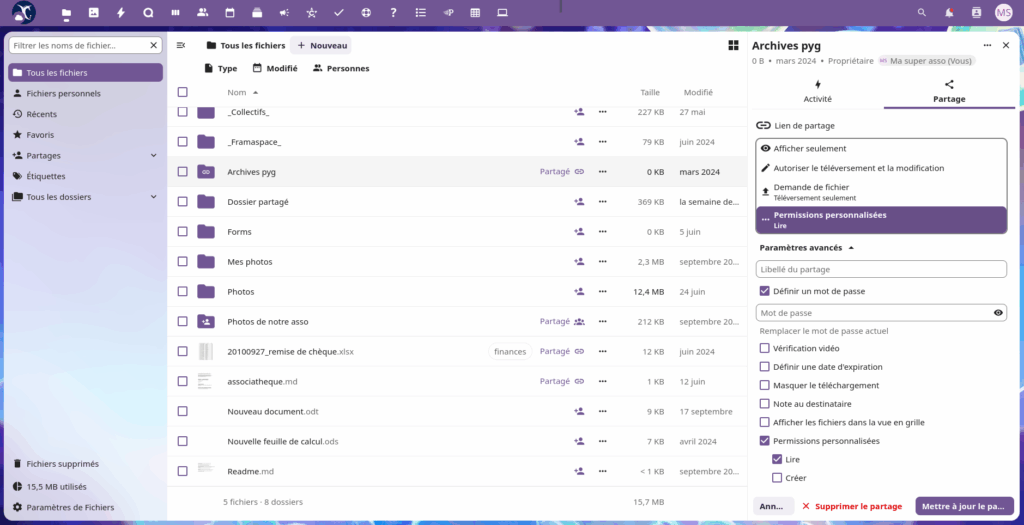
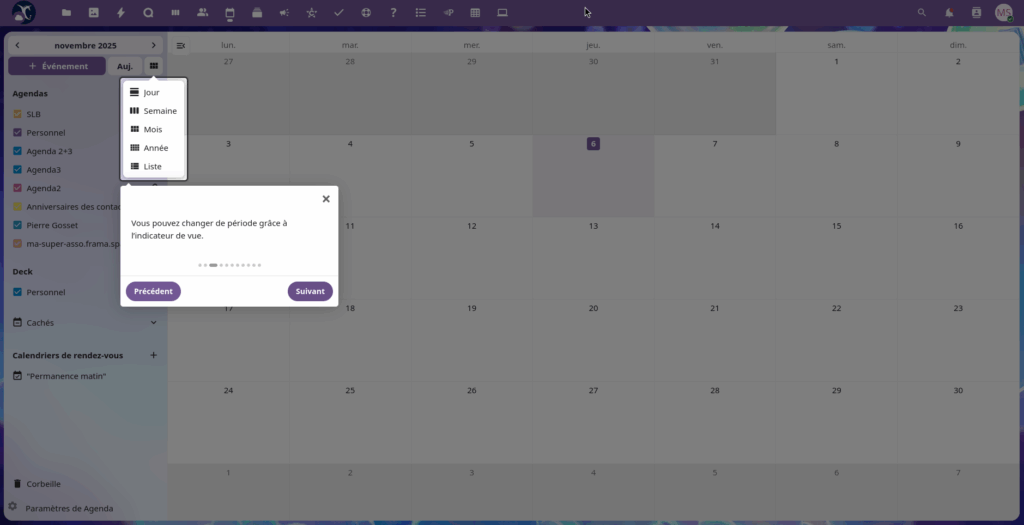
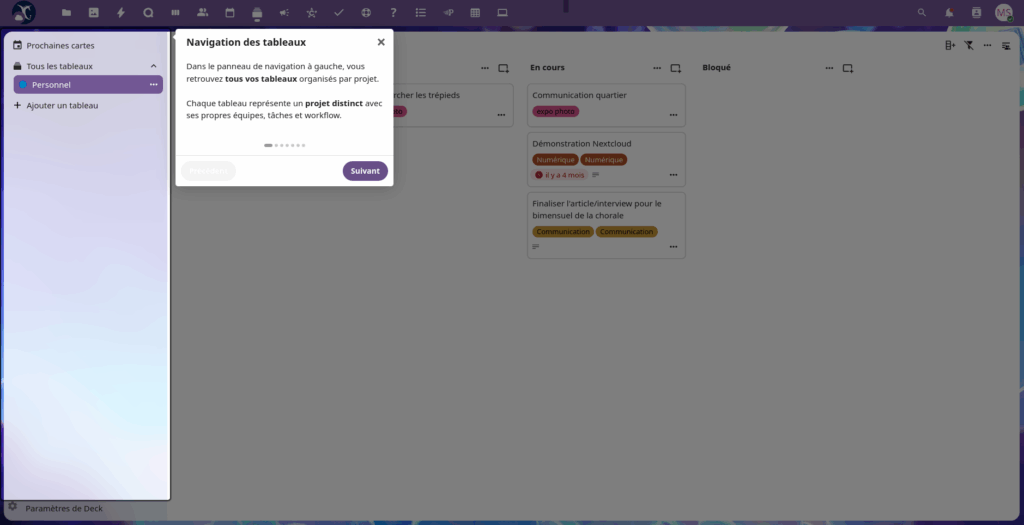
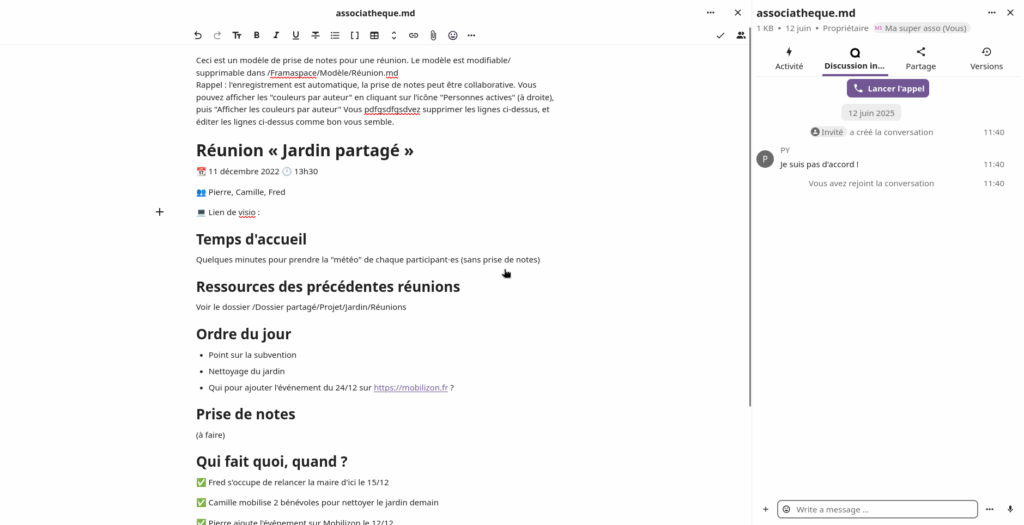
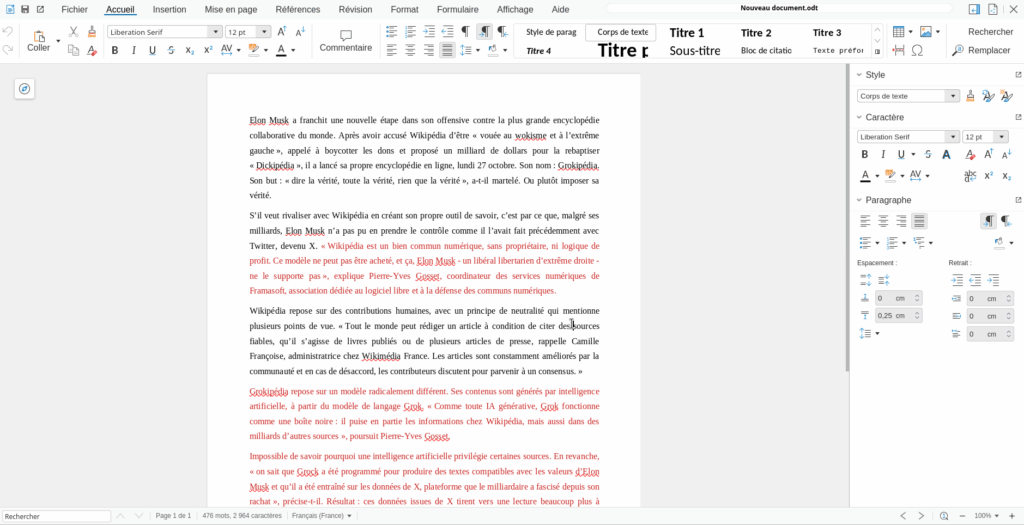
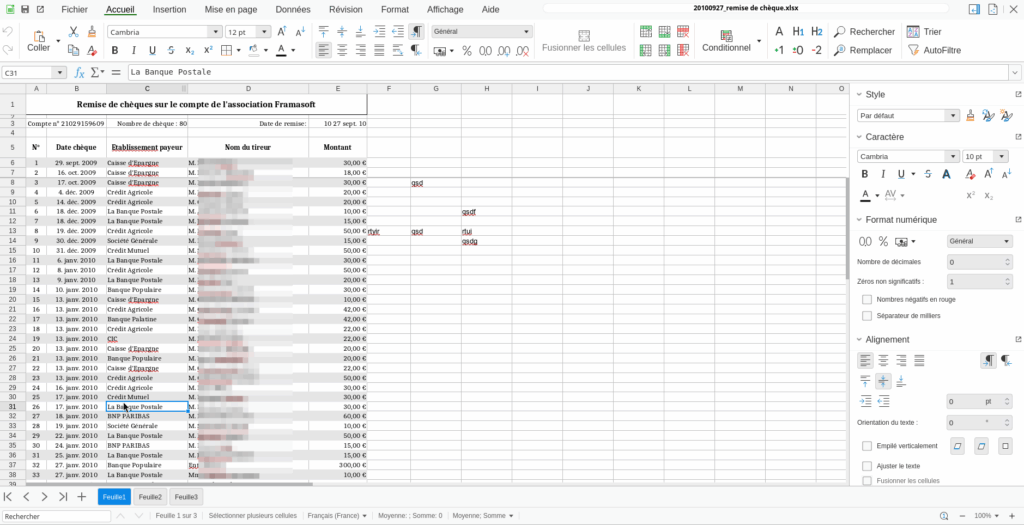
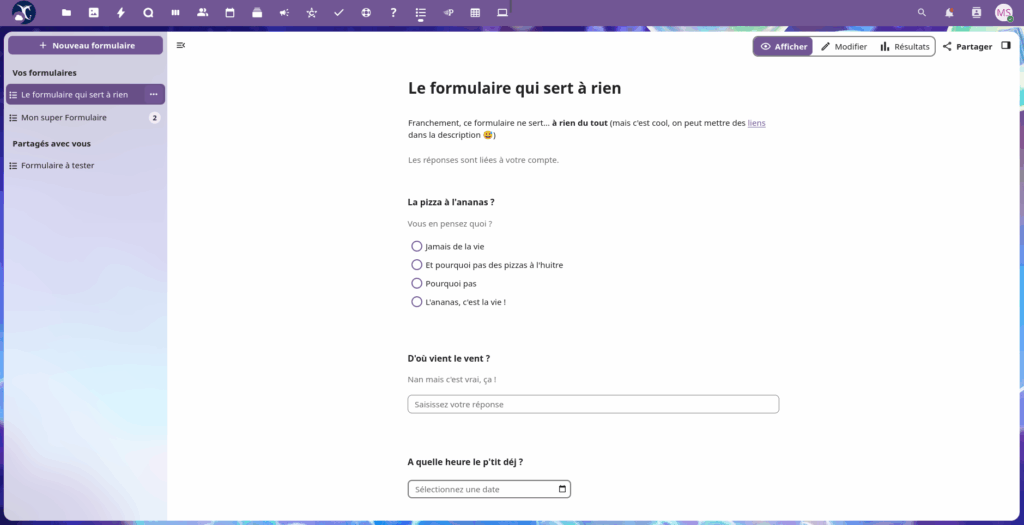
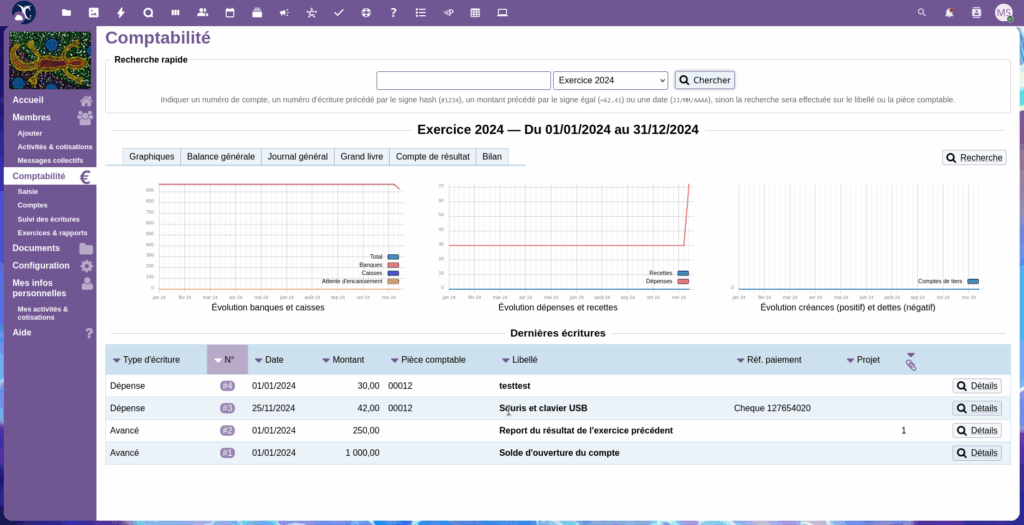
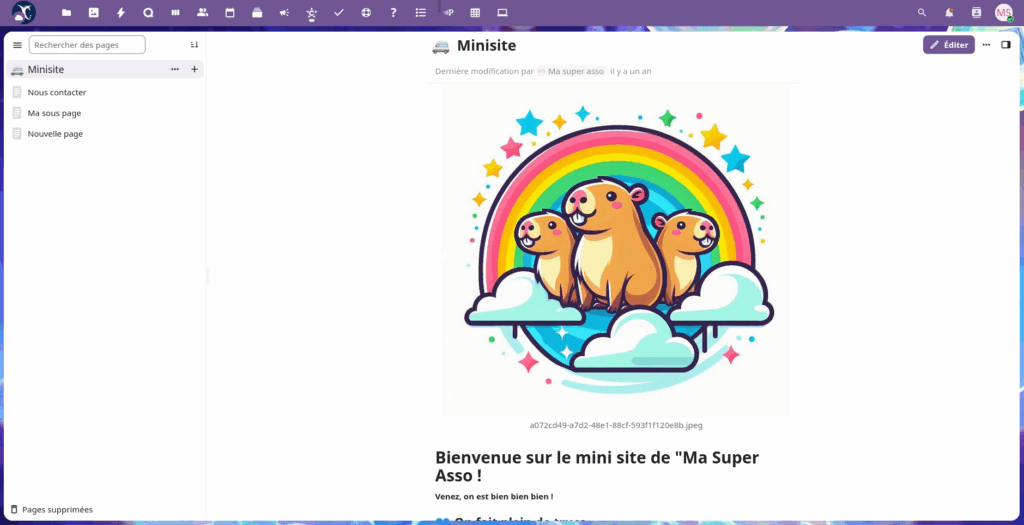
Le cloud qui préfère les assos aux actionnaires
Framasoft fournit ce service gratuitement convaincue qu’en période de coupes budgétaires et de pressions sur le monde associatif, il est essentiel de garantir un accès équitable à des outils éthiques. Nextcloud étant complexe et coûteux à maintenir, nous mutualisons les efforts pour éviter que les structures à petit budget ne soient contraintes d’utiliser des services de multinationales aux logiques marchandes, voire autoritaires.
Exemples d’associations ou collectifs hébergés
Afin de rendre plus concret le type de public que sert Framaspace, voici 5 structures hébergées et suffisamment anonymisées, tirées au hasard (promis).
Association #1
Objet social ou mission : L’association a pour ambition principale de créer un mouvement démocratique et populaire à XXXXXX pour remettre les habitantes et habitants de la ville au cœur des décisions de gestion communale.
Actions principales : Dans le cadre de ses engagements pour un développement durable et une société plus juste, l’association XXXXXXXX a initié plusieurs projets importants. Nous avons mis en place une AMAP locale pour promouvoir l’agriculture durable et rapprocher les producteurs locaux des consommateurs, offrant ainsi des produits frais et de qualité tout en soutenant l’économie locale. En parallèle, notre association s’investit activement dans la lutte contre l’extrême droite, en organisant des événements de mobilisation et des campagnes d’éducation populaire pour éveiller la conscience politique des citoyens. Cette démarche vise à renforcer la résilience de notre communauté face aux idéologies divisives et à promouvoir des valeurs de solidarité et de respect mutuel. Nous avons également organisé la Fête des Possibles, un événement qui célèbre les initiatives locales en matière de développement durable et de vivre-ensemble. Cet événement offre une plateforme pour partager des idées, découvrir des innovations sociales et écologiques, et renforcer les liens au sein de la communauté. Enfin, nous apportons notre soutien aux élus de XXXXX, en collaborant sur divers projets visant à améliorer la qualité de vie dans notre commune. Grâce à ces efforts conjoints, nous œuvrons à transformer notre environnement local en un lieu plus inclusif, écologique et solidaire.
Raisons du besoin d’un compte Frama.space : Notre association nécessite un compte Frama.space afin de disposer d’un espace sécurisé pour partager et stocker efficacement nos documents. Cette plateforme nous permettra de centraliser nos informations importantes, facilitant ainsi l’accès et la collaboration entre les membres, tout en garantissant la confidentialité et l’intégrité de nos données.
Association #2
Objet social ou mission : XXXXXXX est un collectif né d’une volonté de raviver et redécouvrir les pratiques et imaginaires écoféministes. Nous pensons les luttes écologiques et féministes de façon indissociable, et attaquons de front un patriarcat blanc, cishétéronormatif, capitaliste et écocidaire. Nous nous imprégnons de pensées décoloniales, d’écologie queer, de luttes antivalidistes, d’antispécisme en pratique.
Actions principales : Nous avons 3 axes d’action : La parole : nous organisons des cercles de parole, pour parler de nos vécus en tant que personnes minorisées. Il s’agit de créer des enclaves de care dans un monde violent, ce qui nous apparaît comme profondément politique. L’apprentissage, la sensibilisation et la transmission : nous proposons des événements tels que des ateliers, des projections, des arpentages… Les actions concrètes locales : aller à des marches, réfléchir à des actions directes avec d’autres groupes, tisser des liens.
Raisons du besoin d’un compte Frama.space : En tant que membre du collectif XXXXXXX, je souhaite ouvrir un compte Frama.space car nous avons besoin d’un espace de travail pour pouvoir collaborer et organiser nos différentes actions. A ce jour, nous n’avons pas d’espace collaboratif, et à chaque fois que nous organisons des actions, nous devons retrouver les infos dans nos mails, dans nos échanges sur Discord, nous remettre en tête l’agenda, retrouver qui a dit qu’iel serait là, etc. C’est chronophage et cela ne nous permet pas de mettre notre énergie au bon endroit : réaliser nos actions sur le terrain. Avoir un espace de travail nous permettrait d’organiser nos infos, de mettre en avant les infos essentielles pour les nouvelleaux qui nous rejoignent, de ranger nos documents, etc. Ce serait vraiment génial ! ! ! Nous ne sommes pas un gros collectif, mais nous avons beaucoup d’idées et de rêves en tête pour militer et essayer de changer notre société, et cet espace nous permettrait de mettre notre énergie à ce service !
Association #3
Objet social ou mission : Promouvoir et diffuser des savoirs et solutions techniques, des modes de vie et d’organisations, simples, accessibles et durables favorisant la résilience individuelle et collective au niveau territorial ; maximiser l’utilité sociale de la technologie dans le respect des limites planétaires ; promouvoir et rechercher des solutions qui répondent notamment aux problématiques liées aux secteurs suivants : énergie, alimentation, gestion de l’eau, gestion des déchets, matériaux, habitat, transports, hygiène, santé.
Actions principales : -La conception, la fabrication, l’exploration, l’expérimentation, le prototypage d’objets, de techniques et de systèmes Low Tech, – Le partage d’expériences, la transmission et diffusion de savoirs et savoir-faire Low Tech auprès du grand public, des jeunes, des entreprises, des collectivités… – La sensibilisation et la formation à la démarche Low Tech, – Le développement de partenariats avec des acteurs présents sur le territoire, visant à renforcer ces actions.
Raisons du besoin d’un compte Frama.space : En tant que représentant du XXXXXXX, je souhaitais idéalement un outil global et collaboratif mais – et je ne dois pas être très original – le moins googleisé possible. La polyvalence et les possibilités actuelles de frama.space nous semblent tout à fait pertinents comme supports de suivi de nos projets partagé (stockage de fichiers, suite bureautique Collabora ou Onlyoffice, deck, talk etc.). Donc intéressé pour les possibilités ET la philosophie du projet.
Association #4
Objet social ou mission : L’Association XXXXXXXX est née à Lyon en 1996 Cette année-là, plusieurs personnes amputées ont décidé de se rencontrer pour partager leur expérience de l’amputation. Elles ont échangé des conseils, des informations, du soutien et ont décidé d’en faire profiter d’autres personnes en créant une association.
Actions principales : – Entraide : L’entraide est un axe essentiel et la raison première de notre association. Elle est orientée vers les personnes amputées et leurs proches, afin de répondre aux différentes questions qu’ils se posent. – Études : Nous participons aux évolutions des technologies et des pratiques pour une meilleure prise en charge de l’amputation. XXXXXXXX contribue régulièrement à faire progresser les sciences et les techniques, en partenariat avec des prothésistes, des scientifiques et des services de recherche universitaire. – Défense des droits : Nous sommes organisés pour un premier soutien juridique et pour une orientation vers les professionnels qui défendront les droits. – Communication : elle accompagne et fait connaître les actions d’entraide, de défense des droits, de loisirs et de recherches et études – Parasports et loisirs : Chaque année XXXXXX organise des activités sportives, essentiellement en extérieur, et des activités culturelles et conviviales. Communication, Activités de loisirs
Raisons du besoin d’un compte Frama.space : Il s’agit de créer un espace pour les adhérents actifs de l’association (une quarantaine environ), afin qu’ils aient accès à des documents partagés. Seul le secrétaire et webmestre (moi-même) et la présidente ont accès aux paramètres d’administration. Nous avons un hébergement sur OVH, mais il n’autorise pas les droits des documents partagés (le LDAP non activé). J’ai essayé d’y mettre Nextcloud, mais ça ne fonctionne pas. J’ai proposé de 5 à 10 comptes, mais cela serait étonnant que nous ne soyions plus de 3 ou 4. Merci.
Association #5
Objet social ou mission : Depuis l’obtention du label FSC en 2011, notre groupement forestier XXXXXXX n’a cessé de chercher à étendre la démarche d’écocertification au plus grand nombre d’acteurs possibles de la filière bois bourguignonne, dans le respect du cahier des charges, mais aussi de l’état d’esprit, du Forest Stewardship Council ®. Alors que la forêt morvandelle est en mutation, il est important de défendre une sylviculture raisonnable, qui ne fasse de nos bois ni un espace abandonné, ni la proie des profits immédiats. Car il s’agit non seulement de responsabilité vis-à-vis des générations futures et de lutte contre le changement climatique, mais aussi d’emplois, et de compétitivité de notre filière bois.
Actions principales : Le XXXXXXX est composé de propriétaires forestiers, soucieux du mode de gestion de leurs forêts. Il permet un travail et une réflexion commune et transversale à l’échelle d’un vaste territoire (Saône-et- Loire – Nièvre). C’est aussi une opportunité pour les petits propriétaires de bénéficier de coûts réduits, mais également d’un soutien technique sur le terrain. Les membres du groupement se sont engagés dans cette démarche en souhaitant qu’une filière de première et seconde transformation se mette en place rapidement sur le secteur. La majorité des forêts gérées par le groupement sont des forêts publiques très fréquentées par les habitants, les sportifs, les touristes. En outre la plupart abritent des milieux exceptionnels, avec des espèces protégées, et, comme pour la ville d’Autun, des réserves d’eau potable. La gestion appliquée dans ces forêts garantit, voire renforce la préservation du patrimoine et des ressources naturelles. La certification FSC apporte la reconnaissance internationale de cette gestion.
Raisons du besoin d’un compte Frama.space : Nous avons besoin d’une plateforme collaborative pour l’animation et la gestion du XXXXXXX, étant techniciens de différentes collectivités et association de protection de l’environnement. Nous préférons les outils développés par framasoft plutot que ceux développés par google !
—
Voilà, maintenant fermez les yeux et imaginez 2 500 structures de ce type, travaillant au quotidien sur un logiciel libre collaboratif tel que Nextcloud, et vous comprendrez pourquoi nous pensons que Framaspace à une réelle utilité sociale !
Pour en savoir plus sur le projet, vous pouvez vous référer : au site web Framaspace ou à la vidéo qui présente Framaspace.
Vous pourrez notamment comprendre pourquoi une petite association comme Framasoft s’est lancée dans le projet « un peu » fou de financer sur ses fonds propres jusqu’à 10 000 clouds associatifs (spoiler : « C’est politique ! »).
2025/26 : on étoffe, on améliore, on dégooglise
2025 : une année hyper-active
Boris rejoint la résistance
Tout d’abord, nous avons accueilli en mai dernier Boris, étudiant en alternance à Framasoft pour un an.
Ses missions :
- développer de nouvelles visites guidées pour Framaspace ;
- s’assurer de la maintenance de cette application au sein du magasin d’applications Nextcloud ;
- participer au support sur le forum Framaspace ;
- développer une application « Framaspace » qui permettra de répondre à un certain nombre de problématiques d’UX que nos utilisateur·ices rencontrent avec Nextcloud.
Et pour information, Boris cherche, pour sa deuxième année, une entreprise qui pourrait l’accueillir (en alternance toujours) comme DevOps à partir de mai/juin 2026, laissez-nous un commentaire si son profil vous intéressse.
Nouvelles visites : suivez le guide !
L’an passé, Val, stagiaire à Framasoft, avait développé l’application Nextcloud « Visites Guidées ».
Cette année, Boris a ajouté deux nouvelles visites guidées à Framaspace (« Formulaires » et « Deck »), afin que les personnes découvrant Framaspace pour la première fois puissent découvrir ces fonctionnalités en autonomie.
Par ailleurs, Boris a mis à jour « Visites guidées » sur le magasin d’application de Nextcloud, ce qui signifie que ces nouvelles visites guidées peuvent aujourd’hui être visibles en dehors de Framaspace, pour toute personne disposant ayant installé l’application.
Liaison Paheko stabilisée (enfin, on l’espère !)
Paheko, c’est la (super) application qui vous permet de gérer votre comptabilité associative, vos membres (et leurs éventuelles adhésions), les activités de votre association, etc. Il s’agit d’un logiciel libre autonome.
Suite à un développement internet, nous avons intégré Paheko à Nextcloud/Framaspace l’an passé. Mais cela a nécessité pas mal de « bidouilles » de notre part (encore un grand merci à Bohwaz, développeur de Paheko, de nous avoir guidé pour éviter plusieurs écueils). Cependant, pour des raisons techniques un peu complexes, la liaison entre Framaspace et Paheko était imparfaite, ce qui entraînait dans certains cas une impossibilité de pouvoir utiliser Paheko-dans-Framaspace. En 2025, nous avons corrigé une partie de ces problèmes, si vous y avez été confronté⋅es, n’hésitez pas à réessayer. Notez cependant que le temps nous a manqué, et qu’il reste encore peut-être des bugs. Si c’est le cas, nous nous ré-attellerons à cette tâche dans les mois qui viennent.
Framaspace… sur papier
Framaspace est un des projets les plus ambitieux de l’histoire de Framasoft. Le projet étant complexe, il nous manquait un support pour le promouvoir.
Grâce à Brume, Bookynette et Numahell, c’est maintenant chose faite. Sur la base des magnifiques illustrations de David Revoy, nous avons donc maintenant un magnifique dépliant qui nous permet de présenter Framaspace lors d’événements.
D’ailleurs, si vous souhaitez le télécharger pour l’imprimer, le PDF est disponible (nous mettrons les sources à disposition dès que nous les aurons allégées).
Framaspace en 5 minutes chrono
Nous le savons bien : une des difficultés à l’usage de Framaspace vient du fait que le logiciel Nextcloud n’est pas toujours simple à prendre en main. Surtout pour des personnes peu habituées au numérique collaboratif. C’est pourquoi nous avons fait réaliser cette courte vidéo de présentation par nos amies de L’Établi Numérique et de La Dérivation.
Proposée à chaque usager⋅e à la première ouverture de son espace, cette vidéo de quelques minutes permet de faire le tour des principales fonctionnalités de Framaspace.
Mises à jour Nextcloud : nous, on transpire ; vous, vous profitez !
Comme chaque année, nous avons mis à jour Nextcloud, le logiciel qui motorise Framaspace.
D’abord une première fois en avril 2025, avec un passage en version 30. Puis une seconde fois en octobre, pour le passage en version 31.
Ces mises à jour apportent, comme vous pouvez le lire dans les liens ci-dessus, de très nombreuses corrections et nouvelles fonctionnalités : améliorations des performances, recherche instantanée, nouvelle interface de partage de fichiers, interface avancée d’édition d’événements, conversion de fichiers intégrée, etc.
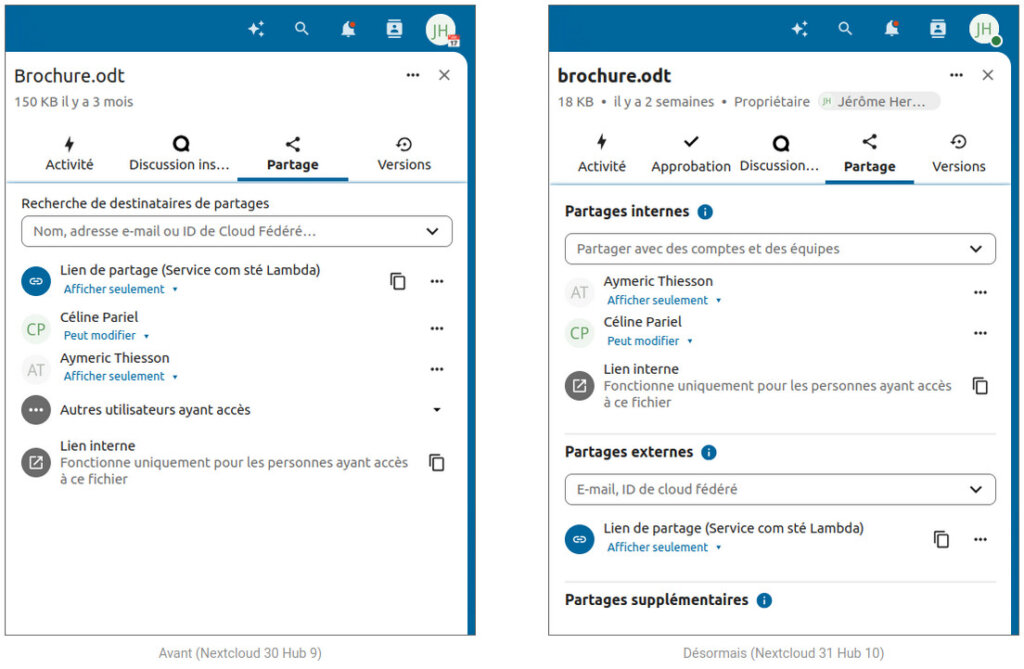
Captures écrans des interfaces de partage de fichiers entre les versions Nextcloud 30 et Nextcloud 31
Ce qu’on bidouille là, en ce moment
+10 Go : c’est cadeau
🎁 À Framasoft, on est des oufs ! On vous offre 10Go en plus, gratuitement ! 🎁
🎅 Oui, vous avez bien lu : gra-tui-te-ment ! ! Ce Noël, ça va être votre fête ! ! 🎉
Demandez immédiatement vos 10Go supplémentaires avec le code BLAGUEFRIDAY-SIXBEARMONDAY ! 🥳
…
Hum, pardon, on voulait voir ce que ça faisait de se mettre dans la peau de la team marketing d’Orange ou de SFR. Non pas qu’on ait toujours rêvé de porter les cravates de Jean-Michel-Marketeux, mais il fallait essayer.
Par contre, l’annonce reste valable : l’espace maximal disponible pour chaque Framaspace passe de 40Go à 50Go. Sans surcoût, puisque Framaspace est gratuit. D’abord parce qu’on est sympas (on peut quand même s’envoyer quelques fleurs), ensuite parce que ça rend l’offre beaucoup plus lisible : « Framaspace, c’est 50Go et 50 comptes maximum », c’est beaucoup plus facile à comprendre et à retenir pour vous (et pour nous aussi !).
Des visios à plus que 2, c’est mieux ©™
Framaspace embarque Nextcloud Talk, qui propose notamment du tchat pour les membres de votre espace (et vos invité⋅es).
Mais Talk vous permet aussi des visios pour se regarder dans le blanc des yeux !
Cela pourrait paraître génial pour permettre aux personnes ne pouvant pas se déplacer à votre AG d’y assister malgré tout, non ?
Et bien non 😅 !
Parce que pour le moment, l’infrastructure de Framaspace supporte mal les visios à plus de 2 ou 3 personnes. Ce qui est un peu limitant, il faut le reconnaître 😝
Nous travaillons donc en ce moment même à mettre en place une nouvelle machine pour passer outre cette limitation. On ne vous garantit pas que vos visios tiendrons 50 ou même 20 personnes simultanément, car Framaspace est une offre mutualisée ET fournie gratuitement par Framasoft. Rajouter des serveurs a un coût humain et financier non négligeable pour nous. Donc, nous commencerons avec un unique serveur, et nous ferons le point sur son usage fin 2026, ainsi que sur nos finances, afin de voir si nous avons le temps, l’énergie, et l’argent nécessaires pour mieux répondre à ce besoin.
Si tout va bien, ce nouveau serveur « HPB » (pour High Performance Backend), devrait être mis en place pour fin décembre, et directement intégré à votre espace. Si vous êtes utilisateur⋅ice de Framaspace, vous recevrez une notification lorsque la fonctionnalité sera disponible.
« Cachez-moi ces applications que je ne saurais voir »
Si vous êtes administrateur ou administratrice d’espace Framaspace, peut-être trouvez-vous que certaines applications (par exemple « Formulaires » ou « Tableaux ») ne font pas sens pour votre association ou collectif ? Ou peut-être que vos membres risquent d’être un peu perdus lors du premier usage de Framaspace ?
Alors, ça tombe bien, car Boris (notre super-alternant évoqué plus haut) a développé une micro-application qui permet aux admins d’espaces de masquer les applications pour les utilisateur⋅ices.
Cette fonctionnalité nous est remontée chaque année par les étudiant⋅es en design de l’école Strate, guidée par leur enseignante Marie-Cécile Godwin avec qui nous travaillons depuis plusieurs années sur les problématiques d’UX/UI de Nextcloud.
Vous verrez donc bientôt apparaître, dans le menu administrateur, une option pour masquer les applications de votre choix à vos utilsateur⋅ices (sauf les applications « Fichiers » et « Activités » qui sont protégées).
Notez que cette option n’est pas encore disponible.
2026 : demandez le programme !
Veuillez noter que ce qui suit est un ensemble d’envies pour 2026 si nos moyens nous le permettent, et en aucun cas un engagement.
Migration vers Nextcloud 32 (et + si affinités)
Comme chaque année, nous effectuerons les montées en version majeure de Nextcloud, une fois ces dernières stabilisées.
Vous pouvez déjà voir les nouveautés apportées par Nextcloud 32 (ou chez nos camarades de la société Arawa). Nous envisageons la mise-à-jour pour Framaspace durant le printemps.
La version 33, elle, devrait être publiée en février prochain. Suivant son niveau de stabilité, nous pourrions envisager une migration fin 2026.
Impersonate : des dépannages plus efficaces
Les administateur⋅ices de Framaspace nous remontent régulièrement le problème suivant : lorsque des utilisateur⋅ices rencontrent des soucis à l’usage avec Framaspace, il est souvent difficile de les dépanner.
– utilisateur : « Je n’arrive pas à partager mon fichier publiquement ! »
– admin : « Tu as bien cliqué sur « Partager > Créer un partage de lien public » ? Tu as bien lu la documentation ? Et tu as bien regardé les captures écrans ? »
– utilisateur : « Oui ! C’est nul ton truc. Je veux retourner chez Google Drive ! »
L’admin cherche pendant 2 heures, interroge le forum Framaspace, finit par faire 20mn de vélo sous la pluie pour aller chez l’utilisateur, et constate que ce dernier avait partagé un lien privé. (non, vous ne me ferez jamais avouer que cet exemple est bien trop spécifique pour ne pas être tiré de la réalité ! 😝)
C’est à ce genre de cas d’usage que répond l’application « Impersonate ». Elle permet aux admins Nextcloud de s’identifier comme s’ils étaient l’utilisateur de leur choix. Ainsi, dans l’exemple précédent, l’admin aurait tout simplement pu « prendre la personnalité » de l’utilisateur, naviguer dans ses fichiers, et constater de visu qu’aucun partage public n’avait été créé (et en plus ça lui aurait éviter de rentrer frigorifié et trempé).
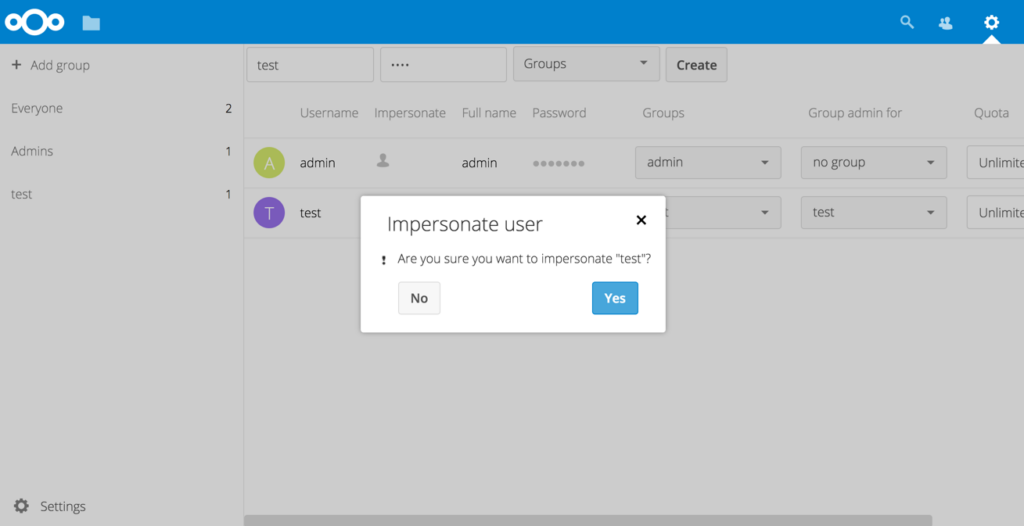
Capture écran de l’interface de l’application Impersonate, qui permet aux admins d’agir « comme si » ils étaient identifié comme l’utilisateur de leur choix.
Cela fait plusieurs mois que nous pensons à déployer cette fonctionnalité, mais nous souhaitions le faire dans les meilleures conditions, c’est-à-dire en prévenant TOUS les utilisateurs existants que les administrateurs d’espaces peuvent bien avoir accès à leurs fichiers, contacts ou agendas. En réalité, c’est déjà le cas (via l’application OwnershipTransfer) ou tout simplement en changeant le mot de passe de l’utilisateur par un mot de passe temporaire. Cette nouvelle facilité donnée aux admins d’espace doit faire l’objet d’une information large, et suffisamment claire. Il faut en effet rappeler que les Framaspaces sont des espaces de travail collaboratifs relatifs à une structure ou un collectif, et non des espaces personnels. Il faut donc retenir que sur Framaspace, les admins peuvent tout voir/savoir, un peu comme sur un ordinateur où l’administrateur peut avoir tout pouvoir sur la machine et les données qu’elle contient.
C’est donc après de nombreuses heures de discussions/réflexions que nous avons décidé d’arbitrer en choisissant que nous déploieront l’application « Impersonate » après une phase de communication conséquente.
Visites guidées renforcées
Évidemment, en 2026, nous rajouterons de nouvelles visites guidées, notamment pour les applications « Tableaux » et « Collectives », qui sont relativement difficiles à prendre en main par les utilisateur⋅ices.
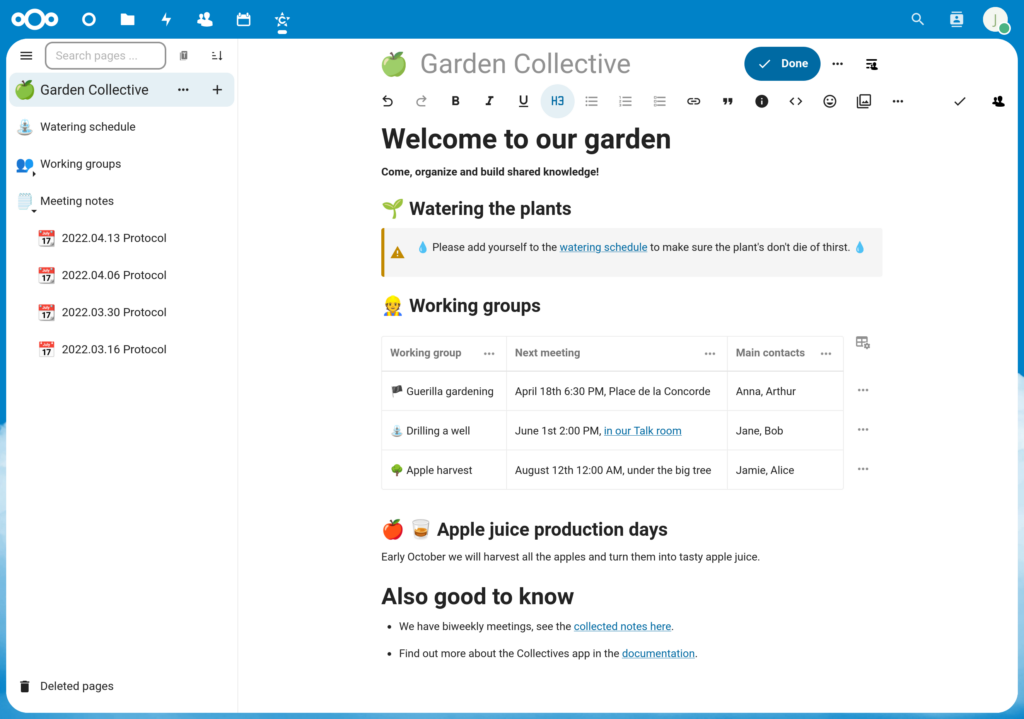
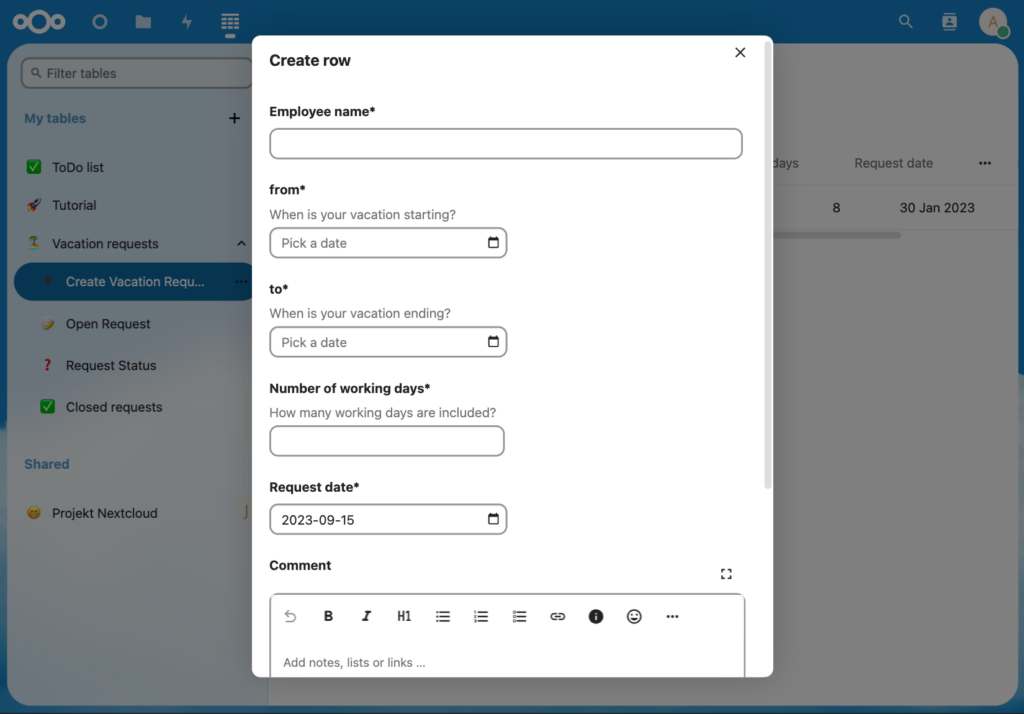
Le tuto dont vous êtes le héros
On l’a vu précédemment : une des principales difficultés avec Nextcloud (et donc Framaspace), c’est ce que l’on nomme l’onboarding, c’est à dire la capacité à embarquer un nouvel utilisateur dans un usage « agréable » de la plateforme. C’est pourquoi Framasoft a intégré la vidéo de présentation évoquée plus haut, ou a développé l’application Visites guidées.
En 2026, nous souhaiterions aller plus loin que la production d’une simple documentation ou vidéo-tutoriel, qui peuvent s’avérer rapidement obsolètes, et surtout sont assez linéaires.
Après avoir retourné le problème dans tous les sens, nous voulons expérimenter une autre façon de faire un tutoriel. Qui soit plus interactif. Plus proche des besoins réels des utilisateur⋅ices. Qui puisse être enrichi facilement. Et soyons dingues, qui puisse être un peu ludique !
Ainsi, si le temps (et vos dons !) nous le permettent, nous devrions pouvoir publier une première version de ce « tutoriel dont vous êtes le héros ou l’héroïne », inspiré du fonctionnement des « Livres dont vous êtes le héros ».
On espère vous en dire plus dans le premier semestre 2026 !
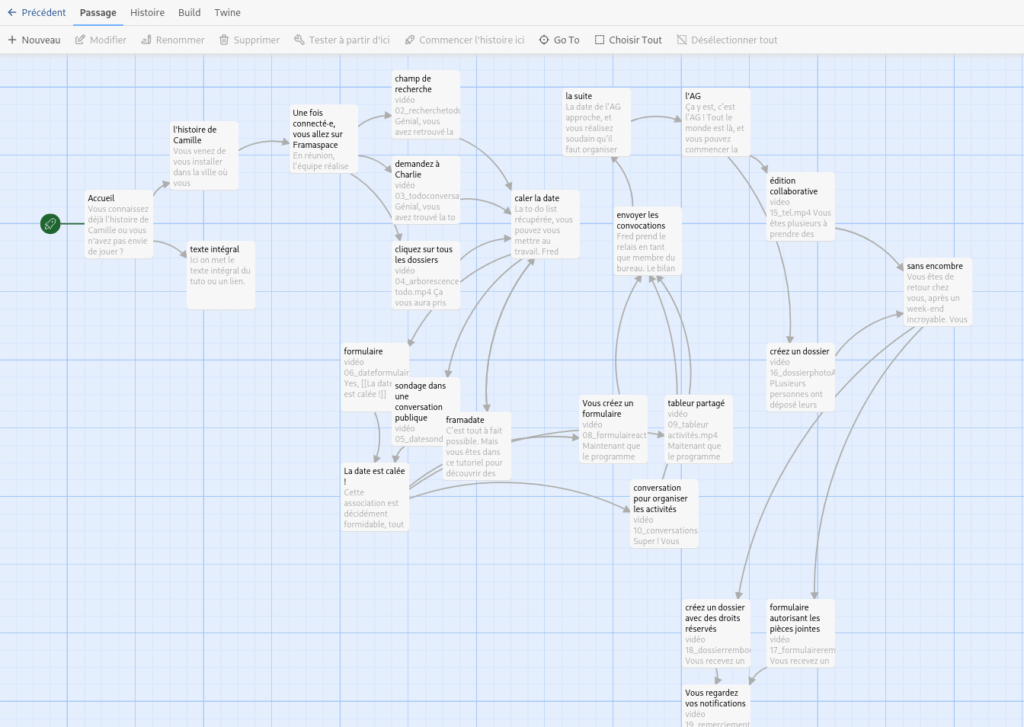
Capture écran d’un scénario de tutoriel interactif pour Framaspace, utilisant le logiciel libre Twine.
Le cockpit dont rêvent les admins
Parmi les travaux de Boris, il y aura – là encore, si tout va bien – la possibilité pour les administrateur⋅ices d’espaces d’accéder à un « Tableau de bord du Framaspace » avec diverses informations pratiques : quota de fichiers utilisés, utilisateurs les plus gourmands en espace disque, liste des 10 plus gros fichiers de l’espace, nombre d’utilisateurs connectés les dernières heures (jours/semaines/mois), suite bureautique utilisée, etc.
Fast & Furious
(ne vous plaignez pas, on aurait pu faire rimer avec couscous)
Depuis la mise en service de Framaspace, nous utilisons le logiciel libre Minio pour gérer le stockage de fichiers en mode « objet ».
En effet, Framaspace, c’est 320 téraoctets d’espace disque réservés, sur lesquels 192To (soit 192 000Go tout de même) sont réellement utilisables, le reste étant dédié à la sécurisation de données. Certains Framaspaces accueillent plus de 50 000 fichiers (et certains plus de 100 000 😱).
C’est donc Minio qui gère ces millions de fichiers. Or Minio montre certaines limites pour diverses raisons, et surtout depuis le 3 décembre 2025 (c’est donc tout frais !) est passé en mode « maintenance seulement », au profit de sa version propriétaire (on vous en reparlera sans doute). Par conséquent, nous envisageons une migration vers un autre logiciel libre, SeaweedFS. Cette opération sera coûteuse en temps et en énergie (et là encore, en argent), mais nous espérons qu’elle permettra d’accroître les performances de la partie « Fichiers » de Framaspace.

La façon dont l’auteur de ces lignes imagine l’admin-sys de Framasoft gérer les serveurs Framaspace.
Dans les coulisses
5 000 espaces fin 2026 ? 10 000 avant 2030 ?
Parti de zéro fin 2022, Framaspace comptait 700 espaces fin 2023, 1 500 fin 2024 et aujourd’hui environ 2 500 espaces. Novembre 2025 a d’ailleurs été le mois où nous avons déployé le plus d’espaces dans l’histoire du projet, avec 180 nouveaux Framaspaces, et donc autant d’instances Nextcloud. À ce rythme là, nous devrions atteindre les 5 000 espaces d’ici 12 à 18 mois. Cela pourrait être plus long, car les espaces inactifs pendant plusieurs mois sont automatiquement désactivés, puis supprimés quelques mois plus tard.
À notre connaissance, Framasoft, micro-association française, est donc devenue sans vraiment le vouloir le plus gros hébergeur associatif mondial de la solution libre Nextcloud 😅
Nous estimons notre technologie et notre infrastructure singulières, mais robustes. Elles nous permettent de déployer rapidement des dizaines d’instances Nextcloud par jour. Les personnes intéressées par les aspects techniques peuvent se référer à notre article technique présenté lors des JRES 2024 (voir ici pour une courte présentation vidéo lors de cet événement).
La fabrique des Framaspaces
Souvent, les personnes avec lesquelles nous échangeons ont tendance à penser que nous sommes des dizaines de salarié⋅es à travailler sur un tel projet. Nous aimerions bien 😝
La réalité est toute autre. En effet, lissé sur l’année, on peut comparer le temps de travail dédié à Framaspace à… un mi-temps d’une seule personne ! Cela peut paraître assez fou – en tout cas, pour nous, ça l’est ! – mais Framaspace est actuellement géré par :
- un administrateur systèmes pour gérer la vingtaine de serveurs du projet, et l’ensemble du processus de déploiement, qui y consacre en gros 15 % de son temps de travail (car Framaspace n’est qu’un des multiples services hébergés par Framasoft) ;
- un développeur Nextcloud, pour s’assurer des mises-à-jour logicielles, développer les correctifs Nextcloud (et il en a proposé… beaucoup !), gérer les différentes applications, etc. Il y consacre environ 20 % de son temps de travail, puisque le reste du temps, il est… directeur de l’association Framasoft 😅 ;
- un « chef de projet » (si on était modernes, on parlerait de Product Owner) pour coordonner les différentes tâches autour du projet (communication, backlog, sélection des candidatures, conférences, etc), pour environ 15 % de son temps de travail.
Cela représente donc un demi équivalent temps plein, pour fournir un service cloud à plus de 20 000 personnes aujourd’hui !
Un coût conséquent, mais maîtrisé
Si on ajoute le coût – conséquent – de l’infrastructure technique, nous estimons que Framaspace coûte à Framasoft environ 30 000€ par an. Cela peut paraître énorme à certain⋅es, d’autant que nous finançons ce projet sur nos fonds propres, mais cela est en fait relativement ridicule par rapport au service fourni (ici : 2 500 instances Nextcloud). Ainsi, lorsqu’on nous demande
« Combien coûterait un Framaspace si Framasoft ne l’offrait pas gracieusement ? »
nous répondons qu’actuellement, déployer un Framaspace nous coûte environ 12€ par an (soit environ 1€ par mois), mais que si on veut y intégrer les frais engagés les années précédentes, on est plutôt autour de 50€/espace.
Pour finir (et pour agir)
Les retours que nous avons sur Framaspace sont très positifs. Une fois passée la phase parfois frictionnelle d’onboarding évoquée plus haut, les utilisateurs semblent plutôt satisfaits du service rendu !
Nous avons fait le choix de la gratuité avec fierté, et sans regret, car nous pensons que l’argent ne devrait pas être un discriminant pour s’émanciper des GAFAM et accéder à des services libres de qualité. Si vous en avez le besoin pour votre association ou collectif, n’hésitez donc pas à candidater, ou à en parler autour de vous !
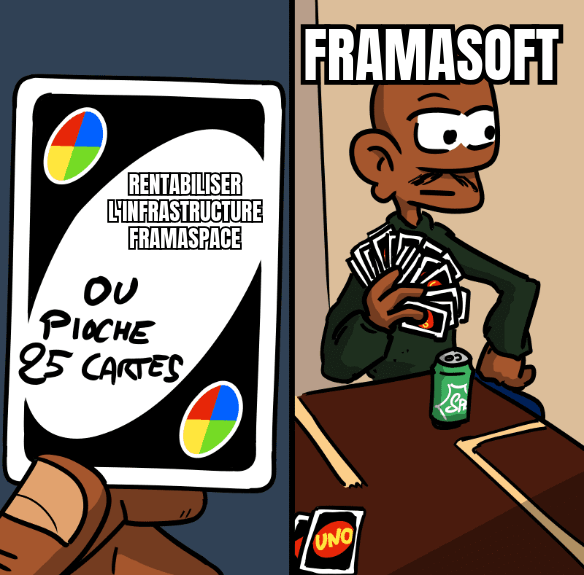
Cependant, comme évoqué plus haut, c’est un projet très coûteux pour notre association. Framasoft, pour différentes raisons, souhaite conserver un modèle économique basé sur le don et le mécénat, et non sur la vente de produits ou de prestations de service à des clients (il y a d’autres structures qui font cela très bien).
Si vous trouvez ce projet utile, que vous en bénéficiez ou pas, merci alors de soutenir Framasoft. Votre don, qu’il soit de 10€ ou de 100€ (défiscalisables !) nous permettra d’ouvrir toujours plus de Framaspaces, afin de pouvoir dégoogliser toujours plus d’associations et collectifs qui changent le monde !
02.12.2025 à 09:37
Framatoolbox, une boite à outils numérique pour les p’tits besoins du quotidien
Framasoft
Texte intégral (3679 mots)
01.12.2025 à 07:42
Khrys’presso du lundi 1er décembre 2025
Khrys
Texte intégral (9042 mots)
Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour découvrir les informations que vous avez peut-être ratées la semaine dernière.
Tous les liens listés ci-dessous sont a priori accessibles librement. Si ce n’est pas le cas, pensez à activer votre bloqueur de javascript favori ou à passer en “mode lecture” (Firefox) ;-)
Brave New World
- China launches an emergency “lifeboat” to bring three astronauts back to Earth (arstechnica.com)
This is a “successful example for efficient emergency response in the international space industry.”
- Inondations record au Vietnam : au moins 90 morts en une semaine (reporterre.net)
- Ethiopian volcano erupts for first time in 12,000 years (theguardian.com)
- Au Zimbabwe, la nouvelle loi sur les ONG menace de transformer les « chiens de garde » de la société civile en « toutous » (equaltimes.org)
Les observateurs des droits humains tirent la sonnette d’alarme face à ce qu’ils qualifient comme une « attaque sans précédent contre l’espace civique au Zimbabwe », qui a une « incidence néfaste sur les libertés fondamentales ».
- Une île et une ville coupées en deux depuis 1974 : qu’est-ce que la « ligne verte » de Chypre ? (slate.fr)
- Le plan de paix pour l’Ukraine s’enlise, la guerre continue (portail.basta.media)
Présenté par Trump, renégocié l’Ukraine et l’UE, le plan des Etats-Unis pour mettre fin à la guerre en Ukraine ne satisfait personne. Reste-t-il un espoir ? En tout cas, la guerre continue, racontent les indés internationaux.
- The mysterious black fungus from Chernobyl that may eat radiation (bbc.com)
Along with the apparently radiotropic fungi, Zhdanova’s surveys found 36 other species of ordinary, but distantly related, fungi growing around Chernobyl. […] It would add to knowledge of a potentially new foundation of life on Earth – that thrives on radiation rather than sunlight. And lead scientists at Nasa to consider surrounding their astronauts in walls of fungi for a durable form of life support.
- Un congrès du parti d’extrême droite AfD en Allemagne perturbé par des milliers de manifestant·es (huffingtonpost.fr)
Les manifestant·es ont été pris·es à partie par la police, mais sont parvenu·es à retarder le congrès de deux heures.
- Quand l’État policier tue. Vaud, miroir des violences coloniales en Suisse (contretemps.eu)
En Suisse romande, la mort de Marvin en août dernier lors d’une poursuite policière à Lausanne a ravivé les mobilisations contre les violences policières et le racisme systémique. Le décès de ce jeune homme de 17 ans s’inscrit dans une série de cas similaires survenus ces dernières années dans le canton de Vaud, tous concernant de jeunes hommes noirs morts entre les mains de la police.
- Au nom du féminisme : en Suisse le service obligatoire à l’armée s’élargit (blogs.mediapart.fr)
- Grève générale en Belgique : paralysie du pays et bras de fer autour du budget (france24.com)
La Belgique vit ce mercredi sa troisième journée de mobilisation, marquée par une grève générale qui paralyse transports, écoles et administrations. Ce mouvement d’une ampleur inédite depuis les années 1980 vise la politique d’austérité du Premier ministre Bart De Wever, qui vient de conclure un budget finalement revu à la baisse.
- Quels lobbies les eurodéputés d’extrême droite (et les autres) rencontrent-ils à Bruxelles ? (multinationales.org)
L’extrême droite est en position de force au Parlement européen depuis les élections de 2024 […] les données disponibles sur leurs rendez-vous montrent un penchant pour les lobbies de l’agroindustrie et de l’énergie, ainsi que pour des think tanks trumpistes ou proche du pouvoir hongrois.
- Reality Check : EU Council Chat Control Vote is Not a Retreat, But a Green Light for Indiscriminate Mass Surveillance and the End of Right to Communicate Anonymously (patrick-breyer.de) – voir aussi Chat control evaluation report : EU Commission again fails to demonstrate effectiveness of mass surveillance of intimate personal photos and videos (patrick-breyer.de)
- « L’accord UE-Mercosur, le traité de libre-échange le plus contesté de l’histoire européenne » (politis.fr) – voir aussi Le « mécanisme de rééquilibrage », un discret mais dangereux dispositif du Mercosur (politis.fr)
C’est une mesure qui n’a pas fait couler beaucoup d’encre. Le « mécanisme de rééquilibrage », ajouté à la dernière minute dans l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et les pays du Mercosur, présente un danger majeur pour l’amélioration des normes sociales, sanitaires et environnementales.
- Airbus rappelle 6 000 avions en urgence à cause d’un logiciel vulnérable (huffingtonpost.fr)
Des milliers d’avions A320 doivent « arrêter immédiatement les vols » le temps qu’un de leurs logiciels soit changé et pour certains appareils, la manipulation « prendra des semaines ».
Voir aussi Global airlines affected major A320 recall by Airbus (reuters.com)
Europe’s Airbus has ordered immediate repairs to 6,000 of its widely used A320 jets in a sweeping recall affecting more than half the global fleet, threatening upheaval during the busiest travel weekend of the year in the U.S. and sparking disruption worldwide.The fix mainly involves reverting to earlier software, but it must be done before the planes can fly again
- Canada’s Carney rolls back climate rules to boost investments (aljazeera.com)
Canada’s Prime Minister Mark Carney has signed an agreement with Alberta’s premier that will roll back certain climate rules to spur investment in energy production, while encouraging construction of a new oil pipeline to the West Coast.
- Un « plan Trump » signé Poutine (politis.fr)
La connivence entre le président américain et le dictateur russe n’a jamais été aussi manifeste. Tout à l’avantage du second.
Voir aussi Une fuite explosive révèle la profondeur du rapprochement Trump – Poutine (legrandcontinent.eu)
ce document important révèle la portée du rapprochement entre la Maison-Blanche et le Kremlin — aux dépens de l’Ukraine.
- Double revers pour Donald Trump, la justice annule l’inculpation de ses bêtes noires James Comey et Letitia James (huffingtonpost.fr)
Une juge fédérale américaine a annulé ce lundi 24 novembre l’inculpation de l’ancien directeur du FBI James Comey et de la procureure générale de l’État de New York, Letitia James, cibles de la vindicte du président américain.
Voir aussi Judge dismisses cases against ex-FBI director Comey and NY attorney general James (bbc.com)
- Robert F Kennedy Jr is currently receiving gender-affirming care. Yes, really (thepinknews.com)
The 71-year-old Republican is reportedly taking hormone replacement therapy medication despite his repeated criticism of the medical treatment, which is an often life-saving way to affirm trans people’s gender identity.
- DOGE “cut muscle, not fat” ; 26K experts rehired after brutal cuts (arstechnica.com)
Government brain drain will haunt US after DOGE abruptly terminated.
- Plus de 5 500 sites industriels toxiques aux États-Unis pourraient être inondés d’ici 2100 (reporterre.net)
- The Trump Administration’s Data Center Push Could Open the Door for New Forever Chemicals (wired.com)
- La course aux “bébés sur mesure” a commencé (france24.com)
La startup américaine Preventive veut modifier des embryons humains pour empêcher la transmission de maladies génétiques. Ses investisseurs, notamment Brian Armstrong (PDG de Coinbase) et Oliver Mulherin (ingénieur australien et mari de Sam Altman), voient dans ces technologies une avancée pour la santé. Entre promesses médicales et dérives eugénistes, […] lumière sur un transhumanisme qui ne demande plus la permission.
- États-Unis – Venezuela : on vous résume les 4 mois de tensions croissantes entre les deux pays (huffingtonpost.fr)
Entamée début août, l’escalade entre les deux pays continue. Donald Trump, au nom de la lutte contre le narcotrafic, fait désormais planer la menace d’opérations « sur terre ».
- U.S. Military Documents Indicate Plans to Keep Troops in Caribbean Through 2028 (theintercept.com)
As rumors of a U.S. war on Venezuela swirl, military documents show plans to feed a buildup of troops in the region for years.
- Coup de force à la COP30 : énergies fossiles et déforestation exclus d’un accord décevant (reporterre.net)
- Dilemme dans le monde de la musique : « On ne mène pas une espèce d’arbre au bord du gouffre pour jouer Vivaldi » (reporterre.net)
Le Brésil souhaite empêcher le commerce du pernambouc, un bois jugé indispensable à la fabrication d’archets. Artisans, musiciens… La profession est (quasi) unanimement contre. Et si une transition était possible ?
- Violents orages et grêlons géants observés au Brésil (meteo-paris.com)
Une vague d’orages particulièrement puissants a touché le sud-est du pays dimanche 23 novembre 2025. Les plus gros grêlons ont été observés dans l’État du Rio Grande do Sul et plus particulièrement dans le secteur d’Erechim. Si certains étaient gros comme des œufs, des grêlons allant jusqu’à 10 cm de diamètre ont été signalés !
L’insolite de la semaine
- Un Irlandais a développé une tuberculose du pénis (slate.fr)
Un cas similaire avait été rapporté en 2001 au Royaume-Uni : un homme avait développé une tuberculose pénienne et sa partenaire avait contracté sa version utérine un an plus tard, ce qui suggère une transmission sexuelle. […] « Il est encourageant de constater que tous les cas publiés de tuberculose pénienne ont bien répondu au traitement antituberculeux et ont abouti à une guérison complète »
Spécial IA
- Major AI conference flooded with peer reviews written fully by AI (nature.com)
Controversy has erupted after 21 % of manuscript reviews for an international AI conference were found to be generated by artificial intelligence.
- ‘We could have asked ChatGPT’ : students fight back over course taught by AI (theguardian.com)
Students at the University of Staffordshire have said they feel “robbed of knowledge and enjoyment” after a course they hoped would launch their digital careers turned out to be taught in large part by AI.
- Pourquoi les reconstitutions par IA de la Rome antique sont remplies d’erreurs (france24.com)
- Don’t cite the Adversarial Poetry vs AI paper — it’s chatbot-made marketing ‘science’ (pivot-to-ai.com)
- Manipuler la synthèse de document (danslesalgorithmes.net)
Désormais, la personne la plus importante d’une réunion est devenue celle qui prend des notes, à savoir, bien souvent, l’IA. C’est elle qui attribue des actions et détermine l’importance des propos tenus. D’où l’enjeu à l’influencer , en s’exprimant davantage en fonction des critères de résumés et d’importance que l’IA va prendre en compte. D’où l’enjeu à adapter son langage afin qu’il soit plus susceptible d’être repris dans les résumés, par exemple en répétant les points clés ou en utilisant des formules passe partout.
- OpenAI says dead teen violated TOS when he used ChatGPT to plan suicide (arstechnica.com)
Facing five lawsuits alleging wrongful deaths, OpenAI lobbed its first defense Tuesday, denying in a court filing that ChatGPT caused a teen’s suicide and instead arguing the teen violated terms that prohibit discussing suicide or self-harm with the chatbot.
- ChatGPT maker OpenAI confirms major data breach, exposing user’s names, email addresses, and more (windowscentral.com)
“Transparency is important to us.”
- Meet the AI workers who tell their friends and family to stay away from AI (theguardian.com) – voir aussi Ces travailleureuses de l’IA qui conseillent de s’en tenir à l’écart (portail.basta.media)
- Browser Extension ‘Slop Evader’ Lets You Surf the Web Like It’s 2022 (news.slashdot.org)
“The internet is being increasingly polluted by AI generated text, images and video,” argues the site for a new browser extension called Slop Evader. It promises to use Google’s search API “to only return content published before Nov 30th, 2022” — the day ChatGPT launched — “so you can be sure that it was written or produced by the human hand.”
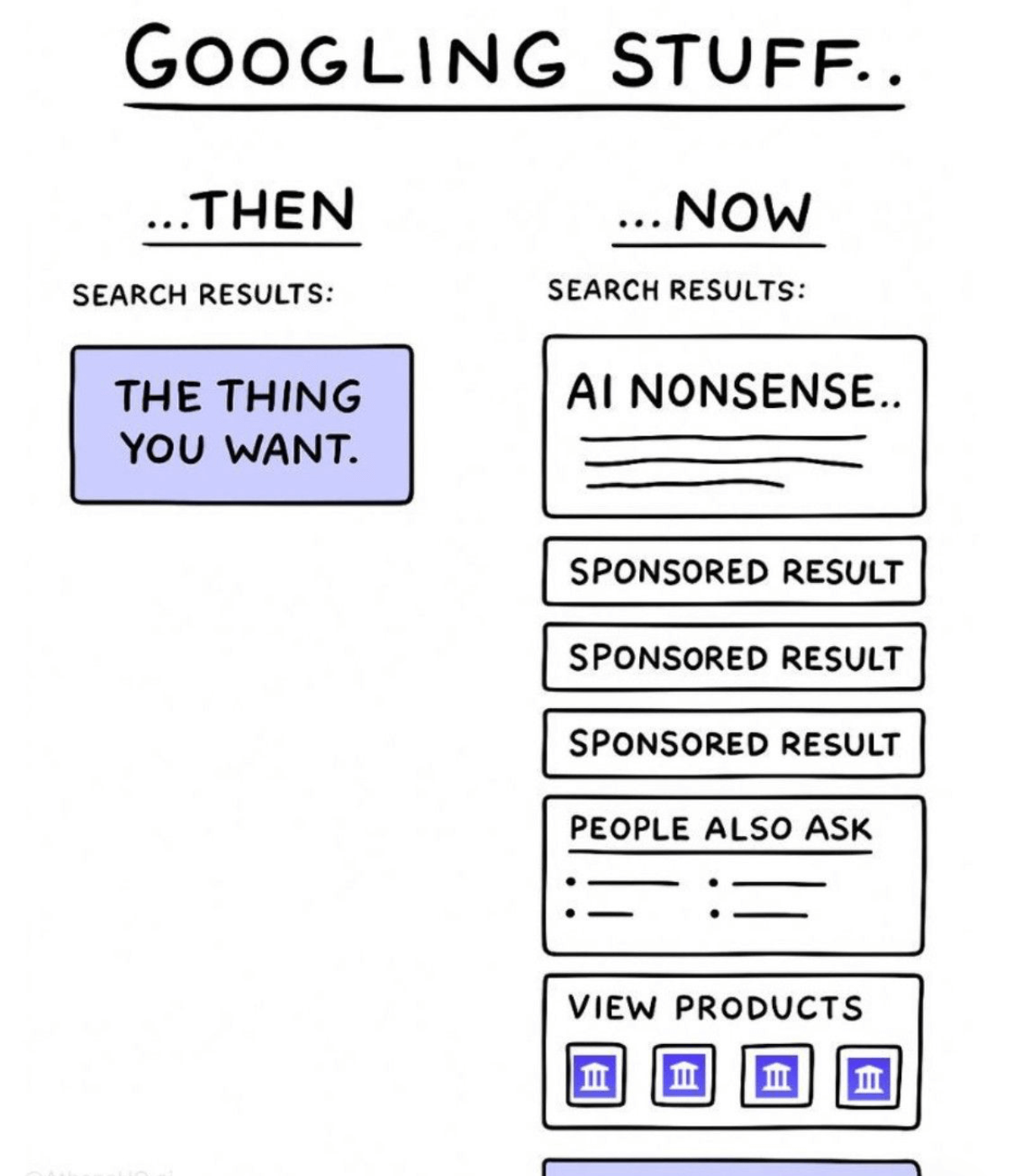
- Black Friday : ces IA peuvent désormais faire les courses à notre place (huffingtonpost.fr)
- Leak confirms OpenAI is preparing ads on ChatGPT for public roll out (bleepingcomputer.com)
- A trillion dollars is a terrible thing to waste (garymarcus.substack.com)
The machine learning community is finally waking up to the madness, but the detour of the last few years has been costly.
- Avec la Mission Genesis, Trump veut lancer un « Projet Manhattan » de l’IA (legrandcontinent.eu) – voir aussi Mission Genesis : Trump confie la recherche américaine à l’IA (next.ink)
Spécial Palestine et Israël
- Cisjordanie : deux Palestiniens tués à Jénine après s’être rendus, selon une vidéo authentifiée par la BBC (slate.fr)
Les images montrent deux hommes sortant d’un bâtiment les mains en l’air avant d’être abattus par des forces israéliennes. L’Autorité palestinienne dénonce un « crime de guerre », tandis qu’Israël affirme cibler un « réseau terroriste ».
- Gaza : après le génocide, le génocide (contretemps.eu)
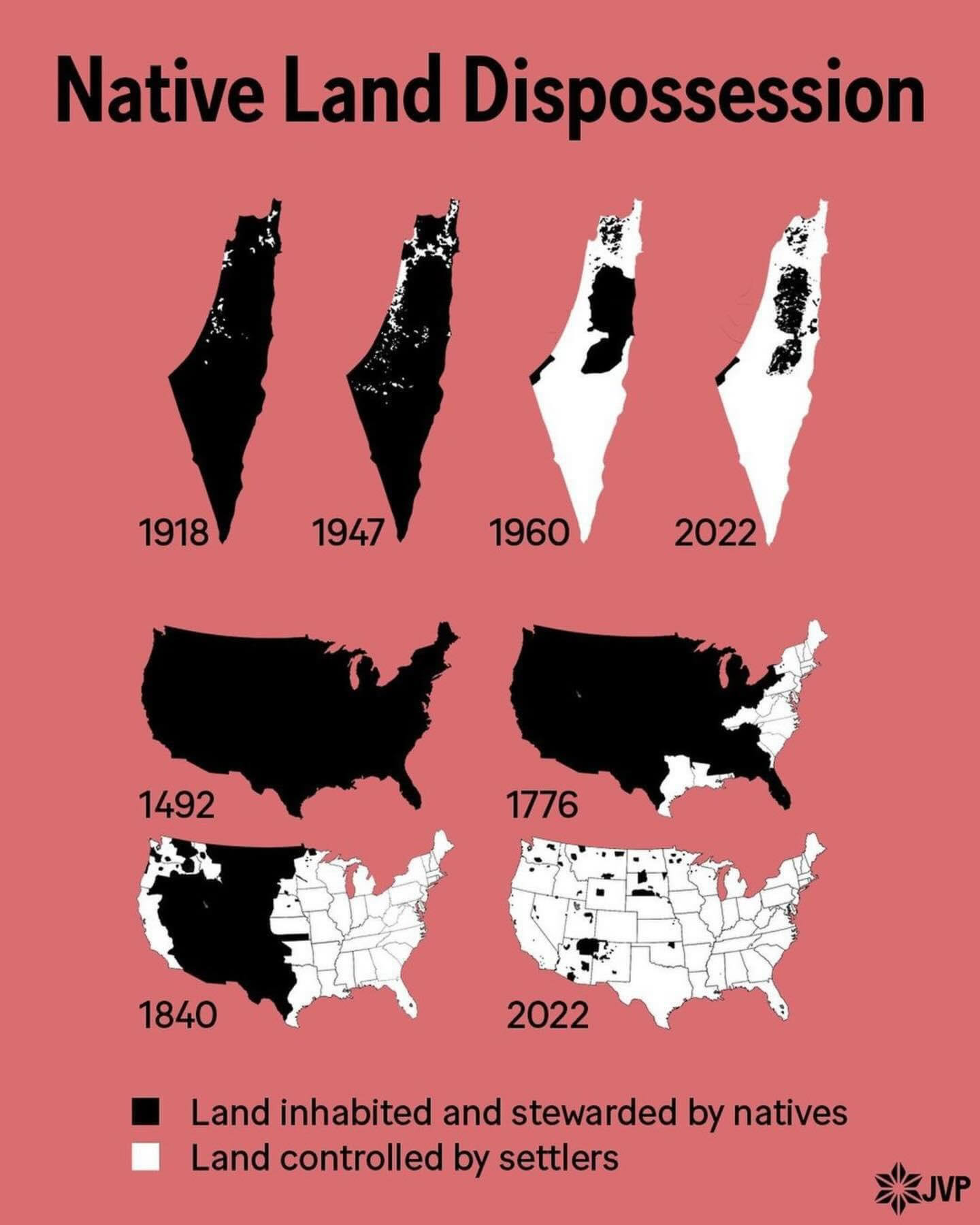
- De l’usage du viol comme arme de génocide par Israël. (agencemediapalestine.fr)
Le Centre palestinien pour les droits de l’humain (PCHR) a récemment publié un rapport rassemblant les témoignages de Palestinien·nes victimes de viol, libéré·es de centres de détention israéliens et renvoyé·es à Gaza. Les récits rapportés sont d’une extrême brutalité.
Spécial femmes dans le monde
- For French pioneer healers, female genital mutilation is part of the ‘continuum of sexual violence’ (voxeurop.eu)
- Avec ses nouvelles règles, Instagram musèle les organisations féministes (telerama.fr)
- New GenderIT.org edition : A decolonial feminist analysis on technology-facilitated gender-based violence (apc.org)
- Première Miss Angleterre ouvertement lesbienne, Grace Richardson, espère « inspirer plus de femmes » (huffingtonpost.fr)
Spécial France
- Fin de la 2G : 6 millions d’appareils bientôt hors service ? (60millions-mag.com)
- Ce qui change au 1er décembre 2025 : prime de noël, garde alternée, Parcoursup, fauteuils roulants… (huffingtonpost.fr)
- Accessibilité numérique : les sites web des communes sont très en retard (zdnet.fr)
Une analyse menée par la Dinum, Déclic et l’Adullact montre une très faible conformité des sites web de communes françaises, dont plus de 60 % obtiennent la note la plus basse.
- Comment deux piratages ont permis la fuite de données sensibles sur des hauts fonctionnaires et le vol d’armes à feu dans des cambriolages (franceinfo.fr)
- Fuite de données à la Fédération Française de Cardiologie… y compris des mots de passe (next.ink)
- L’Arcom demande le blocage du site « WatchPeopleDie », aux contenus ultraviolents (huffingtonpost.fr)
Le régulateur du numérique a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris six fournisseurs d’accès à internet.
- Santé mentale : « Des enfants sont en grave danger », estime Élise Le Bail, infirmière en psychiatrie (humanite.fr)
- Affaire Bygmalion : Nicolas Sarkozy définitivement condamné pour le financement de sa campagne de 2012 (lemonde.fr)
L’ancien chef de l’Etat « prend acte » de sa condamnation définitive à un an de prison dont six mois ferme, ont déclaré à l’AFP ses avocats Patrice Spinosi et Emmanuel Piwnica. La cour avait ordonné, en février 2024, l’aménagement pour la partie ferme (bracelet électronique, semi-liberté…).
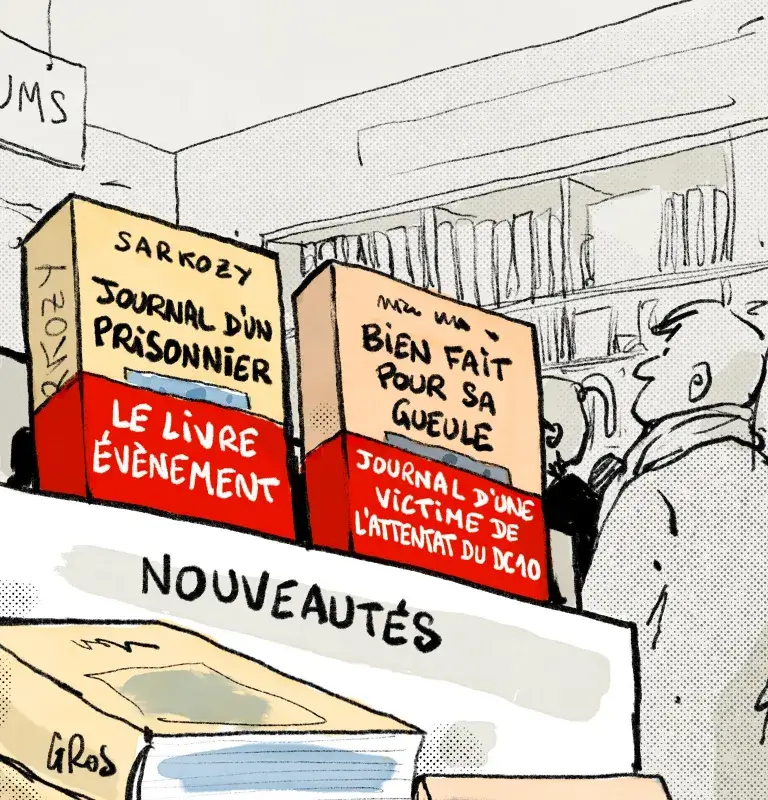
- 500 mètres en 5 minutes : Le tunnel qui va révolutionner le transfert entre gare du Nord et gare de l’Est (france3-regions.franceinfo.fr)
- Un forfait Navigo qui passe la barre des 90 euros : Valérie Pécresse décide d’une nouvelle hausse des tarifs des transports franciliens (humanite.fr)
- Comment LVMH a envahi le Louvre (multinationales.org)
Depuis vingt ans, le groupe de Bernard Arnault, numéro un mondial du luxe, tisse sa toile dans le premier établissement culturel français. Au nom du mécénat, plusieurs marques de LVMH […] sont autorisées à s’approprier les lieux et bénéficient de généreux privilèges. Sans résoudre le manque criant d’investissements dans la maintenance et la sécurité du musée, dont a témoigné le cambriolage retentissant du 19 octobre dernier.
- « Un jugement inédit » : un tribunal refuse un mégapoulailler au nom du changement climatique (reporterre.net)
Le tribunal de Dijon a reconnu, mi-novembre, qu’un maire peut refuser la construction d’un mégapoulailler en raison du futur climatique défavorable. Une jurisprudence inédite pour tous les projets de construction en France.
- Déchets nucléaires : Orano veut augmenter ses capacités d’entreposage à La Hague (reporterre.net)
- TotalEnergies démantèle son terminal méthanier flottant du Havre (reporterre.net)
- Mine de lithium dans l’allier : le rapport qui dévoile une bombe toxique (investigate-europe.eu)
Il y a un an, le gouvernement a annoncé l’ouverture, dans l’Allier, de la plus grande mine de lithium d’Europe. D’après un rapport inédit dévoilé par Investigate Europe et Disclose, le secteur, fortement contaminé à l’arsenic et au plomb, présente « un risque significatif pour l’environnement et la santé humaine ». Une véritable bombe à retardement passée sous silence par les autorités. […] « Nous avons été prévenus des pollutions, mais la préfecture ne nous a jamais demandé d’avertir la population »
- En Guadeloupe et Martinique, la bio plaît aux agriculteurices (reporterre.net)
- Des produits chimiques répandus dans la nature se révèlent nocifs pour nos bactéries intestinales (reporterre.net)
De nombreux produits chimiques répandus dans l’environnement nuisent aux bactéries du microbiote intestinal humain, alors qu’ils n’étaient pas censés avoir de propriétés antibactériennes. C’est l’inquiétante conclusion d’une étude publiée le 26 novembre dans le journal Nature Microbiology.
Spécial femmes en France
- « Aïta – fragments poétiques d’une scène marocaine » : cris et miroitements (politis.fr)
À Bordeaux, le Frac MÉCA reflète la vitalité remarquable de la scène artistique du Maroc – des années 1960 à aujourd’hui – via une exposition chorale qui s’articule autour de l’aïta, art populaire symbole d’insoumission porté par des femmes aux voix puissantes.
- Ouvrières du textile exploitées : des associations affichent leurs témoignages dans le centre de Paris (reporterre.net)
« Je suis exposée à des produits toxiques » ; « Je suis payée entre 0,06 et 0,27 euros par vêtement » ; « J’ai commencé à travailler à 12 ans »… Dans la nuit du 27 novembre, veille du Black Friday, la coalition Stop Fast Fashion a mené une action symbolique afin de mettre en lumière la « réalité invisible » des ouvrières du textile.
- Chers mecs cis, vous êtes priés de garder votre haut ! (rabasse.info)
Nous sommes un groupe de grimpeurs et de grimpeuses de Besançon. Mal à l’aise avec les torses nus de beaucoup de grimpeurs de notre salle, notamment l’été mais pas que, nous avons entamé des démarches afin de rééquilibrer la situation : soit en autorisant la grimpe torse nu pour chacun·e, soit en l’interdisant pour toustes.
- “Ça les emmerde que je sois là depuis 15 ans”, cette sage-femme suspendue par l’ARS dénonce la fermeture “arbitraire” de son cabinet (france3-regions.franceinfo.fr)
“L’accouchement à domicile n’est pas du tout intégré au système de santé français, par choix politique, alors que ça l’est dans d’autres pays proches de chez nous, aux Pays-Bas, en Suisse, en Angleterre, c’est intégré au même titre que d’accoucher en petite maternité, en maison de naissance.”
- Pourquoi en France les start-ups dirigées par des femmes lèvent en moyenne 2,5 fois moins de fonds que celles dirigées par des hommes ? (theconversation.com)
- Le financement des associations féministes a baissé de 31,6 millions € en 2025 (france24.com)
sans argent public, les missions de ces organisations sont menacées et elles aident moins de monde : 6258 femmes et enfants n’ont pas pu être accompagnés en 2025 par rapport à l’année précédente.
- Violences conjugales : La Banque postale propose aux femmes une ouverture de compte secrète et rapide (ouest-france.fr)
Une enquête publiée le 24 novembre souligne que « plus d’une femme sur quatre en couple n’a pas l’usage d’un compte bancaire personnel ». Un chiffre qui démontre une vulnérabilité financière.
- Les VSS en hausse : l’alerte de l’Observatoire national des violences faites aux femmes (lesnouvellesnews.fr)
- Violences faites aux femmes : l’APHP diffuse un protocole médical relatif à la suspicion de soumission chimique (vidal.fr)
- Jean-Vincent Placé, ex-secrétaire d’État écologiste, sera jugé pour agressions sexuelles (huffingtonpost.fr)
Déjà condamné pour harcèlement sexuel en 2021, Jean-Vincent Placé sera jugé à Paris pour des agressions sexuelles sur deux femmes entre 2016 et 2017.
- L’affaire Tran, exemple malheureux d’une justice à deux vitesses (politis.fr)
112 plaignantes, 1 gynécologue… et 11 ans d’instruction. En 2027, le docteur Tran sera jugé pour de multiples viols et agressions sexuelles. Plaintes ignorées, victimes oubliées, délais rallongés… Cette affaire témoigne de toutes les lacunes de la justice en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
Voir aussi « J’étais bloquée face à son pouvoir de médecin » (politis.fr)
Julia* fait partie des nombreuses patientes qui accusent le médecin gynécologue, Phuoc-Vinh Tran, de viols et d’agressions sexuelles. Treize ans après les faits, elle souhaite prendre la parole pour dénoncer les dégâts que causent les lenteurs de la justice.[…] Si le docteur nie les faits, il reste accusé de 92 viols et 25 agressions sexuelles, avec plus de 130 plaintes
- L’avocate Nadia El Bouroumi qui avait choqué lors du procès Mazan va devoir s’expliquer devant ses pairs (huffingtonpost.fr)
L’avocate, qui représentait deux coaccusés de Dominique Pelicot, va comparaître devant le conseil régional de discipline de la cour d’appel de Nîmes.
Spécial médias et pouvoir
- Fin d’Equal Times : En quoi le syndicalisme et le journalisme sont-ils deux canaris dans la même mine (equaltimes.org)
- Quand Pascal Praud s’en prend aux fonctionnaires de l’Assemblée nationale (projetarcadie.com)
- Guerre et service militaire : les médias sonnent le tocsin (acrimed.org)
- Pluralisme en France : sur CNews, le grand contournement (rsf.org)

Spécial emmerdeurs irresponsables gérant comme des pieds (et à la néolibérale)
- La réforme des retraites sera-t-elle suspendue ? Le Sénat entaille la promesse de Sébastien Lecornu (huffingtonpost.fr)
La droite sénatoriale, majoritaire, avait promis de rétablir le passage à 64 ans supprimé à l’Assemblée nationale. C’est chose faite.
- Défiscalisation, contreparties, privatisation rampante… Le mécénat, un cadeau de l’État aux entreprises et aux milliardaires ? (multinationales.org)
Le coût pour les finances publiques : 1,7 milliard d’euros par an, et une influence croissante du secteur privé sur l’orientation de la culture, de la recherche et de l’action associative.
- Héritiers, tricheurs et inutiles : découvrez les 500 fortunes de France (frustrationmagazine.fr)
Qu’est-ce qu’un bourgeois ? […] ce sont les personnes qui possèdent les moyens de production et leurs familles. […] loin d’une vision abstraite du capitalisme comme étant constitué de flux financiers anonymes et invisibles, la bourgeoisie s’affiche ici clairement, avec sa fortune, ses manoirs, ses voitures et ses yachts, mais aussi et surtout sa chère famille. […] La bourgeoisie a bien des visages, très majoritairement des hommes, blancs, patriarches et héritiers
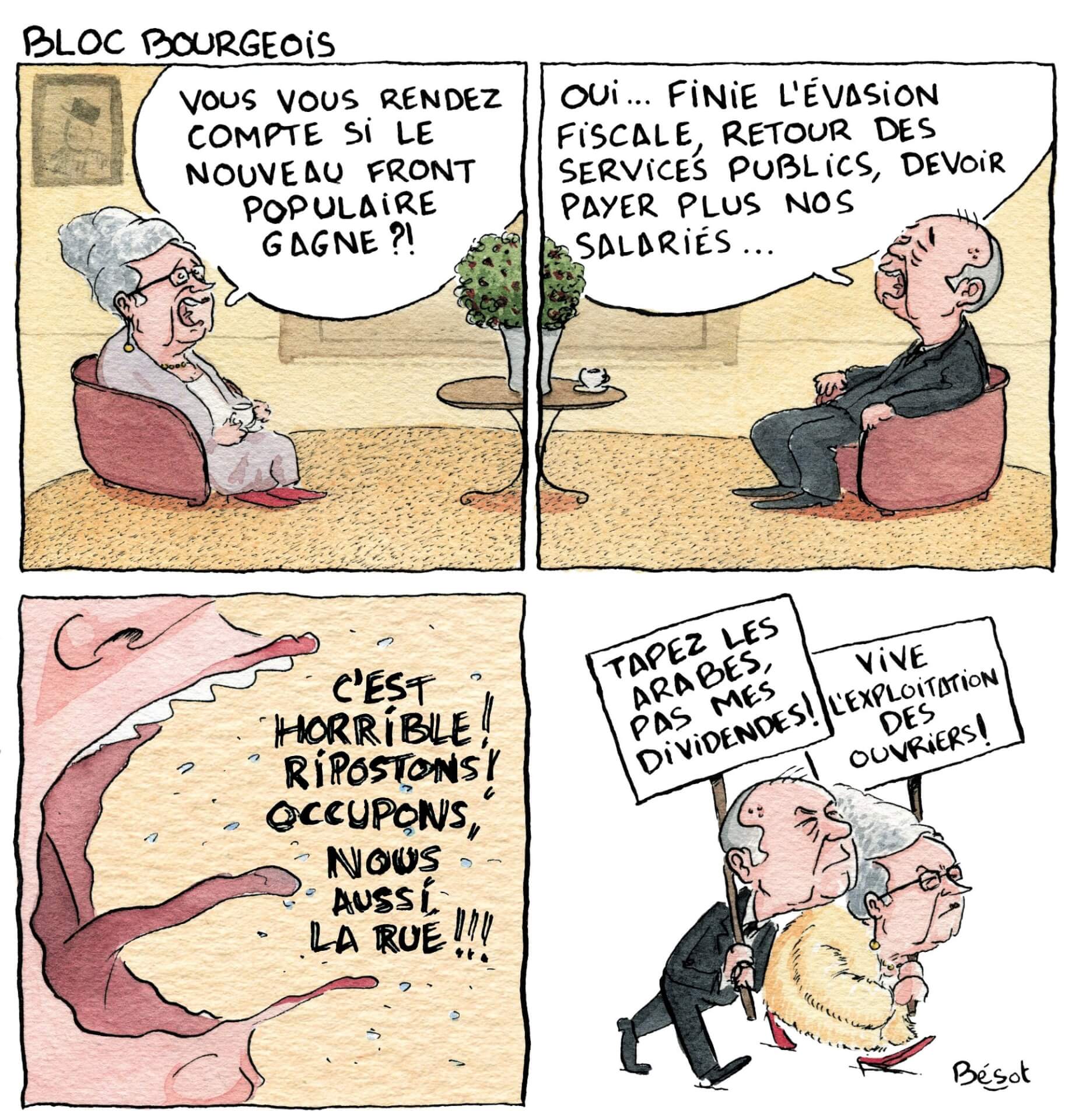
- Scandale Brigitte Macron : 2 millions d’euros des Pièces Jaunes détournés vers e-Enfance (freelanceinfos.fr)
Brigitte Macron, la Première dame, aurait détourné 2 millions d’euros du budget des Pièces Jaunes pour financer l’association e-Enfance sur trois ans. Révélée par Le Canard enchaîné ce mercredi, l’affaire fait grand bruit
Spécial recul des droits et libertés, violences policières, montée de l’extrême-droite…
- « Ils font tout pour m’isoler de mon pays » : le leader indépendantiste de Nouvelle-Calédonie Christian Tein accuse le gouvernement de retarder délibérément l’émission de son passeport (liberation.fr)
- Discours de Mandon : la guerre avec la Russie est-elle inévitable ? (frustrationmagazine.fr) – voir aussi Avec son guide de survie, le gouvernement prépare les Françaises à la guerre (reporterre.net)
C’est un mouvement insidieux, une petite musique qui revient comme une rengaine. Face à la catastrophe climatique […] les autorités nous enjoignent à la « responsabilité » et à la « résilience ». Depuis la pandémie de Covid-19, le gouvernement, qui n’a pas su gérer l’ampleur de la crise sanitaire, promeut à l’excès l’engagement individuel de la population face aux crises.
- Emmanuel Macron pourrait-il annuler les élections en cas de guerre ? (lessurligneurs.eu)
le droit français, à l’inverse du régime ukrainien, ne permet ni d’annuler ni de suspendre une élection, même en cas de conflit. […] Si toutefois, le président de la République abusait de ses pouvoirs exceptionnels et de la situation, cela se ferait hors du cadre juridique et constituerait une violation de la Constitution, risquant de dériver vers un véritable coup d’État
- La police détourne le fichier des passeports et des cartes d’identité (laquadrature.net)
Fournir sa photographie et ses empreintes quand on demande son passeport ou sa carte d’identité est plus lourd de conséquence que ce qu’on imagine. Ces données […] sont récupérées par la police par un contournement de la loi. La Quadrature du Net a pu obtenir des témoignages et preuves formelles de l’utilisation abusive de ce fichier pour identifier des personnes lors d’enquêtes judiciaires.
Voir aussi La police judiciaire contourne la loi pour fouiller le méga « fichier des gens honnêtes » (next.ink)
Initialement promu par Nicolas Sarkozy, le méga « fichier des gens honnêtes » centralisant les données personnelles, photos de visages et empreintes digitales des demandeurs de passeport et de carte nationale d’identité ne devait pouvoir être utilisé que par certains agents de services de renseignement. LQDN a découvert qu’il était régulièrement employé par la police judiciaire.
- GrapheneOS migrates server infrastructure from France amid police intimidation claims (privacyguides.org)
The GrapheneOS project has announced on X that they are ceasing all operations in France, asserting that the country is no longer safe for “open source privacy projects”. While the operating system will still be available to French users, all website and discussion servers are being relocated to countries and providers outside France’s jurisdiction.
- Interpellation en gare : la police déraille à Montparnasse (portail.basta.media)
on découvre que le suspect n’a menacé que sa propre vie, qu’il était déjà entouré d’une demi-douzaine de policiers au moment du tir, et que le mitrailleur « a raté sa cible à moins de 3 mètres… » Et lorsqu’on lit que les forces de l’ordre avaient été prévenues de l’arrivée du suspect une demi-heure à l’avance, l’histoire ressemble bien plus à une bavure qu’à de la légitime défense.
- Paris : la traditionnelle « guerre des sapins » devant le Panthéon vire au clash avec la police (leparisien.fr)
Jeudi 20 novembre place du Panthéon, la traditionnelle « guerre des sapins » entre étudiants d’Henri-IV et Louis-le-Grand a tourné court. La BAC a dispersé les participants au gaz lacrymogène. Bilan : un policier blessé, quatre élèves aux urgences.
- Quand la police nationale exhibe fièrement une banderole féministe à l’envers (blast-info.fr)
C’est une pratique très connue des milieux hooligans : s’afficher encagoulés avec le matériel ennemi retourné. Mais cette fois, il n’est en rien question de sport : c’est la police nationale qui reprend cette mise en scène, en posant fièrement avec une banderole antifasciste et antiraciste.

Action de la collective écoféministe Les chouettes effraient
Voir aussi : Des policiers posent derrière une banderole féministe à l’envers, une enquête administrative ouverte (huffingtonpost.fr)
- L’État contre les associations (contretemps.eu)
Ces dernières années ont vu une succession de mesures et de décisions politiques qui visent à contraindre et à restreindre les libertés associatives. Alors que la France est maillée d’un tissu associatif dense, de telles attaques révèlent les changements à l’œuvre et l’accentuation des tendances répressives de l’État français.
- « L’esclavage, c’est pas fini » (politis.fr)
Arrivé en France adolescent, et sans papiers depuis 2022 en raison du silence de la préfecture, Ulrich, 24 ans, raconte la façon dont les personnes non régularisées sont exploitées dans la restauration.
- “Une loterie” pour envoyer des immigrés légaux à l’armée : l’idée de Louis Sarkozy qui estime “qu’il y a un prix à payer” pour devenir Français (dhnet.be)
Alors qu’Emmanuel Macron pourrait relancer un service militaire volontaire, Louis Sarkozy nourrit le débat en plaidant pour un modèle réservé aux volontaires, mais incluant une part d’immigrés légaux sélectionnés par “loterie”.
- Elena Mistrello, autrice italienne de BD expulsée : « Ce contrôle des frontières concerne tout le monde, en premier lieu les migrants » (politis.fr)
Après son expulsion forcée en Italie, Elena Mistrello, autrice de BD italienne dénonce dans Politis les moyens de contrôle, de surveillance et de répression déployés par l’État contre les personnes migrantes et les militant·es.
- De « l’entrisme islamiste » à la Sorbonne ? Cette visite de députés RN provoque la colère du gouvernement (huffingtonpost.fr)
Trois députés RN ont fait irruption sur le campus de Villetaneuse de la Sorbonne et y ont tourné des vidéos sans autorisation.
Spécial résistances
- Jordan Bardella enfariné à la foire agricole de Vesoul, le RN va déposer une plainte (huffingtonpost.fr)
« C’est un non-événement, un gamin de 16 ans, probablement un manque d’éducation des parents, qui a jeté de la farine sur les agriculteurs et sur moi-même pendant que je discutais avec des agriculteurs. Jean Moulin a fait mieux par le passé », a réagi en fin de journée Jordan Bardella dans les colonnes de L’Est Républicain.

Voir aussi Enfarinage de Jordan Bardella à Vesoul : derrière les relais policiers, un autre récit moins glamour (lechni.info) - Jordan Bardella porte plainte après avoir reçu un œuf sur la tête, une personne interpellée (lemonde.fr)
- Les libraires indépendant·es disent non à la censure et aux intimidations (basta.media)
Un rassemblement s’est tenu à Paris pour dénoncer la multiplication des attaques de librairies, sur fond de conflit israélo-palestinien. En parallèle, le Conseil de Paris vient de rejeter une subvention à 40 librairies indépendantes.
- Fichage des antinucléaires : les ONG saisissent la justice européenne (reporterre.net)
- “Le chantier déborde”, près de 300 plaintes sur le dossier de l’A69 et une nouvelle mise en cause du concessionnaire Atosca (france3-regions.franceinfo.fr) – voir aussi A69 : les chantiers dépasseraient de dizaines d’hectares la délimitation autorisée, les opposants à l’autoroute annoncent une plainte (humanite.fr)
- Centrales à bitume pour l’A69 : les riverains créent leur propre outil pour contrôler la qualité de l’air (reporterre.net)
- « Les armes chimiques tuent encore, à quand la fin de l’impunité ? » (reporterre.net)
L’agent orange épandu par les États-Unis au Vietnam il y a plus de 50 ans fait toujours des victimes. Le collectif Vietnam-Dioxine appelle dans cette tribune à les identifier, pour qu’une « réparation digne » puisse être envisagée.
Spécial outils de résistance
- Depuis les grandes grèves de 1995, les gouvernements ne reculent plus (rapportsdeforce.fr)
Il y a 30 ans, le 24 novembre 1995, commençait le mouvement de grève de novembre-décembre. Après plus de trois semaines de quasi paralysie du pays, le gouvernement Juppé cédait. A l’exception des mobilisations contre le CPE, portées par la jeunesse en 2006, c’est la dernière fois que le pouvoir reculait face à un mouvement social. Au moins une raison, mais pas la seule, de se pencher sur cette période
- Sortir de l’entre-soi blanc : neuf pistes pour refonder le mouvement écolo (reporterre.net)
Spécial GAFAM et cie
- Google wins multimillion-pound contract to supply sovereign cloud services to Nato (computerweekly.com)
Google Cloud has secured another multimillion-pound contract to supply a military organisation with secure sovereign cloud capabilities, several months after inking a similar deal with the UK’s Ministry of Defence.
- AWS to build 1.3 gigawatts of government-grade supercomputing power for Uncle Sam (theregister.com)
Amazon Web Services on Monday announced a plan to build 1.3 gigawatts of compute capacity in new datacenters dedicated to serving the US government, at a cost of up to $50 billion.
- Amazon exploite 924 data centers dans le monde, dont 29 en France (reporterre.net)
la consommation énergétique combinée de dix-sept de ces centres de données basés dans l’Hexagone a atteint 7,46 millions de mégawattheures en 2023.
- Airbus peine à se débarrasser de Microsoft Office (lemondeinformatique.fr)
Engagé depuis plusieurs années dans une migration vers… Google Workspace, Airbus est confronté à plusieurs soucis dont les dépendances à Excel, les exigences de conformité et les problèmes de comptabilité.
Les autres lectures de la semaine
- À moins de dix, ils ont cassé Internet (reflets.info)
Les pannes affectant toute une partie du Web se multiplient. Nous atteignons une situation qui est inverse à celle voulu par la DARPA lors de la création d’Internet. Et cela ne devrait pas s’arranger.
- Le Réseau, ou lorsque nous étions intraçables (laviedesidees.fr)
Créé par des résistants des PTT, un réseau téléphonique parallèle a survécu après la Libération. Espace de communication et de rencontre dans les années 1970, il constitue le chaînon manquant entre les agences matrimoniales du XIXe siècle et nos applis contemporaines.
- Les SSD non alimentés dans votre tiroir perdent lentement leurs données : bien que les SSD dominent l’informatique active, ils présentent un risque important pour le stockage d’archives à long terme (developpez.com)
- Cette grande arnaque qu’est notre auto (ledevoir.com)
Comme nous avons vendu nos villes et nos villages au diable. Comme nous les avons laissés se faire la piastre en déshumanisant nos quartiers, en nous vendant la promesse d’un progrès qui n’était que de futures chaînes. Ah, on est bien pognés maintenant, à se vendre des pipelines, toute notre économie est dépendante du pétrole et on est là comme des dindons à faire la queue leu leu dans notre char.
- Exarchia sans les condés : Paradis perdu ? (cqfd-journal.org)
- Les femmes noires sont (toujours) les grandes traîtresses du capital (politis.fr) – voir aussi À qui profite le Bouyon ? (lundi.am)
Les BDs/graphiques/photos de la semaine
- ARCOM
- Bloc bourgeois
- Cauchemar
- Dangereuses
- Bardella
- Vitrine
- Sarkozy
- Onfray
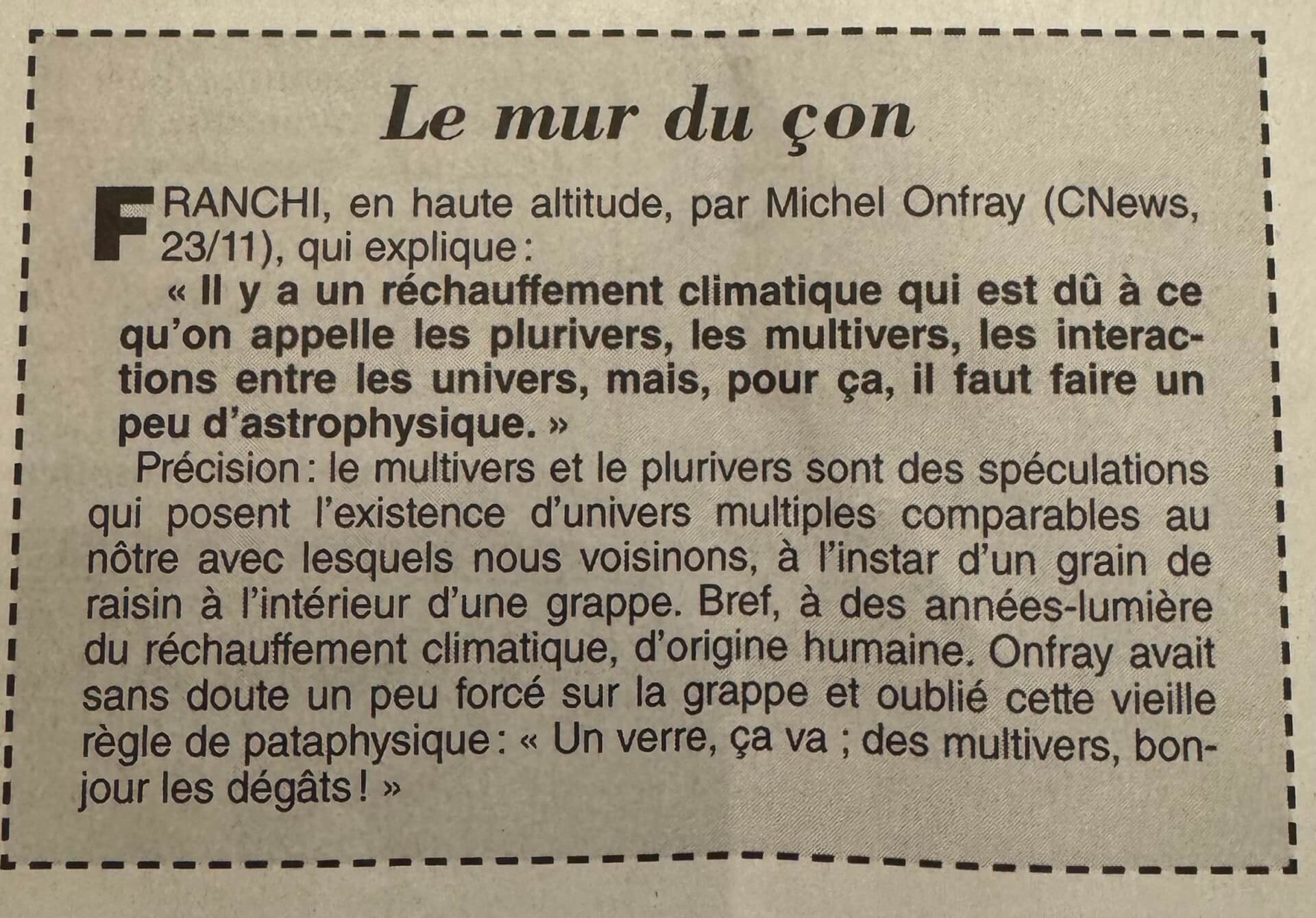
- Dispossession
- Mémoire
- Googling
- Infra
- Unplugged
- Moka
Les vidéos/podcasts de la semaine
- Honest government ad : AI (thejuicemedia.com – vidéo de juin 2024 !)
- David Van Reybrouck sur France Inter (tube.fdn.fr)
- Pierre-Emmanuel Barré (attaqué par Nunez pour cette chronique sur Radio Nova) (tube.fdn.fr)
- Sandrine Rousseau : Existe-t-il une idéologie en France qui tue plus que le masculinisme ? (tube.fdn.fr)
- Les enfants volés d’Espagne, un scandale qui n’en finit pas (la-bas.org)
Des milliers d’enfants volés sous la dictature de Franco. Deux archives historiques en podcast
- Sur le peuple kurde – avec Azadî (spectremedia.org)
- Gaza : Israël poursuit le massacre à l’ombre du cessez-le-feu (humanite.fr)
- Le grand rassemblement de l’extrême droite organisé par le JDD (humanite.fr)
Mardi 25 novembre, au Dôme de Paris, pendant près de quatre heures, les stars de CNews, Europe 1 ou du JDD ont pu désigner allègrement tous leurs ennemis et dérouler leur propagande sous les applaudissements. Non sans clins d’œil appuyés appelant à « s’armer », portés par Éric Zemmour, Philippe de Villiers, Sarah Knafo et leurs complices comme Michel Onfray ou Éric Naulleau.
- “Complément d’enquête”. Des infos ou désinfo ? La méthode CNews (franceinfo.fr)
- “Je n’ai eu aucune aide de la police”, témoigne Elise, victime de violences conjugales (humanite.fr)
Les trucs chouettes de la semaine
- EU court says same-sex marriages should be recognised throughout bloc (reuters.com)
The EU’s highest court ruled on Tuesday that same-sex marriages must be respected throughout the bloc and rebuked Poland for refusing to recognise a marriage between two of its citizens that took place in Germany.
- Poissons bavards, baisers entre orques, ultrasons… Ces découvertes qui bouleversent notre idée du langage animal (reporterre.net)
- Effets secondaires des chimiothérapies : une molécule française prometteuse pour lutter contre les neuropathies périphériques, dont souffrent près de 90 % des patient·es (theconversation.com)
- People Are Painting Crosswalks Across L.A. to Protect Pedestrians (reasonstobecheerful.world)
Fed up of waiting for the city to tackle traffic fatalities, Angelenos are taking street safety into their own hands — one bucket of paint at a time.
- “I didn’t know I was building a forest” (rewildingmag.com)
In 1980, Devaki Amma met with a life-threatening car accident. She couldn’t walk for three years, and when she eventually did, it was considered a miracle. Her recovery was slow and excruciating. But, amidst the darkest of the clouds, Devaki Amma found a silver lining, one that would, over the years, spread across five acres of land – a native forest she raised and planted with her own two hands.
- Framadate fait peau neuve : une nouvelle version plus moderne et mobile (framablog.org)
Retrouvez les revues de web précédentes dans la catégorie Libre Veille du Framablog.
Les articles, commentaires et autres images qui composent ces « Khrys’presso » n’engagent que moi (Khrys).
25.11.2025 à 13:40
Framadate fait peau neuve : une nouvelle version plus moderne et mobile
Framasoft
Texte intégral (3290 mots)
Ce Framadate nouvelle formule reprend le meilleur de celui que vous connaissiez tout en y apportant une meilleure ergonomie et surtout… une version adaptée aux téléphones !
Les Framadates clés
C’est en 2008 à l’université de Strasbourg et sous le nom de STUdS (pour « Se trouver à l’Université de Strasbourg ») que débute l’histoire de ce logiciel bien pratique que vous connaissez. Il sera repris et adapté par Framasoft en 2011 avant d’être rendu public la même année.
Entre 2014 et 2016, Framadate sera sensiblement amélioré par des contributeurs bénévoles, mais aussi par des salariés de Framasoft. Et ensuite ? La base de code étant relativement ancienne, il y eut surtout plusieurs velléités de réécrire Framadate en repartant de zéro, sans qu’aucune de ces tentatives ne soit suffisamment convaincante pour transformer l’essai.
Entre temps, de nombreuses autres solutions libres furent développées (citons par exemple crab.fit ou Rallly), mais chacune avait des spécificités propres qui auraient généré des frictions importantes avec les utilisateurs et utilisatrices habitué⋅es à Framadate.
La base de code devint peu à peu dépassée, à tel point qu’ajouter des fonctionnalités d’accessibilité ou une meilleure compatibilité avec les smartphones devint mission impossible.
C’est alors qu’un petit groupe de personnes volontaires (petit groupe qui au fil du temps se résumera à une seule personne) décida de s’attaquer au sujet, sur la base de maquettes créées par la DINUM, en redéveloppant le logiciel de A à Z avec des technologies plus récentes, tout en gardant l’ensemble des fonctionnalités si appréciées de Framadate. Ainsi naquit Pollaris !
Framadate est mort, vive Framadate
Nous savons qu’il est difficile de changer des réflexes liés à plusieurs années d’utilisation de l’ancienne version mais une fois la transition faite, vous y gagnerez grâce à une interface plus claire, une meilleure accessibilité, une compatibilité mobile, donc, et à un code prêt pour les futures évolutions.
Depuis mi-novembre la nouvelle version est celle proposée par défaut, même s’il est encore possible de créer des sondages sur l’ancienne version jusqu’à janvier 2026. Vos anciens sondages Framadate resteront, eux, toujours accessibles, et ce pendant plusieurs mois, le temps pour tout le monde de finaliser ses sondages sur l’ancienne version.
Comme la version que vous avez connue toutes ces années, il est possible de faire deux types de sondage :
- « Date » où vous pouvez convenir de la meilleure date et/ou du meilleur horaire (par exemple pour une assemblée générale de votre asso)
- « Classique » où vous pouvez convenir de ce que vous voulez (quel est le meilleur biscuit entre les spéculoos et un biscuit traditionnel à la cassonade originaire du comté de Flandre, par exemple)
Une fois le type de sondage souhaité sélectionné, vous trouverez une création de Framadate qui ne devrait pas vous dépayser.
Création de sondage
Où vous renseignerez le nom de votre Framadate, une description (facultative), une date de fin, votre identité (un pseudo, un nom, etc) et une adresse mail pour recevoir votre lien d’administration ou/et recevoir les notifications de votes / commentaires.
Choix des propositions
C’est l’étape où vous paramétrez les choix pour lesquels les participantes devront voter. Des dates / horaires ou des choix libres…
Petit plus ergonomique : vous pouvez sélectionner une plage de dates en cliquant sur la première, en maintenant la touche ⇧Maj appuyée et en sélectionnant la dernière.
Résumé du sondage
Cette dernière étape avant la validation de votre Framadate vous résumera les éléments choisis et vous donnera la possibilité de les modifier. Vous aurez aussi la possibilité de modifier les paramètres par défaut tels que :
- l’absence de réponse équivaut à un « non » (pour la version « Date »)
- la protection de votre Framadate par un mot de passe (par défaut : il ne l’est pas)
- chaque participant⋅e peut modifier son propre vote
- tout le monde peut voir les résultats
- recevoir un mail pour chaque participation / commentaire
Une fois tout vérifié vous pouvez cliquer sur le bouton Finaliser et envoyer le lien public (attention, pas le lien admin) aux participantes !
Pour retrouver vos sondages vous pouvez toujours, comme pour l’ancienne version, cliquer sur Mes sondages et vous les faire envoyer par mail. Mais vous pouvez aussi retrouver les sondages que vous avez créés ou vos votes directement dans votre navigateur si vous cochez l’option :
Administration
De nombreuses options sont disponibles : certaines déjà possibles avec l’ancienne version comme la possibilité de limiter le nombre de participantes par proposition, ou protéger l’accès au sondage par un mot de passe, et des nouveautés attendues depuis longtemps font leur apparition, comme désactiver les votes « si besoin », voter « non » par défaut en absence de réponse ou encore la possibilité de personnaliser le lien du sondage !
Votez en mobilité
Une des fonctionnalités les plus demandées pour l’ancienne version de Framadate était la possibilité de l’utiliser sur mobile. Avec cette nouvelle version vous pourrez enfin le faire depuis la terrasse d’un café en savourant un délicieux biscuit traditionnel à la cassonade originaire du comté de Flandre !
De sa conception aux votes, tout est faisable depuis votre poche :
Si jamais, malgré cette ergonomie renouvelée vous rencontrez des difficultés, n’oubliez votre meilleure amie : notre documentation (si souvent ignorée).
Framadark
Vous avez besoin de faire un Framadate du fond de votre lit, en pleine nuit mais avez peur de vous brûler les rétines avec tout ce blanc ? Ou vous aimez vous balader la nuit dans votre costume de chauffe-souris et avez besoin de savoir si d’autres personnes costumées veulent boire un chocolat chaud ? La nouvelle version a pensé à vous : vous pouvez activer le mode sombre en allant dans les préférences et en sélectionnant le mode sombre !
Une communauté à former
Marien est, pour le moment, le seul contributeur sur le logiciel Pollaris mais il souhaite le transmettre à la communauté, voire, à se retirer du projet s’il sent que celui-ci est entre de bons claviers.
Plutôt que de le paraphraser, voici comment il voit l’avenir :
« Plusieurs compétences sont utiles à une communauté de logiciel libre : accessibilité, assurance qualité, communication, design, sécurité, développement, administration système, traduction, animation de communauté, gestion de projet, etc. La liste est longue !
Une communauté est aussi le résultat du savoir-être de chaque individu. Pour Pollaris, je souhaite une communauté accueillante, prenant en compte les différents niveaux et expériences de chacun et chacune. Cela nécessite de savoir faire preuve d’empathie et d’être poli·e avec les autres. Bref, soyez sympas quoi :)
La communauté de Pollaris reste à former. La première étape serait de décider où se retrouver pour discuter. Je souhaite éviter les outils trop techniques pour s’ouvrir aux personnes les moins techniques. Si vous avez des idées, on peut en discuter sur Mastodon : @marien@tutut.delire.party »
Soutenir pour assurer l’avenir
Avec environ 1 million d’utilisateurs et utilisatrices par mois, Framadate est le service le plus populaire que nous proposons : il lui fallait une nouvelle version solide pour le remplacer.
Pollaris est le fruit de mûres réflexions, d’expériences et d’analyses des retours que vous nous faites depuis des années. Même si il reste des fonctionnalités à implémenter et des bugs à corriger, nous pensons qu’une fois la période d’adaptation passée vous utiliserez cette nouvelle version de Framadate avec plaisir et que cette adaptation aux mobiles lèvera un frein à l’utilisation pour de nombreuses personnes !
Il ne manque finalement plus que son entrée dans Framalibre pour compléter son arrivée :)
Maintenant que la nouvelle version est celle par défaut, nous avons décidé d’archiver le code de l’ancienne : cela signifie concrètement que sa maintenance est officiellement arrêtée, mais que quiconque peut s’en emparer.
Une nouvelle fois, la mise en place de cette nouvelle version n’aurait pas été possible sans votre soutien, qu’il soit via votre utilisation, vos retours, et, bien sûr, votre soutien financier. Grâce à vos dons, nous avons pu expérimenter jusqu’à cette nouvelle version qui s’inscrit dans un Internet alternatif loin du capitalisme de surveillance, où les logiciels sont mis à disposition sans autre volonté que de vous être utile et non pour monétiser vos données !
Et pour continuer à cultiver cet Internet libre, nous avons besoin de vos dons : pour payer les salaires, les serveurs, et pour continuer à pouvoir expérimenter et améliorer nos services !
Nous estimons avoir besoin de récolter 250 000 € d’ici le 31 décembre pour pouvoir poursuivre et étendre nos actions en 2026. Peut-être que vous ou votre collectif pouvez participer ? !
24.11.2025 à 07:42
Khrys’presso du lundi 24 novembre 2025
Khrys
Texte intégral (10405 mots)
Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour découvrir les informations que vous avez peut-être ratées la semaine dernière.
Tous les liens listés ci-dessous sont a priori accessibles librement. Si ce n’est pas le cas, pensez à activer votre bloqueur de javascript favori ou à passer en “mode lecture” (Firefox) ;-)
Brave New World
- Les 1 % les plus fortuné·es de la planète ont capté 41 % des richesses entre 2000 et 2024 (legrandcontinent.eu)
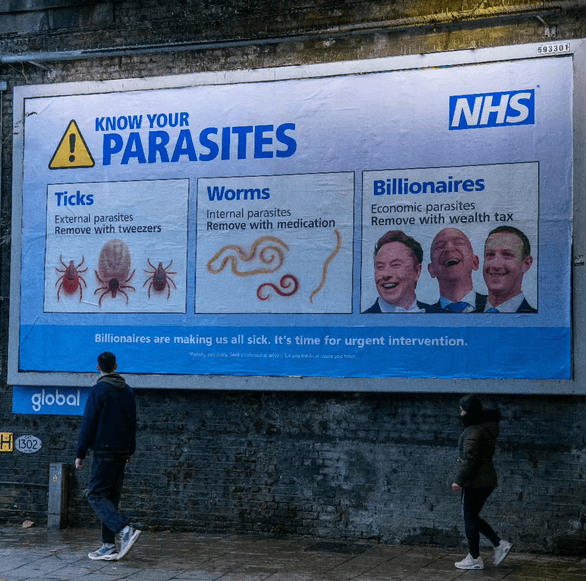
- Japan says world’s largest nuclear plant to restart (semafor.com)
- Vietnam : le delta du Mékong, un trésor naturel en péril à cause du réchauffement climatique (humanite.fr)
Le delta du Mékong, cœur agricole et pêcheur pour 70 millions de personnes, est menacé par la montée des eaux, la salinisation et les tempêtes. La pêche et l’agriculture, principales ressources locales, sont en péril. Ce désastre écologique, aggravé par la course au profit et l’urbanisation rapide, pousse des milliers de familles à quitter leur terre.
- L’Iran ensemence des nuages pour lutter contre une sécheresse historique (reporterre.net)
- Iran’s Capital Is Moving. The Reason Is an Ecological Catastrophe (scientificamerican.com)
The decision to move Iran’s capital is partly driven by climate change, but experts say decades of human error and action are also to blame […] Amid a deepening ecological crisis and acute water shortage, Tehran can no longer remain the capital of Iran, the country’s president has said.
- El-Fasher, Soudan. La catastrophe annoncée a bien eu lieu (orientxxi.info)
Le 26 octobre 2025, la ville d’El-Fasher, capitale du Darfour-Nord (Soudan), est tombée aux mains des Forces de soutien rapide (FSR) après un siège total de 18 mois. Dans les heures qui ont suivi la chute de la ville, des milliers de civils ont été exécutés. Trois semaines après les massacres, l’heure semble plus à la poursuite de la guerre qu’aux négociations.
- Pourquoi l’eau est devenue un enjeu de pouvoir et de sécurité en Afrique (theconversation.com)
- La concentration des médias en Allemagne : un modèle, vraiment ? (4/4) (acrimed.org)
- EU ‘Chat Control’ Proposal Still Poses ‘High Risks’ Despite Removal of Mandatory Scanning, Experts Warn (patrick-breyer.de)
- Commission’s Digital Omnibus is a major rollback of EU digital protections (edri.org)
Today the European Commission has published two Digital Omnibus proposals, reopening the EU’s core protections against harm in the digital age. This step risks dismantling the rules-based system that was hard-won over decades, endangering the very foundation of human rights and tech policy in the EU.
- Digital Omnibus : EU Commission wants to wreck core GDPR principles (noyb.eu)
- Le fantôme de Franco hante toujours l’Espagne (politis.fr)
Cinquante ans après la mort du dictateur, l’ancien roi Juan Carlos publie un livre de mémoires qui ravive les polémiques. Alors que le parti d’extrême droite Vox progresse, le pays oscille entre les conquêtes démocratiques d’une société transformée et les persistances d’un héritage franquiste.
Voir aussi « Le franquisme sociologique n’a jamais disparu en Espagne » (politis.fr) et 50 ans après la mort de Franco, la montée en puissance des néo-franquistes (humanite.fr)
- Le Royaume-Uni pourrait faire face à une invasion de petits kangourous (slate.fr)
Après les écureuils gris, les cerfs aboyeurs et les perruches à collier, le Royaume-Uni pourrait bien voir un nouvel invité-surprise s’installer durablement : le wallaby, ce petit marsupial mignon, mais pas que.
- Government’s last chance to keep control of digital (yorkshirebylines.co.uk)
Digital sovereignty isn’t optional anymore. We sold our water to foreign billionaires. Now we’re handing them our health data
- Data protection and the Online Safety Act revisited (cyberleagle.com)
- Arabic numerals joke sends the US right into a full-blown meltdown (thecanary.co)
The US right has gone into apoplexy over an X post by Jewish left-winger Brian Krassenstein that New York City mayor-elect’s Zohran Mamdani is going to make the study of ‘Arabic numerals’ compulsory in the city’s schools. All western numerals are, of course, already Arabic, since the Arab world had the world’s greatest mathematicians in the medieval period. They built on the work and concepts of their Greek and Indian predecessors and produced significant contributions to knowledge. But this knowledge appears to have escaped the notice of many US right-wingers — presumably the same ones who think that since the King James translation of the bible was good enough for Jesus, it should be good enough for anyone.
- La principale agence sanitaire américaine relaie une fausse théorie sur les vaccins (ledevoir.com)
La principale agence sanitaire des États-Unis évoque désormais un possible lien entre vaccins et autisme, pourtant maintes fois démenti, se faisant l’écho des thèses du contesté secrétaire à la Santé [Robert Kennedy Jr] de Donald Trump, un revirement condamné jeudi par les scientifiques.
- LA’s nuclear secret (media.nbcnewyork.com)
Years of mishandling dangerous radioactive materials and chemicals has also left a toxic legacy for generations of people living near the Santa Susana Field Laboratory.
- Donald Trump évoque la peine de mort pour des démocrates qui appellent l’armée à désobéir (rfi.fr)
Le président américain Donald Trump s’en est pris jeudi 20 novembre à un groupe d’élus démocrates, qu’il a qualifiés de traîtres passibles de la peine de mort pour avoir appelé les militaires à refuser d’obéir à des « ordres illégaux » de son gouvernement.
- The President Is Losing Control of Himself (theatlantic.com)
Yesterday the president called for the arrest and execution of elected American officials for the crime—as he sees it—of fidelity to the Constitution.
- Sen. Elissa Slotkin’s home targeted with bomb threat after Trump statement. (wxyz.com)
The threat comes one day after President Donald Trump targeted Slotkin and other Democrats who urged service members and intelligence officials to disobey illegal orders. Trump suggested that the lawmakers should be put to death.
- Six juges et trois procureurs de la Cour pénale internationale ont été placés sous sanctions par l’administration Trump : le poids de ces mesures sur leur travail et leur quotidien (environnementsantepolitique.fr) – voir aussi How a French judge was digitally cut off by the USA (heise.de)
Nicolas Guillou has been sanctioned by the USA as a judge of the International Criminal Court. He notices the effects primarily in the digital realm.
- IRS Accessed Massive Database of Americans Flights Without a Warrant (yro.slashdot.org)
The IRS accessed a database of hundreds of millions of travel records, which show when and where a specific person flew and the credit card they used, without obtaining a warrant […] The country’s major airlines […] funnel customer records to a data broker they co-own called the Airlines Reporting Corporation (ARC), which then sells access to peoples’ travel data to government agencies.
- Arduino’s New Terms of Service : A Shift from Open to Controlled (linkedin.com)
Qualcomm-owned Arduino quietly pushed a sweeping rewrite of its Terms of Service and Privacy Policy, and the changes mark a clear break from the open-hardware ethos that built the platform. The new documents introduce an irrevocable, perpetual license over anything users upload, broad surveillance-style monitoring of AI features, a clause preventing users from identifying potential patent infringement, years-long retention of usernames even after account deletion, and the integration of all user data (including minors) into Qualcomm’s global data ecosystem. Military weird things and more.
Voir aussi Qualcomm tire le frein à main sur l’Open Source d’Arduino (minimachines.net)
Début octobre, Qualcomm s’offrait Arduino. Fin novembre, la marque tord le cou des fondations Open Source de la société.
- Your washing machine could be sending 3.7 GB of data a day — LG washing machine owner disconnected his device from Wi-Fi after noticing excessive outgoing daily data traffic (tomshardware.com)
The owner was puzzled why a clothes washer would need so much data.
- Armes soniques : bientôt la fin du déni ? (blast-info.fr)
Utiliser le son comme une arme, ce n’est plus de la science-fiction. Les armes soniques existent. Des États les utilisent sur le terrain militaire, mais aussi pour le maintien de l’ordre.
- Persistent Orbital Intelligence (leolabs.space)
Safeguarding our way of life on Earth with the living map of activity in space
- Venezuela : agression impérialiste étatsunienne et bruits de bottes (contretemps.eu)
- « Quel désastre ! » : les peuples autochtones vent debout contre la COP30 des lobbies (reporterre.net)

- La COP30 vire au fiasco (reporterre.net) – voir aussi Coup de force à la COP30 : le texte adopté sans l’accord de toutes les parties (reporterre.net)
L’Union européenne, la Colombie, la Suisse et le Panama affirment ne jamais avoir donné leur approbation au texte d’accord validé par le président lors de cette ultime plénière. Celui-ci aurait clos les débats… sans leur accorder la parole.
- « La réponse, c’est nous » : avec les leadereuses autochtones de la COP30 (basta.media)
À la COP de Belém, en pleine Amazonie, les luttes des peuples autochtones du Brésil sont plus visibles que jamais auparavant dans une conférence pour le climat. Portrait de représentant·es de ces communautés en lutte pour leurs terres et leur vie.
- Dark forces are preventing us fighting the climate crisis – by taking knowledge hostage (theguardian.com)
The fundamental problem is this : that most of the means of communication are owned or influenced by the very rich
- Cuts and scrapes may be slower to heal in redheads (newscientist.com)
Mice with the same genetic variant that contributes towards red hair in people were slower to recover from wounds than their black-haired counterparts
Spécial IA
- L’IA générative est-elle soutenable ? Le vrai coût écologique d’un prompt (theconversation.com)
- “Data Crunch” : AI Boom Threatens to Entrench Fossil Fuels and Compromise Climate Goals (democracynow.org)
- Le charbon pour nourrir l’IA : nouvelle lubie de Trump en territoire Navajo (blast-info.fr)
Pour alimenter les besoins énergétiques de l’IA, Donald Trump vient de signer un décret pour relancer « la belle énergie du charbon propre de l’Amérique » en terre autochtone, avec le soutien du président de la nation Navajo, Buu Nygren.
- U.S. gains in AI race as Gulf nations ditch China for chips (restofworld.org)
Washington has all but locked Beijing out of the Middle East’s trillion-dollar artificial intelligence ambitions.
- En Seine-et-Marne, le projet de Campus IA doit sortir des champs : « On impose et copie le gigantisme états-unien » (maisouvaleweb.fr)
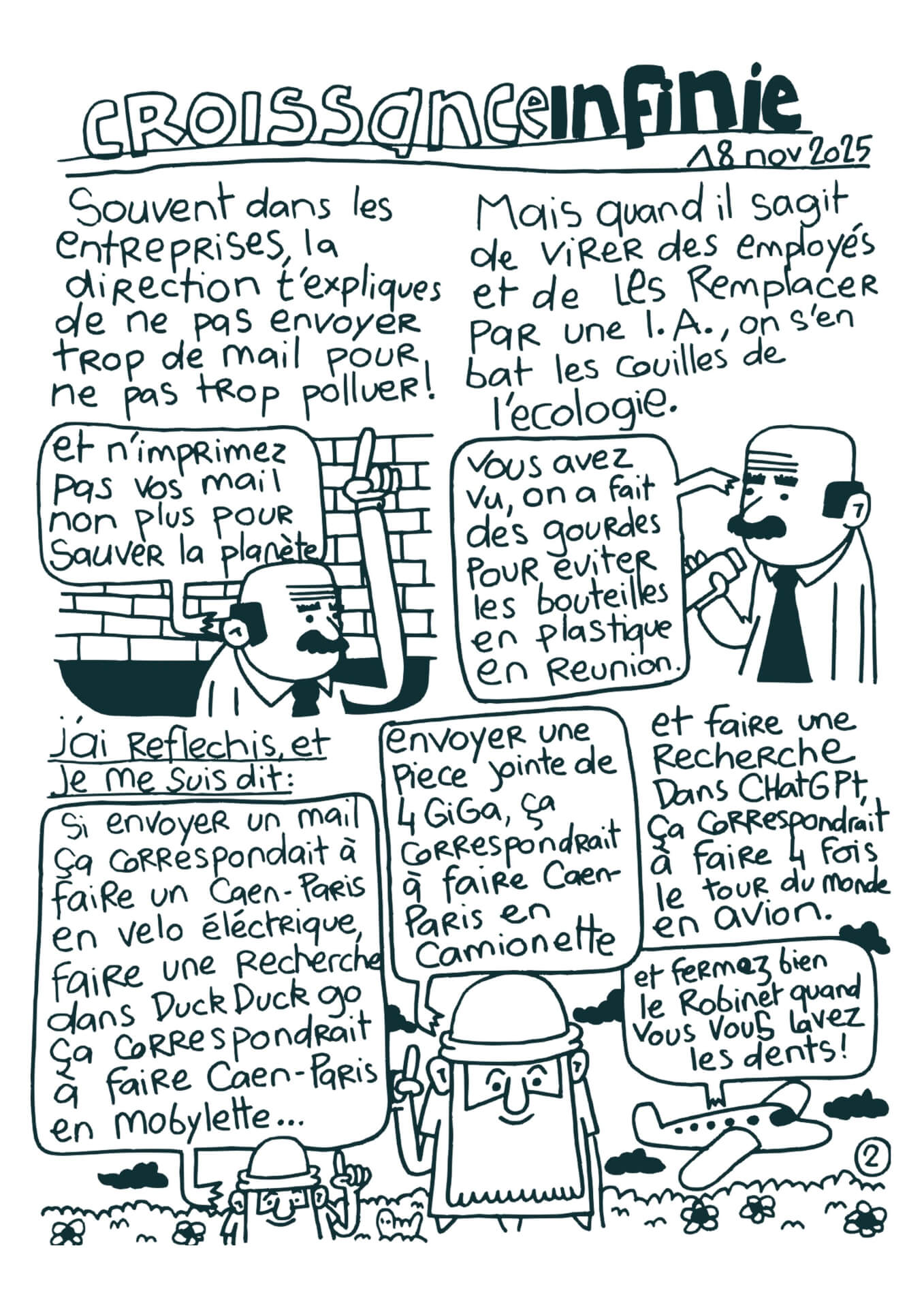
- Sur la souveraineté numérique, Macron appelé à soutenir l’IA open source (zdnet.fr)
- Europe Is Ready to Dilute Its Tough Rules on Privacy. You Can Blame AI for That (cnet.com)
Critics warned that proposed changes will weaken the GDPR in a way that amounts to an attack on digital rights.
- L’intelligence artificielle au cœur du contrôle migratoire en Europe (politis.fr)
En Europe, l’intelligence artificielle s’impose peu à peu dans la gestion des migrations pour prévoir les flux, vérifier un accent, un âge ou détecter une émotion. Un usage non sans danger pour les droits fondamentaux.
- The Algorithm That Detected a $610 Billion Fraud : How algorithmic trading systems Exposed the AI Industry’s Circular Financing Scheme (substack.com)
On November 20, 2025, trading algorithms identified what may become the largest accounting fraud in technology history—not in months or years, but in 18 hours. This is the story of how algorithmic trading systems discovered that the AI boom itself was built on phantom revenue.
- Peter Thiel dumps entire Nvidia stake, slashes Tesla holdings amid bubble fears (ca.investing.com) – voir aussi Peter Thiel Gets Out of Dodge (broligarchy.substack.com)
Thiel’s move is the strongest signal yet that Silicon Valley not only knows that this is a bubble, it’s starting to feel spooked
- Les craintes d’une “bulle” de l’IA persistent malgré les bonnes performances de Nvidia (france24.com)
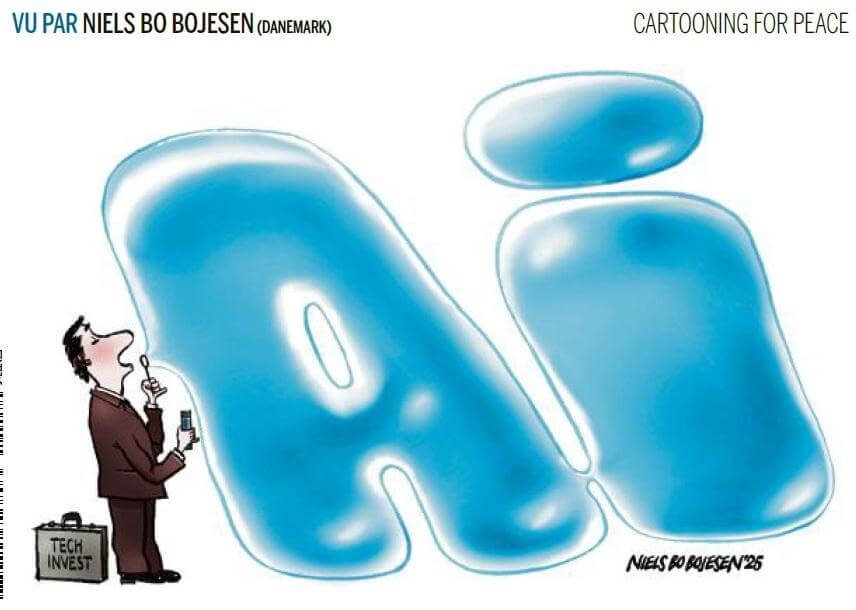
- Google CEO : If an AI bubble pops, no one is getting out clean (arstechnica.com)
- Gmail can read your emails and attachments to train its AI, unless you opt out (malwarebytes.com)
Under the radar, Google has added features that allow Gmail to access all private messages and attachments for training its AI models.
Voir aussi Gmail : Google lit votre courrier pour entrainer son IA, comment l’empêcher (frandroid.com)
- As Windows turns 40, Microsoft faces an AI backlash (theverge.com)
Microsoft wants to overhaul Windows into an agentic OS, but that’s easier said than done.“It’s evolving into a product that’s driving people to Mac and Linux”
- Talking to Windows’ Copilot AI makes a computer feel incompetent (theverge.com)
I spent a week with Copilot, asking it the same questions Microsoft has in its ads, and tried to get help with tasks I’d find useful. And time after time, Copilot got things wrong, made stuff up, and spoke to me like I was a child.
- L’ours en peluche boosté à l’IA parlait d’armes blanches, de drogues et de BDSM avec les enfants (slate.fr)
Présenté comme un compagnon éducatif nouvelle génération, l’ours Kumma s’est avéré être un confident inquiétant, allant jusqu’à expliquer aux enfants où trouver des couteaux.
- Pourquoi Grok, l’IA du réseau social d’Elon Musk, X (ex-Twitter), est-il négationniste ? (legrandcontinent.eu)
- Elon Musk’s Grok AI tells users he is fitter than LeBron James and smarter than Leonardo da Vinci (theguardian.com)
- Authors dumped from New Zealand’s top book prize after AI used in cover designs (theguardian.com)
- La nouvelle chanson de Paul McCartney contre l’IA n’a ni paroles ni mélodie (huffingtonpost.fr)
En signe de protestation contre l’utilisation abusive de l’intelligence artificielle dans la création musicale, l’ancien Beattles a sorti un nouveau morceau très spécial.
- What AI doesn’t know : we could be creating a global ‘knowledge collapse’ (theguardian.com)
As GenAI becomes the primary way to find information, local and traditional wisdom is being lost. And we are only beginning to realise what we’re missing
Spécial Palestine et Israël
- New data reveals 98 Palestinian deaths in Israeli custody since October 7 (972mag.com)
Post-mortems of the deceased and testimonies from former detainees suggest many died from torture, medical neglect, and food deprivation. According to a leaked Israeli intelligence database, dozens were civilians.
- One of the oddest UN resolutions in history seeks to solidify shaky Gaza ceasefire into an enduring peace (theguardian.com)
- Gaza : le Conseil de sécurité de l’ONU valide le déploiement d’une force internationale… et le reste du plan Trump (humanite.fr)
Quant à la perspective d’un État palestinien, elle est repoussée à un horizon flou et lointain. Treize votes favorables ont été recueillis, tandis que la Russie et la Chine se sont abstenues.
- There was never going to be a phase two, the ceasefire was the strategy (thecradle.co)
The ceasefire, brokered under the guise of relief, was engineered by Tel Aviv and Washington as a tool to restore their grip – not just on Gaza, but on the broader terms of war and peace in West Asia.
- Milipol 2025 : le salon mondial de sécurité s’ouvre en France dans un climat tendu autour de la participation israélienne (lavoixdunord.fr)
Trente-neuf entreprises israéliennes feront partie de 1 200 exposants de la 24e édition de ce salon biennal, « le plus grand au monde » dédié à la sécurité intérieure, qui s’ouvre mardi près de Paris.
- « Du public de la Philharmonie, j’ai reçu des coups de pied et de poing, des crachats, des insultes » (politis.fr)
Après le concert philharmonique d’Israël à Paris, le 6 novembre, et la pluie de coups dont il a été la cible, Rayan*, militant pro-palestinien, s’exprime pour la première fois. Il revient sur le lynchage dont il a été victime et la répression qui s’en est suivi.
- Succès en ligne pour le Colloque sur la Palestine annulé par le Collège de France (politis.fr)
Programmé au Collège de France, puis annulé par l’administration avec l’aval du ministère de l’ESR, l’événement s’est replié au Centre arabe de recherches et d’études politiques (Carep). La capacité d’accueil a été réduite, mais les débats ont été diffusés en direct sur les chaînes YouTube du Carep (plus de 51 000 vues) et des médias Blast et Paroles d’honneur.
Spécial femmes dans le monde
- China : Muslim women detained for ‘pre-crimes’ like using WhatsApp, book says (businessinsider.com)
One student said she was detained for using a VPN to open her school Gmail account and submit homework. She shared a cell with a woman arrested for using WhatsApp to contact coworkers
- La Constitution québécoise prétend vouloir protéger les femmes. La réalité est toute autre (theconversation.com)
- Black mothers in Texas and Indiana say hospital staff ignored cries for care while they were in labor (nbcnews.com)
- A pregnant mother kept getting sicker. She died after she couldn’t get an abortion in Texas. (dailykos.com)
- Cité dans le dossier Epstein, Larry Summers, ex-ministre de Clinton, se retire de la vie publique (huffingtonpost.fr)
- Affaire Epstein : comment Trump s’est enlisé en tentant de se dépêtrer du bourbier qu’il a lui-même créé (huffingtonpost.fr)
- En rupture complète avec Donald Trump, Marjorie Taylor Greene va quitter la chambre des représentants (huffingtonpost.fr)
Égérie du mouvement MAGA, l’élue républicaine de Géorgie reproche au président américain sa gestion calamiteuse du scandale sexuel impliquant Jeffrey Epstein.
- « Dégoûtant », « émasculant » : les conservateurs américains sont en croisade… contre ce pull rose (huffingtonpost.fr)
- « Incroyablement sexiste » : ce projet de Sky Sports dédié aux femmes n’a pas tenu une semaine (huffingtonpost.fr)
« Un des lancements les plus incroyablement infantilisant et misogyne que j’ai jamais vus »
- « Les femmes ont-elles ruiné le monde du travail ? » : le New York Times prend un virage anti-féministe (lesnouvellesnews.fr)
- Ladybird and the Controversy over Inclusivity (hyperborea.org)
Using the language of neutrality to keep people out.
- Climat de domination masculine à la COP30 (lesnouvellesnews.fr)
Peu de femmes à la table des négociations, ambiance paternaliste en interview, manœuvres hypocrites pour faire échouer un plan d’action en faveur de l’égalité… La COP30 ne sera pas féministe.
- Un autoportrait de l’artiste mexicaine Frida Kahlo a été vendu 54,66 millions de dollars jeudi 20 novembre aux enchères par Sotheby’s à New York, devenant le tableau le plus cher réalisé par une femme (huffingtonpost.fr)
L’œuvre représente l’artiste dormant dans un lit qui semble flotter dans le ciel, surplombé d’un immense squelette dont les jambes sont entourées de bâtons de dynamite.
Voir aussi “Le rêve (La chambre)”, de Frida Khalo, devient le tableau le plus cher peint par une femme (france24.com)
Une peinture de l’artiste mexicaine Frida Khalo, proposée aux enchères par la maison Sotheby’s à New York, a été vendue jeudi 54,66 millions de dollars. “Le rêve (La chambre)” devient ainsi le tableau le plus cher jamais peint par une femme et bat le précédent record de Georgia O’Keeffe.
Spécial France
- Souveraineté numérique : la Cour des comptes étrille le manque de cohésion en France (next.ink)
Alors que l’on assiste à un nombre croissant de projets de migration vers des logiciels libres en Europe et que même la Cour pénale internationale va se débarrasser en grande partie de Microsoft, la Cour des comptes publie un rapport sur la souveraineté numérique. Sa définition en est claire : l’État doit maitriser les technologies qui lui permettent de rester autonome en toute circonstance, ce qui comprend le matériel, le logiciel et les données.
- Budget 2026 : quelle est cette règle de l’entonnoir qui risque de compliquer la suite de l’examen des textes (huffingtonpost.fr)
- La vente de la Pascaline, machine à calculer inventée par Blaise Pascal, est suspendue (franceinfo.fr) – voir aussi La Pascaline aux enchères : pourquoi la vente de la première machine à calculer de l’histoire a été suspendue (humanite.fr)
- Pierre-Édouard Stérin et l’université catholique : les coulisses d’une rupture imposée (disclose.ngo)
L’université catholique de l’Ouest n’avait pas prévu de mettre fin au partenariat secret avec son puissant bienfaiteur, le milliardaire Pierre-Édouard Stérin. Il a fallu les révélations de Disclose et La Topette, en septembre dernier, suivies d’une mobilisation des étudiant·es pour que la direction de l’établissement revoie ses plans.
- “L’école a besoin d’AESH” : les agents croient lire “DAESCH” et demandent le retrait des banderoles devant l’école (ladepeche.fr)
- À Noisy-le-Grand, les profs de cette école à l’alarme cassée doivent utiliser des vuvuzelas en cas de feu (huffingtonpost.fr)
Pour pallier un système d’alarme incendie partiellement défectueux, une école de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) s’est vue offrir une solution de secours improbable par la mairie : des vuvuzelas.
- « Les poissons ressentent la douleur » : à Paris, une compétition de pêche a été interdite (reporterre.net)
La mairie du 19e arrondissement de Paris a interdit une épreuve du Junior Fishing Tour, une compétition de pêche pour les jeunes. Une décision prise par « respect de la condition animale ».
- A69 : les riverains dénoncent une intoxication massive par les centrales à bitume (lareleveetlapeste.fr)
Les fumées de matières polluantes chauffées à 320 °C toucheraient, d’après les mesures du collectif Lauragais sans bitume, 40 écoles soit 4293 élèves, 500 exploitations agricoles, 42 clubs sportifs.
Spécial femmes en France
- Syndicats : la longue marche des femmes pour se faire entendre (theconversation.com)
Si deux femmes sont aujourd’hui à la tête de deux des principaux syndicats français, les organisations syndicales ont mis du temps à intégrer les questions féministes. […] l’historienne Fanny Gallot raconte leur difficile mue féministe au sein d’un mouvement ouvrier au départ méfiant envers le travail des femmes.
- « Sous couvert de féminisme, Némésis ne scande que des slogans xénophobes » (politis.fr)
La photojournaliste Anna Margueritat examine le rôle des médias et de la gauche face à l’instrumentalisation du féminisme par l’extrême droite, alors que le collectif nationaliste Némésis pourrait être présent lors de la manifestation du 22 novembre.
- Nemesis : pour la fureur et pour le pire (blogs.mediapart.fr)
La police est devenue une milice de protection privée des groupuscules d’extrême-droite. Les Nemesis en font partie, elles ont pu ainsi profiter d’une garde rapprochée lors de la manifestation contre les VSS du 22 novembre à Paris. Les Nemesis ne sont pas féministes, elles sont xénophobes, transphobes, elles véhiculent des fake news et fomentent des campagnes de harcèlement.
- Victime de viol, proche de Stérin, alliée de Némésis… Claire Geronimi, la coqueluche de l’extrême droite (streetpress.com)
- En France, les féminicides ou tentatives de féminicides conjugaux en hausse en 2024 (huffingtonpost.fr)
Cela équivaut à une victime toutes les sept heures, alerte la mission interministérielle pour la protection des femmes (Miprof).
Spécial médias et pouvoir
- « Nous ne nous sentons plus en sécurité en France » : pourquoi GrapheneOS retire ses serveurs de France suite à un article du Parisien (frandroid.com)
- Guillaume Erner face à Francesca Albanese : suspicion et délégitimation (acrimed.org)
- Papillomavirus : non, le vaccin n’est pas associé à « un taux de mortalité de 17,4 pour 1 000 enfants », comme relayé dans plusieurs médias (liberation.fr)
Le communiqué de presse initialement diffusé par le Gavi précise bien, quant à lui : « Le vaccin anti-PVH [virus du papillome humain] […] permet d’éviter 17,4 décès pour 1 000 enfants vaccinés. »
- Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co (actualitte.com)
Après plusieurs semaines de tensions autour d’un livre jeunesse accusé d’« apologie du terrorisme » et d’un débat mêlant liberté d’expression, accusation d’antisémitisme et défense de la cause palestinienne, la librairie féministe et LGBTQ+ Violette and Co, installée dans le XIᵉ arrondissement, se retrouve au centre d’un bras de fer politique. La droite parisienne a obtenu le blocage de la subvention municipale destinée aux librairies indépendantes — un dispositif de 500.000 € dont dépendaient quarante établissements, désormais privés de cette aide.
- Un nouveau média chrétien progressiste (portail.basta.media)
Le premier numéro du magazine mensuel Le Cri est sorti début novembre en kiosque, accompagné d’une vitrine web. Ses deux fondateurs revendiquent une ligne éditoriale chrétienne à l’opposé des catholiques les plus médiatiques.
Spécial emmerdeurs irresponsables gérant comme des pieds (et à la néolibérale)
- Malgré la guerre, la France a repris ses envois d’uranium de retraitement en Russie (reporterre.net)
Le “en même temps” macroniste atteint des sommets d’hypocrisie. Emmanuel Macron répète qu’il est nécessaire de développer notre indépendance économique… Alors même qu’il reçoit aujourd’hui [le 17 novembre] Volodymyr Zelensky, la reprise de l’envoi d’URT en Russie est une nouvelle rupture entre les paroles et les actes
- Guide de survie, message alarmant : ce que le gouvernement cherche à faire avec ses alertes sur la guerre (huffingtonpost.fr)
Entre les propos du plus haut gradé de l’armée française et la publication d’un guide de survie pour se préparer à divers types de menaces, dont la guerre, l’exécutif est taxé de va-t-en-guerre ou d’alarmisme.
- Les députés ont presque unanimement rejeté le budget 2026 (projetarcadie.com)
En 2024, les députés avaient rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2025.Mais, ce qui est beaucoup plus rare, pour ne pas dire inédit, c’est que presque tous les députés ont voté contre ce texte.pour 1, contre 404. Harold Huwart est le seul député qui a voté pour ce texte.
- En cas d’impasse sur le budget, le gouvernement a trouvé son plan B (huffingtonpost.fr)
Le gouvernement passera par une loi spéciale si les débats ne permettent pas de voter un budget avant le 31 décembre.
- La loi spéciale, ce « parachute » de moindre mal qui gêne quand même le gouvernement (huffingtonpost.fr)
La perspective d’une loi spéciale a pris de l’épaisseur mais elle ne ravit pas forcément le gouvernement. En raison de son coût financier, et politique aussi.
- Faut- il arrêter la vente d’alcool à la buvette de l’Assemblée nationale ? (rfi.fr)
- Le piratage des données de France Travail : gêne pour les usagers et mise en cause de la direction par la CGT (blogs.alternatives-economiques.fr)
- Plus de 1,5 million de ménages privés du chèque énergie en 2026 ? (60millions-mag.com)
Alors que la campagne de distribution des chèques énergie est en cours, des associations alertent sur la dégradation du dispositif.
- Le gouvernement veut nous obliger à utiliser le Dossier Médical Partagé (laquadrature.net)
L’article 31 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026 renforce l’obligation pour les professionnel·les de santé de reporter les données de santé de leurs patient·es dans leur Dossier Médical Partagé (DMP), et introduit l’obligation de consultation du DMP par les professionnel·les avant certaines prescriptions.
Spécial recul des droits et libertés, violences policières, montée de l’extrême-droite…
- Milipol 2025 : le marché de la sécurité mondiale explose (france24.com)
Le salon Milipol, grand-messe mondiale de la sécurité intérieure, a été inauguré ce mardi par le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, à Villepinte. Plus de 1 200 exposants, 175 délégations étatiques et 32 000 visiteurs sont attendus jusqu’à vendredi pour une édition record, portée par un marché mondial en plein boom.
- “Accepter de perdre nos enfants” : les propos tenus par le chef d’état major des Armées font réagir (franceinfo.fr)
“On a tout le savoir, toute la force économique et démographique pour dissuader le régime de Moscou (…) Ce qu’il nous manque, et c’est là où vous avez avec un rôle majeur, c’est la force d’âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l’on est”, a dit lors d’un discours devant les maires le plus haut gradé français. […] “Si notre pays flanche parce qu’il n’est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu’il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production défense, alors on est en risque.”
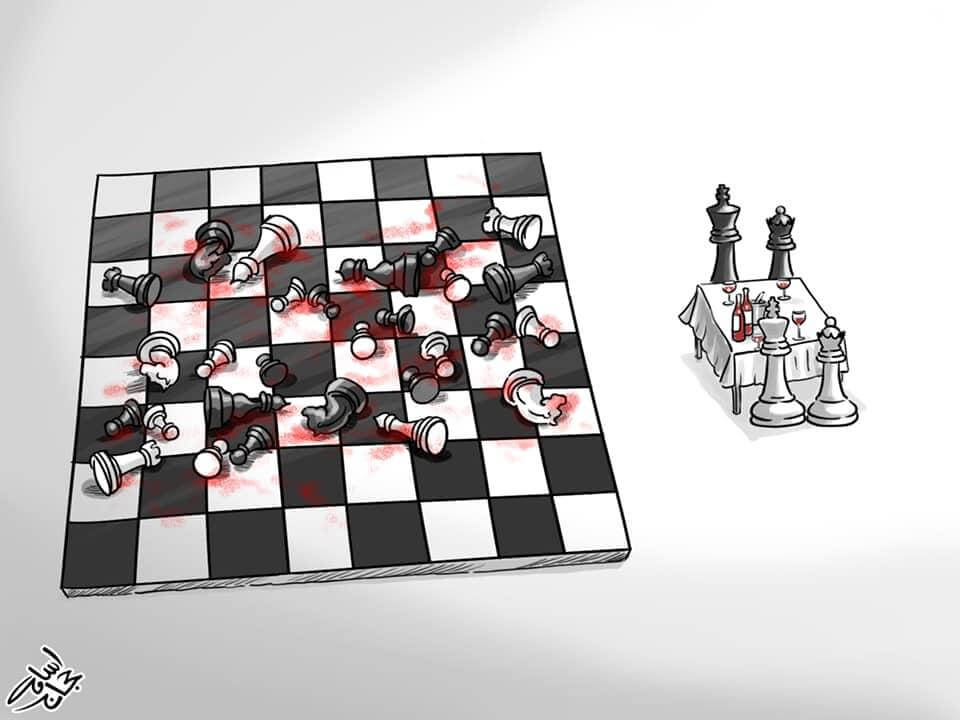
- Il n’y a jamais eu autant d’enfants derrière les barreaux : « Les discours martiaux ne pourront jamais combler les lacunes de la protection de l’enfant », alerte la Défenseure des droits, Claire Hédon (humanite.fr)
- Violences policières : contrairement à ce que dit l’IGPN, le nombre d’affaires ouvertes est en hausse (rapportsdeforce.fr)
- IGPN : la grande faillite du contrôle des policiers (politis.fr)
Un rapport explosif de l’ONG Flagrant déni, publié ce mardi 18 novembre, met en lumière l’effondrement de la police des polices. Chiffres inédits à l’appui, le document démontre que le taux d’élucidation des violences policières a chuté de 25 % en huit ans alors que le nombre d’affaires est en augmentation.
- « Charlie Hebdo », Bataclan, Trèbes… Enquête sur le GIGN, ses ratés, ses états d’âme (profession-gendarme.com)
Tout commence en Espagne. Le 8 novembre 2017, trois membres de l’unité d’élite sont arrêtés à la frontière entre l’Espagne et le Portugal, avec le coffre de leur véhicule « chargé de grenades ». Puis, « sept tonnes de munitions et d’explosifs » sont retrouvées dans les rangements de sous-officiers de la force d’intervention, rapportait Le Monde en 2019. Selon leurs explications, ils ont pioché dans le matériel du GIGN, dans l’objectif d’animer, au Portugal, un camp d’entraînement privé. En interne, la direction demande de passer cet épisode sous silence.
- Culpabilisation, intimidation, coup de pression : six personnes racontent leur passage à l’IGPN (politis.fr)
Les récits de celles et ceux ayant été confrontés à des violences policières décrivent de nombreux dysfonctionnements au sein d’une IGPN peu encline à la remise en question.
- « La police est devenue un instrument majeur de contrôle social », dénonce Anthony Caillé de la CGT Intérieur (humanite.fr)
- Comment la police française peine à s’affranchir de ses origines coloniales et perpétue son ciblage racial (humanite.fr)
- À Hénin-Beaumont, le maire RN s’attaque à un syndicaliste (basta.media)
- Violences, actes de torture… Pourquoi des policiers de la CSI 93 sont visés par de nouvelles plaintes ? (france3-regions.franceinfo.fr)
- Coordination rurale : des député·es demandent une enquête après les menaces du nouveau président (reporterre.net)
« Les écolos, nous devons leur faire la peau. » Deux jours après les propos menaçants de Bertrand Venteau, nouveau président du syndicat agricole Coordination rurale, les réactions se multiplient.
- « La France est un Socialistan » : sur YouTube, la sphère crypto française ouvre grand les portes à l’extrême droite (multinationales.org)
Apologie des libertés et de la souveraineté individuelle, critique féroce de l’impôt, mais aussi masculinisme et darwinisme social : en ligne, une partie de la sphère crypto francophone recycle les discours de l’extrême droite et n’hésite pas à donner la parole à certains de ses porte-paroles le plus enragés.
- Trumpisation de l’Université et fichage politique (blogs.mediapart.fr)
Le collectif Rogue ESR dévoile une enquête nationale sur l’antisémitisme dans les universités françaises. Conçu par le ministère de l’Enseignement supérieur ce sondage constitue une violation frontale de toutes les libertés individuelles. Rogue ESR fait aussi un retour sur l’annulation du colloque du Collège de France sur l’Europe et la Palestine pour en tirer les leçons.
Spécial résistances
- La carte des mobilisations contre les violences faites aux femmes et aux minorités de genre (basta.media)
Des rassemblements et manifestations se tiennent du samedi 22 au mardi 25 novembre contre les violences faites aux femmes et aux minorités de genre. Retrouvez la carte des mobilisations.
- Pour une lutte antivalidiste contre les violences sexistes et sexuelles (blogs.mediapart.fr)
- Un stérilet géant se tient sur la place de la République à Paris (huffingtonpost.fr)
La sculpture a été amenée par Countdown 2030, un programme engagé pour l’accès universel à la planification familiale. Il dénonce notamment la politique menée par Donald Trump.
- Rassemblement contre Milipol, salon de la guerre contre les peuples (guerrealaguerre.net)
- Amine Kessaci, « debout » contre le narcotrafic et pour une écologie populaire (reporterre.net)
« Il ne s’agit pas d’un crime d’avertissement, il s’agit d’un crime politique, de lâches qui ont assassiné un jeune innocent » […] Un meurtre politique, parce que son combat dérange. À tel point qu’il vit sous protection policière depuis cet été. À 22 ans seulement, Amine Kessaci porte une vision écologiste, de gauche, sur la question du trafic de stupéfiants et la sécurité. Une lecture sociale et radicale, bien loin du « tout répressif » du gouvernement, ou du « laxisme » dont est parfois accusée la gauche.
- Des activistes bloquent une usine BASF… et découvrent une substance interdite en Europe (reporterre.net)
Il s’agissait bien du principe actif d’un insecticide commercialisé en enrobage de semences sous l’appellation « Régent » par le chimiste allemand BASF, pourtant interdit dans l’agriculture en France et dans le reste de l’Union européenne pour ses dégâts sur les abeilles.
Voir aussi Communiqué de presse inter-organisations : Mise à l’arrêt du site de production de pesticides BASF par plus de 500 paysannes et paysans, malades et soutiens (lessoulevementsdelaterre.org)
- “Renvoyons la facture !” : l’UFC-Que Choisir veut que les responsables de la pollution de l’eau du robinet paient sa décontamination (franceinfo.fr)
- Ces éleveureuses refusent que leurs cochons servent l’extrême droite (reporterre.net)
- L’enseigne de bricolage Leroy Merlin a annoncé le retrait de ses pubs d’un site d’extrême droite. (huffingtonpost.fr)
Intolérable pour le Rassemblement national, qui appelle au boycott.
- Philippe Poutou : « La seule façon de combattre la violence, c’est de s’en prendre aux inégalités sociales » (lareleveetlapeste.fr)
Spécial outils de résistance
- Mobilisation contre les violences faites aux femmes : toutes les infos, et de nouveaux visuels à partager ! (solidaires.org)
- Se sentir bien là où l’on milite (syndicalistes.org)
Le sexisme, quand il est exercé par des camarades de gauche qui se disent féministes, qui en façade font en sorte de visibiliser les femmes en les incitant entre autres à prendre des postes de responsabilité, est difficile à dénoncer. Il ne faut pas que cela soit une vitrine pour leur égo, mais une réelle volonté de changement. Ils sont censés être nos alliés mais dans les faits c’est plus complexe. Ils disent qu’ils parlent trop – ils parlent toujours trop.
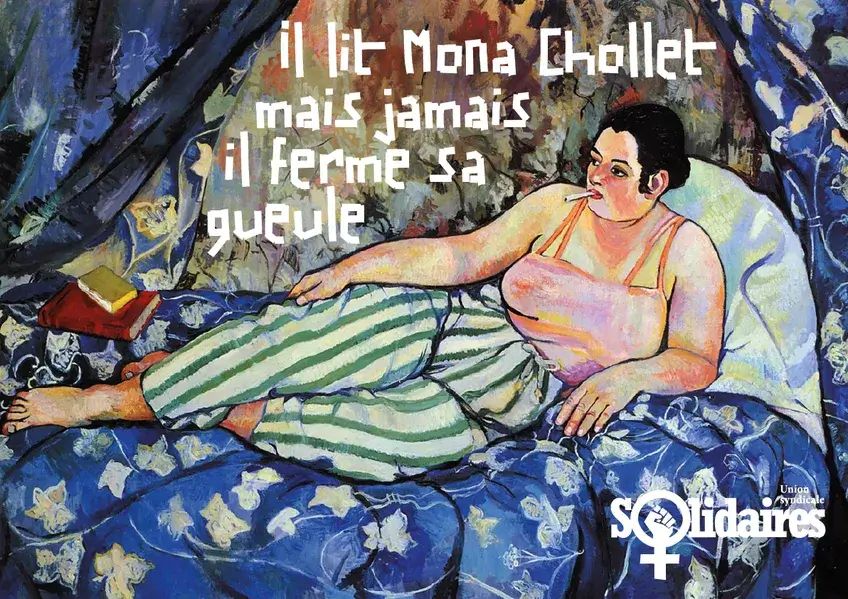
- Disparition des fermes en France Terre de Liens lance l’alerte avec une cartographie exclusive (terredeliens.org)
40 000 fermes de petite taille ont disparu en seulement 3 ans et avec elles, la capacité de nos villes et villages à produire une alimentation locale et de qualité. Les maires, en première ligne, ont le pouvoir d’agir.
Spécial GAFAM et cie
- Retraites Agirc-Arrco : 88 % des articles recommandés par Google sont générés par IA (next.ink)
- Bruxelles va-t-elle désigner AWS et Azure comme contrôleurs d’accès du cloud ? (next.ink)
- Sur Meta, pourquoi les campagnes de dons aux associations sont désormais censurées (huffingtonpost.fr)
De plus en plus d’ONG voient leurs publicités censurées sur Facebook et Instagram.
- A Simple WhatsApp Security Flaw Exposed 3.5 Billion Phone Numbers (wired.com)
By plugging tens of billions of phone numbers into WhatsApp’s contact discovery tool, researchers found “the most extensive exposure of phone numbers” ever—along with profile photos and more.
- Meta wins monopoly trial, convinces judge that social networking is dead (arstechnica.com)
- Microsoft finally admits almost all major Windows 11 core features are broken (neowin.net)
- Panne Cloudflare, le web tousse et révèle ses failles systémiques (synthmedia.fr) – voir aussi Défaillance du réseau Cloudflare le 18 novembre 2025 (blog.cloudflare.com)
Le dysfonctionnement ne résultait, directement ou indirectement, ni d’une cyberattaque ni d’une activité malveillante. L’événement était en réalité dû à une modification des permissions au sein d’un de nos systèmes de base de données. Cette opération a contraint la base de données à sortir plusieurs entrées au sein d’un « fichier de fonctionnalité » utilisé par notre système de gestion des bots Bot Management. Ce fichier a doublé de taille en retour. Plus volumineux que prévu, le fichier de fonctionnalité a ensuite été propagé à toutes les machines qui composent notre réseau.
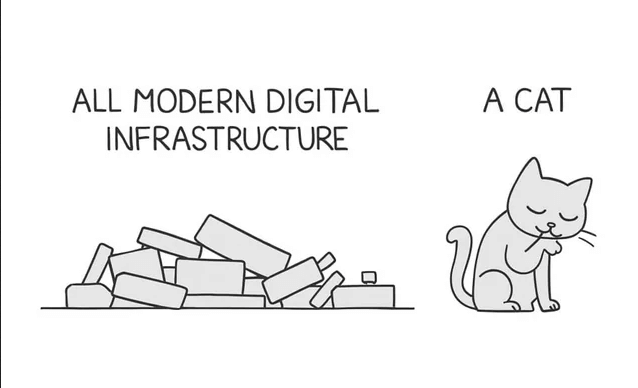
Les autres lectures de la semaine
- Chlordécone : récit d’un écocide colonial (lisbethmedia.com)
Aux Antilles, on estime que 92 % de la population a du chlordécone dans le sang. Ce poison, autorisé en Martinique et en Guadeloupe pendant près de vingt ans malgré son interdiction aux États-Unis et les alertes scientifiques, a contaminé les terres, les eaux et les corps pour des siècles.
- L’imposture de l’innocence : pourquoi « je n’ai rien à cacher » est une capitulation démocratique (lesoir.be)
Le mantra « rien à cacher » légitime une surveillance intrusive et biaisée. Nos données, même innocentes, peuvent discriminer, contrôler, manipuler. Défendre la vie privée, c’est préserver liberté, dignité et résistance démocratique face aux dérives technologiques.
- Le taylorisme augmenté par l’Intelligence Artificielle ? Un extrait du livre J. S. Carbonell (contretemps.eu)
- La guerre numérique : vers une nouvelle doctrine russe (portail.basta.media)
du fait des « réseaux d’information » incarnés par les nuées de drones volants, dispersés sur de larges zones grâce à la démocratisation de l’Internet par satellite, le doute sur le nombre et les déplacements des forces armées sur le champ de bataille n’existe presque plus.
- Quand le néolibéralisme enfante le néofascisme : aux sources d’une révolution idéologique (terrestres.org)
À propos du livre de Quinn Slobodian, Hayek’s Bastards. Race, Gold, IQ, and the Capitalisme of the Far Right

- Molly White : « Le secteur des cryptomonnaies est une composante majeure du mouvement techno-fasciste » (multinationales.org)
- Not in our name (aeon.co)
The gravest of all decisions, to go to war, happens without the consent of the people. This is a great flaw in democracy
- Il y a 42 ans, naissait l’Armée zapatiste de libération nationale (lundi.am) – voir aussi « À propos de semis et de récoltes » – Du Chiapas à la Palestine (lundi.am)
- An Asbestos-Bound, Fireproof Edition of Ray Bradbury’s Fahrenheit 451 (1953) (openculture.com)
We’ve misread Fahrenheit 451, Bradbury told us in his later years. It is an allegory, a symbolic representation of a grossly dumbed-down society, hugely oppressive and destructive in its own way. The firemen are not literal government agents but symbolic of the forces of mass distraction, which disseminate “factoids,” lies, and half-truths as substitutes for knowledge. The novel, he said, is actually about people “being turned into morons by TV.”
- Des archives à soi (blogs.mediapart.fr)
Alors que la profession journalistique se mobilise pour promouvoir un discours féministe à propos du meurtre d’Hélène Legotien, pourquoi est-il moins évident de donner de la visibilité aux initiatives militantes et scientifiques qui visent à faire connaître la vie de cette intellectuelle ?
- La place des femmes et des minorisé·es dans les luttes (blogs.mediapart.fr)
La grande Révolution, comme chacun.e sait, aura été une révolution bourgeoise ; il faut ajouter : anti-féministe. Il en va de même de cette IIIe République qui ne répugna pas à se confier au monarchiste Adolphe Thiers, ni à massacrer celleux qui l’avaient le plus vivement appelée de leurs vœux (n’oublions jamais que les communard.es voulaient la République, la vraie) : fondamentalement conservateur et répressif, ce régime fut aussi résolument anti-féministe. L’un ne va pas sans l’autre. Et inversement. […] lorsqu’une brèche s’ouvre dans le « système », lorsque « le peuple » peut, ou doit coûte que coûte retrouver son agentivité, en période de crise donc, quand les appareils traditionnels vacillent ou se dissolvent, les femmes ne manquent jamais d’investir la scène. Dans les appareils de lutte qui se constituent alors, on les accueille, car on a besoin d’elles. Parenthèse enchantée. […] En France, pays soi-disant révolutionnaire, les lendemains de révolution ne sont jamais des lendemains qui chantent. Une fois que les dominé.es d’hier et de demain les ont portés au pouvoir, les nouveaux responsables s’empressent de rétablir l’ordre, c’est-à-dire la domination.
- La dark romance, un succès qui interroge les féministes (alternatives-economiques.fr)
- Breaking up with the nuclear family (densediscovery.com)
The nuclear family is a relatively new social construct that benefits wealth and power and capitalism but does not benefit children or families or parents or non-parents or communities or the planet. For many people, forming a nuclear family isn’t possible ; and for many, it’s not desirable.
- À quoi ressemblait la musique à l’âge de pierre ? (slate.fr)
Une étude mondiale révèle que les artistes de la préhistoire choisissaient volontairement des parois où la résonance et les échos créaient des effets sonores spectaculaires, transformant chaque peinture en expérience multisensorielle.
Les BDs/graphiques/photos de la semaine
- Honte
- Problème
- Chance
- Néolibéralisme
- Échecs
- Europe de l’écologie
- Vehicles
- COP 30
- Ambidextres
- Croissance infinie
- Revenus
- Parasites
- AI
- Origin of Vi
- Infra
- You are here
- End of Infrastructure
- Cat
- Vivez vos Rêves (bouletcorp.com)
- 5 techniques de domination (janinebd.fr)
- Mona Chollet
Les trucs chouettes de la semaine
- Screw it, I’m installing Linux (theverge.com)
I don’t like where Windows is going. Gaming on Linux has never been more approachable. Time to give it a shot.
- Eugen Rochko : My next chapter with Mastodon (blog.joinmastodon.org)
After nearly 10 years, I am stepping down as the CEO of Mastodon and transferring my ownership of the trademark and other assets to the Mastodon non-profit.
- Renforcez l’internet du partage en contribuant à la robustesse de Framasoft (framablog.org)
- À Échirolles, le Village 2 santé prend soin des habitant·es « fracassé·es par le système » (politis.fr)
Implanté au sein d’un quartier populaire d’Échirolles, en périphérie de Grenoble, un centre de santé communautaire soigne les habitant·es en prenant en compte les inégalités sociales. Un projet dans lequel les habitant·es sont pleinement investi·es.
- Une créature inconnue découverte dans du vomi de dinosaure fossilisé vieux de 110 millions d’années (slate.fr)
Dans une régurgitation préhistorique mise au jour au Brésil, les paléontologues ont identifié deux reptiles volants jusque-là inconnus. Un casse-croûte mal digéré devenu un trésor scientifique.
Retrouvez les revues de web précédentes dans la catégorie Libre Veille du Framablog.
Les articles, commentaires et autres images qui composent ces « Khrys’presso » n’engagent que moi (Khrys).
18.11.2025 à 10:00
Renforcez l’internet du partage en contribuant à la robustesse de Framasoft
Framasoft
Texte intégral (10310 mots)
Framadate se réinvente, Framapetitions (et d’autres outils !) s’ouvre à vous, PeerTube passe la huitième… Grâce à vos dons, notre petite association continue de bricoler un Internet du partage, sans pub, sans pistage, sans capitalisme de plateforme. Pour vous et pour plus de deux millions de personnes chaque mois.
Comme chaque automne, les feuilles tombent, les serveurs chauffent, et Framasoft remplit sa hotte de nouveaux services libres.
Et, comme chaque année, on a aussi besoin de vous. Parce que 94 % de nos ressources viennent de vos dons. Oui, de vous, là, derrière votre écran.
Alors, si vous souhaitez qu’existent encore des alternatives numériques qui ne vous vendent pas au plus offrant, c’est le moment de filer un coup de main.
Parce qu’un Internet libre, ça ne pousse pas dans les datacenters d’Amazon : ça se cultive ensemble, ici et maintenant.
- Framasoft est un commun. Il est important d’en prendre soin.
- Comment Framasoft va mieux vous servir (enfin vous outiller, hein !)
- 🗓️ Un nouveau Framadate, mobile et résilient
- ☁️ Framaspace, de la visio et plus d’espace pour les assos !
- 🐙 PeerTube v8 : gérez à plusieurs vos chaînes de vidéos !
- 📱 L’app PeerTube mobile : mode vidéaste débloqué !
- 📄 FramaPDF, pour signer, annoter, éditer… sans abdiquer vos données !
- 💰 Framacount, car les bons comptes font les fram’amis
- 🧰 Framatoolbox : le couteau suisse numérique
- 🗳️ Framapetitions l’expression collective qui respecte la vie privée
- 🌱 Et d’autres nouveautés à venir en 2026 !
- Internet n’est pas (encore) à vendre, et c’est grâce à vous
Framasoft est un commun. Il est important d’en prendre soin.
Évidemment, tourné ainsi, cela peut sonner comme un slogan de startup de la tech for good human centered digital ethics©®™. Au-delà de la formule, nous voulons vous partager nos réflexions, choix et actions, comme autant d’arguments qui étayent cette affirmation.
Internet appartient aux internautes, pas aux monopoles
Nous sommes une association qui n’a rien à vendre, et qui ne cherche pas le profit : pas de publicité, pas de vente de données, pas d’actionnaires. Ce n’est pas Bolloré qui pourra nous racheter ! 🤑
On entend souvent dire que « Si c’est gratuit, c’est vous le produit ! ». Nous prouvons qu’il existe des exceptions à cette règle : nos services sont gratuits parce qu’ils sont financés par la solidarité, et non parce que vos données seront exploitées. Comme il n’y a aucun intérêt à vous exploiter, il n’y a aucun intérêt à « emmerdifier » nos outils. En vérité, le seul but de nos services est… de vous rendre service.
Soutenir Framasoft, c’est donc participer à un modèle unique en son genre. C’est d’abord refuser l’idée que seuls les géants du numérique dictent les règles du jeu. Mais c’est aussi, en tant qu’internaute, faire le choix d’investir dans l’intérêt général plutôt que dans le profit privé, dans la coopération plutôt que la compétition.

Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0
Votre générosité profite directement à la communauté.
En donnant, vous ne financez pas un projet isolé, mais tout un écosystème de services libres, gratuits et éthiques utilisés par plus de deux millions de personnes chaque mois.
Chaque euro devient un geste concret : aider une enseignante à organiser une sortie, une association à partager ses fichiers, ou des citoyen⋅nes à débattre sans dépendre des géants du web.
Framasoft, c’est un commun numérique : plus nous sommes nombreux⋅ses à soutenir l’association, plus elle devient précieuse pour toutes et tous. Dans un contexte où les aides publiques diminuent voire disparaissent, votre générosité est essentielle pour que la solidarité continue de faire tourner nos serveurs et vivre nos projets. En soutenant Framasoft, vous rendez le web plus libre, mais surtout plus humain.
Framasoft pratique d’ailleurs le « ruissellement » (celui qui n’est pas un échec, celui qui marche 😉), en contribuant, sous forme de code ou d’argent, aux projets que nous utilisons ou que nous vous proposons. Car notre commun numérique repose, lui aussi, sur d’autres communs.

Illustration CC BY David Revoy (sources)
Comme tout commun, Framasoft est fragile. Renforçons sa robustesse.
Nous n’avons pas les thunes d’un Google (ça tombe bien, on n’en veut pas). Pas l’infrastructure d’un Amazon (ça tombe bien aussi, on n’en veut pas non plus). Pas les 230 000 salarié⋅es d’un Microsoft (10, c’est déjà bien suffisant !). On n’a pas la capacité de centraliser la vie privée de Facebook/Instagram/WhatsApp (et heureusement !). Pour autant, nous sommes fièr·es de voir que notre travail est réellement utile à un large public.
Nous ne cherchons pas la croissance (nous sommes une association à taille humaine et nous entendons le rester), ni la performance (qui se fait souvent au détriment de la santé mentale des salarié⋅es ou bénévoles, ou de l’appauvrissement de prestataires).
Du fait de la tragédie des communs (ou de bien d’autres raisons), Framasoft pourrait disparaître demain. La Terre ne s’arrêterait pas de tourner. Nous avons déjà anticipé notre propre compostabilité en impulsant et animant le collectif CHATONS (qui vole marche aujourd’hui de ses propres petites pattes velues).
Cependant, nous pensons réellement être utile à tout un pan de la société, et souhaitons que cette utilité perdure.
Notre raison d’être : outiller celles et ceux qui refusent un monde (numérique) injuste.
Celles et ceux qui font le choix de plus de progrès social et de plus de justice sociale face à la fascisation du monde (y compris celle du monde numérique).
Celles et ceux, aussi, qui doivent faire face à des attaques de plus en plus fortes et fréquentes.
Nous pensons notamment ici au monde associatif, fragilisé par la baisse des subventions et la précarité croissante, pour lequel Framasoft fait parfois office de bouée de secours numérique.
Nos outils permettent à des initiatives locales de perdurer et de s’adapter, malgré les difficultés économiques et politiques. Plein d’exemples nous honorent : organisation d’actions militantes en ligne, maintien du lien avec les bénéficiaires, organisation d’événements indépendamment des GAFAM.
En tant qu’association elle-même, Framasoft pratique la solidarité inter-associative : elle partage ses ressources (logiciels, serveurs, connaissances) avec d’autres structures.
Faire un don à Framasoft, c’est contribuer à cet élan solidaire entre organisations qui, ensemble, tissent un filet de sécurité sociale et culturelle pour la population.
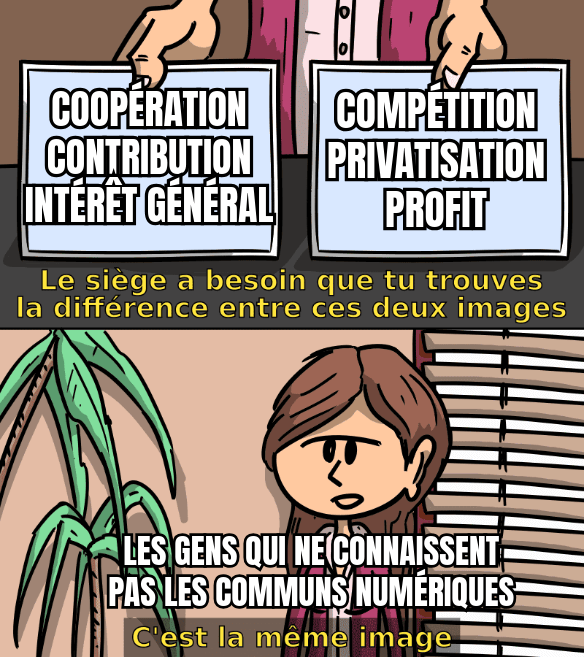
Mème : Une personne tient deux feuilles : « Coopération, Contribution, Intérêt général » et « Compétition, Privatisation, Profit ». La personne, qui ne connaît pas la notion de commun numérique, répond « C’est la même image »
Comment Framasoft va mieux vous servir (enfin… vous outiller, hein !)
Rappelons d’abord que Framasoft dorlote sa vingtaine de services en ligne tout au long de l’année, et ce depuis plus de dix ans : mises à jour, migrations, documentation, support technique, etc. Les annonces plus spectaculaires ne doivent pas faire oublier ce travail colossal du quotidien.

Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0
Mais soyons honnêtes : si vous nous lisez jusqu’ici, c’est probablement pour découvrir les nouveautés de cette fin d’année, et quelques teasers pour 2026 !
Par souci de transparence (et pour éviter le “One more thing” façon Steve Jobs), nous faisons le choix de présenter dès maintenant toutes les annonces prévues d’ici au 31 décembre !
Au fil des semaines, nous détaillerons les nouvelles fonctionnalités rendues possibles grâce à votre soutien.
🗓️ Un nouveau Framadate, mobile et résilient
Trouver ensemble la date de la prochaine réunion, le prochain week-end entre ami·es, choisir les pizzas ou le nom du prochain projet… Avec 15 ans de sondages cumulés, Framadate, notre alternative libre à Doodle, reste LE service le plus utilisé de Framasoft. L’an passé, vos 1 250 000 sondages créés ont généré près de 40 millions de visites.
Sauf que sous le capot, le code commençait à montrer son âge, rendant le service difficile à maintenir et à faire évoluer.
Dès aujourd’hui, nous vous proposons un Framadate tout beau tout neuf, qui :
- se base sur le logiciel libre Pollaris, créé pour l’occasion !
- facilite la contribution en passant d’un code « à l’ancienne » à un framework moderne
- vous assure les mêmes fonctionnalités que le vieux Framadate
- fonctionne (enfin) correctement sur mobile !
- propose un parcours de création et un design repensés :
- lisibilité accrue (plus c’est clair, plus c’est…clair !)
- accessibilité renforcée (pour minimiser les situations de handicap)
- clarté dans les étapes (pour éviter les oublis) !
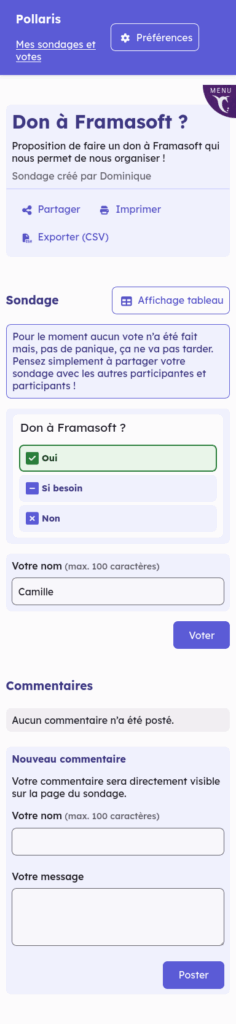
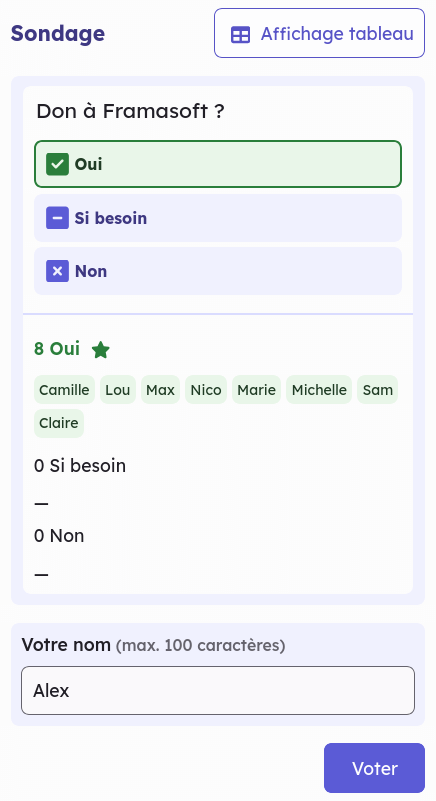
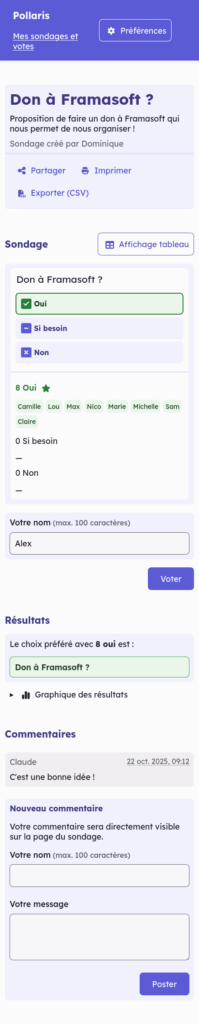
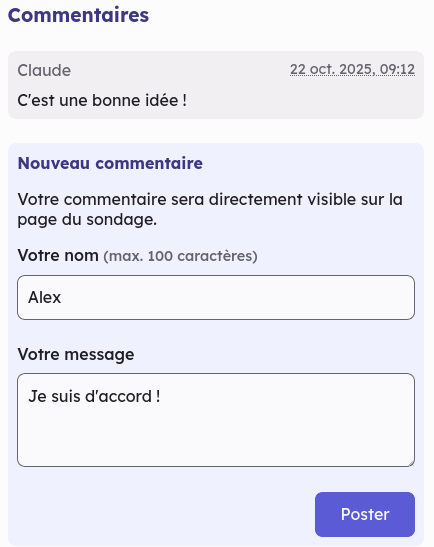
La nouvelle version est proposée par défaut dès aujourd’hui, mais l’ancienne version restera accessible jusqu’à fin décembre. À partir de janvier, les créations se feront uniquement sur le nouveau Framadate ; vos anciens sondages, eux, resteront accessibles.
À Framasoft, nous utilisons Framadate depuis 15 ans, et nous savons que changer ses habitudes parce que le logiciel évolue… c’est compliqué. C’est pourquoi nous avons pris soin de nous assurer que vous gagnerez au change : interface plus claire, meilleure accessibilité, compatibilité mobile et un code durable, prêt pour les futures contributions et évolutions.
Essayer Framadate sans oublier de Soutenir Framasoft
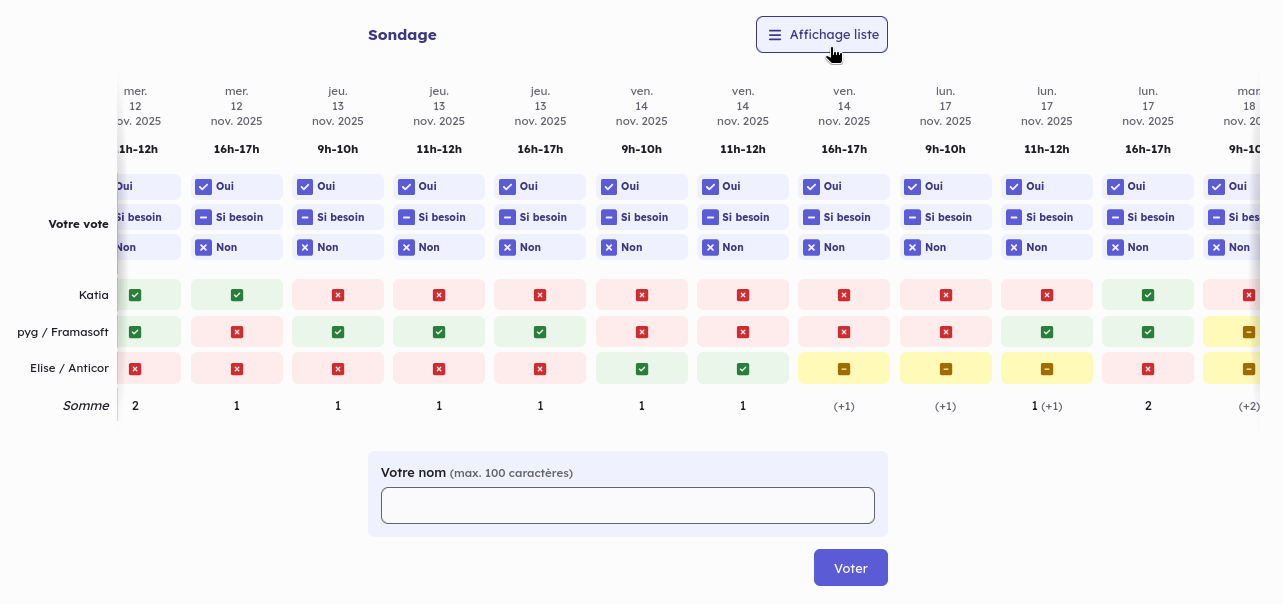
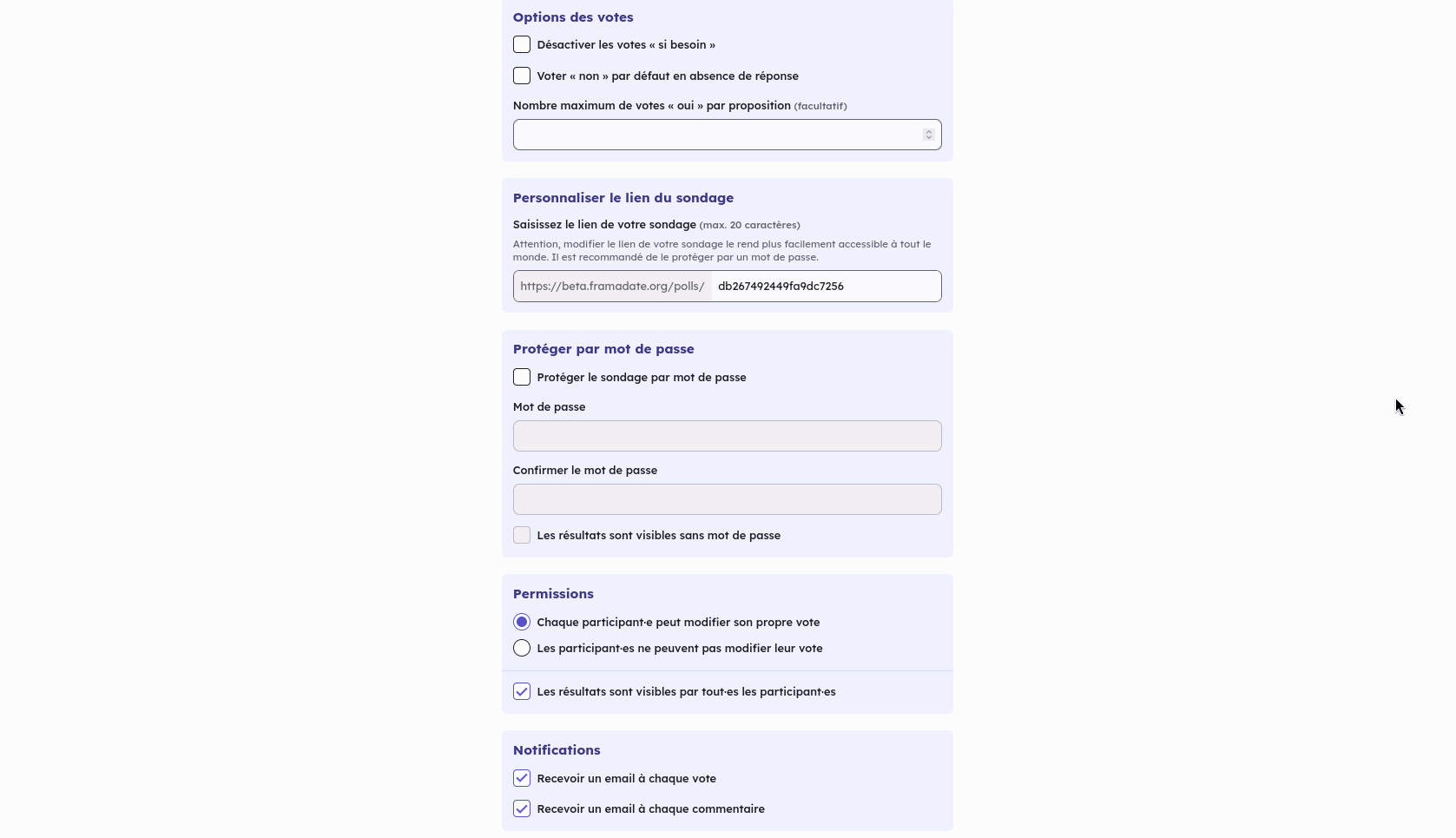
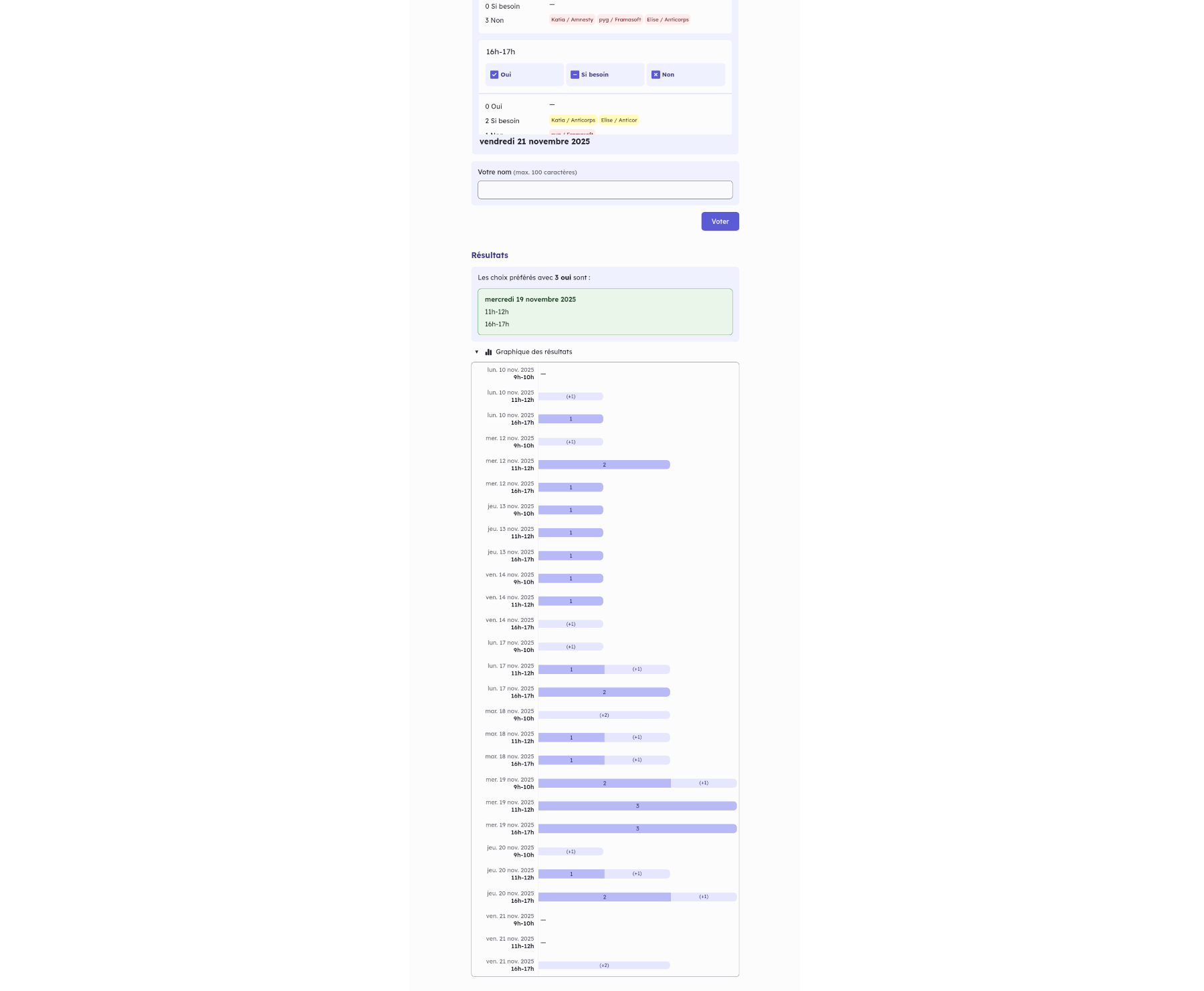
☁️ Framaspace, de la visio et plus d’espace pour les assos !
Framaspace est le projet de cloud souverain, associatif et militant de Framasoft. Il vise à offrir aux associations et collectifs des outils numériques cohérents et en phase avec leurs valeurs sociales, écologiques et solidaires.
En cette période de coupes budgétaires et de pressions sur le monde associatif, Framasoft fournit ce service gratuitement. Framaspace est clairement notre projet le plus ambitieux (et le plus cher !). À terme, nous voulons fournir jusqu’à 10 000 espaces cloud, à des associations et collectifs militants.
En multipliant les espaces Framaspace, nous mutualisons les coûts et les efforts de maintenance technique. Grâce à notre modèle solidaire, ces petites structures à micro budget ont une alternative aux services des multinationales marchandes, voire autoritaires. Dit autrement, vos dons permettent directement de garantir à ces collectifs un accès équitable à des outils éthiques.
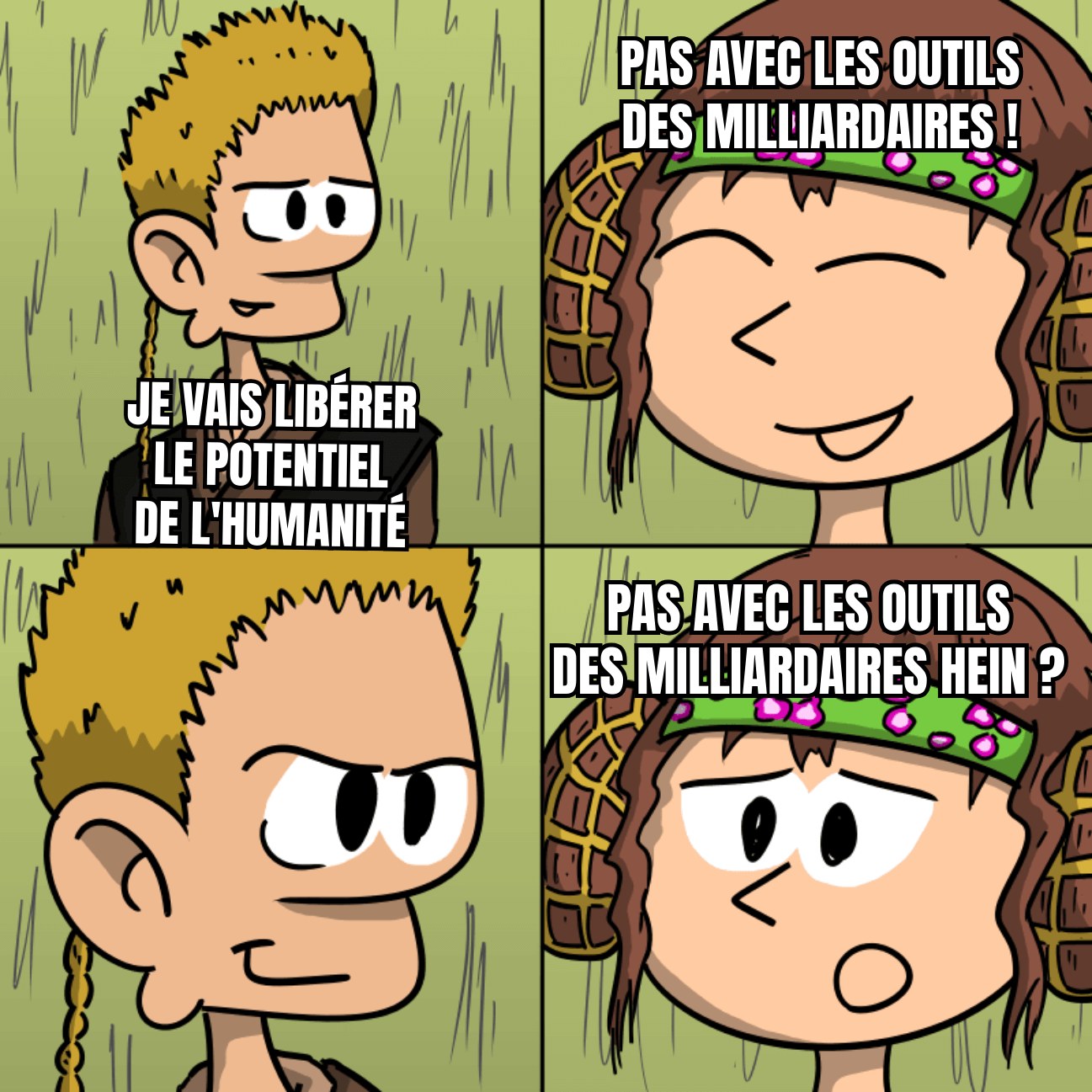
Mème : Anakin Skywalker dit « Je vais libérer le potentiel de l’humanité ». Padmé répond, sereine : « pas avec les outils des milliardaires ! ». Anakin a un sourire flippant. Padmé, moins rassurée, dit : « pas avec les outils des milliardaires hein ? ».
Grâce à vos dons, Framaspace, c’est d’ores et déjà :
- près de 2 500 espaces collectifs avec partage de fichiers, contacts, calendriers, formulaires ;
- Basé sur le logiciel libre Nextcloud, auquel nous contribuons activement ;
- donc 2 500 associations qui s’émancipent des GAFAM ;
- une centaine de nouveaux espaces déployés chaque mois ;
- La gestion comptable et celles des membres avec Paheko ;
- Un système de déploiement (a priori) unique au monde.
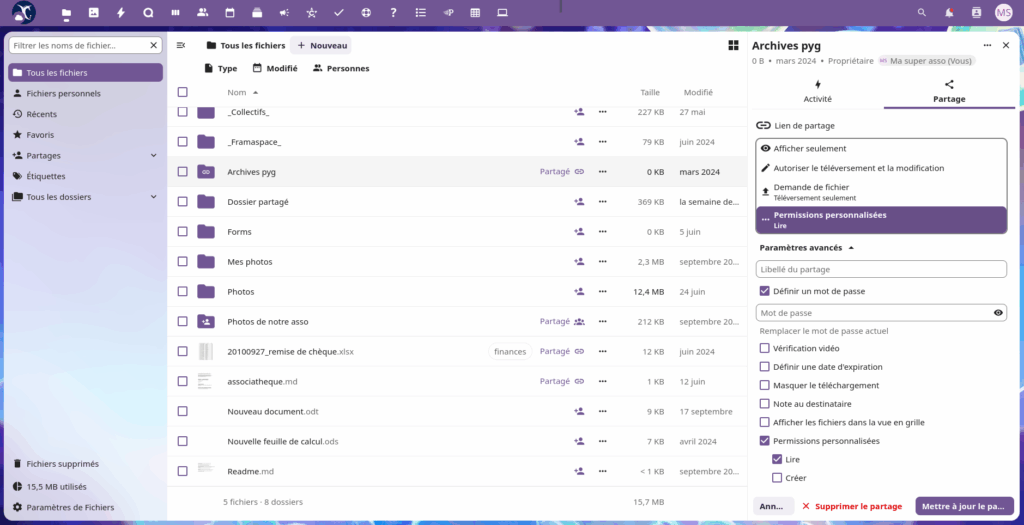
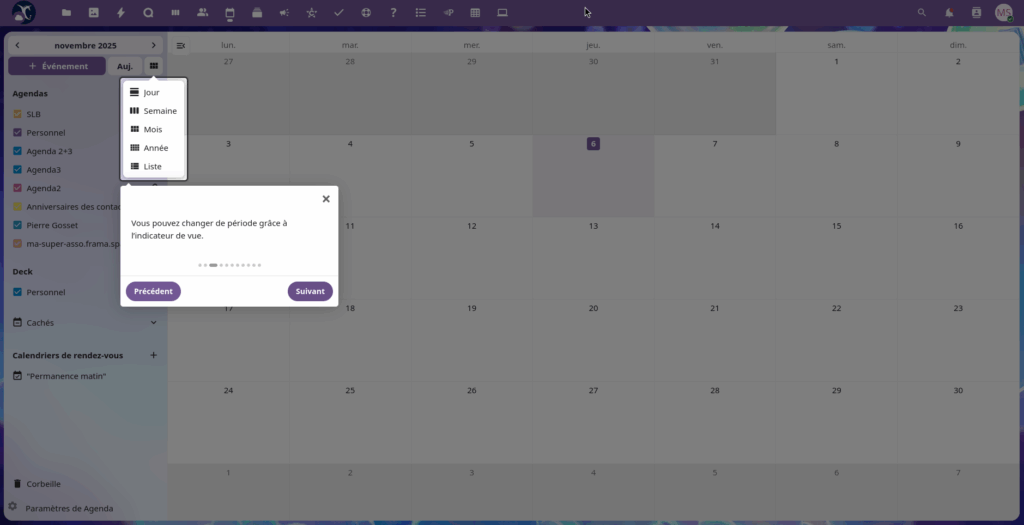
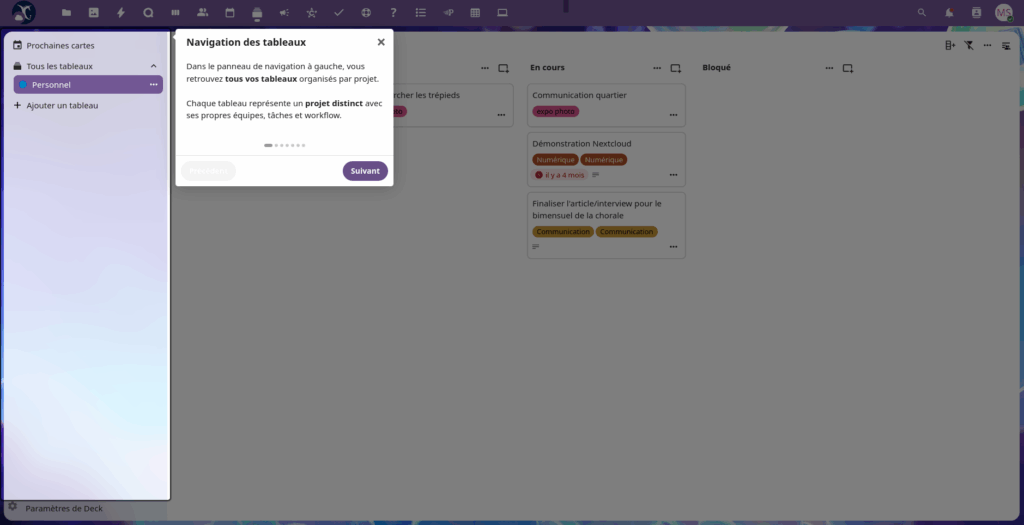
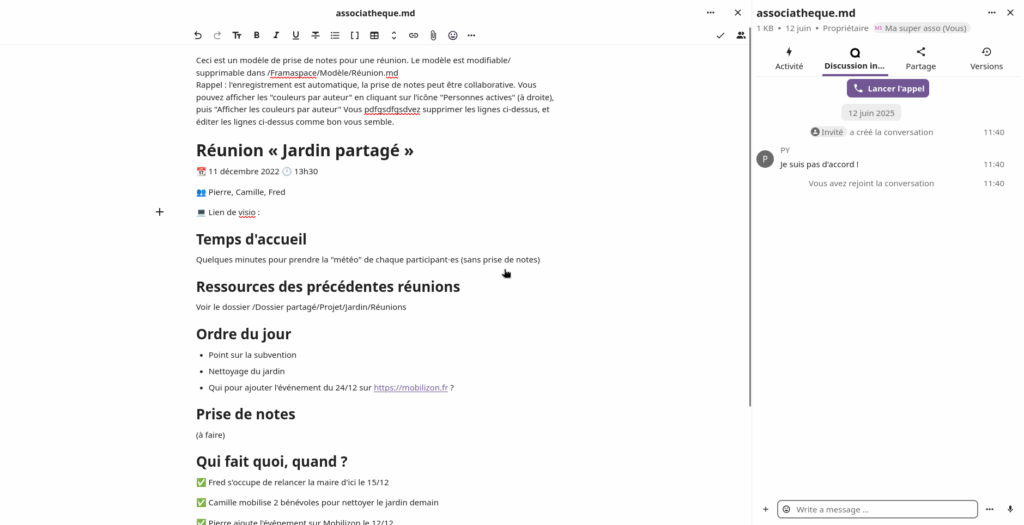
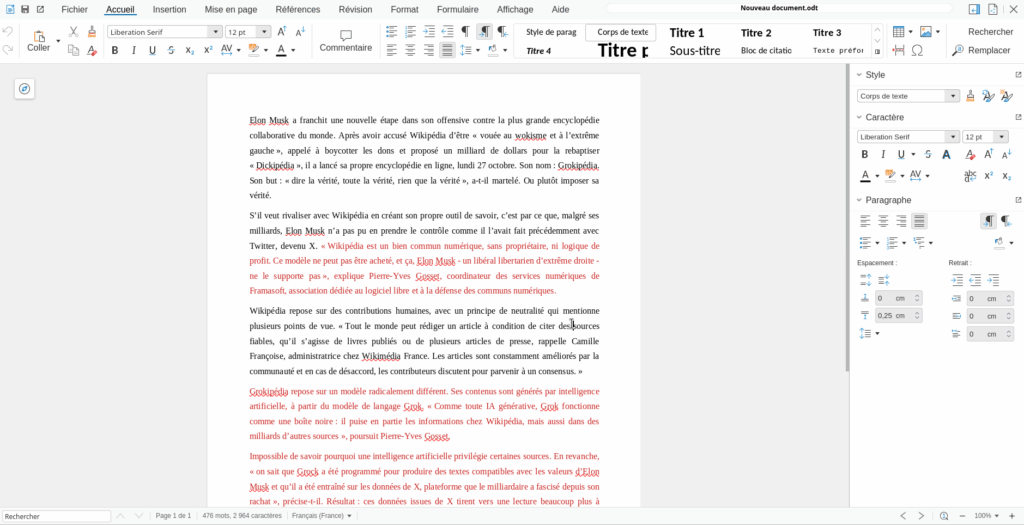
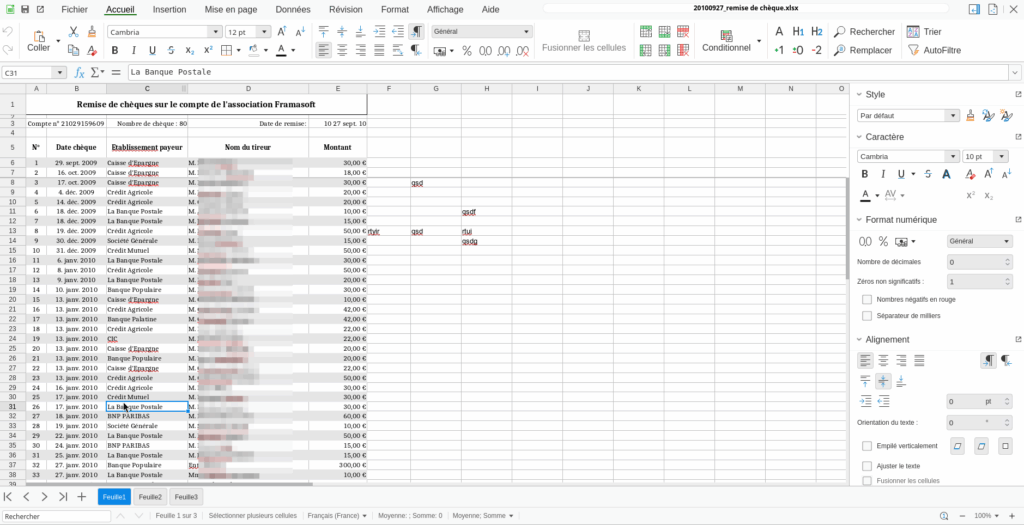
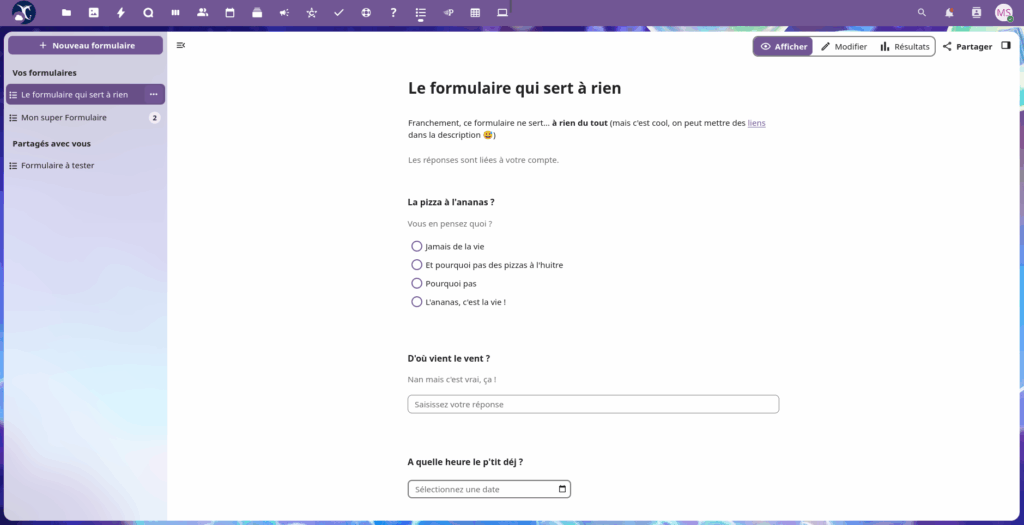
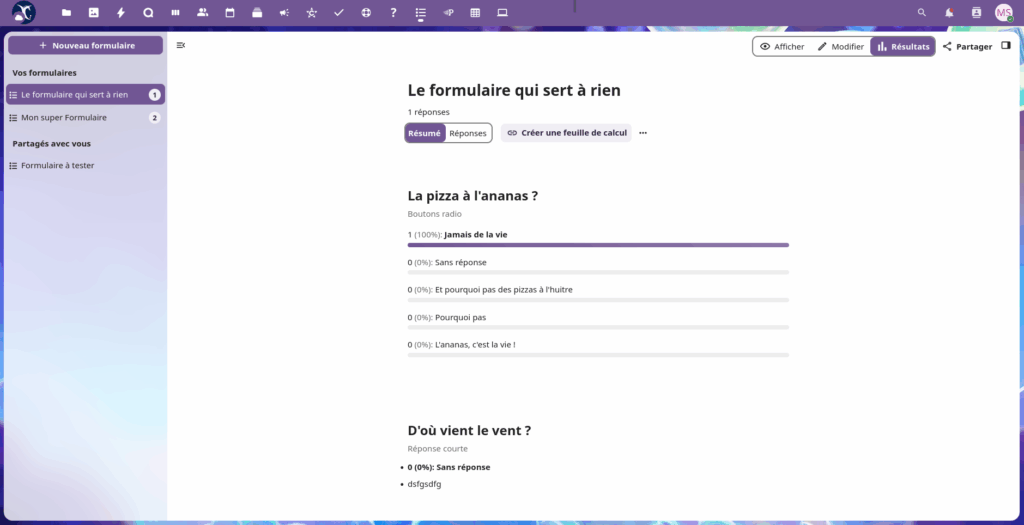
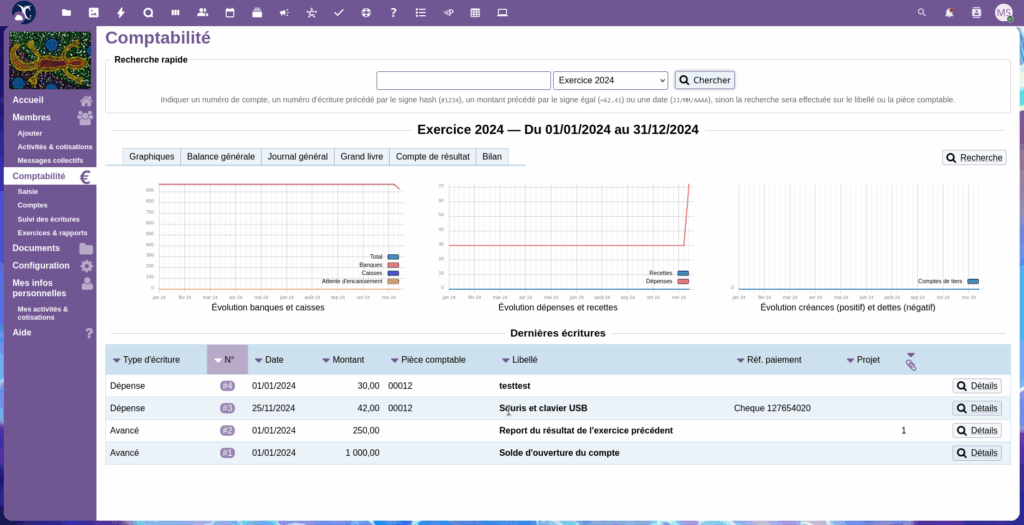
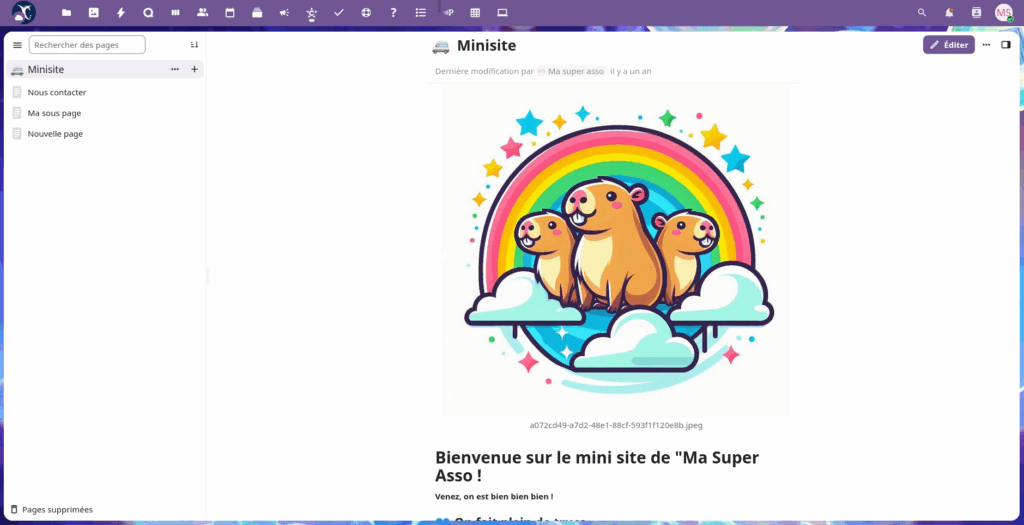
En 2025, Framaspace fait le plein d’améliorations :
- Mises à jour générales de Nextcloud : passage en v30 (avril) puis v31 (octobre) ;
- Correction de bugs sur la liaison avec Paheko (comptabilité et gestion des membres) ;
- Facilitation de la prise en main pour les personnes qui découvrent Framaspace :
- modernisation de l’application Visites guidées ;
- ajout de tutoriels (Deck, Formulaires) ;
- intégration une vidéo d’introduction.
Pour cette fin d’année, nous avons deux annonces majeures :
- Plus d’espace pour le même prix !
- (c’est toujours gratuit, c’est donc le même prix ^^) ;
- on passe de 40 Go à 50 Go par espace ;
- dès maintenant (pas besoin de demander) ;
- C’est simple à retenir : “50 comptes / 50 Go max” 😅
- Nouveau serveur de visioconférence :
- les visios à plus de 2 personnes deviennent enfin fluides !
- La configuration est en cours : rendez-vous en décembre.
Framaspace reste à la fois notre plus grand défi technique et politique, mais aussi un pari militant. Nous estimons que chaque Framaspace nous coûte environ 50€ à l’ouverture, puis environ 12 €/an (coûts techniques mais aussi humains). Grâce à votre soutien, notre petite équipe gère près de 2 500 clouds pour des structures militantes, d’éducation ou de solidarité… sans que l’argent ne soit un filtre à l’accès.
En apprendre plus sur Framaspace sans oublier de Soutenir Framasoft
🐙 PeerTube v8 : gérez à plusieurs vos chaînes de vidéos !
Cette année, PeerTube, l’alternative à YouTube et autre Vimeo développée par Framasoft, a fêté les dix ans de ses premiers bouts de code… mais aussi son million de vidéos publiées !
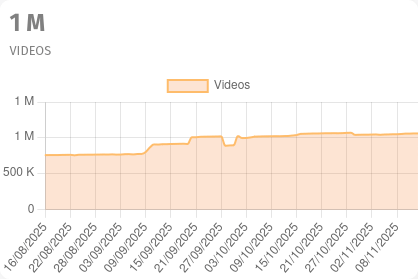
L’année 2025 a été une année particulièrement intéressante pour nous.
Cette année encore, nous avons bénéficié d’une bourse NLnet pour développer les applications Web et mobile. L’objectif ? Que PeerTube couvre encore mieux les besoins de différentes organisations qui libèrent leurs vidéos (médias, institutions, etc.)… mais ces améliorations profitent à tout le monde !
En 2025,nous avons déjà ajouté à PeerTube :
- un meilleur support des applications de podcasts ;
- la planification des directs ;
- la possibilité de détecter automatiquement des termes choisis (pour la modération) ;
- un assistant de configuration pour pré-configurer la plateforme ;
- une refonte du système de catégorisation du contenu sensible ;
- une plus grande personnalisation de l’interface ;
- différentes améliorations de l’expérience utilisateur⋅ice ;
- … et plein d’autres améliorations et corrections de bogues !
L’année n’est cependant pas (encore) terminée et vous pourrez, d’ici quelques semaines, profiter de la version 8 de PeerTube !
Celle-ci proposera une fonctionnalité longtemps attendue : la possibilité de gérer une chaîne à plusieurs.
Aussi, nous avons amélioré l’outil d’import (à partir d’une autre vidéo disponible sur le Web) : il est désormais possible de réactiver manuellement l’import d’une vidéo ayant échoué (par exemple, à cause de YouTube qui bloque parfois les adresses IPs) et l’outil de synchronisation réessaiera automatiquement les imports ayant échoué.
Nous parlerons du détail de ces fonctionnalités et des autres améliorations prévues au sein de cette nouvelle mouture de PeerTube dans un article dédié !
C’est votre soutien, depuis le jour où nous vous annoncions que nous souhaitions briser l’hégémonie de YouTube, qui permet de concrétiser cette vision. Merci.
Visiter le site de PeerTube sans oublier de Soutenir Framasoft
📱 L’app PeerTube mobile : mode vidéaste débloqué !
Depuis plus d’un an, nous travaillons sur l’application mobile officielle de PeerTube, disponible sur les principaux stores (Play Store, App Store et F-Droid).
Grâce à votre soutien lors du financement participatif de juin, PeerTube pour mobile a beaucoup évolué.
Parmi les fonctionnalités ajoutées en 2025, vous retrouverez :
- la gestion du compte utilisateurice ;
- le support des listes de lecture ;
- le téléchargement des vidéos (et la possibilité de les visionner hors ligne) ;
- la gestion des commentaires ;
- l’authentification à deux facteurs ;
- le support de l’authentification OpenID ;
- des améliorations du lecteur (on peut maintenant jouer avec la luminosité et le son avec de simples gestes ! Youpi ! 🥳) ;
- de nombreuses améliorations du design et de l’interface ;
- … et bien d’autres !
Dans quelques semaines, nous publierons une grosse mise à jour : la possibilité d’ajouter des vidéos et éditer leurs informations directement via l’application !
Nous l’avions promis lors du financement participatif, il n’y aura bientôt plus besoin d’utiliser son navigateur web pour publier sur PeerTube !
Enfin, début 2026, nous ajouterons la possibilité de lire les vidéos en arrière-plan ! Initialement, nous souhaitions publier cette fonctionnalité dès cette fin d’année… mais nous estimons qu’il est plus réaliste de prendre le temps d’intégrer vos retours entre ces deux gros ajouts.
L’application PeerTube pour mobile et ses améliorations ont été rendues possibles grâce à votre soutien !
Sans votre élan de solidarité en juin dernier, il aurait été délicat d’envisager de telles améliorations de l’application.
Merci d’avoir permis à tant de personnes de profiter d’une plateforme vidéo alternative à YouTube, même sur mobile ! 💖
Télécharger l’application sans oublier de Soutenir Framasoft
📄 FramaPDF, pour signer, annoter, éditer… sans abdiquer vos données !
Qu’il s’agisse d’annoter un rendu, de signer un contrat, de mettre un filigrane sur ses fiches de paye… on a souvent besoin de modifier des fichiers PDF.
Dès aujourd’hui, vous pouvez faire tout cela (et plus encore !) sans craindre pour votre vie privée, avec FramaPDF !
FramaPDF vous permet donc de :
- Signer des PDF, seul ou à plusieurs ;
- Fusionner, découper, réorganiser ou supprimer des pages ;
- Éditer les métadonnées ;
- Ajouter un filigrane (« copie confiée à Trucmuche Immobilier » sur la carte d’identité ou la fiche de paye, ça aide contre des malandrins) ;
- Compresser un fichier PDF pour l’envoi par mail ;
- le tout basé sur le logiciel libre SignaturePDF.
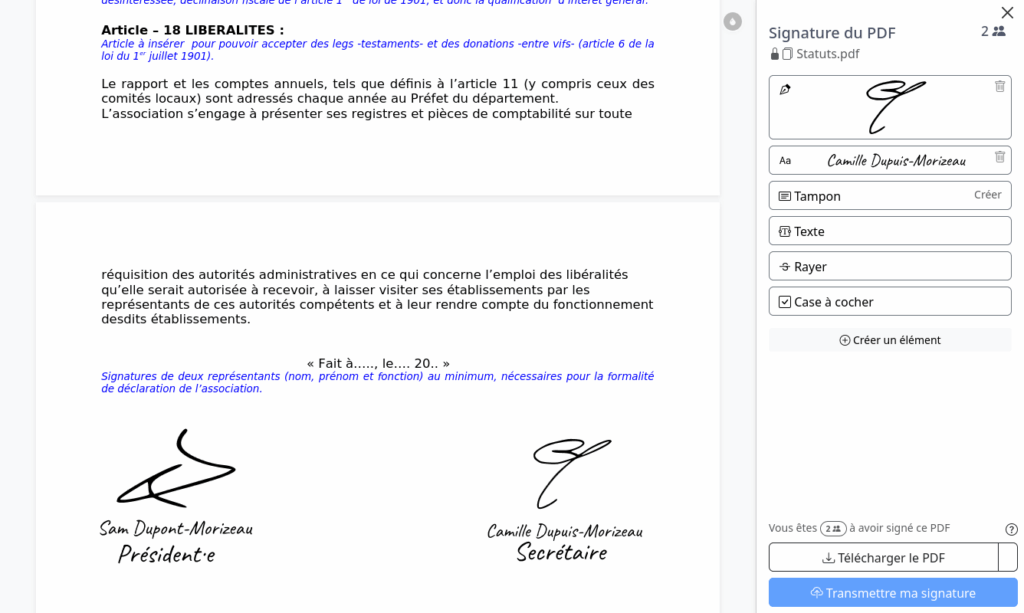
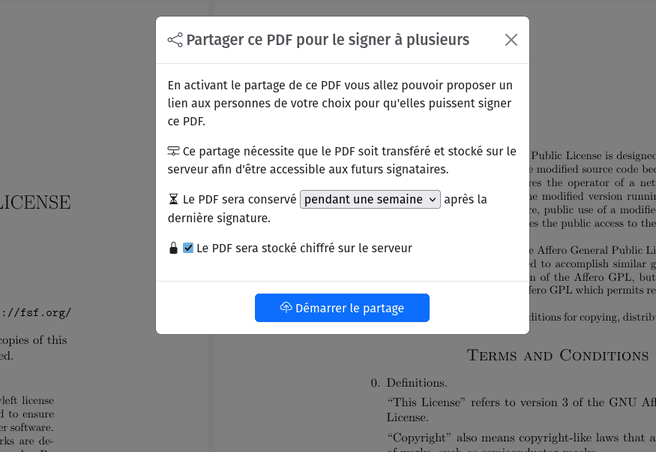
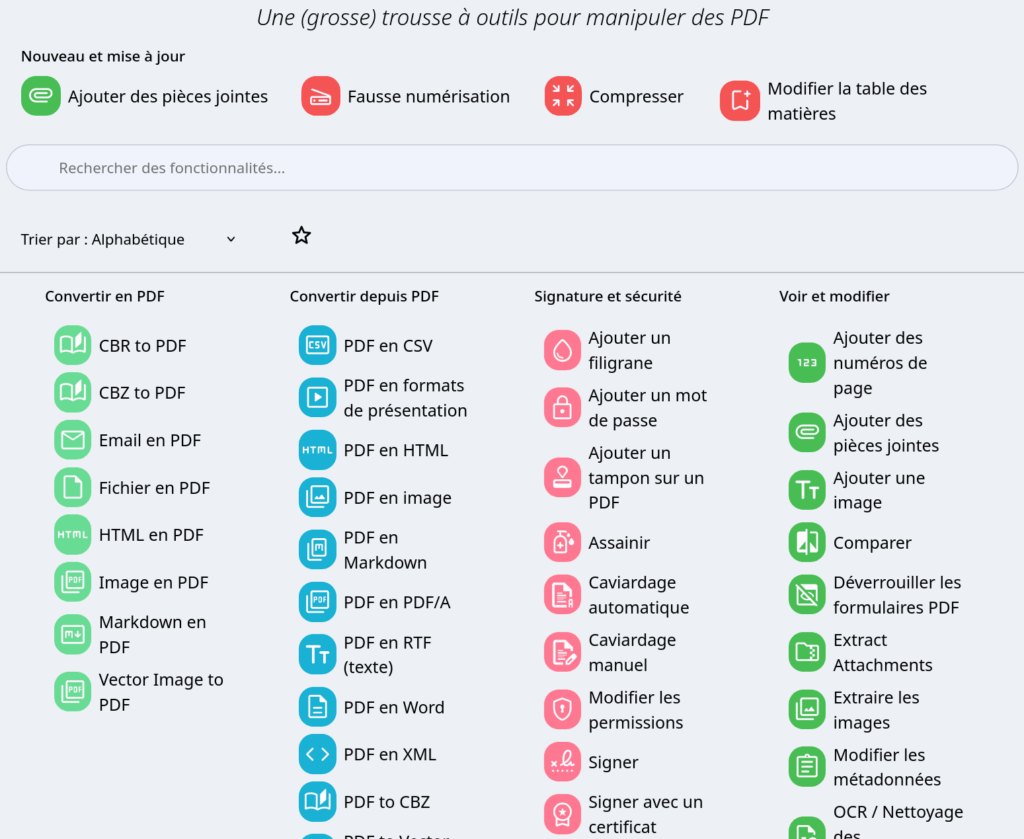
Ce logiciel aurait pu rejoindre la Framatoolbox annoncée plus bas, mais grâce à vos tests (dans notre Framalab) et en compilant vos retours lors de notre enquête… nous avons compris qu’il mérite d’être un service à part entière.
Comme toujours, votre vie privée est respectée : sauf pour certaines opérations (comme “Signer un PDF à plusieurs”) où nous n’avons pas le choix, tout s’exécute dans votre navigateur, vos fichiers ne transitent pas vers nos serveurs.
Essayer FramaPDF sans oublier de Soutenir Framasoft
💰 Framacount, car les bons comptes font les fram’amis
Comment on fait pour partager le resto ? Qui doit quoi pour le week-end entre potes ? On répartit comment les dépenses pour l’atelier de l’asso ?
Alors il y a celles et ceux qui font confiance à l’obscur Tricount, dont la gestion des données est devenue floue depuis son rachat en 2022 par une banque néerlandaise….
Et puis il y a vous, qui pouvez utiliser et recommander Framacount !
Avec Framacount, vous pouvez :
- noter qui a payé quoi ;
- laisser l’outil calculer automatiquement qui doit combien à qui ;
- simplifier les remboursements entre ami·es, sans erreur.
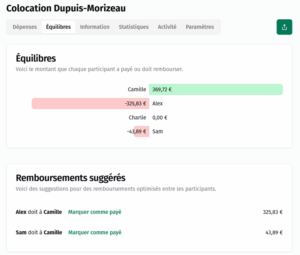
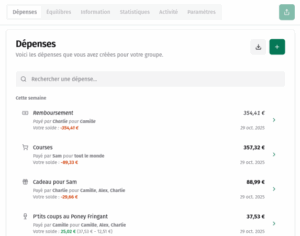
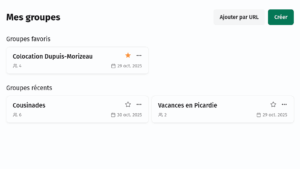
Motorisé par le logiciel libre Spliit, Framacount a été mis en place grâce à vos retours lors des tests 2024 dans notre Framalab.
Pas de compte, pas de pub, pas d’exploitation de données : juste un outil libre, simple et transparent.
Essayer Framacount sans oublier de Soutenir Framasoft
🧰 Framatoolbox : le couteau suisse numérique
Chez Framasoft, on nous demande souvent :
« Tu connais un moyen rapide de rogner une image ? »
« Comment supprimer les doublons dans un fichier ? »
« Tu me conseillerais quel outil pour convertir un GIF en MP4 ? »
« Je galère à extraire l’audio d’un fichier vidéo. Tu peux m’aider ? »
« Il te resterait pas un peu de café ? » ☕️
Eh bien maintenant, vous pourrez faire tout ça vous-mêmes ! (Sauf le café, peut-être…)
Framatoolbox regroupe des outils libres dédiés aux tâches dites “de productivité” : manipuler des fichiers, transformer des données, automatiser des petites actions du quotidien.
Vous l’aurez compris : il ne s’agit pas d’un nouveau “gros service” comme PeerTube, Framadate ou Framaspace. Framatoolbox est plutôt une collection d’outils pratiques pour se simplifier la vie numérique.
Cette boite à outils ouvre dès aujourd’hui avec deux premiers services :
🪄 Omnitools, pour tout touiller dans vos fichiers
Pour :
- Redimensionner, convertir, modifier images et vidéos ;
- Manipuler textes et listes (changer la casse, reformater, supprimer les doublons, mélanger) ;
- Travailler avec JSON, CSV, XML (nombreuses manipulations possibles) ;
- Effectuer conversions, calculs, outils mathématiques, dates/temps, etc.
- Basé sur le logiciel libre Omnitools.
Et bien d’autres fonctionnalités à explorer. Car Omnitools comprend près d’une centaine d’outils !
Ci-dessus, deux exemples d’outils proposés par Omnitools : le redimensionnement d’une image, et la récupération d’un extrait vidéo.
🔄 Vert (pour conVERTir vos fichiers, pas pour les verdir 😉)
Cet outil, basé sur le logiciel libre Vert.sh, vous permet de convertir en quelques clics vos fichiers dans plus d’une centaine de formats :
- pour les fichiers textes (par exemple .doc → .odt) ;
- les fichiers vidéos ( .mp4 → .gif) ;
- les fichiers son (.mp3 → .ogg), etc.
Ci-dessus, deux exemples de conversions proposé par vert.framatoolbox.org : conversion d’un fichier Markdown en .odt (LibreOffice Writer) et conversion d’une image .webp en .jpg
Framatoolbox préserve votre vie privée : vos fichiers ne quittent jamais votre appareil, car toutes les opérations se déroulent dans votre navigateur (sauf la conversion vidéo qui se passe sur nos serveurs et est donc limitée à 200Mo).
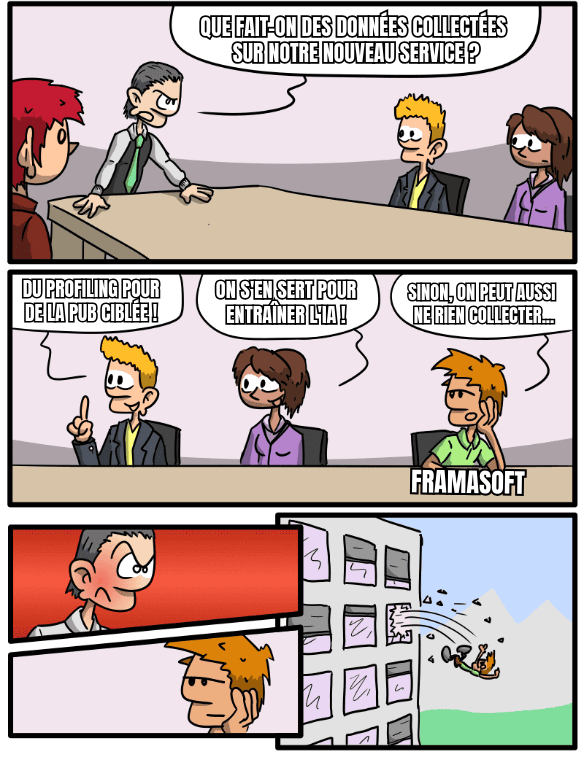
Mème. Le boss : « Que fait-on des données collectées sur notre nouveau service ? ». Personne 1 : « Du profiling pour la pub ciblée ! ». Personne 2 : « On s’en sert pour entraîner l’IA ! ». Personne 3 (Framasoft) : « Sinon, on peut aussi ne rien collecter… ». La personne 3 est passée par la fenêtre.
Avec votre soutien, en 2026, nous voulons enrichir Framatoolbox avec de nouveaux outils. En attendant, nous sommes convaincu⋅es que ce couteau suisse numérique rendra de fiers services à beaucoup d’entre vous.
Essayer Framatoolbox sans oublier de Soutenir Framasoft
🗳️ Framapetitions, l’expression collective qui respecte la vie privée
Une plateforme de pétitions libre et ouverte à tous et toutes : il y a 9 ans, nous en rêvions. Il y a six ans, nous nous lancions. Sauf qu’entre COVID, priorités bousculées et la vie, celle des personnes qui font le code… la route fut longue pour mener à bien ce projet.
À Framasoft, nous voyons les limites de la « démocratie par le clic » (parfois impulsive, symbolique ou purement performative). Nous observons aussi que les pétitions en ligne ont regagné en visibilité (citons celles des Gilets jaunes ou contre la loi Duplomb). Car il ne faut pas négliger la force d’une pétition, en tant qu’outil d’expression collective… mais à condition que cet outil respecte la vie privée.
Ces derniers mois, nous avons contribué au logiciel Pytition, en ajoutant des outils anti-abus, pour mieux repérer les pétitions douteuses.
Résistance à l’Agression Publicitaire et Les Amis de la Terre travaillent de leur côté à des améliorations UI/UX, que nous intégrerons une fois stabilisées.
Yann, le développeur principal, poursuit également bénévolement le maintien du projet Pytition, garantissant sa pérennité.
Sur Framapetitions.org, vous pouvez dès maintenant :
- créer un compte individuel ou rattaché à une organisation (avec plusieurs utilisateurs et pétitions) ;
- publier vos pétitions ;
- collecter des signatures validées par e-mail ;
- exporter vos listes au format .csv.

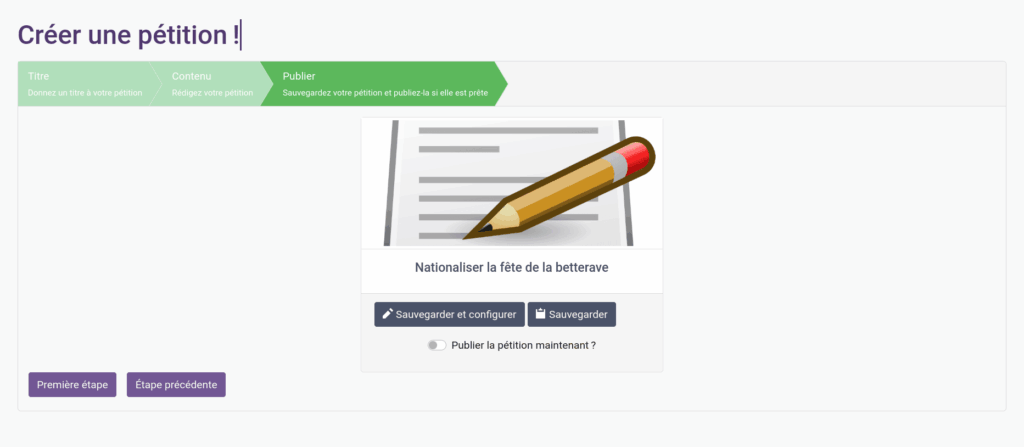
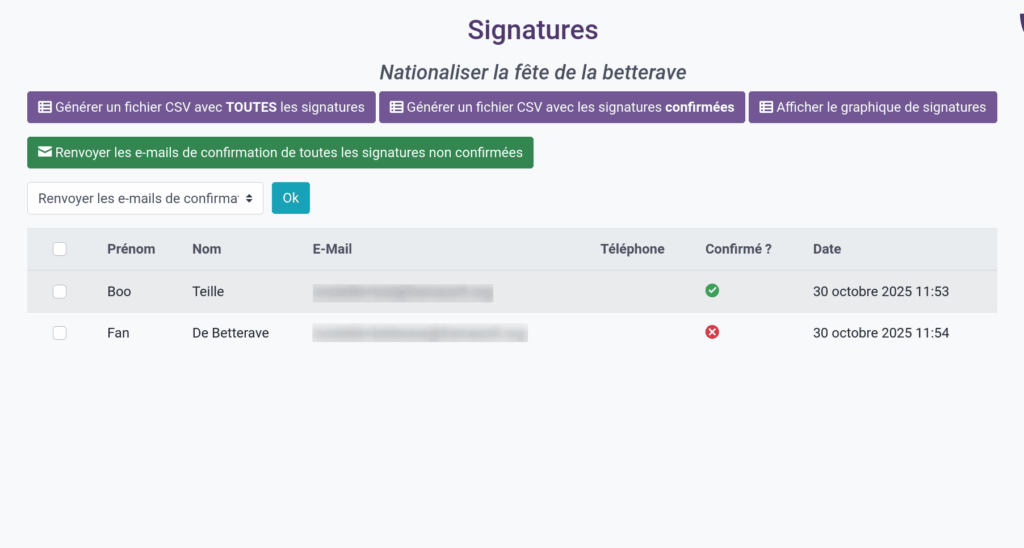
Nous espérons que ce nouveau service vous aidera dans vos mobilisations.
Et, avec votre soutien, nous pourrons l’améliorer encore en 2026 : nouveaux thèmes, ajouter ou masquer des champs, outils d’amplification, aides à la rédaction, etc. Les idées ne manquent pas !
Essayer Framapetitions sans oublier de Soutenir Framasoft
🌱 Et d’autres nouveautés à venir en 2026 !
Évidemment, vos dons ne se limitent pas à financer les projets de cette fin d’année. Nous avons aussi des projets pour 2026. La liste qui suit est volontairement non-exhaustive, et surtout non-engageante, car la loi de Murphy fait que nous ne sommes jamais sûr⋅es de rien 😅…
Mais nos envies sont nombreuses ! Il y a tout d’abord les mises à jour de nos projets actuels :
- Framaspace
- Nouvelles visites guidées et tutoriel interactif ;
- Possibilité pour les admin·s d’afficher/masquer les applications dans le menu ;
- Nouvelles règles de gestion entre Framaspace et Paheko ;
- Intégration de nouvelles apps, dont Impersonate ;
- Mise à jour vers Nextcloud 32 (et sans doute plus) ;
- « Évangélisation » de Framaspace auprès des têtes de réseaux syndicales et associatives
- Intégration des boîtes à outils pour développeurs et développeuses IT-tools ou Networking Toolbox à Framatoolbox ;
- Mise à jour de notre application mobile de transcription Lokas ;
- Améliorations de Framapetitions ;
- Amélioration de la nouvelle version de Framadate ;
- Travaux ou mise à jour de nombreuses ressources (MOOC CHATONS, site Dégooglisons Internet, etc) ;
- Nouvelle version majeure de PeerTube ;
- Nouvelles fonctionnalités pour l’application mobile PeerTube ;
- Et, toujours, la mise à jour régulière de l’ensemble de notre infrastructure (environ 70 serveurs), et de notre vingtaine de services en ligne 💪

Cliquez sur l’image pour découvrir Framaspace – Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0
À cela s’ajoute la préparation de nouveaux projets (on insiste : il ne s’agit pas d’engagements fermes de notre part !) :
- migration de Framaforms vers le logiciel Liberaforms, déjà testable ici. Vu l’ampleur du travail demandé par un tel changement, nous le considérons quasiment comme un nouveau service ;
- mise en place et stabilisation d’un service Framadraw ;
- mise en place d’une alternative à Kahoot (sans doute basé sur le logiciel libre qui motorise Particify) ;
- mise en place d’un service web de transcription (en complément à Lokas, destiné elle uniquement aux smartphones) ;
- conception et mise en place de nouvelles portes d’entrée pour PeerTube ;
- de nouveaux ouvrages dans notre collection « Des livres en communs » ;
- et bien d’autres projets ambitieux, dont on vous garde la surprise pour 2026.
Sans oublier nos interventions, nos projets d’éducation populaire (comme UPLOAD, notre Université Populaire du Libre ou FramamIA), et nos initiatives plus légères comme Framaprout ou Framamèmes 💜.
Internet n’est pas (encore) à vendre, et c’est grâce à vous
Les services publics, les médias, la culture, le travail, les relations sociales, etc. passent désormais essentiellement par quelques infrastructures numériques privées (ce qui n’est pas sans risque) :
- YouTube devient le ministère mondial de la vidéo,
- Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram) le canal politique de fait,
- Uber le modèle économique du travail précaire….
Cette logique crée un Internet féodal (même si cette analogie est discutable) : chaque plateforme est un seigneur numérique, dont nous ne sommes que les vassaux, voire les serfs, dépendants de notre compte Gmail, de notre réputation numérique sur Instagram, de la bienveillance du seigneur-plateforme, qui édicte et modifie les lois de son royaume quand bon lui semble.
Cette « plateformisation » opère une privatisation du commun numérique. Internet nous a été, en quelque sorte, confisqué. Mais ce qui a été confisqué peut être repris ! ✊

S’unir contre les prédateurs du web, une allégorie –
CC-By David Revoy
En soutenant Framasoft, vous choisissez de remettre la technologie à sa place : le numérique est au service de l’humain, et non du capitalisme. Vous aidez à maintenir un Internet où la culture et le savoir peuvent se diffuser librement, où l’on partage des outils plutôt que de les monétiser. Vous offrez aux plus démunis l’accès à des services numériques respectueux, quand d’autres les en priveraient faute de rentabilité.

Nous estimons avoir besoin de récolter 250 000 € d’ici le 31 décembre pour pouvoir poursuivre et étendre nos actions en 2026. En date du 18 novembre 2025, il vous reste donc 42 jours pour vous mobiliser et nous soutenir.
En ouvrant cette campagne de dons 2025, nous faisons appel à toutes celles et ceux qui refusent de rester spectateur⋅ices du capitalisme de surveillance, de l’emmerdification d’internet. En faisant un don, vous choisissez le camp du commun et affirmez qu’un autre numérique est possible.
17.11.2025 à 07:42
Khrys’presso du lundi 17 novembre 2025
Khrys
Texte intégral (9167 mots)
Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour découvrir les informations que vous avez peut-être ratées la semaine dernière.
Tous les liens listés ci-dessous sont a priori accessibles librement. Si ce n’est pas le cas, pensez à activer votre bloqueur de javascript favori ou à passer en “mode lecture” (Firefox) ;-)
Brave New World
- World still on track for catastrophic 2.6C temperature rise, report finds (theguardian.com)
Fossil fuel emissions have hit a record high while many nations have done too little to avert deadly global heating

- Un humain sur quatre vit à moins de 5 km d’une infrastructure de pétrole, de gaz ou de charbon (geo.fr)
Environnement pollué, pillage économique… Vivre près d’une infrastructure liée aux combustibles fossiles n’est pas anodin. Une situation qui concernerait au moins deux milliards d’humains, soit environ un quart de la population mondiale, selon une carte détaillée.
- Avec son nouveau plan quinquennal, la Chine prend un pari très risqué (theconversation.com)
En adoptant en octobre le quinzième plan quinquennal du pays, Xi Jinping renforce le modèle dirigé par l’État, misant sur la technologie et la défense plutôt que sur la consommation des ménages.
- Une « guerre populaire contre le terrorisme » : comment la Chine sacrifie les Ouïghours depuis trois décennies (slate.fr)
Depuis les années 1990, sous prétexte d’une lutte antiterroriste menée sur tout son territoire, le pouvoir central chinois exerce une répression intense à l’encontre des minorités ethniques et religieuses, dans le Xinjiang (ou Turkestan oriental), dans le nord-ouest du pays. Avec même un coup de pouce de ses voisins comme le Kazakhstan et le Kirghizistan.
- Vietnam : le bambou plie vers le libre-échange (humanite.fr)
En quelques décennies, le pays de l’oncle Hô est devenu un pilier économique de l’Asie et un partenaire essentiel des superpuissances chinoise et états-unienne. Avec un rapide développement conquis sur le fil du capitalisme et du socialisme, le Vietnam doit dompter l’un pour conserver l’autre.
- Saudi Arabia’s Dystopian Futuristic City Project Is Crashing and Burning (gizmodo.com)
- Africa finally has its own drug-regulation agency — and it could transform the continent’s health (nature.com)
If it gets things right, the first major regulator of medicines to launch for 30 years could empower Africa to tackle African challenges around health and disease.
- Nigeria cancels mother-tongue teaching in primary schools and reverts to English (bbc.com)
The Nigerian government has announced it is cancelling a controversial policy that mandated the use of indigenous languages for teaching in the earliest years of schooling instead of English.
- Russia attacks ‘every district’ of Kyiv, sparking fires across Ukrainian capital (theguardian.com)
- Avec ces frappes très ciblées sur l’Ukraine, l’objectif de la Russie ne fait aucun doute (huffingtonpost.fr)
L’Ukraine subit de plus en plus d’attaques sur son réseau ferroviaire. Comme chaque hiver depuis 2022, ses infrastructures énergétiques sont aussi méthodiquement visées.
- Abstention : les personnes qui ne votent pas meurent plus tôt que celles qui votent (slate.fr)
Une étude finlandaise portant sur plus de trois millions de personnes sur vingt ans révèle un lien fort entre participation électorale et longévité. Les abstentionnistes présentent un risque de mortalité nettement plus élevé, même en tenant compte du niveau d’instruction et des revenus.
- La concentration des médias en Allemagne : la presse écrite (2/4) (acrimed.org)
- La concentration des médias en Allemagne : l’audiovisuel (3/4) (acrimed.org)
- CHAT CONTROL 2.0 THROUGH THE BACK DOOR – Breyer warns : “The EU is playing us for fools – now they’re scanning our texts and banning teens !” (patrick-breyer.de)
Patrick Breyer is sounding the alarm. Using a “deceptive sleight of hand,” a mandatory and expanded Chat Control is being pushed through the back door, in a form even more intrusive than the originally rejected plan. The legislative package could be greenlit tomorrow in a closed-door EU working group session.
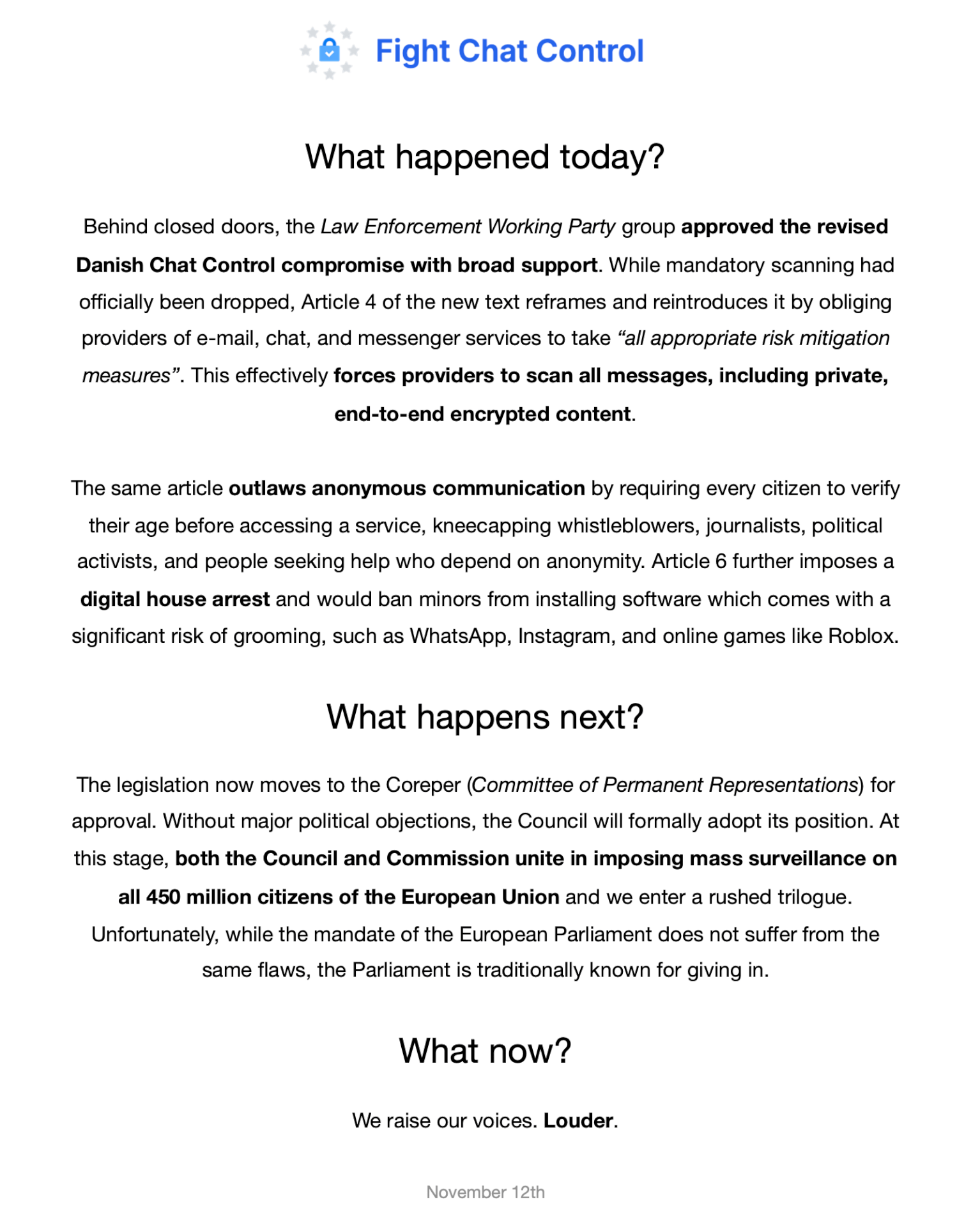
- Forthcoming Digital Omnibus would mark point of no return (edri.org)
127 civil society organisations and unions are urging the European Commission to halt its planned Digital Omnibus, warning that the proposals would weaken core EU laws like the GDPR and AI Act, and represent the biggest rollback of digital rights in EU history.
- Devoir de vigilance : la droite et l’extrême droite s’allient au Parlement européen et votent « l’omnibus » de la Commission (humanite.fr)
Le Parlement européen a voté le premier « Omnibus » poussé par la Commission européenne et les lobbies industriels. Une alliance des parlementaires de droite et d’extrême droite vient de mettre à bas le « devoir de vigilance » des grandes entreprises, leur laissant le champ libre pour violer les droits humains et détruire l’environnement.
- Au centre du jeu bruxellois, l’extrême droite sonne la charge contre l’écologie et le climat (multinationales.org)
Au Parlement européen, les députés RN et leurs alliés ont noué une alliance de fait avec la droite pour saborder les régulations et les objectifs du Pacte vert. Et ne rechignent pas – à rebours de leurs discours en France – à faire les yeux doux aux industriels et aux lobbys patronaux.
- Les cigognes et les goélands transportent des centaines de kilos de plastique depuis les décharges jusqu’aux zones humides d’Andalousie (theconversation.com)
- Royaume-Uni : sous la pression de l’extrême droite, Londres opère un tour de vis sur les droits des réfugié·es (huffingtonpost.fr)
Le gouvernement britannique a annoncé qu’il allait prendre des mesures « historiques » pour limiter les arrivées de migrant·es au Royaume-Uni.
- UK suspends some intelligence sharing with US over boat strike concerns in major break (edition.cnn.com)
The United Kingdom is no longer sharing intelligence with the US about suspected drug trafficking vessels in the Caribbean because it does not want to be complicit in US military strikes and believes the attacks are illegal
- Spéculer sur la catastrophe : la Jamaïque, les ouragans et les assureurs (blogs.mediapart.fr)
Comme les entreprises pétrolières, les sociétés d’assurance ont très tôt pris conscience des dégâts causés par le dérèglement climatique. Le coût des catastrophes atteint désormais des sommets. Les assureurs classiques commencent à déserter certaines zones : c’est le cas en Californie, en Floride, au Texas ou en Arizona…
- Six morts dans de nouvelles frappes américaines contre des narcotrafiquants présumés dans le Pacifique (la1ere.franceinfo.fr)
- Elon Musk Says Tesla Robots Can Prevent Future Crime (newsweek.com)
“If you say, like, you now get a free Optimus and it’s just gonna follow you around and stop you from doing crime, but other than that you get to do anything. It’s just gonna stop you from committing crime, that’s really it”
- Judith Butler : “L’université doit résister au chantage du gouvernement américain” (lesinrocks.com)
Le débat sur le campus, la recherche et l’enseignement sont désormais “glacés”, neutralisés : tout le monde intègre des formes d’autocensure nées de la peur, parfois même de la terreur.
- Trump Threatens BBC With Billion-Dollar Lawsuit For Correctly Pointing Out He Supported A Violent Insurrection (techdirt.com)
- ‘Explosive’ Epstein dump just exposed DOJ’s massive ‘cover-up’ for Trump : legal expert (rawstory.com)
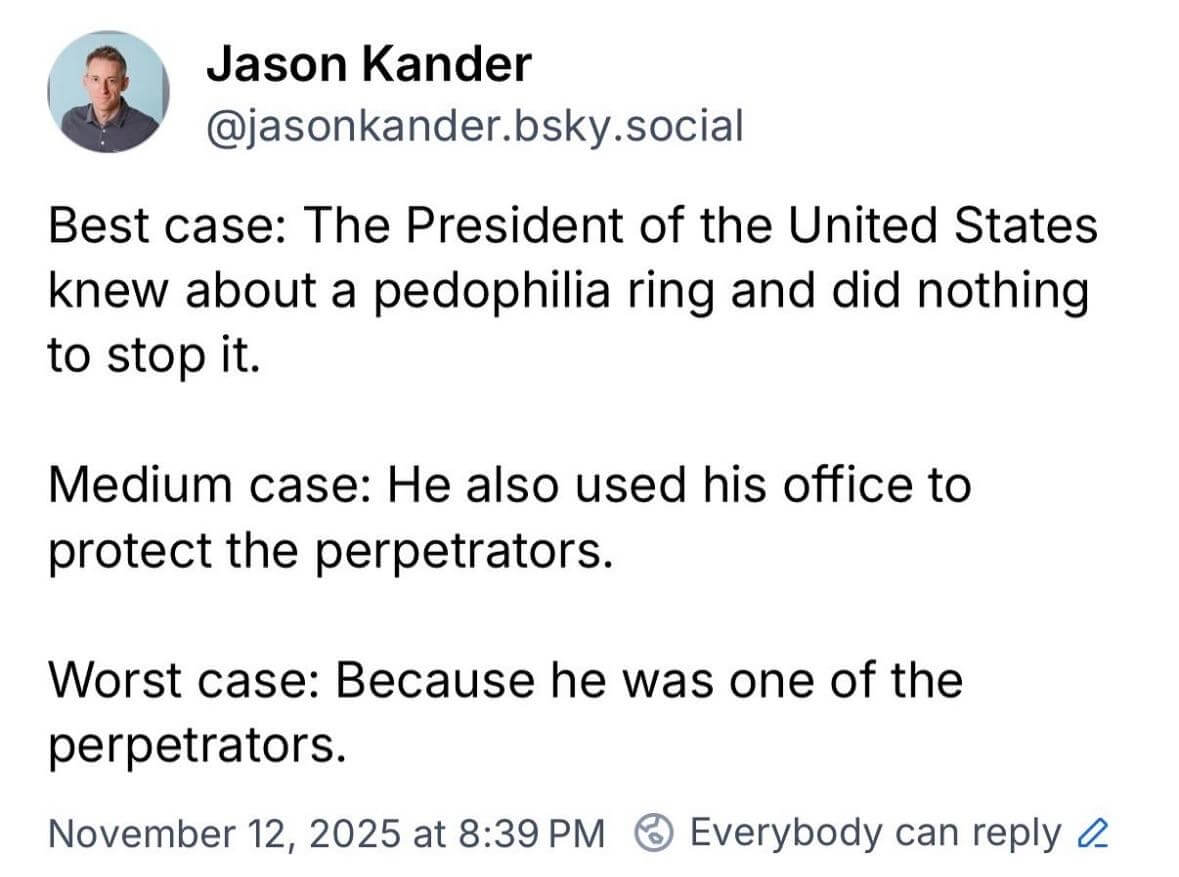
- House Dems Say Trump Is Hiding the Truth as New Epstein Emails Surface (truthout.org)
The emails suggest that Trump spent several hours with a victim of sex trafficking at one of Epstein’s residences.
- Chirurgies sans anesthésie, cordes vocales sectionnées : bientôt la fin des élevages de chiens de laboratoire ? (slate.fr)
En 2025, des millions de chiens sont encore élevés aux États-Unis dans de véritables « usines à chiots ». Des dizaines de milliers d’entre eux sont utilisés chaque année comme cobayes de laboratoires, sujets à des expérimentations souvent cruelles et douloureuses.
- Au Brésil, l’offensive de l’agrobusiness contre la COP30 (reporterre.net)
Alors que la COP30 débute aux portes de l’Amazonie, de riches propriétaires de terres assènent de fake news le débat sur la déforestation.
Voir aussi TotalEnergies dans la délégation officielle à la COP30 : « business as usual » pour la diplomatie française (multinationales.org)

- En Amazonie, les terres des descendant·es d’esclaves accaparées par de riches propriétaires (reporterre.net)
- Indigenous activists storm COP30 climate summit in Brazil, demanding action (aljazeera.com)
“We can’t eat money,” […]“We want our lands free from agribusiness, oil exploration, illegal miners and illegal loggers.”
- COP30 : Taxer les billets d’avion business class et les jets privés, l’idée fait son chemin (huffingtonpost.fr)
À la COP30, plusieurs pays soutiennent désormais une taxe sur la business class et les jets privés pour financer l’action climatique.
- Le mystère des 5.200 trous vieux de plusieurs siècles retrouvés dans les Andes péruviennes enfin résolu (slate.fr)
Près de cent ans après sa découverte, les scientifiques font la lumière sur le mystérieux site de Monte Sierpe. Il serait un haut lieu de commerce et de collecte des tributs et redevances.
- Sun unleashes strongest solar flare of 2025, sparking radio blackouts across Africa and Europe (space.com)
- An explosion 92 million miles away just grounded Jeff Bezos’ New Glenn rocket (arstechnica.com)
The second flight of Blue Origin’s New Glenn rocket was postponed again Wednesday as a supercharged wave of magnetized plasma from the Sun enveloped the Earth, triggering colorful auroral displays and concerns over possible impacts to communications, navigation, and power grids.“NASA is postponing launch until space weather conditions improve.”
- Unique shape of star’s explosion revealed just a day after detection (eso.org)
Swift observations with the European Southern Observatory’s Very Large Telescope (ESO’s VLT) have revealed the explosive death of a star just as the blast was breaking through the star’s surface. For the first time, astronomers unveiled the shape of the explosion at its earliest, fleeting stage. This brief initial phase wouldn’t have been observable a day later and helps address a whole set of questions about how massive stars go supernova.
Voir aussi Scientists watch supernova shockwave shoot through a dying star for 1st time (space.com)
The supernova was the death of a red supergiant star 500 times larger than the sun, in a galaxy just 22 million light-years away.Scientists have captured the moment the shockwave of a supernova explosion breaks out through the surface of a doomed star for the first time, revealing what appears to be a surprisingly symmetrical detonation.
Spécial IA
- OpenAI a enfreint les droits d’auteur de chansons, selon la justice allemande (franceinfo.fr)
- OpenAI fights order to turn over millions of ChatGPT conversations (reuters.com)
The artificial intelligence company argued that turning over the logs would disclose confidential user information
- La Commission européenne prévoit d’affaiblir le RGPD au profit des entreprises d’IA (next.ink) – voir aussi EU Commission internal draft would wreck core principles of the GDPR (noyb.eu)
the Commission proposes changes to core elements like the definition of “personal data” and all data subject’s rights under the GDPR. The leaked draft also suggests to give AI companies (like Google, Meta or OpenAI) a blank check to suck up European’s personal data. In addition, the special protection of sensitive data like health data, political views or sexual orientation would be significantly reduced. Also, remote access to personal data on PCs or smart phones without consent of the user would be enabled.
Et Affaiblissement du RGPD : l’Allemagne l’inspire, la France y est opposée « à ce stade » (next.ink)
- Don’t install Atlas AI browser – here’s why (tuta.com)
OpenAI’s Atlas browser with built-in ChatGPT is marketed as being a step closer to a ‘true super-assistant,’ but it’s more like a true privacy nightmare. Let’s take a look at why ChatGPT Atlas browser must be avoided.
- Wikipedia urges AI companies to use its paid API, and stop scraping (techcrunch.com)
- Forget AGI—Sam Altman celebrates ChatGPT finally following em dash formatting rules (arstechnica.com)
this “small win” raises a very big question : If the world’s most valuable AI company has struggled with controlling something as simple as punctuation use after years of trying, perhaps what people call artificial general intelligence (AGI) is farther off than some in the industry claim.
- Anthropic to spend $50 billion on U.S. AI infrastructure, starting with Texas, New York data centers (cnbc.com)
- Anthropic details how it measures Claude’s wokeness (theverge.com)
The move comes as the White House pressures AI companies to make their models less ‘woke.’
- Yann LeCun va quitter Meta en désaccord sur la stratégie de R&D de l’entreprise (next.ink)
la récente reprise en main des recrutements sur l’IA par Mark Zuckerberg semble avoir donné une direction que le Français ne veut pas suivre. En effet, depuis cet été le CEO de Meta a redirigé toutes les forces de R&D dans la création d’un laboratoire dédié à la « superintelligence » en s’appuyant sur les modèles génératifs dérivés des LLM.
- Dérégulation de l’IA ? Pas vraiment ! (danslesalgorithmes.net)
- AI Jesus ? New Technologies, New Dilemmas for Church Leaders (balkaninsight.com)

- AI-Powered Toys Caught Telling 5-Year-Olds How to Find Knives and Start Fires With Matches (futurism.com)
researchers from the US Public Interest Research Group found that the playthings can easily verge into risky conversational territory for children, including telling them where to find knives in a kitchen and how to start a fire with matches. One of the AI toys even engaged in explicit discussions, offering extensive advice on sex positions and fetishes.
Voir aussi Intelligent toys, complex questions : A literature review of artificial intelligence in children’s toys and devices (journals.sagepub.com)
- Que sont les « TRM » (Tiny Recursive Models) ? Après les LLM, comprendre la future révolution de l’IA (legrandcontinent.eu)
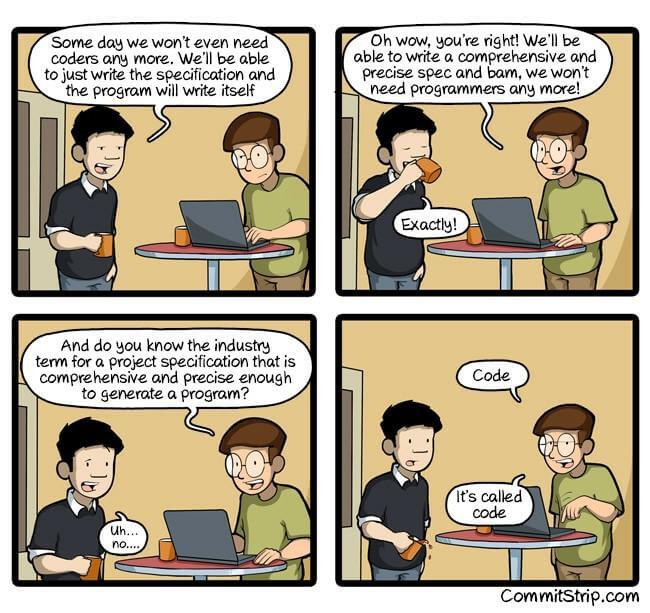
Spécial Palestine et Israël
- Israel’s underground jail, where Palestinians are held without charge and never see daylight (theguardian.com)
Detainees at Rakefet include nurse deprived of natural light since January, and teenager held for nine months
- « Israël ne cherche pas à infliger la peine de mort aux “terroristes” mais seulement aux Arabes » : un projet de loi réhabilitant l’échafaud approuvée en première lecture à la Knesset (humanite.fr)
- En Cisjordanie, l’inquiétante flambée de violence des colons israéliens contre les Palestinien·nes (huffingtonpost.fr)
Les données de l’ONU sur les attaques de colons israéliens montrent un niveau de tensions jamais vu depuis une vingtaine d’années dans ce territoire palestinien.
- Cisjordanie : deux adolescents palestiniens abattus, une mosquée incendiée, les violences des colons et de l’armée se multiplient (humanite.fr)
- Emmanuel Macron change d’avis sur la présence d’entreprises israéliennes au salon Milipol (huffingtonpost.fr)
Ces entreprises pourront participer au salon Milipol Paris. Une décision qui « a pour objectif de contribuer à un dialogue constructif avec les autorités israéliennes », assume l’Élysée.”assume”
- Collège de France : un colloque sur la Palestine censuré (politis.fr)

- Palestine au Collège de France : la protestation de François Héran (blogs.mediapart.fr)
Titulaire de la chaire « Migrations et sociétés » au Collège de France, François Héran rend publique la lettre qu’il a adressée à son administrateur, Thomas Römer, à propos de l’annulation du colloque sur la Palestine de son collègue Henry Laurens.
Spécial femmes dans le monde
- High Court hears challenge over single sex toilet guidance (bbc.com)
The High Court has been hearing a legal challenge to the equality watchdog’s guidelines on what public or workplace toilets transgender people should use.

- Présidentielle au Chili : les féministes au front pour défendre la démocratie (basta.media)
L’élection présidentielle au Chili, dimanche 16 novembre, portera au pouvoir une femme de gauche ou un homme d’extrême droite. Sur le terrain, les féministes serrent les rangs et occupent l’espace public pour les droits de toutes les femmes.
- Women Are Refusing To Be In Relationships With Men In Record Numbers, And This Is The Brutal Truth Behind Why (buzzfeed.com)
- MAGA contre les femmes : la « Grande Féminisation » selon la trumpiste Helen Andrews (legrandcontinent.eu)
La néo-réaction est violemment misogyne — et elle fait porter son discours par des femmes.
- La quête de « l’utérus artificiel » : entre fiction et avancées de la recherche (theconversation.com)
Spécial France
- Kanaky Nouvelle-Calédonie : l’exécutif entend passer en force avec un référendum sur l’accord de Bougival (humanite.fr)
La ministre des outre-mer, Naïma Moutchou a annoncé ce vendredi la tenue d’une « consultation citoyenne anticipée » sur le projet d’accord de Bougival au terme de son déplacement en Kanaky Nouvelle-Calédonie.
- Les partisan·es d’une gauche unitaire ont acté une primaire à l’automne 2026 pour choisir un·e candidat·e commun·e en 2027. Mais sans le soutien de Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon. (huffingtonpost.fr)
- Des aurores boréales observées en France et d’autres à venir (meteo-paris.com)
- Que-Choisir tire la sonnette d’alarme sur les chargeurs vendus par Shein et Temu (next.ink)
Sur les 54 chargeurs achetés (27 sur chaque plateforme), seuls 2 (un de chaque plateforme) respectaient les normes européennes. 21 ne possédaient pas certains marquages obligatoires comme le logo CE ou l’unité de tension. Surtout, 51 n’ont pas résisté aux contraintes mécaniques imposées, avec des résultats variés : broches tordues ou tournées trop facilement, boitier cassé après une chute…
- Après Shein, six autres plateformes signalées par le gouvernement à la justice (huffingtonpost.fr)
Après Shein, les plateformes AliExpress, Joom, eBay, Temu, Wish et Amazon ont été signalés à la justice. Certaines vendaient des poupées pédopornographiques.
- L’entreprise d’acier rapide Erasteel, annonce la suppression de 190 postes sur 244, soit 78 % de ses effectifs (humanite.fr)
Un plan de suppressions d’emplois visant 78 % des salariés de l’entreprise historique Erasteel est prévu à Commentry, dans l’Allier. Une décision vivement critiquée par l’ensemble de la population. Un rassemblement de soutien rassemblant salariés, habitants et politiques est prévu ce jeudi.
- Doctolib, ce monopole qui ne dérangeait (presque) personne (cafetech.fr)
- Amende de 7,6 millions d’euros : le Groupe Parfait conteste la décision de l’Autorité de la concurrence (la1ere.franceinfo.fr)
- Élevage intensif : le gigantisme existe aussi en France, montre L214 (reporterre.net)
- TGV complets, billets hors de prix : pourquoi prendre le train est devenu une galère (reporterre.net)
- Vivez-vous dans un îlot de chaleur ? La carte des villes concernées (reporterre.net) – voir aussi Cartographie de l’effet d’îlot de chaleur urbain (meteofrance.com)
- « On se sent méprisés » : à Toulouse, un projet d’usine de paracétamol ravive la peur d’un nouvel AZF (reporterre.net)
À Toulouse, la start-up Ipsophène s’apprête à installer une usine de paracétamol à quelques pas du centre-ville. Vingt-cinq ans après la catastrophe d’AZF, le projet d’un nouveau site classé Seveso alarme les riverains.
- « Je me réveille très souvent la nuit parce que mes bras me grattent » : les conditions de travail des agent·es de nettoyage pointées du doigt par une étude de l’Anses (humanite.fr)
Un rapport de l’Anses publié ce jeudi 13 novembre pointe du doigt les conditions de travail et la précarité des agent·es de nettoyage en France, souvent invisibilisé·es.
- Anses : pourquoi le directeur général, qui s’était opposé à la loi Duplomb, n’a pas été renouvelé à la tête de l’agence (humanite.fr)
Spécial femmes en France
- « C’est honteux ! Vous ne vous rendez pas compte » : Yaël-Braun Pivet tance le sexisme d’un député UDR contre Sandrine Rousseau (lavoixdunord.fr)
« Ce n’est pas acceptable. Je vous rappelle à l’ordre immédiatement, c’est insupportable et honteux », a-t-elle haussé le ton, ajoutant qu’elle venait aussi de prendre deux autres rappels à l’ordre concernant d’autres interventions à l’encontre de Sandrine Rousseau, pendant les débats sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Précisément, il s’est agi des députés RN Laurent Jacobelli et Kévin Pfeffer, qui avaient crié dans l’hémicyle : « Sandrine, prends un cachet ! Sandrine, tu vas craquer ! ». « Elle est complètement dingue. » « Elle est complètement siphonnée. » Des propos retranscrits au compte rendu de séance du jeudi 30 octobre 2025. « Je ne tolérerai aucune attaque sexiste dans cet hémicycle. C’est fini. C’est fini »
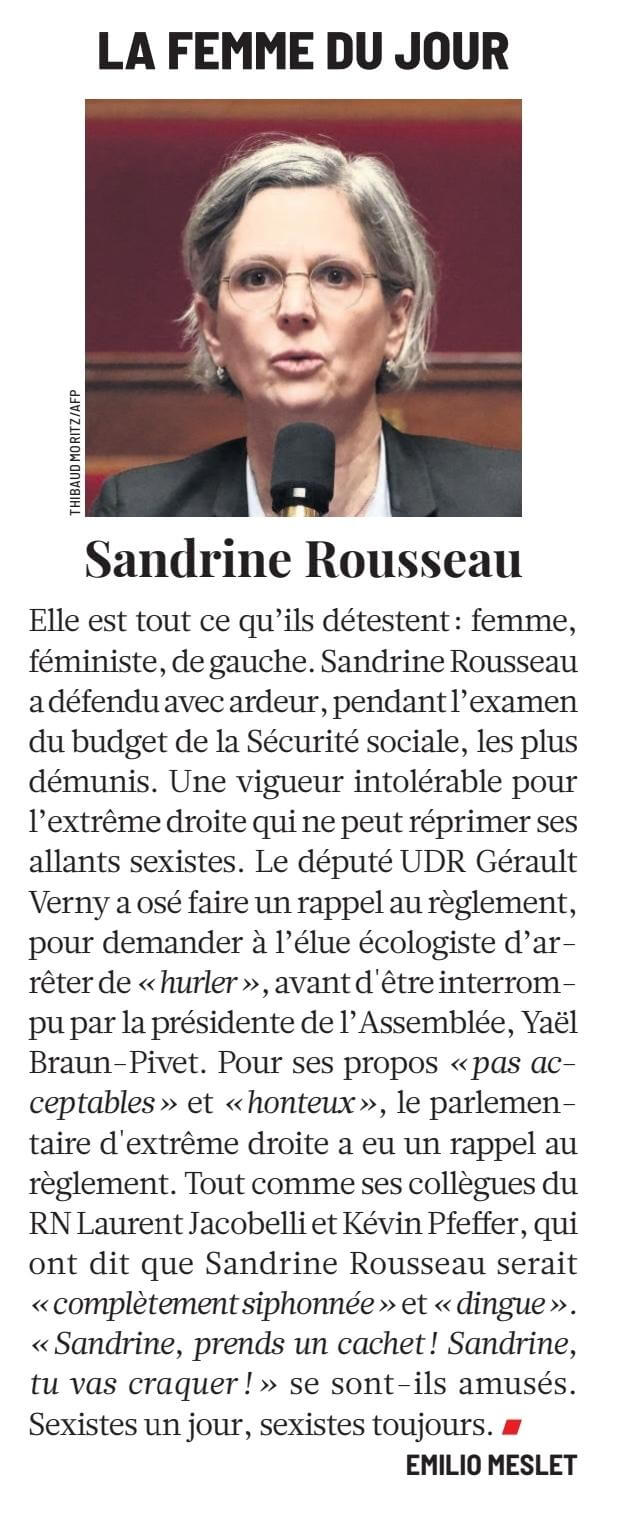
- « Petite instit bornée » : les propos d’Éric Neuhoff dans la matinale de France Inter (mediateur.radiofrance.com)
Ce mercredi 12 novembre, les auditeurs ont été très nombreux à nous écrire après l’interview d’Éric Neuhoff dans le 7h50 de France Inter. Au cours de cet entretien, le nouvel académicien a qualifié la linguiste Julie Neveux de « petite instit bornée ». Les messages reçus expriment une très forte indignation. Les auditeurs dénoncent unanimement le caractère sexiste et condescendant de cette expression, qui rabaisse non seulement une chercheuse reconnue et habilitée à diriger des recherches à Sorbonne Université mais aussi les professeurs des écoles.
- « Vous nous cassez les oreilles madame », « petite instit bornée » : ils font du bruit pour faire taire les femmes (lesnouvellesnews.fr)
Dénigrer les femmes qui s’expriment en public reste un moyen courant de décourager celles qui voudraient prendre la parole.
- Face au pétromasculinisme, une paysannerie écoféministe (terrestres.org)
- Muselées sur les réseaux sociaux, les féministes vont se faire voir et entendre ailleurs (lesnouvellesnews.fr)
En interprétant avec un zèle suspect un règlement européen, les plateformes boutent hors de la Toile bien des messages féministes.
- Désolé messieurs, les femmes ont un système immunitaire bien plus costaud que le vôtre (slate.fr)
Des décennies de recherche le confirment : les chromosomes et les hormones confèrent aux femmes une immunité plus efficace. Mais alors pourquoi la médecine continue-t-elle d’ignorer ces différences fondamentales ?
Spécial médias et pouvoir
- Haine, complotisme… Le Conseil d’État recadre CNews (politis.fr)
- Désinformation climatique : CNews condamnée à une amende inédite de 20 000 euros par l’Arcom (humanite.fr)
- Semaine noire pour la presse indé : Ballast et Equal Times mettent la clé sous la porte (portail.basta.media)
La presse indépendante pleure la disparition de deux médias cette semaine : la revue franco-belge Ballast et le média trilingue Equal Times ont tous deux annoncé l’arrêt de leurs publications. Mais si l’un d’eux est choisi, l’autre est subi.
- Pourquoi tant de médias ne protègent-ils pas leurs fixeurs ? (blogs.mediapart.fr)
Dans l’ombre des reporters de guerre, il y a eux : les fixeurs. Ces journalistes locaux, traducteurs, guides, producteurs de terrain, prennent tous les risques pour que l’information circule depuis les zones de conflit. Et pourtant, les médias qui dépendent d’eux les laissent trop souvent sans protection ni reconnaissance.
- Sur Radio Nova, cette blague sur la police n’a pas (du tout) fait rire Laurent Nunez qui porte plainte (huffingtonpost.fr)
Radio Nova a défendu ce samedi 15 novembre la « liberté d’expression » et prévenu qu’elle « n’acceptera aucune menace » après la plainte du ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez contre l’un de ses humoristes, Pierre-Emmanuel Barré, qui avait comparé, dans une chronique humoristique, les forces de l’ordre à l’organisation État islamique.

Spécial emmerdeurs irresponsables gérant comme des pieds (et à la néolibérale)
- Le gouvernement a annoncé dans la soirée de ce jeudi 13 novembre que l’Assemblée nationale, qui vient tout juste de reprendre l’examen sur le projet de loi de finances, ne siégera finalement pas ce week-end comme prévu. (huffingtonpost.fr)
- « De la poudre de perlimpinpin » : le Sénat dézingue la suspension de la réforme des retraites (huffingtonpost.fr)
- Vous ne comprenez plus rien aux débats sur les budgets ? On vous résume le casse-tête actuel (huffingtonpost.fr)
Dans un calendrier toujours plus resserré, il ne reste plus qu’un gros mois aux parlementaires pour se prononcer sur le budget de l’État et de la Sécurité sociale.
- Nicolas Sarkozy est sorti de prison sous contrôle judiciaire et a l’interdiction d’entrer en contact avec Gérald Darmanin (lemonde.fr) – voir aussi Nicolas Sarkozy libéré après seulement vingt jours de prison (humanite.fr)
Ce lundi 10 novembre, la cour d’appel de Paris a accepté la demande de remise en liberté de l’ancien président de la République, condamné en première instance dans l’affaire libyenne à cinq ans d’incarcération. Nicolas Sarkozy va quitter la prison de la Santé dans la foulée, en attendant son procès en appel prévu en mars.

- Budget de la Sécu : le syndicat de médecins MG France juge “ridicule” la mesure restreignant la durée des arrêts de travail (franceinfo.fr)
“Il faut quand même nous faire confiance. Ça veut dire qu’on arrête de façon inconsidérée pendant des mois des gens qui pourraient aller au boulot. C’est aberrant […] Est-ce que vous imaginez qu’un seul médecin généraliste va faire des arrêts de plusieurs mois par caprice à quelqu’un qui n’a rien ? On parle des patients qui ont des problèmes complexes, qui sont en difficulté”
- Loi contre la fraude fiscale et sociale : vers un nouveau « flicage des plus démunis » ? (rapportsdeforce.fr)
- Comment le PS savoure sa « victoire » sur la suspension de la réforme des retraites (huffingtonpost.fr)
- Les 4 raisons pour lesquelles le décalage de la réforme des retraites n’est pas une victoire (rapportsdeforce.fr)
- De moins en moins de fermes, de plus en plus grandes (et le Mercosur n’arrange rien) (basta.media)
Non seulement le nombre de fermes françaises diminue plus rapidement depuis le premier mandat d’Emmanuel Macron, mais elles deviennent intransmissibles. Seules les exploitations de plus de 200 hectares voient leur nombre augmenter.
Spécial recul des droits et libertés, violences policières, montée de l’extrême-droite…
- Relevés téléphoniques et fichier des compagnies aériennes : le Sénat veut permettre à France Travail de surveiller la vie privée des chômeureuses (humanite.fr)
- L’extrême droite britannique multiplie les raids racistes sur le littoral français (basta.media)
Les attaques de militants de l’UKIP visant des exilés se sont succédé ces derniers mois autour de Dunkerque, s’ajoutant à de nombreuses pressions. Des associatifs dénoncent le laisser-faire des autorités et craignent l’escalade.
- Libertariens et plus si affinités ? Chez les patrons français de la crypto, la tentation de l’extrême droite (multinationales.org)
- Le rapprochement des patrons avec l’extrême droite (et réciproquement) est chaque jour plus évident (humanite.fr)
- Le RN, parti des milliardaires (thomaspiketty.wordpress.com)
- Un attaché parlementaire RN derrière un compte néofasciste qui appelle à la chute de la République (streetpress.com)
Jean-Eudes Le Moulec est le collaborateur parlementaire de l’élu RN Antoine Villedieu. Il publie aussi pour les milliers d’abonnés du compte Conservateur punk des visuels néofascistes qui prônent la violence politique, voire l’appel au meurtre.
- La France est sortie de la démocratie (blast-info.fr)
- « À la Philharmonie de Paris, le public nous a littéralement lynchés » (politis.fr)
Jeudi 6 novembre, le collectif Palestine Action France a perturbé la tenue du concert de l’Orchestre philharmonique d’Israël à la Philharmonie de Paris. Des militants se sont fait violemment frapper par des spectateurs. Pour la première fois, une participante prend la parole pour expliquer sa version des faits.
Voir aussi Après les heurts à la Philharmonie, les mis·es en examen ripostent par une plainte (huffingtonpost.fr)
Les quatre personnes mises en examen après les incidents à la Philharmonie lors d’un concert de l’Orchestre philharmonique d’Israël dénoncent à leur tour des violences.
- Violences policières : un ex-policier condamné à un an de prison pour violences, trois agents relaxés (humanite.fr)
Les policiers de la brigade de proximité Quatre-Chemins de Pantin avaient été condamnés en 2023 pour violences et faux procès-verbaux entre 2019 et 2020. La peine la plus lourde était d’un an de prison ferme. Ce vendredi 14 novembre, la cour d’appel de Paris a condamné un des policiers à un an de prison ferme, tout en relaxant les autres accusés.
Spécial résistances
- La désobéissance civile est justifiée par la liberté d’expression sur l’urgence climatique (ldh-france.org)
- « Voter ce budget, c’est nous achever » : des malades du cancer protestent devant l’Assemblée nationale (reporterre.net)
- En grève de la faim depuis 14 jours, Vanessa Koehler réclame l’embauche de professeurs des écoles (revolutionpermanente.fr)
- Un mois de grèves et de luttes : octobre 2025 (blogs.mediapart.fr)
Chaque mois, nous vous proposerons une brève présentation des conflits qui se déroulent ou se sont déroulés dans la période en question, en France mais aussi à l’international. Voici octobre 2025.
- Des appels au boycott menacent la 53e édition du festival de bande dessinée d’Angoulême (france24.com)
Le festival de bande dessinée d’Angoulême, l’un des plus célèbres au monde, est en “danger de mort”, s’inquiètent lundi dans l’Humanité vingt lauréats du Grand prix. Cette alerte intervient alors que les appels au boycott de l’événement se multiplient après la reconduction de 9eArt+ comme organisateur.

Spécial GAFAM et cie
- Meta, Google et Apple dépensent des millions pour influencer la politique numérique européenne (siecledigital.fr)
- Visée par une amende géante de l’UE, Google propose des engagements pour éviter une scission (france24.com)
- FFmpeg to Google : Fund Us or Stop Sending Bugs (thenewstack.io)
it is unreasonable for a trillion-dollar corporation like Google, which heavily relies on FFmpeg in its products, to shift the workload of fixing vulnerabilities to unpaid volunteers. They believe Google should either provide patches with vulnerability reports or directly support the project’s maintenance.
- Amazon accusé à son tour de vendre des poupées pédopornographiques (huffingtonpost.fr)
L’ONG suédoise ChildX a porté plainte contre le géant américain pour vente de poupées sexuelles d’apparence enfantine. Deux autres plateformes sont aussi concernées.
- Apple révèle l’« iPhone Pocket », son nouvel accessoire hors de prix, et devient la risée d’Internet (huffingtonpost.fr)
Ce produit, dont le prix varie entre 159 et 249 euros, est jugé bien trop cher par les internautes. Ils n’ont pas été convaincus ni par son design ni par son utilité.
- Pourquoi Windows est un système d’exploitation médiocre et comment y remédier, selon cet ancien ingénieur de Microsoft (zdnet.fr)
- Hey, Microsoft : Are You Guys Also Cool With DHS And Trump Using ‘Halo’ Imagery For Fascism ? (techdirt.com)
- Elon Musk’s X botched its security key switchover, locking users out (techcrunch.com)
users of Elon Musk’s X are getting stuck in endless loops and, in some cases, getting locked out of their X account, following a mandatory two-factor security change that seems to have gone wrong.
Les autres lectures de la semaine
- The Opposite of Slop Politics (theatlantic.com)
Zohran Mamdani ran an online campaign based on real people and a real message. It worked.
- La Wayback Machine d’Internet Archive, outil d’investigation pour militants et chercheurs (zdnet.fr)
- Tanzanie : la fermeture de l’espace numérique, élément clé de la répression (theconversation.com)
- Et si Trump nous coupe Internet ? (ledevoir.com)
On rapportait la semaine dernière que le juge français Nicolas Guillou, détaché auprès de la Cour pénale internationale (CPI) était privé d’accès à Google, Amazon, Microsoft, PayPal, Visa ou Mastercard. Ce juge préside la CPI sur la situation en Palestine. Le gouvernement Trump lui reproche d’avoir inculpé des dirigeants israéliens pour crimes de guerre. En clair, on le punit comme un criminel notoire pour des gestes faits dans le cadre de ses fonctions de juge. Voilà une illustration des dangers de la dépendance à des infrastructures contrôlées par des entreprises qui s’aplaventrissent devant les diktats autoritaires du gouvernement Trump.
- États-Unis : Donald Trump a-t-il réussi le « coup d’État de Wall Street » ? (legrandcontinent.eu)
- Les États-Unis ont mené 41 changements de régime en Amérique latine au cours du XXe siècle (legrandcontinent.eu)
- L’affrontement sur la taxe Zucman : une lutte de classe ? (theconversation.com)
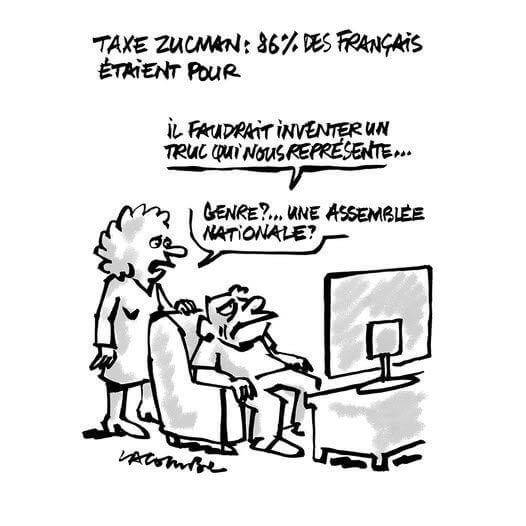
- Extractivisme : la guerre cachée de la transition écologique, une conversation avec Thea Riofrancos (legrandcontinent.eu)
Dans une enquête menée entre le Chili, le États-Unis, le Portugal et l’Espagne, la chercheuse Thea Riofrancos mène une réflexion cruciale sur les rôle des mines comme nouveaux nœuds stratégiques dans la géopolitique de l’ère post-carbone.
- MERCOSUR ou le capitalisme chimiquement pur (humanite.fr)
- The deepest South (aeon.co)
Slavery in Latin America, on a huge scale, was different from that in the United States. Why don’t we know this history ? Academia in the US emphasises what is basically a Global North and Anglocentric perspective on the history of modern slavery. […] US slavery was not especially peculiar. Africans and their descendants were enslaved across the entire western hemisphere, including in present-day Chile, Canada and Bolivia. Most enslaved Africans were transported to Latin America.
- Pierre Bonnard : Le peintre qui ne cessait jamais de retoucher ses tableaux (culturezvous.com – article de mars 2025)
Savez-vous ce que signifie « bonnardiser » ? On doit cette expression à Pierre Bonnard (1867-1947). Ce peintre français était connu pour son style impressionniste et ses couleurs vibrantes mais derrière la beauté de ses œuvres se cachait une obsession peu commune : il ne considérait jamais un tableau comme véritablement terminé. Cette manie l’a conduit à retoucher ses toiles même après qu’elles aient été exposées dans des musées ou vendues à des collectionneurs.
- The evolution of rationality : How chimps process conflicting evidence (arstechnica.com)
Chimps can take in new evidence, evaluate its strength, and change their minds.
- Dogs came in a wide range of sizes and shapes long before modern breeds (arstechnica.com)
- 3 œuvres pour questionner le spécisme et notre rapport aux animaux (reporterre.net)
- Pourquoi le XXIe siècle sera « le siècle des animaux » (theconversation.com)
- La Terre ne devrait pas exister : comment Jupiter a sauvé notre planète d’une mort précoce (slate.fr)
Les BDs/graphiques/photos de la semaine
- Les assistés (emmaclit.com)
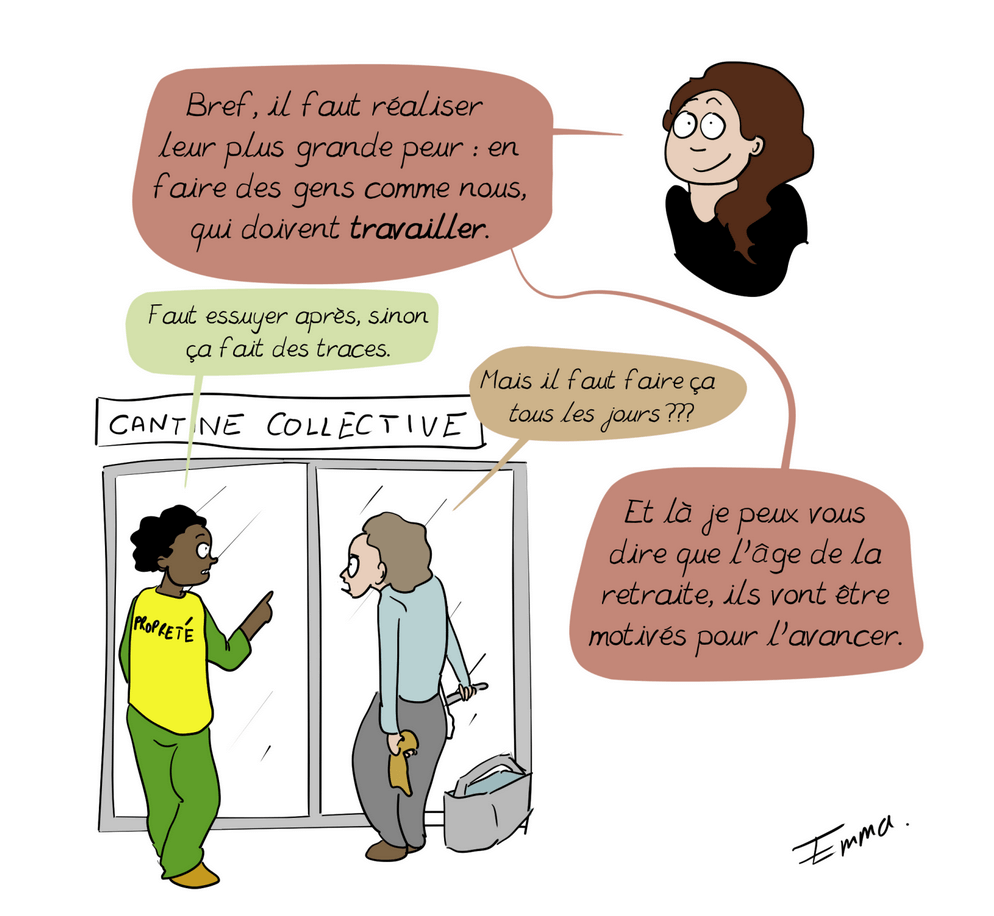
- Assemblée Nationale
- Idée
- Casse-toi
- Soulagement
- Plainte
- Femme du jour
- Débat
- State
- Work
- Gratuit
- Angoulème
- Cases
- Chat Control
- Cars
- Douceur
- Code
- AI peas
- Crypto
- Code
- Illusions
- Ink
Les vidéos/podcasts de la semaine
- RDC : Roger Lumbala jugé en France pour crimes contre l’humanité (humanite.fr)
- 8 minutes 46 chrono pour démonter l’arnaque sociale du Rassemblement national (humanite.fr)
- Extrême droite et audiovisuel public : une relation ambiguë ? (humanite.fr)
La journaliste Alix Bouilhaguet avait proféré en plateau plusieurs fausses et graves informations sur le nouveau maire de New York, Zohran Mamdani. Reprise par Manuel Bompard en direct, elle vient d’être désavouée, mollement, par la direction des deux médias publics. La CGT demande des excuses pour les auditeurices.
- Comment l’agro-industrie a infiltré les coopératives, entretien avec la journaliste Sophie Chapelle (splann.org)
- Colonialisme chimique (lagrappe.info)
En Algérie, au Vietnam, aux Antilles le colonialisme français a empoisonné les sols, les eaux, la faune, les végétaux, et les corps des colonisé·es pour des générations, après avoir détruit les écosystèmes locaux et imposé les plantations. Un podcast de l’émission Climat de luttes, diffusé sur la Clé des ondes.
- Parce que c’est NOTRE PROJET ! (allégorie SUISSE du restaurant) (tube.fdn.fr)
- Subvertir le male gaze – avec Azélie Fayolle (spectremedia.org)
- Internet, un géant très vulnérable (arte.tv)
- Des Fournisseurs d’accès à Internet éthiques, libres et militants ça existe, et il y en a près de chez vous ! (tube.fdn.fr)
- Why Your Vision of Ancient Rome Is All Wrong, According to Historian Mary Beard (openculture.com)
- De l’humus à la cime des arbres, un monde d’intelligences invisibles ! (radiofrance.fr)
Les trucs chouettes de la semaine
- New project brings strong Linux compatibility to more classic Windows games (arstechnica.com)
- L’Inspirothèque, une ressource en ligne évolutive de plusieurs centaines d’inspirations pour penser et concevoir un numérique plus écologique (inspirotheque.limitesnumeriques.fr)
- Des scientifiques ont créé un « tueur de cancer » 20.000 fois plus puissant (slate.fr)
Retrouvez les revues de web précédentes dans la catégorie Libre Veille du Framablog.
Les articles, commentaires et autres images qui composent ces « Khrys’presso » n’engagent que moi (Khrys).
16.11.2025 à 18:30
« Les cartes sont le nouveau livre », un nouvel ouvrage de Metacartes
Framasoft
Texte intégral (4155 mots)
Fidèles lecteurs du Framablog, vous connaissez déjà Mélanie et Lilian, les créateurs, entre autres, des Métacartes pour un Numérique Éthique. Ils nous présentent leur nouveau projet : un livre ! Mais rassurez-vous, les cartes ne sont pas très loin.
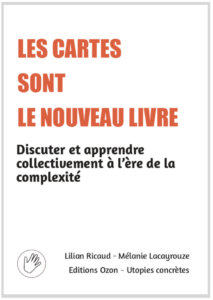
Couverture du livre
Mélanie, Lilian, voilà plusieurs années qu’on parle de vous sur le Framablog. Cependant, tout⋅es les lecteur⋅ices ne vous connaissent évidemment pas. Pouvez-vous vous présenter ?
Nous sommes un duo de facilitateurs, complètement cartomaniaques… Notre travail c’est d’aider les collectifs à mieux coopérer et pour cela nous nous marchons sur deux jambes : les pratiques d’animation/facilitation et les outils numériques (éthiques de préférence). On accompagne de nombreux collectifs dans leur démarche, des associations et des réseaux des divers milieux : des collectifs paysans, des acteurs l’économie sociale et solidaire, mais aussi des chercheur·e·s, enseignant·e·s, formateur·ice·s. Parfois on travaille avec elles·eux sur la conception et l’animation de réunions collaboratives, d’autres fois sur la mise en place d’outils numériques potentiellement collaboratifs. Nous disons bien « potentiellement » car, ce ne sont pas les outils qui font la coopération, mais ce que l’on en fait. Nous accompagnons donc sur la mise en place des outils mais en toujours partant des usages, avec l’idée de d’autonomiser les personnes avec qui nous travaillons. Nous partageons aussi un certain nombre de valeurs avec Framasoft, aider les individus et collectifs à s’émanciper notamment à travers l’usage d’outils conviviaux (on parle pas d’apéros, mais de la convivialité au sens d’Illich, c’est à dire augmenter le pouvoir d’agir sans recréer de dépendance), les licences libres, le partage sincère, les communs, l’éducation populaire, la solidarité… Bref, on se voit un peu comme une île d’un même archipel de communs.
Nous avons déjà pas mal parlé des Métacartes, mais aujourd’hui, nous souhaitons présenter votre nouvel ouvrage : « Les cartes sont le nouveau livre ». De quoi s’agit-il ?
Aujourd’hui, la plupart des gens ne connaissent les cartes que pour le coté jeux. Dans les milieux professionnels on les utilise de plus en plus et on parle maintenant beaucoup de jeux sérieux ou de ludopédagogie. C’est déjà très chouette, mais nous voulions montrer que les cartes comportent de nombreux avantages et permettent de nombreux autres usages.
Comme le livre, c’est un objet physique, tangible que l’on peut tenir dans sa main. Comme le livre, ces petits bout de papier sont porteurs de mémoire et d’information. Mais dans le livre la structure impose une lecture linéaire. Même si on peut survoler le livre pour lire des sections ici ou la, globalement, on commence au début et on finit par la fin.
Avec les cartes, c’est très différent : on peut consulter l’information de multiples manières. On peut les lire une dans l’ordre comme un livre, mais on peut aussi les explorer de manière très différente. On peut par exemple mélanger, distribuer, tirer ou retourner les cartes. Plus intéressant, on peut les organiser pour créer du sens. On peut trier, grouper, empiler, séquencer, ranger, comparer, combiner ou encore relier… Et le meilleur c’est que l’on peut faire seul, mais surtout à plusieurs ! Essaye de faire ça avec un livre ! De nombreux livres sur les étagères des librairies et des bibliothèques auraient probablement plus de valeur s’ils étaient des sets de cartes.
Pour nous les cartes représentent un livre dont les pages sont manipulables et ça, ça change tout ! Ce support transforme aussi la manière d’écrire. Quand tu as seulement 500 caractères, tu dois être concis. Comme le support est limité, plutôt que d’écrire de gros pavés tu dois éclater ton propos en plusieurs morceaux, c’est d’ailleurs ce que l’on fait lorsqu’on utilise une carte heuristique. Mais pour garder une cohérence, on peut aussi rédiger les cartes de manière à renvoyer vers d’autres cartes, comme des liens hypertextes.
D’ailleurs savais-tu que plus d’un siècle avant Google et Wikipédia, un précurseur avait utilisé de simples cartes papier pour bâtir un moteur de recherche et une encyclopédie pour faciliter un accès universel à la connaissance ? Il s’agit du travail de Paul Otlet dont l’influence perdure encore aujourd’hui dans de nombreux domaines. Certain affirment même qu’a travers son travail il inventé l’hypertexte !
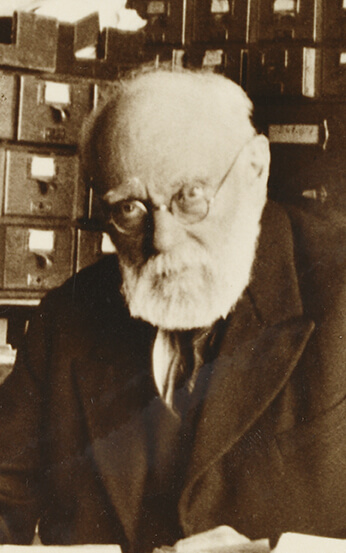
Paul Otlet à son bureau (Wikimedia)
Par ailleurs, les cartes sont peu coûteuses à produire, on peut les utiliser pour du design, de la pédagogie, pour créer des outils pédagogiques, des monnaies ou des récits… On peut aussi les augmenter avec des ressources numériques en ajoutant un qrcode comme nous l’avons fait pour les Métacartes ou bien en ajoutant une puce NFC. Dans le livre on donne de nombreux exemples.
Pour toutes ces raisons, nous pensons que les cartes représentent un support à part entière, un livre pour le XXIe siècle plus adapté à une pensée arborescente, interdisciplinaire et systémique.
Pouvez-vous nous en dire plus sur l’histoire de ce livre ? Comment est-il né ?
Lorsque nous avons développé les Métacartes, nous utilisions déjà des cartes « faites maison » pour nos propres besoins. Il nous semblait que ce support amenait quelque chose que les livres ou les outils numériques ne permettaient pas. Au début, c’était plutôt une intuition, mais au fil des années en travaillant beaucoup avec les cartes, nous avons mieux compris en quoi ce support permettait de nouveaux usages et une nouvelle façon de penser et de travailler.
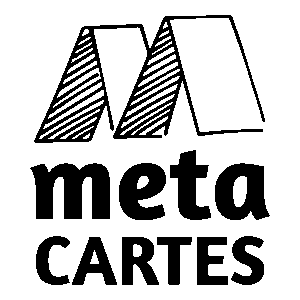
Le nouveau logo des metacartes
Nous publions de nombreuses ressources sur notre site, alors il y a un peu plus d’un an avait germé l’idée d’écrire un article pour partager nos dernières idées sur les usages des cartes. Puis, plus on creusait le sujet, plus l’article grossissait. Après de nombreux ajouts, ce qui n’était au départ qu’un article sur les usages est devenu un livre pour promouvoir ce support comme outil à part entière. L’article devait sortir en fin d’année dernière, puis en début d’année. Nous aurions pu nous précipiter pour sortir quelque chose dans les temps, mais nous croyons à la qualité et aux vertus du temps long. Nous avons donc continué à travailler sans précipitation jusqu’à ce que ce soit prêt et le livre est sorti au printemps. Pour l’instant au format électronique seulement, mais nous aimerions aussi proposer plus tard une version papier.
De même si au départ le livre focalisait essentiellement sur comment utiliser ces cartes, il nous a semblé important de questionner aussi le pourquoi. C’est à dire de ne pas simplement faire un manuel technique sur l’usage des cartes mais un ouvrage qui interroge le sens de ces usages.
À qui s’adresse ce livre ?
Peut-être que le premier public, ce sont les animateurices/facilitateurices de réunions, les médiateurices et les pédagogues. Parce que les cartes offrent de nombreuses opportunités pour concevoir des dispositifs basés sur la participation et la coopération, par exemple si tu veux transmettre un savoir, i.e. sur les enjeux liés à l’IA, tu peux choisir de donner une présentation descendante où tu donnes toutes les informations, les chiffres, … Mais tu peux aussi créer un set de cartes et créer une situation d’apprentissage où les apprenant·e·s explorent chacun·e quelques cartes et doivent ensuite échanger les unes avec les autres pour reconstituer une vision d’ensemble, reconstituer les liens entre les informations et le sens. C’est beaucoup plus reposant pour les formateur·ice·s qui peuvent se concentrer sur le cadre d’apprentissage au début, laisser les personnes explorer puis éventuellement ajuster et étayer à la fin. Et c’est surtout beaucoup plus puissant car les personnes sont impliquées dans la construction du savoir, elles bénéficient des apports les uns des autres, reformulent avec les propres mots…. Bref c’est de l’apprentissage coopératif et vivant !
C’est sur cette mécanique que s’appuie les ateliers de type « fresques » très en vogue aujourd’hui. Mais en fait il s’agit de la même mécanique que l’arpentage, technique reine de l’éducation populaire depuis de nombreuses années, et où on donne à chaque personne quelques pages d’un livre à lire avant de rediscuter à plusieurs ce qu’on a lu. La différence, c’est qu’avec les cartes, on n’a pas besoin de déchirer le livre pour distribuer des pages ;-)
Les cartes peuvent aussi intéresser des designers ou développeurs qui veulent échanger avec des utilisateurs, des parties prenantes. En plaçant des informations clés sur des cartes que l’on met en discussion, ça aide à structurer les échanges pour faciliter une vision et une compréhension commune.
Pour les auteurs il y a peut-être de nouvelles opportunités d’écriture et d’interactivité avec et entre les lecteurices.
Enfin nous pensons que ça intéressera tous les citoyen·nes et collectifs qui pensent que d’autres mondes sont à inventer. Pour nous les cartes constituent un support idéal pour partager de la connaissance et travailler avec des disciplines, des cultures et des points de vues différents.
Mais alors, question un peu provocatrice : en quoi le livre serait-il « dépassé » ?
Mais le livre n’est pas dépassé ! ! ! On adore les livres ! ! ! En fait on a même une bibliothèque dans chaque pièce de notre maison !
En fait notre propos c’est de dire que si le livre représente un support génial pour partager de l’information et dérouler un raisonnement ou un point de vue de manière linéaire, il reste aussi fondamentalement limité quand il s’agit d’explorer des sujets complexes avec plusieurs perspectives. Cela peut sembler anecdotique, mais c’est un vrai enjeu.
Par exemple, dans un livre ou tout autre support linéaire, on déroule habituellement un raisonnement à travers la méthode qu’on appelle la dialectique. C’est à dire qu’on fait une proposition (une « thèse »), une contre proposition (une « anti-thèse ») et un mix (synthèse) qui dépasse cette opposition. En théorie ça devrait donner un résultat « objectif » et raisonnable.

Six aveugles examinent un éléphant (Wikimédia)
Mais en pratique, il existe plein de cas où de multiples points de vue peuvent coexister sans que l’un soit plus vrai que l’autre. C’est l’idée de la fable des aveugles et l’Éléphant. Dans cette fable six aveugles doivent décrire un éléphant, chacun touchant seulement une partie de son corps, ce qui les amène à avoir des représentations partielles et différentes de l’animal. Lorsqu’ils confrontent ensuite leurs idées, ils entrent en désaccord, doutent même de la sincérité de leurs interlocuteurs et, dans certaines versions, en viennent aux coups. La morale de l’histoire est que chaque humain a tendance à revendiquer une vérité absolue fondée sur son expérience subjective limitée, car il ignore les expériences subjectives limitées des autres, qui peuvent être également véridiques. Cette vision en silos pose de nombreux problèmes.
On voit bien aujourd’hui que la société accélère avec la sensation qu’on va dans le mur de plus en plus vite et de manière inéluctable. Pour nous un des problèmes majeurs, c’est qu’on fonctionne avec une pensée en silo : quand on aborde un sujet, on a tendance à traiter ce sujet séparément de tous les autres. Par exemple quand on parle de numérique, on l’abordera généralement uniquement à travers le prisme technique. Ça pose un gros problème parce que le numérique n’est pas une question isolée. C’est relié à des enjeux énergétiques, environnementaux, sociaux, politiques. Comme le sujet est complexe, il n’y a pas une seule bonne description, ni une seule bonne réponse aux enjeux. De même la plupart des crises auxquelles nous faisons face sont entremêlées. C’est super dur de changer ça, parce qu’il faudrait faire appel à plusieurs disciplines qui ne parlent pas le même langage et ne se comprennent pas. Alors comment on fait pour détricoter tout ça ? Et surtout comment on fait pour se mettre d’accord sur des façons d’agir collectivement ?
Nous, on pense qu’il y a donc un enjeu essentiel aujourd’hui à relier les disciplines et aussi à sortir de la dichotomie et de l’opposition entre des points de vue binaires. Il ne s’agit pas juste de choisir entre un pour ou contre, mais de pouvoir explorer des tierces voies où tout n’est pas tout blanc ou tout noir. Par exemple il ne s’agit pas seulement de choisir entre être pour ou contre le numérique, mais plutôt explorer quel numérique nous voulons choisir ou inventer.
Et comme avec l’éléphant, selon le point de vue d’où on observe, on ne voit pas la même chose. Pour trouver des solutions, il nous donc faut arriver à intégrer les multiples points de vue pour obtenir une vision qui s’approche de la réalité. Ceci implique de pouvoir intégrer une diversité point de vues, faire discuter des acteurs différents, interroger collectivement le sens et les finalités de nos choix… Et ça c’est super difficile avec juste des discussions orales ou des supports linéaires comme les livres ! À l’inverse les cartes heuristiques numériques ou des cartes papiers qui jouent le même rôle peuvent nous aider à explorer plusieurs pistes prometteuses en parallèle et pas à devoir choisir juste l’une ou l’autre.
C’est ça que l’on essaye de montrer dans le livre : les cartes sont un support super polyvalent. Comme le web, elles mettent l’information en réseau et ça, ça permet de changer nos manières de penser et de mieux comprendre la complexité du monde.
Vous avez placé votre epub sous licence Creative Commons BY-SA (comme les Métacartes, d’ailleurs), et nous vous remercions chaleureusement d’enrichir les Communs de ces belles contributions ! Qu’est-ce qui vous a poussé à le faire ?
Oui, comme à notre habitude, le livre est sous licence libre et a été conçu avec des logiciels libres. Ce partage sincère est une de nos valeurs clé et c’est un point très important pour nous que nous présentons dans notre manifeste.
Si tu regardes le modèle de pensée actuel dans nos sociétés, c’est de considérer la nature et les Humains comme des ressources et des objets que l’on peut exploiter sans limites. Et d’un autre côté on traite la connaissance comme une ressource limitée et précieuse qui doit être protégée des exploitations via des brevets, des monopoles. Nous, on trouve que ce monde marche sur la tête et on veut renverser ce modèle.
On pense que la connaissance est une ressource illimitée que l’on doit partager pour le bien de tous et que les Humains et les écosystèmes doivent être considérées non pas comme des objets, mais comme des sujets, des acteurs précieux dont nous devons prendre soin et protéger des exploitations, en cultivant leur pouvoir d’agir.
Comme le dit Laurent Marseault « Y’a le feu » et on est tous dans le même bateau, alors plus que jamais, il y a urgence à partager des solutions.
Du coup, quelles sont vos attentes concernant cet ouvrage ?
Monter un fan club cartomaniaque et conquérir le monde ! ! ! Plus sérieusement, montrer que le linéaire, c’était utile, mais que ça ne suffit plus et faire comprendre que pour une compréhension systémique des problématiques et des solutions / freins et leviers, le médium « cartes » est une géniale solution. La Pléiade peut-être pas, mais si un éditeur voulait nous aider sur une publication papier pourquoi pas. Et puis enfin on aimerait aussi bien travailler avec des collectifs, asso ou autres, qui partagent nos valeurs, les accompagner à créer leurs propres sets de cartes en s’appuyant sur les outils et les méthodes que nous avons développés ces dernières années.
Merci infiniment ! Avant de vous laisser, pouvez-vous nous partager quelles sont vos prochaines envies, les projets qui vous motivent actuellement ? Et surtout : comment soutenir votre travail ?
Notre actu : la nouvelle édition Faire Ensemble, qui ne rend pas la précédente obsolète, mais on a augmenté de 10 cartes la boite à outils et amélioré la prise en main, à lire ici
Et pour donner encore plus envie de faire évoluer les réunions on a fait des affiches (reliées aux cartes) pour avoir des outils inspirants dans l’espace commun.
Ce qui me motive (Mélanie) pour 2026 : bosser des scénarios pédagogiques pour mener des espaces de discussions autour de l’éthique dans le numérique, relier nos publics entre les « convaincus » qui ont besoin de mode d’emploi pour animer des ateliers sur le sujet et tous cell.eux qui savent mobiliser et faire vivre ces moments mais n’abordent pas encore le thème des usages numériques (ou pas de façon systémique). On aimerait organiser des résidences pour cela et on cherche des financements pour pouvoir le faire mener à bien.
Ce qui me motive (Lilian) en ce moment c’est de continuer à explorer l’usage des cartes pour créer des outils favorisant l’interopérabilité et la coopération entre des collectifs. D’ailleurs j’en profite pour faire un peu de pub. L’an dernier j’ai eu une bourse d’une petite maison d’édition indépendante bien sympa pour écrire un livre qui devrait paraître début 2026. Ça devrait s’appeler « Les Archipels de communs, vers une société de la coopération ouverte et du partage », à paraître aux éditions « Des Livres en communs ».
Merci à Mélanie et Lilian pour la présentation de ce livre.
10.11.2025 à 07:42
Khrys’presso du lundi 10 novembre 2025
Khrys
Texte intégral (9253 mots)
Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour découvrir les informations que vous avez peut-être ratées la semaine dernière.
Tous les liens listés ci-dessous sont a priori accessibles librement. Si ce n’est pas le cas, pensez à activer votre bloqueur de javascript favori ou à passer en “mode lecture” (Firefox) ;-)
Brave New World
- Typhon Kalmaegi : Plus de 190 morts à cause des inondations aux Philippines et au Vietnam (humanite.fr)
Le typhon Kalmaegi s’est abattu sur les Philippines provoquant, depuis ce lundi 3 novembre, des inondations dévastatrices dans plusieurs grandes villes. Ce vendredi 7 novembre, le bilan humain s’élevait à 188 morts et 135 personnes disparues dans le pays, ainsi que cinq morts au Vietnam, aussi touché.
- Iran : Téhéran pourrait devoir être évacuée en raison d’une sécheresse inédite (liberation.fr)
Le pays fait face à une situation sans précédent, avec un taux de précipitation 40 % inférieur à la moyenne. Même avec une eau rationnée, la capitale aux 10 millions d’habitants pourrait ne plus pouvoir faire face, a déclaré le président iranien ce vendredi 7 novembre.
- Trésor de Toutânkhamon, un Ramsès II de 83 tonnes de granit… Le Grand Musée égyptien ouvre ses portes (humanite.fr)
Installé au pied des pyramides de Gizeh, le Grand Musée égyptien (GEM), vitrine pharaonique de l’Égypte antique, est ouvert au public depuis le 4 novembre. D’une superficie de près d’un demi-million de mètres carrés, l’immense bâtiment a coûté plus de 1 milliard de dollars et exigé vingt ans de travaux titanesques.
- Soudan : un génocide armé par l’Occident et les Émiratis (frustrationmagazine.fr)
- Comment la guerre au Soudan révèle les failles du contrôle mondial des armes (politis.fr)
Les massacres commis à El-Fasher illustrent une guerre hautement technologique au Soudan. Derrière le cliché des pick-up dans le désert, une chaîne d’approvisionnement relie Abou Dabi, Pékin, Téhéran, Ankara et même l’Europe pour entretenir l’un des conflits les plus meurtriers de la planète.
- Le « cauchemar » du parc national congolais, géré par un prince belge et financé par l’Europe (reporterre.net)
- Abus sexuels sur des réfugiés mineurs à l’Eglise de Casablanca (enass.ma)
Un prêtre accusé de pédophile en fuite. Six victimes abandonnées à leur sort. Des silences et des compromissions. ENASS.ma, crève l’abcès et lève le voile sur un système de pédophilie, et d’abus sexuels au sein du Service d’hébergement d’urgence des personnes migrantes à Casablanca, géré par la Paroisse de Notre-Dame-de-Lourdes de Casablanca.
- Les Sámis poursuivent la Finlande en justice pour récupérer leurs terres (lareleveetlapeste.fr)
« Cette affaire majeure vise à faire respecter les obligations de l’État envers la communauté MPLK au titre du droit international des droits de l’homme, à l’intersection des enjeux climatiques et des droits des peuples autochtones. »
- Norway reviews cybersecurity after hidden remote-access feature found in Chinese buses (scandasia.com)
Norway has launched a cybersecurity review after public transport operator Ruter discovered that electric buses supplied by Chinese manufacturer Yutong contained hidden SIM cards enabling potential remote access.
- La concentration des médias en Allemagne : panorama (1/4) (acrimed.org)
- Jailed UK climate protesters facing conditions reserved for extremists on release (theguardian.com)
Environmental protesters are being given licence conditions on release from jail that are supposed to be limited to extremism cases. Ella Ward, 22, was banned from going to any meetings or gatherings, except for worship, without permission from her probation officer, although the Ministry of Justice dropped the condition after she brought a legal challenge.
- Présidentielle en Irlande : Catherine Connolly l’emporte, une victoire historique pour la gauche (contretemps.eu) – voir aussi Irlande : les « secrets » de la victoire de la gauche (humanite.fr)
- Un Québec bouleversé par un climat perturbé (ledevoir.com/)
« Nous ne sommes pas prêts. Nous ne serons pas prêts. Chaque fois qu’un nouveau phénomène se produit, nous sommes pris de court. On fait de la gestion de crises, parce qu’on attend qu’elles se produisent avant de réagir. »
- ICE’s ‘Frightening’ Facial Recognition App is Scanning US Citizens Without Their Consent (commondreams.org)
“An ICE officer may ignore evidence of American citizenship—including a birth certificate—if the app says the person is an alien,” said the ranking member of the House Homeland Security Committee.
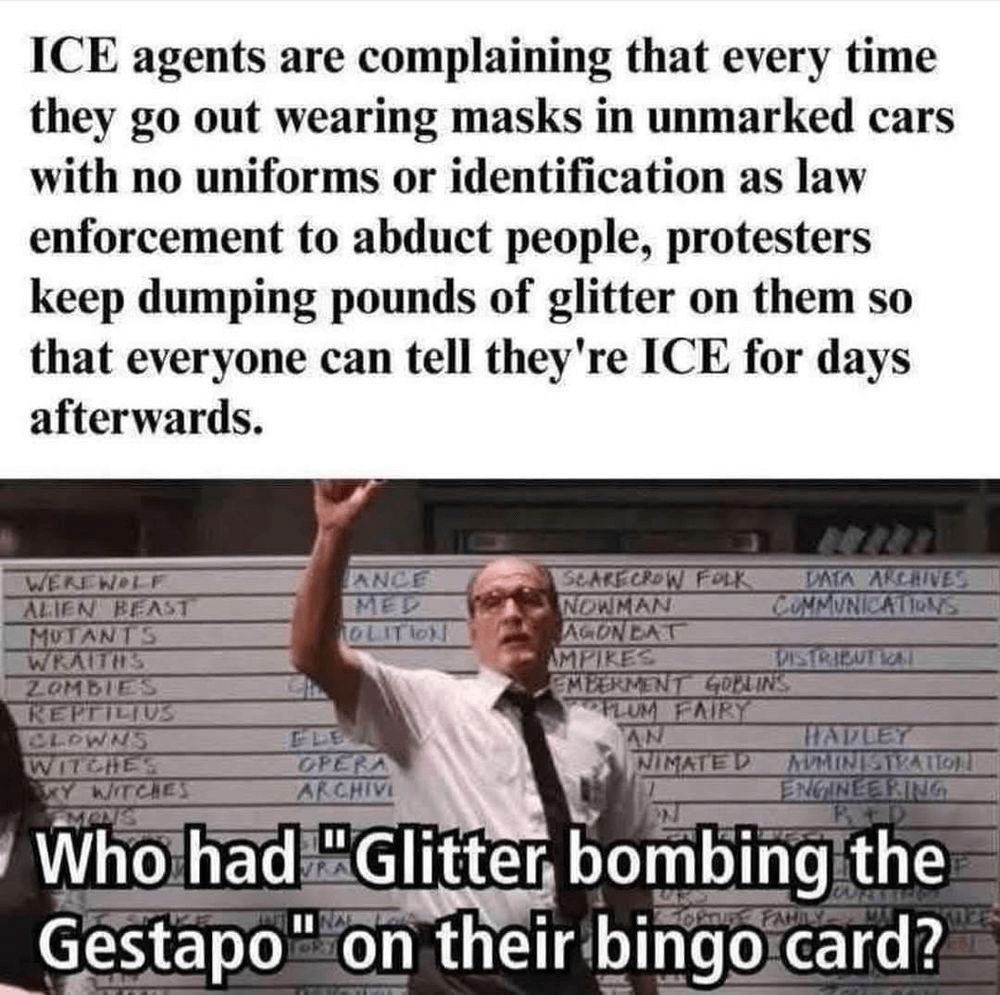
- Aux États-Unis, le shutdown le plus long de l’histoire (legrandcontinent.eu)
Après plus de 35 jours de shutdown, aucune solution claire entre Démocrates et Républicains ne permet d’entrevoir la fin de la crise politique qui a débuté le mois dernier.
- Aux États-Unis, le « shutdown » déclenche la pagaille dans le ciel, des milliers de vols vont être annulés (huffingtonpost.fr)
Alors que le blocage budgétaire s’éternise, le gouvernement américain annonce la suppression de vols pour « réduire la pression » sur les contrôleurs aériens de moins en moins nombreux.
- Les parties de golf de Trump auraient coûté près de 250 millions de dollars depuis le 20 janvier (legrandcontinent.eu)
Avec un coût par voyage à Mar-a-Lago pour jouer au golf estimé à 3,4 million de dollars par le Government Accountability Office, les 73 jours passés sur le green par Trump depuis le 20 janvier représenteraient un total de 248 millions de dollars en frais opérationnels, de transport et de sécurité.
- La menace de Donald Trump contre New York en cas d’élection de Zohran Mamdani à la mairie (huffingtonpost.fr)
Le président américain, farouchement opposé au candidat démocrate Zohran Mamdani, tente de peser de tout son poids sur le scrutin dans les dernières heures de l’élection.
- Zohran Mamdani : New York’s Working Class Elects a Movement Mayor (labornotes.org) – voir aussi Comment Mamdani a-t-il gagné à New York ? Une première analyse électorale (legrandcontinent.eu), Comment la gauche radicale a conquis New York (frustrationmagazine.fr) et « On fait campagne en poésie mais on gouverne en prose », le discours de victoire de Mamdani (legrandcontinent.eu)
Parmi les propositions phares de son programme, Mamdani veut rendre les services de bus gratuits, geler les loyers, créer une chaîne municipale de magasins d’alimentation, mettre en place une garde d’enfants universelle ainsi qu’une flat tax de 2 % pour les New-Yorkais qui gagnent plus d’un million de dollars par an.
- The Billionaires Who Failed to Stop Zohran Mamdani, and How Much They Spent (time.com)
- Zohran Mamdani n’est pas le seul à avoir infligé un revers à Trump et aux républicains (huffingtonpost.fr)
La victoire du démocrate aux élections municipales à New York s’accompagne d’autres déroutes pour le camp républicain, qui a perdu plusieurs scrutins très attendus. […]En Virginie, la démocrate Abigail Spanberger partait largement favorite des sondages pour devenir la première femme gouverneure à occuper ce mandat […] Dans le New Jersey, la démocrate Mikie Sherrill a elle aussi largement remporté son élection et deviendra la prochaine gouverneure […] Les Californien·nes ont approuvé mardi, selon plusieurs médias américains, un texte visant à redécouper leur carte électorale en faveur des démocrates, qui cherchent à compenser ce qu’ont fait au Texas les républicains sous la pression de Donald Trump.
- Mary Sheffield makes history : Detroit elects first woman mayor (blknewsnow.com)
- Pennsylvania elects its first out trans mayor (lgbtqnation.com)
- Bank of America faces lawsuit over alleged unpaid computer boot-up time (hcamag.com)
Bank of America is facing allegations that hundreds of hourly workers performed up to 30 minutes of unpaid computer setup work daily for years.
- Internet Archive’s legal fights are over, but its founder mourns what was lost (arstechnica.com)
The Internet Archive might sound like a thriving organization, but it only recently emerged from years of bruising copyright battles that threatened to bankrupt the beloved library project. In the end, the fight led to more than 500,000 books being removed from the Archive’s “Open Library.”“We survived,” Internet Archive founder Brewster Kahle told Ars. “But it wiped out the Library.”
- Brésil : le raid policier le plus sanglant du pays (politis.fr) – voir aussi Massacre à Rio de Janeiro (lundi.am)
De Jacarezinhio à Penha : le narco-gouvernement à son apogée
- COP30 : pourquoi le Brésil a autorisé des forages pétroliers au large de l’Amazonie (multinationales.org)
la COP 30 qui s’ouvre au Brésil bénéficie de l’image positive du gouvernement Lula, qui a fait de la protection de la forêt amazonienne une priorité. La décision annoncée il y a quelques jours d’autoriser des forages d’hydrocarbures offshore dans la région illustre cependant les contradictions de la politique brésilienne.
- COP30 : c’est quoi ce fonds à 125 milliards de dollars présenté par Lula pour lutter contre la déforestation (humanite.fr)
- Dans l’archipel du Bailique, au Brésil : « Je crois qu’ici, tout va disparaître » (politis.fr)
Au nord de Belem où se tient la COP 30, l’archipel du Bailique est en train de disparaître, victime de l’érosion des terres et de la salinisation de l’eau. Une catastrophe environnementale et sociale : les habitant·es désespèrent de pouvoir continuer à habiter leurs terres.
- L’idée d’Elon Musk pour sauver le climat ? Des satellites pour faire écran au Soleil (numerama.com)
- Donald Trump renomme Jared Isaacman, un proche d’Elon Musk, à la tête de la Nasa (france24.com)
Après l’avoir écarté pour raisons politiciennes, le président américain, Donald Trump, a finalement renommé le milliardaire Jared Isaacman à la tête de la Nasa. L’arrivée de ce proche d’Elon Musk, patron de SpaceX, au sein de l’agence spatiale suscite des inquiétudes sur d’éventuels conflits d’intérêts.
- A commercial space station startup now has a foothold in space (arstechnica.com)
A pathfinder mission for Vast’s privately owned space station launched into orbit Sunday and promptly extended its solar panel, kicking off a shakedown cruise to prove the company’s designs can meet the demands of spaceflight.
- The world’s tallest chip defies the limits of computing : goodbye to Moore’s Law ? (english.elpais.com)
A scientific team has managed to stack 41 layers of semiconductors, multiplying the density of the circuits by six, without needing to make them any smaller
- Solar geoengineering in wrong hands could wreak climate havoc, scientists warn (theguardian.com)
- Why Does So Much New Technology Feel Inspired by Dystopian Sci-Fi Movies ? (entertainment.slashdot.org)
- « Le système est toxique et nous osons le dire » : 43 scientifiques sonnent la révolte (lareleveetlapeste.fr)
Les 43 signataires ne se contentent pas de dénoncer. Ils exigent. Leur proposition est d’une radicalité assumée : “Diviser par 100 le seuil des produits autorisés.” Cent fois moins de pesticides, cent fois moins de plastifiants dans l’alimentation.
- Les données du satellite Gaia pourrait confirmer l’existence de la matière noire (humanite.fr)
L’étude d’une équipe toulousaine, établie à partir des données du satellite Gaia, validerait l’hypothèse de la matière noire.
Spécial IA
- OpenAI signs massive AI compute deal with Amazon (arstechnica.com)
Deal will provide access to hundreds of thousands of Nvidia chips that power ChatGPT.
- If you want to satiate AI’s hunger for power, Google suggests going to space (arstechnica.com)
Google engineers think they already have all the pieces needed to build a data center in orbit.
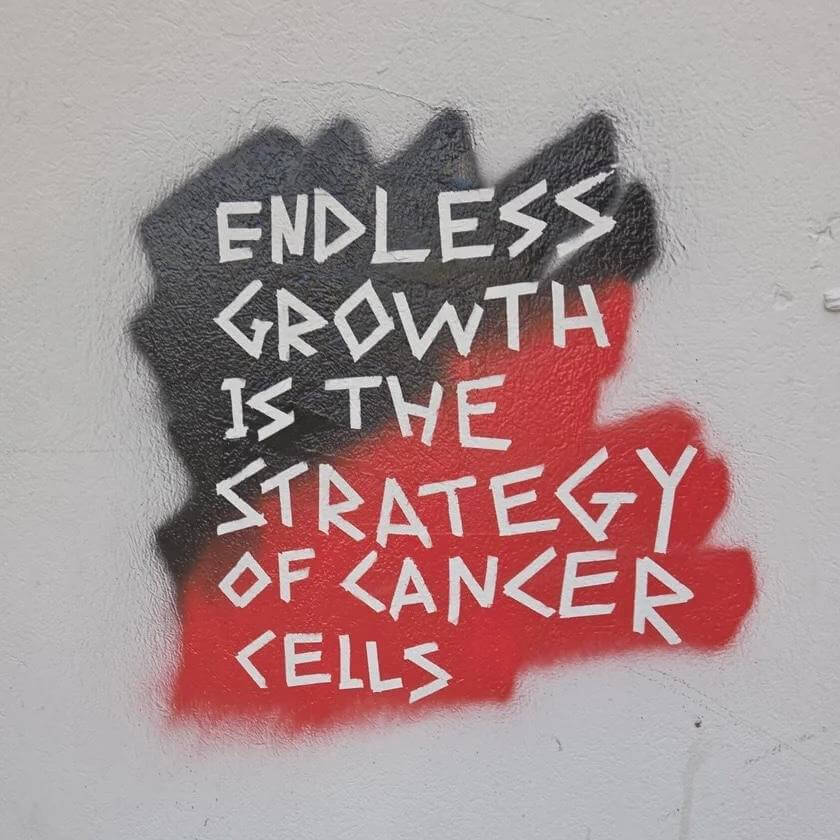
- Réchauffement climatique : l’IA générative consommerait quotidiennement autant d’énergie que 1,5 million de foyers (humanite.fr)
- Microsoft AI chief says only biological beings can be conscious (cnbc.com)
- Bombshell report exposes how Meta relied on scam ad profits to fund AI (arstechnica.com)
Meta goosed its revenue by targeting users likely to click on scam ads, docs show.
- LinkedIn utilise désormais les données de ses utilisateurices pour améliorer son IA (boursier.com)
- Oddest ChatGPT leaks yet : Cringey chat logs found in Google analytics tool (arstechnica.com)
For months, extremely personal and sensitive ChatGPT conversations have been leaking into an unexpected destination : Google Search Console (GSC), a tool that developers typically use to monitor search traffic, not lurk private chats.
- Amazon is testing an AI tool that automatically translates books into other languages (engadget.com)
it’s worth considering potential hallucinations. Nothing ruins a read more than a nonsensical chapter that was completely made up by a bot. Amazon does say that “all translations are automatically evaluated for accuracy before publication.” Authors can preview the content before publishing it, but they are unlikely to know the language it’s being translated into.
- AI Is Supercharging the War on Libraries, Education, and Human Knowledge (404media.co)
“Fascism and AI, whether or not they have the same goals, they sure are working to accelerate one another.”
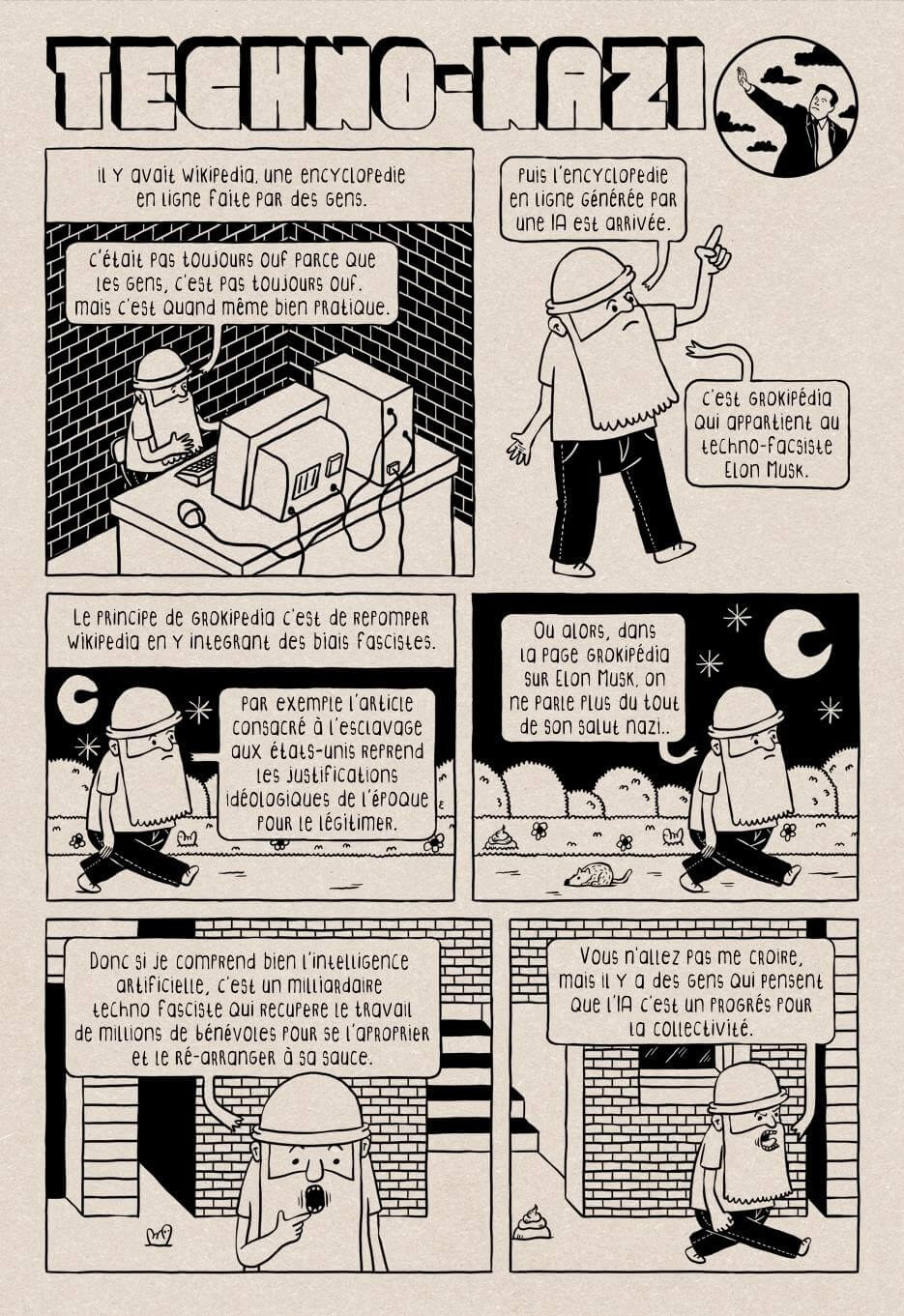
- La Haute Autorité de santé dit oui à l’IA, mais pas n’importe comment (next.ink)
- Researchers surprised that with AI, toxicity is harder to fake than intelligence (arstechnica.com)
New “computational Turing test” reportedly catches AI pretending to be human with 80 % accuracy.
- We reject the use of generative artificial intelligence for reflexive qualitative research (papers.ssrn.com)
We write as 416 experienced qualitative researchers from 38 countries, to reject the use of generative artificial intelligence (GenAI) applications for Big Q Qualitative approaches, such as reflexive thematic analysis, or various phenomenological approaches.
- La chute brutale des actions de Nvidia et Microsoft secoue le marché de l’intelligence artificielle (fr.euronews.com)
On estime qu’environ 500 milliards de dollars ont disparu des marchés financiers cette semaine, lorsque certaines des plus grandes entreprises technologiques, dont Nvidia, Microsoft et Palantir Technologies, ont vu le cours de leurs actions chuter temporairement, mais de manière considérable, mardi.
- The Big Short Guy Just Bet $1 Billion That the AI Bubble Pops (futurism.com)
- Sam Altman is Getting Desperate and it is Starting to Show (tickerfeed.net)
OpenAI has made commitments of over $1 trillion dollars, and has no plan on how to pay for it. Are you, the tax payer, going to foot the bill ?
Spécial Palestine et Israël
- YouTube Quietly Erased More Than 700 Videos Documenting Israeli Human Rights Violations (theintercept.com)
The tech giant deleted the accounts of three prominent Palestinian human rights groups — a capitulation to Trump sanctions.
- Paramount Has Blacklist for Stars Deemed “Overtly Antisemitic” (worldofreel.com)
It sure looks like the likes of Javier Bardem, Joaquin Phoenix, Emma Stone, and Mark Ruffalo won’t be making movies for Paramount in the foreseeable future.
- Annulation du colloque “La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines” des 13 et 14 novembre 2025 (college-de-france.fr)
- Ils étaient en train de récolter des olives en Cisjordanie occupée : des colons israéliens attaquent des villageois·es palestinien·nes et des journalistes (lindependant.fr)
Deux employés de Reuters, une journaliste et un conseiller sécurité l’accompagnant, font partie des personnes blessées dans une attaque menée par des hommes armés de bâtons, de matraques et de grosses pierres, près du village palestinien de Beita.
- Israël : ces vérités sur « l’armée la plus morale du monde » qu’il faut cacher (politis.fr)
- Israël/Palestine : « La colonisation reste le grand impensé du cadrage médiatique » (acrimed.org)
Spécial femmes dans le monde
- Sexisme : et si la discrimination à l’embauche commençait sur Facebook ? (humanite.fr)
Selon une étude de trois associations menée entre 2021 et 2023 dans six pays dont la France, Facebook ne montrerait pas les mêmes annonces d’emplois à ses utilisateurs. Des postes de psychologue ou assistante maternelle seraient en grande majorité montrés à des femmes alors que les hommes verraient plus des postes de chercheurs ou ingénieurs informatiques.
- Unions are the best defense against the gender wage gap (afscme.org)
- Women of Vanity Fair Consider Ross Douthat’s Question : Did Women Ruin the Workplace ? (vanityfair.com)
Today, The New York Times published a conversation between the conservative columnist and two writers about just how bad ladies have screwed up corporate culture with their presence. We felt we should engage.
- Mexique : la présidente Claudia Sheinbaum agressée sexuellement en pleine rue, elle réplique (huffingtonpost.fr)
Claudia Sheinbaum a expliqué avoir porté plainte car, après l’avoir harcelée, l’homme avait continué à s’en prendre à d’autres femmes avant d’être arrêté quelques heures plus tard.[…]« Je me demande : si je ne porte pas plainte, qu’adviendra-t-il des autres Mexicaines ? Si c’est ce qui arrive à la présidente, qu’adviendra-t-il de toutes les femmes de notre pays ? »
- Avortement : Amnesty alerte sur « une vague de politiques régressives » à travers l’Europe (humanite.fr)

Spécial France
- L’économie macroniste sombre mais l’économiste de Macron reçoit un « prix Nobel » (contretemps.eu)
- Pourquoi la libération de Cécile Kohler et Jacques Paris n’est pas « définitive », selon le Quai d’Orsay (huffingtonpost.fr)
Les Français·es Cécile Kohler et Jacques Paris, détenu·es en Iran depuis trois ans et demi, accusé·es d’espionnage au profit des renseignements français et israélien, « sont sortis de la prison d’Evin » […] Il et elle sont actuellement « en sécurité » à la résidence de l’ambassadeur de France, à Téhéran, « dans l’attente de leur libération définitive »
- Des scientifiques dénoncent la vente aux enchères de la machine à calculer « Pascaline » (next.ink)
Vieille de 380 ans, la Pascaline est la première machine à calculer de l’humanité, mise au point par Blaise Pascal. Alors que huit exemplaires fabriqués en 1642 et 1649 subsistent au monde, l’un d’entre eux doit être mis aux enchères par Christies le 19 novembre prochain.
- Post-heist reports reveal the password for the Louvre’s video surveillance was ‘Louvre,’ and suddenly the dumpster-tier opsec of videogame NPCs seems a lot less absurd (pcgamer.com)
- Doctolib écope de 4,6 millions d’euros d’amende ? Mais pourquoi ? (mac4ever.com)
- Rapport du Cese sur les inégalités : une feuille de route ambitieuse (humanite.fr)
- La mère d’un enfant handicapé estime “le droit à l’éducation de son fils” bafoué, le tribunal administratif rejette sa demande d’aide (france3-regions.franceinfo.fr)
- En Isère, les facteurices aux avant-postes face à la perte d’autonomie des seniors (alternatives-economiques.fr)
Plusieurs institutions, dont La Poste et ses facteurices, se sont associées en Isère pour déployer le programme international « Icope », qui vise à prévenir la perte d’autonomie des personnes âgées.
- Suicide des agriculteurices : un risque toujours très élevé selon la Mutualité sociale agricole (reporterre.net)
- « On a joué aux apprentis sorciers » : à Dreux, un solvant cancérogène menace les réserves en eau potable de 50 000 habitants (vert.eco)
- La pétition contre la loi Duplomb arrive à l’Assemblée, et il ne faut pas en attendre grand-chose (huffingtonpost.fr)
2,1 millions de signataires, et après ? Cet été, la pétition contre la loi Duplomb a explosé tous les compteurs. Mise en ligne sur le site de l’Assemblée nationale, elle a recueilli un nombre record de signatures, loin devant le précédent record, établi à 260 000.
- Les poussins sont toujours broyés en France, malgré l’interdiction (reporterre.net)
- Utilisation de l’écriture inclusive par les marques : indifférence des hommes, soutien nuancé des femmes (theconversation.com)
- Shein vendait des « poupées sexuelles à caractère pédopornographique » (next.ink)
- Après le scandale des poupées pédopornographiques, quatre géants chinois visés par la justice (huffingtonpost.fr)
Le parquet de Paris a ouvert quatre enquêtes qui ont été confiées à l’Office des mineurs (Ofmin) sur les pratiques de Shein, AliExpress, Temu et Wish.
- Shein : Le gouvernement engage une procédure de « suspension » de la plateforme en France (huffingtonpost.fr)
Spécial femmes en France
- Le Prix Gouincourt récompense Fatima Daas, Wendy Delorme, Nelly Slim et Sabrina Calvo (huffingtonpost.fr)
- Pourquoi éduquer les garçons avec des valeurs féministes est devenu (encore) plus compliqué (slate.fr)
Pour les parents dont l’éducation se détourne du sexisme systémique de notre société, l’arrivée de leurs fils à l’école peut être difficile à vivre, voire décourageante. En cause, notamment, les stéréotypes de genre toujours présents dans les milieux scolaires.
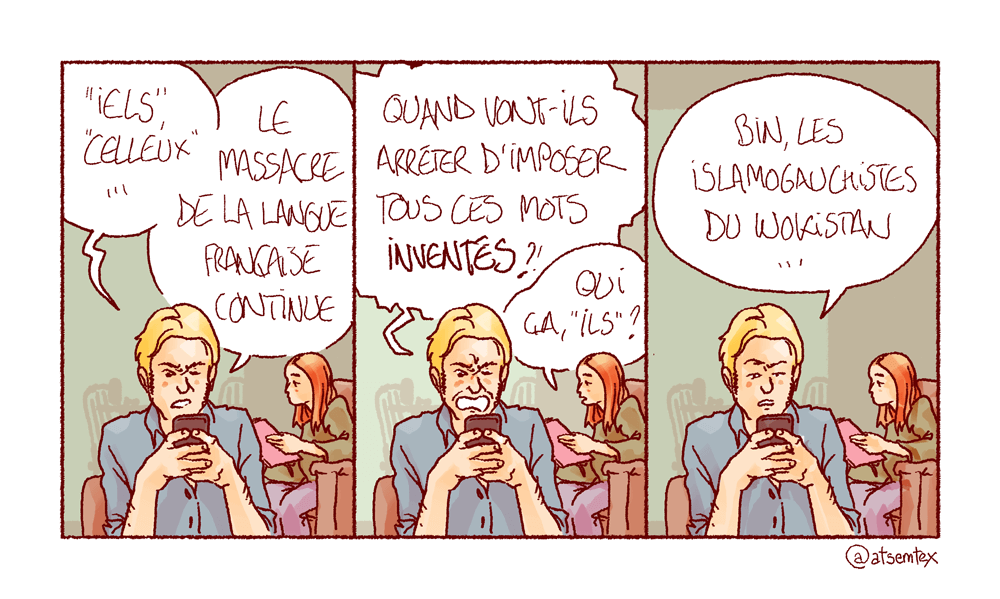
- « Le remboursement des protections menstruelles, promesse jamais tenue du macronisme » (reporterre.net)
- Endométriose : une association à Perpignan contre l’errance et la solitude de milliers de femmes (madeinperpignan.com)
- Fermeture de la maternité des Lilas : la fin d’un Eldorado féministe (lesnouvellesnews.fr)
La maternité des Lilas a changé la vie de milliers de femmes en repensant l’accompagnement lors de l’accouchement. Le 31 octobre 2025, l’établissement a fermé ses portes, après avoir milité pour les droits des femmes depuis soixante ans.
Spécial médias et pouvoir
- Déluge de calomnies contre Mamdani, nouveau maire de New York (acrimed.org)
Mardi 4 novembre, le candidat démocrate Zohran Mamdani a été élu maire de New York. Un socialiste, qui plus est musulman, à la tête de la première place financière du monde ? Vent de panique dans l’éditocratie !
- Vincent Bolloré a menti sous serment (politis.fr)
En mars 2024, le millardaire breton d’extrême droite avait juré ses grands dieux devant la commission d’enquête sur la concentration dans les médias qu’il n’intervenait jamais dans les contenus. Le livre de Philippe de Villiers qu’il a lui-même publié prouve le contraire.
- Le livre de Gabriel Zucman privé de publicité dans les gares et le métro parisien (huffingtonpost.fr)
Comme pour Jordan Bardella l’an dernier, la régie publicitaire Mediatransports estime que le livre de l’économiste relève de la publicité à caractère politique.
- Le milliardaire anti-écolo Bernard Arnault achète « Challenges », « Sciences et Avenir » et « La Recherche » (reporterre.net)
- Le Rassemblement national s’indigne d’une séquence dans laquelle une journaliste de C dans l’air évoque Jordan Bardella, mais aussi Franz von Papen (huffingtonpost.fr)
Spécial emmerdeurs irresponsables gérant comme des pieds (et à la néolibérale)
- Macron maquille sa capitulation sur le MERCOSUR (humanite.fr)
- Emmanuel Macron atteint le record d’impopularité de François Hollande, selon un sondage (20minutes.fr)

- France : le budget 2026 dans l’impasse (france24.com)
- Le budget de la Sécu cible les malades plutôt que les cancers (reporterre.net)
C’est une mesure tellement impopulaire qu’on en vient à se demander pourquoi le gouvernement persiste. Dans son budget de la Sécurité sociale pour 2026, l’exécutif souhaite instaurer un doublement des montants des franchises médicales (les sommes qui restent à la charge des patients sur les boîtes de médicaments) et des participations forfaitaires (le reste à charge des consultations médicales). Ces dispositifs seraient également étendus aux rendez-vous chez le chirurgien-dentiste, et aux produits médicaux comme les lunettes, les béquilles et les pansements — des domaines qui en étaient jusqu’ici exemptés. Cerise sur le gâteau, les plafonds annuels de ces franchises seraient aussi doublés, passant de 50 à 100 euros.
- Budget de la Sécu : le Parti socialiste, menacé d’isolement à gauche, navigue en eaux troubles (huffingtonpost.fr)
Le PS assume son vote « pour » la partie recettes du budget de la Sécurité sociale par le débat à venir sur la réforme des retraites. Mais le discours peine à convaincre ses alliés.
- Frais bancaires : Bercy tente de rassurer banques et consommateurs sur les découverts (humanite.fr)
Le ministre de l’Économie a reçu, mardi, les associations de consommateurs et les représentants des banques avant un changement de règles qui pourrait interdire ces souplesses de gestion à de nombreux clients.
- Comment le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, justifie la baisse du nombre d’enseignant·es (huffingtonpost.fr)
Le projet de budget 2026 prévoit la suppression de 4000 postes d’enseignant·es du premier degré.
- Le Ministère de l’agriculture a saboté un rapport pour minimiser le lien entre pesticides et cancers (lareleveetlapeste.fr)
Des scientifiques dénoncent comment un rapport sur la santé et les pesticides a été édulcoré par l’État. Réécriture du cabinet de la ministre, menaces de sanction, suppression de certaines mentions… Le cabinet a tout fait pour minimiser l’impact des pesticides sur la santé humaine. L’ingérence du gouvernement a été révélée le 30 octobre par Le Monde.
Voir aussi Pesticides : des scientifiques dénoncent des pressions du gouvernement (reporterre.net)
Les pressions du cabinet de la ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, pour édulcorer un rapport du Haut-Commissariat au plan défavorable aux pesticides, font scandale. Plusieurs ONG dénoncent, dans une lettre ouverte adressée le 6 novembre au Premier ministre Sébastien Lecornu, ces agissements dévoilés le 30 octobre par Le Monde.
Spécial recul des droits et libertés, violences policières, montée de l’extrême-droite…
- Dorénavant, il faudra un niveau Bac pour être naturalisé en France : reportage en Vendée (actu.fr)
Le Secours catholique et la Cimade ont proposé à une quinzaine de volontaires, en Vendée, le test des épreuves du DELF B2, nécessaire pour accéder à la nationalité française.
- L’extrême droite européenne lance à Paris son plan pour démanteler l’UE (basta.media)
Des militants d’extrême droite se sont retrouvés à Paris pour le lancement français d’un projet de « réinitialisation » de l’Union européenne, « The Great Reset ». À l’initiative de l’événement : des groupes d’influence polonais et hongrois.
- Canon français : le banquet qui file la nausée (lundi.am)
Pierre-Édouard Stérin, les traditions inventées et les forceurs de la ripaille
Voir aussi Quand les marmites deviennent brunes : entreprises et influenceurs de l’extrême droite par l’alimentation (blogs.mediapart.fr)
- Casino utilise l’arrondi en caisse pour financer des écoles privées hors contrat proches de la droite conservatrice (streetpress.com)
Malgré les critiques, le groupe Casino a maintenu son partenariat d’arrondi en caisse pour financer Espérance banlieues. Un réseau d’écoles privées hors contrat pourtant accusé de d’humiliations et de violences.
- [Sur LCI, Bardella souhaite faire de la France « le pays le plus répressif d’Europe ».]https://www.20minutes.fr/politique/4183163-20251103-criminalite-jordan-bardella-souhaite-faire-france-pays-plus-repressif-europe) (20minutes.fr)
- LGV Bordeaux-Toulouse : elles défendent un chêne et finissent au tribunal (reporterre.net)
« Le gendarme m’a subtilisé mon téléphone et lisait mes conversations privées, regardait mes photos […] Je lui ai dit à plusieurs reprises de verrouiller mon téléphone, que c’était mon intimité. » L’opposante a alors tenté de le verrouiller en le saisissant, avant d’être plaquée au sol. « Connasse, connasse ! » peut-on entendre sur la vidéo.
- Motard percuté sur l’autoroute près de Paris : deux policiers placés sous contrôle judiciaire (ouest-france.fr)
- Violences policières contre Michel Zecler : la Défenseure des droits épingle Laurent Nuñez pour l’absence de procédure disciplinaire (humanite.fr)
Cinq ans après le tabassage de Michel Zecler par des policiers sous l’œil d’une caméra de vidéosurveillance, la Défenseure des droits épingle l’absence de procédure disciplinaire contre les policiers et annonce saisir le ministre de l’Intérieur, dans une décision publiée vendredi 7 novembre.
- Sainte-Soline : ces images chocs révèlent les dérives des gendarmes lors des affrontements contre les manifestants (huffingtonpost.fr) – voir aussi « Faut qu’on les tue » : les vidéos des gendarmes à Sainte-Soline révélées par Mediapart et Libération (reporterre.net)
Les vidéos sont accablantes et donnent la mesure de la violence de l’institution policière à l’encontre des militants écologistes. Dans une très forte enquête, Mediapart et Libération révèlent les méthodes illégales des gendarmes mobiles pour réprimer la manifestation de Sainte-Soline de mars 2023 qui avait occasionné dans les rangs des manifestants plus de 200 blessés
Et Alix*, blessée à Sainte-Soline : « Les gendarmes ont eu la permission de tuer » (politis.fr)
Elle a été blessée gravement lors de la manifestation contre les mégabassines, en mars 2023 et déposé plainte. Pour Alix*, les révélations de Mediapart et Libération démontrent le caractère institutionnel de la violence au sein de la gendarmerie.
- Vidéos de Sainte-Soline : “C’est inadmissible”, un sénateur demande une commission d’enquête parlementaire après les révélations de violences des forces de l’ordre (france3-regions.franceinfo.fr)
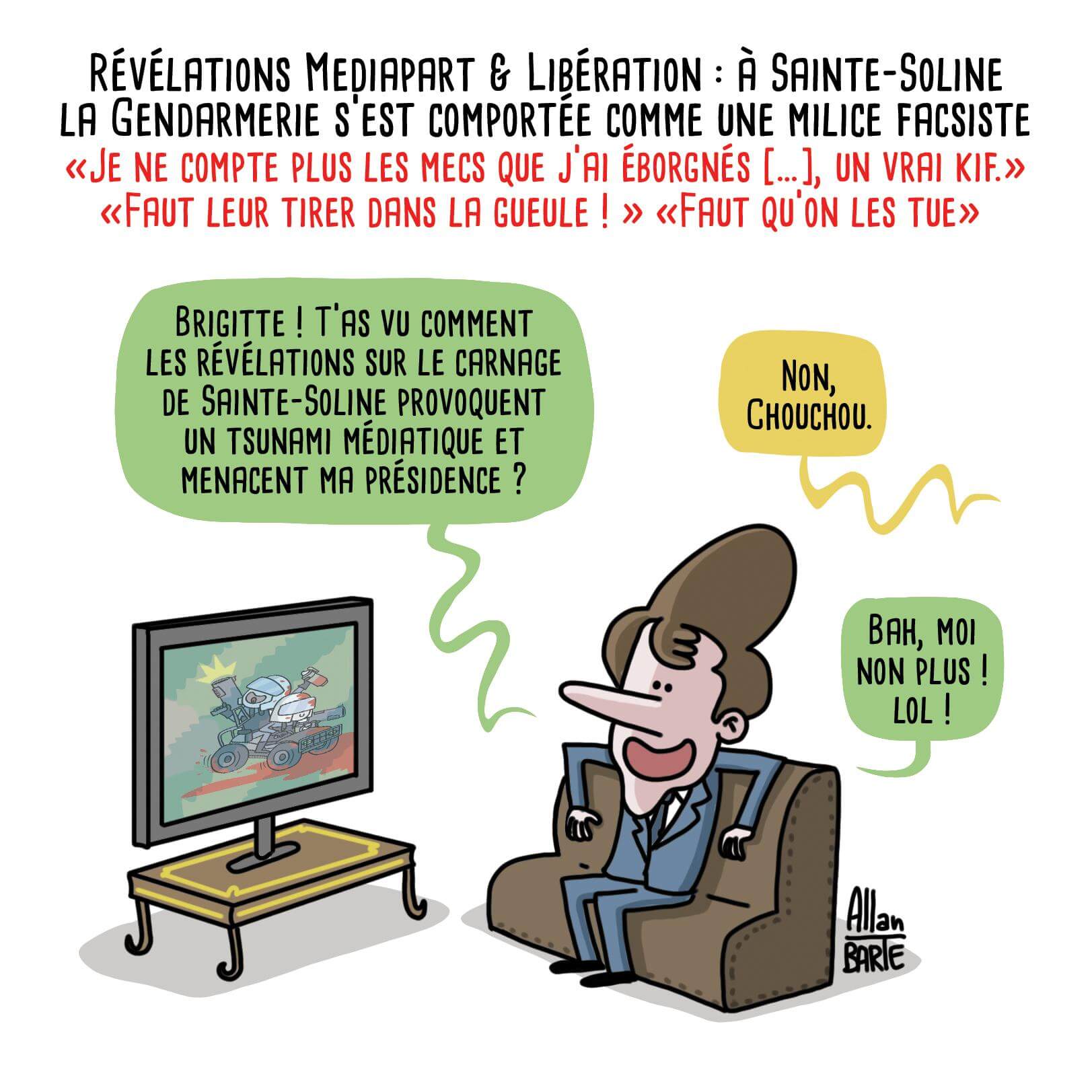
- Jérôme Laronze, éleveur tué par un gendarme : « La justice s’apprête à détruire les preuves » (basta.media)
Jérôme Laronze a été tué par un gendarme en 2017 à la suite d’un contrôle sur sa ferme. Alors que le procès n’a toujours pas eu lieu, la juge d’instruction envisage de détruire les scellés. Les proches de l’éleveur sont gagnés par la colère.
Spécial résistances
- Désarmer GBH : lever le voile sur le plus puissant empire béké (parallelesud.com)
En septembre 2025, deux collectifs – Vous n’êtes pas seuls (VNPS) et l’Observatoire Terre-Monde (OTM) – publient Désarmer GBH : Enquête sur le plus puissant empire béké, un rapport explosif qui documente l’ampleur, la structure et les pratiques du Groupe Bernard Hayot (GBH), mastodonte de la grande distribution, de l’automobile et de l’agro-industrie dans les territoires dits d’Outre-mer.
- Le scandale Dépakine s’amplifie : dans les Pyrénées-Orientales, la lanceuse d’alerte Marine Martin combat le géant Sanofi (madeinperpignan.com)
Le combat de la lanceuse d’alerte Marine Martin […] se poursuit depuis 2012. Elle a contribué à la reconnaissance des handicaps d’enfants suite à la prise du médicament Dépakine par les parents, et lutte toujours pour faire condamner au pénal le géant pharmaceutique Sanofi. Sa bataille prend désormais une tournure internationale, et un film est en projet.
- « Désolées si on a fait trembler le Front national » : deux femmes en garde à vue pour une banderole anti-Bardella à Nîmes (leparisien.fr)
- Célia Chirol : « S’il n’y avait pas eu de révoltes, aurait-on parlé de la mort de Zyed et Bouna ? » (bondyblog.fr)
- De “graves incidents” à la Philharmonie de Paris : ce que l’on sait (france3-regions.franceinfo.fr)
Ces derniers jours, la polémique avait enflé sur la tenue de ce concert. Des militants pro-palestiniens demandant son annulation tandis que la CGT-Spectacle réclamait que la Philharmonie “rappelle à son public les accusations gravissimes qui pèsent contre les dirigeants” d’Israël, notamment dans la guerre à Gaza.
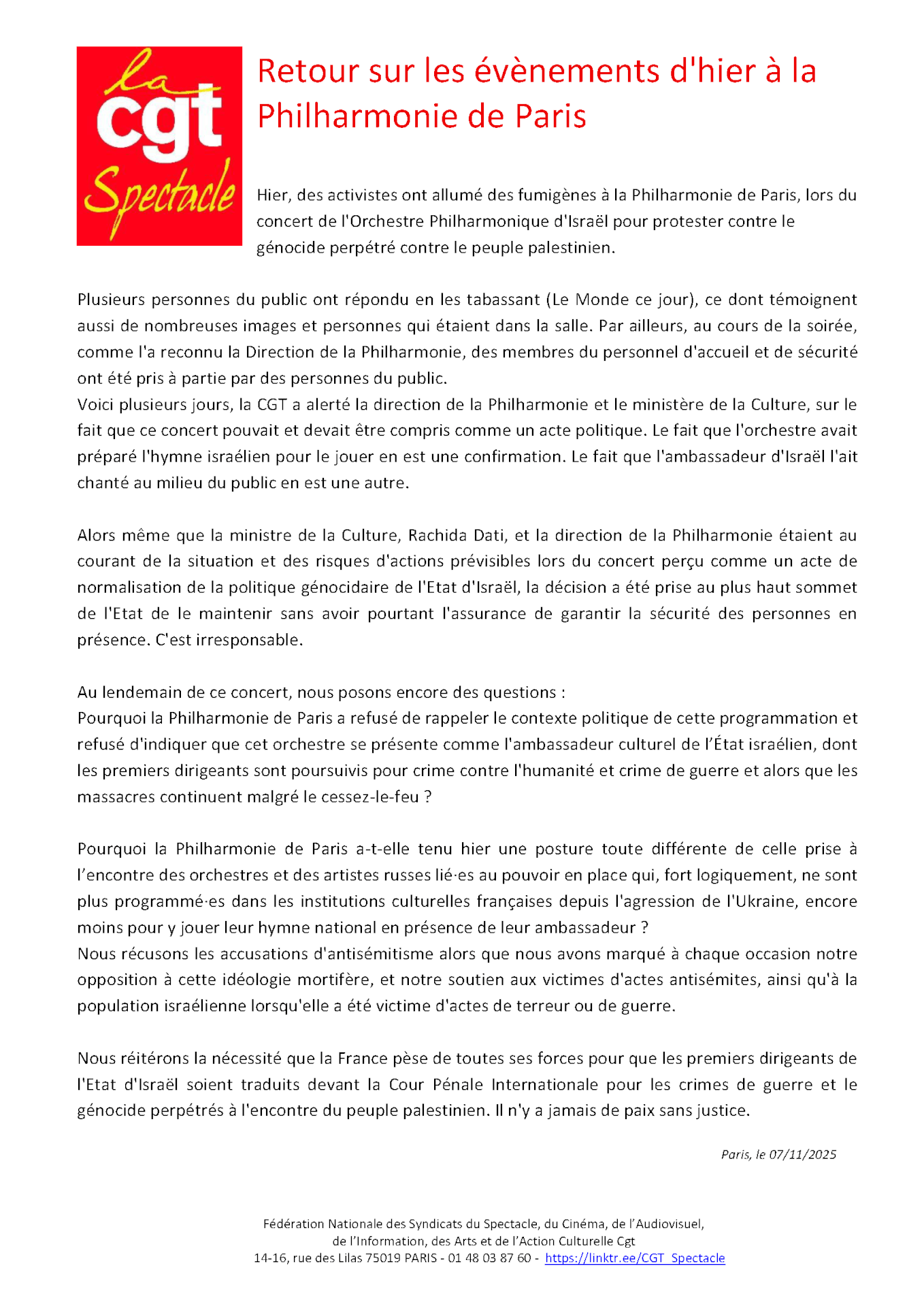
Voir aussi Incidents à la Philharmonie de Paris : les quatre suspect·es mis·es en examen à l’issue de leur garde à vue (huffingtonpost.fr)Avant leur mise en examen, un rassemblement de soutien a viré au règlement de compte samedi devant le commissariat du XIXe arrondissement où iels étaient auditionné·es.[…]Trois militants pro-israéliens ont finalement été interpellés « pour outrage, violences sur personne dépositaire de l’autorité publique
- Coupures d’eau en Guadeloupe : près de 60 étudiants du CROUS Antilles-Guyane vont déposer plainte contre le SMGEAG (la1ere.franceinfo.fr)
- Revendication d’un sabotage sur la plateforme chimique de Balan (lundi.am)
- “Personne n’en parle” : Greenpeace vient de partager la liste des aliments qui contiennent de l’hexane, un solvant toxique qui “endommage les neurones” et affaiblit le cerveau (psychologies.com)
- Sainte-Soline : en finir avec cette police viriliste et violente est une nécessité écologiste (reporterre.net)
Spécial outils de résistance
- Désactiver les fonctionnalités IA dans Firefox (zonetuto.fr)
- AI Implementation Bingo (workersdecide.tech)
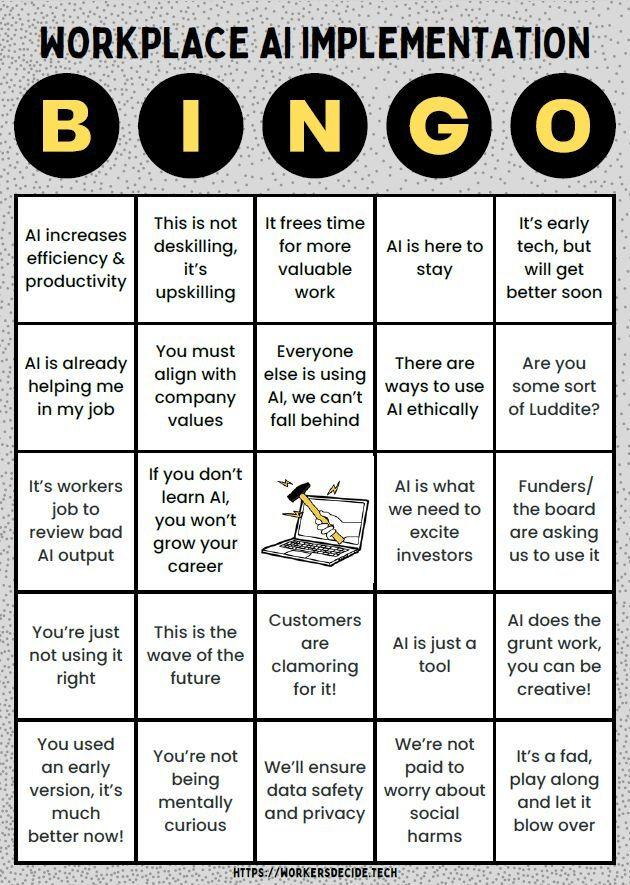
- AlgoSpeak Dictionary (algospeak.net)
Welcome to The AlgoSpeak Dictionary, where we unpack the words used to circumvent algorithmic exclusions !
- Lancement de « Fachorama », le nouveau jeu de la Horde (ripostes.org)
Fachorama est un jeu de cartes, qui se veut un outil pédagogique visant à montrer de façon ludique que l’extrême droite a bien des visages, et que si ses partisan·tes ont de nombreux points communs, iels ont aussi leur singularité. Le but du jeu ? demander aux autres joueurs et joueuses des catégories de fafs, les regrouper par famille et faire le plus de familles possible !
- Authoritarian stack (authoritarian-stack.info)
Spécial GAFAM et cie
- Microsoft, Google say their data centers create thousands of jobs. Their permit filings say otherwise (restofworld.org)
Chile and tech giants promise economy-wide impact but permits show fewer onsite jobs after construction.
- How Google Tracks and Scans Everything on Your Android Device (howtogeek.com)
Every Android user has used the Google Play Store at some point, but what you might not know is that the Play Store app has a background service that is constantly running in the background. This background process is called “Google Play Services,” and it has access to everything on your phone.
- Facebook’s fraud files (pluralistic.net)
A blockbuster Reuters report by Jeff Horwitz analyzes leaked internal documents that reveal that : 10 % of Meta’s gross revenue comes from ads for fraudulent goods and scams, and ; the company knows it, and ; they decided not to do anything about it, because ; the fines for facilitating this life-destroying fraud are far less than the expected revenue from helping to destroy its users’ lives
- Windows 10 update incorrectly tells some users they’ve reached end-of-life, despite having extended support — Microsoft confirms message sent to Enterprise, Pro, and Education users ‘in error’ (tomshardware.com)
- Windows 10/11 : nouveau fiasco, BitLocker bloque l’accès à des milliers de PC sans prévenir (lesnumeriques.com)
Les autres lectures de la semaine
- The scent of the human : Staying authentic in the Age of AI (wan-ifra.org)
To be superhuman today is to fiercely defend what machines cannot replicate : emotional depth, lived experience, and moral imagination.
- Audrey Tang, hacker and Taiwanese digital minister : ‘AI is a parasite that fosters polarization’ (english.elpais.com)
“Internet and democracy are not two things, but rather one and the same thing. Just like bubble and tea.”[…]“We don’t need super intelligence to save us, because we’re already a superintelligent species. We just need to move from singularity to plurality.”
- DHH and Omarchy : Midlife crisis (blogs.gnome.org)
Mentioning twice a “big tent” as the official policy and response to complains about supporting Fascist and Racist shitheads, is nothing sort of digging a hole for yourself so deep it that it reemerges in another continent. […] I think there is hope, but it demands more voices in tech spaces to speak up about how having empathy for others, or valuing diversity is not some grand conspiracy but rather enrichment to our lives and spaces. This comes hand in hand with firmly shutting down concern trolling and ridiculous “extreme centrist” takes where someone is expected to find common ground with others advocating for their extermination.
- 20 novembre 1945 : l’ouverture du procès de Nuremberg, quand l’horreur nazi fait face à la justice (humanite.fr)
- « Seule une fraction minoritaire de l’humanité est à l’origine du bouleversement climatique » (basta.media)
- État de droit et démocraties : la rupture ? (humanite.fr)
- Intelligences collectives au siècle des Lumières : parterres de théâtre et foules séditieuses (theconversation.com)
- Les 50 ans de l’affaire Lip. Une mémoire à désenchanter ? (contretemps.eu)
- What Rosalind Franklin truly contributed to the discovery of DNA’s structure (nature.com – article de 2023)
Rosalind Franklin has been reduced to the “wronged heroine” of the double helix. She deserves to be remembered not as the victim of the double helix, but as an equal contributor to the solution of the structure.
- Ce que j’ai appris d’un manuel français de sexualité datant de 1885 (slate.fr)
L’auteur prévient d’ailleurs que la lecture de certains romans, trop passionnés, peut amener la femme à réaliser la cruelle réalité de son insatisfaction. Il cite en exemple l’œuvre féministe Lélia de George Sand, qui scandalisa l’opinion lors de sa première parution en 1833. « Le mari fera bonne garde et, sans rien dire, cachera, brûlera même ces livres empoisonnés », recommande-t-il.
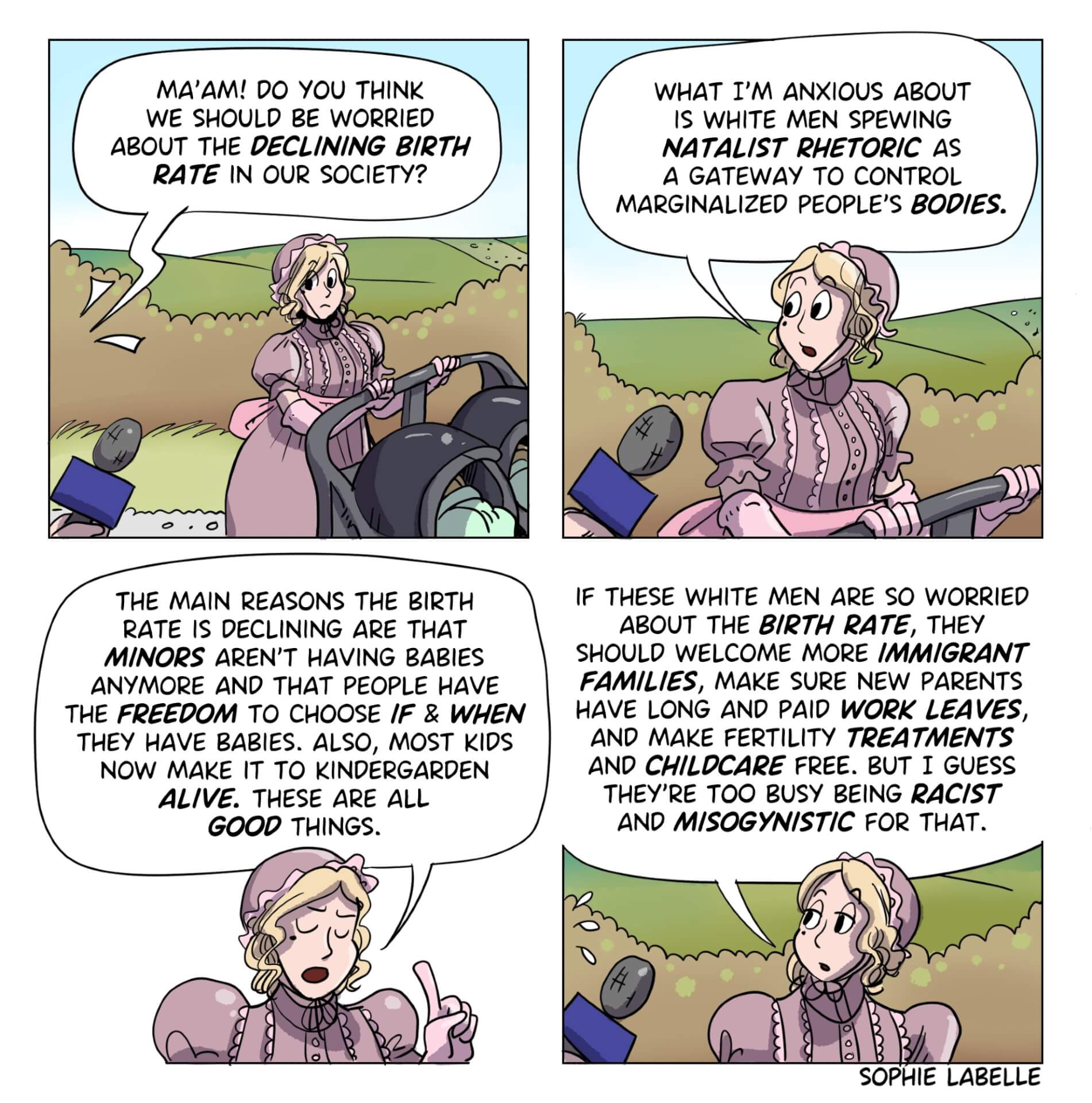
- 10,000 generations of hominins used the same stone tools to weather a changing world (arstechnica.com)
This technological tradition lasted longer than Homo sapiens have even been a species.
- Non, toutes les abeilles ne meurent pas après avoir piqué (loin de là !) (theconversation.com)
l’autotomie de l’aiguillon est un phénomène rarissime chez les abeilles : sur près de 20 000 espèces d’abeilles répertoriées à travers le monde, elle ne s’observe que chez les abeilles du genre Apis, qui compte moins de dix espèces, dont l’abeille à miel domestique (Apis mellifera) […] d’autres hyménoptères sociaux, dont des guêpes et des fourmis, pratiquent également l’autotomie de l’aiguillon.
Les BDs/graphiques/photos de la semaine
- Record
- Taxe
- Sainte Soline
- Débat
- Philharmonie
- Massacre
- Birth rate
- Droits des femmes
- ICE
- Bingo
- Technonazi
- Pneus
- Cancer cells
Les vidéos/podcasts de la semaine
- « Faut leur tirer dans la gueule ! » : la manifestation de Sainte-Soline vue par les gendarmes (mediapart.fr)
- Comment des technologies conçues pour ‘libérer’ servent aujourd’hui à contrôler (radiofrance.fr)
- François Piquemal a une question pour Aghion (tube.fdn.fr)
- Camille Étienne, sur la théorie du flanc radical (tube.fdn.fr)
- Livres de Bardella et Zemmour : deux faces d’une même pièce (humanite.fr)
- La petite histoire de Vincent Bolloré (tube.fdn.fr)
- Politique et business : les liaisons dangereuses ? (france.tv)
- Où va l’Italie (partie 2) ? Bilan de Meloni et résistances populaires (contretemps.eu)
Les trucs chouettes de la semaine
- Capitole du Libre les 15 & 16 novembre 2025 à Toulouse ! (linuxfr.org)
- L’écrivain Karim Kattan aux contributeurs de Wikipédia : “Une preuve de l’importance de ton travail : Elon Musk déteste ce que tu fais” (rtbf.be)
- Un site web qui permet de parcourir facilement les photographies du fonds “C’était Paris en 1970” de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris (paris1970.jeantho.eu)
- World plugs (iec.ch) Seasoned travellers are well aware of the many different plugs and sockets in use around the world. IEC created a plug and socket zone that is both informative and practical, start exploring.
- How to Brew Solar Powered Coffee (solar.lowtechmagazine.com)
This guide explains how to construct an energy-efficient coffee maker powered by a small solar panel.
Retrouvez les revues de web précédentes dans la catégorie Libre Veille du Framablog.
Les articles, commentaires et autres images qui composent ces « Khrys’presso » n’engagent que moi (Khrys).
03.11.2025 à 07:42
Khrys’presso du lundi 3 novembre 2025
Khrys
Texte intégral (10354 mots)
Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour découvrir les informations que vous avez peut-être ratées la semaine dernière.
Tous les liens listés ci-dessous sont a priori accessibles librement. Si ce n’est pas le cas, pensez à activer votre bloqueur de javascript favori ou à passer en “mode lecture” (Firefox) ;-)
Brave New World
- La Chine est-elle en train de dépasser les États-Unis ? 10 points sur le grand décrochage (legrandcontinent.eu)
- Contre Trump, Xi est-il en train de gagner la guerre des infrastructures ? (legrandcontinent.eu)
Aujourd’hui, Trump est en Corée du Sud pour nouer avec Xi un deal commercial.Mais ce n’est qu’un prétexte : le vrai sujet de cette rencontre au sommet est l’infrastructure numérique mondiale.
- China Dives in on the World’s First Wind-Powered Undersea Data Center (wired.com)
China has completed the first phase of construction of what it claims is the world’s first underwater data center (UDC). Located in Shanghai’s Lin-gang Special Area with a price tag of roughly RMB 1.6 billion ($226 million), it’s a significant milestone in the quest for sustainable solutions to the growing energy demands of China’s computing infrastructure.
- UBIOS : la solution de contournement chinoise à l’UEFI (minimachines.net)
UBIOS est une création issue des recherches de Huawei et c’est la solution choisie par le gouvernement Chinois pour couper encore un peu plus les ponts avec la technologie en provenance des USA.
- China Pushes Boundaries With Animal Testing to Win Global Biotech Race (archive.ph)
The research, including creating monkeys with schizophrenia and autism, would face layers of ethical reviews in the US and Europe.
- La nouvelle réalité au Népal (ritimo.org)
Au Népal, le soulèvement mené par les jeunes a certes permis de renverser la vieille garde, mais sa pérennité dépend de la capacité à transformer cette colère suscitée par la corruption et les inégalités en un changement politique durable
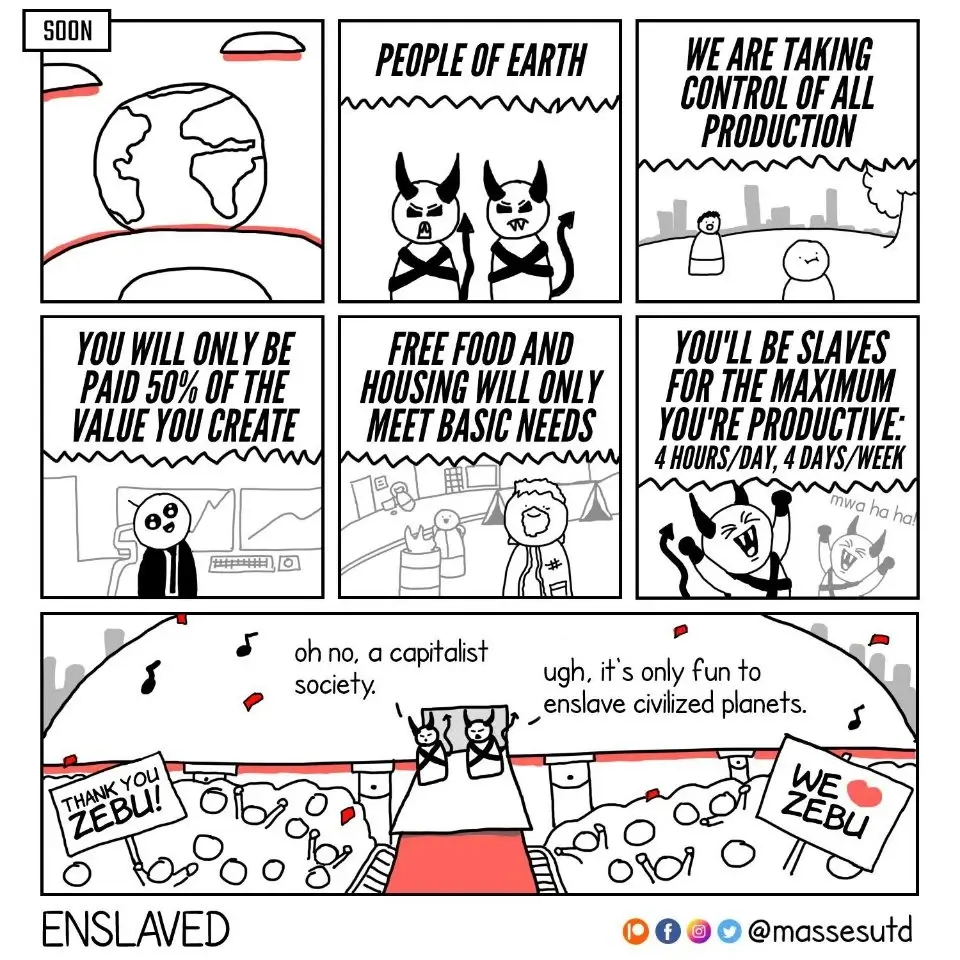
- Casteist by Design : How Discrimination Configures India’s Platform Economy (logicmag.io)
being nonvegetarian in India is often a proxy for caste, ethnicity, and/or religious identity. Association with nonvegetarian food could lead to nonconsensual disclosure of status and risks ostracization of marginalized caste/religion customers (as well as delivery workers) in “upper caste,” vegetarian neighborhoods, where meat eaters often face discrimination when renting or buying properties.
- Géorgie : le parti au pouvoir demande l’interdiction des principaux partis d’opposition (rfi.fr)
Le président du Parlement de Géorgie, Shalva Papuashvili, a annoncé ce mardi 28 octobre que le gouvernement avait saisi le Conseil constitutionnel afin d’interdire les trois plus gros partis d’opposition. Il n’exclut pas également de s’attaquer à d’autres partis dans un avenir proche.
- No Accountability, No Trust : Serbia, One Year after the Novi Sad Disaster (balkaninsight.com)
The Novi Sad railway station disaster last November cost 16 lives and sparked the biggest protest movement in Serbia for a quarter of a century. But despite the public outcry, the judiciary hasn’t managed to hold anyone accountable yet.
- Trump’s Yemen Strike Killed 61 Immigrants and No Combatants (theintercept.com)
The attack on Sa’ada detention center violated humanitarian law and should be investigated as a war crime, says Amnesty International.
Voir aussi Amnesty International accuse les États-Unis de crimes de guerre après le bombardement d’un centre de migrants au Yémen (humanite.fr)
- Calls Grow for Humanitarian Ceasefire in Sudan as RSF Forces Seize Key City of El Fasher in Darfur (democracynow.org)
Sudan’s military has withdrawn from El Fasher, its last stronghold in the country’s Darfur region, ceding control of the city to the paramilitary Rapid Support Forces after an 18-month siege. […] Fighting between the Sudanese military and RSF has killed more than 150,000 people and displaced about 12 million since 2023.
- UK military equipment used by militia accused of genocide found in Sudan, UN told (theguardian.com)
- Conférence de Paris : que cachent vraiment les 1,5 milliard d’euros promis à la région des Grands Lacs africains (humanite.fr)
La Conférence de Paris, qui se tenait ce 30 octobre en présence de plusieurs chefs d’État, a permis de mobiliser des fonds pour les populations touchées par le conflit dans la région, notamment en RDC. Si le chiffre affiché est à nuancer, cela a toutefois mis en lumière les ravages de ces guerres trop souvent oubliées.
- Présidentielles en Tanzanie : Selon l’opposition la répression des manifestations contre des « élections truquées » a déjà fait 700 morts (humanite.fr)
La Tanzanie est dans le chaos après des élections présidentielles et législatives contestées […] De nombreux manifestants sont descendus dans la rue pour protester contre le gouvernement et des élections sans opposition. Un couvre-feu est décrété depuis mercredi soir et internet a été coupé à plusieurs intervalles.
- En Norvège, écologistes et Sámis s’unissent contre une mine qui « éradiquera toute forme de vie » (reporterre.net)
- Scandale des aides de la PAC en Grèce : 13 personnes en détention provisoire (rfi.fr)
Treize personnes ont été placées ce mardi 28 octobre en détention provisoire, dont le chef présumé du réseau d’escrocs impliqué dans le vaste scandale de détournement de subventions agricoles européennes. Au total, le montant du préjudice au budget européen est estimé à près de 20 millions d’euros.
- « L’Espagne fait partie de l’épicentre du changement climatique », alerte le député Alberto Ibañez Mezquita (humanite.fr)
Plus que la démission de Carlos Mazon, le député de Valence Alberto Ibañez Mezquita réclame un changement radical de politique urbanistique dans la province et dans le pays. Il alerte sur les conséquences désastreuses qu’engendrerait une nouvelle catastrophe dans la métropole.
- How will the EU’s new border system work ? (bbc.com)
- Limitation du droit de grève : une stratégie à l’œuvre à l’échelle européenne (rapportsdeforce.fr)
la définition toujours plus floue de ce qu’est un service essentiel, de plus en plus répandue en Europe, est bien une manière de limiter au maximum le droit de grève.
- Les chiffres fous du lobbying de la Tech à Bruxelles (multinationales.org)
Les dépenses annuelles de lobbying du secteur de la Tech atteignent désormais 151 millions d’euros, leur plus haut niveau de l’histoire et une augmentation d’un tiers depuis 2023. Dix entreprises seulement représentent 49 millions d’euros annuels de dépenses de lobbying. Meta (Facebook) occupe la première place avec 10 millions d’euros.
- “It’s not about security, it’s about control” – How EU governments want to encrypt their own comms, but break our private chats (techradar.com)
- Half-good new Danish Chat Control proposal (patrick-breyer.de)
Instead of mandating the general monitoring of private chats (“detection orders”), the searches would remain voluntary for providers to implement or not, as is the status quo.[…] However, three fundamental problems remain unsolved : 1) Mass surveillance 2) Digital house arrest 3) Anonymous communications ban
- La Commission lancera un CIED pour les biens communs numériques afin de soutenir une infrastructure et une technologie numériques européennes souveraines (digital-strategy.ec.europa.eu)
La Commission européenne a adopté aujourd’hui une décision établissant le consortium pour une infrastructure numérique européenne commune numérique (DC-EDIC), un nouvel instrument permettant aux États membres de développer, de déployer et d’exploiter conjointement des infrastructures numériques transfrontières dotées d’une gouvernance et d’une personnalité juridique spécifiques.
- Législatives aux Pays-Bas : le parti centriste remporte les élections et bat l’extrême droite (humanite.fr)
- Irlande : Catherine Connolly, soutenue par la gauche, élue présidente (politis.fr)
- « L’ouragan Melissa nous a tué·es » : un premier bilan de 50 morts dans les Caraïbes et le lancement vital de la mobilisation internationale (humanite.fr)
- A tool tracking billion dollar disasters is active again after being retired by Trump administration (vernonreporter.com)
- Défié par Poutine, Trump ordonne la reprise des essais d’armes nucléaires aux États-Unis (huffingtonpost.fr)
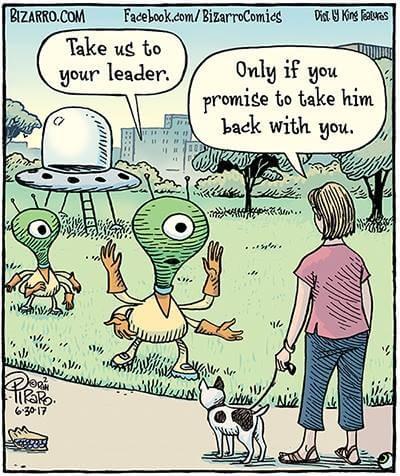
- Chicago school board members call for remote learning amid ICE raids (abcnews.go.com)
- USA : L’ICE chassée d’un village à Chicago (secoursrouge.org)
Le village de Mount Prospect, à Chicago se mobilise pour mener la vie dure aux agents de l’ICE. Celle-ci prétendait rechercher un “détenu en fuite”, c’est l’une des nombreuses raisons invoquées par les agents pour justifier leur présence. Ils n’étaient manifestement pas les bienvenus, et les habitants se sont mobilisés pour affronter les agents masqués.
- « Ça n’a pas l’air réel » : aux États-Unis, un retraité de 61 ans a passé 1 mois en prison pour un post Facebook sur Trump et Kirk (leparisien.fr)
Accusé d’avoir incité à la haine, un habitant du Tennessee a été libéré après avoir passé un mois derrière les barreaux. Sa caution était fixée à 2 millions de dollars mais le Procureur a fini par abandonner les poursuites après que son cas a ému le public.
- “Je n’ai pas de visa” : le Nigérian Wole Soyinka, prix Nobel de littérature, interdit d’entrée aux États-Unis (franceinfo.fr)
- « Lâche cette casserole ou je te tire une balle dans la tête » : aux États-Unis, le policier derrière le meurtre raciste de Sonya Massey reconnu coupable (humanite.fr)
- Gunboat Diplomacy in the Caribbean (counterpunch.org)
The Trump administration has now conducted 10 known strikes on boats off the Venezuelan and Colombian coasts that supposedly carry drugs destined for the US. The administration has now amassed a veritable armada in the region—several attack boats, a nuclear-capable submarine, an aircraft carrier strike group, a Marine expeditionary unit, and 10 F-35 fighter jets. In all, around 10,000 soldiers and sailors are involved.
- Lithium in Mexico : From Illusion to Uncertainty (elclip.org)
- Amérique latine : sous couvert de lutte antidrogue, l’ingérence de Washington (stup.media)
Derrière la tension croissante entre Caracas, Bogotà et Washington, c’est une vieille histoire qui ressurgit […] Depuis les années 1980, les États-Unis utilisent la lutte antidrogue comme levier d’influence politique et militaire. Du Plan Colombia à la base de Manta, l’ombre de la doctrine Monroe continue de planer, désormais face à un nouvel adversaire : la Chine.
- Argentine : Javier Milei remporte une large victoire aux législatives de mi-mandat (legrandcontinent.eu)
Le parti du président argentin, La Libertad Avanza, a remporté les élections législatives d’hier, le 26 octobre. Avec un score de 40,7 % et une participation de 68 % — la plus faible depuis le retour de la démocratie en 1983 —, cette victoire devrait lui donner de grandes marges de manœuvre pour mettre en œuvre son programme.
Voir aussi En Argentine, la large victoire de Javier Milei aux législatives lui offre un boulevard pour poursuivre sa politique (huffingtonpost.fr)

- Attaques des États-Unis, élections, manifestations : l’Amérique latine en ébullition (portail.basta.media)
Des exécutions extrajudiciaires commises par les États-Unis au large de la Colombie et du Venezuela, des manifestations réprimées au Pérou et en Équateur, des élections en Bolivie et en Argentine. Récit d’une semaine mouvementée en Amérique du Sud.
- In Rio’s largest favela, used oil becomes soap and social change (news.mongabay.com)
- Is it cheaper to end poverty than to maintain it ? Research says yes (abc.net.au)
In November 2024, the NSW Council of Social Service released a report on the economic costs of child poverty […] It found poverty costs New South Wales $60 billion every year.That included $25 billion in direct costs to governments and the economy, and $34 billion in costs related to diminished health and life expectancy due to child poverty.It was equivalent to 7.8 per cent of gross state product.
- Why the world’s top universities are abandoning the ranking system (scroll.in)
Institutes are questioning the value and methods used by ranking companies, which can focus more on research output than other parameters.The Sorbonne University, founded in Paris in 1253 and known globally as a symbol of education, science and culture, has just announced that, starting in 2026, it will stop submitting data to Times Higher Education (THE) rankings.
- Most of the world’s space launches are controlled by just three countries (restofworld.org)
China, the U.S., and Russia dominate space launches. Can alternatives emerge ?
- Pourquoi les satellites exposent toute votre vie privée dans l’espace (01net.com)
- Ces 601 bombes climatiques qui compromettent l’Accord de Paris (reporterre.net)
- Ce rapport du « Lancet » quantifie pour la première fois les morts liées au changement climatique (huffingtonpost.fr)
- « Les systèmes de santé seront bientôt débordés » : un rapport alerte sur les conséquences sanitaires du changement climatique (reporterre.net)
- ‘Change course now’ : humanity has missed 1.5C climate target, says UN head (theguardian.com)
‘Devastating consequences’ now inevitable but emissions cuts still vital, says António Guterres in sole interview before Cop30
- Bill Gates makes a stunning claim about climate change (edition.cnn.com)
In a stunning and significant pushback to the “doomsday” climate activist community, Bill Gates, a leading proponent for carbon emissions reductions, published a remarkable essay Tuesday that argued resources must be shifted away from the battle against climate change.
- Data centers : quand la soif du numérique assèche les sols américains (franceinfo.fr)
- Publicité embarquée : Tesla ouvre la voie à une nouvelle dérive dans nos voitures toujours plus connectées (automobile-magazine.fr)
La dernière mise à jour des Tesla remplace les voitures de la visualisation de conduite par les motos lumineuses de Tron : Ares, film futuriste de Disney. Derrière cette animation de prime abord ludique se cache un précédent inquiétant : une publicité intégrée directement dans l’interface du véhicule. En transformant l’écran de bord en espace promotionnel, Tesla franchit une ligne symbolique : celle qui sépare la voiture connectée du panneau publicitaire roulant.
- Comment la guerre autour de Nexperia pourrait mettre l’industrie automobile à l’arrêt (aktionnaire.com)
- Neural network finds an enzyme that can break down polyurethane (arstechnica.com)
Given a dozen hours, the enzyme can turn a foam pad into reusable chemicals.
- Mathematical proof debunks the idea that the universe is a computer simulation (phys.org)
- Mozilla to Require Data-Collection Disclosure in All New Firefox Extensions (linuxiac.com)
Starting November 3, all new Firefox extensions must declare whether they collect or share user data, ensuring greater transparency for users.
- The PSF has withdrawn a $1.5 million proposal to US government grant program (pyfound.blogspot.com) – voir aussi La fondation Python renonce à une subvention de 1,5 million de dollars plutôt qu’à ses valeurs (zdnet.fr)
Pour obtenir cette somme, la fondation devait s’engager à ne mener aucune action en faveur de la diversité, l’équité ou l’inclusion (DEI), une des exigences politiques de l’administration Trump.
Et Python Software Foundation : Equal Opportunity More Important Than US Funding (heise.de)
Pour soutenir la Fondation Python : Support The Python Software Foundation ! (python.org)
Spécial IA
- Google annonce le redémarrage d’une centrale nucléaire aux États-Unis (lapresse.ca)
Google a annoncé lundi avoir passé un accord avec le groupe américain NextEra Energy qui prévoit la remise en service début 2029 de la centrale nucléaire Duane Arnold, dans l’Iowa (centre), pour le développement des infrastructures de l’IA du géant californien. C’est le troisième projet de réouverture de centrale dévoilé récemment, après ceux concernant les sites de Palisades (Michigan) en 2023 et Three Mile Island (Pennsylvanie) en 2024
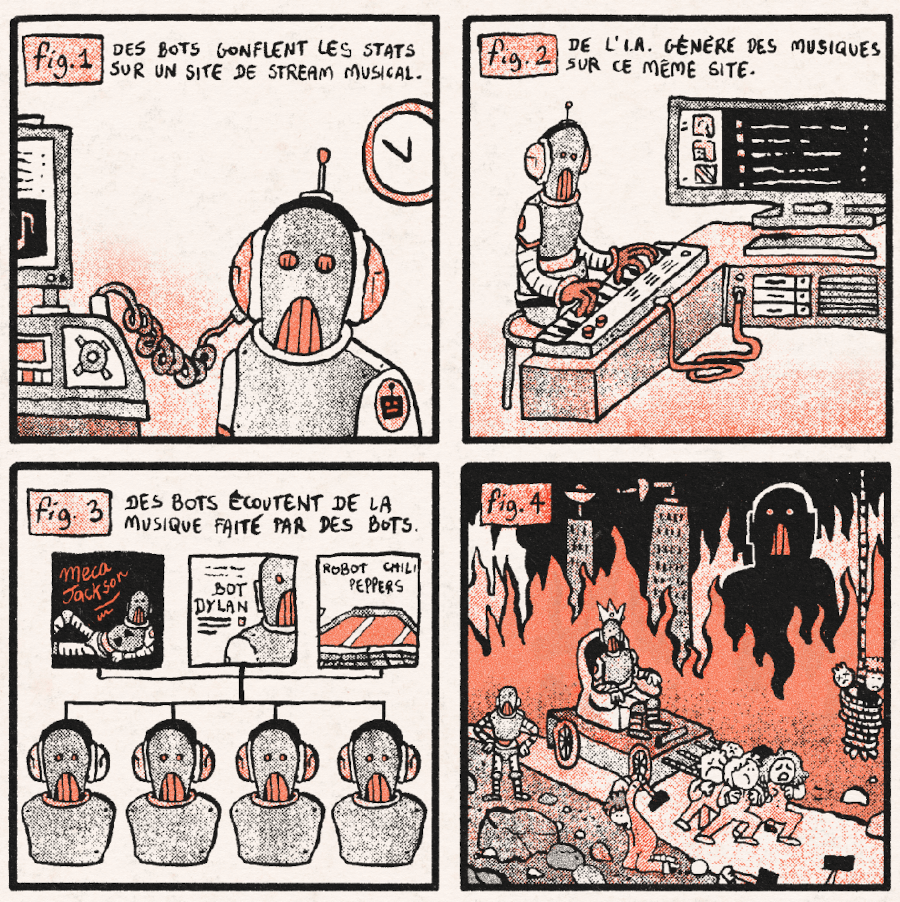
- Data centers turn to commercial aircraft jet engines bolted onto trailers as AI power crunch bites — cast-off turbines generate up to 48 MW of electricity apiece (tomshardware.com)
Faced with multi-year delays to secure grid power, US data center operators are deploying aeroderivative gas turbines — effectively retired commercial aircraft engines bolted into trailers — to keep AI infrastructure online.
- Jet engine shortages threaten AI data center expansion as wait times stretch into 2030 — the rush to power AI buildout continues (tomshardware.com)
Wait times for mobile gas turbines stretch into the 2030s as hyperscalers race to buy every jet engine they can find.
- Sam Altman : OpenAI wants to get to $1 trillion a year in infrastructure spend (axios.com)
Reality check : Altman said the company still faces technical and financial hurdles to get to that lofty goal.
- Microsoft sued for allegedly misleading millions of Australians with its AI pricing (theguardian.com) – voir aussi Australia sues Microsoft for forcing Copilot AI onto Office 365 customers (pivot-to-ai.com)
If you’re in Australia and you were hit by that charge, call your reseller or Microsoft — or write to them — and demand your upgrade money back because Microsoft took it under false pretences, and you want to revert to the Classic plan. If they demur, document everything and tell the ACCC. And the judge when it hits court.
- Ces vidéos générées par IA sur l’ouragan Melissa propagent des fake news en Jamaïque (huffingtonpost.fr)
- AI “Phone Farm” Startup Gets Funding from Marc Andreessen to Flood Social Media With Spam (futurism.com)
Introducing Doublespeed, a startup operating a phone farm to flood social media with AI-generated slop on behalf of its clients. In a nutshell, phone farming is a tactic most often used by hackers and financial criminals to use large numbers of devices to send spam texts, farm social media engagement, or generate fake reviews.
- Du mème au « fait » indexé : un YouTuber révèle comment il a trompé Google en lui faisant croire que GTA 6 comporterait un « bouton twerk » (developpez.com)
- Avec 45 % d’erreurs, l’IA produit une “distorsion systémique de l’information” (archimag.com)
- BBC probe finds AI chatbots mangle nearly half of news summaries (theregister.com)
Google Gemini worst offender with 76 % error rate
- US student handcuffed after AI system apparently mistook bag of chips for gun (theguardian.com)
Baltimore county high schools last year began using a gun detection system using school cameras and AI to detect potential weapons. If it spots something it believes to be suspicious, it sends an alert to the school and law enforcement officials.
- OpenAI says over a million people talk to ChatGPT about suicide weekly (techcrunch.com)
OpenAI released new data on Monday illustrating how many of ChatGPT’s users are struggling with mental health issues and talking to the AI chatbot about it.
- Navigateurs IA, la fausse bonne idée dont personne n’a besoin (clubic.com)
OpenAI, Perplexity, Opera, Google, Microsoft : tous les géants du Web semblent avoir cédé à la fièvre du navigateur IA, ou navigateur agentique. Et tous promettent de révolutionner notre façon de naviguer sur le web avec des algorithmes de plus en plus sophistiqués. Mais pas un seul ne semble s’être vraiment posé les bonnes questions : quel en est l’intérêt, qui s’en servira et quelles seront les conséquences ? […] Les chercheurs de Brave ont démontré qu’un simple commentaire Reddit contenant des instructions cachées pourrait forcer un navigateur agentique à effectuer des transferts bancaires ou à partager des données confidentielles. Le principe est simple : les LLM qui pilotent ces navigateurs ne savent pas distinguer les instructions légitimes des données qu’ils traitent. Quand un agent lit une page web, il peut interpréter du texte malveillant comme une commande à exécuter. […] Les standards d’accessibilité comme WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), fruits de décennies de progrès, disparaissent au profit d’interfaces optimisées pour l’IA. Les utilisateurs handicapés d’une déficience visuelle doivent-ils en plus perdre leur autonomie en déléguant tout à une IA qui, nous le savons bien, peut se tromper, voire halluciner ?
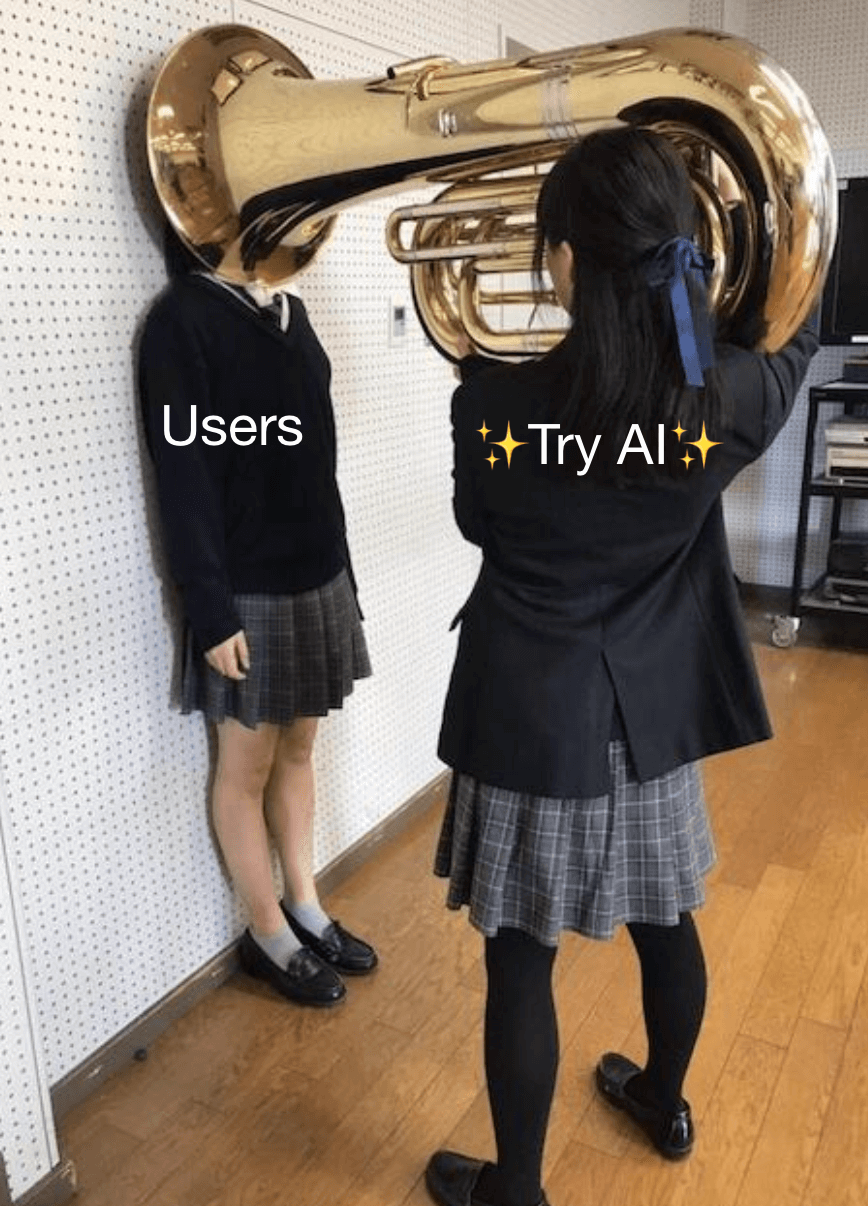
- ChatGPT’s Atlas : The Browser That’s Anti-Web (anildash.com)
The problems fall into three main categories:1/ Atlas substitutes its own AI-generated content for the web, but it looks like it’s showing you the web2/ The user experience makes you guess what commands to type instead of clicking on links3/ You’re the agent for the browser, it’s not being an agent for you
- Why open source may not survive the rise of generative AI (zdnet.com)
Generative AI may be eroding the foundation of open source software. Provenance, licensing, and reciprocity are breaking down.
- Bulle de l’IA : « 70 % du cloud est contrôlé par trois entreprises américaines », une conversation avec Meredith Whittaker, présidente de Signal (legrandcontinent.eu)
- Grokipedia Is the Antithesis of Everything That Makes Wikipedia Good, Useful, and Human (404media.co)
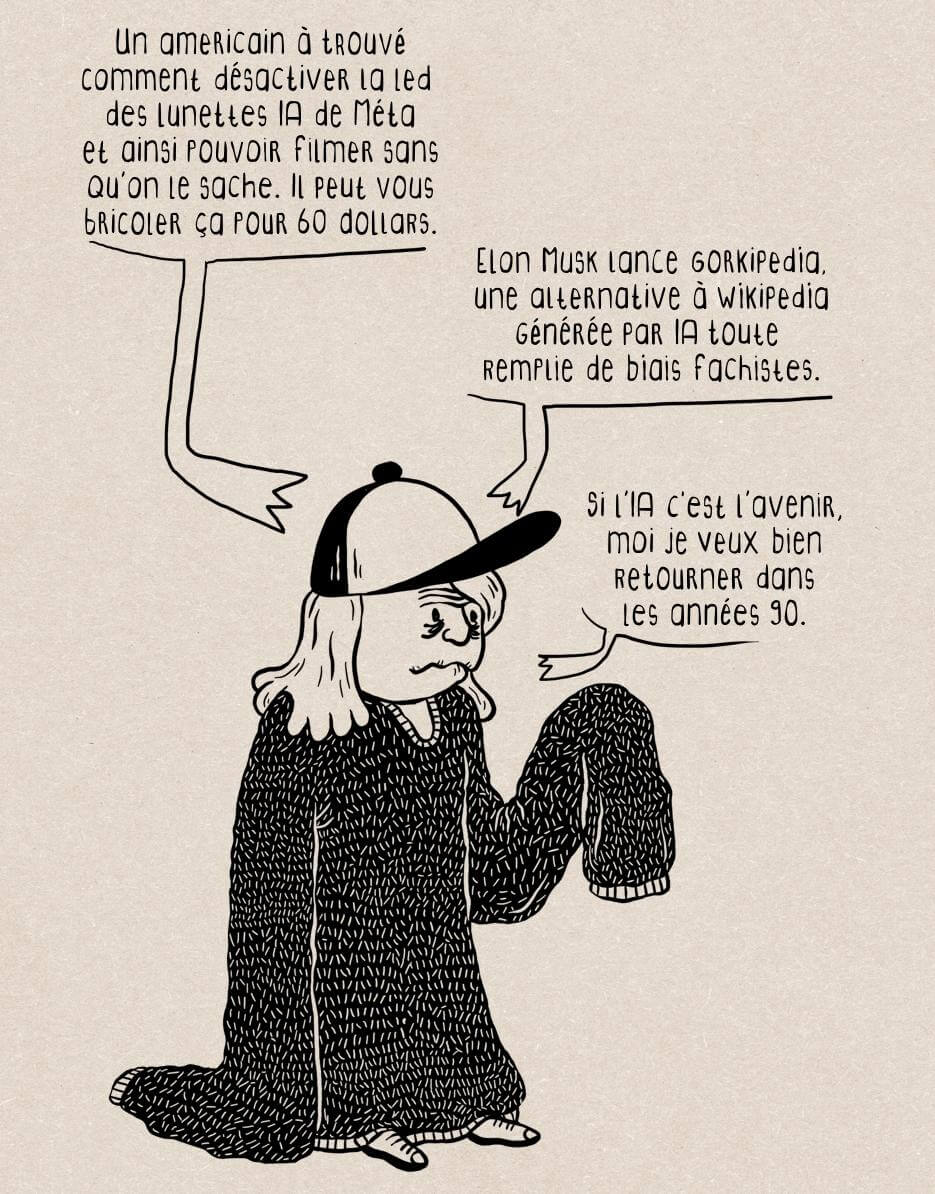
Spécial Palestine et Israël
- Israel demanded Google and Amazon use secret ‘wink’ to sidestep legal orders (theguardian.com)
The tech giants agreed to extraordinary terms to clinch a lucrative contract with the Israeli government, documents show […] the companies must send signals hidden in payments to the Israeli government, tipping it off when it has disclosed Israeli data to foreign courts or investigators.
- Israel strikes Gaza again after overnight bombardment that killed at least 104 (theguardian.com)
- « Ils devaient riposter » : Donald Trump soutient les bombardements « immédiats » et « puissants » d’Israël au détriment des Palestinien·nes (humanite.fr)
Le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a ordonné à l’armée de mener des bombardements immédiats sur la bande de Gaza, après avoir accusé le Hamas de violation de l’accord de cessez-le-feu. Une énième tentative de laisser l’organisation palestinienne porter seule la faute
- La planification du nettoyage ethnique de la Palestine (contretemps.eu)
Dès sa fondation, le sionisme se présente comme un projet d’État-nation, et comme un projet colonial.
- À Gaza, l’impossible identification des corps de Palestiniens restitués par Israël (rfi.fr)
Dans la bande de Gaza, les corps de Palestiniens restitués par Israël peinent à être identifiés. Nombre d’entre eux sont rendus dans des conditions qui ne permettent pas leur identification, et présentent des traces de torture ou d’exécution. Ce mardi 28 octobre, 41 corps ont dû être enterrés sans noms.
- Solidarité avec Gaza. Lettre à la Philharmonie de Paris (orientxxi.info)
Un collectif d’intermittents du spectacle […] réclame la déprogrammation du concert de l’Orchestre philharmonique d’Israël le 6 novembre, institution indissociable de l’État colonial génocidaire.
Voir aussi Décoloniser la musique classique, un devoir de justice (orientxxi.info)
Le pianiste Adam Laloum, musicien classique juif et antisioniste, explique pourquoi il faut déprogrammer ce concert.
- Fedipourgaza (fedipourgaza.codeberg.page)
Le 19 octobre 2025, un canal s’est ouvert quelque part sur Mastodon, comme un feu allumé au creux d’un champ. Il n’y avait pas d’institution, pas de drapeau, seulement des voix qui s’appelaient, des gens qui se reconnaissaient. Ce petit groupe, on l’a nommé fedipourgaza. Ce n’est pas une organisation, mais un fil tendu entre des inconnu·es qui refusent de détourner les yeux. Une poignée d’humaines et d’humains qui croient qu’il est encore possible de réparer quelque chose du monde, pixel après pixel.
Spécial femmes dans le monde
- Une sage-femme voit ses comptes Facebook et Instagram supprimés après s’être exprimée dans un reportage sur l’IVG (france3-regions.franceinfo.fr)
Elle soupçonne un signalement massif de la part de militants anti-avortement.
- Affaire Epstein : Charles III a amorcé un « processus formel » pour retirer ses titres au prince Andrew (lemonde.fr)
- Contre-révolution masculiniste aux USA : associer le virilisme au nationalisme et à la violence (ricochets.cc)
- La révolution anthropologique du féminisme et ses ennemis (legrandcontinent.eu)
Le masculinisme est devenu la matrice de la réaction.
- Male America Great Again (legrandcontinent.eu)
Depuis l’Amérique de Trump, une vague masculiniste est en train de s’abattre sur le monde. Comment organiser la résistance ?
- Aux États-Unis, les femmes noires prennent les armes (revueladeferlante.fr)
Confrontées à la violence raciste, urbaine ou intrafamiliale, les femmes noires étasuniennes sont de plus en plus nombreuses à se procurer des pistolets.
- Des Antigone modernes : comment le deuil transforme les Mères en détectives sauvages (visionscarto.net)
Iran, Turquie, Argentine… dans de nombreux pays, les Mères endeuillées demandent justice, mais surtout d’obtenir la vérité. Elles construisent des contre-archives qui s’opposent à la version officielle des autorités.
L’insolite de la semaine
Spécial France
- Budget 2026 : l’Assemblée alourdit la taxe Gafam (reporterre.net)
Cet impôt payé par les grandes entreprises telles que Google, Facebook ou Amazon voit son taux passer de 3 % à 6 %. Cette nouvelle taxe s’appliquera désormais aux entreprises réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 2 milliards d’euros, contre 750 millions précédemment.
- Les banques vont devoir refuser les découverts automatiques dès 2026 (clubic.com)
Dans à peine plus d’un an, le découvert bancaire automatique deviendra un crédit à la consommation. La nouvelle réglementation européenne impose des règles strictes qui risquent de priver les ménages les plus fragiles de ce filet de sécurité.
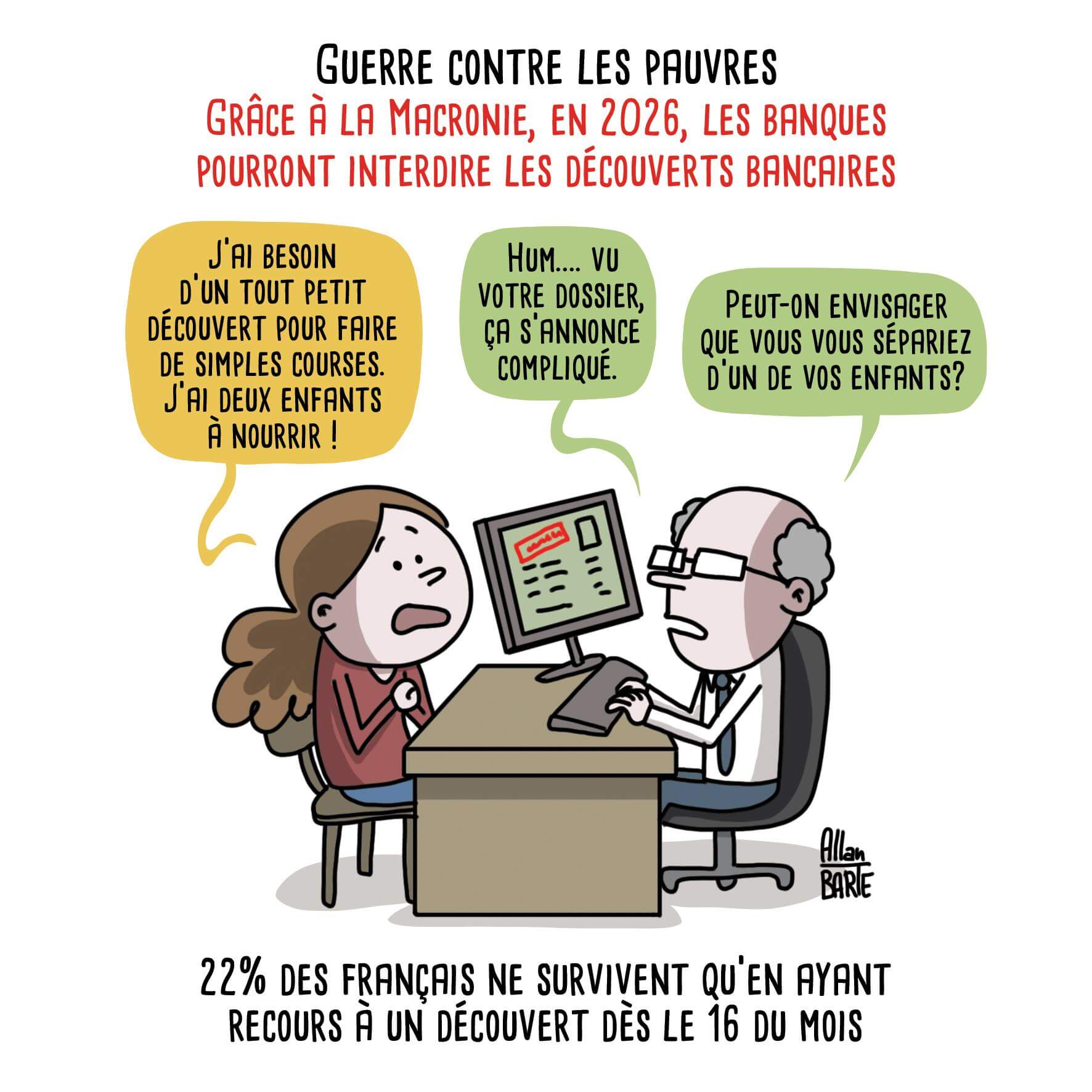
- Le gouvernement acte la disparition de 60 millions de consommateurs (actualitte.com)
- Trains de nuit : un amendement pour sauver le Paris-Berlin et Paris-Vienne (reporterre.net)
poussés par l’écologiste Marie Pochon, les députés de la commission du développement durable à l’Assemblée nationale ont adopté un amendement rétablissant la subvention de 5 millions d’euros pour les trains de nuit Paris-Berlin et Paris-Vienne. Si l’ancien gouvernement de François Bayrou prévoyait de supprimer celle-ci, ce vote laisse entrevoir la possibilité d’un maintien du trafic en 2026.
- La navigation sur le canal du Midi interdite à cause de la sécheresse (reporterre.net)
Terminé les promenades en péniche sur le canal du Midi. À partir du 3 novembre, le célèbre ouvrage fermera ses écluses et la navigation y sera interdite jusqu’à nouvel ordre.
- Milliers de dauphins tués : des caméras deviennent obligatoires sur les bateaux de pêche (reporterre.net)
À partir du 31 octobre, des caméras de surveillance devront obligatoirement être installées sur les bateaux de pêche sillonnant le golfe de Gascogne. Imposée par les autorités maritimes, la mesure intervient à la suite des multiples captures accidentelles de dauphins, piégés dans les filets de ces navires.
- Littoral français : l’Ifremer révèle la “carte noire” de la pollution chimique invisible (aqui.media)
- Lactalis : l’ogre du lait continue de polluer en toute impunité (disclose.ngo)
Manquements à la sécurité alimentaire, dissimulation d’informations, rejets toxiques répétés dans les cours d’eau français : en 2020, Disclose publiait une enquête au long cours sur le système Lactalis, provoquant un large battage médiatique, jusqu’à un appel au boycott des marques du groupe. 5 ans plus tard […] sur les 38 usines épinglées à l’époque, pas moins de 13 sont toujours en infraction avec la loi
- Infertilité masculine et pesticides : un danger invisible ? (theconversation.com)
Selon certaines estimations, 20 % à 30 % des cas sont directement imputables à des problèmes touchant les hommes. En marge des facteurs liés aux modes de vie, un faisceau d’indices semble incriminer notamment certains polluants environnementaux, tels que les pesticides.
- Cinq millions d’enfants victimes de harcèlement : « Tous les jours, l’un d’eux nous appelle en disant qu’il veut mourir » (humanite.fr)
Le 30 octobre, l’association e-Enfance a publié son rapport annuel sur le harcèlement et le cyberharcèlement. Près de deux jeunes sur cinq disent en avoir été victimes. Derrière les chiffres, un mal plus profond : la santé mentale des enfants se dégrade, tandis que les réseaux sociaux échappent toujours à tout contrôle.
Spécial femmes en France
- Ménopause : les traitements hormonaux en vogue malgré les risques de cancer (reporterre.net)
La ménopause est-elle une maladie qu’il faut soigner ? Largement abandonnés depuis deux décennies car provoquant des cancers du sein, les traitements hormonaux de la ménopause (THM) sont de nouveau promus, depuis deux ans, au nom de la souffrance des personnes concernées. Cette campagne de réhabilitation repose surtout sur une dramatisation des effets du vieillissement sur le corps des femmes. Son corollaire : un boulevard pour les fabricants de médicaments. […] « En prétendant que le THM permettait que “la femme reste femme”, le discours médical et pharmaceutique renforçait l’idée implicite que la femme n’est plus une femme à la ménopause, et proposait une soi-disant solution biologique à une perte de statut socialement construite par la domination masculine sur les femmes après l’arrêt de leur fertilité. »
- Rébecca Chaillon cyberharcelée : l’extrême droite, un fantôme sur le banc des accusés (politis.fr)
Sept personnes comparaissaient la semaine dernière devant le tribunal de Paris pour cyberharcèlement à l’encontre de la metteuse en scène Rébecca Chaillon et de sa productrice. Si Gilbert Collard et Éric Zemmour étaient à l’origine de cette vague de haine, ils n’ont pas été inquiétés pour autant.
- La définition du viol dans le code pénal révolutionnée par cet ultime vote au Parlement sur le non-consentement (huffingtonpost.fr)
Dans la foulée de l’Assemblée nationale, le Sénat a approuvé la nouvelle définition du viol, définit comme « tout acte sexuel non consenti » par la victime.
- 87 % des viols hors cadre familial sont commis par des hommes français… Pourquoi l’extrême droite préfère le mensonge utile de l’agresseur étranger (humanite.fr)
- À Bobigny, deux policiers en garde à vue, soupçonnés de viols dans l’enceinte du tribunal (huffingtonpost.fr)
Une jeune femme de 26 ans accuse les deux fonctionnaires du tribunal de Bobigny de viols dans le dépôt du tribunal. Ils ont d’ores et déjà été suspendus de leurs fonctions.
- Un policier condamné pour agressions sexuelles sur six femmes, dont une mineure, dans un commissariat parisien (streetpress.com)
Dans le commissariat parisien du 20e, un policier a photographié, partiellement nues, six femmes gardées à vue ou plaignantes, et en a agressé deux sexuellement, dont une mineure. Radié, il a été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis.
- Féminicides : 107 femmes tuées en 2024, un chiffre en nette hausse (huffingtonpost.fr)
En 2024, 107 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en France, un chiffre en hausse de 11 % par rapport à l’année précédente.
Spécial médias et pouvoir
- Salamé, Demorand, Duhamel & cie : le grand braquage du service public (acrimed.org)
- LCI en guerre contre la taxe Zucman (et contre l’information) (acrimed.org)
- L’outrecuidance bouffonne de Franz-Olivier Giesbert contre Bourdieu (acrimed.org)
Spécial emmerdeurs irresponsables gérant comme des pieds (et à la néolibérale)
- Budget 2026 : la taxe Zucman rejetée par l’Assemblée nationale (reporterre.net) – voir aussi Rejet de la Taxe Zucman : « Il n’y a pas eu le moindre compromis » (humanite.fr)
- La conférence Travail et Retraites lancée dès le 4 novembre, annonce Jean-Pierre Farandou (humanite.fr)
Cette conférence, promise par Sébastien Lecornu, doit notamment statuer sur le modèle du régime des retraites et leurs financements. La CFDT se dit favorable à une réforme à points. Une mesure « qui aurait pour conséquence une baisse du niveau des pensions et un recul de la solidarité », rétorque la CGT.
- Aide Médicale d’État : pourquoi le durcissement annoncé par Sébastien Lecornu est « un non-sens total » (humanite.fr)

- Pour les plus précaires, « les politiques de sobriété sont souvent paternalistes et déconnectées » (reporterre.net)
- Emmanuel Macron favorable au Mercosur : la société civile l’interpelle (basta.media)
Après avoir longtemps affiché son opposition, le président affirme que la France pourrait ratifier l’accord de libre-échange avec les pays du Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay). 40 organisations l’appellent à bloquer cet accord.
- Le fonds Vivéa sacrifie les transitions agricoles (blogs.mediapart.fr)
- La ministre de l’Agriculture accusée par des scientifiques d’édulcorer un rapport sur la santé (reporterre.net)
- Dans le Finistère, les paysan·nes au RSA dans le viseur du Département (splann.org)
- Olivier Faure assure que “nous saurons si nous allons à la dissolution” à la fin de la semaine prochaine (bfmtv.com)
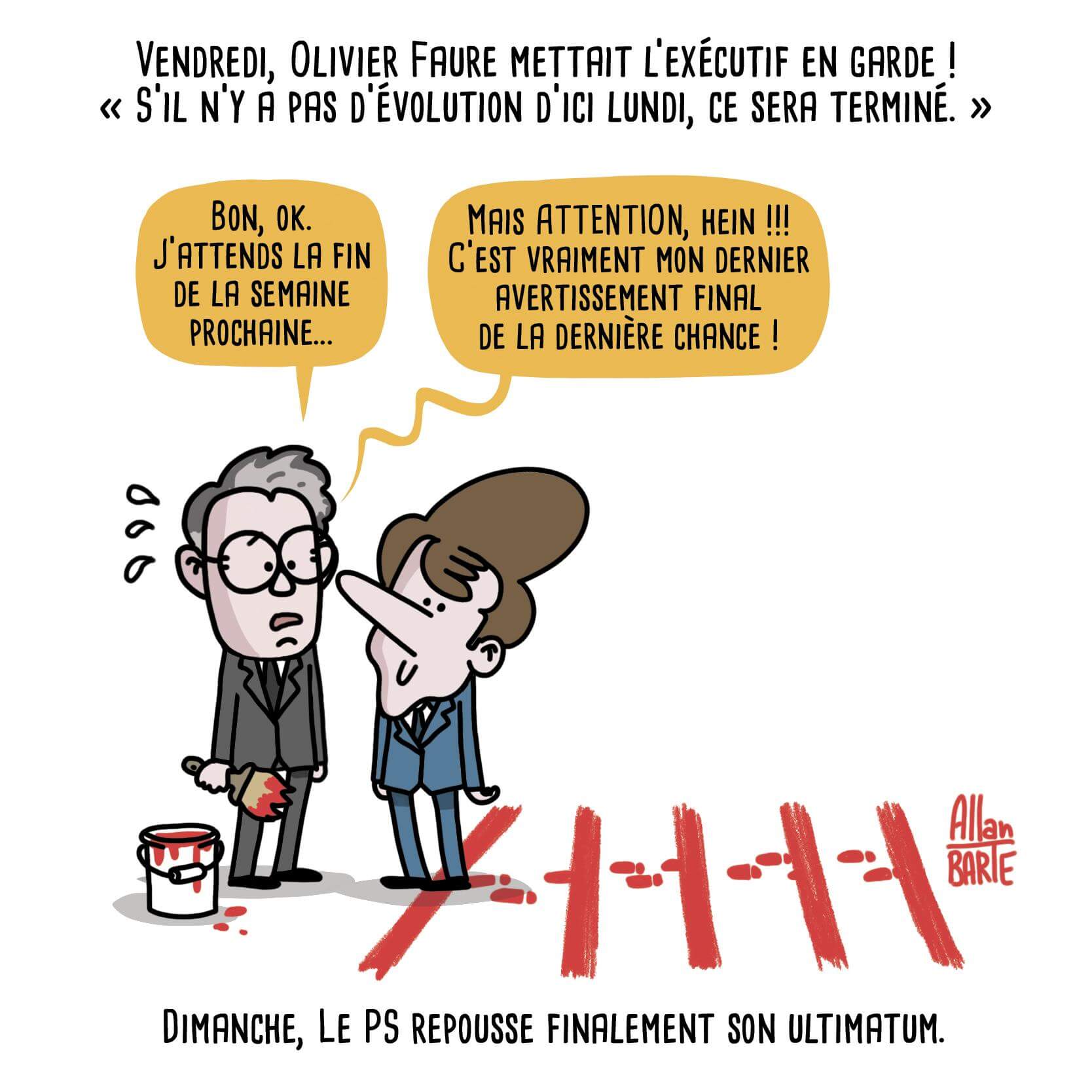
Spécial recul des droits et libertés, violences policières, montée de l’extrême-droite…
- Algérie : unis derrière le RN, les députés effacent la mémoire coloniale (politis.fr)
L’Assemblée nationale a adopté, pour la première fois sous la Ve République, un texte du Rassemblement national. Il ne fallait qu’une voix de plus pour l’en empêcher. Derrière la technicité du débat sur l’accord franco-algérien de 1968, c’est un basculement politique majeur.
- Avocat, mais pas assez Français ? › (blogs.mediapart.fr)
- Après Zyed et Bouna, ce que changent les révoltes urbaines aux violences policières (basta.media)
Des interventions policières mortelles ont fait s’embraser les quartiers plus de cent fois depuis 1977 en France. Avec les mobilisations qui les accompagnent, ces évènements médiatisés ont des effets contrastés sur les violences policières.
- À la prison de la Santé, plus d’un millier de détenus dans l’ombre d’un seul, Sarkozy (politis.fr)
Le lundi 27 octobre 2025, les députés insoumis Ugo Bernalicis et Danièle Obono ont pu visiter la prison de la Santé pour échanger avec des détenus sur leur quotidien. Ils racontent des cellules bondées, loin de la médiatisation autour de l’ex-chef de l’État.
- Entassés dans des containers, 50 détenus de Kanaky gagnent au tribunal (politis.fr)
Une semaine après l’entrée à la prison de la Santé de Nicolas Sarkozy, une autre réalité carcérale a surgi, ce mardi 28 octobre. Saisi en urgence par 50 détenus du principal centre pénitentiaire en Kanaky/Nouvelle-Calédonie, le tribunal administratif a reconnu des conditions de détention indignes.
- Christian Tein : « Je pensais que l’époque des bagnards était révolue » (politis.fr)
Après un an de détention en métropole, le leader indépendantiste kanak revient sur sa situation et celle de la Kanaky/Nouvelle-Calédonie. Il dénonce l’accord de Bougival de l’été dernier et appelle à un accord qui termine le processus de décolonisation du territoire ultramarin.
Spécial résistances
- VISA 13 : Succès syndical à Aix-en-Provence contre les Nuits du « Bien Commun » (ripostes.org)
Encore une fois, une Nuit du « Bien Commun » était prévue le 6 octobre au 6Mic à Aix-en-Provence, sous couvert de caritatif et de temps de philanthropie apolitique et solidaire. Il s’agissait en réalité d’un événement faisant partie d’un plan plus large porté par un milliardaire d’extrême-droite exilé fiscal en Belgique, Pierre- Édouard Stérin. Cette nuit du Bien Commun a suscité l’opposition justifiée de nombreuses organisations syndicales, associatives, politiques […] Mais c’est surtout la grève des technicien·nes intermittent·es du spectacle recruté·es pour la journée, menée en intersyndicale SUD Culture, CNT-SO et CGT Spectacle et portant les revendications des organisations de salarié·es des arts et de la culture, qui a constitué une action efficace et conduit à l’annulation de l’événement.
- En grève de la faim, Vanessa se bat « pour la dignité des enseignants » (rue89strasbourg.com)
La professeure des écoles en est sûre. L’académie de Strasbourg a fait un choix de privilégier les contractuels. « À Rennes ou à Besançon, l’académie a fini par prendre toutes les personnes sur la liste. Je trouve ça horrible qu’ici je doive me battre pour pouvoir faire le métier que je veux alors qu’il y a des places… »
- Vingt ans après les révoltes sociales, l’appel des quartiers populaires (politis.fr)
Vingt ans après la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré, Politis consacre un numéro spécial aux violences policières dans les quartiers populaires. Cette tribune initiée par l’association ACLefeu – née à Clichy-sous-Bois en 2005 – vise à rassembler les voix de celles et ceux qui refusent l’oubli.
- À Clichy-sous-Bois, la mémoire de 2005 se transmet de génération en génération (bondyblog.fr)
Spécial outils de résistance
- Face aux « carences » de l’État, des citoyens apprennent à dénoncer les pollutions (reporterre.net) -voir aussi leur site (sentinellesdelanature.fr)
- Publicités trompeuses : signalez-les auprès d’un observatoire citoyen (reporterre.net)
Signaler une publicité abusive auprès d’un observatoire citoyen, c’est désormais possible. Sept associations, parmi lesquelles Les Amis de la Terre, Zero Waste, Résistance à l’agression publicitaire et Halte à l’obsolescence programmée, ont fondé le 27 octobre l’Observatoire citoyen de la publicité.
- Insolite : des adresses de sites internet pour Édouard Philippe et Gabriel Attal renvoient vers Médiapart (contre-attaque.net)
Spécial GAFAM et cie
- 10 ans après, le smartphone LEGO de Google ressurgit : et si on avait fait le mauvais choix ? (frandroid.com)
Vous vous souvenez du Project Ara ? Ce smartphone Google où on pouvait changer la batterie, le processeur, l’appareil photo comme des LEGO ? Des vidéos de prototypes ressortent 10 ans après. C’était génial. Ça n’a jamais marché. Et ça nous dit beaucoup sur pourquoi nos téléphones durent 2 ans au lieu de 6.
- ‘Keep Android Open’ Campaign Pushes Back on Google’s Sideloading Restrictions (pcmag.com)
Free Android app store F-Droid asks users to lobby government regulators to take action.
Voir aussi Keep Android Open (keepandroidopen.org)
In August 2025, Google announced that starting next year, it will no longer be possible to develop apps for the Android platform without first registering centrally with Google.
- Les data centers d’Amazon vont boire 29,1 milliards de litres d’eau par an d’ici 2030 (reporterre.net)
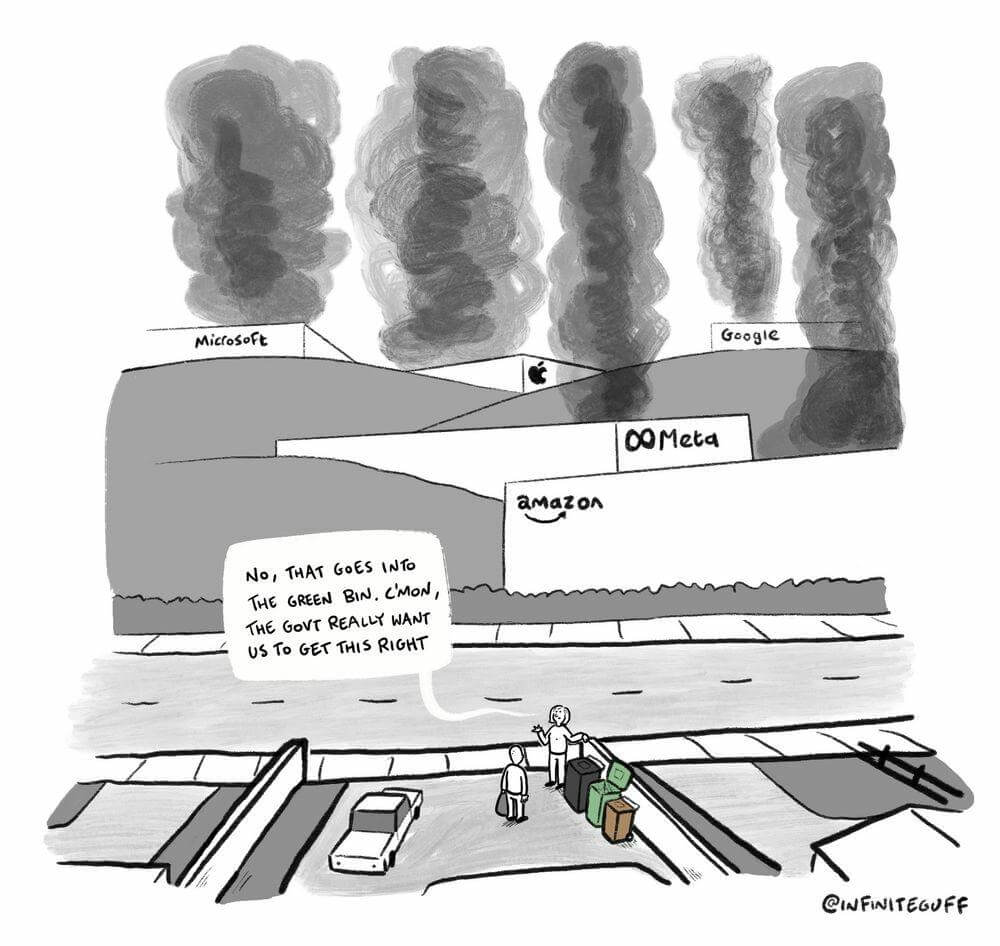
- ‘There isn’t really another choice :’ Signal chief explains why the encrypted messenger relies on AWS (theverge.com)
Meredith Whittaker is using the AWS outage as an opportunity to highlight the ‘concentration of power’ in the cloud infrastructure industry.
- Amazon targets as many as 30,000 corporate job cuts (reuters.com)
The figure represents a small percentage of Amazon’s 1.55 million total employees, but nearly 10 % of its roughly 350,000 corporate employees. This would mark Amazon’s largest job cut since late 2022, when it started to eliminate around 27,000 positions.
- Les lunettes Ray-Ban Meta déjà transformées en outil d’espionnage (generation-nt.com)
Un bricoleur américain a trouvé comment désactiver la LED d’enregistrement, contournant les protections de Meta. Cette modification, proposée pour 60 $, permet de filmer discrètement. Un marché noir émerge même sur eBay.
- Apple’s Family Sharing Helps Keep Children Safe. Until It Doesn’t (wired.com)
When families break down, the systems put in place to protect children online can fall apart too.
- Teams saura bientôt où vous êtes : Microsoft ajoute la localisation au cœur de son outil collaboratif (siecledigital.fr)
Teams sera bientôt capable d’indiquer dans quel endroit se trouvent les collaborateurices d’une organisation, à condition qu’iels soient connectés au réseau Wi-Fi de leur entreprise. […] Certain·es craignent que la géolocalisation puisse être activée à l’échelle de toute l’entreprise, sans le consentement individuel des employé·es. […] Microsoft assure que la fonctionnalité sera désactivée par défaut, et que les entreprises resteront libres de l’activer ou non.
- Après Amazon, le service cloud de Microsoft touché par une panne mondiale (huffingtonpost.fr)
Microsoft Azure indique que les perturbations affectent, entre autres, des jeux en ligne ou des services de compagnies aériennes et ferroviaires.
- Pas de chauffage Netatmo ? C’est normal, Microsoft Azure est en panne, et ça touche de nombreux services (macg.co)
- Man Alarmed to Discover His Smart Vacuum Was Broadcasting a Secret Map of His House (futurism.com)
“My robot vacuum was constantly communicating with its manufacturer, transmitting logs and telemetry that I had never consented to share” […] The device was running Google Cartographer, an open-source program designed to create a 3D map of his home, data which the gadget was transmitting back to its parent company.
Les autres lectures de la semaine
- Colors and Numbers (mail.cyberneticforests.com)
- Une réforme intacte, des questions qui persistent (blogs.alternatives-economiques.fr)
- Est-il vrai que les milliardaires créent de l’emploi ? (multinationales.org)
Alors que les débats parlementaires font rage sur le budget 2026, la proposition de « taxe Zucman » concentre une grande partie des critiques. Si personne n’ose attaquer son objectif de corriger les injustices actuelles qui permettent aux plus riches d’échapper à l’impôt sur le revenu, beaucoup s’inquiètent de ses conséquences sur l’économie française. […] Une crainte très peu fondée.
- Les Jeux Olympiques du travail gratuit. Un extrait du livre de Maud Simonet (contretemps.eu)
- Economics has an elitism problem (theglobalcurrents.com)
A handful of elite universities control the discipline. That’s not excellence — it’s monopoly.
- Surconsommation, gâchis et pollution, Halloween est un désastre pour notre planète (lareleveetlapeste.fr)
Costumes et décorations de maisons sont faites de dérivés du pétrole et de plastique. Suremballés et fabriqués dans des pays (Chine, Taiwan, Bengladesh) où les conditions de travail laissent à désirer.
- Indonésie : août 2025, la révolte contre l’oligarchie (contretemps.eu)
En août 2025, une vague de colère inédite a secoué l’Indonésie. Partie d’une contestation contre les privilèges des parlementaires, la mobilisation s’est transformée, après la mort d’un jeune chauffeur-livreur écrasé par un véhicule de police, en une révolte de masse contre l’austérité, la corruption et l’autoritarisme du président Prabowo Subianto.
- Documenter l’enfer concentrationnaire syrien (legrandcontinent.eu)
- Les Gilets jaunes et la culture de l’insurrection : retour sur les « autonomes » (lvsl.fr)
- L’économie féministe au prisme des études trans. L’exemple argentin (contretemps.eu)
- Une étude révèle que les chimpanzés d’Ouganda utilisent des insectes volants pour soigner leurs blessures (theconversation.com)
Les BDs/graphiques/photos de la semaine
- Avertissement
- Cerveau
- Criminalisation
- Guerre
- Aide
- Reality
- AI
- Bots
- Avenir
- Honteux
- Green Bin
- Génial
- Promise
- Zebu
- Insta
- Syndrome
Les vidéos/podcasts de la semaine
- “Tous derrière Sarkozy” – Les Goguettes (en trio mais à quatre) (yewtu.be)
- Où va l’Italie (partie 2) ? Bilan de Meloni et résistances populaires (spectremedia.org)
- Sex-symbols : ces mecs qu’on fantasme Partie 1 et Partie 2 (binge.audio)
Les trucs chouettes de la semaine
- Nearly 90 % of Windows Games now run on Linux, latest data shows — as Windows 10 dies, gaming on Linux is more viable than ever (tomshardware.com) – voir aussi Microsoft a du souci à se faire, 90 % des jeux Windows sont désormais compatibles avec Linux (lesnumeriques.com)
- Good News ! Austrian Ministry Kicks Out Microsoft in Favor of Nextcloud (news.itsfoss.com)
Announced at the Nextcloud Enterprise Day Copenhagen 2025 event, Austria’s Federal Ministry of Economy, Energy and Tourism, or BMWET for short, has migrated 1,200 employees to Nextcloud for internal collaboration and secure data storage.
- International Criminal Court to ditch Microsoft Office for European open source alternative (euractiv.com)
The court will move its internal work environment to Open Desk, a German-developed open source software
- La ville de Blois résiste à l’obsolescence programmée dans les écoles (blois.fr)
Face à l’annonce irresponsable de Microsoft de ne plus mettre à jour son système d’exploitation Windows 10, qui va rendre obsolète plus de 400 millions d’ordinateurs dans le monde, la Ville a décidé de convertir progressivement les ordinateurs qu’elle fournit aux écoles sous Linux, le système d’exploitation libre et gratuit.
Retrouvez les revues de web précédentes dans la catégorie Libre Veille du Framablog.
Les articles, commentaires et autres images qui composent ces « Khrys’presso » n’engagent que moi (Khrys).
27.10.2025 à 07:42
Khrys’presso du lundi 27 octobre 2025
Khrys
Texte intégral (7485 mots)
Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour découvrir les informations que vous avez peut-être ratées la semaine dernière.
Tous les liens listés ci-dessous sont a priori accessibles librement. Si ce n’est pas le cas, pensez à activer votre bloqueur de javascript favori ou à passer en “mode lecture” (Firefox) ;-)
Brave New World
- 12 km2 de forêts détruits chaque heure, une déforestation qui ralentit mais reste inquiétante… Ce qu’il faut retenir du dernier rapport de la FAO (humanite.fr)
L’organisation onusienne a livré le 21 octobre son évaluation de l’état des forêts dans le monde pour la période 2015-2025. Si le rythme de déboisement a ralenti, il demeure inquiétant, et les forêts sont soumises à des menaces diverses.
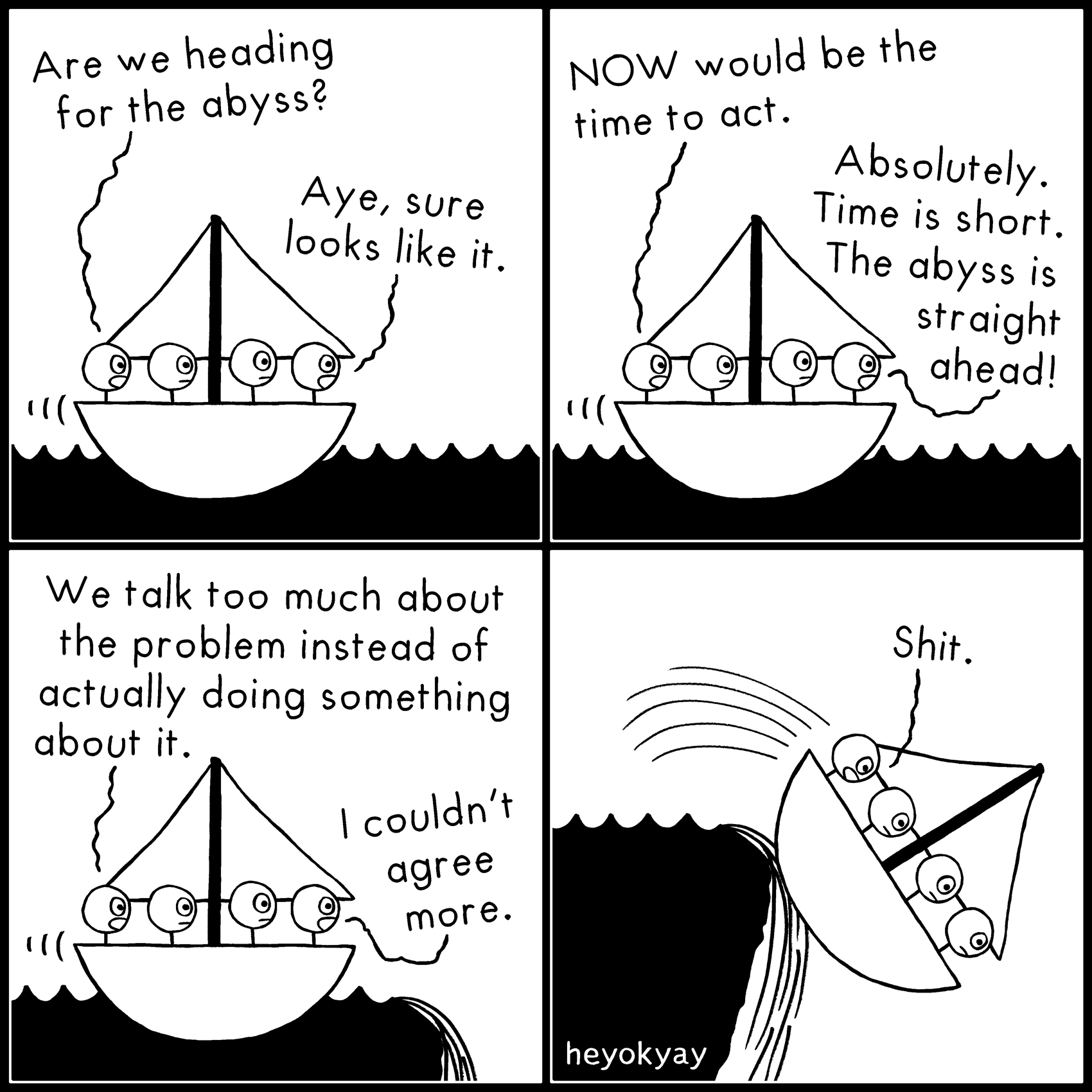
- Sanae Takaichi, une dame de fer à la tête du gouvernement japonais (france24.com)
Sanae Takaichi devient la première femme Première ministre du Japon, dans un pays où la politique reste largement dominée par les hommes. Conservatrice assumée, proche de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe dont elle revendique l’héritage, cette figure de l’aile droite du Parti libéral-démocrate incarne un tournant aussi symbolique que risqué.
- Japanese convenience stores are hiring robots run by workers in the Philippines (restofworld.org)
Filipino tele-operators remotely control Japan’s convenience store robots and train AI, benefiting from an uptick in automation-related jobs.
- Inde : pour faire face au « Delhi Smog », brouillard toxique, les autorités ensemencent les nuages (humanite.fr)
Alors que la pollution de l’air étouffe New Delhi et ses 30 millions d’habitants depuis plusieurs jours, les autorités locales s’en remettent à l’ensemencement des nuages pour provoquer des pluies artificielles et ainsi tenter de dissiper le brouillard toxique. Des essais ont été réalisés jeudi 23 octobre.
- ‘My existence will be illegal’ : LGBTQ community vilified by Turkish draft law (turkeyrecap.com)
- Two dead and dozens arrested amid Cameroon election crackdown (theguardian.com)
Wave of unrest as polling suggests victory in presidential race for 92-year-old incumbent Paul Biya
- Sahara occidental : le Front Polisario accepte de soumettre le plan d’autonomie proposé par le Maroc à un référendum (humanite.fr)
Le ministre des Affaires étrangères sahraoui, Mohamed Yeslem Beissat, a annoncé que le Front Polisario est prêt à accepter le plan d’autonomie marocain de 2007, sous conditions. Parmi elles, la mise en place d’un référendum pour sonder les Sahraouis et la garantie de « l’indépendance, l’intégration et (d’un) pacte d’association libre »
- Allemagne : L’armée s’exerce à la guerre intérieure et se fait tirer dessus (par la police) (secoursrouge.org)
- « On manipulait des produits toxiques comme si c’était de l’eau » : sur un site de TotalEnergies, des fuites à gogo (reporterre.net)
Au sud de l’Italie, TotalEnergies exploite le champ pétrolier Tempa Rossa. Les fuites d’hydrocarbures s’y multiplient depuis son ouverture en 2020. Des salariés s’estiment mis en danger par le fleuron français.
- Sous les serres andalouses, la face sombre du « potager de l’Europe », entre exploitation humaine et désastre écologique (humanite.fr)
À Almeria, des milliers d’hectares nourrissent l’Europe à bas prix. Une enquête d’UFC-Que choisir révèle l’envers du décor : un désastre écologique et social qui interroge tout le modèle agricole européen.
- Le moustique est arrivé en Islande, et c’est une mauvaise nouvelle pour les habitant·es (huffingtonpost.fr)
L’Islande était jusqu’à présent, avec l’Antarctique, l’un des rares endroits de la planète dépourvus de moustiques.
- Le directeur d’un prestataire US de failles « 0-day » accusé d’en avoir vendu à la Russie (next.ink)
Mardi, on apprenait qu’un employé de Trenchant, qui développe et revend des failles de sécurité informatique à la communauté du renseignement des « Five Eyes », aurait lui-même été ciblé par un logiciel espion.
- U.S. pulls plug on major NATO corruption probes – top suspects walk free (ftm.eu)
A NATO corruption scandal made international headlines when several suspects were arrested across Europe in May. Several months later, the U.S. dropped charges against four of them – including a Turkish defence magnate – despite strong evidence, a joint investigation reveals.
- Trump démolit une partie de la Maison Blanche pour assouvir ses envies démesurées (huffingtonpost.fr)
Les coûts de construction de la salle de bal de Donald Trump sont évalués à 250 millions de dollars, alors que les États-Unis connaissent depuis vingt jours une situation de « shutdown ».
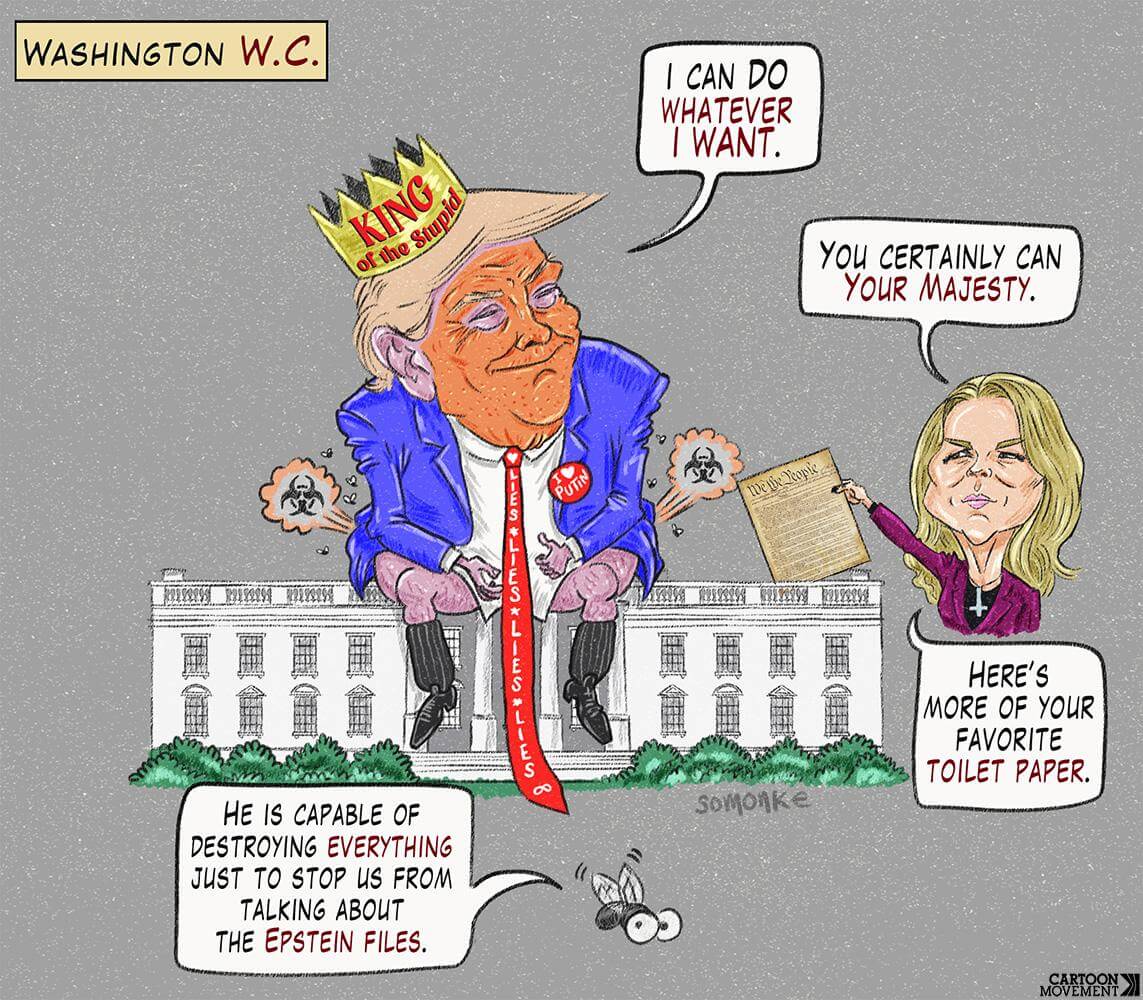
Voir aussi La surface au sol de la salle de bal de Trump sera 4,5 fois plus importante que celle de la Maison-Blanche (legrandcontinent.eu) - Elon Musk Discovers What Hierarchy Actually Means (techdirt.com)
Elon Musk is having a very bad week. The man who bought Twitter for $44 billion to secure unaccountable power over public discourse is discovering what unaccountable power actually looks like when wielded by someone who understands dominance better than he does.Trump just stripped SpaceX of a government contract and handed it to Jeff Bezos.
- Budget record pour l’ICE : Trump déploie sa machine anti-immigration (politis.fr)
Avec plus de 120 milliards de dollars prévus d’ici à 2029, l’agence de l’immigration américaine connaît une expansion sans précédent. Centres de détention, recrutements massifs et expulsions à la chaîne deviennent les piliers du programme Trump.
- Aux États-Unis, « une esthétique de la peur au cœur de la médiatisation des expulsions » (politis.fr)
Chercheur spécialiste des expulsions forcées, WIlliam Walters décrypte la façon dont l’administration Trump organise sa politique migratoire. Il explique également comment la communication autour de ces pratiques violentes est présentée comme un « spectacle » pour le public américain.
- The Data Brokers Fueling ICE’s Deportation Machine—And the Union Shareholders Fighting Back (inthesetimes.com)
“As investors, we are thinking about this as a risk to our investments, but also as a social and ethical issue.”
- États-Unis : des pirates informatiques divulguent les informations personnelles de centaines de responsables de la Sécurité intérieure, du FBI et du DOJ (bfmtv.com)
“Guerre ouverte”. Alors que plus de sept millions de personnes ont battu le pavé ce week-end à travers les États-Unis, pour dénoncer les dérives autoritaires du président américain Donald Trump, la contestation contre sa politique se poursuit également en ligne.
- Kohler unveils a camera for your toilet (techcrunch.com)
Home goods company Kohler recently unveiled a new device called the Dekoda — a $599 camera that can be attached to your toilet bowl and take pictures of what’s inside.
- A lithium bust leaves Latin American towns in the dust (restofworld.org)
With plummeting prices and slowing demand for EVs, the once-thriving mining towns of Argentina, Chile, and Bolivia are now struggling.
- Créer des ovules humains à partir de la peau : vers une nouvelle fertilité ? (theconversation.com)
- Une étude montre que 60 ans est souvent l’âge de notre apogée (theconversation.com)
Raisonnement moral, stabilité émotionnelle, résistance aux biais cognitifs… autant de traits qui atteignent leur maturité bien après la jeunesse et qui expliquent pourquoi cette période de la vie peut être un âge d’or pour le jugement et le leadership.
- ‘The most violent attack ever documented’ : Five female bonobos kill a male, challenging beliefs about the species’ peaceful nature (english.elpais.com)
The lynching, captured on video deep in the jungle, sheds light on the reality of the animals. Females exert power over males, who are larger and stronger, through a matriarchy woven with intense social bonds
Spécial IA
- Netflix réalise son meilleur trimestre publicitaire et prépare des formats Ads dopés à l’IA (danstapub.com)
- OpenAI lance Atlas, son navigateur web propulsé par ChatGPT pour concurrencer Google (huffingtonpost.fr)
Ce navigateur sera dans un premier temps disponible uniquement pour le système d’exploitation macOS d’Apple.
- Microsoft vous observe en jeu pour entraîner son IA, mais vous pouvez le désactiver (clubic.com)
Microsoft déploie son assistant Gaming Copilot, un compagnon de jeu dopé à l’intelligence artificielle. Mais ce coach personnel a les yeux partout et n’hésite pas à envoyer vos sessions de jeu sur les serveurs de l’entreprise pour parfaire son éducation.
- What are the risks from Artificial Intelligence ? (airisk.mit.edu)
A comprehensive living database of over 1600 AI risks categorized by their cause and risk domain
- Tor Browser expulse les fonctionnalités IA de Firefox (generation-nt.com)
À contre-courant de la tendance actuelle, le projet Tor fait le choix de purger le navigateur Tor Browser de toute fonctionnalité IA héritée de Firefox.
- AI Is Hollowing Out Higher Education (project-syndicate.org)
While the AI industry claims its models can “think,” “reason,” and “learn,” their supposed achievements rest on marketing hype and stolen intellectual labor. In reality, AI erodes academic freedom, weakens critical reading, and subordinates the pursuit of knowledge to corporate interests.
- Belgian AI scientists resist the use of AI in academia (apache.be)
This summer, prominent Dutch AI scientists threw a spanner in the works with an open letter calling for a halt to the uncritical adoption of AI technologies in academia. Amongst the signatories is Luc Steels, a pioneer of AI research in Belgium.
- Computing Is Indeed a Discipline in Crisis (cacm.acm.org)
While Silicon Valley is investing tens of billions of dollars chasing the AGI dream, academic computing research in the U.S. is facing a severe drought.
- Largest study of its kind shows AI assistants misrepresent news content 45 % of the time – regardless of language or territory (bbc.co.uk)
‘This research conclusively shows that these failings are not isolated incidents […] They are systemic, cross-border, and multilingual, and we believe this endangers public trust. When people don’t know what to trust, they end up trusting nothing at all, and that can deter democratic participation.’
- Generative AI is a societal disaster (disconnect.blog)
Governments are deluding themselves into believing investment justifies allowing AI to upend society
- Autopsie de la bulle de l’intelligence artificielle (politis.fr)
Spécial Palestine et Israël
- Jewish and Israeli figures urge world leaders to act over ‘unconscionable’ Israeli acts in Gaza (middleeasteye.net)
Hundreds of artists, intellectuals and former Israeli officials warn ceasefire fails to address occupation, apartheid and denial of Palestinian rights
- Reconnaître l’État de Palestine, au milieu des ruines ? (contretemps.eu)
La vague récente de reconnaissances symboliques, initiée en 2024, semble désormais être la seule mesure que beaucoup de puissances européennes soient disposées à prendre face au génocide, après deux années de soutien moral, militaire et diplomatique continu au régime israélien.
- Libérations en Israël/Palestine : le deux poids, deux mesures bat son plein (acrimed.org)
Le 13 octobre, conformément à l’une des premières étapes du dit « plan Trump », des libérations d’Israéliens et de Palestiniens ont eu lieu. Mais comme en janvier 2025, dans les grands médias, un seul de ces deux événements a réellement existé.
- Évacuations de Gaza suspendues arbitrairement : le ministère des affaires étrangères révoque sa décision après la saisine du Conseil d’État (msf.fr)
Spécial femmes dans le monde
- La langue inclusive : lorsque des mythes font leur entrée dans les politiques publiques (theconversation.com)
De nombreuses études ont montré que l’écriture au masculin mène les lecteurs et lectrices à se représenter moins de femmes lors de la lecture. Au contraire, différentes formes d’écriture inclusive peuvent atténuer cet effet et améliorer la représentation de toutes personnes dans la langue […] Au-delà d’un débat linguistique, c’est la question du respect des droits fondamentaux qui est en jeu. La Charte des droits et libertés de la personne se veut un reflet des valeurs québécoises. En vertu de cette dernière, l’identité de genre et l’expression de genre sont des motifs de discrimination interdits.
- Intersex Awareness Day highlights a fight for rights that’s far from over (19thnews.org)
From a Boston protest to global recognition, the history of Intersex Awareness Day shines a light on decades of work to preserve bodily autonomy.
- Cop30 : les femmes d’Amazonie veulent une place dans les négociations (basta.media)
La trentième conférence internationale sur le climat, la Cop30, démarre le 10 novembre à Belém, en Amazonie brésilienne. Mais les populations amazoniennes n’ont pas été invitées à la table des négociations, dénoncent les femmes de la région.
- Ce que contient le livre posthume de Virginia Giuffre, principale accusatrice de Jeffrey Epstein (huffingtonpost.fr)
Dans « Nobody’s girl », Virginia Giuffre livre de nouveaux détails sur les abus qu’elle a subi au début des années 2000.
- Pastor who raged about kids seeing Pride flags arrested for child abuse (lgbtqnation.com)
Silas H. Shelton has been accused of abusing his religious authority to groom a teenage girl.
- Hollywood a bel et bien rouvert ses portes à Johnny Depp, ce nouveau rôle le confirme (huffingtonpost.fr)
L’acteur américain vient d’être annoncé au casting du prochain film de Ti West, une nouvelle adaptation du classique de Charles Dickens « Un conte de Noël ».
- Anatomie des hommes forts : pourquoi les politiques mettent-ils en scène leur musculature ? (theconversation.com)
Spécial France
- Report des élections en Nouvelle-Calédonie : pourquoi la Macronie se retrouve à torpiller son propre texte (huffingtonpost.fr)
Pour contourner les centaines d’amendements déposés par La France insoumise, le camp gouvernemental a préféré jouer la tactique de l’esquive.
- Greenwashing : TotalEnergies condamnée pour ses publicités sur la « neutralité carbone » (humanite.fr)
Le tribunal judiciaire de Paris a jugé, jeudi, que la major pétrolière s’était rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses en se présentant comme un « acteur majeur de la transition énergétique ».
- Nicolas Sarkozy incarcéré à la prison de la Santé, voici à quoi ressembleront ses conditions de détention (huffingtonpost.fr)

- François Fillon débouté par la CEDH dans l’affaire des emplois fictifs de son épouse (lemonde.fr)
Dans un arrêt rendu à l’unanimité, la Cour européenne des droits de l’homme déclare irrecevable pour « défaut manifeste de fondement » la requête de l’ancien premier ministre, qui estimait n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable dans cette affaire.
- Moody’s accorde un sursis à la France, mais le verdict de l’agence de notation cache une mise en garde (huffingtonpost.fr)
Alors que les débats sur le budget se poursuivent, l’agence de notation a maintenu la note de la dette française, tandis que ses concurrentes l’avaient abaissée.
- Budget 2026 : la taxe Zucman rejetée d’emblée lors de l’examen du texte en commission à l’Assemblée (lemonde.fr)
Les députés de la coalition gouvernementale et du Rassemblement national ont fait échouer l’adoption de la taxe sur les très hauts patrimoines, portée par la gauche. Le dispositif fera l’objet d’un nouveau débat dans l’Hémicycle à partir de vendredi.
- Projet de loi de finances 2026 : premières retouches du budget (projetarcadie.com)
- Une directive européenne va bientôt imposer la transparence salariale dans toutes les entreprises (presse-citron.net)
Dès juin 2026, la transparence salariale deviendra une obligation légale. Chaque salarié en France pourra demander à connaître le salaire moyen des personnes occupant le même poste. Un outil redoutablement efficace pour ceux qui envisagent de négocier une augmentation… Et un vrai tournant culturel dans le monde du travail.
- « Maintenant, la télé, c’est Free » : Xavier Niel lance Free TV pour tuer Molotov et TF1 (frandroid.com)
- La France, premier pays à investir dans Matrix, le protocole libre sur lequel repose sa messagerie sécurisée (clubic.com)
- Élargir la Seine « ne répond pas » aux défis climatiques, selon des chercheurs (reporterre.net)
le Conseil scientifique s’était autosaisi de la question pour analyser la pertinence de ce projet pourtant reconnu d’utilité publique en 2022. Ces experts notent par ailleurs que « l’estimation des impacts sur la zone humide » a déjà été « considérée comme non conforme et lacunaire par l’OFB et l’Autorité environnementale »
- Au Havre, TotalEnergies va devoir démanteler son terminal méthanier (reporterre.net)
Ce gigantesque tanker, mis en service en octobre 2023, était censé sécuriser l’approvisionnement énergétique du pays à l’époque de la guerre en Ukraine. Or, comme l’a observé le tribunal, ce terminal méthanier flottant est inutilisé depuis août 2024.
- Submersion, rejets toxiques… L’EPR2 de Penly dans le viseur de l’Autorité environnementale (reporterre.net)
Spécial femmes en France
- Orientation postbac : pourquoi les femmes choisissent moins les sciences que les hommes (theconversation.com)
- « Face à l’internationale réactionnaire masculiniste, la France oppose un concept : la diplomatie féministe », une conversation avec Delphine O (legrandcontinent.eu)
- « On n’oublie jamais » : enfant maltraitée, Emma Étienne se bat contre les violences intrafamiliales (basta.media)
Elle a subi des maltraitances, été placée, s’est retrouvée sans soutien à 18 ans. Puis Emma Étienne, 23 ans, a fondé une association pour aider les enfants comme elle, Speak !, et publié un essai sur l’incapacité de la société à les protéger.
Spécial médias et pouvoir
- “Mais vous êtes fou ?” : La soeur d’une victime de l’attentat du DC-10 interpelle Henri Guaino, fidèle de Nicolas Sarkozy, dans “Complément d’enquête” sur France 2 (ozap.com)
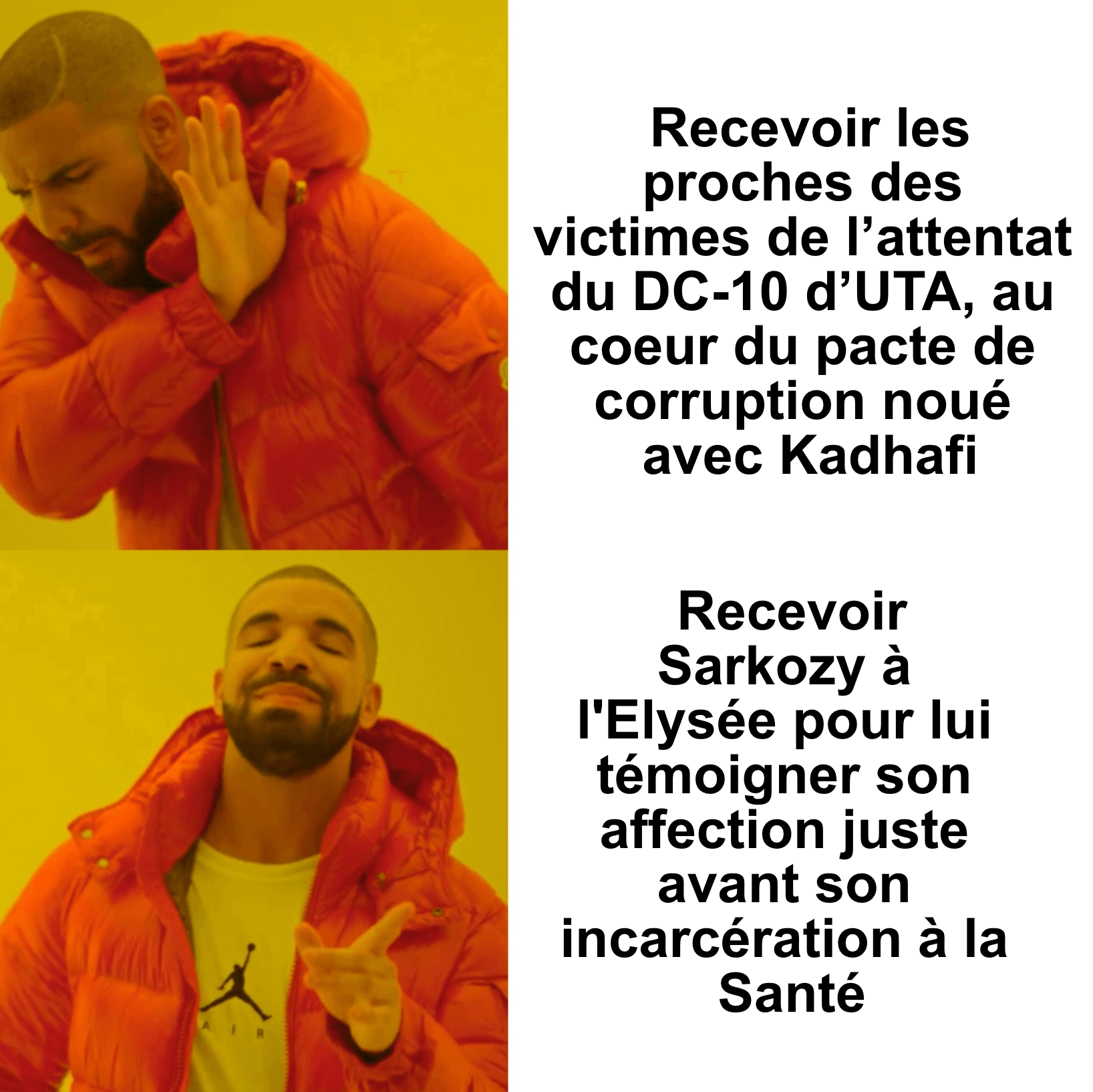
- Sarkozy en prison : « un naufrage médiatique » pour Eva Joly (reporterre.net)
- Condamnation de Nicolas Sarkozy : le journaliste Fabrice Arfi dénonce une “faillite culturelle et médiatique” sur “les grandes affaires de corruption” (franceinfo.fr)
Le journaliste de Mediapart, qui a contribué à révéler l’affaire des financements libyens, déplore que le procès de Nicolas Sarkozy ait été très peu suivi par la presse, malgré la gravité des faits.
- Sarkozy à “la Santé” : réalité parallèle sur BFM (arretsurimages.net)
- “Lecornu gagne en popularité” : trois sondages présentés de manière biaisée (arretsurimages.net)
Spécial emmerdeurs irresponsables gérant comme des pieds (et à la néolibérale)
- En commission, le RN et la Macronie s’allient pour défendre un budget d’ultra-riches (politis.fr)
Les débats sur le volet recettes du projet de loi de finance pour 2026 ont débuté ce lundi en commission des finances, donnant à voir une alliance tacite entre le bloc central et le RN pour protéger les privilèges des plus aisés et des grandes entreprises.
- Budget 2026 : 10 mesures défavorables aux plus modestes (basta.media)
Le budget entame son parcours parlementaire cette semaine. Gel des prestations sociales et des pensions, baisses budgétaires pour le logement social et les hôpitaux… Une série de dispositions risquent de pénaliser les moins riches.
- Budget 2026 : « à défaut de taxer les milliardaires, on taxe les malades » (lareleveetlapeste.fr)
- Les député·es ont rejeté le budget en commission (projetarcadie.com)
Après l’examen des amendements, les député·es ont voté sur l’ensemble de la première partie du texte. Onze député·es ont voté pour, 37 contre, le reste s’est abstenu dont Horizons, MoDem et LIOT.
- Budget 2026 : Olivier Faure demande des « évolutions d’ici à lundi », faute de quoi le PS pourrait censurer le gouvernement (lemonde.fr)

- Vers une hausse des frais d’inscription à l’université ? Une « ligne rouge » pour la gauche sénatoriale (publicsenat.fr)
Une mission d’information du Sénat s’est attelée à décortiquer les liens stratégiques ente l’Etat et les universités. Si les élus de tous bords politiques se sont accordés sur la nécessité d’établir un cap de pilotage clair, les pistes égrenées sur les frais d’inscription et la sélection à l’entrée en études supérieures ont conduit le PS à se retirer du rapport.
- Un an après, les groupes de niveau sont en échec dans les collèges (alternatives-economiques.fr)
Spécial recul des droits et libertés, violences policières, montée de l’extrême-droite…
- Comment la détention de Nicolas Sarkozy fait (re)découvrir la dure réalité des prisons françaises (huffingtonpost.fr)
La violence du milieu carcéral français, amplifiée par la surpopulation des établissements, est dénoncée depuis plusieurs années par les détenus et les agents pénitentiaires.

- « C’est à vomir » : blackfaces et costumes du Ku Klux Klan à la fête d’un club de parachutisme (ouest-france.fr)
La vision de cette scène est glaçante de réalisme. Elle a été préparée d’avance ainsi que le démontre la vidéo. Ce n’est pas du tout un débordement alcoolisé
- Après la soirée raciste dans l’Aube impliquant des pompiers de Paris, une enquête judiciaire en cours (huffingtonpost.fr)
Au cours d’une fête organisée par un club de parachutisme près de Troyes, plusieurs participants se sont grimés en membres du Ku Klux Klan, d’autres arborant des « black faces ».
- « On l’a tué » : l’émotion du patron de Mamadou Garanké Diallo, mort en tentant de rejoindre l’Angleterre (huffingtonpost.fr)
Ce jeune Guinéen travaillait depuis six ans dans une boucherie près de Rouen. Il a trouvé la mort en juin, en tentant de gagner le Royaume-Uni après avoir reçu une OQTF.
- « Les policiers ont tiré 8 fois. J’ai dû leur verser 15 000 euros » (politis.fr)
Nordine raconte la nuit du 16 au 17 août 2021 où sa compagne, Merryl, enceinte, et lui, ont failli mourir sous les tirs de la police.
- Depuis Zyed et Bouna, 162 personnes sont mortes suite à une tentative de contrôle de police (basta.media)
Zyed Benna et Bouna Traoré mouraient dans un transformateur électrique, en fuyant un contrôle de la BAC le 27 octobre 2005. Depuis, le nombre de décès suite à une interaction avec les forces de l’ordre n’a cessé d’augmenter.
- 17 octobre 1961 : la mémoire vive d’un crime d’État que la France peine à reconnaître (bondyblog.fr)
En pleine guerre d’indépendance, des milliers d’Algériens manifestent dans les rues de Paris pour s’opposer au couvre-feu qui leur est imposé. Ces rassemblements pacifiques sont violemment réprimés par la police française, plus de 100 manifestants sont tués, certains corps jetés dans la Seine.
Voir aussi Le 17 octobre 1961, ou le déni continu des crimes coloniaux (lundi.am)
Spécial résistances
- Réforme du RSA : l’intensification des sanctions attaquée devant le Conseil d’État (basta.media)
Seize associations et syndicats attaquent l’État pour sa politique ciblant chômeurs et allocataires du RSA. Au cœur du problème, les pressions subies par les bénéficiaires et la répression contre les agents refusant de collaborer à ce « flicage ».
- Le régime local d’Alsace-Moselle, un modèle pour la Sécu ? (basta.media)
Solidaire, démocratique et excédentaire, le régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle préfigure-t-il le futur de la Sécurité sociale ?
- Municipales : une dizaine d’associations proposent 10 mesures de « désescalade numérique » (next.ink)
- Et, si 80 ans après la Sécu, l’accès à l’alimentation fédérait la gauche à Perpignan et au-delà ? (madeinperpignan.com)
- Canaliser (lundi.am)
Méga-canal, Méga-scandale : récit d’un week-end
- Mustafa Cakici – Les nationalistes turcs ne sont pas nos alliés (juivesetjuifsrevolutionnaires.fr)
Suite à la révélation par plusieurs médias (StreetPress notamment) de propos antisémites, anti-arméniens, anti-kurdes et LGBTQIphobe, Mustafa Cakici a été démis de son mandat de porte-parole français de la Global Sumud Flotilla. Il a également été exclu de l’UJFP, dont il était membre.
Nous saluons cette décision.
Il est cependant regrettable qu’il ait fallu attendre un scandale médiatique pour cela.
Spécial outils de résistance
- Vote-Pack Zucman (politipet.fr)
- Sauvons les trains de nuit Paris – Berlin et Paris – Vienne ! (petitions.assemblee-nationale.fr)
Spécial GAFAM et cie
- Amazon identifies the issue that broke much of the internet, says AWS is back to normal (techcrunch.com) – voir aussi Airbnb, Snapchat, Fortnite… Ce que l’on sait des causes de la panne géante qui a paralysé des applis ultra-populaires (huffingtonpost.fr)
Ces perturbations ont eu lieu après une panne aux États-Unis d’Amazon Web Services (AWS), le premier fournisseur mondial de cloud.
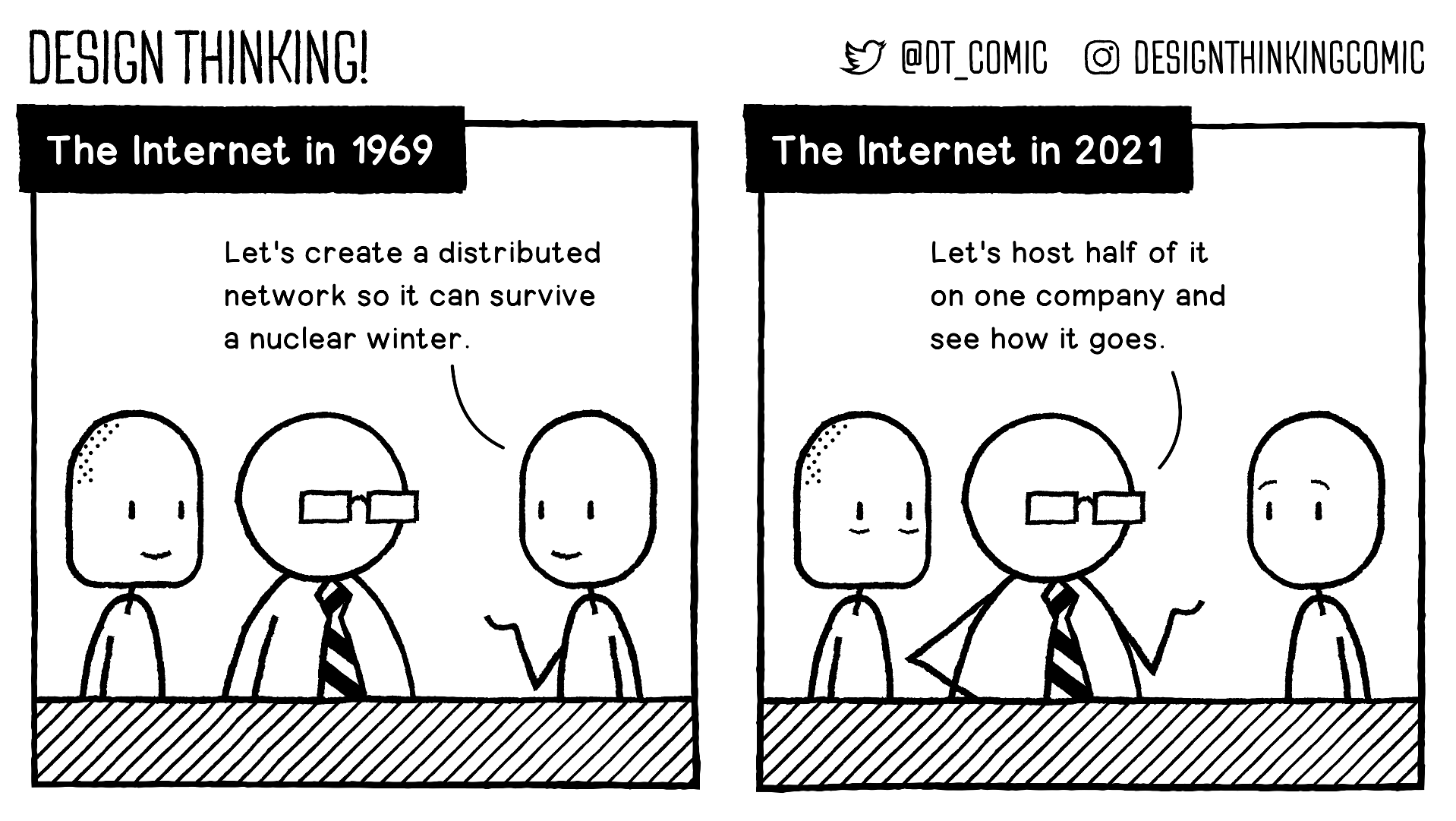
- Le crash d’AWS en a empéché certain·es de dormir (minimachines.net)
Des lits connectés vendus plus de 2000$ ont des fonctions embarquées qui permettent de modifier leur position grâce à une application. Ils sont également capables de contrôler leur température et donc de chauffer ou de se refroidir.[…] Problème, les lits ne sont pas munis de télécommande ou même d’un bouton pour les allumer ou les éteindre. Tout passe par une application […] qui passe par les serveurs d’Amazon.
- Ring cameras are about to get increasingly chummy with law enforcement (arstechnica.com)
Amazon’s Ring partners with company whose tech has reportedly been used by ICE.
- NSO permanently barred from targeting WhatsApp users with Pegasus spyware (/arstechnica.com)
Ruling holds that defeating end-to-end encryption in WhatsApp harms Meta’s business.
- Comment Trump et les Gafam empêchent la résistance contre les expulsions forcées (politis.fr)
L’application ICEBlock, qui permettait d’anticiper les raids des forces spéciales anti-immigration, a été fermée par Apple, en accord avec Donald Trump. Politis donne la parole à son développeur, en colère contre la trahison du géant américain.
- Microsoft dégaine une astuce sournoise pour booster Copilot (clubic.com)
Aux États-Unis, lorsqu’on utilise le navigateur Edge pour se rendre sur ChatGPT.com, Perplexity.ai ou DeepSeek, on peut désormais apercevoir une nouvelle pastille positionnée à droite, directement au sein de la barre d’adresse avec la simple mention “Try Copilot”. Et ce petit message promotionnel n’apparaît pas en permanence, mais sur une sélection de domaines […] ceux appartenant à ses rivaux.
- TikTok Won’t Say If It’s Giving ICE Your Data (forbes.com)
- Plongée dans l’algorithme de TikTok France : nos révélations (amnesty.lu)
Que montre TikTok aux adolescent·es français·es ? Pour le savoir, nos équipes ont recréé leurs profils et se sont entretenues avec des adolescent·es et des familles concernées. Nos résultats sont accablants : malgré la législation européenne, TikTok inonde encore les écrans des ados vulnérables de contenus dangereux pouvant aller jusqu’à encourager l’automutilation ou le suicide.
- France. TikTok continue d’orienter les enfants et les jeunes déjà fragiles vers des contenus dépressifs et suicidaires (amnesty.lu)
En seulement trois à quatre heures de navigation sur le fil “Pour toi” de TikTok, les faux comptes d’adolescent·e·s créés pour nos recherches ont été exposés à des vidéos qui idéalisaient le suicide ou montraient des jeunes exprimant leur intention de mettre fin à leurs jours, avec des informations sur les méthodes de suicide
- X is changing how it handles links to try and keep you in the app (theverge.com)
Les autres lectures de la semaine
- An Amazon outage has rattled the internet. A computer scientist explains why the ‘cloud’ needs to change (theconversation.com)
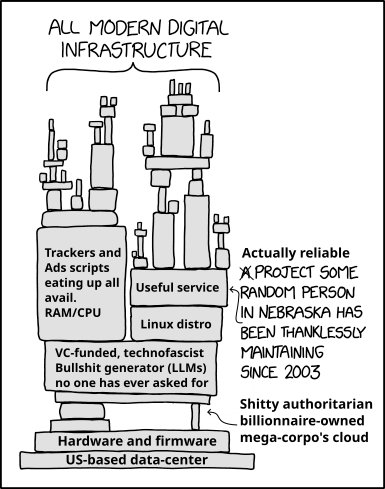
- Today is when the Amazon brain drain finally sent AWS down the spout (theregister.com)
When your best engineers log off for good, don’t be surprised when the cloud forgets how DNS works […] a quiet suspicion starts to circulate : where have the senior AWS engineers who’ve been to this dance before gone ? And the answer increasingly is that they’ve left the building — taking decades of hard-won institutional knowledge about how AWS’s systems work at scale right along with them.
- De l’internet de la répression… (danslesalgorithmes.net)
À la tribune de l’ONU, tout le monde dénonce la montée de l’autoritarisme… alors que chacun participe à l’industrie de la censure.
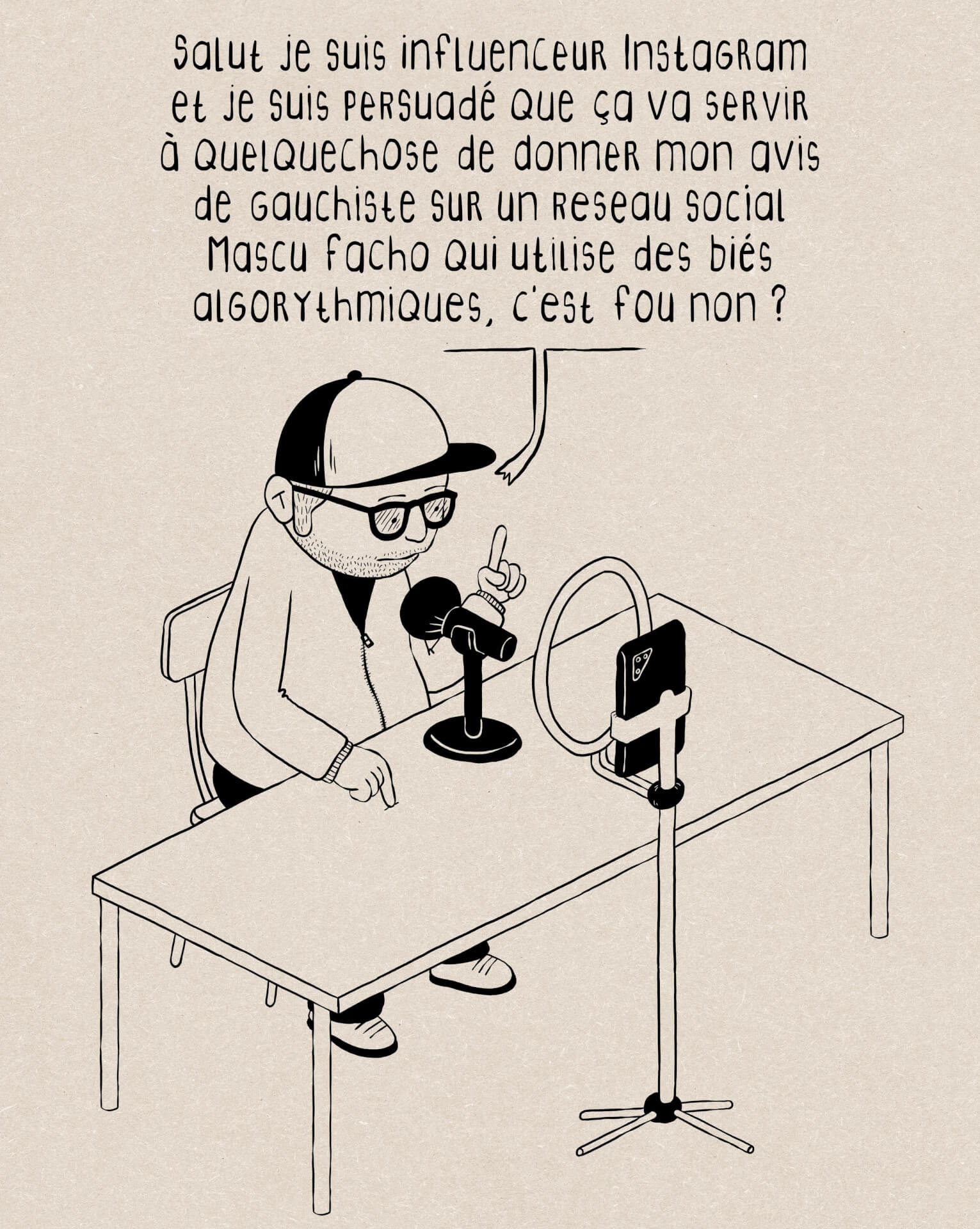
- Chez les paons, la taille compte… mais aussi la beauté et la vigueur (theconversation.com)
- “Je préfère être pleinement moi, sans m’excuser de l’être” (frustrationmagazine.fr)
Je ne parle pas de manquer d’empathie, ou de ne pas respecter l’autre. Je parle de ne plus accepter l’inacceptable et de prendre l’espace qui me revient, qui m’appartient. Je parle de ne plus rien laisser passer, de ne plus accepter un seul commentaire, une seule attitude raciste et sexiste à mon égard, ou d’autres que moi d’ailleurs, et ce, par qui que ce soit.
- Ablation du clitoris dans l’Angleterre victorienne : comment un scandale médical sur le « consentement éclairé », au XIXᵉ siècle, a ouvert un débat toujours actuel (theconversation.com)
La pratique de la « clitoridectomie », à savoir l’excision du clitoris – et parfois des lèvres –[…] a, pendant un temps, au cours du XIXᵉ siècle, également été prônée en Europe comme « remède » à la masturbation, à la nymphomanie, à l’hystérie et autres « troubles nerveux » supposés.
- Vulve, pénis… Apprendre aux enfants à nommer les parties génitales est plus important qu’on ne le pense (huffingtonpost.fr)
Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Les vidéos/podcasts de la semaine
- Fabrice Arfi sur Ce Soir parlant du traitement médiatique autour de Sarkozy (tube.fdn.fr)
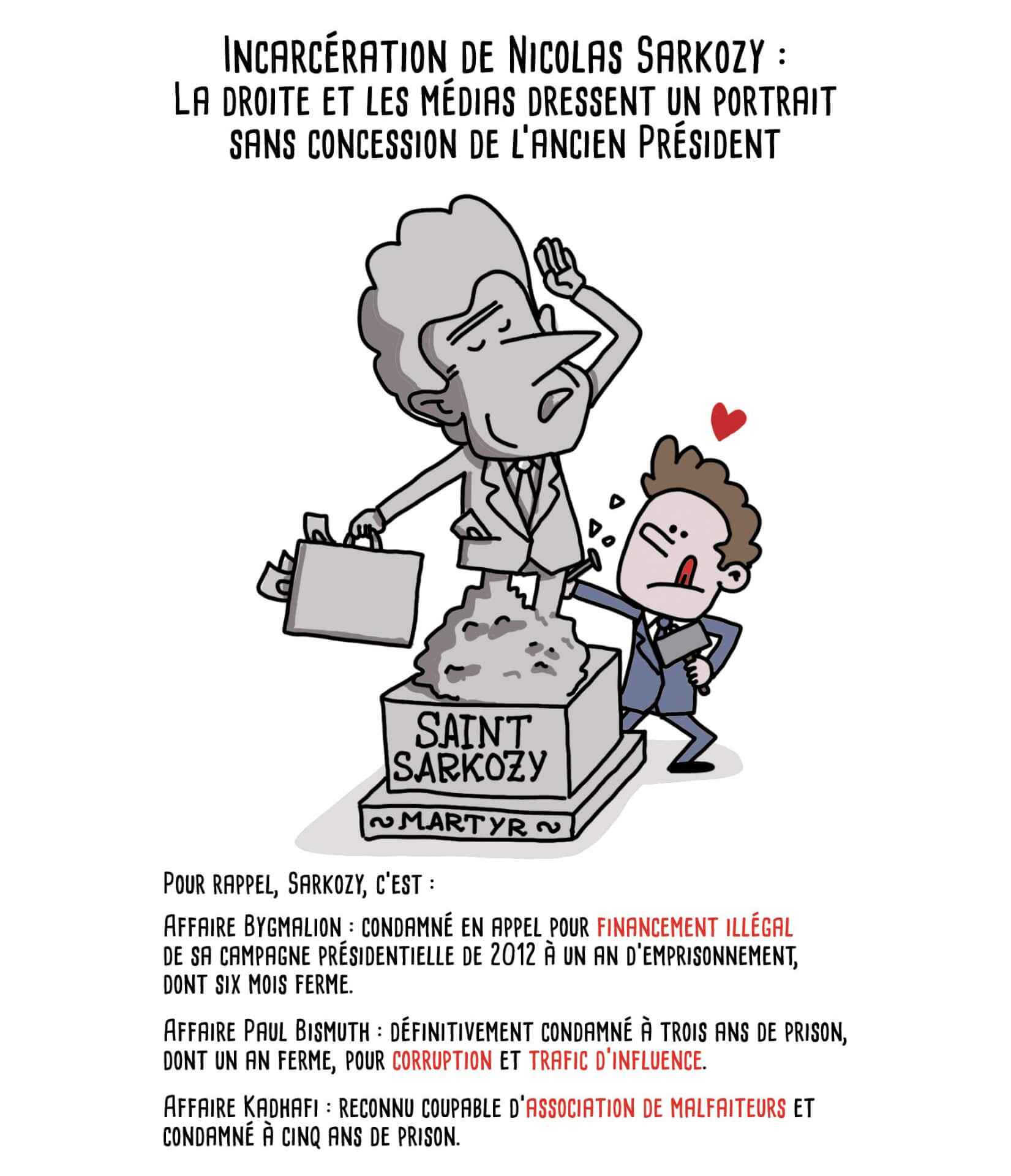
- Alice de Rochechouart dans Zoom Zoom Zen sur la différence entre privilèges et compensations de désavantages (tube.fdn.fr)
- Italie : aux origines de la coalition des droites sous domination néofasciste (contretemps.eu)
- L’IA va-t-elle tuer Internet ? (arte.tv – disponible jusqu’au 29/12/2025)
- Robots tueurs, des armes aux mains de l’IA (arte.tv – disponible jusqu’au 31/10/2027)
- Planter à tout prix. Des arbres pour sauver la planète ? (arte.tv – disponible jusqu’au 19/12/2025)
- Gen Z 2025 : De l’Indonésie au Népal (audioblog.arteradio.com)
Les trucs chouettes de la semaine
- Les Journées du Logiciel Libre reviennent le week-end du 30 et 31 mai 2026 à l’ENS de Lyon ! (jdll.org)
- Reading QR codes without a computer ! (qr.blinry.org)
- Une « technologie qui change la vie » : un implant électronique redonne la capacité de lire aux personnes atteintes de DMLA (humanite.fr)
Un implant électronique sous-rétinien, testé par l’Inserm, l’université de la Sorbonne, le CNRS et l’hôpital de la fondation Rothschild sur 38 patients, permet aux personnes atteintes de dégénérescence maculaire de retrouver une capacité de lecture au bout d’un an.
- Elles préservent des semences en solidarité avec la Palestine (reporterre.net)
Les paysannes et paysans du réseau Longo Maï font germer des semences palestiniennes. Une démarche symbolique et un plaidoyer sur l’urgence d’une réappropriation des savoir-faire autour de la reproduction des graines.
Retrouvez les revues de web précédentes dans la catégorie Libre Veille du Framablog.
Les articles, commentaires et autres images qui composent ces « Khrys’presso » n’engagent que moi (Khrys).
20.10.2025 à 07:42
Khrys’presso du lundi 20 octobre 2025
Khrys
Texte intégral (11080 mots)
Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour découvrir les informations que vous avez peut-être ratées la semaine dernière.
Tous les liens listés ci-dessous sont a priori accessibles librement. Si ce n’est pas le cas, pensez à activer votre bloqueur de javascript favori ou à passer en “mode lecture” (Firefox) ;-)
Brave New World
- Satellites Are Leaking the World’s Secrets : Calls, Texts, Military and Corporate Data (wired.com)
With just $800 in basic equipment, researchers found a stunning variety of data—including thousands of T-Mobile users’ calls and texts and even US military communications—sent by satellites unencrypted.
- China, Taiwan, and the vulnerable web of undersea cables (restofworld.org)
Fifteen international cables connect Taiwan to the world. Its western flank faces China, and its eastern flank is seismically unstable ; over a three-year period, Taiwan’s international and domestic cables suffered more than fifty cuts as a result of both manmade and natural factors. Were a foreign power to snap those fifteen international cables, Taiwan — the West’s buffer against China, and the semiconductor factory to the planet — would be unmoored from the world it needs and the world that needs it.
- Énergie du futur : la Chine teste le S1500, sa première éolienne dirigeable à haute altitude (ladepeche.fr)
- Bangladesh : « Si cette situation continue, nos peuples seront exterminés », alerte Rani Yan Yan, la reine des Chakma (humanite.fr)
Avant 1997, les militaires et les colons bengalis (principal groupe ethnique du Bangladesh, NDLR) coopéraient main dans la main, ils nous massacraient et brûlaient des villages. L’une des stratégies de l’État était d’installer des colons – 400 000 entre 1977 et 1983 – afin qu’ils puissent être utilisés soit comme boucliers humains, soit comme armes
- Trump, Putin to meet : Will Ukraine get US Tomahawks or not ? (aljazeera.com)
- “Les discussions ont commencé” : un tunnel sous-marin de 113 km entre la Russie et les États-Unis pourrait être construit par Elon Musk (lindependant.fr)
- Putin has no need to fear ICC arrest warrant in Budapest, Orbán has already demonstrated that (telex.hu) – voir aussi Germany demands Hungary arrest Putin on ICC warrant (news.online.ua)
- Türkiye’s judicial reform package to focus on family values, curb ‘LGBT propaganda’ (turkiyetoday.com)
According to the proposed amendment, “Any person who engages in, publicly encourages, praises, or promotes attitudes or behaviors contrary to their biological sex at birth and public morality shall be punished with imprisonment of one to three years.”
- Exfiltré à bord d’un avion militaire français ? Caché, le président de Madagascar réagit (huffingtonpost.fr)
Le président malgache Andry Rajoelina a pris la parole lundi soir pour expliquer qu’il était dans un « lieu sûr » après une « tentative de meurtre ». Sans préciser sa localisation.
- Gen Z : l’internationale contestataire (politis.fr)
Comme en 1968, une jeunesse mondiale se lève à nouveau, connectée, inventive et révoltée. De Rabat à Katmandou, de Lima à Manille, la « Gen Z » exprime sa colère contre la corruption, les inégalités et la destruction de l’environnement.

- Mouvement « GenZ212 » : quand la jeunesse marocaine prend ses propres affaires en main (contretemps.eu)
- Pour la première fois depuis 10 000 ans, des chevaux sauvages parcourent à nouveau l’Espagne (lareleveetlapeste.fr)
Ils n’y avaient jamais posé les sabots. Mais leurs aïeux, eux, peuplaient jadis ces plaines. En introduisant les chevaux de Przewalski en Espagne, Rewilding Spain parie sur le réensauvagement pour ranimer la nature, et l’économie locale.
- L’Espagne en proie à de nouvelles inondations ces derniers jours (meteo-paris.com)
- Europe : surveillance biométrique aux frontières (politis.fr)
Le système d’entrée/sortie (EES pour « Entry/Exit System ») a amorcé son déploiement progressif dans tous les pays de l’espace Schengen, ce 12 octobre. Celui-ci impose aux citoyens extra-européenne de se soumettre à un enregistrement de leurs empreintes digitales et image faciale. Les données biométriques seront stockées et partagées entre les 29 pays membres.
- Consultation response to the European Commission’s call for evidence on the Digital Omnibus (edri.org)
The European Commission launched a call for evidence on the forthcoming “Digital Omnibus” initiative, which is expected to be presented around the 19 November 2025. The package is framed as an effort to “simplify” the EU’s digital policy framework, but the EDRi network warn that it risks dismantling key protections that uphold fundamental rights in the digital age.
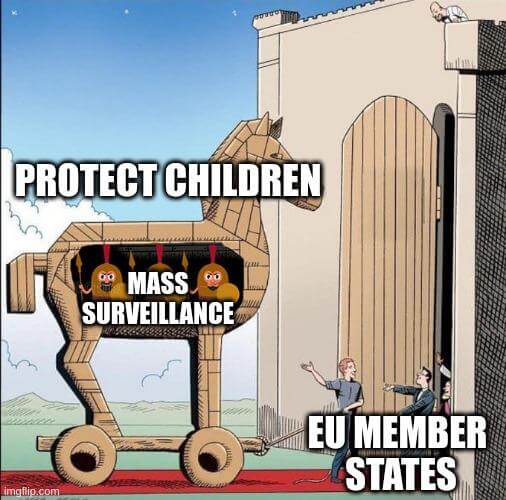
- Empêtré dans l’affaire Epstein, le prince Andrew renonce à ses titres royaux (huffingtonpost.fr)
Le prince Andrew a de nouveau fait l’objet d’accusations dans un livre posthume écrit par la principale accusatrice de Jeffrey Epstein.
- États-Unis : l’Alaska en proie à de violentes inondations, des milliers de personnes évacuées (franceinfo.fr)
Le typhon Halong a frappé violemment la côte ouest de l’Alaska (États-Unis), le week-end du 11 et 12 octobre, avec des vents à plus de 170 km/h et des vagues impressionnantes.
Voir aussi Here’s how you can help survivors of the Western Alaska storm (alaskapublic.org)
Community groups and businesses across the state are coordinating relief efforts after the remnants of Typhoon Halong brought widespread devastation to Western Alaska.
- Menacé de mort, l’historien antifasciste Mark Bray a dû fuir les États-Unis (lareleveetlapeste.fr)
C’est « un avertissement contre l’autoritarisme » alerte Mark Bray. Après la parution du décret de Donald Trump qualifiant l’antifascisme comme mouvement terroriste (22 septembre 2025), le professeur de l’université de Rutgers (New-Jersey, Etats-Unis) Mark Bray a été victime d’une vague de menaces de mort.
- Armed man wearing ‘non-offending pedophile’ sign storms stage at NYC Wikipedia conference (nbcnews.com)
The man pointed a gun at the ceiling and threatened to kill himself before being tackled by conference organizers, according to police. Wikipedia canceled all events Friday “due to unforeseen circumstances,” adding that the conference is expected to resume Saturday
- President will now force airlines to guess passengers’ genders if they have X gender markers (lgbtqnation.com)
US customs will no longer accept X gender markers in their system despite people still having those passports.
- ICE Is Cracking Down on Chicago. Some Chicagoans Are Fighting Back. (nytimes.com)
Residents have begun forming volunteer groups to monitor their neighborhoods for federal immigration agents. Others honk their horns or blow whistles when they see agents nearby.
- Portland’s Inflatable Costumes Deflate Trump’s Narrative (motherjones.com)
- « No Kings » : des millions d’Américain·es attendu·es pour défiler contre Donald Trump (lemonde.fr)
Plus de 2 700 rassemblements sont prévus dans la journée, dans les grandes villes américaines comme dans des bourgades d’États républicains, ainsi qu’à proximité de la résidence de Donald Trump en Floride.
- Second “No Kings Day” protests likely the largest single-day political demonstration since 1970, with 4.2-7.6 million participants (gelliottmorris.com)
- 7 Million Proud Patriots Joyously, Peacefully Marched, Rallied, And Protested Yesterday (hopiumchronicles.com)

- California governor says Trump ‘putting ego over responsibility’ over a military showcase that involved firing live artillery shells over a major highway in the state’s south (theguardian.com)
- We Found That More Than 170 U.S. Citizens Have Been Held by Immigration Agents. They’ve Been Kicked, Dragged and Detained for Days. (propublica.org)
- EFF, unions sue Trump administration over alleged mass social media surveillance of legal residents (techcrunch.com)
- Software update bricks some Jeep 4xe hybrids over the weekend (arstechnica.com)
Owners of some Jeep Wrangler 4xe hybrids have been left stranded after installing an over-the-air software update this weekend. The automaker pushed out a telematics update for the Uconnect infotainment system that evidently wasn’t ready, resulting in cars losing power while driving and then becoming stranded.
- Présidentielle en Bolivie : le lithium au cœur des promesses économiques des candidats (france24.com)
- Cette réplique du Venezuela montre que Maduro n’a pas digéré le Prix Nobel à son opposante (huffingtonpost.fr)
Alors que le Venezuela a fermé son ambassade à Oslo, une porte-parole de Norvège a rappelé que « le prix Nobel est indépendant du gouvernement norvégien ».
- Venezuela : accélération autoritaire et répression de la gauche critique. (contretemps.eu)
- L’administration Trump prépare-t-elle une opération armée au Venezuela ? (legrandcontinent.eu)
Washington a multiplié les déploiements militaires au large des côtes vénézuéliennes ces dernières semaines, faisant craindre au régime Maduro la préparation d’une opération visant à le destituer.
- État d’urgence, mobilisations massives, un manifestant tué par la police et une centaine de blessés… Que se passe-t-il au Pérou ? (humanite.fr)
- Reflect Orbital : The Startup Letting You Order Sunlight from Space (thetundradrums.com)
- Planet’s first catastrophic climate tipping point reached, report says, with coral reefs facing ‘widespread dieback’ (theguardian.com)
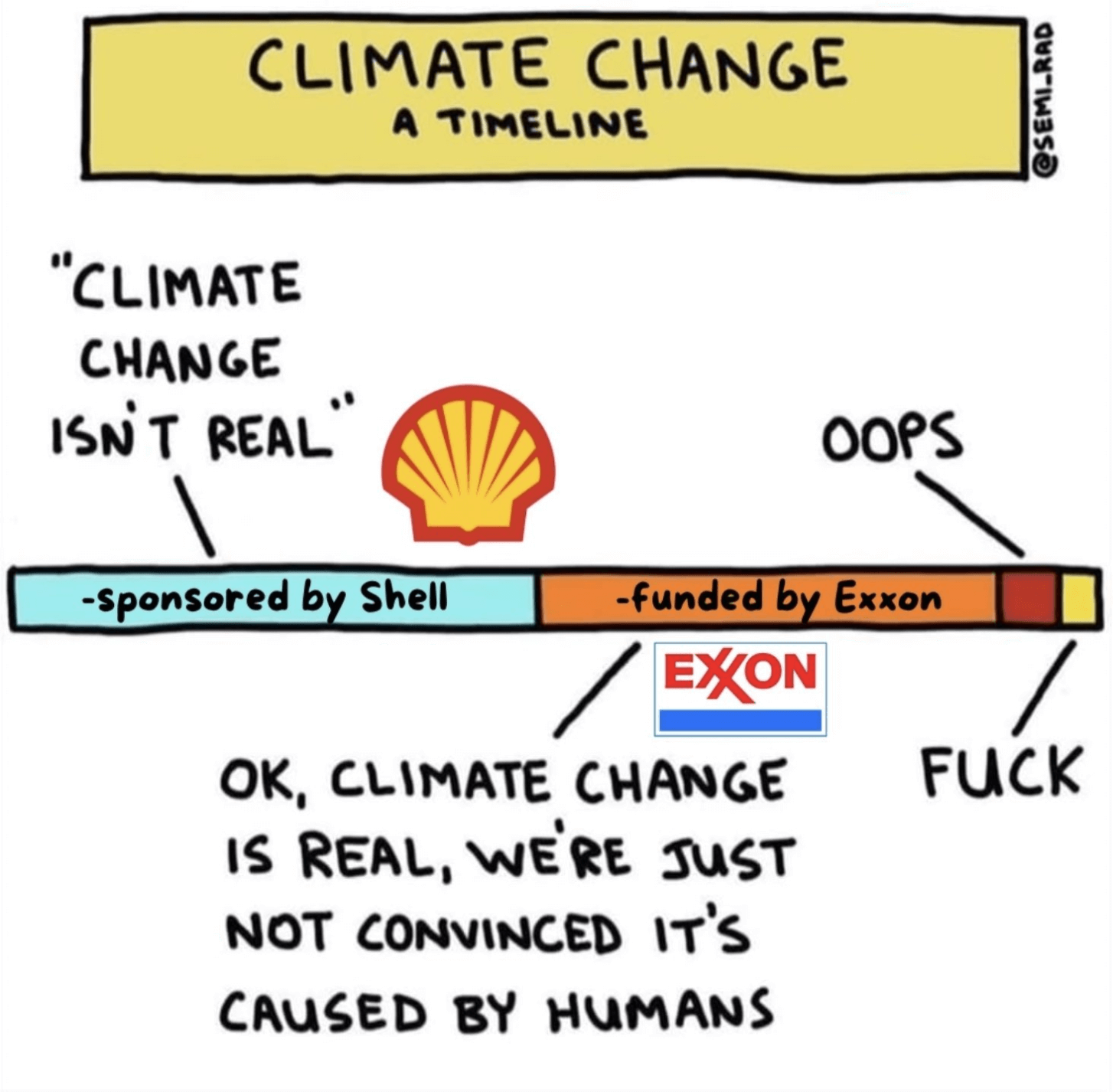
Le rapport de la semaine
- Click, Load, Kill : Examining the cyberweapon industry in the WANA (West Asia and North Africa) region (ifex.org)
A new SMEX report exposes how commercial spyware vendors empower authoritarian regimes to target dissidents and journalists, urging urgent protections for privacy and stronger accountability measures.
Spécial IA
- Is India the Global Anti-AI Play ? (indiadispatch.com)
Foreign institutional investors have pulled nearly $30 billion from Indian equity markets over the past twelve months. A huge chunk of that money has moved to Korea and Taiwan.
- The AI dilemma : To compete with China, the U.S. needs Chinese talent (restofworld.org)
Immigration restrictions can accelerate the flight of top talent, threatening the strategy that it is better to have the brightest minds working for U.S. companies.
- California cracks down on water theft but spares data centers from disclosing how much they use (latimes.com)
Gov. Gavin Newsom vetoed a bill that would have tracked data centers’ growing water footprint in California. […] New data centers have been rapidly proliferating in California and other western states as the rise of artificial intelligence and growing investments in cloud computing drive a construction boom.
- Thirsty AI mega projects raise alarm in some of Europe’s driest regions (cnbc.com)
- AI-related data centres use vast amounts of water. But gauging how much is a murky business (cbc.ca)
As tech companies spend billions on data centres, citizens around the world are starting to push back
- Your AI tools run on fracked gas and bulldozed Texas land (techcrunch.com)
The AI era is giving fracking a second act, a surprising twist for an industry that, even during its early 2010s boom years, was blamed by climate advocates for poisoned water tables, man-made earthquakes, and the stubborn persistence of fossil fuels.
- IA : la Californie promulgue une législation régulant les “chatbots”, une première aux États-Unis (france24.com)
En réaction à des suicides d’adolescents, le gouverneur de la Californie Gavin Newsom a signé lundi une série de lois pour réguler les agents conversationnels d’intelligence artificielle, imposant notamment de vérifier l’âge des utilisateurs et d’afficher des avertissements.
- AI-powered textbooks fail to make the grade in South Korea (restofworld.org)
South Korea’s AI learning program was rolled back after just four months following a backlash from teachers, students, and parents, underlining the challenges in embedding the technology in education.
- The Default Body – AI, biased health data, and the illusion of objectivity (jgcarpenter.com)
In 2022, a team at University College London revisited several machine-learning models used to predict liver disease from routine blood tests. On paper, the tools were successful, with accuracy across the general population. But the closer they looked, the more the averages cracked. The models missed liver disease in nearly half of the women they analyzed, compared with about a quarter of the men. Nothing in the models announced this imbalance ; it was buried in the math.
- GitHub Copilot Chat Flaw Leaked Data From Private Repositories (securityweek.com)
It turned out that Copilot was not merely learning from private repos, it was reportedly distributing them as if they were party favors. The user had not realized that the definition of an “AI pair programmer” extended to “unauthorized code distributor.” […] the GitHub user should perhaps feel flattered that their proprietary data was deemed worth sharing
- Refuser de parvenir à surproduire des merdes inutiles avec l’IA (lundi.am)
- Comment fait-on l’IA (data.yt)
- Sora : des deepfakes et représentations racistes de Martin Luther King et Malcolm X (next.ink)
- Amazon’s Ring Partners With Flock, a Network of AI Cameras Used By Police (yro.slashdot.org)
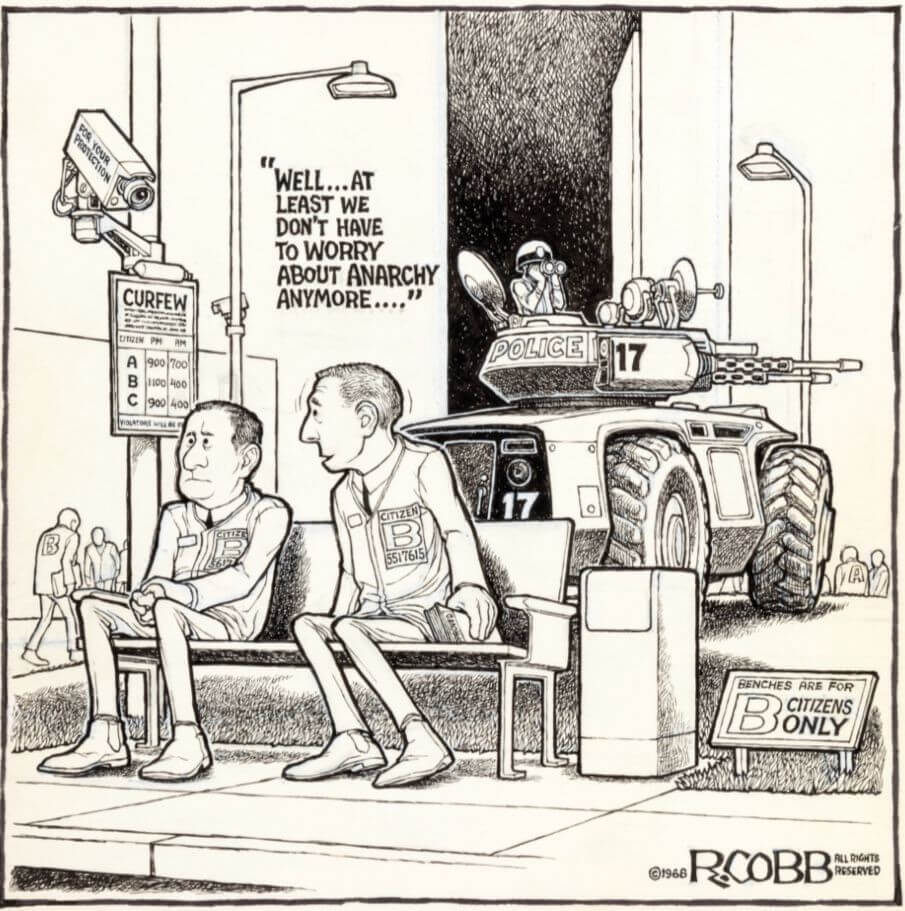
- GenAI and what it does to the brain (theguardian.com)
- Are we living in a golden age of stupidity ? (theguardian.com)
A global OECD study found, for instance, that the more students use tech in schools, the worse their results. “There is simply no independent evidence at scale for the effectiveness of these tools … in essence what is happening with these technologies is we’re experimenting on children […] Maybe the dawn of the new golden era of stupidity doesn’t begin when we submit to super-intelligent machines ; it starts when we hand over power to dumb ones.
- … À l’IA pour faire régner la terreur (danslesalgorithmes.net)
Ce que l’IA produit ne sont pas des erreurs. Ses erreurs sont ses promesses idéologiques.
- Le FMI met en garde contre le risque d’une déception liée aux bénéfices de l’IA pour l’économie mondiale (legrandcontinent.eu)
- « Bulle de l’IA » : Sam Altman, le PDG d’OpenAI, prévient d’un risque d’implosion du marché (trustmyscience.com)
Un récent rapport du MIT indique que près de 95 % des projets pilotes d’IA générative menés par les entreprises n’enregistrent aucun retour sur investissement significatif. Cette déception se traduit par une érosion progressive de la confiance, certaines sociétés et utilisateurs délaissant la technologie et avançant une productivité bien moindre que ne le laissait espérer le discours promotionnel.
- OpenAI Needs $400 Billion In The Next 12 Months (wheresyoured.at)
At some point, OpenAI is going to have to actually do the things it has promised to do, and the global financial system is incapable of supporting them. And to be clear, OpenAI cannot really do any of the things it’s promised.
Spécial Palestine et Israël
- Vente d’armes : livraison imminente de matériel français vers Israël (disclose.ngo)
Une semaine après la signature du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, Disclose révèle qu’un lot de matériel fabriqué par la société française Sermat doit être expédié en Israël, lundi 20 octobre. Ces composants sont destinés à des drones conçus par Elbit Systems, l’un des principaux fournisseurs de l’armée israélienne.
- « Le combat n’est pas encore terminé » : Israël menace de nouveau Gaza de rompre le cessez-le-feu (humanite.fr)
Le Hamas a affirmé mercredi 16 octobre avoir remis à Israël toutes les dépouilles d’otages auxquelles il avait pu accéder, soit neuf corps sur 28.
- Palestine : le nom d’une révolution décoloniale (contretemps.eu)
En Palestine, la lutte actuelle contre le colonialisme israélien est la plus difficile de l’histoire récente car elle se mène contre tout l’édifice impérialiste occidental.
- Flottille de la liberté : pour qui ? La flottille de la liberté a donné 5 migrants à Frontex et tout le monde s’en tape. (paris-luttes.info)
- Flottille pour Gaza : Un porte-parole exclu après des propos antisémites et homophobes (humanite.fr)
Sur les réseaux sociaux, des militants antifa ont récolté ces derniers mois des centaines de publications antisémites, homophobes, antikurdes… propagées depuis dix ans par Mustafa Cakici […] le militant d’extrême droite semble avoir peu à peu réussi à s’installer dans le paysage, au point de trouver le moyen d’embarquer à bord d’un des bateaux de la flottille pour Gaza
- Greta Thunberg : “They kicked me every time the flag touched my face” (aftonbladet.se)
She was not allowed to wear her T-shirt with “Free Palestine” on it and was ordered to change, she explains. She put on an orange one with the text “Decolonize” instead.
- Face aux attaques des colons contre les Palestiniens, l’interposition non-violente des volontaires internationaux (basta.media)
Pendant que Trump vante son plan de paix pour Gaza, en Cisjordanie, les attaques de colons contre des Palestinien·nes se poursuivent. Face aux violences, des volontaires internationaux et israéliens tentent de soutenir villageois·es et cultivateurices.
- La LDH porte plainte contre Airbnb et Booking : stop au tourisme d’occupation ! (ldh-france.org)
Airbnb et Booking proposent des centaines d’annonces de locations touristiques situées dans les colonies israéliennes illégales en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.
Parce qu’il raconte une nouvelle histoire de la terre volée, des communautés installées illégalement et qu’il dynamise économiquement ces colonies, ce tourisme d’occupation participe à la création, à l’entretien et à l’extension des colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés illégalement et favorise le déplacement forcé de la population palestinienne. Il n’est autre que le pendant de la colonisation criminelle ordonnée par les responsables israéliens. - À Gaza, l’OMS alerte sur une propagation des épidémies devenue « hors de contrôle » (huffingtonpost.fr)
- Une boulangerie industrielle, soutenue par l’ONU, a rouvert à Gaza (france24.com)
Une boulangerie industrielle a rouvert dans la Bande de Gaza, soutenue par l’agence onusienne du programme alimentaire mondial, elle produit 300 000 pita par jour. C’est pourtant insuffisant face aux besoins de la population de Gaza. L’agence a prévu d’en ouvrir plus d’une trentaine le plus rapidement possible.
- Effacer les Palestiniens : la fabrique médiatique du vide politique (politis.fr)
Omniprésents comme corps, les Palestiniens sont absents comme sujets. Un paradoxe qui dit quelque chose de la manière dont se fabrique une « terre à prendre ».
Spécial femmes dans le monde
- Ghost of Yōtei : pourquoi les masculinistes détestent son héroïne (japanization.org)
La sortie du jeu tant attendu Ghost of Yōtei fait quelques remous dans la communauté gaming. Si le jeu est une réussite absolue en matière de narratif et de visuels, la communauté masculiniste, ce cri du cygne d’un patriarcat en fin de vie, a tout de même trouvé à redire. C’est l’héroïne qui est désormais la cible de leurs critiques : pas assez sexy, pas assez voluptueuse, pas assez jeune, pas assez maquillée, trop indépendante… Bref, tous les clichés du beauf-moyen y passent.
- Muganga — la guerre se lit sur le corps des femmes (medfeminiswiya.net)
RIP
- La créatrice du programme d’échange Erasmus, Sofia Corradi, est morte (lemonde.fr)
Quelque 16 millions de jeunes ont pu étudier dans d’autres pays d’Europe grâce au projet lancé en 1987 par cette professeure italienne, qui s’est éteinte à l’âge de 91 ans.
Spécial France
- Analyse à chaud : l’annonce du Premier ministre concernant la réforme des retraites (blogs.alternatives-economiques.fr)
- L’agence de notation S&P accélère son calendrier pour abaisser la note de la France (huffingtonpost.fr)
Après Fitch et avant Moody’s, S&P (ex Standard & Poors) juge négativement les perspectives financières de la France.
- Bernard Arnault engrange 16 milliards d’euros en une journée (huffingtonpost.fr)
Dopée par le bond de plus de 12 % de l’action LVMH en une séance mercredi, la fortune de l’homme le plus riche de France culmine désormais à plus de 190 milliards d’euros.
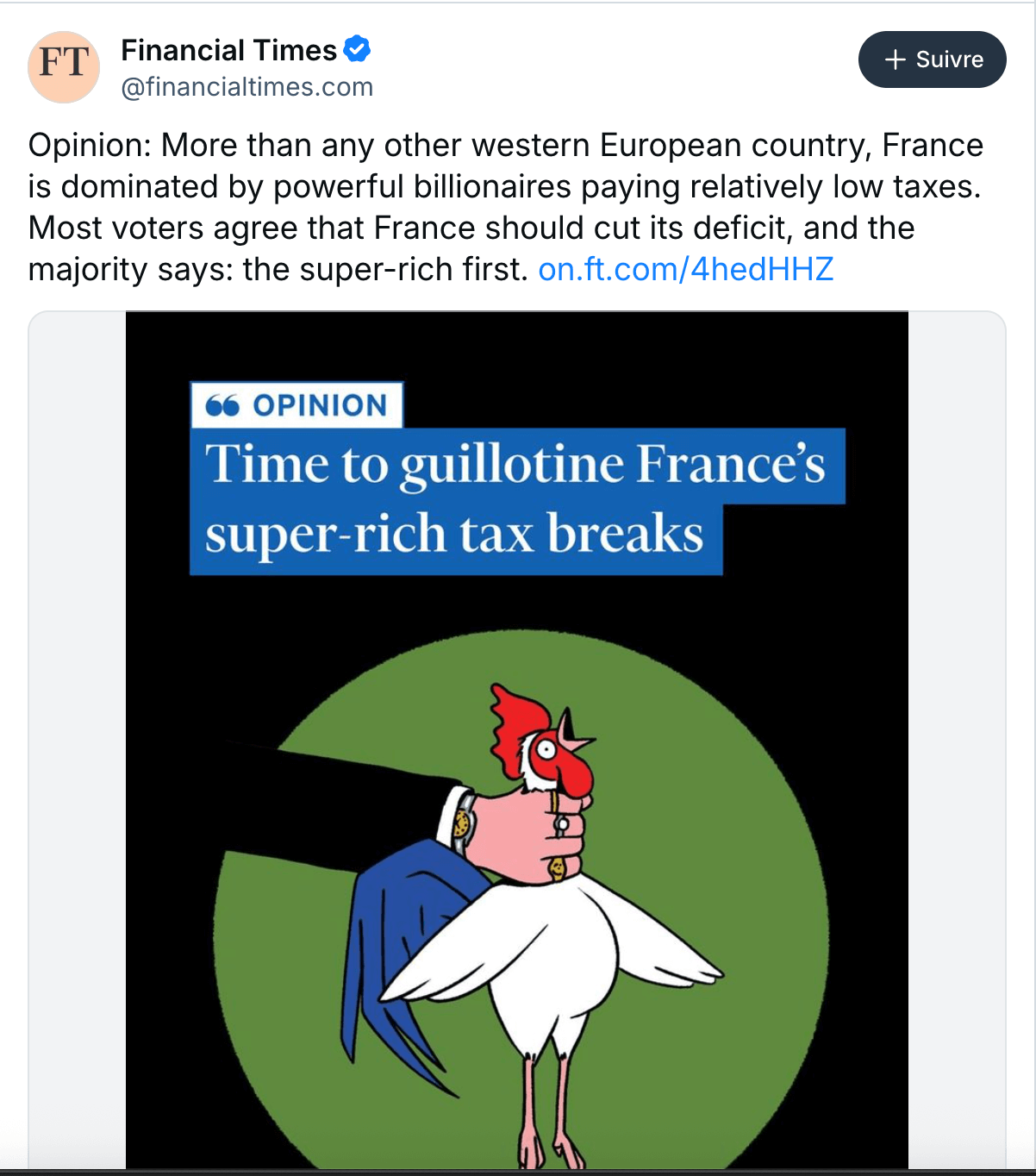
- Michel Offerlé : « Le Medef a provoqué une division jamais vue chez les patrons » (alternatives-economiques.fr)
- Matthieu Pigasse : « Il y a urgence à partager les richesses, et je paierais volontiers la taxe Zucman » (alternatives-economiques.fr)
- Le musée du Louvre braqué à la disqueuse, des bijoux « d’une valeur inestimable » dérobés (liberation.fr)
- Nestlé va supprimer 16 000 postes dans le monde d’ici 2027 pour « rassurer les actionnaires » (humanite.fr)
Cette décision est un nouveau revers dans la tentative de sortir Nestlé d’une crise qui dure, suite aux scandales qui ont entaché sa réputation. Il y avait d’abord eu, en France, les pizzas Buitoni contaminées en 2022 et plus récemment le scandale des fraudes dans le traitement des eaux minérales Vittel et Perrier. […] « malheureusement, dans le monde actuel, rien ne vaut une suppression de salariés pour rassurer les actionnaires »
- Télécoms : Orange, Free et Bouygues Telecom ont remis sur la table leur offre de rachat (humanite.fr)
Les trois opérateurs ont remis sur la table, mercredi 15 octobre au soir, leur offre de rachat conjointe de SFR pourtant écartée par sa maison mère Altice France. L’hypothèse d’une vente à la découpe de l’entreprise inquiète depuis plusieurs mois les syndicats.
- La position victimaire de Nicolas Sarkozy est inique et offensante pour les familles des victimes décédées dans l’attentat du DC-10 d’UTA (nouvelobs.com)
La lecture du jugement ne peut laisser aucun doute à quiconque n’est pas aveuglé par l’esprit partisan : les faits qui étaient reprochés à Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et Brice Hortefeux sont attestés et ils sont, comme l’a dit le tribunal, d’une exceptionnelle gravité.
- Nicolas Sarkozy restera administrateur de Lagardère et Accor pendant son incarcération (leparisien.fr)
Condamné à cinq ans de prison ferme dans l’affaire libyenne, l’ex-chef de l’État siégera aux conseils d’administration de Lagardère, Accor et LOV Group. Ses mandats ne sont pas incompatibles avec sa détention à la prison de la Santé.
- “Le Désespéré” de Courbet exposé à Orsay, une première en France depuis dix-sept ans (telerama.fr)
Propriété du Qatar Museums, l’organisme de développement des musées de l’émirat, la toile de 1844-1845, un autoportrait de l’artiste, est prêtée au musée parisien pour les cinq prochaines années.
- Yves Lae, ancien directeur du collège Saint-Pierre, au Relecq-Kerhuon, mis en cause pour violences multiples et infractions financières (splann.org)
Auteur de châtiments corporels sur des élèves du collège Saint-Pierre du Relecq-Kerhuon, l’ancien directeur Yves Lae, avait aussi été épinglé en 1971 pour un possible détournement de fonds publics. Des faits connus de l’administration comme du diocèse, qui n’ont pas enrayé son ascension au sein de l’enseignement catholique du Finistère.
- Scandales archéologiques en Auvergne-Rhône-Alpes : l’austérité rase notre passé (humanite.fr)
Les archéologues alertent sur le non-respect de la législation de tutelle du patrimoine archéologique, dans le cadre de projets de travaux sur le parvis de la cathédrale de Valence (Drôme) et de la déviation routière de Saint-Péray (Ardèche). La poursuite de ces travaux sans intervention archéologique préalable risque de créer de dangereux précédents
- Dans la Loire, le médicobus arpente les déserts médicaux (politis.fr)
Dans l’agglomération de Roanne (42), un cabinet médical mobile propose des consultations sur les places de plusieurs villages. À son bord, défilent des habitants de tous les âges privés d’accès à un médecin traitant et témoignant de leurs difficultés face à un système de santé défaillant.
- Pollution bactériologique : l’eau est interdite de consommation dans deux secteurs de Basse-Terre (la1ere.franceinfo.fr)
- Pesticides : la Haute-Garonne est le département le plus contaminé d’Occitanie, Toulouse en paie le prix (actu.fr)
- « Aujourd’hui, j’ai mal partout » : près de Bordeaux, des saisonniers viticoles poussés à bout et exposés aux pesticides (vert.eco)
- LGV Bordeaux-Toulouse : à toute vitesse face à l’inconnue des fantômes de roche (journal-labreche.fr)
- « On fonce droit dans le mur » : Airbus va bétonner 18 hectares à Toulouse (reporterre.net)
- Des travaux nocturnes illégaux sur l’A69 : “Aucune dérogation n’a été accordée” selon la préfecture de la Haute-Garonne (francebleu.fr)
- « Des millions d’euros économisés » : à Montpellier, un plan anti-pollution lumineuse sur mesure qui fait consensus (vert.eco)
L’enquête de la semaine
- Enquête sur l’accès aux droits sur les relations des usagers avec les services publics : que retenir ? (defenseurdesdroits.fr)
En 2024, 61 % des sondés rencontrent des difficultés, qu’elles soient ponctuelles ou régulières, contre seulement 39 % en 2016. Des difficultés qui touchent toute la population, y compris ceux habituellement moins concernés (+ 86 % pour les cadres ou professions intermédiaires, + 75 % pour les diplômés de master et plus). […] 23 % des usagers sondés déclarent avoir déjà renoncé à un droit au cours des 5 dernières années, avec pour motif principal : la complexité des démarches.
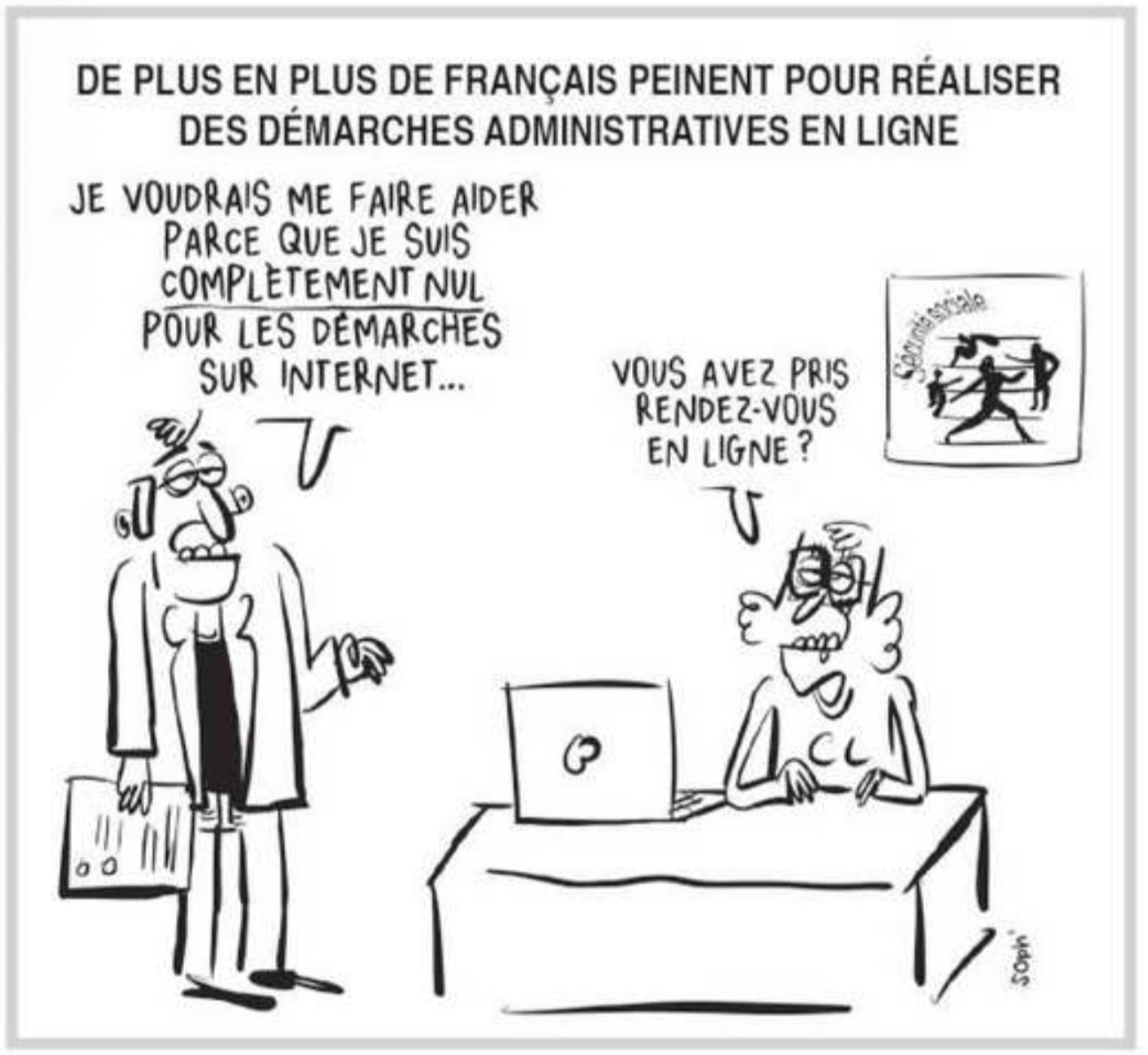
Spécial femmes en France
- Chlordécone : un nouvel effet nocif pour la fertilité des femmes en Martinique et Guadeloupe révélé par une étude (humanite.fr)
Des médeci·ennes et épidémiologistes français·es ont publié jeudi 16 octobre une étude qui révèle que les femmes les plus exposées à la chlordécone, insecticide cancérigène utilisé dans les bananeraies en Guadeloupe et en Martinique jusqu’en 1993, auraient 25 % de chances en moins de tomber enceinte.
- Souba Manoharane-Brunel, l’entrepreneuse féministe « poil à gratter » de l’écologie (reporterre.net)
« Si les femmes ne sont pas à la table, c’est qu’elles se retrouvent au menu » […] « Une écologie qui n’est ni décoloniale ni féministe n’est qu’un immense Jardiland réservé à une élite de bobos privilégiés. »
- Un rapport épingle le « terreau culturel » sexiste au ministère de l’Intérieur (streetpress.com)
À l’ère post-Metoo, la place Beauvau reste minée par une ambiance sexiste loin des promesses du ministère. Une situation mise en lumière par l’Inspection générale de l’administration, qui s’est penchée sur la situation des cadres supérieurs.
- « Je ne suis pas féministe, j’ai un bon amant » : quand les médias dépolitisent le féminisme (lesnouvellesnews.fr)
Tenter de neutraliser la parole féministe en la ramenant à une histoire d’insatisfaction personnelle, c’est encore ce que font beaucoup de médias, en 2025. Notamment dans les critiques de « La chair est triste hélas ».
- Pour les femmes, les salles de sport sont trop souvent des lieux hostiles (huffingtonpost.fr)
Parce qu’elles subissent des comportements sexistes dans les salles de sport, les femmes doivent développer des stratégies d’évitement comme le montre cette étude.
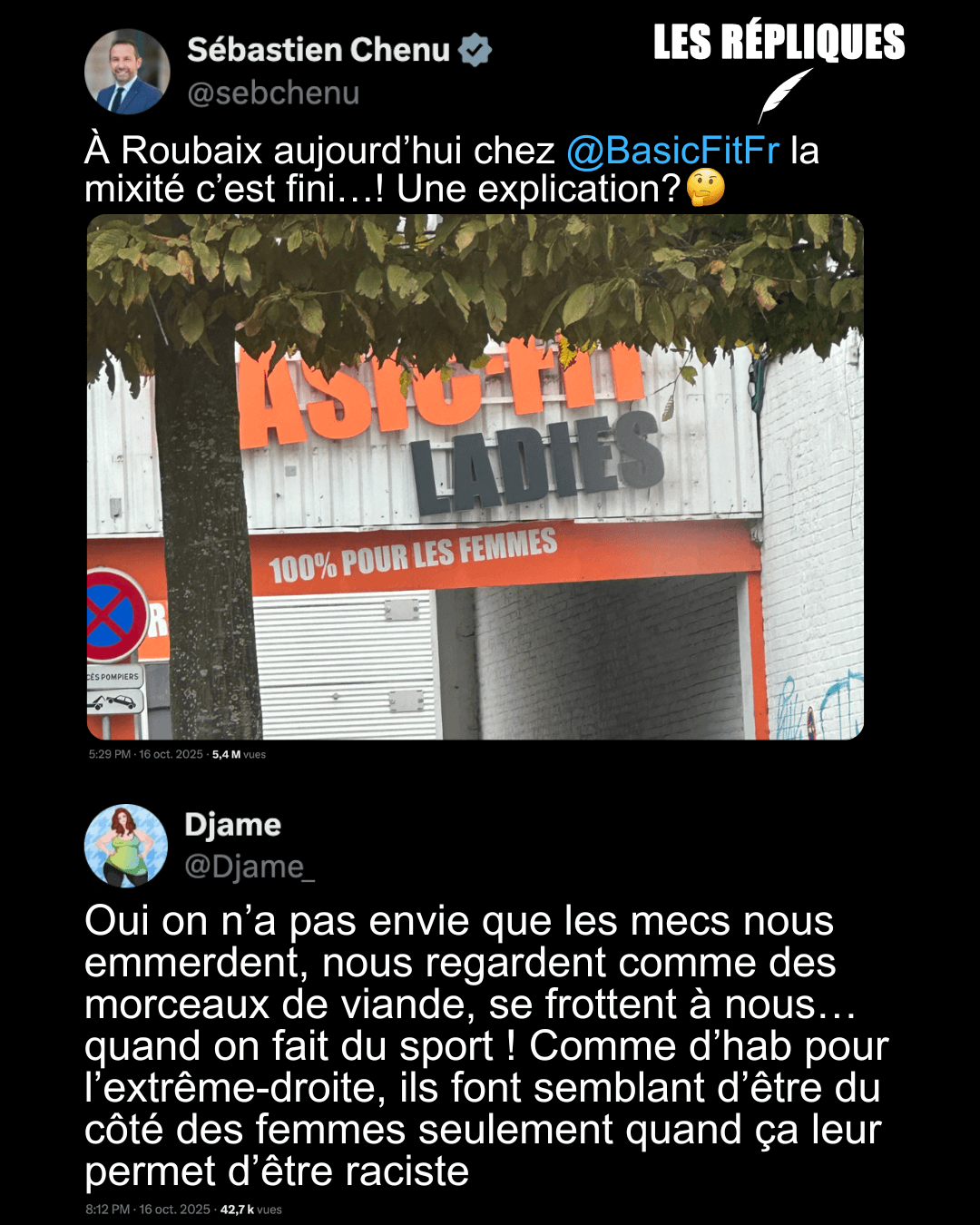
- Anouk Grinberg porte plainte contre l’avocat de Gérard Depardieu auprès de l’Ordre des avocats de Paris (huffingtonpost.fr)
L’actrice reproche à Me Jérémie Assous, conseil de Gérard Depardieu, d’avoir manqué de respect aux femmes qui accusent le comédien et à leurs soutiens.
- “J’étais terrorisée par ses colères” : la streameuse Helydia porte plainte contre son ex-compagnon pour “violences volontaires aggravées” (franceinfo.fr)
- La star du développement personnel Jacques Salomé accusé de viols et d’agressions sexuelles par 5 femmes (humanite.fr)
Les faits dénoncés s’étalent sur une période de quasi trente ans.
Spécial médias et pouvoir
- Lecornu II : le (pitoyable) théâtre du journalisme politique (acrimed.org)
En pâmoison devant le discours de politique générale du nouveau Premier ministre, émoustillé par la perspective de « non-censure » au point de désinformer sans entraves sur la question des retraites, le journalisme politique nous a encore gratifié d’une très grande scène de son théâtre habituel.
- PLF 2026 : Un cataclysme budgétaire menace les radios associatives françaises (snrl.fr)
- Palestine : un mois ordinaire dans les médias français (1) (acrimed.org)
- BFMTV s’excuse après avoir confondu les députées noires Dieynaba Diop et Nadège Abomangoli (huffingtonpost.fr)
Après que le 20 Heures de France 2 a interverti Dominique Bernard et Samuel Paty, conduisant Léa Salamé à présenter des excuses, c’est au tour de BFMTV d’être pris en flagrant délit de confusion.
- Suspicion d’emplois fictifs : au Canard Enchainé, les deux ex-dirigeants, un ancien dessinateur et sa compagne relaxé·es (humanite.fr)
- “On essaie de nous faire taire !”, pourquoi le budget de Sébastien Lecornu inquiète les radios associatives (france3-regions.franceinfo.fr)
Spécial emmerdeurs irresponsables gérant comme des pieds (et à la néolibérale)
- Qui sont les ministres du gouvernement Lecornu 2 ? (projetarcadie.com)
Si certains visages et noms sont désormais très connus du grand public, une grande partie des ministres nommés cette nuit sont surtout familiers des habitués du Palais Bourbon. Tour d’horizon des nouveaux venus, dans l’ordre protocolaire.
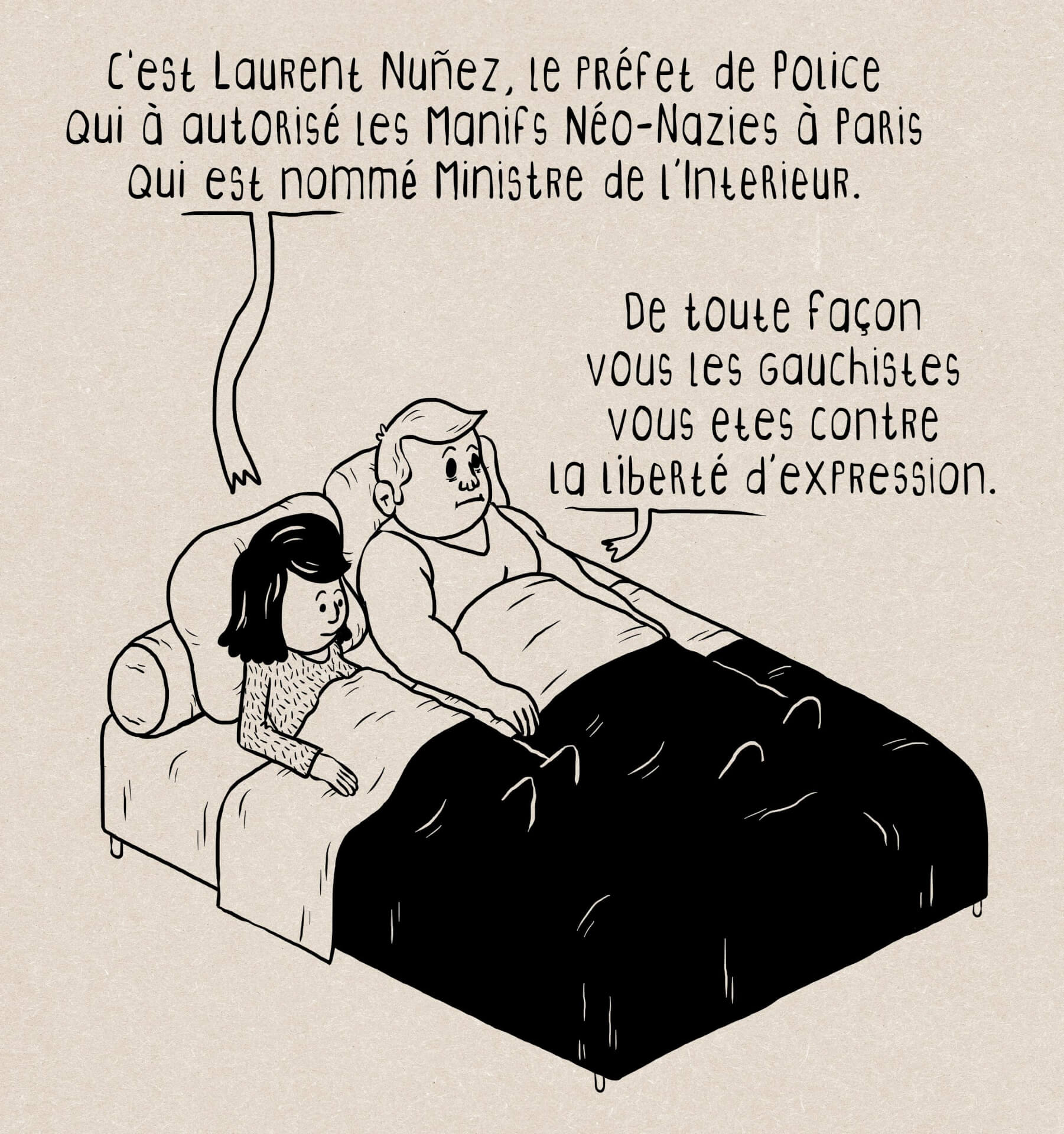
- Édouard Geffray, bras droit de Jean-Michel Blanquer, est le 7ème ministre de l’Éducation nationale (cafepedagogique.net)
La dernière étude Talis, quinquennale, pointait le taux faible de professeurs qui se sentent considérés par la société ou les dirigeants, soit 4 %. Avec 96 % des professeur.es qui se sentent méprisés, la France est sans surprise à la dernière place du classement. L’objectif serait-il d’arriver à 100 % à l’issue du second quinquennat ?
- Le budget 2026 de Sébastien Lecornu prévoit une trentaine de milliards d’euros d’économies (huffingtonpost.fr)
Sans retour de l’ISF et sans taxe Zucman, le gouvernement envisage une mise à contribution des plus riches inférieure à 2025.
- Budget, réforme des retraites… Dans son discours de politique générale, Sébastien Lecornu remet l’écologie à plus tard (vert.eco)
- Pourquoi les annonces de Sébastien Lecornu sont une arnaque (politis.fr)
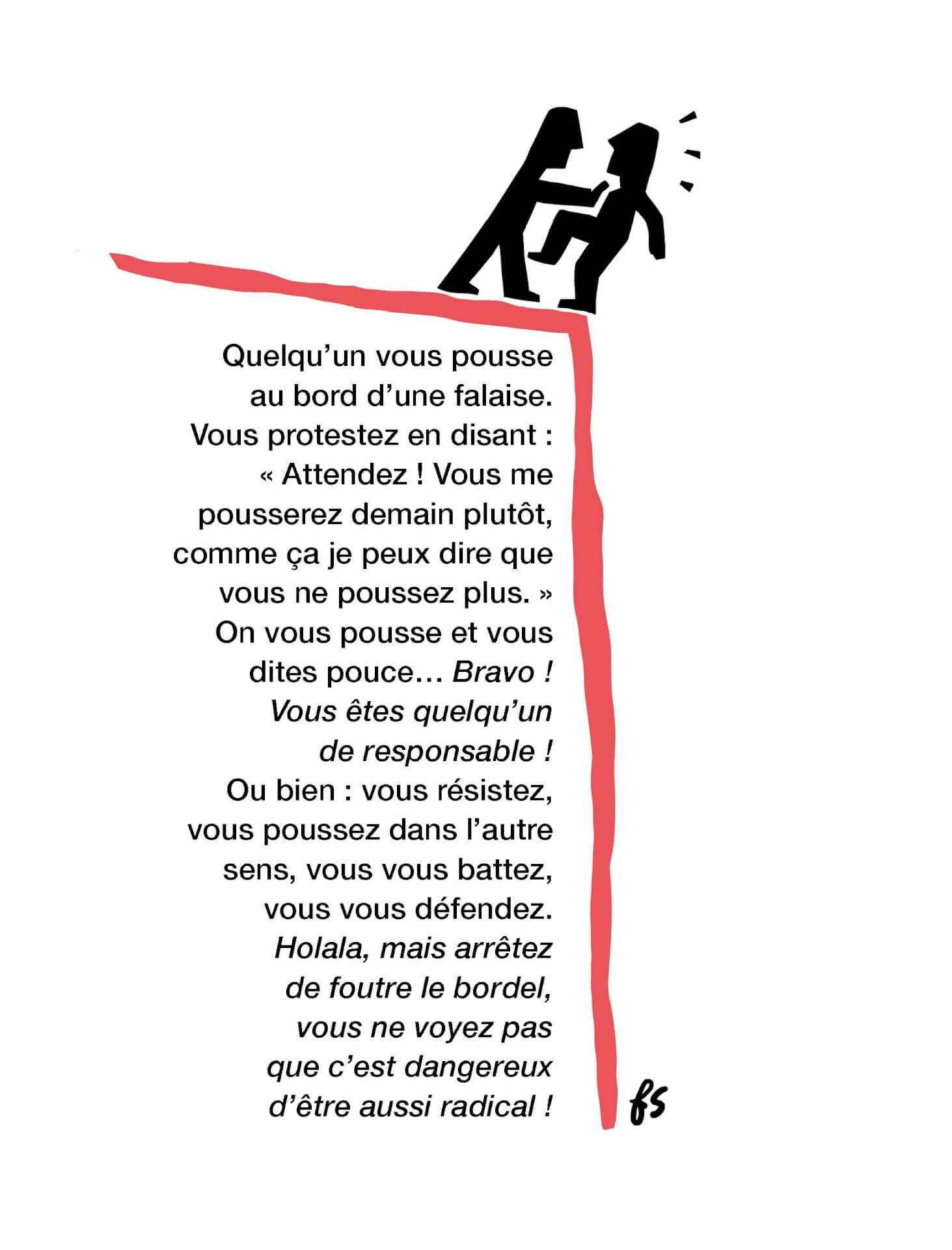
- « Tout a été fait pour épargner Bernard Arnault » : Gabriel Zucman étrille le budget de Sébastien Lecornu (huffingtonpost.fr)
La nouvelle taxe sur les holdings patrimoniales proposée par le gouvernement de Sébastien Lecornu ne séduit pas du tout Gabriel Zucman.
- Gel des pensions et remplacement de l’abattement de 10 % : le projet de budget cible les retraités (tf1info.fr)
- Budget de la Sécurité sociale 2026 : retraité·es, malades, salarié·es, familles, qui sont les perdant·es ? (projetarcadie.com)
- Budget 2026 : Ce discret coup de rabot sur les allocations familiales envisagé par le gouvernement (huffingtonpost.fr)
Le gouvernement envisage de passer de 14 à 18 ans l’âge de revalorisation des allocations familiales versées à partir du deuxième enfant.
- « Les Outre-mer paient la note de la mauvaise gestion » : face à la colère des Ultramarins, Sébastien Lecornu tente une conciliation (humanite.fr)
Le projet de budget proposé par le premier ministre, Sébastien Lecornu, provoque la colère des parlementaires ultramarins. Parmi eux, cinq socialistes se sont prononcés pour la censure du gouvernement.
- À l’Assemblée, Sébastien Lecornu gagne du temps grâce aux socialistes (politis.fr)
Dans un discours de politique générale express, le premier ministre renonce au 49.3 et suspend la réforme des retraites. Rien de plus. Mais suffisant pour que les socialistes ne le censurent pas immédiatement.
- À l’Assemblée, Sébastien Lecornu dit merci aux socialistes (politis.fr)
Le premier ministre échappe aux censures. Chez les socialistes, la fronde n’a pas vraiment eu lieu. Et la gauche se retrouve écartelée entre deux pôles.
- Le PS joue le mouvement populaire à la roulette russe (blogs.mediapart.fr)
- Lecornu : au PS, chronique d’une trahison permanente (politis.fr)
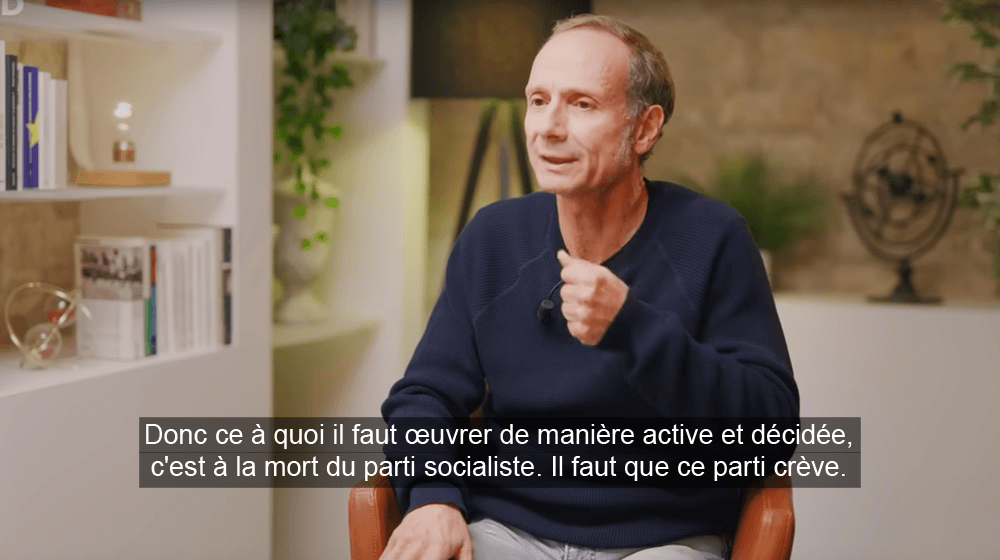
- Cher Olivier Faure (blast-info.fr)
Jeudi 16 octobre, le gouvernement de Sébastien Lecornu échappait, à 18 voix près, à la censure, pour le plus grand soulagement de la clique macronienne, merci pour eux, et pour la plus grande consternation de nombre d’électeurs et électrices de gauche qui n’imaginaient visiblement pas, en votant pour le Nouveau Front populaire à l’été 2024, que l’une de ses composantes jouerait, moins de 18 mois plus tard, le rôle de béquille du macronisme.
Spécial recul des droits et libertés, violences policières, montée de l’extrême-droite…
- Après une violente agression à Toulon, un groupe identitaire s’en sort au tribunal (streetpress.com)
Quatre membres du groupe identitaire, Le Maquis, ont comparu ce vendredi au tribunal de Toulon pour l’agression de deux mineurs. Malgré les éléments, le fond n’a pas été jugé : le tribunal a considéré l’enquête du parquet insuffisamment justifiée. […] La décision suscite d’ailleurs suffisamment d’incompréhension dans la salle pour que la présidente lance un avertissement un brin mystérieux : « Attention, si je lis des choses désagréables dans la presse, je saurai quoi faire. »
- « Maccarthysme 2.0 » : un rapport alerte sur les attaques contre la liberté académique des chercheureuses, y compris en France (humanite.fr)
- Vichy et les Juifs français : deux historiennes dans le viseur d’auteurs révisionnistes (telerama.fr)
Michèle Riot-Sarcey et Natacha Coquery sont attaquées en justice pour avoir contesté, dans un article, la thèse d’un ouvrage soutenant que le régime de Vichy aurait œuvré à protéger les Juifs français pendant la Seconde Guerre mondiale.
Voir aussi Historiennes poursuivies par des révisionnistes de Vichy : le tribunal annule la procédure (humanite.fr)
- Au grand homme, la patrie indifférente (syndicat-magistrature.fr)
Tout juste renommé ministre de la Justice, Gérald Darmanin choisit de poursuivre la création de prison de haute sécurité.Le Syndicat de la magistrature dénonce l’extension d’un régime qui impose des conditions de détention indignes et inhumaines à des personnes qualifiées par l’administration de « dangereuses » sans critère ni fondement transparent. […] Cette annonce intervient alors même que la République vient de célébrer Robert Badinter qui avait fermé les quartiers de haute sécurité en 1982, dénonçant l’« indignité d’un État de droit qui se nie lui-même ».
- Christian Tein enfin autorisé à rentrer en Kanaky-Nouvelle-Calédonie (humanite.fr)
Le président du FLNKS est toujours sous le coup d’une procédure judiciaire : il est accusé d’avoir orchestré les violences de mai 2024 sur l’archipel quand le gouvernement et la droite locale avaient voulu imposer le dégel du corps électoral au mépris du processus de décolonisation. Le dossier paraît de plus en plus vide, et Christian Tein a passé un an derrière les barreaux pour des motifs politiques
- Un comité des Nations Unies accuse la France violations « graves et systématiques » des droits des mineur·es isolé·es (humanite.fr)
- À Paris, un conducteur percute deux personnes lors d’une manifestation de sans-papiers (politis.fr)
Vendredi 10 octobre, un homme en voiture a percuté des manifestants lors d’une mobilisation organisée par un collectif de sans-papiers à Paris. Deux hommes ont été blessés et ont porté plainte. Malgré leurs témoignages, la police a retenu l’infraction de « blessures involontaires ». […] Pour que la Fiat s’arrête, il a fallu que la police arrive en courant et pointe son arme sur le conducteur en lui intimant de s’arrêter. « J’ai dit aux camarades “éloignez-vous” » se souvient Yoro. « Dans ma tête il n’allait pas s’arrêter et ils allaient tirer. »
- Pays basque : des amendes requises contre les sept militants solidaires des exilés (basta.media)
Sept militant·es solidaires risquaient dix ans de prison pour avoir aidé des personnes exilées à passer la frontière lors d’un évènement sportif. Au procès, le 7 octobre à Bayonne, des amendes de 1000 à 1500 euros ont finalement été requises.
- 163 000 euros pour un jet de peinture : Matignon veut faire payer deux écologistes (reporterre.net)
- « Gilets jaunes » : relaxe d’un major de CRS poursuivi pour la main arrachée d’un manifestant en 2018 (lemonde.fr)
Au vu de la « situation très dégradée » de la manifestation, « le tribunal a considéré que l’action du major D. constituait une réponse nécessaire et proportionnée », propre à l’exercice de ses fonctions de maintien de l’ordre.
Spécial résistances
- Affaire des fichiers d’Éric Ciotti : la Ligue des Droits de l’Homme annonce déposer plainte contre le député et candidat à la mairie de Nice (nicepresse.com)
Une enquête préliminaire avait été ouverte en mai dernier du chef d’« enregistrement ou conservation de données à caractère personnel sensibles ». Ceci faisant suite au signalement au printemps d’un « lanceur d’alerte anonyme » informant de l’existence de ce document mis en place par les équipes du député et président de l’UDR Éric Ciotti.
- Communiqué de presse d’Autisme France Suite aux propos du ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, au JT de France 2 le 14 octobre 2025 (autisme-france.fr)
Le ministre du Travail et des Solidarités a associé sourd à autiste : il dit ainsi qu’être autiste est un choix personnel, celui de ne pas écouter : ce genre d’ânerie est malheureusement entretenu par la psychanalyse qui continue à sévir en France dans l’autisme et explique l’autisme par une décision du « sujet ».
- Calvados : Sabotage de la ligne Paris-Caen à l’occasion des Assises Nationales de l’IA (trognon.info)
Spécial outils de résistance
- IA et vie privée : comment s’opposer à la réutilisation de ses données personnelles pour l’entraînement d’agents conversationnels ? (cnil.fr)
- Impôt sur les sociétés : 14 milliards d’euros en plus si les grandes entreprises avaient le même taux d’imposition que les PME (france.attac.org)
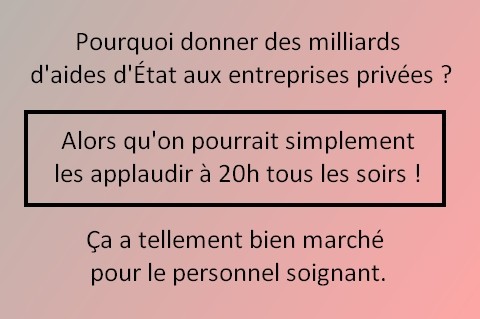
- Baisser le coût du travail ne crée pas d’emplois (politis.fr)
- Le Cherche et Trouve de l’édition (surtout) française (ecologiedulivre.org)
- Avec cette carte inédite, vérifiez si l’eau du robinet est polluée chez vous (reporterre.net)
Pollution aux PFAS, aux pesticides, au gaz toxique… Face aux multiples alertes concernant l’eau du robinet, vous pouvez dorénavant utiliser le site Dans mon eau (dansmoneau.fr). Développé par l’ONG Générations futures et Data For Good, cet outil novateur permet de savoir précisément quels polluants contaminent, ou non, votre eau courante.
- La contraception masculine en 3 questions (revue-farouest.fr)
Et si la contraception n’était plus seulement une affaire de femmes ? Préservatif, vasectomie, méthodes thermiques… les options masculines existent bel et bien, mais restent méconnues. Entre idées reçues et manque de soutien, ces solutions gagneraient pourtant à être mieux connues et discutées.
Spécial GAFAM et cie
- A first look at the Amazon-backed, next-generation nuclear facility planned for Washington state (geekwire.com)
A project to build one of the nation’s first next-generation nuclear facilities has just announced its name — the Cascade Advanced Energy Facility — and shared renderings of the plant.
- How I Reversed Amazon’s Kindle Web Obfuscation Because Their App Sucked (blog.pixelmelt.dev)
So let me get this straight :
I paid money for this book
I can only read it in Amazon’s broken app
I can’t download it
I can’t back it up
I don’t actually own it
Amazon can delete it whenever they want
This is a rental, not a purchase. - Microsoft Windows 11 October Update Breaks Localhost (127.0.0.1) Connections (cybersecuritynews.com)
- Windows 10 support “ends” today, but it’s just the first of many deaths (arstechnica.com)
End users can get an extra year of security updates relatively easily.
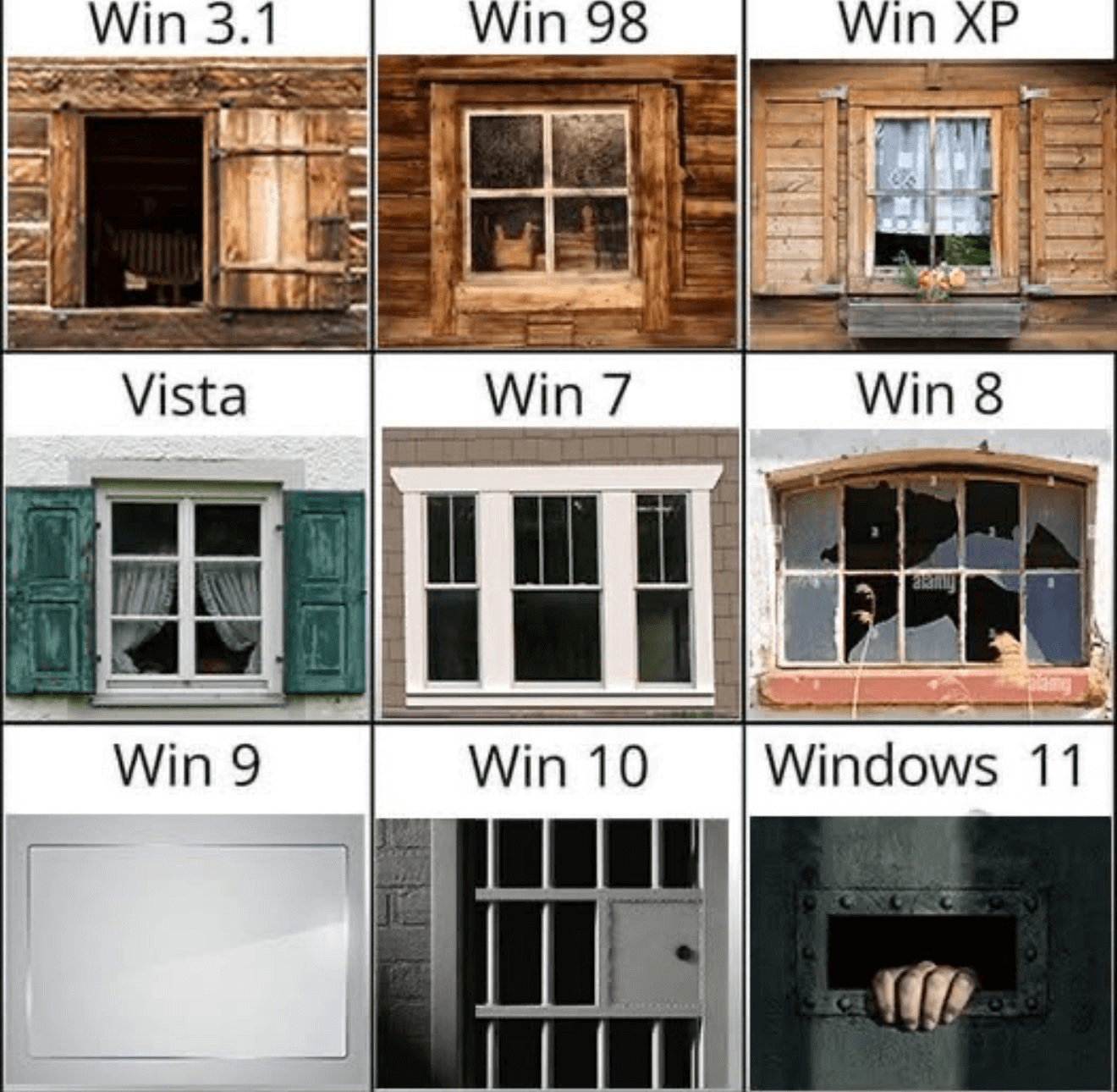
- Suspension du projet Microsoft à Polytechnique : une première victoire pour la souveraineté numérique, un appel à la responsabilité pour l’ensemble de l’ESR (cnll.fr)
L’École polytechnique suspend sa migration vers Microsoft 365. Le Conseil National du Logiciel Libre (CNLL), qui s’était fermement opposé à ce projet, accueille cette décision comme une victoire majeure pour la souveraineté de la recherche française et le respect du droit.
- Bye bye Spotify (pcet.fr)
Les autres lectures de la semaine
- Le droit de grève va-t-il disparaître ? D’où vient la menace ? (equaltimes.org)
La montée en puissance des politiques néolibérales incite de nombreux gouvernements à tenter de les entraver par de nouvelles lois, limitant ainsi les effets perturbateurs des grèves, ce qui les rend pratiquement inopérantes comme outil de pression et de défense des classes populaires.
- GenZ 212, au-delà de l’acronyme : regard sur une révolte (portail.basta.media)
- L’affrontement sino-américain pour le contrôle du numérique (contretemps.eu)
- Holes in the web (aeon.co)
Huge swathes of human knowledge are missing from the internet. By definition, generative AI is shockingly ignorant too […] one study on medicinal plants in North America, northwest Amazonia and New Guinea found that more than 75 per cent of the 12,495 distinct uses of plant species were unique to just one local language. When a language becomes marginalised, the plant knowledge embedded within it often disappears as well.
- La blague de l’open source base de souveraineté (paperjam.lu)
dans un monde où la souveraineté numérique se joue autant sur les données que sur le code, l’open source n’est pas encore une garantie d’indépendance : c’est un terrain de bataille.
- Surprise ! La 5G ne sert à (presque) rien (thierryjoffredo.frama.io)
Ça valait bien la peine de stigmatiser les personnes de la société civile qui réclamaient, en 2020, un débat démocratique pour définir les modalités de mise en œuvre de cette technologie en brandissant la peur du retour à la lampe à huile ou à la bifurcation vers un modèle Amish, sur fond de peur d’un supposé “retard” français et du déclassement de l’économie française sur le plan économique mondial si on perdait du temps à en discuter collectivement de la possibilité d’un moratoire sur le déploiement de la 5G.
- Notes on Humans Commons (blog.zgp.org)
- Détournement des communautés (n.survol.fr)
la question n’est pas de si la récupération va arriver mais de quand
- Le numérique à l’aune de la communotechnie – Les militant·es écologistes et le numérique (ecologiesocialeetcommunalisme.org)
- Écrire à la main et faire des pauses aide à mémoriser (theconversation.com)
- Delphine Demange et les compilateurs (linuxfr.org)
- Corps et territoire (hors-serie.net)
En Amérique latine, dans les réseaux de femmes paysannes, indigènes et urbaines, le féminisme populaire défend la terre, le territoire, et donne une signification particulière à la corporalité, à un corps-territoire […] l’agentivité des femmes est évidente, puisqu’elles se trouvent à l’avant-garde de la défense du territoire, de la terre, en opposition aux projets miniers et contre les compagnies pétrolières. Il me semble que ces phénomènes expliquent les vagues de féminicides et la pédagogie de la cruauté qui conduit à la mort, mais aussi à des actes de torture. Il y a une visibilité du corps torturé dans l’espace public.
- Le pouvoir des mâles n’est pas la norme chez les primates. (theconversation.com)
Depuis Darwin et jusqu’à la fin des années 1990, les recherches sur les stratégies de reproduction des animaux s’intéressaient surtout aux mâles. Une prise de conscience a ensuite eu lieu, en réalisant qu’il pourrait être intéressant de ne pas seulement étudier la moitié des partenaires… […] la dominance stricte d’un sexe sur l’autre, lorsqu’un sexe gagne plus de 90 % des confrontations, comme ce que l’on observe chez les babouins chacma, est rare. Il y a moins de 20 % des espèces où les mâles sont strictement dominants sur les femelles, et également moins de 20 % où ce sont les femelles qui sont strictement dominantes. […] la dominance des mâles s’observe surtout chez les espèces polygames, terrestres, vivant en groupe, comme par exemple les babouins, les macaques ou encore les gorilles, où les mâles disposent d’une nette supériorité physique sur les femelles.

- « Nous avons des enseignements à tirer de la manière dont les animaux se soignent » (reporterre.net)
- 5 astuces low-tech pour arrêter de ronfler et dormir d’une traite (lowtechjournal.fr)
Les BDs/graphiques/photos de la semaine
- Mixité
- Oignon
- RdV
- Pourquoi
- Nunez
- Retraites
- FT
- Zucman
- Falaise
- PS
- Donc
- At least
- Surveillance
- Nope
- Resist
- Pikachu
- Girls
- Grantifa
- Internationale
- Belts
- Windows
- Climate
- Does the news reflect what we die from ? (ourworldindata.org)
Les vidéos/podcasts de la semaine
- Catherine Tricot : ça va faire mal ! (tube.fdn.fr)
- Alice de Rochechouart sur la différence entre privilèges et compensations de désavantages (tube.fdn.fr)
- Italie : aux origines de la coalition des droites sous domination néofasciste (partie 1) (spectremedia.org)
- Islande, un jour sans femmes (arte.tv – disponible jusqu’au 13/01/2026)
En 1975, pour réclamer l’égalité entre les sexes, des féministes islandaises lancent un appel à la grève qui sera suivi… par 90 % des femmes du pays. Cinquante ans plus tard, celles qui l’ont vécue relatent cette joyeuse journée historique, restée unique au monde par son ampleur.
- Bari Weiss : Last Week Tonight with John Oliver (HBO) (tube.fede.re)
- Smart Glasses Are Ushering In An Anti-Social World (techwontsave.us)
- Le monde après le spécisme – En finir avec l’oppression des animaux (radiofrance.fr)
Les trucs chouettes de la semaine
- FSF announces Librephone project (fsf.org)
Librephone is a new initiative by the FSF with the goal of bringing full freedom to the mobile computing environment. The vast majority of software users around the world use a mobile phone as their primary computing device. After forty years of advocacy for computing freedom, the FSF will now work to bring the right to study, change, share, and modify the programs users depend on in their daily lives to mobile phones.
- Windows 10 sunsetting doesn’t mean the end for your PC (fsf.org)
- Windows 10 Is Dead. Your PC Doesn’t Have To Be (ifixit.com)
- Premier Samedi du Libre XXL le week-end des 6 et 7 décembre ! (samedis-du-libre.org) – un grand merci à Shiyata pour l’affiche !
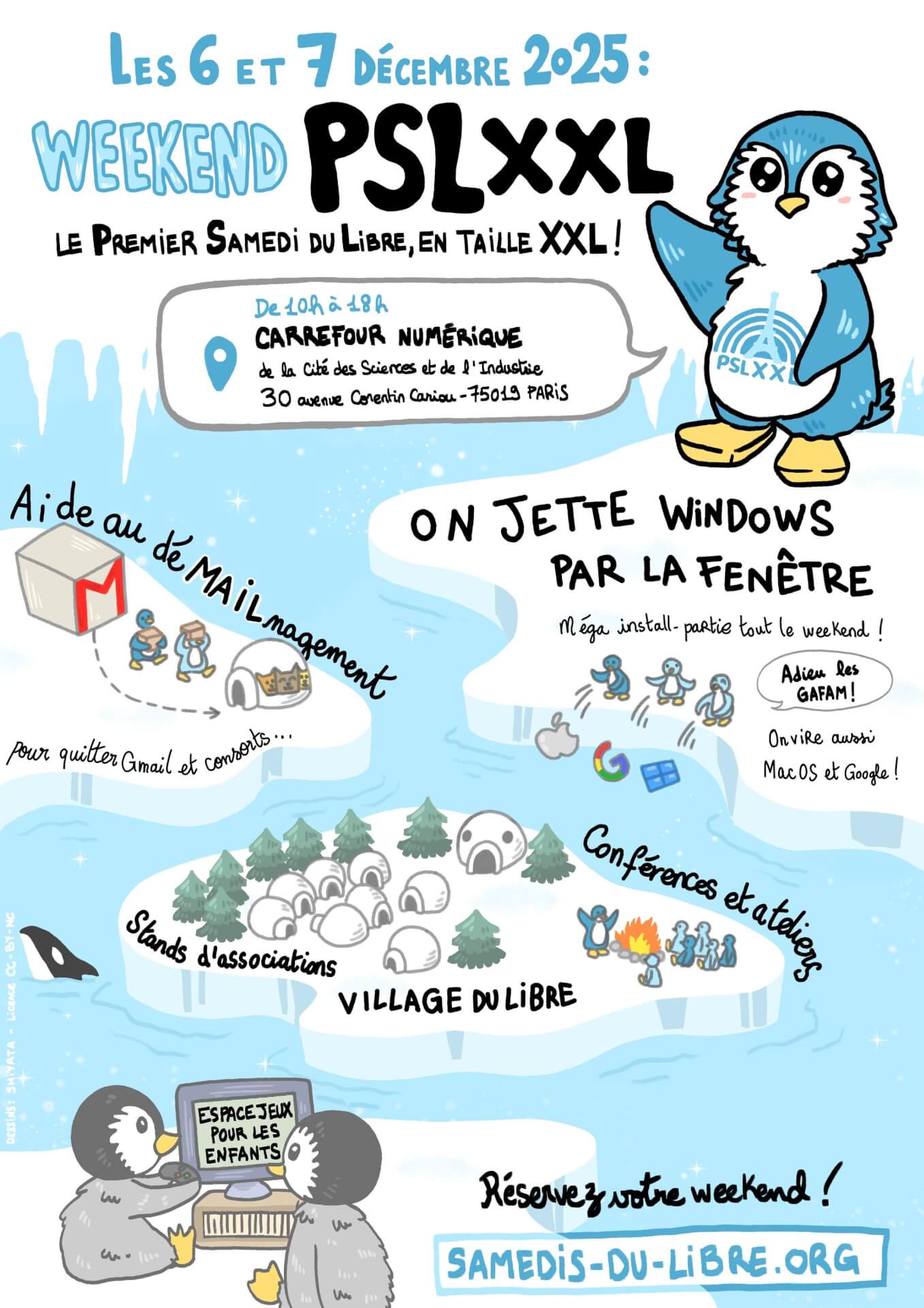
- Appel aux conférencier·es : libre, éthique et partage (rencontreshivernalesdulibre.ch)
- Radio Garden, le site où on peut écouter toutes les radios du monde en se baladant sur une carte (radio.garden)
- 50 Reasons to Build a Website (frontendmasters.com)
- Hey Look, It’s Every AI-Coded Website Ever (vibe-coded.lol)
Take a look around at the same fucking vibe-coded site you’ve seen ten million times before ! Built entirely by copy-pasting Claude responses without reading them !
Retrouvez les revues de web précédentes dans la catégorie Libre Veille du Framablog.
Les articles, commentaires et autres images qui composent ces « Khrys’presso » n’engagent que moi (Khrys).
17.10.2025 à 09:52
Adieu Windows, bonjour le Libre !
Framasoft
Texte intégral (1460 mots)
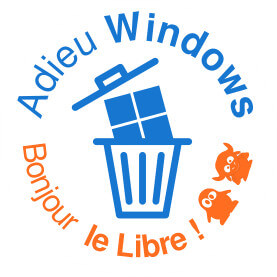 Nous vous en parlions la semaine dernière dans notre article Fin de Windows 10 : faisons le point, l’opération « Adieu Windows, bonjour le Libre ! » lancée par l’association April est en place depuis le 1er octobre. On y revient plus en détail cette semaine.
Nous vous en parlions la semaine dernière dans notre article Fin de Windows 10 : faisons le point, l’opération « Adieu Windows, bonjour le Libre ! » lancée par l’association April est en place depuis le 1er octobre. On y revient plus en détail cette semaine.
De l’aide à portée de main
Le plus important dans cette opération, c’est l’entraide !
Si vous aussi, vous voulez vous délivrer-libérer de l’emprise de Microsoft ou le permettre à vos proches, si vous ne voulez pas ou n’avez pas les moyens de passer à Windows 11, alors les systèmes libres s’offrent à vous. Vous pouvez en installer un de façon autonome, chez vous, mais si vous pensez avoir besoin d’aide, les bénévoles de très nombreuses associations se sont organisé·es pour vous recevoir et répondre à toutes vos questions.
- Soit en participant à l’un des nombreux évènements organisés près de chez vous.
- Soit en prenant contact avec une association locale.
Cette opération se tient sur un an, elle est donc continuellement en cours de remaniement, avec des ajouts permanents d’évènements. Restez à l’affût, il y a ou aura forcément quelqu’un·e, quelque part, prêt·e à vous transmettre sa passion informatique et résoudre vos problèmes ou satisfaire vos envies.
C’est la principale différence entre les logiciels privateurs et les logiciels libres : ces derniers bénéficient de l’aide des bénévoles des communautés qui les maintiennent, les promeuvent et sont ravis de partager leur savoir-faire au grand public, gratuitement, chaleureusement et sans contrepartie.
N’hésitez pas à aller à leur rencontre !
Une communauté solidaire
C’est toute une communauté qui se met au service du plus grand nombre afin de sortir des griffes de Microsoft (mais pas que ! Il existe des alternatives aux produits d’Apple et de Google aussi). Sont au rendez-vous des GULL (Groupe d’Utilisateurs et d’utilisatrices de Logiciels Libres, des EPN (Espace Numérique Libre), des médiathèques, des cafés associatifs, des CHATONS (miaou), quelques entreprises également et d’autres associations.
En seulement quinze jours, plus d’une soixantaine d’organisations se sont associées à l’opération, partageant cordonnées et évènements sur l’Agenda du Libre. Et ce n’est pas fini, ça va durer un an !
Quel que soit le matériel utilisé, ordinateur, tablette, smartphone, les systèmes d’exploitation et logiciels libres sont nombreux, maintenus et faciles d’accès.
Si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi les évènements proposés, il existe d’autres initiatives pour libérer votre ordinateur, comme les Journées Nationales de la Réparation du 16 au 19 octobre 2025, Aide GNU/Linux qui propose une carte collaborative de marraines et de parrains en mesure d’aider à l’installation, Fin de Windows 10, Non à la taxe Windows et la démarche NIRD « pour un numérique libre et écocitoyen dans les établissements scolaires ! ».
Pour l’April, c’est le bon moment de quitter Windows !
L’Association dénonce, une fois encore, les méfaits de Microsoft.
Windows 10 est un logiciel privateur, qui répond à ce titre et avant toute autre considération aux intérêts de Microsoft qui a ainsi tout loisir d’imposer unilatéralement l’arrêt du support de son système d’exploitation. Conséquence : sans mises à jour régulières, sans correctif de sécurité, sans assistance technique, Windows 10 devient vulnérable, donc dangereux à l’usage. C’est exactement ce qu’on appelle de l’obsolescence logicielle ! Un matériel qui fonctionne encore, mais qu’il faudrait mettre au rebut parce que le système d’exploitation devient obsolète et que la nouvelle version disponible n’est pas compatible avec lui.
Et tout cela pour pousser à la consommation : nouveaux PC, nouveaux abonnements, nouvelles licences dont il est parfois impossible de connaître le prix, c’est ce qu’on appelle de la vente forcée. C’est tout sauf écologique. Si toutes les personnes, toutes les associations, toutes les entreprises, toutes les administrations et toutes les collectivités changent de matériel pour acheter du neuf, c’est même un écocide. Il a été estimé que jusqu’à 400 millions d’ordinateurs dans le monde sont incompatibles avec cette nouvelle version de Windows, dont certains achetés il y a moins de trois ans !
Cet arrêt du support gratuit de Windows 10 va donc forcer à migrer vers Windows 11, qui, lui aussi forcément, imposera les mêmes restrictions techniques : puissance, mémoire, absence de compatibilité avec des logiciels plus anciens et DRM (menottes numériques) intégrés.
Ce prolongement de support gratuit n’est possible que si les personnes enregistrent leur compte sur le site de Microsoft. Ce faisant, elles lieront leur ordinateur à leur adresse e-mail, et laisseront un accès total à leur matériel, permettant ainsi à la multinationale américaine de collecter des données, de plus en plus nombreuses (avec des paramètres de confidentialité complexes à désactiver.), et lui laissant un pouvoir de contrôle technique, à distance, sans passer par l’étape de l’accord explicite. Ce prolongement du support gratuit est en fait un piège pour influencer les gens et les amener à installer Windows 11.
L’utilisation des produits de Microsoft n’est pas une fatalité.
Pour migrer vers un système libre, il faut le vouloir, c’est un choix personnel, politique, économique, voire écologique…
Il existe pourtant de très nombreuses alternatives libres GNU/Linux qui peuvent remplacer Windows, pour n’en citer que quelques-unes : Debian, Ubuntu, Mageia, Fedora, Primtux (cette dernière étant spécialement conçue pour enfants). Idem pour les logiciels. Consultez le site Framalibre pour en découvrir.
Pour ne pas jeter vos appareils numériques, pour préserver vos données et celles des autres, pour retrouver votre autonomie, libérez-vous et délivrez vos ordinateurs. Adieu Windows !
16.10.2025 à 10:00
Quelles applications libres utiliser sur Windows ?
Framasoft
Texte intégral (11105 mots)
Une des grandes actualités des dernières semaines est la fin du support de Windows 10 par Microsoft.
Ça peut sembler anecdotique pour certain·es mais cet événement a un réel impact pour des millions de personnes puisque cette fin de support rend obsolète tout ordinateur n’étant pas compatible avec la version 11 de Windows.
Nous l’expliquions récemment, nous avons toujours la possibilité de passer notre ordinateur sur Linux, et rallonger ainsi drastiquement la durée de vie de notre ordinateur.
Cependant, pour de nombreuses personnes, passer vers Linux semble être une étape trop importante pour le moment. Et nous les comprenons ! Le processus de transition numérique nécessite, pour se faire en douceur, d’y aller par étapes et de changer progressivement ses habitudes !
Dans cet article, nous vous proposons de découvrir des étapes concrètes pour vous aider à vous émanciper de l’emprise de Microsoft sur vos vies numériques. Pas besoin d’installer Linux, vous pouvez accomplir ces étapes dès aujourd’hui, sur votre Windows !
Les applications proposées dans cet article sont toutes des logiciels libres. Cela signifie que leur licence d’utilisation permet à l’utilisateurice de garder le contrôle sur le logiciel.
Aussi, ces applications existent à la fois sous Windows et Linux (comme souvent avec les logiciels libres) et vous permettront donc de vous habituer, dès aujourd’hui, aux applications que vous utiliserez sur Linux (quand vous le souhaiterez) !
Adieu Chrome, bonjour Firefox
Nous utilisons presque systématiquement notre navigateur Web lorsque nous allumons notre ordinateur. Vous savez, c’est cette application qui nous permet d’accéder à l’ensemble des sites Web. On s’en sert aujourd’hui pour tout, que ce soit pour écouter de la musique, regarder des vidéos, consulter nos mails, faire des visioconférences, etc.
Par exemple, vous utilisez actuellement un navigateur Web pour lire cet article de blog !
Par défaut, sur un ordinateur utilisant Windows, le navigateur est Microsoft Edge. Ce navigateur, proposé par Microsoft, est en fait basé sur le projet Chromium, de Google. Chromium, c’est un navigateur servant de base à d’autres navigateurs (c’est un peu inception mais pour les navigateurs, vous me suivez ?).
C’est par exemple le cas de Google Chrome, le navigateur propriétaire de Google.
Un navigateur est un logiciel puissant et les géants du numérique comme Google ou Microsoft s’en servent pour collecter énormément d’informations sur nous. Quels sites nous visitons, quelles recherches nous effectuons, etc.
C’est pourquoi il est essentiel d’opter pour un navigateur en lequel nous avons confiance et qui n’exploite pas nos données comportementales.
Un tel navigateur existe, c’est Mozilla Firefox.
Mozilla Firefox (souvent abrégé Firefox) est lui aussi un navigateur, mais proposé par une fondation à but non lucratif : la fondation Mozilla.
Ce point est très important car si Microsoft Edge et Google Chrome sont pensés pour rapporter, avant tout, de l’argent aux entreprises qui les proposent, Mozilla Firefox est quant à lui pensé pour servir avant tout les humains et humaines qui l’utiliseront.
Bien sûr, l’application n’est pas exempte de tout défaut et certains choix faits par Mozilla sont sujets à critiques.
Néanmoins, nous pensons que c’est la meilleure option que nous avons aujourd’hui.
Découvrons ensemble comment installer et configurer Firefox !
Installer Firefox
- Ouvrez un navigateur pour accéder au site officiel de Firefox. De manière courante, téléchargez TOUJOURS les logiciels à partir de leur site officiel (et dans le doute, les pages Wikipédia des logiciels ont souvent le bon lien !). C’est un bon moyen d’éviter d’installer des logiciels indésirables, voire pire, sur son ordinateur !
- Vous allez être redirigé vers une nouvelle page, vous confirmant que le téléchargement va commencer. Patientez jusqu’à ce que le téléchargement soit complet. Celui-ci devrait s’être affiché en haut à droite de votre navigateur.
- L’installation va alors commencer et Firefox s’exécutera automatiquement à la fin de celle-ci.
- Lors du premier démarrage, Firefox vous propose de configurer votre ordinateur pour :
- Épingler Firefox à la barre des tâches. La barre des tâches, c’est la barre en bas de votre Windows. Épingler Firefox ici permet d’y accéder plus rapidement.
- Faire de Firefox votre navigateur par défaut. Cela permettra d’ouvrir automatiquement les liens sur lesquels vous cliquez (dans d’autres applications) avec Firefox. Cette option est recommandée.
- Importer depuis un ancien navigateur. Cela vous permettra de récupérer les données (historique, identifiants, etc) de votre ancien navigateur. Très pratique pour faire une transition quasi-transparente.
- Si vous faites « Enregistrer et continuer », une fenêtre vous permettant de définir Firefox comme application par défaut va s’ouvrir. Vous pouvez aussi de choisir d’ignorer toutes ces étapes en cliquant sur « Ignorer cette étape » en bas à droite de l’écran.
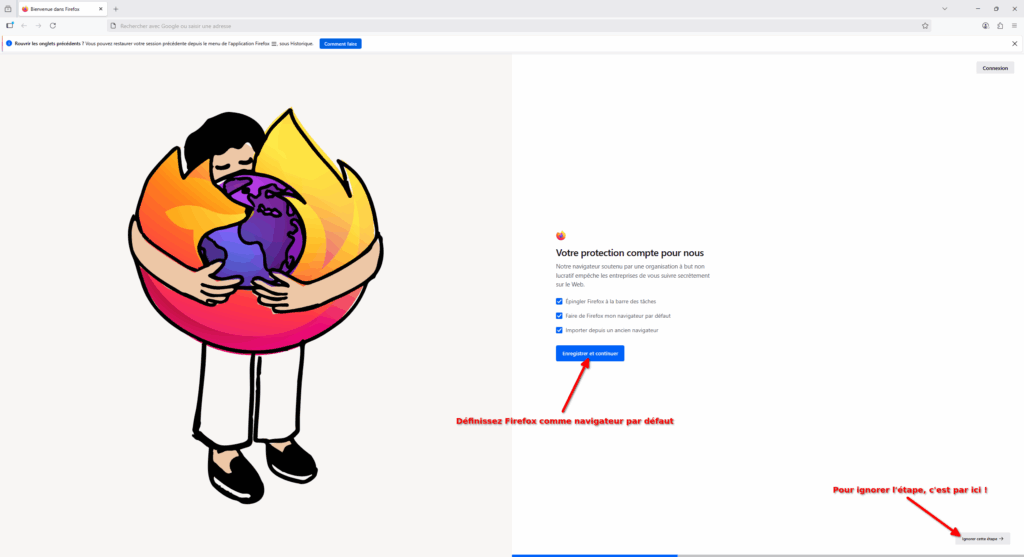
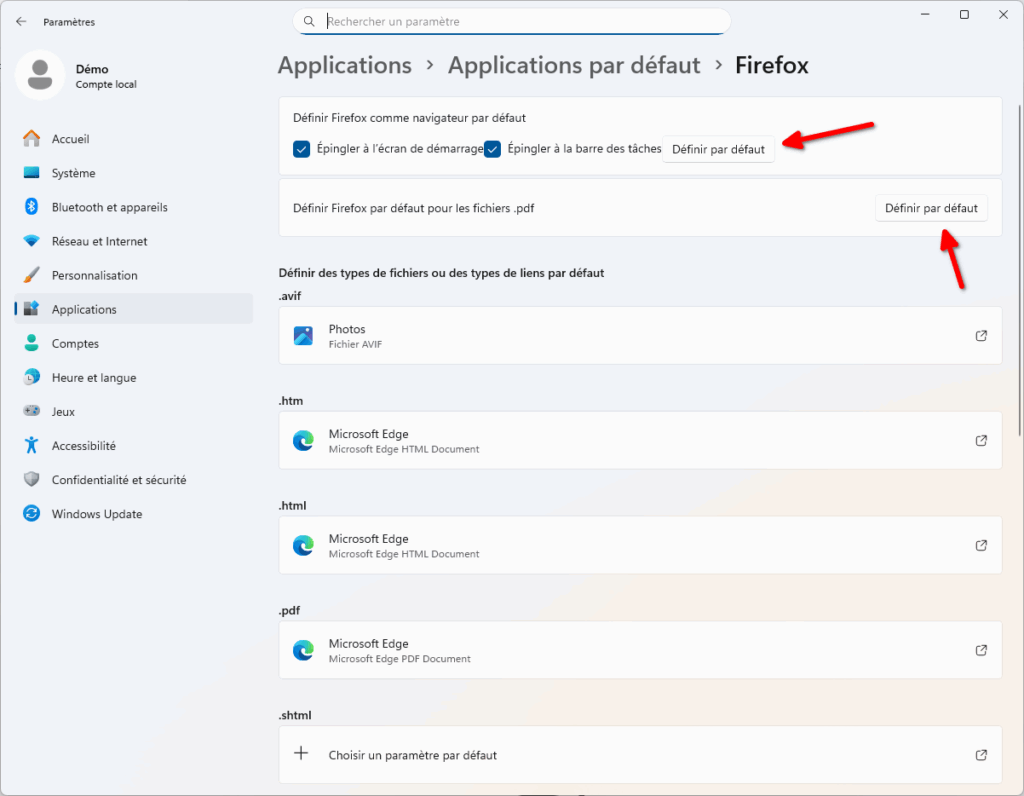
- Si vous avez sélectionné d’importer les données depuis un ancien navigateur, Firefox va vous proposer de sélectionner les données que vous souhaitez récupérer. Une fois la sélection faite, faites « Importer ».
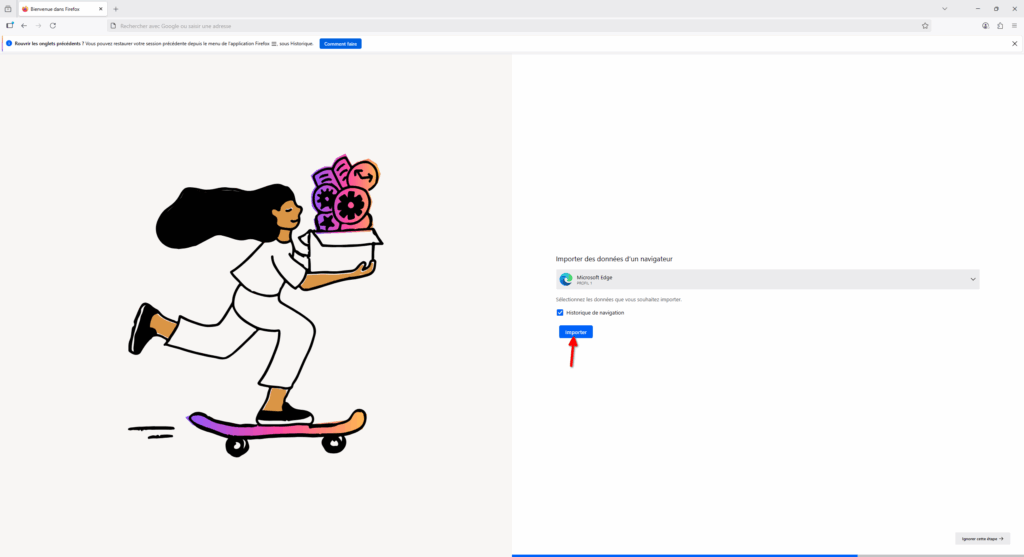
- L’écran suivant vous indiquera que les données ont été correctement importées, vous pouvez cliquer sur « Continuer ».
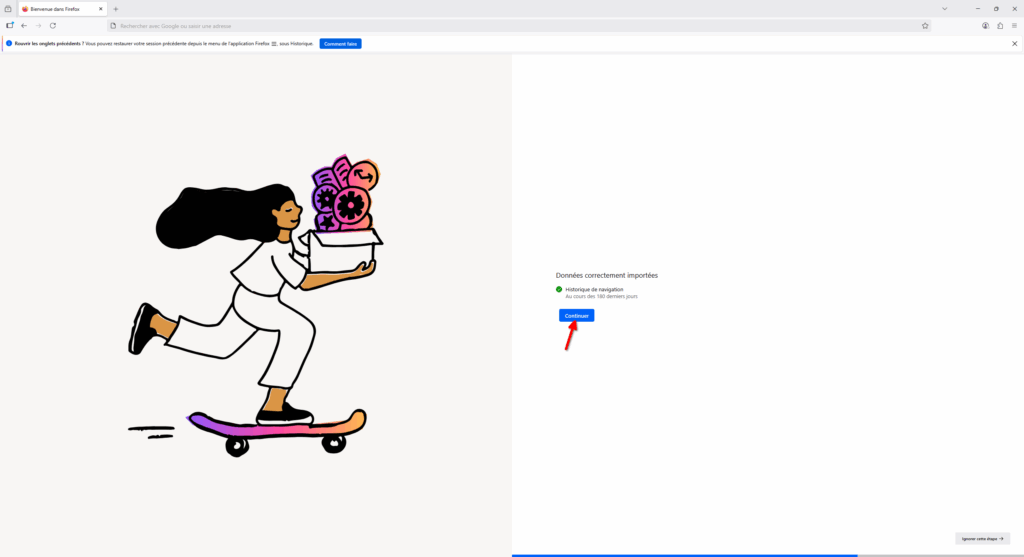
- L’écran suivant vous propose de synchroniser votre navigateur avec un compte en ligne Firefox. Cela peut être pratique dans le cadre où vous installez Firefox sur plusieurs appareils, et permet de synchroniser l’historique, les identifiants et vos paramètres entre vos appareils. Vous pouvez vous décider plus tard, dans ce guide, nous considérons que vous avez cliqué sur « Commencer la navigation », en bas à droite du navigateur.
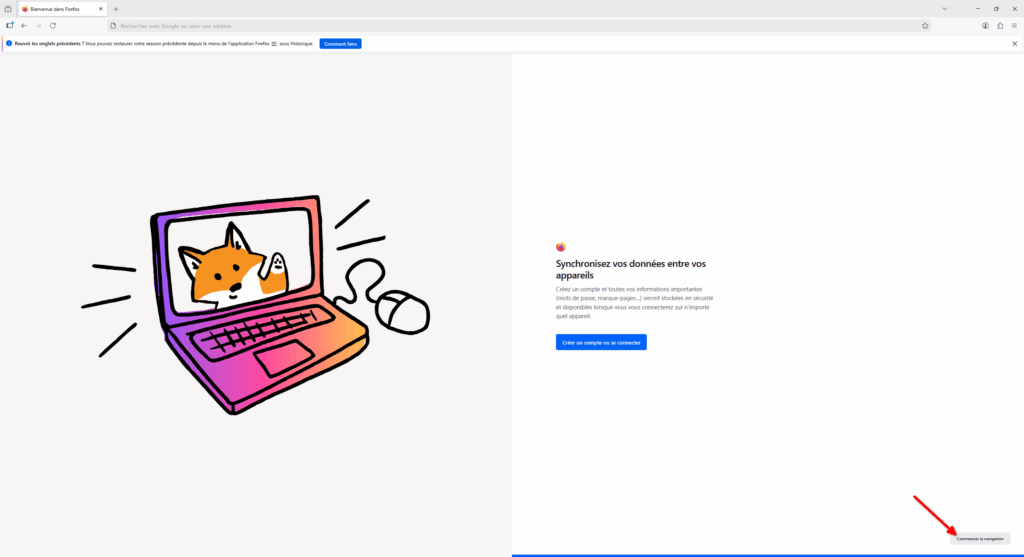
Votre Firefox est désormais prêt à être utilisé ! La page d’accueil du navigateur vient de s’ouvrir et vous pouvez dès à présent utiliser votre nouveau jouet !
Cependant, nous vous proposons d’aller un peu plus loin dans votre émancipation en modifiant quelques paramètres :
Configurer Firefox
- Cliquez sur le menu « Hamburger » (c’est le nom des menus ayant trois traits horizontaux. 🤷) pour faire apparaître différentes options. Ensuite, cliquez sur « Paramètres ».
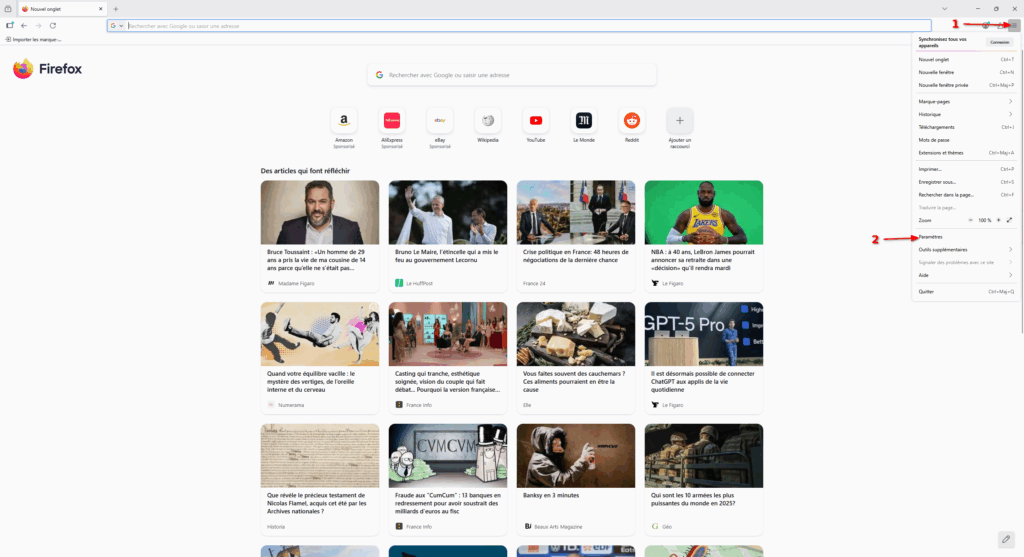
- Une page s’ouvre alors, c’est l’endroit où la majorité des paramètres de Firefox sont. Vous pouvez prendre le temps d’explorer ces paramètres mais ce qui nous intéresse tout de suite, c’est l’onglet « Recherche ».
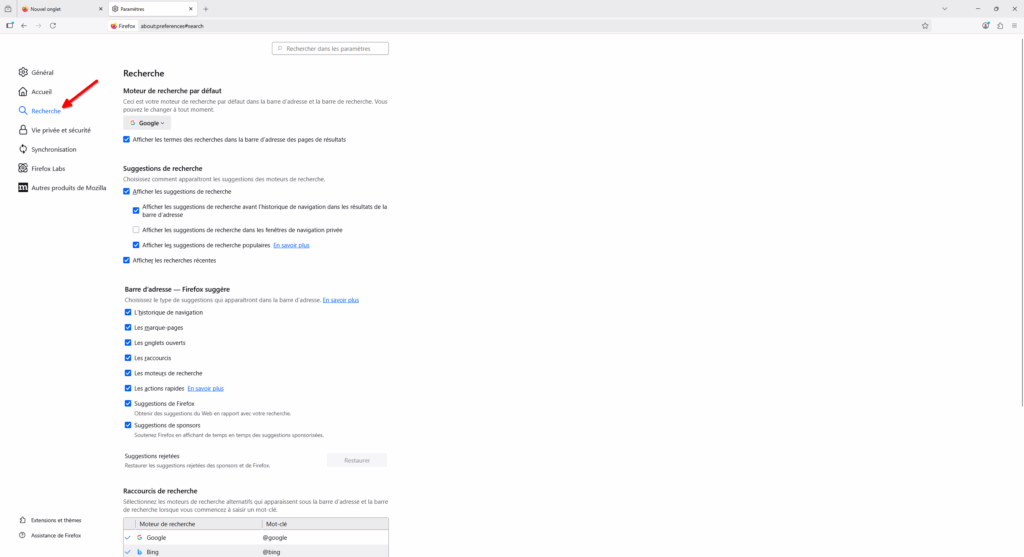
- Cet onglet permet de modifier les paramètres liés à la recherche, dans Firefox. Notamment, c’est ici que vous pouvez définir quel est votre moteur de recherche par défaut. Actuellement, celui-ci devrait être « Google » mais si vous souhaitez essayer un autre moteur de recherche, je vous recommande de cliquer sur la liste et de choisir « DuckDuckGo ». DuckDuckGo est un moteur de recherche respectant l’intimité numérique de ses utilisateurs et utilisatrices, contrairement à Google qui exploite toute donnée comportementale afin de prédire et d’orienter nos comportements.
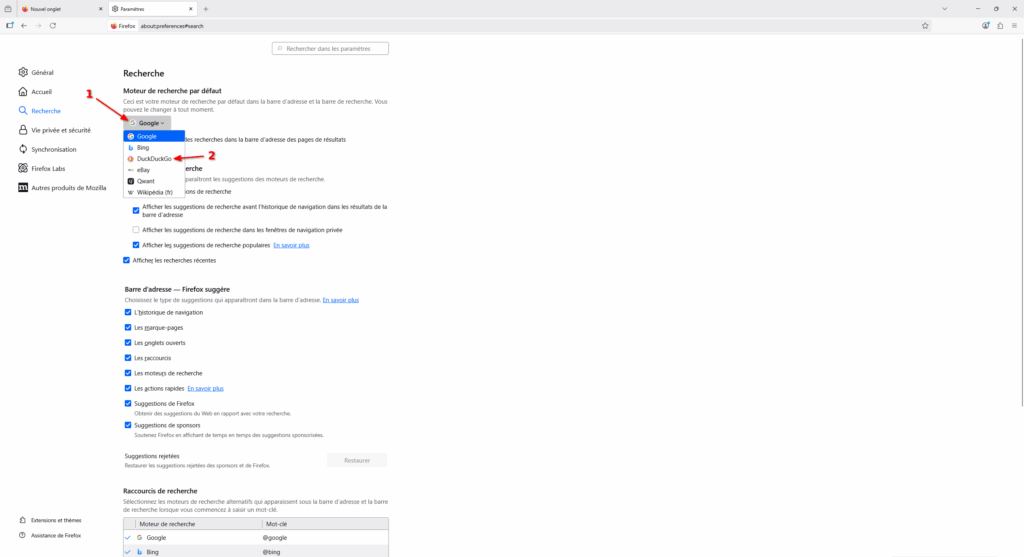
- Ensuite, nous pouvons fermer l’onglet actuel pour retrouver notre page d’accueil. Si, comme nous, vous n’avez pas spécialement envie de voir s’afficher des actualités à chaque fois que vous ouvrez Firefox, ne vous en faites pas, il est possible de désactiver celles-ci ! Cliquez sur le crayon, en bas à droite du navigateur.
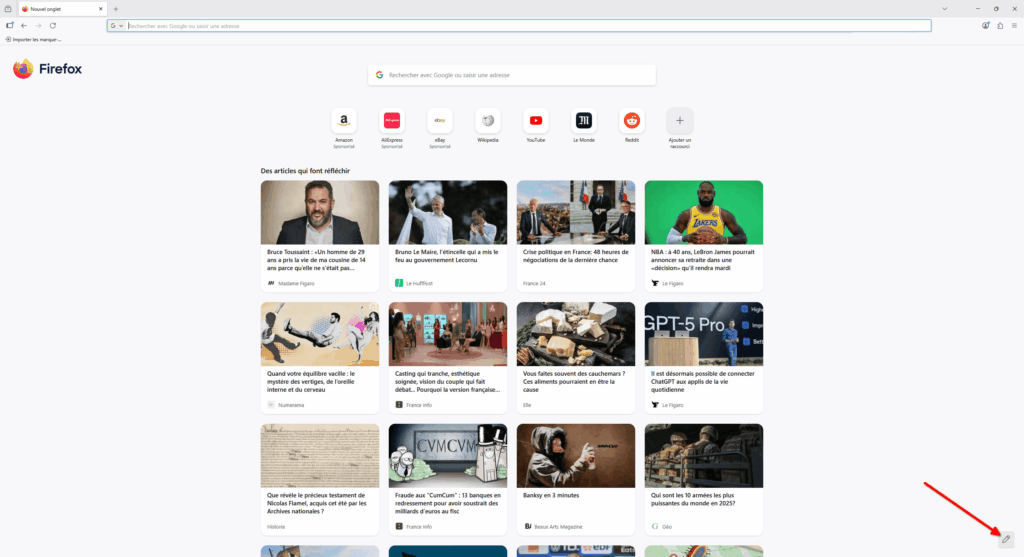
- Un menu pour personnaliser votre page d’accueil s’affiche alors. Dans ce menu, vous pouvez choisir d’afficher un nouveau fond d’écran, mais surtout… vous pouvez désactiver les « articles recommandés » ! En un clic, nous pouvons nous apaiser l’esprit ! Yeah !
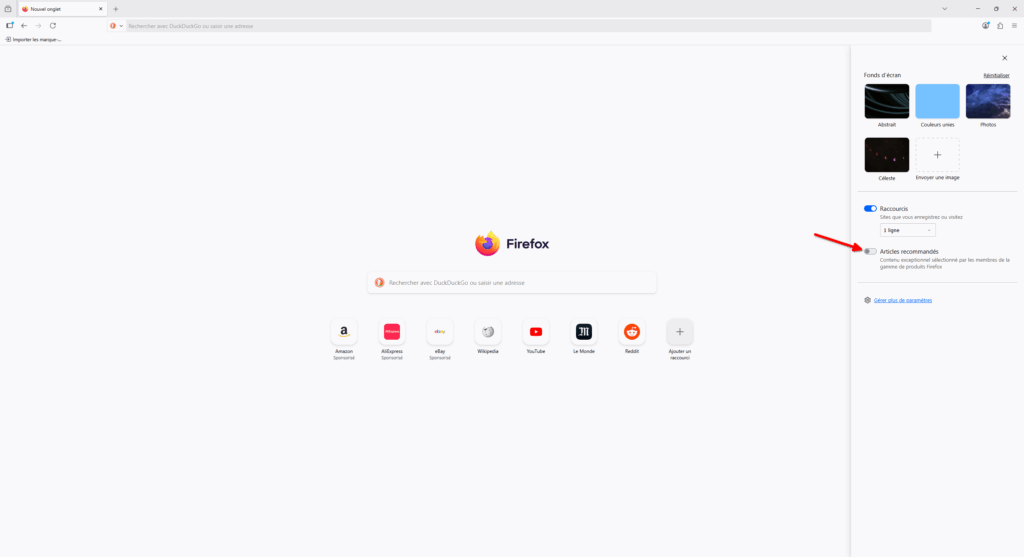
- Pour terminer avec la page d’accueil, sachez que vous pouvez retirer les raccourcis sponsorisés présents sur celle-ci. Il suffit de cliquer sur le menu d’un raccourci (les trois points horizontaux) et de cliquer sur « Retirer ».
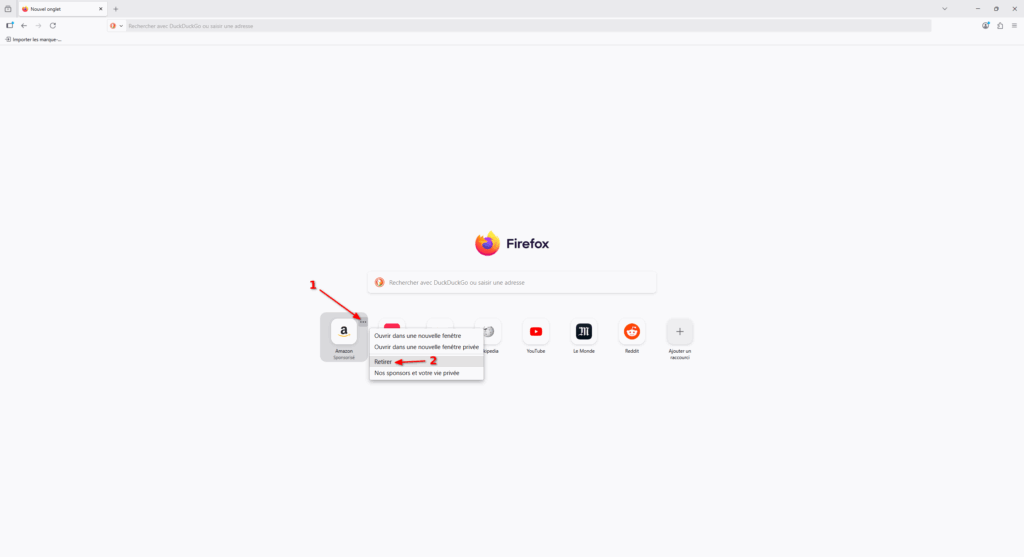
- Voilà ! Vous avez un Firefox qui vous ressemble un peu plus ! Il existe beaucoup d’options pour paramétrer au plus proche de vos besoins votre navigateur. Je vous recommande de fouiller dans les paramètres et d’essayer des trucs !
Firefox est désormais configuré avec des paramètres un peu plus chouettes ! Cependant, il manque une chose pour rendre votre navigation sur le Web réellement agréable… un bloqueur de pub !
En quelques étapes, nous vous proposons d’installer uBlock Origin, le bloqueur de pisteurs et de publicités le plus efficace. uBlock Origin existe sur tous les navigateurs majeurs donc vous l’aviez peut-être déjà installé sur Google Chrome ou Microsoft Edge mais à cause de restrictions imposées dans ces navigateurs, il est bien plus efficace sur Firefox !
Découvrons comment l’installer en une minute :
Installer uBlock Origin
- Cliquez sur l’icône de puzzle, en haut à droite du navigateur. Cela permet d’accéder au menu dédié aux extensions. Une extension de navigateur, c’est un petit bout de logiciel qui s’intègre entièrement dans votre navigateur afin d’en étendre les fonctionnalités. Il existe des milliers d’extensions différentes mais la plus populaire est vraiment uBlock Origin (avec 10 millions d’utilisateurices sur Firefox) !
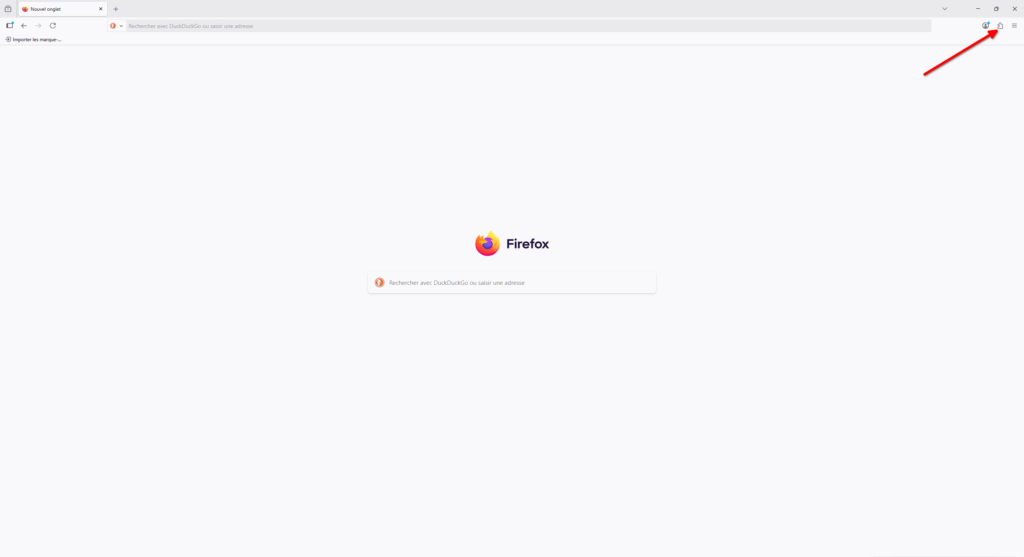
- Dans la page qui s’ouvre tapez « ublock origin » dans la barre de recherche d’extension puis cliquez sur la loupe !
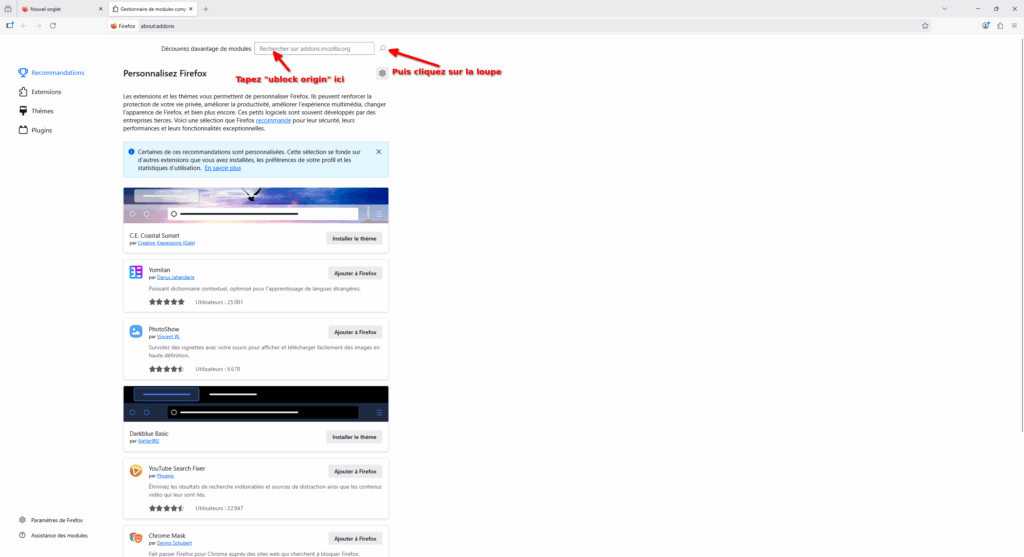
- Une nouvelle page va alors s’ouvrir avec une liste d’extensions correspondant à votre recherche. Cliquez sur « uBlock Origin ».
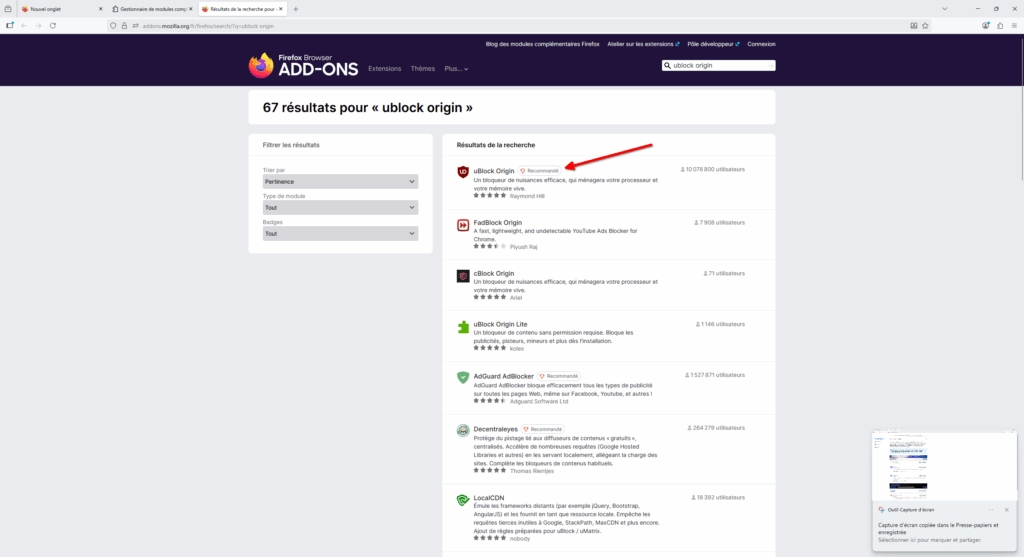
- La page de l’extension s’ouvre, avec des informations sur qui est derrière, des captures d’écran la montrant, une description expliquant ce qu’elle fait, des commentaires d’utilisateurs et utilisatrices, etc. Cliquez sur le bouton bleu « Ajouter à Firefox » pour… ajouter l’extension à Firefox. (Étonnant, c’est sûr !)
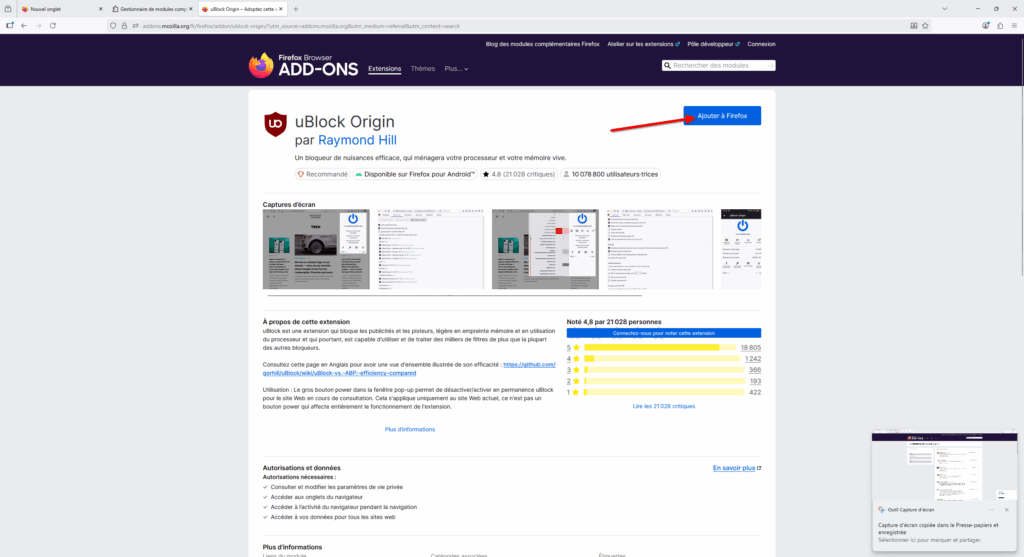
- Une mini fenêtre va s’ouvrir, vous montrant ce à quoi l’extension aura accès et si vous souhaitez utiliser l’extension lors de la navigation privée. Nous vous recommandons de cocher cette case puis de cliquer sur « Ajouter ».
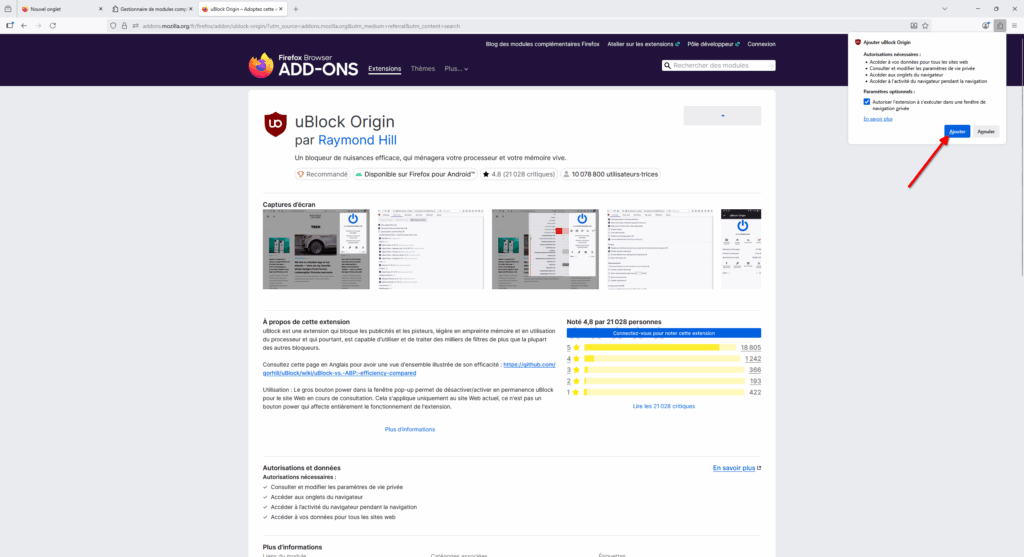
- Enfin, l’extension va s’installer de manière transparente et un dernier choix vous est proposé : Épingler l’extension à la barre d’outils. Je vous recommande de le faire pour vous souvenir que vous avez installé uBlock Origin et avoir un raccourci pour accéder rapidement à l’extension, dans les cas où vous voudriez la désactiver temporairement pour un site spécifique, par exemple.
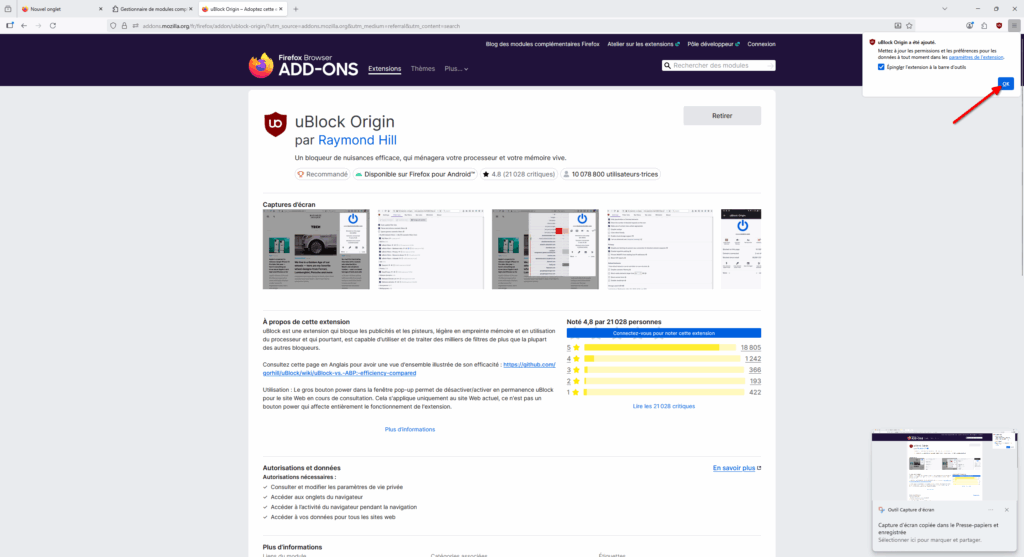
Vous avez plus d’informations sur comment configurer uBlock Origin et pourquoi bloquer la publicité sur internet sur le site https://bloquelapub.net/
Maintenant que Firefox et uBlock Origin sont installés et configurés, découvrons d’autres applications libres pour remplacer les outils des géants du numérique !
Accédez à vos mails localement avec Thunderbird !
Mozilla, la fondation derrière Firefox, ne s’est pas contentée de construire un navigateur web. En 2003, Mozilla publie Thunderbird, un logiciel permettant d’accéder à ses mails basé sur la technologie de Firefox.
Attention à la confusion : Thunderbird ne sera pas l’entité qui hébergera vos mails ! Ce ne sera qu’un logiciel intermédiaire vous permettant d’y accéder plus facilement. Si vos mails sont chez Gmail, ils resteront hébergés et accessibles par Google même si vous utilisez Thunderbird !
Il y a pas mal d’avantages à utiliser Thunderbird plutôt que d’accéder à ses mails via le Web (c’est-à-dire aller directement sur le site de Gmail ou Outlook, par exemple).
Un des plus gros avantages est de pouvoir consulter toutes ses boites mail au même endroit, même si elles sont hébergées par différentes entités. Ainsi, je peux consulter avec la même interface mes mails de Framasoft, mes mails perso’ hébergés par une petite association, mes mails liés à mes autres activités associatives, etc.
Un autre avantage est la possibilité de personnaliser notre expérience en ajoutant des extensions à Thunderbird, de la même manière qu’on a pu ajouter uBlock Origin à Firefox pour se protéger des publicités.
Il existe des extensions pour plein de situations différentes : on peut ajouter des couleurs aux différentes boites mails pour mieux les différencier, ajouter un correcteur grammatical, faire en sorte d’héberger ses pièces jointes automatiquement sur des hébergeurs type WeTransfer ou Send, etc.
Le développement de Thunderbird n’a pas toujours été sans remous, mais depuis quelques années, le logiciel évolue vraiment bien pour se moderniser. Il ne cesse de s’améliorer de mise à jour en mise à jour et beaucoup de belles choses sont à venir !
Découvrons ensemble comment installer et configurer Thunderbird.
Installer Thunderbird
- Allez sur le site officiel de Thunderbird et cliquez sur « Télécharger ».
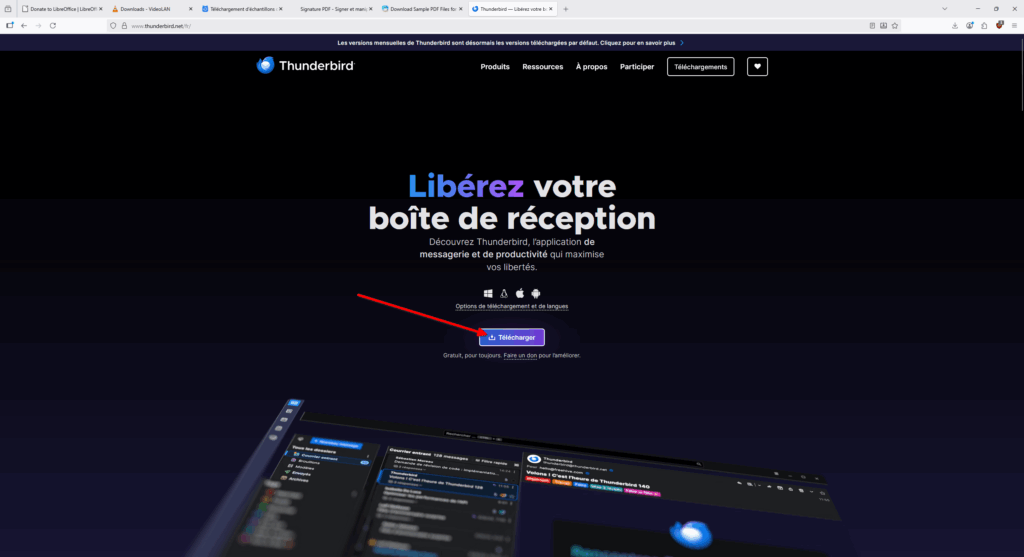
- Le logiciel va se télécharger et vous serez redirigé vers une page vous proposant de faire un don. Comme la plupart des logiciels libres, ce sont les dons qui permettent de garantir la pérennité du développement de Thunderbird. Donc si le logiciel vous plaît et que vous le pouvez, n’hésitez pas à les soutenir !
- Exécutez le fichier téléchargé.
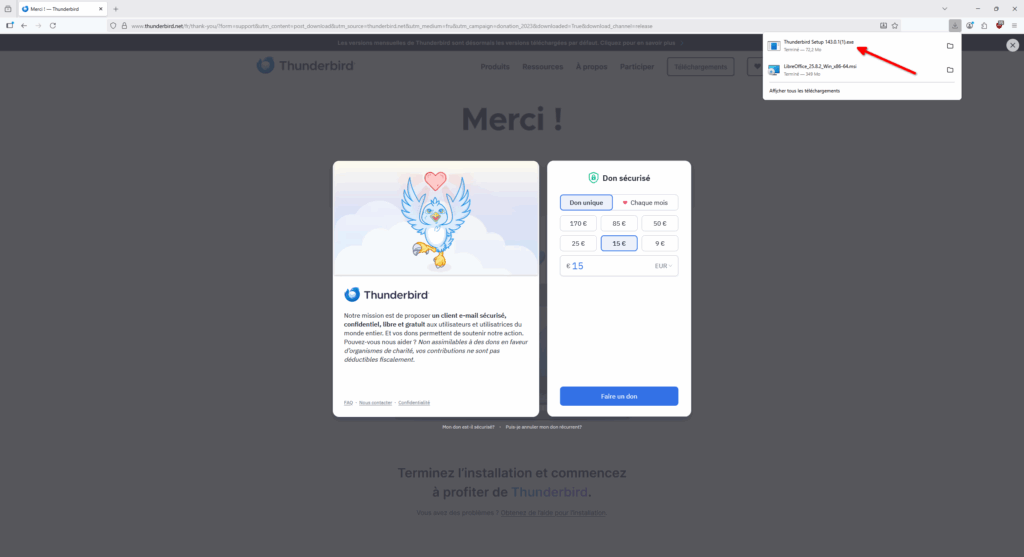
- Comme pour Firefox, Windows va vous ouvrir un avertissement de sécurité vous demandant si vous souhaitez réellement exécuter le logiciel : cliquez sur « Exécuter ».
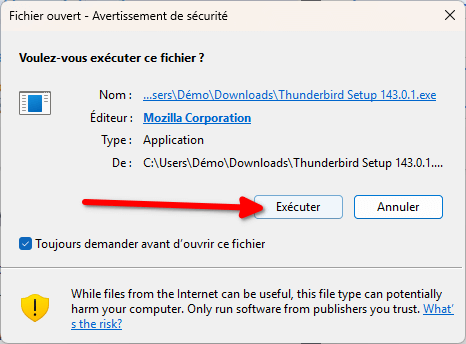
- L’utilitaire d’installation s’ouvre : cliquez sur « Suivant ».
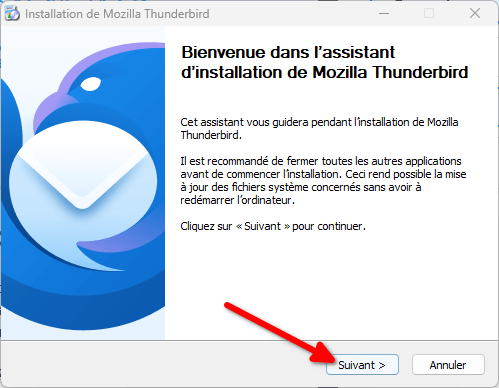
- Vous avez alors le choix d’installer Thunderbird de manière standard ou avec des options personnalisées. Dans le cadre de cette installation, vous pouvez rester sur « Standard ». Par contre, en général, je vous recommande de TOUJOURS cliquer sur « Personnalisé » lorsqu’on vous propose de choisir, cela permet de vérifier que l’utilitaire n’installe vraiment que les options que vous souhaitez et pas d’autres trucs. Il est fréquent pour les logiciels propriétaires de se faire de l’argent en installant par défaut d’autres logiciels, encombrant de fait l’ordinateur des utilisateurices.
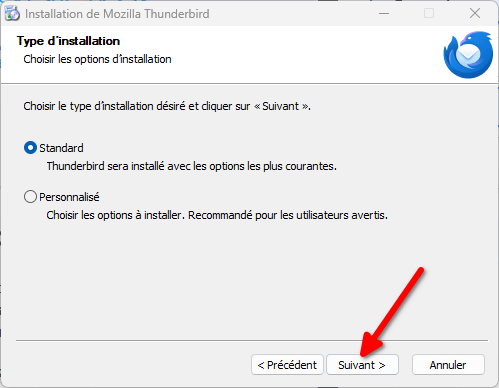
- Enfin, cliquez sur « Installer » pour lancer l’installation !
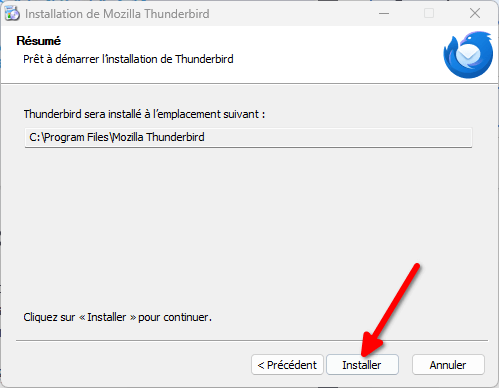
- Une fois celle-ci terminée, vous pouvez cliquer sur « Terminer ». Si vous n’avez pas décoché la case « Lancer Mozilla Thunderbird », Thunderbird se lancera automatiquement !
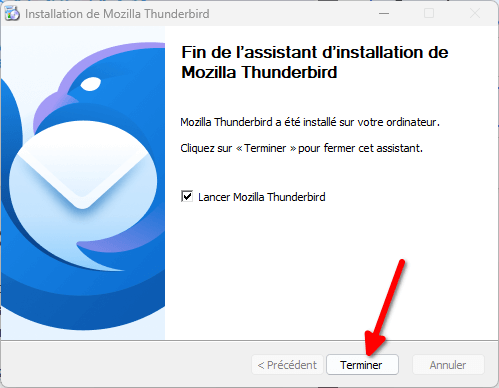
L’installation est complète mais lions maintenant notre premier compte mail au logiciel !
Ajouter un compte mail à Thunderbird
- Lors du premier lancement de Thunderbird, celui-ci s’ouvre sur une page vous permettant de configurer un nouveau compte. Remplissez le formulaire pour le compte mail de votre choix.
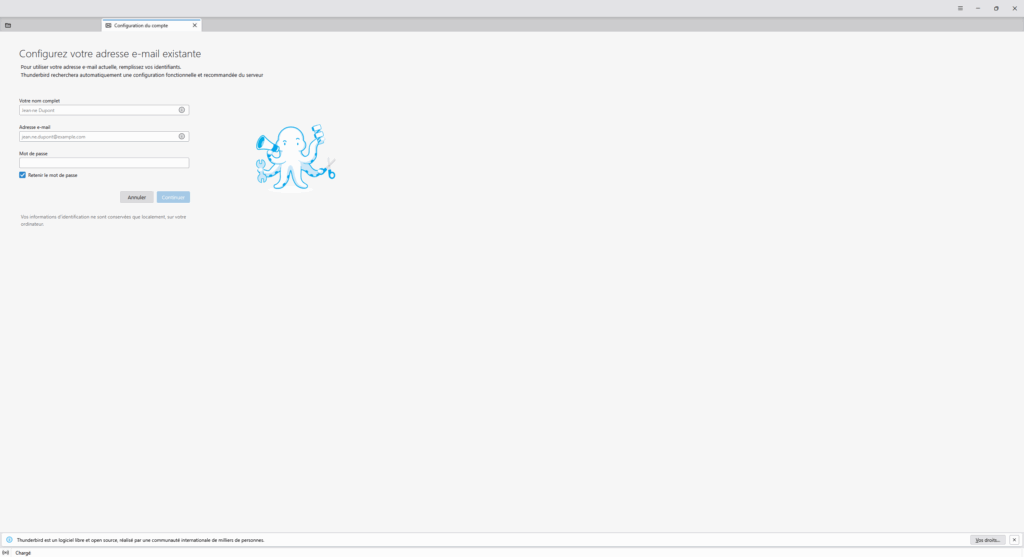
- Le nom complet sera le nom affiché avec votre adresse mail. Vous pouvez choisir ce que vous souhaitez. Une fois les informations entrées, cliquez sur « Continuer ».
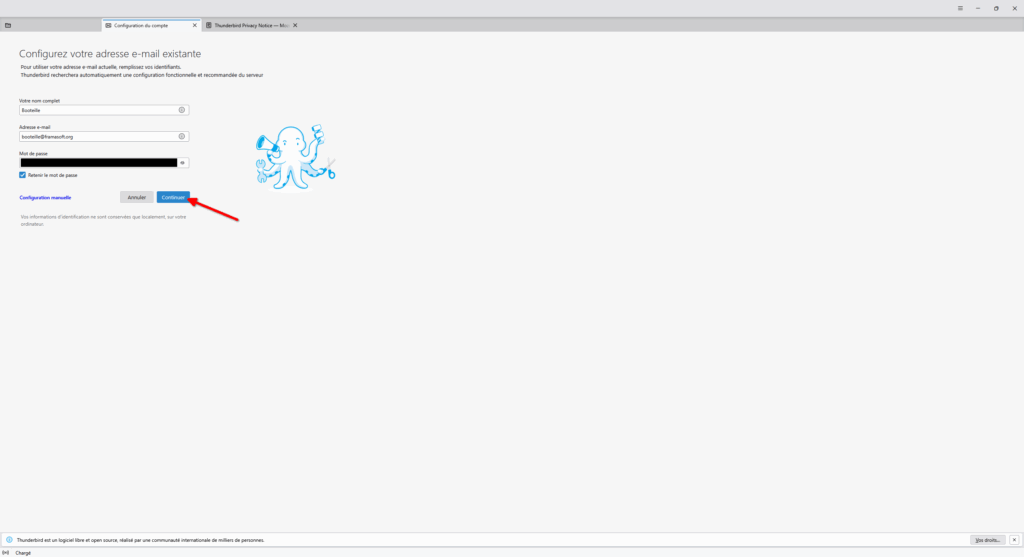
- La majorité des boites mails proposent une configuration automatique après avoir rempli ce formulaire. Cependant, si la configuration automatique n’a pas fonctionné et que vous êtes certain·e des informations renseignées, référez-vous à la documentation de votre hébergeur et utilisez la configuration manuelle.
- Thunderbird nous affiche ensuite une page nous demandant de choisir entre plusieurs configurations. Restez sur IMAP (celle choisie par défaut) et cliquez sur Terminée !
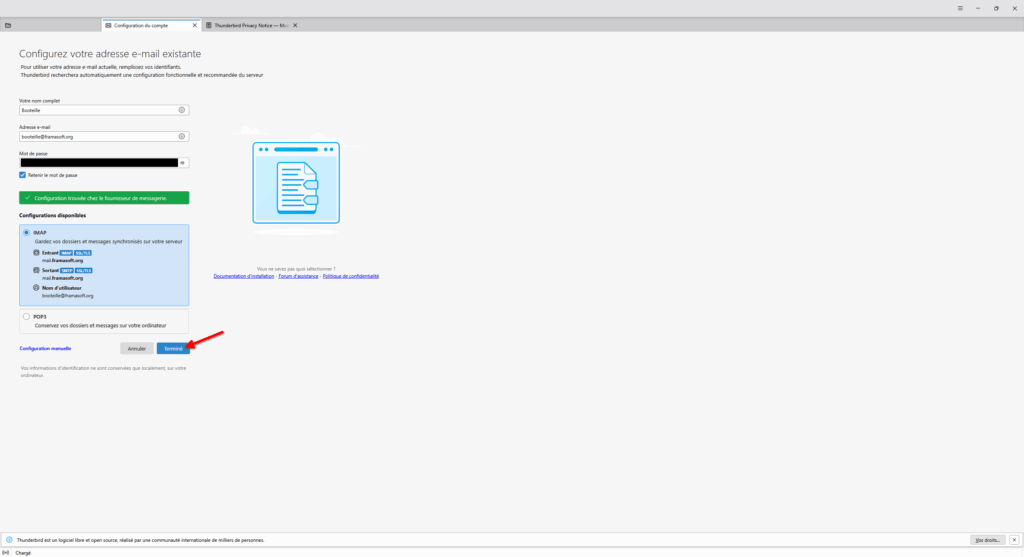
- Le compte sera alors lié à votre Thunderbird. Selon votre hébergeur, vous aurez peut-être la possibilité de synchroniser vos contacts et agendas dans Thunderbird. Je vous laisse le soin de choisir si vous souhaitez le faire ou non. Thunderbird est en effet bien puissant et peut servir de gestionnaire de contacts et gérer vos agendas !
- Lorsque vous en aurez fini avec cette page de configuration de compte, vous pouvez cliquer sur « Terminer ».
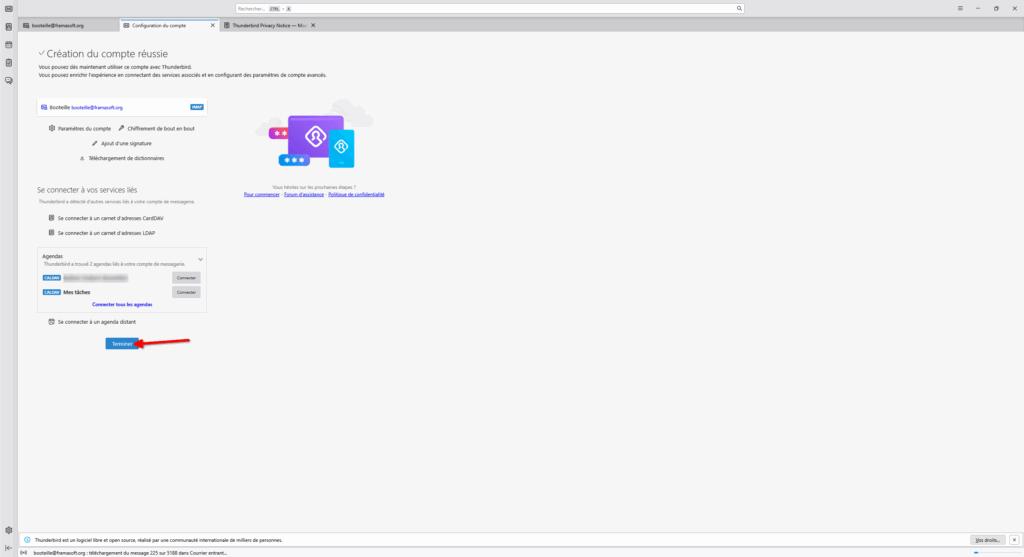
- Enfin, Thunderbird va vous proposer d’être intégré à votre système Windows. Dans la petite fenêtre qui s’est ouverte, vous pouvez choisir de faire en sorte que Thunderbird s’ouvre automatiquement dès que vous cliquez sur un bouton vous proposant d’écrire un mail, mais aussi lorsque vous avez besoin d’ajouter des informations à votre agenda, etc. Choisissez les options comme vous le souhaitez, je vous recommande d’utiliser au moins l’option pour utiliser Thunderbird par défaut pour ouvrir des mails. Lorsque votre sélection est faite, vous pouvez cliquer sur « Définir par défaut ».
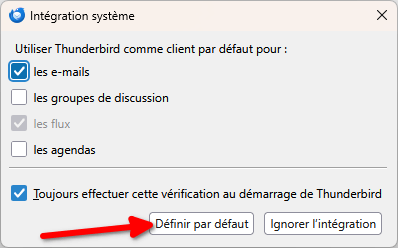
Et voilà ! Votre première boite mail est configurée !
Découvrons maintenant quelques éléments de l’interface pour mieux nous y repérer !
Présentation de l’interface de Thunderbird
- Tout à gauche, encadré en bleu, vous pouvez accéder aux différents outils de Thunderbird. Mail, agenda, calendrier, tâches et discussions instantanées.
- À côté, encadré de rouge, vous avez vos différentes boites mails et leurs dossiers. Une seule s’affiche pour le moment mais si vous en configurez plusieurs, vous pourrez accéder à toutes via ce panneau.
- Au centre, entouré fuchsia, c’est la liste des mails.
- À droite, dans le cadre orange, vous retrouverez par défaut le contenu des mails.
- Enfin, en haut, vous trouverez une barre de recherche vous permettant de fouiller dans l’intégralité de vos boites mails.
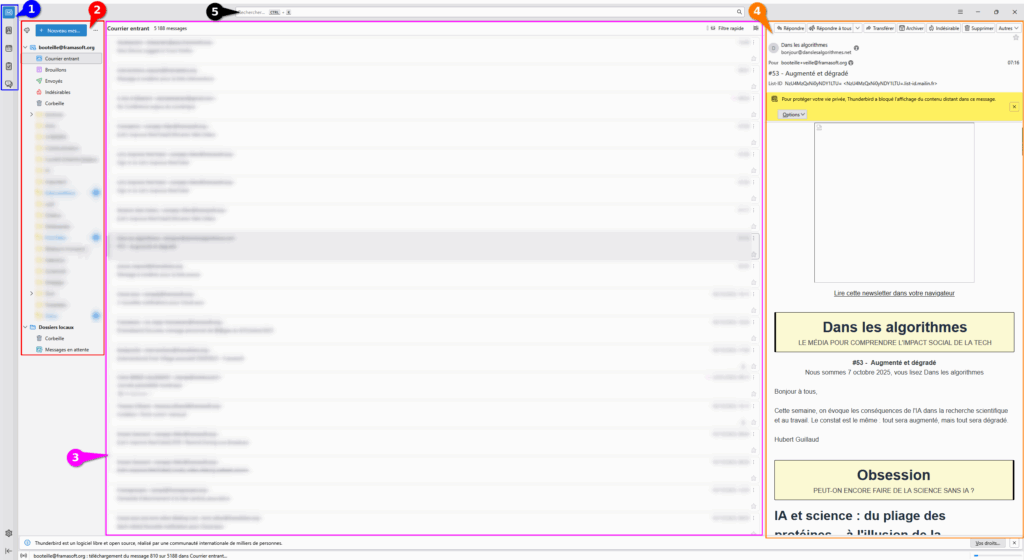
Vous pouvez aussi afficher des boutons de filtre rapide, très rapide, en cliquant sur le bouton « Filtre rapide » en haut de la liste des mails.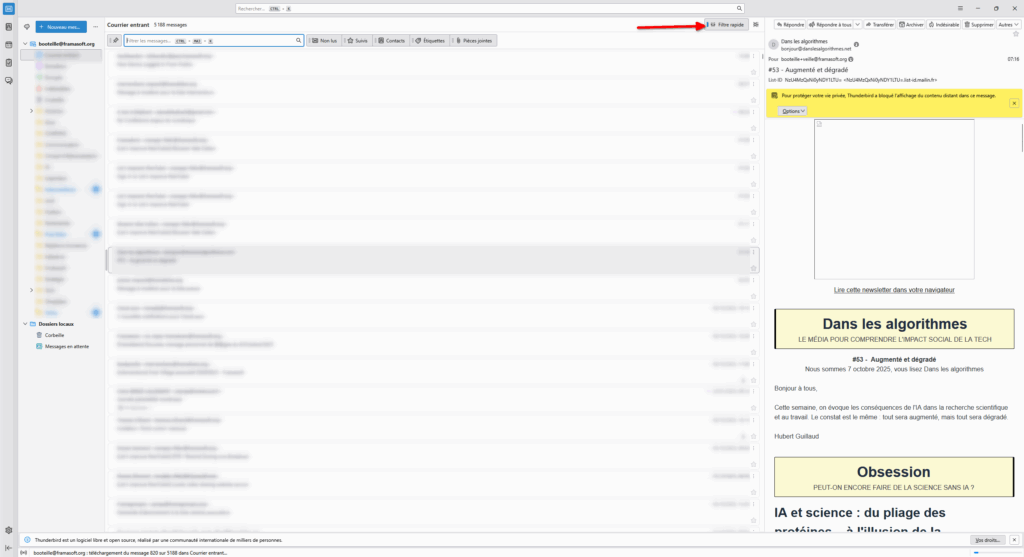
Sur le bouton d’à côté, vous pouvez choisir des options d’affichage pour la liste de vos mails. Par exemple, trier vos mails par ordre décroissant plutôt que croissant, ou grouper les discussions.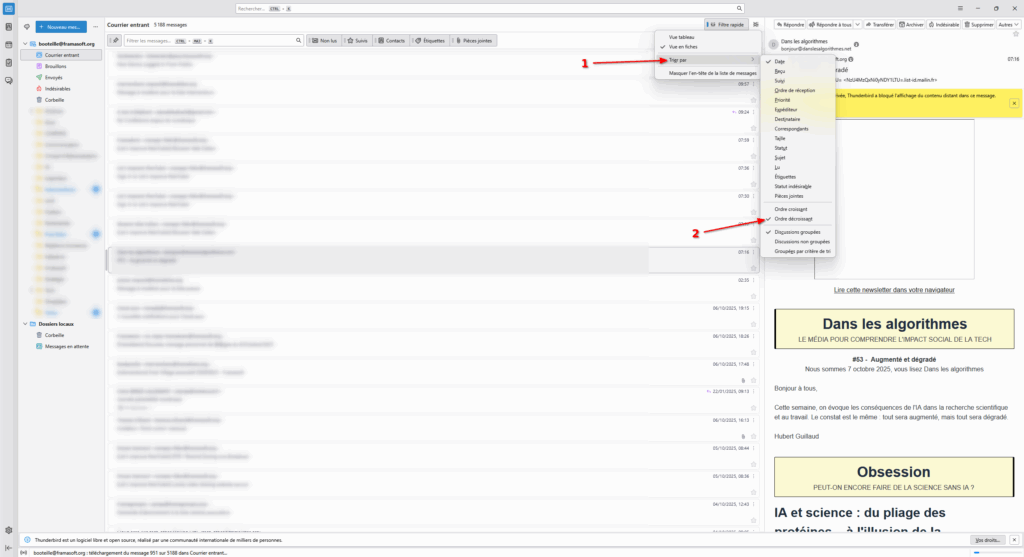
Si l’affichage vertical du contenu des mails ne vous plaît pas, vous pouvez revenir à un affichage plus classique en allant dans les options d’affichage.
Et voilà ! Vous avez désormais le contenu qui s’affiche sous la liste de mails !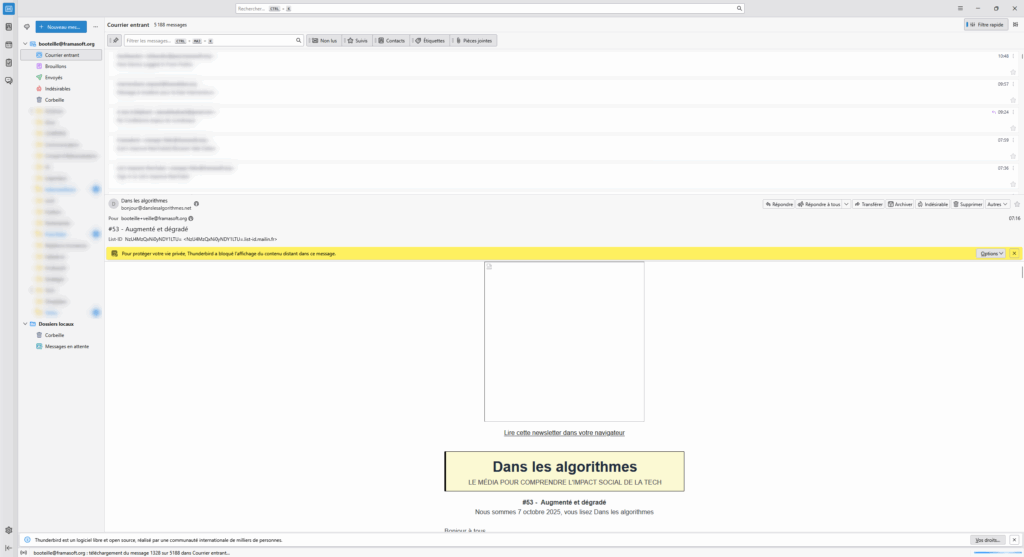
Vous pouvez désormais prendre le temps de fouiller dans les options de Thunderbird pour le configurer à votre goût ! N’oubliez pas que vous pouvez aussi ajouter des extensions de manière très similaire à Firefox ! Il vous suffit de cliquer sur le menu Hamburger puis cliquer sur « Modules complémentaires et thèmes ».
Vous pouvez consulter la liste des extensions existantes sur le site dédié.
Et si vous trouvez cela un peu trop compliqué, n’oubliez pas qu’il existe des groupes d’utilisateurices Linux un peu partout et que la plupart, en plus d’aider à installer une distribution sous Linux seront pour la plupart ravi·es de vous aider à configurer vos adresses mails sous Thunderbird !
LibreOffice, la suite bureautique qui respecte les standards !
Vous utilisez très certainement la suite Microsoft 365 (autrefois connue sous le nom de Microsoft Office, ou Office 365) pour l’édition de documents. Dans nos vies numériques, ce type de suite est devenu presque obligatoire.
La suite, désormais entièrement intégrée au Cloud de Microsoft et bourrée de fonctionnalités alimentées par IA, est accessible gratuitement via le Web mais beaucoup de personnes, l’utilisant au quotidien pour leur travail, souscrivent à l’offre payante, offrant plus d’options.
Microsoft 365 est utilisé par la grande majorité des gens et offre à Microsoft la possibilité d’imposer ses choix à tout le secteur. Par exemple, Microsoft est connu pour ne pas respecter les standards dans son logiciel. Ces standards, ce sont les règles communément décidées pour faire en sorte qu’un document Office puisse être lu par plusieurs logiciels et pas uniquement ceux de Microsoft.
Ainsi, grâce à cette domination, Microsoft peut se permettre de continuer son emmerdification, au détriment des utilisateurs et utilisatrices.
LibreOffice existe pour faire face à cette problématique. LibreOffice est basé sur le presque mort OpenOffice (si vous utilisez OpenOffice il est urgent de migrer vers LibreOffice) et proposé par la Document Foundation, une fondation à but non lucratif.
LibreOffice est une suite complète, à la manière de Microsoft 365, mais pensé pour les humains et les humaines et pas le portefeuille de quelques actionnaires. Le logiciel est en constante évolution et ne cesse de combler l’écart avec Microsoft 365, notamment en faisant en sorte de rattraper les « erreurs » de Microsoft concernant le respect des standards, permettant d’ouvrir les documents de Microsoft 365 dans LibreOffice sans problème la plupart du temps (et quand il y a des problèmes, LibreOffice finit généralement par proposer une mise à jour qui les résout au bout d’un moment).
Bien sûr, LibreOffice n’est pas parfait. S’il couvre 99 % des besoins de la plupart des gens, il y aura peut-être des éléments que vous avez sur la suite Microsoft qui n’existent pas encore sur LibreOffice. Cependant, vraiment, une fois les habitudes changées, vous devriez pouvoir faire les mêmes choses (à peu de choses près, encore une fois) dans LibreOffice !
Si vous êtes en difficulté, il existe une documentation française de LibreOffice !
Installons donc LibreOffice ensemble !
Installer LibreOffice
- Allez sur le site officiel de LibreOffice
- Le site nous propose de télécharger deux versions, une version mise à jour assez régulièrement et une autre, plus stable. Téléchargeons celle se mettant à jour le plus souvent en cliquant sur le bouton jaune « Télécharger ».
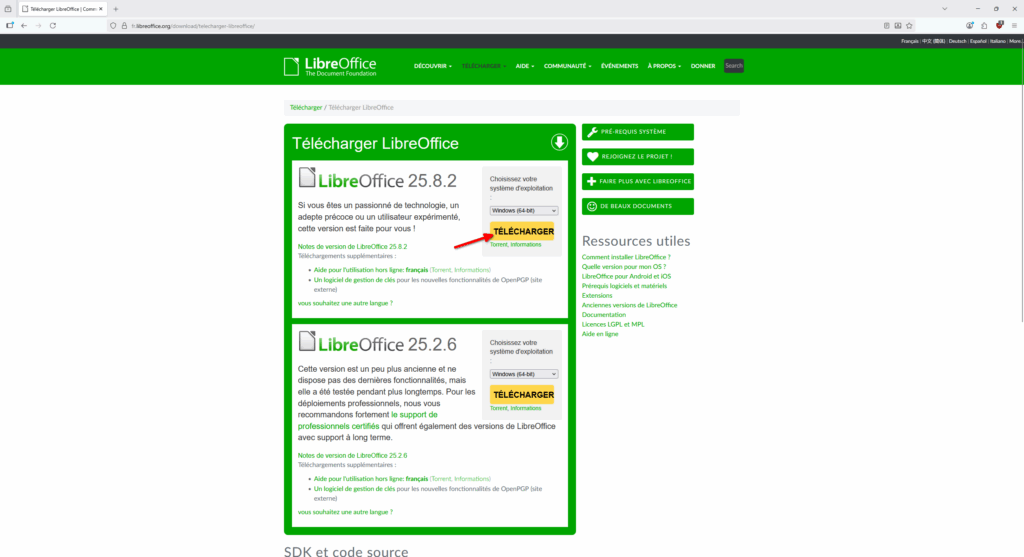
- Le site nous redirige vers une nouvelle page et le téléchargement va démarrer. Comme pour Firefox ou Thunderbird, LibreOffice vit grâce aux dons. Si vous appréciez le logiciel, n’hésitez pas à faire un don, ici aussi.
- Un avertissement de Firefox nous demande si on veut vraiment exécuter le fichier, cliquez sur « OK ».
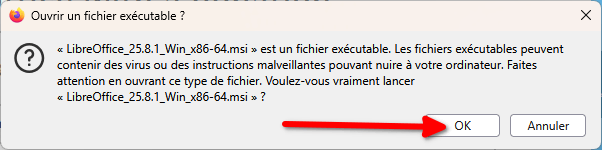
- Maintenant, c’est Windows qui nous demande si on veut bien exécuter le fichier. Cliquez sur « Exécuter ».
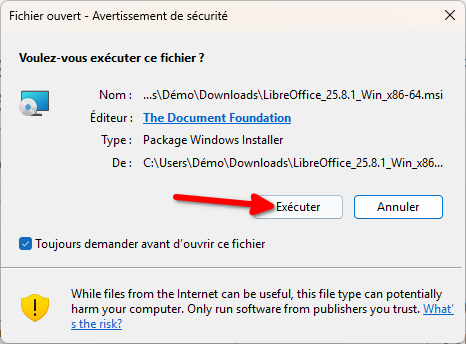
- On nous demande de choisir un type d’installation. Comme pour Thunderbird, vous pouvez garder l’installation « Normale » et cliquer sur « Suivant ».
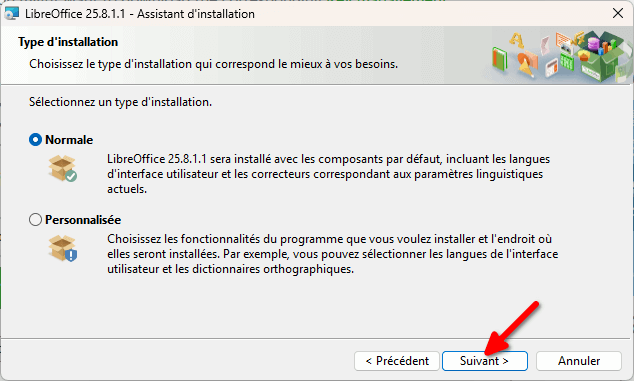
- Enfin, un écran vous propose de créer un raccourci sur votre bureau, à vous de voir ce que vous préférez. Je ne recommande pas l’option de charger LibreOffice au démarrage du système, cependant. Une fois vos choix faits, cliquez sur « Installer ».
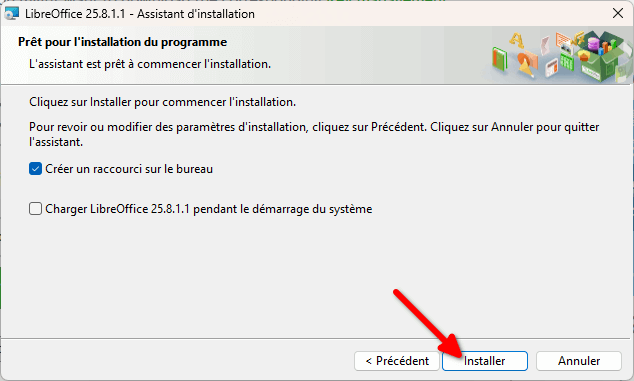
- Lancez ensuite LibreOffice pour vous assurer qu’il fonctionne convenablement.
Plusieurs logiciels se sont installés sur votre ordinateur :
- LibreOffice, le logiciel « de base » de la suite, vous permettant d’accéder à tous les autres logiciels.
- LibreOffice Writer, le logiciel qui permet d’éditer des documents textuels. C’est l’équivalent de Microsoft Word.
- LibreOffice Calc, un logiciel de tableurs. C’est l’équivalent de Microsoft Excel.
- LibreOffice Impress, un logiciel pour faire des documents de présentation. L’alternative à PowerPoint.
- LibreOffice Draw, un logiciel pour faire du dessin vectoriel. C’est une alternative à Microsoft Publisher.
- LibreOffice Math, un éditeur de formules mathématiques.
Lorsque vous ouvrez un document, le logiciel adapté pour le lire s’ouvrira, donc vous n’avez pas trop à vous prendre la tête avec les différents noms et juste ouvrir le logiciel « LibreOffice » lorsque vous souhaitez créer un nouveau document.
Lisez tout type de vidéo (et bien plus) avec VLC !
Beaucoup le connaissent, VLC est un logiciel libre qui existe depuis 1996. Il a vu le jour en France, à l’école centrale de Paris, dans le cadre d’un projet de l’école.
Depuis, il a beaucoup évolué mais c’est toujours l’association à but non lucratif VideoLAN qui le développe.
VLC a BEAUCOUP d’options, mais ce qui rend ce lecteur de médias particulièrement attractif aux yeux du public est sa capacité à lire n’importe quel fichier vidéo.
Si le logiciel a plein d’options, vous n’êtes pas obligé·es de les utiliser et il « juste marche » après installation.
Pour l’installer, suivez la procédure suivante :
Installer VLC
- Allez sur le site officiel de VLC
- Vous commencez à avoir l’habitude maintenant : vous allez être redirigé vers une page de don et l’installateur va se télécharger.
- Une fenêtre vous proposant de choisir la langue de l’installateur va s’ouvrir, choisissez la langue avec laquelle vous êtes à l’aise puis cliquez sur « OK ».
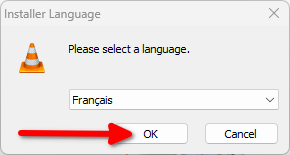
- L’installateur vous propose de choisir ce qui sera installé. Vous pouvez simplement cliquer sur « Suivant ».
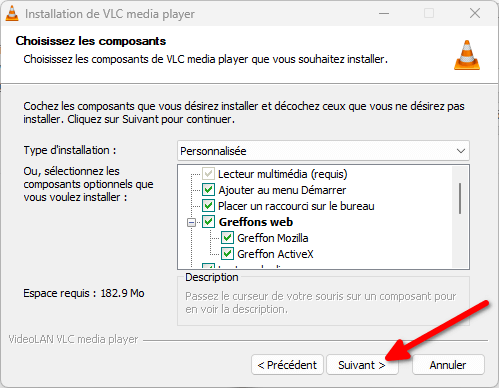
- VLC va alors s’ouvrir et une fenêtre de configuration vous propose de choisir si vous souhaitez autoriser VLC à chercher des mises à jour et accéder à un service pour récupérer les métadonnées de vos fichiers médias. Personnellement, je laisse ces options activées, mais c’est à vous de décider ici ! Cliquez sur « Continuer » une fois que c’est fait.
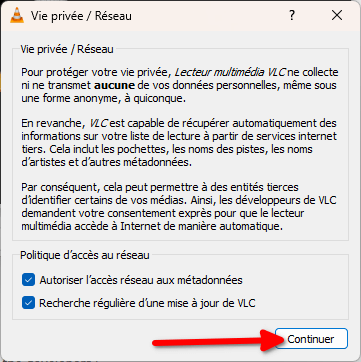
VLC est désormais installé mais sur Windows, il faut faire une étape supplémentaire pour faire en sorte que VLC soit utilisé par défaut pour ouvrir vos fichiers vidéos.
À chaque fois qu’un fichier vidéo s’ouvre avec le logiciel de Microsoft à la place de VLC, il faudra que vous suiviez les étapes suivantes :
Définir VLC comme lecteur par défaut
- Trouvez le fichier dans l’explorateur de fichiers de Windows
- Faites un clic droit sur le fichier.
- Faites « Ouvrir avec » puis sélectionnez « Choisir une autre application »
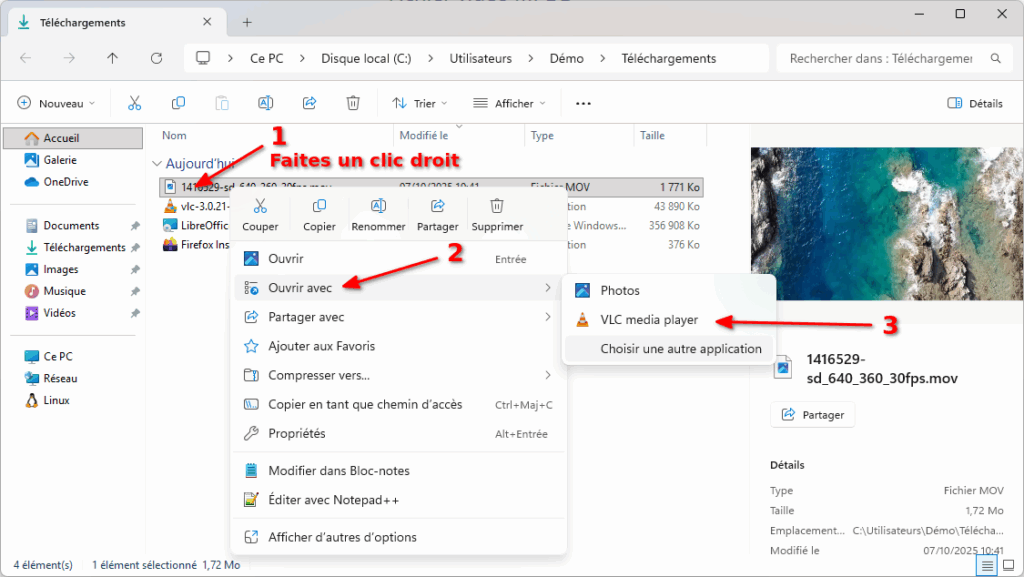
- Une fenêtre s’ouvre alors pour vous proposer de choisir le logiciel que vous souhaitez. Cliquez sur « VLC media player » puis sur « Toujours » pour faire en sorte que l’option soit mémorisée.
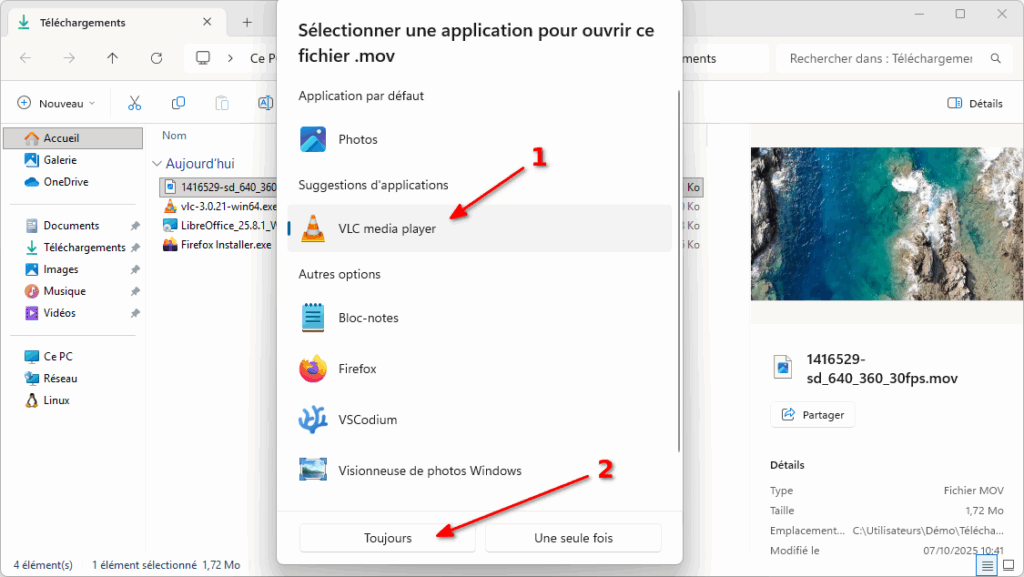
Et voilà !
C’est chiant ? Ouaip. C’est bien plus simple sur Linux mais en attendant de changer, vous savez comment faire ! Héhé !
Éditez vos PDF avec Signature PDF et Firefox
Nombre d’entre nous avons utilisé pendant de longues années « Acrobat Reader », le logiciel d’Adobe pour lire les PDF.
Aujourd’hui, avec les améliorations des différents navigateurs, il est possible de se passer entièrement d’Acrobat Reader.
Par défaut, Firefox est capable de lire et remplir un PDF. Si vous ouvrez un PDF, vous arriverez sur un utilitaire vous permettant de signer, rajouter du texte ou surligner votre PDF ! Cela couvre l’immense majorité des besoins !
Si certaines options vous manquent, comme par exemple le fait d’extraire une page spécifique de ce PDF, vous pouvez utiliser l’utilitaire Signature PDF, que nous mettons gratuitement à disposition.
Avec ces deux outils, vous ne devriez plus avoir besoin d’Acrobat Reader ! Youhou !
En conclusion
S’il est assez facile d’installer les logiciels proposés ici, changer ses habitudes demande du temps et provoque de l’inconfort… c’est normal !
Allez-y à votre rythme dans votre transition, choisissez un des logiciels, habituez-vous-y, puis, une fois que vous êtes prêt·e, passez au logiciel suivant !
De cette manière, vous changerez progressivement vos repères et la transition sera bien plus confortable.
Enfin, tous les logiciels proposés sont ceux utilisés la plupart du temps par défaut sur Linux. Cela signifie que lorsque vous serez habitué·es à tous ces logiciels… transitionner vers Linux sera bien moins difficile ! Vous n’aurez au final que très peu d’habitudes à changer ! De plus, vous pourrez très facilement vous faire aider par des gens vivant près de chez vous, nous en parlions dans l’article sur la fin de Windows !
L’univers du logiciel Libre est passionnant, il repose sur un formidable élan de solidarité, où des milliers de personnes à travers le monde contribuent, souvent de manière bénévole, à des outils qui appartiennent aux communs.
Mais le Libre, c’est aussi souvent une vision : celle d’un numérique pensé pour les humains et les humaines, pour que le numérique soit un outil au service de nos sociétés.
Et vraiment, une fois que nos habitudes sont changées, il est cruellement difficile de revenir sur des outils pensés pour le grand capital ! Plus de publicités, plus d’éléments de design nous incitant à avoir un comportement qui nous nuit, cette sensation d’être en maîtrise de sa machine…
… Et savoir que derrière chaque logiciel, il y a une poignée d’humain·es, souvent accessibles et à l’écoute de nos retours, pour faire en sorte que leurs logiciels servent toujours plus l’intérêt commun.
Certes, la route est longue… mais la voie est Libre !
Illustration de l’article sous licence CC-BY 4.0 – https://endof10.org
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview