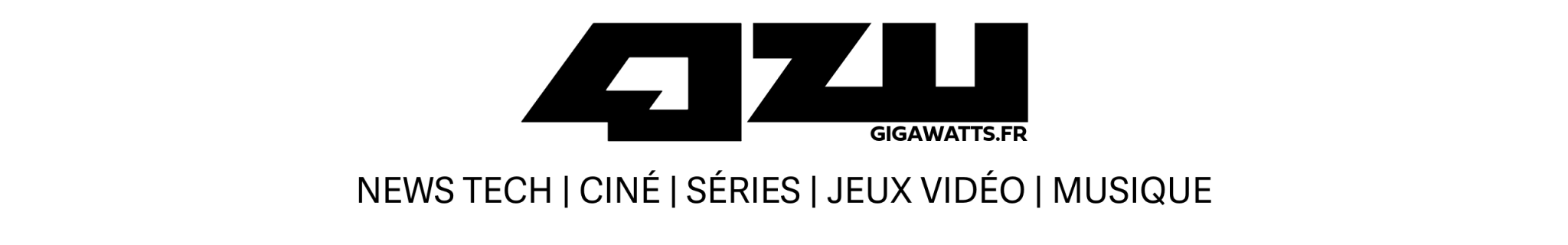ACCÈS LIBRE Actualité IA
29.10.2025 à 15:50
NEO – Le robot domestique révolutionnaire
Romain Leclaire
Texte intégral (1949 mots)

L’arrivée des robots humanoïdes dans nos foyers est imminente et NEO de 1X se positionne comme un pionnier prêt à transformer la vie quotidienne. Présenté comme un assistant capable de prendre en charge les tâches ennuyeuses et mondaines, il promet de récupérer du temps pour ses propriétaires en automatisant les corvées ménagères. Mais derrière la promesse d’une maison plus propre et d’une intelligence utile se cachent des défis techniques et logistiques qui méritent une analyse critique.
NEO est conçu pour l’autonomie et l’utilité pratique. Le robot utilise Redwood AI, le modèle d’IA généraliste de 1X, pour l’apprentissage et la répétition des tâches. Vous pouvez lui fournir une liste de corvées et planifier l’heure de leur exécution, revenant ainsi à une maison plus propre chaque jour. Le robot est entièrement mobile et utilise l’IA pour naviguer jusqu’à l’endroit où il est nécessaire.
En tant que compagnon, NEO est doté d’une intelligence utile. Son interaction est gérée par un LLM intégré, capable de comprendre, de raisonner et de converser. Il peut répondre à toutes sortes de questions (histoire, recettes ou conseils) en temps réel. Son intelligence est personnalisée grâce à l’utilisation de la mémoire pour retenir des informations et à la prise en compte du contexte visuel et spatial. Il peut même rendre les conversations plus légères en partageant des blagues, des histoires et des jeux. Concernant les spécifications, NEO, d’une hauteur d’1 mètre 67, peut soulever jusqu’à 70 kg et en transporter 25. Pour l’interaction, il est équipé d’une interface vocale, d’une application mobile permettant de gérer les horaires et de surveiller à distance, et même d’une fonction de haut-parleur Bluetooth mobile (Boom Box).
Sécurité, conception et dépendance à l’expertise humaine
L’un des arguments de vente de NEO est sa conception axée sur la sécurité et la douceur. Le robot est léger, incroyablement silencieux (seulement 22 dB, soit moins qu’un réfrigérateur moderne). Tout le matériel est enveloppé d’un polymère à réseau 3D personnalisé (Soft Body) qui fournit un amorti et une sécurité accrues. Les mouvements sont générés par des actionneurs à entraînement par tendon garantissant des mouvements doux, sûrs et de faible énergie. De plus, les articulations sont entièrement couvertes, rendant la surface anti-pincement.

Sa pleine autonomie n’est cependant pas immédiate. Bien qu’il soit conçu pour l’autonomie totale, les premiers acquéreurs bénéficient d’une autonomie fondamentale et NEO « grandit » en capacités avec une utilisation continue. C’est ici qu’intervient le Mode Expert. Lorsqu’il rencontre une tâche complexe qu’il ne connaît pas, vous pouvez planifier la supervision à distance de ses actions par un expert de 1X. Ce processus permet à NEO d’apprendre de nouvelles capacités tout en s’assurant que la tâche est accomplie.
Interrogations critiques – Les zones d’ombre de l’autonomie domestique
Malgré les avancées impressionnantes, plusieurs questions importantes se posent concernant sa viabilité et son adoption à long terme, basées sur les informations fournies:
1. La dépendance au « Mode Expert » – Quel coût et quelle fiabilité ?
NEO est commercialisé comme un robot autonome, mais pour les tâches complexes, il nécessite la supervision à distance par un expert de 1X.
- Cette supervision humaine est-elle facturée ? Le besoin constant d’un Expert pour guider le robot dans son apprentissage de départ ou pour les tâches complexes soulève la question du coût d’exploitation réel au-delà du dépôt de 200 $ requis pour la commande.
- Quelles sont les implications pour la vie privée ? Le fait qu’un expert puisse surveiller à distance et guider les actions de NEO à des heures planifiées soulève des interrogations sur la confidentialité des données et de l’environnement domestique de l’utilisateur.
2. Autonomie de la batterie et temps de service – 4 heures suffisent-elles ?
L’autonomie de la batterie est de 4 heures. Bien que NEO gère sa propre batterie et se recharge tout seul, une période d’activité aussi courte pourrait nécessiter de multiples cycles de recharge pour couvrir une journée complète de corvées complexes. Si le robot doit constamment retourner à sa base pour une recharge rapide de 6 minutes par heure d’autonomie, cela pourrait impacter l’efficacité et la continuité du service.
3. Durabilité et maintenance des composants de haute technologie
Les actionneurs à entraînement par tendon assurent des mouvements doux et précis. L’entreprise indique que ces mécanismes ont un cycle de charge nominal de 2 000 000 cycles, suivi d’un remplacement de service d’un jour. Quelle est donc sa fréquence en usage normal ? Un utilisateur domestique moyen pourrait-il s’attendre à des remplacements de composants clés et quel sera le coût et l’interruption de service associés à cette maintenance régulière ?
4. Les limites de l’apprentissage initial
NEO est livré avec une autonomie fondamentale pour les premiers propriétaires et grandit en capacité avec le temps. Quelles tâches le robot est-il capable d’effectuer dès le premier jour, avant le processus d’apprentissage par IA ou par Expert ? Si l’autonomie de départ est trop limitée, le processus d’intégration du robot pourrait être frustrant et chronophage pour l’utilisateur, contredisant la promesse de « récupérer du temps ».
NEO représente une avancée spectaculaire dans la robotique humanoïde domestique, combinant une puissance de calcul impressionnante (jusqu’à 2070 FP4 TFLOPS via la puce 1X NEO Cortex) avec un design axé sur la sécurité. Toutefois, l’étape de l’autonomie totale semble passer par une période de dépendance à l’expertise humaine à distance et par des contraintes énergétiques claires.

Le processus d’acquisition du robot est actuellement structuré autour d’une précommande nécessitant un acompte. Pour passer commande, un dépôt de 200 $ est exigé. Il est important de noter que ce montant est spécifiquement présenté comme étant entièrement remboursable. Selon les informations disponibles, les livraisons aux États-Unis sont prévues pour commencer en 2026.
29.10.2025 à 13:30
Comment le plus petit pixel jamais créé va changer nos écrans
Romain Leclaire
Texte intégral (1892 mots)

Nous vivons, sans l’ombre d’un doute, à l’ère de la miniaturisation. C’est une obsession collective, une course technologique effrénée pour rendre chaque composant plus petit, plus fin, plus léger. Regardez autour de vous, nos montres sont devenues des ordinateurs de poignet, nos téléphones sont des supercalculateurs plats et les lunettes de réalité augmentée promettent de superposer le numérique au réel sans nous alourdir. La tendance est évidente, la technologie la plus puissante est celle qui sait se faire oublier.
Mais pour que cette fusion devienne transparente, pour que nos gadgets s’intègrent à nous au lieu de nous encombrer, nous devons repousser les limites fondamentales de l’ingénierie. Le pixel est la brique de base de tout notre monde numérique. Aujourd’hui, une nouvelle recherche vient de pulvériser tous les records en la matière, présentant au monde le plus petit jamais conçu. Une avancée qui pourrait bien être le chaînon manquant vers la prochaine génération d’appareils portables intelligents.
La création d’un pixel fonctionnel mesurant à peine 300 par 300 nanomètres est un véritable exploit. Pour saisir l’échelle, un nanomètre est un milliardième de mètre. Ce nouveau pixel est environ 17 fois plus petit qu’un pixel OLED conventionnel, celui-là même qui illumine l’écran de votre smartphone haut de gamme. Et le plus incroyable ? Il parvient à maintenir une luminosité comparable.
L’ampleur de cette découverte devient vertigineuse quand on la traduit en résolution. Avec cette technologie, un écran d’une surface totale d’un seul millimètre carré (plus petit qu’une tête d’épingle) pourrait contenir une résolution Full HD de 1920 par 1080 pixels. Imaginez un projecteur si minuscule qu’il pourrait être intégré dans la monture d’une paire de lunettes, ou un écran si dense qu’il deviendrait indiscernable à l’œil nu. De plus, ce pixel brille de sa propre lumière, une caractéristique essentielle pour révolutionner nos appareils.
Pour comprendre pourquoi cette avancée est si capitale, il faut d’abord faire un petit détour par le fonctionnement de nos écrans actuels. La plupart des écrans de haute qualité utilisent la technologie OLED, acronyme de « Organic Light-Emitting Diode » (diode électroluminescente organique). Comme son nom l’indique, un pixel OLED est composé de plusieurs films ultra-fins de matériaux organiques, pris en sandwich entre deux électrodes. Lorsqu’un courant électrique traverse ce système, il active le matériau organique, qui libère alors de l’énergie sous forme de lumière. C’est un système élégant et efficace, qui permet d’obtenir des noirs parfaits et des couleurs éclatantes.
Le pixel, lui, est l’unité d’information la plus petite d’un affichage numérique. La logique est simple, plus on peut en mettre dans un espace donné, plus l’image est nette et détaillée. Le problème, c’est que la technologie OLED, si performante soit-elle, se heurte à un mur physique. L’article scientifique souligne que les technologies existantes font face à des défis de fabrication substantiels et à des pertes d’efficacité lorsqu’on tente de les réduire à l’échelle du micromètre ou du sous-micromètre. Ce mur devient infranchissable lorsque les chercheurs essaient de réduire la taille d’un pixel OLED en dessous des longueurs d’onde de la lumière visible, qui se situent entre 400 et 700 nanomètres. À cette échelle, les lois de la physique classique s’effacent au profit des effets quantiques. Pour le dire simplement, la géométrie même du système OLED crée des déséquilibres dans la distribution électrique au sein de la cellule.

B ) Coupe de (A) selon l’axe α-β. L’injection de trous (anode inférieure) et d’électrons (cathode supérieure), contrôlée spatialement, induit la formation d’excitons au-dessus de la nano-ouverture, dans la couche émissive. Lors de leur recombinaison, les excitons se couplent au(x) mode(s) plasmonique(s) de la nanoélectrode en or, générant une forte émission. (
C ) Dispositif sans nano-ouverture : L’injection inhomogène de porteurs de charge conduit à une faible émission et favorise la croissance du filament (voir encart à droite).
Jens Pflaum, co-auteur de l’étude et physicien à l’université de Wurtzbourg en Allemagne, utilise une analogie parlante. « Comme pour un paratonnerre« , explique-t-il, « le simple fait de réduire la taille du concept OLED établi provoquerait une concentration des courants, qui s’émettraient principalement depuis les coins de l’antenne. » Ces concentrations de courant indésirables forment ce que les scientifiques appellent des filaments. Ces derniers sont instables et agissent comme de minuscules courts-circuits qui, non seulement, gaspillent de l’énergie, mais peuvent tout simplement détruire le pixel. C’est ici que l’ingéniosité de l’équipe de Wurtzbourg entre en jeu. Ce qui est si impressionnant dans leur nouvelle publication, c’est qu’ils ont identifié un moyen de bloquer activement la formation de ces filaments destructeurs. Leur solution est à la fois élégante et radicalement nouvelle.
Au lieu de simplement miniaturiser l’ancien design, ils ont repensé l’architecture du pixel. Ils ont d’abord fabriqué une antenne optique en or. Cette antenne a un double rôle important. D’une part, elle utilise un phénomène physique pour convertir le rayonnement en minuscules bits d’énergie focalisés. D’autre part, elle aide à concentrer l’énergie électromagnétique et à amplifier la luminosité, ce qui est essentiel pour qu’un point aussi infime soit visible. Mais la véritable astuce réside dans ce qu’ils ont placé par-dessus cette dernière. Ils ont ajouté une fine couche isolante, non conductrice, percée d’une minuscule ouverture circulaire en son centre. C’est le coup de génie. Cette ouverture force le courant électrique à ne circuler qu’à travers ce point central parfaitement rond. Et qu’est-ce qu’un cercle n’a pas ? De coins. En les éliminant, ils ont supprimé l’effet paratonnerre. Le courant circule de manière uniforme, les filaments ne peuvent plus se former et le pixel fonctionne sans se détruire.
Bien sûr, il faut rester mesuré. Le système n’est encore qu’un prototype. Son efficacité actuelle n’est que d’environ 1 %. C’est très faible comparé aux écrans commerciaux. Les chercheurs notent malgré tout que le plus grand défi (celui de la stabilité et de la fabrication à l’échelle nanométrique) est désormais résolu. L’optimisation de l’efficacité est une étape ultérieure, un problème d’ingénierie qui semble maintenant beaucoup plus facile à aborder.
Les implications, elles, donnent le vertige. Avec cette technologie, les écrans et les projecteurs pourraient devenir si petits à l’avenir qu’ils pourraient être intégrés de manière presque invisible dans des appareils portés sur le corps. Oubliez les montres connectées. Pensez à des montures de lunettes qui projettent des informations directement sur votre rétine sans que personne ne voie d’écran. Pensez à des lentilles de contact intelligentes. C’est la promesse d’une réalité augmentée véritablement transparente, où le numérique ne sera plus un écran que l’on regarde, mais une couche d’information que l’on vit. Ce minuscule pixel n’est peut-être pas grand, mais il vient d’ouvrir une porte immense.
29.10.2025 à 09:33
YouTube durcit ses règles sur le gaming et la protection des mineurs
Romain Leclaire
Texte intégral (1527 mots)

YouTube a annoncé une mise à jour de sa politique qui va imposer des restrictions d’âge plus strictes sur les vidéos de jeux vidéo contenant ce qu’elle qualifie de « violence graphique ». Cette décision, qui couve depuis un certain temps, pourrait bien changer la manière dont les créateurs partagent leurs sessions de jeu et dont le public y accède.
Le jeu vidéo est devenu une forme de divertissement dominante, rivalisant avec le cinéma et la musique. La frontière entre la fiction et le réalisme n’a jamais été aussi mince. C’est précisément cette ligne floue que YouTube semble vouloir adresser. Plongeons dans les détails de cette nouvelle politique et explorons ses implications pour les créateurs, les joueurs et la plateforme elle-même.
Ce qui change concrètement le 17 novembre
Jusqu’à présent, YouTube faisait preuve d’une certaine indulgence à l’égard des jeux vidéo. Sa politique existante reconnaissait que la violence mise en scène ou fictive, comme celle que l’on trouve dans les animations ou les jeux, ne justifiait généralement pas une suppression ou une restriction, car le contexte indiquait clairement qu’il ne s’agissait pas de la réalité. C’était une exception de bon sens qui a permis à la communauté gaming de prospérer. Cette exception est maintenant sur le point de se contracter.
La nouvelle directive cible très spécifiquement des scénarios précis. Les vidéos montrant des personnages humains réalistes impliqués dans des scènes de violence de masse contre des non-combattants ou des actes de torture seront désormais soumises à une restriction d’âge. Concrètement, cela signifie que les utilisateurs de moins de 18 ans et toute personne non connectée à un compte ne pourront tout simplement pas visionner ces contenus.
La délicate question du réalisme et des zones grises
L’annonce soulève immédiatement une vague de questions. Qu’entend-on exactement par personnages humains réalistes ? Quid des jeux au style graphique prononcé mais extrêmement violents ? La plateforme précise qu’elle prendra plusieurs facteurs en compte pour évaluer une vidéo. La durée de la scène graphique, la présence d’un zoom sur l’action violente et le fait qu’elle soit ou non l’élément central de la séquence seront des critères déterminants.
Cette politique jette inévitablement une ombre d’incertitude sur des franchises emblématiques. Des jeux comme Grand Theft Auto, connus pour leur satire sociale mais aussi pour leur violence débridée, pourraient-ils voir leurs « let’s play » systématiquement restreints ? Et que dire de moments de jeu vidéo devenus tristement célèbres, comme la mission « No Russian » de Call of Duty: Modern Warfare 2, qui met le joueur dans la peau d’un terroriste commettant un attentat de masse dans un aéroport ? Cette scène correspond presque point par point à la nouvelle définition de YouTube: « violence de masse contre des non-combattants » impliquant des personnages « réalistes ».
Dans une déclaration, le porte-parole de YouTube, Boot Bullwinkle, a tenté de clarifier la position de l’entreprise. Il explique que certains contenus pourront être soumis à une restriction d’âge s’ils ne sont pas fugaces ou s’ils sont zoomés. Cela suggère qu’une scène de torture graphique qui dure trente secondes et sur laquelle la caméra s’attarde sera traitée différemment d’un tir rapide dans un jeu de shoot à la première personne.
L’impact sur les créateurs de contenu
Pour les millions de créateurs sur la plateforme, cette mise à jour est une source d’inquiétude. La restriction d’âge n’est pas neutre, elle réduit drastiquement l’audience potentielle d’une vidéo et, par conséquent, sa monétisation. Une vidéo restreinte n’apparaît pas dans les recommandations de la même manière et génère beaucoup moins de revenus publicitaires. YouTube ne les laisse pas sans options pour autant. Le même porte-parole a indiqué qu’il pourrait y avoir des façons pour eux de choisir de jouer une mission afin d’éviter le contenu qui conduirait à une restriction d’âge. En d’autres termes, la plateforme encourage l’autocensure ou, du moins, l’édition stratégique. Les créateurs pourront choisir de flouter ou d’obscurcir les moments de violence extrême.
C’est un arbitrage difficile. Un streameur qui réalise un « walkthrough » complet et non censuré d’un jeu classé « Mature » (18+) le fait souvent pour un public adulte qui souhaite voir le jeu tel qu’il est. Devoir désormais couper ou masquer des parties pourrait être perçu comme une dénaturation de l’œuvre et du contenu proposé.
Protéger les jeunes utilisateurs – Le motif officiel
La raison invoquée par YouTube est sans équivoque, la protection des utilisateurs plus jeunes.
« Les politiques de YouTube sont conçues pour s’adapter au monde numérique en constante évolution, et ces mises à jour reflètent notre engagement continu à protéger les jeunes utilisateurs et à promouvoir une plateforme responsable », a déclaré M. Bullwinkle.
Il est indéniable que le photoréalisme croissant des jeux vidéo rend certaines scènes indiscernables de la réalité pour un œil non averti et particulièrement pour un jeune public. La décision de YouTube s’inscrit dans un mouvement visant à responsabiliser les plateformes face aux contenus qu’elles hébergent et recommandent. D’ailleurs, la mise à jour du 17 novembre ne concerne pas uniquement la violence. YouTube en profite pour renforcer ses règles concernant les jeux d’argent, un autre sujet brûlant dans l’écosystème du gaming.
La plateforme va désormais empêcher les créateurs de diriger les utilisateurs vers des contenus de jeux d’argent en ligne impliquant des biens numériques, tels que les skins de jeux vidéo, les cosmétiques ou les NFTs. C’est une attaque directe contre une zone grise qui a longtemps prospéré, où la frontière entre le jeu vidéo et le pari en ligne est devenue poreuse (on pense notamment aux controverses sur les « loot boxes » ou les sites de paris de skins).
Cette mesure s’ajoute aux restrictions mises en place en mars dernier, qui interdisaient déjà la promotion de services de jeux d’argent non approuvés par Google et qui restreignaient l’accès aux contenus de jeux d’argent approuvés pour les moins de 18 ans. Désormais, même les contenus de type « casino social » (jeux de casino qui n’utilisent pas d’argent réel mais qui en imitent fortement les mécaniques) seront également soumis à une restriction d’âge.
Ce double ajustement politique montre un YouTube qui cherche activement à nettoyer sa plateforme et à répondre aux critiques sur la protection des mineurs. Si l’intention est louable, l’application de ces règles, notamment sur la « violence graphique réaliste », sera scrutée de près. La communauté gaming, habituée à une grande liberté, va devoir s’adapter et il est probable que de nombreux débats sur la censure et la responsabilité émergeront dans les mois à venir.
28.10.2025 à 17:12
Melissa, le monstre qui menace la Jamaïque
Romain Leclaire
Texte intégral (1463 mots)

Les météorologues qui, depuis des jours, ont les yeux rivés sur l’océan Atlantique, retiennent leur souffle. Ils assistent à la naissance d’un monstre. L’ouragan Melissa, qui s’est développé à une vitesse foudroyante, est sur le point de frapper la Jamaïque aujourd’hui. Et il ne s’agit pas d’une simple tempête tropicale, Melissa est un ouragan de catégorie 5, la classification la plus élevée et la plus destructrice qui soit. Les experts sont unanimes, son intensité soutenue, et toujours croissante, est tout simplement remarquable. Il a toutes les caractéristiques d’une tempête qui marquera l’histoire.
L’alarme est sonnée. L’heure n’est plus à la simple observation, mais à la préparation au pire. Pour comprendre la puissance d’un tel phénomène, il faut regarder les chiffres. Il existe plusieurs façons de mesurer la force d’un ouragan. La première est la pression atmosphérique: plus la pression est basse au centre de la tempête, plus celle-ci est puissante. Ce mardi, alors que Melissa s’approche dangereusement des côtes jamaïcaines, sa pression minimale a été mesurée à 901 millibars. C’est déjà un chiffre effrayant. À titre de comparaison, c’est plus bas que la pression minimale atteinte par le tristement célèbre ouragan Katrina, qui était de 902 mb.
Mais le plus incroyable, c’est que l’ouragan n’a pas encore fini de se renforcer. La pression de la tempête a déjà chuté à 892 mb. Si Melissa touche terre avec une telle pression, il égalerait le record absolu d’intensité. Ce qui stupéfie le plus les scientifiques, c’est de voir cette pression chuter aussi drastiquement alors que l’ouragan est si proche des terres, surtout d’une île montagneuse comme la Jamaïque. Le relief montagneux aurait dû le perturber un peu, commencer à l’affaiblir. Mais en réalité, il est toujours en train de s’intensifier à l’heure actuelle.
La seconde méthode pour évaluer un ouragan est la vitesse de ses vents. Sur ce point aussi, Melissa a surpris les météorologues, non seulement par sa force brute, mais aussi par la vitesse à laquelle il l’a acquis. Samedi, alors que la tempête se formait dans le bassin atlantique, les vents de Melissa ne soufflaient qu’à environ 112 km/h, soit moins que la force requise pour un ouragan de catégorie 1. Vingt-quatre heures plus tard, les vents avaient bondi à environ 225 km/h, atteignant la force d’une catégorie 4. Et l’escalade ne s’est pas arrêtée là. Aujourd’hui, il enregistrait des vents soutenus de près de 300 km/h. Il est extrêmement rare qu’une tempête s’intensifie rapidement alors qu’elle est déjà incroyablement intense. On observe généralement une intensification rapide lorsqu’il s’agit d’une tempête tropicale ou d’un ouragan de catégorie 1 ou 2. C’est très courant à ce stade. Mais pas lorsqu’il est déjà au sommet de l’échelle d’intensité.
Alors, comment expliquer une telle puissance ? Melissa a commencé à se former la semaine dernière, quittant la côte ouest-africaine pour dériver sur des eaux océaniques anormalement chaudes. Les ouragans sont alimentés par la chaleur de l’océan. Parfois, ils peuvent stagner. Habituellement, lorsqu’un l’un d’eux reste immobile, il brasse l’eau et fait remonter des eaux plus profondes et plus froides, ce qui le prive de son carburant et l’affaiblit. Mais pas cette fois. Les eaux profondes de la mer des Caraïbes sont actuellement bien plus chaudes que la normale dans le reste de l’Atlantique. Au lieu de s’affaiblir, Melissa s’est littéralement surchargée en énergie sur son chemin vers la Jamaïque.
Le contexte de cette saison est également préoccupant. Melissa est la troisième tempête de catégorie 5 à se former dans l’Atlantique cette année. La dernière fois qu’une telle chose s’est produite, c’était lors de la saison mortelle de 2005, qui nous a donné les ouragans Emily, Katrina, Rita et Wilma. La comparaison avec Katrina, qui s’était légèrement affaiblie avant de toucher terre en catégorie 3, n’est pas la bonne. Il faut plutôt regarder du côté de l’ouragan Andrew en 1992. Ce dernier avait frappé la Floride en catégorie 5, avec des vents de 265 km/h, soit bien moins que les vents actuels de Melissa. Andrew reste l’une des tempêtes les plus catastrophiques à avoir jamais frappé les États-Unis, causant 65 décès et plus de 27 milliards de dollars de dégâts à l’époque.
Bien sûr, la question du changement climatique se pose. Les eaux de l’océan se sont réchauffées au cours des vingt dernières années, et ces eaux chaudes ont servi de carburant à Melissa.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Lava
- La revue des médias
- Le Grand Continent
- Le Diplo
- Le Nouvel Obs
- Lundi Matin
- Mouais
- Multitudes
- Politis
- Regards
- Smolny
- Socialter
- The Conversation
- UPMagazine
- Usbek & Rica
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- Contretemps
- A Contretemps
- Alter-éditions
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- Philo Mag
- Terrestres
- Vie des Idées
- ARTS
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
- Fiabilité 3/5
- Slate
- Fiabilité 1/5
- Contre-Attaque
- Issues
- Korii
- Positivr