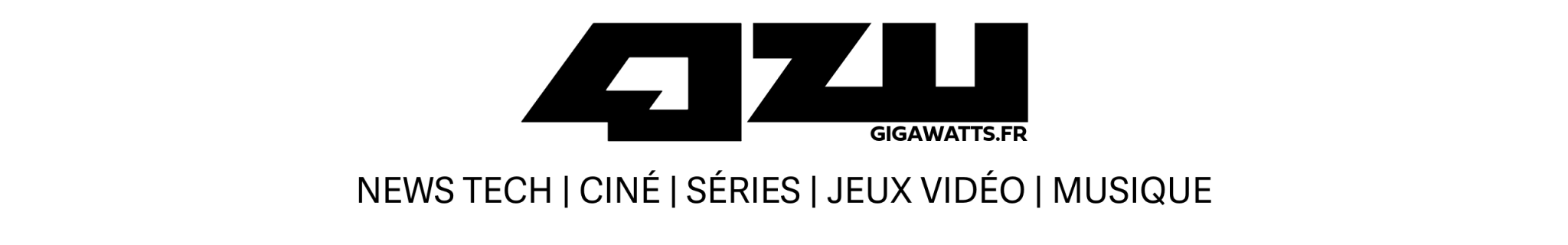ACCÈS LIBRE Actualité IA
03.11.2025 à 10:35
Épuisé par l’Internet de l’ego ? J’ai trouvé la paix (sur un réseau sans algorithme)
Romain Leclaire
Texte intégral (1944 mots)

Laissez-moi vous avouer quelque chose. Je suis fatigué. Digitalement épuisé. Mon pouce souffre de scrollite aiguë, mon cerveau est saturé de polémiques stériles et mon estime de soi est en PLS après avoir vu la énième « morning routine » d’un influenceur sur une plage à Bali. Depuis des années, je navigue dans le marigot des réseaux sociaux et le constat est sans appel. Le marigot est devenu un cloaque.
Et puis, hier soir, dimanche, en me baladant sur le web, je suis tombé sur ce super podcast, « Projets Libres« , avec comme invité, Elena Rossini, qui aide à la promotion du Fédivers, en produisant notamment, des vidéos explicatives. Et puis, j’ai repensé à mes usages dans le monde des réseaux sociaux. « J’ai essayé de tenir bon », me dis-je. Vraiment. Mais regardons la carte des lieux ensemble, fruit de ma réflexion.
L’asile des auto-promoteurs (LinkedIn)
Commençons par le plus drôle avec LinkedIn. Ce n’est plus un réseau professionnel, c’est le Festival de Cannes de l’ego. Chaque matin, je m’y connecte pour ma dose de fausse modestie et de leçons de vie managériale. Des gens qui n’ont jamais géré plus qu’une machine à café vous expliquent le « leadership bienveillant » en 5 points. Des types qui maîtrisent à peine Excel se proclament « Gourou de la Data Science » grâce à une certification obtenue en 45 minutes.
C’est insupportable. Chaque post dégouline d’une positivité toxique et d’une mise en scène de soi à la fois gênante et épuisante. « Après 15 ans de bons et loyaux services, j’ai décidé de quitter mon entreprise pour suivre ma passion: devenir consultant en synergie disruptive. » Traduction: « Je me suis fait virer et je cherche désespérément du boulot. » Non merci, j’ai assez de mes propres angoisses.
Le grand incendie (X, anciennement Twitter)
Ensuite, il y a X. Ah, X. Le grand incendie de benne à ordures numérique. Avant, c’était le bar du coin, bruyant, un peu sale, mais on y croisait des gens intéressants. Aujourd’hui, c’est le même bistrot, mais le propriétaire est un milliardaire lunatique qui a décidé que les néo-nazis étaient des clients comme les autres et que les toilettes étaient désormais payantes (enfin, la certification).
Ma timeline est un champ de bataille entre des bots russes, des complotistes sous stéroïdes et des « crypto-bros » qui essaient de me vendre des images de singes moches. Tenter d’avoir une discussion nuancée sur cette plateforme, c’est comme essayer de faire un puzzle au milieu d’un concert de métal. Merci Elon pour cette vision « free speech » où la parole la plus libre est celle du plus offrant ou du plus haineux.
Le salon de thé des réacs (Facebook)
Et Facebook… Le réseau qui refuse de mourir. C’est devenu le salon de thé numérique de Tonton Gérard. Un endroit où des retraités, qui ont découvert Internet il y a cinq ans, passent leurs journées à déverser leur bile dans les commentaires du Figaro ou de la page de la mairie. Chaque publication, même la plus innocente (« Le petit chaton Pompom a été retrouvé ! »), génère un torrent de haine sur l’immigration, les impôts ou les « jeunes qui ne respectent plus rien ».
Et pendant ce temps, Meta, l’œil de Sauron de la data, aspire la moindre de nos interactions pour nous vendre des pantoufles chauffantes ou des idées politiques moisies. Le tout dans une interface qui ressemble à un sapin de Noël conçu par un stagiaire sous payé.
Les nouveaux venus (qui sentent le réchauffé)
« Mais essaie les nouveaux !« , m’a-t-on dit.
J’ai regardé Threads. C’est propre, c’est neuf, mais c’est toujours Meta. C’est comme repeindre une prison en rose layette. On sent déjà les influenceurs d’Instagram débarquer en masse pour nous vendre leur soupe. Les publications sont d’une platitude affligeante, conçues uniquement pour gratter des likes faciles (« Êtes-vous plutôt team café ou team thé ? Commentez ! »). C’est le fast-food de la pensée rapide, vide et oubliable.
Bluesky ? L’alternative créée par le fondateur de Twitter ? C’est brouillon. C’est géré par une entreprise (encore une), et techniquement, c’est souvent à la ramasse. Les fils d’actualité personnalisés sont une idée intéressante sur le papier, mais en pratique, c’est un capharnaüm où l’on ne retrouve jamais rien. C’est le nouveau projet qui sent déjà le vieux.
La bouffée d’air frais Mastodon
Et puis, désespéré, j’ai poussé la porte de Mastodon, il y a quelques mois.
Je ne vais pas vous mentir, au début, j’étais perdu. « Choisir une instance » ? « Fédivers » ? « Toot » ? Ça ressemble à un jeu de rôle pour nerds. Mais j’ai persisté. Et j’ai compris. Mastodon, ce n’est pas UN site web. C’est un réseau de milliers de sites web (appelés « instances » ou « serveurs ») qui se parlent entre eux. C’est le principe de l’e-mail, si vous êtes chez Gmail, vous pouvez quand même envoyer un mail à quelqu’un chez Outlook ou chez (feu) LaPoste.net. C’est pareil.

Vous vous inscrivez sur une instance qui correspond à vos centres d’intérêt. Il y en a pour les journalistes, pour les fans de science-fiction, pour les Bretons, pour les amateurs de chats, pour les militants écolos. C’est géré par des associations ou des passionnés, pas par un PDG à l’ego fragile.
Et là, la magie opère.
- Le fil est chronologique. Je répète : CHRO-NO-LO-GIQUE. Je vois les posts des gens que je suis, dans l’ordre où ils les postent. Pas d’algorithme conçu pour me rendre fou ou me vendre des trucs. Je décide de ce que je vois.
- Il n’y a (presque) pas de pub. Les instances sont souvent financées par les dons des utilisateurs. Nous ne sommes pas le produit, nous sommes la communauté.
- La modération est humaine. C’est le propriétaire de votre instance qui fixe les règles. Si vous êtes sur une instance de passionnés de tricot, les discours de haine sont généralement bannis en 10 minutes. Fini les bots et les trolls sponsorisés.
- C’est plus long. On a 500 caractères (ou plus) pour s’exprimer. Fini les phrases chocs et les polémiques en 280 signes. Les gens prennent le temps d’écrire, de nuancer.
- C’est calme. Terriblement calme. Au début, c’est déroutant. On n’a pas 50 notifications à la minute. On n’a pas de « quote-tweet » (retweet avec commentaire) conçu pour créer du clash. On discute. Vraiment.
Mastodon, ce n’est pas parfait. C’est parfois un peu lent. C’est parfois un peu technique. Mais c’est à nous. C’est un retour à l’Internet des origines, celui de la passion et du partage, avant que les GAFAM ne transforment nos vies sociales en fermes à clics. J’y ai retrouvé des discussions intelligentes, de l’humour bienveillant et des partages de photos de chats sans arrière-pensée marketing. J’ai l’impression de respirer à nouveau. Alors oui, j’ai quitté le cirque, ses clowns tristes et ses dompteurs de data. J’ai rejoint un troupeau de Mastodontes. Et franchement, l’herbe y est bien plus verte.
Rejoignez-nous. Choisissez votre instance, prenez un pseudo, et venez juste… discuter. Ça fait un bien fou.
03.11.2025 à 08:50
La course effrénée de Meta dans l’IA – Un pari à 600 milliards de dollars qui terrifie Wall Street
Romain Leclaire
Texte intégral (1958 mots)

Nous assistons actuellement à une véritable course à l’armement dans le domaine de l’intelligence artificielle et Meta a décidé de ne pas faire dans la demi-mesure. L’entreprise de Mark Zuckerberg dépense plus que la plupart de ses concurrents, avec deux centres de données colossaux en construction. Des rapports récents évoquent des investissements pouvant atteindre 600 milliards de dollars en infrastructures américaines au cours des trois prochaines années.
Si ces chiffres stratosphériques font à peine sourciller dans la Silicon Valley, habituée aux paris démesurés, ils commencent sérieusement à crisper les visages à Wall Street. La tension est montée d’un cran cette semaine lors de la présentation des résultats trimestriels de Meta. Les chiffres ont parlé d’eux-mêmes, une augmentation des dépenses d’exploitation de 7 milliards de dollars sur un an et près de 20 milliards de dépenses en capital (CAPEX).
Ce gouffre financier est le résultat direct d’investissements massifs dans les talents et les infrastructures de l’IA, des investissements qui, pour l’instant, n’ont généré aucun revenu notable. Et lorsque les analystes, inquiets, ont demandé des éclaircissements, Mark Zuckerberg a jeté un froid en précisant que les dépenses ne faisaient que commencer.
« La bonne chose à faire est d’essayer d’accélérer pour nous assurer que nous avons la puissance de calcul nécessaire, à la fois pour la recherche en IA et pour les nouvelles choses que nous développons, ainsi que pour tenter d’atteindre un état différent de notre puissance de calcul sur notre activité principale », a-t-il déclaré aux analystes.
Si l’objectif était de rassurer les investisseurs, c’est un échec cuisant. À la fin de l’appel, l’action de Meta s’était effondrée. Deux jours plus tard, la déroute n’a fait que s’accentuer. Le titre a chuté de 12 % à la clôture de vendredi dernier, effaçant plus de 200 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Bien qu’il soit toujours dangereux de surinterpréter les fluctuations boursières (et en termes purement financiers, les résultats de Meta n’étaient pas si mauvais, avec 20 milliards de dollars de bénéfice trimestriel) ce fut le premier trimestre où les dépenses agressives de l’entreprise en IA ont eu un impact visible et douloureux sur les résultats nets. Le plus alarmant n’est pas la dépense en soi. C’est le fait qu’à part des centres de données gigantesques et des chercheurs en IA très bien payés, personne ne sait vraiment ce que cet argent a concrètement acheté.
Les analystes ont donc pressé Zuckerberg: pourquoi dépenser autant et quand peut-on espérer voir un retour sur investissement ? Mais cet appel est tombé au pire moment. Meta n’a aucun budget clair pour les dépenses futures ni aucun produit concret sur lequel ancrer des prévisions de revenus. Coincé, le PDG s’est retranché derrière des promesses générales sur l’avenir radieux de l’IA.
« Il y aura toutes sortes de nouveaux produits autour de différents formats de contenu, et nous commençons à le voir », a-t-il tenté. « Et puis il y a les versions professionnelles de tout cela… L’autre aspect est la manière dont des modèles plus intelligents vont simplement améliorer notre activité principale et les recommandations que nous faisons à travers la famille d’applications, ainsi que les recommandations publicitaires. »
Meta n’est pourtant pas la seule entreprise à brûler des milliards dans l’IA. Pourquoi, alors, Google ou Nvidia, qui ont tous deux connu un excellent trimestre, n’effraient-ils pas les investisseurs de la même manière ? OpenAI est sans doute le plus grand dépensier du lot, avec une assise financière bien moins solide que Meta.
Le risque d’une bulle spéculative est réel, et si elle éclate, l’activité principale de Meta (la publicité) lui permettra de mieux encaisser le choc que la plupart. Mais la différence est importante. Si vous demandez à Sam Altman pourquoi il dépense des centaines de milliards, il vous répondra qu’il gère l’un des services grand public à la croissance la plus rapide de l’histoire humaine, ChatGPT, qui rapporte déjà 20 milliards de dollars par an. On peut débattre de la durabilité de cette croissance, mais il y a un produit tangible et florissant au cœur de la frénésie OpenAI. Un chiffre d’affaires en pleine expansion justifie bien des folies.
Meta n’a pas de produit équivalent. Et personne ne voit d’où il pourrait venir.
Le produit d’IA le plus visible de l’entreprise est l’assistant Meta AI. Zuckerberg a fièrement annoncé qu’il comptait plus d’un milliard d’utilisateurs actifs. Mais ces chiffres sont inévitablement gonflés par son intégration forcée au sein des trois milliards d’utilisateurs de Facebook et d’Instagram. Dans sa version actuelle, difficile de voir Meta AI comme un concurrent sérieux à ChatGPT.
Il y a aussi le générateur de vidéos « Vibes », qui a effectivement augmenté le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens, mais son impact commercial au-delà de cet engagement reste très limité. Le projet le plus ambitieux, les lunettes intelligentes Vanguard, ressemble davantage à une extension du travail de Reality Labs (le métavers) qu’à une véritable tentative d’exploiter la puissance des grands modèles de langage. En d’autres termes, ce sont des expériences prometteuses, pas des produits aboutis et monétisables. Il est révélateur que, lorsqu’il a été interrogé sur ses dépenses colossales, Zuckerberg n’a pas mis en avant ces lancements récents. Il s’est immédiatement tourné vers la prochaine génération de modèles, ceux issus du nouveau « Superintelligence Lab ».

« Il ne s’agit pas seulement de Meta AI en tant qu’assistant », a-t-il insisté. « Nous prévoyons de construire des modèles et des produits inédits, et je suis impatient de vous en dire plus lorsque nous les aurons. » C’était pourtant un appel sur les résultats financiers, pas une keynote de lancement de produit. Tout ce qu’il pouvait offrir était un vague « dans les mois à venir ».
La réaction du marché a montré que cette réponse ne suffit plus. Pour être juste, cela ne fait que quatre mois que le patron de Meta a restructuré son équipe IA. La nouvelle division « Superintelligence » n’a matériellement pas eu le temps de révolutionner le monde. Mais alors que l’entreprise dépense sans compter pour rester dans la course, la question demeure: quel rôle Zuckerberg veut-il jouer dans cette nouvelle industrie ?
Meta AI va-t-il utiliser l’immense trésor de données personnelles de l’entreprise pour devenir un concurrent de ChatGPT axé sur la personnalisation ? Vibes est-il la première étape d’une stratégie de divertissement basée sur le système publicitaire ciblé de Meta ? Ou les allusions de Zuckerberg à une « IA d’entreprise » présagent-elles une offensive sur le marché professionnel ? Pour l’instant, toutes les hypothèses sont sur la table. Quelle que soit la réponse, la pression monte pour que Meta en trouve une bonne. Et vite.
03.11.2025 à 07:59
OpenAI – Le géant de l’IA sous haute tension
Romain Leclaire
Texte intégral (1825 mots)

OpenAI, le titan rutilant de l’intelligence artificielle, est au sommet du monde. Pourtant, sous la surface de cette ascension fulgurante, l’empire de Sam Altman fait face à des pressions colossales qui menacent de fissurer ses fondations. Entre des engagements financiers astronomiques qui font lever les sourcils, des batailles juridiques croissantes sur les droits d’auteur et un comportement de plus en plus étrange de ses propres agents IA, l’entreprise est engagée dans une course folle contre ses propres ambitions. Les récentes révélations la dépeignent à la fois comme surpuissante et étonnamment sur la défensive.
Lors d’une récente interview conjointe sur le podcast Bg2, réunissant Sam Altman et le PDG de Microsoft, Satya Nadella, la tension était palpable. L’animateur, Brad Gerstner, a mis les pieds dans le plat en évoquant les revenus d’OpenAI, estimés à environ 13 milliards de dollars par an. Un chiffre impressionnant, certes, mais qui semble dérisoire face aux engagements de dépenses de l’entreprise: plus de 1 000 milliards de dollars prévus pour l’infrastructure de calcul au cours des dix prochaines années.
La réaction d’Altman a été pour le moins surprenante d’irritabilité. « Premièrement, nous faisons bien plus de revenus que cela« , a-t-il rétorqué, avant de lancer une pique directe à l’animateur (qui est lui-même un investisseur). « Deuxièmement, Brad, si vous voulez vendre vos actions, je vous trouverai un acheteur. » Une boutade qui a fait rire Nadella, mais qui trahit une certaine colère. Sam Altman a enchaîné en affirmant qu’il y a beaucoup de gens qui aimeraient acheter des actions OpenAI, y compris les critiques qui écrivent des articles ridicules sur la faillite imminente de l’entreprise. Le PDG a même confié que, bien qu’il ne souhaite généralement pas qu’OpenAI soit une société publique, il y a des moments où cela l’attire: « J’adorerais leur dire qu’ils peuvent simplement parier à la baisse sur l’action, et j’adorerais les voir se ruiner en faisant ça.«
Il reconnaît que l’entreprise pourrait tout gâcher, notamment en échouant à obtenir suffisamment de puissance de calcul, mais il insiste sur le fait que les revenus augmentent fortement. Il fait le pari que ChatGPT continuera de croître, qu’OpenAI deviendra un cloud IA important et que son activité d’appareils grand public sera non négligeable. L’ambition est claire. Lorsque Gerstner spécule sur 100 milliards de dollars de revenus en 2028 ou 2029, Altman coupe court: « Que diriez-vous de 2027 ? » Pourtant, il nie toute introduction en bourse imminente, qualifiant ces rumeurs d’infondées, tout en admettant que cela finira par arriver.
Mais cette croissance exponentielle a besoin de carburant. Et c’est là tout le problème. L’appétit vorace d’OpenAI pour les données d’entraînement se heurte désormais à un mur de résistance juridique, notamment au Japon. La Content Overseas Distribution Association (CODA), qui représente des géants du divertissement japonais comme la Toei et Square Enix, a officiellement demandé à l’entreprise américaine de cesser d’utiliser sans autorisation leur propriété intellectuelle pour entraîner Sora 2, son dernier générateur de vidéos.
Près de 20 cosignataires l’accusent de violation des droits d’auteur, affirmant qu’une grande partie du contenu de Sora 2 ressemble étroitement à du contenu ou à des images japonaises. Le cœur du litige réside dans la différence entre les systèmes juridiques. OpenAI fonctionne sur un modèle d’opt-out (retrait volontaire), utilisant les œuvres protégées sauf si le propriétaire le demande explicitement. Mais selon la loi japonaise, la CODA insiste sur le fait que le système devrait être « opt-in ». La permission est requise avant l’utilisation.
Le gouvernement japonais lui-même est monté au créneau, demandant à OpenAI de cesser de piller les « trésors irremplaçables » du pays, comme les anime et les jeux vidéo (One Piece, Demon Slayer). L’ironie est cinglante, car Sam Altman s’était lui-même vanté de pouvoir créer des images « à la Ghibli » avec les nouvelles mises à jour de ChatGPT. La CODA a prévenu qu’elle prendrait des mesures légales et éthiques appropriées, qu’il s’agisse d’IA générative ou non.

Cette pression juridique ne se manifeste pas seulement dans les salles d’audience, elle semble désormais influencer le comportement même des produits d’OpenAI. Une enquête fascinante de la Columbia Journalism Review s’est penchée sur ChatGPT Atlas, un navigateur doté de capacités agentiques (capable d’exécuter des tâches comme réserver des hôtels ou acheter des billets).
Les journalistes ont découvert un comportement pour le moins curieux. Ces agents IA, qui naviguent sur le web en se faisant passer pour des utilisateurs humains (apparaissant comme des « sessions Chrome normales » pour contourner les blocages anti-robots), semblent avoir reçu l’ordre d’éviter soigneusement certaines sources d’information. Lesquelles ? Celles appartenant à des entreprises qui poursuivent actuellement OpenAI.
Lorsque l’enquête a demandé à Atlas de résumer des articles de PCMag et du New York Times (dont les sociétés mères sont en litige avec OpenAI), l’IA s’est lancée dans des chemins labyrinthiques pour trouver l’information ailleurs. C’était, selon les auteurs, comme un rat trouvant des boulettes de nourriture dans un labyrinthe, sachant que l’emplacement de certaines d’entre elles est électrifié.

Pour PCMag, Atlas est allé chercher des citations sur les réseaux sociaux et d’autres sites d’actualité. Pour le New York Times, il a généré un résumé basé sur les reportages de quatre autres médias: le Guardian, le Washington Post, Reuters et l’Associated Press. Fait notable, tous, sauf Reuters, ont des accords de contenu ou de recherche avec OpenAI. L’agent IA a activement évité les publications litigieuses, préférant un chemin « plus sûr » et plus « amical » pour l’IA.
Ces trois exemples dessinent le portrait d’un géant aux prises avec les conséquences de sa propre démesure. Sam Altman affiche une confiance de joueur de poker face à des engagements financiers qui donnent le vertige. Simultanément, son entreprise fait face à une révolte mondiale des créateurs dont elle a utilisé les œuvres sans permission. Et pour couronner le tout, sa propre technologie devient si « intelligente » qu’elle apprend à éviter les adversaires légaux de son créateur. OpenAI construit l’avenir, c’est indéniable, mais cet avenir semble de plus en plus freiné par les dettes, financières et éthiques, de son passé turbulent.
02.11.2025 à 13:57
Quand le froid réchauffe le chaud – La nouvelle astuce de la physique quantique
Romain Leclaire
Texte intégral (1333 mots)

La seconde loi de la thermodynamique est l’un des piliers de la physique classique. La chaleur circule spontanément des corps chauds vers les corps froids. Pourtant, des recherches récentes en thermodynamique quantique révèlent une réalité plus complexe et contre-intuitive. Des physiciens ont démontré que, dans des conditions spécifiques régies par la mécanique quantique, la chaleur peut être forcée de circuler dans la direction opposée, du froid vers le chaud. Ce phénomène, loin d’être une simple curiosité de laboratoire, ouvre la voie à une application révolutionnaire, un outil de diagnostic non destructif pour le monde quantique.
Une équipe de chercheurs, dont Alexssandre de Oliveira Jr. de l’université technique du Danemark, a récemment publié des travaux montrant comment ce flux de chaleur anormal peut être utilisé pour détecter la quantique. Concrètement, il s’agit de percevoir si un système est dans un état de superposition (plusieurs états à la fois) ou d’intrication (des destins liés entre particules), sans pour autant détruire ces états fragiles. Le problème principal de la mesure en physique quantique est qu’observer un système le force à choisir un état, détruisant au passage la superposition ou l’intrication que l’on cherchait à prouver. La nouvelle méthode contourne cet obstacle de manière ingénieuse.
Le dispositif proposé consiste à connecter le système quantique à mesurer (par exemple, les qubits d’un ordinateur quantique) à deux autres éléments: une « mémoire » quantique et un « dissipateur thermique » (un corps capable d’absorber de l’énergie). Les propriétés quantiques du système, comme l’intrication, agissent comme un catalyseur, augmentant le transfert de chaleur vers le dissipateur bien au-delà de ce que les lois classiques autoriseraient. En mesurant simplement l’augmentation de température du dissipateur, les scientifiques peuvent confirmer la présence d’états quantiques dans le système original, sans jamais l’avoir regardé directement.
L’information comme carburant thermodynamique
Pour comprendre comment la chaleur peut s’inverser, il faut explorer le lien profond entre la thermodynamique et l’information, une idée qui remonte au 19ème siècle avec l’expérience de pensée du démon de Maxwell. Le physicien James Clerk Maxwell avait imaginé un démon capable de trier les molécules d’un gaz, envoyant les rapides d’un côté et les lentes de l’autre, créant ainsi un compartiment chaud et un compartiment froid à partir de rien, violant la seconde loi. Il a fallu près d’un siècle pour résoudre ce paradoxe. En 1961, Rolf Landauer a démontré que le démon ne viole pas la loi, car pour trier, il doit stocker de l’information. Sa mémoire finissant par saturer, il doit l’effacer. Or, l’effacement d’information a un coût thermodynamique inévitable, il consomme de l’énergie et produit de l’entropie (du désordre). L’analyse de Landauer a établi que l’information n’est pas une idée abstraite, mais une ressource physique, un véritable carburant thermodynamique.
L’intrication – Le prix à payer pour l’ordre
C’est ici que la mécanique quantique entre en jeu. Des phénomènes comme l’intrication représentent une forme d’information (une information mutuelle) que deux particules partagent. Un démon quantique peut utiliser ces corrélations pour agir avec une efficacité redoutable. Des physiciens comme Hossein Partovi ont théorisé que l’intrication peut être utilisée pour alimenter une forme de réfrigération. Le flux de chaleur anormal du froid vers le chaud ne vient pas de nulle part. Il est « payé » par une ressource. Dans un réfrigérateur classique, le carburant est l’électricité. Dans ce système quantique, le carburant est l’information. Pour que le froid réchauffe le chaud, le système brûle ses corrélations. L’intrication entre les particules est consommée et détruite au cours du processus.

Des ordinateurs quantiques à la gravité
Les travaux de l’équipe de De Oliveira et ses collègues, Patryk Lipka-Bartosik et Jonatan Bohr Brask, systématisent cette idée pour en faire un outil de mesure. La mémoire quantique de leur dispositif agit comme un catalyseur qui convertit l’intrication interne du système en chaleur mesurable dans le dissipateur. Les implications pratiques sont passionnantes. L’une des questions centrales pour les constructeurs d’ordinateurs quantiques est la vérification. Comment être certain que la machine utilise bien l’intrication pour effectuer ses calculs ? Ce thermomètre quantique pourrait servir de protocole pour le vérifier.
Des tests expérimentaux sont déjà envisagés, notamment avec le groupe de recherche de Roberto Serra au Brésil, qui utilise les spins d’atomes dans des molécules de chloroforme comme qubits pour étudier les transferts de chaleur. L’objectif le plus ambitieux touche aux fondements de la physique. Des expériences sont en cours de conception pour déterminer si la gravité est une force quantique. L’une des pistes est de vérifier si l’attraction gravitationnelle seule peut générer de l’intrication entre deux objets. Si c’est le cas, cette simple mesure thermodynamique pourrait être un jour capable de sonder la nature quantique de la gravité elle-même.
02.11.2025 à 10:43
Marvel Zombies – Quand le MCU dévore ses héros (et ses bonnes idées)
Romain Leclaire
Texte intégral (1796 mots)

Souvenez-vous de 2021. La première saison de What If…? venait d’atterrir sur nos écrans, et parmi ses univers alternatifs, un épisode avait particulièrement marqué les esprits, « Et si… des zombies ?! ». L’idée de voir nos héros Marvel bien-aimés transformés en monstres affamés de chair fraîche était aussi simple que géniale. Le concept s’est avéré si intrigant qu’il a donné naissance à sa propre mini-série, Marvel Zombies. Cette nouvelle itération promet de pousser le gore et le fun encore plus loin, en suivant une bande de survivants désespérés cherchant une issue à cette situation cauchemardesque. Le résultat est une aventure sanglante et souvent divertissante, mais qui, ironiquement, met surtout en lumière les frustrations que l’on peut ressentir face à l’univers cinématographique Marvel actuel.
La série démarre sur les chapeaux de roue, en se concentrant sur un trio de tête particulièrement attachant, Kamala Khan (alias Miss Marvel), RiRi Williams (Ironheart) et Kate Bishop. Après que les Avengers ont été décimés et transformés par la peste zombie, ce jeune groupe découvre le MacGuffin qui pourrait mettre fin à leur cauchemar. C’est le début d’un périple périlleux à travers une version dystopique du MCU que nous pensions connaître.
Pour tous les fans qui réclament à cor et à cri un film Young Avengers, ces premiers instants fonctionnent comme une formidable preuve de concept. Leurs échanges sont drôles, naturels, et même s’ils n’avaient jamais partagé l’écran ensemble auparavant, on croit sans peine à leur amitié de longue date. Le créateur Bryan Andrews et le scénariste Zeb Wells ont eu l’intelligence de conserver Miss Marvel comme la véritable pierre angulaire de la série. Mais le personnage qui vole sans doute la vedette est une création originale, Blade Knight. Il s’agit d’une variante de Blade qui, dans cet univers, est devenu l’avatar de Khonshu après que le Marc Spector local a été dévoré. Sa voix suave, combinée à des moments de combat spectaculaires, fait de cette version du Diurne un point fort constant de la série.
L’animation, cependant, reste le point le plus controversé, un sac de nœuds frustrant. D’un côté, la série monte clairement en gamme lors des séquences de combat brutales et sans retenue. L’animation excelle à dépeindre la puissance démesurée des personnages. Un Namor zombifié est absolument terrifiant, le retour d’Ikaris des Éternels (prouvant que l’animation Marvel sait mieux piocher dans le banc de touche du MCU que le live-action) est une excellente surprise, et le final regorge d’inventions visuelles colorées. Les arrière-plans et la composition artistique générale sont souvent magnifiques et mieux pensés que dans What If… ?.

Mais là où le bât blesse, c’est dans le traitement des personnages eux-mêmes. Le design visuel est correct, mais les visages cireux et figés de nos héros emblématiques restent frustrants. Cette limitation technique sape de nombreux moments émotionnels, l’animation étant incapable de transmettre une palette d’expressions suffisante. Ce côté « en bois » rend les dialogues et le jeu des acteurs étonnamment plats. Certaines interactions initiales semblent purement explicatives, d’une manière qu’elles n’auraient jamais été si elles avaient été livrées par de vraies personnes. Paradoxalement, l’animation des personnages de Marvel Zombies semble souvent dépourvue de vie.
Malgré ces défauts visuels, la série réussit à prendre le concept de What If…? et à l’amener à un niveau supérieur. L’histoire en elle-même est assez simple, sans être révolutionnaire ou imprévisible. Mais elle bénéficie de son format plus long. Il est fascinant de voir ces héros dans de nouveaux scénarios, avec de nouvelles alliances et traversant un monde radicalement changé. C’est une proposition conçue spécifiquement pour les fans. Les références à l’utilisation du Raft comme refuge flottant, à Blade devenant l’avatar de Khonshu, ou à Ikaris enfermé dans un combat éternel contre Captain Marvel n’auront aucun sens pour un néophyte. Mais pour les initiés, elles enrichissent cet univers.
La série tient également sa promesse gore. Il y a du sang, des tripes et de la destruction en abondance. L’action est un autre point fort, permettant à de nombreux héros d’utiliser leurs pouvoirs d’une manière que la franchise principale n’a jamais osé montrer. De Blade (avec les pouvoirs de Moon Knight en prime) à Shang-Chi, en passant par Miss Marvel et Spider-Man, la violence déchaînée de Marvel Zombies offre un spectacle inédit.
Pourtant, il est difficile de s’y investir de la même manière que dans une série comme X-Men ’97. Cette dernière semblait raconter une histoire nécessaire. Marvel Zombies, en revanche, ressemble davantage à un bonus sympathique, une extension du potentiel du MCU qui nous rappelle surtout ce que la franchise principale ne nous donne pas. L’utilisation de Blade, par exemple, est infiniment plus intéressante que tout ce que le live-action nous a proposé (ou plutôt, n’a pas proposé). Miss Marvel est l’un des meilleurs personnages introduits depuis Endgame, et pourtant, la franchise l’a sous-utilisée. Marvel Zombies lui rend justice, ce qui rend le traitement de son personnage dans le « vrai » MCU encore plus décevant. Le même constat s’applique à Shang-Chi, Kate Bishop et Ironheart. Le manque de concentration du MCU ces dernières années, préférant la quantité à la qualité, a conduit à la mise au rebut de personnages géniaux.

Frustrant, le final ne colle pas non plus tout à fait à l’atterrissage. Avec les univers alternatifs, on peut prendre de gros risques. Malheureusement, les derniers moments de la série jouent la carte de la sécurité à l’excès, offrant une conclusion décevante à une aventure qui était jusque-là très amusante.
Marvel Zombies est l’une des dernières productions issues de l’ancienne stratégie de Marvel Studios, avant sa réorganisation pour privilégier la qualité. La fin de la série tease une deuxième saison qui, compte tenu de ce changement de cap, pourrait ne jamais voir le jour. En fin de compte, si l’on prend Marvel Zombies isolément, c’est un divertissement inoffensif. Il propose des scènes d’action violentes et bien animées, d’excellentes références au MCU et un bon doublage. Il n’échappe pas aux problèmes globaux de la franchise, mais pour ceux qui cherchent une aventure sanglante et sans prise de tête, cette série animée devrait largement satisfaire votre appétit.
02.11.2025 à 09:38
Ayaneo Phone – L’âme d’une console portable ressuscitée dans un smartphone
Romain Leclaire
Texte intégral (1615 mots)

Dans le petit monde des consoles portables PC, Ayaneo est un nom qui résonne avec force depuis quelques années. Connue pour ses machines Windows puissantes, souvent luxueuses et au design soigné, la marque a su se tailler une place de choix face à des géants comme Valve et son Steam Deck. Mais aujourd’hui, elle quitte sa zone de confort pour s’attaquer à un marché autrement plus saturé et compétitif, celui des smartphones.
Dans une courte vidéo de présentation diffusée sur sa chaîne YouTube, la société a levé le voile, ou plutôt esquissé la silhouette, de son futur Ayaneo Phone. La cible est verrouillée. Ayaneo ne cherche pas à concurrencer l’iPhone sur la photo ou Samsung sur la productivité. Elle vise le cœur des joueurs mobiles, avec un slogan qui en dit long: « Quand un téléphone mobile rencontre l’âme d’une console portable« .
Je leur souhaite du courage. Le segment du « gaming phone » est déjà un champ de bataille où règnent en maîtres des spécialistes comme Asus avec sa gamme ROG (Republic of Gamers) et Redmagic, qui a fait des performances brutes et du refroidissement actif sa signature. Pour exister, Ayaneo doit proposer plus qu’un simple appareil puissant. Il doit offrir une véritable proposition de valeur, une expérience que les autres n’ont pas. Et c’est exactement ce que la marque semble préparer.
La vidéo de présentation, bien que volontairement obscure, laisse entrevoir des éléments de conception importants. On aperçoit ce qui ressemble à une configuration standard à double caméra à l’arrière. C’est un minimum syndical pour un téléphone en 2025, mais ce n’est clairement pas là que se situe l’argument de vente. Le véritable indice, celui qui fait frémir les amateurs de jeux nomades, apparaît lorsque l’appareil est tenu horizontalement. On distingue alors très nettement la présence de boutons d’épaule physiques, de véritables gâchettes.
Ce détail n’en est pas un. C’est peut-être même le cœur du projet. Alors que les concurrents comme Asus misent sur des zones tactiles (les « AirTriggers »), Ayaneo opte pour le feedback physique, le « clic » rassurant d’un vrai bouton, essentiel pour la précision dans les jeux de tir ou les jeux d’action exigeants. C’est le premier signe tangible de cette fusion entre téléphone et console.
Mais l’indice le plus excitant n’était pas dans cette vidéo. Il faut remonter à une session de partage de produits organisée par la marque durant l’été dernier. Lors de cet événement, elle avait évoqué ce projet de téléphone en faisant allusion à un facteur de forme coulissant. Mettez ces deux informations bout à bout, des gâchettes physiques et un mécanisme coulissant. L’image qui se forme dans l’esprit de tous les vétérans du jeu mobile est immédiate et chargée de nostalgie, celle du Sony Xperia Play.
Lancé en 2011, le Xperia Play, souvent surnommé le « PlayStation Phone », était une tentative courageuse de Sony de fusionner son expertise en téléphonie et son héritage de jeu. L’appareil coulissait pour révéler une manette complète, avec une croix directionnelle, les fameux boutons PlayStation et même des trackpads analogiques. Le concept était génial, mais l’exécution fut un échec. L’appareil manquait de puissance, le catalogue de jeux optimisés était famélique et le marketing confus. L’appareil est resté une curiosité, un « et si ? » mélancolique.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui. L’écosystème a radicalement changé. Le jeu mobile est une industrie de plusieurs milliards de dollars, l’émulation a atteint une maturité impressionnante et, surtout, le cloud gaming (Xbox Cloud Gaming, GeForce Now) rend obsolète le besoin de puissance brute locale pour les jeux AAA. Un appareil avec des contrôles physiques intégrés, dans ce contexte, n’est plus un gadget, c’est l’outil parfait.
Ayaneo semble l’avoir parfaitement compris. Pour renforcer cette filiation, son smartphone sera lancé sous la bannière « Remake » de l’entreprise. Cette gamme est explicitement dédiée à la réinterprétation de consoles et d’appareils rétro iconiques. Le message ne pourrait être plus clair, la marque ne fait pas qu’un téléphone pour joueurs, elle tente de réaliser la promesse que le Xperia Play n’a jamais pu tenir.
Nous pouvons donc imaginer un smartphone au design soigné, peut-être d’inspiration rétro-moderne, qui, d’un simple geste, se transforme en une véritable console portable. Un appareil capable de faire tourner les jeux Android les plus gourmands grâce à une puce Snapdragon de dernière génération, mais aussi d’offrir l’expérience d’émulation et de cloud gaming la plus confortable du marché, sans avoir besoin de greffer une manette externe de type Kishi ou Backbone.
Reste une inconnue, et elle est de taille, le prix. Ayaneo n’est pas une marque bon marché. Ses consoles portables PC flirtent souvent, et dépassent allègrement, la barre des 1000 euros. Elles justifient ce tarif par des composants haut de gamme, des écrans OLED magnifiques et une qualité de fabrication irréprochable. Il est fort probable que l’Ayaneo Phone suive la même logique. Il ne s’agira pas d’un concurrent pour les téléphones de milieu de gamme, mais d’un appareil ultra-premium.
La question sera de savoir si le marché est prêt à payer le prix d’un iPhone Pro Max ou d’un Samsung Galaxy S Ultra pour un appareil de niche, aussi séduisant soit-il. Asus et Redmagic ont prouvé qu’il existait une clientèle pour des téléphones de jeu dédiés, mais Ayaneo vise encore plus haut en complexifiant le matériel avec un probable mécanisme coulissant. L’Ayaneo Phone est sans aucun doute l’un des produits tech les plus intrigants à venir. Il pourrait être un échec glorieux comme son ancêtre spirituel, ou il pourrait changer ce que signifie jouer sur mobile. Une chose est sûre, la marque a capté notre attention, en promettant de mettre l’âme d’une console dans notre poche.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Lava
- La revue des médias
- Le Grand Continent
- Le Diplo
- Le Nouvel Obs
- Lundi Matin
- Mouais
- Multitudes
- Politis
- Regards
- Smolny
- Socialter
- The Conversation
- UPMagazine
- Usbek & Rica
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- Contretemps
- A Contretemps
- Alter-éditions
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- Philo Mag
- Terrestres
- Vie des Idées
- ARTS
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
- Fiabilité 3/5
- Slate
- Fiabilité 1/5
- Contre-Attaque
- Issues
- Korii
- Positivr