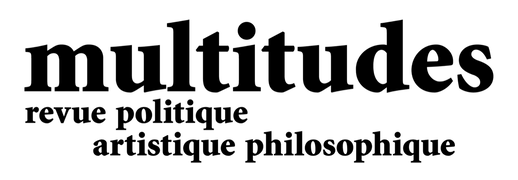25.09.2025 à 11:23
Décolonial Y a-t-il de bons usages du « décolonial » ?
Cocco Giuseppe
Décolonial Y a‑t‑il de bons usages du « décolonial » ? Et si les débats autour des approches « décoloniales » pouvaient s’éclairer d’une opposition entre attitudes anthropémiques (qui vomissent l’étranger) et anthropophagiques (qui l’absorbent) ? Decolonial Are there Good Uses for “Decolonial”? What if the debates around “decolonial” approaches could be illuminated by an opposition between the anthropemic (which rejects the foreign) and the anthropophagic attitudes (which absorbs it)?
L’article Décolonial <br>Y a-t-il de bons usages du « décolonial » ? est apparu en premier sur multitudes.
Texte intégral (5764 mots)
« Je hais les voyages et les explorateurs1 ». Voilà comment Claude Lévi-Strauss commence le journal de ses expéditions. À un certain moment, il y suggère qu’on peut « opposer deux types de sociétés, celles qui pratiquent l’anthropophagie, c’est-à-dire, qui voient dans l’absorption de certains individus détenteurs de forces redoutables le seul moyen de neutraliser celles-ci, et même, de les mettre à profit ; et celles qui, comme la nôtre, adoptent ce qu’on pourrait appeler l’anthropémie (du grec émein, vomir) ; placées devant le même problème, elles ont choisi la solution inverse, consistant à expulser ces êtres redoutables hors du corps social en les tenant temporairement ou définitivement isolés, sans contact avec l’humanité, dans des établissements destinés à cet usage2 ».
Aujourd’hui, cette opposition fonctionne à l’envers : les récits décoloniaux, qui articulent contre « nos » sociétés un sentiment anti-occidental, peuvent être définis comme anthropémiques, alors que nous appellerons anthropophages les approches qui se proposent de dépasser le clivage Nord/Sud, aussi bien que celui Occident/Orient3.
Que s’est-il passé ? Tout d’abord, la base matérielle (le capitalisme) des sociétés dont parlait Lévi-Strauss en 1955 s’est transformée : au lieu d’organiser le travail autour de la prolétarisation (exclusion anthropéme) qui portait à une inclusion disciplinaire, le capitalisme contemporain est structuré sur l’inclusion modulaire (anthropophage) de tout le monde : des travailleurs d’Uber aux autochtones d’Australie. Tout le monde travaille (sur ou pour les plateformes), mais sans rentrer dans le rapport salarial industriel.
Par un autre paradoxe, ceux qui défendent le dehors se trouvent bien au cœur de la mondialisation et en viennent à définir le capitalisme global comme étant « négativement » anthropophage : c’est le cas, explicitement, de Nancy Fraser4 ou de Olúfémi O. Táíwò5 et, implicitement, de Slavoj Zizek6. Ceux qui, au contraire, défendent le dedans se trouvent, eux, aux marges de l’Empire, dans les favelas latino-américaines, dans les forêts tropicales, aux Antilles françaises et surtout dans l’exode des migrants.
Multitudes a évolué en oscillant entre ces deux lignes. En même temps, celles-ci ont été traversées et transformées par une ligne de fuite nomade et africaine.
La communauté qui vient
En 1990, le numéro 1 de Futur Antérieur, la revue dont dérive Multitudes, publiait un article de Giorgio Agamben sur la « communauté qui vient », celle qui venait d’être massacrée sur la place Tienanmen à Pékin par un régime déterminé à rentrer dans le marché global en faisant de sa main de fer sur les mouvements sociaux un « avantage comparatif ». « (L)a nouveauté de la politique qui s’annonce – écrivait le philosophe italien – c’est qu’elle ne sera plus une lutte pour la conquête ou le contrôle de l’État, mais une lutte entre l’État et le non-État (l’humanité), une disjonction irrémédiable des singularités quelconques et de l’organisation étatique7 ». Les luttes ont lieu dans la globalisation et contre les effets de domination, dans un horizon post souverain.
La première livraison de Multitudes sort exactement dix ans après, en mars 2000 et semble confirmer l’intuition d’Agamben. Un article propose une réflexion sur la gêne de la gauche des pays du Sud devant les manifestations qui avaient eu lieu à Seattle pendant le sommet de l’Organisation mondiale du commerce : alors que les mobilisations demandaient la démocratisation de sa gouvernance, la gauche tiers-mondiste était carrément contre la mondialisation8. C’est la répétition du paradoxe de l’abolition de l’esclavage décrite par Maurice Merleau-Ponty. Inspiré par les travaux de l’historien jamaïcain C.L.R. James sur les Jacobins noirs de Saint Domingue, Merleau-Ponty retrace les oscillations du premier ministre anglais, Pitt the Younger9 : d’abord il appuie le camp abolitionniste en France et ensuite il s’allie aux maîtres esclavagistes de Saint Domingue en fonction de l’évolution du conflit avec la France. Les soldats de Napoléon envoyés pour rétablir l’esclavage constataient que les Haïtiens, dont on leur avait dit qu’ils étaient des « agents » des exilés armés par l’étranger, chantaient la Marseillaise et le Ça ira : « La justice serait-elle du côté de nos ennemis barbares10 ? ». Merleau-Ponty insiste justement sur la manière dont les « mêmes principes (ceux de la Révolution) peuvent être mobilisés au même moment dans les deux camps d’un même conflit ». Or, le mécanisme de cette corruption des principes est bien celui de la « raison d’État » : l’exclusion de la citoyenneté sert à faire de l’inclusion une domination (l’esclavage) au nom d’intérêts nationaux et donc des plantations coloniales.
Dans le même numéro de Multitudes, Yann Moulier Boutang publie une fiche de lecture11 de Ghassan Hage, White Nation. Fantasies of White Supremacy12 et de Theodore W. Allen, The Invention of the White Race13. Ces recherches montrent, écrit-il, que le système d’apartheid mis en place dans les colonies britanniques émerge de l’expérience de la colonisation en Europe : il y a un rapport étroit entre la colonisation de l’Irlande catholique et l’asservissement concomitant des Noirs dans les plantations en Virginie. L’oppression est une production et le racisme peut s’imposer tant sur des Blancs – par le truchement de la discrimination religieuse – que sur des Noirs – par le truchement de la couleur : ainsi, « l’apartheid des Blancs contre d’autres Blancs aura duré plus longtemps que le système raciste afrikaner ». L’anomalie irlandaise et celle de l’esclavage, en se télescopant, confirment que le racisme n’est jamais une question de race, mais toujours et seulement d’oppression. Cela permet à l’auteur d’affirmer : « […] partout où apparaît un statut juridique dérogatoire […] attentatoire à la liberté de circuler, au libre accès à l’ensemble des droits de propriété communs, il faut se demander non pas à qui profite le crime (c’est une lapalissade), ni quelle nouvelle ligne de division se creuse (travail purement descriptif), mais quelle nouvelle dynamique de la multitude est visée14 ».
C’est dans cette même perspective qu’un an plus tard, en discutant à propos de la Raison métisse, Yann Moulier Boutang fait état de la crise d’« un » universel pour immédiatement affirmer qu’il y en a un autre, celui justement des Jacobins noirs : un universel qui ne se plie pas à la « ruse de la raison d’État » et qui est donc « l’universel de la liberté », effectivement « inconditionnel et mondial15 ». Dans ce même dossier, Walter Mignolo présente une tout autre approche et qui, au fond, est essentialiste16. Pour lui, la différence coloniale est absolue et atemporelle : elle explique tout, tout le temps et partout17. La pauvreté du Sud trouve ses causes dans la richesse du Nord. Et vice-versa : l’émergence du Sud implique la décadence du Nord. On est en plein dans la dialectique (occidentale) qu’on veut combattre : « son désir est constitutivement le désir du désir du maître18 ». L’horizon est curieusement spenglerien, l’imaginaire décolonial est celui du « crépuscule de l’Ouest, de l’Europe et de la modernité19 ».
La ligne anthropophagique réapparait en 2005. Raphaël Confiant pose la créolité au-delà des « trois idéologies, Blanchitude, Négritude, Indianité », car celles-ci n’ont pas « su (ou pu) penser la nouvelle réalité qui se mettait en place ». Or, dit-il, « la créolité n’est pas une idéologie : c’est une réalité anthropologique et historique20 ». Dans la même direction, en 2006, Antonio Negri et moi-même appréhendions les « hybridations » brésiliennes comme la « fabrique d’un biopouvoir qui […] s’est fondé sur la gestion de la vie (par) la modulation des flux de sang des migrations internes aussi bien qu’externes21 ». Toujours en 2006, la ligne de l’anthropémie est développée dans une Mineure sur Empire et « colonialité » du pouvoir : « La colonialité et la modernité », écrit Grosfoguel, sont la même chose22. Selon Castro-Gomez, l’Empire ne tolère qu’une forme de connaissance, « la rationalité techno-scientifique de l’Occident23 ». En 2009, dans une interview qui fait le bilan du cycle progressiste en Amérique latine, Anibal Quijano estime que la réintégration du régime cubain dans les instances de coopération régionales (Groupe de Rio, Unasur, Mercosur) est le signe d’un « grand changement ». L’apologie du régime cubain se complète par une évaluation générale qui met en avant « (l)es cas de la Bolivie, du Venezuela, de l’Équateur » comme les plus « avancés » du cycle24. Malheureusement ce sont bien ces cas qui se révèleront les plus problématiques.
La ligne de fuite est africaine
La ligne de fuite est dessinée par des dossiers « africains ». En 2017, Abdul-Karim Mustapha et Juan Obarrio écrivent que « (l)a technologie en elle-même est la matrice dans laquelle la vie se développe, la matrice où s’épanouissent les subjectivités, les communautés, les formes de vie et où elles explorent des nouvelles dimensions de l’être, profondément cosmopolites et abstraites, tout aussi bien qu’absolument localisées et concrètes25 ». Achille Mbembe rappelle que « quand on regarde les mythes africains de l’origine, la migration y joue toujours un rôle central26 ».
Dans une Mineure qu’elle organise, en 2019, Elara Bertho écrit que « toute langue est voyage27 ». Interviewé par Julie Peghini, l’écrivain ivoirien Gauz rappelle : « Quand on parle de colonie, on parle d’abord de migration, de mouvement d’hommes et de femmes. Nous sommes foncièrement nomades ». Cela signifie que « l’intérieur des uns est peut–être l’extérieur des autres […]. Ce qui compte […] c’est le mouvement vers une autre culture, un autre territoire28 ». Un an après, le dossier inspiré de la saga du Black Star Line change de perspective : de même que la flottille qui, au début du siècle dernier, voulait transporter les Afro-américains en Afrique, « les diasporas africaines désirent une terre, un territoire ferme où amarrer ». Dans une critique explicite de Gilroy, Nadia Yala Kisukidi affirme ainsi que « l’Atlantique noir […] est truffé de rêves de sédentarité29 ». Mais, dans la même livraison, le dossier « Interzones Sud-américaines » se propose, lui, d’aller au-delà du Sud et du Nord, de penser les « interzones30 ». La ligne éditoriale continue donc dans la richesse de sa sinuosité et de ses oscillations.
Le dehors contre l’immanence
La logique du dehors (le décolonial) complémente celle du négatif, et cela a été bien explicité dès 2003 par Frédéric Neyrat dans sa critique du post-opéraïsme italien : « […] l’immanence est, par définition, investie par une infinité de dehors et le problème du concept d’Empire est qu’il n’en propose aucun : tout est déjà là31 ». Ce sont là les mêmes termes que nous retrouvons dans le pamphlet de Benjamin Noys contre l’affirmationnist theory, c’est-à-dire, le post-opéraïsme autant que la philosophie de la différence : « plus on élimine toute sorte de dehors du capitalisme, moins convaincantes seront les forces révolutionnaires, plus inutile apparait toute subjectivité : le capitalisme fera le travail pour nous32 ». Pour lui, c’est le capitalisme qui est anthropophage.
Sans dehors, l’anticapitalisme idéologique est orphelin et le décolonial lui offre une boussole. Mais c’est celle de l’inimitié schmittienne : le Sud contre le Nord, le « reste » contre l’Occident, les « bons » contre les « méchants ». Mignolo ne craint donc pas d’appuyer la Russie de Poutine et de défendre l’agression de l’Ukraine comme une « dés-occidentalisation » qui serait positive en soi33. Les décoloniaux épousent, même si c’est à l’envers, les thèses du choc des civilisations de Samuel Huntington.
Il n’est plus question des valeurs produites dans les luttes qui traversent les rapports de domination (créolisations, métissages, migrations), mais de la morale et d’une essence « imposée » par le dehors. Or, ce dehors est bien là, et il est fasciste : c’est Poutine et c’est Trump. Les décoloniaux éliminent les nuances et les hybridations et tombent ainsi – peut-être sans le vouloir – dans l’escarcelle des réactionnaires de nouveau type. Et c’est bien pour cela que chez eux, les migrations ne jouent aucun rôle. Il n’y a plus de contradictions qui traversent l’Occident autant que le Sud, mais un conflit entre les deux, comme si c’était deux « blocs » homogènes, comme s’ils avaient une essence. Les décoloniaux essentialisent l’Occident autant que l’Orient et le Sud et ainsi, finissent par appuyer la logique du revanchisme russe et de la guerre.
Or, Lévi-Strauss rappelait aussi « qu’aucune société n’est parfaite ». Dans les pages finales de Tristes Tropiques, il définit l’Islam comme étant « l’Occident de l’Orient34 ». Son relativisme culturel est un perspectivisme, un échange d’échanges de points de vue. Il n’est pas aveugle devant les autres formes de domination, justement parce qu’il évite toute forme d’essentialisation. C’est bien dans cette direction que Jack Goody appréhende la modernité comme « un phénomène commun à l’Orient et à l’Occident35 ». Comme le souligne le philosophe nigérien Olúfémi Táíwò, l’approche décoloniale ignore l’agentivité des colonisés. Táíwò rappelle que, « depuis l’indépendance, les Africains ont été libres de conduire leurs propres politiques ». S’ils n’ont pas choisi des voies démocratiques, ce n’est pas parce que les puissances postcoloniales ne le permettaient pas, la variété des trajectoires le démontre : parti unique socialiste en Lybie, monarchie absolue au Maroc, gouvernements militaires en Afrique centrale, etc.36
Pour conclure, traversons l’Atlantique Sud, et débarquons à Salvador da Bahia, au Brésil. C’est l’état le plus africain du pays, avec 14 millions d’âmes, et il est gouverné – sans interruption – par le Parti des travailleurs de Lula depuis 2006. Or, les différents corps de police y ont tué, en 2023, 1 699 personnes, alors que toutes les polices des États-Unis (340 millions d’habitants) ont tué (toujours en 2023), 1 164 personnes : les polices gouvernées par la gauche anti-impérialiste brésilienne depuis 20 ans d’un petit état y tuent 46 % plus, en termes absolus ( !), et 32 fois plus que « l’Amérique impérialiste ». L’état gouverné par le PT dispose donc des polices les plus violentes du Brésil37. Le décolonial, l’idée que la violence des polices dans l’état de Bahia serait la conséquence d’un dehors impérialiste (les États-Unis) auquel il faudrait opposer un autre dehors (par exemple, dans les mots de Mignolo, la Russie) est fausse. Les migrants qui résistent à la chasse lancée par le gouvernement Trump pour rester en Amérique le savent très bien : les luttes sont internes à l’Empire.
La perspective décoloniale doit éviter ces raccourcis et revenir sur la notion de colonialidad : une oppression héritée du passé colonial, mais qui est interne aux raisons d’État qui sévissent au Nord autant qu’au Sud.
1Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques (1955) in Oeuvres, Pléiade Gallimard, 2008, p. 3.
2Ibid., p. 415. C’est nous qui soulignons. Ce clivage a été utilisé par nous dans Giuseppe Cocco, « Cannibaliser le décolonial ? », Multitudes no 84, 2021, p. 113-121.
3La littérature décoloniale est très vaste. Dans cet article, nous nous concentrons sur celle issue de la notion de colonialidad, et donc sur Anibal Quijano, Henrique Dussel, Walter Mignolo, Rámon Grosfoguel et Boaventura de Sousa Santos.
4Nancy Fraser, Capital Cannibalism, Verso, 2023.
5Olúfémi O. Táíwò, Elite Capture: How the Powerfull Took over Identity Politics, Haymarket Books, 2022.
6Chez Negri, écrit-il, « le communisme n’est-il pas réduit à ce que rien moins que Bill Gates appelle frictionless capitalism ? », Slavoj Zizek, Defence of Lost Causes, Verso, Londres, 2008, p. 352.
7Giorgio Agamben, « La communauté qui vient. Théorie de la singularité quelconque », Futur Antérieur (1990) no 1, p. 5-25.
8« L’empire et la traite des esclaves », Multitudes no 1 (2000), p. 132-143.
9C. L. R. James, Les Jacobins noirs (1938), Éditions Amsterdam, 2009.
10Maurice Merleau-Ponty, « Note sur Machiavel » (1949), Signes, Gallimard, 1960, p. 359.
11Yann Moulier Boutang, « Les couleurs de l’histoire », Multitudes no 1, 2000, p. 212-221.
12Ghassan Hage, White Nation,. Fantasies of White Supremacy, Pluto Press, 1998.
13Theodore W. Allen, The Invention of the White Race, Verso, 1994 et 1997.
14Yann Moulier Boutang, art. cit., p. 216 et 226.
15Yann Moulier Boutang, « Raison métisse », Multitudes no 6 (2001), p. 9.
16Sur l’essentialisme du « décolonial », voir aussi Rodrigo Castro Orellana, « Le côté obscur de la décolonialité », in Collectif, Critique de la raison décoloniale, Traduction de Michaël Faujour et Pierre Madelin, L’échappée, Paris, 2024, p. 71-109.
17Ato Sekyi-Otu, Fanon’s Dialectic of Experience, Cambridge, Harvard, 1996, p. 14-15.
18Yann Moulier Boutang, « Raison Métisse », art. cit., p. 13.
19Walter Mignolo, « Géopolitique de la connaissance, colonialité du pouvoir et différence coloniale », Multitudes no 6 (2001), p. 60.
20Raphaël Confiant, « La créolité contre l’enfermement identitaire », Multitudes no 22, 2005, p. 182 & 183.
21Antonio Negri et Giuseppe Cocco, « Les modulations chromatiques du biopouvoir au Brésil », Multitudes no 23, hiver 2006, p. 54.
22Ramon Grosfoguel, « Les implications des altérités épistémiques dans la redéfinition du capitalisme global », Multitudes no 26, 2006, p. 59.
23Santiago Castro-Gómez, « Le chapitre manquant d’Empire », Multitudes no 26, p. 28.
24Aníbal Quijano, « La revanche des indiens ? », Multitudes no 35 (2009), p. 99.
25Abdul-Karim Mustapha et Juan Obarrio, « Externalités africaines », Multitudes no 69 (2017), p. 161.
26Achille Mbembe « Afrocomputation », Multitudes no 69 (2017), p. 204.
27Elara Bertho, « Déplacements littéraires africains », Multitudes no 76, (2019), p. 175.
28Gauz, « Le français c’est de l’italien mal gaulé », Multitudes no 76, (2019), p. 196-7.
29Nadia Yala Kisukidi, Majeure Kinshasa Star Line, Multitudes no 81 (2020), p. 54.
30Barbara Szaniecki et Giuseppe Cocco, Mineure Interzones sud-américaines, Multitudes no 81, (2020), p. 166.
31Frédéric Neyrat, « La République de la Multitude. Pour en finir avec le concept d’immanence absolue », Multitudes no 13 (2003).
32Benjamin Noys, The Persistence of the Negative, Edinburgh, 2010, p. 7-8.
33Walter Mignolo, « It is a change of era, no longer the era of changes », Postcolonial Politics, 19 janvier 2023. https://postcolonialpolitics.org/it-is-a-change-of-era-no-longer-the-era-of-changes. Pour un aperçu des positions pro-russes des décoloniaux, voir aussi Pierre Madelin, « Des pensées décoloniales à l’épreuve de la guerre en Ukraine », Lundi Matin, 27 février 2023, https://lundi.am/Des-pensees-decoloniales-a-l-epreuve-de-la-guerre-en-Ukraine
34Lévi-Strauss, Tristes tropiques, op. cit. p. 414 et 433.
35Jack Goody, L’Orient en Occident, traduction de Pierre-Antoine Fabre, Seuil, Paris, 1999, p. 290. C’est nous qui soulignons.
36Olúfémi Táíwò, Against Decolonisation. Taking African Agency Seriously, Hurst, 2022, p. 7 et 185.
37Cf. l’interview du chercheur de l’Université Fédérale Fluminense (UFF), Daniel Hirata, par Pedro Vilas-Boas, « Policiais da Bahia matam 46 % mais que os dos Estados Unidos », 18 décembre 2024, UOL, https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2024/12/18/policia-bahia-eua.htm
L’article Décolonial <br>Y a-t-il de bons usages du « décolonial » ? est apparu en premier sur multitudes.
25.09.2025 à 11:21
Démocratie Multitudes et le renouvellement de la pensée démocratique
Laugier Sandra
Démocratie Multitudes et le renouvellement de la pensée démocratique Et si la démocratie n’était pas prioritairement un régime constitutionnel, mais une forme de vie, une pratique de care, une école de désobéissance civile, une demande pour plus de démocratie ? Democracy Multitudes and the Renewal of Democratic Thought What if democracy were not primarily an constitutional regime, but a form of life, a practice of care, a school of civil disobedience, a demand for more democracy?
L’article Démocratie<br> Multitudes et le renouvellement de la pensée démocratique est apparu en premier sur multitudes.
Texte intégral (3591 mots)
2000 : la date marque le début de ce siècle, le démarrage de Multitudes et l’explosion de la pensée démocratique. On oublie parfois que le thème de la démocratie, désormais omniprésent, n’était pas central dans la pensée politique de gauche d’avant 2000 : il n’est développé comme tel ni chez Foucault, ni chez Bourdieu, par exemple. Ainsi 2000 marque l’appropriation par la multitude de la démocratie comme concept, comme revendication et comme pratique.
La démocratie comme multitude globale
La mise en avant de la démocratie et sa transformation est bien le noyau de Multitudes et de ses composantes – « revue politique, artistique et philosophique » non confinée aux institutions ni au monde académique. La revue Multitudes, dès ses premiers numéros, propose une redéfinition radicale de la démocratie, en la concevant non seulement comme un régime institutionnel, mais aussi comme une forme de vie. Inspirée par les traditions philosophiques de Wittgenstein, Emerson, Thoreau ou encore Dewey, la revue s’appuie également sur des approches issues de la sociologie, de l’anthropologie, de la théorie politique critique et sur les compétences des citoyens engagés dans des actions. Elle interroge les formes concrètes de subjectivation démocratique à l’heure d’une crise de la représentation et d’un déplacement de la politique vers de nouveaux espaces collectifs.
En articulant philosophie critique avec mouvements sociaux, arts, écologie et technologies, en mobilisant des courants aussi divers et incompatibles que l’opéraïsme, la pensée décoloniale, le féminisme, l’écologie et le travail du care ; en redéfinissant le politique via le capitalisme cognitif, les formes de vie post-industrielles et les pratiques expérimentales de la démocratie comme les assemblées citoyennes les occupations, la désobéissance civile, les activismes féministes et queer, Multitudes a d’emblée pris et nourri le tournant démocratique contemporain par une méthode radicalement inclusive avant la lettre, intégrant au pouvoir démocratique des acteurs de plus en plus divers : travailleurs, femmes, handis ; mais aussi non-humains : environnement, animaux. Ainsi, la revue explore l’extension de la démocratie aux écosystèmes non humains, notamment à travers des assemblées territoriales pour la terre et les forêts (no 90, 2023) ; une « reforesting democracy » inspirée notamment par les expériences de la COP26 ; le patriarcat (no 79, 2020), la colonialité (no 84, 2021) ; la justice tranformatrice (no 89, 2022).
Toutes ces explorations montrent que la démocratie chez Multitudes est d’abord intersectionnelle et inclusive avant d’être normative et institutionnelle. Elle vise à dépasser les formes traditionnelles de pouvoir et les limites des communautés politiques en intégrant les luttes de genre, raciales, décoloniales, sociales, environnementales (voir Écologie), redéfinissant la démocratie hors des institutions démocratiques.
L’érosion du régime représentatif et l’avènement de pratiques autonomes
S’appuyant d’abord sur Hardt et Negri, la revue explore l’idée d’une « démocratie de la multitude » à l’échelle planétaire, qui se pose en antagonisme face aux mécanismes de l’Empire (géopolitiques, militaires, financiers). Elle revendique un nouveau modèle démocratique global, fondé sur l’émancipation, la coopération et la préservation des différences. Dans Multitudes no 32 (2008) dédié au capitalisme cognitif, la revue montre comment la financiarisation, l’autonomisation du travail et les nouvelles subjectivités (précariat, care, formes de vie post-fordistes) redéfinissent les conflits démocratiques. Ces transformations exigent une démocratie confrontée à la rente mondiale, non uniquement fondée sur l’État-providence.
Dans Multitudes no 32 (2008), consacré au capitalisme cognitif, la revue constate la perte de légitimité du gouvernement représentatif. Le miracle électoral – selon lequel les élus peuvent agir au nom du peuple – s’essouffle, confronté à la méfiance croissante des citoyen·nes. Cette défiance donne lieu à l’essor de pratiques politiques autonomes : mobilisations citoyennes, luttes collectives, occupations de l’espace public, créations de nouvelles institutions. Multitudes interprète ce phénomène non comme une crise, mais comme un approfondissement du désir démocratique : une exigence de participation réelle, continue et horizontale. De ses débuts jusqu’à aujourd’hui en passant par le numéro classique Philosophie politique des multitudes (no 9, 2005) la revue n’a cessé d’explorer les limites et ambivalences de la démocratisation et de son propre élargissement du politique. La Majeure Populismes (2015) trace les limites d’un « populisme de gauche », la Majeure Transparence numérique et démocratie ambivalente (2019) s’interroge sur les tyrannies de la transparence : si la transparence numérique semble renforcer la démocratie, elle peut aussi étouffer l’opacité nécessaire à la pluralité de la vie ordinaire. L’exigence de visibilité totale, via les algorithmes ou la mise en scène des corps, peut écraser les médiations nécessaires à l’autonomie et à l’intimité politique.
La démocratie comme forme de vie
Une autre originalité de Multitudes fut d’articuler ces innovations conceptuelles sur le nouveau modèle démocratique global avec les redéfinitions de la démocratie portées par les citoyens, notamment lors de mobilisations des années 2010. La revue reformule la démocratie non comme un régime figé, mais comme une forme de vie, un usage partagé du langage. Selon Sandra Laugier et Albert Ogien, la démocratie est une enquête expérientielle entre égaux – une intelligence collective à l’œuvre. La démocratie ne se limite pas au vote et aux institutions démocratiques, objets habituels de la pensée libérale de la démocratie. Elle traverse le langage ordinaire, l’apprentissage de la parole et la reconnaissance de chaque voix. Estelle Ferrarese, dans « La critique comme forme de vie démocratique » (no 71, 2018), reprend la notion wittgensteinienne de « forme de vie » pour penser la démocratie au-delà du simple cadre juridique. Être démocrate ne se réduit pas à voter, mais suppose une participation active à un univers partagé de pratiques, de langages, de gestes politiques. Cette démocratie vécue se construit dans la reconnaissance de l’égalité de chaque voix dans la sphère publique. C’est cette logique de co-appartenance à un monde commun qui fonde la légitimité démocratique.
Dans la perspective de Wittgenstein, la démocratie est alors un concept à deux faces. Il nomme, d’un côté, un type de régime politique, fondé sur l’élection, l’alternance, la séparation des pouvoirs et le respect des libertés individuelles ; de l’autre, une forme de vie, c’est-à-dire, un ordre de relations sociales exemplifié par l’organisation des mouvements d’occupation ou de rébellion, dans lesquels le point de vue de chacun·e compte autant que celui de n’importe quel autre, sans trace de domination, de classe, de genre, d’origine ou de compétence. La notion de forme de vie ne peut être pensée hors de cet inextricable complexe épistémique qui lie entre eux jeu de langage, vie ordinaire, accord dans le langage et histoire naturelle des êtres humains.
La revue développe alors une véritable esthétique et politique de l’ordinaire, notamment dans le no 90 (2023) consacré à la démocratie élargie et à l’écologie politique. Le quotidien – les interactions banales, les gestes partagés – est le lieu premier de la démocratie. Revaloriser les expériences, c’est ouvrir un espace de résistance à l’individualisme néolibéral et réinventer le sens du commun. Sandra Laugier, dans « La démocratie comme enquête et comme forme de vie » (no 71, 2018), mobilise la philosophie pragmatiste de John Dewey pour penser la démocratie comme une enquête collective. Il ne s’agit pas d’un système clos, mais d’un processus vivant, où les citoyen·nes sont des enquêteurs·trices qui identifient ensemble des problèmes publics et y répondent. Critique de la raison antidémocratique.
À plusieurs reprises, Multitudes a valorisé la désobéissance civile comme paradigme de la vie démocratique et non comme « frange » de la démocratie : le dissensus et la rupture comme modes politiques nécessaires. Ces formes réinventent le politique hors de la légalité instituée – Multitudes no 24 (2006), au fil d’articles mobilisant les pensées d’Emerson, Thoreau, Cavell enrichies des mouvements environnementaux ou numériques. La désobéissance civile est une composante essentielle de la vie démocratique y compris sous sa forme récente de désobéissance climatique (no 96, 2024 Soulèvements /révolutions). Dans la lutte pour le climat, les mouvements citoyens, les ONG, les associations et les collectifs se mobilisent en recourant fréquemment à cette forme particulière d’action politique qu’est la désobéissance civile. La désobéissance climatique retrouve l’esprit des éthiques du care (voir Care) qui, en attribuant une importance déterminante à l’ordinaire des choses et à leur vulnérabilité, reflètent une nouvelle sensibilité politique. Refuser un ordre injuste, contester une norme, revendiquer le droit de se retirer ou de s’exprimer autrement sont autant de manières de réinvestir le champ politique. La démocratie ne peut s’épanouir qu’en reconnaissant la légitimité du dissensus. Les récentes formes de criminalisation de la désobéissance, en France ou outre-Atlantique, sont de sérieux signaux d’alerte antidémocratique.
Un thème fondamental de la revue est bien la dénonciation de ce qu’elle appelle « la pensée de l’antidémocratie » (no 71 et no 84). Celle-ci repose sur l’idée que le peuple serait incompétent, irrationnel, trop passionné ou immature pour décider de son propre bien. Elle sert à légitimer le pouvoir des experts et des « élites » gouvernantes. Or, pour Multitudes, ces discours masquent un projet d’abus et de confiscation du pouvoir. L’enjeu est de redonner confiance (en soi) aux citoyen·nes dans leur capacité à délibérer et agir.
Démocratiser (par) le revenu universel
Multitudes articule la démocratie et le revenu universel (ou revenu d’existence) en tant que dispositif permettant de redonner à chacun une autonomie matérielle, et de refonder la société sur des bases contributives, collectives et démocratiques. Le revenu universel interroge la distribution actuelle des richesses – fondée sur le mérite, l’égalité ou le hasard.
Le revenu universel apparaît ainsi comme une modalité d’égalité matérielle permettant à chacun·e de bénéficier de ces biens communs (no 86, 2022 – Majeure Votons revenu universel !) et donc, comme une méthode de démocratisation. Cette Majeure historique affronte la question du risque que le revenu universel soit individualiste ou insuffisant à l’émancipation : comment un revenu universel pour être réellement démocratique doit prendre en compte les inégalités de genre. La revue promeut à cette occasion un modèle de société contributive où chacun·e peut participer à la création du bien commun, y compris par des activités non salariées (solidarité, soin, éducation informelle…). Multitudes insiste régulièrement sur les conditions pour que le revenu universel soit véritablement émancipateur, incluant la dimension de genre, l’accessibilité à toutes et tous, sans condition de nationalité, d’âge ni de statut socio-économique – pour éviter les exclusions ou l’uberisation. Le revenu universel est donc pensé à l’échelle européenne, voire globale – accompagné d’une réforme fiscale et du développement d’institutions capables d’articuler les contributions individuelles au bien commun.
Care démocratique
Multitudes a largement contribué à la diffusion et à l’élaboration d’une pensée du care (voir Care) – ou « souci des autres » – en lien avec cette vision renouvelée de la démocratie avec une Majeure (no 37-38, 2009) entièrement consacrée aux Politiques du care, qui explore le care non seulement comme éthique féministe, mais comme politique démocratique ; on y trouve l’interview de Carol Gilligan où elle affirme clairement : « Dans une société et une culture démocratiques, basées sur l’égalité des voix et le débat ouvert, le care est par contre une éthique féministe : une éthique conduisant à une démocratie libérée du patriarcat et des maux qui lui sont associés, le racisme, le sexisme, l’homophobie, et d’autres formes d’intolérance et d’absence de care. Une éthique féministe du care est une voix différente parce que c’est une voix qui articule les normes et les valeurs démocratiques ». Cette Majeure pose les bases de la démocratisation du care et de la reconnaissance institutionnelle et politique de pratiques invisibles. Le no 71 Inventer les formes de vie (2018) en élargit l’espace, en montrant que la démocratie se réalise dans des pratiques quotidiennes et relationnelles ainsi que dans le soin mutuel.
Plus globalement, Multitudes s’inscrit dans une démarche qui cherche à politiser les tâches souvent marginalisées ou invisibilisées, notamment le ménage, le travail reproductif, la gestion de l’environnement ordinaire (Nathalie Blanc). Ces activités, souvent assurées par les femmes ou les minorités racisées, sont affirmées et décrites comme des pratiques fondamentales pour la vie démocratique. Le care est ainsi une dimension structurelle d’une démocratie élargie. Multitudes développe également des pratiques artistiques qui mettent en scène ou expérimentent des formes d’attention, de solidarité ou d’écoute, élaborant au fil des années et dans ses Icônes à une esthétique du care qui alimente une politique du sensible démocratique. Cette attention aux pratiques artistiques dissidentes trouve un prolongement dans la belle Majeure d’Anne Querrien Gouines rouges et viragos vertes (no 42) qui présente les héritières activistes des « Gouines rouges » des années 1970, mêlant performance artistique et action politique démocratique directe.
Une démocratie encore élargie : de la multitude queer aux multitudes racisées et crip, la revue Multitudes a progressivement articulé une réflexion à l’interface de la démocratie radicale, des études décoloniales, handies et queer, en élaborant des croisements théoriques et militants. Elle a eu un apport épistémologique majeur avec le décentrement de la normativité, via les pensées décoloniales et la valorisation des savoirs minoritaires, autochtones, féminins, handicapés (crip ou « estropiés »). Notons que dès le no 12 (2003) la philosophe Beatriz Preciado (désormais Paul Preciado), proposait dans la Majeure Féminismes, queer, multitudes, dans « Notes pour une politique des “anormaux” », une politique queer radicale qui dépassait les catégories sexuelles normées et inventait la « multitude queer » comme sujet. Des contributions plus récentes de la revue prolongent et radicalisent cette pensée queer (Sara Ahmed, Karen Barad, Nick Walker ou Jasbir Puar) en la croisant avec les matériaux, la matière et la sphère nonhumaine, ouvrant la démocratie à des formes de sensibilité alternative ou divergente.
Multitudes fait dans les années 2020 un nouveau pas dans le renouvellement radical de la démocratie en envisageant des formes politiques plurielles décoloniales, rompant avec l’idée d’un modèle démocratique occidental (no 79, 2020 ; no 84, 2021). Le postcolonial, historiquement présent dans la revue, évolue vers une critique du féminisme colonial blanc et de sa fausse universalité (Majeure Lignes décoloniales, coordonné par Elara Bertho et Anne Querrien). Soumaya Mestiri souligne les modalités décoloniales de décentrement qui visent à ébranler les fondements épistémologiques du colonialisme.
Multitudes no 94 (2024) et sa Majeure Justice handie pour des futurs dévalidés, coordonnée par Emma Bigé, introduit la notion de justice handie : un regard critique sur le validisme, l’eugénisme et les normativités qui excluent les corps dits « invalides ». Elle développe des notions comme la réduction des risques (RDRD toxicocrip), les pratiques de pairaidance, l’expertise handicapée, les récits crip et queer qui deviennent des modalités de représentation de soi capables de nourrir une démocratie réelle. Ce numéro 94, à l’intersection de crip, queer, race et décolonial, prolonge, reformule et conteste le processus d’élargissement de la multitude opéré depuis 2000 dans la revue, et prouve remarquablement que la démocratie ne peut se comprendre et se défendre sans inclure les identités minorisées selon ces catégories. Les activismes queer, crip, racisés sont ainsi perçus comme co-constructeurs de formes démocratiques dissidentes. En refusant depuis toujours la norme du « bon corps », Multitudes invite à penser des subjectivités démocratiques hors du cadre biopolitique et éthique mainstream et à inventer des sujets démocratiques au-delà de la citoyenneté normée. La rencontre entre luttes queers et écologiques déplace les questions de justice pour en faire des questions d’entraide et de solidarité, entre humains et au-delà de l’humain (« Care des robots », no 58, « Écoféminismes », no 67).
Aujourd’hui, un peu partout, les institutions démocratiques sont violemment attaquées par des forces qui les vident de leur substance (droite, extrême droite, fascisme, technocratie néolibérale). Au point que certains vont douter de cette priorité donnée par Multitudes à un élargissement démocratique. Mais la meilleure façon de consolider ces institutions démocratiques est de continuer d’inventer des pratiques démocratiques à la hauteur des aspirations contemporaines à l’égalité.
En refusant les visions libérales idéalisées et finalement égoïstes de la social-démocratie, comme les narrations pessimistes et défaitistes sur la fin de la démocratie, Multitudes demande inlassablement PLUS de démocratie. Assumant les conflits qui la traversent, la revue ouvre depuis 2020 la voie à une démocratie du futur fondée sur la critique, l’attention, la pluralité des formes de vie et la puissance d’agir collective. Elle offre un laboratoire théorique et pratique à celles et ceux qui veulent continuer à penser et défendre la démocratie en un temps où elle est particulièrement vulnérable.
L’article Démocratie<br> Multitudes et le renouvellement de la pensée démocratique est apparu en premier sur multitudes.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Lava
- La revue des médias
- Le Grand Continent
- Le Diplo
- Le Nouvel Obs
- Lundi Matin
- Mouais
- Multitudes
- Politis
- Regards
- Smolny
- Socialter
- The Conversation
- UPMagazine
- Usbek & Rica
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- Contretemps
- A Contretemps
- Alter-éditions
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- Philo Mag
- Terrestres
- Vie des Idées
- ARTS
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
- Fiabilité 3/5
- Slate
- Ulyces
- Fiabilité 1/5
- Contre-Attaque
- Issues
- Korii
- Positivr
- Regain