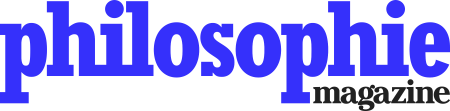12.12.2025 à 17:00
Au Soudan, la guerre oubliée
hschlegel
Depuis deux ans, le Soudan est le théâtre d’une guerre civile d’une rare violence, qui a atteint un nouveau paroxysme avec les massacres dans la ville d’El-Fasher, en octobre. Pourtant, ce conflit très meurtrier mobilise peu l’attention internationale et la diplomatie peine à trouver une issue.
[CTA2]
« L’épicentre de la souffrance humaine dans le monde. » C’est en ces termes que Tom Fletcher, chef des opérations humanitaires de l’ONU, a qualifié ce qui se passe actuellement au Soudan. Si les chiffres précis de la dévastation manquent, puisque ni les membres de l’ONU, ni les ONG, ni les journalistes ne sont autorisés à se rendre sur les terrains d’affrontement, les morts se comptent en dizaines de milliers et les déplacés, en millions.
Khartoum, capitale fantômePourtant, en octobre 2025, lorsque les Forces de soutien rapide (FSR) ont pris le contrôle de la ville d’El-Fasher (Darfour) dans un bain de sang, et que cette attaque a été médiatisée, nous avions presque oublié que le chaos régnait au Soudan depuis plus de deux ans. Au printemps 2023, dans la ville d’El-Geneina, près de 15 000 personnes avaient déjà été tuées en deux semaines par les mêmes milices du général Dogolo, dit « Hemetti », rival du général al-Burhan, le chef des Forces armées soudanaises (FAS), l’armée régulière. Qui s’en souvient ?
“Depuis vingt ans, aucun travail de mémoire n’a été effectué au Soudan, pays déchiqueté par les exactions”
La capitale Khartoum, reprise début 2025 par les hommes d’al-Burhan qui contrôlent le centre et l’est du pays, a également été le théâtre de violents affrontements. Elle semble aujourd’hui vidée de ses habitants. Dans la ville d’El-Fasher, chef-lieu du Darfour (ouest du pays), où environ 200 000 habitants sont restés bloqués pendant les dix-huit mois du siège tout juste terminé, des dizaines de milliers de personnes manquent toujours à l’appel. Soit qu’elles aient été assassinées par les FSR, soient qu’elles errent encore sur les routes montagneuses de cette région aride du pays.
El-Fasher, du siège au bain de sangPour enquêter sur les massacres dans cette ville, il a fallu l’intervention à distance de chercheurs de l’université de Yale, qui ont pu recouper des images satellites avec des vidéos diffusées par les bourreaux sur internet. Ils relatent des faits d’une immense gravité : des civils exécutés à bout portant, des réfugiés fouettés sur la route ou se faisant rouler dessus par des 4x4. À plusieurs endroits, de larges traces rouges visibles depuis le ciel évoquent des exécutions de masse. Ailleurs, des talus laissent craindre que les miliciens ont creusé des fosses communes pour dissimuler leurs actes.
“Nous avons alerté le Conseil de sécurité de l’ONU six fois, mais nous n’avons pas eu de réponse” Nathaniel Raymond, chercheur en laboratoire humanitaire
« L’ampleur et la rapidité avec laquelle ces atrocités ont été commises doivent être comparées avec celles qui ont eu cours au Rwanda », assure Nathaniel Raymond, membre du Humanitarian Research Lab de l’université de Yale, sur CNN. Aucune enquête pour génocide n’a été encore été lancée par les institutions internationales et le terme reste sujet à caution. Mais un nettoyage ethnique, à tout le moins, a bien eu lieu à El-Fasher. « C’était le massacre de masse le plus prévisible qui soit, poursuit l’universitaire sur la chaîne américaine. Nous avions d’ailleurs alerté le Conseil de sécurité de l’ONU six fois, mais nous n’avons pas eu de réponse. »
Ethnicisation du conflitComment qualifier les crimes au Soudan ? S’agit-il d’un génocide ? La nature du conflit rend la question particulièrement ardue. Sur la plan national, deux groupes politiques s’affrontent : une armée régulière et une armée dissidente, dont les hommes sont d’ailleurs issus des rangs de la première – les miliciens Janjawids, essentiellement, qui avaient servi lors du conflit de 2003-2004. Ethniquement, ces deux camps sont arabes. Mais le conflit est en réalité tripartite : FAS et FSR terrorisent également des populations noires, surtout présentes au Darfour, considérées ethniquement comme « inférieures ». Elles font l’objet de persécutions redoublées depuis que des groupes rebelles locaux sont sortis de leur neutralité, fin 2023, et ont pris parti pour les FAS.
L’ONU alerte contre une ethnicisation croissante du conflit, qui vise notamment le peuple Masalit. Dans un communiqué publié en septembre, l’organisation écrit :
“Après la reprise de Wad Madani par les FAS, [nos] services ont reçu des images montrant des soldats soudanais commettant des actes de violence à l’encontre de civils originaires de l’ouest du Soudan. Ces derniers sont qualifiés de wassekh (‘saleté’), afan (‘moisissure’), beheema (‘animal’) et abnaa e-dheif (‘bâtards’). Les éléments des FAS ont fait référence à des nadhafa (‘opérations de nettoyage’) dans ce contexte”
Communiqué de l’ONU, septembre 2025
Côté FSR, le terme de falangai est souvent utilisé pour nommer ces populations noires rurales, « un terme péjoratif désignant les personnes réduites en esclavage ».
Le conflit mêle donc des éléments politiques « classiques », qui ne peuvent être associés au qualificatif de génocide du point de vue du droit, et une composante raciale qui rappelle bien, elle, le génocide de 2004. Dans une tribune publiée sur Le Monde, Jean-Nicolas Armstrong-Dangelser, coordinateur des urgences au Soudan pour Médecins sans frontières, s’alarme :
“Les violences perpétrées au début des années 2000 impliquaient exactement les mêmes acteurs que ceux qui sont à l’œuvre aujourd’hui, même si de nombreuses alliances ont changé. Dans leurs écrits et leurs discours, les acteurs du conflit au Soudan font disparaître l’humanité de communautés entières afin de justifier l’extermination physique et culturelle de ces populations”
Jean-Nicolas Armstrong-Dangelser
Jeux d’alliances étrangèresFace à l’urgence de la situation, que fait la communauté internationale ? Les tractations diplomatiques, qui se sont accélérées depuis le nettoyage ethnique d’El-Fasher, interviennent dans une configuration d’alliances très complexe. Comme l’explique l’émission Le Dessous des cartes, chaque camp reçoit le soutien, plus ou moins dissimulé, d’acteurs étrangers qui se livrent bataille à distance, dans le but de mettre la main sur les richesses naturelles du pays : or, pétrole, manganèse, etc.
Les Émirats arabes unis, en particulier, sont accusés de livrer des armes en quantité aux FSR. L’Arabie saoudite soutient, de son côté, l’armée régulière. La République du Soudan a ainsi porté plainte contre les Émirats arabes unis devant la Cour pénale internationale, pour crime de génocide. Une plainte rejetée par la CPI en mai 2025. Début novembre, une première trêve humanitaire a été accordée par les FSR, après des tractations avec les États-Unis, les Émirats, l’Arabie saoudite et l’Égypte – une médiation connue sous le nom de « Quad ». Mais ce cessez-le-feu a rapidement été rompu. Le 8 décembre, les FSR ont pu prendre le contrôle du champ pétrolier stratégique de Heglig, dans le Kordofan-Occidental, forçant les FAS à se retirer de la zone.
Impuissance ou indifférence ?La temporalité des événements, combinée à leur gravité, ne peut manquer de faire surgir une question sur ce que le responsable de l’ONU Tom Fletcher appelle une « guerre oubliée ». Pourquoi les opinions publiques internationales ont-elles aussi peu manifesté leur réprobation face à ce conflit où des milliers de Soudanais ont perdu la vie dans des conditions d’une rare cruauté – et que des millions ont été forcés de quitter leur domicile et souffrent, entre autres, de malnutrition voire de famine ? Deux grandes hypothèses peuvent être avancées.
“Dans ce conflit, impossible de caler une grille de lecture où il serait possible de dénoncer une puissance envahissante qui aurait des visées sur son voisin”
D’une part, trois conflits aux dimensions internationales ont éclaté à peu près au même moment : la guerre en Ukraine, la guerre entre Israël et le Hamas et la guerre au Soudan. Médiatiquement, les deux premières ont davantage capté l’attention. Les pays occidentaux, peu impliqués dans ce lointain pays de la Corne de l’Afrique, y possèdent moins d’intérêts stratégiques et sont donc moins actifs diplomatiquement, ce qui en retour donne une plus faible caisse de résonance médiatique. Le fait, par exemple, que des armes de confection chinoise aient été livrées par les Émirats arabes unis aux FSR – ce qu’atteste un rapport d’Amnesty International – ne provoque pas la même fureur que lorsque les États-Unis livrent des armes à Israël.
Mais cette composante géopolitique, fondée sur la question des intérêts, n’explique pas tout. La guerre civile au Soudan, qui reprend vingt ans après celle de 2003-2004, intervient dans un monde où les catégories intellectuelles ont quelque peu changé. Cette guerre ressemble à une guerre « traditionnelle » du XXe siècle, mue par des intérêts stratégiques entre des acteurs politiques locaux. Il ne s’agit pas d’une guerre « existentielle », comme le sont les affrontements en Ukraine et au Proche-Orient. Impossible de caler une grille de lecture où il serait possible de dénoncer une puissance envahissante qui aurait des visées sur son voisin. Le Soudan n’est pas en proie à une « guerre impérialiste » et la France, qui se tient plutôt à distance, ne saurait être accusée de s’y impliquer illégitimement.
Les fantômes du génocide de 2004Cette relative indifférence du grand public est d’autant plus visible qu’en 2004, la mobilisation avait été intense et multiforme. On se souvient notamment de l’implication de l’acteur George Clooney, qui avait fait de la guerre au Darfour une cause à l’écho mondial. La coalition « Save Darfur » avait alors réuni plus de cent associations et fait preuve d’un lobbying intense auprès des dirigeants politiques. Rien de tel n’a été instauré depuis deux ans. Malgré les alertes répétées de l’ONU et de Médecins sans frontières, une chape de plomb recouvre cette nouvelle guerre. Quand début 2025, les États-Unis ont assuré qu’un « génocide » était en cours au Soudan, et que des viols systématiques ciblaient les femmes, l’information a peu été reprise et n’a pas éveillé les consciences.
Le fait que le génocide de 2003-2004 n’ait pas encore été jugé ajoute sans doute également au sentiment d’impuissance généralisé. Pas moins de six ex-dirigeants soudanais sont officiellement inculpés par la Cour pénale internationale, mais seulement un seul a pour l’instant été condamné, et très récemment : le 7 octobre 2025, Ali Mohamed Ali Abdelrahman, ancien chef de la milice Janjawid responsable de la mort de 300 000 personnes, a écopé de 20 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Quant au seul dirigeant poursuivi pour génocide, Omar el-Bechir, ancien président soudanais aujourd’hui âgé de 81 ans et chassé du pouvoir en 2019, il est toujours détenu dans une prison militaire et n’est pas près d’être extradé – encore moins jugé.
Double jeu des bourreauxDepuis vingt ans, aucun travail de mémoire n’a été effectué au Soudan, pays à l’instabilité chronique et au tissu social déchiqueté. Au vu du contexte, les bourreaux d’hier sont, à bien des égards, les mêmes qu’aujourd’hui. Dans un article publié dans le numéro Les Génocides oubliés ? de la revue Mémoires en jeu (2020), l’historienne Soko Phay, de l’université Paris 8, souligne l’importance de ce travail de mémoire, pour pacifier les sociétés traumatisées par des atrocités de masse. À propos des massacres de 1965-1966 en Indonésie, elle écrit :
“Les tortionnaires [encore en vie] sont comme atteints d’‘engourdissement psychique’. Ils ont une déconnexion avec leurs propres affects, une absence de sentiment de culpabilité et une perte de contact avec la réalité”
Soko Phay, historienne
Un état mental qui rend possible de nouveaux passages à l’acte violents, si les circonstances l’imposent.
Cette ombre portée du génocide de 2004, les FSR tentent habilement de s’en détacher, pour garder un semblant de crédibilité sur la scène internationale. Cet auomne, ils ont ainsi fait arrêter Abou Loulou, l’un des bourreaux d’El-Fasher qui s’était vanté, dans une vidéo diffusée sur TikTok, d’avoir exécuté plus de 2 000 personnes à lui tout seul. Une manœuvre cynique qui leur permet de continuer d’avancer militairement tout en faisant mine de ne pas vouloir reproduire l’hécatombe du début du siècle.
décembre 202512.12.2025 à 12:00
L’Europe, région la plus rurale du monde ?
hschlegel
D’après les projections de l’ONU, l’Europe est en passe de devenir la partie du monde la plus rurale. Comment le continent qui a inventé la grande ville moderne résiste-t-il, plus que les autres endroits du globe, à l’urbanisation galopante ? Par des mouvements de retour à la campagne, et peut-être aussi en raison d’une forme de mal-être urbain. Analyse.
[CTA2]
24,8% de la population européenne devrait vivre à la campagne en 2050, selon l’ONU. Le chiffre prospectif confirme certes le déclin du poids de la démographie rurale (27,7% en 2010, 30% en 2015 au sein de l’Union européenne). Entre 2014 et 2024, l’Europe a perdu 8 millions d’habitants ruraux (-8,3 %), tandis que les villes en ont gagné 10 millions. Cependant, cette diminution est beaucoup moins rapide que dans la plupart des autres régions du monde. Si bien que, d’ici un quart de siècle, le Vieux Continent – berceau de l’industrialisation et de l’urbanisme moderne – devrait être… la région la plus rurale du monde, devant l’Amérique du Nord (23%) et très au-dessus de la moyenne mondiale (17,2%). Parmi les espaces les moins ruraux en 2050 : l’Asie centrale et du sud (11,9%) ou encore l’Asie du Sud-Est (16,6%), qui compte parmi les régions les plus peuplées au monde.
Au départ, l’effacement du village…À quoi tient cette stabilité de la population rurale en Europe ? On ne saurait l’imputer à la fécondité légèrement supérieure des populations rurales : si les habitants des campagnes font un peu plus d’enfants que les urbains, beaucoup de ces derniers quittent rapidement leurs terres natales pour faire des études et travailler en ville. L’exode rural est globalement terminé, avec le renversement radical et rapide de l’équilibre ville/campagne. Mais les régions rurales continuent à perdre une partie de leur population. Ce déclin amorce un cercle vicieux : moins d’habitants conduit à la disparition de certains services (écoles, cliniques, médecins, etc.), ce qui nourrit le sentiment d’abandon et de frustration – certains parlent de « peine géographique ».
“Le village s’est progressivement effacé. On ne travaille plus dans la commune où l’on vit et les commerces de centre-bourg disparaissent”
Délaissés, les habitants des campagnes doivent souvent faire œuvre de « débrouille rurale », selon l’expression de la chercheuse Fanny Hugues. S’ils peuvent aussi compter sur des formes de « solidarité rurale », cette entraide décline à mesure de la dilution de la vie locale et de l’étiolement des relations de voisinage : « Progressivement, le village s’est effacé en tant que point d’ancrage de la vie rurale. » La place du village est moins un lieu de rencontre et de connaissance de l’autre. La vie rurale s’étale, « élargie avec le développement des mobilités ». On ne travaille plus dans la commune où l’on vit. La consommation s’effectue davantage dans de grandes zones commerciales ; les commerces de centre-bourg disparaissent. Bref, les villages perdent de leur attractivité. Cette baisse d’attractivité accentue, en retour, le flux migratoire des campagnes vers les villes, plus attractives.
…mais une tendance qui s’inverse (lentement)De nombreuses initiatives s’efforcent néanmoins d’inverser la tendance, d’enrayer le cercle vicieux. Certaines politiques publiques tentent de revitaliser les territoires ruraux : développement d’infrastructures, soutien à la vie rurale, aux commerces de proximité, subvention de l’agriculture, aide à l’installation (d’habitants comme de médecins), etc. De nombreuses mairies entendent développer le tourisme ou misent sur l’accueil de réfugiés. Les nouvelles technologies sont également mobilisées comme un instrument permettant de contrebalancer le manque d’infrastructures – la téléconsultation est par exemple un outil précieux dans les déserts médicaux. À côté des politiques publiques, il y a aussi des initiatives citoyennes : créations d’associations, de « tiers lieux » permettant de renforcer le lien social, etc.
“Lassés des rythmes effrénés de la grande ville anonyme, aspirant à un mode de vie plus simple, plus proche de la nature, beaucoup sont en quête d’un retour à la terre”
Bref, les campagnes se réinventent lentement. Si elles perdent des habitants, elles en gagnent aussi, stimulées par ces logiques de revitalisation. Deux flux migratoires principaux impactent positivement la démographie rurale : l’installation de retraités et l’installation de néo-ruraux actifs (souvent entre 30 et 50 ans). Les premiers sont en quête d’un cadre de vie plus paisible pour passer leurs vieux jours. Leur implantation – qui n’est pas un phénomène nouveau – augmente la population locale, mais aussi l’âge moyen (vieillissement) sans augmenter la natalité. La néoruralité est une dynamique plus récente (la notion émerge dans les années 1970, dans le sillage de Mai-68). Les néo-ruraux, dont beaucoup profitent de la possibilité de télétravailler pour changer de cadre sans nécessairement changer d’employeur, recherchent eux aussi de meilleures conditions de vie – des logements plus grands et moins chers, notamment pour accueillir des enfants, moins de stress, plus de sécurité au quotidien, etc. Certains font le choix de la campagne pour mettre en place des projets écologiques tels que des exploitations agricoles bio, de la création d’artisanat, etc. La plupart, lassés des rythmes effrénés de la grande ville anonyme et aspirant à un mode de vie plus simple, plus proche de la nature, sont en quête d’un « retour à la terre » sans connotation réactionnaire (voir Revenir à la terre, l’art de vivre des néoruraux, collectif, 2019). Claire Desmares-Poirrier célèbre cette tendance à l’« exode urbain ». De nombreux penseurs contemporains ont emboîté le pas, du philosophe jardinier Aurélien Berlan (Terre et Liberté) à Gaspard Kœnig (qui a publié Agrophilosophie et parle dans nos pages de sa vie à la campagne) en passant par Léo Coutellec (Devenirs paysans), qui reprennent en un sens le geste radical du célèbre philosophe naturaliste Henry David Thoreau.
Le bonheur est dans le pré ?L’installation de ces néo-ruraux, qui agace parfois les « autochtones », contribue modestement à la revitalisation des villages, augmentant la population active mais aussi, souvent, la natalité. Toutes les régions ne sont pas également concernées par ces migrations « positives ». Certaines sont très attractives (climat doux, moins de pollution, proximité d’une grande ville facilement accessible en transports en commun), d’autres beaucoup moins. Des disparités existent par ailleurs au sein des espaces ruraux : si les villages connaissent, en France notamment, une croissance parfois plus rapide que celle des villes, c’est beaucoup moins le cas des zones de peuplement dispersé ou très dispersé. Mais globalement, si elle reste en baisse, la part de la population rurale tend à se stabiliser en Europe, au contraire de la plupart des autres régions du monde, qui manquent souvent de politiques de dynamisation des espaces ruraux.
Peut-être est-ce aussi que le Vieux Continent, plus que le reste du monde, s’est lassé de la grande ville motorisée qu’elle a vu naître ? Déjà en 1902, le sociologue Georg Simmel soulignait le caractère accablant et étouffant, de l’environnement urbain.
“La base psychologique sur laquelle repose le type des individus habitant la grande ville est l’intensification de la vie nerveuse, qui résulte du changement rapide et ininterrompu des impressions externes et internes. […] Tandis que la grande ville crée justement ces conditions psychologiques – à chaque sortie dans la rue, avec le rythme et la diversité de la vie sociale, professionnelle, économique –, elle établit […] une profonde opposition avec la petite ville et la vie à la campagne, dont le modèle de vie sensible et spirituel a un rythme plus lent, plus habituel et qui s’écoule d’une façon régulière”
Georg Simmel, Les Grandes Villes et la vie de l’esprit (1902)
Pour se protéger de l’hyperstimulation sensorielle, l’urbain « se crée un organe de protection contre le déracinement dont le menacent les courants et les discordances de son milieu extérieur : au lieu de réagir avec sa sensibilité à ce déracinement, il réagit essentiellement, avec l’intellect […] La réaction à ces phénomènes est enfouie dans l’organe psychique le moins sensible, dans celui qui s’écarte le plus des profondeurs de la personnalité ».
Bref, l’urbain, en guise de carapace protectrice, tient à distance sa sensibilité. Mais ce renoncement peut-être une source de souffrance – et il l’est bien souvent. Que faire alors, sinon quitter la ville, quand on ne la supporte plus ?
décembre 202512.12.2025 à 06:00
Se faire de nouveaux amis, mission impossible ? Nous avons relevé le défi lors d'un dîner avec de parfaits inconnus
nfoiry
Pour réussir une première rencontre, faut-il bien présenter ou faire tomber le masque, se livrer ou écouter ? Pour le savoir, notre rédacteur en chef Cédric Enjalbert s’est inscrit sur une plateforme qui organise des dîners entre inconnus. Il s’est donné une règle méthodologique : ne pas parler de lui ! Découvrez comment s'est passée sa soirée dans notre tout nouveau numéro, disponible également chez votre marchand de journaux.
décembre 2025- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview