09.01.2026 à 12:24
Reprendre la politique aux élites : la solidarité radicale contre les privilèges
Olúfémi O. Táíwò
Et si on démontait les lieux de pouvoir au lieu de faire en sorte que d’autres y accèdent ? Dans un article anticipant son livre “Elite Capture”, le philosophe étasunien Olúfémi O. Táíwò appelle à défendre les perspectives situées contre ce qu’il appelle la “déférence épistémique”, qui fragmente le collectif politique et entrave la solidarité.
L’article Reprendre la politique aux élites : la solidarité radicale contre les privilèges est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (10000 mots)
Temps de lecture : 24 minutes
Ce texte est la traduction de l’article d’Olúfẹ́mi O. Táíwò, « Being-in-the-Room Privilege : Elite Capture and Epistemic Deference », paru dans la revue The Philosopher en 2021.
La traduction a été réalisée par Mathias Rollot.
La revue Terrestres et le traducteur remercient l’auteur Olúfẹ́mi O. Táíwò et son agente littéraire Stephanie Steiker de nous avoir permis de traduire cet article.
« J’ai abandonné l’idée d’écrire à ce sujet car je ne crois pas être la bonne personne pour écrire là-dessus – je n’ai aucune idée de ce que c’est que d’être Noir… mais je peux vous envoyer mon brouillon avec mes notes, si vous voulez. »
Un frisson m’a parcouru. C’était pourtant une proposition aussi innocente que compréhensible : ses principes éthiques invitaient Helen, journaliste indépendante, à renoncer à son sujet pour me le laisser. Pourtant, j’ai craint qu’il ne s’agisse aussi d’un piège.
Même en mettant de côté l’erreur faite au sujet des dynamiques en place dans la conversation (je suis certes Noir, mais aussi professeur associé à l’université), il y avait là un problème que j’avais rencontré de nombreuses fois par le passé. Derrière l’hypothèse que je possédais une expérience vécue qu’elle n’avait pas, on pouvait reconnaître la marque d’un horizon épistémologique, politique et culturel aussi controversé que polarisant : l’épistémologie du positionnement (standpoint epistemology)1.
Consulter un dictionnaire ne permet pas vraiment de se faire une idée des controverses autour de cette idée d’épistémologie du positionnement. L’Encyclopédie Internationale de Philosophie se borne à considérer trois affirmations a priori inoffensives :
- Le savoir est socialement situé
- Les personnes marginalisées sont avantagées pour acquérir certains types de savoirs
- Les programmes de recherche devraient refléter ces faits.
Le philosophe Liam Kofi Bright montre bien que ces affirmations peuvent être déduites 1) d’une logique empirique de base, et 2) d’une explication un tant soit peu plausible des manières dont le monde social affecte les savoirs que des groupes de personnes sont susceptibles de chercher et de trouver.
Mais si le problème ne vient pas de l’idée de base, alors d’où vient-il ? Je crois qu’il n’est pas tant lié au concept initial qu’à sa mise en pratique par les normes en vigueur. L’appel à « écouter les plus concerné·es » ou à « remettre au centre les plus marginalisé·es » est très fréquent dans bon nombre de cercles académiques et militants. Je n’ai jamais été à l’aise avec ça. Selon l’expérience que j’en ai, quand les gens disent qu’il est important « d’écouter les plus concerné·es », ce n’est pas parce qu’ils prévoient de faire une visio avec un camp de réfugié·es ou de collaborer avec des sans-abris. Plus souvent, il s’agit plutôt de confier la légitimité de parole et l’attention à celles et ceux qui correspondent le mieux aux catégories sociales associées à ces maux – sans même se préoccuper de savoir ce qu’iels savent réellement, ou ce qu’iels ont personnellement vécu sur le sujet. Dans le cas de ma conversation avec Helen, ma race sociale semble me lier de façon plus « authentique » à une expérience qu’aucun·e de nous deux n’a jamais eue. Selon les règles du jeu telles que les comprenions, elle se sentait obligée de s’en remettre à moi. Ces règles prévalent souvent, même là où les enjeux sont importants – que ce soit au sein d’un groupe de recherche discutant des manières de comprendre un phénomène social ou d’un groupe militant discutant des cibles à viser.
Le piège n’était pas que l’épistémologie du positionnement puisse affecter la conversation, mais comment elle le faisait. De façon générale, lorsqu’on cherche à appliquer concrètement l’épistémologie du positionnement, on s’engage dans des pratiques révérencielles : faire des dons, passer le micro, croire en la parole de l’autre. C’est bienvenu dans de nombreux cas, et les normes sociales qui nous invitent à nous tenir prêt·es à les mettre en œuvre proviennent de motivations admirables : un désir de favoriser la situation sociale des personnes marginalisées, considérées comme sources de savoirs et destinataires légitimes de pratiques respectueuses. Hélas, le fait que de tels égards deviennent la règle de base, l’orientation politique par défaut, peut avoir pour conséquence d’aller à l’encontre des intérêts des groupes marginalisés, tout particulièrement au sein des cercles dominants (elite spaces).
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Certains lieux possèdent une influence et une puissance démesurée : la salle des réunions de crise, la salle du comité de rédaction, la table des négociations, la salle de conférence… (the Situation Room, the newsroom, the bargaining table, the conference room). Être dans ces lieux signifie être en mesure d’affecter les institutions et les dynamiques sociales au sens où on est alors en position de décider de ce qu’il convient de dire et de faire. L’accès à ces lieux est déjà, en soi, une forme d’avantage social, du genre de ceux qu’on ne peut acquérir que grâce à d’autres avantages sociaux préalablement acquis. D’un point de vue sociétal, les personnes les plus « affectées » par les injustices sociales associées aux identités politiques principales (genre, classe, race, nationalité) ont beaucoup plus de probabilités d’être emprisonnées, sous-employées, ou d’être dans les 44 % de la population mondiale sans accès à Internet – et donc d’être mises à l’écart des lieux du pouvoir et tout à fait ignorées par les personnes présentes dans ces lieux. Les individus qui ont le plus de chances de se trouver dans ces lieux sont, au contraire, ceux qui réussissent à passer au travers des différents mécanismes de sélection sociale filtrant les identités sociales associées à ces résultats négatifs. En d’autres termes, ces personnes sont d’autant plus susceptibles de se retrouver dans les lieux du pouvoir qu’elles sont systématiquement différentes (et donc non-représentatif·ves) des gens qu’iels sont ensuite supposées représenter une fois entrés à l’intérieur.
J’avais l’intuition que la proposition d’Helen était un piège. Non pas un piège qu’elle aurait tendu elle-même, mais un piège qui menaçait de nous piéger elle et moi de la même manière. Les normes culturelles – du genre de celles qu’on mobilise quand on introduit une déclaration par « En tant qu’homme noir… » – ont installé un ensemble de pratiques respectueuses de l’épistémologie du positionnement que beaucoup d’entre nous connaissent par cœur, consciemment ou inconsciemment. Mais voilà : les formes de révérence sociale qui en découlent finissent souvent par devenir contreproductives, et ne servir efficacement que la capture du pouvoir par les élites2, à savoir le contrôle des programmes politiques et des ressources par le groupe le plus avantagé. Si l’objectif était d’utiliser l’épistémologie du positionnement pour remettre en cause les configurations de pouvoir injustes, difficile de faire pire.
➤ Lire aussi | Nous danserons avec les montagnes・Báyò Akómoláfé (2024)
Pour expliquer ce qui ne va pas avec l’habituelle façon révérencielle (deferential) de mettre en œuvre l’épistémologie du positionnement, nous devons commencer par voir ce qui la rend si populaire. Commençons par évoquer les postures les plus cyniques : certain·es chez les plus avantagé·es d’un point de vue social, ne pas veulent pas réellement de changement social réel – iels n’en désirent que l’apparence. Par ailleurs, la révérence (deference) à l’égard des personnes liées aux communautés opprimées peut n’être qu’une performance qui édulcore, s’excuse, ou encore détourne du fait que la personne à qui est faite cette politesse a finalement déjà le privilège de se tenir dans les lieux où se prennent les décisions, et que le changement de perspective qu’elle suggère sera entendu.
Quoique j’ai l’intuition qu’il y a bien quelques vérités dans tout ça, je reste malgré tout insatisfait. La plupart des gens qui soutiennent et mettent en pratique ce genre de politesses sociales (deferential norms) ressemblent à Helen : bien intentionnés, mais confiants à l’idée que les personnes avec qui iels partagent ces lieux du pouvoir peuvent les aider à trouver l’expression qui convient à leurs engagements moraux communs. Pour expliquer le phénomène, il n’est même pas nécessaire de croire que la plupart de celles et ceux qui interprètent l’épistémologie du positionnement de la sorte sont de mauvaise foi, et on ne voit d’ailleurs même pas bien en quoi cela pourrait aider de croire cela. Les mauvais « colocataires » peuplant les lieux du pouvoir ne sont pas le problème, de la même façon que l’hypothèse selon laquelle Helen puisse être une bonne colocataire n’était pas la solution. Le problème vient de la manière dont ces lieux du pouvoir sont construits et gérés.
Pour en revenir à mon exemple initial avec Helen, la problématique n’était pas simplement que je n’ai pas grandi dans le milieu populaire et opprimé qu’elle imaginait. Épistémologiquement parlant, la situation était bien pire que ça. Bon nombre des faits sociaux qui ont rendu ma vie différente de celle des gens auxquels elle pensait sont justement les raisons pour lesquelles on me propose aujourd’hui des choses en leur nom. Si j’avais grandi dans un tel milieu, nous n’aurions probablement jamais été au téléphone ensemble, Helen et moi.

À bien des égards, notre système social repose sur un ensemble de mécanismes filtrants, qui déterminent quelles interactions peuvent avoir lieu, entre qui et qui, et donc, en définitive, quelles structures sociales les gens sont en mesure d’observer ou non. Durant la majeure partie du 20e siècle, le système de quota d’immigration des États-Unis a rendu accessible presque exclusivement aux Européens l’immigration légale et le chemin vers la citoyenneté (ce qui a valu au pays d’être considéré par Hitler comme le « leader incontesté dans l’élaboration de politiques explicitement racistes en matière de nationalité et d’immigration »3). Avant que le 1965 Immigration and Nationality Act n’ouvre de nouvelles possibilités migratoires pour les « travailleur·ses qualifié·es ».
Que mes parents aient pu intégrer cette catégorie des travailleur·ses qualifié·es explique aussi bien leur entrée sur le territoire américain que les avantages de classe et les ressources financières (notamment la richesse) dont j’ai bénéficié depuis toujours. Cette situation n’a rien d’inhabituel : la communauté immigrée nigériane-américaine est une de celles qui a le mieux réussi (ce que personne ne dit, bien sûr, c’est que les quelques 112 000 Nigérian·nes-Américain·es diplômé·es ne représentent que bien peu par rapport aux 82 millions de Nigérian·nes qui vivent avec moins d’un dollar par jour, ni comment le premier fait recoupe le second). La sélectivité des lois en matière d’immigration explique bien les taux de réussite scolaire de la communauté nigériane de la diaspora qui m’a élevé ; ce qui explique à son tour comment j’ai pu intégrer les plus prestigieuses classes du lycée ; ce qui aide à son tour à comprendre comment j’ai pu poursuivre avec des études supérieures ; etc.
Les faits qui font que telle personne atterrit dans telle pièce construisent notre monde bien plus puissamment que les combats de coq qui ont lieu à l’intérieur de ces pièces.
Ainsi, il est assez facile de voir comment cette manière très particulière d’appliquer l’épistémologie du positionnement contribue à favoriser la capture du pouvoir par les élites. L’accès aux salles du pouvoir, aux lieux influents (rooms of power and influence), est conditionné par une longue série de sélections sociales en chaîne. Plus votre niveau social est élevé, et plus vos expériences sociales se réduisent – certains sont directement acheminés vers les doctorats, et d’autres vers les prisons. S’engager dans les questions d’identité par le biais de politesses épistémologiques, c’est risquer de reproduire les déformations produites par ces processus de sélection sociale.
Cela étant dit, il est aussi assez facile de voir, à plus petite échelle – dans une pièce, dans un champ ou dans un pan de la littérature scientifique, dans une conversation –, pourquoi ces pratiques révérencielles peuvent paraître sensées. C’est souvent un moindre mal au regard des épistémologies qui les ont précédées : la personne traitée avec déférence peut en effet être un peu mieux positionnée, épistémologiquement parlant, que les autres personnes présentes dans la pièce (the room). Ça peut aussi être ce que nous avons à faire de mieux tant que les pièces elles-mêmes ne sont pas remises en cause – quel pouvoir on y trouve, qui y est admis, etc.
Mais n’est-ce pas la dernière chose que nous devrions espérer voir changer ? Faire mieux que les normes épistémologiques que nous a légué une histoire fondée sur un genre d’apartheid explicite global, voilà un objectif affreusement bas. Les faits qui font que telle personne atterrit dans telle pièce construisent notre monde bien plus puissamment que les combats de coq qui ont lieu à l’intérieur de ces pièces. Et quand on en vient à débattre de justice sociale, les mécanismes sociaux qui déterminent la position de chacun sont précisément les fragments de la société que nous cherchons à confronter. Par exemple, le fait que les personnes emprisonnées ne peuvent pas participer aux discussions académiques sur la liberté qui se tiennent sur les campus universitaires est intimement lié au fait qu’elles sont en cellule.
Les discussions en matière de justice semblent aujourd’hui façonnées par des gens plus préoccupés par la répartition de l’attention et des discours.
La politesse épistémologique se positionne comme une solution à un double problème à la fois politique et épistémique. Hélas, non seulement cela ne permet pas de résoudre ces problèmes, mais cela en ajoute de nouveaux. On pourrait penser que les questions de justice devraient être avant tout dirigées vers la résolution des disparités en matière d’accès à la santé, de conditions de travail, ou de sécurité. Mais voilà : les discussions en matière de justice semblent aujourd’hui façonnées par des gens plus préoccupés par la répartition de l’attention et des discours. Les pratiques révérencielles qui ne se placent qu’au service de la question de l’attention (du genre « nous avons lu trop d’hommes blancs, maintenant il faut lire ce qu’écrivent les gens de couleur ») peuvent échouer sur le terrain de leurs propres termes : recentrer l’attention sur les orateur·ices issus des groupes marginalisés peut, par exemple, décentrer l’attention de la nécessité de changer le système social qui les marginalise.
Les élites issues des groupes sociaux marginalisés peuvent bénéficier de ce processus de bien des manières, et ce n’est pas forcément un mal pour le progrès social. Mais il faudrait vraiment être très naïf·ve pour croire que les intérêts des élites sont nécessairement – ou même supposément – alignés avec ceux de la population dans son ensemble. Considérer de la sorte les intérêts des élites, c’est faire preuve d’un genre de Reaganomics racial – une stratégie qui repose sur le fantasme d’un dialogue entre économie de l’attention et économie réelle.
Peut-être que les quelques personnes payées pour décrire le carnage permanent dans lequel nous nous trouvons, et ce, de la manière la plus authentique – culturellement parlant – et la plus radicale – cosmétiquement parlant – sont réellement en train d’emporter une victoire culturelle. Et peut-être que lorsque nous, les bavards, nous aurons gagné l’attention et l’influence que nous méritons, et que nous aurons mis la main sur le butin, son contenu ruissellera magiquement sur les travailleur·ses qui nettoient la salle après nos conférences, sur les bidonvilles des mégalopoles des Sud globaux, et même jusque dans les campagnes.
Ou peut-être pas.
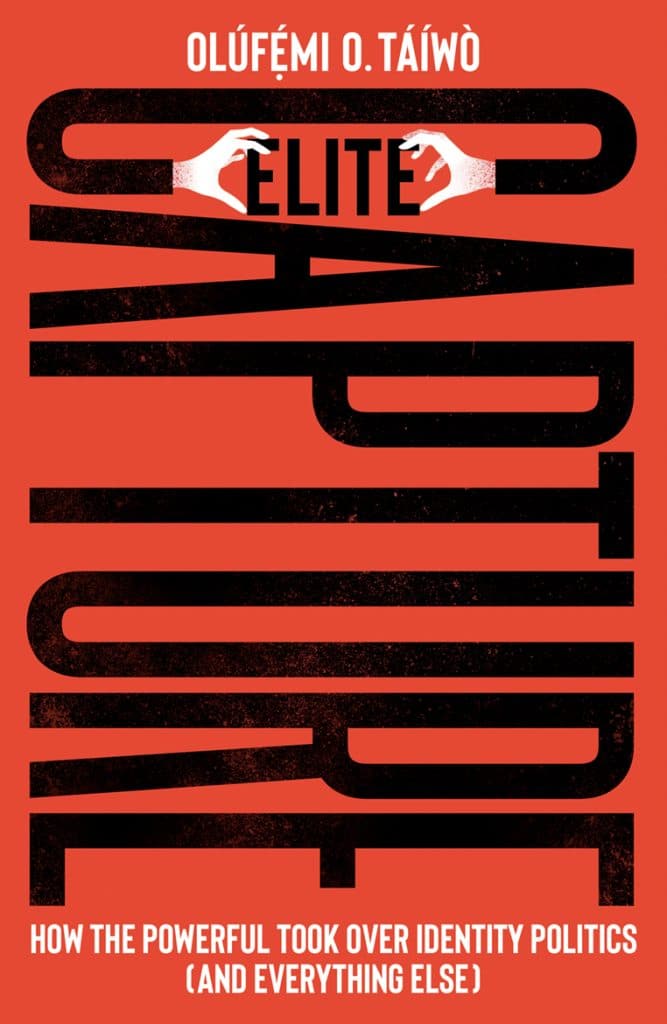
Pour pouvoir évaluer de façon plus complète et plus juste l’enjeu posé par ces façons révérencieuses de pratiquer l’épistémologie du positionnement, il faudrait aller au-delà des arguments de principe et affronter les attraits émotionnels d’une telle approche. Celles et ceux qui se tiennent dans les lieux du pouvoir ont beau faire partie de l’« élite », ça ne dit rien des manières dont on les y traite. Après tout, qu’une personne soit privilégiée, au sens strict du terme – c’est-à-dire qu’elle fait partie de la moitié de la population mondiale ayant un accès garanti aux besoins fondamentaux – n’empêche pas qu’elle puisse être constamment en position d’infériorité dans les rapports de force qu’elle vit au quotidien. La politesse épistémologique est une réponse à des expériences réelles et pesantes – celles du mépris, de l’ignorance, de l’exclusion. Elle s’avère donc tout particulièrement attirante pour les membres des groupes marginalisés ou stigmatisés, en ce qu’elle intervient directement sur les pratiques moralement fondamentales que sont l’attention et le respect.
Les dynamiques sociales dont nous faisons l’expérience ont un rôle énorme dans le développement et la redéfinition de notre subjectivité politique, autant que dans la perception que nous avons de nous-mêmes. Mais la force de l’épistémologie du positionnement – sa reconnaissance de l’importance de cette mise en situation des discours – devient sa fragilité lorsqu’elle n’est mise en œuvre qu’au moyen de pratiques révérencieuses. Mettre l’accent sur la manière dont nous sommes marginalisé·es conduit souvent à voir le monde de la façon dont nous en avons fait l’expérience. Cependant, si on adopte une perspective plus structurelle, il est peut-être plus intéressant pour comprendre le monde et la place que nous y occupons de s’attarder sur les lieux où nous n’avons jamais eu besoin d’entrer (et de considérer les raisons qui expliquent pourquoi nous pouvons éviter d’y entrer). Si cela est vrai, alors toute pratique révérencieuse de l’épistémologie du positionnement empêche, en fait, tout « centrage » sur les plus marginalisé·es, voire même rend leur discours inaudible. Cela nous amène à ne nous concentrer que sur les interactions se déroulant dans les lieux que nous occupons, au détriment de celles dont nous ne faisons pas habituellement l’expérience. En plus du fait que parler au nom des autres est potentiellement problématique (en particulier quand iels ne sont pas là pour parler elleux-mêmes de leurs propres situations), s’intéresser uniquement à la question de savoir qui est dans la pièce permet d’éviter de remettre en cause la centralité de notre propre souffrance – et de la souffrance des personnes marginalisées qui parviennent à entrer dans les lieux du pouvoir avec nous.
Celles et ceux qui se tiennent dans les lieux du pouvoir ont beau faire partie de l’« élite », ça ne dit rien des manières dont on les y traite.
Ces politiques révérencieuses posent donc tout autant de problèmes que le fait d’être tenu à l’écart des lieux les plus importants du pouvoir. Or, chez celleux envers qui on fait preuve de déférence, cela peut ne faire qu’amplifier les normes et stéréotypes dont souffre la communauté marginalisée en question. Dans son ouvrage Le Conflit n’est pas une agression, Sarah Schulman écrit que, bien qu’ils aient des origines et des conséquences morales très différentes, les effets psychologiques nés du traumatisme et ceux nés du sentiment de supériorité entraînent pourtant des comportements similaires chez les personnes. Cela peut notamment conduire à déformer les enjeux d’un conflit (souvent en exagérant les dommages), ou bien à considérer l’indépendance de l’autre comme une menace (par exemple en échouant à se concentrer sur les bonnes problématiques ou les bonnes personnes). Peu importe leur origine : ce genre de comportements a des effets néfastes à la fois pour les individus qui les adoptent et pour les communautés qui les incluent — particulièrement quand ces dernières favorisent et valorisent ces comportements au lieu de les limiter ou de les digérer.
➤ Lire aussi | À mes ami·es blanc·ches・Báyò Akómoláfé (2022)
Concernant celleux qui s’inclinent, cette pratique révérencielle peut aussi avoir pour effet de favoriser la lâcheté morale. En effet, cette stratégie fournit une couverture sociale bien utile pour se délester de toute forme de responsabilité personnelle : il suffit de reporter sur d’autres héro·ïnes individuel·les, sur une classe héroïsée, ou encore sur un passé mythifié, le travail qui est le nôtre et que nous devrions accomplir aujourd’hui. La perspective des personnes sur qui cette charge est reportée a beau être plus claire sur un point ou un autre, leur point de vue général n’est pas moins subjectif et socialement déterminé que le nôtre. Plus important encore, la politesse épistémologique déplace la responsabilité qui nous incombe, pour la déposer sur d’autres que nous – et, en plus, le plus souvent, sur une version caricaturale, hyper-aspetisée et totalement fictives d’elleux.
Ce faisant, ces mêmes tactiques révérencielles ne nous isolent pas seulement de la critique, mais aussi de la possibilité de nous relier à d’autres et d’évoluer. Elles nous empêchent de nous engager authentiquement, avec une empathie réelle, dans les luttes des autres – ce qui est tout de même la condition préalable à toute forme d’alliance politique. À mesure que les questions d’identité et que les dissensus se précisent, il apparaît que les « coalitions politiques » (au sens des luttes collectives par-delà nos différences) ne sont juste que des pratiques politiques tout court. C’est pourquoi la politesse épistémologique, au même titre que l’atomisation des groupes politiques qu’elle génère, est en fin de compte parfaitement anti-politique.
Remplacer l’interdépendance par la révérence peut bien faciliter les choses sur le moment. Mais le coût global de ce court-termisme est élevé, au sens où on risque alors de saper les objectifs de l’épistémologie du positionnement, et de s’engager dans une direction politique défavorable à quiconque se bat pour la liberté plutôt que pour les privilèges, et pour la libération collective plutôt que pour des guerres de chapelle.

En quoi est-ce qu’une approche constructive (constructive approach4) de l’épistémologie du positionnement diffèrerait fondamentalement de cette approche révérencielle ? Une approche pragmatique se concentrerait sur la poursuite d’un objectif ou d’un résultat particulier, plutôt que seulement adhérer à des principes moraux ou d’éviter à tout prix la « complicité » dans l’injustice. Elle se préoccuperait surtout de la construction des institutions et s’attacherait à cultiver les pratiques de collecte partagée d’informations, plutôt que de juste vouloir « aider ». Elle se concentrerait sur la responsabilité plutôt que sur la conformité. Elle mettrait son énergie sur la question de la distribution sociale des ressources et du pouvoir, plutôt que de s’attarder sur des objectifs intermédiaires et d’aboutir à des tactiques de valorisation symboliques sans conséquences. Elle se concentrerait sur les manières dont sont construits les lieux du pouvoir, et non sur la régulation des flux de personnes à l’intérieur de ces lieux. Elle s’engagerait dans un projet de construction sociale, visant à déconstruire et reconstruire les structures sociales actuelles, les mouvements sociaux et leurs interconnections, plutôt que de se contenter de critiquer les systèmes sociaux en place.
La crise de l’eau à Flint, dans le Michigan, permet de comprendre tant les possibilités que les limites d’une telle réorientation de nos manières de faire. Le Michigan’s Department of Environmental Quality (MDEQ), une agence gouvernementale de santé environnementale chargée d’aider les communautés, avec à sa disposition une équipe d’une cinquantaine de scientifiques expérimentés, s’est rendu complice de dissimulation de l’ampleur et de la gravité d’un scandale sanitaire arrivé entre 2014, début de la crise, et 2015, date à laquelle il a attiré l’attention à échelle nationale.
➤ Lire aussi | Freedom farmers, la résistance agriculturelle noire aux États-Unis・Flaminia Paddeu, Monica M. White (2025)
Le MDEQ, autorité épistémologique et politique, a défendu le statut quo à Flint. L’agence a affirmé que « l’eau de Flint est propre à la consommation ». Elle a été citée par le Maire de Flint, Dayne Walling, dans ses déclarations d’avril 2014 « contre les affabulations et pour rétablir la vérité au sujet de la rivière Flint ». Il s’agissait alors d’engager la transition vers un captage de l’eau potable dans la rivière. Une transition orchestrée par le responsable des urgences municipales Darnell Earley – qui est Afro-Américain, tout comme bon nombre des habitant·es de la ville qu’il a contribué à empoisonner. En juillet 2014, l’American Civil Liberties Union (ACLU) rendit publique une note interne produite par l’agence fédérale Environmental Protection Agency (EPA) exprimant son inquiétude quant aux taux de plomb dans l’eau en question. En réponse, le MDEQ rédigea un rapport bidon, dans lesquels les niveaux de plomb restaient conformes aux normes en vigueur. Il avait juste mystérieusement omis de compter deux échantillons contaminés.
La réaction des habitant·es ne se fit pas attendre. Dans le mois qui suivit la transition d’une station de captage à l’autre, les riverains signalèrent bien à quel point l’eau de leur robinet avait une couleur étrange et dégageait une odeur inquiétante. Les habitant·es n’avaient pas besoin que l’oppression dont iels faisaient l’objet soit « célébrée », que l’attention soit « centrée » sur elleux, ou que tout ça soit retranscrit dans la langue de l’académisme en vigueur. Les habitant·es n’avaient pas besoin que les autres comprennent ce que ça fait que d’être empoisonné. Ce dont les habitant·es avaient besoin, c’était d’une eau sans plomb. Alors iels se mirent au travail.
Premièrement, il leur fallait pouvoir répondre avec la même autorité épistémologique. Pour cela, les habitant·es s’engagèrent donc dans la construction d’un nouveau lieu de pouvoir : une pièce où habitant·es et activistes pourraient se retrouver et collaborer avec les laboratoires scientifiques ayant les capacités de prouver que le rapport du MDEQ était bidon. La mobilisation organisée par les communautés habitantes de Flint permit de rallier des scientifiques bien établis à leur cause, et déboucha sur une campagne de « sciences participatives » via la distribution de kits de mesure citoyens, ce qui participa à visibiliser plus encore l’urgence et la gravité de la situation sanitaire. L’empoisonnement des enfants de Flint devint un scandale national. L’alliance entre habitant·es et scientifiques l’emporta.
Les habitant·es n’avaient pas besoin que les autres comprennent ce que ça fait que d’être empoisonné. Ce dont les habitant·es avaient besoin, c’était d’une eau sans plomb.
Mais ce n’était pas suffisant. La deuxième étape – retrouver une eau saine – nécessitait plus qu’une reconnaissance de la situation : il fallait désormais des ressources et des heures de travail, pour réparer le réseau hydraulique et répondre aux inquiétudes sanitaires toujours présentes. Au départ, les habitant·es de Flint ne reçurent que des moqueries et des fadaises de la part de l’élite en place (dont certaines émises par le Président des États-Unis lui-même, et ce bien qu’il partage la même identité raciale que beaucoup d’entre elleux). Mais à la suite de l’activisme acharné des habitant·es de la ville, et à mesure que grandissait la liste de leurs allié·es, quelques victoires fut arrachées : les canalisations problématiques furent finalement remplacées une à une, et l’État du Michigan a été obligé de verser plus de 600 millions de dollars de dédommagement aux familles concernées.

Ce résultat n’est en aucun cas une victoire totale : non seulement il faut en déduire les frais de justice engagés dans cette affaire, mais surtout ce dédommagement financier ne saurait annuler à lui seul les dommages subis par les habitant·es. Une épistémologie constructive ne peut garantir de victoire totale face à un système oppresseur. Aucun horizon épistémologique ne peut, de lui-même, défaire les asymétries de pouvoir à l’œuvre entre un peuple et l’impérialisme d’un système social. Mais il peut aider à rééquilibrer un peu les forces en présence – sans même qu’on ait à faire appel à une quelconque politesse épistémologique.
La justice sociale et les économies de l’information ne sont pas menacées par un manque de jargon qui permettrait de décrire plus précisément ou radicalement les afflictions épistémologiques, attentionnelles ou interpersonnelles des sans-pouvoirs.
Ce qui menace la justice sociale, c’est l’érosion des bases pratiques et matérielles permettant l’émergence de contrepouvoirs populaires face aux systèmes de production et de distribution du savoir en place – en particulier si ces bases populaires peuvent favoriser une action politique efficace, et limiter ou éliminer la prédation par les élites. Rien n’arrête pour l’heure la mainmise sur ces bases populaire et leur corruption par les élites bien placées, en particulier les entreprises de la tech, et on n’assiste à aucune remise en cause : ni de l’influence exercée par l’entreprenariat sur les journaux d’information locaux, ni de la destruction et du pillage de la profession de journaliste, ni des collusions entre les grandes entreprises et les politiques à des points clés du système démocratique, ni de la prédominance d’une production de savoir universitaire favorisant les intérêts des élites, pas plus que de la diffusion par les médias traditionnels des résultats de ces processus très orientés.
Confronter ces menaces nécessite d’abandonner certains des lieux de pouvoir en place. Et d’en construire de nouveaux.
Ce qui menace la justice sociale, c’est l’érosion des bases pratiques et matérielles permettant l’émergence de contrepouvoirs populaires face aux systèmes de production et de distribution du savoir en place.
Approcher l’épistémologie du positionnement de façon constructive est exigeant. Il faut nager à contre-courant : réfléchir de façon responsable avec celles et ceux qui ne sont pas encore dans la pièce avec nous ; construire de nouveaux lieux de rencontre au sein desquels nous pourrions nous retrouver, plutôt que de juste nous déplacer au sein des lieux de pouvoir que l’histoire nous a légué. Mais après tout, c’est probablement normal dès lors qu’il s’agit de politiques de la connaissance : la philosophe Sandra Harding a bien montré en quoi l’épistémologie du positionnement, lorsqu’elle est pleinement considérée, requiert non pas moins mais davantage de rigueur des sciences et des processus de production de la connaissance en général.
Mais voilà : un sujet important reste encore en suspens. L’approche révérencielle de l’épistémologie du positionnement est souvent inséparable d’une préoccupation et d’une reconnaissance de l’importance de l’expérience vécue. Dont, tout particulièrement, les expériences traumatiques.
À ce point de l’argumentation, je dois reconnaître manquer de distanciation et de capacité à rationaliser froidement le sujet. L’essence de ce que j’ai à dire ici tient plus de la conviction que de l’hypothèse scientifique. Heureusement, la vie des idées m’a appris au fil des années que nous n’avons pas moins à apprendre de nos convictions, quoiqu’elles se posent et se travaillent différemment. Je poursuis donc.
Je prends très au sérieux la question du traumatisme. J’ai grandi aux États-Unis, une nation fondée sur un colonialisme de peuplement, l’esclavage, le racisme et leurs conséquences respectives. Tout le monde a son lot de traumatismes historiques et collectifs ici. J’ai aussi grandi au sein de la diaspora Nigériane, une communauté vivant avec des souvenirs brûlants de génocide. Tant au niveau national qu’au niveau communautaire, bon nombre de traits de caractères, de personnalité, d’habitudes et de comportements que j’observe me semblent liés à ces histoires traumatiques. À l’échelle individuelle, j’ai pu craindre pour ma vie ou pour ma dignité, ressentir douleurs intenses et humiliation ; et je me suis vu changer en fonction de ces sentiments. Je repense souvent à ces souvenirs traumatisants. Mais je ne me dis que très rarement : « ça m’a appris quelque chose ».

Ces expériences peuvent être, si on est vraiment chanceux·ses, des éléments fondateurs de notre vie. Ce qui en sort dépend de la manière dont ces éléments s’agencent les uns avec les autres – ce que la théorie du positionnement nomme « thèse de l’accomplissement » (achievement thesis). Briana Toole met bien en lumière en quoi notre situation sociale ne nous place qu’en position de savoir quelque chose. Mais pour ce qui est du « privilège épistémique », de l’avantage, il ne peut être obtenu que par le biais d’une lutte concertée, délibérée, menée depuis cette position.
Je concède bien volontiers que l’expérience de l’oppression peut conduire à cela : je n’ai aucun doute sur le fait que l’humiliation, la privation et la souffrance peuvent construire les individus (en particulier lorsque le contexte est favorable aux luttes volontaires et structurées vers la conscientisation (consciousness raising) dont parle Toole). Mais ces mêmes expériences peuvent aussi s’avérer destructrices. Lequel de ces deux effets a le plus de chance d’advenir ? Pour ma part, je parierais plutôt sur le second. Comme l’a justement noté Agnes Callard, le traumatisme – et même la colère légitime et méritée qui l’accompagne souvent – peut corrompre autant qu’il peut ennoblir. Peut-être même davantage.
Quoiqu’en dise le proverbe, qu’elle soit ou non le fruit de l’oppression, la souffrance n’est pas un bon professeur. La souffrance est partiale : elle ne voit pas bien loin et reste tournée sur elle-même. On ne devrait pas fonder nos relations sociales sur d’autres attentes que cela là : l’oppression, ce n’est pas une classe prépa.
Le traumatisme – et même la colère légitime et méritée qui l’accompagne souvent – peut corrompre autant qu’il peut ennoblir. Peut-être même davantage.
Au bout du compte, ce que je crois le plus profondément au sujet de l’épistémologie du positionnement, c’est que cela demande au traumatisme quelque chose que le traumatisme ne peut offrir. Oui, l’approche constructive est exigeante. Mais la pratique de la révérence épistémologique l’est bien plus encore, tout en s’avérant aussi être bien plus injuste : elle demande aux traumatisé·es de porter sur leurs seules épaules ce que nous devrions toutes et tous travailler collectivement. Quand je pense à mon propre traumatisme, il ne me vient pas de grandes leçons de vie. Je pense plutôt à la noblesse, bien silencieuse, de la simple survie. Le fait même que ces chapitres n’aient pas été les derniers de ma vie est déjà, en soi, bien assez puissant. Je suis toujours là pour me rappeler de ces histoires, et c’est déjà pas mal.
La politesse épistémologique nous demande d’être moins que ce que nous sommes véritablement et ce, sans même que ce soit dans notre propre intérêt. Comme Nick Estes a pu le montrer dans le contexte de pratiques politiques autochtones : « qu’on parle de racisme, de citoyenneté autochtone ou d’appartenance, la fourberie des politiques actuelles en matière de traumatisme est de transformer les personnes et les luttes en question de préjudice. Elles ramènent des peuples entiers à leurs traumatismes plutôt au détriment de leurs aspirations, ou même de leur simple humanité »5. Un processus qui n’est jamais en faveur des peuples autochtones, mais destiné aux « audiences blanches et aux institutions du pouvoir ».
Je pense aussi à la prise de conscience de James Baldwin réalisant que les choses qui l’ont le plus tourmenté dans sa vie étaient « les choses qui [le] connectaient avec toustes celleux qui sont vivant·es, qui ont été vivant·es »6. Le fait que j’ai survécu à différents types d’abus et que j’ai frôlé la mort à la fois à la suite d’un accident et de violence subies (même si ces expériences diffèrent entre elles comme elles diffèrent de celles vécues par les personnes autour de moi) n’est pas une carte que je peux jouer en société, ni une arme à manier pour gagner quelques points de prestige social. Ça ne me donne aucun droit particulier pour parler, évaluer, ou décider au nom d’un groupe ou d’un autre. C’est une manifestation concrète, une expérience de la vulnérabilité qui me rapproche plutôt d’une grande partie de l’humanité. Ce n’est pas quelque chose qui s’érige entre les autres et moi comme un mur : c’est un pont qui nous relie.
Après une longue discussion, j’ai finalement répondu à l’offre d’Helen par cette proposition : et si on écrivait quelque chose ensemble ?
Note du traducteur
J’ai découvert ce texte dans Radical Futurisms, de T. J. Demos (Steinberg Press, 2023), riche ouvrage dont les pages 211-212 synthétisent bien la proposition de ce puissant article d’Olúfémi Táíwò. Il s’agit d’une traduction humaine (et non machinique-automatique par IA), réalisée à l’automne 2025, en appui sur quelques conversations informelles avec Daphné Hamilton-Jones, Céline Bonicco-Donato et Mireille Roddier. Elle a été relue par Emilie Letouzey que je remercie vivement pour l’immense travail effectué.
Image d’accueil : Signet-976 sur Unsplash.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
Notes
- NDT : Suivant l’invitation de Sarah Bracke, María Puig de la Bellacasa et Isabelle Clair, le concept de standpoint est traduit dans cet article par « positionnement » et non « point de vue ». Renvoyons aux explications lucides des autrices à ce sujet : « Nous faisons le choix que standpoint feminism soit traduit par féminisme ‘du positionnement’, plutôt que ‘du point de vue’, alors que cette dernière expression est la plus courante en français et que le terme standpoint est, en anglais, synonyme de viewpoint. Mais le ‘point de vue’, ou encore la ‘perspective’, exposerait notre propos à des interprétations perspectivistes voire relativistes, contraires à notre intention et à celle des auteures dont nous présentons les écrits. ‘Point de vue’ ou ‘perspective’ auraient aussi l’inconvénient de diluer l’intensité contenue dans le terme standpoint qui suggère la résistance, l’opposition, l’adoption d’une attitude, la prise de position. La traduction par ‘positionnement’ permet dès lors d’insister sur le caractère politique, actif et construit du standpoint. » Pour plus de détails à ce sujet, lire María Puig de la Bellacasa, Politiques féministes et construction des savoirs. Penser nous devons !, 2012, Paris, L’Harmattan, p. 170-72. » Bracke, S., Puig de la Bellacasa, M., et Clair, I. (2013), « Le féminisme du positionnement. Héritages et perspectives contemporaines », Cahiers du Genre, 54(1), 45-66.
- NDT : Sur le sujet des « elite capture », on lira d’Olúfẹ́mi O. Táíwò son ouvrage éponyme paru peu de temps après cet article : Elite Capture : How the Powerful Took Over Identity Politics (And Everything Else), Pluto Press, 2022. L’ouvrage est paru en français en novembre 2023 chez l’éditeur québécois Lux, sous le titre L’élite cannibale : comment les puissants se sont appropriés les luttes identitaires (et tout le reste).
- NDT : Cité notamment dans David Scott Fitzgerald & David Cook-Martin, Culling the Masses : The Democratic Origins of Racist Immigration Policy in the Amiricas, 7 (2014), p. 36.
- Nous choisissons de traduire constructive par constructif en accord avec le choix fait par la traduction québécoise dans L’Élite cannibale, Lux, 2023).
- NDT : https://sokokisojourn.wordpress.com/2020/09/11/nick-estes-on-trauma-politics/
- NDT : “You think your pain and your heartbreak are unprecedented in the history of the world, but then you read. It was books that taught me that the things that tormented me most were the very things that connected me with all the people who were alive, who had ever been alive.”— James Baldwin, “The Doom and Glory of Knowing Who You Are”, Life Magazine, mai 24, 1963.
L’article Reprendre la politique aux élites : la solidarité radicale contre les privilèges est apparu en premier sur Terrestres.
28.12.2025 à 10:30
Le tournant féministe de la primatologie
Donna Haraway
1989 : dans une enquête magistrale sur le rôle des femmes dans la primatologie, Donna Haraway articulait sciences, patriarcat, racisme et impérialisme. Un classique fondateur des humanités environnementales enfin traduit, alors que les grands singes, à l’interface entre nature et culture, vivent désormais au seuil de l’extinction. Préface inédite et introduction.
L’article Le tournant féministe de la primatologie est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (15451 mots)
Temps de lecture : 41 minutes
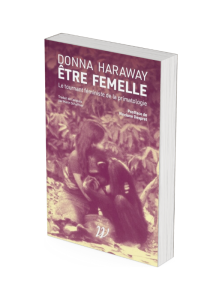
Ce texte est un extrait du livre Être femelle. Le tournant féministe de la primatologie, traduit de l’anglais par Marin Schaffner et paru aux Éditions Wildproject en 2025 (avec une postface inédite de Vinciane Despret).
Note de traduction, par Marin Schaffner
À Dian Fossey, et à toutes les femmes qui ont été tuées en défendant la vie
Primate Visions est le deuxième livre de Donna Haraway1. Entamé à la fin des années 1970 et publié en 1989, il propose une histoire critique de la primatologie au 20e siècle, sur près de 500 pages. Être femelle est la traduction de l’introduction générale de ce livre – que vous retrouverez ci-dessous en intégralité – ainsi que de sa troisième et dernière partie.
Lorsqu’elle entame Primate Visions, Donna Haraway enseigne à la Johns Hopkins University (1974-1980), dans le département d’histoire des sciences. Ses travaux de l’époque explorent principalement les implications philosophiques et politiques de la biologie à laquelle elle a été formée.
Nommée professeure à l’université de Santa Cruz en 1980 (où elle finira la rédaction de Primate Visions), elle obtient alors la première chaire en théorie féministe des États-Unis. Dès ce moment, ses recherches se déploient à la croisée de la critique des sciences, des études de genre, de la science-fiction et de l’écologie. Deux articles majeurs publiés alors témoignent de sa singularité transdisciplinaire : « Manifeste cyborg : science, technologies et féminisme socialiste à la fin du 20e siècle » (1985)2 et « Savoirs situés : la question de la science dans le féminisme et le privilège de la perspective partielle » (1988)3. Le sous-titre original de Primate Visions – « Genre, race et nature dans le monde de la science moderne » – résume sans détour son approche.
Contrairement au français, le terme anglais female peut à la fois signifier « femelle » et « femme » – même s’il reste différent, en ce second sens, de woman. Nous avons volontairement choisi de traduire ce terme sous sa première acception, tout au long du livre, afin d’insister sur l’ancrage de la question féministe dans les enjeux de la biologie, et sur leurs enchevêtrements multiples – ce qui est un des cœurs battants de la critique de la primatologie ici développée par Donna Haraway.
Préface de l’autrice à l’édition française (2025)
Il y a plus de quarante ans, j’ai commencé à sérieusement interroger les manières dont l’amour, le pouvoir et la science s’entremêlent au sein des constructions de ce qui est considéré comme relevant de la « nature » pour les sociétés contemporaines.
Quarante ans plus tard, je continue de m’interroger à ce sujet, avec un sentiment d’urgence toujours plus grand – et cela, quand bien même la nature est devenue pour moi des naturecultures. Les « naturecultures » s’écrivent nécessairement en un mot ; et ce mot est empli des histoires des pratiques masculinistes, coloniales, raciales, capitalistes, écocidaires et génocidaires – mais pas seulement. Jamais seulement. Les naturecultures sont aussi emplies de recherches empiriques et de théories astucieuses qui changent des vies, d’un engagement profond en faveur de mondes qui dépassent l’exceptionnalisme humain, et d’un amour passionné pour les êtres vivants et mourants de la Terre. Les scientifiques francophones dans les pays francophones sont et ont été des act·rices majeur·es de ce drame complexe.
En écrivant Primate Visions, j’ai demandé de l’aide à mes parentés primates et je l’ai reçue en abondance. Ces parentés étaient composées à la fois de scientifiques humain·es qui étudiaient les singes (sur le terrain, dans les zoos ou dans des laboratoires) et des primates plus-qu’humain·es elles et eux-mêmes. À l’époque où j’ai écrit ce livre imposant, les mondes de ces autres primates étaient encore plus menacés par la destruction des habitats, la cupidité et l’ignorance que les mondes de leurs voisin·es humain·es tourmenté·es. Mais les destins des peuples humains et ceux des autres animaux sont liés depuis le commencement. Et je crois que leurs futurs, nos futurs, dépendent les uns des autres.
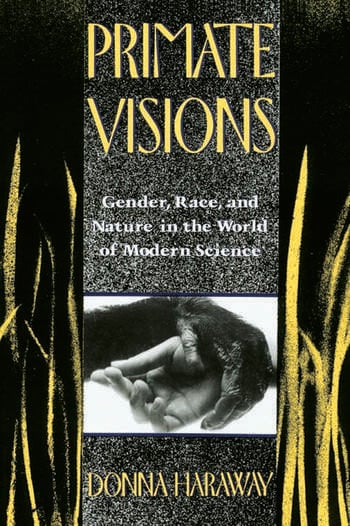
Progressivement, et souvent à contrecœur, les scientifiques ont appris à connaître les populations humaines et les cultures humaines des pays abritant des singes, et la science des primates est aujourd’hui une tentative véritablement diversifiée et mondiale. Malgré cela, bon nombre de nos parents primates n’auront plus de sociétés, de parentés, de cultures, ni d’habitats d’ici la fin de ce siècle. Tous les grands singes et la plupart des autres vivent désormais au seuil de l’extinction. Nous ne devons pas permettre que la grande aventure touffue de toutes les générations issues de la longue diversification évolutive des primates se termine par des projets visant à envoyer Elon Musk sur Mars – ni par une quelconque autre forme d’exceptionnalisme humain. Vivre de façon robuste sur une Terre partiellement guérie, en réparant collectivement tous les dommages possibles à travers les sciences et bien d’autres méthodes, tel est notre véritable travail.
Dans Primate Visions, je me suis demandé quelles formes prenait l’amour de la nature dans les sociétés techno-industrielles, à quel prix et un prix pour qui. Aujourd’hui, je me demande avec urgence comment nourrir des naturecultures dignes d’avenir. Je me soucie plus que jamais des primates plus-qu’humain·es ; et je vois dans leurs corps et dans leurs habitats les stigmates sanglants du genre, de la race, de la classe et des nations humaines. J’espère que les lect·rices de cette traduction y trouveront du réconfort et des idées pour des réparations partielles, des remédiations partielles, et l’espoir de générations futures pour toutes les parentés primates.
Je pense que mon slogan doit désormais être : « Des sciences primates pour la survie terrestre ! »
Donna Haraway, mai 2025
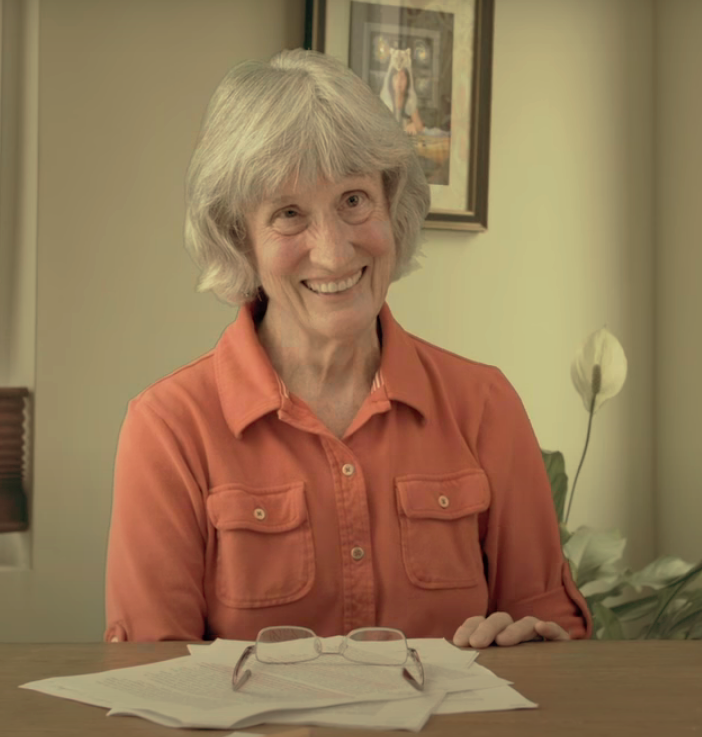
Introduction de Primate Visions (1989) : « Une vision persistante »4
« Les noms que vous, primates sans cage, donnez aux choses affectent votre attitude à leur égard pour toujours. » – Ruth Herschberger, Adam’s Rib, 1970
« Car c’est ainsi que tout doit commencer, par un acte d’amour. » – Eugène Marais, The Soul of the White Ant, 1980
Comment l’amour, le pouvoir et la science s’entremêlent-ils au sein des constructions de la nature, en cette fin de 20e siècle ? Qu’est-ce qui peut bien être considéré comme « nature » par les gens de la société industrielle tardive ? Quelles formes l’amour de la nature prend-il dans des contextes historiques particuliers ? Pour qui et à quel prix ? Dans quels lieux spécifiques, à partir de quelles histoires sociales et intellectuelles, et avec quels outils la nature est-elle construite en tant qu’objet de désir érotique et intellectuel ? Comment les terribles marques du genre et de la race permettent-elles et limitent-elles l’amour et la connaissance dans des traditions culturelles particulières, y compris dans les sciences naturelles modernes ? Qui peut contester ce que sera le corps de la nature ? Telles sont les questions qui guident mon histoire des sciences modernes et des cultures populaires émergeant des récits sur les corps et les vies des singes.
Depuis le 18e siècle, les thèmes de la race, de la sexualité, du genre, de la nation, de la famille et de la classe sociale ont été inscrits dans le corps de la nature par les sciences de la vie occidentales. Dans le sillage de la décolonisation post-Seconde Guerre mondiale, dans celui des mouvements antiracistes et féministes locaux et mondiaux, dans le sillage également des menaces nucléaires et environnementales, et de la prise de conscience généralisée de la fragilité des réseaux soutenant la vie sur Terre, la nature reste un mythe et une réalité : elle est à la fois profondément contestée et d’une importance cruciale. Comment les liens symboliques et matériels s’entrecroisent-ils au sein du tissu qu’est la nature pour les gens de la société industrielle tardive, en cette fin de 20e siècle ? »
Pour les Occidentaux, les singes ont une relation privilégiée à la nature et à la culture : les simiens occupent les zones frontalières de ces deux puissants pôles mythiques. Dans ces zones frontalières, l’amour et la connaissance présentent une riche ambiguïté et génèrent des significations dans lesquelles de nombreuses personnes trouvent des intérêts. Le trafic commercial et scientifique des singes est aussi bien un trafic de significations que de vies animales. Les sciences qui lient les singes et les humains ensemble au sein d’un ordre des Primates sont construites à partir de pratiques disciplinaires profondément enchevêtrées à la narration, à la politique, au mythe, à l’économie et aux possibilités techniques. Les femmes et les hommes qui ont contribué à l’étude des primates ont véhiculé les marques de leurs propres histoires et de leurs propres cultures. Ces marques sont inscrites dans les textes sur la vie des singes, mais souvent de façon subtile et inattendue. Les personnes qui étudient ces autres primates défendent des discours scientifiques contradictoires, et doivent rendre des comptes à de nombreux types de publics et de financeurs. Elles se sont engagées dans des relations d’amour et de connaissance dynamiques, disciplinées et intimes avec les animaux qu’elles avaient le privilège d’observer. Les primatologues comme les animaux dont ils et elles ont rapporté la vie suscitent un intérêt populaire intense – dans les musées d’Histoire naturelle, les émissions télévisées, les zoos, la chasse, la photographie, la science-fiction, les politiques de protection, la publicité, le cinéma, l’actualité scientifique, les cartes de vœux, ou encore les blagues. Les animaux ont été considérés comme des sujets privilégiés par diverses sciences de la vie et diverses sciences humaines – anthropologie, médecine, psychiatrie, psychobiologie, physiologie de la reproduction, linguistique, neurobiologie, paléontologie et écologie comportementale. Les singes ont modelé une vaste gamme de problèmes et d’espoirs humains. Plus encore, dans les sociétés européennes, américaines et japonaises, les singes ont été soumis à des interrogations prolongées et culturellement spécifiques sur ce que signifie être « presque humain ».

Les singes – et les personnes qui construisent les connaissances scientifiques et populaires à leur sujet – font partie de cultures en conflit. Jamais innocente, la « technologie » narrative de visibilisation propre à ce livre s’inspire à la fois des théories contemporaines sur la production culturelle, des études historiques et sociales sur la science et la technologie, et des mouvements et théories féministes et antiracistes, afin d’élaborer une vision de la nature telle qu’elle est construite et reconstruite dans les corps et les vies d’animaux du « tiers-monde » qui servent de substituts à l’« homme ».
J’ai essayé d’emplir mon livre Primate Visions (1989) de puissantes images verbales et visuelles : le cadavre d’un gorille abattu en 1921 au « cœur de l’Afrique » et transformé en leçon de vertu civique au musée américain d’Histoire naturelle de New York ; une petite fille blanche emmenée au Congo belge dans les années 1920 pour « chasser » le gorille avec un appareil photo, et qui s’est métamorphosée dans les années 1970 en une autrice de science-fiction, considérée pendant des années comme un modèle de prose masculine ; le chimpanzé Ham dans sa capsule spatiale pour le projet Mercury en 1961 ; David Greybeard (contemporain du chimpanzé Ham) tendant la main à Jane Goodall, « seule » dans les « étendues sauvages de Tanzanie », l’année où quinze nations africaines abritant des primates ont accédé à leur indépendance nationale ; une édition spéciale du magazine Vanity Fair sur Dian Fossey en 1986, un an après son assassinat, dans un cimetière de gorilles au Rwanda ; les os d’un fossile antique, reconstitués comme étant ceux de la grand-mère de l’humanité, et disposés comme des joyaux sur du velours rouge dans le laboratoire d’un paléontologue, selon un modèle destiné à fonder, une fois de plus, une théorie sur l’origine de la « monogamie » ; les bébés singes du laboratoire de Harry Harlow, dans les années 1960, s’accrochant aux vêtements de leurs « mères de substitution », à un moment historique où les images de la maternité de substitution commençaient à faire surface dans les politiques américaines de reproduction5 ; l’étreinte émotionnellement déchirante entre une jeune scientifique blanche de classe moyenne et un chimpanzé adulte parlant la langue des signes américaine, sur une île du fleuve Gambie, où des femmes blanches apprennent aux singes captifs à « retourner » à l’état « sauvage » ; une carte de vœux Hallmark inversant l’image de King Kong, où l’on voit une femme blonde gigantesque et un gorille à dos argenté qui se recroqueville dans un lit, la scène étant intitulée « Getting Even » (« prendre sa revanche ») ; des femmes et des hommes ordinaires d’Afrique, des États-Unis, du Japon, d’Europe, d’Inde et d’ailleurs, muni·es de magnétophones et de presse-papiers, transcrivant la vie des singes dans des textes spécialisés, qui deviendront des éléments contestés au sein des controverses politiques de multiples cultures.

J’écris sur les primates parce qu’ils sont populaires, importants, merveilleusement variés et controversés. Et tou·tes les membres de l’ordre des Primates – singes comme humain·es – sont menacé·es. La primatologie de la fin du 20e siècle peut être considérée comme faisant partie d’une littérature complexe de la survie, au sein de la culture nucléaire mondialisée. La production et la stabilisation des connaissances concernant l’ordre des Primates comportent des enjeux émotionnels, politiques et professionnels pour de nombreuses personnes, y compris moi-même. Il ne s’agira donc pas ici d’une étude objective et désintéressée, ni d’une étude exhaustive – en partie parce que de telles études sont impossibles pour qui que ce soit, et en partie parce qu’il y a des enjeux que je tiens à rendre visibles (et probablement d’autres encore). Je veux que ce livre puisse intéresser de nombreux publics, et qu’il soit à la fois agréable et dérangeant pour chacun et chacune d’entre nous. En particulier, je veux que ce livre remplisse son devoir à la fois vis-à-vis des primatologues, des historien·nes des sciences, des théoricien·nes de la culture, des vastes mouvements de gauche, antiracistes, anticoloniaux et féministes, des animaux, et de celles et ceux qui aiment les histoires sérieuses. Il n’est peut-être pas toujours possible de rendre des comptes à ces différents publics, mais c’est grâce à eux que ce livre a pu voir le jour. Ils sont tous présents dans ce texte. Les primates, qui existent aux frontières de tant d’espoirs et d’intérêts, sont des sujets merveilleux avec lesquels on peut explorer la perméabilité des murs, la reconstitution des frontières et le dégoût des dualismes interminables imposés par la société.
J’écris sur les primates parce qu’ils sont populaires, importants, merveilleusement variés et controversés. Et tou·tes les membres de l’ordre des Primates – singes comme humain·es – sont menacé·es.
Donna Harraway
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Fait et fiction
La science et la culture populaire sont toutes deux inextricablement tissées de faits et de fictions. Il semble naturel, et même moralement obligatoire, d’opposer fait et fiction ; pourtant, leurs similarités sont profondément ancrées dans les cultures et les langues occidentales. Les faits peuvent être imaginés comme des nœuds, originaux et irréductibles, à partir desquels une compréhension fiable du monde peut être construite. On pense généralement que les faits doivent être découverts, et non pas fabriqués ou construits. Mais l’étymologie du mot « fait » nous renvoie à l’action humaine, à la performance, voire aux exploits humains. Les faits naissent des actes, par opposition aux mots. Autrement dit, aussi bien d’un point de vue linguistique qu’historique, l’action humaine est à la racine de tout ce que nous pouvons considérer comme étant un fait. Un fait est une chose faite, un participe passé neutre issu du latin, notre langue parente commune. Dans ce sens originel, les faits sont ce qui s’est réellement passé. De telles choses sont connues via l’expérience directe, via le témoignage et via l’interrogation – des voies d’accès à la connaissance extraordinairement privilégiées en Occident.
La fiction, elle, peut être envisagée comme une version dérivée et fabriquée du monde et de l’expérience, comme une sorte de double perverti des faits, ou comme une évasion imaginaire vers un monde meilleur que « ce qui s’est réellement passé ». La variété des tonalités au sein de la fiction nous laisse penser que son origine se trouve dans la vision, l’inspiration, la perspicacité, le génie. Nous entrevoyons la racine de la fiction dans la poésie et nous croyons, avec un certain romantisme, que c’est par une bonne fiction que se révèlent les natures originelles. En d’autres termes, la fiction peut être vraie, ou du moins reconnue comme telle, du fait de son attrait pour la nature. Et comme la nature est prolifique – elle est la mère de la vie dans nos principaux systèmes de mythes –, la fiction semble être une vérité intérieure qui donne naissance à nos vies réelles. Il s’agit là aussi d’une voie d’accès à la connaissance très privilégiée dans les cultures occidentales, y compris aux États-Unis. Enfin, l’étymologie de la fiction nous renvoie à nouveau à l’action humaine, à l’acte de façonner, de former ou d’inventer, ainsi qu’à celui de feindre. La fiction s’inscrit donc inéluctablement dans une dialectique du vrai (naturel) et du faux (artefact). Mais dans toutes ses significations, la fiction concerne l’action humaine. De même, tous les récits de la science – fictions et faits – concernent l’action humaine.
La fiction est proche des faits, sans qu’ils soient des jumeaux identiques. Les faits s’opposent aux opinions, aux préjugés, mais pas à la fiction. La fiction et les faits sont tous deux ancrés dans une épistémologie qui fait appel à l’expérience. Cependant, il existe une différence importante : le mot fiction est une forme active, qui renvoie à un acte présent de façonnage, tandis que le mot fait provient d’un participe passé, une forme verbale qui masque l’acte générateur ou la performance. Un fait semble achevé, immuable, apte seulement à être enregistré ; la fiction, elle, semble toujours inventive, ouverte à d’autres possibilités, à d’autres façonnements de la vie. Mais dans cette ouverture réside la menace d’une simple feinte, celle de ne pas dire la vraie forme des choses.
La pratique scientifique est avant tout une pratique narrative – entendue comme une pratique historiquement spécifique d’interprétation et de témoignage.
Donna Haraway
D’un certain point de vue, les sciences naturelles semblent offrir des outils qui permettent de distinguer les faits de la fiction, de remplacer l’invention par son participe passé, et de préserver ainsi l’expérience vraie de toute contrefaçon. Par exemple, l’histoire de la primatologie a été racontée à maintes reprises comme une clarification progressive de l’observation des singes et des êtres humains. Il y a d’abord eu les premiers indices de l’existence d’une forme commune « primate », suggérés, dans les brumes préscientifiques, par les récits inventifs de chasseurs, de voyageurs et d’indigènes. Peut-être ces indices datent-ils de l’Antiquité, ou peut-être du 16e siècle, lors de la tout aussi mythique époque des Découvertes et de la naissance de la Science moderne. Puis, progressivement, la vision claire et éclairée est apparue, sur la base de dissections et de comparaisons anatomiques. L’histoire de ce qu’est la vision correcte de la forme sociale propre aux primates suit d’ailleurs la même trame : le passage d’une vision brumeuse et encline à l’invention, vers une connaissance quantitative et perçante, enracinée dans ce type particulier d’expérience qu’on appelle experiment en anglais. C’est l’histoire du passage d’une science immature, fondée sur la simple description et la libre interprétation qualitative, vers une science mature, fondée sur des méthodes quantitatives et des hypothèses falsifiables, et aboutissant à une reconstruction scientifique synthétique de la réalité des primates. Mais ces histoires (histories) sont des histoires (stories) à propos d’autres histoires ; elles sont des récits qui se terminent bien – c’est-à-dire les faits rassemblés, la réalité scientifiquement reconstruite. Et ces histoires ont une esthétique particulière (le réalisme) et une politique particulière (l’engagement pour le progrès).
Depuis une perspective très légèrement différente, l’histoire des sciences apparaît comme un récit sur l’histoire des moyens techniques et sociaux utilisés pour produire les faits. Les faits eux-mêmes sont des types d’histoires, des types de témoignages relatant des expériences. Mais provoquer une expérience scientifique requiert une technologie élaborée – comprenant des outils physiques, une tradition d’interprétation accessible et des relations sociales spécifiques. Ce n’est pas n’importe quoi qui peut devenir un fait ; ce n’est pas n’importe quoi qui peut être vu ou produit, et ainsi être raconté. La pratique scientifique peut ainsi être considérée comme une sorte de pratique narrative – un art de raconter l’histoire de la nature, qui est régi par des règles, qui est soumis à des contraintes et qui évolue historiquement. La pratique scientifique et les théories scientifiques produisent des types particuliers d’histoires, et sont intégrées dans des types particuliers d’histoires. Toute déclaration scientifique sur le monde dépend intimement du langage, de la métaphore. Les métaphores peuvent être mathématiques ou culinaires ; dans tous les cas, elles structurent la vision scientifique. La pratique scientifique est avant tout une pratique narrative – entendue comme une pratique historiquement spécifique d’interprétation et de témoignage.
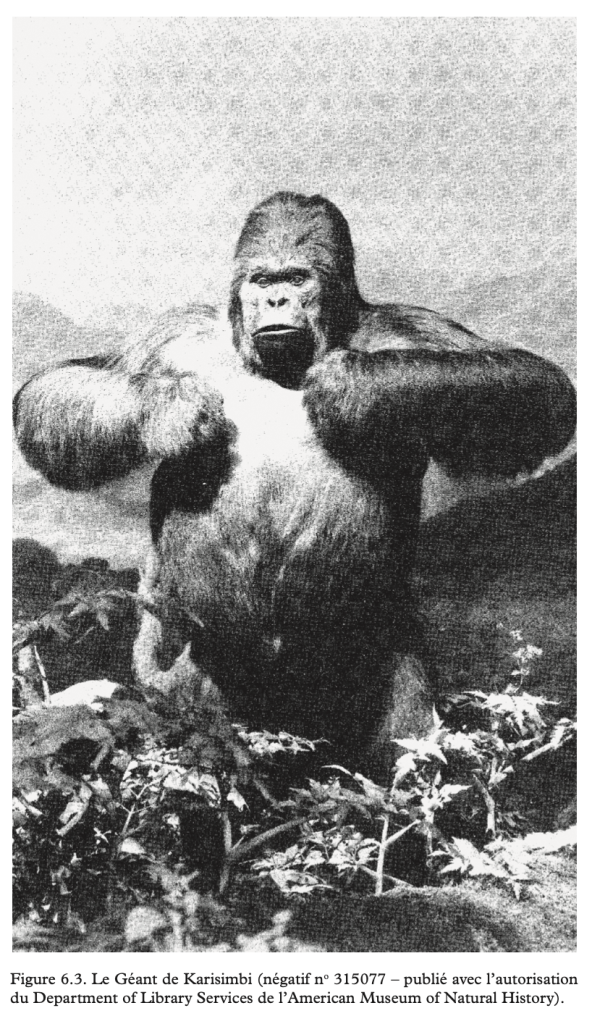
Regarder la primatologie, une branche des sciences de la vie, comme une fabrique narrative peut s’avérer particulièrement approprié. Premièrement, le discours de la biologie, qui a débuté aux alentours des premières décennies du 19e siècle, s’est intéressé aux organismes, aux êtres ayant une histoire de vie – c’est-à-dire une trame possédant une structure et une fonction6. La biologie est intrinsèquement historique, et la forme de son discours est intrinsèquement narrative. La biologie, comme manière de connaître le monde, s’apparente à la littérature romantique et à son discours sur les formes et les fonctions organiques. La biologie est la fiction appropriée pour les objets qu’on appelle « organismes » ; la biologie modèle les faits « découverts » au sujet des êtres organiques. Les organismes accomplissent une performance pour les biologistes, qui la transforment en une vérité attestée par une expérience disciplinée – c’est-à-dire en un fait, qui est l’acte ou la prouesse conjointement accomplie par le scientifique et l’organisme. Le romantisme se mêle au réalisme, et le réalisme au naturalisme ; le génie se mêle au progrès, et l’idée au fait. Les scientifiques autant que les organismes sont des acteurs au sein d’une pratique narrative.
Deuxièmement, les singes et les êtres humains apparaissent, dans la primatologie, à l’intérieur de narrations élaborées, sur les origines, les natures et les possibilités. La primatologie concerne l’histoire vivante d’un ordre taxonomique qui inclut les êtres humains. Et ce sont tout particulièrement les humains occidentaux qui produisent des histoires à propos des primates, tout en racontant simultanément des histoires à propos des relations entre nature et culture, animal et humain, corps et esprit, origine et futur. En effet, depuis son apparition, au milieu du 18e siècle, l’ordre des Primates a été construit sur des récits à propos de ces dualismes et de leur résolution scientifique.
Traiter une science comme un discours narratif n’est pas signe de mépris, c’est même plutôt le contraire. Mais il ne s’agit pas non plus d’avoir une attitude mystifiée et adoratrice face à un participe passé. Je m’intéresse aux narrations sur les faits scientifiques – ces puissantes fictions de la science – prises à l’intérieur d’un champ complexe que j’identifierai avec le signifiant « SF ». À la fin des années 1960, la critique littéraire de science-fiction Judith Merril a commencé à utiliser, de façon singulière, le signifiant SF pour désigner un champ narratif complexe et émergent, au sein duquel les frontières entre science-fiction (qu’on appelle par convention « sf », en minuscules) et fantasy devenaient perméables dans une propension déroutante, tant d’un point de vue commercial que linguistique. Son appellation, SF, se trouva être largement adoptée par les critiques, les lect·rices, les aut·rices, les fans ; et les maisons d’édition ont peiné à comprendre cet éventail de plus en plus hétérodoxe de pratiques d’écriture, de lecture et de marketing, repérables par une prolifération d’expressions correspondant à l’acronyme « sf » en anglais : fiction spéculative, science-fiction, science-fantasy, futurs spéculatifs, fabulation spéculative.
➤ Lire aussi | L’ère de la standardisation : conversation sur la Plantation・Anna Tsing et Donna Haraway (2024)
La SF est un territoire de reproduction culturelle controversée au sein des mondes technologisés. Placer les récits de faits scientifiques à l’intérieur de l’espace hétérogène de la SF transforme tout un champ. Ce champ transformé crée alors des résonances entre toutes ses régions et toutes ses composantes. Aucune région ou composante n’est « réduite » à aucune autre, mais les pratiques de lecture et d’écriture se répondent les unes les autres à travers un espace structuré. La fiction spéculative révèle des tensions différentes lorsque son champ contient également les pratiques d’inscription qui constituent le fait scientifique. Les sciences sont liées à des histoires complexes, en ce qui concerne la constitution des mondes imaginatifs comme la constitution des corps réels au sein des cultures modernes et postmodernes du « premier monde ». Teresa De Lauretis a avancé l’idée que le travail de création de sens impliqué par le terme SF était « potentiellement créateur de nouvelles formes sociales d’imagination – créateur, dans le sens où il peut permettre de révéler l’existence d’espaces où le changement culturel pourrait avoir lieu ; d’envisager un ordre différent des relations entre les gens, et entre les gens et les choses, c’est-à-dire une conceptualisation différente de l’existence sociale, incluant à la fois l’existence physique et matérielle » (1980 : 161). Or cela est aussi l’une des tâches du « travail de création de sens » qu’est la primatologie.
Ainsi, du moins en partie, ce livre propose de lire tout texte sur les primates comme une science-fiction – où les mondes possibles sont constamment réinventés, dans le cadre de la lutte pour des mondes présents et bien réels. Toutefois, la conclusion de l’ouvrage proposera une lecture alternative d’une histoire de sf – sur une espèce extraterrestre intervenant dans la politique de reproduction humaine –, comme s’il s’agissait d’une monographie sur les primates. Le présent ouvrage – enraciné dans les mythes, les sciences et les pratiques sociales historiques qui ont placé les singes dans l’Éden puis dans l’espace (au commencement et à la fin de la culture occidentale) – implante des étrangers (aliens) dans le texte comme un moyen de comprendre ce que sont l’amour et le savoir parmi les primates, sur notre fragile Terre contemporaine.

Quatre tentations
Analyser un discours scientifique, la primatologie, comme un récit au sein de plusieurs champs narratifs contestés est un moyen d’entrer dans les débats actuels sur la construction sociale du savoir scientifique, sans succomber complètement à aucune des quatre positions suivantes (pourtant très tentantes), qui sont néanmoins aussi des ressources majeures pour les méthodes utilisées dans ce livre. J’utilise l’image de la tentation car je trouve que ces quatre positions sont persuasives, fécondes mais aussi dangereuses, particulièrement si l’une de ces positions réduit finalement les autres au silence, créant ainsi une fausse harmonie au sein de l’histoire primate.
La première tentation, pleine de ressources, provient de la tendance la plus active au sein des études sociales sur la science et la technologie. Par exemple, l’éminent analyste des sciences Bruno Latour rejette radicalement toutes les formes de réalisme épistémologique, et analyse la pratique scientifique comme totalement sociale et interprétative. Réfutant la distinction entre le social et le technique, il décrit la pratique scientifique comme le raffinement de « dispositifs d’inscription » – c’est-à-dire des dispositifs permettant de retranscrire l’immense complexité et l’immense chaos des interprétations concurrentes sous forme de traces, d’écrits, qui marquent l’émergence d’un fait, d’un cas de réalité. S’intéressant à la fois à la science en tant que nouvelle forme de pouvoir dans le monde social-matériel, et aux scientifiques comme investissant « leur capacité politique au cœur de la pratique de la science », Bruno Latour et son collègue Stephen Woolgar ont puissamment décrit comment les processus de construction sont faits pour s’inverser et apparaître sous forme de découverte (1979 : 213). Les comptes rendus des scientifiques à propos de leurs propres processus deviennent des données ethnographiques, sujettes à une analyse culturelle.
Depuis la perspective de leur ouvrage La Vie de laboratoire, la pratique scientifique est fondamentalement une pratique littéraire, une pratique d’écriture qui repose sur le fait de se disputer le pouvoir de stabiliser des définitions et des normes permettant d’affirmer que quelque chose est vrai. Gagner, c’est rendre trop élevé le coût de la déstabilisation d’un récit donné. Cette approche peut expliquer les luttes scientifiques autour du pouvoir de clore le débat, et elle peut rendre compte des succès et des échecs de ces luttes. La pratique scientifique est faite de négociations, de déplacements stratégiques, d’inscription et de traduction. Il y a beaucoup à dire sur la science comme croyance effective, ainsi que sur son pouvoir à renforcer et incarner une telle croyance7. Que peut-on demander de plus à une théorie de la pratique scientifique ?
La seconde tentation importante vient d’une branche de la tradition marxiste, qui défend la supériorité historique de certains points de vue dans la connaissance du monde social – et possiblement du monde « naturel » également. D’un point de vue fondamental, les adeptes de cette tradition considèrent que le monde social est structuré par les relations sociales de production et de reproduction de la vie quotidienne, de sorte qu’il n’est possible de voir clairement ces relations que depuis certains points de vue. Il ne s’agit pas d’une affaire individuelle, et la bonne volonté n’est pas en cause. Depuis le point de vue des groupes sociaux en position de domination et de pouvoir systématiques, la véritable nature de la vie sociale sera opaque ; ils ont trop à perdre de la clarté.
Ainsi, les propriétaires des moyens de production vont voir de l’équité dans un système d’échange, là où le point de vue de la classe ouvrière révélera la nature dominatrice d’un système de production fondé sur le salariat, et donc sur l’exploitation et la déformation du travail humain. Celles et ceux pour qui la définition sociale de l’identité prend racine dans le système raciste ne pourront pas voir que la définition de l’humain n’a jamais été neutre, et ne le sera pas tant que de profonds changements matériels et sociaux ne se produiront pas à l’échelle mondiale. De la même manière, pour celles et ceux dont la possibilité même d’accéder au statut d’adulte repose sur le pouvoir de s’approprier l’« autre » au sein d’un système socio-sexuel genré, le sexisme n’apparaîtra pas comme un obstacle fondamental à une connaissance correcte en général. La tradition redevable à l’épistémologie marxiste est en mesure de rendre compte de la plus grande adéquation de certains modes de connaissance, et elle est en mesure de montrer que la race, le sexe et la classe sociale déterminent fondamentalement les détails les plus intimes de la connaissance et de la pratique, en particulier là où l’apparence est celle de la neutralité et de l’universalité8.
Pour l’observateur d’animaux, les peuples autochtones d’Afrique et d’Asie étaient une nuisance, une menace à la protection, jusqu’à ce que la décolonisation oblige les scientifiques occidentaux blancs à restructurer leur biopolitique du soi et de l’autre, du natif et de l’étranger.
Donna Haraway
Ces questions sont loin d’être sans rapport avec la primatologie, une science qui, aux États-Unis, est pratiquée presque exclusivement par des personnes blanches, et même jusqu’à très récemment par des hommes blancs, et toujours en grande majorité par des personnes économiquement privilégiées. Une part importante de ce livre examine les conséquences, pour la primatologie, des relations sociales de race, de sexe et de classe impliquées dans la construction du savoir scientifique. Par exemple, la plupart des primatologues des premières décennies après la Seconde Guerre mondiale n’ont probablement pas compris que les interrelations entre les gens, la terre et les animaux en Afrique et en Asie sont, au moins en partie, dues aux positions des chercheurs eux-mêmes au sein des systèmes racistes et impérialistes. Nombre d’entre eux ont recherché une nature « pure », vierge de tout contact humain ; et donc aussi des espèces intactes – de façon analogue aux « indigènes » autrefois recherchés par les anthropologues coloniaux. Mais pour l’observateur d’animaux, les peuples autochtones d’Afrique et d’Asie étaient une nuisance, une menace à la protection – en fait des « étrangers » (aliens) envahissants –, jusqu’à ce que la décolonisation oblige les scientifiques occidentaux blancs à restructurer leur biopolitique du soi et de l’autre, du natif et de l’étranger. Ainsi, les frontières entre animaux et êtres humains se déplacent lors de la transition d’un point de vue colonial à un point de vue postcolonial ou néocolonial. En insistant sur le fait qu’on peut trouver des contenus et des méthodes moins déformatrices dans les sciences naturelles comme dans les sciences sociales, les approches marxistes, féministes et antiracistes rejettent le relativisme propre à l’étude sociale des sciences. Les approches explicitement politiques prennent parti quant à la question de savoir ce qu’est une connaissance plus adéquate, et plus humainement acceptable. Mais ces analyses ont aussi leurs limites pour ce qui est de guider une exploration des études sur les primates. Le travail salarié, l’appropriation sexuelle et reproductive et l’hégémonie raciale sont des aspects structurants du monde social humain. Il n’y a aucun doute sur le fait qu’ils affectent la connaissance de façon systématique, mais on ne sait pas dire précisément comment ils se relient aux savoirs sur les modèles d’alimentation des singes patas, ou sur la réplication des molécules d’ADN.
Cependant, un autre pan de la tradition marxiste a fait des avancées significatives dans les méthodes pour répondre à ce genre de questions. Dans les années 1970, des personnes associées au Radical Science Journal britannique ont développé l’idée de la science comme processus de travail, cela afin d’étudier et de modifier les médiations scientifiques perpétuant des dominations de classe dans les relations de production et de reproduction de la vie humaine9. Tout comme Bruno Latour, ces personnes n’ont laissé aucune place pour des épistémologies réalistes ou positivistes – qui sont pourtant les versions préférées de la plupart des scientifiques en exercice. Chaque aspect de la pratique scientifique peut être décrit à travers le concept de médiation : le langage, les hiérarchies de laboratoire, les liens industriels, les doctrines médicales, les préférences théoriques de base, et les histoires à propos de la nature. Malgré cela, le concept de « processus de travail » peut sembler cannibale, car il fait passer les relations sociales de tous les autres processus basiques comme des choses qui dériveraient de ce processus premier. Par exemple, les systèmes complexes de domination, de complicité, de résistance, d’égalité et de soin au sein des pratiques genrées de gestation et d’éducation des enfants ne peuvent pas répondre au seul concept de travail. Pour autant, ces pratiques reproductives affectent clairement un certain nombre de contenus et méthodes au sein des études sur les primates. D’ailleurs, même un concept élargi de médiation au sein de processus sociaux systémiques – qui n’insisterait pas sur la réduction de toute chose au travail, dans un sens marxiste classique – laisserait encore trop de pans de l’équation de côté.
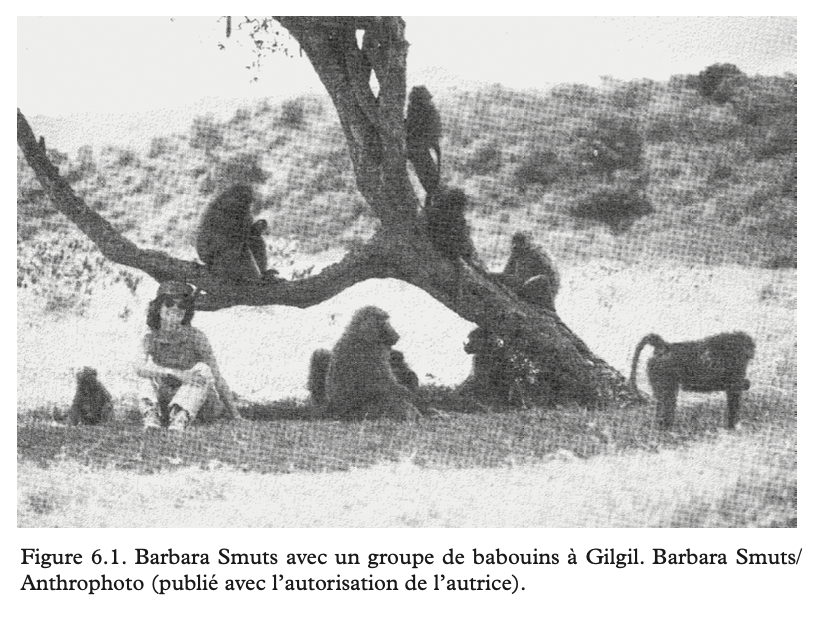
La troisième tentation vient du chant des sirènes des scientifiques eux-mêmes, qui ne cessent de rappeler que, parmi d’autres choses, ils et elles observent des singes. En un sens, plus ou moins nuancé, ils et elles insistent sur le fait que la pratique scientifique est « au contact » du monde. Ils et elles affirment que la connaissance scientifique n’est pas simplement une question de pouvoir et de contrôle. Et que leurs connaissances traduisent en quelque sorte la voix active de leurs sujets – qui sont les objets de la connaissance. Sans être nécessairement forcée de suivre leur esthétique du réalisme ou leurs théories de la représentation, je les crois dans la mesure où ma vie imaginative et intellectuelle ainsi que mes engagements professionnels et politiques dans le monde répondent à ces récits scientifiques. Les scientifiques sont habiles à fournir de bonnes raisons de croire en leurs récits et d’agir sur la base de ceux-ci. Mais la question de savoir comment la science est « en contact » avec le monde est loin d’être résolue. Ce qui semble résolu, cependant, c’est que la science se développe à partir de modes de vie concrets, et crée des modes de vie concrets – y compris des constructions particulières de l’amour, de la connaissance et du pouvoir. C’est là le cœur de son instrumentalisme, et la limite de son universalisme.
Je souhaite trouver un concept pour raconter une histoire de la science qui ne dépende pas des dualismes entre actif et passif, culture et nature, humain et animal, social et naturel.
Donna Haraway
Les preuves sont toujours une question d’interprétation ; et les théories sont des récits depuis et pour des types spécifiques de vies. Je cherche donc une façon de raconter une histoire de la production d’une branche des sciences de la vie, branche qui inclut les êtres humains de façon centrale – qui eux-mêmes écoutent ces histoires très attentivement. Ainsi, mon histoire se doit d’écouter les pratiques d’interprétation de l’ordre des Primates, au sein desquels les primates eux-mêmes et elles-mêmes – singes comme humain·es – exercent toutes et tous une sorte d’« autorat ». Je voudrais donc suggérer que la notion de « récit contraint et contesté » permet d’apprécier la construction sociale de la science, tout en guidant le lecteur ou la lectrice vers la recherche des autres animaux participant activement à la primatologie. Je souhaite trouver un concept pour raconter une histoire de la science qui ne dépende pas des dualismes entre actif et passif, culture et nature, humain et animal, social et naturel.
La quatrième tentation recoupe chacune des trois autres ; et cette tentation principale consiste à toujours regarder les constructions des sciences modernes, aux quatre coins du monde, à travers le prisme des histoires complexes de genre et de race. Cela signifie qu’il faut examiner les productions culturelles, y compris les sciences des primates, depuis les perspectives permises par les politiques et les théories féministes et antiracistes. Le défi est de se remémorer sans cesse la particularité aussi bien que la puissance de cette façon-là de lire et d’écrire. Mais c’est le même défi qui devrait être intégré à toute lecture ou écriture d’un texte scientifique. La race et le genre ne sont pas des catégories sociales universelles premières – et encore moins des réalités naturelles ou biologiques. La race et le genre sont les produits d’histoires spécifiques, mais très vastes et durables, qui ont changé le monde. Et il en va de même pour la science. Le champ de vision de ce livre dépend d’un triple filtre : la race, le genre et la science. C’est le filtre qui retient le mieux les corps marqués par l’histoire, afin de les examiner de plus près10.
Les histoires sont toujours des productions complexes, comprenant de nombreux conteurs et auditeurs, et de nombreuses conteuses et auditrices, mais qui ne sont pas toutes et tous visibles et audibles. La narration est une notion sérieuse, mais heureusement dépourvue du pouvoir de revendiquer des lectures uniques ou fermées. La primatologie semble être une science composée d’histoires, et le but de ce livre est d’entrer dans les contestations liées à la construction de ces histoires. Le prisme de la narration définit une ligne ténue entre réalisme et nominalisme – même si les primates semblent être des scolastiques naturels, ayant tendance à devenir équivoques lorsqu’on les presse. Aussi, je pense qu’il y a une esthétique et une éthique dans le fait de considérer la pratique scientifique comme un art de raconter les histoires – une esthétique et une éthique différentes de la capitulation devant le « progrès », et différentes de la croyance dans la connaissance comme reflet passif de « la façon dont les choses sont », et différentes également du scepticisme ironique et de la fascination pour le pouvoir si fréquents dans les études sociales sur la science. L’esthétique et l’éthique latentes dans l’examen de l’art de raconter les histoires pourraient procurer plaisir et responsabilité dans le tissage des contes. Les histoires sont des moyens d’accéder à des modes de vie. Les histoires sont des technologies permettant d’incarner des primates.
➤ Lire aussi | L’invasion silencieuse. La primatologie d’Imanishi et les préjugés culturels dans les sciences・Frans de Waal (2022)
La primatologie est une science (judéo-)chrétienne
Les juifs et les chrétiens occidentaux, ou les post-judéo-chrétiens, ne sont pas les seuls à pratiquer les sciences des primates. Mais ce livre se concentre avant tout sur l’histoire des études sur le comportement social des singes réalisées aux États-Unis ou par des Euro-Américain·es au cours du 20e siècle. Dans ces histoires, on retrouve un refrain tiré de l’histoire du salut : la primatologie concerne à la fois les histoires primales (l’origine et la nature de « l’homme ») et les histoires de réformation (la réforme et la reconstruction de la nature humaine). Implicitement et explicitement, l’histoire du jardin d’Éden apparaît dans les sciences des singes, à côté de diverses versions de l’origine de la société, du mariage et du langage.
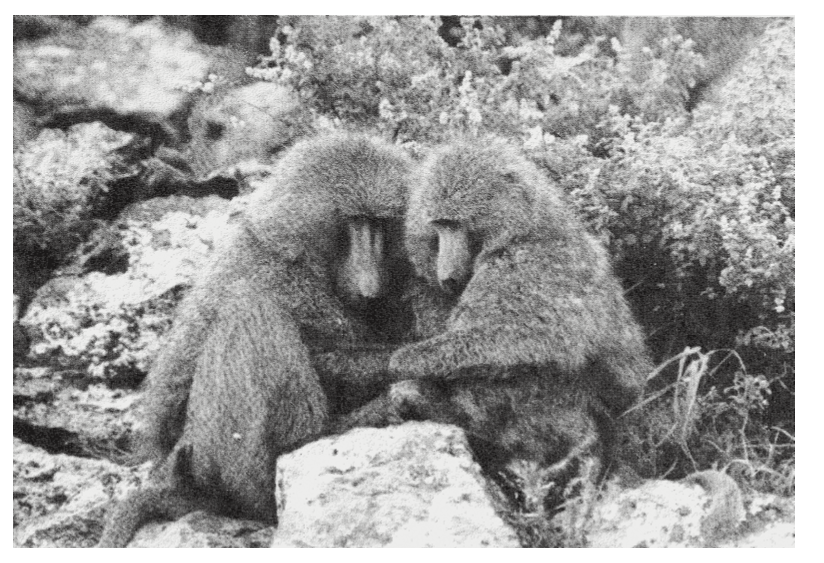
Dès ses débuts, la primatologie a eu ce caractère en Occident. Si Linné, le « père » moderne de la classification biologique au 18e siècle, est constamment cité par les scientifiques du 20e siècle, c’est pour avoir placé les êtres humains dans un ordre taxonomique de la nature aux côtés d’autres animaux – c’est-à-dire pour avoir fait un grand pas de côté par rapport aux hypothèses chrétiennes. Linné a placé l’« homme » en tant qu’Homo sapiens au sein de son ordre taxonomique des primates ; dans le même genre qu’Homo troglodytes, une créature intéressante mais douteuse, illustrée comme une femme poilue. Le nouvel ordre des Primates de la dixième édition du Systema naturae (1758) comprenait également un genre pour les singes et les grands singes, un pour les lémuriens, et un pour les chauves-souris. Mais l’activité de Linné, considéré comme le « père » d’un discours sur la nature, peut aussi être perçue d’une tout autre manière. Il parlait de lui-même comme d’un second Adam, ou comme « l’œil » de Dieu, pouvant donner de vraies représentations et de vrais noms, et réformant ainsi – ou restaurant – la pureté des noms perdus à cause du premier péché d’Adam11. La nature était un théâtre, une scène où se jouaient l’histoire naturelle et l’histoire du salut. Le rôle de celui qui a renommé les animaux était d’assurer un ordre de la nature vrai et fidèle, de purifier à la fois l’œil et le mot. « L’équilibre de la nature » était en partie maintenu par le rôle d’un nouvel « homme » qui pourrait voir clairement et nommer correctement – une identité loin d’être anodine en regard de l’expansion européenne du 18e siècle. C’est d’ailleurs là l’identité du sujet-auteur moderne, pour qui écrire le corps de la nature est l’assurance de pouvoir la maîtriser.
Implicitement et explicitement, l’histoire du jardin d’Éden apparaît dans les sciences des singes, à côté de diverses versions de l’origine de la société, du mariage et du langage.
Donna Haraway
La science de l’histoire naturelle, chez Linné, était une science intimement chrétienne. Sa tâche première, accomplie dans l’œuvre de Linné et de ses correspondants, a été d’annoncer la parenté de l’« homme » et de la bête au sein de l’ordre moderne d’une Europe en expansion. L’homme naturel ne se trouvait pas seulement parmi les « sauvages », mais aussi parmi les animaux – qui ont été nommés « primates » en conséquence, eux le premier Ordre de la nature. Ceux qui étaient en mesure de donner de tels noms avaient une vocation moderne puissante : ils devenaient des scientifiques. La taxonomie a eu une fonction séculaire sacrée. L’« appel » à pratiquer la science a maintenu ce caractère sacralisé jusqu’à aujourd’hui – même si nous verrons que son apogée était au début du 20e siècle. Les histoires produites par de tels praticiens ont un statut spécial au sein d’une culture biblique protestante réprimée comme celle des États-Unis.
Pour Linné, la nature ne devait pas être comprise de façon « biologique », mais de façon « représentative ». Au cours du 19e siècle, la biologie est devenue un discours à propos de la nature productive et expansive. La biologie a été construite comme un discours sur la nature entendue comme un système de production et de reproduction, et comprise sur le modèle d’une division fonctionnelle du travail, selon des critères d’efficacité mentale, agissante et sexuelle des organismes. Dans ce contexte, au 20e siècle, les primates ont été intégrés au sein d’un « théâtre écologique » et d’un « jeu évolutif » (Hutchinson, 1965). L’intrigue a porté sur l’origine et le développement de nombreux thèmes mythiques persistants : le sexe, le langage, l’autorité, la société, la compétition, la domination, la coopération, la famille, l’État, la subsistance, la technologie et la mobilité.
Dans ce livre, deux lectures principales de cette pièce de théâtre ont été retenues. La première s’intéresse aux significations symboliques, aux sciences des primates comme une certaine forme d’art faisant un usage répété des ressources narratives des systèmes de mythes judéo-chrétiens. La seconde accorde une attention particulière aux façons dont la biologie au sujet des primates est théorisée en tant que système matériel de production et de reproduction – une sorte de lecture « matérialiste ». Ces deux interprétations sont à l’écoute des échos et des déterminants de race, de sexe et de classe au sein de ces histoires. Le corps primate, en tant que partie du corps de la nature, peut être lu comme une carte du pouvoir. La biologie et la primatologie sont des discours intrinsèquement politiques, dont les principaux objets de connaissance, tels que les organismes et les écosystèmes, sont des icônes (des condensations) de l’ensemble de l’histoire et des politiques de la culture qui les a construits pour la contemplation et la manipulation. Le corps primate lui-même est un type intrigant de discours politique.
La primatologie est un orientalisme simien
L’argument de ce livre est que la primatologie s’intéresse à un Ordre, un ordre taxonomique et par conséquent politique, qui fonctionne à travers la négociation de frontières obtenues par l’ordonnancement des différences. Ces frontières démarquent des territoires sociaux importants (tels que la norme d’une famille correcte) et sont établies par des pratiques sociales (telles que le développement de programmes de recherche, des politiques de santé mentale, des politiques de protection, la réalisation de films et la publication de livres). Les deux axes majeurs qui structurent ces puissants récits scientifiques de la primatologie – élaborés au sein de toutes ces pratiques – sont définis par des dualismes en interaction : sexe/genre et nature/culture. Le sexe et l’Occident sont des axiomes de la biologie comme de l’anthropologie. Dans la logique qui guide ces dualismes complexes, la primatologie occidentale se révèle comme un orientalisme simien [figure ci-dessous].

Edward Saïd (2015 [1978]) a affirmé que les chercheurs occidentaux (européens et nord-américains) ont participé à une longue histoire d’acceptation des pays, des peuples et des cultures du Proche-Orient et de l’Extrême-Orient, qui s’appuie sur la place particulière de l’Orient dans l’histoire occidentale – le lieu des origines de la langue et de la civilisation, des riches marchés, de la possession et de la pénétration coloniale, et celui de la projection des imaginaires. L’Orient a été une ressource troublante dans la production de l’Occident – lui, l’autre de « l’Est », sa périphérie, qui devint matériellement son dominateur. L’Occident est placé en dehors de l’Orient, et cette extériorité fait partie des pratiques de représentation de l’Occident. Saïd cite Marx : « Ils ne peuvent se représenter eux-mêmes ; ils doivent être représentés. » Ces représentations sont des miroirs complexes de l’évolution du moi occidental à des moments historiques spécifiques. L’Occident s’est aussi placé de manière flexible : les Occidentaux pouvaient se trouver là avec relativement peu de résistance de la part de l’autre. La différence s’est donc située au niveau du pouvoir. Cette structure a été limitante, bien sûr, mais, plus important encore, elle a été productive. Cette productivité s’est opérée au sein des pratiques et des discours structurés de l’orientalisme – où ces structures étaient une condition pour avoir quelque chose à dire. Il n’est jamais question d’avoir quelque chose de vraiment original à dire sur les origines. Une partie de l’autorité des pratiques quant aux récits des origines réside précisément dans leurs relations intertextuelles.
La primatologie est un discours occidental, et c’est un discours sexualisé. Symboliquement, la nature et la culture, aussi bien que le sexe et le genre, se construisent mutuellement (mais pas équitablement) : un pôle d’un dualisme ne peut exister sans l’autre.
Donna Haraway
Sans pousser la comparaison trop loin, les signes du discours orientalistes marquent la primatologie. Mais ici, la scène des origines n’est pas le berceau de la civilisation : elle est le berceau de la culture, de l’être humain se distinguant de l’existence animale. Si l’orientalisme concerne l’imagination occidentale sur les origines de la cité, la primatologie, elle, met en scène l’imagination occidentale sur les origines de la socialité elle-même, et en particulier sur cette icône si chargée symboliquement qu’est « la famille ». Les origines sont par principe inaccessibles par témoignage direct ; toute voix provenant de l’époque des origines est structurellement la voix de l’autre, et qui donc génère le soi. C’est pourquoi, dans les représentations et les simulations au sujet des primates, l’esthétique réaliste et l’esthétique postmoderne ont toutes deux été des modes de production d’illusions complexes, qui fonctionnent comme des générateurs féconds de faits scientifiques et de théories scientifiques. Et il ne faut pas mépriser l’« illusion » lorsqu’elle fonde des vérités si puissantes.
L’idée d’orientalisme simien signifie que la primatologie occidentale concerne : la construction du moi à partir de la matière première de l’autre ; l’appropriation de la nature dans la production de la culture ; le mûrissement de l’humain à partir du sol de l’animal ; la clarté du blanc à partir de l’obscurité du coloré ; l’homme (man) sorti du corps de la femme ; l’élaboration du genre à partir de la ressource sexuelle ; et l’émergence de l’esprit par l’activation du corps. Pour rendre effectives de telles opérations de transformation, l’« orientaliste » simien doit d’abord en construire les termes : animal, nature, corps, primitif, femelle. Les singes – traditionnellement associés à des significations obscènes, à la luxure sexuelle et au corps sans retenue – ont reflété les humains, dans un jeu complexe de distorsions, à travers des siècles de commentaires occidentaux au sujet de ces doubles troublants. La primatologie est un discours occidental, et c’est un discours sexualisé. Elle traite du potentiel et de sa réalisation. Nature/culture et sexe/genre ne sont pas des paires de termes vaguement liés : leur forme spécifique de relation est une appropriation hiérarchique, connectée (comme l’enseignait Aristote) à la logique actif/passif, forme/matière, forme achevée/ressource, homme/animal, finalité/cause matérielle. Symboliquement, la nature et la culture, aussi bien que le sexe et le genre, se construisent mutuellement (mais pas équitablement) : un pôle d’un dualisme ne peut exister sans l’autre.
La critique de Saïd envers l’orientalisme devrait nous alerter sur un autre point important : ni le sexe ni la nature ne sont la vérité sous-jacente du genre et de la culture ; pas plus que l’« Orient » n’est réellement l’origine et le miroir déformant de l’« Occident ». La nature et le sexe sont tout autant fabriqués que leur « autre », les pôles dominants. Mais leurs fonctions et leurs pouvoirs sont différents. La tâche de ce livre est de participer à montrer comment l’ensemble de l’édifice dualiste est construit, quels sont les enjeux liés à ses architectures, et comment cet édifice peut être redessiné. Il importe de savoir précisément comment le sexe et la nature deviennent des objets de connaissance naturels-techniques ; et il importe tout autant d’expliquer leurs doubles – le genre et la culture. Il n’est pas vrai qu’aucune histoire ne pourrait être racontée sans ces dualismes, ni qu’ils font partie de la structure de l’esprit ou du langage. D’ailleurs, il existe des histoires alternatives au sein de la primatologie. Mais ces binarités ont été à la fois particulièrement productives et particulièrement problématiques pour les constructions des corps femelles et des corps marqués par la race ; il est crucial de voir comment ces binarités peuvent être déconstruites et peut-être redéployées.
➤ Lire aussi | Aux sens large : comment l’éthologie agrandit le monde・Thibault De Meyer et Vinciane Despret (2025)
Pour celles et ceux qui gagnent leur vie en produisant les sciences naturelles et en les commentant, il semble pratiquement impossible de croire qu’il n’y a pas de réalité donnée en deçà des écritures de la science, qu’il n’y a pas de centre sacré intouchable permettant de fonder et d’autoriser un ordre de la connaissance innocent et progressiste. Peut-être que dans les « humanités », il n’y a pas d’échappatoire à la représentation, à la médiation, à la narration et à la saturation sociale. Mais les sciences naturelles l’emportent sur cet autre ordre défectueux que sont les « humanités » – comme le prouve leur pouvoir de convaincre et de réordonner le monde entier, et non pas juste une culture locale. Les sciences naturelles sont l’« autre » des sciences humaines, avec tous leurs tragiques orientalismes. Pour autant, un tel édifice ne résiste pas à l’examen.
Ce n’est pas seulement parce que les sciences naturelles sont présentées comme cet « autre » que les plaidoyers des scientifiques convainquent. Leurs assertions sont prévisibles et semblent plausibles à celles et ceux qui les formulent parce qu’elles sont intégrées dans les taxonomies du savoir occidental, et parce que les besoins sociaux et psychologiques des chercheu·ses sont satisfaits par les affirmations persistantes de la division entre sciences naturelles et humaines – par cette division du travail et de l’autorité au sein de la production des discours. Sauf que de telles observations quant aux assertions prévisibles et aux besoins sociaux ne réduisent pas les sciences naturelles à un « relativisme » cynique qui n’aurait aucune norme au-delà de son pouvoir arbitraire. Mon argumentation ne prétend pas non plus que le monde dont les gens s’efforcent de rendre compte n’existe pas, qu’il n’y a pas de référent dans le système de signes et de productions des savoirs, ni de progrès dans l’élaboration de meilleurs récits au sein de ces traditions de pratiques. Cela reviendrait précisément à réduire un champ complexe à l’un des pôles des dualismes ici analysés : le pôle désigné comme idéal par rapport à un matériau impossible, celui désigné comme apparence par rapport à un réel interdit.

Le cœur de mon argumentation est plutôt que les sciences naturelles, tout comme les sciences humaines, se trouvent inextricablement prises au sein des processus qui leur donnent naissance. Et donc, comme les sciences humaines, les sciences naturelles sont culturellement et historiquement spécifiques, modifiées, impliquées. Elles importent pour des personnes réelles. Il est alors logique de se demander quels sont les enjeux, les méthodes et les genres d’autorités impliqués dans les récits des sciences naturelles – et comment ils diffèrent, par exemple, de la religion ou de l’ethnographie. En retour, il n’est par contre pas logique de chercher une forme d’autorité qui échapperait au réseau de ces champs culturels si productifs, et qui, au commencement, rendent les récits possibles. L’œil détaché de la science objective est une fiction idéologique, et elle est puissante. Mais c’est une fiction qui cache – et qui est conçue pour cacher – combien les puissants discours des sciences naturelles opèrent sur le réel. Là encore, les limites sont ici productives, et non pas réductrices et invalidantes.
L’une des conséquences désagréables de mon argument est que les sciences naturelles sont légitimement sujettes à la critique, et ce au niveau des « valeurs », et pas seulement des « faits ». Elles sont sujettes à une évaluation culturelle et politique « de l’intérieur », et pas seulement « en extérieur ». Mais l’évaluation, elle aussi, est impliquée, liée, pleine d’enjeux et d’intérêts croisés, et fait partie du champ de pratiques qui créent du sens pour des personnes réelles en rendant compte de vies situées – et y compris de ces choses hautement structurées que l’on appelle « observations scientifiques ». Les évaluations et les critiques ne peuvent pas enjamber les normes fabriquées pour produire des récits crédibles au sein des sciences naturelles, car ni les critiques ni les objets dont elles parlent n’ont de place « en dehors » qui permettrait de légitimer une vue d’ensemble aussi arrogante. Insister sur le fait que la production du savoir scientifique est fondamentalement chargée de valeurs et d’histoires n’équivaut pas à se tenir nulle part en ne parlant de rien d’autre que de ses propres préjugés – c’est même plutôt le contraire. Seule la façade d’une objectivité désintéressée rend impossible une « objectivité concrète ».
La nature n’est que la matière première de la culture ; et, dans la logique du colonialisme capitaliste, elle doit être appropriée, préservée, esclavagisée, exaltée ou rendue flexible afin d’être mise à la disposition de la culture.
Donna Haraway
Une partie de la difficulté à approcher les constructions intégrées, intéressées et passionnées de la science d’une façon non réductrice nous vient d’une tradition analytique – que nous héritons notamment d’Aristote et de l’histoire transformative du « patriarcat capitaliste blanc » (comment bien nommer cette chose scandaleuse ?) – et qui fait de toute chose une ressource à s’approprier. En tant que « ressource », un objet de connaissance n’est finalement qu’une matière pour le pouvoir séminal, et donc pour l’acte du sachant. Ici, l’objet à la fois garantit et revigore le pouvoir du sachant ; mais tout statut d’agent doit être dénié à l’objet dans les productions de savoir. Le monde doit, en somme, être objectivé en chose, pas en agent ; il doit être de la matière pour la formation de soi du seul être social au sein des productions de savoir, le sachant humain. La nature n’est que la matière première de la culture ; et, dans la logique du colonialisme capitaliste, elle doit être appropriée, préservée, esclavagisée, exaltée ou rendue flexible afin d’être mise à la disposition de la culture. De la même manière, le sexe est seulement la matière de l’acte de genre ; la logique productionniste semble inéluctable au sein des traditions dualistes occidentales. Cette logique narrative analytique et historique explique ma nervosité à propos de la distinction sexe/genre lorsqu’elle est vue, au sein de l’histoire récente des théories féministes, comme un moyen d’aborder les reconstructions de ce qui peut compter comme étant « femelle » ou « nature » dans la primatologie – et de pourquoi ces reconstructions importent au-delà des frontières des études sur les primates. Il a semblé pratiquement impossible d’éviter le piège d’une logique de domination appropriationniste, enchâssée dans la binarité nature/culture et dans sa lignée générative, ce qui inclut la distinction sexe/genre.
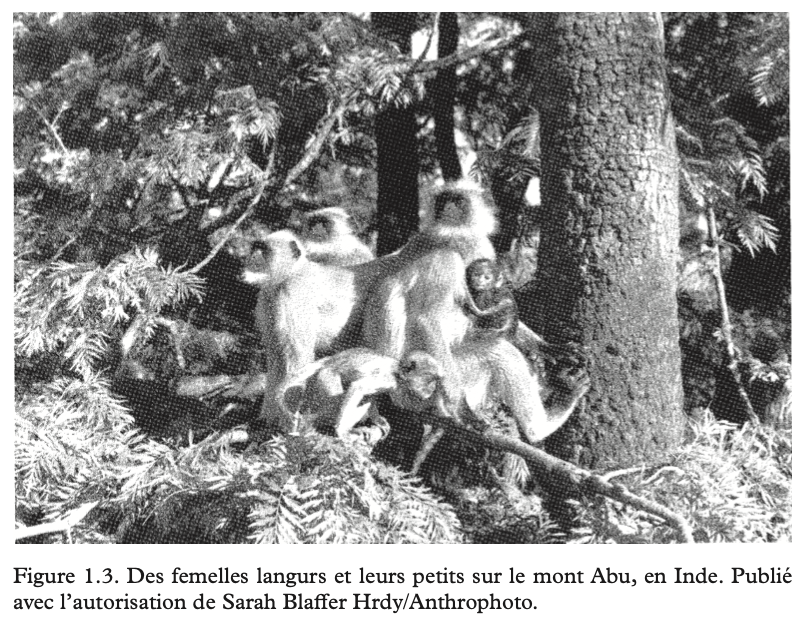
Lire dans les zones frontières
De nombreux sujets dans l’histoire de la biologie et de l’anthropologie pourraient venir nourrir les thèmes discutés dans cette introduction : alors pourquoi ce livre a-t-il choisi d’explorer les sciences des primates en particulier ? La raison principale est que les singes, et les êtres humains considérés comme leurs descendants taxonomiques, existent aux frontières d’une myriade de luttes pour déterminer ce qui comptera comme étant du savoir. Les primates ne se sont pas gentiment enfermés dans une discipline ou un champ spécialisé et sécurisé. Même en cette fin de 20e siècle, de nombreux types de personnes peuvent prétendre connaître les primates, suscitant la consternation et le grand dam de nombreux autres candidats à l’expertise officielle. La possibilité de déstabiliser les savoirs à propos des primates reste à la portée non seulement des praticien·nes de divers champs des sciences de la vie et des sciences humaines, mais aussi à la portée de personnes en marge de toute science – des écrivain·es scientifiques, des philosophes, des historien·nes, comme des visiteu·ses de zoos. De surcroît, raconter des récits à propos des animaux est une pratique si profondément populaire que le discours produit au sein des spécialités scientifiques est approprié par d’autres personnes, à leurs propres fins. La frontière entre discours technique et discours politique est aussi fragile que perméable. Même en cette fin de 20e siècle, le langage de la primatologie est mobilisé au sein de débats politiques controversés sur la nature humaine, son histoire et son avenir. Et cela reste vrai malgré la transformation des discours spécialisés de la primatologie en d’autres langages : mathématiques, théorie des systèmes, analyses ergonomiques, théorie des jeux, stratégies au sein de l’histoire de la vie, et biologie moléculaire.
En plaçant ce récit de primatologie au sein de la SF, j’invite les lecteurs et lectrices à redessiner les frontières entre nature et culture.
Donna Haraway
Parmi les conflits frontaliers intéressants à propos des primates – qui et que sont-ils (et qui et à quoi servent-ils) –, il y a ceux qui opposent : la psychiatrie et la zoologie ; la biologie et l’anthropologie ; la génétique et la psychologie comparée ; l’écologie et la recherche médicale ; l’agriculture et les industries touristiques dans le « tiers-monde » ; les chercheu·ses de terrain et les scientifiques de laboratoire ; les défenseu·ses de l’environnement et les multinationales de l’exploitation forestière ; les braconniers et les gardes-chasse ; les scientifiques et les administrateurs au sein des zoos ; les féministes et les antiféministes ; les spécialistes et les profanes ; l’anthropologie physique et la biologie éco-évolutionnaire ; les scientifiques confirmé·es et les récent·es titulaires de doctorat ; les étudiant·es en études de genre et les professeur·es en comportement animal ; des linguistes et des biologistes ; des responsables de fondation et des demandeu·ses de subvention ; des écrivain·es scientifiques et des chercheu·ses ; des historien·nes des sciences et des vrai·es scientifiques ; des marxistes et des libéraux ; des libéraux et des néo-conservateurs. Et toutes ces intersections apparaissent dans ce livre.
Comment différent·es lectrices et lecteurs pourraient-ils voyager avec plaisir dans ces zones frontières ? Chaque chapitre relève à la fois de l’histoire des sciences, des études culturelles, de l’exploration féministe et d’une intervention engagée pour la constitution d’amour et de connaissance au sein de la fabrique disciplinée de l’ordre des Primates. J’espère que les lecteurs et lectrices n’y seront pas un « public », dans le sens de la réception d’une histoire finie. Les conventions au sein du champ narratif qu’est la SF semblent exiger des lectrices et lecteurs qu’ils réécrivent radicalement les histoires par l’acte même de les lire. En plaçant ce récit de primatologie au sein de la SF – les narrations de la fiction spéculative comme des faits scientifiques –, j’invite les lecteurs et lectrices (historien·nes, critiques culturel·les, féministes, anthropologues, biologistes, antiracistes et amoureu·ses de la nature) à redessiner les frontières entre nature et culture. Je souhaite que les lecteurs et lectrices trouvent ici un « ailleurs » à partir duquel envisager un ordre de relations différent et moins hostile entre les gens, les animaux, les technologies et la terre. Tout comme les acteurs et actrices des histoires qui suivent, je souhaite également proposer de nouveaux termes qui nous aident à circuler entre ce que nous avons historiquement appris à connaître comme nature et culture.
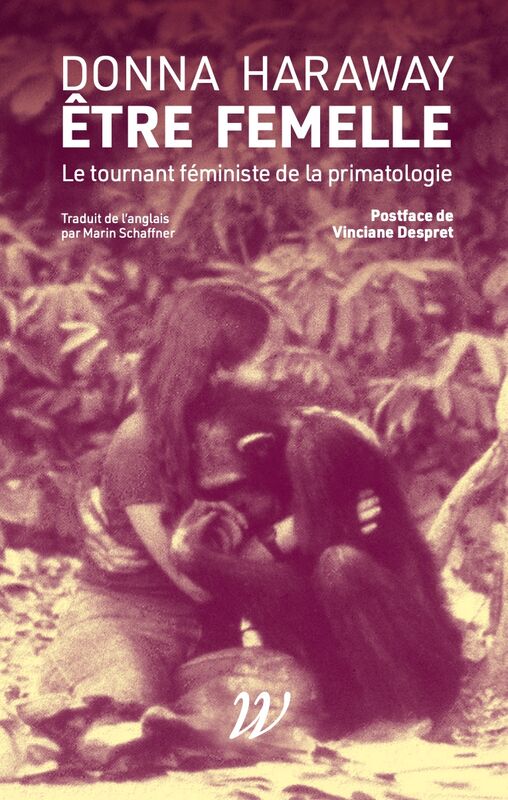
Image principale : « Les singes dans l’orangeraie », Henri Rousseau, 1910. Wikiart.
L’ensemble des images en noir et blanc de cet article sont tirées des divers chapitres du livre Être femelle – les autres sont libres de droits.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
Notes
- Le premier, Crystals, Fabrics and Fields (non traduit), paru en 1976, était la publication de sa thèse en biologie.
- Traduit en 2002 par Marie-Hélène Dumas, Charlotte Gould et Nathalie Magnan, dans Connexions : art, réseaux, média, anthologie établie par Nathalie Magnan et Annick Bureaud, Paris : éditions Ensba.
- Une nouvelle traduction de « Savoirs situés » est à paraître aux Éditions Wildproject en mars 2026 – accompagnée d’un entretien avec Jeanne Burgart Goutal.
- La nouvelle de science-fiction de John Varley, The Persistence of Vision, est en partie à l’origine de ce livre. Dans cette nouvelle, Varley décrit une communauté utopique conçue et construite par des personnes sourdes et aveugles. Il explore ensuite les technologies et autres moyens de communication de ces personnes, ainsi que leurs relations avec les enfants voyants et les visiteu·ses (Varley, 1978). L’interrogation sur les limites et la violence de la vision fait partie de la politique d’apprentissage de la révision.
- NdT : Tout au long de l’ouvrage, l’expression « politiques de reproduction » (reproductive politics) renverra au terme forgé par les féministes dans les années 1970 pour décrire les luttes de pouvoir contemporaines sur la contraception, l’avortement, l’adoption, la gestation pour autrui, et les questions qui leur sont corollaires.
- Foucault (1963) ; Albury (1977) ; Canguilhem (2013 [1966]) ; Figlio (1976).
- Voir aussi Latour (1983, 2005 [1987], 2012 [1984]) ; Bijker et al. (1987) ; Gallon et Latour (1981) ; Knorr-Cetina (1983) ; Knorr-Cetina et Mulkay (1983) ; Traweek (1988).
- Voir Hartsock (1983) ; Harding (1986) ; Rose (1983).
- Voir Young (1977, 1985a) ;Yoxen (1981, 1983) ; Figlio (1977).
- Voir Fee (1986) ; Gould (1981) ; Hammonds (1986) ; Hubbard, Henifin et Fried (1982) ; Gilman (1985) ; Lowe et Hubbard (1983) ; Keller (1985).
- Je dois cette analyse de Linné comme Œil/Je (Eye/I) de Dieu à Camille Limoges, de l’université de Québec à Montréal.
L’article Le tournant féministe de la primatologie est apparu en premier sur Terrestres.
19.12.2025 à 10:35
Logique du capitalisme logistique, de la plantation à l’entrepôt
Jacopo Rasmi
“Qu’est que ça fait d’être un problème dans la chaine d’approvisionnement de quelqu’un ?”, demandent Fred Moten et Stefano Harney dans “All incomplete”, un essai théorique sur les infrastructures du capitalisme logistique, vues à travers le prisme de la tradition radicale afro-américaine. Compte-rendu de lecture pour regarder autrement Amazon et son monde.
L’article Logique du capitalisme logistique, de la plantation à l’entrepôt est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (9806 mots)
Temps de lecture : 22 minutes
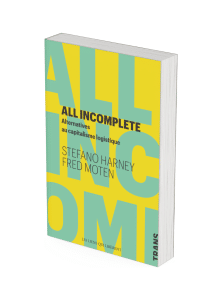
À propos du livre All incomplete. Alternatives au capitalisme logistique, de Fred Moten et Stefano Harney, paru en 2025 aux éditions Les Liens qui Libèrent ; traduction collective finalisée par Mabeuko Oberty.
Récemment traduit en langue française, All Incomplete, le dernier essai de Stefano Harney et Fred Moten, met au centre de sa réflexion la question du « capitalisme logistique ». Les auteurs, tous deux étasuniens – le premier enseignant à la KHM de Cologne, le second poète, performeur et enseignant à la New York University – sont surtout connus pour leur premier livre écrit à quatre mains : Les sous-communs (Brook, 2022), sur lequel nous reviendrons. Disons-le d’emblée : leur dernier ouvrage est ardu et diffère du style classique en sciences humaines et sociales. Il ne faut pas s’attendre à une prose didactique et progressive. Ce livre assez dense et foisonnant propose une réflexion qui mêle philosophie et sciences politiques, poésie et culture radicale black (tradition de pensée nord-américaine dont certains auteurs essentiels comme Cedric Robinson commencent à peine à circuler dans l’espace francophone1).
Quiconque réfléchit aux limites écologiques de notre système socio-productif trouvera des intuitions importantes dans les trajectoires théoriques vertigineuses que Motent et Harney élaborent autour de la question cardinale de la logistique. Dès 2009, l’antropologue Anna Tsing affirmait l’importance d’analyser notre situation en termes de « capitalisme de la chaîne d’approvisionnement (supply chain capitalism) » :
Le « capitalisme de la chaîne d’approvisionnement » désigne ici les chaînes commerciales basées sur la sous-traitance, l’externalisation et les accords connexes dans lesquels l’autonomie des entreprises impliquées est légalement établie, tout en les soumettant à une discipline au sein de la chaîne dans son ensemble.2
C’est ce double mouvement corrélé de séparation en entités autonomes et compétitives, d’une part, et d’enchainement à un écosystème économique hégémonique, d’autre part, que nous retrouvons dans les analyses philosophiques d’All Incomplete. Les terrains de recherche anthropologiques d’Anna Tsing nous suggéraient, à ce propos, de ne pas nous attarder excessivement sur l’épouvantail de la standardisation globale, en nous invitant à voir plutôt comment cette forme de productivité capitaliste se fondait sur une variété (diversity) de « niches économiques fragmentés mais reliées ».
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
« La nature aime se cacher », disait une maxime célèbre d’Héraclite3. Tout un courant intellectuel qui peut être qualifié de « post-naturel » s’est consacré depuis un certain nombre d’années à déconstruire l’évidence fuyante de cette nature à partir de traditions hétérogènes. Du marxisme à l’anthropologie en passant par les gender studies, de Bruno Latour à Timothy Morton en passant par Donna Haraway, on nous a appris à observer de manière critique les mécanismes culturels et politiques qui instaurent le périmètre du « naturel ».
Au sein de « l’écologie-monde4 » contemporaine, il y a cependant une chose qui, bien qu’elle soit partout, « aime se cacher » : la logistique. On pourrait la considérer comme une sorte de seconde nature d’origine technique et qui demande, elle aussi, un effort de compréhension critique. Nous ne pouvons pas comprendre les relations matérielles que nous entretenons avec l’écosystème planétaire en faisant l’économie d’une lecture méticuleuse des chaînes de déplacement et d’approvisionnement qui structurent le métabolisme de nos communautés interconnectées. À l’heure de l’économie globalisée, de la production just in time ou de la consommation à la demande de biens et de services, la reproduction de nos modes de vies dépend d’un immense régime logistique qui soutient la production et la livraison de ce qui nous permet de communiquer, manger, lire, nous habiller…5
La logistique aussi aime se cacher. La logistique préfère disparaître derrière ses effets, ses derniers maillons, ses services accomplis. Elle tente d’apparaitre comme neutre afin éviter d’être appréhendée comme un exercice de pouvoir et gouvernement6. Nous recevons le livre commandé par Amazon : en quelques jours à peine, voilà qu’il arrive « magiquement » dans notre boite aux lettres. Et voilà aussi que cette « magie » fait oublier les entrepôts de stockage, les serveurs de traitement des commandes, l’exploitation salariale, la sous-traitance compétitive de la livraison, le carburant brûlé par les navires cargo…
Dans l’essai Planète B, Gwenola Wagon écrit à propos du protagoniste B, avatar explicite de Jeff Bezos :
B a profité de l’accélération de l’information comme de l’envoi des colis pour raccourcir le temps de livraison. Réduire l’attente et court-circuiter l’espace-temps pour répondre instantanément au désir d’achat. Diminuer le coût de la consultation du site. Faire disparaître les traces de la locomotion et simuler que le produit est déjà là.7
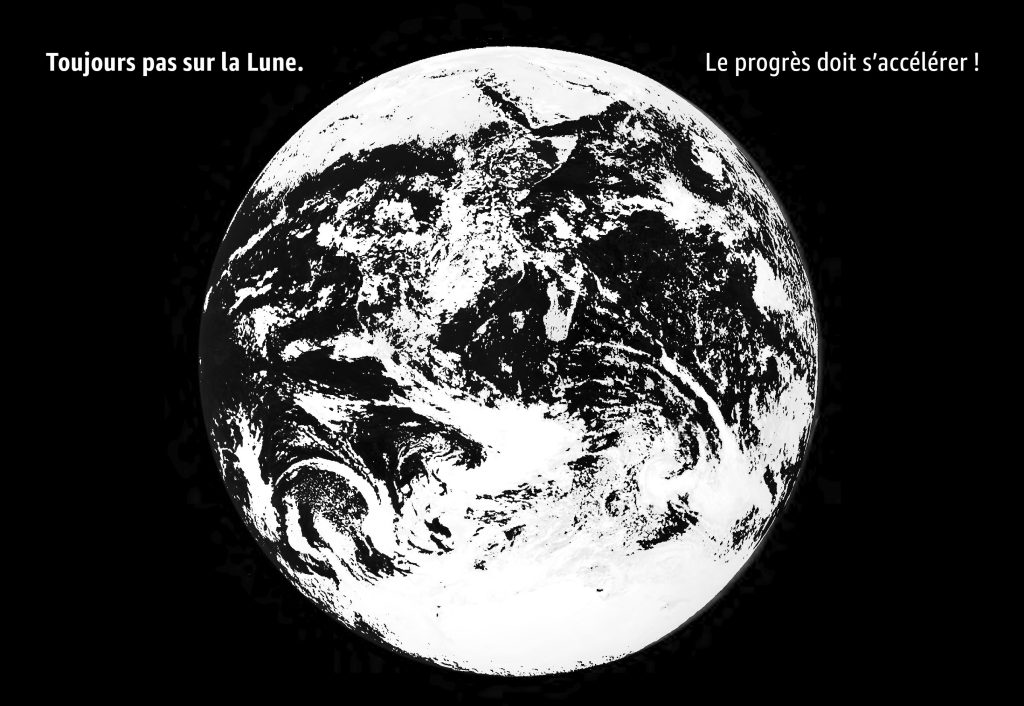
Le fonctionnement de la logistique peut être inscrit dans la tendance plus générale des médiations techniques à se cacher derrière le résultat qu’elles livrent – du moins tant que rien ne coince ou ne bugge8. Si aujourd’hui la montée en puissance de la logistique évoque immédiatement les infrastructures de la plateforme numérique et ses black boxes, elle s’inscrit dans la continuité historique de phénomènes majeurs tels que l’exploitation des énergies fossiles (charbon, pétrole…) ou l’invention du container.
Une des façons de rendre compte de cette réalité cruciale dans le champ théorique contemporain a été le développement d’études sur les questions infrastructurelles (Infrastructure Studies / Critical Infrastructure Studies), un domaine ancré surtout dans les sciences sociales9. L’infrastructure constitue dans ce champ de recherche un objet composite qui permet d’analyser autant des écosystèmes matériels de connexion, coordination et transport, que des formes de gouvernementalité et subjectivation. Voici la définition qu’en donne la chercheuse Keller Esterling dans un essai ayant marqué cette approche théorique :
Le mot « infrastructure » évoque généralement des associations avec des réseaux physiques permettant le transport, la communication ou les services publics. L’infrastructure est considérée comme un substrat caché, le moyen de liaison ou le courant entre des objets caractérisés par des conséquences, des formes et des lois positives. Pourtant, aujourd’hui, au-delà des réseaux de tuyaux et de câbles, l’infrastructure comprend des micro-ondes émises par des satellites et des appareils électroniques miniaturisés que nous tenons dans nos mains. Les normes (standards) et les concepts qui déterminent à peu près tout – des objets techniques aux styles de gestion – constituent également une infrastructure. Loin d’être cachée, l’infrastructure est désormais le point de contact et d’accès manifeste entre nous tous – les règles qui régissent l’espace de la vie quotidienne10.

Bien qu’on puisse ressentir une dilution face à cette ouverture de la focale conceptuelle, la perspective proposée par Esterling nous permet d’appréhender plus efficacement les dispositifs qu’on appelle « infrastructures » comme des objets complexes impliquant autant des couches matérielles et que des couches abstraites, des modifications des paysages terrestres tout comme des protocoles politiques internationaux ou des modulations d’espaces intérieurs subjectifs. Moten et Harney nous invitent précisément à observer le capitalisme logistique comme une combinaison d’éléments hard (des routes, des câbles, des zones de stockage, des canaux d’approvisionnement énergétique…) et d’éléments soft (programmes informatiques, ingénierie des flux, management des stocks, attentes sociales…). Si on prend, par exemple, l’infrastructure d’UberEats, nous pouvons comprendre la logistique de cet acheminement de repas à domicile comme un assemblage qui réunit une série de composantes enchevêtrées mais disparates : des véhicules particuliers, des algorithmes d’appariement demande/offre, un certain droit du travail, des smartphones connectés au réseau 5G, le désir de confort alimentaire dans un rythme de vie frénétique, des systèmes de paiement sécurisé en ligne, une cartographie interactive intégrant la géolocalisation en temps réel, une culture diffuse de l’auto-entrepreneuriat…

Le travail universitaire des études infrastructurelles n’épuise pas le spectre des gestes qui explorent ce domaine. De nombreuses opérations performatives et artistiques tentent d’entrainer collectivement une « proprioception infrastructurelle », selon le terme de l’artiste-chercheur Jamie Allen11. Des cartes du collectif Bureau d’études12 aux démontages analytiques du tandem Raffard-Roussel13 en passant par les essais cinématographiques de Gwenola Wagon et Stephane Degoutin14, les artistes essayent d’alimenter la sensibilité et la conscience des environnements infrastructurels qui façonnent notre quotidien par des gestes hétérogènes : par des ateliers pratiques de démontage, par des représentations graphiques synthétiques, par des balades-enquêtes dans l’espace urbain et numérique, par des récits spéculatifs. Comment percevoir les écosystèmes infrastructurels sur lesquels nous sommes branchés ? Et pourquoi le faire ?15 Si on les connait, alors on peut les débrancher.
Le simple sabotage des antennes 5G ou la cartographie visuelle du stack numérique ne suffisent pas tactiquement : elles doivent être accompagnées par la fabrication d’écosystèmes différents et plus désirables en termes écologiques et démocratiques.
Le même Jamie Allen a mis en évidence les limites d’un simple « dévoilement constructiviste » des infrastructures techniques, qui serait dépourvu de propositions tactiques pour des infrastructures alternatives. Il parle à ce propos de la nécessité d’une « rêverie infrastructurelle » qui activerait d’autres organisations socio-techniques par l’imagination et l’exploration16. Les limites d’un simple sabotage des infrastructures dominantes méritent également d’être questionnées. En d’autres termes, la conscience des chaînes logistiques hégémoniques et leur obstruction est nécessaire mais non suffisante. Comme l’écrit la chercheuse Fanny Lopez, il faut envisager le problème logistique des infrastructures techniques par de multiples opérations qui prolongent et dépassent les gestes d’exploration et de blocage : « débrancher des segments, réinventer les liens techniques sans forcer ni arraisonner le vivant ; repenser les structures et la gouvernementalité des réseaux »17. Cela équivaut à dire que le simple sabotage des antennes 5G ou la cartographie visuelle du stack numérique ne suffisent pas tactiquement : elles doivent être accompagnées, si on reste dans l’exemple du numérique, par la fabrication d’écosystèmes différents et plus désirables en termes écologiques et démocratiques (comme dans le cas du permacomputing ou du cloud associatif).
Ce court cadrage théorique permet de situer l’abstraction poétique de l’essai All Incomplete de Moten et Harney dans un contexte de réflexion et d’action politique plus vaste, ainsi que ses « alternatives au capitalisme logistique » mises en avant par le sous-titre de la traduction en français.
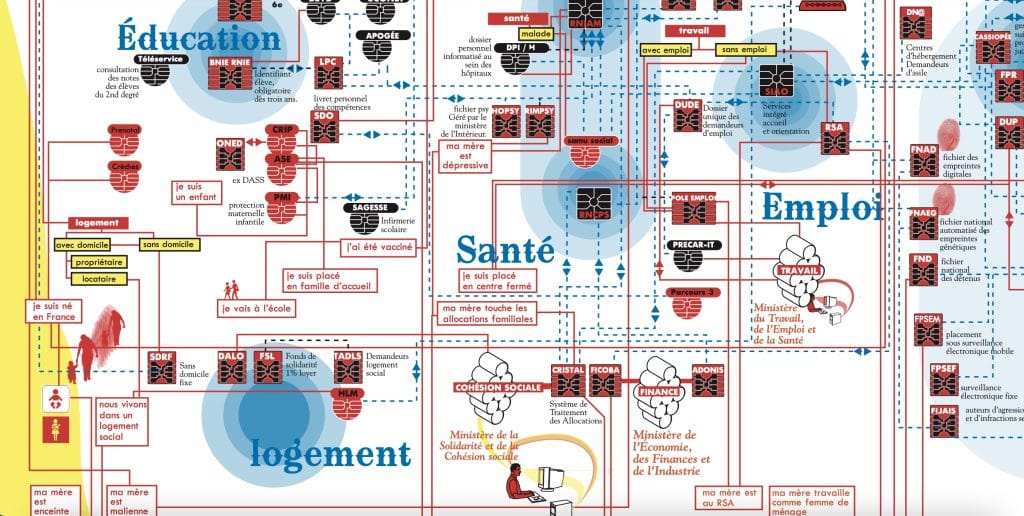
Mais qu’est-ce que donc le « capitalisme logistique » ? En trahissant partiellement la densité organique de l’écriture des auteurs, j’essaie de tracer les contours de cette perspective à la fois intellectuelle et lyrique après avoir participé à l’aventure collective de traduction de ce texte fascinant et fuyant. Cet exercice souhaite moins épuiser en la synthétisant sa prose originale qu’attiser le désir de se perdre dans le tourbillon de pensée et d’images d’All Incomplete.
Si le récit philosophique de la logistique dans « All Incomplete » s’échafaude autour de l’implication violente des corps, c’est aussi et surtout à cause de la référence raciale et esclavagiste qui l’inspire transversalement.
1. Amazon vient des cales sombres des navires négriers
Le problème de la logistique se manifeste pleinement dans le contre-jour de l’histoire coloniale – donc en amont de la motorisation, de l’automatisation ou encore de la numérisation qui ont alimenté la période d’expansion technologique et productive la plus récente, entre les XIXe et XXIe siècles. Ancré dans l’expérience passée et présente des communautés afro-américaines, All Incomplete présente « la logistique » comme « la science blanche » par excellence (p. 37). C’est dans l’appropriation et l’organisation déployées au sein de la traite esclavagiste et de la plantation que se forge à une échelle aussi grande que décisive cette science du flux : « Bien sûr, la logistique existait déjà en tant que pratique dans les affaires militaires, depuis qu’il y a des sièges, des invasions et des forts. […] La traite esclavagiste africaine et transatlantique a représenté la grande et hideuse introduction de la logistique de masse à des fins commerciales plutôt que militaires ou étatiques » (p. 180). Si le récit philosophique de la logistique dans All Incomplete s’échafaude autour de l’implication violente des corps (opposés au principe d’une expérience plus fugitive et moins individuelle de ce qu’on appelle dans le texte la « chair »18) c’est aussi et surtout à cause de la référence raciale et esclavagiste qui l’inspire transversalement.
Tout en faisant un clin d’œil aux manifestations numériques contemporaines du pouvoir logistique, chez Moten et Harney l’emploi récurrent du terme « algorithme » résume une mise en forme plus vaste et profonde que le domaine des technologies digitales. Elle s’impose corporellement comme une pulsation musicale et chorégraphique (riddim) : « Être formé·e, c’est être formé·e dans ce rythme, être composé·e algorithmiquement, être contraint·e de porter ce rythme mais aussi de le développer, de l’améliorer, de l’exporter et de l’importer, ce qui revient à dire qu’être composé·e algorithmiquement, ce n’est pas seulement être battu·e, mais battre. » (p. 99). Cette représentation ample et poétique du capitalisme logistique esquissée par Moten et Harney peut surprendre car elle n’est pas immédiatement « infrastructurelle » comme celle de beaucoup d’analyses en sciences sociales19. Sans exclure la pertinence de l’infrastructure, en effet, All Incomplete propose une interprétation plus-qu’infrastructurelle de la question logistique qui s’infiltre dans les pulsations physiques et affectives du sujet.
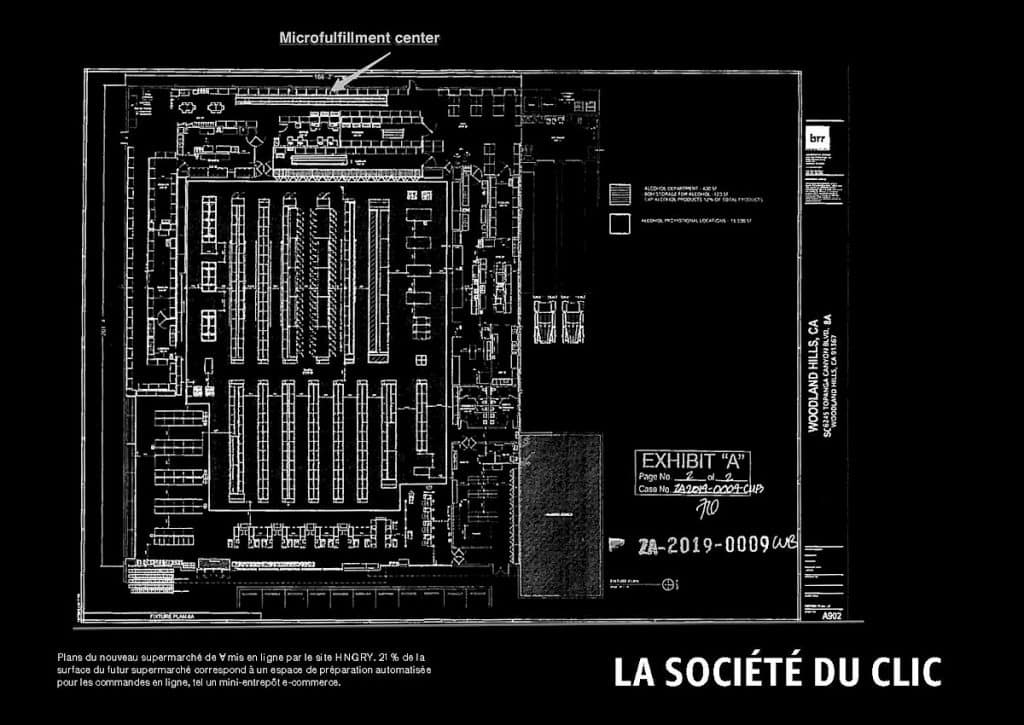
2. La logistique est Zen
Dans l’élan initial du livre, Moten et Harney se demandent : « que devons-nous tirer du fait qu’aujourd’hui la science qui semble avoir le plus réalisé la Doctrine du Cœur du bouddhisme Zen est la logistique ? » (p. 34). Cette doctrine prône une fluidité, une mobilité ou un vide qui s’avèrent être des conditions de prolifération idéales pour les opérations du régime logistique. Est-ce donc un hasard si ces disciplines orientales connaissent un si grand succès dans le monde contemporain ? La stratégie logistique adhère avec enthousiasme au ji ji muge bouddhiste entendu comme « non blocage » : « C’est la science de la logistique qui rêve de flux sans blocage et essaie de faire de ces rêves une réalité. La logistique hard et la logistique soft fonctionnent ensemble. Le yang de la Nouvelle Route de la Soie et le yin de l’algorithme fantasment tous les deux sur le non blocage. » (p. 34). Adepte acharnée de cette discipline zen, la logistique envisage la fluidité du vide comme une opportunité d’aménagement stratégique voué à la réalisation d’une accessibilité universelle et d’une mobilité sans frein. Le détournement du zen est l’emblème des aspirations totalisantes du capitalisme logistique.
Adepte acharnée de cette discipline zen, la logistique envisage la fluidité du vide comme une opportunité d’aménagement stratégique voué à la réalisation d’une accessibilité universelle et d’une mobilité sans frein.
Pour Moten et Harney, « la science capitaliste de la logistique » est condensée par la formule « mouvement + accès » (p. 71). Toute maladresse, toute déviation ou tout épuisement équivalent donc à un « sabotage » qui ralentit ou entrave ces principes de fonctionnement : « tout repos dans la vie sociale – ce que nous appellerions, avec Valentina Desideri, notre conservation militante, la fermentation de nos désirs – [est amené à être] dénoncé comme antisocial » (p. 186). Ici, il n’est pas question spécifiquement de « soulèvements infrastructurels » (infrastructural unrest) qui troublent au premier degré les flux de marchandises dans les entrepôts Amazon ou les flux de pétrole dans les pipelines20. Ce sont des phénomènes mineurs et diffus d’inaccessibilité et d’interruption – pas décorrélés, au fond, des évènements majeurs et médiatiques mentionnés que Moten et Harney célèbrent par leurs réflexions : le « repli » d’une danse, d’un barbecue, une crèche, un atelier de mécanique (p. 217)… All Incomplete nous encourage à penser des résistances « anti-héroiques » qui prennent forme dans une multitudes de moments « fugitifs » de socialité quotidienne où se réalise une soustraction au flux de la production et de l’organisation logistique. Si on reprend les catégories du matérialisme féministe, la pensée des deux auteurs étasuniens s’intéresse davantage aux couches « reproductives » de notre existence collective qu’à celles « productives ». Access denied : refuser l’accès signifie consentir au partage, précieux paradoxe.
La logistique tend ainsi à phagocyter les valeurs supposément émancipatrices de droit d’accéder et se déplacer dont devrait abstraitement jouir tout sujet. Ou, du moins, elle sème des doutes au sein de toute adhésion hâtive à la liberté d’accès ou de mouvement21. All Incomplete nous apprend à nous méfier de l’universalité positive de ces droits, à y ressentir l’intrusion impitoyable des logiques capitalistes, bien qu’on ne doive pas arrêter de célébrer contextuellement la nécessité d’un accès culturel démocratique dans le champ numérique (open access, creative commons…) ou le droit de circulation contre les frontières. À cette conception du mouvement qui fait l’objet d’une critique en tant que volonté souveraine de l’individu et processus d’accumulation capitaliste on peut opposer le « mouvementement » dont parle la théoricienne Emma Bigé : une activation corporelle et un déplacement animé plutôt par de forces environnementales et transindividuelles22. Être mouvementé est une condition irréductible à la mobilité capitaliste, dépend d’une solidarité physique ingouvernable avec ce qui nous entoure et nous traverse. En somme, le contraire de la logistique ne coïncide pas nécessairement avec une stase.
3. La logistique vise le kaizen
Le capitalisme logistique n’est pas uniquement Zen. Il aspire aussi au « kaizen », dans ses volontés de gestion pointilleuse. La logistique fonctionne selon une logique « d’optimisation » permanente et capillaire. Telle est la signification du terme japonais « kaizen » qui a été mobilisé historiquement pour exprimer l’esprit du toyotisme et la mutation du management industriel vers une flexibilité allégée (lean)23. Il faut s’améliorer et améliorer, sans cesse. Il est surtout question, ici, d’une amélioration du flux, toute amélioration individuelle ayant pour fin l’accélération du processus général : « L’importance de la marchandise n’est rien en comparaison de la qualité du flux qu’elle emprunte, qui est l’infrastructure que les travailleureuses fabriquent et rendent meilleure, plus résiliente. » (p. 185). Améliorer signifie conquérir plus de communication, plus d’accessibilité, plus de connexion, plus de vitesse, plus de production. S’améliorer signifie se rendre davantage disponible à ces augmentations, embrasser activement sa propre insuffisance comme un travail infini (donc éreintant) au service des chaînes de valorisation24. Telle est la circularité perverse de cette injonction : « La logistique vise à nous corriger, à nous démêler et à nous ouvrir à son usufruit, son amélioration ; un tel accès à nous, à son tour, améliore la ligne de flux, la ligne droite » (p. 39).
« L’importance de la marchandise n’est rien en comparaison de la qualité du flux qu’elle emprunte, qui est l’infrastructure que les travailleureuses fabriquent et rendent meilleure, plus résiliente. »
Fred Moten et Stefano Harney
Les systèmes d’évaluation et de mesure viennent au secours de cette optimisation ubiquitaire. Ils la guident, ils nous guident vers de nouvelles frontières d’efficacité et d’optimisation. Si le principe du kaizen trouve son ancrage historique dans le dépassement de la chaîne fordiste par le flux just in time toyotiste, il anime une tension plus générale de la modernité individualiste et capitaliste obsédée par ce que Moten et Harney appellent « l’usufruit » : à savoir, « la réunion de deux types d’amélioration – l’amélioration de soi et l’amélioration de la propriété au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle » (p. 177). D’une part rendre plus fluide et efficace la structure productive et sa rentabilité, de l’autre inculquer cette soif de perfection et performance au sein de l’intimité personnelle.
Vous pouvez traduire « amélioration » par « progrès », si cela rend le raisonnement plus clair. Et il n’y a progrès que si on peut s’approprier quelque chose pour exercer pleinement son droit/devoir d’amélioration contre celleux qui n’en seraient pas capables. Le capitalisme logistique perfectionne voracement, il souhaite compléter ce qui est incomplet en chacun·e. Mais cette incomplétude imparfaite constitue le partage social le plus précieux et profond, ce qui nous rassemble et nous anime. L’améliorer signifie perdre cette socialité fondamentale, la dissiper ou la canaliser productivement : « Pouvons-nous accepter et embrasser une telle imperfection, pour continuer à imparfaire chaque effondrement logistique ancien et nouveau ? » (p. 201)

4. La logistique ne nous sépare individuellement que pour nous enchainer ensemble
Moten et Harney reprennent la structure binaire qui triomphe dans la technologie informatique pour résumer la tension qui structure le capitalisme logistique. Cette structure n’évoque pas uniquement le fonctionnement numérique, elle est présentée également sous la forme déjà mentionnée d’un rythme. C’est un « rythme qui tue » (p. 98). Il a deux temps corrélés : « Le premier temps sépare, délimite, isole chaque marchandise de la suivante. Le deuxième temps rend chaque chose égale à toutes les autres. Le premier temps fait de chaque chose une entité discrète. Le deuxième temps rend toutes choses identiques. » (p. 97) On ne sépare que pour mieux relier, on n’identifie que pour mieux homogénéiser.
D’une part, le gouvernement de la logistique impose de se posséder soi-même, de devenir individu autonome et agent souverain, de s’affirmer comme productivement autonome, de s’isoler, « d’être des fins en soi » (p. 167). De l’autre, il met inexorablement les entités individuelles au service du flux, enchaîne cette prétendue autonomie à un processus frénétique et global de valorisation où l’individualité est finalement emportée, subsumée : « Aujourd’hui la logistique nous mobilise et nous met en réseau comme elle ne l’a jamais fait auparavant. Elle fait de nous des moyens comme elle ne l’a jamais fait auparavant. Elle ouvre l’accès partout et à tout » (p. 166-167). Pour le dire autrement, l’univers socio-économique contemporain encourage un individualisme forcené tout en le mettant au service de dynamiques économiques et politiques qui dépassent largement la conscience et la volonté individuelle. D’où le corollaire du point suivant.
D’une part, le gouvernement de la logistique impose de se posséder soi-même. De l’autre, il met inexorablement les entités individuelles au service du flux.
5. Le contraire de l’infrastructure n’est pas l’individu
On pourrait opposer instinctivement l’échelle personnelle et individuelle aux logiques impersonnelles et systémiques des écosystèmes infrastructurels, mais on risque de se tromper de solution, de penser qu’on résiste alors qu’on alimente l’ennemi. All Incomplete nous démontre avec véhémence ce que nous ressentons souvent comme un malaise sourd et confus : que les processus d’individuation et de subjectivation sont mis au service de la production d’un « surplus : volé, accumulé, régulé » (p. 166) qui nourrit le métabolisme capitaliste. En ce sens, Moten et Harney s’attellent à mettre à l’épreuve une certaine matrice foucaldienne et ses perspectives d’émancipation fondées sur un « souci de soi ». Ils rejettent les politiques du sujet et de l’individu, autant celles libérales basées sur des principes marchands que celles plus subversives basées sur une volonté d’émancipation individuelle : « toute forme de subjectivation, ou d’identité individuelle dématérialisée et isolée de l’écologie générale et générative de la société par le régime de travail propre au capitalisme logistique, est déjà liée à une chaîne de valeur attachant cerveau, esprit, identité et sujet. » (p. 187).
Penser contre la logistique ou contre l’échelle des systèmes infrastructurels ne signifie pas s’enfermer dans la forteresse de l’autonomie individuelle qui s’avère en être largement complice. La critique du capitalisme logistique déployée par Moten et Harney fait plutôt appel à un principe d’« antagonisme général ». La crête qui sépare ces expériences politiques opposées semble parfois fine et ambiguë – ce qui permet au premier de mieux s’accaparer les puissances du second et devenir moins intelligible. Bien que la dynamique impersonnelle et collective de l’antagonisme général pourrait rappeler certaines spécificités de la dimension logistique, il en constitue une subversion foncièrement radicale : « Au cœur de sa production [d’un tel antagonisme], il y a une certaine absence de discernement, une certaine différenciation qui ne divise pas, une consolation sans bornes contre l’isolement, une résonance haptique qui rend possible et impossible ce rythme meurtrier, la musique sous-commune qui échappe sans cesse à la logistique émergente de ce rythme mortel et l’épuise » (p. 98). Être antagoniste, généraliser cet antagonisme signifie concevoir et entretenir une résistance qui échappe à la confrontation guerrière et frontale, qui ne découle pas d’une précise rationalité stratégique. L’antagonisme qui est loué par All Incomplete consiste en une puissance solidaire et ubiquitaire qui ne cesse pas de se reproduire et de s’expérimenter dans le sous-sol d’une organisation capitaliste et étatique à laquelle la vie sociale refuse de se réduire.
6. L’informalité sociale excède toujours la mise en forme des flux
La logistique strie l’espace et le temps pour organiser des lignes de flux qui orientent les agitations locales et spontanées : « La logistique cherche à imposer une position, une direction et un flux à notre mouvement, à notre pédèse, à notre marche aléatoire, à notre errance vagabonde » (p. 166). Ainsi elle dessine des grilles dans lesquelles on canalise les lignes de fuites de ce qui s’oppose à l’appropriation et au gouvernement logistique. Ces fuites émergent sans cesse sous la forme de ce que Moten et Harney n’appellent pas seulement « antagonisme général » mais aussi « informalité ». Si le mantra de la logistique est l’accès, alors le principe de la socialité informelle est l’excès.
Si le commun demeure une perspective fondée sur des catégories politiques classiques comme l’individu ou la contractualisation, le sous-commun y échappe farouchement.
Ce qui excède renvoie à une impossibilité d’appropriation où nous nous retrouvons ensemble, donc à une sorte de puissance plutôt qu’à une diminution : « la préservation militante de ce que vous avez (un vous entendu comme un nous), dans la dépossession commune, qui est la seule forme possible de possession, de manière d’avoir en excès de celleux qui ont. » (p. 57). Et bien qu’il lui soit étranger et antagoniste, « le capital […] cherchera néanmoins à calculer, exproprier et brûler cet excès » (p. 149). La posture devient diagonale. Parler d’antagonisme permet d’éviter de parler d’ennemi, déplacer le terrain de l’affrontement, trahir moins la complexité de la situation politique dans laquelle nous sommes embourbé·es.

7. À la souveraineté contractuelle s’oppose le principe de « jurisgenerativité » sous-commune
Dans leurs travaux précédents, Motent et Harney avaient forgé une formule devenue célèbre pour décrire la dimension informelle : « les sous-communs » (undercommons). Cette formule dialoguait explicitement avec le concept de communs devenu si central dans les mouvements politiques et écologistes contemporains pour en rejeter une certaine racine contractualiste et économiciste : « L’idée des communs comme un ensemble de ressources et de relations que nous (qui sommes par ailleurs exploité·es et exproprié·es) construisons ou protégeons, gérons ou exploitons » (p. 218). Si le commun demeure une perspective fondée sur des catégories politiques classiques comme l’individu ou la contractualisation, le sous-commun y échappe farouchement : « Être sous-commun·e, c’est vivre de manière incomplète au service d’une incomplétude partagée, qui reconnaît et insiste sur la condition inopérante de l’individu et de la nation, alors que ces fantasmes brutaux et insoutenables, avec tous les effets matériels qu’ils génèrent, oscillent dans l’intervalle toujours plus court entre le libéralisme et le fascisme. Ces formes inopérantes tentent toujours d’opérer à travers nous » (p. 218).
Dans les sous-communs s’exprime ce que Moten et Harney appellent une « force jurisgénératrice » (p. 89), aux antipodes des régulations du « contrat antisocial » (selon leur jeu de mot). Ils défendent par ce concept de « jurisgenerativité » la capacité de produire des formes de vie collective par le bas et dans le partage, au lieu d’être gouverné·es par une souveraineté transcendante (ne serait-ce que celle d’un individu maître qui négocie avec un autre individu maître). Le simple fait de traverser ou habiter ensemble un certain espace public d’une certaine façon (par exemple dans le cadre d’une socialité afro-américaine) peut être appréhendé comme un moment « jurisgénératif » : « la vie noire, qui (con)sent à ne pas être seule en son irréductible socialité, est prise en flagrant délit de marcher – avec toute sa fécondité jurisgénératrice – au milieu de la rue » (p. 84)25. La théorie d’All Incomplete exprime, en ce sens, un anarchisme qui ne croit ni à la souveraineté de l’État ni à celle du sujet individuel. Et sa façon de ne pas y croire n’est pas la même, bien entendu, que cette logistique qui déborde sans cesse états et individus.
8. Le monde de la logistique s’empare de la terre
Qu’est que génère la logistique ? Un monde, essentiellement. Et ce monde infrastructuré par le capitalisme logistique se sert d’une façon extractive de la vie terrestre. À ce dernier élément se rattache la puissance de l’informalité qu’on a mentionné : « l’informalité terreuse de la vie » (p. 204), ou pour le dire autrement « la capacité résidente de vivre sur la terre » (p. 101). Par ces figures conceptuelles (monde/terre), le discours de Fred Moten et Stefano Harney exprime philosophiquement le fondement écologique sous-jacent à sa critique du capitalisme logistique qui, en ce sens, est appréhendé comme une saisie de la terre, comme un effort de la piéger et de la posséder : « Le mouvement de la terre doit être interrompu, contenu, ou affaibli ; ou alors, il faudrait pouvoir y avoir accès. Les terreux·ses doivent devenir clair·es et transparent·es, responsables et productif·ves, unifié·es dans la séparation » (p. 206).
L’appel à « tout bloquer » du 10 septembre 2025 exprimait la conscience de cette promesse de puissance qui vient de la soustraction aux injonctions du flux socio-économique du « capitalisme logistique ».
« Qu’est que ça fait d’être un problème dans la chaine d’approvisionnement de quelqu’un ? » se demandent les deux auteurs au milieu du livre. La question est bonne et complexe. Cela peut faire mal, si le quelqu’un en question décide de se débarrasser avec violence des entraves à la fluidité de sa productivité et de son progrès : de la violence sournoise d’un harcèlement administratif pour cellui qui chôme, jusqu’à la violence furieuse de l’expulsion policière d’une ZAD qui empêche le trafic aérien de s’améliorer par l’installation d’un nouvel aéroport. Le décret Sicurezza du gouvernement Meloni – par exemple – a récemment alourdi la criminalisation d’actions non-violentes propres au mouvement du soi-disant « terrorisme climatique » comme le délit d’obstruction du trafic routier ou ferroviaire26. Mais cela peut faire du bien, également, lorsque l’interruption de cette chaîne d’approvisionnement constitue un levier de mobilisation collective qui pèse dans le rapport de force contre des pouvoirs publics et privés qui soutiennent les projets les plus déchainés du capitalisme logistique. Le problème de quelqu’un peut ainsi devenir la puissance de quelqu’un d’autre. L’appel à « tout bloquer » du 10 septembre 2025 exprimait – ne serait-ce que d’une façon instinctive – la conscience de cette promesse de puissance qui vient de la soustraction aux injonctions du flux socio-économique nommé par Moten et Harney « capitalisme logistique ». Une lecture d’All Incomplete ne peut qu’approfondir et élargir la résonance de cet appel qui demeure suspendu à une mobilisation inachevée.
Image d’accueil : Pedro Farto sur Unsplash.

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
Notes
- Cedric Robinson, Marxisme noir. La genèse de la tradition radicale noire, Genève, Entremonde, 2023. Des auteurs comme Norman Ajari (Noirceur : race, genre, classe et pessimisme dans la pensée africaine-américaine au XXIe siècle, Paris, Divergences, 2022) ont récemment contribué à diffuser cette culture théorique et politique.
- Anna Tsing, « Supply Chains and the Human Condition », Rethinking Marxism, 2009, n° 21, p. 148–176.
- En réalité plus compliquée que ce qui nous donne à entendre cette traduction en langue moderne de physis kruptesthai philei.
- L’expression est de Jason W. Moore dans L’écologie-monde du capitalisme. Comprendre et combattre la crise environnementale, Paris, Amsterdam éditions, 2024.
- La veine « collapsologue » de la pensée écologiste contemporaine – de Pablo Servigne à Jean-Marc Jancovici – s’est construite autour de cette conscience en la poussant jusqu’à ses frontières les plus inquiétantes et radicales.
- Voir à ce sujet : Breit Neilson, « Five theses on understanding logistics as power », Distinktion : Scandinavian Journal of Social Theory, Vol. 13/3, 2012, p. 323–340.
- Gwenola Wagon, Planète B, Cognac, 369, 2022, p. 59.
- Voir : Yves Citton, Médiarchie, Paris, Seuil, 2017.
- Sur ce champ d’études, voir par exemple le numéro monographique de revue : Edwards, Paul N. et al. (dir.) “Special Issue on e-Infrastructure”, Journal of the Association for Information, 10/5, 2009.
- Keller Esterling, Extrastatecraft. The Power of Infrastructure Space, Londres, Verso, 2014.
- Jamie Allen, Infrastructures critiques, Dijon/Paris, Presses du Réel / Artec, 2024, p. 39.
- Pour un aperçu des œuvres cartographiques critiques du collectif voir : https://bureaudetudes.org/
- Nous pensons en particulier au travail d’enquête mené sur des outils emblématiques de notre univers technologiques quotidien comme l’imprimante ou la trottinette électrique : https://www.raffard-roussel.com/fr
- Voir en particulier le film World brain (2015) : https://d-w.fr/en/projects/world-brain/
- Voir aussi les propositions de collectifs comme Limites Numériques (https://limitesnumeriques.fr/) ou d’artistes comme Mario Santamaria (https://www.mariosantamaria.net/).
- Voir le chapitre « Au-delà du dévoilement médial » dans Infrastructures critiques, op. cit.
- Fanny Lopez, A bout de Flux, Paris, Divergences, 2022, p. 13.
- Voir les textes cités dans l’ouvrage : Theodore Harris & Amiri Baraka, Our Flesh of Flames, Anvil Arts Press, 2008 ; R. A. Judy, Sentient Flesh Thinking in Disorder Poiesis in Black, Durham, Duke University Press, 2020.
- Voir par exemple les travaux emblématiques du collectif bolognais Into the black box : https://www.intotheblackbox.com/
- Jamie Allen, « Infrastructural Unrest », 2021 (document pdf).
- La juriste Sara Vanuxem analyse finement les paradoxes et les complications des libertés de déplacement et circulation dans son dernier livre : Du droit de déambuler, Marseille, Éditions Wildproject, 2025
- Emma Bigé, Mouvementements. Écopolitiques de la danse, Paris, La Découverte, 2023.
- Sur le lien entre cette mutation et le capitalisme de plateforme contemporain, voir : Nick Snircek, Le capitalisme de plateforme. L’hégémonie de l’économie numérique, Montréal, Lux, 2018.
- On pourrait considérer la nécessité de démantèlement prônée par certains penseurs contemporains (notamment les auteurs de : Héritage et fermeture. Une écologie du démantèlement, Paris, Divergences, 2021) comme un renversement de cette injonction à l’amélioration et au progrès.
- Certains penseurs noirs critiquent ces positions, les considérant comme excessivement optimistes ou compromises : Norman Ajari, « Chair en miettes. Pessimisme, optimisme et tradition radicale noire », Multitudes, n° 89, 2022, p. 149-157.
- Voir le résumé de Vert à ce propos : https://vert.eco/articles/prison-ferme-expulsion-des-squats-litalie-de-giorgia-meloni-sur-le-point-dadopter-une-loi-securite-qui-cible-les-ecologistes
L’article Logique du capitalisme logistique, de la plantation à l’entrepôt est apparu en premier sur Terrestres.
09.12.2025 à 12:11
La Gen Z face à la corruption du monde
Alain Bertho
Avez-vous remarqué ce drapeau de pirate qui flotte aux quatre coins du monde et sert d’étendard aux peuples en révolte ? Madagascar, Maroc, Népal, Pérou… Alors que l’impuissance domine en Europe occidentale, la vitalité des insurrections récentes de la Génération Z élargit l’horizon. Cartographie et analyse de révoltes qui font vaciller les pouvoirs.
L’article La Gen Z face à la corruption du monde est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (12020 mots)
Temps de lecture : 23 minutes
Une tête de mort coiffée d’un chapeau de paille : ce curieux drapeau « Jolly Roger », emprunté au manga One piece, flotte désormais sur des foules en colère1. En octobre 2025, il est devenu le symbole de la « Génération Z », autoproclamée Gen Z, dans les rues de Lima, Antanarivo, Jakarta, Mexico, Manille, Katmandou, Marrakech et … Paris le 18 octobre.
Symbole générationnel, il est le premier drapeau international à être ainsi brandi depuis 20 ans. Le drapeau arc en ciel, symbole de paix apparu au début du siècle au sein du mouvement altermondialiste, avait été depuis longtemps troqué pour le drapeau national lors des soulèvements du printemps arabe (2011) et des places occupées (2011-2014), comme lors des soulèvements de 2018-2019 – à commencer par celui des Gilets Jaunes en France. Le drapeau national, toujours présent, est aujourd’hui complété par ce trait d’union planétaire qui proclame des exigences communes.
Enfants pirates de la Matrice
Le nom de Génération Z n’est pas né dans la rue mais trouve son origine dans la sphère médiatico-managériale2. Suivant les « génération X et Y » et précédant la « génération Alpha », démographiquement définie comme née entre 1997 et 2010, elle serait la première génération « nativement digitale », née et élevée dans un monde numérique infiniment plus prégnant qu’il y a seulement quinze ans3.
Ce constat est factuellement juste. Rappelons que depuis la naissance du World Wide Web en 1991, du SMS en 1992, du smartphone Ibm en 1994 et de l’IPhone en 2007, la croissance de la toile a été exponentielle. Nous sommes passés de 1 million d’ordinateurs connectés en 1992 à 36 millions en 1996, 370 millions au tournant du siècle, et plus de 5 milliards aujourd’hui.
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Durant ces 25 années, alors le nombre d’ordinateurs connectés est multiplié par 15, le téléphone portable a supplanté ces derniers dans les usages personnels d’Internet… et dans le nombre d’appareils. Les estimations sur le parc mondial actuel oscillent entre 8,5 milliards et 7,1 milliards, contre 3,7 milliards en 2016. Ils représentent plus de 60 % du trafic Web mondial, allant jusqu’à 90 % dans des pays sous équipés comme le Soudan, la Libye, la Syrie ou le Tchad4.
La « Matrice », née dans l’imagination de deux réalisatrices visionnaires en 19995, semble devenue réalité. Ne sommes-nous pas aujourd’hui confronté·es à un univers numérique qui capte les flux financiers comme nos rêves, nos désirs de résistance comme la surveillance policière, machine globale d’information et de désinformation, de promotion de soi manipulée par des algorithmes, de production d’images irréelles dans un monde où les ruines progressent, notamment en raison des besoins énergétiques exponentiels de la gestion des données ? L’Agence internationale de l’énergie prévoit un doublement des besoins d’électricité des Data Centers avec la progression de l’IA. Comme dans le film de 1999, la Matrice se nourrit de la destruction de la planète et de son humanité.
L’une des spécificités démographiques de la Génération Z est bien d’être née dans un monde déjà dominé par la Matrice et d’avoir été biberonnée par les portails offerts à chacune et chacun que sont les déjà vieux Facebook (2004), YouTube (2005), X (ex-Twitter 2006), mais aussi des portails plus récents comme Instagram (2010), Snapchat (2011), Tiktok, Telegram (2014) et Discord (2015).
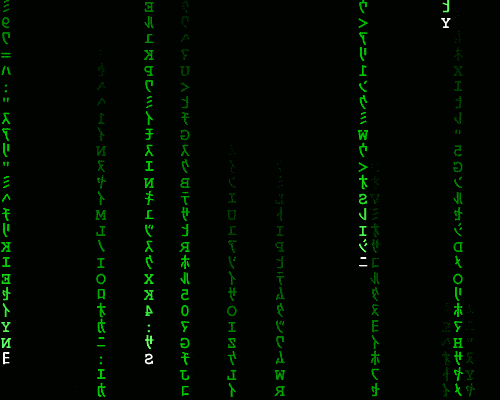
Mais ce constat ne nous dit rien du rapport de cette génération au monde social et à son avenir. Pourquoi imaginer qu’elle serait plus prisonnière de la Matrice que celles qui l’ont précédée ? Comme dans le film de 1999, et depuis vingt ans au moins, la résistance articule l’action au sein du monde numérique et l’action rematérialisée, celle des corps eux-mêmes libérés de la toile digitale. Le développement des liaisons numériques a accompagné toutes les grandes révoltes du siècle. Les photos des voitures brulées circulaient comme des trophées sur Skyrock en 20056. En 2008, Twitter a été mis en vedette pour son usage au sein de la contestation de masse des élections présidentielles de juin en Iran. En 2011, les jeunes Tunisien·es ont prouvé comment la censure d’Internet par Ben Ali avait fait d’eux des experts en cyber-résistance. Le partage des images a été un élément de poids dans le printemps arabe7. Depuis lors, quelle mobilisation peut se passer d’une présence en ligne, de compte Facebook ou Instagram ?8
À cette longue antériorité s’ajoute une expérience biographique. Voici une génération entrée dans la vie adulte dans la confrontation à une pandémie universelle, à un retour dramatique de la matérialité vitale de l’humanité et de sa fragilité. Cette génération COVID a fait l’expérience du contrôle policier universel des corps, des relations sociales enfermées dans les écrans.
Comment s’étonner, dans ces conditions, que la marque politique brandie par la Gen Z soit le Jolly Roger de One Piece ? C’est peut-être l’indice de sa capacité universelle de détourner ces portails numériques au profit d’une résistance qui prend corps dans la rue, dans l’espace public matériel de la politique.

Comment penser qu’une telle génération connectée n’aurait pas vent de ce qu’on dit ou écrit sur elle ? La voici donc qui, d’un continent à l’autre, s’approprie le vocabulaire objectivant des commentaires de celles et ceux qui l’observent comme des entomologistes observent des insectes en laboratoire. Tels les révoltés des Pays Bas en 1566 traités de « Gueux » par la royauté espagnole, elle retourne le stigmate et revendique l’étiquette qu’on lui a accolée. La voici qui brandit son nom comme une subjectivité politique pirate symbolisée par le manga le plus lu au monde, apologie universelle d’une piraterie de justice sociale. Nous y reviendrons.
➤ Lire aussi | L’effondrement a commencé. Il est politique・Alain Bertho (2019)
Le message singulier des révoltes
Les mobilisations de l’auto-nommée Gen Z marquent une étape singulière dans le message que portent les révoltes des peuples depuis 25 ans9. Elle s’affirme comme un acteur politique apartisan et exigeant, promoteur de mobilisations, porteur de principes de vie commune. La Génération Z émerge comme symbole d’un nouveau cycle de confrontation des peuples et des pouvoirs.
Elle se pense comme telle : l’adoption du nom et de la bannière affirme une culture et une subjectivité commune, une communauté de révolte. La circulation des informations, des images et des symboles construit une dynamique de propagation. Les jeunes Marocain·es de 2025 ont l’exemple du Népal en tête comme Aminatou, Bewdo et Khouma me faisaient part à Dakar en 2011 de leur souhait de faire aussi bien que les jeunes Tunisien·nes10. De la même façon, en 2019, le port du Gilet jaune avait fait école en Belgique, au Royaume Uni, en Allemagne, en Afrique du Sud, au Canada, en Irak, dans une trentaine de pays au total. Sauf en Égypte ou le gouvernement avait interdit préventivement la vente de gilets aux particuliers.
Caractérisée par ses modes d’organisation numériques et horizontaux et l’usage notamment de la plateforme Discord, la Gen Z ne se mobilise pas prioritairement en réaction à des évènements tels que ceux qui ont déclenché émeutes et soulèvements depuis 20 ans comme la mort d’un jeune ou la hausse des prix des transports ou du carburant. Ses mobilisations portent sur des principes de gouvernement et ce qu’elle perçoit comme des entorses fondamentales au bien commun : la corruption, l’austérité budgétaire qui ravage les services publics, la désinvolture démocratique, l’effondrement des états face aux mafias et à la corruption généralisée du Capital. Peu porteuse, dans l’état actuel des choses, d’une alternative constituante, elle se manifeste d’abord par la soudaineté des révoltes et par son efficacité dégagiste.

Sri Lanka, Bangladesh, Népal, Madagascar : un dégagisme expéditif
Depuis 20 ans, combien de soulèvements ont mis à bas le pouvoir en place ? Trois en 2011 (Tunisie, Égypte et Libye), un en 2014 (Ukraine), deux en 2019 (Chili et Soudan). En trois ans, depuis 2022, quatre cheffes et chefs de gouvernement ont dû prendre la fuite en urgence face à la mobilisation de la rue : le président srilankais, la première ministre bengali, le premier ministre népalais et le président malgache.
Il n’a fallu que quelques semaines aux manifestations de « l’Aragalaya » (la lutte), pour mettre en fuite le président du Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa. La lourde répression des premières manifestations contre les pénuries n’a fait que renforcer la révolte. Le blocage des réseaux sociaux a été contourné par une jeunesse virtuose d’une technologie dans laquelle elle a grandi et notamment de l’usage de VPN. Le 9 juillet 2022, l’occupation du palais présidentiel à Colombo signe la fin de la domination de la famille Rajapaksa.
Car les pénuries, la dette publique qui ont fait suite à la gestion du Covid sont entièrement mis au compte d’une dynastie dominant la vie politique du pays depuis la fin de la guerre civile en 2009. Le président Gotabya Rajapaska est le frère d’un ancien président, Mahinda, devenu son premier ministre. Leur autre frère, Basil, était ministre des finances. À l’accaparement du pouvoir politique s’ajoutent les pratiques de corruption massive d’une famille qui a mis les intérêts de l’État au service de ses intérêts patrimoniaux. La crise met en avant la coalition de gauche National People’s Power (NPP), créée en 2019, qui gagne haut la main les législatives de 2024.
La Gen Z se mobilise contre ce qu’elle perçoit comme des entorses fondamentales au bien commun : la corruption, l’austérité budgétaire qui ravage les services publics, la désinvolture démocratique, l’effondrement des états face aux mafias et à la corruption généralisée du Capital.
Deux ans plus tard, ce n’est pas la corruption mafieuse qui met le feu au Bangladesh, mais la mise en place d’un système préférentiel de recrutement de la fonction publique au profit de ce qui apparaît comme un clan. Le système des quotas instauré au profit des vétérans de la guerre d’indépendance et de leurs descendants avait été aboli en 2018. Sa restauration par décision de la Cour suprême le 5 juin 2024 génère immédiatement une mobilisation étudiante.
Le « Mouvement étudiant anti-discrimination » lance alors le « blocus du Bangladesh ». La suspension provisoire de la réforme par la Cour d’Appel le 10 juillet ne fait que renforcer la détermination du mouvement. Dans les jours qui suivent, la répression est violente, faisant une centaine de morts. Internet est coupé. La prise d’assaut du palais gouvernemental provoque la fuite en Inde de la première ministre Sheikh Hasina en poste depuis 15 ans et le basculement de l’armée du côté du soulèvement. La « Révolution de la mousson » met ainsi fin au règne de la Ligue Awami, cheville ouvrière de l’indépendance. Le prix Nobel de la paix Muhammad Yunus est nommé Premier ministre par intérim.
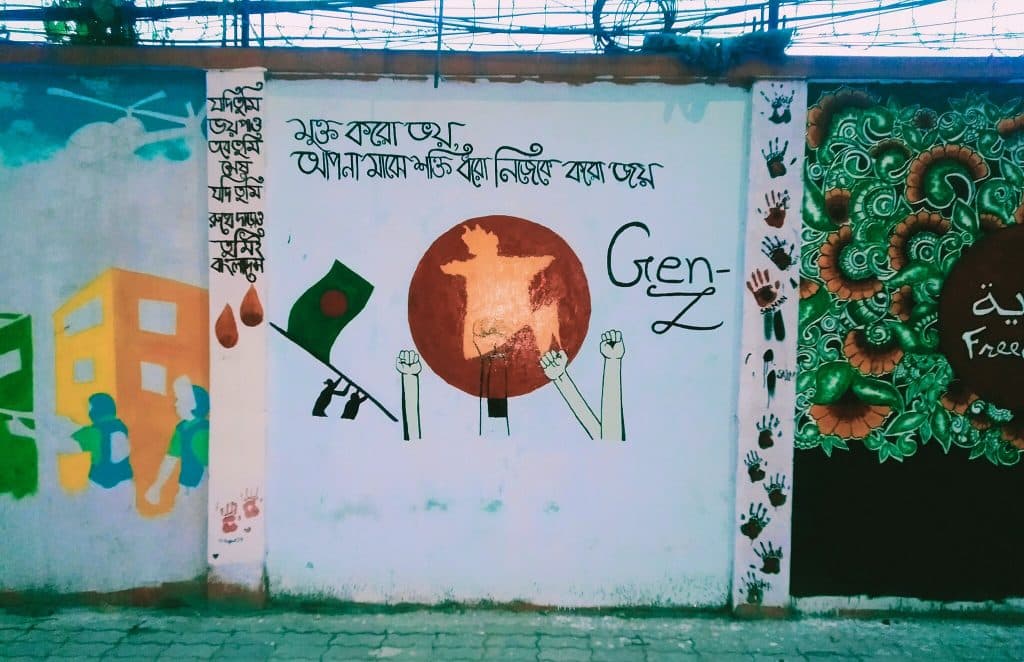
En 2025 vient le tour du Népal, où Khadga Prasad Shama Oli, dirigeant du Parti Communiste du Népal, est premier ministre pour la troisième fois. La jeunesse se mobilise sur Internet contre la corruption du gouvernement et des administrations, le népotisme et l’opulence affichée sur les réseaux sociaux par la classe politique. Pour y répondre, le 4 septembre 2025, le gouvernement ferme 26 réseaux sociaux non légalement déclarés en vertu d’une décision de la Cour suprême datant de 2023, dont Facebook, YouTube, LinkedIn, Signal et Snapchat. Mais il n’empêche pas pas Tiktok, ni la possibilité de recourir à un VPN. La Gen Z, qui constitue 40 % de la population du pays, se soulève le 8 septembre. Le drapeau Jolly Roger surgit quand la foule tente d’investir le Parlement fédéral. L’affrontement est violent. Human Rights Watch parle de 76 morts11. Dans la soirée, le blocage des réseaux est levé. Trop tard : le 9 septembre, les résidences du premier ministre et celles de membres du gouvernement et du Parlement sont prises d’assaut et incendiées, ainsi que les locaux du Parti Communiste. Le premier ministre prend la fuite. L’armée investit la rue. Le 11 septembre, des pourparlers s’engagent entre l’armée et les représentants de la Gen Z. Soutenue par ces derniers, l’ancienne juge en chef de la Cour Suprême, Sushila Karki, est nommée première ministre par intérim.
À Madagascar, comme au Sri Lanka, pénuries structurelles et corruption étatique sont aux racines de la colère. Et comme au Népal, le Jolly Roger surgit dans les manifestations. Comme au Bangladesh, l’armée rejoint le mouvement. Quatre jours suffisent pour mettre en fuite le président. La Haute Cour Constitutionnelle confie le pouvoir au colonel Michael Randrianirina qui dissout les institutions en attendant d’éventuelles élections dans un délai de deux ans.
Dans ces quatre cas, la corruption politique, l’accaparement de l’institution publique au profit de quelques un·es, famille, clan, parti, ont été les moteurs de la révolte. À l’instar des mouvements tunisien et égyptien en 2011, les soulèvements qui ne portaient pas d’alternative laissent gérer leur victoire par d’autres : les militaires au Népal et à Madagascar, une figure symbolique au Bangladesh.

La corruption comme effondrement du commun
D’autres pays sont secoués par la Gen Z sans que la mobilisation ne provoque l’effondrement immédiat du pouvoir. La corruption, et parfois l’insécurité mafieuse, sont les moteurs d’une mobilisation contre l’effondrement de l’esprit public.
En Indonésie, le Jolly Roger a été brandi par la mobilisation lancée à l’initiative de l’Union des étudiants Indonésiens contre des coupes budgétaires massives, puis contre l’augmentation des frais de fonction des députés en août. Du 25 août 2025 au 1er septembre, la répression est violente. Internet est coupé.
Aux Philippines, depuis 2024, une controverse grossit sur les milliards de pesos alloués à la gestion des inondations, les constructions au rabais et l’accaparement des contrats par un petit groupe d’entrepreneurs. Le Jolly Roger flotte à Manille le 21 septembre 2025 lors d’une violente manifestation contre la corruption. Au même moment, au Timor oriental, la décision d’acheter des SUV aux députés (pour 4 millions de dollars) mobilise victorieusement durant trois jours les étudiants à Dili, la capitale.
Au Pérou, en octobre 2025, le mouvement lancé sur les réseaux sociaux exprime l’épuisement populaire face à l’instabilité institutionnelle (huit présidents en dix ans), l’insécurité et la corruption. Le remplacement de la présidente destituée Dina Boluarte par son vice-président José Jeri, accusé de corruption et de viol, met le feu à Lima, Arequipa, Cusco et Puno. Le vieux slogan « que se vayan todos » (qu’ils s’en aillent tous) côtoie le Jolly Roger.

En novembre, des mobilisations massives emplissent les rues du Mexique contre la corruption et la violence des cartels à l’appel de la Gen Z. Le Jolly Roger flotte sur le Zocalo lors de l’assaut symbolique contre le Palais National. Si la manifestation n’a pas conduit à un soulèvement, la Gen Z fait maintenant partie du débat politique national.
En Serbie, tout est parti de l’effondrement meurtrier du portail flambant neuf de la gare de Novi Sad le 1er novembre 2024. Le drame devient le symbole de la corruption de l’État pour la jeunesse. Malgré la répression, la mobilisation sur l’ensemble du pays ne faiblit pas. Sept mois après le drame, des barricades sont encore érigées à Belgrade.
➤ Lire aussi | Pour que la dignité devienne une habitude・Omar Felipe Giraldo (2022)
La démocratie comme puissance populaire
Reste la démocratie. La politique au sens institutionnel du terme s’invite ici de deux façons : par la contestation brutale des dynasties électorales et des scores obscurs qui font des urnes une farce quasi officielle, mais aussi par la volonté de peser directement sur les grands choix du pays, notamment budgétaires.
La contestation brutale des processus électoraux est devenue un classique dans certains pays d’Afrique. Les émeutes de Guinée en 2020, de Côte d’Ivoire en 2020 et 2025, du Cameroun en 2025, ne sont pas une surprise. Quant à la crise institutionnelle du Pérou en 2023, conséquence de la destitution du président Pedro Castillo, elle a mobilisé beaucoup plus largement que la génération Z.
En 2024, il n’en est pas de même en Tanzanie où la domination trentenaire du Chama cha Mapinduzi (Parti de la Révolution) est personnifiée par Samia Suluhu, la présidente sortante et candidate à sa réélection. L’élection est précédée d’une répression systématique des opposants (parti Chadema), des journalistes et de la société civile, qualifiée de « vague de terreur » par Amnesty international. Les candidats d’opposition sont disqualifiés. L’élection de Samia Suluhu avec 97.95 % des voix provoque un soulèvement à Dar Es Salaam et dans toutes les grandes villes du pays. La jeunesse, qui s’est massivement abstenue, affronte une répression féroce. On compte au moins 700 morts.
En 2024, au Kenya, c’était la même jeunesse, connectée, informée mais sans illusion sur les processus électoraux, qui avait décidé de s’opposer à une nouvelle loi fiscale et s’en est donné les moyens en ligne : #OccupyParliament et #RejectFinanceBill2024, crowdfunding pour financer le voyage vers Nairobi le jour des manifestations. Des numéros de téléphone des dirigeants politiques sont divulgués pour les spammer avec des SMS et des messages WhatsApp. Sur le Web, un « mur de la honte » dresse la liste des hommes politiques qui soutiennent le projet de loi de finance12. Le 18 juin 2024, la rue donne corps à la mobilisation à Nairobi. Le 19 juin, le Parlement amende le texte sans le retirer, provoquant une mobilisation violente dans tout le pays. Le 25, le Parlement lui-même est pris d’assaut. Le 26 juin, le projet de loi est annulé. Comme la loi de finance de l’année précédente, annulée par la justice après une mobilisation massive en dépit de la répression. Cette puissance démocratique directe s’installe dans la durée et la Gen Z est encore dans la rue en juin 2025 pour l’anniversaire de sa victoire, et encore le 7 juillet pour les 35 ans du soulèvement de 199013.
Cette puissance est autant dans l’air du temps que dans l’ADN de la Gen Z. En Colombie, en 2021, une mobilisation populaire majoritaire et intergénérationnelle, très violemment réprimée (47 morts) s’oppose aux coupes budgétaires et aux hausses massives d’impôt prévues par la réforme fiscale. La réforme est finalement abandonnée.

Au Maroc, alors qu’on annonce depuis janvier un budget de 200 milliards d’euros pour financer la Coupe d’Afrique des Nations, mi-septembre, huit femmes enceintes meurent à l’hôpital d’Agadir lors de césariennes. Ce sacrifice meurtrier des budgets de la Santé et de tous les services publics, notamment de l’éducation, est au cœur de la mobilisation de la « Gen Z 212 » (212 est le code téléphonique du pays), qui commence le 27 septembre 2025 à Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir et Tanger, puis se répand à Salé Didi, Bibi, Kelaât M’Gouna, Inzegane, Témara, Beni Mellal, Aït Amira, Oujda et Lqliaâ. Plus de 1 500 personnes font l’objet de poursuites judiciaires. En octobre, la cour d’Appel d’Agadir prononce des peines de prison lourdes allant jusqu’à quinze ans de prison ferme pour trois accusés.
Plus modeste, le mouvement « Bloquons tout », lancé en mai 2025, appartient à la même galaxie. Certes, en France, les réserves démographiques de la Gen Z sont sans commune mesure avec le Kenya ou la Tanzanie. Mais on trouve ici aussi dans le viseur un budget particulièrement austéritaire. Les modes opératoires sont les mêmes : organisation horizontale, usage systématique de la messagerie Telegram. La fréquentation des assemblées locales préparatoires ne fait pas de doute sur la dynamique générationnelle. Si le mouvement n’a pas vraiment bloqué le pays le 10 septembre, il a néanmoins eu deux conséquences historiques : la chute volontaire du gouvernement Bayrou dès le 8 septembre et l’appel à la grève générale de tous les syndicats le 18. Jamais un gouvernement n’avait décidé de se faire harakiri devant le Parlement à la seule annonce d’une mobilisation. Jamais le mouvement syndical unanime n’avait appelé à la grève contre un projet de budget ! Et le « Jolly Roger » est sporadiquement apparu sur les défilés…
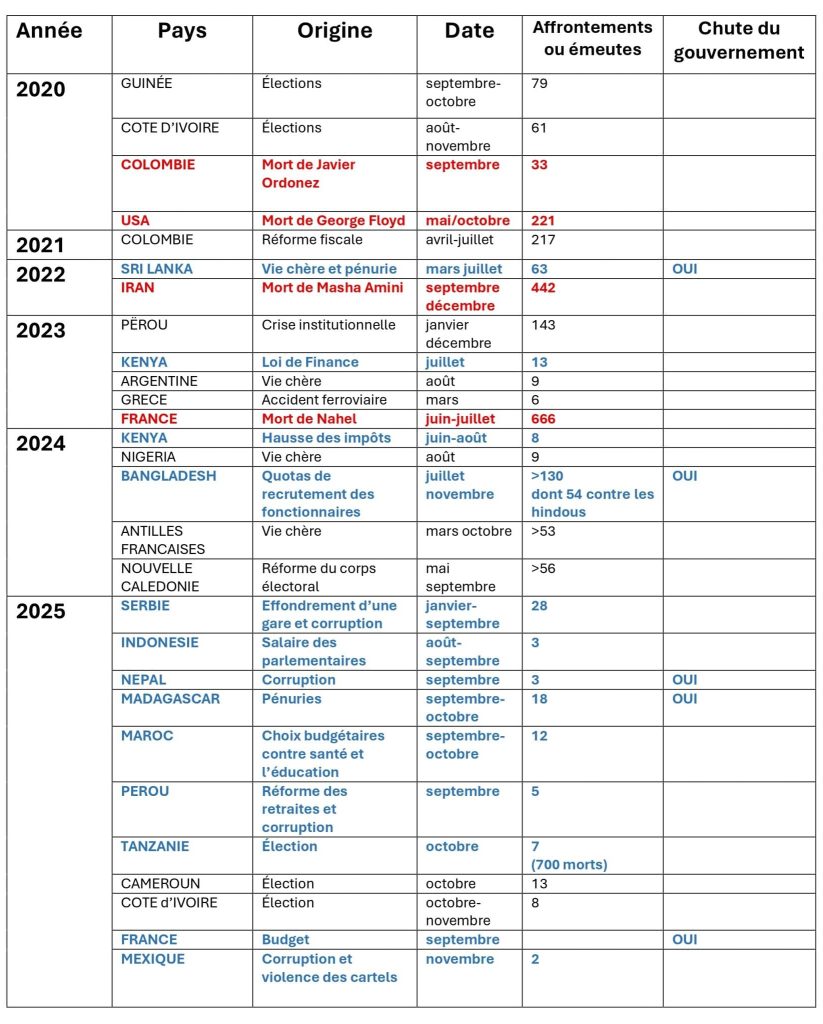
2019-2020, universalisation de la lutte, défaillance des États
Partout donc, la corruption, le népotisme et la prévarication symbolisent l’effondrement de l’esprit public, de l’État comme garant de l’avenir commun au profit d’intérêt de clans à l’heure où l’avenir même de l’humanité semble compromis. C’est un élément nouveau dans les 25 années de mobilisation et de répression violente qui ont ouvert le XXIème siècle. Ce tournant s’enracine visiblement dans l’expérience de la pandémie et la multiplication des catastrophes climatiques et écologiques vécues auxquelles les pouvoirs ne font pas face.
Inaugurée par les émeutes de Seattle à l’occasion d’une conférence de l’Organisation Mondiale du Commerce (29-30 novembre 1999) et de Gènes lors de la réunion du G8 (19 juillet 2001), la longue période de brutalisation mondiale des rapports politiques trouve donc un nouveau souffle. La mondialisation (et la financiarisation) du capitalisme et de sa gouvernance politique, engagée depuis un demi-siècle a mis à distance systématique des hommes et des femmes tant des lieux stratégiques de production du profit que des lieux de décision politique. Dans des situations nationales très diverses, les peuples ont fait l’expérience de l’impuissance politique face aux choix néolibéraux. En désarticulant les sociétés, les pouvoirs étatiques et financiers désarticulent et désarment le Demos. Les souffrances n’ont plus d’expression politique ni les revendications d’interlocuteurs. Dans ces conditions, chaque conflit court le risque de s’exprimer dans ce que Martin Luther King nommait « le langage de ceux qui ne sont pas entendus » : l’émeute. Et les émeutes se sont en effet multipliées contre la vie chère (2008 par exemple) comme face la mort de jeunes tués par la police (France 2005 et 2023, USA 2012-2014 et 2020, Iran 2022), contre la hausse du prix du carburant ou du métro (soulèvements de 2019).
Le plus souvent ponctuelles et sans lendemains visibles, prenant parfois au contraire la forme brusque d’un soulèvement national voire d’une insurrection, les émeutes, par leur récurrence peuvent aussi installer une sorte de dissidence populaire durable, de soulèvement à bas bruit. Elles cimentent alors une méfiance structurelle entre les peuples et les pouvoirs, entre le Demos et le kratos.
Ces émeutes ont une histoire que j’ai rappelée à grands traits dans un précédent article de Terrestres14. Les soulèvements de 2019 dans le monde marquent une étape cruciale. Après le lancement du mouvement des Gilets jaunes le 17 novembre 2018, de proche en proche plus de vingt pays dans le monde ont connu des soulèvements concomitants. C’est plus, en extension géographique et en durée, que les mobilisations de 2011 nommées alors « printemps arabe ».

En 2019, le déclencheur fut toujours très concret, lié à une décision ou à des pratiques gouvernementales mettant en danger la survie matérielle ou la liberté des personnes et des familles. Partout la colère englobe toute la classe politique. Mais là où le dégagisme de 2011 avait laissé de vieux chevaux de retour ramasser le pouvoir abandonné par des dictateurs en déroute comme en Tunisie ou en Égypte, les révoltés de 2019 n’ont laissé personne parler et décider à leur place. Les soulèvements devenus insurrection au Chili et au Soudan, ont engagé un processus constituant remarquable, quelle qu’en soit l’issue finale (coup d’État militaire au Soudan, référendum négatif au Chili sur la Constitution). Si le bilan global de l’année est une défaite des peuples face à la répression, celle-ci ne signe pas pour autant une victoire politique des pouvoirs en place qui perdent en légitimité ce qu’ils ont gagné par la violence d’État.
Après le lancement du mouvement des Gilets jaunes le 17 novembre 2018, de proche en proche plus de vingt pays dans le monde ont connu des soulèvements concomitants.
Immédiatement après, en 2020, la pandémie a enfoncé le clou. Avec son lot de peurs, de dénis complotistes, de solidarité, d’obéissance et de révoltes, elle a été un choc pour les peuples mais aussi pour les États. Ces derniers ont camouflé par un contrôle autoritaire des populations la révélation universelle de leur défaillance biopolitique, de leur lien privilégié avec des puissances financières – qui font même de la mort une source de profit.
2020 a été une année record pour le nombre d’émeutes et d’affrontements civils. Un cinquième des affrontements a concerné les politiques sanitaires et un cinquième les mobilisations contre la police et les violences policières. Si on ajoute les émeutes et affrontements liés aux élections, à la corruption des États et aux attaques contre les libertés, plus de 60 % des situations d’affrontement ont été générées par une remise en cause fondamentale de l’autorité publique, de sa légitimité et de sa police15.
➤ Lire aussi | Quand le néolibéralisme enfante le néofascisme : aux sources d’une révolution idéologique・Haud Guéguen (2025)
2021-2025 : un nouveau cycle
Quand la défaillance biopolitique des États devient clairement universelle, la physionomie et la géométrie des révoltes se transforme. En 2021, la brutalisation se maintient de façon diffuse. Le monde, hormis la Colombie16, ne connaît pas de grands mouvements nationaux. Puis, dans les années qui suivent, l’expression violente et localisée des révoltes marque le pas au profit de soulèvements plus larges à la fois plus fréquents et plus directement motivés par la remise en cause globale de la gouvernance néolibérale autoritaire : la violence d’État, la corruption, les choix budgétaires, le trompe l’œil démocratique des institutions électorales.
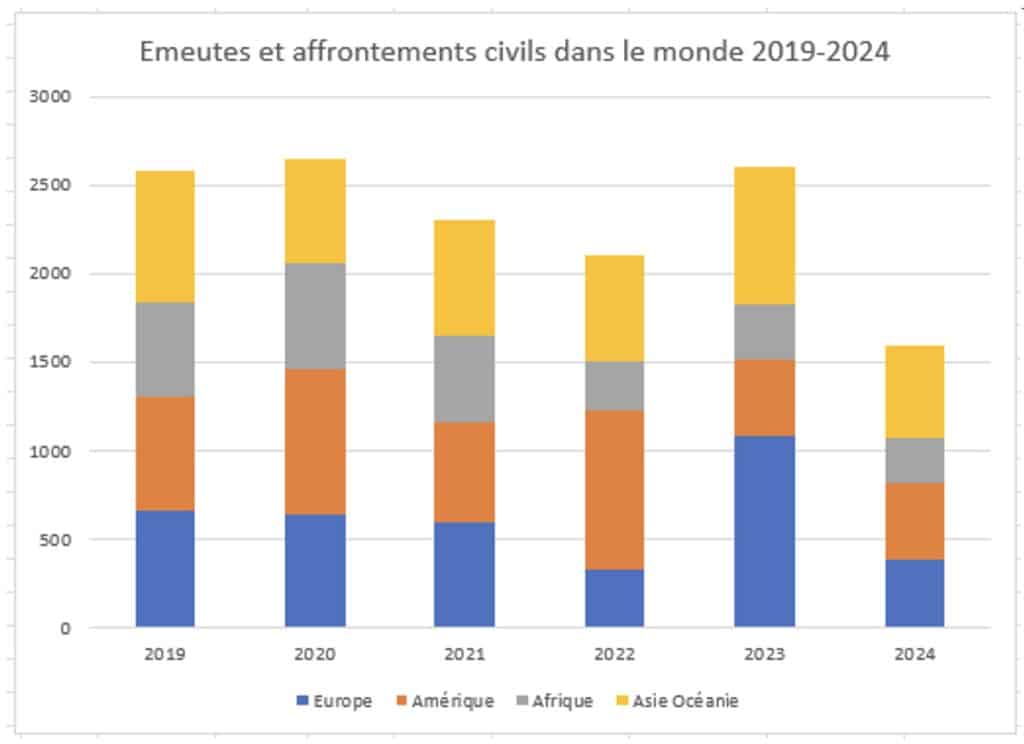
Ainsi émergent d’abord trois soulèvements nationaux : aux USA après l’assassinat de George Floyd (25 mai 2020), en Iran après celui de Masha Amini (16 septembre 2022) et en France après celui de Nahel Merzouk (27 juin 2023). Dans les trois cas, la répression est à la hauteur de la puissance de la colère populaire. Dans deux cas au moins, ces soulèvements ont une résonnance mondiale, jamais vue jusqu’à présent, dont témoigne alors la viralité soudaine et mondiale de deux mots d’ordre : « I can’t breathe » et « Femmes Vie Liberté ».
Ainsi s’ouvre donc le cycle de la Génération Z. Dans un monde aux prises avec le néolibéralisme autoritaire et une financiarisation écocidaire, depuis le début du siècle, émeutes et soulèvements sont un signe incontestable de vie des peuples et de l’humanité tout entière. Ces mobilisations ont été les véritables pulsations du siècle, portant lumière et exigences sur tous les fronts de souffrance et de résistance collective. En 25 ans, six pulsations ont ainsi secoué le monde : l’égale dignité de toutes les vies, la volonté collective de survie, la défiance démocratique, la décolonisation, la lutte contre le patriarcat et la défense du vivant17.
La Génération Z les rassemble toutes en contestant aux États le monopole de la compétence publique et celui de la légitimité démocratique, en portant le fer sur le cœur de l’époque : le sacrifice de tout intérêt public ou collectif au profit de quelques puissants. La corruption comme les budgets austéritaires sont le nom de cette mainmise universelle des logiques de profit financier sur les décisions collectives. L’exigence démocratique n’est pas qu’une question institutionnelle. Elle est une exigence de reconstitution de la puissance du Démos.

One Piece n’est pas qu’un drapeau : c’est la revendication d’une trame subjective commune, un combat contre la corruption du gouvernement du monde.
Le commun, le demos et l’ethnos
Dans ces conditions, quelques questions politiques se posent. La Gen Z a-t-elle un projet ? La référence à One Piece n’est pas indifférente, ni le succès planétaire de ce manga au propos fortement politique : un héros issu de quartiers pauvres et marginalisés, une confrontation à un gouvernement mondial corrompu…. Pour certains militants plus âgés, comme Youcef Brakni, un des animateurs du comité Vérité et Justice pour Adama Traoré, ou Fatima Ouassak, politologue et fondatrice du Front de mères, c’est clairement une leçon d’engagement qui les a formé.es dès leur enfance18.
One Piece n’est pas qu’un drapeau : c’est la revendication d’une trame subjective commune, un combat contre la corruption du gouvernement du monde. Cet ancrage culturel fait la différence entre la Gén Z autoproclamée, mobilisée et pirate, et la « Génération Z » telle qu’elle est définie démographiquement. On ne peut pas affirmer que ses « idéaux » seraient « ambivalents » au titre de la diversité politique de la génération19. Si la génération démographique est très diverse, la Gen Z mobilisée porte quelques grands principes communs et une aspiration affirmée à la défense du commun, à l’instar de Luffy le pirate. D’autre part, en comparaison avec les soulèvements de 2019, on ne peut pas dire que la Gen Z est purement pragmatique20.
Pour autant, elle n’est pas encore porteuse d’une aspiration démocratique incarnée dans un peuple politique, un Demos. Quels sont aujourd’hui les enjeux de sa constitution et de sa puissance du Demos ? Il y en a deux : la rematérialisation politique par l’assemblée et l’ancrage national du Démos politique contre la tentation de l’Ethnos identitaire.
Avec des moments forts comme « ¡Democracia Real ya! » en Espagne, les printemps arabes en 2011, la révolution ukrainienne en 2014, les mobilisations de 2019 et notamment les Gilets Jaunes, voire la mobilisation contre la réforme des retraites en France en 202321, cette question s’affirme de façon de plus en plus explicite. Elle est bien sûr une dimension incontournable des mobilisations écologiques lorsqu’elles veulent opposer une expertise populaire au monopole de la compétence revendiqué par les pouvoirs publics.

Cette affirmation d’un corps politique commun passe par l’incarnation corporelle, physique de l’exigence démocratique dans l’espace public alors que le monde économique, social, informationnel et gouvernemental veut par tous les moyens se protéger de la démocratie notamment par une numérisation galopante. Dès son origine antique, la démocratie s’est fondée dans les assemblées que la démocratie représentative a voulu ensuite éloigner du pouvoir. Les assemblées resurgissent obstinément lors de la Commune de Paris, de la révolution russe et dans tous les grands moments de soulèvement populaire. On les voit renaitre au XXIème siècle avec les places occupées de Tunisie, d’Égypte, d’Espagne et de Grèce en 2011, suivies d’Istanbul et Kiev, Nuit Debout à Paris en 2016, les ronds-points et les assemblées de Gilets Jaunes de 2018-2019.
Cette dimension est encore embryonnaire dans la Gen Z. L’installation dans la durée nécessite organisation, débat, réflexion collective sur les objectifs du mouvement. Une mention spéciale doit être accordée à la situation serbe22. Les zborovi, assemblées citoyennes, se forment au mois de mars dans les villages ou les quartiers des grandes villes23. Des revendications sont adoptées par le mouvement dès le mois de mars, débordant largement la colère initiale. « Liberté, justice, dignité, État, jeunesse, solidarité, savoir et avenir » structurent la plateforme d’un mouvement apartisan bien décidé à affirmer sa puissance citoyenne. Une véritable dissidence populaire prend racine.
En 2024, la chute de la fièvre émeutière et des affrontements civils dans le monde a été spectaculaire. La violence s’est pour une part déplacée : dans la guerre civile, dans la guerre faite aux civils jusqu’au génocide, dans des déchainements xénophobes d’une ampleur inédite.
Reste à éviter la tentation identitaire de l’Ethnos, très présente aujourd’hui. L’année 2024 fut à cet égard critique24. La chute de la fièvre émeutière et des affrontements civils dans le monde a été spectaculaire. La violence s’est pour une part déplacée : dans la guerre civile, dans la guerre faite aux civils jusqu’au génocide, dans des déchainements xénophobes d’une ampleur inédite. Il n’y a pas qu’en Cisjordanie que la logique de guerre civile et de guerre coloniale mobilise les civils. Le nombre d’affrontements directs entre les populations a augmenté de 50 % et leur poids dans la totalité des émeutes et affrontements civils est passé de 7 % à 18 %.
Nous en avons vu une manifestation terrifiante en Angleterre durant l’été 2024 quand, dans 26 villes, des foules populaires s’en sont pris physiquement aux mosquées et aux hôtels de demandeurs d’asile25. L’été 2025 a vu la peste s’étendre : en Irlande du Nord contre les Rroms, en Espagne contre les Marocains, en Angleterre enfin où les manifestations anti migrants se sont multipliées.
La Gen Z n’est pas à l’abri de cette dérive du Démos politique à l’Ethnos identitaire. Le Bangladesh en a été le théâtre dans les jours qui ont suivi la chute de la première ministre Sheikh Hasina en août 2024. Du 8 au 13 août, dans 53 districts du pays, les Hindous, stigmatisés comme partisans de l’ancien gouvernement, sont victimes de violences de masse26.
Il reste donc de ces derniers mois un sentiment d’inachèvement politique. La critique que porte en acte la Gen Z sur le gouvernement du monde est d’une grande acuité. Ni idéologie ni pragmatisme mais exigence impatiente d’un État soucieux du commun, de solidarité institutionnalisée (dans des services publics et des choix budgétaires), d’honnêteté publique. Cette impatience est expéditive, mais sans lendemains convaincants, là où les pouvoirs sont faibles. Ailleurs, elle fait l’expérience de leur résistance violente. Elle ne réalisera vraiment ses exigences en puissance d’alternative durable que dans sa capacité à redevenir, jusqu’au bout, obstinément terrestre.

Image d’accueil : Mexique, novembre 2025. Wikimedia.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
Notes
- One Piece, manga de Eiichiro Oda, est sorti pour la première fois en 1997. En 2025, 113 tomes sont publiés au Japon. Avec plus de 530 millions d’exemplaires, c’est la série la plus vendue au monde, dessinée par un seul auteur. Son jeune héros, Luffy, cherche à devenir le roi des pirates.
- Elisabeth Soulié, La génération Z aux rayons X, Cerf, 2020.
- La caractérisation alphabétique des générations est née dans les années 1960 : Jane Deverson et Charles Hamblett, Generation X, 1964 ; Jean Louis Lavallard, « Génération y les millenials », Raison Présente n°11, 2019/3
- Sources https://wearesocial.com/fr/ et https://statcounter.com/web-analytics/
- Matrix, 1999, réalisé par Larry et Andrew Wachowski, devenues depuis Lana et Lilly Wachowski.
- Réseau social créé en 2002 et fermé en 2023. Il permettait la création de blogs individuels (Skyblog).
- C’est l’objet de la thèse de Ulrike Riboni « Juste un peu de vidéo » : la vidéo partagée comme langage vernaculaire de la contestation – Tunisie 2008-2014, Université de Paris 8, 2016. Cf. Ulrike Lune Riboni, Vidéoactivismes. Contestation audiovisuelle et politisation des images, Amsterdam, 2023.
- Alain Bertho :« Énoncés visuels des mobilisations : autoportraits des peuples », in Anthropologie et sociétés, « Reconnaissances et stratégies médiatiques », 2016/40/1, pages 31-50 ; Alain Bertho « Soulèvements contemporains et mobilisations visuelles », Socion°2 , pages 217-228 ; Alain Bertho,« Émeutes sur Internet : montrer l’indicible ? », Journal des anthropologues, 126-127 2011, pages 435-452.
- Alain Bertho, De l’émeute à la démocratie, La dispute, 2024.
- Ibid., page 33.
- https://www.hrw.org/fr/news/2025/11/19/nepal-recours-illegal-a-la-force-lors-des-manifestations-de-la-generation-z
- Job Mwaura, « Manifestation au Kenya : la génération Z montre le pouvoir de l’activisme numérique faire passer le changement de l’écran à la rue », The Conversation, 25 juin 2024
- Robert Amalemba, « Kenya. Soutenue et organisée, la Gen Z résiste malgré la censure », AfriqueXXI, 22 juillet 2025.
- Alain Bertho : « L’effondrement a commencé, il est politique », novembre 2019.
- Alain Bertho, « Bilan 2020 : les peuples ne peuvent plus respirer », Médiapart, 30 janvier 2021
- D’avril à mai 2021, la grève contre la réforme fiscale et des manifestations violentes touchent toutes les villes de Colombie.
- Ces six « pulsations » du cœur battant du monde sont documentées dans le deuxième chapitre de mon livre De l’émeute à la démocratie, la Dispute, 2024.
- Voir la vidéo : ONE PIECE : Un manga POLITIQUE ??? – Fatima Ouassak, YouTube, Histoires crépues, 21 mars 2023
- Jean-François Bayart, sociologue : « Les idéaux politiques de la génération Z sont très ambivalents, et facilement récupérables », Le Monde, 9 novembre 2025
- Cécile Van de Velde, « La colère de la génération Z est très pragmatique », Le Monde, 31 octobre 2025, propos recueillis par Yasmine Khiat.
- Alain Bertho, « Et maintenant quel ordre de bataille ? », Regards, 24 avril 2023 et « Faire peuple sans populisme », Regards, 20 juin 2023.
- Pauline Soulier, « Serbie : la révolte des étudiants va-t-elle tout renverser ? », The Conversation, 10 mars 2025.
- Milica Cubrilo Filipovic et Jean Arnault Dérens, « Zbor : quand la Serbie réinvente la démocratie directe », Le Courrier des Balkans, 24 mars 2025.
- https://blogs.mediapart.fr/alain-bertho/blog/140125/fievres-populaires-en-2024-le-calme-et-la-tempete
- https://blogs.mediapart.fr/alain-bertho/blog/110924/face-l-ombre-du-pogrom-ordinaire
- https://berthoalain.com/2024/08/14/violences-anti-hindous-a-dhaka-et-52-districts-8-9-10-11-12-13-aout-2024/
L’article La Gen Z face à la corruption du monde est apparu en premier sur Terrestres.
29.11.2025 à 11:19
Gaza Inc.
Aurélien Bellanger
« La porte de l’Orient. Un Dubaï occidental. Un second Monaco. Que Gaza devienne une plateforme touristique est dans la logique des choses. » Dans un texte tranchant, l’écrivain Aurélien Bellanger projette Gaza dans un devenir technocapitaliste. Gaza Inc., futur du monde ? Toute ressemblance avec des projets réels n’est en tout cas pas fortuite.
L’article Gaza Inc. est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (2434 mots)
Temps de lecture : 5 minutes
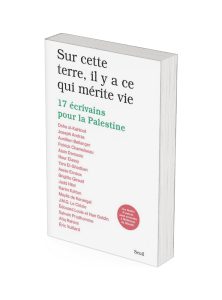
Extrait du livre collectif Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie. 17 écrivains pour la Palestine, paru en octobre 2025 aux éditions du Seuil.
On peut trouver au Japon un petit monticule fabriqué entièrement de nez, des nez tranchés et emportés comme trophées à la fin du xvie siècle après l’invasion japonaise de la Corée. On raconte qu’après la prise de Bagdad en 1258, les Mongols auraient dressé d’immenses plateformes de cadavres pour fêter leur triomphe. Les États-Unis se fantasment parfois en vaste cimetière indien.
Gaza, à son tour, sera peut-être demain agrandi d’une gigantesque marina tant il y aura de gravats à jeter à la mer – le premier complexe de luxe fondé sur une fosse commune.
On oublie souvent qu’Auschwitz, merveilleusement bien desservi et parfaitement situé au cœur de la grande plaine orientale européenne, une fois la guerre finie et sa fonction première achevée, aurait dû être le nom d’une cité idéale du Reich millénaire.
Gaza Inc.
La porte de l’Orient. Un Dubaï occidental. Un second Monaco.
Assez de gravats encore, une fois la marina mise à l’eau, pour construire un hub aéroportuaire et un quartier d’affaires.
Qu’une présence excessive d’os dans le ciment affaiblisse ses propriétés mécaniques sera un problème d’ingénierie facilement réglé – du même ordre que celui de la construction du Burj Khalifa sur le sable mou du désert.
Gaza : une épopée architecturale. Gaza : les constructeurs de l’extrême.
Mieux : un verrou historique longtemps bloqué qui saute.
Non pas une solution à un, deux ou trois États, mais une solution sans État.
Un pays effacé par les bulldozers, une page blanche géographique.
C’est Curtis Yarvin, un conseiller officieux de l’administration Trump, qui a donné le meilleur aperçu du projet – l’un de ceux qui poussent à l’abolition de la République et à la proclamation de l’Empire, sur le modèle de ces entités que les technocapitalistes chérissent, et derrière lesquelles les lecteurs de dystopies cyberpunk reconnaissent les zaibatsus de leurs cauchemars.
Il faudrait faire de Gaza, écrivait-il dans un texte prémonitoire qui a sans doute servi de prompt à ces vidéos de Trump et de Netanyahou se délassant des fatigues de la guerre dans un Gaza futur rempli de Trump Towers, il faudrait faire de Gaza l’avant-pont d’une gestion toute capitalistique de l’histoire et de la géographie.
Évacuer ces Palestiniens archaïques, mais leur laisser des parts du capital du Gaza à venir. Gaza comme lieu de toutes les mutations et expérimentations du capitalisme dérégulé.
Qu’ils prennent aussi, on n’est pas des monstres, leur part du spectacle.
Le billet de l’exil leur donnera droit à quelques dividendes.
Ce n’est pas un hasard si l’administration Trump s’est entichée du président salvadorien, qui gouverne son pays comme une prison de haute sécurité et dont le père appartient à la diaspora palestinienne.
Si la majorité des Israéliens, qui soutiennent la guerre, doivent considérer Gaza comme un problème local – sur un spectre allant de la gestion sécuritaire d’un quartier sensible au messianisme du Grand Israël –, on aurait tort de ne pas considérer Gaza comme une question mondiale.
Comme la section R&D de l’entreprise monde.
Que les démocraties, pour se défendre, aient tous les droits, n’a pas manqué de mobiliser les droites du monde, enfin réconciliées avec ce modèle de gouvernement pour lequel elles n’avaient pas d’affection particulière – jusqu’à ce qu’il leur soit démontré qu’il pouvait servir d’alibi à un déchaînement de violence qu’on tolérerait moins bien d’une dictature.
Gaza a remis la mort à l’agenda démocratique, et cela sera toujours bon à prendre, pour plus tard. Encore plus quand on possède, comme la France, certains des derniers territoires non décolonisés du globe.
À Gaza, on tue des civils, des enfants, des journalistes, en toute impunité ; à Gaza, des intelligences artificielles et des drones déciment des familles entières ; à Gaza, le maintien de l’ordre tient son salon à ciel ouvert.
Mais si nos démocraties regardent Gaza comme le banc d’essai des arts du gouvernement au xxie siècle, les technocapitalistes regardent déjà, par-dessus leur épaule, le butin supérieur qu’ils pourront emporter.
Et si le déni de la légitimité de la cause palestinienne était le cheval de Troie de la suppression du concept vieillissant d’État-nation ?
Ce qui ne poserait d’ailleurs pas de problème particulier à Israël, qui aura profité de la guerre pour définitivement muter d’État-nation européen fantôme de l’après-1848 à une entité religieuse chargée d’une mission largement œcuménique, qui séduit autant les évangélistes messianiques que les amateurs de croisades tardives.
Gaza Inc.
On passe à autre chose. On investit dans une plateforme territoriale comme on investirait dans une plateforme de cryptomonnaie.
La chose est bien documentée : Gaza est le dernier avatar du concept de zone par où le capitalisme a échappé aux régulations nationales.
Que le capitalisme, pour muter, doive se transformer parfois en machine de mort, c’est quelque chose que le théoricien marxiste Moishe Postone avait relevé dans ses analyses d’Auschwitz en tant qu’usine.
Usine à cadavres, dont on a longtemps pensé qu’elle était, en contradiction avec le projet capitaliste, une aberration absurde et monstrueuse. À moins de considérer qu’elle visait au contraire à purifier le capitalisme de son élément abstrait, traditionnellement confondu, selon la grille de lecture antisémite, avec les Juifs. Voilà ce que le capitalisme, pour devenir enfin productif, devait expier. Pour prouver qu’il n’était pas un système de domination, qu’il était naturel, qu’il servait les besoins des hommes, qu’il était la douceur même et qu’il n’avait rien de barbare, il lui fallut donc, à un stade critique de son développement, se lancer dans une entreprise génocidaire inédite.
Et si c’était cela que Gaza nous montrait ?
Gaza et l’étrange passé simple de ce nom qui désigne l’à-jamais révolu, le crime unique et absolu, qui pourrait, en régime capitaliste, revenir pourtant comme un fantôme purificateur.
La zone la mieux aménagée reste à ce jour le parc d’attractions – dont le premier du genre, selon une légende urbaine qui dit tout de la nature sépulcrale du projet, cacherait le corps cryogénisé de son fondateur sous les fondations d’une montagne russe.
Gaza Inc. aura bien ses montagnes russes.
Qui seront, comme elles le sont toutes, des machines à générer l’effroi.
Des petits trains de la mort, dans ces usines à prélever, mieux que la force de travail et la survaleur fétichisée des créatures humaines, directement leur temps de loisir et leurs derniers instants de liberté.
Que Gaza devienne une plateforme touristique est dans la logique des choses. Le tourisme, qui se présente encore comme la dernière récompense accordée aux travailleurs, organise plutôt leur disparition progressive.
Le petit train fantôme roule déjà sur les réseaux sociaux sans même qu’il soit besoin de recourir aux images générées. Des bras coupés nous frôlent, des têtes de bébés sans yeux, des corps tranchés en deux.
Gaza ne sera bientôt plus qu’une rampe inclinée au fond de la Méditerranée orientale – la machinerie qui nous entraîne plus bas et plus loin qu’on ne pensait, encore plus bas que la mer Morte, là où la vie sur Terre pourrait même disparaître.
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Image issue du plan « Gaza 2035 » diffusé par le cabinet de Benjamin Netanyahu au printemps 2024.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
L’article Gaza Inc. est apparu en premier sur Terrestres.
25.11.2025 à 17:22
Décoloniser nos assiettes
Vipulan Puvaneswaran· Clara Damiron · Shams Bougafer
Universelle, la viande ? Pas du tout : c’est la colonisation et le capitalisme qui ont imposé le carnisme. Dans la plupart des cultures, l’alimentation de base est largement végétale. Même en France, on pourrait composer un véritable “véganisme populaire” avec d’anciennes recettes. Tour d’horizon des coutumes, pour mieux liquider nos héritages impérialistes.
L’article Décoloniser nos assiettes est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (13528 mots)
Temps de lecture : 30 minutes
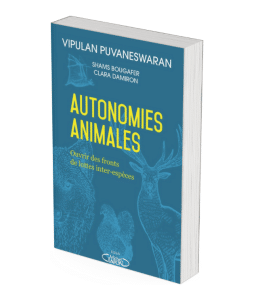
Ce texte est extrait du livre Autonomies animales – Ouvrir des fronts de luttes inter-espèces (Michel Lafon, 2023), écrit par Vipulan Puvaneswaran, Clara Damiron et Shams Bougafer.
Comprendre, raconter ou écrire l’histoire des mécanismes d’oppression a souvent été un outil pour lutter contre ceux-ci. Dès lors qu’on cherche à comprendre les faits et gestes de notre quotidien, la plupart des choses qui composent nos journées, ce que l’on mange notamment, se révèlent fondées sur des représentations symboliques ou des rapports de domination. L’hégémonie et l’omniprésence actuelle de certaines pratiques sont donc le résultat de rapports de force, de circonstances historiques précises, et parfois d’un peu de hasard, qui ont favorisé et généralisé une chose plutôt qu’une autre. Les plantations bananières n’auraient peut-être pas recouvert et asservi les Antilles si un « explorateur » espagnol n’avait pas eu l’idée d’emporter, en 1516, des plants de bananiers africains dans son navire, et si les plantations n’avaient pas par la suite été encouragées par l’empire colonial. Sur un autre plan, c’est la viande des vaches de race limousine qui est la deuxième la plus convoitée sur le marché français aujourd’hui. Pourtant, cette race, fabriquée à l’origine par la sélection humaine pour sa force au travail, a manqué de peu de s’éteindre au lendemain de la guerre : sa descendance a tenu à peu de choses. Et on ne servirait pas de tartiflette dans les restaurants savoyards de toutes les grandes villes françaises si un restaurateur, à La Clusaz, n’avait pas baptisé ainsi cette vieille recette régionale en 1970, lors d’une crise de surproduction du reblochon. Ces choses, qui font aujourd’hui partie de notre quotidien, auraient pu ne pas arriver, ou arriver autrement, ou à un autre moment, si les rapports de force avaient été différents.
Enquêter sur l’évolution des pratiques alimentaires – que ce soit la composition de l’alimentation, les façons de cuisiner, les habitudes populaires, et les imaginaires qui y sont rattachés – peut nous permettre de cerner le rôle que l’impérialisme et la colonisation ont joué dans la diffusion massive du régime carné, et des rapports au monde qu’il véhicule sans pour autant affirmer que toute alimentation carnée est le fait de la colonisation européenne.
Retrouver nos héritages végétaux, inventer des pratiques conviviales
Nos héritages sont la marque d’autres rapports aux mondes animaux et d’autres manières de vivre, nous pouvons apprendre de ceux-ci et nous en inspirer. Aujourd’hui, l’idée que la chair des animaux terrestres ou aquatiques, le lait ou les œufs sont des « choses », des produits consommables, est très fortement répandue. L’estomac humain est effectivement adapté à une grande diversité de régimes1, mais c’est la « norme carnée » (celle qui dit qu’il est normal de consommer quotidiennement des produits d’origine animale : chair, produits laitiers, œufs, etc.) qui domine à présent presque partout dans le monde. Faudrait-il donc systématiquement exploiter, enfermer, tuer pour se nourrir ? Et, si la colonisation et le racisme sont allés jusque dans nos assiettes, comment s’en défaire ? A-t-on d’autres héritages sur lesquels s’appuyer ?
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Nous avons choisi d’utiliser le terme de carnisation, formé à partir du terme « carnisme2 » qui désigne le système de valeurs qui accompagne et légitime la consommation de produits issus d’animaux. La carnisation, pour nous, est un processus de transformation des sociétés qui les amène à utiliser les corps d’animaux pour leur subsistance d’une certaine manière : plus systématique, plus banalisée, plus marchandisée. Cela se traduit notamment par l’adoption d’un régime alimentaire de plus en plus carné, au sein de sociétés qui n’avaient pas ce régime auparavant – c’est-à-dire que leur alimentation reposait principalement sur des produits d’origine végétale3. Lorsqu’on parle de carnisation, cela ne veut pas seulement dire qu’il arrive de manger de la viande, mais que cela devient la norme. C’est un nouveau régime alimentaire car, si on lui soustrayait ses aliments issus d’animaux, il serait largement admis qu’il lui « manque » quelque chose, en termes nutritifs mais aussi symboliques ; plutôt qu’une diversification de l’alimentation, on assiste davantage à l’abandon et l’oubli progressif des autres pratiques qui le précédaient : on perd de vue les plats de base qui contenaient des protéines végétales, et donc aussi le savoir-faire pour les cultiver et les cuisiner. Bien souvent, la diversité des végétaux consommés diminue car cette carnisation, nous l’avons vu, est allée de pair avec le développement de la monoculture. Au-delà de ce que l’on plante et de ce que l’on met dans son estomac, la carnisation met aussi en jeu (et c’est peut-être le plus important) une transformation des relations entre humains et non-humains, avec la mise en place de moyens de domestication, de domination et de contrôle plus approfondis et plus systématiques, la transformation du travail dont nous avons parlé précédemment et la mise à mort systématique. La carnisation implique donc un nouveau gouvernement du vivant, tourné vers la marchandisation des corps et des produits animaux. Sans le processus de carnisation à l’échelle mondiale, des scientifiques n’auraient pas établi par exemple que les ossements de poules (70 milliards de poules d’élevage tuées dans le monde en seulement une année) sont si nombreux dans le sol, que cela constituera l’un des principaux marqueurs de l’anthropocène au niveau géologique4. Le terme de carnisation sert ainsi à s’appuyer sur l’impact matériel et la transformation du quotidien, de l’intime qu’implique l’exploitation animale. Ce mot insiste aussi sur le fait qu’il s’agit bien d’un processus historique (progressant par étapes, parfois freiné ou interrompu) lié à l’action de certains groupes sur la société : nous verrons que des colons européens ont souvent joué ce rôle de carnisateurs, en fonction de leurs intérêts économiques, politiques et territoriaux.

➤ Lire aussi | Vivre avec les animaux : une proposition politique・Pierre Madelin (2019)
La bétaillisation des Amériques
À nouveau, commençons notre récit en Amérique centrale. Au second voyage de Christophe Colomb, celui qui marque le début de la conquête des Amériques, les colonisateurs espagnols transportèrent 34 chevaux et un grand nombre d’animaux de bétail. Les navires qui suivirent continuèrent à disperser le bétail européen dans toutes les Antilles5. Au cours du xvie siècle, l’invasion du Mexique fut l’occasion pour les conquistadors d’y introduire à leur tour chevaux et bétail. Une fois les Aztèques vaincus, les colons espagnols s’emparèrent des terres de l’empire mexicain pour y installer des animaux exploités pour leur viande et leur peau. Le décalage avec les façons de vivre et d’habiter des Aztèques est saisissant. En effet, l’alimentation aztèque reposait beaucoup sur la culture du maïs, des haricots, de la courge (ces plantes sont d’ailleurs surnommées les « trois sœurs ») et de quelques insectes. Il arrivait aux Aztèques de manger de la viande mais il semble que c’était très rare. Ils n’ont domestiqué que deux types d’animaux avec lesquels ils partageaient leur espace de vie : des dindes et des canards (outre les chiens, mais leur domestication n’est pas le fruit de la civilisation aztèque)6. Alors que la conquête coloniale avançait, les Espagnols étaient surpris du faible nombre d’animaux domestiqués (et mangés) en Amérique du Sud, et ce malgré l’existence d’espèces qui auraient pu l’être (comme le capybara, l’agouti doré ou le tapir du Brésil)7. Aussi, les colons ont démarré l’élevage d’animaux du continent déjà domestiqués, tels que les dindes, canards et lamas, leur donnant une nouvelle dimension.

La bétaillisation a profondément transformé les territoires et les sociétés, comme le montre par exemple l’introduction de bovins et de chevaux au xvie siècle dans la région du Rio de la Plata (située entre l’actuelle Argentine, le Paraguay et l’Uruguay). Celle-ci a créé de nombreux groupes d’animaux marron qui ont suscité l’intérêt des gauchos (des colons espagnols et enfants « mixtes » issus d’Espagnols et d’indigènes). Ceux-ci chassaient le bétail sauvage et combattaient les indigènes qui résistaient à la colonisation. Leur gagne-pain provenait essentiellement de la traite des peaux de chevaux et du bétail marron. Le marché des peaux et du cuir, qui explosa, attirait toujours plus de colons venus tenter leur chance en Argentine. Alors que 150 000 peaux étaient exportées du port de Buenos Aires en 1778 à destination de l’Europe, pas moins de 1 400 000 peaux (presque dix fois plus) transitèrent vers le Vieux Continent cinq ans plus tard. À la fin du xviiie siècle, les colons installèrent des usines de salaison qui permettaient également d’exporter la viande argentine. Les clôtures finirent par structurer le paysage. Le développement de ces activités économiques a considérablement favorisé l’immigration d’Européens et d’Européennes, en même temps que les populations amérindiennes disparaissaient, si bien qu’en 1890, l’Argentine est devenue l’un des principaux exportateurs de viande à l’échelle mondiale. Sur des terres qui ont connu des peuples dont les rapports de domesticité étaient peu nombreux et non systématiques, les populations européennes ont établi l’une des plaques tournantes de l’élevage industriel. Sous les effets de la colonisation, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont connu pareilles trajectoires.
Nulle part ailleurs, on ne mange autant d’animaux qu’en Amérique. Cette société carniste s’est pourtant fondée sur des terres où le spécisme moderne n’existait pas.
La bétaillisation des Amériques se fonde donc sur une violente prise de terres, qui organise un nouveau rapport au monde. Nous pouvons parler ici, comme dans le cas des monocultures généralisées qui vont recouvrir les Antilles, d’un « habiter colonial8 », c’est-à-dire une nouvelle organisation de la vie qui s’impose par la violence à ceux qui peuplaient le territoire auparavant (humains comme non-humains) : monocultures, prés privés, routes sur lesquelles on convoie les animaux vers les abattoirs. On parle ici d’une façon violente d’habiter le monde, en s’appropriant les corps et la terre. Cet habiter colonial n’a pas disparu avec la soi-disant fin des impérialismes, car c’est bien cette façon de se rapporter à la terre et aux corps (comme des propriétés) qui conditionne encore nos façons de vivre aujourd’hui. Nulle part ailleurs, on ne mange autant d’animaux qu’en Amérique. Cette société carniste s’est pourtant fondée sur des terres où le spécisme moderne n’existait pas : il a été imposé par la conquête coloniale, et a occupé la terre jusqu’à faire disparaître presque tous ceux et celles qui vivaient autrement. La bétaillisation des Amériques, accompagnée de sa carnisation, se répand encore partout où l’habiter colonial continue sa course, notamment au Brésil où la déforestation de la forêt amazonienne et la spoliation des terres paysannes par l’agro-industrie et pour l’élevage avancent plus vite que jamais sous l’action de puissants lobbys9. Cette façon d’habiter signe aussi la fin de nombreux liens entre humains et animaux, et poursuit la transformation des corps et des terres en « machines à produire ». Ces trajectoires historiques donnent lieu à des luttes partagées, notamment au Brésil où les paysans et paysannes dépossédés et les mal-logés (les « sans-terre » et les « sans-toit ») font alliance avec les animalistes contre les lobbys de l’élevage et de la malbouffe : la carnisation a aussi ouvert des fronts de lutte communs.
La carnisation des plats en Afrique de l’Ouest
Le véganisme est souvent associé et défendu par ses militants et militantes comme un horizon de progrès : après avoir aboli l’esclavage et donné le droit de vote aux femmes, il serait dans la suite naturelle de l’histoire de libérer les animaux de l’exploitation. Le véganisme serait la suite logique du progrès des sociétés occidentales. Mais la carnisation contredit cette lecture « progressiste » de l’évolution des régimes alimentaires. Elle montre, au contraire, que c’est l’avènement des sociétés capitalistes modernes qui a conduit à une augmentation sans précédent du nombre d’animaux tués pour les sociétés humaines ; engendrant une crise profonde des rapports que l’on entretient aux animaux et au vivant, de façon générale. Cette lecture ouvre aussi la voie à un « racisme de l’assiette », qui consiste à associer les personnes racisées à certaines viandes qu’elles mangeraient, une généralité (dépréciative) qui sous-entend aussi que les colonisés et leurs descendants ne seraient pas « arrivés » au stade moral avancé du « devenir végane ». En multipliant les clichés, sur l’abattage rituel, les fêtes religieuses, le traitement des animaux dans les pays du Sud, on déforme la réalité et on en vient à penser que les plus cruels avec les animaux sont les personnes non blanches. Il est pourtant inutile de « blanchir » le régime végétalien en prétendant qu’il serait une invention occidentale, de même que d’essayer d’en faire une marque de distinction ou le signe d’une moralité plus avancée. Au contraire, nous voulons rappeler que les traditions alimentaires végétales ont souvent été bien plus puissantes dans des histoires non occidentales.
La carnisation montre que c’est l’avènement des sociétés capitalistes modernes qui a conduit à une augmentation sans précédent du nombre d’animaux tués pour les sociétés humaines.
En effet, nous connaissons tous des stéréotypes sur l’alimentation des personnes racisées. KFC a abusé de ces représentations10 en ciblant, dans une publicité australienne pour la viande de poulet, les populations noires que l’on assigne à la malbouffe et au fast-food. En parallèle, en Afrique de l’Ouest, on assiste à une forme de néocolonisation de l’assiette avec l’importation massive de ce que les Béninois appellent le « poulet morgue » : de la volaille à très bas prix congelée et importée d’Europe, des États-Unis ou du Brésil, élevée avec des intrants (antibiotiques, farines, hormones), à l’origine de problèmes de santé et de zoonoses (maladies ou infections qui se transmettent des animaux vertébrés à l’humain et vice versa). Cette viande fait concurrence aux « poulets bicyclette » : une viande issue d’animaux rustiques à croissance lente, vivant en plein air, dans la nature ou dans les rues, et se nourrissant des restes de récoltes ou de maisons. Des campagnes citoyennes parlent même de « nutricide », un terme inventé aux États-Unis, qui désigne la façon dont l’industrie agroalimentaire produit une alimentation à destination des populations pauvres, noires en particulier, qui augmente les risques de problèmes cardio-vasculaires, de diabète et d’obésité11.

Pourtant, jusqu’à la colonisation, nombre de régimes alimentaires africains, ceux de l’Afrique de l’Ouest plus particulièrement, reposaient essentiellement sur les plantes et les végétaux. La flore luxuriante de ces pays (notamment en zone tropicale) y était propice. Des spiritualités africaines et plusieurs mythes fondateurs sont emplis d’histoires d’animaux ayant rendu service à leur communauté, au point de marquer des interdits de consommation de leur chair. Par exemple, pour les Nyabwa de Côte-d’Ivoire, les interdits qui varient de village en village concernent la chair de la panthère, de la gazelle, du chien, du bouc, de la chèvre, du bœuf (mêlant donc animaux domestiques et animaux dits « de brousse »), des poissons de certaines rivières, de l’aigle, du poulet, etc.12. Historiquement, quantité de plats « africains » étaient entièrement basés sur le végétal. Il en reste d’ailleurs des traces : que ce soit l’attiéké de Côte-d’Ivoire, l’atassi du Bénin ou le mafé du Mali, ces plats bien connus portent tous des noms de plantes. La viande est secondaire, voire n’y a été ajoutée que très récemment. Chaque fois que l’on mange de la viande dans l’un de ces plats, il semble qu’il s’agit de plats « carnisés », c’est- à-dire détachés de leurs contextes végétaux pour n’être plus envisagés autrement qu’avec de la viande. Nous manquons de données et de recherches pour mieux comprendre qui a joué quel rôle dans ce processus : les colons, les élites locales ? Ou encore les diasporas ? Quoi qu’il en soit, ce processus s’est accompagné d’une valorisation culturelle du fait de manger un animal ou de boire du lait. Un fait marquant à ce sujet concerne le nombre de personnes intolérantes au lactose, très élevé dans l’ensemble des pays africains (70-90 %)13, alors que ce taux est de 21 % chez les populations d’origine britannique en Amérique du Nord, et descend en dessous de 20 % en Italie, en Autriche ou en Angleterre, par exemple. Nos microbiotes intestinaux portent ainsi la marque des différentes époques de la carnisation : les intolérances alimentaires révèlent, entre autres choses, que la consommation de lait est plus ou moins récente d’une population à l’autre. Malgré cela, de grandes firmes européennes exportent chaque année sur le continent africain des milliers de litres de lait pour écouler la surproduction européenne, en particulier du lait en poudre enrichi en graisses végétales, ce qui selon le réseau IFBAN constituerait l’une des causes majeures de la dénutrition des enfants dans les pays concernés. Le réseau accuse 27 fabricants de violer l’interdiction prononcée par l’OMS en 1981 en faisant de la publicité pour leurs laits de substitution, en incitant les femmes à stopper l’allaitement, et en corrompant les professionnels de santé à qui ils distribuent des échantillons gratuits14.
Pour déconstruire cette idée que le véganisme serait « un truc de Blanc », ou quelque chose d’essentiellement nouveau, des communautés noires revendiquent l’afro-véganisme.
La carnisation, nous commençons à le comprendre, ne s’opère pas que dans les assiettes et les estomacs. Elle a également lieu dans les esprits : l’interdit des Nyabwa doit paraître aujourd’hui ridicule à bien des afrodescendants. Il n’y a pourtant pas si longtemps, ces manières de se rapporter aux vies animales étaient encore majoritaires sur le continent.
Pour déconstruire cette idée que le véganisme serait « un truc de Blanc », ou quelque chose d’essentiellement nouveau, des communautés noires revendiquent l’afro-véganisme15. L’afrovéganisme, pour des communautés afrodescendantes, consiste à revaloriser un véganisme en lien avec une histoire particulière que l’on se réapproprie. Il s’agit de dire que le véganisme n’entre pas en opposition avec le fait de revendiquer un attachement à sa terre d’origine. Il n’est évidemment pas question de dire qu’avant la colonisation, personne ne mangeait d’animal ou n’avait quelque geste violent que ce soit à leur égard. Il s’agit de simplement rappeler que le véganisme peut trouver ses sources en dehors du référentiel occidental. Comme nous l’avons vu plus haut, le véganisme est aussi un choix de solidarité entre personnes qui subissent racisme et animalisation. Cela peut aussi être un choix politique : faire tout son possible pour refuser les produits carnés importés, souvent mauvais à long terme pour la santé (volaille et poisson congelés, viande cuisinée, lait en poudre16) et se reposer au maximum sur les cultures locales végétales – évidemment, si on en a la possibilité. Se rendre compte que ses ancêtres avaient, peut-être, des rapports aux mondes animaux différents avant la colonisation, s’en faire les héritiers et les renouveler, voilà qui donne de la puissance à d’autres récits. Des récits sans aucun doute plus mobilisateurs que l’imaginaire d’un végétarisme sans histoire, aseptisé, qui fabrique de la viande cellulaire en laboratoire.
➤ Lire aussi | Cuisine et politique : les recettes d’une anthropologue・Gaëlle Ronsin (2024)

Les héritages végétaux de l’Inde et du Sri Lanka
La cuisine indienne est l’un des exemples les plus utilisés pour penser les héritages végétaux dans des mondes non occidentaux. On peut d’ores et déjà démentir cela, car il n’existe pas une cuisine indienne, qui serait uniforme : il serait plus juste de parler de pratiques alimentaires qui diffèrent en fonction des régions et sont d’ailleurs aussi à la source de conflits ethnico-religieux récents (comme entre les musulmans et les hindous).
Il est vrai que la présence de protéines végétales a été, et est encore très importante dans beaucoup de plats typiques de cette région du monde, avec notamment une large proportion de légumineuses, associées aux céréales : le dahl qui accompagne le riz tous les midis, par exemple (le plat porte d’ailleurs le nom de son ingrédient principal, la lentille). Même dans les plats avec viande, les protéines végétales font toujours partie du fondement de la préparation : on peut considérer que la carnisation n’a pas, dans ce cas précis, effacé les héritages végétaux. Au contraire, ceux-ci sont encore mis en avant aujourd’hui comme des marqueurs de cette cuisine. Il existe aussi un héritage culturel et historique qui permet de savoir cuisiner des légumes savoureux grâce à la forte présence d’épices. Historiquement, c’est aussi lié à des conditions matérielles car l’utilisation d’épices dans les pays chauds permettait une meilleure conservation des aliments : cela fait aujourd’hui partie de ce qui rend ces préparations aussi appréciées.
En Inde et au Sri Lanka, la carnisation n’a pas effacé les héritages végétaux. Au contraire, ceux-ci sont mis en avant comme des marqueurs de cette cuisine.
Cependant, ces héritages viennent aussi en partie de pratiques de distinctions sociales des classes dominantes : les brahmanes, qui ne mangeaient pas de viande, constituaient l’élite socioreligieuse du pays, et leurs pratiques étaient donc aussi en partie perçues comme des moyens de se distinguer du reste de la population. Le fait de ne pas manger de viande était ainsi considéré comme un gage de pureté morale, de « maîtrise de soi » (c’est-à-dire de son appétit pour la viande), mais aussi un signe de bienveillance et de cohérence (c’est l’idée que, puisque les humains perçoivent aussi la souffrance animale, il est paradoxal qu’ils mangent des animaux17). La distinction sociale recherchée à travers ces régimes n’est pas propre à cette région du monde : elle fait écho à bien d’autres18. En Inde ou au Sri Lanka, les personnes dont les grands-parents (et leurs parents avant eux) mangeaient de la viande viennent plutôt des castes les plus basses : le travail « souilleur » de tuer les animaux non humains leur était en outre confié, pour que les hautes castes ne soient pas atteintes dans leur pureté morale.

Cependant, c’est la colonisation et l’entrée dans le marché capitaliste qui a « carnisé » cette région à plus grande échelle. Cela s’est traduit par la substitution d’aliments végétaux par des aliments carnés : par exemple, l’abandon progressif du lait de coco pour un usage plus généralisé du lait de vache (les vaches étant considérées comme sacrées, il était jusqu’alors inconcevable de tuer leurs petits pour prendre le lait, mais cela est de plus en plus massivement pratiqué aujourd’hui). On observe un usage plus important de lait et d’œufs, y compris dans les gâteaux et pâtisseries qui étaient pour beaucoup traditionnellement entièrement végétaliens. En parallèle, la présence plus importante de firmes capitalistes et de chaînes de fast-food comme McDonald’s, Pizza Hut ou KFC parvient à attirer de nombreuses personnes vers la consommation de viande.
C’est la colonisation et l’entrée dans le marché capitaliste qui a « carnisé » la région à plus grande échelle.
En dépit de ces considérations historiques, c’est la persistance d’une culture matérielle végétale, également présente dans les classes populaires aujourd’hui, qui montre les possibilités de retrouver des assiettes végétales tout en les vidant de leurs stigmates passés. En outre, ces moyens de distinction sociale par le biais de l’alimentation végétale sont en réalité déjà en partie tombés dans l’oubli, le végétarisme n’est plus autant une pratique qui confère un statut moral spécifique ni particulièrement associée à un statut social : le végétarisme est un « fait social » beaucoup plus diffus. De nombreux militants et militantes antispécistes indiens ou issus de la diaspora s’en inspirent et y trouvent un appui pour lutter contre la carnisation des pratiques alimentaires de leurs communautés. On pourrait trouver bien d’autres situations similaires en Asie, qui montrent que là aussi des héritages végétaux ont subsisté, par exemple au Vietnam où la consommation de soja est quotidienne et procure une partie du lait et des protéines à la population. Reste à assurer une alimentation saine et suffisamment riche à tout le monde, et à redonner leur autonomie aux producteurs et productrices19 – mais déjà, les savoir-faire et les ancrages culturels sont présents et largement partagés.
➤ Lire aussi | Freedom Farmers : la résistance agriculturelle noire aux États-Unis・Flaminia Paddeu et Monica M. White (2025)

Carnisme, nation et tradition en France
Il nous paraît à présent essentiel de revenir là où nous sommes, à ce qui est propre au territoire que l’on habite et sur lequel nous pouvons avoir prise. De prime abord, le processus de carnisation paraît moins évident, moins lisible en France. Lorsque l’on pense à la cuisine française, nous viennent spontanément en tête des menus de bistrots qui regorgent de plats à la viande, au poisson, à la crème, aux lardons, au fromage. Mais malgré cela, il serait faux de penser que la « norme carnée » a toujours dominé les assiettes.
La cuisine française renvoie généralement à la gastronomie. Or, celle-ci ne reflète pas (parce que ce n’est pas son but) les manières dont mange la population vivant en France : la gastronomie est bien plus le reflet de ce que mange une élite sociale donnée. D’ailleurs, le « repas français » (inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2010) est défini non pas comme une pratique populaire mais comme un « art » de manger, une « cuisine », transmise de maîtres en apprentis, qui se déroule selon un schéma ritualisé : apéritif, entrée, poisson et/ou viande, légumes, fromage, dessert, généralement accompagné d’un digestif. Les produits issus d’animaux y occupent une place centrale. Et pourtant, ce schéma est bien loin du quotidien du plus grand nombre : il s’agit davantage d’une forme rituelle reflétant les habitudes des classes sociales les plus élevées. Les débuts de la « cuisine française » comme patrimoine remontent à la Révolution française, où des écrivains et notables, en exil, vantent ce qu’ils estiment être les spécialités de leur pays et, empreints de nostalgie, contribuent à créer des identités culinaires régionales. Les cuisines bourguignonne, provençale, bretonne ou bordelaise ont ainsi chacune leur réputation, que d’autres voyageurs commenteront ensuite. La Révolution industrielle, avec son lot d’émigration rurale, alimente aussi la nostalgie des produits du pays qui donneront, ensuite, les produits du terroir : la nourriture « du pays » fait office de refuge d’identité pour les populations prises dans le tumulte de la grande ville. La cuisine comporte, comme ailleurs, un aspect collectif et est donc un marqueur d’identité – ce qui n’a d’ailleurs pas échappé à certains nationalistes qui ont fait du couple vin/viande un instrument de propagande culturelle et politique20. Ce patrimoine ainsi constitué est aussi devenu un atout pour le secteur du tourisme, de la restauration et de la grande distribution.
Lorsque l’on pense à la cuisine française, nous viennent en tête des menus de bistrots avec viande, poisson, crème, lardons, fromage. Il serait pourtant faux de penser que la « norme carnée » a toujours dominé les assiettes.
De même, ce qui est considéré comme la cuisine traditionnelle de France et les spécialités régionales, plus communément partagées que ne l’est la gastronomie, relève également d’une construction sociale. Ce qui ne veut pas dire que les traditions sont « fausses » mais qu’elles sont toujours fabriquées, pour répondre à une situation nouvelle. C’est ce que l’on appelle la « tradition inventée21 », une pratique rituelle et symbolique qui fait office de « référence au passé au cœur du présent », alors même que sa continuité avec le passé est largement fictive. Son rôle est symbolique, et non pas historique. Les États-nations et tous les mouvements nationalistes ont eu besoin de ces traditions inventées pour créer un imaginaire national, et faire qu’on puisse se « sentir Français » avant d’être Normand ou Berrichon. La cuisine traditionnelle fait amplement partie de cela, car le repas partagé est un moment de consolidation du groupe – et l’on y mange notamment du cochon, ce qui a permis à certains de justifier de ne pas traiter des juifs ou des musulmans comme des citoyens à part entière, au motif qu’ils dérogent au « grand banquet fraternel de la République22 » en raison de leur régime halal ou casher.

L’État a joué un rôle notable dans le développement de ces traditions inventées : comme nous l’avons vu précédemment, les transformations des sociétés paysannes avec la centralisation de l’État, l’exode rural, puis les politiques agricoles d’après-guerre, et enfin la politique agricole commune (PAC) européenne ont favorisé l’essor d’un « capitalisme carné ». L’agriculture française est la plus subventionnée de toute l’Europe, et 71 % des élevages de « volailles », 89 % des élevages de cochons et quasiment l’intégralité des élevages de moutons, chèvres et vaches bénéficient d’argent public. On produit donc plus de viande qu’on ne le pourrait s’il n’y avait pas ces politiques publiques : on estime que 53 % des élevages ne s’en sortiraient pas sans les subventions. En comparaison, les producteurs et productrices de fruits et grandes cultures sont 37 % dans cette situation, et les maraîchers et maraîchères 17 % : leur autonomie est plus grande. Il faut en outre compter dans le budget du spécisme à la française l’argent des impôts versé pour permettre, par exemple, le transport par camion, la prise en charge des coûts en matière de santé publique et d’environnement et, comme si ça ne suffisait pas, la publicité aux produits carnés23. En parallèle, l’État a contribué à la carnisation des imaginaires depuis plusieurs siècles : au travers du soutien des municipalités à l’organisation des foires à bestiaux (xviiie-xixe siècle), puis la création des premiers concours généraux agricoles (à partir de 1870), des salons de l’agriculture régionaux, nationaux puis internationaux (à partir du milieu du xixe siècle), la concentration des « tueries » dans de gigantesques abattoirs (comme ceux de La Villette à Paris, en 1867), et la recherche agronome (génétique et autres techniques). En somme, l’investissement de l’État dans le développement d’un marché national alimentaire a permis d’outrepasser les limites techniques, économiques, spatiales et animales qu’aurait rencontrées la carnisation dans les sociétés paysannes.
La spécialisation des régions s’est accrue continuellement : dans certains territoires, comme en Bretagne, on retrouve aujourd’hui une densité inédite d’élevages (55 % des cochons, 43 % des poules pondeuses, 21 % des vaches laitières du pays) et d’abattoirs (40 % des animaux abattus dans les 960 abattoirs de France le sont en Bretagne, où se trouvent les plus grands établissements du pays). Le plus souvent cette spécialisation ne s’est pas faite selon la volonté ni dans l’intérêt économique des éleveurs et éleveuses : au contraire, ceux-ci comptent parmi la population agricole la moins aisée et la plus dépendante des subventions. Ce sont les grandes industries qui, en créant des situations de monopole local, ont même fini par inventer leur « tradition » pour écouler la surproduction : le camembert de Normandie, le foie gras d’Aquitaine, les sardines du Finistère, les huîtres et moules du Nord, chaque territoire a un exemple à fournir. La dévitalisation des savoirs, dans les campagnes qui se vident, a conduit à fabriquer un « patrimoine », c’est-à-dire, « un passé que l’on peut vendre24 ». Ainsi, on ne vend plus seulement un produit mais un imaginaire de terroir ou de spécialité régionale, qui prétend être hérité du passé, ce qui permet… d’augmenter les prix. Mais comme, très vite, la demande créée par cette publicité excède de loin les capacités (tant vantées) de productions locales, et pour rendre ces produits moins chers (afin d’en vendre plus), le camembert est désormais produit à partir de laits importés du monde entier, les escargots de Bourgogne viennent de Grèce, le foie gras de Hongrie, les sardines du Maroc, et ainsi de suite. En plus de néocoloniser des millions d’hectares de terres et de territoires marins pour procurer à chacun son morceau de viande, ce système de concentration-spécialisation-importation fait miroiter l’idée qu’il serait possible de « démocratiser » le carnisme. Pourtant, c’est au prix d’une exploitation toujours plus grande des animaux, des terres, des classes dominées et des énergies fossiles que l’on peut manger de la viande à quasiment toutes les tables en France. En parallèle, cela a conduit au déclin de tout un tas d’autres productions notamment celles de légumineuses, légumes anciens, blés et autres céréales cultivées depuis le Moyen Âge, les terres servant désormais au fourrage et à l’élevage25.
En plus de néocoloniser des millions d’hectares de terres et de territoires marins pour procurer à chacun son morceau de viande, ce système de concentration-spécialisation-importation fait miroiter l’idée qu’il serait possible de « démocratiser » le carnisme.
Tant que cette tradition arrivera à se confondre avec la norme, on pourra faire passer le végétalisme pour une mode, un lifestyle importé sans aucune continuité avec nos héritages, donc en quelque sorte, une chose illégitime et/ou vouée à rester marginale. C’est d’ailleurs tout dans l’intérêt de l’agro-industrie de le faire passer pour « tendance » et moderne, car cela permet là aussi de vendre plus cher des produits estampillés véganes à celles et ceux qui cherchent une distinction sociale via l’alimentation. Au-delà du fait qu’on peut trouver la « tradition carnée » violente, elle est surtout surreprésentée et fantasmée.
L’alimentation des gens en France n’est pas nécessairement – et n’a pas toujours été – carnée : il y eut des périodes avec, d’autres sans, des spécialités basées sur le végétal et d’autres qui se sont constituées autour des ressources de la mer, de la chasse et de l’élevage. Au début du Moyen Âge, période dite « d’abondance », même les familles paysannes pouvaient chasser du gibier et l’on servait couramment plusieurs viandes à table.

Dès le milieu du xvie siècle, la chair animale se fait bien plus rare, tant à la chasse que dans les fermes, en raison notamment d’une pression accrue sur les ressources et de la suppression de plusieurs droits coutumiers. C’est alors qu’elle devient un signe de richesse. En revanche, on utilise depuis très longtemps le fromage et les œufs comme sources de protéines : les œufs sont un aliment de base quasiment au même titre que le pain, et le fromage très commun et pratique pour avoir accès aux protéines et graisses du lait en dehors des périodes de lactation (il se conserve et se transporte). Dans le Sud-Est, bénéficiant d’un climat plus clément pour les cultures tout au long de l’année, l’alimentation provençale ou méditerranéenne est moins carnée : ratatouille, tian de légumes, socca, estouffade, fougasse, châtaignes, noix, tomates et autres ingrédients sont cuisinés aux condiments frais et à l’huile végétale (d’olive, notamment) au lieu de la crème ou du beurre26. À partir du Moyen Âge et jusqu’à ce que la modernisation agricole et l’urbanisation lissent ces différences régionales, au nord de la France, on mangeait couramment de la flamiche aux poireaux, des betteraves, de l’ail et des galettes de sarrasin ; dans le centre, de nombreux plats de lentilles et autres légumineuses ; et dans le sud-ouest, ce n’est pas tant du canard et de la brebis que l’on mange au quotidien, quoiqu’il y en ait, qu’un ensemble de légumes et légumineuses assaisonnés, piperade27 et autres spécialités.
Il est dans l’intérêt de l’agro-industrie de le faire passer le véganisme pour « tendance » et moderne.
Du fait de ces héritages, il existe de réelles bases pour développer un « véganisme populaire » en France. Certains produits, tels que le soja (sous toutes ses formes) ou le seitan (gluten extrait du blé), sont certes récemment apparus dans nos champs ou nos assiettes, mais bien d’autres y sont présents et produits dans les différentes régions depuis des siècles. On regorge d’exemples de recettes et de préparations plus ou moins anciennes qui ont été oubliées, ou carnisées : le cassoulet, le « plat du pauvre » dans le Languedoc, a longtemps été constitué de fèves sans confits d’animaux (ces derniers n’étaient incorporés qu’à de rares occasions), contrairement à aujourd’hui. Nombre de ces plats sont davantage représentatifs d’une culture populaire transmise et appropriée par de nombreuses générations que ne l’est la gastronomie française traditionnelle. Il peut s’agir du pain, dont l’histoire est à peu près aussi vieille que l’installation des premiers villages28, et plus généralement d’un ensemble de préparations typiques à base de céréales (galettes de blé noir, tourteaux) qui formaient la base de l’alimentation paysanne. Mais on peut citer aussi l’emploi des protéines végétales, qui fut bien plus avancé à des époques passées : la consommation de pois, fèves et lentilles, arrivés dans la région il y a plus de 2 000 ans, était proportionnellement plus répandue au Moyen Âge qu’aujourd’hui29. La carnisation n’a pas effacé toutes ces façons de manger : la soupe au pistou, le plat de lentilles, les galettes de céréales complètes, les graines, les jeunes pousses, les fruits à coque, les aliments lactofermentés30, la choucroute et bien d’autres demeurent. La plupart de ces aliments sont peu coûteux, moins que la viande ou les produits laitiers, et il est relativement facile de les préparer soi-même.
Nous avons donc maintenant en tête différentes formes de carnisation : aux Amériques, avec la prise de terres par et pour le bétail et la création d’un imaginaire pionnier fortement attaché à la consommation de viande ; en Afrique de l’Ouest, où elle relève à la fois de la destruction coloniale et esclavagiste des pratiques et spiritualités incompatibles avec l’exploitation intensive des animaux, et de l’économie néolibérale (« dumping » pratiquée par les firmes étrangères importatrices, et création d’un marché africain de la viande et du lait souvent soutenu par les institutions internationales). En Inde et au Sri Lanka, on voit que la carnisation est plus avancée que l’image fantasmée de « l’Inde végétarienne » ne nous le laisse penser. Mais si le régime alimentaire fut au cœur d’intenses conflits de classe et de religion, et si l’industrie carnée y a trouvé un nouveau marché à conquérir, le végétarisme a laissé un héritage conséquent. En France enfin, cela relève d’une multitude de facteurs liés à des enjeux de classe, d’urbanisation, d’imposition de l’État et de nationalisme, mais tout cela n’a pas effacé la possibilité de se nourrir autrement : au contraire, l’insoutenabilité de la production alimentaire actuelle l’a rendue d’autant plus urgente.
➤ Lire aussi | Instituer le droit à l’alimentation en France au XXIe siècle・Tanguy Martin (2021)

Renverser la carnisation : instituer des coutumes végétales conviviales
Force est de constater qu’on ne pourra pas revenir à des alimentations végétales en nous appuyant sur des héritages impérialistes ni sur le modèle extractiviste qui se perpétue dans nos assiettes. Car si l’on peut se procurer lait de coco, noix de cajou, café, chocolat, avocat, arachides et autres en abondance pour des recettes « véganes », c’est aussi parce que l’on jouit du privilège économique de manger des richesses d’ailleurs, à un prix qui ne rémunérera jamais ce qu’elles coûtent réellement. Une alimentation même exclusivement végétale qui repose sur ce type de produits ne nous intéresse pas : nous pouvons, tout comme pour les aliments carnés, « faire tout notre possible » pour les éviter. Sans perspective d’autonomie alimentaire, sans la constitution de sociétés paysannes véganes, nous n’aurons pas fait le travail de décoloniser nos assiettes, nous continuerons de manger ce qui porte la marque de l’exploitation.
Il existe en France de réelles bases pour développer un « véganisme populaire ». On regorge d’exemples de recettes et de préparations plus ou moins anciennes qui ont été oubliées, ou carnisées.
Seulement voilà, trop souvent, les mouvements militants « progressistes » négligent l’importance de la tradition : surtout conservatrice, on n’y accorde donc pas d’importance (« Du passé, faisons table rase »). Pour nous, cette question est un peu plus compliquée. Nous reconnaissons la dimension sociale et le rôle d’identification collective que joue l’alimentation. Les manières de se nourrir sont vectrices d’un rapport aux autres et aux mondes non humains, et c’est précisément pour cela qu’elles nous intéressent. Nous ne voulons pas d’une révolution qui efface tout le rituel, le familier, le spécifique, mais au contraire qui le multiplie. Même si nous la critiquons, ce que nous proposons n’est pas une croisade absolue contre la tradition, mais l’instauration de nouvelles pratiques. Beaucoup des mouvements politiques qui sont parvenus à transformer des espaces ne l’ont pas fait en débattant ou en votant, mais en créant une culture matérielle au fil de la lutte, une pratique de résistance quotidienne.
Nous voulons que les luttes contre l’exploitation animale, mais aussi toutes les autres formes de luttes sociales et écologistes puissent participer à renverser le processus de carnisation en se dotant de nouvelles pratiques d’autonomie conviviales et qui ne reposent pas sur de l’exploitation animale. Par « convivialité », nous entendons non seulement qu’elles soient collectives mais surtout, au sens d’Ivan Illich31, qu’elles soient largement appropriables et accessibles, qu’elles ne soient pas contrôlées par en haut, ou encore que la production demeure suffisamment mesurée pour ne pas devenir aliénante ou écraser toutes les autres. Que faire, alors, de la tradition ? Ce terme renvoie à quelque chose de figé et d’invariable, donc nécessairement détaché de son contexte : nous lui préférons le terme de « coutumes », qui désigne ce qui s’instaure par la pratique. Les coutumes ne sont jamais exécutées à l’identique, même si elles font appel à une forme d’expérience et de transmission : elles ne peuvent pas être figées dans le marbre, tout simplement parce que la vie ne l’est pas. C’est donc une manière de créer des pratiques qui convient mieux à ce que nous voulons : des communautés de vies autonomes, en mouvement, et aussi horizontales que possible. Ces coutumes peuvent être de toutes sortes : cantines véganes, soupes populaires, récoltes et cueillettes, mais aussi éducation à la cohabitation avec les non-humains en ville, veillées en forêt, réparation des milieux de vie endommagés, célébration des naissances et des morts non humaines et autres pratiques ritualisées… Sauf qu’elles ne célébreront pas une victoire sur les mondes animaux (comme c’est le cas aujourd’hui) mais plutôt l’invention de nouveaux rapports avec eux, la fragilisation du système spéciste, le grain de sable jeté dans l’engrenage. Pour que ces coutumes adviennent, qu’elles soient fortes et vivantes, il nous faut amorcer une rupture avec le monde spéciste et carniste qui nous enferme, et faire de la question de l’autonomie alimentaire une priorité de la lutte contre l’exploitation animale.
Vipulan Puvaneswaran, Clara Damiron et Shams Bougafer sont toustes trois issu·es de milieux politisés par un mélange de luttes écologistes, sociales et décoloniales, par des questions agricoles et par des enjeux liés aux questions animales, et inspirés par l’autonomie des mouvements sociaux, particulièrement ceux de 2018-2020. Leur livre Autonomies animales est le fruit de discussions collectives plus larges que les trois auteur·ices.
Image d’accueil : four à pain à l’ancienne, Fuerteventura, Îles Canaries, 2012. Wikimedia.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
Notes
- À ce sujet : Thomas Lepeltier, « Petite litanie des arguments anti-végétaliens », Sens-dessous, vol. 12, n° 2, 2013, p. 31-42.
- Melanie Joy est à l’origine de la définition de ce terme : Melanie Joy, Why We Love Dogs, Eat Pigs and Wear Cows. An Introduction to Carnism, Conari Press, 2010.
- On peut comprendre « végétalienne » ou « végane » ici, mais le terme serait anachronique.
- Jan Zalasiewicz et al., « Et l’os de poulet devient le symbole de l’anthropocène », The Conversation, 30 décembre 2018.
- Charles Patterson, Un éternel Treblinka, 2002, trad. Dominique Letellier, Calmann-Lévy, 2008, p. 92.
- Michael E. Smith, The Aztecs, Wiley Blackwell, 2002.
- Valérie Chansigaud, Histoire de la domestication animale, Delachaux et Niestlé, 2020, p. 126.
- L’habiter colonial est une notion développée par Malcolm Ferdinand dans Une écologie décoloniale, Seuil Anthropocène, 2019.
- À ce sujet : « La patte de la vache : récit de luttes antispécistes au Brésil », podcast Avis de tempête, épisode 7, 2022.
- En 2010, une pub australienne de KFC avait mis en scène un supporter blanc à côté d’une foule déchaînée de supporters noirs. Pour les calmer, la personne blanche sort un pot de poulet frit qu’il se met à distribuer.
- Pour en savoir davantage sur cette notion, voir le livre de Llaila Afrika, Nutricide The Nutritional Destruction of the Black Race, EWorld Inc., 2013.
- P. Zézé Béké, « Les interdits alimentaires chez les Nyabwa de Côte-d’Ivoire », Journal des Africanistes, 1989, p. 229-237.
- Selon le Centre d’information et de recherche sur les intolérances et l’hygiène alimentaires, l’intolérance au lactose se retrouve aussi dans les pays d’Asie de l’Est (90-100 %), Asie centrale (80 %), ainsi que dans des minorités en Amérique du Nord : populations ashkénazes juives (60-80 %), populations indigènes (80-100 %).
- Rapport « Breaking the rule, stretching the rules », GIFA, 16 mai 2014.
- Pour en savoir plus sur l’afrovéganisme : Syl Ko, « Qu’est-ce que le black veganism », L’Amorce, 2019.
- Un rapport récent de la FAO détaille cela : « Croissance agricole en Afrique de l’Ouest : facteurs déterminants de marché et de politique ».
- Cette sensibilité « innée » à la souffrance animale, conjuguée à un régime qui se base sur la mort ou l’exploitation d’animaux, est ce que Rob Percival appelle le « meat eating paradox ». Nous remercions Nicolas Baumard pour les informations précises qu’il nous a fournies à ce sujet et plus largement sur l’alimentation en Inde.
- Par exemple au sein du christianisme, le « vendredi maigre », jour sans viande (mais avec poisson…), est associé à la « vertu chrétienne de sobriété ».
- En 2020-2021, un gigantesque mouvement social (la « révolte des paysans ») a fédéré dix des onze syndicats agricoles principaux et jusqu’à 250 millions de grévistes qui ont bloqué les accès des villes d’Haryana et Delhi, pour lutter contre la nouvelle politique agricole nationale. Il s’agirait de la plus grande grève de l’histoire du pays.
- Marie Aline et Nicolas Santolaria, « Viande, digestif et extrême droite, bienvenue dans la mangeosphère », Le Monde, 29 janvier 2022.
- Eric Hobsbawm, L’Invention de la tradition, trad. Christine Vivier, Éditions Amsterdam, 2006.
- Dans La République et le cochon (Seuil,2013), Pierre Birnbaum explique que le cochon serait un marqueur identitaire de la nation française « célébré par les représentants de la nation les plus divers comme un emblème qui unifie les manières de faire, de sentir, de se réjouir de tous les citoyens » (p. 25). Ainsi, le « retour en force du cochon » dans des banquets sert aujourd’hui de « réaffirmation identitaire » contre la présence du halal ou du casher.
- Au niveau européen, 252 millions d’euros de fonds publics ont été dépensés entre 2016 et 2020 pour financer à hauteur de 80 % les publicités des plus grands acteurs des filières viande et lait.
- Merci à Damien Darcis pour son travail d’enquête et de synthèse sur la question : Pour une écologie libertaire, Eterotopia, 2021.
- En France, on estime que 70 % des terres agricoles sont consacrées au bétail, et parmi celles-ci, au moins la moitié serait cultivable en l’état pour la production de fruits, légumes, grandes cultures et céréales. C’est sans compter le fait qu’une large partie des céréales fourragères est importée : l’occupation réelle des terres et la déforestation engendrées par l’élevage français s’étendent donc au-delà des chiffres annoncés.
- D’ailleurs, les intolérances au lactose sont bien plus fréquentes chez les personnes originaires du sud de la France (65 %) que du nord (17 %), selon une étude du CIRIHA.
- Spécialité basque à base de tomates et de piment.
- Adam Maurizio, Histoire de l’alimentation végétale, depuis la préhistoire jusqu’à nos jours, Ulmer, 2019.
- Ibid.
- La lactofermentation est obtenue par fermentation des légumes dans une eau de saumure, sans intrant animal.
- La Convivialité d’Ivan Illich (Seuil, 1973) propose une critique de la technique qui peut aussi guider des pratiques alimentaires.
L’article Décoloniser nos assiettes est apparu en premier sur Terrestres.
19.11.2025 à 17:33
Gaza ou la trahison de la lumière
Abdullah Hany Daher
Comment continuer à vivre quand on se sent coupable d'avoir survécu ? Comment espérer encore quand la guerre vous a appris à craindre tout ce qui fait la vie et la joie — et jusqu'à la lumière elle-même ? Alors qu'Israël continue à tuer et à bombarder, Abdullah Hany Daher, écrivain et journaliste palestinien, livre depuis Gaza un témoignage aussi bref que bouleversant.
L’article Gaza ou la trahison de la lumière est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (1954 mots)
Temps de lecture : 4 minutes
Ce texte a été originellement publié le 12 août 2025 dans la revue Jewish Currents sous le titre « The Betrayal of Light ».
Il a été traduit de l’anglais par Aurélien Gabriel Cohen.
Avant, je me réveillais avec les rayons du soleil qui brillaient à travers la fenêtre. Maintenant, c’est la frappe d’un missile deux rues plus loin qui me réveille. Il n’y a plus de matin désormais – plus de travail, plus d’école, plus d’heure pour les repas. Il n’y a que l’instant suivant et la peur de ne pas y survivre.
Même le ciel de Gaza a changé. Le soleil se lève, mais il n’apporte aucune chaleur. La nuit arrive, mais elle n’offre aucun repos.
Ce que nous appelions sommeil n’est plus du sommeil. C’est de la fatigue avec un seul œil ouvert. Nous faisons nos valises. Nous gardons nos enfants entièrement habillés. Chaque bourdonnement au-dessus de nos têtes suspend nos respirations. Lorsque le calme demeure pendant plus de dix minutes, nous nous détendons un peu.
La quatrième nuit après octobre 2023, le ciel s’est illuminé. Une ceinture de feu a balayé notre rue. J’étais allongé sur le sol à côté de mon frère. Nous avons entendu des cris perçants. Puis plus rien. Puis de la poussière et des hurlements. J’ai vu la poitrine de mon cousin s’ouvrir. Dans sa chute, son corps a fait un bruit indescriptible. Mon frère et moi avons rampé sous les éclats de verre. La moitié du bâtiment d’en face avait disparu. Nous n’avons pas eu le temps d’enterrer mon cousin comme il se doit. Pas de tissu. Pas de lumière. Pour la première fois, je me suis interrogé sur l’équité de la survie. Quelque chose s’est figé en moi, puis s’est brisé. Je n’ai pas pleuré. Je suis resté brisé. Après tout, la guerre n’avait pas cessé. Me reconstruire ne signifierait que me préparer à être à nouveau brisé.
Dans un abri, un enfant pleurait son père, mort le matin même. Sa mère, silencieuse et impassible, le tenait entre ses bras, raides comme de la pierre. « Maman, pourquoi tu ne pleures pas ? » demanda l’enfant. La mère s’effondra. J’aurais préféré ne rien voir, ne pas voir son visage se décomposer ainsi.
Autrefois, j’étudiais à la lumière d’une lampe. Je lisais des livres. Je rêvais de la vie. Aujourd’hui, la lueur de mon téléphone me fait sursauter. Une bougie est une cible. Une allumette, une trahison. Les drones sont en quête de lumière. Je me souviens de la nuit où la lampe torche d’un voisin lui a coûté sa maison. L’avion a décrit un cercle. Puis la lumière est apparue. Puis la destruction.
Nous couvrons nos fenêtres. Nous ne parlons plus qu’en murmures. J’apprends par cœur chacun des recoins de notre appartement détruit. Le nombre de pas entre le couloir et l’évier. Le motif des fissures sur le sol. L’odeur de brûlé au loin.
Les enfants jouent à des jeux de silence. Je prends la main de ma mère pour m’assurer qu’elle existe. Nous ne posons plus de questions. Les réponses sont implacables : aucun lieu n’est sûr, aucun être n’est indemne.
En décembre 2023, nous nous étions réfugiés dans une zone industrielle. Les chars tournaient autour. Aucune issue. Aucun futur. Mon père m’a dit : « Maintenant, cours. » J’ai vu la poussière sous les chenilles des chars. J’ai senti leur odeur d’acier. Je ne sais pas comment nous avons réussi, mais ce moment ne me laisse rien d’autre qu’un fait – nous avons survécu – et un sentiment – la culpabilité que d’autres n’aient pas eu cette chance.
J’ai peur de la lumière. J’ai peur de l’obscurité. J’ai peur du silence. Je crains le bruit. Quand les explosions s’arrêtent, la peur grandit encore. Le silence n’est qu’un prélude. Chaque seconde est comme une attente. Qu’attendons-nous ? Nous ne le savons pas.
Au bord du précipice qui précède chaque instant, deux voix me parlent. L’une dit : « Tu as survécu. » L’autre : « Cela va recommencer. »
Une part de moi veut croire au lendemain. Une autre se prépare à une nouvelle nuit.
Avant, je concevais le temps comme un calendrier, un projet, un objectif. Aujourd’hui, le temps n’est plus que quelque chose que l’on endure.
Parfois, je ferme les yeux et j’imagine un lever de soleil qui m’évoquerait le café plutôt que la peur. Je rêve d’ouvrir une fenêtre sans y penser pour sentir la brise, de lire un livre sans le bruit des drones au-dessus de ma tête. Je rêve des nuits à Gaza telles qu’elles étaient autrefois : des amoureux qui marchent le long des rues éclairées par la lune, des enfants qui jouent. Mais je ne crois pas à ces rêves.
Je me demande qui je serai si tout cela s’arrête. Est-ce que je pourrai un jour m’asseoir près d’une lampe sans frémir ? Les enfants de mes enfants pourront-ils un jour faire confiance à la lumière ? Il n’y a pas de métaphores à Gaza. Il n’y a plus que ce qui a disparu et ce qui demeure : cette vie entre les ombres et un souvenir, celui d’une autre lumière.
➤ Lire aussi | Gaza et la défaite de l’humanité・Dominique Eddé (2025)
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Photo de couverture · UNRWA · Des enfants réfugiés palestiniens regardent un bulldozer israélien démolir les derniers vestiges d’un abri détruit dans le camp d’Ein El Hilweh, au Liban · 1982

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
L’article Gaza ou la trahison de la lumière est apparu en premier sur Terrestres.
23.10.2025 à 17:25
« La terre se souvient » : raconter l’écocide depuis le Sud-Liban
Amélie David
Les bombardements massifs de l’armée israélienne au Liban ne tuent pas seulement des civil·es, ils ravagent aussi les terres et le vivant. À l’occasion de la Biennale de Venise, un collectif d’architectes libanais·es se mobilise et conçoit un pavillon à partir des données récoltées sur le terrain par des bénévoles et des chercheur·ses. Reportage.
L’article « La terre se souvient » : raconter l’écocide depuis le Sud-Liban est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (6190 mots)
Temps de lecture : 13 minutes
Le Liban est marqué dans sa chair. De sa frontière avec Israël/Palestine occupée, à celle du nord, avec la Syrie, de la mer Méditerranée à l’ouest, à la chaîne de montagne de l’Anti-Liban à l’est, la guerre a meurtri le cœur des habitant·es du pays et a laissé des plaies béantes dans sa terre. En ce matin de la fin août 2025, les rues de la plus grande ville du sud, Tyr, portent encore les stigmates des 14 mois de guerre qui ont sévi à travers le pays. Dans la foulée du massacre du 7 Octobre, qui a fait au moins 1 200 morts dans l’État hébreu, le Hezbollah (parti politique chiite doté d’une puissante milice) a apporté son soutien au Hamas et a ouvert un front contre Israël depuis le sud du Liban.
A Tyr, la vie a peu à peu repris, mais les destructions restent massives. En novembre 2024, alors que l’on compte plus de 4 000 mort·es, 16 000 blessé·es et près de 2 millions de déplacé·es, un cessez-le-feu entre en vigueur. Les habitants tentent d’oublier en reprenant le cours normal de leur vie. Mais les bruits de la guerre, comme les drones et les bombardements israéliens, ne sont jamais loin. « La guerre ? On n’en parle plus. La situation ? Ça va », balaie d’un revers de main une commerçante dans une des rues perpendiculaires à la corniche de Tyr, largement frappée par les bombardements.
Tyr se situe à une vingtaine de kilomètres d’Israël/Palestine occupée. Dans le port, les pêcheurs ont repris leur activité, mais la peur, elle, ne les a pas quittés malgré le cessez-le-feu, entré en vigueur le 27 novembre 2024. En sortant leur embarcation, les pêcheurs risquent de se faire harceler ou agresser voire pire, enlever par l’armée israélienne1, comme c’est le cas d’Ali Fneich et Mohammad Jouhair, dont personne n’a de nouvelles2. Ces artisans de la mer ne peuvent pas profiter des ressources naturelles comme ils le devraient pour assurer leur pain quotidien. « Les Israéliens m’ont demandé de m’arrêter et j’ai répondu : “Nous sommes sur notre terre !” Ils ont envoyé des bombes et des drones dans ma direction. Je me suis dit que c’est ainsi que j’allais mourir… », lâche Ali, un pêcheur. Attaqué par l’armée israélienne plusieurs mois auparavant, il a réussi à regagner le rivage sain et sauf.
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
D’après les autorités libanaises, en juin 2025, l’armée israélienne avait transgressé plus de 3 000 fois (sur terre, en mer et dans les airs) l’accord de cessez-le-feu depuis son entrée en vigueur 8 mois plus tôt. Malgré le cessez-le-feu et les désarmements des groupes armés du Liban en cours, et notamment du Hezbollah, la menace persiste. Les bombardements n’ont pas cessé : au cours de ces derniers jours, l’armée israélienne a bombardé à plusieurs reprises les terres du sud et de l’ouest du Liban. Les invasions terrestres continuent et l’armée israélienne est toujours positionnée à au moins six endroits dans le sud du Liban.
Quelques mois plus tôt, dans le village de Kfar Kila, plus à l’ouest, d’où il est possible de voir le mur de séparation entre Israël et le Liban, la guerre avait laissé un paysage de désolation. Selon les autorités, le village a été détruit à 90% pendant la guerre – et même après, lorsque la zone était occupée par l’armée israélienne. Ici, des oliviers sont déracinés par des bulldozers. Là, des chevaux errent à la recherche d’herbe à brouter. Ils s’arrêtent au milieu de bâtiments en ruines. Là encore, des bâtiments complètement détruits, des panneaux solaires hors service et des puits d’où ne sortira plus d’eau. Ali (qui ne souhaite pas donner son nom de famille) a tenté de reconstruire sa maison après la guerre à plusieurs reprises. Elle a été détruite à chaque fois. Quand nous l’avions rencontré en avril 2025, il expliquait, en faisant le tour de son terrain marqué par les chenilles de bulldozer : « Ici, il y avait de grands oliviers, centenaires ou plus : ils ont tout déraciné, tout brisé ». Auprès de lui, Jamal, le dromadaire de ses grands-parents, ruminait encore le peu d’herbe trouvée. Parmi les bêtes d’Ali, il était l’unique survivant des bombardements israéliens.

➤ Lire aussi | En Palestine, « l’huile qu’on attend un an, les soldats la jettent en un instant »・Forum palestinien d’agroécologie (2025)
Repenser, réimaginer, reconstruire
À Beyrouth, si le fracas de la guerre semblait parfois loin, il a fini par se rapprocher. Par toucher toutes et tous. Si bien que sur les hauteurs de la ville, un collectif d’architectes a souhaité se mobiliser. Le Collective for Architecture Lebanon (CAL) a monté un projet de pavillon pour la 19ème exposition internationale d’architecture de la Biennale de Venise, qui se tient en Italie du 10 mai au 23 novembre 2025. « La guerre venait de commencer au Liban », explique Edouard Souhaid, l’un des fondateurs du collectif, lorsque nous le rencontrons à la terrasse d’un café branché de Beyrouth. « Il fallait au moins que le Liban soit présent pour alerter sur ce qu’il se passe, pour montrer que le Liban est encore là, qu’on a des choses à dire en termes de culture ».
CAL a conscience que la biennale reste un évènement élitiste, difficilement accessible pour des pays du continent africain ou asiatique. Le collectif souhaite tout de même y représenter le Liban et la guerre qui le frappe. « Avec tout ce qu’il se passait ici, c’est là où le terme écocide est arrivé. Au nord, on parle beaucoup de soutenabilité, de durabilité, mais ce qui se passe chez nous, c’est l’opposé total. C’est de la destruction totale… », continue celui qui a fait une partie de ses études en France.
« La Terre se souvient » présente un ministère fictif, celui de l’Intelligence de la Terre, dont l’objectif est de soigner la terre et constituer une archive vivante de la destruction intentionnelle de l’environnement. Pour monter le pavillon, le collectif s’est appuyé sur des chercheurs et chercheuses, des paysans, des écologistes et des activistes. « Nous ne voulions pas d’un projet qui romantise le Liban, ou qui était trop dans la nostalgie. Nous voulions quelque chose de très politique et qui soit ancré dans le présent, avec les évènements que traversait le Liban », continue l’un des fondateurs du collectif.
« La Terre se souvient » présente un ministère fictif, celui de l’Intelligence de la Terre, dont l’objectif est de soigner la terre et constituer une archive vivante de la destruction intentionnelle de l’environnement.

Edouard Souhaid et ses collègues ont souhaité faire du pavillon un appel à l’action : « un espace d’activisme qui confronte les visiteurs à la réalité brutale de la dévastation délibérée de l’environnement », comme le décrit la présentation du pavillon sur le site de la Biennale. La démarche du pavillon s’inscrit aussi dans une logique de documentation de cet écocide en cours à travers les récits, les images et les cartographies des zones impactées par les bombes au phosphore blanc et par d’autres, contenant un grand nombre de métaux lourds qui s’infiltrent dans le sol et dans l’eau, et dont les particules se retrouvent dans l’air.
D’après les chiffres de la Banque mondiale, le coût total de la reconstruction et des besoins de reprise est estimé à 11 milliards de dollars (avril 2025)3. D’après la FAO (l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture), les dommages pour le secteur agricole se chiffrent à plus de 118 millions USD et les pertes à environ 586 millions USD. La production d’olives a été la plus touchée avec plus de 230 millions de pertes et des incendies qui ont ravagé au moins 814 oliveraies, sans compter l’impossibilité d’accès aux terrains et à la récolte, empêchant de perpétuer des traditions familiales millénaires. « Quand la guerre a commencé en 2023, nous étions dans les champs. Nous avons entendu les bombes : nous avons ramassé ce que nous avons pu, pressé et filtré… Et nous sommes repartis vers Beyrouth, en sécurité », explique Rose Becharra, fondatrice de Darmmess, qui produit de l’huile d’olives à Deir Mimas, village dans le sud du Liban. En septembre 2024, Rose Bechara décide de déménager l’un de ses entrepôts, situé à la frontière, dans un village plus éloigné supposé plus sécurisé. « Mais alors que nous venions juste de nous y installer, un bombardement de l’armée israélienne a tout détruit, se souvient-elle avec amertume. Tout l’entrepôt a été réduit en cendres. » Agrumes et bananes ont également souffert. La guerre a aussi détruit 1 050 hectares de systèmes d’irrigation de plein champ, 23 hectares de serres, 1 hectare de panneaux solaires agricoles et d’autres équipements4. Cette année, Rose Becharra a pu retourner sur ses terres familiales pour récolter les fruits de ses arbres centenaires. Une petite victoire pour elle et les paysans locaux avec qui elle travaille, même si la production reste très basse en raison des conditions climatiques et des conséquences de la guerre. « Beaucoup d’habitants craignent de revenir sur leurs terres dans le sud. Nous risquons nos vies pour ramasser nos olives. Cela fait partie de notre culture, de notre héritage : cette récolte a un autre goût cette année. »

Documenter, archiver, raconter
Pour mettre tout ceci en lumière dans son pavillon, le Collective for Architecture Lebanon s’appuie sur une constellation de récits et d’enquêtes : étude de la contamination des sols au phosphore blanc dans le sud, cartographie des écocides industriels, archives photographiques de terres blessées ou encore paysages sonores captés sous les drones. Autant de pièces d’un territoire qui parle à travers ses cicatrices.
L’association de protection de la nature et des paysages Green Southerners effectue un travail de terrain et fournit les photographies de la faune et de la flore endommagées. « Dès le début de la guerre, en octobre 2023, nous avons documenté les attaques contre l’environnement dans le sud du Liban », explique Hisham Younes, le président de cette association locale qui mène des projets de sensibilisation sur la biodiversité du sud Liban et qui, depuis le début de la guerre en 2023, documente aussi les attaques sur l’environnement. « Nous avons mis en place une équipe dédiée à l’observation et à l’analyse de l’utilisation du phosphore blanc, qui a été utilisé à une échelle bien plus importante que lors de la guerre de 2006 [NDLR : en juillet 2006, une guerre a éclaté entre Israël et le Hezbollah]. Nous n’avions jamais vu quelque chose d’aussi important dans l’utilisation du phosphore et de métaux lourds. »
Selon un rapport des Nations unies, plus de 5 600 frappes israéliennes ont été recensées entre le 8 octobre 2023 et le 20 septembre 2024 dans le Sud-Liban. Certaines contenaient du phosphore blanc, arme incendiaire dont l’utilisation dans des zones densément peuplées et contre des civil·es est proscrite par la Convention de 1980 de l’ONU sur les armes classiques, ce qui est considéré par plusieurs ONG internationales comme un crime de guerre. Des bombes incendiaires ont aussi été employées.
Selon un rapport des Nations unies, plus de 5 600 frappes israéliennes ont été recensées entre le 8 octobre 2023 et le 20 septembre 2024 dans le Sud-Liban.
Tous les jours, les bénévoles de l’association se rendent sur le terrain pour documenter les conséquences de la guerre sur la vie de la population et sur l’environnement. L’un de leurs, Oussama Farhat, également membre de la sécurité civile libanaise, a été tué le 1er mai dernier par un drone israélien alors qu’il poursuivait son travail5. « C’est une tragédie pour nous. Il a offert sa vie pour montrer et documenter ce qu’il se passait… », souffle le président de l’association.

De son côté, le studio de recherches Public Works fournit les cartes des différentes attaques. Ce studio de recherches et de design surveille et documente les attaques militaires israéliennes contre le Liban depuis l’aube de la guerre. Les chercheuses suivent leur fréquence, leur géographie et leur impact à travers des mises à jour quotidiennes et une cartographie interactive. « L’un des impacts centraux de cette guerre a été la destruction ciblée des terres, des forêts, des champs agricoles et des réserves naturelles [NDLR : la région de Tibnine a souvent été la cible de bombardements alors qu’un projet de classement en Réserve naturelle est en cours] dans le sud du Liban, ce que nous identifions comme des formes d’écocide. Lorsque les commissaires du Pavillon libanais nous ont invités à participer, c’était précisément parce que notre travail traite directement de ce thème », décrit l’une des chercheuses de Public Works, qui préfère conserver son anonymat.
Le pavillon « La Terre se souvient » permet une confrontation entre la violence écologique et l’effacement spatial en tant que forme de guerre. « Notre contribution met en lumière le fait que le ciblage des paysages du sud du Liban n’est pas un dommage collatéral, mais bien une stratégie systématique de destruction. En le documentant par la cartographie, la narration et l’analyse spatiale, nous cherchons à donner de la visibilité à une forme de violence souvent méconnue, mais dont les conséquences sur les populations, les terres et les moyens de subsistance sont durables », continue-t-elle.
➤ Lire aussi | La Palestine, l’impérialisme et la catastrophe climatique・Hamza Hamouchene (2025)
Avec ses élèves, Rami Zurayk, professeur de gestion des écosystèmes à l’Université Américaine de Beyrouth (UAB), a fabriqué les briques pour le pavillon. « La création de ces briques faite de la Terra Rosa, terre rouge du sud du Liban qui selon la légende a été colorée par le sang d’Adonis, accompagnée des autres articles, amène une réflexion intéressante. Ils lient entre eux la mythologie de la région à son paysage », précise le professeur. D’après la mythologie, Adonis, jeune dieu de la beauté et de la fertilité, était aimé d’Astarte (Aphrodite). Il aurait été tué par un sanglier dans les montagnes du Liban, près du fleuve aujourd’hui appelé Nahr Ibrahim. Son sang se serait alors déversé dans le fleuve qui se jette dans la Méditerranée. Lorsque les pluies entrainent la terre rouge dans les eaux du fleuve, les anciens y voient le sang d’Adonis se déverser sur la terre, symbole de renouveau et de fertilité. La Terra Rosa, terre ferrugineuse caractéristique du sud du Liban, est chargée d’une forte symbolique mythologique et écologique car elle représente la continuité entre la culture, la nature et la mémoire. Le paysage du sud du Liban porte les traces de ce mythe. Avec l’utilisation de cette terre pour fabriquer les briques du pavillon, Rami Zurayk et ses étudiant·es relient la symbolique antique du sang d’Adonis à la réalité écologique contemporaine du Sud-Liban — une région reconnue pour la beauté de ses sols, mais aussi marquée par les blessures de la guerre. Rami Zurayk a également rédigé plusieurs articles sur la pollution des sols, le paysage du sud du Liban et les produits agricoles qui constituent la mosaïque du pays, du nord au sud.
« Notre contribution met en lumière le fait que le ciblage des paysages du sud du Liban n’est pas un dommage collatéral, mais bien une stratégie systématique de destruction. »
Une chercheuse du studio de recherches Public Works
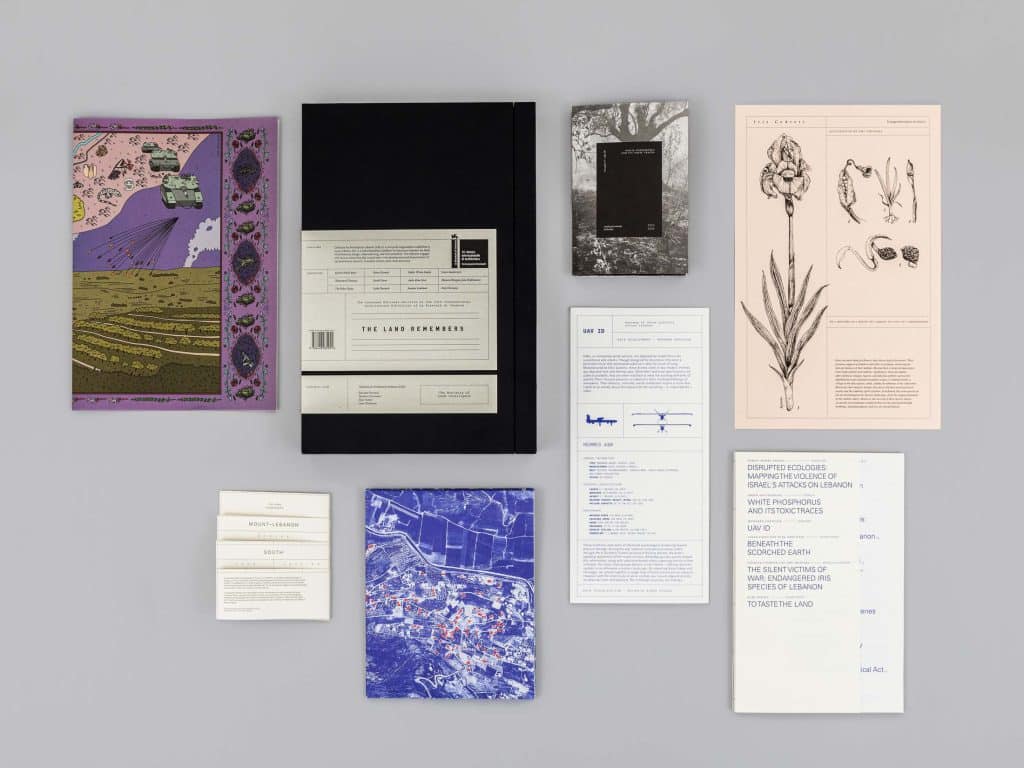
Sarah Sinno, chercheuse et fondatrice du Earth preservation project, une association libanaise, a aussi pris part à cette documentation par l’écrit. Elle a notamment publié un article où elle s’appuie sur l’un des plus anciens écrits de l’humanité, l’épopée de Gilgamesh, et en tire une métaphore autour des abeilles. D’après les derniers chiffres, 4 000 ruches ont été détruites par la guerre dans le sud du Liban. « Les abeilles jouent un rôle essentiel pour la nature et pour la vie, elles sont des ingénieures d’une terre florissante. Même si Israël essaie de nous imposer la mort, nous devons apprendre des abeilles, de leur rythme et de la manière dont elles travaillent ensemble. Elles sont les témoins des crimes environnementaux qui se passent au Liban », explique la jeune femme, qui continue de documenter l’écocide dans le sud du Liban. « Les abeilles sont l’incarnation d’une résistance collective », croit Sarah Sinno, car elles continuent de travailler ensemble malgré les circonstances et rebâtissent ce qui est détruit.
Des illustrateurs et d’autres chercheurs se joignent aussi au projet. Le résultat : une large table faite en briques rouges avec ici et là des végétaux, des cartes et un livre qui regroupe des écrits autour qui expliquent ce qu’il se passe au Liban. « Nous voulions documenter tout ceci, ce que l’État aurait dû faire mais ne faisait pas. Il y a une vraie politique créée pour coloniser à travers cet écocide. Nous voulions aussi réfléchir à des solutions, comme la bioremédiation ou la préservation des sols, par exemple, explique Edouard Souhaid. Le thème de la Biennale est l’intelligence artificielle, mais on ne croit pas que la technologie va nous sauver écologiquement. »

➤ Lire aussi | Prise de terre et terre promise : sur l’État colonial d’Israël・Ali Zniber (2024)
Pas de dommage collatéral
Les architectes entendent aussi interroger le sens de l’architecture dans la reconstruction d’un pays dévasté. L’accès restreint au terrain et la récolte des données par les scientifiques limitent la création d’une base de données solides pour illustrer les pertes, mais tous les experts s’accordent pour dire qu’elles sont importantes et que les conséquences sur les ressources naturelles seront de plus en plus visibles sur le long terme. « Quand tu détruis un arbre, tu détruis toute une communauté, souligne le curateur. El ared [NDLR : « la terre » en arabe] a une signification très émotionnelle : d’où tu viens, des ancêtres, la nourriture… » Selon lui, les architectes au Liban doivent arrêter de construire et penser à la réhabilitation d’un pays endeuillé. « Nous avons une responsabilité en tant qu’architecte : quand tu construis, il y a un côté culturel et émotionnel qui va au-delà du scientifique », insiste Edouard Souhaid, qui affirme qu’il faut aujourd’hui repolitiser l’architecture.
Le CAL a souhaité utiliser cette plateforme qu’est la Biennale pour transmettre un message et proposer des idées. Pour Ramy Zurayk, ce pavillon n’est pas seulement à propos du Liban. « Il fait partie de ces voix qui s’élèvent pour dire que le génocide en cours à Gaza n’est plus possible. » Quant au Liban : « Il a une importance très symbolique. Aujourd’hui, et pour une des rares fois par le biais de ce pavillon, le Liban entier est représenté. Le Liban entier s’identifie au sud du Liban, c’est vraiment unique et j’espère que cela va déclencher une remise en question de la façon dont nous, Libanais, de toutes les parties du Liban et de toutes les dénominations, de toutes les appartenances politiques, voyons le Liban sud », s’enthousiasme le chercheur, lui-même originaire du sud et qui se félicite que l’équipe à l’origine du projet vienne de différentes régions. Hisham Younes, le président de Green Southerners, estime que cette participation à la Biennale donne plus de sens à une crise humaine et au niveau de souffrance d’une telle destruction. « L’art n’est pas distant de l’environnement, de l’identité, de la culture… Cela a tout à voir avec la culture humaine. Et cela n’a pas seulement trait au Liban, c’est toute la Méditerranée », souligne-t-il.
Après Venise – la biennale prend fin en novembre 2025 -, le pavillon libanais sera rapatrié sur sa terre d’origine. L’idée est de le rapprocher du public concerné, pour ne pas le laisser aux mains d’une élite eurocentrée. « Ce n’est pas seulement un message, c’est aussi du matériel : des publications, des données, des voix… C’est du tangible, du savoir qui est partagé », insiste Rami Zurayk. Raconter, exposer, témoigner : se souvenir. Car la Terre, au Liban ou ailleurs, n’oublie jamais. Et la souffrance des habitant·es, elle, continue.

Le site du projet The land remembers et celui du Collective for Architecture Lebanon – CAL.
Image d’accueil : Disrupted ecologies. Mapping the violence of Israel’s attacks on Lebanon, mise en carte et recherche par Public Work Studio, design et visualisation des données par NEM Studio (détail).

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
Notes
- https://www.dropsitenews.com/p/lebanese-fishermen-abducted-israel-naqoura-south
- https://www.lorientlejour.com/article/1461835/mohammad-jouhair-ce-pecheur-libanais-emprisonne-en-israel-depuis-plus-de-trois-mois.html
- https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/03/07/lebanon-s-recovery-and-reconstruction-needs-estimated-at-us-11-billion
- https://ewsp.gov.lb/wp-content/uploads/2025/04/Agricultural-damage-and-loss-assessment_FAO.pdf
- https://today.lorientlejour.com/article/1460174/oussama-farhat-a-life-devoted-to-animals-and-others-cut-short-by-an-israeli-strike.html
L’article « La terre se souvient » : raconter l’écocide depuis le Sud-Liban est apparu en premier sur Terrestres.
07.10.2025 à 18:47
Gaza et la défaite de l’humanité
Dominique Eddé
97 % des cultures arboricoles ont été détruites par deux ans de guerre alors que 78 % des immeubles et 97 % des écoles ont été rasés ou endommagés. Face à cet anéantissement délibéré, l'essayiste franco-libanaise Dominique Eddé offre dans son livre « La mort est en train de changer » des réflexions très justes sur l'engrenage mortifère de cette guerre. Extraits choisis.
L’article Gaza et la défaite de l’humanité est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (5310 mots)
Temps de lecture : 14 minutes
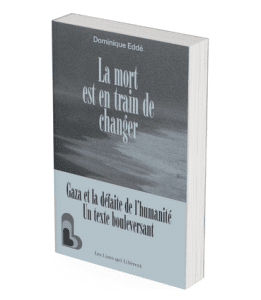
Ce texte est composé de deux extraits du livre de Dominique Eddé La mort est en train de changer paru en septembre 2025 aux éditions Les Liens qui Libèrent.
La peur de soi, la peur de l’autre
Quand la souffrance dépasse le seuil du tolérable, le peu de force qui reste est employé à la supporter. Il suffit de regarder les visages des enfants amputés, affamés à Gaza, des porteurs de cadavres, de leurs parents, de leurs proches, des prisonniers au sortir de la torture : ils sont tous inatteignables. Leur colère est comme asséchée par leur douleur ; et leur douleur, privée d’identité, traitée en masse. J’imagine ce même degré d’épuisement chez les otages israéliens. Chez les torturés des prisons syriennes à la brusque apparition du jour… Je l’ai vu sur les visages des Libanais brûlés par les bombardements du Sud. Tous ces êtres ont habité au même endroit : là où vivre consiste à mourir en vie.
Écrire pendant ce temps est une épreuve à la limite de l’obscénité. Ne pas écrire, alors que l’on peut donner du fil à retordre à la haine, est encore moins glorieux. Je vais donc essayer d’écrire. Et, en écrivant, d’écarter les mots qui ne servent plus à rien, sinon à retarder le moment d’en inventer peut-être d’autres.
L’interdiction de nommer le génocide en cours à Gaza, sous peine d’être taxé d’antisémitisme, est un verrou qui a tenu durant des mois, mois qui, pourtant, ne cessaient d’en donner la preuve. Notamment en Allemagne, en France, en Europe : dans les pays qui ont permis, à des degrés divers, que le nazisme organise la mort de six millions de juifs. Ce verrou vient de sauter. Ce ne sont plus seulement quelques esprits lucides, ou dissidents israéliens de longue date, qui le disent haut et fort. À présent, des ONG et des responsables israéliens, anciens ministres ou ambassadeurs, conviennent du processus d’extermination de la population de Gaza.
L’interdiction de nommer le génocide en cours à Gaza, sous peine d’être taxé d’antisémitisme, est un verrou qui a tenu durant des mois, mois qui, pourtant, ne cessaient d’en donner la preuve.
Pour ma part, je me suis bornée à remplacer un mot par un autre : abattoir, par exemple. Ce fut troublant de constater qu’il ne soulevait pas d’objections. Les esprits aveuglés en seraient-ils au point où il leur suffit que l’horreur absolue soit nommée d’un mot plutôt que d’un autre pour la leur rendre acceptable ? Surtout, comment comprendre qu’il ait fallu attendre si longtemps pour prendre au sérieux le ministre de la Défense israélien qui traitait impunément les Palestiniens d’« animaux humains » au lendemain du 7 octobre 2023 ? Faut-il que les territoires de la surdité et du mensonge soient faits de la même étoffe pour que la crédulité et la mauvaise foi se soient trouvées en même temps, au même endroit. En bloc, juifs et musulmans ont été désignés, menacés, en lieu et place des chefs de guerre qui, juifs ou musulmans, les mettaient en danger. Tout s’est passé comme si le langage ne servait plus qu’à écraser la pensée. On a entendu dire que l’armée israélienne était « l’armée la plus éthique du monde ». On a entendu dire par d’autres que les enfants palestiniens étaient des cibles légitimes, étant, par nature, de futurs terroristes. On a fait le procès de l’antisionisme au moment où le sionisme faisait naufrage. On a mis les mémoires en demeure de choisir chacune son pré carré dans le champ des cimetières. On a entendu des militants de la cause palestinienne douter de l’étendue du massacre du 7 octobre. On a surtout entendu un silence dévastateur, plein de sous-entendus et de réflexes coloniaux, confier à la peau blanche le pouvoir inné de mater la brune, la sauvage.

Un réfugié palestinien porte ses deux petits enfants blessés après le bombardement du camp de Nuseirat dans la bande de Gaza, 29 octobre 2023. Crédits : Ashraf Amra, UNRWA CC BY-SA 4.0.
Dès lors, l’être humain, blanc ou brun, perdait ses droits, au profit de la masse. Les régimes arabes ont excellé dans leurs vieilles habitudes : s’allier en douce à l’ennemi, simuler la désapprobation, réduire leurs peuples au silence. En France et en Allemagne, toute objection était passible de procès médiatique. Aux États-Unis, si la censure fut moins drastique dans un premier temps, elle est maintenant sans pitié. Les universités, pour ne citer qu’elles, payent d’un prix exorbitant leur quart d’heure de liberté. Celles et ceux qui tiennent, envers et malgré tout, n’ont plus de mots pour dire la suffocation. Ils regardent la mort achever son travail sur les visages exsangues d’une population cadavérique.
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Aucune des lignes que je viens d’écrire ne dédouane le Hamas de ses crimes. Aucune. Vivement le jour où il sera vu du même œil par ceux qui s’entêtent à le protéger et par ceux qui y voient un diable sorti de nulle part. Sachant que sa part « diabolique » fut méthodiquement entretenue par le pouvoir israélien. Il s’agit maintenant d’essayer de réfléchir dans l’ordre, c’est-à-dire hors symétrie, car il n’y en a pas, à l’étendue d’un désastre programmé par les répétitions infernales de notre espèce : la cécité, le mensonge et les moyens qu’elle se donne pour les avaliser. Israël est un État qui n’a pas attendu Netanyahou pour humilier, coloniser, déposséder le peuple palestinien. À quel titre devrait-on oublier que les colonies ont prospéré sous les gouvernements travaillistes au lendemain des accords d’Oslo ? Il n’y aura pas de perspective d’apaisement possible tant que la défense de soi passera par la négation de l’autre, par la mise à l’écart de l’histoire, par l’injustice dans le traitement de l’injustice.
Israël aura beau assurer sa supériorité militaire, recommencer encore et encore, il ne parviendra à assurer la pérennité de sa population qu’en renonçant à l’emmurer. Sans quoi l’avenir l’expulsera comme il est en train d’expulser les habitants de Gaza et déjà, de Cisjordanie. La reconnaissance est le mot clé de ce qui reste à sauver : la reconnaissance officielle par Israël du mal sans nom que ce pays a causé au peuple palestinien.
Il n’y aura pas de perspective d’apaisement possible tant que la défense de soi passera par la négation de l’autre, par la mise à l’écart de l’histoire, par l’injustice dans le traitement de l’injustice.
(…)
Israël : récapitulation
Étant de ceux qui, à 20 ans, ne pouvaient accepter l’existence d’Israël et qui, cinquante ans plus tard, défend sa survie dans le cadre d’un changement de cap, je voudrais commencer par me servir de moi, qui ne représente personne, comme on se sert d’un cobaye dans une expérience médicale. D’abord préciser les termes de mon cheminement. Ne pas confondre les mots. Que signifie de mon point de vue défendre la survie d’Israël ? S’agit-il de souscrire à un État juif ? Non. Pas plus que je ne peux souscrire à un État musulman ou chrétien. Il tombe sous le sens que cette région actuellement gangrenée par la fusion du religieux et du politique n’entrera en convalescence que le jour où elle y renoncera. Sachant par ailleurs que plus de 20 % de la population israélienne n’est pas juive, je ne vois pas selon quelle logique cet État pourrait se définir comme juif. S’agit-il de considérer Israël comme un principe de réalité ? Oui. S’agit-il de défendre l’avenir du peuple israélien sur cette terre et de réfléchir aux conditions pouvant assurer sa sécurité ? Oui.
Ce point crucial appelle un effort d’imagination considérable qui, pour l’heure, n’a été fait à grande échelle ni par les Israéliens, ni par les pouvoirs palestiniens, ni par les Arabes. Moins encore par les puissances étrangères. Une mauvaise foi réciproque entretient en cet endroit un tabou qui permet aux uns d’œuvrer activement au Grand Israël, au prix d’un génocide et de dégâts régionaux considérables, aux autres d’entretenir le double langage de la reconnaissance d’Israël d’un côté et du fantasme de voir ce pays disparaître de l’autre. Les régimes arabes misent sur la reconnaissance, les fondamentalistes islamistes misent sur le fantasme, les uns comme les autres ont l’autre moitié de l’équation en tête. Tous empoisonnent l’avenir. Les Palestiniens n’en finissent pas d’en mourir.

Aucun processus de paix n’a pris en compte la pression des non-dits qui la rendent impossible, aucun n’a désamorcé les bombes que fabriquent les inconscients. Plus le temps passe, plus il est dicté par le couple infernal de la prédation et de la haine. Ceci n’est qu’un début. Il faut oser continuer à creuser là où ça fait mal si l’on veut ramener tous ces corps moribonds à la vie. La région a payé trop cher l’entretien des arrière-pensées. Elle ne sortira de l’ornière que le jour où l’on aura entamé, de tous côtés, un travail simultané de récapitulation, de renoncement et de redéfinition de la réalité. Ceci implique du fait même un changement de représentation de soi et de l’autre. La tâche ne concerne pas que le Moyen-Orient. Les peuples du monde entier, toutes identités de naissance confondues, sont appelés à faire ce que l’intelligence mécanique ne peut pas faire : renoncer au miroir pour survivre. Plus exactement, troquer le miroir contre la fenêtre. Il est vrai qu’en cette première moitié du XXIe siècle, le triomphe de l’argent et celui des dictatures rendent la figure du miroir écrasante, celle de la fenêtre improbable.
➤ Lire aussi | Pendant ce temps, l’insupportable quotidien de Gaza・Rami Abou Jamous (2025)
À l’heure où j’écris ces lignes, des enfants palestiniens courent dans tous les sens à Gaza, tombent comme des oiseaux, gisent ensanglantés dans les bras de leurs parents. L’incapacité de la grande majorité de la société israélienne à en prendre conscience, à voir au-delà d’elle-même, incarne tragiquement la figure du miroir. Elle ne date pas d’aujourd’hui. Mais le degré de cécité n’a jamais connu un tel pic. Le point aveugle remonte au moment où le sionisme, pour s’installer et se construire, a eu recours à un gigantesque mensonge : il s’est inventé « une terre sans peuple pour un peuple sans terre ». Il a feint de croire – ou voulu croire à force de s’en convaincre – que le Palestinien n’existait pas. Il a donc fallu lui inventer un sens au moment où sa réalité s’est imposée. Le mot « terrorisme » a rempli le vide, il a soufflé sur les peurs et soulagé les consciences. Ce n’est pas un hasard si, parmi les voix occidentales que ce mensonge délivrait d’une culpabilité écrasante, ce sera plus tard celle du général de Gaulle, à la pointe du combat contre le nazisme, qui fera entendre sans détours sa résistance à l’injustice, son attachement au droit international ; sans laisser tomber pour autant le droit d’Israël, désormais constitué en État à dominante juive, à exister et à assurer sa sécurité.
Dans la mesure où je suis depuis toujours une irréductible de la liberté, dépourvue de fibre nationaliste, je crois pouvoir affirmer que j’aurais été farouchement antisioniste si j’étais née juive. J’y aurais vu, outre l’injustice flagrante envers les Palestiniens, une perte pour la richesse culturelle juive qui se situe bien au-delà de la fabrication d’une identité nationale. En ce sens, j’aurais sans doute dit ce qui ne peut être dit que par des juifs et que formule notamment l’historien Ilan Pappé : « Les juifs ont une contribution au monde beaucoup plus importante en tant que peuple sans État, qu’en tant que peuple doté d’un État. » J’y aurais vu par ailleurs le trop commode remboursement de la dette européenne envers les juifs. J’y aurais surtout vu le signe d’une reconduction insidieuse de l’antisémitisme, du fait même que des juifs français, allemands ou hongrois ne recevaient pas, au lendemain de l’horreur nazie, les raisons et les preuves d’une véritable réparation : l’obtention d’une entière sécurité et reconnaissance dans leurs pays de naissance. À présent que le fait accompli israélien est un principe de réalité, il revient à ses amis comme à ses ennemis déclarés de procéder à ce que j’ai appelé « le deuil de l’idéal ». Là où l’avenir reprend ses droits sur les répétitions machinales du passé, là où le goût de la paix l’emporte sur le goût exclusif de soi, des « siens ».
« Les juifs ont une contribution au monde beaucoup plus importante en tant que peuple sans État, qu’en tant que peuple doté d’un État. »
Ilan Pappé
L’antisémitisme refait des ravages depuis le 7 octobre 2023. On ne cessera de répéter qu’il ne s’agit en aucun cas du même phénomène en Occident et en Orient. L’actuelle poussée de haine envers les juifs, parmi les peuples arabes, est à voir sous un angle foncièrement différent de ce qu’elle fut, de ce qu’elle est en Europe. On ne peut pas déclarer Israël État juif, coloniser le peuple palestinien, annexer Jérusalem, et programmer la disparition de la Palestine sans prendre le risque – le mot est faible – de créer le pire des amalgames dans l’esprit de ceux que l’on humilie, que l’on dresse ainsi contre soi. Il est compréhensible que de nombreux juifs aient vécu le massacre du 7 octobre comme un pogrom antisémite, cela ne signifie pas que c’en était un. Ce massacre s’est déroulé dans le cadre d’une région démolie, livrée au chaos ; il a été mené par des hommes enragés par une colonisation sans pitié, vieille de 70 ans. Les responsabilités de cette barbarie – qui dévaste par ailleurs la région, toutes communautés confondues depuis un demi-siècle – sont largement partagées. Ignorer ce fait, s’en tenir à la version d’une agression antisémite, obstrue la pensée, bloque les issues. Que la haine envers les juifs ait terriblement augmenté ces deux dernières années dans le monde arabe, c’est indéniable. Mais se borner à la condamner, hors contexte, sans prendre en compte ce qui la cause et l’enflamme, ce n’est pas la combattre, c’est y contribuer.

De l’autre côté, force est de constater – exceptions mises à part – une tragique panne de pensée au sein des sociétés civiles arabes. Gagnés par la frustration et la colère, un nombre considérable de personnes ne raisonnent plus. Au prétexte du carnage en cours à Gaza, elles renoncent à l’autocritique, dédouanent le Hamas, relativisent le traitement infligé aux otages, cèdent au sinistre argument du chiffre et de la comparaison : « Ce n’est rien par rapport au génocide en cours. » Quand l’ennemi devient une aubaine pour se blottir dans un camp et se borner à la récrimination, alors la défaite est double : elle est physique, infligée par la force militaire de l’ennemi, et morale, infligée par soi.
Il n’y a jamais eu de société arabe plus riche qu’en temps de mixité. La perte de la présence juive dans les pays arabes est incommensurable.
Il n’y a jamais eu de société arabe plus riche qu’en temps de mixité. La perte de la présence juive dans les pays arabes est incommensurable. La plupart des esprits le savent et le regrettent. Ignorer ce que l’on sait équivaut à se couper de ce qui reste à inventer, à découvrir. Il va de soi que la lutte contre le mépris, l’ostracisme et la haine dont sont victimes les populations d’origine arabe ou musulmane, les militants, les étudiants en faveur de la Palestine, où qu’ils se trouvent, va de pair avec la lutte contre l’antisémitisme. C’est la même. Amputée de sa moitié, l’équation est une bombe.
La tragédie a acté, à Gaza, la fin d’un mensonge
La tragédie a acté, à Gaza, la fin d’un mensonge. Les États qui ont soutenu le gouvernement de Netanyahou se savent désormais coupables devant l’histoire de collaboration active avec un partenaire sanguinaire. Ils lui ont fourni des armes, des alibis, et – plus cher que tout – le temps qu’il fallait pour accomplir le boulot. Le Hamas a certes largement contribué au désastre. Les régimes arabes, n’en parlons pas. C’est pourquoi nous sommes à présent sommés de penser l’ennemi comme un monstre à mille têtes, accouché par un monde détraqué. Nous sommes très loin du nazisme, qui nous donnait à voir le mal, en un seul bloc, derrière des barreaux. Le mal, comme le monde, est liquéfié à l’heure qu’il est. Nos vieilles certitudes flottent sans avenir à la surface des eaux. Nous n’en sommes pas moins témoins, en direct, d’un mal innommable que les gouvernants de la plupart des pays démocratiques ont laissé faire – et, pour certains, alimenté. Comment comprendre que dans un pays tel que la France, ni les gouvernants, ni la majorité des médias et des intellectuels n’aient jugé utile de s’alarmer de l’interdiction des médias étrangers sur les lieux du crime ?
➤ Lire aussi | En Palestine, « l’huile qu’on attend un an, les soldats la jettent en un instant »・Forum palestinien d’agroécologie (2025)
La mise à mort de la Palestine a mis Israël au pied du mur. Le judaïsme n’entre plus dans le gant déformé de ce pays emmuré. Pas plus que d’être chrétien, musulman ou athée, le fait d’être juif n’est un passeport d’humanité. Je ne cesse de m’étonner d’entendre des phrases convenues telles que « un juif ne tue pas des enfants » ou « c’est contraire à la pensée juive d’affamer un peuple ». Il est un postulat qui vaut pour l’humanité tout entière : elle n’est jamais à l’abri, quelle que soit l’identité en jeu, du meilleur et du pire. Sans compter qu’à partir du moment où un peuple se constitue en nation avec des moyens militaires écrasants, il s’expose, quel qu’il soit, à tout ce que ces armements impliquent. Pas plus que Bach n’est responsable d’Hitler, Einstein n’est responsable de Smotrich, ou Ibn Arabi des talibans. Il appartient en revanche à tous les esprits dits libres, provenant de ces cultures, de s’interroger sur ce que les inconscients fabriquent pour mener à de tels extrêmes.
Comment comprendre que dans un pays tel que la France, ni les gouvernants, ni la majorité des médias et des intellectuels n’aient jugé utile de s’alarmer de l’interdiction des médias étrangers sur les lieux du crime ?
Ainsi, s’agissant d’Israël, qui nous fera croire que le fantasme du Grand Israël date de Netanyahou et de ses sbires ? Qui nous fera croire que c’est par inadvertance qu’année après année les terres palestiniennes ont été colonisées ? Qui, d’entre les adeptes du processus d’Oslo, nous expliquera logiquement comment la paix pouvait avoir lieu sans une restitution des territoires ? La mauvaise foi, dont Sartre disait qu’elle est une manière de mimer le rôle que l’on s’est assigné, est bel et bien au cœur de la politique israélienne, gauche et droite confondues. Sachant bien sûr que quelques personnalités politiques israéliennes, dont Yitzhak Rabin, ont souhaité la combattre et frayer une autre voie à l’avenir. Une partie de leur effort, dicté par une douloureuse conversion au réalisme, a été freinée par leur méfiance. Leur méfiance envers les Palestiniens découlant de leur méfiance envers eux-mêmes : de leur incapacité à affronter l’étendue des dégâts causés depuis 1948. Car ce n’était pas tant l’OLP qu’il fallait reconnaître en 1993, que la souveraineté du territoire palestinien.
Il est vrai qu’Israël est adossé à une mémoire terrifiante dont on peut comprendre qu’elle ait eu besoin de mentir pour survivre. Encore faut-il que ce mensonge soit un jour reconnu s’il veut se faire oublier. La question que tout le monde élude et qui engage l’avenir de millions de vies est la suivante : que veut Israël pour Israël ? Mais aussi, que veut Israël pour les juifs ? Que veulent les juifs pour Israël et pour eux-mêmes ? Sachant que le mot « juifs » recouvre un océan de différences qui leur ferait perdre le sens même de leur existence s’ils étaient condamnés à y renoncer. Et du côté arabe, se pose la question cruciale de savoir comment, sous quelle forme, les élites conçoivent-elles leur lutte contre l’invasion du champ politique par l’Islam ?
Autant dire que, pour l’heure, la catastrophe spirituelle est générale.
Photo d’ouverture : Déplacés palestiniens retournant vers la ville de Gaza et le nord de l’enclave par la rue al-Rashid, le 28 janvier 2025. Crédits : Ashraf Amra, UNRWA CC BY-SA 4.0.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
L’article Gaza et la défaite de l’humanité est apparu en premier sur Terrestres.
24.09.2025 à 19:14
Conseils #4 : Nastassja Martin, Non-noyées, un Déluge et des barrages sur la Loire
La rédaction de Terrestres
Une nouvelle vague de conseils des Terrestres pour bien résister à la rentrée. Quatre livres au programme : des glaciers qui donnent le vertige, l'héritage de la lutte majeure de SOS Loire Vivante, un « manuel de dénoyade » pour s’immerger dans l’époque et un grand roman du dérèglement climatique. Bonnes lectures !
L’article Conseils #4 : Nastassja Martin, Non-noyées, un Déluge et des barrages sur la Loire est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (4216 mots)
Temps de lecture : 11 minutes
Beau livre · Les sources de glace · Olivier de Sépibus & Nastassja Martin

Le retrait des glaciers signe la catastrophe en cours, comme un condensé d’Anthropocène. Le livre Les sources de glaces participe de la mise en récit de ces disparitions et des luttes à naître pour ne pas qu’elles sombrent dans les oubliettes de la mauvaise conscience des Modernes.
Il faut l’avouer, en matière d’édition, le beau coûte cher, et notre conseil de lecture ne déroge pas à la règle. Si ses 37€ excèdent votre budget lecture, vous pouvez feuilleter l’ouvrage en librairie, le faire commander par votre bibliothèque ou vous le faire offrir. Mais il faut dire la beauté de l’objet, le travail d’orfèvre des éditions Paulsen, la peau duveteuse de la couverture, le chemin parfaitement maîtrisé qui serpente entre textes, poèmes et photographies.
Le regard s’égare dans l’image. On peine à saisir l’échelle, le plan, la nature même de ce que l’on voit. La verticalité parfois permet de ressaisir l’ensemble, il est immense. Par ses photos, Olivier de Sépibus nous fait sentir la texture du glacier, on effleure sa peau, poreuse, craquelée, épiderme endormi d’un dragon millénaire. Mais aussi, à mesure que l’on avance dans des séries chapitrées par la poésie magnifique de René Char, peau de chagrin : la moraine gagne, la neige brunie s’épuise en filet d’eau, il ne reste plus rien de blanc et pourtant, le glacier est là, immense, métamorphosé, mais partout présent dans la forme du vallon, la pente du pierrier.
Dans un texte dont on aurait rêvé pour Terrestres, mais qui se trouve ici dans un si bel écrin que l’on ne regrette vraiment rien, Nastassja Martin nous invite à sentir-penser le glacier comme sujet, un être animé, qui se gonfle et se dégonfle dans sa lente respiration annuelle, glisse, s’étale et dont la pulsation insuffle les battements du monde, circulant de l’océan aux sommets alpins et délivrant à tous les êtres l’eau qui les fait vivre. Le glacier renferme la mémoire du monde, et sa disparition signale les pathologies de notre civilisation.
Lorsqu’on considère le glacier comme une ressource, son épuisement inexorable invite à l’action. Si c’est un stock d’eau potable, bâchons-le pour en ralentir la fonte ; si c’est une source d’informations sur l’histoire longue de notre planète, extrayons des carottes pour les conserver dans des réfrigérateurs ; si c’est un substrat qui stabilise le sol et retient la montagne, le pompage subglaciaire pourrait offrir un répit pour les villages de l’aval. Mais si le glacier est un être avec lequel nous partageons le monde, qui nous constitue et auquel nous sommes liés de mille façons, alors cette agitation ne peut suffire. Pire, elle détourne de ce que nous devons aux êtres chers lorsqu’ils disparaissent : le recueillement, la joie de les aimer et la responsabilité de leur faire une place dans nos vies et nos mémoires pour transmettre ces liens à celles et ceux qui ne les connaîtront pas. J’ai l’impression que ce livre fait cela.
On ne « sauvera » pas les glaciers des Alpes, mais on peut faire vivre leurs fantômes afin que ces géants qui ont façonné les montagnes et ses habitants persistent sous d’autres formes. Transmettre la conscience de leur puissance, de leur majesté, quand bien même celles-ci ne se manifestent plus sous l’aspect grandiose d’une immense étendue blanche mais dans les formes modestes et surprenantes de cette vie nouvelle qui émerge et s’organise là où la glace se retire.
Comme le monument au pigeon disparu dont nous parle Aldo Leopold, mais libéré des réflexes mémoriels d’une civilisation bâtisseuse qui fige dans la pierre le souvenir de ses héros, ce livre contribue à une œuvre collective : inventer des récits et bricoler des mémoires, non pas tant pour honorer les êtres disparus que pour les garder bien vivants en nous et autour nous, comme autant de petites touches qui diffractent le sublime du paysage pour en faire un milieu plein de liens, de signes et de sens.
« Revers des sources :
pays d’amont,
pays sans biens,
hôte pelé,
je roule ma chance
vers vous »René Char, Retour amont – Poèmes
Virginie Maris
► Les sources de glace, d’Olivier de Sépibus & Nastassja Martin, Paulsen, 2025
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Récit · Au pied du barrage · Martin Arnould
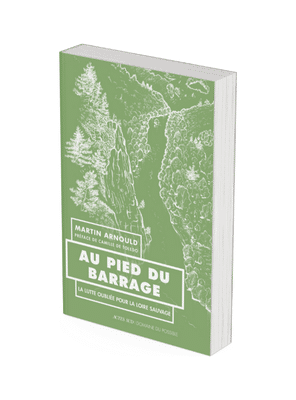
Première enquête dans la nouvelle ligne de la collection Domaine du possible, désormais dirigée par Anne de Malleray, le livre de Martin Arnould nous replonge dans une lutte à la fois majeure et méconnue du mouvement écologiste français : le combat, à partir de 1986, de SOS Loire Vivante contre la construction programmée de plusieurs barrages sur le haut bassin de la Loire, en particulier celui de Serre-de-la-Fare qui menaçait d’engloutir vingt kilomètres de gorges sauvages entre Goudet et Solignac-sur-Loire.
En mêlant un amour palpable des lieux avec une description minutieuse des modes d’action et de l’organisation du mouvement, quelques éléments biographiques, des anecdotes, des connaissances écologiques et hydrographiques, une mise en perspective historique, Martin Arnould parvient à nous faire à la fois sentir et comprendre la lutte, notamment l’occupation résolue du site durant cinq ans, à partir de 1988, qui a fini par contraindre l’État à renoncer d’abord au barrage de Serre-de-la-Fare en 1991, puis à l’ensemble du programme d’aménagement lourd de la Loire en 1994.
Mais il faut dire aussi à quel point le livre constitue un pari éditorial réussi, qui amorce une vraie réflexion sur les manières de raconter les luttes et les expériences de l’écologie politique, pour « nourrir la critique et outiller l’action » comme le défend le nouveau manifeste de la collection.
Autour du récit principal, qui constitue la colonne vertébrale de l’ouvrage, on sinue ainsi entre les superbes dessins de Jean-Alfredo Albert (qui disent, depuis aujourd’hui, les paysages sauvés des eaux), les photographies historiques de la lutte (qui rappellent parfois la joie drôle et rageuse de celles de la lutte des femmes de Greenham) et un entretien particulièrement émouvant entre l’éditrice, Martin Arnould et son père, Jean-François, aujourd’hui âgé de 90 ans, figure de la lutte lui aussi.
Cette composition donne au livre la puissance croisée du témoignage, forcément partiel et partial, de l’un des acteurs de la lutte, et des matériaux plus bruts, qui permettent à chacun·e de s’approprier le récit, avec ses failles, ses étonnements, ses certitudes, ses doutes, ses enthousiasmes, tout en le laissant résonner avec nos propres attachements et nos propres expériences.
Je dois d’ailleurs dire que le livre m’a d’autant plus touché que nos séminaires de travail avec le collectif de rédaction de la revue se passent souvent dans ces coins de Haute-Loire que j’ai appris à aimer, et parce que j’ai aussi tenté de me bagarrer — avec nettement moins de succès — pour défendre un autre bout de Loire, plus en aval, contre un autre grand projet stupide et destructeur.
Ce côté « ouvert » d’un livre-matériaux et sa rencontre avec ma propre expérience affective et militante a d’ailleurs fait naître une interrogation — mais vos lectures feront certainement émerger d’autres questions !
Pour ma part, je n’arrête pas de me demander comment les militant·es de SOS Loire Vivante ont pu échapper à ce qui est aujourd’hui le quotidien de toute opposition à un grand projet, à savoir la violence policière constante, les expulsions du moindre début d’occupation, le fichage par les services de renseignement, bref la répression méthodique.
Le récit de la lutte n’est certes pas exempt de violence, avec notamment des incendies et des coups de fusil de la part des partisans du projet. Elle est aussi hantée par l’ombre du meurtre de Vital Michalon, tué en 1978 par la grenade d’un gendarme lors d’une manifestation antinucléaire à Creys-Malville, traumatisme durable du mouvement écologiste français.
Mais comme le concède Arnould avec un étonnement rétrospectif, les Premiers ministres successifs, de gauche comme de droite, de Rocard à Balladur, tous ont eu « l’obligeance de ne jamais envoyer les gendarmes mobiles, comme Jean-Marc Ayrault le fera à Notre-Dame-des-Landes ou Manuel Valls à Sivens » (p. 91). Pourquoi cette retenue ? Faut-il, comme semble le faire parfois l’auteur, chercher l’explication dans les formes d’organisation particulière revendiquées par SOS Loire Vivante (non-violence totale, composition politique très large, alliance avec de grandes ONG comme le WWF) ? Ou bien doit-on plutôt attribuer cette relative paix policière à un contexte politique particulier, un moment où, peut-être, le capitalisme n’a pas pleinement conscience de la menace existentielle qu’une écologie politique conséquente constitue pour lui ?
Le livre, par sa construction, laisse élégamment la question en suspens : à nous d’y réfléchir ! Ce faisant, il se place à l’endroit le plus juste pour raconter aujourd’hui un combat comme celui de Loire Vivante. Tout en contribuant à garder vivace la mémoire d’une lutte, il maintient cette mémoire ouverte : comme une matière à inspiration autant qu’à discussion.
Aurélien Gabriel Cohen
► Au pied du barrage de Martin Arnould, Actes Sud, 2025
Essai · Non noyées : leçons féministes Noires apprises auprès des mammifères marines · Alexis Pauline Gumbs
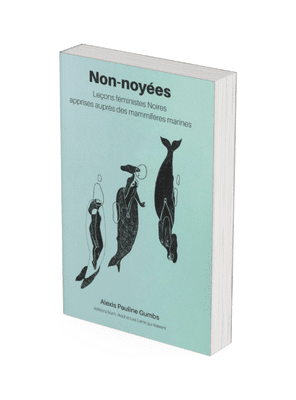
Ce n’est pas vraiment un recueil de poésie, ni un récit de « nature writing » à la première personne, et pas un pamphlet antispéciste non plus. Non noyées est un peu tout ça, et aussi autre chose : un « manuel de dénoyade » pour respirer dans des conditions irrespirables qui explore dix-neuf « leçons féministes Noires apprises auprès des mammifères marines » (le féminin générique est employé à travers le livre). S’auto-définissant comme « semeuse de troubles queer noire, évangéliste de l’amour et cousine aspirante de tous les êtres sensibles », Alexis Pauline Gumbs s’est imposée ces dernières années comme une penseuse incontournable des féminismes Noires, de l’écologie, et des maternités radicales.
Du « droit à l’obscurité » inspiré de la baleine à bec, aux pratiques d’alimentation collectives et circulaires des raies manta, en passant par l’abandon confiant des dauphins-pandas qui s’échouent sur les rivages, certains que la marée les ramènera à la mer, l’autrice tisse habilement savoirs naturalistes et poésie pour décrire les existences étonnamment queer, féroces, et parfois ludiques des mammifères de la mer. Au-delà des dualismes stériles – entre spirituel et politique, masculin et féminin (jusque dans le choix des polices de caractères, qui explorent une écriture dégenrée), elle pratique « l’art de l’identification » : non pas un geste de nomination, de capture ou de classification d’autres espèces, mais un mouvement par lequel on se reconnaît en elles, et avec elles.
Celles et ceux qui s’attendent à trouver ici un manifeste antiraciste pour une justice interespèces rigoureusement argumenté risquent d’être désorientés, peut-être même irrités, par l’absence de direction programmatique, par la pluie de « je t’aime » qui émaillent le texte, et par la primauté accordée à la résonance sensible plutôt qu’à la critique acérée. Pour reprendre le titre de la célèbre invitation d’Audre Lorde à nommer ce qui est structurellement invisibilisé, coulé et marginalisé, la poésie n’est pourtant pas un luxe, et encore moins quand elle rend hommage aux héritages des féministes Noires et qu’elle nous permet de nous identifier « avec une personne qui appartient soi disant à une autre espèce ». Encore faut-il accepter de ralentir. Et là encore, nous pouvons apprendre des mammifères marines : la phoque commune, lorsqu’elle plonge, peut faire tomber les battements de son cœur à trois, parfois quatre par minute (leçon 17).
Les dessins de Maya Mihindou sont d’une puissance radieuse, et à eux seuls, justifient qu’on ouvre le livre et qu’on s’y attarde – des baleines, des bateaux, des racines, des bulles et des sirènes s’entrelacent, nagent, s’affrontent, et résistent, évoquant la mue, la fugitivité, le souffle et la guérison – c’est magnifique, ça fait songer, et, comme dirait l’ami à qui j’ai envoyé des photos du livre par message, « purée, ça donne tellement envie de se faire tatouer » !
Léna Silberzahn
► Non noyées : leçons féministes Noires apprises auprès des mammifères marines d’Alexis Pauline Gumbs,
Burn~Août / Les liens qui libèrent, 2024
Roman · Le Déluge · Stephen Markley
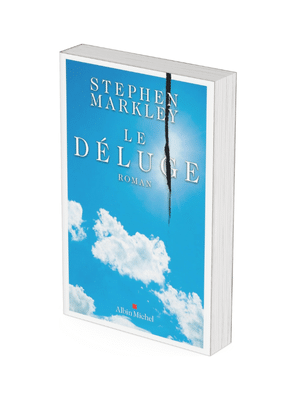
Le roman de Stephen Markley intitulé Le Déluge, paru aux États-Unis en 2022, prend la forme d’une fresque sociale et politique décrivant les affres d’une civilisation prise dans la tourmente du réchauffement climatique.
Situé dans le contexte géopolitique des États-Unis, le décor dressé par l’auteur au début du roman est des plus réalistes. On y retrouve ce qui semble de plus en plus, aujourd’hui, former le tissu de nos vies quotidiennes et de notre actualité médiatique : multiplication des catastrophes écologiques, montée de la violence et du fascisme, développement des technologies numériques, de l’IA et des systèmes de surveillance.
Sur une période temporelle allant de 2013 à 2039, on suit les trajectoires de personnages mis à l’épreuve de ces bouleversements et de leurs conséquences sur les plans intime, social et politique. Des liens, frictions, échos ou dépendances se nouent entre les vies de Tony, climatologue menacé de mort pour ses travaux sur la fonte des glaces arctiques ; de Keeper, jeune prolétaire drogué et désœuvré devenu le jouet involontaire de groupes terroristes ; d’Ashir, ingénieur informaticien qui construit des systèmes de modélisation prédictifs pour tenter de limiter les effets de la crise climatique ; de Murdock, ancien démineur de l’armée américaine recruté par un groupe de saboteurs ; de Kate, jeune militante transformée en égérie internationale de la lutte écologique ; de Jackie, publicitaire BCBG avide d’ascension sociale, prête à vendre son âme aux lobbys pétroliers et industriels pour empêcher le vote d’une loi sur le climat ; ou encore celle du « Pasteur », ancien acteur hollywoodien converti à l’évangélisme qui utilise les réseaux sociaux et la réalité virtuelle pour diffuser massivement son message d’apocalypse.
Quelles réponses chacune de ces trajectoires tente d’apporter aux bouleversements engendrés par le réchauffement climatique, pour le meilleur comme pour le pire ? Markley nous fait entrer dans la tête de chaque personnage pour suivre les mouvements et métamorphoses qui s’opèrent en lui au cours du temps et face aux événements, tout en explorant les effets de résonance ou de rétroaction à distance qui se produisent entre ces lignes de vie, tissant la toile d’une intrigue complexe, prise dans les soubresauts d’une Terre en éruption.
La montée se fait tout en crescendo, augmentant en proportion du déchaînement et de la multiplication des catastrophes écologiques – montée des eaux, méga-feux, sécheresses, ouragans, tempêtes -, exacerbant les inégalités, les dominations de classe, la déshumanisation technologique et le racisme qui déchirent la société américaine contemporaine.
À mesure que l’étau climatique se resserre, toutes ces vies se trouvent emportées dans le mouvement d’une spirale collective infernale au sein de laquelle elles ne cessent de se débattre et de chercher des issues. La montée en puissance des catastrophes écologiques nourrit une angoisse grandissante et une désagrégation du corps social, se traduisant par la montée de politiques techno-sécuritaires et autoritaires qui ne font, en retour, qu’accroître les violences et les destructions.
Le roman tire sa force de la description progressive et minutieuse, quasi-scientifique, de la complexité des ressorts, à la fois politiques, économiques, sociaux et psychologiques, qui participent à la formation de cette spirale infernale. Il déplie aussi la palette des choix qui s’offrent à nous aujourd’hui pour tenter d’y répondre et leurs possibles conséquences sur notre avenir commun : transformation sociale, réforme politique, quête eschatologique, sacrifice apocalyptique ou repli identitaire violent. Sa lecture peut indéniablement susciter de l’éco-anxiété, tant la dystopie qui s’y dessine semble réaliste, fidèle portrait d’un ensemble de tendances à l’œuvre dans notre monde contemporain.
Mais il est aussi possible de le voir comme une œuvre cathartique, réveillant et explorant toutes les émotions de pitié et de terreur que peuvent susciter les bouleversements de notre époque, moins pour condamner les lecteurs à la passivité et à l’inaction que pour leur donner les moyens d’appréhender un réel de plus en plus complexe, en révélant les tensions, contradictions, et ambivalences de notre nouvelle condition.
Sophie Gosselin
► Le Déluge de Stephen Markley, Albin Michel, 2024 (traduit de l’américain par Charles Recoursé)
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci
!
L’article Conseils #4 : Nastassja Martin, Non-noyées, un Déluge et des barrages sur la Loire est apparu en premier sur Terrestres.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Time [Fr]
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- L'Autre Quotidien
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- Gauche.Media
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
