09.01.2026 à 12:24
Reprendre la politique aux élites : la solidarité radicale contre les privilèges
Olúfémi O. Táíwò
Et si on démontait les lieux de pouvoir au lieu de faire en sorte que d’autres y accèdent ? Dans un article anticipant son livre “Elite Capture”, le philosophe étasunien Olúfémi O. Táíwò appelle à défendre les perspectives situées contre ce qu’il appelle la “déférence épistémique”, qui fragmente le collectif politique et entrave la solidarité.
L’article Reprendre la politique aux élites : la solidarité radicale contre les privilèges est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (10000 mots)
Temps de lecture : 24 minutes
Ce texte est la traduction de l’article d’Olúfẹ́mi O. Táíwò, « Being-in-the-Room Privilege : Elite Capture and Epistemic Deference », paru dans la revue The Philosopher en 2021.
La traduction a été réalisée par Mathias Rollot.
La revue Terrestres et le traducteur remercient l’auteur Olúfẹ́mi O. Táíwò et son agente littéraire Stephanie Steiker de nous avoir permis de traduire cet article.
« J’ai abandonné l’idée d’écrire à ce sujet car je ne crois pas être la bonne personne pour écrire là-dessus – je n’ai aucune idée de ce que c’est que d’être Noir… mais je peux vous envoyer mon brouillon avec mes notes, si vous voulez. »
Un frisson m’a parcouru. C’était pourtant une proposition aussi innocente que compréhensible : ses principes éthiques invitaient Helen, journaliste indépendante, à renoncer à son sujet pour me le laisser. Pourtant, j’ai craint qu’il ne s’agisse aussi d’un piège.
Même en mettant de côté l’erreur faite au sujet des dynamiques en place dans la conversation (je suis certes Noir, mais aussi professeur associé à l’université), il y avait là un problème que j’avais rencontré de nombreuses fois par le passé. Derrière l’hypothèse que je possédais une expérience vécue qu’elle n’avait pas, on pouvait reconnaître la marque d’un horizon épistémologique, politique et culturel aussi controversé que polarisant : l’épistémologie du positionnement (standpoint epistemology)1.
Consulter un dictionnaire ne permet pas vraiment de se faire une idée des controverses autour de cette idée d’épistémologie du positionnement. L’Encyclopédie Internationale de Philosophie se borne à considérer trois affirmations a priori inoffensives :
- Le savoir est socialement situé
- Les personnes marginalisées sont avantagées pour acquérir certains types de savoirs
- Les programmes de recherche devraient refléter ces faits.
Le philosophe Liam Kofi Bright montre bien que ces affirmations peuvent être déduites 1) d’une logique empirique de base, et 2) d’une explication un tant soit peu plausible des manières dont le monde social affecte les savoirs que des groupes de personnes sont susceptibles de chercher et de trouver.
Mais si le problème ne vient pas de l’idée de base, alors d’où vient-il ? Je crois qu’il n’est pas tant lié au concept initial qu’à sa mise en pratique par les normes en vigueur. L’appel à « écouter les plus concerné·es » ou à « remettre au centre les plus marginalisé·es » est très fréquent dans bon nombre de cercles académiques et militants. Je n’ai jamais été à l’aise avec ça. Selon l’expérience que j’en ai, quand les gens disent qu’il est important « d’écouter les plus concerné·es », ce n’est pas parce qu’ils prévoient de faire une visio avec un camp de réfugié·es ou de collaborer avec des sans-abris. Plus souvent, il s’agit plutôt de confier la légitimité de parole et l’attention à celles et ceux qui correspondent le mieux aux catégories sociales associées à ces maux – sans même se préoccuper de savoir ce qu’iels savent réellement, ou ce qu’iels ont personnellement vécu sur le sujet. Dans le cas de ma conversation avec Helen, ma race sociale semble me lier de façon plus « authentique » à une expérience qu’aucun·e de nous deux n’a jamais eue. Selon les règles du jeu telles que les comprenions, elle se sentait obligée de s’en remettre à moi. Ces règles prévalent souvent, même là où les enjeux sont importants – que ce soit au sein d’un groupe de recherche discutant des manières de comprendre un phénomène social ou d’un groupe militant discutant des cibles à viser.
Le piège n’était pas que l’épistémologie du positionnement puisse affecter la conversation, mais comment elle le faisait. De façon générale, lorsqu’on cherche à appliquer concrètement l’épistémologie du positionnement, on s’engage dans des pratiques révérencielles : faire des dons, passer le micro, croire en la parole de l’autre. C’est bienvenu dans de nombreux cas, et les normes sociales qui nous invitent à nous tenir prêt·es à les mettre en œuvre proviennent de motivations admirables : un désir de favoriser la situation sociale des personnes marginalisées, considérées comme sources de savoirs et destinataires légitimes de pratiques respectueuses. Hélas, le fait que de tels égards deviennent la règle de base, l’orientation politique par défaut, peut avoir pour conséquence d’aller à l’encontre des intérêts des groupes marginalisés, tout particulièrement au sein des cercles dominants (elite spaces).
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Certains lieux possèdent une influence et une puissance démesurée : la salle des réunions de crise, la salle du comité de rédaction, la table des négociations, la salle de conférence… (the Situation Room, the newsroom, the bargaining table, the conference room). Être dans ces lieux signifie être en mesure d’affecter les institutions et les dynamiques sociales au sens où on est alors en position de décider de ce qu’il convient de dire et de faire. L’accès à ces lieux est déjà, en soi, une forme d’avantage social, du genre de ceux qu’on ne peut acquérir que grâce à d’autres avantages sociaux préalablement acquis. D’un point de vue sociétal, les personnes les plus « affectées » par les injustices sociales associées aux identités politiques principales (genre, classe, race, nationalité) ont beaucoup plus de probabilités d’être emprisonnées, sous-employées, ou d’être dans les 44 % de la population mondiale sans accès à Internet – et donc d’être mises à l’écart des lieux du pouvoir et tout à fait ignorées par les personnes présentes dans ces lieux. Les individus qui ont le plus de chances de se trouver dans ces lieux sont, au contraire, ceux qui réussissent à passer au travers des différents mécanismes de sélection sociale filtrant les identités sociales associées à ces résultats négatifs. En d’autres termes, ces personnes sont d’autant plus susceptibles de se retrouver dans les lieux du pouvoir qu’elles sont systématiquement différentes (et donc non-représentatif·ves) des gens qu’iels sont ensuite supposées représenter une fois entrés à l’intérieur.
J’avais l’intuition que la proposition d’Helen était un piège. Non pas un piège qu’elle aurait tendu elle-même, mais un piège qui menaçait de nous piéger elle et moi de la même manière. Les normes culturelles – du genre de celles qu’on mobilise quand on introduit une déclaration par « En tant qu’homme noir… » – ont installé un ensemble de pratiques respectueuses de l’épistémologie du positionnement que beaucoup d’entre nous connaissent par cœur, consciemment ou inconsciemment. Mais voilà : les formes de révérence sociale qui en découlent finissent souvent par devenir contreproductives, et ne servir efficacement que la capture du pouvoir par les élites2, à savoir le contrôle des programmes politiques et des ressources par le groupe le plus avantagé. Si l’objectif était d’utiliser l’épistémologie du positionnement pour remettre en cause les configurations de pouvoir injustes, difficile de faire pire.
➤ Lire aussi | Nous danserons avec les montagnes・Báyò Akómoláfé (2024)
Pour expliquer ce qui ne va pas avec l’habituelle façon révérencielle (deferential) de mettre en œuvre l’épistémologie du positionnement, nous devons commencer par voir ce qui la rend si populaire. Commençons par évoquer les postures les plus cyniques : certain·es chez les plus avantagé·es d’un point de vue social, ne pas veulent pas réellement de changement social réel – iels n’en désirent que l’apparence. Par ailleurs, la révérence (deference) à l’égard des personnes liées aux communautés opprimées peut n’être qu’une performance qui édulcore, s’excuse, ou encore détourne du fait que la personne à qui est faite cette politesse a finalement déjà le privilège de se tenir dans les lieux où se prennent les décisions, et que le changement de perspective qu’elle suggère sera entendu.
Quoique j’ai l’intuition qu’il y a bien quelques vérités dans tout ça, je reste malgré tout insatisfait. La plupart des gens qui soutiennent et mettent en pratique ce genre de politesses sociales (deferential norms) ressemblent à Helen : bien intentionnés, mais confiants à l’idée que les personnes avec qui iels partagent ces lieux du pouvoir peuvent les aider à trouver l’expression qui convient à leurs engagements moraux communs. Pour expliquer le phénomène, il n’est même pas nécessaire de croire que la plupart de celles et ceux qui interprètent l’épistémologie du positionnement de la sorte sont de mauvaise foi, et on ne voit d’ailleurs même pas bien en quoi cela pourrait aider de croire cela. Les mauvais « colocataires » peuplant les lieux du pouvoir ne sont pas le problème, de la même façon que l’hypothèse selon laquelle Helen puisse être une bonne colocataire n’était pas la solution. Le problème vient de la manière dont ces lieux du pouvoir sont construits et gérés.
Pour en revenir à mon exemple initial avec Helen, la problématique n’était pas simplement que je n’ai pas grandi dans le milieu populaire et opprimé qu’elle imaginait. Épistémologiquement parlant, la situation était bien pire que ça. Bon nombre des faits sociaux qui ont rendu ma vie différente de celle des gens auxquels elle pensait sont justement les raisons pour lesquelles on me propose aujourd’hui des choses en leur nom. Si j’avais grandi dans un tel milieu, nous n’aurions probablement jamais été au téléphone ensemble, Helen et moi.

À bien des égards, notre système social repose sur un ensemble de mécanismes filtrants, qui déterminent quelles interactions peuvent avoir lieu, entre qui et qui, et donc, en définitive, quelles structures sociales les gens sont en mesure d’observer ou non. Durant la majeure partie du 20e siècle, le système de quota d’immigration des États-Unis a rendu accessible presque exclusivement aux Européens l’immigration légale et le chemin vers la citoyenneté (ce qui a valu au pays d’être considéré par Hitler comme le « leader incontesté dans l’élaboration de politiques explicitement racistes en matière de nationalité et d’immigration »3). Avant que le 1965 Immigration and Nationality Act n’ouvre de nouvelles possibilités migratoires pour les « travailleur·ses qualifié·es ».
Que mes parents aient pu intégrer cette catégorie des travailleur·ses qualifié·es explique aussi bien leur entrée sur le territoire américain que les avantages de classe et les ressources financières (notamment la richesse) dont j’ai bénéficié depuis toujours. Cette situation n’a rien d’inhabituel : la communauté immigrée nigériane-américaine est une de celles qui a le mieux réussi (ce que personne ne dit, bien sûr, c’est que les quelques 112 000 Nigérian·nes-Américain·es diplômé·es ne représentent que bien peu par rapport aux 82 millions de Nigérian·nes qui vivent avec moins d’un dollar par jour, ni comment le premier fait recoupe le second). La sélectivité des lois en matière d’immigration explique bien les taux de réussite scolaire de la communauté nigériane de la diaspora qui m’a élevé ; ce qui explique à son tour comment j’ai pu intégrer les plus prestigieuses classes du lycée ; ce qui aide à son tour à comprendre comment j’ai pu poursuivre avec des études supérieures ; etc.
Les faits qui font que telle personne atterrit dans telle pièce construisent notre monde bien plus puissamment que les combats de coq qui ont lieu à l’intérieur de ces pièces.
Ainsi, il est assez facile de voir comment cette manière très particulière d’appliquer l’épistémologie du positionnement contribue à favoriser la capture du pouvoir par les élites. L’accès aux salles du pouvoir, aux lieux influents (rooms of power and influence), est conditionné par une longue série de sélections sociales en chaîne. Plus votre niveau social est élevé, et plus vos expériences sociales se réduisent – certains sont directement acheminés vers les doctorats, et d’autres vers les prisons. S’engager dans les questions d’identité par le biais de politesses épistémologiques, c’est risquer de reproduire les déformations produites par ces processus de sélection sociale.
Cela étant dit, il est aussi assez facile de voir, à plus petite échelle – dans une pièce, dans un champ ou dans un pan de la littérature scientifique, dans une conversation –, pourquoi ces pratiques révérencielles peuvent paraître sensées. C’est souvent un moindre mal au regard des épistémologies qui les ont précédées : la personne traitée avec déférence peut en effet être un peu mieux positionnée, épistémologiquement parlant, que les autres personnes présentes dans la pièce (the room). Ça peut aussi être ce que nous avons à faire de mieux tant que les pièces elles-mêmes ne sont pas remises en cause – quel pouvoir on y trouve, qui y est admis, etc.
Mais n’est-ce pas la dernière chose que nous devrions espérer voir changer ? Faire mieux que les normes épistémologiques que nous a légué une histoire fondée sur un genre d’apartheid explicite global, voilà un objectif affreusement bas. Les faits qui font que telle personne atterrit dans telle pièce construisent notre monde bien plus puissamment que les combats de coq qui ont lieu à l’intérieur de ces pièces. Et quand on en vient à débattre de justice sociale, les mécanismes sociaux qui déterminent la position de chacun sont précisément les fragments de la société que nous cherchons à confronter. Par exemple, le fait que les personnes emprisonnées ne peuvent pas participer aux discussions académiques sur la liberté qui se tiennent sur les campus universitaires est intimement lié au fait qu’elles sont en cellule.
Les discussions en matière de justice semblent aujourd’hui façonnées par des gens plus préoccupés par la répartition de l’attention et des discours.
La politesse épistémologique se positionne comme une solution à un double problème à la fois politique et épistémique. Hélas, non seulement cela ne permet pas de résoudre ces problèmes, mais cela en ajoute de nouveaux. On pourrait penser que les questions de justice devraient être avant tout dirigées vers la résolution des disparités en matière d’accès à la santé, de conditions de travail, ou de sécurité. Mais voilà : les discussions en matière de justice semblent aujourd’hui façonnées par des gens plus préoccupés par la répartition de l’attention et des discours. Les pratiques révérencielles qui ne se placent qu’au service de la question de l’attention (du genre « nous avons lu trop d’hommes blancs, maintenant il faut lire ce qu’écrivent les gens de couleur ») peuvent échouer sur le terrain de leurs propres termes : recentrer l’attention sur les orateur·ices issus des groupes marginalisés peut, par exemple, décentrer l’attention de la nécessité de changer le système social qui les marginalise.
Les élites issues des groupes sociaux marginalisés peuvent bénéficier de ce processus de bien des manières, et ce n’est pas forcément un mal pour le progrès social. Mais il faudrait vraiment être très naïf·ve pour croire que les intérêts des élites sont nécessairement – ou même supposément – alignés avec ceux de la population dans son ensemble. Considérer de la sorte les intérêts des élites, c’est faire preuve d’un genre de Reaganomics racial – une stratégie qui repose sur le fantasme d’un dialogue entre économie de l’attention et économie réelle.
Peut-être que les quelques personnes payées pour décrire le carnage permanent dans lequel nous nous trouvons, et ce, de la manière la plus authentique – culturellement parlant – et la plus radicale – cosmétiquement parlant – sont réellement en train d’emporter une victoire culturelle. Et peut-être que lorsque nous, les bavards, nous aurons gagné l’attention et l’influence que nous méritons, et que nous aurons mis la main sur le butin, son contenu ruissellera magiquement sur les travailleur·ses qui nettoient la salle après nos conférences, sur les bidonvilles des mégalopoles des Sud globaux, et même jusque dans les campagnes.
Ou peut-être pas.

Pour pouvoir évaluer de façon plus complète et plus juste l’enjeu posé par ces façons révérencieuses de pratiquer l’épistémologie du positionnement, il faudrait aller au-delà des arguments de principe et affronter les attraits émotionnels d’une telle approche. Celles et ceux qui se tiennent dans les lieux du pouvoir ont beau faire partie de l’« élite », ça ne dit rien des manières dont on les y traite. Après tout, qu’une personne soit privilégiée, au sens strict du terme – c’est-à-dire qu’elle fait partie de la moitié de la population mondiale ayant un accès garanti aux besoins fondamentaux – n’empêche pas qu’elle puisse être constamment en position d’infériorité dans les rapports de force qu’elle vit au quotidien. La politesse épistémologique est une réponse à des expériences réelles et pesantes – celles du mépris, de l’ignorance, de l’exclusion. Elle s’avère donc tout particulièrement attirante pour les membres des groupes marginalisés ou stigmatisés, en ce qu’elle intervient directement sur les pratiques moralement fondamentales que sont l’attention et le respect.
Les dynamiques sociales dont nous faisons l’expérience ont un rôle énorme dans le développement et la redéfinition de notre subjectivité politique, autant que dans la perception que nous avons de nous-mêmes. Mais la force de l’épistémologie du positionnement – sa reconnaissance de l’importance de cette mise en situation des discours – devient sa fragilité lorsqu’elle n’est mise en œuvre qu’au moyen de pratiques révérencieuses. Mettre l’accent sur la manière dont nous sommes marginalisé·es conduit souvent à voir le monde de la façon dont nous en avons fait l’expérience. Cependant, si on adopte une perspective plus structurelle, il est peut-être plus intéressant pour comprendre le monde et la place que nous y occupons de s’attarder sur les lieux où nous n’avons jamais eu besoin d’entrer (et de considérer les raisons qui expliquent pourquoi nous pouvons éviter d’y entrer). Si cela est vrai, alors toute pratique révérencieuse de l’épistémologie du positionnement empêche, en fait, tout « centrage » sur les plus marginalisé·es, voire même rend leur discours inaudible. Cela nous amène à ne nous concentrer que sur les interactions se déroulant dans les lieux que nous occupons, au détriment de celles dont nous ne faisons pas habituellement l’expérience. En plus du fait que parler au nom des autres est potentiellement problématique (en particulier quand iels ne sont pas là pour parler elleux-mêmes de leurs propres situations), s’intéresser uniquement à la question de savoir qui est dans la pièce permet d’éviter de remettre en cause la centralité de notre propre souffrance – et de la souffrance des personnes marginalisées qui parviennent à entrer dans les lieux du pouvoir avec nous.
Celles et ceux qui se tiennent dans les lieux du pouvoir ont beau faire partie de l’« élite », ça ne dit rien des manières dont on les y traite.
Ces politiques révérencieuses posent donc tout autant de problèmes que le fait d’être tenu à l’écart des lieux les plus importants du pouvoir. Or, chez celleux envers qui on fait preuve de déférence, cela peut ne faire qu’amplifier les normes et stéréotypes dont souffre la communauté marginalisée en question. Dans son ouvrage Le Conflit n’est pas une agression, Sarah Schulman écrit que, bien qu’ils aient des origines et des conséquences morales très différentes, les effets psychologiques nés du traumatisme et ceux nés du sentiment de supériorité entraînent pourtant des comportements similaires chez les personnes. Cela peut notamment conduire à déformer les enjeux d’un conflit (souvent en exagérant les dommages), ou bien à considérer l’indépendance de l’autre comme une menace (par exemple en échouant à se concentrer sur les bonnes problématiques ou les bonnes personnes). Peu importe leur origine : ce genre de comportements a des effets néfastes à la fois pour les individus qui les adoptent et pour les communautés qui les incluent — particulièrement quand ces dernières favorisent et valorisent ces comportements au lieu de les limiter ou de les digérer.
➤ Lire aussi | À mes ami·es blanc·ches・Báyò Akómoláfé (2022)
Concernant celleux qui s’inclinent, cette pratique révérencielle peut aussi avoir pour effet de favoriser la lâcheté morale. En effet, cette stratégie fournit une couverture sociale bien utile pour se délester de toute forme de responsabilité personnelle : il suffit de reporter sur d’autres héro·ïnes individuel·les, sur une classe héroïsée, ou encore sur un passé mythifié, le travail qui est le nôtre et que nous devrions accomplir aujourd’hui. La perspective des personnes sur qui cette charge est reportée a beau être plus claire sur un point ou un autre, leur point de vue général n’est pas moins subjectif et socialement déterminé que le nôtre. Plus important encore, la politesse épistémologique déplace la responsabilité qui nous incombe, pour la déposer sur d’autres que nous – et, en plus, le plus souvent, sur une version caricaturale, hyper-aspetisée et totalement fictives d’elleux.
Ce faisant, ces mêmes tactiques révérencielles ne nous isolent pas seulement de la critique, mais aussi de la possibilité de nous relier à d’autres et d’évoluer. Elles nous empêchent de nous engager authentiquement, avec une empathie réelle, dans les luttes des autres – ce qui est tout de même la condition préalable à toute forme d’alliance politique. À mesure que les questions d’identité et que les dissensus se précisent, il apparaît que les « coalitions politiques » (au sens des luttes collectives par-delà nos différences) ne sont juste que des pratiques politiques tout court. C’est pourquoi la politesse épistémologique, au même titre que l’atomisation des groupes politiques qu’elle génère, est en fin de compte parfaitement anti-politique.
Remplacer l’interdépendance par la révérence peut bien faciliter les choses sur le moment. Mais le coût global de ce court-termisme est élevé, au sens où on risque alors de saper les objectifs de l’épistémologie du positionnement, et de s’engager dans une direction politique défavorable à quiconque se bat pour la liberté plutôt que pour les privilèges, et pour la libération collective plutôt que pour des guerres de chapelle.

En quoi est-ce qu’une approche constructive (constructive approach4) de l’épistémologie du positionnement diffèrerait fondamentalement de cette approche révérencielle ? Une approche pragmatique se concentrerait sur la poursuite d’un objectif ou d’un résultat particulier, plutôt que seulement adhérer à des principes moraux ou d’éviter à tout prix la « complicité » dans l’injustice. Elle se préoccuperait surtout de la construction des institutions et s’attacherait à cultiver les pratiques de collecte partagée d’informations, plutôt que de juste vouloir « aider ». Elle se concentrerait sur la responsabilité plutôt que sur la conformité. Elle mettrait son énergie sur la question de la distribution sociale des ressources et du pouvoir, plutôt que de s’attarder sur des objectifs intermédiaires et d’aboutir à des tactiques de valorisation symboliques sans conséquences. Elle se concentrerait sur les manières dont sont construits les lieux du pouvoir, et non sur la régulation des flux de personnes à l’intérieur de ces lieux. Elle s’engagerait dans un projet de construction sociale, visant à déconstruire et reconstruire les structures sociales actuelles, les mouvements sociaux et leurs interconnections, plutôt que de se contenter de critiquer les systèmes sociaux en place.
La crise de l’eau à Flint, dans le Michigan, permet de comprendre tant les possibilités que les limites d’une telle réorientation de nos manières de faire. Le Michigan’s Department of Environmental Quality (MDEQ), une agence gouvernementale de santé environnementale chargée d’aider les communautés, avec à sa disposition une équipe d’une cinquantaine de scientifiques expérimentés, s’est rendu complice de dissimulation de l’ampleur et de la gravité d’un scandale sanitaire arrivé entre 2014, début de la crise, et 2015, date à laquelle il a attiré l’attention à échelle nationale.
➤ Lire aussi | Freedom farmers, la résistance agriculturelle noire aux États-Unis・Flaminia Paddeu, Monica M. White (2025)
Le MDEQ, autorité épistémologique et politique, a défendu le statut quo à Flint. L’agence a affirmé que « l’eau de Flint est propre à la consommation ». Elle a été citée par le Maire de Flint, Dayne Walling, dans ses déclarations d’avril 2014 « contre les affabulations et pour rétablir la vérité au sujet de la rivière Flint ». Il s’agissait alors d’engager la transition vers un captage de l’eau potable dans la rivière. Une transition orchestrée par le responsable des urgences municipales Darnell Earley – qui est Afro-Américain, tout comme bon nombre des habitant·es de la ville qu’il a contribué à empoisonner. En juillet 2014, l’American Civil Liberties Union (ACLU) rendit publique une note interne produite par l’agence fédérale Environmental Protection Agency (EPA) exprimant son inquiétude quant aux taux de plomb dans l’eau en question. En réponse, le MDEQ rédigea un rapport bidon, dans lesquels les niveaux de plomb restaient conformes aux normes en vigueur. Il avait juste mystérieusement omis de compter deux échantillons contaminés.
La réaction des habitant·es ne se fit pas attendre. Dans le mois qui suivit la transition d’une station de captage à l’autre, les riverains signalèrent bien à quel point l’eau de leur robinet avait une couleur étrange et dégageait une odeur inquiétante. Les habitant·es n’avaient pas besoin que l’oppression dont iels faisaient l’objet soit « célébrée », que l’attention soit « centrée » sur elleux, ou que tout ça soit retranscrit dans la langue de l’académisme en vigueur. Les habitant·es n’avaient pas besoin que les autres comprennent ce que ça fait que d’être empoisonné. Ce dont les habitant·es avaient besoin, c’était d’une eau sans plomb. Alors iels se mirent au travail.
Premièrement, il leur fallait pouvoir répondre avec la même autorité épistémologique. Pour cela, les habitant·es s’engagèrent donc dans la construction d’un nouveau lieu de pouvoir : une pièce où habitant·es et activistes pourraient se retrouver et collaborer avec les laboratoires scientifiques ayant les capacités de prouver que le rapport du MDEQ était bidon. La mobilisation organisée par les communautés habitantes de Flint permit de rallier des scientifiques bien établis à leur cause, et déboucha sur une campagne de « sciences participatives » via la distribution de kits de mesure citoyens, ce qui participa à visibiliser plus encore l’urgence et la gravité de la situation sanitaire. L’empoisonnement des enfants de Flint devint un scandale national. L’alliance entre habitant·es et scientifiques l’emporta.
Les habitant·es n’avaient pas besoin que les autres comprennent ce que ça fait que d’être empoisonné. Ce dont les habitant·es avaient besoin, c’était d’une eau sans plomb.
Mais ce n’était pas suffisant. La deuxième étape – retrouver une eau saine – nécessitait plus qu’une reconnaissance de la situation : il fallait désormais des ressources et des heures de travail, pour réparer le réseau hydraulique et répondre aux inquiétudes sanitaires toujours présentes. Au départ, les habitant·es de Flint ne reçurent que des moqueries et des fadaises de la part de l’élite en place (dont certaines émises par le Président des États-Unis lui-même, et ce bien qu’il partage la même identité raciale que beaucoup d’entre elleux). Mais à la suite de l’activisme acharné des habitant·es de la ville, et à mesure que grandissait la liste de leurs allié·es, quelques victoires fut arrachées : les canalisations problématiques furent finalement remplacées une à une, et l’État du Michigan a été obligé de verser plus de 600 millions de dollars de dédommagement aux familles concernées.

Ce résultat n’est en aucun cas une victoire totale : non seulement il faut en déduire les frais de justice engagés dans cette affaire, mais surtout ce dédommagement financier ne saurait annuler à lui seul les dommages subis par les habitant·es. Une épistémologie constructive ne peut garantir de victoire totale face à un système oppresseur. Aucun horizon épistémologique ne peut, de lui-même, défaire les asymétries de pouvoir à l’œuvre entre un peuple et l’impérialisme d’un système social. Mais il peut aider à rééquilibrer un peu les forces en présence – sans même qu’on ait à faire appel à une quelconque politesse épistémologique.
La justice sociale et les économies de l’information ne sont pas menacées par un manque de jargon qui permettrait de décrire plus précisément ou radicalement les afflictions épistémologiques, attentionnelles ou interpersonnelles des sans-pouvoirs.
Ce qui menace la justice sociale, c’est l’érosion des bases pratiques et matérielles permettant l’émergence de contrepouvoirs populaires face aux systèmes de production et de distribution du savoir en place – en particulier si ces bases populaires peuvent favoriser une action politique efficace, et limiter ou éliminer la prédation par les élites. Rien n’arrête pour l’heure la mainmise sur ces bases populaire et leur corruption par les élites bien placées, en particulier les entreprises de la tech, et on n’assiste à aucune remise en cause : ni de l’influence exercée par l’entreprenariat sur les journaux d’information locaux, ni de la destruction et du pillage de la profession de journaliste, ni des collusions entre les grandes entreprises et les politiques à des points clés du système démocratique, ni de la prédominance d’une production de savoir universitaire favorisant les intérêts des élites, pas plus que de la diffusion par les médias traditionnels des résultats de ces processus très orientés.
Confronter ces menaces nécessite d’abandonner certains des lieux de pouvoir en place. Et d’en construire de nouveaux.
Ce qui menace la justice sociale, c’est l’érosion des bases pratiques et matérielles permettant l’émergence de contrepouvoirs populaires face aux systèmes de production et de distribution du savoir en place.
Approcher l’épistémologie du positionnement de façon constructive est exigeant. Il faut nager à contre-courant : réfléchir de façon responsable avec celles et ceux qui ne sont pas encore dans la pièce avec nous ; construire de nouveaux lieux de rencontre au sein desquels nous pourrions nous retrouver, plutôt que de juste nous déplacer au sein des lieux de pouvoir que l’histoire nous a légué. Mais après tout, c’est probablement normal dès lors qu’il s’agit de politiques de la connaissance : la philosophe Sandra Harding a bien montré en quoi l’épistémologie du positionnement, lorsqu’elle est pleinement considérée, requiert non pas moins mais davantage de rigueur des sciences et des processus de production de la connaissance en général.
Mais voilà : un sujet important reste encore en suspens. L’approche révérencielle de l’épistémologie du positionnement est souvent inséparable d’une préoccupation et d’une reconnaissance de l’importance de l’expérience vécue. Dont, tout particulièrement, les expériences traumatiques.
À ce point de l’argumentation, je dois reconnaître manquer de distanciation et de capacité à rationaliser froidement le sujet. L’essence de ce que j’ai à dire ici tient plus de la conviction que de l’hypothèse scientifique. Heureusement, la vie des idées m’a appris au fil des années que nous n’avons pas moins à apprendre de nos convictions, quoiqu’elles se posent et se travaillent différemment. Je poursuis donc.
Je prends très au sérieux la question du traumatisme. J’ai grandi aux États-Unis, une nation fondée sur un colonialisme de peuplement, l’esclavage, le racisme et leurs conséquences respectives. Tout le monde a son lot de traumatismes historiques et collectifs ici. J’ai aussi grandi au sein de la diaspora Nigériane, une communauté vivant avec des souvenirs brûlants de génocide. Tant au niveau national qu’au niveau communautaire, bon nombre de traits de caractères, de personnalité, d’habitudes et de comportements que j’observe me semblent liés à ces histoires traumatiques. À l’échelle individuelle, j’ai pu craindre pour ma vie ou pour ma dignité, ressentir douleurs intenses et humiliation ; et je me suis vu changer en fonction de ces sentiments. Je repense souvent à ces souvenirs traumatisants. Mais je ne me dis que très rarement : « ça m’a appris quelque chose ».

Ces expériences peuvent être, si on est vraiment chanceux·ses, des éléments fondateurs de notre vie. Ce qui en sort dépend de la manière dont ces éléments s’agencent les uns avec les autres – ce que la théorie du positionnement nomme « thèse de l’accomplissement » (achievement thesis). Briana Toole met bien en lumière en quoi notre situation sociale ne nous place qu’en position de savoir quelque chose. Mais pour ce qui est du « privilège épistémique », de l’avantage, il ne peut être obtenu que par le biais d’une lutte concertée, délibérée, menée depuis cette position.
Je concède bien volontiers que l’expérience de l’oppression peut conduire à cela : je n’ai aucun doute sur le fait que l’humiliation, la privation et la souffrance peuvent construire les individus (en particulier lorsque le contexte est favorable aux luttes volontaires et structurées vers la conscientisation (consciousness raising) dont parle Toole). Mais ces mêmes expériences peuvent aussi s’avérer destructrices. Lequel de ces deux effets a le plus de chance d’advenir ? Pour ma part, je parierais plutôt sur le second. Comme l’a justement noté Agnes Callard, le traumatisme – et même la colère légitime et méritée qui l’accompagne souvent – peut corrompre autant qu’il peut ennoblir. Peut-être même davantage.
Quoiqu’en dise le proverbe, qu’elle soit ou non le fruit de l’oppression, la souffrance n’est pas un bon professeur. La souffrance est partiale : elle ne voit pas bien loin et reste tournée sur elle-même. On ne devrait pas fonder nos relations sociales sur d’autres attentes que cela là : l’oppression, ce n’est pas une classe prépa.
Le traumatisme – et même la colère légitime et méritée qui l’accompagne souvent – peut corrompre autant qu’il peut ennoblir. Peut-être même davantage.
Au bout du compte, ce que je crois le plus profondément au sujet de l’épistémologie du positionnement, c’est que cela demande au traumatisme quelque chose que le traumatisme ne peut offrir. Oui, l’approche constructive est exigeante. Mais la pratique de la révérence épistémologique l’est bien plus encore, tout en s’avérant aussi être bien plus injuste : elle demande aux traumatisé·es de porter sur leurs seules épaules ce que nous devrions toutes et tous travailler collectivement. Quand je pense à mon propre traumatisme, il ne me vient pas de grandes leçons de vie. Je pense plutôt à la noblesse, bien silencieuse, de la simple survie. Le fait même que ces chapitres n’aient pas été les derniers de ma vie est déjà, en soi, bien assez puissant. Je suis toujours là pour me rappeler de ces histoires, et c’est déjà pas mal.
La politesse épistémologique nous demande d’être moins que ce que nous sommes véritablement et ce, sans même que ce soit dans notre propre intérêt. Comme Nick Estes a pu le montrer dans le contexte de pratiques politiques autochtones : « qu’on parle de racisme, de citoyenneté autochtone ou d’appartenance, la fourberie des politiques actuelles en matière de traumatisme est de transformer les personnes et les luttes en question de préjudice. Elles ramènent des peuples entiers à leurs traumatismes plutôt au détriment de leurs aspirations, ou même de leur simple humanité »5. Un processus qui n’est jamais en faveur des peuples autochtones, mais destiné aux « audiences blanches et aux institutions du pouvoir ».
Je pense aussi à la prise de conscience de James Baldwin réalisant que les choses qui l’ont le plus tourmenté dans sa vie étaient « les choses qui [le] connectaient avec toustes celleux qui sont vivant·es, qui ont été vivant·es »6. Le fait que j’ai survécu à différents types d’abus et que j’ai frôlé la mort à la fois à la suite d’un accident et de violence subies (même si ces expériences diffèrent entre elles comme elles diffèrent de celles vécues par les personnes autour de moi) n’est pas une carte que je peux jouer en société, ni une arme à manier pour gagner quelques points de prestige social. Ça ne me donne aucun droit particulier pour parler, évaluer, ou décider au nom d’un groupe ou d’un autre. C’est une manifestation concrète, une expérience de la vulnérabilité qui me rapproche plutôt d’une grande partie de l’humanité. Ce n’est pas quelque chose qui s’érige entre les autres et moi comme un mur : c’est un pont qui nous relie.
Après une longue discussion, j’ai finalement répondu à l’offre d’Helen par cette proposition : et si on écrivait quelque chose ensemble ?
Note du traducteur
J’ai découvert ce texte dans Radical Futurisms, de T. J. Demos (Steinberg Press, 2023), riche ouvrage dont les pages 211-212 synthétisent bien la proposition de ce puissant article d’Olúfémi Táíwò. Il s’agit d’une traduction humaine (et non machinique-automatique par IA), réalisée à l’automne 2025, en appui sur quelques conversations informelles avec Daphné Hamilton-Jones, Céline Bonicco-Donato et Mireille Roddier. Elle a été relue par Emilie Letouzey que je remercie vivement pour l’immense travail effectué.
Image d’accueil : Signet-976 sur Unsplash.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
Notes
- NDT : Suivant l’invitation de Sarah Bracke, María Puig de la Bellacasa et Isabelle Clair, le concept de standpoint est traduit dans cet article par « positionnement » et non « point de vue ». Renvoyons aux explications lucides des autrices à ce sujet : « Nous faisons le choix que standpoint feminism soit traduit par féminisme ‘du positionnement’, plutôt que ‘du point de vue’, alors que cette dernière expression est la plus courante en français et que le terme standpoint est, en anglais, synonyme de viewpoint. Mais le ‘point de vue’, ou encore la ‘perspective’, exposerait notre propos à des interprétations perspectivistes voire relativistes, contraires à notre intention et à celle des auteures dont nous présentons les écrits. ‘Point de vue’ ou ‘perspective’ auraient aussi l’inconvénient de diluer l’intensité contenue dans le terme standpoint qui suggère la résistance, l’opposition, l’adoption d’une attitude, la prise de position. La traduction par ‘positionnement’ permet dès lors d’insister sur le caractère politique, actif et construit du standpoint. » Pour plus de détails à ce sujet, lire María Puig de la Bellacasa, Politiques féministes et construction des savoirs. Penser nous devons !, 2012, Paris, L’Harmattan, p. 170-72. » Bracke, S., Puig de la Bellacasa, M., et Clair, I. (2013), « Le féminisme du positionnement. Héritages et perspectives contemporaines », Cahiers du Genre, 54(1), 45-66.
- NDT : Sur le sujet des « elite capture », on lira d’Olúfẹ́mi O. Táíwò son ouvrage éponyme paru peu de temps après cet article : Elite Capture : How the Powerful Took Over Identity Politics (And Everything Else), Pluto Press, 2022. L’ouvrage est paru en français en novembre 2023 chez l’éditeur québécois Lux, sous le titre L’élite cannibale : comment les puissants se sont appropriés les luttes identitaires (et tout le reste).
- NDT : Cité notamment dans David Scott Fitzgerald & David Cook-Martin, Culling the Masses : The Democratic Origins of Racist Immigration Policy in the Amiricas, 7 (2014), p. 36.
- Nous choisissons de traduire constructive par constructif en accord avec le choix fait par la traduction québécoise dans L’Élite cannibale, Lux, 2023).
- NDT : https://sokokisojourn.wordpress.com/2020/09/11/nick-estes-on-trauma-politics/
- NDT : “You think your pain and your heartbreak are unprecedented in the history of the world, but then you read. It was books that taught me that the things that tormented me most were the very things that connected me with all the people who were alive, who had ever been alive.”— James Baldwin, “The Doom and Glory of Knowing Who You Are”, Life Magazine, mai 24, 1963.
L’article Reprendre la politique aux élites : la solidarité radicale contre les privilèges est apparu en premier sur Terrestres.
28.12.2025 à 10:30
Le tournant féministe de la primatologie
Donna Haraway
1989 : dans une enquête magistrale sur le rôle des femmes dans la primatologie, Donna Haraway articulait sciences, patriarcat, racisme et impérialisme. Un classique fondateur des humanités environnementales enfin traduit, alors que les grands singes, à l’interface entre nature et culture, vivent désormais au seuil de l’extinction. Préface inédite et introduction.
L’article Le tournant féministe de la primatologie est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (15451 mots)
Temps de lecture : 41 minutes

Ce texte est un extrait du livre Être femelle. Le tournant féministe de la primatologie, traduit de l’anglais par Marin Schaffner et paru aux Éditions Wildproject en 2025 (avec une postface inédite de Vinciane Despret).
Note de traduction, par Marin Schaffner
À Dian Fossey, et à toutes les femmes qui ont été tuées en défendant la vie
Primate Visions est le deuxième livre de Donna Haraway1. Entamé à la fin des années 1970 et publié en 1989, il propose une histoire critique de la primatologie au 20e siècle, sur près de 500 pages. Être femelle est la traduction de l’introduction générale de ce livre – que vous retrouverez ci-dessous en intégralité – ainsi que de sa troisième et dernière partie.
Lorsqu’elle entame Primate Visions, Donna Haraway enseigne à la Johns Hopkins University (1974-1980), dans le département d’histoire des sciences. Ses travaux de l’époque explorent principalement les implications philosophiques et politiques de la biologie à laquelle elle a été formée.
Nommée professeure à l’université de Santa Cruz en 1980 (où elle finira la rédaction de Primate Visions), elle obtient alors la première chaire en théorie féministe des États-Unis. Dès ce moment, ses recherches se déploient à la croisée de la critique des sciences, des études de genre, de la science-fiction et de l’écologie. Deux articles majeurs publiés alors témoignent de sa singularité transdisciplinaire : « Manifeste cyborg : science, technologies et féminisme socialiste à la fin du 20e siècle » (1985)2 et « Savoirs situés : la question de la science dans le féminisme et le privilège de la perspective partielle » (1988)3. Le sous-titre original de Primate Visions – « Genre, race et nature dans le monde de la science moderne » – résume sans détour son approche.
Contrairement au français, le terme anglais female peut à la fois signifier « femelle » et « femme » – même s’il reste différent, en ce second sens, de woman. Nous avons volontairement choisi de traduire ce terme sous sa première acception, tout au long du livre, afin d’insister sur l’ancrage de la question féministe dans les enjeux de la biologie, et sur leurs enchevêtrements multiples – ce qui est un des cœurs battants de la critique de la primatologie ici développée par Donna Haraway.
Préface de l’autrice à l’édition française (2025)
Il y a plus de quarante ans, j’ai commencé à sérieusement interroger les manières dont l’amour, le pouvoir et la science s’entremêlent au sein des constructions de ce qui est considéré comme relevant de la « nature » pour les sociétés contemporaines.
Quarante ans plus tard, je continue de m’interroger à ce sujet, avec un sentiment d’urgence toujours plus grand – et cela, quand bien même la nature est devenue pour moi des naturecultures. Les « naturecultures » s’écrivent nécessairement en un mot ; et ce mot est empli des histoires des pratiques masculinistes, coloniales, raciales, capitalistes, écocidaires et génocidaires – mais pas seulement. Jamais seulement. Les naturecultures sont aussi emplies de recherches empiriques et de théories astucieuses qui changent des vies, d’un engagement profond en faveur de mondes qui dépassent l’exceptionnalisme humain, et d’un amour passionné pour les êtres vivants et mourants de la Terre. Les scientifiques francophones dans les pays francophones sont et ont été des act·rices majeur·es de ce drame complexe.
En écrivant Primate Visions, j’ai demandé de l’aide à mes parentés primates et je l’ai reçue en abondance. Ces parentés étaient composées à la fois de scientifiques humain·es qui étudiaient les singes (sur le terrain, dans les zoos ou dans des laboratoires) et des primates plus-qu’humain·es elles et eux-mêmes. À l’époque où j’ai écrit ce livre imposant, les mondes de ces autres primates étaient encore plus menacés par la destruction des habitats, la cupidité et l’ignorance que les mondes de leurs voisin·es humain·es tourmenté·es. Mais les destins des peuples humains et ceux des autres animaux sont liés depuis le commencement. Et je crois que leurs futurs, nos futurs, dépendent les uns des autres.
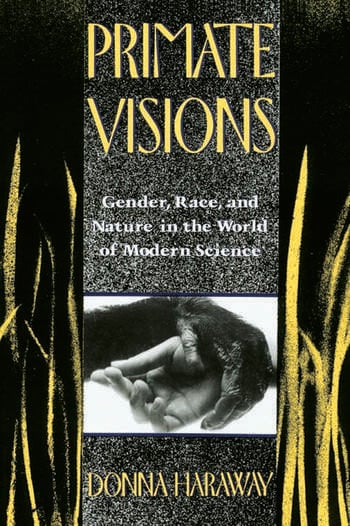
Progressivement, et souvent à contrecœur, les scientifiques ont appris à connaître les populations humaines et les cultures humaines des pays abritant des singes, et la science des primates est aujourd’hui une tentative véritablement diversifiée et mondiale. Malgré cela, bon nombre de nos parents primates n’auront plus de sociétés, de parentés, de cultures, ni d’habitats d’ici la fin de ce siècle. Tous les grands singes et la plupart des autres vivent désormais au seuil de l’extinction. Nous ne devons pas permettre que la grande aventure touffue de toutes les générations issues de la longue diversification évolutive des primates se termine par des projets visant à envoyer Elon Musk sur Mars – ni par une quelconque autre forme d’exceptionnalisme humain. Vivre de façon robuste sur une Terre partiellement guérie, en réparant collectivement tous les dommages possibles à travers les sciences et bien d’autres méthodes, tel est notre véritable travail.
Dans Primate Visions, je me suis demandé quelles formes prenait l’amour de la nature dans les sociétés techno-industrielles, à quel prix et un prix pour qui. Aujourd’hui, je me demande avec urgence comment nourrir des naturecultures dignes d’avenir. Je me soucie plus que jamais des primates plus-qu’humain·es ; et je vois dans leurs corps et dans leurs habitats les stigmates sanglants du genre, de la race, de la classe et des nations humaines. J’espère que les lect·rices de cette traduction y trouveront du réconfort et des idées pour des réparations partielles, des remédiations partielles, et l’espoir de générations futures pour toutes les parentés primates.
Je pense que mon slogan doit désormais être : « Des sciences primates pour la survie terrestre ! »
Donna Haraway, mai 2025

Introduction de Primate Visions (1989) : « Une vision persistante »4
« Les noms que vous, primates sans cage, donnez aux choses affectent votre attitude à leur égard pour toujours. » – Ruth Herschberger, Adam’s Rib, 1970
« Car c’est ainsi que tout doit commencer, par un acte d’amour. » – Eugène Marais, The Soul of the White Ant, 1980
Comment l’amour, le pouvoir et la science s’entremêlent-ils au sein des constructions de la nature, en cette fin de 20e siècle ? Qu’est-ce qui peut bien être considéré comme « nature » par les gens de la société industrielle tardive ? Quelles formes l’amour de la nature prend-il dans des contextes historiques particuliers ? Pour qui et à quel prix ? Dans quels lieux spécifiques, à partir de quelles histoires sociales et intellectuelles, et avec quels outils la nature est-elle construite en tant qu’objet de désir érotique et intellectuel ? Comment les terribles marques du genre et de la race permettent-elles et limitent-elles l’amour et la connaissance dans des traditions culturelles particulières, y compris dans les sciences naturelles modernes ? Qui peut contester ce que sera le corps de la nature ? Telles sont les questions qui guident mon histoire des sciences modernes et des cultures populaires émergeant des récits sur les corps et les vies des singes.
Depuis le 18e siècle, les thèmes de la race, de la sexualité, du genre, de la nation, de la famille et de la classe sociale ont été inscrits dans le corps de la nature par les sciences de la vie occidentales. Dans le sillage de la décolonisation post-Seconde Guerre mondiale, dans celui des mouvements antiracistes et féministes locaux et mondiaux, dans le sillage également des menaces nucléaires et environnementales, et de la prise de conscience généralisée de la fragilité des réseaux soutenant la vie sur Terre, la nature reste un mythe et une réalité : elle est à la fois profondément contestée et d’une importance cruciale. Comment les liens symboliques et matériels s’entrecroisent-ils au sein du tissu qu’est la nature pour les gens de la société industrielle tardive, en cette fin de 20e siècle ? »
Pour les Occidentaux, les singes ont une relation privilégiée à la nature et à la culture : les simiens occupent les zones frontalières de ces deux puissants pôles mythiques. Dans ces zones frontalières, l’amour et la connaissance présentent une riche ambiguïté et génèrent des significations dans lesquelles de nombreuses personnes trouvent des intérêts. Le trafic commercial et scientifique des singes est aussi bien un trafic de significations que de vies animales. Les sciences qui lient les singes et les humains ensemble au sein d’un ordre des Primates sont construites à partir de pratiques disciplinaires profondément enchevêtrées à la narration, à la politique, au mythe, à l’économie et aux possibilités techniques. Les femmes et les hommes qui ont contribué à l’étude des primates ont véhiculé les marques de leurs propres histoires et de leurs propres cultures. Ces marques sont inscrites dans les textes sur la vie des singes, mais souvent de façon subtile et inattendue. Les personnes qui étudient ces autres primates défendent des discours scientifiques contradictoires, et doivent rendre des comptes à de nombreux types de publics et de financeurs. Elles se sont engagées dans des relations d’amour et de connaissance dynamiques, disciplinées et intimes avec les animaux qu’elles avaient le privilège d’observer. Les primatologues comme les animaux dont ils et elles ont rapporté la vie suscitent un intérêt populaire intense – dans les musées d’Histoire naturelle, les émissions télévisées, les zoos, la chasse, la photographie, la science-fiction, les politiques de protection, la publicité, le cinéma, l’actualité scientifique, les cartes de vœux, ou encore les blagues. Les animaux ont été considérés comme des sujets privilégiés par diverses sciences de la vie et diverses sciences humaines – anthropologie, médecine, psychiatrie, psychobiologie, physiologie de la reproduction, linguistique, neurobiologie, paléontologie et écologie comportementale. Les singes ont modelé une vaste gamme de problèmes et d’espoirs humains. Plus encore, dans les sociétés européennes, américaines et japonaises, les singes ont été soumis à des interrogations prolongées et culturellement spécifiques sur ce que signifie être « presque humain ».

Les singes – et les personnes qui construisent les connaissances scientifiques et populaires à leur sujet – font partie de cultures en conflit. Jamais innocente, la « technologie » narrative de visibilisation propre à ce livre s’inspire à la fois des théories contemporaines sur la production culturelle, des études historiques et sociales sur la science et la technologie, et des mouvements et théories féministes et antiracistes, afin d’élaborer une vision de la nature telle qu’elle est construite et reconstruite dans les corps et les vies d’animaux du « tiers-monde » qui servent de substituts à l’« homme ».
J’ai essayé d’emplir mon livre Primate Visions (1989) de puissantes images verbales et visuelles : le cadavre d’un gorille abattu en 1921 au « cœur de l’Afrique » et transformé en leçon de vertu civique au musée américain d’Histoire naturelle de New York ; une petite fille blanche emmenée au Congo belge dans les années 1920 pour « chasser » le gorille avec un appareil photo, et qui s’est métamorphosée dans les années 1970 en une autrice de science-fiction, considérée pendant des années comme un modèle de prose masculine ; le chimpanzé Ham dans sa capsule spatiale pour le projet Mercury en 1961 ; David Greybeard (contemporain du chimpanzé Ham) tendant la main à Jane Goodall, « seule » dans les « étendues sauvages de Tanzanie », l’année où quinze nations africaines abritant des primates ont accédé à leur indépendance nationale ; une édition spéciale du magazine Vanity Fair sur Dian Fossey en 1986, un an après son assassinat, dans un cimetière de gorilles au Rwanda ; les os d’un fossile antique, reconstitués comme étant ceux de la grand-mère de l’humanité, et disposés comme des joyaux sur du velours rouge dans le laboratoire d’un paléontologue, selon un modèle destiné à fonder, une fois de plus, une théorie sur l’origine de la « monogamie » ; les bébés singes du laboratoire de Harry Harlow, dans les années 1960, s’accrochant aux vêtements de leurs « mères de substitution », à un moment historique où les images de la maternité de substitution commençaient à faire surface dans les politiques américaines de reproduction5 ; l’étreinte émotionnellement déchirante entre une jeune scientifique blanche de classe moyenne et un chimpanzé adulte parlant la langue des signes américaine, sur une île du fleuve Gambie, où des femmes blanches apprennent aux singes captifs à « retourner » à l’état « sauvage » ; une carte de vœux Hallmark inversant l’image de King Kong, où l’on voit une femme blonde gigantesque et un gorille à dos argenté qui se recroqueville dans un lit, la scène étant intitulée « Getting Even » (« prendre sa revanche ») ; des femmes et des hommes ordinaires d’Afrique, des États-Unis, du Japon, d’Europe, d’Inde et d’ailleurs, muni·es de magnétophones et de presse-papiers, transcrivant la vie des singes dans des textes spécialisés, qui deviendront des éléments contestés au sein des controverses politiques de multiples cultures.

J’écris sur les primates parce qu’ils sont populaires, importants, merveilleusement variés et controversés. Et tou·tes les membres de l’ordre des Primates – singes comme humain·es – sont menacé·es. La primatologie de la fin du 20e siècle peut être considérée comme faisant partie d’une littérature complexe de la survie, au sein de la culture nucléaire mondialisée. La production et la stabilisation des connaissances concernant l’ordre des Primates comportent des enjeux émotionnels, politiques et professionnels pour de nombreuses personnes, y compris moi-même. Il ne s’agira donc pas ici d’une étude objective et désintéressée, ni d’une étude exhaustive – en partie parce que de telles études sont impossibles pour qui que ce soit, et en partie parce qu’il y a des enjeux que je tiens à rendre visibles (et probablement d’autres encore). Je veux que ce livre puisse intéresser de nombreux publics, et qu’il soit à la fois agréable et dérangeant pour chacun et chacune d’entre nous. En particulier, je veux que ce livre remplisse son devoir à la fois vis-à-vis des primatologues, des historien·nes des sciences, des théoricien·nes de la culture, des vastes mouvements de gauche, antiracistes, anticoloniaux et féministes, des animaux, et de celles et ceux qui aiment les histoires sérieuses. Il n’est peut-être pas toujours possible de rendre des comptes à ces différents publics, mais c’est grâce à eux que ce livre a pu voir le jour. Ils sont tous présents dans ce texte. Les primates, qui existent aux frontières de tant d’espoirs et d’intérêts, sont des sujets merveilleux avec lesquels on peut explorer la perméabilité des murs, la reconstitution des frontières et le dégoût des dualismes interminables imposés par la société.
J’écris sur les primates parce qu’ils sont populaires, importants, merveilleusement variés et controversés. Et tou·tes les membres de l’ordre des Primates – singes comme humain·es – sont menacé·es.
Donna Harraway
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Fait et fiction
La science et la culture populaire sont toutes deux inextricablement tissées de faits et de fictions. Il semble naturel, et même moralement obligatoire, d’opposer fait et fiction ; pourtant, leurs similarités sont profondément ancrées dans les cultures et les langues occidentales. Les faits peuvent être imaginés comme des nœuds, originaux et irréductibles, à partir desquels une compréhension fiable du monde peut être construite. On pense généralement que les faits doivent être découverts, et non pas fabriqués ou construits. Mais l’étymologie du mot « fait » nous renvoie à l’action humaine, à la performance, voire aux exploits humains. Les faits naissent des actes, par opposition aux mots. Autrement dit, aussi bien d’un point de vue linguistique qu’historique, l’action humaine est à la racine de tout ce que nous pouvons considérer comme étant un fait. Un fait est une chose faite, un participe passé neutre issu du latin, notre langue parente commune. Dans ce sens originel, les faits sont ce qui s’est réellement passé. De telles choses sont connues via l’expérience directe, via le témoignage et via l’interrogation – des voies d’accès à la connaissance extraordinairement privilégiées en Occident.
La fiction, elle, peut être envisagée comme une version dérivée et fabriquée du monde et de l’expérience, comme une sorte de double perverti des faits, ou comme une évasion imaginaire vers un monde meilleur que « ce qui s’est réellement passé ». La variété des tonalités au sein de la fiction nous laisse penser que son origine se trouve dans la vision, l’inspiration, la perspicacité, le génie. Nous entrevoyons la racine de la fiction dans la poésie et nous croyons, avec un certain romantisme, que c’est par une bonne fiction que se révèlent les natures originelles. En d’autres termes, la fiction peut être vraie, ou du moins reconnue comme telle, du fait de son attrait pour la nature. Et comme la nature est prolifique – elle est la mère de la vie dans nos principaux systèmes de mythes –, la fiction semble être une vérité intérieure qui donne naissance à nos vies réelles. Il s’agit là aussi d’une voie d’accès à la connaissance très privilégiée dans les cultures occidentales, y compris aux États-Unis. Enfin, l’étymologie de la fiction nous renvoie à nouveau à l’action humaine, à l’acte de façonner, de former ou d’inventer, ainsi qu’à celui de feindre. La fiction s’inscrit donc inéluctablement dans une dialectique du vrai (naturel) et du faux (artefact). Mais dans toutes ses significations, la fiction concerne l’action humaine. De même, tous les récits de la science – fictions et faits – concernent l’action humaine.
La fiction est proche des faits, sans qu’ils soient des jumeaux identiques. Les faits s’opposent aux opinions, aux préjugés, mais pas à la fiction. La fiction et les faits sont tous deux ancrés dans une épistémologie qui fait appel à l’expérience. Cependant, il existe une différence importante : le mot fiction est une forme active, qui renvoie à un acte présent de façonnage, tandis que le mot fait provient d’un participe passé, une forme verbale qui masque l’acte générateur ou la performance. Un fait semble achevé, immuable, apte seulement à être enregistré ; la fiction, elle, semble toujours inventive, ouverte à d’autres possibilités, à d’autres façonnements de la vie. Mais dans cette ouverture réside la menace d’une simple feinte, celle de ne pas dire la vraie forme des choses.
La pratique scientifique est avant tout une pratique narrative – entendue comme une pratique historiquement spécifique d’interprétation et de témoignage.
Donna Haraway
D’un certain point de vue, les sciences naturelles semblent offrir des outils qui permettent de distinguer les faits de la fiction, de remplacer l’invention par son participe passé, et de préserver ainsi l’expérience vraie de toute contrefaçon. Par exemple, l’histoire de la primatologie a été racontée à maintes reprises comme une clarification progressive de l’observation des singes et des êtres humains. Il y a d’abord eu les premiers indices de l’existence d’une forme commune « primate », suggérés, dans les brumes préscientifiques, par les récits inventifs de chasseurs, de voyageurs et d’indigènes. Peut-être ces indices datent-ils de l’Antiquité, ou peut-être du 16e siècle, lors de la tout aussi mythique époque des Découvertes et de la naissance de la Science moderne. Puis, progressivement, la vision claire et éclairée est apparue, sur la base de dissections et de comparaisons anatomiques. L’histoire de ce qu’est la vision correcte de la forme sociale propre aux primates suit d’ailleurs la même trame : le passage d’une vision brumeuse et encline à l’invention, vers une connaissance quantitative et perçante, enracinée dans ce type particulier d’expérience qu’on appelle experiment en anglais. C’est l’histoire du passage d’une science immature, fondée sur la simple description et la libre interprétation qualitative, vers une science mature, fondée sur des méthodes quantitatives et des hypothèses falsifiables, et aboutissant à une reconstruction scientifique synthétique de la réalité des primates. Mais ces histoires (histories) sont des histoires (stories) à propos d’autres histoires ; elles sont des récits qui se terminent bien – c’est-à-dire les faits rassemblés, la réalité scientifiquement reconstruite. Et ces histoires ont une esthétique particulière (le réalisme) et une politique particulière (l’engagement pour le progrès).
Depuis une perspective très légèrement différente, l’histoire des sciences apparaît comme un récit sur l’histoire des moyens techniques et sociaux utilisés pour produire les faits. Les faits eux-mêmes sont des types d’histoires, des types de témoignages relatant des expériences. Mais provoquer une expérience scientifique requiert une technologie élaborée – comprenant des outils physiques, une tradition d’interprétation accessible et des relations sociales spécifiques. Ce n’est pas n’importe quoi qui peut devenir un fait ; ce n’est pas n’importe quoi qui peut être vu ou produit, et ainsi être raconté. La pratique scientifique peut ainsi être considérée comme une sorte de pratique narrative – un art de raconter l’histoire de la nature, qui est régi par des règles, qui est soumis à des contraintes et qui évolue historiquement. La pratique scientifique et les théories scientifiques produisent des types particuliers d’histoires, et sont intégrées dans des types particuliers d’histoires. Toute déclaration scientifique sur le monde dépend intimement du langage, de la métaphore. Les métaphores peuvent être mathématiques ou culinaires ; dans tous les cas, elles structurent la vision scientifique. La pratique scientifique est avant tout une pratique narrative – entendue comme une pratique historiquement spécifique d’interprétation et de témoignage.
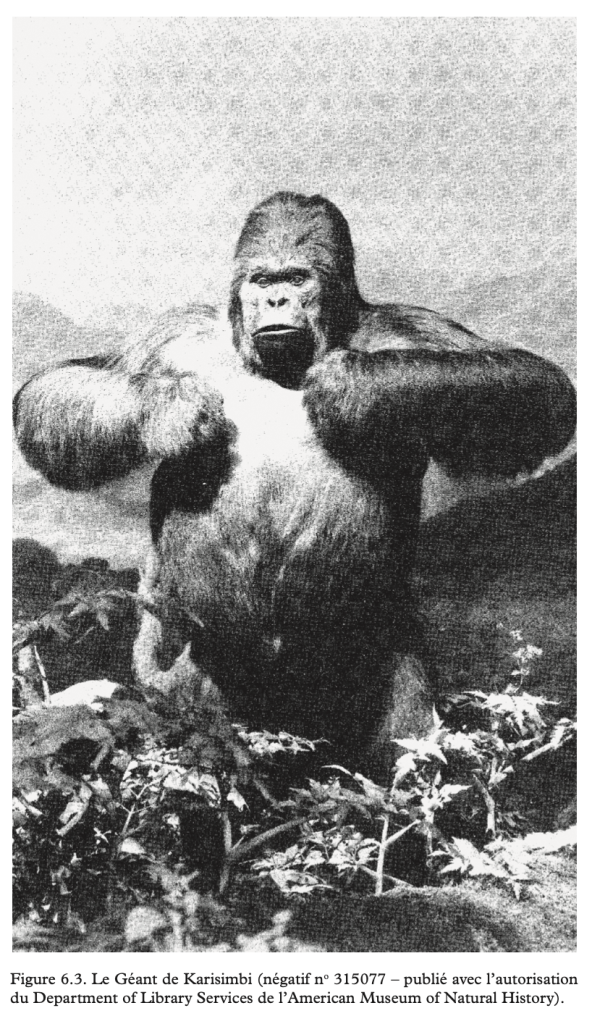
Regarder la primatologie, une branche des sciences de la vie, comme une fabrique narrative peut s’avérer particulièrement approprié. Premièrement, le discours de la biologie, qui a débuté aux alentours des premières décennies du 19e siècle, s’est intéressé aux organismes, aux êtres ayant une histoire de vie – c’est-à-dire une trame possédant une structure et une fonction6. La biologie est intrinsèquement historique, et la forme de son discours est intrinsèquement narrative. La biologie, comme manière de connaître le monde, s’apparente à la littérature romantique et à son discours sur les formes et les fonctions organiques. La biologie est la fiction appropriée pour les objets qu’on appelle « organismes » ; la biologie modèle les faits « découverts » au sujet des êtres organiques. Les organismes accomplissent une performance pour les biologistes, qui la transforment en une vérité attestée par une expérience disciplinée – c’est-à-dire en un fait, qui est l’acte ou la prouesse conjointement accomplie par le scientifique et l’organisme. Le romantisme se mêle au réalisme, et le réalisme au naturalisme ; le génie se mêle au progrès, et l’idée au fait. Les scientifiques autant que les organismes sont des acteurs au sein d’une pratique narrative.
Deuxièmement, les singes et les êtres humains apparaissent, dans la primatologie, à l’intérieur de narrations élaborées, sur les origines, les natures et les possibilités. La primatologie concerne l’histoire vivante d’un ordre taxonomique qui inclut les êtres humains. Et ce sont tout particulièrement les humains occidentaux qui produisent des histoires à propos des primates, tout en racontant simultanément des histoires à propos des relations entre nature et culture, animal et humain, corps et esprit, origine et futur. En effet, depuis son apparition, au milieu du 18e siècle, l’ordre des Primates a été construit sur des récits à propos de ces dualismes et de leur résolution scientifique.
Traiter une science comme un discours narratif n’est pas signe de mépris, c’est même plutôt le contraire. Mais il ne s’agit pas non plus d’avoir une attitude mystifiée et adoratrice face à un participe passé. Je m’intéresse aux narrations sur les faits scientifiques – ces puissantes fictions de la science – prises à l’intérieur d’un champ complexe que j’identifierai avec le signifiant « SF ». À la fin des années 1960, la critique littéraire de science-fiction Judith Merril a commencé à utiliser, de façon singulière, le signifiant SF pour désigner un champ narratif complexe et émergent, au sein duquel les frontières entre science-fiction (qu’on appelle par convention « sf », en minuscules) et fantasy devenaient perméables dans une propension déroutante, tant d’un point de vue commercial que linguistique. Son appellation, SF, se trouva être largement adoptée par les critiques, les lect·rices, les aut·rices, les fans ; et les maisons d’édition ont peiné à comprendre cet éventail de plus en plus hétérodoxe de pratiques d’écriture, de lecture et de marketing, repérables par une prolifération d’expressions correspondant à l’acronyme « sf » en anglais : fiction spéculative, science-fiction, science-fantasy, futurs spéculatifs, fabulation spéculative.
➤ Lire aussi | L’ère de la standardisation : conversation sur la Plantation・Anna Tsing et Donna Haraway (2024)
La SF est un territoire de reproduction culturelle controversée au sein des mondes technologisés. Placer les récits de faits scientifiques à l’intérieur de l’espace hétérogène de la SF transforme tout un champ. Ce champ transformé crée alors des résonances entre toutes ses régions et toutes ses composantes. Aucune région ou composante n’est « réduite » à aucune autre, mais les pratiques de lecture et d’écriture se répondent les unes les autres à travers un espace structuré. La fiction spéculative révèle des tensions différentes lorsque son champ contient également les pratiques d’inscription qui constituent le fait scientifique. Les sciences sont liées à des histoires complexes, en ce qui concerne la constitution des mondes imaginatifs comme la constitution des corps réels au sein des cultures modernes et postmodernes du « premier monde ». Teresa De Lauretis a avancé l’idée que le travail de création de sens impliqué par le terme SF était « potentiellement créateur de nouvelles formes sociales d’imagination – créateur, dans le sens où il peut permettre de révéler l’existence d’espaces où le changement culturel pourrait avoir lieu ; d’envisager un ordre différent des relations entre les gens, et entre les gens et les choses, c’est-à-dire une conceptualisation différente de l’existence sociale, incluant à la fois l’existence physique et matérielle » (1980 : 161). Or cela est aussi l’une des tâches du « travail de création de sens » qu’est la primatologie.
Ainsi, du moins en partie, ce livre propose de lire tout texte sur les primates comme une science-fiction – où les mondes possibles sont constamment réinventés, dans le cadre de la lutte pour des mondes présents et bien réels. Toutefois, la conclusion de l’ouvrage proposera une lecture alternative d’une histoire de sf – sur une espèce extraterrestre intervenant dans la politique de reproduction humaine –, comme s’il s’agissait d’une monographie sur les primates. Le présent ouvrage – enraciné dans les mythes, les sciences et les pratiques sociales historiques qui ont placé les singes dans l’Éden puis dans l’espace (au commencement et à la fin de la culture occidentale) – implante des étrangers (aliens) dans le texte comme un moyen de comprendre ce que sont l’amour et le savoir parmi les primates, sur notre fragile Terre contemporaine.

Quatre tentations
Analyser un discours scientifique, la primatologie, comme un récit au sein de plusieurs champs narratifs contestés est un moyen d’entrer dans les débats actuels sur la construction sociale du savoir scientifique, sans succomber complètement à aucune des quatre positions suivantes (pourtant très tentantes), qui sont néanmoins aussi des ressources majeures pour les méthodes utilisées dans ce livre. J’utilise l’image de la tentation car je trouve que ces quatre positions sont persuasives, fécondes mais aussi dangereuses, particulièrement si l’une de ces positions réduit finalement les autres au silence, créant ainsi une fausse harmonie au sein de l’histoire primate.
La première tentation, pleine de ressources, provient de la tendance la plus active au sein des études sociales sur la science et la technologie. Par exemple, l’éminent analyste des sciences Bruno Latour rejette radicalement toutes les formes de réalisme épistémologique, et analyse la pratique scientifique comme totalement sociale et interprétative. Réfutant la distinction entre le social et le technique, il décrit la pratique scientifique comme le raffinement de « dispositifs d’inscription » – c’est-à-dire des dispositifs permettant de retranscrire l’immense complexité et l’immense chaos des interprétations concurrentes sous forme de traces, d’écrits, qui marquent l’émergence d’un fait, d’un cas de réalité. S’intéressant à la fois à la science en tant que nouvelle forme de pouvoir dans le monde social-matériel, et aux scientifiques comme investissant « leur capacité politique au cœur de la pratique de la science », Bruno Latour et son collègue Stephen Woolgar ont puissamment décrit comment les processus de construction sont faits pour s’inverser et apparaître sous forme de découverte (1979 : 213). Les comptes rendus des scientifiques à propos de leurs propres processus deviennent des données ethnographiques, sujettes à une analyse culturelle.
Depuis la perspective de leur ouvrage La Vie de laboratoire, la pratique scientifique est fondamentalement une pratique littéraire, une pratique d’écriture qui repose sur le fait de se disputer le pouvoir de stabiliser des définitions et des normes permettant d’affirmer que quelque chose est vrai. Gagner, c’est rendre trop élevé le coût de la déstabilisation d’un récit donné. Cette approche peut expliquer les luttes scientifiques autour du pouvoir de clore le débat, et elle peut rendre compte des succès et des échecs de ces luttes. La pratique scientifique est faite de négociations, de déplacements stratégiques, d’inscription et de traduction. Il y a beaucoup à dire sur la science comme croyance effective, ainsi que sur son pouvoir à renforcer et incarner une telle croyance7. Que peut-on demander de plus à une théorie de la pratique scientifique ?
La seconde tentation importante vient d’une branche de la tradition marxiste, qui défend la supériorité historique de certains points de vue dans la connaissance du monde social – et possiblement du monde « naturel » également. D’un point de vue fondamental, les adeptes de cette tradition considèrent que le monde social est structuré par les relations sociales de production et de reproduction de la vie quotidienne, de sorte qu’il n’est possible de voir clairement ces relations que depuis certains points de vue. Il ne s’agit pas d’une affaire individuelle, et la bonne volonté n’est pas en cause. Depuis le point de vue des groupes sociaux en position de domination et de pouvoir systématiques, la véritable nature de la vie sociale sera opaque ; ils ont trop à perdre de la clarté.
Ainsi, les propriétaires des moyens de production vont voir de l’équité dans un système d’échange, là où le point de vue de la classe ouvrière révélera la nature dominatrice d’un système de production fondé sur le salariat, et donc sur l’exploitation et la déformation du travail humain. Celles et ceux pour qui la définition sociale de l’identité prend racine dans le système raciste ne pourront pas voir que la définition de l’humain n’a jamais été neutre, et ne le sera pas tant que de profonds changements matériels et sociaux ne se produiront pas à l’échelle mondiale. De la même manière, pour celles et ceux dont la possibilité même d’accéder au statut d’adulte repose sur le pouvoir de s’approprier l’« autre » au sein d’un système socio-sexuel genré, le sexisme n’apparaîtra pas comme un obstacle fondamental à une connaissance correcte en général. La tradition redevable à l’épistémologie marxiste est en mesure de rendre compte de la plus grande adéquation de certains modes de connaissance, et elle est en mesure de montrer que la race, le sexe et la classe sociale déterminent fondamentalement les détails les plus intimes de la connaissance et de la pratique, en particulier là où l’apparence est celle de la neutralité et de l’universalité8.
Pour l’observateur d’animaux, les peuples autochtones d’Afrique et d’Asie étaient une nuisance, une menace à la protection, jusqu’à ce que la décolonisation oblige les scientifiques occidentaux blancs à restructurer leur biopolitique du soi et de l’autre, du natif et de l’étranger.
Donna Haraway
Ces questions sont loin d’être sans rapport avec la primatologie, une science qui, aux États-Unis, est pratiquée presque exclusivement par des personnes blanches, et même jusqu’à très récemment par des hommes blancs, et toujours en grande majorité par des personnes économiquement privilégiées. Une part importante de ce livre examine les conséquences, pour la primatologie, des relations sociales de race, de sexe et de classe impliquées dans la construction du savoir scientifique. Par exemple, la plupart des primatologues des premières décennies après la Seconde Guerre mondiale n’ont probablement pas compris que les interrelations entre les gens, la terre et les animaux en Afrique et en Asie sont, au moins en partie, dues aux positions des chercheurs eux-mêmes au sein des systèmes racistes et impérialistes. Nombre d’entre eux ont recherché une nature « pure », vierge de tout contact humain ; et donc aussi des espèces intactes – de façon analogue aux « indigènes » autrefois recherchés par les anthropologues coloniaux. Mais pour l’observateur d’animaux, les peuples autochtones d’Afrique et d’Asie étaient une nuisance, une menace à la protection – en fait des « étrangers » (aliens) envahissants –, jusqu’à ce que la décolonisation oblige les scientifiques occidentaux blancs à restructurer leur biopolitique du soi et de l’autre, du natif et de l’étranger. Ainsi, les frontières entre animaux et êtres humains se déplacent lors de la transition d’un point de vue colonial à un point de vue postcolonial ou néocolonial. En insistant sur le fait qu’on peut trouver des contenus et des méthodes moins déformatrices dans les sciences naturelles comme dans les sciences sociales, les approches marxistes, féministes et antiracistes rejettent le relativisme propre à l’étude sociale des sciences. Les approches explicitement politiques prennent parti quant à la question de savoir ce qu’est une connaissance plus adéquate, et plus humainement acceptable. Mais ces analyses ont aussi leurs limites pour ce qui est de guider une exploration des études sur les primates. Le travail salarié, l’appropriation sexuelle et reproductive et l’hégémonie raciale sont des aspects structurants du monde social humain. Il n’y a aucun doute sur le fait qu’ils affectent la connaissance de façon systématique, mais on ne sait pas dire précisément comment ils se relient aux savoirs sur les modèles d’alimentation des singes patas, ou sur la réplication des molécules d’ADN.
Cependant, un autre pan de la tradition marxiste a fait des avancées significatives dans les méthodes pour répondre à ce genre de questions. Dans les années 1970, des personnes associées au Radical Science Journal britannique ont développé l’idée de la science comme processus de travail, cela afin d’étudier et de modifier les médiations scientifiques perpétuant des dominations de classe dans les relations de production et de reproduction de la vie humaine9. Tout comme Bruno Latour, ces personnes n’ont laissé aucune place pour des épistémologies réalistes ou positivistes – qui sont pourtant les versions préférées de la plupart des scientifiques en exercice. Chaque aspect de la pratique scientifique peut être décrit à travers le concept de médiation : le langage, les hiérarchies de laboratoire, les liens industriels, les doctrines médicales, les préférences théoriques de base, et les histoires à propos de la nature. Malgré cela, le concept de « processus de travail » peut sembler cannibale, car il fait passer les relations sociales de tous les autres processus basiques comme des choses qui dériveraient de ce processus premier. Par exemple, les systèmes complexes de domination, de complicité, de résistance, d’égalité et de soin au sein des pratiques genrées de gestation et d’éducation des enfants ne peuvent pas répondre au seul concept de travail. Pour autant, ces pratiques reproductives affectent clairement un certain nombre de contenus et méthodes au sein des études sur les primates. D’ailleurs, même un concept élargi de médiation au sein de processus sociaux systémiques – qui n’insisterait pas sur la réduction de toute chose au travail, dans un sens marxiste classique – laisserait encore trop de pans de l’équation de côté.
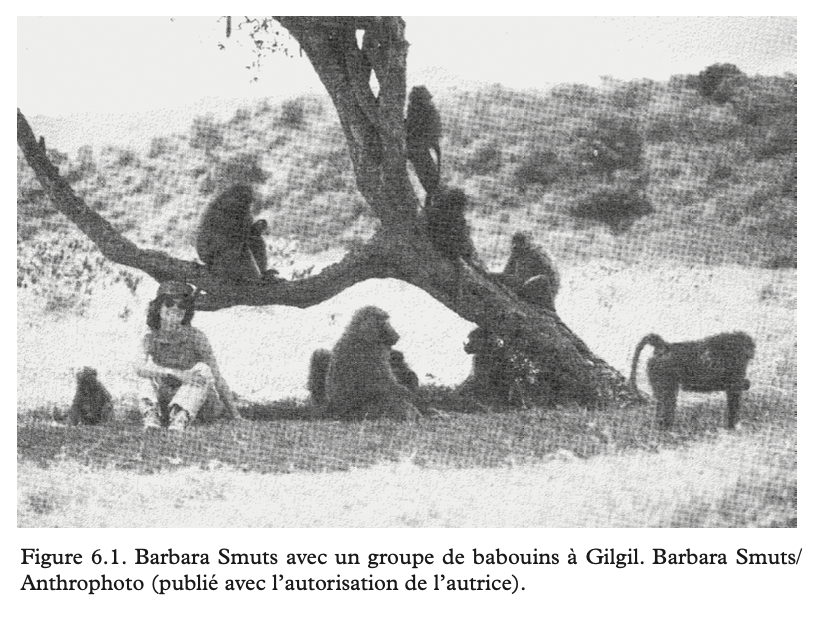
La troisième tentation vient du chant des sirènes des scientifiques eux-mêmes, qui ne cessent de rappeler que, parmi d’autres choses, ils et elles observent des singes. En un sens, plus ou moins nuancé, ils et elles insistent sur le fait que la pratique scientifique est « au contact » du monde. Ils et elles affirment que la connaissance scientifique n’est pas simplement une question de pouvoir et de contrôle. Et que leurs connaissances traduisent en quelque sorte la voix active de leurs sujets – qui sont les objets de la connaissance. Sans être nécessairement forcée de suivre leur esthétique du réalisme ou leurs théories de la représentation, je les crois dans la mesure où ma vie imaginative et intellectuelle ainsi que mes engagements professionnels et politiques dans le monde répondent à ces récits scientifiques. Les scientifiques sont habiles à fournir de bonnes raisons de croire en leurs récits et d’agir sur la base de ceux-ci. Mais la question de savoir comment la science est « en contact » avec le monde est loin d’être résolue. Ce qui semble résolu, cependant, c’est que la science se développe à partir de modes de vie concrets, et crée des modes de vie concrets – y compris des constructions particulières de l’amour, de la connaissance et du pouvoir. C’est là le cœur de son instrumentalisme, et la limite de son universalisme.
Je souhaite trouver un concept pour raconter une histoire de la science qui ne dépende pas des dualismes entre actif et passif, culture et nature, humain et animal, social et naturel.
Donna Haraway
Les preuves sont toujours une question d’interprétation ; et les théories sont des récits depuis et pour des types spécifiques de vies. Je cherche donc une façon de raconter une histoire de la production d’une branche des sciences de la vie, branche qui inclut les êtres humains de façon centrale – qui eux-mêmes écoutent ces histoires très attentivement. Ainsi, mon histoire se doit d’écouter les pratiques d’interprétation de l’ordre des Primates, au sein desquels les primates eux-mêmes et elles-mêmes – singes comme humain·es – exercent toutes et tous une sorte d’« autorat ». Je voudrais donc suggérer que la notion de « récit contraint et contesté » permet d’apprécier la construction sociale de la science, tout en guidant le lecteur ou la lectrice vers la recherche des autres animaux participant activement à la primatologie. Je souhaite trouver un concept pour raconter une histoire de la science qui ne dépende pas des dualismes entre actif et passif, culture et nature, humain et animal, social et naturel.
La quatrième tentation recoupe chacune des trois autres ; et cette tentation principale consiste à toujours regarder les constructions des sciences modernes, aux quatre coins du monde, à travers le prisme des histoires complexes de genre et de race. Cela signifie qu’il faut examiner les productions culturelles, y compris les sciences des primates, depuis les perspectives permises par les politiques et les théories féministes et antiracistes. Le défi est de se remémorer sans cesse la particularité aussi bien que la puissance de cette façon-là de lire et d’écrire. Mais c’est le même défi qui devrait être intégré à toute lecture ou écriture d’un texte scientifique. La race et le genre ne sont pas des catégories sociales universelles premières – et encore moins des réalités naturelles ou biologiques. La race et le genre sont les produits d’histoires spécifiques, mais très vastes et durables, qui ont changé le monde. Et il en va de même pour la science. Le champ de vision de ce livre dépend d’un triple filtre : la race, le genre et la science. C’est le filtre qui retient le mieux les corps marqués par l’histoire, afin de les examiner de plus près10.
Les histoires sont toujours des productions complexes, comprenant de nombreux conteurs et auditeurs, et de nombreuses conteuses et auditrices, mais qui ne sont pas toutes et tous visibles et audibles. La narration est une notion sérieuse, mais heureusement dépourvue du pouvoir de revendiquer des lectures uniques ou fermées. La primatologie semble être une science composée d’histoires, et le but de ce livre est d’entrer dans les contestations liées à la construction de ces histoires. Le prisme de la narration définit une ligne ténue entre réalisme et nominalisme – même si les primates semblent être des scolastiques naturels, ayant tendance à devenir équivoques lorsqu’on les presse. Aussi, je pense qu’il y a une esthétique et une éthique dans le fait de considérer la pratique scientifique comme un art de raconter les histoires – une esthétique et une éthique différentes de la capitulation devant le « progrès », et différentes de la croyance dans la connaissance comme reflet passif de « la façon dont les choses sont », et différentes également du scepticisme ironique et de la fascination pour le pouvoir si fréquents dans les études sociales sur la science. L’esthétique et l’éthique latentes dans l’examen de l’art de raconter les histoires pourraient procurer plaisir et responsabilité dans le tissage des contes. Les histoires sont des moyens d’accéder à des modes de vie. Les histoires sont des technologies permettant d’incarner des primates.
➤ Lire aussi | L’invasion silencieuse. La primatologie d’Imanishi et les préjugés culturels dans les sciences・Frans de Waal (2022)
La primatologie est une science (judéo-)chrétienne
Les juifs et les chrétiens occidentaux, ou les post-judéo-chrétiens, ne sont pas les seuls à pratiquer les sciences des primates. Mais ce livre se concentre avant tout sur l’histoire des études sur le comportement social des singes réalisées aux États-Unis ou par des Euro-Américain·es au cours du 20e siècle. Dans ces histoires, on retrouve un refrain tiré de l’histoire du salut : la primatologie concerne à la fois les histoires primales (l’origine et la nature de « l’homme ») et les histoires de réformation (la réforme et la reconstruction de la nature humaine). Implicitement et explicitement, l’histoire du jardin d’Éden apparaît dans les sciences des singes, à côté de diverses versions de l’origine de la société, du mariage et du langage.

Dès ses débuts, la primatologie a eu ce caractère en Occident. Si Linné, le « père » moderne de la classification biologique au 18e siècle, est constamment cité par les scientifiques du 20e siècle, c’est pour avoir placé les êtres humains dans un ordre taxonomique de la nature aux côtés d’autres animaux – c’est-à-dire pour avoir fait un grand pas de côté par rapport aux hypothèses chrétiennes. Linné a placé l’« homme » en tant qu’Homo sapiens au sein de son ordre taxonomique des primates ; dans le même genre qu’Homo troglodytes, une créature intéressante mais douteuse, illustrée comme une femme poilue. Le nouvel ordre des Primates de la dixième édition du Systema naturae (1758) comprenait également un genre pour les singes et les grands singes, un pour les lémuriens, et un pour les chauves-souris. Mais l’activité de Linné, considéré comme le « père » d’un discours sur la nature, peut aussi être perçue d’une tout autre manière. Il parlait de lui-même comme d’un second Adam, ou comme « l’œil » de Dieu, pouvant donner de vraies représentations et de vrais noms, et réformant ainsi – ou restaurant – la pureté des noms perdus à cause du premier péché d’Adam11. La nature était un théâtre, une scène où se jouaient l’histoire naturelle et l’histoire du salut. Le rôle de celui qui a renommé les animaux était d’assurer un ordre de la nature vrai et fidèle, de purifier à la fois l’œil et le mot. « L’équilibre de la nature » était en partie maintenu par le rôle d’un nouvel « homme » qui pourrait voir clairement et nommer correctement – une identité loin d’être anodine en regard de l’expansion européenne du 18e siècle. C’est d’ailleurs là l’identité du sujet-auteur moderne, pour qui écrire le corps de la nature est l’assurance de pouvoir la maîtriser.
Implicitement et explicitement, l’histoire du jardin d’Éden apparaît dans les sciences des singes, à côté de diverses versions de l’origine de la société, du mariage et du langage.
Donna Haraway
La science de l’histoire naturelle, chez Linné, était une science intimement chrétienne. Sa tâche première, accomplie dans l’œuvre de Linné et de ses correspondants, a été d’annoncer la parenté de l’« homme » et de la bête au sein de l’ordre moderne d’une Europe en expansion. L’homme naturel ne se trouvait pas seulement parmi les « sauvages », mais aussi parmi les animaux – qui ont été nommés « primates » en conséquence, eux le premier Ordre de la nature. Ceux qui étaient en mesure de donner de tels noms avaient une vocation moderne puissante : ils devenaient des scientifiques. La taxonomie a eu une fonction séculaire sacrée. L’« appel » à pratiquer la science a maintenu ce caractère sacralisé jusqu’à aujourd’hui – même si nous verrons que son apogée était au début du 20e siècle. Les histoires produites par de tels praticiens ont un statut spécial au sein d’une culture biblique protestante réprimée comme celle des États-Unis.
Pour Linné, la nature ne devait pas être comprise de façon « biologique », mais de façon « représentative ». Au cours du 19e siècle, la biologie est devenue un discours à propos de la nature productive et expansive. La biologie a été construite comme un discours sur la nature entendue comme un système de production et de reproduction, et comprise sur le modèle d’une division fonctionnelle du travail, selon des critères d’efficacité mentale, agissante et sexuelle des organismes. Dans ce contexte, au 20e siècle, les primates ont été intégrés au sein d’un « théâtre écologique » et d’un « jeu évolutif » (Hutchinson, 1965). L’intrigue a porté sur l’origine et le développement de nombreux thèmes mythiques persistants : le sexe, le langage, l’autorité, la société, la compétition, la domination, la coopération, la famille, l’État, la subsistance, la technologie et la mobilité.
Dans ce livre, deux lectures principales de cette pièce de théâtre ont été retenues. La première s’intéresse aux significations symboliques, aux sciences des primates comme une certaine forme d’art faisant un usage répété des ressources narratives des systèmes de mythes judéo-chrétiens. La seconde accorde une attention particulière aux façons dont la biologie au sujet des primates est théorisée en tant que système matériel de production et de reproduction – une sorte de lecture « matérialiste ». Ces deux interprétations sont à l’écoute des échos et des déterminants de race, de sexe et de classe au sein de ces histoires. Le corps primate, en tant que partie du corps de la nature, peut être lu comme une carte du pouvoir. La biologie et la primatologie sont des discours intrinsèquement politiques, dont les principaux objets de connaissance, tels que les organismes et les écosystèmes, sont des icônes (des condensations) de l’ensemble de l’histoire et des politiques de la culture qui les a construits pour la contemplation et la manipulation. Le corps primate lui-même est un type intrigant de discours politique.
La primatologie est un orientalisme simien
L’argument de ce livre est que la primatologie s’intéresse à un Ordre, un ordre taxonomique et par conséquent politique, qui fonctionne à travers la négociation de frontières obtenues par l’ordonnancement des différences. Ces frontières démarquent des territoires sociaux importants (tels que la norme d’une famille correcte) et sont établies par des pratiques sociales (telles que le développement de programmes de recherche, des politiques de santé mentale, des politiques de protection, la réalisation de films et la publication de livres). Les deux axes majeurs qui structurent ces puissants récits scientifiques de la primatologie – élaborés au sein de toutes ces pratiques – sont définis par des dualismes en interaction : sexe/genre et nature/culture. Le sexe et l’Occident sont des axiomes de la biologie comme de l’anthropologie. Dans la logique qui guide ces dualismes complexes, la primatologie occidentale se révèle comme un orientalisme simien [figure ci-dessous].

Edward Saïd (2015 [1978]) a affirmé que les chercheurs occidentaux (européens et nord-américains) ont participé à une longue histoire d’acceptation des pays, des peuples et des cultures du Proche-Orient et de l’Extrême-Orient, qui s’appuie sur la place particulière de l’Orient dans l’histoire occidentale – le lieu des origines de la langue et de la civilisation, des riches marchés, de la possession et de la pénétration coloniale, et celui de la projection des imaginaires. L’Orient a été une ressource troublante dans la production de l’Occident – lui, l’autre de « l’Est », sa périphérie, qui devint matériellement son dominateur. L’Occident est placé en dehors de l’Orient, et cette extériorité fait partie des pratiques de représentation de l’Occident. Saïd cite Marx : « Ils ne peuvent se représenter eux-mêmes ; ils doivent être représentés. » Ces représentations sont des miroirs complexes de l’évolution du moi occidental à des moments historiques spécifiques. L’Occident s’est aussi placé de manière flexible : les Occidentaux pouvaient se trouver là avec relativement peu de résistance de la part de l’autre. La différence s’est donc située au niveau du pouvoir. Cette structure a été limitante, bien sûr, mais, plus important encore, elle a été productive. Cette productivité s’est opérée au sein des pratiques et des discours structurés de l’orientalisme – où ces structures étaient une condition pour avoir quelque chose à dire. Il n’est jamais question d’avoir quelque chose de vraiment original à dire sur les origines. Une partie de l’autorité des pratiques quant aux récits des origines réside précisément dans leurs relations intertextuelles.
La primatologie est un discours occidental, et c’est un discours sexualisé. Symboliquement, la nature et la culture, aussi bien que le sexe et le genre, se construisent mutuellement (mais pas équitablement) : un pôle d’un dualisme ne peut exister sans l’autre.
Donna Haraway
Sans pousser la comparaison trop loin, les signes du discours orientalistes marquent la primatologie. Mais ici, la scène des origines n’est pas le berceau de la civilisation : elle est le berceau de la culture, de l’être humain se distinguant de l’existence animale. Si l’orientalisme concerne l’imagination occidentale sur les origines de la cité, la primatologie, elle, met en scène l’imagination occidentale sur les origines de la socialité elle-même, et en particulier sur cette icône si chargée symboliquement qu’est « la famille ». Les origines sont par principe inaccessibles par témoignage direct ; toute voix provenant de l’époque des origines est structurellement la voix de l’autre, et qui donc génère le soi. C’est pourquoi, dans les représentations et les simulations au sujet des primates, l’esthétique réaliste et l’esthétique postmoderne ont toutes deux été des modes de production d’illusions complexes, qui fonctionnent comme des générateurs féconds de faits scientifiques et de théories scientifiques. Et il ne faut pas mépriser l’« illusion » lorsqu’elle fonde des vérités si puissantes.
L’idée d’orientalisme simien signifie que la primatologie occidentale concerne : la construction du moi à partir de la matière première de l’autre ; l’appropriation de la nature dans la production de la culture ; le mûrissement de l’humain à partir du sol de l’animal ; la clarté du blanc à partir de l’obscurité du coloré ; l’homme (man) sorti du corps de la femme ; l’élaboration du genre à partir de la ressource sexuelle ; et l’émergence de l’esprit par l’activation du corps. Pour rendre effectives de telles opérations de transformation, l’« orientaliste » simien doit d’abord en construire les termes : animal, nature, corps, primitif, femelle. Les singes – traditionnellement associés à des significations obscènes, à la luxure sexuelle et au corps sans retenue – ont reflété les humains, dans un jeu complexe de distorsions, à travers des siècles de commentaires occidentaux au sujet de ces doubles troublants. La primatologie est un discours occidental, et c’est un discours sexualisé. Elle traite du potentiel et de sa réalisation. Nature/culture et sexe/genre ne sont pas des paires de termes vaguement liés : leur forme spécifique de relation est une appropriation hiérarchique, connectée (comme l’enseignait Aristote) à la logique actif/passif, forme/matière, forme achevée/ressource, homme/animal, finalité/cause matérielle. Symboliquement, la nature et la culture, aussi bien que le sexe et le genre, se construisent mutuellement (mais pas équitablement) : un pôle d’un dualisme ne peut exister sans l’autre.
La critique de Saïd envers l’orientalisme devrait nous alerter sur un autre point important : ni le sexe ni la nature ne sont la vérité sous-jacente du genre et de la culture ; pas plus que l’« Orient » n’est réellement l’origine et le miroir déformant de l’« Occident ». La nature et le sexe sont tout autant fabriqués que leur « autre », les pôles dominants. Mais leurs fonctions et leurs pouvoirs sont différents. La tâche de ce livre est de participer à montrer comment l’ensemble de l’édifice dualiste est construit, quels sont les enjeux liés à ses architectures, et comment cet édifice peut être redessiné. Il importe de savoir précisément comment le sexe et la nature deviennent des objets de connaissance naturels-techniques ; et il importe tout autant d’expliquer leurs doubles – le genre et la culture. Il n’est pas vrai qu’aucune histoire ne pourrait être racontée sans ces dualismes, ni qu’ils font partie de la structure de l’esprit ou du langage. D’ailleurs, il existe des histoires alternatives au sein de la primatologie. Mais ces binarités ont été à la fois particulièrement productives et particulièrement problématiques pour les constructions des corps femelles et des corps marqués par la race ; il est crucial de voir comment ces binarités peuvent être déconstruites et peut-être redéployées.
➤ Lire aussi | Aux sens large : comment l’éthologie agrandit le monde・Thibault De Meyer et Vinciane Despret (2025)
Pour celles et ceux qui gagnent leur vie en produisant les sciences naturelles et en les commentant, il semble pratiquement impossible de croire qu’il n’y a pas de réalité donnée en deçà des écritures de la science, qu’il n’y a pas de centre sacré intouchable permettant de fonder et d’autoriser un ordre de la connaissance innocent et progressiste. Peut-être que dans les « humanités », il n’y a pas d’échappatoire à la représentation, à la médiation, à la narration et à la saturation sociale. Mais les sciences naturelles l’emportent sur cet autre ordre défectueux que sont les « humanités » – comme le prouve leur pouvoir de convaincre et de réordonner le monde entier, et non pas juste une culture locale. Les sciences naturelles sont l’« autre » des sciences humaines, avec tous leurs tragiques orientalismes. Pour autant, un tel édifice ne résiste pas à l’examen.
Ce n’est pas seulement parce que les sciences naturelles sont présentées comme cet « autre » que les plaidoyers des scientifiques convainquent. Leurs assertions sont prévisibles et semblent plausibles à celles et ceux qui les formulent parce qu’elles sont intégrées dans les taxonomies du savoir occidental, et parce que les besoins sociaux et psychologiques des chercheu·ses sont satisfaits par les affirmations persistantes de la division entre sciences naturelles et humaines – par cette division du travail et de l’autorité au sein de la production des discours. Sauf que de telles observations quant aux assertions prévisibles et aux besoins sociaux ne réduisent pas les sciences naturelles à un « relativisme » cynique qui n’aurait aucune norme au-delà de son pouvoir arbitraire. Mon argumentation ne prétend pas non plus que le monde dont les gens s’efforcent de rendre compte n’existe pas, qu’il n’y a pas de référent dans le système de signes et de productions des savoirs, ni de progrès dans l’élaboration de meilleurs récits au sein de ces traditions de pratiques. Cela reviendrait précisément à réduire un champ complexe à l’un des pôles des dualismes ici analysés : le pôle désigné comme idéal par rapport à un matériau impossible, celui désigné comme apparence par rapport à un réel interdit.

Le cœur de mon argumentation est plutôt que les sciences naturelles, tout comme les sciences humaines, se trouvent inextricablement prises au sein des processus qui leur donnent naissance. Et donc, comme les sciences humaines, les sciences naturelles sont culturellement et historiquement spécifiques, modifiées, impliquées. Elles importent pour des personnes réelles. Il est alors logique de se demander quels sont les enjeux, les méthodes et les genres d’autorités impliqués dans les récits des sciences naturelles – et comment ils diffèrent, par exemple, de la religion ou de l’ethnographie. En retour, il n’est par contre pas logique de chercher une forme d’autorité qui échapperait au réseau de ces champs culturels si productifs, et qui, au commencement, rendent les récits possibles. L’œil détaché de la science objective est une fiction idéologique, et elle est puissante. Mais c’est une fiction qui cache – et qui est conçue pour cacher – combien les puissants discours des sciences naturelles opèrent sur le réel. Là encore, les limites sont ici productives, et non pas réductrices et invalidantes.
L’une des conséquences désagréables de mon argument est que les sciences naturelles sont légitimement sujettes à la critique, et ce au niveau des « valeurs », et pas seulement des « faits ». Elles sont sujettes à une évaluation culturelle et politique « de l’intérieur », et pas seulement « en extérieur ». Mais l’évaluation, elle aussi, est impliquée, liée, pleine d’enjeux et d’intérêts croisés, et fait partie du champ de pratiques qui créent du sens pour des personnes réelles en rendant compte de vies situées – et y compris de ces choses hautement structurées que l’on appelle « observations scientifiques ». Les évaluations et les critiques ne peuvent pas enjamber les normes fabriquées pour produire des récits crédibles au sein des sciences naturelles, car ni les critiques ni les objets dont elles parlent n’ont de place « en dehors » qui permettrait de légitimer une vue d’ensemble aussi arrogante. Insister sur le fait que la production du savoir scientifique est fondamentalement chargée de valeurs et d’histoires n’équivaut pas à se tenir nulle part en ne parlant de rien d’autre que de ses propres préjugés – c’est même plutôt le contraire. Seule la façade d’une objectivité désintéressée rend impossible une « objectivité concrète ».
La nature n’est que la matière première de la culture ; et, dans la logique du colonialisme capitaliste, elle doit être appropriée, préservée, esclavagisée, exaltée ou rendue flexible afin d’être mise à la disposition de la culture.
Donna Haraway
Une partie de la difficulté à approcher les constructions intégrées, intéressées et passionnées de la science d’une façon non réductrice nous vient d’une tradition analytique – que nous héritons notamment d’Aristote et de l’histoire transformative du « patriarcat capitaliste blanc » (comment bien nommer cette chose scandaleuse ?) – et qui fait de toute chose une ressource à s’approprier. En tant que « ressource », un objet de connaissance n’est finalement qu’une matière pour le pouvoir séminal, et donc pour l’acte du sachant. Ici, l’objet à la fois garantit et revigore le pouvoir du sachant ; mais tout statut d’agent doit être dénié à l’objet dans les productions de savoir. Le monde doit, en somme, être objectivé en chose, pas en agent ; il doit être de la matière pour la formation de soi du seul être social au sein des productions de savoir, le sachant humain. La nature n’est que la matière première de la culture ; et, dans la logique du colonialisme capitaliste, elle doit être appropriée, préservée, esclavagisée, exaltée ou rendue flexible afin d’être mise à la disposition de la culture. De la même manière, le sexe est seulement la matière de l’acte de genre ; la logique productionniste semble inéluctable au sein des traditions dualistes occidentales. Cette logique narrative analytique et historique explique ma nervosité à propos de la distinction sexe/genre lorsqu’elle est vue, au sein de l’histoire récente des théories féministes, comme un moyen d’aborder les reconstructions de ce qui peut compter comme étant « femelle » ou « nature » dans la primatologie – et de pourquoi ces reconstructions importent au-delà des frontières des études sur les primates. Il a semblé pratiquement impossible d’éviter le piège d’une logique de domination appropriationniste, enchâssée dans la binarité nature/culture et dans sa lignée générative, ce qui inclut la distinction sexe/genre.
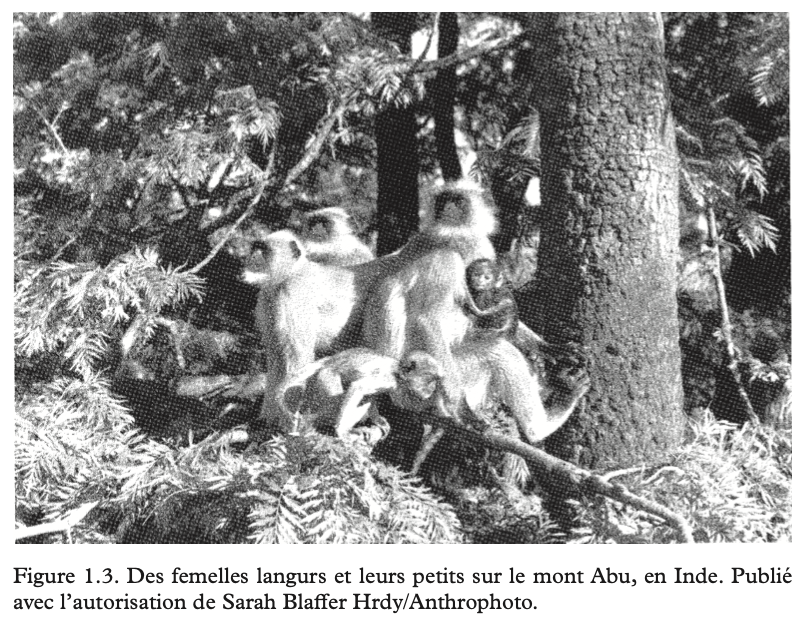
Lire dans les zones frontières
De nombreux sujets dans l’histoire de la biologie et de l’anthropologie pourraient venir nourrir les thèmes discutés dans cette introduction : alors pourquoi ce livre a-t-il choisi d’explorer les sciences des primates en particulier ? La raison principale est que les singes, et les êtres humains considérés comme leurs descendants taxonomiques, existent aux frontières d’une myriade de luttes pour déterminer ce qui comptera comme étant du savoir. Les primates ne se sont pas gentiment enfermés dans une discipline ou un champ spécialisé et sécurisé. Même en cette fin de 20e siècle, de nombreux types de personnes peuvent prétendre connaître les primates, suscitant la consternation et le grand dam de nombreux autres candidats à l’expertise officielle. La possibilité de déstabiliser les savoirs à propos des primates reste à la portée non seulement des praticien·nes de divers champs des sciences de la vie et des sciences humaines, mais aussi à la portée de personnes en marge de toute science – des écrivain·es scientifiques, des philosophes, des historien·nes, comme des visiteu·ses de zoos. De surcroît, raconter des récits à propos des animaux est une pratique si profondément populaire que le discours produit au sein des spécialités scientifiques est approprié par d’autres personnes, à leurs propres fins. La frontière entre discours technique et discours politique est aussi fragile que perméable. Même en cette fin de 20e siècle, le langage de la primatologie est mobilisé au sein de débats politiques controversés sur la nature humaine, son histoire et son avenir. Et cela reste vrai malgré la transformation des discours spécialisés de la primatologie en d’autres langages : mathématiques, théorie des systèmes, analyses ergonomiques, théorie des jeux, stratégies au sein de l’histoire de la vie, et biologie moléculaire.
En plaçant ce récit de primatologie au sein de la SF, j’invite les lecteurs et lectrices à redessiner les frontières entre nature et culture.
Donna Haraway
Parmi les conflits frontaliers intéressants à propos des primates – qui et que sont-ils (et qui et à quoi servent-ils) –, il y a ceux qui opposent : la psychiatrie et la zoologie ; la biologie et l’anthropologie ; la génétique et la psychologie comparée ; l’écologie et la recherche médicale ; l’agriculture et les industries touristiques dans le « tiers-monde » ; les chercheu·ses de terrain et les scientifiques de laboratoire ; les défenseu·ses de l’environnement et les multinationales de l’exploitation forestière ; les braconniers et les gardes-chasse ; les scientifiques et les administrateurs au sein des zoos ; les féministes et les antiféministes ; les spécialistes et les profanes ; l’anthropologie physique et la biologie éco-évolutionnaire ; les scientifiques confirmé·es et les récent·es titulaires de doctorat ; les étudiant·es en études de genre et les professeur·es en comportement animal ; des linguistes et des biologistes ; des responsables de fondation et des demandeu·ses de subvention ; des écrivain·es scientifiques et des chercheu·ses ; des historien·nes des sciences et des vrai·es scientifiques ; des marxistes et des libéraux ; des libéraux et des néo-conservateurs. Et toutes ces intersections apparaissent dans ce livre.
Comment différent·es lectrices et lecteurs pourraient-ils voyager avec plaisir dans ces zones frontières ? Chaque chapitre relève à la fois de l’histoire des sciences, des études culturelles, de l’exploration féministe et d’une intervention engagée pour la constitution d’amour et de connaissance au sein de la fabrique disciplinée de l’ordre des Primates. J’espère que les lecteurs et lectrices n’y seront pas un « public », dans le sens de la réception d’une histoire finie. Les conventions au sein du champ narratif qu’est la SF semblent exiger des lectrices et lecteurs qu’ils réécrivent radicalement les histoires par l’acte même de les lire. En plaçant ce récit de primatologie au sein de la SF – les narrations de la fiction spéculative comme des faits scientifiques –, j’invite les lecteurs et lectrices (historien·nes, critiques culturel·les, féministes, anthropologues, biologistes, antiracistes et amoureu·ses de la nature) à redessiner les frontières entre nature et culture. Je souhaite que les lecteurs et lectrices trouvent ici un « ailleurs » à partir duquel envisager un ordre de relations différent et moins hostile entre les gens, les animaux, les technologies et la terre. Tout comme les acteurs et actrices des histoires qui suivent, je souhaite également proposer de nouveaux termes qui nous aident à circuler entre ce que nous avons historiquement appris à connaître comme nature et culture.
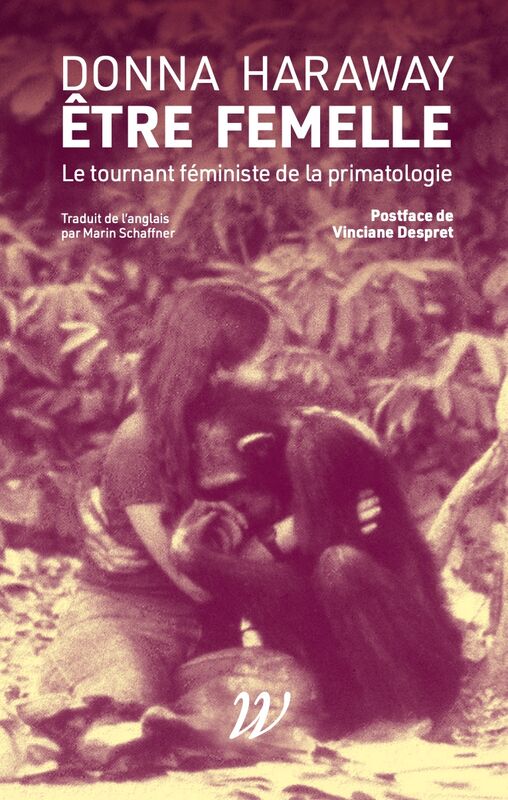
Image principale : « Les singes dans l’orangeraie », Henri Rousseau, 1910. Wikiart.
L’ensemble des images en noir et blanc de cet article sont tirées des divers chapitres du livre Être femelle – les autres sont libres de droits.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
Notes
- Le premier, Crystals, Fabrics and Fields (non traduit), paru en 1976, était la publication de sa thèse en biologie.
- Traduit en 2002 par Marie-Hélène Dumas, Charlotte Gould et Nathalie Magnan, dans Connexions : art, réseaux, média, anthologie établie par Nathalie Magnan et Annick Bureaud, Paris : éditions Ensba.
- Une nouvelle traduction de « Savoirs situés » est à paraître aux Éditions Wildproject en mars 2026 – accompagnée d’un entretien avec Jeanne Burgart Goutal.
- La nouvelle de science-fiction de John Varley, The Persistence of Vision, est en partie à l’origine de ce livre. Dans cette nouvelle, Varley décrit une communauté utopique conçue et construite par des personnes sourdes et aveugles. Il explore ensuite les technologies et autres moyens de communication de ces personnes, ainsi que leurs relations avec les enfants voyants et les visiteu·ses (Varley, 1978). L’interrogation sur les limites et la violence de la vision fait partie de la politique d’apprentissage de la révision.
- NdT : Tout au long de l’ouvrage, l’expression « politiques de reproduction » (reproductive politics) renverra au terme forgé par les féministes dans les années 1970 pour décrire les luttes de pouvoir contemporaines sur la contraception, l’avortement, l’adoption, la gestation pour autrui, et les questions qui leur sont corollaires.
- Foucault (1963) ; Albury (1977) ; Canguilhem (2013 [1966]) ; Figlio (1976).
- Voir aussi Latour (1983, 2005 [1987], 2012 [1984]) ; Bijker et al. (1987) ; Gallon et Latour (1981) ; Knorr-Cetina (1983) ; Knorr-Cetina et Mulkay (1983) ; Traweek (1988).
- Voir Hartsock (1983) ; Harding (1986) ; Rose (1983).
- Voir Young (1977, 1985a) ;Yoxen (1981, 1983) ; Figlio (1977).
- Voir Fee (1986) ; Gould (1981) ; Hammonds (1986) ; Hubbard, Henifin et Fried (1982) ; Gilman (1985) ; Lowe et Hubbard (1983) ; Keller (1985).
- Je dois cette analyse de Linné comme Œil/Je (Eye/I) de Dieu à Camille Limoges, de l’université de Québec à Montréal.
L’article Le tournant féministe de la primatologie est apparu en premier sur Terrestres.
19.12.2025 à 10:35
Logique du capitalisme logistique, de la plantation à l’entrepôt
Jacopo Rasmi
“Qu’est que ça fait d’être un problème dans la chaine d’approvisionnement de quelqu’un ?”, demandent Fred Moten et Stefano Harney dans “All incomplete”, un essai théorique sur les infrastructures du capitalisme logistique, vues à travers le prisme de la tradition radicale afro-américaine. Compte-rendu de lecture pour regarder autrement Amazon et son monde.
L’article Logique du capitalisme logistique, de la plantation à l’entrepôt est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (9806 mots)
Temps de lecture : 22 minutes
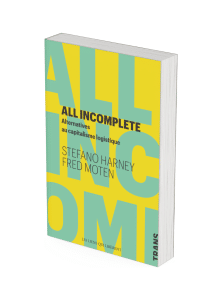
À propos du livre All incomplete. Alternatives au capitalisme logistique, de Fred Moten et Stefano Harney, paru en 2025 aux éditions Les Liens qui Libèrent ; traduction collective finalisée par Mabeuko Oberty.
Récemment traduit en langue française, All Incomplete, le dernier essai de Stefano Harney et Fred Moten, met au centre de sa réflexion la question du « capitalisme logistique ». Les auteurs, tous deux étasuniens – le premier enseignant à la KHM de Cologne, le second poète, performeur et enseignant à la New York University – sont surtout connus pour leur premier livre écrit à quatre mains : Les sous-communs (Brook, 2022), sur lequel nous reviendrons. Disons-le d’emblée : leur dernier ouvrage est ardu et diffère du style classique en sciences humaines et sociales. Il ne faut pas s’attendre à une prose didactique et progressive. Ce livre assez dense et foisonnant propose une réflexion qui mêle philosophie et sciences politiques, poésie et culture radicale black (tradition de pensée nord-américaine dont certains auteurs essentiels comme Cedric Robinson commencent à peine à circuler dans l’espace francophone1).
Quiconque réfléchit aux limites écologiques de notre système socio-productif trouvera des intuitions importantes dans les trajectoires théoriques vertigineuses que Motent et Harney élaborent autour de la question cardinale de la logistique. Dès 2009, l’antropologue Anna Tsing affirmait l’importance d’analyser notre situation en termes de « capitalisme de la chaîne d’approvisionnement (supply chain capitalism) » :
Le « capitalisme de la chaîne d’approvisionnement » désigne ici les chaînes commerciales basées sur la sous-traitance, l’externalisation et les accords connexes dans lesquels l’autonomie des entreprises impliquées est légalement établie, tout en les soumettant à une discipline au sein de la chaîne dans son ensemble.2
C’est ce double mouvement corrélé de séparation en entités autonomes et compétitives, d’une part, et d’enchainement à un écosystème économique hégémonique, d’autre part, que nous retrouvons dans les analyses philosophiques d’All Incomplete. Les terrains de recherche anthropologiques d’Anna Tsing nous suggéraient, à ce propos, de ne pas nous attarder excessivement sur l’épouvantail de la standardisation globale, en nous invitant à voir plutôt comment cette forme de productivité capitaliste se fondait sur une variété (diversity) de « niches économiques fragmentés mais reliées ».
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
« La nature aime se cacher », disait une maxime célèbre d’Héraclite3. Tout un courant intellectuel qui peut être qualifié de « post-naturel » s’est consacré depuis un certain nombre d’années à déconstruire l’évidence fuyante de cette nature à partir de traditions hétérogènes. Du marxisme à l’anthropologie en passant par les gender studies, de Bruno Latour à Timothy Morton en passant par Donna Haraway, on nous a appris à observer de manière critique les mécanismes culturels et politiques qui instaurent le périmètre du « naturel ».
Au sein de « l’écologie-monde4 » contemporaine, il y a cependant une chose qui, bien qu’elle soit partout, « aime se cacher » : la logistique. On pourrait la considérer comme une sorte de seconde nature d’origine technique et qui demande, elle aussi, un effort de compréhension critique. Nous ne pouvons pas comprendre les relations matérielles que nous entretenons avec l’écosystème planétaire en faisant l’économie d’une lecture méticuleuse des chaînes de déplacement et d’approvisionnement qui structurent le métabolisme de nos communautés interconnectées. À l’heure de l’économie globalisée, de la production just in time ou de la consommation à la demande de biens et de services, la reproduction de nos modes de vies dépend d’un immense régime logistique qui soutient la production et la livraison de ce qui nous permet de communiquer, manger, lire, nous habiller…5
La logistique aussi aime se cacher. La logistique préfère disparaître derrière ses effets, ses derniers maillons, ses services accomplis. Elle tente d’apparaitre comme neutre afin éviter d’être appréhendée comme un exercice de pouvoir et gouvernement6. Nous recevons le livre commandé par Amazon : en quelques jours à peine, voilà qu’il arrive « magiquement » dans notre boite aux lettres. Et voilà aussi que cette « magie » fait oublier les entrepôts de stockage, les serveurs de traitement des commandes, l’exploitation salariale, la sous-traitance compétitive de la livraison, le carburant brûlé par les navires cargo…
Dans l’essai Planète B, Gwenola Wagon écrit à propos du protagoniste B, avatar explicite de Jeff Bezos :
B a profité de l’accélération de l’information comme de l’envoi des colis pour raccourcir le temps de livraison. Réduire l’attente et court-circuiter l’espace-temps pour répondre instantanément au désir d’achat. Diminuer le coût de la consultation du site. Faire disparaître les traces de la locomotion et simuler que le produit est déjà là.7

Le fonctionnement de la logistique peut être inscrit dans la tendance plus générale des médiations techniques à se cacher derrière le résultat qu’elles livrent – du moins tant que rien ne coince ou ne bugge8. Si aujourd’hui la montée en puissance de la logistique évoque immédiatement les infrastructures de la plateforme numérique et ses black boxes, elle s’inscrit dans la continuité historique de phénomènes majeurs tels que l’exploitation des énergies fossiles (charbon, pétrole…) ou l’invention du container.
Une des façons de rendre compte de cette réalité cruciale dans le champ théorique contemporain a été le développement d’études sur les questions infrastructurelles (Infrastructure Studies / Critical Infrastructure Studies), un domaine ancré surtout dans les sciences sociales9. L’infrastructure constitue dans ce champ de recherche un objet composite qui permet d’analyser autant des écosystèmes matériels de connexion, coordination et transport, que des formes de gouvernementalité et subjectivation. Voici la définition qu’en donne la chercheuse Keller Esterling dans un essai ayant marqué cette approche théorique :
Le mot « infrastructure » évoque généralement des associations avec des réseaux physiques permettant le transport, la communication ou les services publics. L’infrastructure est considérée comme un substrat caché, le moyen de liaison ou le courant entre des objets caractérisés par des conséquences, des formes et des lois positives. Pourtant, aujourd’hui, au-delà des réseaux de tuyaux et de câbles, l’infrastructure comprend des micro-ondes émises par des satellites et des appareils électroniques miniaturisés que nous tenons dans nos mains. Les normes (standards) et les concepts qui déterminent à peu près tout – des objets techniques aux styles de gestion – constituent également une infrastructure. Loin d’être cachée, l’infrastructure est désormais le point de contact et d’accès manifeste entre nous tous – les règles qui régissent l’espace de la vie quotidienne10.

Bien qu’on puisse ressentir une dilution face à cette ouverture de la focale conceptuelle, la perspective proposée par Esterling nous permet d’appréhender plus efficacement les dispositifs qu’on appelle « infrastructures » comme des objets complexes impliquant autant des couches matérielles et que des couches abstraites, des modifications des paysages terrestres tout comme des protocoles politiques internationaux ou des modulations d’espaces intérieurs subjectifs. Moten et Harney nous invitent précisément à observer le capitalisme logistique comme une combinaison d’éléments hard (des routes, des câbles, des zones de stockage, des canaux d’approvisionnement énergétique…) et d’éléments soft (programmes informatiques, ingénierie des flux, management des stocks, attentes sociales…). Si on prend, par exemple, l’infrastructure d’UberEats, nous pouvons comprendre la logistique de cet acheminement de repas à domicile comme un assemblage qui réunit une série de composantes enchevêtrées mais disparates : des véhicules particuliers, des algorithmes d’appariement demande/offre, un certain droit du travail, des smartphones connectés au réseau 5G, le désir de confort alimentaire dans un rythme de vie frénétique, des systèmes de paiement sécurisé en ligne, une cartographie interactive intégrant la géolocalisation en temps réel, une culture diffuse de l’auto-entrepreneuriat…

Le travail universitaire des études infrastructurelles n’épuise pas le spectre des gestes qui explorent ce domaine. De nombreuses opérations performatives et artistiques tentent d’entrainer collectivement une « proprioception infrastructurelle », selon le terme de l’artiste-chercheur Jamie Allen11. Des cartes du collectif Bureau d’études12 aux démontages analytiques du tandem Raffard-Roussel13 en passant par les essais cinématographiques de Gwenola Wagon et Stephane Degoutin14, les artistes essayent d’alimenter la sensibilité et la conscience des environnements infrastructurels qui façonnent notre quotidien par des gestes hétérogènes : par des ateliers pratiques de démontage, par des représentations graphiques synthétiques, par des balades-enquêtes dans l’espace urbain et numérique, par des récits spéculatifs. Comment percevoir les écosystèmes infrastructurels sur lesquels nous sommes branchés ? Et pourquoi le faire ?15 Si on les connait, alors on peut les débrancher.
Le simple sabotage des antennes 5G ou la cartographie visuelle du stack numérique ne suffisent pas tactiquement : elles doivent être accompagnées par la fabrication d’écosystèmes différents et plus désirables en termes écologiques et démocratiques.
Le même Jamie Allen a mis en évidence les limites d’un simple « dévoilement constructiviste » des infrastructures techniques, qui serait dépourvu de propositions tactiques pour des infrastructures alternatives. Il parle à ce propos de la nécessité d’une « rêverie infrastructurelle » qui activerait d’autres organisations socio-techniques par l’imagination et l’exploration16. Les limites d’un simple sabotage des infrastructures dominantes méritent également d’être questionnées. En d’autres termes, la conscience des chaînes logistiques hégémoniques et leur obstruction est nécessaire mais non suffisante. Comme l’écrit la chercheuse Fanny Lopez, il faut envisager le problème logistique des infrastructures techniques par de multiples opérations qui prolongent et dépassent les gestes d’exploration et de blocage : « débrancher des segments, réinventer les liens techniques sans forcer ni arraisonner le vivant ; repenser les structures et la gouvernementalité des réseaux »17. Cela équivaut à dire que le simple sabotage des antennes 5G ou la cartographie visuelle du stack numérique ne suffisent pas tactiquement : elles doivent être accompagnées, si on reste dans l’exemple du numérique, par la fabrication d’écosystèmes différents et plus désirables en termes écologiques et démocratiques (comme dans le cas du permacomputing ou du cloud associatif).
Ce court cadrage théorique permet de situer l’abstraction poétique de l’essai All Incomplete de Moten et Harney dans un contexte de réflexion et d’action politique plus vaste, ainsi que ses « alternatives au capitalisme logistique » mises en avant par le sous-titre de la traduction en français.
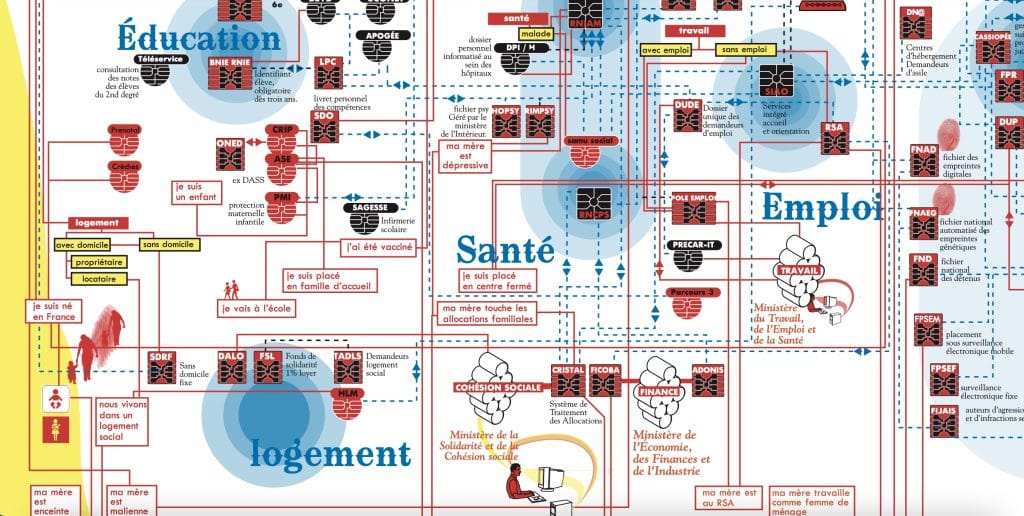
Mais qu’est-ce que donc le « capitalisme logistique » ? En trahissant partiellement la densité organique de l’écriture des auteurs, j’essaie de tracer les contours de cette perspective à la fois intellectuelle et lyrique après avoir participé à l’aventure collective de traduction de ce texte fascinant et fuyant. Cet exercice souhaite moins épuiser en la synthétisant sa prose originale qu’attiser le désir de se perdre dans le tourbillon de pensée et d’images d’All Incomplete.
Si le récit philosophique de la logistique dans « All Incomplete » s’échafaude autour de l’implication violente des corps, c’est aussi et surtout à cause de la référence raciale et esclavagiste qui l’inspire transversalement.
1. Amazon vient des cales sombres des navires négriers
Le problème de la logistique se manifeste pleinement dans le contre-jour de l’histoire coloniale – donc en amont de la motorisation, de l’automatisation ou encore de la numérisation qui ont alimenté la période d’expansion technologique et productive la plus récente, entre les XIXe et XXIe siècles. Ancré dans l’expérience passée et présente des communautés afro-américaines, All Incomplete présente « la logistique » comme « la science blanche » par excellence (p. 37). C’est dans l’appropriation et l’organisation déployées au sein de la traite esclavagiste et de la plantation que se forge à une échelle aussi grande que décisive cette science du flux : « Bien sûr, la logistique existait déjà en tant que pratique dans les affaires militaires, depuis qu’il y a des sièges, des invasions et des forts. […] La traite esclavagiste africaine et transatlantique a représenté la grande et hideuse introduction de la logistique de masse à des fins commerciales plutôt que militaires ou étatiques » (p. 180). Si le récit philosophique de la logistique dans All Incomplete s’échafaude autour de l’implication violente des corps (opposés au principe d’une expérience plus fugitive et moins individuelle de ce qu’on appelle dans le texte la « chair »18) c’est aussi et surtout à cause de la référence raciale et esclavagiste qui l’inspire transversalement.
Tout en faisant un clin d’œil aux manifestations numériques contemporaines du pouvoir logistique, chez Moten et Harney l’emploi récurrent du terme « algorithme » résume une mise en forme plus vaste et profonde que le domaine des technologies digitales. Elle s’impose corporellement comme une pulsation musicale et chorégraphique (riddim) : « Être formé·e, c’est être formé·e dans ce rythme, être composé·e algorithmiquement, être contraint·e de porter ce rythme mais aussi de le développer, de l’améliorer, de l’exporter et de l’importer, ce qui revient à dire qu’être composé·e algorithmiquement, ce n’est pas seulement être battu·e, mais battre. » (p. 99). Cette représentation ample et poétique du capitalisme logistique esquissée par Moten et Harney peut surprendre car elle n’est pas immédiatement « infrastructurelle » comme celle de beaucoup d’analyses en sciences sociales19. Sans exclure la pertinence de l’infrastructure, en effet, All Incomplete propose une interprétation plus-qu’infrastructurelle de la question logistique qui s’infiltre dans les pulsations physiques et affectives du sujet.
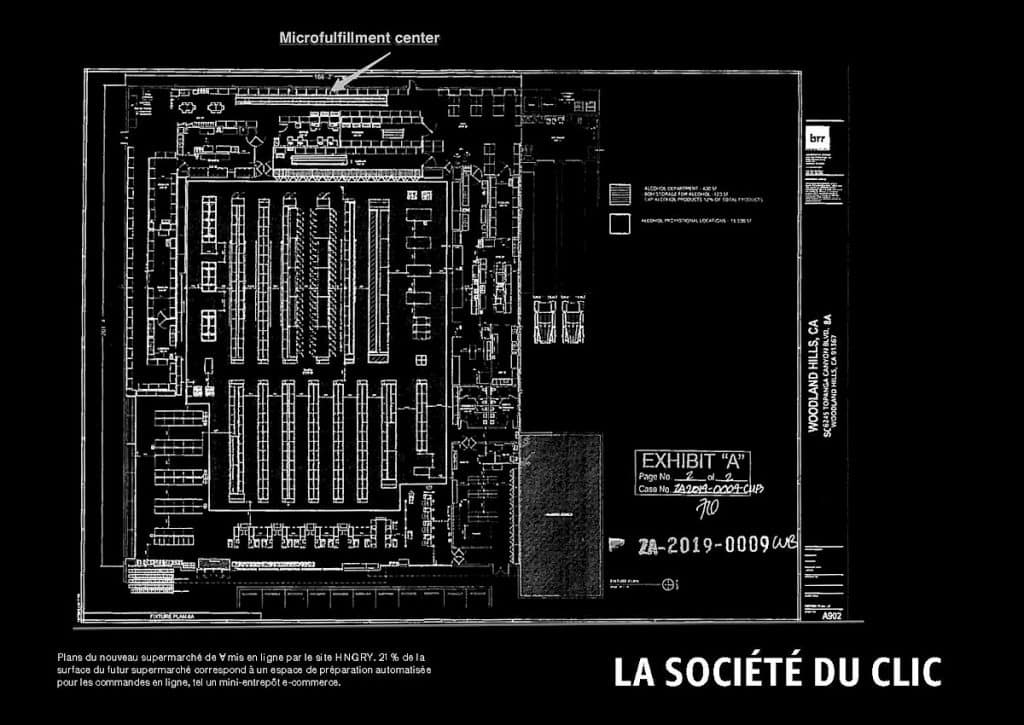
2. La logistique est Zen
Dans l’élan initial du livre, Moten et Harney se demandent : « que devons-nous tirer du fait qu’aujourd’hui la science qui semble avoir le plus réalisé la Doctrine du Cœur du bouddhisme Zen est la logistique ? » (p. 34). Cette doctrine prône une fluidité, une mobilité ou un vide qui s’avèrent être des conditions de prolifération idéales pour les opérations du régime logistique. Est-ce donc un hasard si ces disciplines orientales connaissent un si grand succès dans le monde contemporain ? La stratégie logistique adhère avec enthousiasme au ji ji muge bouddhiste entendu comme « non blocage » : « C’est la science de la logistique qui rêve de flux sans blocage et essaie de faire de ces rêves une réalité. La logistique hard et la logistique soft fonctionnent ensemble. Le yang de la Nouvelle Route de la Soie et le yin de l’algorithme fantasment tous les deux sur le non blocage. » (p. 34). Adepte acharnée de cette discipline zen, la logistique envisage la fluidité du vide comme une opportunité d’aménagement stratégique voué à la réalisation d’une accessibilité universelle et d’une mobilité sans frein. Le détournement du zen est l’emblème des aspirations totalisantes du capitalisme logistique.
Adepte acharnée de cette discipline zen, la logistique envisage la fluidité du vide comme une opportunité d’aménagement stratégique voué à la réalisation d’une accessibilité universelle et d’une mobilité sans frein.
Pour Moten et Harney, « la science capitaliste de la logistique » est condensée par la formule « mouvement + accès » (p. 71). Toute maladresse, toute déviation ou tout épuisement équivalent donc à un « sabotage » qui ralentit ou entrave ces principes de fonctionnement : « tout repos dans la vie sociale – ce que nous appellerions, avec Valentina Desideri, notre conservation militante, la fermentation de nos désirs – [est amené à être] dénoncé comme antisocial » (p. 186). Ici, il n’est pas question spécifiquement de « soulèvements infrastructurels » (infrastructural unrest) qui troublent au premier degré les flux de marchandises dans les entrepôts Amazon ou les flux de pétrole dans les pipelines20. Ce sont des phénomènes mineurs et diffus d’inaccessibilité et d’interruption – pas décorrélés, au fond, des évènements majeurs et médiatiques mentionnés que Moten et Harney célèbrent par leurs réflexions : le « repli » d’une danse, d’un barbecue, une crèche, un atelier de mécanique (p. 217)… All Incomplete nous encourage à penser des résistances « anti-héroiques » qui prennent forme dans une multitudes de moments « fugitifs » de socialité quotidienne où se réalise une soustraction au flux de la production et de l’organisation logistique. Si on reprend les catégories du matérialisme féministe, la pensée des deux auteurs étasuniens s’intéresse davantage aux couches « reproductives » de notre existence collective qu’à celles « productives ». Access denied : refuser l’accès signifie consentir au partage, précieux paradoxe.
La logistique tend ainsi à phagocyter les valeurs supposément émancipatrices de droit d’accéder et se déplacer dont devrait abstraitement jouir tout sujet. Ou, du moins, elle sème des doutes au sein de toute adhésion hâtive à la liberté d’accès ou de mouvement21. All Incomplete nous apprend à nous méfier de l’universalité positive de ces droits, à y ressentir l’intrusion impitoyable des logiques capitalistes, bien qu’on ne doive pas arrêter de célébrer contextuellement la nécessité d’un accès culturel démocratique dans le champ numérique (open access, creative commons…) ou le droit de circulation contre les frontières. À cette conception du mouvement qui fait l’objet d’une critique en tant que volonté souveraine de l’individu et processus d’accumulation capitaliste on peut opposer le « mouvementement » dont parle la théoricienne Emma Bigé : une activation corporelle et un déplacement animé plutôt par de forces environnementales et transindividuelles22. Être mouvementé est une condition irréductible à la mobilité capitaliste, dépend d’une solidarité physique ingouvernable avec ce qui nous entoure et nous traverse. En somme, le contraire de la logistique ne coïncide pas nécessairement avec une stase.
3. La logistique vise le kaizen
Le capitalisme logistique n’est pas uniquement Zen. Il aspire aussi au « kaizen », dans ses volontés de gestion pointilleuse. La logistique fonctionne selon une logique « d’optimisation » permanente et capillaire. Telle est la signification du terme japonais « kaizen » qui a été mobilisé historiquement pour exprimer l’esprit du toyotisme et la mutation du management industriel vers une flexibilité allégée (lean)23. Il faut s’améliorer et améliorer, sans cesse. Il est surtout question, ici, d’une amélioration du flux, toute amélioration individuelle ayant pour fin l’accélération du processus général : « L’importance de la marchandise n’est rien en comparaison de la qualité du flux qu’elle emprunte, qui est l’infrastructure que les travailleureuses fabriquent et rendent meilleure, plus résiliente. » (p. 185). Améliorer signifie conquérir plus de communication, plus d’accessibilité, plus de connexion, plus de vitesse, plus de production. S’améliorer signifie se rendre davantage disponible à ces augmentations, embrasser activement sa propre insuffisance comme un travail infini (donc éreintant) au service des chaînes de valorisation24. Telle est la circularité perverse de cette injonction : « La logistique vise à nous corriger, à nous démêler et à nous ouvrir à son usufruit, son amélioration ; un tel accès à nous, à son tour, améliore la ligne de flux, la ligne droite » (p. 39).
« L’importance de la marchandise n’est rien en comparaison de la qualité du flux qu’elle emprunte, qui est l’infrastructure que les travailleureuses fabriquent et rendent meilleure, plus résiliente. »
Fred Moten et Stefano Harney
Les systèmes d’évaluation et de mesure viennent au secours de cette optimisation ubiquitaire. Ils la guident, ils nous guident vers de nouvelles frontières d’efficacité et d’optimisation. Si le principe du kaizen trouve son ancrage historique dans le dépassement de la chaîne fordiste par le flux just in time toyotiste, il anime une tension plus générale de la modernité individualiste et capitaliste obsédée par ce que Moten et Harney appellent « l’usufruit » : à savoir, « la réunion de deux types d’amélioration – l’amélioration de soi et l’amélioration de la propriété au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle » (p. 177). D’une part rendre plus fluide et efficace la structure productive et sa rentabilité, de l’autre inculquer cette soif de perfection et performance au sein de l’intimité personnelle.
Vous pouvez traduire « amélioration » par « progrès », si cela rend le raisonnement plus clair. Et il n’y a progrès que si on peut s’approprier quelque chose pour exercer pleinement son droit/devoir d’amélioration contre celleux qui n’en seraient pas capables. Le capitalisme logistique perfectionne voracement, il souhaite compléter ce qui est incomplet en chacun·e. Mais cette incomplétude imparfaite constitue le partage social le plus précieux et profond, ce qui nous rassemble et nous anime. L’améliorer signifie perdre cette socialité fondamentale, la dissiper ou la canaliser productivement : « Pouvons-nous accepter et embrasser une telle imperfection, pour continuer à imparfaire chaque effondrement logistique ancien et nouveau ? » (p. 201)

4. La logistique ne nous sépare individuellement que pour nous enchainer ensemble
Moten et Harney reprennent la structure binaire qui triomphe dans la technologie informatique pour résumer la tension qui structure le capitalisme logistique. Cette structure n’évoque pas uniquement le fonctionnement numérique, elle est présentée également sous la forme déjà mentionnée d’un rythme. C’est un « rythme qui tue » (p. 98). Il a deux temps corrélés : « Le premier temps sépare, délimite, isole chaque marchandise de la suivante. Le deuxième temps rend chaque chose égale à toutes les autres. Le premier temps fait de chaque chose une entité discrète. Le deuxième temps rend toutes choses identiques. » (p. 97) On ne sépare que pour mieux relier, on n’identifie que pour mieux homogénéiser.
D’une part, le gouvernement de la logistique impose de se posséder soi-même, de devenir individu autonome et agent souverain, de s’affirmer comme productivement autonome, de s’isoler, « d’être des fins en soi » (p. 167). De l’autre, il met inexorablement les entités individuelles au service du flux, enchaîne cette prétendue autonomie à un processus frénétique et global de valorisation où l’individualité est finalement emportée, subsumée : « Aujourd’hui la logistique nous mobilise et nous met en réseau comme elle ne l’a jamais fait auparavant. Elle fait de nous des moyens comme elle ne l’a jamais fait auparavant. Elle ouvre l’accès partout et à tout » (p. 166-167). Pour le dire autrement, l’univers socio-économique contemporain encourage un individualisme forcené tout en le mettant au service de dynamiques économiques et politiques qui dépassent largement la conscience et la volonté individuelle. D’où le corollaire du point suivant.
D’une part, le gouvernement de la logistique impose de se posséder soi-même. De l’autre, il met inexorablement les entités individuelles au service du flux.
5. Le contraire de l’infrastructure n’est pas l’individu
On pourrait opposer instinctivement l’échelle personnelle et individuelle aux logiques impersonnelles et systémiques des écosystèmes infrastructurels, mais on risque de se tromper de solution, de penser qu’on résiste alors qu’on alimente l’ennemi. All Incomplete nous démontre avec véhémence ce que nous ressentons souvent comme un malaise sourd et confus : que les processus d’individuation et de subjectivation sont mis au service de la production d’un « surplus : volé, accumulé, régulé » (p. 166) qui nourrit le métabolisme capitaliste. En ce sens, Moten et Harney s’attellent à mettre à l’épreuve une certaine matrice foucaldienne et ses perspectives d’émancipation fondées sur un « souci de soi ». Ils rejettent les politiques du sujet et de l’individu, autant celles libérales basées sur des principes marchands que celles plus subversives basées sur une volonté d’émancipation individuelle : « toute forme de subjectivation, ou d’identité individuelle dématérialisée et isolée de l’écologie générale et générative de la société par le régime de travail propre au capitalisme logistique, est déjà liée à une chaîne de valeur attachant cerveau, esprit, identité et sujet. » (p. 187).
Penser contre la logistique ou contre l’échelle des systèmes infrastructurels ne signifie pas s’enfermer dans la forteresse de l’autonomie individuelle qui s’avère en être largement complice. La critique du capitalisme logistique déployée par Moten et Harney fait plutôt appel à un principe d’« antagonisme général ». La crête qui sépare ces expériences politiques opposées semble parfois fine et ambiguë – ce qui permet au premier de mieux s’accaparer les puissances du second et devenir moins intelligible. Bien que la dynamique impersonnelle et collective de l’antagonisme général pourrait rappeler certaines spécificités de la dimension logistique, il en constitue une subversion foncièrement radicale : « Au cœur de sa production [d’un tel antagonisme], il y a une certaine absence de discernement, une certaine différenciation qui ne divise pas, une consolation sans bornes contre l’isolement, une résonance haptique qui rend possible et impossible ce rythme meurtrier, la musique sous-commune qui échappe sans cesse à la logistique émergente de ce rythme mortel et l’épuise » (p. 98). Être antagoniste, généraliser cet antagonisme signifie concevoir et entretenir une résistance qui échappe à la confrontation guerrière et frontale, qui ne découle pas d’une précise rationalité stratégique. L’antagonisme qui est loué par All Incomplete consiste en une puissance solidaire et ubiquitaire qui ne cesse pas de se reproduire et de s’expérimenter dans le sous-sol d’une organisation capitaliste et étatique à laquelle la vie sociale refuse de se réduire.
6. L’informalité sociale excède toujours la mise en forme des flux
La logistique strie l’espace et le temps pour organiser des lignes de flux qui orientent les agitations locales et spontanées : « La logistique cherche à imposer une position, une direction et un flux à notre mouvement, à notre pédèse, à notre marche aléatoire, à notre errance vagabonde » (p. 166). Ainsi elle dessine des grilles dans lesquelles on canalise les lignes de fuites de ce qui s’oppose à l’appropriation et au gouvernement logistique. Ces fuites émergent sans cesse sous la forme de ce que Moten et Harney n’appellent pas seulement « antagonisme général » mais aussi « informalité ». Si le mantra de la logistique est l’accès, alors le principe de la socialité informelle est l’excès.
Si le commun demeure une perspective fondée sur des catégories politiques classiques comme l’individu ou la contractualisation, le sous-commun y échappe farouchement.
Ce qui excède renvoie à une impossibilité d’appropriation où nous nous retrouvons ensemble, donc à une sorte de puissance plutôt qu’à une diminution : « la préservation militante de ce que vous avez (un vous entendu comme un nous), dans la dépossession commune, qui est la seule forme possible de possession, de manière d’avoir en excès de celleux qui ont. » (p. 57). Et bien qu’il lui soit étranger et antagoniste, « le capital […] cherchera néanmoins à calculer, exproprier et brûler cet excès » (p. 149). La posture devient diagonale. Parler d’antagonisme permet d’éviter de parler d’ennemi, déplacer le terrain de l’affrontement, trahir moins la complexité de la situation politique dans laquelle nous sommes embourbé·es.

7. À la souveraineté contractuelle s’oppose le principe de « jurisgenerativité » sous-commune
Dans leurs travaux précédents, Motent et Harney avaient forgé une formule devenue célèbre pour décrire la dimension informelle : « les sous-communs » (undercommons). Cette formule dialoguait explicitement avec le concept de communs devenu si central dans les mouvements politiques et écologistes contemporains pour en rejeter une certaine racine contractualiste et économiciste : « L’idée des communs comme un ensemble de ressources et de relations que nous (qui sommes par ailleurs exploité·es et exproprié·es) construisons ou protégeons, gérons ou exploitons » (p. 218). Si le commun demeure une perspective fondée sur des catégories politiques classiques comme l’individu ou la contractualisation, le sous-commun y échappe farouchement : « Être sous-commun·e, c’est vivre de manière incomplète au service d’une incomplétude partagée, qui reconnaît et insiste sur la condition inopérante de l’individu et de la nation, alors que ces fantasmes brutaux et insoutenables, avec tous les effets matériels qu’ils génèrent, oscillent dans l’intervalle toujours plus court entre le libéralisme et le fascisme. Ces formes inopérantes tentent toujours d’opérer à travers nous » (p. 218).
Dans les sous-communs s’exprime ce que Moten et Harney appellent une « force jurisgénératrice » (p. 89), aux antipodes des régulations du « contrat antisocial » (selon leur jeu de mot). Ils défendent par ce concept de « jurisgenerativité » la capacité de produire des formes de vie collective par le bas et dans le partage, au lieu d’être gouverné·es par une souveraineté transcendante (ne serait-ce que celle d’un individu maître qui négocie avec un autre individu maître). Le simple fait de traverser ou habiter ensemble un certain espace public d’une certaine façon (par exemple dans le cadre d’une socialité afro-américaine) peut être appréhendé comme un moment « jurisgénératif » : « la vie noire, qui (con)sent à ne pas être seule en son irréductible socialité, est prise en flagrant délit de marcher – avec toute sa fécondité jurisgénératrice – au milieu de la rue » (p. 84)25. La théorie d’All Incomplete exprime, en ce sens, un anarchisme qui ne croit ni à la souveraineté de l’État ni à celle du sujet individuel. Et sa façon de ne pas y croire n’est pas la même, bien entendu, que cette logistique qui déborde sans cesse états et individus.
8. Le monde de la logistique s’empare de la terre
Qu’est que génère la logistique ? Un monde, essentiellement. Et ce monde infrastructuré par le capitalisme logistique se sert d’une façon extractive de la vie terrestre. À ce dernier élément se rattache la puissance de l’informalité qu’on a mentionné : « l’informalité terreuse de la vie » (p. 204), ou pour le dire autrement « la capacité résidente de vivre sur la terre » (p. 101). Par ces figures conceptuelles (monde/terre), le discours de Fred Moten et Stefano Harney exprime philosophiquement le fondement écologique sous-jacent à sa critique du capitalisme logistique qui, en ce sens, est appréhendé comme une saisie de la terre, comme un effort de la piéger et de la posséder : « Le mouvement de la terre doit être interrompu, contenu, ou affaibli ; ou alors, il faudrait pouvoir y avoir accès. Les terreux·ses doivent devenir clair·es et transparent·es, responsables et productif·ves, unifié·es dans la séparation » (p. 206).
L’appel à « tout bloquer » du 10 septembre 2025 exprimait la conscience de cette promesse de puissance qui vient de la soustraction aux injonctions du flux socio-économique du « capitalisme logistique ».
« Qu’est que ça fait d’être un problème dans la chaine d’approvisionnement de quelqu’un ? » se demandent les deux auteurs au milieu du livre. La question est bonne et complexe. Cela peut faire mal, si le quelqu’un en question décide de se débarrasser avec violence des entraves à la fluidité de sa productivité et de son progrès : de la violence sournoise d’un harcèlement administratif pour cellui qui chôme, jusqu’à la violence furieuse de l’expulsion policière d’une ZAD qui empêche le trafic aérien de s’améliorer par l’installation d’un nouvel aéroport. Le décret Sicurezza du gouvernement Meloni – par exemple – a récemment alourdi la criminalisation d’actions non-violentes propres au mouvement du soi-disant « terrorisme climatique » comme le délit d’obstruction du trafic routier ou ferroviaire26. Mais cela peut faire du bien, également, lorsque l’interruption de cette chaîne d’approvisionnement constitue un levier de mobilisation collective qui pèse dans le rapport de force contre des pouvoirs publics et privés qui soutiennent les projets les plus déchainés du capitalisme logistique. Le problème de quelqu’un peut ainsi devenir la puissance de quelqu’un d’autre. L’appel à « tout bloquer » du 10 septembre 2025 exprimait – ne serait-ce que d’une façon instinctive – la conscience de cette promesse de puissance qui vient de la soustraction aux injonctions du flux socio-économique nommé par Moten et Harney « capitalisme logistique ». Une lecture d’All Incomplete ne peut qu’approfondir et élargir la résonance de cet appel qui demeure suspendu à une mobilisation inachevée.
Image d’accueil : Pedro Farto sur Unsplash.

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
Notes
- Cedric Robinson, Marxisme noir. La genèse de la tradition radicale noire, Genève, Entremonde, 2023. Des auteurs comme Norman Ajari (Noirceur : race, genre, classe et pessimisme dans la pensée africaine-américaine au XXIe siècle, Paris, Divergences, 2022) ont récemment contribué à diffuser cette culture théorique et politique.
- Anna Tsing, « Supply Chains and the Human Condition », Rethinking Marxism, 2009, n° 21, p. 148–176.
- En réalité plus compliquée que ce qui nous donne à entendre cette traduction en langue moderne de physis kruptesthai philei.
- L’expression est de Jason W. Moore dans L’écologie-monde du capitalisme. Comprendre et combattre la crise environnementale, Paris, Amsterdam éditions, 2024.
- La veine « collapsologue » de la pensée écologiste contemporaine – de Pablo Servigne à Jean-Marc Jancovici – s’est construite autour de cette conscience en la poussant jusqu’à ses frontières les plus inquiétantes et radicales.
- Voir à ce sujet : Breit Neilson, « Five theses on understanding logistics as power », Distinktion : Scandinavian Journal of Social Theory, Vol. 13/3, 2012, p. 323–340.
- Gwenola Wagon, Planète B, Cognac, 369, 2022, p. 59.
- Voir : Yves Citton, Médiarchie, Paris, Seuil, 2017.
- Sur ce champ d’études, voir par exemple le numéro monographique de revue : Edwards, Paul N. et al. (dir.) “Special Issue on e-Infrastructure”, Journal of the Association for Information, 10/5, 2009.
- Keller Esterling, Extrastatecraft. The Power of Infrastructure Space, Londres, Verso, 2014.
- Jamie Allen, Infrastructures critiques, Dijon/Paris, Presses du Réel / Artec, 2024, p. 39.
- Pour un aperçu des œuvres cartographiques critiques du collectif voir : https://bureaudetudes.org/
- Nous pensons en particulier au travail d’enquête mené sur des outils emblématiques de notre univers technologiques quotidien comme l’imprimante ou la trottinette électrique : https://www.raffard-roussel.com/fr
- Voir en particulier le film World brain (2015) : https://d-w.fr/en/projects/world-brain/
- Voir aussi les propositions de collectifs comme Limites Numériques (https://limitesnumeriques.fr/) ou d’artistes comme Mario Santamaria (https://www.mariosantamaria.net/).
- Voir le chapitre « Au-delà du dévoilement médial » dans Infrastructures critiques, op. cit.
- Fanny Lopez, A bout de Flux, Paris, Divergences, 2022, p. 13.
- Voir les textes cités dans l’ouvrage : Theodore Harris & Amiri Baraka, Our Flesh of Flames, Anvil Arts Press, 2008 ; R. A. Judy, Sentient Flesh Thinking in Disorder Poiesis in Black, Durham, Duke University Press, 2020.
- Voir par exemple les travaux emblématiques du collectif bolognais Into the black box : https://www.intotheblackbox.com/
- Jamie Allen, « Infrastructural Unrest », 2021 (document pdf).
- La juriste Sara Vanuxem analyse finement les paradoxes et les complications des libertés de déplacement et circulation dans son dernier livre : Du droit de déambuler, Marseille, Éditions Wildproject, 2025
- Emma Bigé, Mouvementements. Écopolitiques de la danse, Paris, La Découverte, 2023.
- Sur le lien entre cette mutation et le capitalisme de plateforme contemporain, voir : Nick Snircek, Le capitalisme de plateforme. L’hégémonie de l’économie numérique, Montréal, Lux, 2018.
- On pourrait considérer la nécessité de démantèlement prônée par certains penseurs contemporains (notamment les auteurs de : Héritage et fermeture. Une écologie du démantèlement, Paris, Divergences, 2021) comme un renversement de cette injonction à l’amélioration et au progrès.
- Certains penseurs noirs critiquent ces positions, les considérant comme excessivement optimistes ou compromises : Norman Ajari, « Chair en miettes. Pessimisme, optimisme et tradition radicale noire », Multitudes, n° 89, 2022, p. 149-157.
- Voir le résumé de Vert à ce propos : https://vert.eco/articles/prison-ferme-expulsion-des-squats-litalie-de-giorgia-meloni-sur-le-point-dadopter-une-loi-securite-qui-cible-les-ecologistes
L’article Logique du capitalisme logistique, de la plantation à l’entrepôt est apparu en premier sur Terrestres.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Time [Fr]
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- L'Autre Quotidien
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- Gauche.Media
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
