
13.02.2026 à 14:05
« Tous les transports publics du quotidien devraient être gratuits »
Lire plus (89 mots)
Patrick Le Moal, représentant de l’Union pour la gratuité et le développement des transports (UGDT), est l’invité de #LaMidinale.
13.02.2026 à 12:04
Démission de Francesca Albanese : la trumpisation du Quai d’Orsay
Texte intégral (1452 mots)
Un montage vidéo mensonger de la rapporteuse spéciale de l’ONU pour les territoires palestiniens, et voilà la France qui exige sa démission ? For sure !
Qu’il semble loin ce mois de septembre 2025 où Emmanuel Macron reconnaissait, à la tribune des Nations unies, l’État palestinien. Le geste n’était pas qu’un symbole. Il pouvait ouvrir une brèche diplomatique. Mais à force de reculer d’un pas après chaque avancée, à force de s’excuser presque d’avoir osé un geste de droit, ce « en même temps » se transforme en mauvaise conscience permanente. Le problème de ce gouvernement n’est pas tant qu’il fasse un pas – c’est qu’il passe son temps à le neutraliser.
TOUS LES JOURS, RETROUVEZ L’ESSENTIEL DE L’ACTU POLITIQUE DANS NOTRE NEWSLETTER
Or voilà qu’en ce mercredi, le ministre des affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, appelle à la démission de la rapporteuse spéciale de l’ONU pour les territoires palestiniens, Francesca Albanese. Et la France exigera officiellement cette démission le 23 février, lors de la session du Conseil des droits de l’homme des Nations unies. Une décision grave : on ne s’en prend pas impunément à une représentante mandatée par l’ONU.
Qui est donc Francesca Albanese ? Juriste italienne spécialisée en droit international, experte reconnue des droits humains, elle est depuis 2022 rapporteuse spéciale des Nations unies sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens occupés. Son mandat consiste à documenter les violations du droit international, quelles qu’elles soient. Elle est soutenue par de nombreuses ONG et universitaires pour la rigueur de ses rapports ; elle est également violemment attaquée pour la clarté de ses mots. Parce qu’elle nomme les choses. Parce qu’elle rappelle que l’occupation est illégale. Parce qu’elle parle de crimes de guerre lorsque les faits l’y conduisent. Parce qu’au fond, elle dit le droit international.
Qu’a-t-elle donc raconté pour recevoir les foudres du Quai d’Orsay ? Rien d’autre que son travail minutieux exige : « Le fait qu’au lieu d’arrêter Israël, la plupart des pays du monde l’ont armé, lui fournissant des excuses politiques, un appui politique, un soutien financier et économique, c’est un défi. Le fait que la plupart des médias dans le monde occidental amplifient le discours pro-apartheid, le narratif génocidaire, c’est un défi. Et en même temps c’est aussi une opportunité. Car si le droit international a été poignardé en plein cœur, il est également vrai que jamais auparavant la communauté internationale n’a connu les défis auxquels nous sommes tous confrontés, nous qui ne contrôlons pas d’importants capitaux financiers, ni d’algorithme, ni d’armes. Nous voyons maintenant que l’humanité a un ennemi commun, et que le respect des libertés fondamentales est la dernière voie pacifique, le dernier outil pacifique dont nous disposons pour recouvrer notre liberté. »
À l’heure de la désinformation généralisée, nous pensions que la Macronie avait fait de la lutte contre les fake news une priorité. La voilà qui s’appuie sur une fake news pour attaquer une représentante des Nations unies.
Mais ces déclarations, Jean-Noël Barrot ne les a pas entendues. Pour appeler à la démission de Francesca Albanese, il se base sur un montage vidéo diffusée par la députée Renaissance Caroline Yadan, où les propos sont déformés et tronqués pour lui faire dire qu’Israël serait « l’ennemi commun de l’humanité ». In fine, 53 députés macronistes se sont associés à la demande de démission de la rapporteuse onusienne. 53. Ce n’est plus un dérapage isolé, c’est une ligne politique.
Il faut rappeler que Caroline Yadan est notamment à l’origine d’une proposition de loi visant à assimiler l’antisémitisme à toute critique de la politique de l’État d’Israël – une confusion grave. Depuis des mois, elle mène campagne pour faire taire toute voix critique, jusqu’au sein des institutions internationales.
Mais cette fois, elle est suivie dans sa cabale par le parti présidentiel ainsi que par le gouvernement. Jean-Noël Barrot devient alors plus royaliste que le roi. Il justifie sa demande par « une longue liste de prises de position scandaleuses », accusant Francesca Albanese d’avoir justifié le 7-Octobre, évoqué un « lobby juif », comparé Israël au IIIème Reich. Des accusations extrêmement graves. Fondées sur des montages et des déformations. Rien qui ne résiste à l’examen des textes et des interventions complètes. L’association Juristes pour le respect du droit international a d’ailleurs saisi la justice pour « diffusion de fausses nouvelles ».
Nous assistons à une trumpisation assumée : décrédibiliser les institutions internationales, attaquer les mécanismes de contrôle, personnaliser la vindicte. Comme Donald Trump, on s’en prend à l’ONU quand elle dérange.
À l’heure de la désinformation généralisée, nous pensions que la Macronie avait fait de la lutte contre les fake news une priorité. La voilà qui s’appuie sur une fake news pour attaquer une représentante des Nations unies. Mieux : le porte-parole du Quai d’Orsay reconnaît que toute cette affaire s’appuie sur une fake news mais que le ministère demande tout de même à l’ONU la suspension de Francesca Albanese pour son « absence de neutralité » et son « militantisme » !
Nous assistons à une trumpisation assumée : décrédibiliser les institutions internationales, attaquer les mécanismes de contrôle, personnaliser la vindicte. Comme Donald Trump, on s’en prend à l’ONU quand elle dérange. Et puisque tout le monde tape sur l’ONU, pourquoi pas la France ?
Avec une telle attitude, la France peut bien refuser de siéger au « conseil de paix » de Donald Trump : en quoi son action serait-elle plus respectueuse du droit international ? S’en prendre à une rapporteuse indépendante parce qu’elle documente des violations massives, c’est affaiblir encore un peu plus l’architecture fragile du droit international.
Pendant ce temps, les chiffres restent. Depuis le 7 octobre 2023 :
- 71 824 personnes ont été tuées à Gaza [depuis le 7 octobre 2023], dont 21 298 enfants ;
- en Cisjordanie, plus de 1030 personnes ont été tuées, dont 239 enfants ;
- depuis le cessez-le-feu, un enfant est tué chaque jour à Gaza.
Mais la priorité du ministre semble être le non-boycott de l’Eurovision et la mise au pas d’une experte de l’ONU.
« C’est donc ça, un pays qui se tient aux côtés d’un peuple opprimé », écrivions-nous fin janvier à propos de la mobilisation de la Catalogne. La France, elle, choisit l’antithèse : reconnaître un État palestinien d’une main, délégitimer celles et ceux qui documentent son écrasement de l’autre.
S’il y a une démission que les macronistes devraient exiger, ce n’est pas celle de Francesca Albanese. C’est celle de Caroline Yadan de leur groupe parlementaire – pour avoir fait de la manipulation un instrument diplomatique.
13.02.2026 à 12:01
🔴 SUCCESSION DU JOUR
Lire plus (210 mots)
Marine Le Pen out, la droite reprend la boutique ?
Après dix ans de recours, le procès de Marine Le Pen touche à sa fin. Après les réquisitoires de lundi, tout le monde s’attend à une condamnation qui l’empêchera de se présenter et de faire campagne. À droite, deux réactions dominent. Ceux qui maintiennent leur inquiétude de voir la gauche se qualifier au second tour face, probablement, à Jordan Bardella. Ceux-là veulent une primaire. Ils s’appellent Darmanin, Barnier ou Wauquiez. Et il y a ceux qui pensent que Jordan Bardella ne peut convaincre et voit une opportunité soit pour gagner face à lui (Attal et Philippe), soit pour lui chiper sa place (Retailleau). Ceux-ci récusent la primaire et se lancent dans la course. Bruno Retailleau déclare sa candidature en reprenant les thèmes de droite (l’ordre) mais aussi d’extrême droite (anti-immigration, réforme de la justice, etc.). Ses idées lui sont propres ? Pas du tout, on les trouve toutes dans le programme du RN. Mais Bruno Retailleau se croit plus crédible pour les mettre en œuvre.
13.02.2026 à 11:47
Démission de Francesca Albanese : la trumpisation du Quai d’Orsay
Texte intégral (2442 mots)
Un montage vidéo mensonger de la rapporteuse spéciale de l’ONU pour les territoires palestiniens, et voilà la France qui exige sa démission ? For sure !
par Loïc Le Clerc
Qu’il semble loin ce mois de septembre 2025 où Emmanuel Macron reconnaissait, à la tribune des Nations unies, l’État palestinien. Le geste n’était pas qu’un symbole. Il pouvait ouvrir une brèche diplomatique. Mais à force de reculer d’un pas après chaque avancée, à force de s’excuser presque d’avoir osé un geste de droit, ce « en même temps » se transforme en mauvaise conscience permanente. Le problème de ce gouvernement n’est pas tant qu’il fasse un pas – c’est qu’il passe son temps à le neutraliser.
Or voilà qu’en ce mercredi, le ministre des affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, appelle à la démission de la rapporteuse spéciale de l’ONU pour les territoires palestiniens, Francesca Albanese. Et la France exigera officiellement cette démission le 23 février, lors de la session du Conseil des droits de l’homme des Nations unies. Une décision grave : on ne s’en prend pas impunément à une représentante mandatée par l’ONU.
Qui est donc Francesca Albanese ? Juriste italienne spécialisée en droit international, experte reconnue des droits humains, elle est depuis 2022 rapporteuse spéciale des Nations unies sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens occupés. Son mandat consiste à documenter les violations du droit international, quelles qu’elles soient. Elle est soutenue par de nombreuses ONG et universitaires pour la rigueur de ses rapports ; elle est également violemment attaquée pour la clarté de ses mots. Parce qu’elle nomme les choses. Parce qu’elle rappelle que l’occupation est illégale. Parce qu’elle parle de crimes de guerre lorsque les faits l’y conduisent. Parce qu’au fond, elle dit le droit international.
Qu’a-t-elle donc raconté pour recevoir les foudres du Quai d’Orsay ? Rien d’autre que son travail minutieux exige : « Le fait qu’au lieu d’arrêter Israël, la plupart des pays du monde l’ont armé, lui fournissant des excuses politiques, un appui politique, un soutien financier et économique, c’est un défi. Le fait que la plupart des médias dans le monde occidental amplifient le discours pro-apartheid, le narratif génocidaire, c’est un défi. Et en même temps c’est aussi une opportunité. Car si le droit international a été poignardé en plein cœur, il est également vrai que jamais auparavant la communauté internationale n’a connu les défis auxquels nous sommes tous confrontés, nous qui ne contrôlons pas d’importants capitaux financiers, ni d’algorithme, ni d’armes. Nous voyons maintenant que l’humanité a un ennemi commun, et que le respect des libertés fondamentales est la dernière voie pacifique, le dernier outil pacifique dont nous disposons pour recouvrer notre liberté. »
Mais ces déclarations, Jean-Noël Barrot ne les a pas entendues. Pour appeler à la démission de Francesca Albanese, il se base sur un montage vidéo diffusée par la députée Renaissance Caroline Yadan, où les propos sont déformés et tronqués pour lui faire dire qu’Israël serait « l’ennemi commun de l’humanité ». In fine, 53 députés macronistes se sont associés à la demande de démission de la rapporteuse onusienne. 53. Ce n’est plus un dérapage isolé, c’est une ligne politique.
Il faut rappeler que Caroline Yadan est notamment à l’origine d’une proposition de loi visant à assimiler l’antisémitisme à toute critique de la politique de l’État d’Israël – une confusion grave. Depuis des mois, elle mène campagne pour faire taire toute voix critique, jusqu’au sein des institutions internationales.
Mais cette fois, elle est suivie dans sa cabale par le parti présidentiel ainsi que par le gouvernement. Jean-Noël Barrot devient alors plus royaliste que le roi. Il justifie sa demande par « une longue liste de prises de position scandaleuses », accusant Francesca Albanese d’avoir justifié le 7-Octobre, évoqué un « lobby juif », comparé Israël au IIIème Reich. Des accusations extrêmement graves. Fondées sur des montages et des déformations. Rien qui ne résiste à l’examen des textes et des interventions complètes. L’association Juristes pour le respect du droit international a d’ailleurs saisi la justice pour « diffusion de fausses nouvelles ».
À l’heure de la désinformation généralisée, nous pensions que la Macronie avait fait de la lutte contre les fake news une priorité. La voilà qui s’appuie sur une fake news pour attaquer une représentante des Nations unies. Mieux : le porte-parole du Quai d’Orsay reconnaît que toute cette affaire s’appuie sur une fake news mais que le ministère demande tout de même à l’ONU la suspension de Francesca Albanese pour son « absence de neutralité » et son « militantisme » !
Nous assistons à une trumpisation assumée : décrédibiliser les institutions internationales, attaquer les mécanismes de contrôle, personnaliser la vindicte. Comme Donald Trump, on s’en prend à l’ONU quand elle dérange. Et puisque tout le monde tape sur l’ONU, pourquoi pas la France ?
Avec une telle attitude, la France peut bien refuser de siéger au « conseil de paix » de Donald Trump : en quoi son action serait-elle plus respectueuse du droit international ? S’en prendre à une rapporteuse indépendante parce qu’elle documente des violations massives, c’est affaiblir encore un peu plus l’architecture fragile du droit international.
Pendant ce temps, les chiffres restent. Depuis le 7 octobre 2023 :
- 71 824 personnes ont été tuées à Gaza [depuis le 7 octobre 2023], dont 21 298 enfants ;
- en Cisjordanie, plus de 1030 personnes ont été tuées, dont 239 enfants ;
- depuis le cessez-le-feu, un enfant est tué chaque jour à Gaza.
Mais la priorité du ministre semble être le non-boycott de l’Eurovision et la mise au pas d’une experte de l’ONU.
« C’est donc ça, un pays qui se tient aux côtés d’un peuple opprimé », écrivions-nous fin janvier à propos de la mobilisation de la Catalogne. La France, elle, choisit l’antithèse : reconnaître un État palestinien d’une main, délégitimer celles et ceux qui documentent son écrasement de l’autre.
S’il y a une démission que les macronistes devraient exiger, ce n’est pas celle de Francesca Albanese. C’est celle de Caroline Yadan de leur groupe parlementaire – pour avoir fait de la manipulation un instrument diplomatique.
 SUCCESSION DU JOUR
SUCCESSION DU JOUR
Marine Le Pen out, la droite reprend la boutique ?

Après dix ans de recours, le procès de Marine Le Pen touche à sa fin. Après les réquisitoires de lundi, tout le monde s’attend à une condamnation qui l’empêchera de se présenter et de faire campagne. À droite, deux réactions dominent. Ceux qui maintiennent leur inquiétude de voir la gauche se qualifier au second tour face, probablement, à Jordan Bardella. Ceux-là veulent une primaire. Ils s’appellent Darmanin, Barnier ou Wauquiez. Le président des députés LR précise : une primaire de Gabriel Attal à Éric Zemmour. Il veut une alliance de toutes les droites jusqu’aux extrêmes contre le RN. Et il y a ceux qui pensent que Jordan Bardella ne peut convaincre et voit une opportunité soit pour gagner face à lui (Attal et Philippe), soit pour lui chiper sa place (Retailleau). Ceux-ci récusent la primaire et se lancent dans la course. Bruno Retailleau déclare sa candidature en reprenant les thèmes de droite (l’ordre) mais aussi d’extrême droite (anti-immigration, réforme de la justice, etc.). Il se veut précis et annonce faire des référendums anticonstitutionnels pour stopper l’immigration et pour durcir la justice. Il assure aussi que, malgré la signature de la France, les traités internationaux ne primeront plus sur le droit national. Idem pour le droit européen. Il veut s’attaquer à ceux qui « profitent » du système de protection sociale. Ces idées lui sont propres ? Pas du tout, on les trouve toutes dans le programme du RN. Mais Bruno Retailleau se croit plus crédible pour les mettre en œuvre. Il a le soutien d’un méritant, François Fillon.
C.T.
ON VOUS RECOMMANDE…

L’entretien de Gisèle Pelicot dans « La grande librairie ». Gisèle Pelicot, tout le monde connaît son histoire, son courage, sa coupe au carré, sa silhouette fine et son nez en trompette. Mais sa voix, on ne la connaît pas. En quatre mois de procès, elle n’a parlé que quatre minutes à la presse. Voilà donc que dans l’émission d’Augustin Trapenard, on la découvre, cette voix, déterminée mais douce, et ses gestes, empreints de sagesse et de calme. Gisèle Pelicot s’exprime pendant plus d’une heure. Elle raconte comment elle revient à la vie, comment elle retrouve la joie de vivre. Une voix essentielle.
C’EST CADEAU 


L’astronaute Sophie Adenot a décollé pour la station spatiale internationale ce vendredi. Agée de 43 ans, elle est la deuxième Française de l’Histoire à effectuer un vol dans l’espace, après la pionnière Claudie Haigneré en 1996.
ÇA SE PASSE SUR REGARDS.FR
Pour recevoir cette newsletter quotidiennement (et gratuitement) dans votre boîte mail, suivez le lien : regards.fr/newsletter !
12.02.2026 à 12:51
« Dans l’horreur du génocide à Gaza et de la répression en France, il reste un horizon »
Lire plus (88 mots)
Omar Alsoumi, auteur de Enfant de Palestine aux éditions Les Liens qui Libèrent, est l’invité de #LaMidinale.
12.02.2026 à 12:26
L’UE est mortelle : la preuve
Texte intégral (1293 mots)
Sous couvert de compétitivité, l’UE débat de son avenir. Protectionnisme ou libre-échange, investissements et emprunts communs ou discipline budgétaire : les lignes de fracture sont profondes et le social toujours oublié.
Ce jeudi, les dirigeants des 27 pays de l’UE se retrouvent pour une journée de travail avant un sommet officiel prévu mi-mars. Ordre du jour : comment développer la compétitivité européenne.
TOUS LES JOURS, RETROUVEZ L’ESSENTIEL DE L’ACTU POLITIQUE DANS NOTRE NEWSLETTER
Loin d’être une réunion technique sur la politique économique et industrielle, c’est bien le devenir de l’UE – ses objectifs et son architecture – qui est dans toutes les têtes. Les désaccords sur la conduite à tenir face aux États-Unis et à la Chine ont éprouvé l’unité des 27.
Dans une interview à un groupe de journaux européens, Emmanuel Macron développe sa vision. Elle se veut offensive face aux deux grandes puissances. Pour le président, il faut emprunter en commun au niveau européen et massivement – 1200 milliards par an – pour investir dans les industries de la défense, de la transition énergétique (les batteries, la décarbonation notamment de l’acier, plan hydrogène, le nucléaire), dans l’IA et dans les calculateurs quantiques. « Dans un moment de course à l’investissement technologique, c’est une faute profonde que de ne pas utiliser cette capacité d’endettement », dit-il. Emmanuel Macron prône également une dose de protectionnisme et la préférence européenne.
Les « coalitions des volontaires » initiées pour l’Ukraine, proposées par l’Espagne pour le numérique, esquissent une architecture toute nouvelle de l’UE, plus souple, plus réactive. Ne porte-t-elle pas en germe une Europe à plusieurs vitesses et peut-être même l’éclatement de l’Union ? Emmanuel Macron l’entrevoit.
Pour le chancelier allemand Friedrich Merz, ces propositions ne sont pas recevables. Pas question d’emprunter, pas question de protéger l’industrie européenne : le libre-échange et les accords type Mercosur restent sa perspective. La priorité est dans l’amélioration de la productivité. Cela passe par « les réformes structurelles profondes et l’achèvement du marché intérieur ». Le Monde nous apprend que « le chancelier Friedrich Merz a négocié en amont avec Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, une feuille de route qui présente des pistes communes ».
De son côté, Pedro Sanchez, le premier ministre socialiste espagnol, a saisi l’occasion d’un déplacement à Dubaï pour afficher sa détermination : « L’Espagne passe des paroles aux actes » et le sujet sur lequel il entend exercer le pouvoir politique est celui du numérique. Il propose une « coalition des volontaires » pour reprendre le contrôle face aux Gafam.
Enfin, Ursula von der Leyen invite les États à se réunir par groupes d’intérêts, neuf au minimum, pour rester conforme aux traités européens.
En résumé, plusieurs débats se profilent.
Le premier porte sur l’analyse des faiblesses de l’Europe, débat ouvert par le rapport Draghi il y a 18 mois et dont nous rendions compte ici et là. Le diagnostic d’un décrochage de compétitivité ne fait pas entièrement consensus. Et ses raisons encore moins. Mais pour la retrouver, tous veulent simplifier, débureaucratiser, alléger les normes. Les lois européennes dites « omnibus » le traduisent : il s’agit de dérégulation massive avec un abaissement de normes sociales, environnementales, fiscales… Pour Emmanuel Macron, il faut donc également investir dans les technologies du futur. Pour Giorgia Meloni et Friedrich Merz, il faut abaisser les coûts de production. Pour ces derniers, pas question de recourir à des emprunts européens. Le président français élude les désaccords entre pays européens, non seulement sur la question de l’emprunt mais aussi sur le choix des projets européens. Ce qui pourtant mériterait débat.
On se demandera pourquoi la recherche médicale et la pharmacie ou encore l’espace ne font pas partie des axes d’investissement, alors même que la France y a des atouts… Pour l’IA, l’enjeu est peut-être moins celui de son financement que d’un pilotage des finalités : l’IA, pourquoi pas, mais pour quoi faire ? La question des finalités de l’Europe et donc du projet européen est reposée. Significativement, Emmanuel Macron rappelle qu’« on s’était réunis pour ne plus faire la guerre » mais ne parle plus que de défense militaire. Pedro Sanchez, lui, maintient la centralité de la paix.
Le second débat qui s’amorce est celui de l’organisation de l’Europe. Les « coalitions des volontaires » initiées pour l’Ukraine, proposées par l’Espagne pour le numérique, esquissent une architecture toute nouvelle de l’UE, plus souple, plus réactive. Ne porte-t-elle pas en germe une Europe à plusieurs vitesses et peut-être même l’éclatement de l’Union ? Emmanuel Macron l’entrevoit. Sa réponse passerait par une nouvelle répartition des compétences : le social serait renvoyé aux États, privés des leviers décisifs, tandis que la « stratégie », telle qu’il la conçoit (et dont il exclut le développement humain et les politiques sociales), serait consacrée à l’échelle européenne : « Les budgets nationaux sont contraints par notre capacité à adapter nos modèles sociaux au vieillissement de notre démographie ». Il ajoute que « cet investissement, si on veut qu’il préserve le marché intérieur, qu’il ne le fragmente pas un peu plus, il ne faut pas le renvoyer aux nations. Ce doit être un investissement conjoint. » Avec cette vision, c’est toute l’architecture de l’Union européenne, son rôle par rapport aux États et l’insuffisance démocratique de ses institutions et de son fonctionnement qui en serait aggravée. Si Emmanuel Macron devait être suivi, la place du choix politique dans les différents pays serait réduite à bien peu.
Dans ce débat, une chose au moins paraît sûre. Dans un monde d’empires rivaux, de politiques de puissance et de prédation, l’Europe se détruira si elle renonce toujours plus à porter les différences sur lesquelles elle s’est, pour une part, reconstruite après-guerre et qui l’ont rendue attractive : ses droits sociaux, son modèle social, ses services publics. Et plus récemment la prise en compte des enjeux du climat et de la biodiversité.
Les débats qui s’engagent entre les dirigeants européens seront décisifs pour le futur. Ils doivent être beaucoup plus largement partagés et discutés.
12.02.2026 à 12:22
L’UE est mortelle : la preuve
Texte intégral (2237 mots)
Sous couvert de compétitivité, l’UE débat de son avenir. Protectionnisme ou libre-échange, investissements et emprunts communs ou discipline budgétaire : les lignes de fracture sont profondes et le social toujours oublié.
par Catherine Tricot
Ce jeudi, les dirigeants des 27 pays de l’UE se retrouvent pour une journée de travail avant un sommet officiel prévu mi-mars. Ordre du jour : comment développer la compétitivité européenne.
Loin d’être une réunion technique sur la politique économique et industrielle, c’est bien le devenir de l’UE – ses objectifs et son architecture – qui est dans toutes les têtes. Les désaccords sur la conduite à tenir face aux États-Unis et à la Chine ont éprouvé l’unité des 27.
Dans une interview à un groupe de journaux européens, Emmanuel Macron développe sa vision. Elle se veut offensive face aux deux grandes puissances. Pour le président, il faut emprunter en commun au niveau européen et massivement – 1200 milliards par an – pour investir dans les industries de la défense, de la transition énergétique (les batteries, la décarbonation notamment de l’acier, plan hydrogène, le nucléaire), dans l’IA et dans les calculateurs quantiques. « Dans un moment de course à l’investissement technologique, c’est une faute profonde que de ne pas utiliser cette capacité d’endettement », dit-il. Emmanuel Macron prône également une dose de protectionnisme et la préférence européenne.
Pour le chancelier allemand Friedrich Merz, ces propositions ne sont pas recevables. Pas question d’emprunter, pas question de protéger l’industrie européenne : le libre-échange et les accords type Mercosur restent sa perspective. La priorité est dans l’amélioration de la productivité. Cela passe par « les réformes structurelles profondes et l’achèvement du marché intérieur ». Le Monde nous apprend que « le chancelier Friedrich Merz a négocié en amont avec Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, une feuille de route qui présente des pistes communes ».
De son côté, Pedro Sanchez, le premier ministre socialiste espagnol, a saisi l’occasion d’un déplacement à Dubaï pour afficher sa détermination : « L’Espagne passe des paroles aux actes » et le sujet sur lequel il entend exercer le pouvoir politique est celui du numérique. Il propose une « coalition des volontaires » pour reprendre le contrôle face aux Gafam.
Enfin, Ursula von der Leyen invite les États à se réunir par groupes d’intérêts, neuf au minimum, pour rester conforme aux traités européens.
En résumé, plusieurs débats se profilent.
Le premier porte sur l’analyse des faiblesses de l’Europe, débat ouvert par le rapport Draghi il y a 18 mois et dont nous rendions compte ici et là. Le diagnostic d’un décrochage de compétitivité ne fait pas entièrement consensus. Et ses raisons encore moins. Mais pour la retrouver, tous veulent simplifier, débureaucratiser, alléger les normes. Les lois européennes dites « omnibus » le traduisent : il s’agit de dérégulation massive avec un abaissement de normes sociales, environnementales, fiscales… Pour Emmanuel Macron, il faut donc également investir dans les technologies du futur. Pour Giorgia Meloni et Friedrich Merz, il faut abaisser les coûts de production. Pour ces derniers, pas question de recourir à des emprunts européens. Le président français élude les désaccords entre pays européens, non seulement sur la question de l’emprunt mais aussi sur le choix des projets européens. Ce qui pourtant mériterait débat.
On se demandera pourquoi la recherche médicale et la pharmacie ou encore l’espace ne font pas partie des axes d’investissement, alors même que la France y a des atouts… Pour l’IA, l’enjeu est peut-être moins celui de son financement que d’un pilotage des finalités : l’IA, pourquoi pas, mais pour quoi faire ? La question des finalités de l’Europe et donc du projet européen est reposée. Significativement, Emmanuel Macron rappelle qu’« on s’était réunis pour ne plus faire la guerre » mais ne parle plus que de défense militaire. Pedro Sanchez, lui, maintient la centralité de la paix.
Le second débat qui s’amorce est celui de l’organisation de l’Europe. Les « coalitions des volontaires » initiées pour l’Ukraine, proposées par l’Espagne pour le numérique, esquissent une architecture toute nouvelle de l’UE, plus souple, plus réactive. Ne porte-t-elle pas en germe une Europe à plusieurs vitesses et peut-être même l’éclatement de l’Union ? Emmanuel Macron l’entrevoit. Sa réponse passerait par une nouvelle répartition des compétences : le social serait renvoyé aux États, privés des leviers décisifs, tandis que la « stratégie », telle qu’il la conçoit (et dont il exclut le développement humain et les politiques sociales), serait consacrée à l’échelle européenne : « Les budgets nationaux sont contraints par notre capacité à adapter nos modèles sociaux au vieillissement de notre démographie ». Il ajoute que « cet investissement, si on veut qu’il préserve le marché intérieur, qu’il ne le fragmente pas un peu plus, il ne faut pas le renvoyer aux nations. Ce doit être un investissement conjoint. » Avec cette vision, c’est toute l’architecture de l’Union européenne, son rôle par rapport aux États et l’insuffisance démocratique de ses institutions et de son fonctionnement qui en serait aggravée. Si Emmanuel Macron devait être suivi, la place du choix politique dans les différents pays serait réduite à bien peu.
Dans ce débat, une chose au moins paraît sûre. Dans un monde d’empires rivaux, de politiques de puissance et de prédation, l’Europe se détruira si elle renonce toujours plus à porter les différences sur lesquelles elle s’est, pour une part, reconstruite après-guerre et qui l’ont rendue attractive : ses droits sociaux, son modèle social, ses services publics. Et plus récemment la prise en compte des enjeux du climat et de la biodiversité.
Les débats qui s’engagent entre les dirigeants européens seront décisifs pour le futur. Ils doivent être beaucoup plus largement partagés et discutés.
 STRATÉGIE DU JOUR
STRATÉGIE DU JOUR
La division des partis aux municipales relancent l’hypothèse d’un « troisième tour »
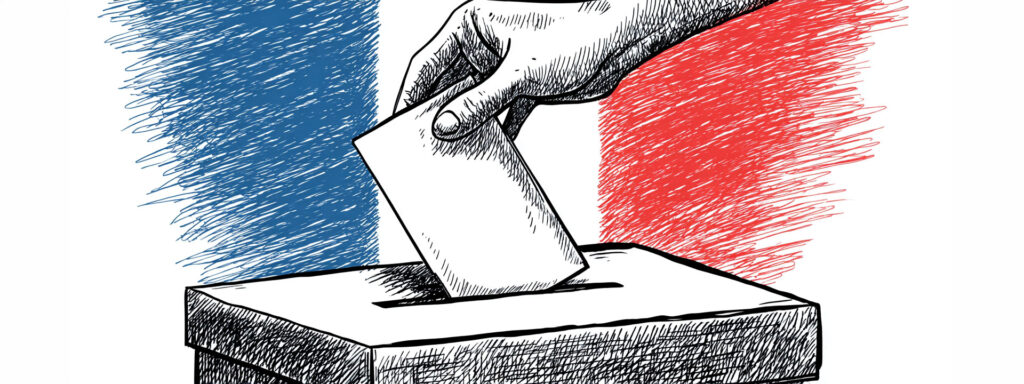
Dans les campagnes municipales en cours, beaucoup jurent aujourd’hui qu’aucune alliance ne verra le jour : ni entre LFI et le PS, ni entre LR et l’extrême droite. Mais les municipales ne se jouent pas seulement en deux tours, au moins à Paris, Lyon et Marseille depuis une loi votée en août dernier. Dans ces trois villes, la liste arrivée en tête au second tour bénéficie d’une prime de 25% des sièges (contre 50% pour le reste des communes françaises de plus de 1000 habitants). Le reste des sièges est réparti à la proportionnelle. Ce mécanisme est conçu pour dégager une majorité, même relative. Seulement, au vu des configurations très fragmentées, cette prime pourrait ne pas suffire à clarifier totalement le rapport de forces. Prenons l’exemple d’une liste en tête au deuxième tour avec 33% des voix : elle aurait 25% des sièges + 33% des 75% de sièges restants soit un total de 49,75% des sièges… en dessous de la majorité absolue. D’où l’hypothèse d’un « troisième tour » : non pas un nouveau vote populaire, mais l’élection du maire par le conseil municipal fraîchement élu, où les équilibres internes et d’éventuelles recompositions peuvent peser. Les intentions d’aujourd’hui résisteront-elles aux réalités arithmétiques du soir du premier, voire du second tour ? Rien n’est moins sûr.
P.P.-V.
ON VOUS RECOMMANDE…

« Iran 1988, l’opposition massacrée », sur France Culture. Ce « Cours de l’histoire » n’est pas optionnel. Alors que l’Iran semble entrer dans un nouveau cycle révolutionnaire, Xavier Mauduit et son invitée, Chowra Makaremi, une anthropologue et cinéaste iranienne, reviennent sur la chute du chah. Ils éclairent les enjeux géostratégiques d’alors, évoquent les différentes forces en présence et rappellent la puissance des partis de gauche, le rôle des intellectuels et des poètes. De formidables éclairages qui portent jusqu’à aujourd’hui.
C’EST CADEAU 


Sarah Knafo a été couronnée « révélation de l’année », ce mercredi, par la revue Le Trombinoscope, avec le partenariat des chaînes LCP et Public Sénat. On n’est plus au niveau de la dédiabolisation, ils mettent carrément l’extrême droite sur un piédestal. Ni Olivier Faure ni Fabien Gay, tous deux récompensés le même soir, n’ont sourcillé au moment de partager ce moment de gloriole avec une facho.
ÇA SE PASSE SUR REGARDS.FR
Pour recevoir cette newsletter quotidiennement (et gratuitement) dans votre boîte mail, suivez le lien : regards.fr/newsletter !
11.02.2026 à 10:34
Police municipale : doubler ou tripler les effectifs, est-ce encore un choix politique ?
Texte intégral (940 mots)
Comment rassurer et assurer la tranquillité publique sans se laisser entraîner dans l’imaginaire sécuritaire dominant ? C’est le dilemme de la gauche dans de nombreuses campagnes municipales.
C’était ce mardi sur le plateau de France Inter : face-à-face entre le maire de Marseille, le sortant socialiste Benoît Payan, et le candidat du Rassemblement national, Franck Allisio. Benjamin Duhamel résume : l’un veut doubler les effectifs de la police municipale, l’autre les tripler. Même logique pour la vidéosurveillance : augmentation contre augmentation.
TOUS LES JOURS, RETROUVEZ L’ESSENTIEL DE L’ACTU POLITIQUE DANS NOTRE NEWSLETTER
Difficile d’être maire. Difficile, surtout, d’ignorer une demande sociale puissante en matière de la tranquillité publique. Les habitants parlent d’incivilités, de trafics, de violences, d’abandon. Ils veulent des réponses concrètes. Et les maires, en première ligne, encaissent la pression.
Mais si la proposition de gauche consiste à augmenter moins vite que l’extrême droite les mêmes dispositifs, quelque chose cloche. Certes, Benoît Payan a raison, en fin de débat, de rappeler qu’il faut davantage de services publics. Il a raison de dire que l’insécurité est aussi sociale. Mais, venant après la promesse d’effectifs augmentés et de davantage de caméras, l’argument ressemble à un correctif, pas à une boussole.
Jusqu’à présent, Brest était la seule métropole française à faire de la résistance : 140 000 habitants et pas de police municipale. Son maire socialiste, François Cuillandre assumait son choix politique : la sécurité est une mission régalienne de l’État. La ville avait néanmoins créé une brigade de tranquillité urbaine : 20 agents, toujours à pied, non armés, dont la mission est d’éteindre les conflits à la naissance, de dialoguer, d’orienter, de faire remonter les informations et, si nécessaire, d’appeler le 17. La droite locale réclamait une « vraie » police municipale armée et un réseau de caméras. Mais la ligne du maire a changé : il promet désormais la création de 50 postes de policiers municipaux s’il est réélu.
Au-delà des effectifs et des caméras, une autre question mérite pourtant d’être posée : celle de la formation. Les policiers municipaux, en particulier lorsqu’ils sont armés, ne bénéficient pas du même niveau ni du même volume de formation que les policiers nationaux… qui en manque déjà trop souvent. Étendre les pouvoirs coercitifs – voire létaux – de forces moins formées pose donc un problème démocratique et professionnel qu’il serait imprudent d’ignorer.
La tension sur la police municipale traverse toute la gauche, jusqu’à La France insoumise. Elle porte, dans ses textes, une critique de l’armement et de l’extension des polices municipales. Mais sur le terrain, la position s’adapte, surtout quand la possibilité de gagner rend tout plus concret : en juillet 2025, David Guiraud, candidat LFI à Roubaix, avait assumé ne pas vouloir désarmer la police municipale s’il devenait maire.
Aujourd’hui, la demande d’ordre structure le débat public. Résister à la réponse par la police et le contrôle de l’espace public par caméra (ou par drones) sans paraître indifférent aux inquiétudes populaires exige un travail de conviction de long terme. On peut donc comprendre les maires qui rencontrent les habitants chaque jour : ils savent que l’abstraction doctrinale pèse peu face à une cage d’escalier squattée ou à un point de deal installé sous les fenêtres. Ils savent aussi que les finances sont contraintes, que l’État délègue sans compenser, que les responsabilités pénales et politiques s’alourdissent.
Mais une question demeure : quelle est la singularité de la gauche municipale si elle s’inscrit dans la même trajectoire que l’extrême droite, en version plus modérée ? Multiplier les caméras, augmenter les effectifs, élargir les prérogatives : est-ce une réponse transitoire en attendant mieux, ou l’installation durable d’un nouveau modèle de gestion urbaine ?
La tranquillité publique n’est pas un slogan. Elle suppose de la présence humaine, de la médiation, des services publics ouverts, des éducateurs, des travailleurs sociaux, des écoles soutenues, des équipements culturels vivants. Elle suppose aussi, évidemment, une police nationale dotée de moyens suffisants et contrôlée démocratiquement. Mais l’équilibre entre prévention, présence sociale et coercition ne se décrète pas au détour d’un débat télévisé. Plutôt que de compter les brigades et les caméras, la gauche gagnerait à formuler une vision cohérente : comment assure-t-on concrètement la tranquillité dans des villes où beaucoup ont le sentiment qu’elle manque ?
Difficile d’être maire. Difficile aussi d’être de gauche dans un moment où l’imaginaire sécuritaire domine. Mais c’est dans ces moments-là qu’une nuance arithmétique ne suffit pas.
11.02.2026 à 10:32
Police municipale : doubler ou tripler les effectifs, est-ce encore un choix politique ?
Texte intégral (2110 mots)
Comment rassurer et assurer la tranquillité publique sans se laisser entraîner dans l’imaginaire sécuritaire dominant ? C’est le dilemme de la gauche dans de nombreuses campagnes municipales.
C’était ce mardi sur le plateau de France Inter : face-à-face entre le maire de Marseille, le sortant socialiste Benoît Payan, et le candidat du Rassemblement national, Franck Allisio. Benjamin Duhamel résume : l’un veut doubler les effectifs de la police municipale, l’autre les tripler. Même logique pour la vidéosurveillance : augmentation contre augmentation.
Difficile d’être maire. Difficile, surtout, d’ignorer une demande sociale puissante en matière de la tranquillité publique. Les habitants parlent d’incivilités, de trafics, de violences, d’abandon. Ils veulent des réponses concrètes. Et les maires, en première ligne, encaissent la pression.
Mais si la proposition de gauche consiste à augmenter moins vite que l’extrême droite les mêmes dispositifs, quelque chose cloche. Certes, Benoît Payan a raison, en fin de débat, de rappeler qu’il faut davantage de services publics. Il a raison de dire que l’insécurité est aussi sociale. Mais, venant après la promesse d’effectifs augmentés et de davantage de caméras, l’argument ressemble à un correctif, pas à une boussole.
Jusqu’à présent, Brest était la seule métropole française à faire de la résistance : 140 000 habitants et pas de police municipale. Son maire socialiste, François Cuillandre assumait son choix politique : la sécurité est une mission régalienne de l’État. La ville avait néanmoins créé une brigade de tranquillité urbaine : 20 agents, toujours à pied, non armés, dont la mission est d’éteindre les conflits à la naissance, de dialoguer, d’orienter, de faire remonter les informations et, si nécessaire, d’appeler le 17. La droite locale réclamait une « vraie » police municipale armée et un réseau de caméras. Mais la ligne du maire a changé : il promet désormais la création de 50 postes de policiers municipaux s’il est réélu.
Au-delà des effectifs et des caméras, une autre question mérite pourtant d’être posée : celle de la formation. Les policiers municipaux, en particulier lorsqu’ils sont armés, ne bénéficient pas du même niveau ni du même volume de formation que les policiers nationaux… qui en manque déjà trop souvent. Étendre les pouvoirs coercitifs – voire létaux – de forces moins formées pose donc un problème démocratique et professionnel qu’il serait imprudent d’ignorer.
La tension sur la police municipale traverse toute la gauche, jusqu’à La France insoumise. Elle porte, dans ses textes, une critique de l’armement et de l’extension des polices municipales. Mais sur le terrain, la position s’adapte, surtout quand la possibilité de gagner rend tout plus concret : en juillet 2025, David Guiraud, candidat LFI à Roubaix, avait assumé ne pas vouloir désarmer la police municipale s’il devenait maire.
Aujourd’hui, la demande d’ordre structure le débat public. Résister à la réponse par la police et le contrôle de l’espace public par caméra (ou par drones) sans paraître indifférent aux inquiétudes populaires exige un travail de conviction de long terme. On peut donc comprendre les maires qui rencontrent les habitants chaque jour : ils savent que l’abstraction doctrinale pèse peu face à une cage d’escalier squattée ou à un point de deal installé sous les fenêtres. Ils savent aussi que les finances sont contraintes, que l’État délègue sans compenser, que les responsabilités pénales et politiques s’alourdissent.
Mais une question demeure : quelle est la singularité de la gauche municipale si elle s’inscrit dans la même trajectoire que l’extrême droite, en version plus modérée ? Multiplier les caméras, augmenter les effectifs, élargir les prérogatives : est-ce une réponse transitoire en attendant mieux, ou l’installation durable d’un nouveau modèle de gestion urbaine ?
La tranquillité publique n’est pas un slogan. Elle suppose de la présence humaine, de la médiation, des services publics ouverts, des éducateurs, des travailleurs sociaux, des écoles soutenues, des équipements culturels vivants. Elle suppose aussi, évidemment, une police nationale dotée de moyens suffisants et contrôlée démocratiquement. Mais l’équilibre entre prévention, présence sociale et coercition ne se décrète pas au détour d’un débat télévisé. Plutôt que de compter les brigades et les caméras, la gauche gagnerait à formuler une vision cohérente : comment assure-t-on concrètement la tranquillité dans des villes où beaucoup ont le sentiment qu’elle manque ?
Difficile d’être maire. Difficile aussi d’être de gauche dans un moment où l’imaginaire sécuritaire domine. Mais c’est dans ces moments-là qu’une nuance arithmétique ne suffit pas.
 BOUSSOLE DU JOUR
BOUSSOLE DU JOUR
L’extrême gauche selon Laurent Nuñez

La France insoumise classée sous la nuance « extrême gauche » par le ministère de l’intérieur, à quelques semaines des élections municipales, la ficelle est un peu grosse. Sans surprise, c’est l’indignation, tant côté LFI que côté trotskistes – cf ce tweet de Nathalie Arthaud. Comment se justifie Laurent Nuñez ? Voyons les arguments : « Chez La France insoumise, il y a un refus de la discussion parlementaire, des appels systématiques à la censure, on refuse d’aller voir le gouvernement pour des réunions de travail », lance le ministre le 5 février, lors d’un déplacement à Charleville-Mézières. Peut mieux faire ! Alors, le 9 février, il va sur BFM pour développer : LFI est d’extrême gauche à cause de « la remise en question très forte de l’autorité judiciaire [coucou Fillon, Sarkozy, Retailleau], des médias [coucou Macron]et les accusations systématiques sur ‘la police qui tue’ [pas sympa pour Bernalicis]. » Laurent Nuñez y voit « une évolution vers une forme de radicalité et parfois des appels à la désobéissance civile ». Coucou Martin Luther King ? Bon, comme ces arguments ne tiennent pas, Laurent Nuñez va sur un terrain plus politique : « Il y a une forme de dés-alliance au sein du bloc de gauche, avec La France insoumise qui appelle à ‘sanctionner’ le Parti socialiste et qui monte des listes contre la gauche traditionnelle ». Faut-il comprendre que, partout, les écolos et les cocos sont copains avec les socs ? LOL. Il reste un dernier argument au locataire de Beauvau : LFI « s’éloigne un peu de nos valeurs universalistes républicaines, en donnant la primauté aux aspects communautaires de l’organisation de la société », car, dit-il, les insoumis assument une lutte « catégorielle » contre les discriminations portée par des personnes « racisées ». Ah, l’argument islamogauchiste, on l’avait pas vu venir (si). L’affaire n’est donc pas rationnelle et institutionnelle, elle est purement politicienne. Bon courage en tout cas pour expliquer le boom de l’extrême gauche aux municipales : 0,48% des voix au premier tour en 2020 – sans LFI donc !
L.L.C.
ON VOUS RECOMMANDE…

« La rage de vaincre », un entretien de l’émission 28 minutes avec Fleur Breteau, touchée par deux cancers du sein en cinq ans. Devenue activiste depuis son premier diagnostic, elle a fondé le collectif « Cancer colère » et devient une figure de l’engagement contre la loi Duplomb, votée l’été dernier, qui a réintroduit certains pesticides… Un texte qui doit être rediscuté aujourd’hui à l’Assemblée nationale (uniquement hélas de manière symbolique), après qu’une pétition a réuni de plus de 2 millions de signatures. À noter que le sénateur Duplomb s’acharne : il a déposé une nouvelle proposition de loi pour la réintroduction de l’acétamipride, un insecticide de la famille des néonicotinoïdes… qui a donné naissance à une nouvelle pétition.
C’EST CADEAU 


ÇA SE PASSE SUR REGARDS.FR
Pour recevoir cette newsletter quotidiennement (et gratuitement) dans votre boîte mail, suivez le lien : regards.fr/newsletter !
10.02.2026 à 12:30
Démocratie : les Français en quête de souffle
Texte intégral (1005 mots)
Une étude et un appel pour la proportionnelle viennent nous parler de la crise démocratique. L’appel répond-il aux constats dressés ?
Depuis 16 ans, le Cevipof (un laboratoire de Sciences Po) pilote une étude sur la confiance des Français dans leur système politique. Les résultats sont comparés à l’Allemagne, aux Pays-Bas, à l’Italie et au Royaume-Uni. Cette nouvelle vague met en évidence l’écart qui se creuse profondément entre les institutions politiques et les Français. Et cela se traduit dans un mal-être certain.
TOUS LES JOURS, RETROUVEZ L’ESSENTIEL DE L’ACTU POLITIQUE DANS NOTRE NEWSLETTER
L’étude ne fait pas directement le lien entre le désamour des Français pour leur institutions politiques et leur pessimisme. On peut pourtant le tenter quand 89% des interrogés demandent davantage de considération par la politique et par la vie au travail. Le mal-être s’exprime par de la méfiance (45%), de la lassitude (45%) voire de la peur (18%). La méfiance en particulier ressort comme un trait spécifique à l’état d’esprit de nos concitoyens : ce ne sont que 24% des Allemands et 29% des Italiens qui en disent de même. Pour la première fois, ceux qui se situent dans le bas de l’échelle sociale dépassent ceux qui se situent dans le haut de cette échelle. Ils sont minoritaires (contrairement à nos voisins) à dire connaître une situation meilleure que celle des générations précédentes. Le sentiment de déclassement s’installe.
Mais cela ne se traduit pas par du ressentiment généralisé. La confiance envers les autres (la famille, les voisins, ceux que l’on rencontre, etc.) reste à des niveaux très élevés et varie peu. C’est à l’endroit de la politique que le jugement est le plus sévère : 78% disent ne pas lui faire confiance. Seuls 22% lui font confiance, moitié moins qu’en Allemagne, au Royaume-Uni et en Italie. Toutes les institutions politiques françaises dégringolent, du parlement au gouvernement, en passant par la présidence. Le pompon revient aux partis politiques : 15% de confiance. Sans surprise, 76% des Français pensent que le personnel politique est corrompu. Et, là encore, la comparaison avec les voisins européens est atterrante.
Pour 30% des Français, les détenteurs du pouvoir réel sont les marchés financiers. Mais cela ne conduit pas les Français à renoncer à la démocratie. Leur adhésion à la démocratie progresse même de 2 points et s’établit à 82%.
Seuls 23% des Français considèrent que la démocratie fonctionne bien. Là encore, c’est moitié moins que chez nos voisins. Parmi les explications : ils sont 87% à considérer que leur avis n’est pas pris en compte. C’est 30 points de plus que chez les pays européens voisins. Et pourtant, bravement, les Français continuent majoritairement à s’intéresser à la politique. Ils pensent qu’« il faudrait davantage associer les citoyens aux grandes décisions politiques et budgétaires »… même si 57% des Français pensent que « les gouvernements ne peuvent plus faire grand-chose aujourd’hui, le pouvoir réel est ailleurs » . C’est 10 à 15% de plus que les voisins. Pour 30% des Français, les détenteurs du pouvoir réel sont les marchés financiers. Mais cela ne conduit pas les Français à renoncer à la démocratie. Leur adhésion à la démocratie progresse même de 2 points et s’établit à 82%. Un gouvernement d’experts vient loin derrière (59%) et le pouvoir d’un homme fort est loin d’être attendu (36%). Tout n’est donc pas foutu.
L’étude est colossale. Chacun peut s’y reporter. Mais le constat de la profondeur et de la spécificité française de la crise est incontestable. C’est évidemment un véritable souffle démocratique qui est attendu : ouvrir des perspectives, écouter, partager le pouvoir pourrait être le mantra des politiques.
Au travers d’un appel paru ce dimanche, certains se saisissent du sujet. Ils rendent public une proposition transpartisane pour établir, d’ici la fin de la législature, un scrutin proportionnel. « Cela contribuerait à débloquer une mécanique politique manifestement grippée et redonnerait de la vitalité démocratique à notre société. » On peut discuter des différents avantages de tel ou tel mode de scrutin. Ce n’est pas sans enjeu. Mais nous n’en sommes plus là. En se focalisant sur le mode d’élection, François Hollande, Élisabeth Borne, Marc Fesneau et Marine Tondelier sont loin d’être à la hauteur des attentes démocratiques. Ils sont aussi loin de la gravité du moment. Ils motivent ainsi leur proposition : « Il nous faut donc désormais apprendre à négocier et faire des compromis, ce que pratiquent depuis longtemps la plupart de nos voisins ». Or, si l’on en croit l’enquête du Cevipof, pour la moitié des enquêtés, le retour à une majorité nette est préférable à une méthode de compromis qui séduit moins d’un quart de l’échantillon. Plus que du compromis, ce qui est demandé, c’est du respect, de l’écoute et de l’engagement.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Time [Fr]
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- L'Autre Quotidien
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- Gauche.Media
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview




 Le prix de la révélation de l'année est décerné à
Le prix de la révélation de l'année est décerné à