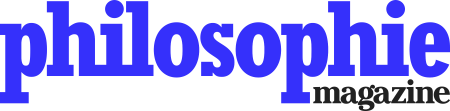14.12.2025 à 07:00
Pas de philo, pas de choco ! Les philosophes et le chocolat
hschlegel
À l’approche des fêtes de fin d’année, peut-être ressentez-vous une envie grandissante de chocolat. Mais quel rapport les philosophes entretiennent-ils avec le chocolat ? Le consomment-ils également ou s’en détournent-ils comme d’un plaisir coupable ? Réponses goûtues.
[CTA2]
Le chocolat n’est bien sûr pas un concept philosophique, ni même un sujet sur lequel les philosophes se sont épanchés, et la Philosophie du chocolat reste à écrire. On trouve cependant ici et là quelques formules où il en est question… quitte à ce que les références soient apocryphes, comme dans cet aphorisme attribué (à tort, puisqu’il n’a jamais rien écrit de tel) à La Rochefoucauld et qui lui fait dire : « Aimez le chocolat à fond, sans complexe ni fausse honte, car rappelez-vous : sans un grain de folie, il n’est point d’homme raisonnable. »
De Voltaire à Nietzsche : un stimulant pour l’espritAussitôt qu’il a été introduit en Europe au XVIIᵉ siècle, le chocolat n’a pas seulement éveillé la curiosité des médecins et des nutritionnistes comme Brillat-Savarin, il a aussi suscité l’intérêt de plusieurs savants et philosophes. Parce qu’il passait pour un stimulant intellectuel, au même titre que le thé ou café ? Exactement, surtout à une époque où il était d’ailleurs consommé sous forme de boisson chaude et non sous forme de tablette. C’est parce qu’il est censé vivifier l’esprit que plusieurs auteurs, comme Voltaire – un grand buveur de chocolat, qu’il mélangeait à son café –, le consommaient. C’est aussi le cas de Nietzsche, qui voyait dans le chocolat un aliment particulièrement sain et vertueux, du moins dans sa version dégraissée. À Turin, on dit qu’il appréciait le gianduja du café Fiorio, une pâte à base de chocolat et de noisette (dont la légende veut qu’elle ait été fabriquée dans un atelier de la Piazza San Carlo, autrement dit au même endroit où le philosophe connaîtra sa crise de folie, le 3 janvier 1889). Dans Ecce Homo (posth., 1908), il évoque le chocolat dans le cadre de considérations plus générales sur son austère hygiène de vie et le lie à ce qu’il appelle sa « morale » :
“Encore quelques préceptes tirés de ma morale. Un repas copieux est plus facile à digérer qu’un repas léger. Il faut que tout l’estomac travaille pour que la digestion se fasse bien, on doit connaître la dimension de son estomac. Pour la même raison, il faut déconseiller ces interminables ripailles, ces suicides écourtés que l’on célèbre à table d’hôte. Rien entre les repas, pas de café : il altère. Le thé n’est bon que le matin. Buvez-en peu, mais prenez-le fort : pour peu qu’il soit trop faible, il vous fait du mal et vous indispose pour la journée. Le degré de concentration à choisir dépend du tempérament de chacun, il est souvent très délicat à déterminer. Dans un climat énervant, le thé est mauvais à jeun : il faut le faire précéder une heure avant d’une tasse de cacao épais et déshuilé. – Rester assis le moins possible ; ne se fier à aucune idée qui ne soit venue en plein air pendant la marche et ne fasse partie de la fête des muscles. Tous les préjugés viennent de l’intestin. Le cul de plomb, je le répète, c’est le vrai pêché contre l’Esprit”
Friedrich Nietzsche, Ecce Homo (posth., 1908), « Pourquoi j’en sais si long », section I, trad. fr. A. Vialatte
On peut s’étonner de voir ce régime alimentaire assez strict, voire sévère, vanté par un philosophe qui est par ailleurs un chantre de la vitalité et de la grande santé (qui chez lui ne se réduit pas à la santé du corps). À moins que ce ne soit précisément sa constitution fragile qui le rende si soucieux de diététique. Mais le chocolat relève-t-il pour autant de la morale, comme le veut le penseur allemand ? Il est vrai qu’avant de passer pour un aliment sain, le chocolat a dû surmonter une autre réputation qu’il a longtemps traînée – à savoir celle d’être un aphrodisiaque puissant, aussi attirant que dangereux et qui soulevait à ce titre un questionnement proprement moral sur la nature du plaisir qu’il procure.
Madame de Sévigné et la sensualité du chocolat, entre Éros et ThanatosIl suffit pour s’en convaincre de lire la correspondance qu’entretient Madame de Sévigné (1626-1696) avec sa fille Madame de Grignan, au sujet de cette boisson alors en vogue à la cour de Versailles en tant que symbole de raffinement et de luxe réservé à la noblesse. Tantôt Madame de Sévigné s’en délecte, tantôt elle s’en méfie, comme si elle entretenait avec cette substance une relation amoureuse tumultueuse. Le 15 avril 1671, elle écrit : « Le chocolat n’est plus avec moi comme il était ; la mode m’a entraînée comme elle fait toujours. Tous ceux qui m’en disaient du bien m’en disent du mal. On le maudit ; on l’accuse de tous les maux qu’on a. Il est la source des vapeurs et des palpitations ; il vous flatte pour un temps, et puis vous allume tout d’un coup une fièvre continue, qui vous conduit à la mort. » Elle le soupçonne d’être à l’origine de la couleur de l’enfant qu’a eu l’une de ses amies (!) et met en garde sa fille enceinte :
“J’ai aimé le chocolat, comme vous savez ; il me semble qu’il m’a brûlée, et depuis, j’en ai bien entendu dire du mal ; mais vous dépeignez et vous dites si bien les merveilles qu’il fait en vous, que je ne sais plus qu’en penser. La marquise de Coëtlogon prit tant de chocolat, étant grosse l’année passée, qu’elle accoucha d’un petit garçon noir comme le diable, qui mourut”
Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné, lettre du 25 octobre 1671
Outre les connotations racistes de la formule, on peut s’étonner de voir le chocolat considéré comme un aliment si sensuel qu’il jouisse de vertus proprement sexuelles, étrangement magiques (ou plutôt démoniaques). Du moins le plaisir qu’il apporte favorise-t-il la sociabilité, à en croire cette autre injonction où, quelques mois plus tard à peine, Madame de Sévigné recommande cette fois à sa fille de « prendre du chocolat, afin que les plus méchantes compagnies vous paraissent bonnes » (lettre du 15 janvier 1672) : au lieu d’être un excitant, le chocolat passe alors pour un désinhibiteur qui met de belle humeur.
Le chocolat comme réconfort existentiel : Simone Weil et Emil CioranLe chocolat apporte de la convivialité – parce qu’il est une sorte de substitut à l’amour et un vecteur d’humanité ? Il est vrai qu’il rassemble les gourmands autour de la faiblesse qu’ils ont pour lui (encore plus quand il se présente sous forme de carrés prêts à être découpés, comme une invitation au partage). Mieux, le chocolat s’offre volontiers en cadeau, comme l’a bien compris Simone Weil qui, alors qu’elle n’était encore qu’une enfant, envoyait son sucre et son chocolat aux soldats du front pendant la Première Guerre mondiale dans l’espoir d’adoucir un peu la dureté de leurs conditions de vie. Celle qui toute sa vie a refusé le confort que pouvait lui offrir son milieu plutôt bourgeois (décidant plus tard d’aller travailler comme ouvrière à l’usine) montrait ainsi toute la grandeur de son âme généreuse par cette attention aux souffrances des autres.
Les matérialistes diront que c’est parce qu’il stimule la production de sérotonine ; toujours est-il que le chocolat est d’un grand réconfort pour les âmes en peine. Il paraît même qu’Emil Cioran, l’auteur de De l’inconvénient d’être né taraudé par la vanité de l’existence, en était gourmand. On raconte que lorsqu’il lui rendait visite dans sa mansarde ascétique de la rue de l’Odéon à Paris, son ami, éditeur et biographe Gabriel Liiceanu avait pris l’habitude d’apporter à son compatriote – qui vivait pourtant de manière très frugale – le fameux gâteau hongrois dobostorta, composé de multiples couches de génoise et de crème au chocolat. Dans Itinéraires d’une vie. E.M. Cioran, il raconte son étonnement de voir avec quelle gourmandise enfantine et quelle joie de vivre celui qui dissertait par ailleurs sur le néant et le suicide se jetait sur cette pâtisserie et s’en délectait… Le chocolat n’est-il pas le meilleur des antidépresseurs s’il a été capable de réconcilier, même provisoirement, Cioran avec la condition humaine ? Il ne faut y voir aucune contradiction : nous vivons sur plusieurs niveaux de conscience, et assurément, le chocolat nous aide à passer de l’un à l’autre, pour notre plus grand plaisir.
décembre 202514.12.2025 à 06:00
L’“hypothèse jizz” : le philosophe Baptiste Morizot livre une nouvelle clé d'interprétation de l'art préhistorique
nfoiry
Avec une audace réjouissante, le philosophe Baptiste Morizot propose, dans son nouvel essai Le Regard perdu (Actes Sud), une clé d’interprétation de l’art préhistorique, qu’il appelle l’« hypothèse jizz ». Dans notre nouveau numéro, nous l’avons invité à partager ses réflexions en s’appuyant sur quelques images.
décembre 202513.12.2025 à 15:00
“Merteuil” ou la misogynie en bas de soie
hschlegel
Merteuil, la compagne de jeu de Valmont dans Les Liaisons dangereuses de Cholderlos de Laclos, est-elle une femme puissante ou aliénée ? Pour l’autrice et chercheuse Jennifer Tamas, le projet féministe de la nouvelle série qui lui est consacrée (Merteuil, de Jessica Palud, sur un scénario de Jean-Baptiste Delafon) rate sa cible : le roman demeure plus intelligent que son adaptation.
[CTA2]
Un point de départ prometteurLa série Merteuil se propose de poser un regard féministe sur l’un des best-sellers du XVIIIe siècle : Les Liaisons dangereuses (1782). Ce roman épistolaire fut écrit par un militaire rompu aux manœuvres guerrières et amoureuses : Pierre Cholderlos de Laclos. Mais cet homme fut aussi l’un de ceux qui s’intéressèrent de près à l’éducation des femmes et à leur émancipation, composant un an après son célèbre roman un traité théorique qui l’éclaire singulièrement : Des femmes et de leur éducation (1783). Laclos y explique que les femmes vivent dans une société qui les a réduites en esclavage et que la seule façon de mettre fin à leur domination est de fomenter une révolution.
“Chez Laclos, Merteuil est un personnage complexe car son émancipation propre ne conduit pas à celle de toutes les femmes”
Qu’on lise son œuvre comme celle d’un allié ou comme celle d’un homme qui ferait du « mansplaining », il ne fait aucun doute que Laclos offre aux Lumières un visage féministe : il critique une société libertine qui prône certes le plaisir, mais un plaisir asymétrique et d’autant plus coûteux et destructeur qu’on est née femme. Rappelons que le mot même de « libertin » renvoie pour l’homme à une liberté d’esprit puis de mœurs, tandis qu’une femme « libertine » est d’abord la jeune fille « qui désobéit à sa mère » puis « la femme qui ne se soumet pas à son mari ». Il suffit donc de dire non pour être vue comme subversive et risquer de perdre sa réputation. Laclos s’attaque ainsi aux contraintes socioculturelles qui pèsent sur les femmes, y compris dans cette nouvelle quête du plaisir sexuel qui parachève cette injustice de genre.
Rien d’étonnant dans ce cadre à vouloir partir du personnage de la marquise de Merteuil – pièce maîtresse de l’œuvre – pour servir un point de vue féministe, en dépit de la troublante complexité du personnage. Pour la réalisatrice, Jessica Palud, l’idée est de voir dans ce roman une sorte de « #MeToo au XVIIIe siècle », tranchant ainsi avec l’image qu’en auraient donné ses prédécesseurs, notamment Roger Vadim en 1959, Stephen Frears en 1988, Miloš Forman en 1989 avec Valmont ou encore Roger Kumble en 1999 avec Sexe Intentions. Pourtant, c’est un double échec.
Merteuil, un personnage complexeD’abord, #MeToo fit événement en 2017 justement parce que pour la première fois, on put exposer sur la scène publique des violences sexuelles sans que ces révélations soient correlées avec une perte de réputation ou une honte sociale pour celle qui les dévoile – ce qui était jusque-là impensable, a fortiori au XVIIIe siècle, où toute femme abusée perdait sa valeur sitôt que c’était su. Ensuite, Laclos nous montrait déjà dans son roman une Merteuil qui transcendait son statut de victime pour s’ériger en maîtresse du jeu, dominant le vicomte de Valmont et servant ses intérêts propres, quitte à instrumentaliser d’autres jeunes femmes. C’est en cela que le personnage de fiction était complexe : son émancipation propre ne conduisait pas à l’émancipation de toutes les femmes. Dans une société patriarcale où la valeur des femmes tient à leur virginité, à leur naissance et à leur dot, les marges de manœuvres demeurent ténues : toute tentative pour conquérir une liberté sexuelle ne peut se faire qu’en sourdine et reconduit nécessairement la domination des hommes sur les femmes. CQFD : pour Laclos, seule une révolution pourra mettre fin aux préjugés et s’affranchir des lois masculines.
Une victime au carréQue nous montre la série Merteuil ? L’idée de remonter aux origines du personnage pour révéler l’antagonisme profond qui travaille le couple Valmont/Merteuil est excellente. Plusieurs séries proposent ainsi un prequel aux grandes fictions pour leur donner une profondeur nouvelle. Sauf que cette adaptation-ci commet un grave contresens, qui rend l’intrigue incohérente. La jeune Merteuil aurait été une orpheline sans titre et recluse dans un couvent de province. Un aristocrate – Valmont – se serait épris d’elle au point de l’épouser. Mais une fausse cérémonie de mariage orchestrée par sa tante, Madame de Rosemonde, aurait permis au libertin de voler à la jeune Merteuil sa vertu, puis de l’abandonner, ce qui justifierait que Merteuil veuille se venger de lui.
Cela n’a aucun sens. D’abord, avec un tel passé, une jeune femme n’aurait trouvé au XVIIIe siècle aucun marquis pour l’épouser : qui voudrait d’une roturière, a fortiori déniaisée et sans appui, à une époque où les contrats de mariage étaient farouchement négociés par les familles ? Cette jeune fille ne serait jamais devenue la marquise de Merteuil.
Ensuite, la réputation sulfureuse de Valmont tient à ce qu’il avilit des jeunes aristocrates pour leur faire perdre leur réputation et humilier les hommes qui la garantissent. Dans cette société scrutatrice, s’attaquer à une nobody n’a stratégiquement aucun intérêt. La série fait de Merteuil une femme violée et sans réputation, méprisée de tous, et qui finit par se faire miraculeusement épouser par un marquis. Ce topos de la jeune fille sortie du ruisseau qui va devenir une Lady n’a rien à voir avec la condition féminine de l’époque. Surtout, elle ne permet pas de comprendre les obstacles qui pèsent sur elle pour s’affranchir.
“Dans la série, ce cliché d’une ‘nobody’ qui va devenir une ‘Lady’ ne correspond en rien à la condition féminine de l’époque”
L’héroïne de Laclos fait son entrée dans le monde ni méprisée ni violée. Elle se marie comme toutes les jeunes filles de l’aristocratie. Or c’est justement la nuit de noces qui est l’occasion d’un viol. À travers le personnage de Merteuil, Laclos interroge ce qu’a de légal cette prise de possession qui réduit la jeune femme à la volonté de son mari. Dans sa célèbre « Lettre 81 » – souvent lue comme un pamphlet féministe –, Merteuil explique que la violence rituelle exécutée par un homme trois fois plus âgé qu’elle fonde sa connaissance du sexe et des rapports de pouvoir. Elle décide de faire de ce traumatisme l’occasion d’un apprentissage social et politique pour s’affranchir des hommes tout en se soumettant aux lois de l’étiquette. Contrairement à Valmont dont la réputation vénéneuse exerce la fascination, l’émancipation de Merteuil doit se faire dans l’ombre car l’honneur des femmes est indissociable d’un régime d’apparences. À aucun moment, elle n’aurait pu être traitée de traînée ni humiliée comme c’est sans cesse le cas dans la série, épisode après épisode. Chez Laclos, la déchéance de l’héroïne est précisément ce qui met fin au roman. Avant ce coup de théâtre final, Merteuil est perçue tout du long comme un modèle de vertu, une vertu qu’elle gagne grâce à une étude approfondie des mœurs de l’époque doublée d’une conduite prudente : elle est, à la manière de Montaigne, son propre ouvrage. Modelée par personne, et encore moins par une Rosemonde qui dans le roman se désespère de son libertin de neveu. Merteuil est une anti-Galatée. Elle s’est créée elle-même et ne doit rien aux manœuvres des hommes pour la modeler selon leurs désirs.
Une sororité manquée, des désirs masculins toujours reconduitsLa série multiplie les contresens. En faisant de Merteuil une ingénue déniaisée par Valmont puis initiée à la société de cour par Rosemonde, l’adaptation anéantit toute l’agentivité du personnage de Laclos. Le scénario prête aussi à Rosemonde les intentions que Laclos attribuait à Merteuil, créant une histoire tout simplement invraisemblable. Comment comprendre en effet que Rosemonde manigance les intrigues amoureuses, voulant se venger d’un Gercourt libertin, dont on comprend mal ce qu’elle lui reproche ?
“À aucun moment, Merteuil n’aurait pu être traitée de traînée ni humiliée comme c’est sans cesse le cas dans la série, épisode après épisode”
Chez Laclos, c’était limpide. Merteuil et Gercourt étaient amants jusqu’au jour où ce dernier la quittait pour épouser une jeune aristocrate vierge : Cécile de Volanges. Ulcérée, Merteuil sollicitait Valmont pour déshonorer (et violer) Cécile afin que Gercourt soit humilié en épousant une jeune femme avilie. Merteuil était donc celle qui tirait toutes les ficelles, dominant aussi bien le cercle vertueux autour de Cécile de Volanges que le libertin Valmont dont elle dirigeait les coups à sa guise. La façon dont la série adapte cet épisode est un nouveau contresens : Gercourt quitte Cécile qu’il est sur le point d’épouser car elle aurait écrit une lettre qui célèbre le sexe de son amant. Merteuil pense humilier Gercourt en lui révélant ce détail intime : en réalité, elle fortifie le pouvoir de cet homme qui n’a qu’à quitter sa promise et réduire son avenir à néant. Les femmes sont toujours les grandes perdantes du marché matrimonial, que ce soit Merteuil qui continue à se faire violer par son mari (alors que chez Laclos, elle devenait vite veuve) ou la jeune Cécile flanquée d’une mère incapable de l’établir.
Il aurait été intéressant d’imaginer des liens de sororité dans une société où le jeu libertin s’appuie sur une guerre des sexes qui reconduit les inégalités et les rivalités entre les femmes, mais la série échoue à le faire. Aucune motivation psychologique n’explique que la jeune Merteuil veuille faire alliance avec une Rosemonde qui, dès le premier épisode, est à l’origine de sa déchéance. En réalité, les errements du scénario et son incohérence dramatique servent on ne peut plus clairement un regard masculin toujours reconduit. La série multiplie les stéréotypes sur la virginité, l’érotisation des scènes de viol ou encore les gros plans sur les yeux écarquillés de femmes qu’on initie au sexe, y compris à travers la reproduction des tableaux de Fragonard filmés au ralenti.
Alors que les réseaux sociaux et l’ère #MeToo ont changé notre rapport à la réputation comme à l’image qu’on donne de nous aux autres, nous attendons encore et toujours que soient revisitées pour le grand écran Les Liaisons dangereuses sous un prisme féministe. Difficile, pourtant, de faire mieux que Laclos lui-même !
Merteuil, de Jessica Palud sur un scénario de Jean-Baptiste Delafon, avec Anamaria Vartolomei, Diane Kruger et Vincent Lacoste, est disponible sur HBO Max et sur la plateforme de Canal+.
décembre 2025- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview