13.10.2025 à 12:43
La censure qui vient
la Rédaction
Texte intégral (574 mots)
Les motions sont déjà déposées. Les socialistes ont peur : une dissolution pourrait conduire le RN au pouvoir. Ils ont raison d’avoir peur, mais de là à rester en PLS…
Sébastien Lecornu a donc composé, en moins d’une semaine, son deuxième gouvernement. On y découvre des nouvelles têtes de la « société civile » tandis que les poids lourds politiques restent à la porte, à l’exception des remarquables Gérald Darmanin et Rachida Dati : on a les cadors qu’on mérite. Les ministres sont appelés à faire passer les arbitrages présidentiels auprès des députés.
TOUS LES JOURS, RETROUVEZ L’ESSENTIEL DE L’ACTU POLITIQUE DANS NOTRE NEWSLETTER
Le PS redoute qu’une dissolution ne conduise le RN au pouvoir, seul ou avec une partie des LR en alliés. La peur évacue-t-elle le danger ? Pourtant les socialistes hésitent et semblent vouloir gagner du temps : attendre le discours de politique générale de mardi. Aujourd’hui, ils ne parlent plus que de « suspension de la réforme des retraites » comme condition de leur abstention. Ils s’éloignent de leurs exigences initiales : abrogation de la réforme des retraites, imposition des plus riches, abandon du 49.3, revalorisation du SMIC et des petits salaires. Ce faisant ils suscitent incompréhension ; ils s’isolent de leurs partenaires de gauche qui tous ont annoncé leur intention de censurer. Et se coupent d’une bonne partie de la rue de gauche.
Alors que la prolongation du gouvernement Macron-Lecornu ne tient qu’à leur décision, en ne votant pas la censure qui vient, le PS abîmerait toute crédibilité à porter une alternative au marcronisme. Ce faisant, il retournerait à la case départ, celle d’un fort doute sur son appartenance à la gauche. Avec, en 2022, un résultat mémorable : 1,74%.
Soit Sébastien Lecornu ne lâche rien sur les retraites… et les socialistes censurent. Soit il met sur pause et le plus probable est que la censure sera quand même votée.
Des motions de censure sont d’ores et déjà déposées. Soit Sébastien Lecornu ne lâche rien sur les retraites… et les socialistes censurent. Soit il met sur pause et le plus probable est que la censure sera quand même votée au bénéfice des désaccords parmi les LR et chez Horizons pour qui la réforme des retraites est un marqueur identitaire. Le groupe LIOT ne sera pas, cette fois encore, homogène. Le gouvernement pourrait donc tomber quelque soit la décision du PS ! Si le parti à la rose s’abstenait, ce serait alors les plumes et le goudron.
Viendrait une loi spéciale sur le budget puis une dissolution et des élections législatives express. Comme la peur n’évacue pas le danger, c’est à cette perspective que la gauche dans son ensemble doit se préparer. Sans perdre un instant.
13.10.2025 à 12:41
La censure qui vient
la Rédaction
Texte intégral (1423 mots)
La lettre du 13 octobre 
par Catherine Tricot et Pablo Pillaud-Vivien
Les motions sont déjà déposées. Les socialistes ont peur : une dissolution pourrait conduire le RN au pouvoir. Ils ont raison d’avoir peur, mais de là à rester en PLS…
Sébastien Lecornu a donc composé, en moins d’une semaine, son deuxième gouvernement. On y découvre des nouvelles têtes de la « société civile » tandis que les poids lourds politiques restent à la porte, à l’exception des remarquables Gérald Darmanin et Rachida Dati : on a les cadors qu’on mérite. Les ministres sont appelés à faire passer les arbitrages présidentiels auprès des députés.
Le PS redoute qu’une dissolution ne conduise le RN au pouvoir, seul ou avec une partie des LR en alliés. La peur évacue-t-elle le danger ? Pourtant les socialistes hésitent et semblent vouloir gagner du temps : attendre le discours de politique générale de mardi. Aujourd’hui, ils ne parlent plus que de « suspension de la réforme des retraites » comme condition de leur abstention. Ils s’éloignent de leurs exigences initiales : abrogation de la réforme des retraites, imposition des plus riches, abandon du 49.3, revalorisation du SMIC et des petits salaires. Ce faisant ils suscitent incompréhension ; ils s’isolent de leurs partenaires de gauche qui tous ont annoncé leur intention de censurer. Et se coupent d’une bonne partie de la rue de gauche.
Alors que la prolongation du gouvernement Macron-Lecornu ne tient qu’à leur décision, en ne votant pas la censure qui vient, le PS abîmerait toute crédibilité à porter une alternative au marcronisme. Ce faisant, il retournerait à la case départ, celle d’un fort doute sur son appartenance à la gauche. Avec, en 2022, un résultat mémorable : 1,74%.
Des motions de censure sont d’ores et déjà déposées. Soit Sébastien Lecornu ne lâche rien sur les retraites… et les socialistes censurent. Soit il met sur pause et le plus probable est que la censure sera quand même votée au bénéfice des désaccords parmi les LR et chez Horizons pour qui la réforme des retraites est un marqueur identitaire. Le groupe LIOT ne sera pas, cette fois encore, homogène. Le gouvernement pourrait donc tomber quelque soit la décision du PS ! Si le parti à la rose s’abstenait, ce serait alors les plumes et le goudron.
Viendrait une loi spéciale sur le budget puis une dissolution et des élections législatives express. Comme la peur n’évacue pas le danger, c’est à cette perspective que la gauche dans son ensemble doit se préparer. Sans perdre un instant.
Catherine Tricot et Pablo Pillaud-Vivien
 NOBEL DU JOUR
NOBEL DU JOUR
Glucksmann félicite l’extrême droite vénézuélienne

La politique, c’est un monde de nuances. On peut légitimement contester le pouvoir autocratique de Nicolas Maduro, on ne peut pas porter aux nues l’extrême droite trumpiste comme alternative. C’est pourtant ce que vient de faire Raphaël Glucksmann, dans un tweet : « Bravo à Maria Corina Machado ! Et vive l’inlassable combat des démocrates vénézuéliens contre la dictature de Maduro ! » Lorsqu’elle a reçu son Nobel de la paix, elle s’est empressée d’adresser ses vœux à Donald Trump, ce dernier rapportant ses propos : « Je l’accepte en votre honneur, car vous le méritez vraiment ». Raphaël Glucksmann espère donc rassembler la gauche en jouant à fond la carte anti-Mélenchon, quitte à soutenir l’impérialisme prédateur américain – les menaces des États-Unis à l’encontre du Venezuela sont de l’ordre de l’invasion… Il y a deux jours encore, le Venezuela appelait l’Onu à agir contre une possible intervention armée.
L.L.C.
ON VOUS RECOMMANDE…

« Après la reconnaissance de la Palestine, quelles voies pour la paix ? » Nos confrères de Politis organisent, ce lundi soir au Petit Bain (Paris 13ème), une soirée débat/concert autour de la Palestine. Les invités du jour : la députée européenne Rima Hassan, l’avocat franco-palestinien Salah Hamouri et Céline Martelet, journaliste spécialiste du Moyen-Orient. La question qui anime ce moment est la suivante : alors que la France reconnaît désormais officiellement l’État de Palestine, la solution à deux États est-elle toujours une voie possible et crédible pour une paix durable ? Pour réserver vos places, suivez le lien !
C’EST CADEAU 


Mesdames et messieurs, voilà ce que disait le nouveau ministre de l’éducation nationale lorsqu’il était directeur général de l’enseignement scolaire, en 2022 :
ÇA SE PASSE SUR REGARDS.FR

La dyssolution Macron — par tOad
Pour recevoir cette newsletter quotidiennement (et gratuitement) dans votre boîte mail, suivez le lien : regards.fr/newsletter !
10.10.2025 à 15:59
Pourquoi toute la gauche se prend les pieds dans le tapis
la Rédaction
Texte intégral (1423 mots)
Comme chaque semaine, le débrief politique de la semaine par Catherine Tricot et Pablo Pillaud-Vivien !
10.10.2025 à 12:10
Ras-le-bol des tractations secrètes !
Catherine Tricot
Texte intégral (841 mots)
La nomination d’un nouveau premier ministre est vouée à l’échec. Mais toute élection précipitée serait une violence qui ne résoudrait pas la crise. Il faut le retour aux urnes et du temps au débat démocratique.
Aujourd’hui, Emmanuel Macron nommera – probablement – un nouveau premier ministre. Auparavant, il aura commis une nouvelle vilénie : inviter toutes les forces politiques… sauf le RN et LFI. Comme Sébastien Lecornu parlant mercredi soir des « forces de gauche républicaines », le président apporte sa contribution à l’opprobre contre LFI. Mesure-t-il seulement que cet ostracisme est aussi un brevet accordé à ces deux forces ?
TOUS LES JOURS, RETROUVEZ L’ESSENTIEL DE L’ACTU POLITIQUE DANS NOTRE NEWSLETTER
Il semble peiner à mesurer le niveau d’exaspération et la honte des Français devant le spectacle lamentable des tractations secrètes. Nous ne sommes pas habitués à être tenus à l’écart des grands débats qui nous engagent. Au 19ème siècle, on a mis fin à la diplomatie secrète avec ses clauses entre États, inconnues de tous. Et voilà qu’on inventerait la politique secrète ! La démocratie ne le permet pas.
Les causes de la grave crise politique sont multiples. Le président et sa gestion autoritaire en prennent leur part. La division du pays et celle de l’Assemblée ne sont pas anecdotiques et leurs désaccords ne relèvent pas de l’irresponsabilité.
Depuis 2017, nous n’avons pas eu de grand débat politique. Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et nous avons été privés de ce débat national. En 2022, le président a construit son élection sur le refus de Marine Le Pen : ça ne suffit pas pour définir la politique de la France. En 2024, il a provoqué des élections législatives en seulement 20 jours.
Une élection présidentielle anticipée à la suite d’une démission du président doit intervenir dans les 30 jours. Absurde. Il faut une élection présidentielle qui ait la force d’un projet clair. Il faut donc du temps pour l’organiser, rassembler les 500 signatures, tenir les meetings, écrire et imprimer les tracts qui iront dans les boîtes-aux-lettres et sur les marchés.
Oui, il faut du temps politique, celui du débat global suivi d’un vote, faute de quoi nous ne nous en sortirons pas. La menace du décrochage collectif et individuel est immense ; le risque de voir l’extrême droite avec un partie des LR sous tutelle prendre le pouvoir est avéré. Pour redonner confiance et allant au pays, il faut trancher tous les enjeux : économiques, de justice, de transformation du travail, de menaces de guerre, de dérèglement climatique…
Ce matin, Jean-Luc Mélenchon, qui défend le retour aux urnes, les résume en choix binaire : oui ou non ? Oui ou non à la justice fiscale, oui ou non au militarisme, oui ou non à la lutte contre le réchauffement climatique ? Les insoumis disent, avec Manuel Bompard, que les débats ont déjà eu lieu et que l’heure est aux arbitrages. Il n’en est rien. Tout le monde ne suit pas LCP et la retransmission des débats au parlement. Il faut un débat devant la nation et qui s’adresse à tous les citoyens. Nous ne pouvons nous placer dans un système plébiscitaire, celui du « oui ou non ».
Il faut une élection présidentielle qui ait la force d’un projet clair. Il faut donc du temps pour l’organiser, rassembler les 500 signatures, tenir les meetings, écrire et imprimer les tracts qui iront dans les boîtes-aux-lettres et sur les marchés. Et il faut du temps pour le porte-à-porte et pour les débats à la télé. La France insoumise est prête. Tant mieux. Les autres doivent pouvoir se préparer et participer.
Une élection présidentielle anticipée à la suite d’une démission du président doit intervenir dans les 30 jours. Absurde : cela ne réglerait pas la crise si on l’identifie bien comme un besoin d’un retour à la politique et à la démocratie. Il faut permettre aux élections municipales de se tenir normalement ; il faut une loi spéciale pour prolonger le budget. Et, en mai, une présidentielle anticipée… et annoncée dès maintenant. Toute élection précipitée ne serait qu’un nouveau mauvais coup à la démocratie et à la politique.
10.10.2025 à 12:06
Ras-le-bol des tractations secrètes !
la Rédaction
Texte intégral (1509 mots)
La lettre du 10 octobre 
par Catherine Tricot
La nomination d’un nouveau premier ministre est vouée à l’échec. Mais toute élection précipitée serait une violence qui ne résoudrait pas la crise. Il faut le retour aux urnes et du temps au débat démocratique.
Aujourd’hui, Emmanuel Macron nommera – probablement – un nouveau premier ministre. Auparavant, il aura commis une nouvelle vilénie : inviter toutes les forces politiques… sauf le RN et LFI. Comme Sébastien Lecornu parlant mercredi soir des « forces de gauche républicaines », le président apporte sa contribution à l’opprobre contre LFI. Mesure-t-il seulement que cet ostracisme est aussi un brevet accordé à ces deux forces ?
Il semble peiner à mesurer le niveau d’exaspération et la honte des Français devant le spectacle lamentable des tractations secrètes. Nous ne sommes pas habitués à être tenus à l’écart des grands débats qui nous engagent. Au 19ème siècle, on a mis fin à la diplomatie secrète avec ses clauses entre États, inconnues de tous. Et voilà qu’on inventerait la politique secrète ! La démocratie ne le permet pas.
Les causes de la grave crise politique sont multiples. Le président et sa gestion autoritaire en prennent leur part. La division du pays et celle de l’Assemblée ne sont pas anecdotiques et leurs désaccords ne relèvent pas de l’irresponsabilité.
Depuis 2017, nous n’avons pas eu de grand débat politique. Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et nous avons été privés de ce débat national. En 2022, le président a construit son élection sur le refus de Marine Le Pen : ça ne suffit pas pour définir la politique de la France. En 2024, il a provoqué des élections législatives en seulement 20 jours.
Oui, il faut du temps politique, celui du débat global suivi d’un vote, faute de quoi nous ne nous en sortirons pas. La menace du décrochage collectif et individuel est immense ; le risque de voir l’extrême droite avec un partie des LR sous tutelle prendre le pouvoir est avéré. Pour redonner confiance et allant au pays, il faut trancher tous les enjeux : économiques, de justice, de transformation du travail, de menaces de guerre, de dérèglement climatique…
Ce matin, Jean-Luc Mélenchon, qui défend le retour aux urnes, les résume en choix binaire : oui ou non ? Oui ou non à la justice fiscale, oui ou non au militarisme, oui ou non à la lutte contre le réchauffement climatique ? Les insoumis disent, avec Manuel Bompard, que les débats ont déjà eu lieu et que l’heure est aux arbitrages. Il n’en est rien. Tout le monde ne suit pas LCP et la retransmission des débats au parlement. Il faut un débat devant la nation et qui s’adresse à tous les citoyens. Nous ne pouvons nous placer dans un système plébiscitaire, celui du « oui ou non ».
Il faut une élection présidentielle qui ait la force d’un projet clair. Il faut donc du temps pour l’organiser, rassembler les 500 signatures, tenir les meetings, écrire et imprimer les tracts qui iront dans les boîtes-aux-lettres et sur les marchés. Et il faut du temps pour le porte-à-porte et pour les débats à la télé. La France insoumise est prête. Tant mieux. Les autres doivent pouvoir se préparer et participer.
Une élection présidentielle anticipée à la suite d’une démission du président doit intervenir dans les 30 jours. Absurde : cela ne réglerait pas la crise si on l’identifie bien comme un besoin d’un retour à la politique et à la démocratie. Il faut permettre aux élections municipales de se tenir normalement ; il faut une loi spéciale pour prolonger le budget. Et, en mai, une présidentielle anticipée… et annoncée dès maintenant. Toute élection précipitée ne serait qu’un nouveau mauvais coup à la démocratie et à la politique.
 BLAGUE DU JOUR
BLAGUE DU JOUR
Sarkozy se prend pour Dreyfus

Chirac, Juppé, Fillon et maintenant… Sarkozy, tous condamnés. Cocorico ! Le 25 septembre dernier, vous le savez, l’ancien président de la République a écopé d’une peine de prison ferme dans l’affaire Kadhafi. Nicolas Sarkozy sera fixé le 13 octobre, par le Parquet national financier, des modalités de son incarcération à venir. En attendant, Mediapart nous informe : l’ex-chef de l’État a organisé un « pot de départ en détention ». Il y avait du beau monde : Rachida Dati, l’ancien directeur de la police nationale Frédéric Péchenard, le secrétaire général de l’Élysée Emmanuel Moulin ou encore la conseillère culture d’Emmanuel Macron Catherine Pégard. Et, tenez-vous bien, Nicolas Sarkozy s’est comparé au capitaine Dreyfus et au comte de Monte-Cristo, arguant que leurs affaires à tous trois « ont commencé avec un faux ». Et Berlusconi, c’est Gramsci ! Pour rappel, Nicolas Sarkozy, déjà multi-condamné, attend toujours le verdict dans quatre affaires judiciaires…
L.L.C.
ON VOUS RECOMMANDE…
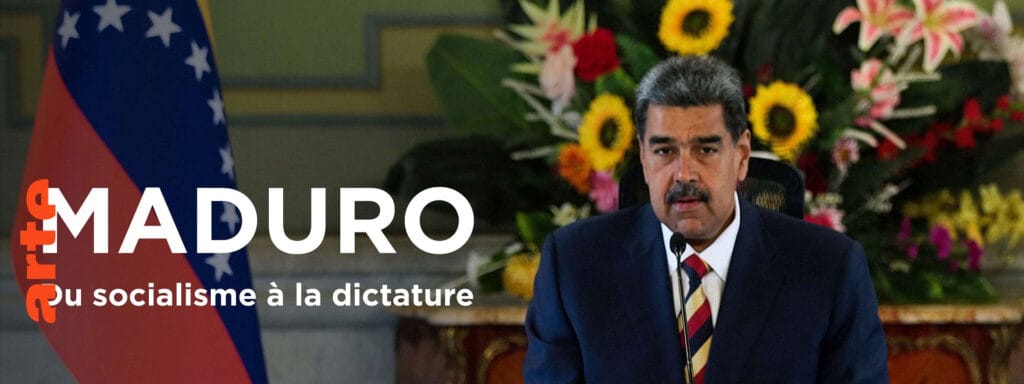
Maria Corina Machado vient d’être couronnée d’un prix Nobel de la paix. La militante des droits humains vénézuélienne vit dans la clandestinité dans son propre pays depuis la réélection contestée du président Nicolas Maduro en juillet 2024. Sur Arte, un documentaire, « Maduro, du socialisme à la dictature », revient sur le parcours de l’autocrate qui, de paria sur la scène internationale, est revenu au centre du jeu vénézuélien grâce à la guerre en Ukraine.
C’EST CADEAU 


ÇA SE PASSE SUR REGARDS.FR

Macron, le plus talentueux de sa génération — par tOad
Pour recevoir cette newsletter quotidiennement (et gratuitement) dans votre boîte mail, suivez le lien : regards.fr/newsletter !
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Lava
- La revue des médias
- Le Grand Continent
- Le Diplo
- Le Nouvel Obs
- Lundi Matin
- Mouais
- Multitudes
- Politis
- Regards
- Smolny
- Socialter
- The Conversation
- UPMagazine
- Usbek & Rica
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- Contretemps
- A Contretemps
- Alter-éditions
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- Philo Mag
- Terrestres
- Vie des Idées
- ARTS
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
- Fiabilité 3/5
- Slate
- Ulyces
- Fiabilité 1/5
- Contre-Attaque
- Issues
- Korii
- Positivr
- Regain

