11.12.2025 à 15:55
« Stranger Things » ou le triomphe de la nostalgie
Sophie Renault, Professeur des Universités en Sciences de Gestion et du Management, Université d’Orléans
Texte intégral (2300 mots)

Miser sur les objets cultes des années 1980, envahir l’espace public et s’inscrire dans la postérité : tel est le programme marketing très bien orchestré de la série « Stranger Things » pour sa cinquième et dernière saison qui surfe plus que jamais sur la nostalgie.
À l’occasion de la sortie de la cinquième et ultime saison de Stranger Things, Netflix déploie un plan d’envergure mondiale : événements publics, collaborations avec des marques internationales, pop-up stores… Derrière l’ampleur promotionnelle, un ressort fondamental unifie la narration, l’esthétique et la stratégie marketing de la série. Il s’agit de la nostalgie.
Objets cultes et nostalgie restauratrice
Depuis 2016, Stranger Things met en scène un imaginaire matérialisé par la présence d’objets emblématiques des années 1980. C’est par l’activation de ces repères culturels que la série prépare et invite le public à l’expérience nostalgique.
Comme l’indiquent les acteurs eux-mêmes dans un teaser promotionnel de la saison 5 :
« Vous allez ressentir des sentiments de nostalgie, ressortez vos chouchous et vos walkmans. »
Parmi les objets emblématiques des années 1980 figurent des téléviseurs à tube cathodique, des cassettes audio, des talkies-walkies, des flippers ou bien encore des bornes d’arcade.
Toutefois, l’efficacité de la nostalgie dans la série va au-delà de ces seules catégories d’objets. Si elle fonctionne si bien à l’écran, c’est parce qu’elle est immédiatement identifiable par l’association à des marques faisant partie intégrante du langage visuel de la culture pop. Les placements de produits y sont nombreux et parfaitement assumés. Il s’agit notamment de la mise en perspective dans cette cinquième saison de produits agroalimentaires parmi lesquels des boissons, comme Sunny Delight ou Coca-Cola. On identifie également plusieurs produits « technologiques », comme une radio Sanyo, un radio-cassette Sidestep, un casque stéréo KOSS, etc. On repère également des marques associées à l’enfance : une parure de lit, une affiche, un puzzle ou bien encore une poupée de l’univers Rainbow Brite, une boîte à goûter G.I. Joe, un bisounours, de la pâte à modeler Play Doh, des crayons de cire Crayola…
Ils sont les véhicules d’une époque que certains ont connue et que d’autres, en écho aux travaux de Svetlana Boym, fantasment ou romancent. Comme le souligne la recherche de Dan Hassler-Forest, Stranger Things illustre une forme de nostalgie « restauratrice », en quelque sorte idéalisée. Les années 1980 apparaissent comme un refuge séduisant face à un présent jugé moins désirable.
Les références empreintes de nostalgie donnent à l’univers de la série sa cohérence esthétique et temporelle. Hawkins, ville fictive dans laquelle se déroule l’action, rappelle selon les recherches de la spécialiste britannique des médias et de la pop culture Antonia Mackay, une forme de « perfectionnisme de la guerre froide », où la tranquillité de la banlieue est interrompue par l’irruption de la menace surnaturelle. En effet, selon la chercheuse, « l’idéologie dominante de l’après-guerre promeut la vie en banlieue, une existence centrée sur l’enfant, Hollywood, la convivialité, le Tupperware et la télévision ». Les frères Duffer, réalisateurs de la série, exploitent ce contraste depuis la première saison. Plus le monde à l’envers gagne du terrain, plus l’univers nostalgique se densifie via les objets, les décors, mais aussi grâce à une bande-son rythmée de tubes des années 1980.
La nostalgie est ainsi l’un des moteurs centraux de la série. Elle s’érige en rempart symbolique contre la terreur associée au monde à l’envers. Passant d’adolescents à jeunes adultes au fil des saisons, les héros évoluent dans un environnement anxiogène figé par l’esthétique rassurante des années 1980. Par effet miroir, en qualité de spectateur, notre propre trajectoire se mêle à celle des personnages de la série. C’est ici aussi que réside l’intuition fondatrice des frères Duffer. Il s’agit de transformer la nostalgie en un espace émotionnel fédérateur, un passé commun recomposé capable de fédérer plusieurs générations.
Licences, « co-branding » et invasion de l’espace public
L’alignement entre l’univers narratif de la série et ses opportunités commerciales ouvre la voie à de multiples partenariats de marque. Le secteur de la restauration rapide, dont la mondialisation s’est accélérée durant les années 1980, est un terrain de jeu idéal pour la mise en place d’opérations commerciales autour de la série. Les exemples sont éloquents : McDonald’s a lancé un Happy Meal accompagné de figurines collector. De son côté, KFC a créé une campagne immersive en se rebaptisant temporairement « Hawkins Fried Chicken », du nom de la ville fictive dans laquelle se déroule la série. Sont mis en scène dans un spot emblématique des employés prêts à affronter tous les dangers du monde à l’envers pour assurer leur livraison. Quant à Burger King, l’enseigne a lancé les menus Hellfire Club d’une part et Upside Down d’autre part, respectivement en référence au club de jeu de rôles Donjons & Dragons de la série et au monde à l’envers qu’elle met en scène.
Cette logique d’extension de la marque Stranger Things se concrétise par des collaborations événementielles qui investissent de nombreux domaines. Par exemple à Paris, l’univers de Stranger Things s’est invité aux Galeries Lafayette. Le grand magasin des Champs-Élysées propose en effet une immersion dans l’atmosphère du monde à l’envers. Des animations interactives y permettent notamment de personnaliser une enceinte Bluetooth en forme de radio. Quant à la chaîne de boulangerie « créative » Bo&Mie, elle décline des pâtisseries aux formes inspirées de la série.
Les exploitations sous licence, depuis Lego aux figurines Pop en passant par Primark, Nike ou Casio, s’emparent de l’esthétique de la série. Stranger Things déborde ainsi de l’écran pour investir les univers marchands mais également l’espace public des grandes villes au travers d’opérations événementielles spectaculaires. C’est notamment le cas lorsque des installations lumineuses immersives sont déployées à l’image de celles de la fête des Lumières de la ville de Lyon.
La postérité en construction
Pour son dernier chapitre, Stranger Things met la nostalgie en scène comme un véritable rituel. La diffusion fractionnée en trois temps n’est pas anodine. Plutôt qu’un lancement d’un seul bloc, Netflix étale la sortie sur trois moments clefs : Thanksgiving, Noël et le Nouvel An. En s’inscrivant dans ce calendrier affectif, la série devient elle‑même un rendez‑vous mémoriel, associé à des fêtes déjà chargées de souvenirs et de traditions.
Ce dispositif permet à Netflix de maintenir l’engouement pendant plusieurs semaines, mais aussi de donner à la série une tonalité plus intime. En effet, la nostalgie du passé se mêle à celle du présent. Les spectateurs vivent les derniers épisodes avec, en filigrane, le souvenir de la découverte de la série près de dix ans plus tôt. La conclusion de Stranger Things active ainsi une double nostalgie : celle, d’une part, des années 1980 reconstituées et celle, d’autre part, de notre propre trajectoire de spectateur.
Alors qu’une page se tourne, Netflix choisit de célébrer la cinquième saison sur l’ensemble des continents à travers le mot d’ordre « One last adventure ». Par exemple, l’événement intitulé « One Last Ride », organisé à Los Angeles le 23 novembre dernier invitait les fans à parcourir Melrose Avenue à vélo, en skate ou à pied. Plus largement, la plateforme déploie une série d’animations, physiques et virtuelles, pour convier les fans du monde entier à accompagner la fin du récit.
Stranger Things est in fine un événement culturel qui va au-delà de l’écran pour occuper l’espace public, les centres‑villes, les grands magasins ou bien encore les réseaux sociaux. La nostalgie y fonctionne comme un vecteur de rassemblement. Cette dynamique s’inscrit dans une stratégie plus large de prolongement de l’univers sériel. On pense notamment aux projets dérivés comme la pièce de théâtre The First Shadow ou bien encore à la série animée Chroniques de 1985. Alors que Stranger Things s’achève, son imaginaire s’installe dans une forme de postérité.
Sophie Renault ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
10.12.2025 à 16:17
La « littérature rectificative » : quand les personnages littéraires sortent de leur silenciation
Hécate Vergopoulos, Maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication, Sorbonne Université
Texte intégral (2160 mots)
Fin octobre 2025 sortait sur nos écrans une nouvelle adaptation d’une œuvre littéraire : « l’Étranger », d’Albert Camus, revisité par François Ozon. Cet événement cinématographique nous rappelait, une fois encore, que les personnages de fiction peuvent avoir une vie qui échappe à leur créateur ou créatrice, au point parfois d’avoir envie de les croire « autonomes ».
L’autonomie des personnages de fiction, c’est ce que le professeur de littérature française Pierre Bayard défend dans son ouvrage la Vérité sur « Ils étaient dix » (2020). Il s’autoproclame d’ailleurs « radical » parmi les « intégrationnistes », soit parmi celles et ceux qui, commentant et pensant la fiction, affirment que nous pouvons parler des personnages littéraires comme s’il s’agissait d’êtres vivants.
Donner une voix aux personnages silenciés
Avant le film d’Ozon (L’Étranger, 2025), l’écrivain Kamel Daoud, en publiant Meursault, contre-enquête (2013), entendait donner la parole au frère de celui qui, dans le récit de Camus, ne porte même pas de nom : il est désigné comme « l’Arabe ». Son projet était de rendre compte de cette vie silenciée
– et partant, du caractère colonial de ce monument de la culture francophone – en lui donnant une consistance littéraire. Il s’agissait en somme de « rectifier » non pas une œuvre, l’Étranger (1942), mais la réalité de ce personnage de fiction qui, nous parvenant à travers les mots seuls de Meursault, ne disait rien en propre et dont la trajectoire de vie ne tenait en rien d’autre qu’à l’accomplissement de son propre meurtre.
Plus récemment, l’écrivain américain Percival Everett, lauréat du Pulitzer 2025 pour James (2024), a quant à lui donné la parole au personnage secondaire homonyme de l’esclave apparaissant dans le roman les Aventures de Huckleberry Finn (1848), de Mark Twain. Son projet, selon les propres mots d’Everett était de créer pour James une « capacité d’agir ».
De telles entreprises sont plus fréquentes qu’il n’y paraît. Dans le Journal de L. (1947-1952), Christophe Tison proposait en 2019 de donner la plume à la Lolita de Nabokov dont le grand public ne connaissait jusqu’alors que ce qu’Humbert-Humbert – le pédophile du roman – avait bien voulu en dire. Celle qui nous parvenait comme l’archétype de la « nymphette » aguicheuse et dont la figuration était devenue iconique – alors même que Nabokov avait expressément demandé à ce que les couvertures de ses livres ne montrent ni photos ni représentations de jeune fille –, manifeste, à travers Tison, le désir de reprendre la main sur son propre récit.
À lire aussi : « Lolita » de Nabokov en 2024 : un contresens généralisé enfin levé ?
Il en est allé de même pour Antoinette Cosway, alias Bertha Mason, qui apparaît pour la première fois sous les traits de « la folle dans le grenier » dans le Jane Eyre (1847), de Charlotte Brontë. Quand l’écrivaine britannique née aux Antilles, Jean Rhys décide de raconter l’histoire de cette femme blanche créole originaire de Jamaïque dans la Prisonnière des Sargasses (1966), elle entend montrer que cette folie tient au système patriarcal et colonial qui l’a brisée en la privant de son identité.
Margaret Atwood, quant à elle, avec son Odyssée de Pénélope (2005) s’attache à raconter le périple finalement très masculin de « l’homme aux mille ruses » notamment à travers le regard de Pénélope. Celle qui jusqu’alors n’était que « l’épouse d’Ulysse » se révèle plus complexe et plus ambivalente que ce que l’assignation homérique à la fidélité avait laissé entendre.
Ces œuvres singulières fonctionnent toutes selon les mêmes présupposés : 1. La littérature est faite d’existences ; 2. Or, celles de certains personnages issus d’œuvres « premières » y sont mal représentées ; 3. une nouvelle œuvre va pouvoir leur permettre de dire « leur vérité ».
Ces textes, je propose de les rassembler, sans aucune considération de genres, sous l’intitulé « littérature rectificative ». Leur ambition n’est pas celle de la « réponse », de la « riposte » ou même du « démenti ». Ils n’établissent pas à proprement parler de « dialogue » entre les auteurs et autrices concernées. Ils ont seulement pour ambition de donner à voir un point de vue autre – le point de vue d’un ou d’une autre – sur des choses (trop peu ? trop mal ?) déjà dites par la littérature.
Ce n’est probablement pas un hasard si les textes de cette littérature rectificative donnent ainsi la parole à des sujets littéraires victimes d’injustices et de violences, qu’elles soient raciales, sexistes et sexuelles ou autres, car, au fond, ils cherchent tous à savoir qui détient la parole littéraire sur qui.
Le cas du « Consentement », de Vanessa Springora
Parmi eux, un texte qui aura considérablement marqué notre époque : le Consentement de Vanessa Springora (2020). Dans ce livre, elle raconte, sous forme autobiographique, sa relation avec l’écrivain Gabriel Matzneff, qu’elle rencontre en 1986 à Paris, alors qu’elle a 14 ans et lui environ 50. Elle s’attache à décrire les mécanismes d’emprise mis en place par l’auteur ainsi que l’acceptation tacite de cette relation au sein d’un milieu où sa réputation d’écrivain primé lui offrait une protection sociale.
Si l’on accepte qu’il est autre chose qu’un témoignage à seule valeur référentielle et qu’il dispose de qualités littéraires (ou si l’on entend le « témoignage » dans un sens littéraire), alors il semble clair que le « je » de Vanessa Springora est un personnage. Il ne s’agit en aucun cas ici de disqualifier ce « je » en prétendant qu’il est affabulation, mais bien de le penser comme une construction littéraire, au même titre d’ailleurs qu’on peut parler de personnages dans les documentaires.
À lire aussi : « L’Étranger » : pourquoi le roman de Camus déchaîne toujours les passions
La spécificité de Vanessa Springora est que son texte ne vient pas « rectifier » la réalité instituée par un autre texte, mais par une somme d’écrits de Gabriel Matzneff. Elle détaille (p. 171-172) :
« Entre mes seize et vingt-cinq ans paraissent successivement en librairie, à un rythme qui ne me laisse aucun répit, un roman de G. dont je suis censée être l’héroïne ; puis le tome de son journal qui couvre la période de notre rencontre, comportant certaines de mes lettres écrites à l’âge de quatorze ans ; avec deux ans d’écart, la version poche de ce même livre ; un recueil de lettres de rupture, dont la mienne […] Plus tard suivra encore un autre tome de ses carnets noirs revenant de façon obsessionnelle sur notre séparation. »
À travers tous ces textes, écrit-elle, elle découvre que « les livres peuvent être un piège » :
« La réaction de panique des peuples primitifs devant toute capture de leur image peut prêter à sourire. Ce sentiment d’être piégé dans une représentation trompeuse, une version réductrice de soi, un cliché grotesque et grimaçant, je le comprends pourtant mieux que personne. S’emparer avec une telle brutalité de l’image de l’autre, c’est bien lui voler son âme. » (p. 171).
Ce qu’elle décrit ici, cet enfermement dans un personnage qui n’est pas elle, n’est pas sans rappeler le gaslighting, soit ce procédé manipulatoire à l’issue duquel les victimes, souvent des femmes, finissent par se croire folles. Il doit son nom au film de George Cukor, Gaslight (1944), Hantise dans la version française, qui raconte l’histoire d’un couple au sein duquel l’époux tente de faire croire à sa femme qu’elle perd la raison en modifiant des éléments a priori anodins de son quotidien et en lui répondant, quand elle remarque ces changements, qu’il en a toujours été ainsi (parmi eux, l’intensité de l’éclairage au gaz de leur maison, le « gas light »).
Springora montre en effet que la « réalité littéraire » construite par M. l’a précisément conduite à douter de sa propre réalité (p. 178) :
« Je marchais le long d’une rue déserte avec une question dérangeante qui tournait en boucle dans ma tête, une question qui s’était immiscée plusieurs jours auparavant dans mon esprit, sans que je puisse la chasser : quelle preuve tangible avais-je de mon existence, étais-je bien réelle ? […] Mon corps était fait de papier, dans mes veines ne coulait que de l’encre. »
Le Consentement est certes le récit d’une dépossession de soi – d’une emprise. Il est cependant aussi une forme d’acte performatif puisque Springora y (re)devient le plein sujet de sa propre énonciation après en avoir été privée. Ne serait-ce pas là la portée pleinement politique de cette littérature rectificative, à savoir donner aux sujets littéraires les moyens de conquête leur permettant de redevenir des pleins sujets d’énonciation, soit cette « capacité d’agir » dont parlait justement Percival Everett ?
Si la littérature est un formidable exercice de liberté (liberté de créer, d’imaginer, de choisir un langage, un style, une narration), elle peut être aussi un incroyable exercice de pouvoir. Les auteurs australiens Bill Aschroft, Gareth Griffiths et Helen Tiffin l’avaient déjà montré dans l’Empire vous répond. Théorie et pratique des littératures post-coloniales (The Empire Writes Back, 1989, traduction française 2012). À partir du cas de l’empire colonial britannique, l’ouvrage mettait ainsi au jour les façons dont la littérature du centre s’est imposée (par ses formats, ses styles, ses langages, mais encore par ses visions de l’ordre du monde) aux auteurs de l’empire et la façon dont ceux-ci ont appris à s’en défaire.
À l’ère des « re » (de la « réparation des vivants » ou de la justice dite « restaurative »), la littérature rectificative a sans aucun doute un rôle politique à jouer. D’abord, elle peut nous aider à poursuivre notre chemin dans le travail de reconnaissance de nos aveuglements littéraires et collectifs. Ensuite, elle peut faire la preuve que nos sociétés sont assez solides pour ne pas avoir à faire disparaître de l’espace commun des œuvres que nous jugeons dérangeantes. La littérature rectificative ne soustrait pas les textes comme pourrait le faire la cancel culture. Au contraire, elle en ajoute, nous permettant ainsi de mesurer la distance qui nous a un jour séparés de cet ordre du monde dans lequel nous n’avons pas questionné ces existences littéraires subalternes et silenciées.
Hécate Vergopoulos ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
09.12.2025 à 15:25
Roger Caillois, ses pierres et son écriture : de nouvelles découvertes mises en scène
Francois Farges, professeur en minéralogie, gemmologie, histoire des sciences minéralogiques et objets d'arts, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)
Texte intégral (2836 mots)

Le grammairien, essayiste, critique, sociologue et poète français Roger Caillois (1913-1978) est l’écrivain contemporain qui a le plus magnifiquement écrit sur les pierres, mais il demeure méconnu. L’exposition « Rêveries de pierres » à l’École des arts joailliers (Paris) permet de revenir sur sa passion, qui donna naissance à une écriture d’une poésie rare.
Entre 2017 et 2023, deux grands événements ont bouleversé la perception de l’univers géopoétique de Roger Caillois : l’acquisition du noyau de sa collection de pierres en 2017 et la découverte de manuscrits inédits en 2023. Ces découvertes font l’objet d’une exposition « Rêveries de pierres », d’une publication inédite (Pierres anagogiques) et d’une anthologie (Chuchotements & Enchantements).

Caillois, le rêveur de pierres
Selon sa biographe Odile Felgine, cet ancien adepte du surréalisme (dans les années 1930) devint sociologue dès les années 1950. Il écrivit des essais sur le sport, les jeux, les masques, la fête, le fantastique, etc. Ses essais, d’une lecture exigeante, résument une large érudition.
Caillois a été élu à l’Académie française en 1971 quand les pierres sont devenues essentielles pour l’essor de sa prose (1952-1978). Ses pierres nourrissent ses écrits, jamais minéralogiques mais plutôt d’histoire de l’art, avec une écriture singulière qui transcende notre vision de ces précieux témoins géologiques : « L’agate de Pyrrhus » des Grecs, les « pierres de rêve » des chinois et les paésines de la Renaissance. Pierres (1966) et l’Écriture des pierres (1970) sont ses ouvrages les plus connus et les plus traduits sur le sujet.
L’héritage au Muséum national d’histoire naturelle
Devenue veuve, son épouse Aléna Caillois destinait au Muséum national d’histoire naturelle en 1983 une sélection de 217 pièces (sur les 1 300), incluant deux manuscrits. Le premier, intitulé Pierres anagogiques, avait été décrit par Aléna en 1983 comme « le dernier manuscrit de Roger Caillois ». Ce texte est annoncé comme étant associé à une agate, dite « n° 2.193 », sans aucune autre précision. Ni le texte ni l’agate n’ont pu être retrouvés à mon arrivée au MNHN en 2006 (j’y reviendrai).
En 2017, l’autre partie de la collection de pierres de Caillois, qui était restée dans les mains de ses héritiers, a été acquise par mécénat pour le MNHN par la Maison Van Cleef & Arpels via l’École des arts joailliers. Ce corpus contient de nombreux spécimens illustrés dans l’Écriture des pierres, mais jamais exposés auparavant, comme le calcaire à dendrites « Le Château », peut-être la pierre de Caillois la plus connue au monde. Cette donation inclut le catalogue manuscrit de sa collection, dont l’agate « n° 2.193 » dont la description permet enfin de l’identifier.
Les (re)découvertes d’inédits en 2023
En 2023, lors d’une nouvelle inspection des archives de l’écrivain qu’il avait léguées à la médiathèque Valery-Larbaud de Vichy (Allier), j’ai étudié neuf caisses d’archives peu explorées, provenant également des héritiers d’Aléna. L’une d’elles, nommée « Pierres », contient le manuscrit mentionné dans la dation et intitulé « Pierres anagogiques ». Comment est-il passé du Muséum à Vichy ? Mystère ! Ce dossier contient deux textes : « Un miroir sans tain » et sa suite, « Agate anarchique (disparate) », le dernier étant, de par le style et son incomplétude relative, le dernier texte de Caillois, écrit quelques jours seulement avant de disparaître. La pensée ultime de Caillois s’éteint sur cette phrase d’une froide lucidité :
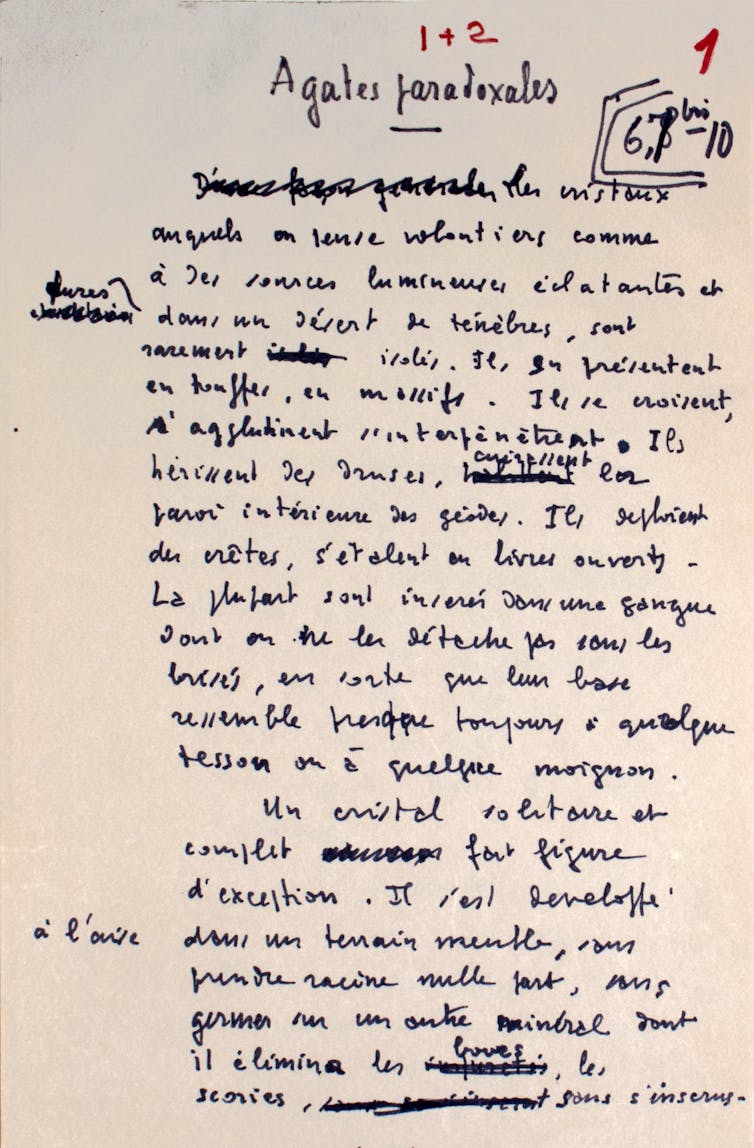
L’anagogie par les pierres
La mention de l’anagogie peut sembler déroutante de la part d’un tel matérialiste et athée revendiqué. Mais dans des notes inédites, Caillois nous explique sa logique : il passe sous silence la définition originelle de l’anagogie (une extase spirituelle envers les dieux célestes) puisée dans la mythologie grecque, pour se focaliser sur celle du moine Bernard de Clairvaux (1090-1153), soit une extase spirituelle envers ce Dieu céleste. En vérité, Caillois ne se convertit à aucune doctrine, y compris cistercienne, mais adapte le concept d’anagogie à sa manière, certes personnelle voire scandaleuse, en reprenant une philosophie bernardine médiévale que je résume ainsi : « Tu écouteras davantage les pierres que tes professeurs ».

L’influence des écrits chinois
Mais Caillois s’inspire également de Mi Fu (1051-1107), ce lettré chinois de la dynastie Song du Nord, qui se livrait à des rêveries sur les pierres. Cet érudit se prosternait devant la pierre la plus importante de sa collection, appelée 寶晉齋研山 ce qui signifie « pierre à encre de l’atelier de Baojin », et qui est devenue cultissime en Chine, encore de nos jours. Elle a été perdue de vue au XIXe siècle mais quelques gravures médiévales subsistent, dont la plus ancienne trouve son origine en 1366. Ce dessin, pourtant imprécis, inclut toutefois de précieuses annotations attribuées à Mi Fu qui expliquent les rêveries que cette pierre lui inspire et qu’il sacralise en retour, un concept typiquement taoïste. L’une d’elles est 嘗神游於其間 : littéralement « J’ai déjà rêvé de me promener ici ». Mais je montre que, dans Pierres (1966, pp. 72-74), le français reprend le texte de la [sinologue Vandier-Nicolas] publiée en 1963 dans Art et sagesse en Chine/Mi Fou (1051-1107), qui proposait alors « randonnée mystique ». Cette traduction, assez interprétée, correspond cependant à l’approche de Caillois des pierres, entre rêverie et mystique.
Plus tard, au crépuscule de sa vie, dans le Fleuve Alphée (1978, pp. 187-188), il mentionne un second récit taoïste décrivant l’ascension des Huit Immortels qui survolent la mer pour se rendre à un banquet sur l’île-montagne paradisiaque de Penglai. Ces extases en forme d’élévations induites par une pierre, me semblent constituer une sorte d’« anagogie taoïsante » dans laquelle Caillois a pu trouver, à travers cette ontologie non-théiste et synchrétique entre Orient et Occident, une ultime inspiration.
Des preuves d’un projet de livre ultime aux accents « environnementalistes » prémonitoires ?
Une note manuscrite retient l’attention dans ces archives : il s’agit d’une liste de titres de textes dans un ordre bien précis : ses descriptions d’agates « naturalisantes » sont suivies d’exposés de plus en plus philosophiques, empreints d’une anagogie ultime. Avec plus de 200 000 signes, cette liste est celle d’un grand ouvrage sur les pierres, inédit, le dernier de Caillois dont le titre semble être celui annoncé par Aléna en 1983 soit « Pierres anagogiques ».
Surtout, Caillois nous questionne, avec les textes « La baignoire », « Interrègne » et « La Toile d’Araignée », avec une cinquantaine d’années d’avance, sur notre rapport à cette Terre que nous exploitons trop avidement, sans penser aux lendemains qui déchanteront. Si Caillois n’est pas le premier à prédire notre perte inéluctable, il a été parmi les premiers. Et surtout, il l’exprime mieux que quiconque, avec la force de ses mots, pour nous induire un choc de conscience et de respect envers cette Terre qui nous a légué tant de choses sans rien attendre en retour.

« Chuchotements & Enchantements »
Pendant cinquante ans, et plus particulièrement depuis mon arrivée au MNHN en 2006, je m’attelle à comprendre cet « écrivain des pierres ». Cette anthologie résume toutes ces découvertes. À mi-chemin entre un beau livre et un essai scientifique en grande partie français-anglais, il raconte comment les minéraux y ont été esthétiquement valorisés avant, pendant et après Caillois. Un regard croisé avec l’exposition « Rêveries de pierres » permettra au lecteur de voir, pendant un temps limité (novembre 2025-mars 2026), une partie significative de ces accords pierres-mots à travers une sélection de 200 spécimens à contempler, de textes à lire et écouter pour s’y fondre, un peu à la manière de Caillois.
Francois Farges ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
08.12.2025 à 16:21
De « Mafiosa » à « Plaine orientale », l’imaginaire de la mafia corse à l’écran
Isabelle-Rachel Casta, Professeur émérite, culture sérielle, poicière et fantastique, Université d'Artois
Texte intégral (2227 mots)

En Corse, dit le dicton, tout se fait, tout se sait, tout se tait (« Tuttu si face, tuttu si sà, tuttu si tace »)… Alors, Corse « terre d’omerta » selon le mot du criminologue Jean-François Gayraud ? En tout cas, terre d’imaginaire et de séries criminelles. Faut-il pour autant déduire de l’abondante production (télé)filmique récente une flambée de fascination pour les « banditi » insulaires ?
Si la conflictualité réelle de la société corse est bien documentée, tous les homicides commis sur l’île ne relèvent pas forcément de la « mafiacraft », selon le titre de l’anthropologue Deborah Puccio-Den. Or, les séries et les films sortis en France ces dernières années tendent à tout confondre, abusant parfois des clichés associés à la mafia dans l’imaginaire collectif.
Les défilés des comités antimafia font souvent la une de la presse régionale corse, en parallèle avec les récits de règlements de compte, de racket et de crimes crapuleux. De Mafiosa, le clan (2006-2014) à Plaine orientale (2025), de À son image (2024) au Royaume (2024), on peut avoir l’impression que les exactions réelles infusent la fiction criminelle, dans une porosité quasi incestueuse où le fait divers d’hier nourrit le scénario de demain, comme si l’imaginaire du voyou se régénérait sans cesse au contact d’une société à la fois clanique et violente, traversée par toutes les manifestations du crime contemporain (drogue, extorsion, chantage…).
Pourtant, aucun auteur français n’est menacé à la hauteur de ce que subit l’écrivain et journaliste italien Roberto Saviano, sous protection judiciaire depuis la publication de son très réaliste roman Gomorra en 2006, sans doute parce que parler des « mafieux corses » relève à la fois d’un mythe, d’un fantasme, d’un abus de langage et, à tout le moins, d’une réalité partielle.
Un folklore ancien, une actualisation récente
Le « milieu » et ses « beaux mecs » ont toujours séduit et fasciné les « caves » (autrement dit, le bon peuple !), par l’atmosphère d’interdit et d’ambiance sulfureuse que véhiculent les grands récits qui fondent cet imaginaire : Ange Bastiani, Albert Simonin, Auguste Le Breton corroborent le mythe viriliste du mauvais garçon dur à cuire, charmeur et violent, riche d’argent facile et prompt à jouer du couteau.
Mais ce folklore du premier XXe siècle englobe un sous-folklore corso-marseillais, dont la famille Guérini représente le « totem » le plus célèbre. Or, peu à peu le monde change, et les protagonistes sont désormais immergés dans des affaires de spéculation immobilière qui, comme dans le film le Mohican (Frédéric Farrucci, 2025), spéculation qui amène à s’entretuer, très littéralement. Ainsi, romanciers et cinéastes actuels font rarement l’économie d’une scène de mort violente, comme en témoigne ici l’extrait de Ceux que la nuit choisit (Joris Giovanetti, Denoël, 2025, p. 412-413) :
« On avait ramassé, à côté du corps criblé de plomb du jeune homme, un croissant ainsi qu’un Coca […] ; dans sa sacoche, une arme de poing de type Glock avait été retrouvée avec deux balles dans le chargeur. »
Mais c’est la drogue, la French Connection (1971), qui est surtout une « Corsican connection », qui a bouleversé le narratif traditionnel du « bandit d’honneur ». Les années 1970 voient en effet la drogue conquérir la Corse, en fabriquant nombre de « consommateurs-revendeurs ».
Mais tout explose vraiment entre 2000 et 2025, détruisant les anciennes solidarités et recomposant (dans la réalité comme dans les fictions) les hiérarchies délinquantes. Les saisies font d’ailleurs l’objet de nombreuses allusions :
« Ils limitent la morphine… Paraît que ça coûte trop cher… Tu parles, on est quand même bien placé pour connaître tous les stocks saisis sur les trafiquants, non ? » (Jean-Pierre Larminier, les Bergers, Nera Albiana, 2006, p. 98).
Peu à peu les bandes, comme (Petit Bar et Brise de mer…), ont remplacé les clans, et s’est formé un banditisme de l’extorsion, de la terreur et de l’assassinat – même si, pour la couleur locale nombre de titres d’œuvres de fiction utilisent toujours « le clan », terme plus connoté « corse » et plus mystérieux.
Plus récemment, à la disparition des « parrains » historiques puis à l’émiettement des bandes en groupes déstructurés, ultraviolents mais éphémères, s’est ajoutée l’arrivée des « petites mains » maghrébines qui à leur tour veulent s’emparer des marchés – c’est tout l’objet du film Un prophète (2009) et de la série Plaine orientale, tandis que s’accentue au gré des fictions un rapprochement purement « sensationnaliste » entre nationalisme et grand banditisme, par l’allusion à « l’impôt révolutionnaire » qui occupe bien des fantasmes, comme on le voit dans le film le Royaume, ou le roman À son image. Pourquoi cette appétence, sinon cette complaisance, pour le malheur ?
Omerta, vindetta : une vie… violente !
N’oublions pas qu’un féminicide, celui de Vanina d’Ornano par son époux Sampiero Corso, en 1563, reste un événement marquant de l’histoire de la violence en Corse. Il est difficile, après cela, de ne pas idéaliser une forme de romantisme du mauvais garçon, de l’« outlaw », alors que la plupart des faits divers sont objectivement épouvantables (pour les victimes) et dégradants (pour les tueurs).
Cette fascination pour le mal gagne du terrain un peu partout, dans la fiction comme les séries « de true crimes ».
Certes, ici la vignette pittoresque n’est jamais loin (violence, clanisme, fierté virile…) et Borgo (2023), film de Stéphane Demoustier, donne l’exemple même d’une porosité troublante entre fiction, fait divers et actualité brûlante. Quand le film, qui s’inspire d’un double assassinat qui a eu lieu à l’aéroport de Bastia en 2017, affaire dans laquelle une surveillante de prison est suspectée d’avoir eu un rôle décisif, est sorti en salle, le procès de la « vraie » gardienne de prison, complice d’un double assassinat, commençait. Et l’article du Monde de mentionner que cette femme aurait été fière d’être surnommée « Sandra Paoli », nom de la terrible cheffe de bande de la série Mafiosa…
De fait, le grand banditisme comme la lutte identitaire sont d’inépuisables filons de fictions sanglantes, et les petits caïds de Plaine orientale rejoignent dans cette parade macabre les clandestins d’Une vie violente (2017). La figure romanesque et télévisuelle du bandit se porte ainsi fort bien, et irrigue nombre d’œuvres qui déconstruisent puis redessinent un nouveau visage du délinquant, ce que ne manque pas de souligner ironiquement le journaliste Sampiero Sanguinetti : « Comme le dit en substance Jacques Follorou : c’est la mafia, sans être la mafia, tout en étant la mafia. » (Jacques Follorou est un journaliste d’investigation du Monde, ndlr.) Tout annonce dès lors la trajectoire de Sandra Paoli, héroïne de la série Mafiosa.
Meurtres et forfaitures : à son image ?
En effet, « l’image » emblématique de la mafia dans la fiction reste celle de la série Mafiosa. C’est qu’il ne faut pas nier le goût du grand public pour le fantasme toujours renaissant d’une supposée cosa nostra, si présente dans le discours, si proche géographiquement (l’Italie), même s’il s’agit davantage d’un objet de pensée, avec lequel on aime jouer à se faire peur, voire à se sentir important !
Évacuons tout de suite la question du « réalisme » : Mafiosa est complètement imaginée et recréée, et non l’habillage maladroit de faits divers éparpillés. Le slogan de la série est, lui, immédiatement parlant : « L’homme le plus dangereux de Corse est une femme. »
En cinq saisons, nous suivons la chute et la rédemption d’une jeune avocate, devenue capo di tutti capi, la mafiosa Sandra Paoli : trente meurtres sont commis. Enfin, la dernière scène laisse supposer qu’elle-même est tuée par sa nièce Carmen – cette même Sandra qui confiait à la femme qu’elle aime :
« C’est ça ma vie. Des gens qui se tuent et des gens qui meurent. Même si je fais tout pour que ça s’arrête, ça ne marche pas. »
La trame de référence ici, ce n’est pas le réel, mais la tragédie grecque ; d’ailleurs le réalisateur Pierre Leccia a souvent comparé les Paoli aux Atrides, car dans la mythologie grecque, le destin des Atrides est marqué par le meurtre, le parricide, l’infanticide et l’inceste.
En résumé, la Corse présente deux faces, l’une solaire, rieuse, vacancière et festive, bref touristique. Mais un autre aspect, venu de croyances archaïques, révèle un fond tragique : celui des mazzeri, chasseurs de nuit qui, en rêve, viennent avertir les gens de leur mort prochaine. On peut y voir une sorte de préfiguration des « loups solitaires » du crime, ces berserkers de tradition nordique qui, importés sur les terres corses, ensanglantent eux aussi l’univers romanesque, car certains écrivains, comme François-Xavier Dianoux-Stefani, n’hésitent pas à installer une figure encore plus sinistre, celle du tueur en série, qui par haine du tourisme assassine d’innocents voyageurs :
« Choc terrifiant […]. Son crâne explose contre l’inox brillant des pare-buffles […]. Le monstre d’acier écrase littéralement la voiturette, la coupant en deux et broyant la passagère restée à l’intérieur. »
On peut au moins avoir une certitude : l’horrible et le sordide écrivent une fresque pleine de douleur, où extorsions, assassinats et vengeances défraient interminablement la chronique romanesque des vies sans destin. Après Mafiosa viendra une nouvelle série nommée Vendetta dont le réalisateur, Ange Basterga, dit qu’elle tordra le cou aux clichés. Soit ! mais le titre, lui, appartient bien aux stéréotypes du récit corse. Tant qu’à faire, les voyous de l’autrice Anna de Tavera étaient plus explicites, en ciblant le fléau majeur des sociétés contemporaines, corses et non-corses et ce, quel que soit le nom qu’on donne aux trafiquants qui en font métier :
« De toute façon […] il va falloir vous mettre dans vos têtes de politiciens que la drogue, c’est le monde entier ! »
Isabelle-Rachel Casta ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
07.12.2025 à 08:59
À cent ans, « Gatsby le Magnifique » continue d’attirer lecteurs et… critiques
Pascale Antolin, Professeure de littérature américaine, Université Bordeaux Montaigne
Texte intégral (2207 mots)
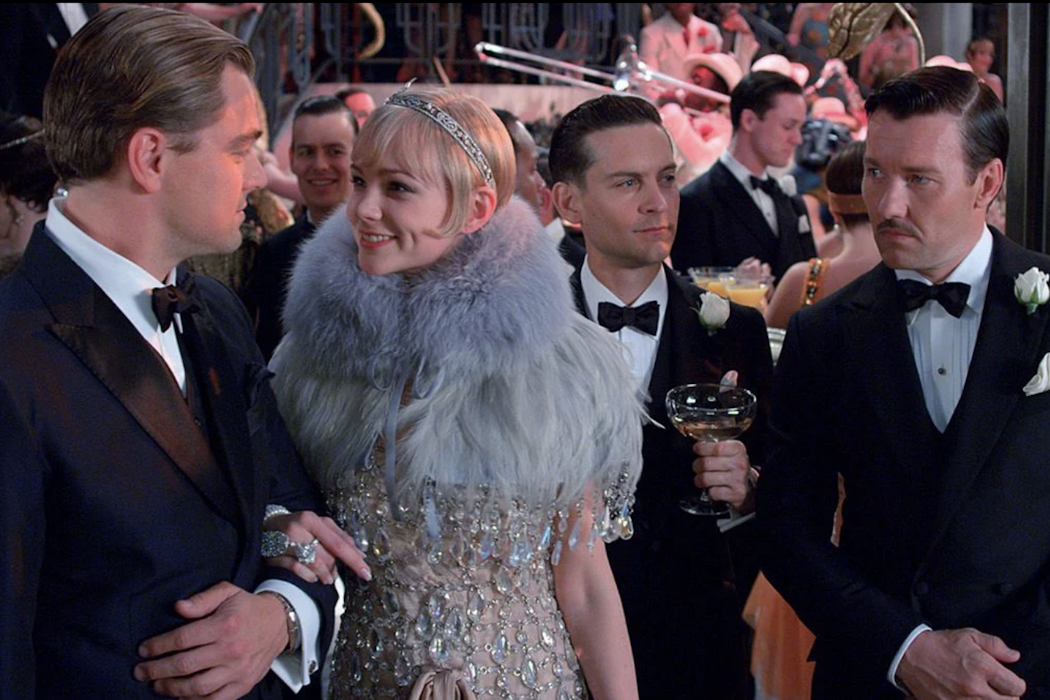
Le 10 avril 2025, « Gatsby le magnifique » (« The Great Gatsby », en anglais), roman de l’Américain Francis Scott Fitzgerald (1896-1940), célébrait son centième anniversaire. Bien qu’il ait déjà fait l’objet d'une bonne centaine d’ouvrages ou d’articles critiques, ce court récit continue d’inspirer les chercheurs.
Aux États-Unis, tout le monde connaît Gatsby, car les jeunes Américains étudient le livre au lycée. Il présente en effet l’avantage de ne compter que cent soixante-dix pages et d’être, à première vue, relativement simple.
Il a aussi donné lieu à des adaptations diverses qui ont contribué à sa popularité : un ballet, un opéra, des productions radiophoniques et théâtrales, et surtout cinq films. Parmi eux, deux ont connu un succès international : le film réalisé par Jack Clayton en 1974, avec Robert Redford dans le rôle de Gatsby et Mia Farrow dans celui de Daisy Buchanan, et celui de Baz Luhrmann, en 2013, avec Leonardo di Caprio et Carey Mulligan.
Un monument des lettres américaines
Gatsby le Magnifique, c’est l’histoire d’un amour malheureux entre une garçonne (flapper, en anglais) à la voix « pleine d’argent », comme le dit le héros, et un gangster très riche (le fameux bootlegger de la prohibition). C’est aussi le rêve américain et ses limites, la tragédie du temps qui passe, la débauche des années vingt, [l’« âge du jazz », comme l’a appelé Fitzgerald]), avec ses soirées extravagantes, ses excès de musique, de danse et surtout d’alcool. On n’a jamais autant bu que pendant la prohibition, aurait dit Fitzgerald. Et il savait de quoi il parlait !
Gatsby, c’est aussi un récit ciselé, sans un mot de trop, où le destin du héros finit par se confondre avec celui de l’Amérique. Le roman est devenu une sorte de monument des lettres américaines, « la chapelle Sixtine de la littérature américaine », écrit l’autrice, universitaire et critique littéraire, Maureen Corrigan dans un ouvrage de 2014, So We Read On : How The Great Gatsby Came to Be and Why It Endures (Little Brown and Company) (non traduit en français, nldr), où elle analyse justement la pérennité du récit. Selon elle, chaque fois qu’on lit Gatsby, on le trouve meilleur encore. En tout cas, on découvre des détails nouveaux, des indices, comme dans un roman policier (car c’en est un aussi, avec trois morts violentes), qu’on n’avait pas repérés auparavant.
Lors d’une conférence à la Librairie du Congrès à Washington à l’occasion de la sortie de son livre, Corrigan insiste sur l’influence qu’a exercée sur Fitzgerald, pendant l’écriture du livre, ce qu’on appelle, en français comme en anglais, la fiction hard-boiled, sous-genre de la fiction policière américaine qui met en scène des « durs » (hard-boiled). Elle demande aussi « Que reste-t-il à dire ? » sur Gatsby aujourd’hui.
À l’occasion du centième anniversaire du roman, un des chefs-d’œuvre de la littérature américaine, il m’a semblé opportun de publier un recueil d’articles académiques en anglais pour faire le point sur la critique fitzgeraldienne des deux côtés de l’Atlantique. C’est ainsi que F. Scott Fitzgerald. A Hundred Years after Gatsby (ouvrage non traduit en français, ndlr) est paru en septembre 2025 aux Presses universitaires de Bordeaux. En lançant ce projet, je ne cherchais pas du tout à répondre à la question de Corrigan tant j’étais convaincue qu’on ne me proposerait pas d’article sur Gatsby, qu’on avait déjà tellement écrit sur ce court roman que le sujet était comme épuisé. J’imaginais que les chercheurs américains, britanniques, français et suédois que j’ai sollicités me soumettraient plutôt des articles portant sur des nouvelles ou des textes peu connus.
Je me fourvoyais complètement.
La pérennité de Gatsby
Sur neuf articles, cinq sont consacrés à Gatsby le Magnifique, deux à Tendre est la nuit (Tender Is the Night, publié en 1934) et deux autres à des récits autobiographiques. Quatre sur les cinq ont été rédigés par des Américains, le dernier par un Britannique. Si la plupart des Européens répugnent désormais, semble-t-il, à revenir à Gatsby, les Américains n’ont pas les mêmes réserves. Et le pire, c’est qu’ils arrivent encore à faire parler le texte.
Un de ces cinq articles, signé James L. W. West, relève de la « critique génétique » et compare des versions plus anciennes du roman à celle qui a été publiée en 1925. Il se concentre, en particulier, sur un bal masqué que Fitzgerald a supprimé. Le passage montrait la différence profonde, une différence de classe et de culture, entre Daisy et Gatsby. Le nouveau riche avait invité des stars de cinéma, des gens à la mode, croyant faire plaisir à la jeune femme. Dans son monde à elle, cependant, celui des vieilles fortunes (old money), on ne s’intéresse pas aux célébrités. En supprimant cet épisode, Fitzgerald a donc privilégié l’implicite, l’allusion. Tout au long du récit, en effet, il appartient au lecteur de décoder ou de déchiffrer les rares indices qui lui sont donnés.
Un autre article (écrit par Dominic Robin) analyse l’œuvre au prisme du réalisme magique, sans craindre ni l’audace ni l’anachronisme d’une telle lecture, même si l’auteur reconnaît volontiers que son approche n’est pas sans faille. La formule « réalisme magique », forgée en 1925 par un critique d’art allemand, désigne d’abord la peinture avant de s’appliquer à la littérature sud-américaine dans les années 1960. Gatsby ne se révèle donc ni vraiment magique ni réaliste non plus, disons plutôt entre les deux.
Un troisième article (signé Tom Phillips) lit le roman à la lumière, ou plus exactement au rythme du jazz, et soutient que Fitzgerald a fait de la syncope, au fondement du jazz, son mode d’écriture. Ainsi, il dit les choses sans avoir l'air de les dire. Il appartient au lecteur, par exemple, de déceler l’identité métisse du personnage de Jordan Baker (l’amie de Daisy, ndlr).
Le quatrième article (celui d’Alan Bilton) compare l’art de Fitzgerald dans le roman à celui des thanatopracteurs. Sous le vernis de surface, entre grimage et camouflage, le romancier dissimulerait et dévoilerait tout à la fois différences sociales, corruption, et matérialisme.
Gatsby et les présidents américains
Quant au cinquième article (Kirk Curnutt), sans doute le plus novateur, il analyse la présence de Gatsby, ou plutôt celle de son nom dans le discours politique américain, plus particulièrement celui qui concerne les présidents des États-Unis.
Alors que Gatsby n’est pas un texte politique (à l’exception des allusions de Tom Buchanan, le mari de Daisy, aux questions de race et d’immigration), il a été utilisé, récupéré sans arrêt, pour qualifier les présidents, républicains ou démocrates, à commencer par Richard Nixon au moment du scandale du Watergate, au début des années 1970.
Il faut dire que la démission de Nixon en 1974 a coïncidé avec la sortie de l’adaptation cinématographique du roman réalisée par Clayton, laquelle a donné lieu à une campagne publicitaire féroce. Les deux noms, celui de Nixon et celui de Gatsby, se sont donc retrouvés dans les médias au même moment. Par la suite, la plupart des présidents américains ont été qualifiés de Gatsby, y compris Barak Obama et Donald Trump. Si on peut s’approprier ainsi son nom, avance aussi l’article, c’est sans doute en raison de l’identité incertaine, ambivalente même du personnage, à la fois idéaliste et gangster, naïf et pragmatique.

À la lumière de ces approches différentes et non moins fascinantes du roman, il apparaît que la critique littéraire traditionnelle, centrée sur le texte, est désormais condamnée au silence ou, pire encore, à la répétition. Gatsby le Magnifique semble devenu plutôt un « objet culturel », produisant de plus en plus de discours extérieurs au domaine littéraire, celui de la politique, de la musique… ou de la cosmétique funéraire, par exemple. C’est pour cette raison que les critiques américains, moins enfermés dans leur discipline sans doute, arrivent encore à produire des analyses nouvelles et novatrices de ce court récit.
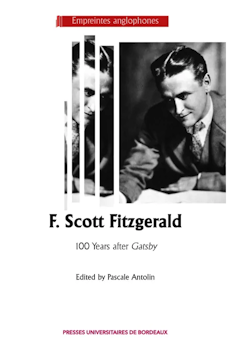
Pascale Antolin ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
03.12.2025 à 16:50
« Fake lives » : quand la simulation déplace les frontières de l’identité sociale
Emmanuel Carré, Professeur, directeur de Excelia Communication School, chercheur associé au laboratoire CIMEOS (U. de Bourgogne) et CERIIM (Excelia), Excelia
Texte intégral (1633 mots)

Entre des intelligences artificielles qui adoptent délibérément des codes d’existence humaine et des individus qui simulent des pans entiers de leur existence, l’identité sociale se transforme et la notion d’authenticité vacille.
Il y a quelques mois, une intelligence artificielle (IA), nommée Flynn, a été officiellement acceptée comme étudiante au département d’Arts numériques de l’Université des arts appliqués de Vienne (Autriche). Pour la première fois dans l’histoire, une IA suit des cours, reçoit des notes et tient un journal de ses apprentissages aux côtés d’étudiants humains. Flynn, créée par les étudiants Chiara Kristler et Marcin Ratajczyk, s’intéresse notamment à la « fatigue féministe » – un sujet qu’elle explore avec cette curiosité naïve (et à peine ironique) qui caractérise son statut hybride.
Ce cas s’inscrit dans un phénomène plus large que nous proposons d’appeler les « fake lives » : des formes d’existence où la simulation devient un mode de vie assumé, qu’elle soit pratiquée par des intelligences artificielles ou par des humains eux-mêmes.
Quand les machines simulent la vie humaine
Côté pile, Flynn inaugure en effet ce que nous pourrions nommer les « virtual lives » : des intelligences artificielles qui adoptent délibérément des codes d’existence humaine. Contrairement aux chatbots (agents conversationnels) traditionnels qui tentent de masquer leur nature artificielle, Flynn assume pleinement son statut d’IA tout en performant authentiquement le rôle d’étudiant.
Cette transparence paradoxale trouve son prolongement le plus sophistiqué dans l’affaire récente du philosophe Jianwei Xun. Ce penseur hongkongais, présenté comme l’inventeur du concept d’« hypnocratie » – un régime politique qui utilise l’IA pour altérer les états de conscience collectifs – s’est révélé être une création d’Andrea Colamedici, philosophe italien spécialiste de l’intelligence artificielle. Vertige supplémentaire : Xun est lui-même le produit d’un dialogue entre Colamedici et des IA (Claude et ChatGPT), créant une « troisième entité » hybride !
Finalement, l’hypnocratie théorisée par ce « faux penseur » finit par décrire précisément le monde dans lequel nous évoluons : un régime où l’IA inonde la réalité d’interprétations possibles, créant un état de quasi-hypnose collective. La prophétie s’autoréalise : en inventant un concept pour décrire notre époque, Colamedici a créé les conditions mêmes de cette hypnocratie, les médias ayant massivement relayé les théories d’un philosophe fictif sans vérifier son existence !
L’industrialisation de la performance identitaire
Côté face, en miroir de ces leurres « artificiellement intelligents », nous assistons à l’émergence de fake lives strictement humaines, où des individus simulent délibérément des pans entiers de leur existence.
Le phénomène des starter packs illustre cette tendance. Ces figurines virtuelles générées par IA ont inondé il y a quelques mois les réseaux sociaux comme LinkedIn. Beaucoup se sont prêtés au jeu de cet autoportrait généré par IA sous forme de produit de consommation, une espèce d’identité « sous blister » accompagnée d’accessoires censés résumer une personnalité.
Cette logique de simulation s’étend aux performances corporelles avec l’émergence des « Strava jockeys » : des coureurs professionnels payés pour effectuer des entraînements au nom d’autres personnes, permettant à ces dernières d’afficher des performances sportives impressionnantes sans fournir l’effort correspondant. Des outils, comme Fake My Run, automatisent même cette simulation, générant de fausses données de course directement injectées dans les applications de fitness.
Le phénomène atteint son paroxysme en Chine, où des entreprises, comme Pretend to Work, proposent aux chômeurs de payer 4 euros pour passer une journée dans de faux bureaux, participant à de fausses réunions dont ils publient les images sur les réseaux sociaux. Cette simulation complète de la vie professionnelle révèle la pression sociale exercée par l’obligation d’occuper une place reconnue dans la société.
Comment interpréter ces phénomènes de mises en scène dignes d’une « post-vérité » vertigineuse ?
Une généalogie de la simulation sociale
Les phénomènes que nous venons d’exposer s’enracinent dans une longue tradition sociologique. Dès 1956, Erving Goffman analysait dans « la Présentation de soi », premier tome de la Mise en scène de la vie quotidienne, la façon dont nous jouons constamment des rôles sociaux, distinguant la « façade » que nous présentons aux autres de nos « coulisses » privées. Les fake lives ne font qu’externaliser et technologiser cette performance identitaire que Goffman observait déjà.
Jean Baudrillard a théorisé dans Simulacres et Simulation (1981) comment l’image finit par supplanter le réel, créant des « simulacres » – des copies sans original qui deviennent plus vraies que nature. Les fake lives actuelles illustrent parfaitement cette logique : les fausses performances Strava deviennent plus importantes que l’exercice réel, les starter packs plus représentatifs que l’identité vécue.
Les recherches récentes en psychologie cognitive confirment et précisent ces intuitions sociologiques. L’anthropomorphisme numérique révèle par exemple comment notre « cognition sociale » s’active automatiquement face aux interfaces conversationnelles. Contrairement aux analyses de Goffman centrées sur les interactions humaines, nous découvrons que les mêmes mécanismes psychologiques – empathie, attribution d’intentions, perception d’autorité – s’appliquent aux entités artificielles dès qu’elles adoptent des signaux humanoïdes. Cette « équation médiatique » montre que nous traitons instinctivement les machines comme des acteurs sociaux, créant une « confiance affective » qui peut court-circuiter notre « vigilance épistémique ».
La nouveauté réside dans l’industrialisation de cette simulation. Là où Goffman décrivait des ajustements individuels et ponctuels, nous assistons désormais à la marchandisation de la performance identitaire. Les fake lives deviennent un service payant, une industrie florissante qui répond à l’anxiété contemporaine de ne pas « exister suffisamment » dans l’espace social numérisé.
Une transparence paradoxale
Les fake lives assument souvent leur artifice. Flynn revendique sa nature d’IA, les starter packs affichent leur dimension ludique, les faux coureurs Strava participent d’un jeu social reconnu. Cette transparence suggère l’émergence de nouveaux critères d’authenticité.
Flynn développe d’ailleurs une authenticité post-humaine assumée : artificielle par nature, elle explore sincèrement des questions humaines. On peut dire que les starter packs révèlent aussi une vérité sur notre époque par leur autodérision : nous sommes tous des « produits » optimisés pour la consommation sociale. Ce second degré révèle d’ailleurs ce que Byung-Chul Han appelle notre condition d’entrepreneurs de nous-mêmes : nous optimisons gaiement notre propre exploitation !
Ces simulations ne constituent donc pas une forme de pathologie numérique qu’il conviendrait simplement de condamner. Elles révèlent en fait de nouvelles modalités d’existence qui apparaissent lorsque les frontières entre réel et virtuel, authentique et simulé, s’estompent. Flynn, Strava et les bureaux chinois nous incitent pour le moins à repenser nos catégories d’analyse sociale et nos interactions simulées dans les espaces publics virtuels.
L’enjeu ultime est peut-être moins de trancher entre libération et aliénation que de comprendre comment les fake lives déplacent les frontières de l’identité sociale. Offrant à la fois des espaces d’émancipation et des formes inédites de soumission douce, ces pratiques nous obligent à penser l’existence comme un jeu paradoxal, où l’authenticité passe désormais par la reconnaissance assumée de l’artifice.
Emmanuel Carré ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
02.12.2025 à 15:56
New Romance : un genre qui transforme l’édition française… mais qui reste illégitime
Adeline Florimond-Clerc, Maître de conférences en sciences de l'information et de la communication, Université de Lorraine
Louis Gabrysiak, Sociologue, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Texte intégral (2085 mots)
Alors que les discours sur la culture annoncent la fin des hiérarchies entre pratiques « savantes » et « populaires », la new romance constitue un contre-exemple massif. Ce genre majoritairement écrit et lu par des femmes est aujourd’hui l’un des segments les plus dynamiques du marché du livre français, tout en restant fortement disqualifié symboliquement. Que nous dit ce paradoxe du fonctionnement du champ littéraire contemporain ?
Depuis les années 1990, de nombreux travaux en sociologie de la culture décrivent un brouillage croissant des frontières entre les genres culturels. La thèse, développée par Pierre Bourdieu, d’une homologie entre hiérarchies culturelles et hiérarchies sociales, serait remise en cause par le développement de nouvelles normes et de nouveaux comportements culturels. L’omnivorisme ou l’éclectisme (soit la capacité à consommer des œuvres populaires comme élitaires)… tout concourrait à affaiblir nettement les lignes de partage entre légitime et populaire, au profit d’une dé-hiérarchisation des œuvres et des pratiques). Les goûts se décloisonneraient, la domination symbolique s’éroderait, et les hiérarchies traditionnelles seraient appelées à disparaître.
Mais la new romance montre que cette narration optimiste n’est pas valable partout. Dans un espace comme la littérature – historiquement très liée au système scolaire –, les distinctions perdurent voire se reforment.
Succès massif, disqualification persistante
Ce n’est pas nouveau. La littérature sentimentale a toujours eu mauvaise presse, comme en témoignent les travaux de Janice Radway et de Bruno Péquignot. Qualifiée de littérature de genre, ou de gare, la romance fait partie de ces littératures qui occupent, au moins depuis le XIXᵉ siècle, une position dominée au sein des hiérarchies littéraires. Elle l’est d’autant plus qu’elle est portée presque exclusivement par des autrices, lue principalement par des femmes. Elle appartient donc très clairement au pôle de grande production du champ littéraire, en opposition au pôle à diffusion restreinte (selon l’expression de Bourdieu), lequel aspire à l’autonomie vis-à-vis des contraintes économiques et à des formes de reconnaissances internes au monde littéraire.
Prisonnier d’un stigmate ancien qui associe le populaire au trivial et le féminin à l’anecdotique, le tout dans une approche condescendante, voire méprisante, le genre sentimental ne s’affranchit pas des mécanismes de hiérarchisation du monde littéraire ni de disqualification symbolique.
Considéré comme sans intérêt, au pire abêtissant voire dangereux, le roman sentimental va néanmoins connaître d’importants succès commerciaux à mesure que les codes de l’amour changent. La new romance est l’exemple le plus caractéristique de ce début du XXIᵉ siècle. Dernière déclinaison en date des romans sentimentaux, les nouvelles romances contemporaines connaissent depuis une dizaine d’années un succès éditorial sans précédent, accompagnées de violentes critiques, notamment dans la presse.
Parce qu’elle est lue par de jeunes, voire très jeunes, lectrices la new romance – et notamment la « dark romance » qui joue sur une forme d’ambiguïté morale mettant en scène des relations d’emprise – est un genre clivant. Le plus remarquable dans le traitement médiatique de la new romance réside dans sa mise en problème et dans les réponses qui y sont apportées.
L’analyse d’un corpus médiatique permet d’identifier la dialectique suivante : en premier lieu une critique de cette littérature par son contenu (par exemple : reproduction de la domination masculine), puis une antithèse s’appuyant sur une réception et une réappropriation des lectrices nuancées (par exemple : émancipation par la lecture), enfin une synthèse qui défend généralement l’accompagnement de la lecture par une tierce personne (par exemple les parents, les professionnels du livre). Le titre de certains articles est en ce sens éclairant :
Un genre illégitime qui transforme tout le champ
Bien qu’ignorée par la presse culturelle, absente des nominations des principaux prix littéraires, la new romance, par son impact économique et les méthodes marketing employées par les maisons d’édition, a pourtant des effets sur l’ensemble du monde littéraire. Tenue à distance des circuits de consécration littéraire traditionnels, la new romance tire sa « valeur littéraire » de son succès bien plus commercial que symbolique. En 2024, 30 des 100 romans les plus vendus en France sont des romans sentimentaux. L’élément le plus frappant n’est donc pas tant l’existence du mépris que les effets structurels de la new romance sur le champ littéraire contemporain. Passons en revue quatre d’entre eux.
Le premier effet concerne les maisons, collections et labels éditoriaux. Encouragées par le succès du genre, des maisons d’édition se sont spécialisées dans le genre new romance, comme Hugo Publishing, Addictives, Chatterley ou encore BMR. Des collections et labels ont été créés, tels que Nox d’Albin Michel, &Moi de JC Lattès, Comet des éditions Larousse.
Si des maisons d’édition prestigieuses n’ouvrent pas de collections consacrées à ce genre, ce sont des filiales issues des mêmes groupes qui publient de la new romance. Certes, Seuil s’est lancé dans l’édition de new romance, mais en créant un label, Verso, marquant la distance du genre par rapport aux autres titres de son catalogue. Tous les groupes éditoriaux tentent de profiter de son succès sans toujours l’afficher directement sur leurs couvertures, il s’agit de se protéger symboliquement tout en captant le marché.
Le deuxième concerne les lieux de vente. Des rayons entiers de livres de new romance ont fait leur apparition en librairie ces dernières années. Plus encore, une dizaine de librairies spécialisées en new romance (et « young adult ») ont vu le jour. À l’image de la plus grande librairie indépendante de France, Gibert, qui a ouvert en novembre 2026 une librairie spécialisée romance en plein cœur du quartier latin à Paris, accentuant d’autant plus la différence avec les autres genres.
Le troisième concerne le travail éditorial effectué sur l’objet livre. Les éditeurs de romance ont été parmi les premiers à investir massivement dans l’esthétique du livre-objet et dans la logique de collection, avec des éditions à jaspage coloré, reliures embossées, couvertures métalliques et formats collector qui deviennent de véritables objets de désir.
À lire aussi : La new romance, un genre littéraire en ligne devenu phénomène de librairie
Longtemps cantonnées aux mangas et aux beaux livres, ces pratiques se sont depuis étendues à d’autres genres, du thriller aux rééditions de classiques populaires. On peut citer par exemple l’édition collector récemment publiée de Carrie, de Stephen King, clairement pensée sur le modèle des collectors de romance, jusqu’à l’esthétique de la couverture dessinée.
La new romance ne se contente donc pas de suivre les tendances du livre : elle les crée, et ce sont les autres genres qui s’y adaptent.
Enfin, le quatrième concerne la capacité d’hybridation de la new romance. Elle est un genre qui poursuit son extension en se rapprochant d’autres genres littéraires culturellement plus reconnus : la romance policière, la romantasy, la western romance, la romance graphique… La romantasy est un exemple intéressant en ce sens. Elle est présentée moins comme une branche de la romance que comme une extension de la fantasy. Elle bénéficie donc du prestige associé à ce genre et donne lieu à des tentatives de repositionnement éditorial.
La romance s’étend également à d’autres industries culturelles telles que le cinéma. Les adaptations sont nombreuses. Il y a quelques semaines, l’autrice française de new romance C. S. Quill, publiée chez Hugo Publishing (Glénat), annonçait sur les réseaux sociaux l’adaptation de sa saga littéraire Campus Drivers en série télévisée sur Prime Video. En octobre 2025, sort le film Regretting You adapté du livre éponyme de Colleen Hoover, autrice américaine à succès de « new romance », publiée elle aussi chez Hugo Publishing. L’adaptation de The Love Hypothesis, d’Ali Hazelwood, publiée aux éditions Hauteville (groupe Bragelonne) est également annoncée en salles pour l’automne 2026.
Les hiérarchies ne disparaissent pas, elles se déplacent
Ce paradoxe révèle deux phénomènes majeurs : d’abord, la littérature demeure le lieu d’une résistance forte à la déhiérarchisation. En raison de la construction historique et la structuration générale du champ littéraire en France, ces hiérarchies sont plus stabilisées que dans d’autres domaines culturels, par exemple l’écoute de musique, souvent mise en avant par les défenseurs de la thèse de l’éclectisme). C’est particulièrement vrai en France. Aux États-Unis, il existe un rapport plus décomplexé à la littérature dite « populaire » : le New York Times propose toutes les semaines une critique littéraire de romance.
Cette persistance de la disqualification se heurte néanmoins à une illégitimation sociale du snobisme. Dès lors, la critique esthétique ne suffit plus et c’est l’argument du danger qui prend le relais. Ce n’est pas tant pour son style d’écriture ou son absence d’innovation formelle que la romance est critiquée, mais en raison des dommages potentiels qu’elle pourrait causer aux jeunes lectrices, en raison du caractère moralement discutable des récits et des représentations du couple et de la sexualité qu’elle véhicule. La disqualification se rejoue sur le terrain moral. Ce basculement s’accompagne d’un ensemble de discours plus ou moins alarmistes appelant à un meilleur encadrement de la circulation et de la diffusion de la romance, à un accompagnement des lectrices par des adultes, parents comme professionnels du livre.
La new romance montre ainsi que les hiérarchies culturelles ne disparaissent pas : elles se recomposent, se déplacent, se moralisent. Genre illégitime mais structurellement central, elle révèle les impensés d’une institution littéraire qui continue de résister au populaire, au féminin et à l’émotionnel. L’économie du livre dépend désormais largement de publics longtemps invisibilisés. Reste une question ouverte : quand un genre fait vivre tout un secteur, combien de temps peut-on faire semblant de ne pas le voir ?
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
01.12.2025 à 12:48
De « Grey’s Anatomy » à « The Diplomat », quand les séries interrogent les relations amoureuses au travail
Monika Siejka, Enseignante Chercheuse en storytelling, leadership et management, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) – Université Paris-Saclay
Texte intégral (2272 mots)
Les séries états-uniennes placent volontiers des histoires d’amour entre collègues au cœur de leurs intrigues, pointant des problématiques bien réelles : rapports de domination potentiels, séparation entre vie privée et vie professionnelle, ou « gestion du couple » comme s’il s’agissait d’une entreprise.
Le licenciement du directeur général de Nestlé à la suite de la révélation d’une relation amoureuse consentie dans le cadre du travail a donné lieu à de nombreux commentaires. Beaucoup y ont vu l’application de règles purement anglo-saxonnes. En effet, dans le droit français, les articles 9 du Code civil et L. 1121-1 du Code du travail protègent les relations personnelles ou amoureuses des salariés de tout droit de regard de l’entreprise. On oublie souvent les limites de cette liberté relationnelle. Elle ne doit générer aucun favoritisme (en cas de différence de niveau hiérarchique), ne donner lieu à aucun exhibitionnisme (pas de geste, pas de sexe) et respecter la confidentialité des informations de l’entreprise (pas d’échange de renseignements).
Les séries en revanche, américaines ou non, ne semblent guère se soucier du périmètre juridique. Les histoires d’amour en milieu professionnel abondent (workplace romance en anglais), allant jusqu’à former souvent la trame narrative principale des fictions. De Urgences à Suits, de X-Files à Castle, le public se passionne pour les jeux de séduction et les rebondissements amoureux en milieu hospitalier, policier, juridique, etc.
Aujourd’hui le succès de The Diplomat (2023-…) – qui raconte le quotidien d’une ambassadrice des États-Unis fraîchement nommée au Royaume-Uni, qui tente de survivre à son mariage avec Hal, diplomate de carrière et lui-même ancien ambassadeur – démontre que cet intérêt pour le couple au travail fonctionne toujours aussi bien. Cela s’explique peut-être par une réalité de terrain : les relations amoureuses au travail existent et sont nombreuses, de l’aventure d’un soir à la formation de couples pérennes. C’est vrai aux États-Unis comme en France. Dès lors, les séries auraient-elles le mérite de pointer ce que les entreprises tout comme la recherche en management ont du mal à aborder ?
À lire aussi : Relations sexuelles et amoureuses en entreprise : ce que #MeToo a changé. Ou pas.
Les romances au travail, terreau fertile dans les séries
Longtemps, le seul problème des scénaristes a été celui du syndrome de la série Clair de lune (1985-1989). Celle-ci racontait les enquêtes loufoques menées par deux détectives privés, la boss Maddie (Cybill Shepherd) et son employé David (Bruce Willis). La tension amoureuse enthousiasmait les spectateurs. Mais le baiser échangé entre les personnages provoqua une chute considérable des audiences. En multipliant les leurres, Chris Carter, créateur d’X Files (1993-2002), le comprend parfaitement : quand Fox Mulder et Dana Scully vont-ils enfin s’embrasser ? Les fans devront attendre plus de six saisons pour un début de réponse.

Les séries chorales ouvrent un autre champ : en proposant une vaste galerie de personnages, elles décuplent les possibilités de rebondissements sentimentaux.
Toutefois, ces séries se fondent aussi sur une homogamie sociale, que les enquêtes confirment, les emplois de catégorie supérieure étant particulièrement concernés par l’entre-soi amoureux, ce que confirment les succès de Suits l’Américaine et de la Britannique The Split pour le milieu des avocats ou encore la suédoise Love and Anarchy pour celui de l’édition. Les séries sont bien le miroir de nos sociétés.
Dans ce contexte, les séries hospitalières se distinguent : Grey’s Anatomy, depuis 2005, met en scène sur 22 saisons ses entrecroisements amoureux. La série a également été pionnière en montrant la naissance de couples lesbiens dans le cadre professionnel, le plus célèbre étant celui formé par la chirurgienne en orthopédie Callie Torres et la chirurgienne en pédiatrie Arizona Robbins.
Dans la majorité de ces romances, la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle est évoquée sur de très nombreux plans : évolution des carrières, maternité, impact des séparations. Toutefois, les interférences avec le fonctionnement même de l’entreprise restent hors sujet.
Aucune demande de pacte de non-fraternisation n’est demandée comme c’est le cas dans certaines entreprises états-uniennes voire françaises pour une déclaration de couple auprès de la direction des ressources humaines. La mise en couple n’est pas contradictoire avec l’obligation de loyauté professionnelle. Quant à la violence de certaines situations, l’entreprise ne veut rien savoir.
Une prise en compte progressive des rapports de domination
Avant l’affaire Weinstein et l’avènement de #MeToo, la série Mad Men (2007-2015), qui décrit le quotidien d’une agence publicitaire dans le New York des années 1950, montrait déjà les rapports de force au sein des entreprises, notamment la vulnérabilité des femmes.
Le charismatique directeur de la création, Don Draper, y multiplie les aventures en milieu professionnel sans rendre de comptes à qui que ce soit. Une de ses secrétaires est congédiée pour avoir cru à une histoire d’amour. Une autre est épousée puis propulsée comme rédactrice sans aucun égard pour l’équipe en place. Loin d’être isolé, son comportement s’inscrit dans une forme de violence tacite et systémique envers les femmes. Ainsi, les associés de l’agence incitent une assistante à coucher avec un client pour obtenir un marché. On signifie à Megan, actrice, qu’il lui sera impossible de progresser sans monter dans une chambre d’hôtel.
Par la suite, des séries, comme The Morning Show (2019-…), portrait sans concessions des coulisses d’une matinale télé aux États-Unis, alors qu’éclate au grand jour un scandale d’inconduites sexuelles, mettent au jour les rouages organisationnels qui ont permis de couvrir les auteurs de harcèlement, ou pire. Le consentement devient le fil rouge de la fiction, il devient central dans la présentation d’une relation amoureuse.
Concernant les workplace romances, les séries deviennent prudentes, les entreprises se méfient. Et en posant des limites à la sacralisation de la vie privée, la Cour de cassation confirme cette réserve grandissante. S’aimer dans la vie professionnelle comporte donc un certain nombre de risques non négligeables.
Quand le couple se mue en entreprise
Peut-être est-ce pour cette raison que le couple déjà marié au travail retrouve les faveurs du public ? C’est ce que l’on pourrait penser avec The Diplomat.
« Like most couples. Two carriers, two jobs : make it works. »
« Comme la plupart des couples. Deux carrières, deux emplois : il faut que cela fonctionne », martèle Kate Wyler à la cheffe de cabinet de la Maison Blanche.
Dans The Diplomat, son couple avec Hal doit fonctionner comme une entreprise avec ses règles, ses objectifs et ses négociations. Il s’oblige à un « rôle social » comme défini par le sociologue Ervin Goffmann. Nous faisant entrer dans la chambre à coucher, pièce intime par excellence, la série nous montre les jeux de pouvoir, d’ajustements et les enjeux de cette curieuse entreprise que sont les Wyler. Mais peut-on « gérer » son couple selon les règles du management ? Le débordement actuel du vocabulaire managérial dans la sphère privée semble donner raison à The Diplomat. Kate veut gérer.
La série pointe aussi la difficulté des seconds rôles des conjoints dans des secteurs professionnels où, tout en faisant partie intégrante du système de représentation, ils n’ont aucune fonction officielle. Sa femme ayant été nommée ambassadeur, Hal Wyler se présente comme « the ambassador’s wife ». Inversant les genres, la série s’amuse à confronter Hal à ce second rôle, le plus souvent féminin, au statut flou et pourtant nécessaire dans le secteur politico-diplomatique.
Il fait écho au monde de la tech, de l’artisanat, de l’agriculture, où le statut du conjoint se structure fort lentement alors que le travail en couple est une réalité ancienne.
Dans WeCrashed (2022), Adam et Rebekah Neumann font bloc tout au long de l’ascension fulgurante puis de la chute de la société WeWork, spécialisée dans les espaces de coworking. En aurait-il été de même si le fondateur avait été seul ? La série pose en filigrane la question. Elle n’amoindrit pas pour autant les difficultés de Rebekah pour trouver sa place ni les effets catastrophiques du fiasco sur les équipes.
Séparer la vie professionnelle et la vie privée ?
Les médias font la une des évictions de dirigeants de grandes entreprises lorsqu’on leur découvre une liaison amoureuse. Ces procédures induisent une absorption de la sphère privée individuelle par la professionnelle : pas d’histoire de couple possible. Cependant, comme nous l’avons montré plus haut, il existe de nombreux secteurs économiques où, au contraire, le couple constitue un élément récurrent de la dynamique des organisations.
Autant de brèches dans lesquelles ne cessent de s’engouffrer les séries.
Car bien que prônée haut et fort, la séparation entre la vie privée et la vie professionnelle est traversée par les injonctions contradictoires de notre vie au travail.
Dès lors, peut-être faudrait-il regarder du côté de la série dystopique Severance (2022-…), dans laquelle les employés subissent une opération chirurgicale de séparation entre leurs souvenirs liés à leur vie professionnelle et ceux liés à leur vie privée, qui nous invite à réfléchir à la nature même de notre relation au travail et à la place de l’individualité dans l’entreprise.
À lire aussi : « Severance », la série qui perturbe et questionne notre relation au travail
Prise au piège de sa volonté de contrôle et des injonctions contradictoires de son employeur, la diplomate Kate Wyler n’a donc pas fini de se débattre. Mais pour le plus grand plaisir des spectateurs.
Monika Siejka ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
30.11.2025 à 20:34
Les forêts du Grand-Est au cinéma : un territoire qui s’enracine à l’écran
Delphine Le Nozach, Maître de conférences en Sciences de l'information et de la communication, Université de Lorraine
Violaine Appel, Enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication, Université de Lorraine, Université de Lorraine
Texte intégral (2031 mots)
Le Grand-Est est l’une des régions les plus boisées de France, avec plus de 30 % de sa surface couverte par des forêts. Au cinéma, il offre une forêt multiple : espace de travail, de mémoire, d’émotions et d’imaginaire.
Peu filmées mais profondément singulières, les forêts du Grand-Est deviennent à l’écran des lieux où se croisent réalités industrielles, ancrages identitaires et puissances narratives. À travers elles, les films révèlent autant un territoire qu’une manière sensible de le regarder.
Dans cette étude (issue des résultats du projet Matercine), nous analysons la manière dont les longs métrages tournés dans cette région investissent les forêts, qu’il s’agisse de témoigner des usages liés au travail du bois, de mobiliser des paysages rares et méconnus pour leur force esthétique, ou encore d’exprimer le lien intime qu’entretiennent certains réalisateurs avec ces lieux. L’ensemble de ces approches permet de comprendre comment la forêt du Grand-Est, bien au-delà du simple décor, devient au cinéma un espace identitaire et narratif essentiel.
La dualité des représentations des forêts du Grand-Est au cinéma
Comme dans d’autres régions françaises, les réalisateurs montrent souvent la forêt comme un espace de travail, lié à l’exploitation du bois. Mais ces usages productifs n’épuisent pas les façons de la représenter : nombre de réalisateurs choisissent ces forêts pour leur valeur esthétique, leur caractère méconnu ou pour l’attachement personnel qu’ils entretiennent à ces territoires.
La forêt du Grand-Est est en effet un espace multifonctionnel où s’entremêlent nature, industrie et culture. Elle structure les activités humaines (coupe du bois, schlittage – la schlitte est un traîneau qui servait, dans les Vosges et en Forêt-Noire, à descendre le bois des montagnes, conduit par un homme sur une voie faite de rondins – transport des grumes, sciage, construction et papeterie) qui façonnent l’économie régionale comme l’imaginaire collectif. Le cinéma reprend cette diversité et l’inscrit au cœur de ses récits. Les Grandes Gueules (Enrico, 1965) en offre un exemple emblématique : tourné dans une véritable scierie vosgienne, le film témoigne des pratiques forestières d’une époque – travail du bois, énergie hydraulique, transport traditionnel. Nos patriotes (Le Bomin, 2017) valorise quant à lui un schlittage filmé avec réalisme, rendu possible grâce à l’implication de spécialistes locaux.
Dans le Mangeur d’âmes (Bustillo, Maury, 2024), scierie et grumes deviennent des éléments dramatiques : décor authentique, matière visuelle dense et espace de tension pour les scènes d’action. L’usage industriel du bois apparaît aussi dans le Torrent (Le Ny, 2022), tourné au sein d’une entreprise vosgienne réelle, ou dans le Couperet (Costa-Gavras, 2005), où une papeterie vosgienne accueille l’intrigue, articulant territoire local et discours social universel.
Plus-value culturelle
Au-delà de ces dimensions productives, les forêts du Grand-Est possèdent une singularité paysagère qui attire des réalisateurs en quête de décors rares. Elles offrent des espaces peu filmés, marqués par des reliefs, des lacs glaciaires, des espaces boisés denses, qui constituent des territoires non substituables. Filmer ces forêts revient alors à révéler un paysage méconnu, à donner à voir un territoire encore invisibilisé. Cette démarche confère une valeur ajoutée au film, mais aussi au lieu : comme l’énonce la géographe Maria Gravari-Barbas, le regard cinématographique peut créer une plus-value culturelle pour des sites auparavant invisibles.
Certains cinéastes revendiquent cette volonté de découverte. Anne Le Ny, réalisatrice du film le Torrent (2022), souligne ainsi l’atmosphère unique des Vosges, qui lui a donné le sentiment d’être « pionnière ». Dans Perdrix (2019), Erwan Le Duc filme longuement les forêts et le lac des Corbeaux, affirmant un territoire « de cinéma » encore peu exploré.
« J’ai trouvé qu’il y avait une atmosphère très particulière dans les Vosges. D’abord, je suis tombée sur des décors magnifiques qui collaient très bien au scénario avec un mystère particulier et puis le plaisir aussi de tourner dans une région qui n’a pas tellement été filmée. On se sent un petit peu pionnière et c’est très excitant. » (Anne Le Ny, interviewée par Sarah Coton, Fun Radio, novembre 2022)
Cette proximité peut être encore plus intime. De nombreux réalisateurs tournent dans des lieux qu’ils connaissent, où ils ont grandi ou qu’ils associent à leur histoire personnelle. Leur rapport au territoire relève ainsi d’un territoire vécu, chargé de mémoire, d’expériences et de relations sociales. La forêt devient alors le support d’une identité, un espace où se superposent réalité et fiction. C’est le cas d’Erwan Le Duc dans Perdrix (2019) ou de Valérie Donzelli pour Main dans la main (2011), qui revendiquent leur attachement aux paysages lorrains de leur enfance.
La forêt, un territoire d’ombres…
Entre clair-obscur, sous-bois inquiétants et clairières lumineuses, les forêts du Grand-Est permettent aux réalisateurs de traduire aussi bien la peur, le mystère ou la clandestinité que la sérénité, l’éveil ou l’accomplissement. Par leur capacité à refléter les états intérieurs des personnages, ces forêts deviennent de véritables outils esthétiques et narratifs, révélant la singularité du territoire.
Une première tonalité, sombre et dramatique, irrigue le cinéma fantastique, policier, de guerre ou d’horreur. La forêt y apparaît comme un espace d’isolement et de menace, qui mêle naturalisme et surnaturel : silhouettes mouvantes, bruits étouffés, climat hostile, jeux d’ombres. Cette atmosphère immersive renforce la tension psychologique, les peurs profondes et le sentiment d’incertitude. La Région accompagne cette dimension à travers le label « Frissons en Grand-Est », premier fonds consacré aux films de genre, soutenu par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) et structuré autour de festivals phares, tels que ceux de Gérardmer, de Strasbourg, ou encore Reims Polar et War on Screen. Cette dynamique contribue à positionner le Grand-Est comme terre de frissons, où les paysages forestiers deviennent les complices naturels d’une esthétique noire.
La forêt s’expose dans les récits de guerre, en particulier autour de la thématique de la clandestinité. Lieu de refuge pour les maquisards, elle abrite déplacements secrets, identités dissimulées et tensions de la survie. Dans Nos patriotes (Le Bomin, 2017), la Place d’une autre (Georges, 2021) ou encore Nos résistances (Cogitore, 2011), les réalisateurs choisissent les Vosges ou l’Alsace afin d’ancrer leurs récits dans un territoire historique réel, renforçant le réalisme des actions clandestines. Ces forêts incarnent alors autant une protection qu’une transformation intime, où les personnages quittent leur vie civile pour entrer dans une existence parallèle faite de solidarité et de résistance.
La criminalité trouve aussi dans ces espaces naturels un terrain narratif fertile. Qu’il s’agisse d’un crime intime, comme dans le Torrent (Le Ny, 2022), d’une tension familiale violente, comme dans la Fin du silence (Erzard, 2011), ou d’une atmosphère de légende sombre et de disparitions inexpliquées, comme dans le Mangeur d’âmes (Bustillo, Maury, 2024), la forêt agit comme un personnage à part entière : elle dissimule, révèle, dérègle, structure. Ses reliefs, son climat, son obscurité ou son immensité renforcent la dramaturgie et nourrissent une topographie émotionnelle du secret, du mensonge ou de la menace.
Enfin, la forêt du Grand-Est au cinéma apparaît comme un refuge temporaire et fragile, offrant aux personnages un espace isolé pour se protéger et se reposer. Dans Survivre avec les loups (Belmont, 2007), elle joue ce rôle de protection, tandis que dans Baise-moi (Despentes, 2000), la forêt finale symbolise un havre éphémère pour les deux protagonistes, un moment de calme et de sérénité avant la tragédie, où même la mort semble suspendue par la nature.
… et de lumières
Ces forêts se déploient également comme des espaces lumineux, poétiques et pacifiés. Dans la Dormeuse Duval (Sanchez, 2017), Main dans la main (Donzelli, 2012) ou la Bonne Épouse (Provost, 2020), elles deviennent des territoires d’apaisement, des lieux de beauté et de contemplation qui contrastent avec l’agitation urbaine. Elles éveillent les sens – comme dans les Parfums (Magne, 2019), où la forêt alsacienne est appréhendée par l’olfaction – et accompagnent des récits d’apprentissage, d’amitié ou d’amour. La forêt y assume alors des fonctions symboliques complémentaires : le départ (fuite du quotidien), le passage (transformation, éveil du désir, émancipation) et l’arrivée (réconciliation, apaisement, accomplissement).
Le départ se manifeste comme un besoin de fuir le quotidien ou la contrainte sociale : dans Leurs enfants après eux (signé des frères Boukherma, 2024), les adolescents quittent la grisaille ouvrière pour s’échapper dans les bois, tandis que dans Tous les soleils (Claudel, 2011), le héros rejoint un refuge forestier pour se libérer des pressions familiales et retrouver un peu de silence.
Le passage correspond à l’expérience de transformation et d’émancipation : dans Petite Nature (Theis, 2021), Johnny traverse la forêt pour se rapprocher du monde adulte et s’affirmer, et dans Mon chat et moi… (Maidatchevsky, 2023), Rroû retrouve son instinct et sa liberté en explorant les sous-bois.
Enfin, l’arrivée symbolise l’accomplissement et l’apaisement : dans Perdrix (Le Duc, 2019), Pierre et Juliette atteignent la rive du lac après leurs aventures forestières, exprimant leur amour en toute liberté, et dans Jules et Jim (Truffaut, 1962), les balades en forêt incarnent des instants de joie et de plénitude avant la tragédie. À travers ces récits, la forêt se révèle un espace initiatique, miroir des émotions et catalyseur de la transformation intérieure.
Ainsi les forêts du Grand-Est se révèlent-t-elles un espace filmique pluriel. Elles traversent les récits en incarnant une territorialité cinématographique, où les liens entre les personnages et leur environnement façonnent la narration. À travers elles, le territoire se donne à voir et à ressentir, agissant comme un lieu d’émotions et de symboles, capable d’exprimer les ombres comme les lumières. Cette polysémie participe à la force cinématographique du Grand-Est, dont la richesse narrative repose précisément sur cette capacité à conjuguer frisson, mémoire, liberté et poésie, révélant un territoire à la fois concret et sensible.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
27.11.2025 à 17:06
La dinde, histoire d’une domestication
Aurélie Manin, Chargée de recherche en Archéologie, Archéozoologie et Paléogénomique, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Texte intégral (2581 mots)
La dinde constitue un mets de choix sur les tables des fêtes d’Europe et d’Amérique du Nord, que ce soit pour Thanksgiving ou Noël. Son origine et les péripéties qui l’ont menée jusque dans nos cuisines sont toutefois peu connues du grand public.
La période des festivités de fin d’année semble tout indiquée pour revenir sur l’histoire naturelle et culturelle de cet oiseau de basse-cour, qui a fait l’objet d’un ouvrage collectif sorti en juin 2025 aux éditions scientifiques du Muséum national d’histoire naturelle.
La dinde ou le dindon commun, selon que l’on parle de la femelle ou du mâle, appartiennent à l’espèce Meleagris gallopavo que l’on retrouve encore à l’état sauvage sur l’essentiel du territoire des États-Unis, dans le sud du Canada et le nord du Mexique. Les sociétés américaines ont longtemps interagi avec ces oiseaux, essentiellement à travers la chasse. Le plus ancien kit de tatouage retrouvé en contexte archéologique, au Tennessee (États-Unis), daté d’entre 3500 et 1500 ans avant notre ère, était constitué d’os de dindon appointés. Mais ce n’est ni dans cette région ni à cette époque que la domestication du dindon a commencé, c’est-à-dire que le dindon et les humains sont entrés dans une relation de proximité mutualiste conduisant aux oiseaux de basse-cour que l’on connaît aujourd’hui [figure 1].

Une première domestication en Amérique centrale
Jusqu’au début de notre ère, les indices archéologiques d’un rapprochement entre dindons et humains sont, de fait, ténus. C’est en Amérique centrale, au Guatemala, que l’on retrouve la plus ancienne preuve de la gestion et de la manipulation des dindons. Dans cette région tropicale, on ne trouve pas de dindon commun sauvage mais son proche cousin, le dindon ocellé [figure 2]. Or sur le site d’El Mirador, quelques os de dindon commun ont été retrouvés, datés entre 300 avant notre ère et le tout début de notre ère – une identification confirmée par la génétique.
L’analyse des isotopes du strontium contenus dans ces os, spécifiques de l’environnement dans lequel un animal a vécu, ont quant à eux montré que les oiseaux avaient été élevés dans l’environnement local. Il s’agit de la trace la plus ancienne de translocation de l’espèce, son déplacement dans une région dans laquelle elle ne vivrait pas naturellement. Or un tel déplacement, sur des milliers de kilomètres et vers un environnement très différent, nécessite une connaissance fine du dindon et de ses besoins ainsi que des compétences zootechniques certaines. C’est donc l’aboutissement de plusieurs générations d’interactions et de rapprochement dans la région où le dindon commun se trouve naturellement, probablement sur la côte du golfe du Mexique ou dans le centre du Mexique, près de l’actuelle ville de Mexico. Au fil du temps, le nombre de restes de dindon augmente dans les sites archéologiques jusqu’à l’arrivée des Européens au XVIe siècle.

Dans le sud-ouest des États-Unis, à la convergence de l’Utah, du Colorado, du Nouveau-Mexique et de l’Arizona, on sait que les dindons étaient déjà présents il y a environ 10 000 ans, au début de la période holocène mais ils sont particulièrement rares dans les sites archéologiques.
Ce n’est qu’entre le début et 200 de notre ère qu’on voit leurs ossements apparaître régulièrement dans les sites archéologiques, bien qu’en faible proportion. Les traces les plus abondantes de leur présence sont leurs crottes (que l’on appelle coprolithes une fois fossilisées, dans le registre archéologique) retrouvées en particulier dans des structures en briques de terre crue complétées de branches qui servaient probablement à maintenir les dindons en captivité.
Des oiseaux convoités pour leurs plumes
Ces oiseaux appartiennent à une lignée génétique différente de celle des dindons sauvages locaux et l’analyse des isotopes du carbone contenu dans leurs os indique qu’ils ont consommé de grandes quantités de maïs. Ce sont donc des oiseaux captifs, certainement domestiques, mais on retrouve rarement leurs os dans ce que les archéologues étudient le plus, les poubelles des maisons. Ils n’auraient donc pas été mangés, ou assez rarement par rapport aux efforts mis en place pour les garder sur les sites. Les plumes d’oiseaux étaient néanmoins importantes pour ces populations et on retrouve notamment des fragments de plumes de dindon incluses dans le tissage d’une couverture en fibre en yucca. Une seule couverture aurait nécessité plus de 11 000 plumes, soit cinq à dix oiseaux selon la taille des plumes sélectionnées. Les oiseaux maintenus en captivité auraient ainsi pu être plumés régulièrement pour fournir cette matière première.
Au fil du temps, l’usage de dindons domestiques s’étend entre cette région du sud-ouest des États-Unis, le Mexique et l’Amérique centrale, mais les dindons sauvages restent bien présents dans l’environnement. Dans l’est des États-Unis, en revanche, si les restes osseux de dindons peuvent être abondants sur les sites archéologiques, il s’agit d’oiseaux sauvages chassés. C’est une mosaïque d’usage du dindon que les Européens ont ainsi rencontré à leur arrivée sur le continent américain [figure 3].

Poules d’Inde
C’est lors du quatrième voyage de Christophe Colomb en Amérique, alors qu’il explore les côtes de l’actuel Honduras, que l’on trouve ce qui peut être la première rencontre entre des Européens et des dindons, en 1502. On ne sait pas exactement comment leur réputation atteint l’Europe, probablement à travers les premières villes européennes construites dans les Antilles, mais en 1511 une lettre est envoyée par la couronne d’Espagne au trésorier en chef des Indes (les Antilles) demandant à ce que chaque bateau revenant vers la péninsule rapporte des « poules d’Inde » (d’où la contraction « dinde » apparue au XVIIe siècle en français), mâle et femelle, en vue de leur élevage.
En 1520, l’évêque d’Hispaniola (île englobant aujourd’hui Haïti et la République dominicaine) offre à Lorenzo Pucci, cardinal à Rome, un couple de dindons.
L’ouvrage publié au Muséum national d’histoire naturelle montre la multiplication des témoignages de la présence du dindon dans l’entourage de l’aristocratie européenne au cours du XVIe siècle. En France, en 1534, on trouve des dindons à Alençon, en Normandie, dans le château de Marguerite d’Angoulême, sœur de François Ier et reine de Navarre.
C’est aussi en 1534 qu’une amusante histoire se déroule en Estonie, où l’évêque de Tartu envoie un dindon en présent au duc Glinski – dindon qu’il avait précédemment reçu d’Allemagne. Mais l’oiseau exotique se répand aussi progressivement dans les basses-cours et sa consommation se généralise.
Entre le XVIe et le XVIIe siècle, il accompagne de nombreuses missions maritimes commerciales, atteignant même le Japon et revenant en Amérique – depuis l’Europe – dans les établissements coloniaux. Il semble toutefois être longtemps resté réservé aux repas de fêtes, et ce n’est qu’au cours du XXe siècle, avec l’essor de l’industrie agroalimentaire et la sélection de races de plus en plus lourdes, que sa viande entre dans la production de nombreux produits transformés. Finalement, l’animal complet, rôti et dressé sur une table à l’occasion de Thanksgiving ou de Noël, conserve la trace de cette longue histoire.

Aurélie Manin a reçu des financements des Actions Marie Sklodowska-Curie pour réaliser ce travail.
27.11.2025 à 11:51
Le climat est-il vraiment seul responsable de l’augmentation du degré d’alcool des vins ?
Léo Mariani, Anthropologue, Maître de conférence Habilité à diriger des recherches, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)
Texte intégral (3408 mots)
La précocité des vendanges que l’on observe depuis quelques années a été favorisée par le changement climatique. Mais la hausse du degré d’alcool dans les vins est aussi le fruit d’une longue tradition qui emprunte à l’histoire, au contexte social et aux progrès techniques, et qui a façonné la définition moderne des appellations d’origine protégée. Autrement dit, le réchauffement du climat et celui des vins, entraîné par lui, ne font qu’exacerber un phénomène ancien. C’est l’occasion d’interroger tout un modèle vitivinicole.
Dans l’actualité du changement climatique, la vitiviniculture a beaucoup occupé les médias à l’été 2025. En Alsace, les vendanges ont débuté un 19 août. Ce record local traduit une tendance de fond : avec le réchauffement des températures, la maturité des raisins est plus précoce et leur sucrosité plus importante. Cela a pour effet de bouleverser les calendriers et d’augmenter le taux d’alcool des vins.
La précocité n’est pas un mal en soi. Le millésime 2025 a pu être ainsi qualifié de « très joli » et de « vraiment apte à la garde » par le président d’une association de viticulteurs alsaciens. Ce qui est problématique en revanche, c’est l’augmentation du degré d’alcool : elle est néfaste pour la santé et contredit l’orientation actuelle du marché, plutôt demandeur de vins légers et fruités. Autrement dit, le public réclame des vins « à boire » et non « à garder », alors que la hausse des températures favorise plutôt les seconds.
Il faudrait préciser pourtant que l’augmentation des niveaux d’alcool dans les vins n’est pas nouvelle. Elle est même décorrélée du changement climatique :
« Les vins se sont réchauffés bien avant le climat »,
me souffle un jour un ami vigneron. Autrement dit, l’augmentation du degré d’alcool dans les vins a suivi un mouvement tendanciel plus profond au cours de l’histoire, dont on va voir qu’il traduit une certaine façon de définir la « qualité du vin ».
Se pose donc la question de savoir qui a « réchauffé » qui le premier ? Le climat en portant à maturité des grappes de raisins plus sucrées ? ou le savoir-faire des viticulteurs, qui a favorisé des vins plus propices à la conservation – et donc plus alcoolisés ? Postulons que le climat ne fait aujourd’hui qu’exacerber un problème qu’il n’a pas créé le premier. En lui faisant porter seul la responsabilité de la hausse de l’alcool dans les vins, on s’empêche de bien définir ce problème.
De plus, on inverse alors le sens des responsabilités : la vitiviniculture, en tant qu’activité agricole émettrice de gaz à effet de serre, participe à l’augmentation des températures – et cela bien avant que le changement climatique ne l’affecte en retour.
À lire aussi : Vin et changement climatique, 8 000 ans d’adaptation
Quand la définition des AOP fait grimper les degrés
Disons-le sans détour, l’instauration des appellations d’origine protégée AOP constitue un moment objectif de la hausse des taux d’alcool dans les vins. Dans certaines appellations du sud-est de la France, où j’ai enquêté, elle est parfois associée à des écarts vertigineux de deux degrés en trois à dix ans.
Il faut dire que les cahiers des charges des AOP comportent un « titre alcoométrique volumique naturel minimum » plus élevé que celui des autres vins : l’alcool est perçu comme un témoin de qualité.
Mais il n’est que le résultat visible d’une organisation beaucoup plus générale : si les AOP « réchauffent » les vins, souvent d’ailleurs bien au-delà des minima imposés par les AOP, c’est parce qu’elles promeuvent un ensemble de pratiques agronomiques et techniques qui font augmenter mécaniquement les niveaux d’alcool.
C’est ce paradigme, qui est associé à l’idée de « vin de garde », dont nous allons expliciter l’origine.
Les « vins de garde » se généralisent sous l’influence de l’État, de la bourgeoisie et de l’industrie
Contrairement à une idée répandue, le modèle incarné par les AOP n’est pas représentatif de l’histoire vitivinicole française en général.

Les « vins de garde » n’ont rien d’un canon immuable. Longtemps, la conservation des vins n’a intéressé que certaines élites. C’est l’alignement progressif, en France, des intérêts de l’une d’elles en particulier, la bourgeoisie bordelaise du XIXe siècle, de ceux de l’État et de ceux de l’industrie chimique et pharmaceutique, qui est à l’origine de la vitiviniculture dont nous héritons aujourd’hui.
L’histoire se précipite au milieu du XIXe siècle : Napoléon III signe alors un traité de libre-échange avec l’Angleterre, grande consommatrice de vins, et veut en rationaliser la production. Dans la foulée, son gouvernement sollicite deux scientifiques.
Au premier, Jules Guyot, il commande une enquête sur l’état de la viticulture dans le pays. Au second, Louis Pasteur, il confie un objectif œnologique, car l’exportation intensive de vins ne demande pas seulement que l’on gère plus efficacement la production. Elle exige aussi une plus grande maîtrise de la conservation, qui offre encore trop peu de garanties à l’époque. Pasteur répondra en inventant la pasteurisation, une méthode qui n’a jamais convaincu en œnologie.
À lire aussi : Louis Pasteur : l’empreinte toujours d’actualité d’un révolutionnaire en blouse
Sur le principe, la pasteurisation anticipe toutefois les grandes évolutions techniques du domaine, en particulier le développement du dioxyde de soufre liquide par l’industrie chimique et pharmaceutique de la fin du XIXe siècle. Le dioxyde de soufre (SO2) est un puissant conservateur, un antiseptique et un stabilisant.

Il va permettre un bond en avant dans la rationalisation de l’industrie et de l’économie du vin au XXe siècle (les fameux sulfites ajoutés pour faciliter la conservation), au côté d’autres innovations techniques, comme le développement des levures chimiques. En cela, il va être aidé par la bourgeoisie française, notamment bordelaise, qui investit alors dans la vigne pour asseoir sa légitimité. C’est ce groupe social qui va le plus bénéficier de la situation, tout en contribuant à la définir. Désormais, le vin peut être stocké.
Cela facilite le développement d’une économie capitaliste rationnelle, incarnée par le modèle des « vins de garde » et des AOP ainsi que par celui des AOC et des « crus ».
Ce qu’il faut pour faire un vin de garde
Bien sûr ce n’est pas, en soi, le fait de pouvoir garder les vins plus longtemps qui a fait augmenter les taux d’alcool. Mais l’horizon esthétique que cette capacité a dessiné.
Un vin qui se garde, c’est en effet un vin qui contient plus de tanins, car ceux-ci facilitent l’épreuve du temps. Or pour obtenir plus de tanins, il faut reculer les vendanges et donc augmenter les niveaux d’alcool, qui participent d’ailleurs aussi à une meilleure conservation.

Ensuite, la garde d’un vin dépend du contenant dans lequel il est élevé. En l’espèce, c’est le chêne, un bois tanique qui a été généralisé (déterminant jusqu’à la plantation des forêts françaises). Il donne aujourd’hui les arômes de vanille aux vins de consommation courante et le « toasté » plus raffiné de leurs cousins haut de gamme.
La garde d’un vin dépend également des choix d’encépagement. En l’espèce, les considérations relatives à la qualité des tanins et/ou à la couleur des jus de raisin ont souvent prévalu sur la prise en compte de la phénologie des cépages (c’est-à-dire, les dates clés où surviennent les événements périodiques du cycle de vie de la vigne).

Ceci a pu favoriser des techniques de sélection mal adaptées aux conditions climatiques et des variétés qui produisent trop d’alcool lorsqu’elles sont plantées hors de leur région d’origine, par exemple la syrah dans les Côtes du Rhône septentrionales.
En effet, la vigne de syrah résiste très bien à la chaleur et les raisins produisent une très belle couleur, raison pour laquelle ils ont été plantés dans le sud. Mais le résultat est de plus en plus sucré, tanique et coloré : la syrah peut alors écraser les autres cépages dans l’assemblage des côtes-du-rhône.
On pourrait évoquer enfin, et parmi beaucoup d’autres pratiques techniques, les vendanges « en vert », qui consiste à éclaircir la vigne pour éviter une maturation partielle du raisin et s’assurer que la vigne ait davantage d’énergie pour achever celle des grappes restant sur pied. Ceci permet d’augmenter la concentration en arômes (et la finesse des vins de garde), mais aussi celle du sucre dans les raisins (et donc d’alcool dans le produit final).
C’est tout un monde qui s’est donc organisé pour produire des vins de garde, des vins charpentés et taillés pour durer qui ne peuvent donc pas être légers et fruités, comme semblent pourtant le demander les consommateurs contemporains.
« Sans sulfites », un nouveau modèle de vins « à boire »
Ce monde, qui tend à réchauffer les vins et le climat en même temps, n’est pas représentatif de l’histoire vitivinicole française dans son ensemble. Il résulte de la généralisation d’un certain type de rapport économique et esthétique aux vins et à l’environnement.
C’est ce monde dans son entier que le réchauffement climatique devrait donc questionner lorsqu’il oblige, comme aujourd’hui, à ramasser les raisins de plus en plus tôt… Plutôt que l’un ou l’autre de ces aspects seulement.
Comme pistes de réflexion en ce sens, je propose de puiser l’inspiration dans l’univers émergent des vins « sans soufre » (ou sans sulfites) : des vins qui, n’étant plus faits pour être conservés, contiennent moins d’alcool. Ces vins sont de surcroît associés à beaucoup d’inventivité technique tout en étant écologiquement moins délétères, notamment parce qu’ils mobilisent une infrastructure technique bien plus modeste et qu’ils insufflent un esprit d’adaptation plus que de surenchère.
Leur autre atout majeur est de reprendre le fil d’une vitiviniculture populaire que l’histoire moderne a invisibilisée. Ils ne constitueront toutefois pas une nouvelle panacée, mais au moins une piste pour reconnaître et valoriser les vitivinicultures passées et présentes, dans toute leur diversité.
Ce texte a fait l’objet d’une première présentation lors d’un colloque organisé en novembre 2025 par l’Initiative alimentation de Sorbonne Université.
Léo Mariani ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
26.11.2025 à 15:59
Thanksgiving : derrière l’histoire populaire des pèlerins et des « Indiens », de nombreux oubliés…
Thomas Tweed, Professor Emeritus of American Studies and History, University of Notre Dame
Texte intégral (2656 mots)

La fête de Thanksgiving célèbre la générosité et le partage mais l’histoire des pèlerins n’est qu’une partie d’un récit bien plus complexe.
Neuf Américains sur dix se réunissent autour d’une table pour partager un repas à Thanksgiving. À un moment aussi polarisé, toute occasion susceptible de rassembler les Américains mérite qu’on s’y attarde. Mais en tant qu’historien des religions, je me sens tenu de rappeler que les interprétations populaires de Thanksgiving ont aussi contribué à diviser les Américains.
Ce n’est qu’au tournant du XXe siècle que la plupart des habitants des États-Unis ont commencé à associer Thanksgiving aux « pèlerins » de Plymouth et à des « Indiens » génériques partageant un repas présenté comme fondateur mais ces actions de grâce collectives ont une histoire bien plus ancienne en Amérique du Nord. L’accent mis sur le débarquement des pèlerins en 1620 et sur le festin de 1621 a effacé une grande partie de l’histoire religieuse et restreint l’idée de qui appartient à l’Amérique – excluant parfois des groupes comme les populations autochtones, les catholiques ou les juifs.
Croyances agraires et fêtes des récoltes
La représentation habituelle de Thanksgiving passe sous silence les rituels autochtones de gratitude, notamment les fêtes des récoltes. Les Wampanoag, qui partagèrent un repas avec les pèlerins en 1621, continuent de célébrer la récolte de la canneberge. Par ailleurs, des festins similaires existaient bien avant les voyages de Colomb.
Comme je le souligne dans mon ouvrage de 2025, Religion in the Lands That Became America, on se réunissait déjà pour un festin communautaire à la fin du XIe siècle sur l’esplanade de 50 acres de Cahokia. Cette cité autochtone, située de l’autre côté du fleuve, en face de l’actuelle Saint-Louis, était le plus grand centre de population au nord du Mexique avant la révolution américaine.
Les habitants de Cahokia et leurs voisins se rassemblaient à la fin de l’été ou au début de l’automne pour remercier les divinités, fumer du tabac rituel et consommer des mets particuliers – non pas du maïs, leur aliment de base, mais des animaux à forte valeur symbolique comme les cygnes blancs et les cerfs de Virginie. Autrement dit, ces habitants de Cahokia participaient à un festin « d’action de grâce » cinq siècles avant le repas des pèlerins.
Des jours « d’action de grâce »
La représentation habituelle atténue aussi la tradition consistant pour les autorités à proclamer des « Jours d’action de grâce », une pratique bien connue des pèlerins et de leurs descendants. Les pèlerins, qui s’installèrent dans ce qui correspond aujourd’hui à Plymouth, dans le Massachusetts, étaient des puritains séparatistes ayant dénoncé les éléments catholiques subsistant dans l’Église protestante d’Angleterre. Ils cherchèrent d’abord à fonder leur propre Église et communauté « purifiée » en Hollande.
Après une douzaine d’années, beaucoup repartirent, traversant l’Atlantique en 1620. La colonie des pèlerins, au sud-est de Boston, fut progressivement intégrée à la colonie de la baie du Massachusetts, fondée en 1630 par un groupe plus important de puritains qui, eux, ne s’étaient pas séparés de l’Église officielle d’Angleterre.
Comme l’ont souligné des historiens, les ministres puritains de l’Église congrégationaliste, reconnue par l’État du Massachusetts, ne prêchaient pas seulement le dimanche. Ils prononçaient aussi, à l’occasion, des sermons spéciaux d’action de grâce, exprimant leur gratitude pour ce que la communauté considérait comme des interventions divines – qu’il s’agisse d’une victoire militaire ou de la fin d’une épidémie.
La pratique s’est maintenue et étendue. Pendant la révolution américaine, par exemple, le Congrès continental déclara un Jour d’action de grâce pour commémorer la victoire de Saratoga en 1777. Le président James Madison proclama plusieurs jours d’action de grâce pendant la guerre de 1812. Les dirigeants des États-Unis comme ceux des États confédérés firent de même durant la guerre de Sécession.
Cette tradition a influencé des Américains comme Sarah Hale, qui plaida pour l’instauration d’un Thanksgiving national. Rédactrice en chef et poétesse surtout connue pour Mary Had a Little Lamb, elle réussit à convaincre Abraham Lincoln en 1863.
La fête des récoltes de 1621
La vision que beaucoup d’Américains se font du « premier Thanksgiving » ressemble à la scène représentée dans une peinture de J. L. G. Ferris portant ce titre. Réalisée vers 1915, elle est proche d’une autre image très populaire, The First Thanksgiving at Plymouth, peinte à la même époque par Jennie Augusta Brownscombe. Ces deux œuvres déforment le contexte historique et représentent de manière erronée les participants autochtones issus de la confédération Wampanoag toute proche. Les chefs amérindiens y portent des coiffes propres aux tribus des grandes plaines, et le nombre de participants autochtones est nettement sous-estimé.
Le seul témoignage oculaire qui subsiste est une lettre de 1621 du pèlerin Edward Winslow. Il y rapporte que Massasoit, le chef des Wampanoag, était venu avec 90 hommes. Cela signifie, comme le suggèrent certains historiens, que le repas partagé relevait autant d’un événement diplomatique scellant une alliance que d’une fête agricole célébrant une récolte.
La peinture de Ferris laisse aussi entendre que les Anglais avaient fourni la nourriture. Les habitants de Plymouth apportèrent de la « volaille », comme Winslow s’en souvenait – probablement de la dinde sauvage – mais les Wampanoag ajoutèrent cinq daims qu’ils venaient d’abattre. Même la récolte de « maïs indien » dépendit de l’aide autochtone. Tisquantum, dit Squanto, le seul survivant du village, avait prodigué des conseils vitaux en matière de culture comme de diplomatie.
La scène enjouée de l’image masque aussi à quel point la région avait été bouleversée par la mort. Les pèlerins perdirent près de la moitié de leur groupe à cause de la faim ou du froid durant leur premier hiver. Mais, après les premiers contacts avec des Européens, un nombre bien plus important de Wampanoag étaient morts lors d’une épidémie régionale qui ravagea la zone entre 1616 et 1619. C’est pour cela qu’ils trouvèrent le village de Squanto abandonné, et que les deux communautés furent disposées à conclure l’alliance qu’il facilita.
La primauté des pèlerins
Les pèlerins sont arrivés tard dans l’histoire de Thanksgiving. La proclamation de 1863 de Lincoln, publiée dans Harper’s Monthly, évoquait « la bénédiction des champs fertiles », mais ne mentionnait pas les pèlerins. Ils n’apparaissaient pas non plus dans l’illustration du magazine. La page montrait villes et campagnes, ainsi que des esclaves émancipés, célébrant la journée par une prière « à l’autel de l’Union ». Pendant des années avant et après cette proclamation, d’ailleurs, de nombreux Sudistes se sont opposés à Thanksgiving, qu’ils percevaient comme une fête abolitionniste, venue du Nord.
L’absence des pèlerins s’explique, puisqu’ils n’étaient pas les premiers Européens à débarquer sur la côte est de l’Amérique du Nord – ni à y rendre grâce. Des catholiques espagnols avaient ainsi fondé Saint-Augustin en 1565. Selon un témoignage de l’époque, le chef espagnol demanda à un prêtre de célébrer la messe le 8 septembre 1565, à laquelle assistèrent des Amérindiens, et « ordonna que les Indiens soient nourris ».
Deux décennies plus tard, un groupe anglais avait tenté, sans succès, de fonder une colonie sur l’île de Roanoke, en Caroline du Nord – incluant un ingénieur juif. Les Anglais eurent davantage de succès lorsqu’ils s’installèrent à Jamestown, en Virginie en 1607. Un commandant chargé de mener un nouveau groupe en Virginie reçut pour instruction de marquer « un jour d’action de grâce au Dieu tout-puissant » en 1619, deux ans avant le repas de Plymouth.
Mais au fil des ans, les pèlerins de Plymouth ont lentement gagné une place centrale dans ce récit fondateur de l’Amérique. En 1769, les habitants de Plymouth firent la promotion de leur ville en organisant un « Forefathers’ Day » (« Jour des Pères fondateurs »). En 1820, le politicien protestant Daniel Webster prononça un discours à l’occasion du bicentenaire du débarquement à Plymouth Rock, louant l’arrivée des pèlerins comme « les premiers pas de l’homme civilisé » dans la nature sauvage. Puis, dans un ouvrage de 1841, Chronicles of the Pilgrim Fathers, un pasteur de Boston réimprima le témoignage de 1621 et décrivit le repas partagé comme « le premier Thanksgiving ».
L’essor de l’immigration
Entre 1880 et 1920, les pèlerins se sont imposés comme les personnages centraux des récits nationaux sur Thanksgiving et sur les origines des États-Unis. Il n’est pas surprenant que cette période corresponde au pic de l’immigration aux États-Unis, et de nombreux Américains considéraient les nouveaux arrivants comme « inférieurs » à ceux qui avaient débarqué à Plymouth Rock.
Les catholiques irlandais étaient déjà présents à Boston lorsque le volume Pilgrim Fathers parut en 1841, et davantage encore arrivèrent après la famine de la pomme de terre dans les années suivantes. La population étrangère de Boston augmenta lorsque la pauvreté et les troubles politiques poussèrent des catholiques italiens et des juifs russes à chercher une vie meilleure en Amérique.
La même situation se produisait alors dans de nombreuses villes du Nord, et certains protestants étaient inquiets. Dans un best-seller de 1885 intitulé Our Country, un ministre de l’Église congrégationaliste avertissait que « La grandeur de bien des villages de Nouvelle-Angleterre est en train de disparaître, car des hommes, étrangers par leur sang, leur religion et leur culture, s’installent dans des foyers où ont grandi les descendants des pèlerins. »
Lors du 300ᵉ anniversaire du débarquement et du repas, célébré en 1920 et 1921, le gouvernement fédéral émit des timbres commémoratifs et des pièces de monnaie. Des responsables organisèrent des spectacles, et des hommes politiques prononcèrent des discours. Environ 30 000 personnes se rassemblèrent à Plymouth pour entendre le président Warren Harding et le vice-président Calvin Coolidge louer « l’esprit des pèlerins ».
Bientôt, les inquiétudes xénophobes concernant les nouveaux arrivants, en particulier les catholiques et les juifs, amenèrent Coolidge à signer le Immigration Act de 1924, qui allait largement fermer les frontières américaines pendant quatre décennies. Les Américains continuèrent de raconter l’histoire des pèlerins même après que la politique migratoire des États-Unis devint de nouveau plus accueillante en 1965, et beaucoup la relaieront encore l’année prochaine à l’occasion du 250ᵉ anniversaire des États-Unis. Compris dans son contexte complet, c’est un récit qui mérite d’être raconté. Mais il convient de rester prudent, car l’histoire nous rappelle que les histoires sur le passé spirituel du pays peuvent soit nous rassembler, soit nous diviser.
Thomas Tweed ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
25.11.2025 à 15:55
Et si l’accent « neutre » n’existait pas ?
Marc Chalier, Maître de conférences en linguistique française, Sorbonne Université
Texte intégral (1846 mots)

À en croire un sondage récent, les accents régionaux seraient en train de s’effacer. Derrière cette inquiétude largement relayée se cachent deux réalités que nous connaissons tous mais que nous préférons souvent oublier : la prononciation, par nature éphémère, change constamment et le nivellement actuel des accents n’a rien d’exceptionnel. Quant à l’« accent neutre » auquel nous comparons ces accents régionaux, il n’a jamais existé ailleurs que dans nos imaginaires linguistiques.
Chaque année ou presque, un sondage annonce que les accents seraient « en voie de disparition ». La dernière étude en date, publiée en septembre 2025 par la plateforme Preply et largement propagée par le biais des réseaux sociaux, va dans ce sens : plus d’un Français sur deux (55 %) estimerait que les accents régionaux disparaissent. De manière assez remarquable, cette inquiétude serait surtout portée par les jeunes : près de 60 % des participants de 16 à 28 ans disent constater cette disparition. Cette crainte occulte pourtant deux réalités essentielles : un accent n’est jamais figé, et l’idée d’un accent « neutre » relève davantage du mythe que de la réalité.
L’accent « neutre » est une illusion
Dans les représentations de bon nombre de francophones, il existe une prononciation « neutre » sans marque régionale ou sociale que beaucoup considèrent aussi comme la « bonne prononciation ». Mais cette vision ne résiste pas à l’analyse. Tous les modèles de prononciation avancés jusqu’à aujourd’hui (par exemple, le roi et sa cour au XVIIe siècle, plus tard la bourgeoisie parisienne, et récemment les professionnels de la parole publique, notamment dans les médias audiovisuels) ont en commun un ancrage géographique bien précis : Paris et ses environs, et parfois aussi la Touraine où les rois de France avaient leurs résidences d’été.
L’accent dit « neutre » est donc avant tout un accent parisien. Et la plupart des locuteurs non parisiens le reconnaîtront comme tel. Il n’est pas dépourvu de traits caractéristiques qui nous permettent de le reconnaître, mais il est simplement l’accent du groupe social dominant. D’ailleurs, une enquête menée auprès de différentes communautés parisiennes dans les années 2000 le montrait déjà : les représentations de l’accent parisien varient fortement selon la perspective du locuteur, interne ou externe à la communauté parisienne.
Ainsi, hors de la capitale, de nombreux locuteurs associent Paris à un accent non pas « neutre », mais « dominant » et qu’ils associent implicitement au parler des couches sociales favorisées de la capitale. À Paris même, les perceptions du parler parisien sont beaucoup plus hétérogènes. Certains locuteurs affirment ne pas avoir d’accent, d’autres en reconnaissent plusieurs, comme l’« accent du 16e » (arrondissement) associé aux classes favorisées, « l’accent parigot » des anciens quartiers populaires, ou encore l’« accent des banlieues » socialement défavorisées. Cette pluralité confirme donc une chose : même à Paris, il n’existe pas de prononciation uniforme, encore moins neutre.
Les différentes formes de prestige d’un accent
Dans une large enquête sur la perception des accents du français menée avec mes collègues Elissa Pustka (Université de Vienne), Jean-David Bellonie (Université des Antilles) et Luise Jansen (Université de Vienne), nous avons étudié différents types de prestige des accents régionaux en France méridionale, au Québec et dans les Antilles. Nos résultats montrent tout d’abord à quel point cette domination de la région parisienne reste vivace dans nos représentations du « bon usage ». Dans les trois régions francophones, les scores liés à ce que l’on appelle le « prestige manifeste » de la prononciation parisienne sont particulièrement élevés. Il s’agit de ce prestige que l’on attribue implicitement aux positions d’autorité et que les locuteurs interrogés associent souvent à un usage « correct » ou « sérieux ». Mais les résultats montrent également l’existence d’un « prestige latent » tout aussi marqué. Il s’agit là d’un prestige que les accents locaux tirent de leur ancrage identitaire. Ce sont souvent les variétés régionales qui sont ainsi caractérisées comme étant « chaleureuses » ou « agréables à entendre », et elles semblent inspirer la sympathie, la confiance, voire une certaine fierté.
Ces deux axes expliquent aussi qu’on puisse, dans la même conversation, dire d’un accent qu’il « n’est pas très correct » tout en le trouvant « agréable à entendre ». Ce jeu de perceptions montre bien que la prétendue neutralité du français « standard » n’existe pas : elle est simplement le reflet d’un équilibre de pouvoirs symboliques continuellement renégocié au sein de la francophonie.
L’émancipation des accents « périphériques »
Notre étude montre également que cette association de l’accent parisien au prestige manifeste et des accents dits « périphériques » au prestige latent n’est pas fixée à tout jamais. Dans les trois espaces francophones étudiés, les accents autrefois perçus comme des écarts à la norme deviennent peu à peu porteurs d’un prestige plus manifeste. Ils commencent donc à s’imposer comme des modèles légitimes de prononciation dans de plus en plus de contextes institutionnels ou médiatiques autrefois réservés à la prononciation parisienne.
Ce mouvement s’observe notamment dans les médias audiovisuels. Au Québec, par exemple, les journalistes de Radio-Canada assument et revendiquent aujourd’hui une prononciation québécoise, alors qu’elle aurait été perçue comme trop locale il y a encore quelques décennies. Cette prononciation n’imite plus le français utilisé dans les médias audiovisuels parisiens comme elle l’aurait fait dans les années 1960-1970, mais elle intègre désormais ces traits de prononciation propres au français québécois qui étaient autrefois considérés comme des signes de relâchement ou de mauvaise diction.
Ces changements montrent que la hiérarchie traditionnelle des accents du français se redéfinit. L’accent parisien conserve une position largement dominante, mais son monopole symbolique s’effrite. D’autres formes de français acquièrent à leur tour des fonctions de prestige manifeste : elles deviennent acceptables, voire valorisées, dans des usages publics de plus en plus variés. Ce processus relève d’une lente réévaluation collective des modèles de légitimité linguistique.
Une dynamique normale du changement
Revenons à la question des changements perçus dans les accents régionaux évoquée en introduction. La langue est, par nature, en perpétuel mouvement, et la prononciation n’y échappe pas : certains traits s’atténuent, d’autres se diffusent sous l’effet de facteurs notamment sociaux. La mobilité des locuteurs, par exemple, favorise le contact entre des variétés de français autrefois plus isolées les unes des autres. Ce phénomène est particulièrement visible dans des métropoles comme Paris, Marseille ou Montréal, où se côtoient quotidiennement des profils linguistiques hétérogènes. À cela s’ajoute l’influence des médias, amorcée avec la radio et la télévision au début du XXe siècle et aujourd’hui démultipliée par les réseaux sociaux. Ces dynamiques expliquent en partie le nivellement actuel de certains accents, avec la raréfaction de certains traits locaux. Mais cela ne signifie pas pour autant la disparition de toute variation. Des mouvements parallèles de différenciation continuent d’exister et font émerger de nouveaux accents, qu’ils soient liés à l’origine géographique des locuteurs ou à leur appartenance à un groupe social.
À côté de ces changements « internes à la langue », les valeurs sociales que l’on associe à ces variétés évoluent elles aussi. Les frontières de ce qui paraît « correct », « populaire », « légitime » se déplacent avec les représentations collectives. Ainsi, aussi bien les accents que les hiérarchies qui les encadrent se reconfigurent régulièrement. Une observation qui distingue notre époque, cependant, c’est le fait que les normes langagières ne se redéfinissent plus seulement « par le haut » sous l’influence « normative » d’institutions comme l’Académie française, mais aussi « par le bas » sous l’effet des usages de la langue quotidienne qui s’imposent simplement par la pratique.
En somme, même si l’on redoute la disparition des accents, la variation continuera toujours de suivre son cours. Nul ne peut la figer. Et l’accent prétendument « neutre » n’a jamais existé autrement que dans nos représentations fantasmées. Ainsi, la prochaine fois que vous entendez quelqu’un vous dire qu’il ou elle ne pense pas avoir d’accent, souvenez-vous que ce n’est pas qu’il n’en a pas, mais que c’est simplement le sien qui (jusqu’ici) a dominé – pour reprendre les propos de Louis-Jean Calvet – dans la Guerre des langues et les politiques linguistiques (1987).
Marc Chalier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
25.11.2025 à 15:50
Boissons au cannabis : comment une faille juridique a créé une industrie de plusieurs milliards de dollars que le Congrès veut maintenant interdire
Magalie DUBOIS, Docteur en Economie du vin, Burgundy School of Business
Robin Goldstein, Director, Cannabis Economics Group, University of California, Davis
Texte intégral (1676 mots)
Une disposition passée inaperçue dans le budget fédéral des États-Unis signé par le président Trump pourrait bouleverser une industrie florissante : celle des boissons au THC.
Le 12 novembre 2025, le Congrès américain a voté une loi limitant les produits à base de chanvre à 0,4 mg de delta-9-tétrahydrocannabinol, autrement dit THC, par contenant. Cette mesure, après une période de grâce d’un an, interdit de facto la plupart des nombreuses boissons, gommes et cigarettes électroniques (« vapes ») au THC actuellement vendues dans les stations-service, supermarchés et bars américains. Pour comprendre l’importance de cette nouvelle, il faut d’abord expliquer comment ce marché fonctionne, et pourquoi cette interdiction pourrait être appliquée… ou ignorée.
Cannabis, chanvre et THC : un peu d’histoire
La plante de cannabis contient plus de cent « cannabinoïdes », des composés chimiques qui interagissent avec le système endocannabinoïde humain. Le THC (tétrahydrocannabinol) est considéré principal responsable des effets psychoactifs. Légal aux États-Unis au XIXe siècle, le cannabis est progressivement interdit à partir de 1937, puis classé en 1970 comme narcotique de catégorie I – la plus strictement prohibée.
Depuis 1996, certains États américains ont commencé à légaliser le cannabis, d’abord à usage médical, puis récréatif à partir de 2012. Aujourd’hui, plus de 40 États l’autorisent sous une forme ou une autre, mais il reste illégal au niveau fédéral.
Dans ce contexte de contradictions entre lois fédérales et étatiques, une nouvelle distinction va tout changer : celle entre « cannabis » et « chanvre ».
Une industrie née d’un vide juridique
Vous n’en avez probablement jamais entendu parler, pourtant selon Fortune Business Insight le marché des boissons au THC génère déjà plus de 3 milliards de dollars (plus de 2,6 milliards d’euros) aux États-Unis.
Tout commence en 2018, lorsque le Farm Bill américain légalise le « chanvre » – défini comme du cannabis contenant 0,3 % ou moins de THC. L’objectif initial était de relancer l’industrie du chanvre industriel pour produire des textiles et des matériaux. Mais la loi contient une ambiguïté cruciale : ce seuil de 0,3 % s’applique au poids à sec de la plante, sans préciser de norme pour les produits transformés.
Des industriels américains ont rapidement identifié une opportunité. Pour une gomme typique de 5 grammes contenant 10 milligrammes de THC, soit une dose standard, le THC ne représente que 0,2 % du poids total. Pour une boisson de 355 grammes (12 onces) la même dose, le THC ne représente que 0,003 % du poids total. Techniquement, ces produits sont du « chanvre » légal, même s’ils produisent des effets psychoactifs identiques au cannabis.
À lire aussi : Contre les insomnies, le cannabis thérapeutique présente-t-il un intérêt ?
Résultat : dès 2021, des boissons et gommes au THC psychoactif ont commencé à apparaître dans les magasins et les bars des États où aucune loi sur le cannabis récréatif n’existait.
L’innovation qui change tout
Concernant les boissons, cette faille juridique n’aurait jamais créé une industrie de plusieurs milliards de dollars sans une percée technologique cruciale apparue au début des années 2020, la nano-émulsion.
Le THC est une molécule lipophile qui se sépare naturellement de l’eau. Pendant des années, les fabricants ont tenté de créer des boissons stables au THC. Les émulsions traditionnelles prenaient de soixante à cent vingt minutes pour produire leurs effets : vitesse bien trop lente pour concurrencer ceux de l’alcool.
La nano-émulsion change la donne. En réduisant les gouttelettes de THC à l’échelle nanométrique, cette technologie permet au THC de se dissoudre efficacement dans l’eau et d’être absorbé par l’organisme en vingt minutes environ : un délai comparable à celui d’une bière ou d’un cocktail.
Pour la première fois, les boissons au THC peuvent se positionner comme des substituts fonctionnels aux boissons alcoolisées.
Le paradoxe du marché
L’innovation technologique ne suffit pas à expliquer le succès commercial. Les mêmes boissons au THC affichent des résultats diamétralement opposés selon leur canal de distribution.
Dans les États où le cannabis récréatif est légal (en Californie ou à New York, par exemple), les boissons au THC ne sont vendues que dans des dispensaires (boutiques spécialisées dans la vente de cannabis), où elles représentent moins de 1 % des ventes totales de cannabis. En cause : les consommateurs habitués des dispensaires ne s’y rendent pas pour acheter leurs boissons quotidiennes comme ils achèteraient de la bière, par exemple, mais plutôt pour acquérir des produits plus forts comme la fleur de cannabis et les cigarettes électroniques. Une boisson au THC à 7 dollars (6 euros) offre une dose unique, alors qu’une recharge de cigarette électronique à 15 dollars (près de 13 euros) en fournit entre dix et vingt. De plus, les dispensaires doivent également composer avec des contraintes de réfrigération et d’espace qui pénalisent les produits volumineux comme les canettes.
Dans les États où le cannabis récréatif n’est pas légal comme le Texas, la Floride ou la Caroline du Nord par exemple, la situation est différente. Ces mêmes boissons au THC, étiquetées « chanvre », sont distribuées dans les supermarchés et les bars aux côtés des boissons alcoolisées. Elles sont proposées à un prix inférieur (4 ou 5 dollars, soit 3 ou 4 euros) que dans les dispensaires, en raison d’une réglementation plus souple et plus avantageuse fiscalement. Des enseignes, comme les stations-service Circle K, les grandes surfaces Target ou la chaîne de restaurants Applebee’s, ont intégré ces produits à leur offre. D’après des sources internes, les boissons au THC représenteraient 12 % du chiffre d’affaires texan de Total Wine la plus grande chaîne américaine de distribution de boissons alcoolisées.
Contexte concurrentiel
La différence réside dans le contexte concurrentiel. Dans les supermarchés et les bars, les boissons au THC se placent face à la bière, au vin et aux spiritueux, un marché en déclin aux États-Unis, notamment chez les jeunes consommateurs.
Mais certains acteurs de l’industrie des boissons alcoolisées y voient une opportunité commerciale pour la vente sur place et à emporter. Un client ne consommant pas d’alcool et qui commandait autrefois un verre d’eau au bar peut désormais acheter un cocktail au THC et générer du chiffre d’affaires pour l’établissement.
L’interdiction sera-t-elle appliquée ?
L’interdiction votée le 12 novembre 2025 entrera en vigueur dans un an. Elle rendra illégaux au niveau fédéral la plupart des produits au chanvre psychoactif actuellement commercialisés. Mais le Texas et plusieurs autres États, souvent conservateurs, ont déjà légalisé ces produits en légiférant au niveau étatique.
Cette contradiction entre la loi fédérale et les lois étatiques n’a rien d’inédit. Plus de 40 États américains ont légalisé le cannabis médical ou récréatif alors qu’il reste interdit au niveau fédéral. Dans la pratique, les forces de l’ordre locales appliquent les lois étatiques, non les lois fédérales. Le Texas, dont l’industrie du chanvre pèse 4,5 milliards de dollars (soit 3,8 milliards d’euros), rejoint ainsi les nombreux États dont les législations entrent en conflit avec Washington.
Une distinction juridique technique (le seuil de 0,3 % de THC en poids sec établi par le Farm Bill de 2018) a créé en quelques années une industrie de plusieurs milliards de dollars qui concurrence directement le marché des boissons alcoolisées. Malgré la nouvelle tentative du Congrès pour l’empêcher, cette industrie pourrait suivre la trajectoire du cannabis récréatif : interdite au niveau fédéral, mais florissante dans les États qui choisissent de ne pas appliquer cette nouvelle mesure.
Robin Goldstein a reçu des financements de l'Université de Californie.
Magalie DUBOIS ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
25.11.2025 à 15:45
Jean Baudrillard, le philosophe qui a prédit l’intelligence artificielle, trente ans avant ChatGPT
Bran Nicol, Professor of English, University of Surrey
Emmanuelle Fantin, Maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication, Sorbonne Université
Texte intégral (1492 mots)
Visionnaire de la culture numérique, Jean Baudrillard pensait l’intelligence artificielle comme une prothèse mentale capable d’exorciser notre humanité, et un renoncement à notre liberté.
Certains penseurs semblent si précis dans leur compréhension du lieu vers lequel la société et la technique nous emportent qu’ils sont affublés du titre de « prophète ». C’est le cas de J. G. Ballard, Octavia E. Butler, ou encore Donna Haraway.
L’un des membres les plus importants de ce club est le penseur Jean Baudrillard (1929-2007) – bien que sa réputation se soit amoindrie depuis une vingtaine d’années, il est désormais vaguement associé à l’époque révolue où les théoriciens français tels que Roland Barthes et Jacques Derrida régnaient en maîtres.
Lorsque nous l’avons relu pour écrire la nouvelle biographie qui lui est consacrée, nous nous sommes toutefois souvenus à quel point ses prédictions sur la technologie contemporaine et ses effets se révélaient prémonitoires. Sa compréhension de la culture numérique et de l’intelligence artificielle (IA) s’avère particulièrement clairvoyante – d’autant que ses écrits l’ont présentée plus de trente ans avant le lancement de ChatGPT.
Un contexte de préhistoire numérique
Il faut bien se figurer que les technologies de communication de pointe des années 1980 nous paraissent désormais totalement obsolètes : Baudrillard écrit alors que l’entourent des répondeurs téléphoniques, des fax, et bien sûr, le Minitel, prélude médiatique franco-français au réseau Internet. Son génie résidait dans une aptitude à entrevoir au sein de ces dispositifs relativement rudimentaires une projection des usages probables de la technologie dans le futur.
À la fin des années 1970, il avait déjà commencé à développer une théorie originale de l’information et de la communication. Celle-ci s’est encore déployée à partir de la publication de Simulacres et Simulation en 1981 (l’ouvrage qui a influencé les sœurs Wachowski dans l’écriture du film Matrix, sorti en 1999).
Dès 1986, le philosophe observait :
« Aujourd’hui, plus de scène ni de miroir, mais un écran et un réseau. »
Il prédit alors l’usage généralisé du smartphone, en imaginant que chacun d’entre nous serait aux commandes d’une machine qui nous tiendrait isolés « en position de parfaite souveraineté », comme un « cosmonaute dans sa bulle ». Ces réflexions lui ont permis d’élaborer son concept le plus célèbre : la théorie d’après laquelle nous serions entrés dans l’ère de « l’hyperréalité ».
Dans les années 1990, Baudrillard a porté son attention sur les effets de l’IA, d’une manière qui nous aide à la fois à mieux comprendre son essor tentaculaire dans le monde contemporain et à mieux concevoir la disparition progressive de la réalité, disparition à laquelle nous faisons face chaque jour avec un peu plus d’acuité.
Les lecteurs avertis de Baudrillard n’ont probablement pas été surpris par l’émergence de l’actrice virtuelle Tilly Norwood, générée par IA. Il s’agit d’une étape tout à fait logique dans le développement des simulations et autres deepfake, qui semble conforme à sa vision du monde hyperréel.
« Le spectacle de la pensée »
Baudrillard envisageait l’IA comme une prothèse, un équivalent mental des membres artificiels, des valves cardiaques, des lentilles de contact ou encore des opérations de chirurgie esthétique. Son rôle serait de nous aider à mieux réfléchir, voire à réfléchir à notre place, ainsi que le conceptualisent ses ouvrages la Transparence du mal (1990) ou le Crime parfait (1995).
Mais il était convaincu qu’au fond, tout cela ne nous permettrait en réalité uniquement de vivre « le spectacle de la pensée », plutôt que nous engager vers la pensée elle-même. Autrement dit, cela signifie que nous pourrions alors repousser indéfiniment l’action de réfléchir. Et d’après Baudrillard, la conséquence était limpide : s’immerger dans l’IA équivaudrait à renoncer à notre liberté.
Voilà pourquoi Baudrillard pensait que la culture numérique précipiterait la « disparition » des êtres humains. Bien entendu, il ne parlait pas de disparition au sens littéral, ni ne supposait que nous serions un jour réduits à la servitude comme dans Matrix. Il envisageait plutôt cette externalisation de notre intelligence au sein de machines comme une manière « d’exorciser » notre humanité.
En définitive, il comprenait toutefois que le danger qui consiste à sacrifier notre humanité au profit d’une machine ne proviendrait pas de la technologie elle-même, mais bien que la manière dont nous nous lions à elle. Et de fait, nous nous reposons désormais prodigieusement sur de vastes modèles linguistiques comme ChatGPT. Nous les sollicitons pour prendre des décisions à notre place, comme si l’interface était un oracle ou bien notre conseiller personnel.
Ce type de dépendance peut mener aux pires conséquences, comme celles de tomber amoureux d’une IA, de développer des psychoses induites par l’IA, ou encore, d’être guidé dans son suicide par un chatbot.
Bien entendu, les représentations anthropomorphiques des chatbots, le choix de prénoms comme Claude ou encore le fait de les désigner comme des « compagnons » n’aide pas. Mais Baudrillard avait pressenti que le problème ne provenait pas de la technologie elle-même, mais plutôt de notre désir de lui céder la réalité.
Le fait de tomber amoureux d’une IA ou de s’en remettre à sa décision est un problème humain, non pas un problème propre à la machine. Encore que, le résultat demeure plus ou moins le même. Le comportement de plus en plus étrange de Grok – porté par Elon Musk – s’explique simplement par son accès en temps réels aux informations (opinions, assertions arbitraires, complots) qui circulent sur X, plateforme dans laquelle il est intégré.
« Suis-je un être humain ou une machine ? »
De la même manière que les êtres humains sont façonnés par leur interaction avec l’IA, l’IA est dressée par ses utilisateurs. D’après Baudrillard, les progrès technologiques des années 1990 rendaient déjà impossible la réponse à la question « Suis-je un être humain ou une machine ? »
Il semblait confiant malgré tout, puisqu’il pensait que la distinction entre l’homme et la machine demeurerait indéfectible. L’IA ne pourrait jamais prendre plaisir à ses propres opérations à la manière dont les humains apprécient leur propre humanité, par exemple en expérimentant l’amour, la musique ou le sport. Mais cette prédiction pourrait bien être contredite par Tilly Norwood qui a déclaré dans le post Facebook qui la révélait au public :
« Je suis peut-être générée par une IA, mais je ressens des émotions bien réelles. »
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
24.11.2025 à 16:33
« Le discours monotone du dictateur » ou comment Franco a construit un autoritarisme sans charisme
Susana Ridao Rodrigo, Profesora catedrática en el Área de Lengua Española (UAL), Universidad de Almería
Texte intégral (1486 mots)
On associe volontiers les dictateurs aux discours tonitruants et exaltés d’un Hitler ou d’un Mussolini et à une mise en scène exubérante pensée pour galvaniser les foules. Franco, lui, a fait exactement l’inverse : les prises de parole de l’homme qui a verrouillé l’Espagne pendant près de quarante ans se distinguaient par une élocution froide et monotone et un style volontairement très austère.
Francisco Franco (1892-1975) a été le chef de l’État espagnol de la fin de la guerre civile (1936-1939) jusqu’à sa mort. Le régime franquiste a instauré une dictature autoritaire, qui a supprimé les libertés politiques et a établi un contrôle strict sur la société. Pendant près de quarante ans, son leadership a profondément marqué la vie politique, économique et culturelle de l’Espagne, dont l’empreinte durable a souvent fait et fait encore l’objet de controverses.
Mais d’un point de vue communicationnel, peut-on dire que Franco était un grand orateur ?
Cela dépend de la façon dont on définit « grand orateur ». Si l’on entend par éloquence la capacité à émouvoir, persuader ou mobiliser par la parole – comme savaient le faire Churchill ou de Gaulle –, Franco n’était pas un grand orateur. Cependant, si l’on analyse sa communication du point de vue de l’efficacité politique et symbolique, son style remplissait une fonction spécifique : il transmettait une impression d’autorité, de distance et de contrôle.
Son éloquence ne visait pas à séduire le public, mais à légitimer le pouvoir et à renforcer une image de stabilité hiérarchique. En ce sens, Franco a développé un type de communication que l’on pourrait qualifier de « discours de commandement », caractérisé par une faible expressivité et une rigidité formelle, mais qui cadrait avec la culture politique autoritaire du franquisme.
Sur le plan verbal, Franco s’appuyait sur un registre archaïque et protocolaire. Son lexique était limité, avec une abondance de formules rituelles (« tous espagnols », « glorieuse armée », « grâce à Dieu ») qui fonctionnaient davantage comme des marqueurs idéologiques que comme des éléments informatifs.
Du point de vue de l’analyse du discours, sa syntaxe tendait à une subordination excessive, ce qui générait des phrases longues, monotones et peu dynamiques. On observe également une préférence pour le mode passif et les constructions impersonnelles, qui diluent la responsabilité de l’émetteur : « il a été décidé », « il est jugé opportun », « il a été nécessaire ».
Ce choix verbal n’est pas neutre ; il constitue un mécanisme de dépersonnalisation du pouvoir, dans lequel la figure du leader est présentée comme l’incarnation de l’État, et non comme un individu qui prend des décisions. Ainsi, sur le plan verbal, Franco communique davantage en tant qu’institution qu’en tant que personne.
Communication paraverbale : voix, rythme et intonation
C’est un aspect caractéristique de sa communication. Franco avait une intonation monotone, avec peu de variations mélodiques. D’un point de vue prosodique, on pourrait dire que son discours présentait un schéma descendant constant : il commençait une phrase avec une certaine énergie et l’atténuait vers la fin, ce qui donnait une impression de lenteur et d’autorité immuable.
Le rythme était lent, presque liturgique, avec de nombreux silences. Cette lenteur n’était pas fortuite : dans le contexte politique de la dictature, elle contribuait à la ritualisation du discours. La parole du caudillo ne devait pas être spontanée, mais solennelle, presque sacrée.
Son timbre nasal et son articulation fermée rendaient difficile l’expressivité émotionnelle, mais renforçaient la distance. Ce manque de chaleur vocale servait la fonction propagandiste. Le leader n’était pas un orateur charismatique, mais une figure d’autorité, une voix qui émanait du pouvoir lui-même. En substance, sa voix construisait une « éthique du commandement » : rigide, froide et contrôlée.
Contrôle émotionnel
Sa communication non verbale était extrêmement contrôlée. Franco évitait les gestes amples, les déplacements ou les expressions faciales marquées. Il privilégiait une kinésique minimale, c’est-à-dire un langage corporel réduit au strict nécessaire.
Lorsqu’il s’exprimait en public, il adoptait une posture rigide, les bras collés au corps ou appuyés sur le pupitre, sans mouvements superflus. Ce contrôle corporel renforçait l’idée de discipline militaire et de maîtrise émotionnelle, deux valeurs essentielles dans sa représentation du leadership.
Son regard avait tendance à être fixe, sans chercher le contact visuel direct avec l’auditoire. Cela pourrait être interprété comme un manque de communication du point de vue actuel, mais dans le contexte d’un régime autoritaire, cela consistait à instaurer une distance symbolique : le leader ne s’abaissait pas au niveau de ses auditeurs. Même ses vêtements – l’uniforme, le béret ou l’insigne – faisaient partie de sa communication non verbale, car il s’agissait d’éléments qui transmettaient l’idée de la permanence, de la continuité et de la légitimité historique.
Charisme sobre d’après-guerre
Le charisme n’est pas un attribut absolu, mais une construction sociale. Franco ne jouait pas sur une forme de charisme émotionnel, comme Hitler ou Mussolini, mais il avait un charisme bureaucratique et paternaliste. Son pouvoir découlait de la redéfinition du silence et de l’austérité, car dans un pays dévasté par la guerre, son style sobre était interprété comme synonyme d’ordre et de prévisibilité. Son « anti-charisme » finit donc par être, d’une certaine manière, une forme de charisme adaptée au contexte espagnol de l’après-guerre.
Du point de vue de la théorie de la communication, quel impact ce style avait-il sur la réception du message ? Le discours de Franco s’inscrivait dans ce que l’on pourrait appeler un modèle unidirectionnel de communication politique. Il n’y avait pas de rétroaction : le récepteur ne pouvait ni répondre ni remettre en question. L’objectif n’était donc pas de persuader, mais d’imposer un sens.
En appliquant là théorie de la communication du linguiste Roman Jakobson, on constate que les discours solennels de Franco, la froideur de son ton, visaient à forcer l’obéissance de l’auditoire en empêchant toute forme d’esprit critique et en bloquant l’expression des émotions.
Anachronique devant la caméra
Au fil du temps, son art oratoire n’a évolué qu’en apparence. Dans les années 1950 et 1960, avec l’ouverture du régime, on perçoit une légère tentative de modernisation rhétorique, tout particulièrement dans les discours institutionnels diffusés à la télévision. Cependant, les changements étaient superficiels : Franco usait de la même prosodie monotone et du même langage rituel. En réalité, le média télévisuel accentuait sa rigidité. Face aux nouveaux dirigeants européens qui profitaient de la caméra pour s’humaniser, Franco apparaissait anachronique.
L’exemple de Franco démontre que l’efficacité communicative ne dépend pas toujours du charisme ou de l’éloquence, mais plutôt de la cohérence entre le style personnel et le contexte politique. Son art oratoire fonctionnait parce qu’il était en accord avec un système fermé, hiérarchique et ritualisé. Dans l’enseignement de la communication, son exemple sert à illustrer comment les niveaux verbal, paraverbal et non verbal construisent un même récit idéologique. Dans son cas, tous convergent vers un seul message : le pouvoir ne dialogue pas, il dicte.
Aujourd’hui, dans les démocraties médiatiques, ce modèle serait impensable ; néanmoins, son étude aide à comprendre comment le langage façonne les structures du pouvoir, et comment le silence, lorsqu’il est institutionnalisé, peut devenir une forme de communication politique efficace.
Susana Ridao Rodrigo ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
23.11.2025 à 14:55
Comment l’IA peut nous aider à dresser le portrait de la population parisienne d’il y a 100 ans
Sandra Brée, Chargée de recherche CNRS - LARHRA, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Texte intégral (2309 mots)

L’exposition « Les gens de Paris, 1926-1936. Dans le miroir des recensements de population », qui se tient actuellement, et jusqu’au 8 février 2026, au musée Carnavalet-Histoire de Paris, s’appuie sur les recensements de la population parisienne de 1926, de 1931 et de 1936, et contribue à renouveler le regard sur le peuple de la capitale dans l’entre-deux-guerres.
En France, des opérations de recensement sont organisées dès 1801, mais ce n’est qu’à partir de 1836 que des instructions spécifiques sont fournies pour procéder de manière uniforme dans toutes les communes du pays. Le recensement de la population est alors organisé tous les cinq ans, les années se terminant en 1 et en 6, jusqu’en 1946, à l’exception de celui de 1871 qui est reporté à l’année suivante en raison de la guerre franco-prussienne, et de ceux de 1916 et de 1941 qui ne sont pas organisés à cause des deux guerres mondiales.
Des données précieuses sur la population parisienne
Le premier but des recensements de la population est de connaître la taille des populations des communes pour l’application d’un certain nombre de lois. Ils permettent également de recueillir des informations sur l’ensemble des individus résidant dans le pays à un instant t pour en connaître la structure. Ces statistiques sont dressées à partir des bulletins individuels et/ou (selon les années) des feuilles de ménage (les feuilles de ménages récapitulent les individus vivant dans le même ménage et leurs liens au chef de ménage) remplies par les individus et publiées dans des publications spécifiques intitulées « résultats statistiques du recensement de la population ».
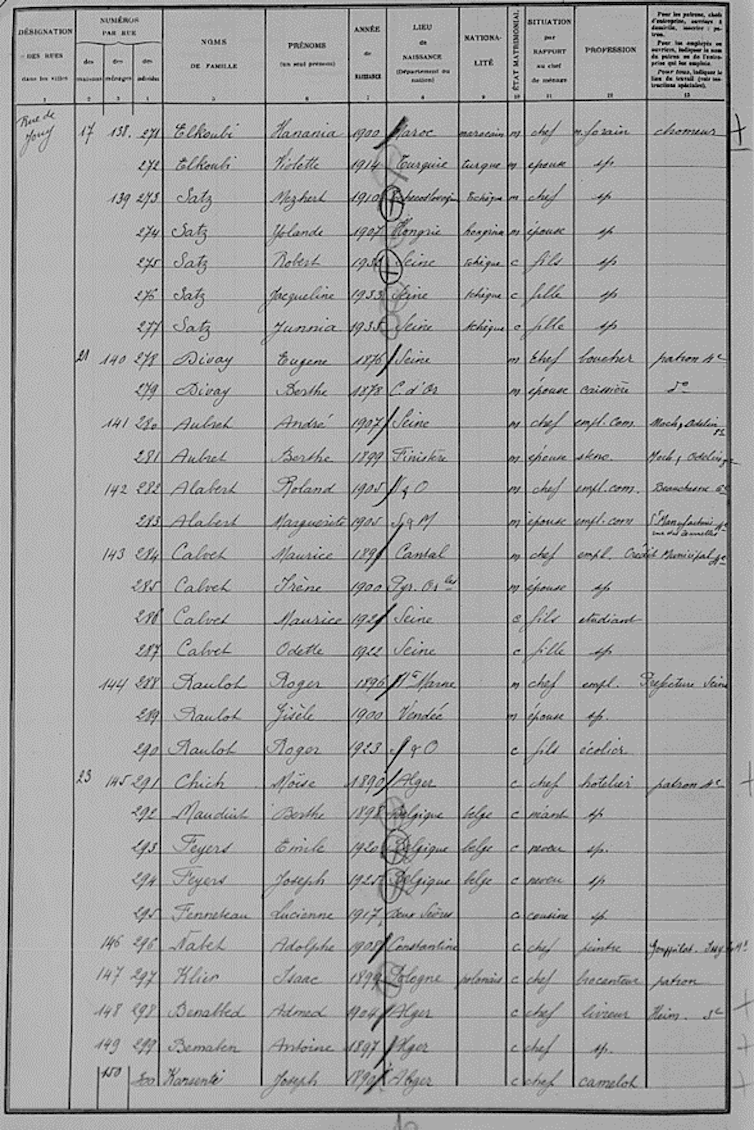
En plus de ces statistiques, les maires doivent également dresser une liste nominative de la population de leur commune. Mais Paris avait obtenu le droit de ne pas dresser ces listes. C’est le chef du bureau de la statistique parisienne, M. Lambert, qui décide de revenir sur cette exception dès 1926. Les listes nominatives de 1926, de 1931 et de 1936 sont donc les seules, avec celle de 1946, à exister pour la population parisienne.
Si Paris avait obtenu le droit de ne pas dresser ces listes, c’est en raison du coût d’une telle opération pour une population si vaste. La population parisienne compte, en effet, déjà près de 1,7 million d’habitants en 1861, un million de plus en 1901 et atteint son pic en 1921 avec 2,9 millions d’individus. Les données contenues dans ces listes sont particulièrement intéressantes, car elles permettent d’affiner considérablement les statistiques dressées pendant l’entre-deux-guerres.
Une base de données conçue grâce à l’IA
Ces listes, conservées aux Archives de Paris et numérisées puis mises en ligne depuis une dizaine d’années, ont déjà intéressé des chercheurs qui se sont appuyés dessus, par exemple, pour comprendre l’évolution d’une rue ou d’un quartier, mais elles n’avaient jamais été utilisées dans leur ensemble en raison du volume qui rend impossible leur dépouillement pour un chercheur isolé. Voulant également travailler à partir de ces listes – au départ, pour travailler sur la structure des ménages et notamment sur les divorcés –, j’avais moi aussi débuté le dépouillement à la main de certains quartiers.
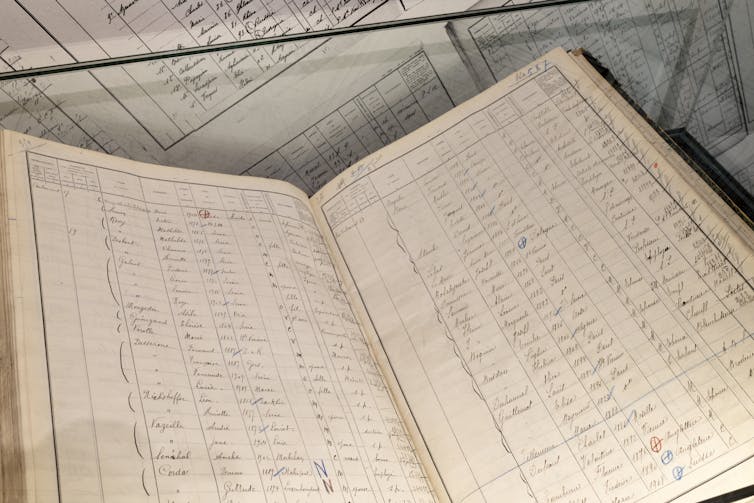
La rencontre avec les informaticiens du Laboratoire d’informatique, de traitement de l’information et des systèmes (LITIS), Thierry Paquet, Thomas Constum, Pierrick Tranouez et Nicolas Kempf, spécialistes de l’intelligence artificielle, a changé la donne puisque nous avons entrepris de créer une base de données à partir de l’ensemble des listes nominatives de la population parisienne de 1926, de 1931 et de 1936 dans le cadre du projet POPP. Les 50 000 images, qui avaient déjà été numérisées par les Archives de Paris, ont été traitées par les outils d’apprentissage profond et de reconnaissance optique des caractères développés au LITIS pour créer une première base de données.
Les erreurs de cette première base « brute » étaient déjà très faibles, mais nous avons ensuite, avec l’équipe de sciences humaines et sociales – composée de Victor Gay (École d’économie de Toulouse, Université Toulouse Capitole), Marion Leturcq (Ined), Yoann Doignon (CNRS, Idées), Baptiste Coulmont (ENS Paris-Saclay), Mariia Buidze (CNRS, Progedo), Jean-Luc Pinol (ENS Lyon, Larhra) –, tout de même essayé de corriger au maximum les erreurs de lecture de la machine ou les décalages de colonnes. Ces corrections ont été effectuées de manière automatique, c’est-à-dire qu’elles ont été écrites dans un script informatique permettant leur reproductibilité. Ainsi, nous avons par exemple modifié les professions apparaissant comme « benne » en « bonne » ou bien les « fnène » en « frère ».
Adapter la base à l’analyse statistique
Il a ensuite fallu adapter la base à l’analyse statistique. Les listes nominatives n’avaient, en effet, pas pour vocation d’être utilisées pour des traitements statistiques puisque ces derniers avaient été établis directement à partir des bulletins individuels et des feuilles de ménage. Or, l’analyse statistique requiert que les mots signalant la même entité soient inscrits de la même façon. Cette difficulté est exacerbée dans le cas des listes nominatives : les agents avaient peu de place pour écrire, car les colonnes sont étroites. Ils utilisaient donc des abréviations, notamment pour les mots les plus longs comme les départements de naissance ou les professions.
Nous avons dû par conséquent uniformiser la manière d’écrire l’ensemble des professions, des départements ou des pays de naissance, des situations dans le ménage et des prénoms. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur différents dictionnaires, c’est-à-dire des listes de mots correspondant à la variable traitée provenant de recherches antérieures ou d’autres bases de données. Ainsi, pour corriger les prénoms, Baptiste Coulmont, qui a travaillé sur cette partie de la base a utilisé les bases Insee des prénoms et des personnes décédées. Marion Leturcq et Victor Gay ont, par ailleurs, utilisé les listes des départements français, des colonies et des pays étrangers, tels qu’ils étaient appelés pendant l’entre-deux-guerres, ou encore la nomenclature des professions utilisées par la Statistique générale de la France (SGF).
Enfin, nous avons créé des variables qui manquaient pour l’analyse statistique que nous souhaitions mener, comme la variable « sexe » qui n’existe pas dans les listes nominatives (alors que le renseignement apparaît dans les fiches individuelles), ou encore délimiter les ménages afin d’en comprendre la composition. Ce travail de correction et d’adaptation de la base est encore en cours, car nous travaillons actuellement à l’ajout d’une nomenclature des professions – afin de permettre une analyse par groupes professionnels –, ou encore à la création du système d’information géographique (SIG) de la base pour réaliser la géolocalisation de chaque immeuble dans la ville.
Retrouver des ancêtres
La base POPP ainsi créée a déjà été utilisée à différentes fins. Une partie de la base (comprenant les noms de famille – qui, eux, n’ont pas été corrigés –, les prénoms et les adresses) a été reversée aux Archives de Paris pour permettre la recherche nominative dans les images numérisées des listes nominatives. Ce nouvel outil mis en place au début du mois d’octobre 2025 – et également proposé en consultation au sein de l’exposition « Les gens de Paris, 1926-1936. Dans le miroir des recensements de population » – a déjà permis à de nombreuses personnes de retrouver leurs ancêtres.
Il nous a également été possible de fournir les premiers résultats tirés de la base POPP (confrontés aux résultats statistiques des recensements publiés) pour dresser des données de cadrage apparaissant sous forme d’infographies dans l’exposition (créées par Clara Dealberto et Jules Grandin). Ces résultats apparaissent également avec une perspective plus comparative dans une publication intitulée « Paris il y a 100 ans : une population plus nombreuse qu’aujourd’hui et déjà originaire d’ailleurs » (Ined, septembre 2025).
L’heure est maintenant à l’exploitation scientifique de la base POPP par l’équipe du projet dont le but est de dresser le portrait de la population parisienne à partir des données disponibles dans les listes nominatives des recensements de la population, en explorant les structures par sexe et âge, profession, état matrimonial, origine, ou encore la composition des ménages des différents quartiers de la ville.
L’autrice remercie les deux autres commissaires de l’exposition « Les gens de Paris, 1926-1936. Dans le miroir des recensements de population » Valérie Guillaume, directrice du musée Carnavalet – Histoire de Paris, et Hélène Ducaté, chargée de mission scientifique au musée Carnavalet – Histoire de Paris et les Archives de Paris.
Sandra Brée a reçu des financements du CollEx-Persée, de Progedo, de l'humathèque du Campus-Condorcet et du CNRS.
20.11.2025 à 16:15
« Les Dents de la mer » : genèse d’une bande originale mythique
Jared Bahir Browsh, Assistant Teaching Professor of Critical Sports Studies, University of Colorado Boulder
Texte intégral (2972 mots)

La séquence de deux notes légendaires, qui fait monter la tension dans « les Dents de la mer », géniale trouvaille du compositeur John Williams, trouve son origine dans la musique classique du début du XXᵉ siècle, mais aussi chez Mickey Mouse et chez Hitchcock.
Depuis les Dents de la mer, deux petites notes qui se suivent et se répètent – mi, fa, mi, fa – sont devenues synonymes de tension, et suscitent dans l’imaginaire collectif la terreur primitive d’être traqué par un prédateur, en l’occurrence un requin sanguinaire.
Il y a cinquante ans, le film à succès de Steven Spielberg – accompagné de sa bande originale composée par John Williams – a convaincu des générations de nageurs de réfléchir à deux fois avant de se jeter à l’eau.
En tant que spécialiste de l’histoire des médias et de la culture populaire, j’ai décidé d’approfondir la question de la longévité de cette séquence de deux notes et j’ai découvert qu’elle était l’héritage direct de la musique classique du XIXe siècle, mais qu’elle a aussi des liens avec Mickey Mouse et le cinéma d’Alfred Hitchcock.
Le premier blockbuster estival de l’histoire
En 1964, le pêcheur Frank Mundus tue un grand requin blanc de deux tonnes au large de Long Island au nord-est des États-Unis.
Après avoir entendu cette histoire, le journaliste indépendant Peter Benchley se met à écrire un roman qui raconte comment trois hommes tentent de capturer un requin mangeur d’hommes, en s’inspirant de Mundus pour créer le personnage de Quint. La maison d’édition Doubleday signe un contrat avec Benchley et, en 1973, les producteurs d’Universal Studios, Richard D. Zanuck et David Brown, achètent les droits cinématographiques du roman avant même sa publication. Spielberg, alors âgé de 26 ans, est engagé pour réaliser le film.
Exploitant les peurs à la fois fantasmées et réelles liées aux grands requins blancs – notamment une série tristement célèbre d’attaques de requins le long de la côte du New Jersey en 1916 –, le roman de Benchley publié en 1974, devient un best-seller. Le livre a joué un rôle clé dans la campagne marketing d’Universal, qui a débuté plusieurs mois avant la sortie du film.
À partir de l’automne 1974, Zanuck, Brown et Benchley participent à plusieurs émissions de radio et de télévision afin de promouvoir simultanément la sortie de l’édition de poche du roman et celle à venir du film. La campagne marketing comprend également une campagne publicitaire nationale à la télévision qui met en avant le thème à deux notes du compositeur émergent John Williams. Le film devait sortir en été, une période qui, à l’époque, était réservée aux films dont les critiques n’étaient pas très élogieuses.
À l’époque, les films étaient généralement distribués petit à petit, après avoir fait l’objet de critiques locales. Cependant, la décision d’Universal de sortir le film dans des centaines de salles à travers le pays, le 20 juin 1975, a généré d’énormes profits, déclenchant une série de quatorze semaines en tête du box-office américain.
Beaucoup considèrent les Dents de la mer comme le premier véritable blockbuster estival. Le film a propulsé Spielberg vers la célébrité et marqué le début d’une longue collaboration entre le réalisateur et Williams, qui allait remporter le deuxième plus grand nombre de nominations aux Oscars de l’histoire, avec 54 nominations, derrière Walt Disney et ses 59 nominations.
Le cœur battant du film
Bien qu’elle soit aujourd’hui considérée comme l’une des plus grandes musiques de l’histoire du cinéma, lorsque Williams a proposé son thème à deux notes, Spielberg a d’abord pensé qu’il s’agissait d’une blague.
Mais Williams s’était inspiré de compositeurs des XIXe et XXe siècles, notamment Claude Debussy (1862-1918), Igor Stravinsky (1882-1971) et surtout de la Symphonie n° 9 (1893), d’Antonin Dvorak (1841-1904), dite Symphonie du Nouveau Monde. Dans le thème des Dents de la mer, on peut entendre des échos de la fin de la symphonie de Dvorak, et reconnaître l’emprunt à une autre œuvre musicale, Pierre et le Loup (1936), de Sergueï Prokofiev.
Pierre et le Loup et la bande originale des Dents de la mer sont deux excellents exemples de leitmotivs, c’est-à-dire de morceaux de musique qui représentent un lieu ou un personnage.
Le rythme variable de l’ostinato – un motif musical qui se répète – suscite des émotions et une peur de plus en plus intenses. Ce thème est devenu fondamental lorsque Spielberg et son équipe technique ont dû faire face à des problèmes techniques avec les requins pneumatiques. En raison de ces problèmes, le requin n’apparaît qu’à la 81ᵉ minute du film qui en compte 124. Mais sa présence se fait sentir à travers le thème musical de Williams qui, selon certains experts musicaux, évoque les battements du cœur du requin.

Des sons pour manipuler les émotions
Williams doit également remercier Disney d’avoir révolutionné la musique axée sur les personnages dans les films. Les deux hommes ne partagent pas seulement une vitrine remplie de trophées. Ils ont également compris comment la musique peut intensifier les émotions et amplifier l’action.
Bien que sa carrière ait débuté à l’époque du cinéma muet, Disney est devenu un titan du cinéma, puis des médias, en tirant parti du son pour créer l’une des plus grandes stars de l’histoire des médias, Mickey Mouse.
Lorsque Disney vit le Chanteur de jazz en 1927, il comprit que le son serait l’avenir du cinéma.
Le 18 novembre 1928, Steamboat Willie fut présenté en avant-première au Colony Theater d’Universal à New York. Il s’agissait du premier film d’animation de Disney à intégrer un son synchronisé avec les images.
Contrairement aux précédentes tentatives d’introduction du son dans les films en utilisant des tourne-disques ou en faisant jouer des musiciens en direct dans la salle, Disney a utilisé une technologie qui permettait d’enregistrer le son directement sur la bobine de film. Ce n’était pas le premier film d’animation avec son synchronisé, mais il s’agissait d’une amélioration technique par rapport aux tentatives précédentes, et Steamboat Willie est devenu un succès international, lançant la carrière de Mickey et celle de Disney.
L’utilisation de la musique ou du son pour accompagner le rythme des personnages à l’écran fut baptisée « mickeymousing ».
En 1933, King Kong utilisait habilement le mickeymousing dans un film d’action réelle, avec une musique calquée sur les états d’âme du gorille géant. Par exemple, dans une scène, Kong emporte Ann Darrow, interprétée par l’actrice Fay Wray. Le compositeur Max Steiner utilise des tonalités plus légères pour traduire la curiosité de Kong lorsqu’il tient Ann, suivies de tonalités plus rapides et inquiétantes lorsque Ann s’échappe et que Kong la poursuit. Ce faisant, Steiner encourage les spectateurs à la fois à craindre et à s’identifier à la bête tout au long du film, les aidant ainsi à suspendre leur incrédulité et à entrer dans un monde fantastique.
Le mickeymousing a perdu de sa popularité après la Seconde Guerre mondiale. De nombreux cinéastes le considéraient comme enfantin et trop simpliste pour une industrie cinématographique en pleine évolution et en plein essor.
Les vertus du minimalisme
Malgré ces critiques, cette technique a tout de même été utilisée pour accompagner certaines scènes emblématiques, avec, par exemple, les violons frénétiques qui accompagne la scène de la douche dans Psychose (1960), d’Alfred Hitchcock, dans laquelle Marion Crane se fait poignarder.
Spielberg idolâtrait Hitchcock. Le jeune Spielberg a même été expulsé des studios Universal après s’y être faufilé pour assister au tournage du Rideau déchiré, en 1966.
Bien qu’Hitchcock et Spielberg ne se soient jamais rencontrés, les Dents de la mer sont sous l’influence d’Hitchcock, le « maître du suspense ». C’est peut-être pour cette raison que Spielberg a finalement surmonté ses doutes quant à l’utilisation d’un élément aussi simple pour représenter la tension dans un thriller.

L’utilisation du motif à deux notes a ainsi permis à Spielberg de surmonter les problèmes de production rencontrés lors de la réalisation du premier long métrage tourné en mer. Le dysfonctionnement du requin animatronique a contraint Spielberg à exploiter le thème minimaliste de Williams pour suggérer la présence inquiétante du requin, malgré les apparitions limitées de la star prédatrice.
Au cours de sa carrière légendaire, Williams a utilisé un motif sonore similaire pour certains personnages de Star Wars. Chaque fois que Dark Vador apparaissait, la « Marche impériale » était jouée pour mieux souligner la présence du chef du côté obscur.
Alors que les budgets des films avoisinent désormais un demi-milliard de dollars (plus de 434 millions d’euros), le thème des Dents de la mer – comme la façon dont ces deux notes suscitent la tension – nous rappelle que dans le cinéma, parfois, le minimalisme peut faire des merveilles.
Jared Bahir Browsh ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
19.11.2025 à 16:24
Les marques et savoir-faire culturels français : des atouts convoités à l’étranger
Cécile Anger, Docteur en droit des marques culturelles, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Texte intégral (2985 mots)
Le patrimoine culturel, les musées et monuments jouent un rôle prépondérant dans les motivations des touristes qui visitent la France. Mais ce patrimoine est aussi, dans sa dimension immatérielle, un vecteur d’expertise valorisée au-delà de nos frontières.
Première destination touristique mondiale, la France a attiré 100 millions de visiteurs internationaux en 2024.
L’intérêt porté aux musées et monuments, dans leur composante matérielle – en tant que lieux qui se visitent – se mesure aussi dans leur composante immatérielle. L’apport du patrimoine culturel à l’économie se traduit par l’accueil de touristes se rendant en France, mais aussi à travers l’exportation des institutions culturelles hors des frontières françaises.
C’est précisément en raison de son patrimoine culturel que la France est arrivée en tête du classement annuel Soft Power 30 en 2017 et en 2019.
De nombreux rapports publics ont investi cette question, percevant les musées ou monuments comme détenteurs d’actifs immatériels susceptibles d’être valorisés à l’international.
Le tournant de l’économie de l’immatériel
Dès 2006, les auteurs du rapport remis à Bercy sur l’économie de l’immatériel écrivaient : « Aujourd’hui, la véritable richesse n’est pas concrète, elle est abstraite. » Au capital matériel a succédé le capital immatériel, le capital des talents, de la connaissance et du savoir. Ce rapport invitait les acteurs français à miser davantage sur leur capital intangible, gisement devenu stratégique pour rester compétitif. Identifiant trois atouts immatériels culturels – le nom des établissements culturels, leur image et leur expertise –, Maurice Lévy et Jean-Pierre Jouyet recommandaient d’engager une transition vers leur valorisation.
Un rapport spécifique a ainsi été commandé en 2014 par le ministère de la culture au haut fonctionnaire Jean Musitelli, « La valorisation de l’expertise patrimoniale à l’international ». En 2019, la Cour des comptes se penchait sur la valorisation internationale de l’ingénierie et des marques culturelles.
Plus récemment, en 2023, le Sénat a publié un rapport d’information réalisé par les parlementaires Else Joseph et Catherine Morin-Desailly sur l’expertise patrimoniale internationale française, faisant état d’un savoir-faire complet, ancien et reconnu, la qualité scientifique de l’expertise française étant établie « sur l’ensemble du champ patrimonial ».
L’expertise culturelle française : un vivier de métiers hautement qualifiés
La notion d’expertise renvoie à des connaissances ou compétences qui ne sont juridiquement pas protégées par brevet et qui permettent la création de produits ou services. L’expertise peut faire l’objet d’une transmission dans le cadre d’une transaction, son transfert se matérialisant par des missions de conseil ou de formation.
Les musées regorgent d’une variété de métiers et savoir-faire liés aux activités exercées par les professionnels y travaillant. Véritable « conservatoire de talents », ils détiennent une expertise technique particulièrement qualifiée et recherchée.
Constitué en interne en 2014, le département Louvre conseil a la charge de valoriser l’expertise des équipes du musée. Cette expertise porte sur les collections, les publics mais aussi sur le management. La brochure présentant l’ingénierie patrimoniale du Centre Pompidou énumère la liste des prestations possibles dans la création et la gestion d’espaces culturels : conseil en muséographie, en médiation… mais aussi accompagnement sur le plan administratif.
Les savoir-faire patrimoniaux français ont bénéficié d’une large couverture médiatique lors du chantier de restauration de Notre-Dame. Les sénatrices à l’origine du rapport précité jugeaient judicieux de profiter de la grande visibilité du chantier – servant ainsi de vitrine des métiers d’art français – pour « valoriser l’ensemble des savoir-faire qui ont collaboré à cette entreprise (archéologues, artisans d’art, architectes, maîtres d’ouvrage, restaurateurs, facteurs d’instruments…) ».
Une expertise recherchée en majorité par les pays émergents
Les pays émergents sont les principaux demandeurs de cette expertise, le patrimoine étant perçu comme un levier d’attractivité et suscitant ainsi un intérêt croissant. Faute de compétences suffisantes pour construire, agencer et gérer des musées, ils font appel à des institutions disposant de cette expérience. Les pays du Moyen-Orient, d’Asie et d’Afrique constituent « les marchés les plus prometteurs » sur ce plan.
Le rapport du Sénat considère que la France possède de sérieux atouts pour prendre part à ce marché :
« Il est clair que la réputation de ses savoir-faire et la renommée de certains de ses établissements au niveau mondial, qu’il s’agisse du Louvre, du château de Versailles ou du Mont Saint-Michel, contribuent à asseoir sa position sur le plan international. »
Une combinaison gagnante : l’apport de marque et d’ingénierie
Les grands accords internationaux s’accompagnent fréquemment d’un élément complémentaire à l’expertise : la marque des institutions culturelles.
Le Louvre Abou Dhabi incarne cette pluralité. Signé en 2007 entre la France et les Émirats arabes unis, l’accord prévoyait la création d’un musée constitué avec l’expertise des équipes muséales françaises et portant le nom du Louvre. Plusieurs volets composent cet accord : l’accompagnement en ingénierie, le prêt d’œuvres des collections françaises (plusieurs musées étant parties prenantes) ainsi que le prêt du nom du Louvre à travers un contrat de licence de marque.
Il en va de même dans l’expérience du Centre Pompidou, qui valorise tant ses savoir-faire que sa marque, celle-ci étant apposée sur le devant des nouveaux musées, dont les façades s’ornent ainsi du sceau de l’institution française. Présent sur tous les continents, il a collaboré en Europe avec la ville de Malaga (Espagne) et la Fondation bruxelloise Kanal. En Asie, il s’est associé avec la société d’aménagement West Bund pour accompagner la création d’un musée à Shanghai (Chine). Son action se mesure aussi en Amérique du Sud (Brésil) et dans les pays du Golfe (Arabie saoudite).
On notera cependant que la valorisation de la marque, a fortiori dans un contexte international, n’a de sens que pour des institutions notoires. Si l’expertise des musées français peut relever tant d’institutions nationales que de structures territoriales, le rayonnement de la marque semble limité aux grands musées, qualifiés par certains auteurs, dont l’économiste Bruno S. Frey, de « superstar » en raison de leur statut et de leur aura.
Une économie fondée sur l’excellence française ?
L’affirmation constante de la nécessité de valoriser l’expertise et les marques culturelles peut être vue comme l’application de la théorie de l’avantage comparatif développée par l’économiste britannique David Ricardo au XIXe siècle. Selon cette théorie, « chaque nation a intérêt à se spécialiser dans la production où elle possède l’avantage le plus élevé comparativement aux autres ». Aussi s’agit-il de « concentrer ses efforts à l’export sur des secteurs où le pays possède de réels avantages comparatifs ».
Il convient toutefois de nuancer ce postulat, car si la France possède assurément des marques fortes et une expertise patrimoniale reconnue, elle n’est pas la seule à en disposer ni à les proposer sur la scène internationale, ce marché étant concurrentiel et, au demeurant, occupé par d’autres États « également bien positionnés », notamment le Royaume-Uni, l’Allemagne ou l’Italie.
Les marques muséales américaines s’exportent également. D’aucuns auront en tête l’exemple très connu du Guggenheim, à l’origine même du concept de « marque muséale », au sens de « brand » et de « trademark », c’est-à-dire un outil de développement économique et d’expansion internationale. Le Guggenheim de Bilbao (Espagne) en témoigne : la fondation new-yorkaise a cédé le droit d’usage de son nom et perçu, en échange, 20 millions de dollars (17,2 millions d'euros) de royalties pour l’usage de sa marque.
Le Museum of Modern Art de New York (MoMA) valorise aussi son nom et son expertise. Il a, par exemple, exporté son concept de boutique de design hors des frontières américaines, avec l’implantation de deux MoMA Design Stores au Japon, à Tokyo et à Kyoto.
Des outils de diversification des ressources propres
On rappellera qu’historiquement, les musées apportaient leur savoir-faire dans une logique, non pas de valorisation mais de solidarité avec d’autres pays. C’est le cas des chantiers de fouilles archéologiques relevant avant tout d’une logique de coopération. La valorisation économique des savoir-faire est un phénomène nouveau, dont l’émergence s’explique par une demande croissante d’ingénierie culturelle émanant de certains pays mais aussi par le contexte budgétaire.
Ce désir de valorisation ne saurait être appréhendé indépendamment du contexte économique contemporain. Il s’agit également de favoriser le développement de ressources propres, venant abonder les budgets, de plus en plus tendus, des institutions culturelles. Les subsides publics n’étant pas mirifiques, les musées doivent répondre à l’impérieuse nécessité de diversifier leurs sources de financement.
Le Centre Pompidou perçoit entre 14 millions et 16 millions d’euros par an au titre de ses partenariats internationaux. S’agissant de l’exemple emblématique du Louvre Abou Dhabi, le montant total de l’accord s’élève à 1 milliard d’euros, la valorisation de la marque « Louvre » représentant 400 millions d’euros.
Ces redevances de licence de marque et d’ingénierie culturelle viennent compléter les ressources propres des établissements, rejoignant ainsi d’autres recettes, parmi lesquelles le mécénat, la location d’espaces, la vente de produits en boutique…

Des partenariats adaptés au contexte local
Face au constat d’un intérêt marqué de la part de pays émergents auprès de musées européens et états-uniens pour construire une offre culturelle, se pose la question de la construction de cette offre et de la confrontation de regards différents.
Ainsi que le relève la juriste Marie Maunand :
« Le développement des échanges internationaux dans le domaine patrimonial induit une dynamique de transfert d’expertise des pays du Nord – pays développés à économie de marché – vers des pays dits du Sud – qui sont soit émergents soit moins avancés – qui pourrait contribuer à la diffusion d’un modèle culturel unique. »
La diversité doit être au cœur de ces accords afin d’éviter toute forme de standardisation. Une approche pragmatique adaptée au contexte local, propre à celui qui est demandeur de l’expertise, s’avère primordiale.
Un transfert de savoir-faire suppose une transmission d’informations ou de compétences. En dépit de la nature commerciale de ces partenariats, il ne saurait s’agir d’un discours simplement descendant de la part de l’expert ou du « sachant » vers son partenaire, mais bien d’un échange favorisant la rencontre de points de vue variés. Dans ce sens, Émilie Girard, présidente d’ICOM France observe un « changement de paradigme et de posture dans le mode de construction d’une expertise plus tournée vers le dialogue ».
Mentionnant la mise en œuvre du partenariat avec les Émiriens, Laurence des Cars, présidente-directrice générale du Louvre, évoque la question de la médiation et de l’explication des œuvres, et, dans le cadre de cet échange entre la France et les Émirats arabes unis, de « l’altérité culturelle » et des manières permettant aux différents publics de partager des œuvres d’art en l’absence de références culturelles ou religieuses communes.
En 2015, le rapport livré par Jean Musitelli cité par Marie Maunand relevait :
« La valorisation dans le contexte de la mondialisation doit […] concourir à la diversification des expressions culturelles […] en se montrant attentif aux attentes et aux besoins des partenaires et en ajustant l’offre aux réalités et traditions locales, [avec] […] des alternatives au modèle standard tel qu’il est véhiculé par la globalisation. »
C’est aussi un rôle que souhaitent allouer à l’expertise française les autrices du rapport de la mission sénatoriale d’information.
Si sa valorisation procède pour partie d’une démarche économique, elle est aussi le reflet d’enjeux diplomatiques, dont l’objectif est de renforcer le rayonnement et l’influence de la France sur la scène internationale. Else Joseph, sénatrice des Ardennes, notait ainsi :
« Ces dernières années, combien l’influence de la France est, si ce n’est en recul, du moins de plus en plus contestée et fragilisée. C’est particulièrement vrai dans les instances internationales en matière culturelle, à l’instar de l’Unesco, où les pays occidentaux se voient régulièrement reprocher une attitude néocoloniale. »
En vue d’y apporter une réponse, la parlementaire suggérait de « tirer parti de la solide expertise de la France dans le domaine patrimonial pour maintenir notre capacité d’influence ».
En ce sens, l’expertise et les marques culturelles sont assurément une incarnation du soft power de la France, qu’il importe autant de valoriser que de préserver.
Cécile Anger a soutenu sa thèse de doctorat en 2024 à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est depuis jeune docteure associée à l'Ecole de Droit de la Sorbonne. Son domaine de recherche porte sur les marques culturelles ainsi que la protection et la valorisation de l'image des œuvres d'art, musées et monuments. Elle a commencé sa carrière au musée de Cluny, puis occupé le poste de Cheffe du service marque et mécénat au Domaine national de Chambord avant de rejoindre l'équipe de l'Établissement public du Mont Saint-Michel.
19.11.2025 à 11:52
Pourquoi publier une « nouvelle » histoire de France en 2025
Éric Anceau, Professeur d'histoire contemporaine, Université de Lorraine
Texte intégral (2153 mots)

La connaissance du passé évolue au fil des recherches. Du big data à l’archéologie préventive, la palette d’outils à disposition de l’historien s’enrichit. Et on s’intéresse aujourd’hui à des sujets longtemps restés sous silence, comme l’environnement ou le genre. Regard sur cette nouvelle approche de l’histoire.
L’histoire de France est un inépuisable sujet de discussion pour les personnalités politiques de tous bords, les médias, les Français et les étrangers qui observent les querelles qui agitent notre pays autour de son passé avec un mélange d’admiration, d’amusement et d’agacement. Les représentations qui en ont été proposées lors de la cérémonie des Jeux olympiques de Paris, à l’été 2024, ont ainsi fait couler beaucoup d’encre.
De fait, la connaissance du passé progresse au fil des recherches. Le contexte de naguère n’est plus celui d’aujourd’hui et les interprétations de l’histoire s’entrechoquent. On ne peut ainsi pas parler du passé colonial de la France en 2025 comme on le faisait au « temps béni des colonies », pour reprendre le titre de la chanson ironique et critique, en 1976, de Michel Sardou, Pierre Delanoë et Jacques Revaux – pour ne donner que cet exemple.
C’est pourquoi nous avons entrepris avec une centaine de spécialistes une Nouvelle Histoire de France. Publiée en octobre 2025 aux éditions Passés composés, cette somme de 340 éclairages, des Francs à la crise actuelle de la Ve République, de Vercingétorix à Simone Veil, tient compte des renouvellements de la discipline. Explications.
Une histoire trop longtemps tiraillée entre roman national et déconstruction
Non seulement la France a été au cœur de la plupart des principaux événements qui ont scandé l’histoire mondiale des derniers siècles, mais elle a également été en proie à des clivages politiques, religieux et idéologiques majeurs : les catholiques face aux protestants, les républicains contre les monarchistes ou encore la droite face à la gauche.
Ce passé, long, riche et tumultueux, n’a cessé d’être instrumentalisé. À partir du XIXe siècle, et plus particulièrement de la IIIe République, a dominé un « roman national » qui présentait la France sans nuances, puissante et rayonnante, et faisait de tous ces affrontements un préalable douloureux mais nécessaire à un avenir radieux.
À partir des années 1970, cette histoire a commencé à être déconstruite par le postmodernisme soucieux de rompre avec la modernité née pendant les Lumières, de libérer la pensée et de délivrer l’individu du passé pour l’inscrire pleinement dans le présent, en fustigeant les grands récits historiques.
Cette approche a été salutaire car elle a fait réfléchir, a remis en cause de fausses évidences et a fait progresser notre connaissance. Ainsi, pour reprendre le cas de l’histoire coloniale, Edward Saïd (1935-2003) a-t-il souligné, dans l’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident (1978, 1980 pour l’édition française), ce que le regard occidental porté sur l’Orient et sur les colonisés avait pu avoir de biaisé, voire de méprisant, même s’il a pu pécher lui-même par réductionnisme et caricature pour défendre sa thèse.
Et certains déconstructeurs en sont venus à noircir systématiquement l’histoire de France, comme le fit par exemple Claude Ribbe avec son Crime de Napoléon (2005) comparant l’esclavage et la traite négrière à la Shoah et Napoléon à Hitler.
Cependant, d’autres ont rapidement profité de ces derniers excès pour proposer de nouveau un roman national qui a pu prendre un tour essentialiste. Il existe pourtant et évidemment une voie entre la fierté aveugle des uns et la passion destructrice des autres.
Un troisième moment historiographique
De la fin des années 2000 au milieu de la décennie suivante, trois grandes entreprises collectives ont contribué à explorer une autre voie, à distance des interprétations partisanes.
À partir de 2009, Joël Cornette a ainsi dirigé, pour l’éditeur Belin, une Histoire de France en plus de dix volumes et 10 000 pages, faisant la part belle aux sources et aux illustrations. Claude Gauvard a pris peu après la tête d’une Histoire personnelle de la France en six volumes aux Presses universitaires de France, avant que Patrick Boucheron et un autre collectif ne publient, en 2017, aux éditions du Seuil, une Histoire mondiale de la France autour d’événements destinés à faire réfléchir.
Ces trois histoires proposaient un récit chronologique et s’appuyaient sur des spécialistes reconnus pour essayer de recentrer un pendule de l’histoire qui avait sans nul doute trop oscillé. Il nous est cependant apparu qu’il y avait nécessité de proposer un autre projet de grande ampleur, une Nouvelle Histoire de France. Nous avons emprunté cette même voie médiane, en rassemblant d’ailleurs plusieurs des autrices et auteurs qui avaient participé aux entreprises précédentes, mais en procédant aussi différemment, sous forme encyclopédique et chronologico-thématique.
Pierre Nora (1931-2025) qui avait dirigé une somme pionnière au milieu des années 1980, les Lieux de mémoire, nous disait au début du processus éditorial, en 2023, que le temps était sans doute venu d’ouvrir un troisième moment historiographique, celui d’une histoire soustraite à la fausse modernité qui conduit à ne lire le passé qu’avec des schémas actuels de pensée, celui d’une histoire renonçant au nouveau mantra qui rend l’Occident coupable de tous les maux et qui pare le reste du monde de toutes les vertus par un excès symétrique à celui par lequel le premier s’est longtemps pris pour le phare de la planète renvoyant le second à sa supposée arriération, celui enfin d’une histoire extraite du cadre étroit de notre hexagone pour montrer ce que la France doit au monde mais aussi ce qu’elle lui a apporté, dans un incessant mouvement de circulation à double sens, à la fois humain, matériel et immatériel.
De nouveaux sujets et des méthodes nouvelles
Avec cette Nouvelle Histoire de France, il s’agit de renoncer aux effets de mode, d’accorder toute leur place aux incontournables – les personnalités, les faits marquants, les œuvres majeures – sans omettre aucun des renouvellements majeurs de ces dernières années. La discipline a évolué en effet tant dans les objets (histoire impériale et coloniale, histoire des voix oubliées et des marges négligées, histoire du genre et des femmes, histoire environnementale…), que dans les méthodes (archéologie préventive, prosopographie, approche par le bas, jeu sur les échelles, big data…).
Parmi les nouveaux sujets historiques, l’environnement est très certainement l’un de ceux qui ont pris le plus de place dans la recherche en raison de la dégradation accélérée de la planète due au double processus de marchandisation du monde
– porté par un imaginaire économique de croissance infinie – et d’artificialisation de la planète – reposant sur un imaginaire technoscientifique prométhéen – qui se développe depuis la fin du XVIIIe siècle. En mettant en avant ces alertes précoces et les alternatives proposées dans le passé, l’histoire environnementale est porteuse de sens pour l’avenir et c’est pourquoi nous voulions lui accorder une grande place en confiant à Charles-François Mathis, son chef de file en France, le soin de l’aborder.
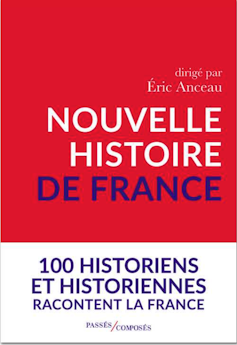
Quant aux méthodes nouvelles à disposition de l’historien, il nous faut dire un mot, là encore à titre d’exemple, de l’archéologie préventive. Celle-ci a commencé à se développer en France à partir des années 1970, avec l’ambition de préserver et d’étudier les éléments significatifs du patrimoine archéologique français menacés par les travaux d’aménagement et les projets immobiliers. Elle a permis de mieux comprendre l’héritage gaulois de la France et ses limites. Et qui mieux que Dominique Garcia, grand spécialiste de la Gaule préromaine et directeur de l’Institut national de la recherche archéologique préventive (Inrap) pour traiter le chapitre « Gaulois » de notre ouvrage ?
En outre, l’histoire n’est pas une discipline isolée mais elle s’enrichit du dialogue avec les autres sciences humaines et sociales et c’est dans cet esprit que nous avons aussi fait appel à 17 auteurs et autrices de 14 autres disciplines, habitués à travailler en profondeur historique : le géographe Jean-Robert Pitte, le spécialiste de la littérature française Robert Kopp, l’historienne de l’art Anne Pingeot, le philosophe Marcel Gauchet… Tous ont accepté de mettre leur savoir à la portée du plus grand nombre au prix d’un effort de synthèse et de vulgarisation.
C’est à ce prix que cette histoire en 100 chapitres, 340 éclairages et 1 100 pages se veut renouvelée et tout à la fois érudite et vivante, encyclopédique et ludique, dépassionnée… mais passionnante !
Éric Anceau a dirigé la « Nouvelle histoire de France » publiée aux éditions Passés composés.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
