31.01.2026 à 13:15
Haies, champs de blé et mégaprojet en Ile-de-France
Une balade naturaliste au nord du Grand Paris, parmi les fauvettes et les églantiers, ça vous dit ? Dans son livre “Sauver les terres agricoles”, l’ethnologue Stéphane Tonnelat raconte la lutte du Collectif pour le Triangle de Gonesse contre l’artificialisation des terres agricoles en général et le mégaprojet EuropaCity en particulier. Extrait.
L’article Haies, champs de blé et mégaprojet en Ile-de-France est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (8774 mots)
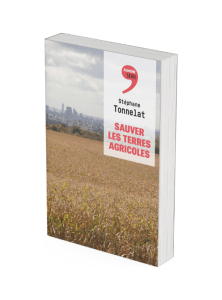
Extrait du livre de Stéphane Tonnelat Sauver les terres agricoles, paru en 2026 aux éditions du Seuil dans la collection « Écocène ». Retrouvez une présentation dessinée par Yug du récit de l’enquête de Stéphane de Tonnelat ici (2024).
Scène 12 : « Un grenier pour les oiseaux ». Où l’on découvre la biodiversité, un milieu complexe, à la fois agricole et sauvage, une écologie bâtie sur les ruines d’une économie industrielle. Bienvenue dans l’Anthropocène !1
Une visite naturaliste
Quand j’arrive à 9 heures ce samedi 25 mai 2019, sous un ciel gris blanc, une semaine après la troisième fête des terres de Gonesse, Georges le naturaliste patiente à la barrière agricole. C’est un homme d’une cinquantaine d’années avec des cheveux raides en mèches rabattues qui lui donnent un air réservé. Mais son visage s’anime lorsqu’il sourit d’un air entendu, comme s’il était au courant d’un scoop : « J’ai eu le temps de faire un tour et j’ai entendu un oiseau intéressant, une tourterelle des bois ! On n’entend pas la même chose à l’aller et au retour, il faut vraiment prendre son temps. »
Pendant que nous attendons les autres, il repère un gravelot en vol. C’est un oiseau limicole. Le nom vient du limon, c’est-à-dire qu’il habite les vasières. Il vit habituellement au bord de rivières pourvues de bancs de sable, des rivières aux cours non contrôlés. Mais les terrains vagues peuvent lui servir de remplacement, dit-il en pointant derrière la palissade. Jeanne arrive à pied. C’est une des quelques militantes qui habite Gonesse, investie aussi dans la lutte contre la chasse et l’exploitation des animaux d’élevage. Elle nous annonce essoufflée que l’hôtel de la Patte d’Oie a été rasé. Les travaux de démolition avancent sur les bords du Triangle. Les bâtiments ont d’abord été expropriés au nom de l’intérêt général, puis abandonnés aux éléments, leur toit enlevé pour empêcher toute occupation et accélérer le pourrissement. Aujourd’hui, le nettoyage commence. La friche serait-elle mûre pour la rénovation ? Georges n’est pas d’accord. Elle grouille de vie !
Denis et Béatrice nous rejoignent. Nous commençons à marcher sur le chemin de la justice vers le petit terrain où nous nous retrouvons les dimanches. Mais Georges nous arrête pour nous faire admirer une haie : « Les buissons d’églantiers et de cornouillers sanguins ne sont pas plantés en ligne. Ils sont arrivés de façon naturelle, disséminés par les oiseaux. Les étourneaux, les grives et les merles mangent les graines au printemps, les rejettent et elles germent au printemps suivant. Ces oiseaux créent le milieu pour d’autres espèces d’oiseaux qui vont nicher dans les buissons. Il faut huit à dix ans pour que le cycle soit bouclé. »
Pour Georges, nous avons là une magnifique haie adulte. Pour moi, elle vient d’apparaître. Une autre espèce endémique est le merisier ou cerisier des oiseaux. Les stries horizontales sur le tronc montrent que c’est un spécimen âgé. Les églantiers à fleurs roses sont des rosiers sauvages. Les fleurs n’ont que cinq pétales. Les fruits s’appellent cynorhodons. Dans mon enfance, on s’en servait pour faire du poil à gratter. On peut aussi en faire des confitures. Les buissons les plus nombreux sont les cornouillers sanguins. Les rameaux sont rouges sous la lumière. Ils produisent énormément de fleurs et leurs fruits sont très consommés par les oiseaux. Ils ont les feuilles opposées et non pas alternes comme les saules, communs dans le Triangle.
Georges insiste sur un point qu’il nous répétera de différentes manières : il apprécie les haies naturelles et n’aime pas les espèces plantées par les humains, particulièrement si elles ne sont pas du coin. Les peupliers d’Italie le long du chemin sont bien alignés, preuve qu’ils ont été plantés. Cela dit, les pics en ont besoin pour se nourrir d’insectes mangeurs de bois et ils servent de perchoirs : « Les haies spontanées nous parlent. Elles nous donnent des informations sur les sols et sur les oiseaux. Les haies plantées ne parlent pas. »

Je commence à comprendre la distinction entre indigène et étranger. Il ne s’agit pas tant de distinguer les plantes rudérales des invasives que de différencier celles qui se sont implantées toutes seules de celles qui n’ont pas eu le choix, plantées de la main de l’homme. Les premières choisissent leur environnement et c’est ainsi que, si l’on connaît leurs préférences, elles en viennent à nous parler2. Les autres n’ont pas eu voix au chapitre.
Au tournant, devant les palissades de la friche de l’entreprise de traitement de déchets polluants dont le bâtiment a été récemment détruit, Georges s’exclame de dépit en voyant les genêts en fleurs et les oliviers de bohème sur la butte qui nous fait face. « Ce sont des espèces d’ornementation typiques de bords de route ! » Juste derrière passe la voie rapide qui coupe le Triangle. Mais ces espèces peuvent aussi être diffusées par les oiseaux, auquel cas elles retrouvent un peu de leur agentivité3. C’est un endroit où personne ne s’arrête habituellement. Les oiseaux, en revanche, y sont nombreux. Leurs chants se mêlent au bruit des avions qui nous survolent toutes les deux minutes. Georges nous les pointe successivement.
Une linotte mélodieuse, dont le nom vient du lin qu’elle mangerait de préférence, est perchée dans un églantier. Elle appartient à la famille des fringilles. Son bec est très court et conique, fait pour broyer des graines. Georges sort son vieux guide Peterson des oiseaux de France et d’Europe pour nous en montrer une reproduction. Il l’aime bien, son guide, car il présente tous les oiseaux de la même famille sur une page. La linotte mâle a la poitrine rouge. Elle fréquente les zones buissonnantes découvertes, comme la butte que nous regardons. Ainsi, comme les haies, les oiseaux nous parlent. Ils sont pris dans le même babillage qui constitue le milieu4.
Je lui demande si c’est une espèce protégée. Cela pourrait nous aider dans le procès qui nous oppose à la Société du Grand Paris, qui menace de commencer les travaux de la ligne 17 Nord dans les champs du Triangle. Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a donné deux avis négatifs successifs en réponse à leur étude d’impact qui sollicite une dérogation pour détruire des spécimens de 17 espèces d’oiseaux. Nos observations pourraient aider Maxime, le juriste de France nature environnement, désigné par le groupe juridique pour porter ce recours. Mais Georges n’aime pas les listes d’espèces protégées. Elles n’ont pas beaucoup de sens pour lui : « Je trouve la linotte intéressante ici, car on est à côté d’une zone urbanisée. Mais dans les études d’impact, ils ne font attention qu’à la rareté. »
Pour lui, l’important n’est pas qu’une espèce d’oiseaux soit inscrite sur une liste, mais qu’elle soit présente dans un milieu improbable. Il défend la protection d’une « nature ordinaire5 » composée d’espèces communes typiques des zones périurbaines, comme ces friches agricoles et industrielles, si près de l’agglomération. Banale, cette nature est aussi menacée que celle considérée comme plus exceptionnelle et ne fait pas l’objet de protection.
On entend une fauvette, commune ici, nous dit-il, car elle aime les zones buissonnantes et ensoleillées. Un hypolaïs polyglotte le ravit. Il nous aide à le repérer avec les jumelles. Il imite les cris des autres oiseaux au début de son chant. Mais à sa façon de répéter le motif, on entend bien que ce n’est pas une linotte. On ne trouve pas l’hypolaïs dans les jardins publics. Cette « fauvette » aime les tiges dégagées pour chanter, comme celle-ci, perchée au sommet d’un arbuste6. Elle est plutôt brune avec des taches claires sur le ventre et le cou. Un accenteur mouchet se perche en haut d’un olivier de bohème pour chanter. Celui-là est plus courant. On le voit dans Paris. Dois-je comprendre que cet oiseau et cet arbre sont moins remarquables, qu’ils ne nous parlent pas autant ?
Nous apercevons une fauvette grisette, au gré de ses courts vols entre les branches. Elle est repérable à sa chorégraphie. Elle vole en suivant une ligne mélodique qui monte, puis redescend, associant le geste à la parole. Les phrases sont appelées strophes, comme si les oiseaux nous chantaient des poèmes7.
Plus avant dans le chemin, Georges repère un chardonneret. Son nom vient du chardon qui serait son régime préféré. Mais ce n’est qu’indicatif, comme la linotte. C’est la première nichée. Il pointe le parent qui nourrit le jeune avec des graines de saule fragile. À côté, un saule cendré. Ces deux espèces indiquent de l’humidité dans le sol. Les saules font des pieds mâles et des pieds femelles. Le saule Marsault, aussi présent, est moins exigeant. Ses feuilles sont plus larges et duveteuses en dessous. Il est intéressant, car il attire les abeilles au printemps.

Naturel ou artificiel ?
Au-dessus de ce bouquet de saules, Denis remarque les cheminées de dégazage du talus, résidu de la construction de la voie rapide. Les travaux remontent au début des années 1990. Les ouvriers sont tombés sur une grande poche de déchets polluants, probablement déposés par l’entreprise de « retraitement » devant laquelle nous sommes passés il y a quelques minutes. Ils l’ont excavée et transformée en deux buttes, de part et d’autre de la voie. La base de données Basol indique que 40 000 m3 de déchets non contrôlés surmontant 20 000 m3 de terres polluées ont été mis au jour sur une surface de deux hectares. C’est un des « points noirs » de Gonesse, une Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) depuis 1994 à cause des composés organiques volatiles et du benzène dont l’origine reste inconnue8. Denis pointe un morceau de bâche noire mise à jour, ce qu’on appelle une « géomembrane ». Elle n’est recouverte que de 15 à 20 centimètres de terre végétale. Dessous, les gravats et les déchets toxiques ne sont pas censés recevoir l’eau de pluie qui ruisselle sur la bâche et nourrit les saules au bord du chemin. Les travaux de la route et l’enfouissement des déchets ont fabriqué une zone humide dans laquelle les saules se sont installés. Cette haie nous parle non seulement de la nature, mais aussi des travaux de l’homme auxquels elle s’est adaptée. La confusion entre naturel et artificiel grandit dans mon esprit.
Cette observation me fait questionner la division que Georges entretient entre les espèces indigènes plantées par les oiseaux et celles apportées par l’homme. Il me semble que dans le cas ci-dessus, la distinction est difficile à maintenir. Certaines espèces comme l’olivier de bohème sont importées comme ornementation, mais on voit bien qu’aujourd’hui, elle s’est replantée toute seule avec l’aide des oiseaux et s’est intégrée à la flore locale. À l’inverse, les saules qui se plantent tout seuls bénéficient de l’humidité apportée par la bâche isolante d’un tas de déchets toxiques installé par une voie rapide. Lequel est le plus naturel ?

« Une troisième nature »
J’aurais tendance à voir ce paysage comme un résidu sur lequel de nouvelles ambitions se projettent aujourd’hui. Ces ruines industrielles et agricoles deviennent une opportunité foncière pour un projet qui cherche à minorer la biodiversité qui a grandi dans les marges des cultures et des aménagements routiers. Cela me fait penser au champignon Matsutake d’Anna Tsing9, qui ne pousse que dans les forêts ravagées par l’exploitation industrielle. Bien sûr, ce n’est pas tout à fait similaire. Mais on est bien dans une friche de l’aménagement, une zone d’aménagement différé depuis 1994, qui a conservé une activité marginale agricole, mais aussi d’industrie polluante et de squats divers et variés, y compris par les plantes. Cette friche a construit sa propre diversité, une nature ordinaire « interstitielle » au sens de Pierre Sansot10, ce que Anna Tsing appelle une « troisième nature », ou « écologie férale » : « Par féral, on entend ici une situation dans laquelle une entité, élevée et transformée par un projet humain d’infrastructure, poursuit une trajectoire au-delà du contrôle humain11. »
Plutôt que de retrouver des haies antiques, Georges prend ce paysage comme il est, un mélange de développement et de désinvestissement urbain avec ses haies mixtes, en quelque sorte ré-ensauvagées. Il faut dire qu’on est servi par les infrastructures avec deux autoroutes, deux aéroports et trois centres commerciaux. Il est occupé par une agriculture industrielle en instance d’expulsion depuis vingt-cinq ans. Ces équipements et ces pratiques en ont fait une zone oubliée de la plupart des habitants.
➤ Lire aussi | Devant l’anéantissement du vivant, des naturalistes entrent en rébellion・Les naturalistes des terres (2023)
Lutter contre l’aliénation du vivant
De l’autre côté du chemin, Georges remarque une plante invasive, le buddleia, souvent appelée « arbre à papillons ». Elle vient de Chine (comme le groupe Wanda, partenaire d’Auchan dans le projet EuropaCity, je ne peux m’empêcher de penser à cette connexion). Elle pousse bien dans les friches, mais dès que la terre devient plus riche, elle se fait doubler, ce qui fait que sa présence reste limitée. Ce côté du chemin est marqué par une levée de terre, constituée de gravats mêlés à des déchets plastiques. Nous l’escaladons et dans le creux derrière, nous découvrons un dense taillis de saules variés et de merisiers : une nouvelle zone humide créée incidemment par l’homme. Elle ne figure pas à l’inventaire de l’étude d’impact de la ligne 17 Nord qui ne considère que les zones naturellement humides, quel que soit le sens de cette nature. Mais elle y figure comme « zone d’évitement. » Les aménageurs sont censés prendre des mesures, imposées par le code de l’environnement, pour limiter la perte de biodiversité. La première, celle à privilégier, est l’évitement. Cela signifie que les travaux ne devront pas toucher cette zone qui devient une forme de mini réserve naturelle. Le problème est que cette zone sera peut-être évitée par les travaux du métro, mais elle ne le sera pas par ceux de la Zone d’aménagement concertée (ZAC) servie par la gare à venir. À quoi sert une zone d’évitement dont on sait qu’elle sera bâtie ? Au tribunal, les avocats de la SGP nous diront que ce sera aux aménageurs de la zone, qui viendront après le métro, de prévoir des mesures de réduction de l’impact et, si la zone est détruite, de compensation. Évitement, réduction et compensation, dans cet ordre, sont les trois mesures imposées. Dans la pratique, la plupart des aménageurs vont directement à la compensation, car elle leur laisse plus de place pour construire sans contrainte. Pour Georges la compensation n’a aucun sens12. Elle sépare une espèce de son milieu pour la réintroduire ailleurs. Là-bas, dans cette réserve, elle ne peut parler, car elle est sortie de l’enchevêtrement (Anna Tsing utilise le mot anglais entanglement) qui animait sa vie. Elle est aliénée dans un sens non seulement économique, car elle sert de ressource pour l’investissement, mais aussi dans un sens écologique, car elle sert de justification à la destruction de son milieu d’origine : « L’aliénation rend l’enchevêtrement de la vie et de l’espace inutile. Le rêve de l’aliénation inspire les transformations du paysage, seul un actif dégagé du reste compte ; tout le reste devient mauvaises herbes ou déchets13. »
La lecture de Tsing m’aide à comprendre le monde contre lequel se mobilise Georges. L’aliénation n’est pas une conséquence des projets d’urbanisation, mais un projet de société. Il consiste à faire du moindre aspect de la vie un élément isolé, catégorisable et quantifiable, pertinent parce que destiné à un type préétabli d’utilisation ou d’investissement, mais qui ne compte plus pour rien sorti de cette logique de valorisation14. Pour Tsing, ce projet de société ne produit que des ruines, comme celle dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui, dans laquelle une « écologie férale » peut ressurgir. Alors pourquoi se mobiliser si la nature finit toujours par revenir. Peut-être parce qu’à force d’hubris, ces infrastructures, comme la ligne 17 et EuropaCity, finiront par annihiler les conditions de notre propre survivance ? Non seulement nous perdrions une occasion de nous nourrir localement et de tisser des solidarités, mais en plus, à force de tout segmenter pour les besoins du marché, la féralité résurgente pourrait devenir mortifère15, à l’image de virus déterrés par les travaux, ou de ces daturas, plantes toxiques qui poussent sous les maïs du Triangle et peuvent finir dans l’ensilage destiné à nourrir les animaux d’élevage.

Un grenier continu
Au bord du chemin, nous admirons un magnifique bouillon-blanc avec ses grandes feuilles duveteuses. Ses fleurs sont très appréciées des abeilles. La potentille a des fleurs jaunes qui la font ressembler à des boutons d’or. Quelques coquelicots sont sortis dans la haie, tandis qu’aucun de ceux que nous avons plantés dans le jardin, en réponse à l’appel « Nous voulons des coquelicots » de Fabrice Nicolino, n’a daigné pousser. Georges remarque une aubépine qui le ravit, car, explique-t-il : « Avec les églantiers et les cornouillers sanguins, elle participe à une succession de floraisons et de graines qui peuvent nourrir les oiseaux du printemps à l’été. Elles accueillent des espèces migratrices qui n’arrivent pas à la même période. C’est un grenier continu. »
Je suis frappé par cette expression de « grenier continu. » D’un seul coup, le Triangle n’est plus seulement un grenier pour nous les humains, mais aussi pour les oiseaux. Les deux seraient-ils compatibles ? C’est peut-être ce que nous dit cette visite.
Georges et moi traversons un grand champ de blé. Les épis sont déjà bien formés alors que les tiges ne sont pas encore hautes. M. Étienne nous avait parlé de produit raccourcisseur pour prévenir le risque qu’ils se fassent coucher par une grosse pluie ou par des nuages d’étourneaux. Georges préfère les blés au maïs. Ils montent plus vite et offrent un couvert où des oiseaux peuvent nicher dès la fin du printemps. Nous entendons de nombreux cris d’alouettes et de bergeronnettes. Nous en apercevons quelques-unes voler furtivement sous le niveau des épis. Les traces des pneus du tracteur sont espacées de 36 mètres, la largeur du diffuseur d’intrants du tracteur du fils de M. Étienne qui vient de contracter un prêt de 220 000 euros pour acheter cet engin adapté aux très grandes surfaces, comme ce champ cultivé maintenant pour l’ensemble des exploitants du Triangle. Les traces offrent des sentiers tout à fait praticables. Le poids de l’engin, autour de 15 tonnes, compacte le sol et empêche toute repousse.
Nous avons la chance d’observer une bergeronnette printanière perchée sur un blé à peine plus haut que les autres. Elle est à une dizaine de mètres et, à la jumelle, nous la voyons très bien. Son ventre est jaune canari. C’est un mâle. Nous sommes saisis par cette tache de lumière qui ne nous prête pas attention. Nous échangeons des sourires complices. Les blés aussi nous parlent ! Ils sont greniers pour nous comme pour ces oiseaux. Les deux sont compatibles, ce qui me rassure.

De nouvelles raisons de se mobiliser
Je demande à Georges comment il a découvert le Triangle. Il était à un dîner où Étienne, l’avocat du Collectif, était invité et leur a expliqué qu’il défendait ces terres. Ça l’a rendu curieux. Il est venu une première fois, dans le nord du Triangle, puis à la fête la semaine dernière, où je l’ai rencontré.
– Et qu’est-ce que tu fais dans la vie ?
– Je fais des études de terrain comme ici, pour des associations. Mais je refuse de travailler pour des bureaux d’études qui ne s’intéressent qu’à la rareté.
– Ce ne doit pas être facile de gagner ta vie avec les associations…
– Oui, c’est vrai.
Il n’élabore pas. J’ai l’impression qu’il vit de peu. Ses vêtements sont modestes. Je me dis qu’il est fidèle à ses idéaux et j’admire sa détermination à rester du côté du vivant ordinaire, celui qui ne rapporte pas d’argent, mais qui nous lie dans un enchevêtrement résistant à la marchandisation. Je lui dis que ce serait bien de dresser un inventaire qu’on pourrait comparer aux études d’impact. Le Collectif serait sûrement prêt à payer. Quinze jours plus tard, il enverra un premier inventaire qui ravira les militants. Beaucoup d’entre nous découvrent alors une nouvelle perspective sur le Triangle. Le site est plus habité que nous le croyions. Il grouille de formes de vie inconnues de la plupart d’entre nous, qui nous parlent de ce milieu et nous montrent sa nature à la fois ordinaire et connectée. Il nous montre la possibilité d’un monde fait de relations dans lesquelles nous serions pris, par opposition à celui des promoteurs qui m’apparaît maintenant comme une entreprise d’aliénation. Celles et ceux à qui cela parle ont de nouvelles raisons de s’opposer au capitalisme commercial spéculatif d’EuropaCity et à l’artificialisation des terres.
➤ Lire aussi | Sauvages, naturelles, vivantes, en libre évolution… quels mots pour déprendre la terre ?・Marine Fauché · Virginie Maris · Clara Poirier (2022)

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
Notes
- Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, L’Événement Anthropocène. La Terre, l’histoire et nous., Seuil, « Points », 2016.
- David G. Haskell, Écoute l’arbre et la feuille, Paris, Flammarion, 2017.
- Vanessa Manceron, « Exil ou agentivité ? Ce que l’anthropologie fabrique avec les animaux », L’Année sociologique, vol. 66, no 2, 2016, p. 279-298.
- Jakob Von Uexküll, Mondes animaux et monde humain et théorie de la signification, Paris, Denoël, 1984.
- Laurent Godet, « La « nature ordinaire » dans le monde occidental », L’Espace géographique, tome 39, no 4, 2010, p. 295-308.
- Vinciane Despret, Habiter en oiseau, Arles, Actes Sud, « Mondes sauvages », 2019.
- Marielle Macé, Une pluie d’oiseaux, Paris, José Corti, 2022.
- Autorité environnementale, « Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Gonesse (95) », 26 avril 2017, p. 17-18.
- Anna Lowenhaupt Tsing, The Mushroom at the End of the World : On the Possibility of Life in Capitalist Ruins, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2015.
- Pierre Sansot, « Pour une esthétique des paysages ordinaires », Ethnologie française, no 3, 1989, p. 239-244.
- Anna Lowenhaupt Tsing, « La vie plus qu’humaine », Terrestres, 26 mai 2019.
- Gilles J. Martin, « La compensation écologique : de la clandestinité honteuse à l’affichage mal assumé », Revue juridique de l’environnement, vol. 41, no 4, 2016, p. 601-616 ; Marthe Lucas, « Regards sur le contentieux français relatif aux mesures compensatoires : quarante ans d’attentes, de déceptions et d’espoirs portés par la jurisprudence », Natures Sciences Sociétés, vol. 26, no 2, 2018, p. 193-202.
- Anna Tsing, The Mushroom at the End of the World…, op. cit., p. 5.
- Laura Centemeri, « Reframing problems of incommensurability in environmental conflicts through pragmatic sociology : From value pluralism to the plurality of modes of engagement with the environment », Environmental values, vol. 24, no 3, 2015, p. 299-320.
- Anna Lowenhaupt Tsing, Jennifer Deger, Alder Keleman Saxena et Feifei Zhou, Notre nouvelle nature. Guide de terrain de l’Anthropocène, Paris, Seuil, « Écocène », 2025.
L’article Haies, champs de blé et mégaprojet en Ile-de-France est apparu en premier sur Terrestres.
28.12.2025 à 10:30
Le tournant féministe de la primatologie
1989 : dans une enquête magistrale sur le rôle des femmes dans la primatologie, Donna Haraway articulait sciences, patriarcat, racisme et impérialisme. Un classique fondateur des humanités environnementales enfin traduit, alors que les grands singes, à l’interface entre nature et culture, vivent désormais au seuil de l’extinction. Préface inédite et introduction.
L’article Le tournant féministe de la primatologie est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (17612 mots)

Ce texte est un extrait du livre Être femelle. Le tournant féministe de la primatologie, traduit de l’anglais par Marin Schaffner et paru aux Éditions Wildproject en 2025 (avec une postface inédite de Vinciane Despret).
Note de traduction, par Marin Schaffner
À Dian Fossey, et à toutes les femmes qui ont été tuées en défendant la vie
Primate Visions est le deuxième livre de Donna Haraway1. Entamé à la fin des années 1970 et publié en 1989, il propose une histoire critique de la primatologie au 20e siècle, sur près de 500 pages. Être femelle est la traduction de l’introduction générale de ce livre – que vous retrouverez ci-dessous en intégralité – ainsi que de sa troisième et dernière partie.
Lorsqu’elle entame Primate Visions, Donna Haraway enseigne à la Johns Hopkins University (1974-1980), dans le département d’histoire des sciences. Ses travaux de l’époque explorent principalement les implications philosophiques et politiques de la biologie à laquelle elle a été formée.
Nommée professeure à l’université de Santa Cruz en 1980 (où elle finira la rédaction de Primate Visions), elle obtient alors la première chaire en théorie féministe des États-Unis. Dès ce moment, ses recherches se déploient à la croisée de la critique des sciences, des études de genre, de la science-fiction et de l’écologie. Deux articles majeurs publiés alors témoignent de sa singularité transdisciplinaire : « Manifeste cyborg : science, technologies et féminisme socialiste à la fin du 20e siècle » (1985)2 et « Savoirs situés : la question de la science dans le féminisme et le privilège de la perspective partielle » (1988)3. Le sous-titre original de Primate Visions – « Genre, race et nature dans le monde de la science moderne » – résume sans détour son approche.
Contrairement au français, le terme anglais female peut à la fois signifier « femelle » et « femme » – même s’il reste différent, en ce second sens, de woman. Nous avons volontairement choisi de traduire ce terme sous sa première acception, tout au long du livre, afin d’insister sur l’ancrage de la question féministe dans les enjeux de la biologie, et sur leurs enchevêtrements multiples – ce qui est un des cœurs battants de la critique de la primatologie ici développée par Donna Haraway.
Préface de l’autrice à l’édition française (2025)
Il y a plus de quarante ans, j’ai commencé à sérieusement interroger les manières dont l’amour, le pouvoir et la science s’entremêlent au sein des constructions de ce qui est considéré comme relevant de la « nature » pour les sociétés contemporaines.
Quarante ans plus tard, je continue de m’interroger à ce sujet, avec un sentiment d’urgence toujours plus grand – et cela, quand bien même la nature est devenue pour moi des naturecultures. Les « naturecultures » s’écrivent nécessairement en un mot ; et ce mot est empli des histoires des pratiques masculinistes, coloniales, raciales, capitalistes, écocidaires et génocidaires – mais pas seulement. Jamais seulement. Les naturecultures sont aussi emplies de recherches empiriques et de théories astucieuses qui changent des vies, d’un engagement profond en faveur de mondes qui dépassent l’exceptionnalisme humain, et d’un amour passionné pour les êtres vivants et mourants de la Terre. Les scientifiques francophones dans les pays francophones sont et ont été des act·rices majeur·es de ce drame complexe.
En écrivant Primate Visions, j’ai demandé de l’aide à mes parentés primates et je l’ai reçue en abondance. Ces parentés étaient composées à la fois de scientifiques humain·es qui étudiaient les singes (sur le terrain, dans les zoos ou dans des laboratoires) et des primates plus-qu’humain·es elles et eux-mêmes. À l’époque où j’ai écrit ce livre imposant, les mondes de ces autres primates étaient encore plus menacés par la destruction des habitats, la cupidité et l’ignorance que les mondes de leurs voisin·es humain·es tourmenté·es. Mais les destins des peuples humains et ceux des autres animaux sont liés depuis le commencement. Et je crois que leurs futurs, nos futurs, dépendent les uns des autres.
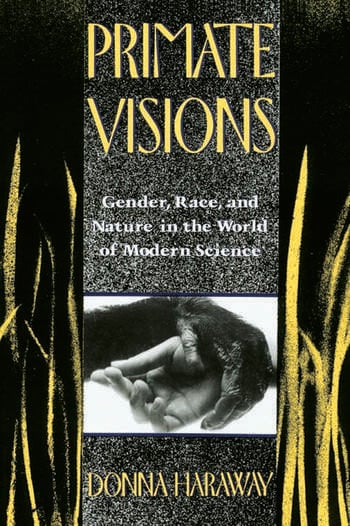
Progressivement, et souvent à contrecœur, les scientifiques ont appris à connaître les populations humaines et les cultures humaines des pays abritant des singes, et la science des primates est aujourd’hui une tentative véritablement diversifiée et mondiale. Malgré cela, bon nombre de nos parents primates n’auront plus de sociétés, de parentés, de cultures, ni d’habitats d’ici la fin de ce siècle. Tous les grands singes et la plupart des autres vivent désormais au seuil de l’extinction. Nous ne devons pas permettre que la grande aventure touffue de toutes les générations issues de la longue diversification évolutive des primates se termine par des projets visant à envoyer Elon Musk sur Mars – ni par une quelconque autre forme d’exceptionnalisme humain. Vivre de façon robuste sur une Terre partiellement guérie, en réparant collectivement tous les dommages possibles à travers les sciences et bien d’autres méthodes, tel est notre véritable travail.
Dans Primate Visions, je me suis demandé quelles formes prenait l’amour de la nature dans les sociétés techno-industrielles, à quel prix et un prix pour qui. Aujourd’hui, je me demande avec urgence comment nourrir des naturecultures dignes d’avenir. Je me soucie plus que jamais des primates plus-qu’humain·es ; et je vois dans leurs corps et dans leurs habitats les stigmates sanglants du genre, de la race, de la classe et des nations humaines. J’espère que les lect·rices de cette traduction y trouveront du réconfort et des idées pour des réparations partielles, des remédiations partielles, et l’espoir de générations futures pour toutes les parentés primates.
Je pense que mon slogan doit désormais être : « Des sciences primates pour la survie terrestre ! »
Donna Haraway, mai 2025

Introduction de Primate Visions (1989) : « Une vision persistante »4
« Les noms que vous, primates sans cage, donnez aux choses affectent votre attitude à leur égard pour toujours. » – Ruth Herschberger, Adam’s Rib, 1970
« Car c’est ainsi que tout doit commencer, par un acte d’amour. » – Eugène Marais, The Soul of the White Ant, 1980
Comment l’amour, le pouvoir et la science s’entremêlent-ils au sein des constructions de la nature, en cette fin de 20e siècle ? Qu’est-ce qui peut bien être considéré comme « nature » par les gens de la société industrielle tardive ? Quelles formes l’amour de la nature prend-il dans des contextes historiques particuliers ? Pour qui et à quel prix ? Dans quels lieux spécifiques, à partir de quelles histoires sociales et intellectuelles, et avec quels outils la nature est-elle construite en tant qu’objet de désir érotique et intellectuel ? Comment les terribles marques du genre et de la race permettent-elles et limitent-elles l’amour et la connaissance dans des traditions culturelles particulières, y compris dans les sciences naturelles modernes ? Qui peut contester ce que sera le corps de la nature ? Telles sont les questions qui guident mon histoire des sciences modernes et des cultures populaires émergeant des récits sur les corps et les vies des singes.
Depuis le 18e siècle, les thèmes de la race, de la sexualité, du genre, de la nation, de la famille et de la classe sociale ont été inscrits dans le corps de la nature par les sciences de la vie occidentales. Dans le sillage de la décolonisation post-Seconde Guerre mondiale, dans celui des mouvements antiracistes et féministes locaux et mondiaux, dans le sillage également des menaces nucléaires et environnementales, et de la prise de conscience généralisée de la fragilité des réseaux soutenant la vie sur Terre, la nature reste un mythe et une réalité : elle est à la fois profondément contestée et d’une importance cruciale. Comment les liens symboliques et matériels s’entrecroisent-ils au sein du tissu qu’est la nature pour les gens de la société industrielle tardive, en cette fin de 20e siècle ? »
Pour les Occidentaux, les singes ont une relation privilégiée à la nature et à la culture : les simiens occupent les zones frontalières de ces deux puissants pôles mythiques. Dans ces zones frontalières, l’amour et la connaissance présentent une riche ambiguïté et génèrent des significations dans lesquelles de nombreuses personnes trouvent des intérêts. Le trafic commercial et scientifique des singes est aussi bien un trafic de significations que de vies animales. Les sciences qui lient les singes et les humains ensemble au sein d’un ordre des Primates sont construites à partir de pratiques disciplinaires profondément enchevêtrées à la narration, à la politique, au mythe, à l’économie et aux possibilités techniques. Les femmes et les hommes qui ont contribué à l’étude des primates ont véhiculé les marques de leurs propres histoires et de leurs propres cultures. Ces marques sont inscrites dans les textes sur la vie des singes, mais souvent de façon subtile et inattendue. Les personnes qui étudient ces autres primates défendent des discours scientifiques contradictoires, et doivent rendre des comptes à de nombreux types de publics et de financeurs. Elles se sont engagées dans des relations d’amour et de connaissance dynamiques, disciplinées et intimes avec les animaux qu’elles avaient le privilège d’observer. Les primatologues comme les animaux dont ils et elles ont rapporté la vie suscitent un intérêt populaire intense – dans les musées d’Histoire naturelle, les émissions télévisées, les zoos, la chasse, la photographie, la science-fiction, les politiques de protection, la publicité, le cinéma, l’actualité scientifique, les cartes de vœux, ou encore les blagues. Les animaux ont été considérés comme des sujets privilégiés par diverses sciences de la vie et diverses sciences humaines – anthropologie, médecine, psychiatrie, psychobiologie, physiologie de la reproduction, linguistique, neurobiologie, paléontologie et écologie comportementale. Les singes ont modelé une vaste gamme de problèmes et d’espoirs humains. Plus encore, dans les sociétés européennes, américaines et japonaises, les singes ont été soumis à des interrogations prolongées et culturellement spécifiques sur ce que signifie être « presque humain ».

Les singes – et les personnes qui construisent les connaissances scientifiques et populaires à leur sujet – font partie de cultures en conflit. Jamais innocente, la « technologie » narrative de visibilisation propre à ce livre s’inspire à la fois des théories contemporaines sur la production culturelle, des études historiques et sociales sur la science et la technologie, et des mouvements et théories féministes et antiracistes, afin d’élaborer une vision de la nature telle qu’elle est construite et reconstruite dans les corps et les vies d’animaux du « tiers-monde » qui servent de substituts à l’« homme ».
J’ai essayé d’emplir mon livre Primate Visions (1989) de puissantes images verbales et visuelles : le cadavre d’un gorille abattu en 1921 au « cœur de l’Afrique » et transformé en leçon de vertu civique au musée américain d’Histoire naturelle de New York ; une petite fille blanche emmenée au Congo belge dans les années 1920 pour « chasser » le gorille avec un appareil photo, et qui s’est métamorphosée dans les années 1970 en une autrice de science-fiction, considérée pendant des années comme un modèle de prose masculine ; le chimpanzé Ham dans sa capsule spatiale pour le projet Mercury en 1961 ; David Greybeard (contemporain du chimpanzé Ham) tendant la main à Jane Goodall, « seule » dans les « étendues sauvages de Tanzanie », l’année où quinze nations africaines abritant des primates ont accédé à leur indépendance nationale ; une édition spéciale du magazine Vanity Fair sur Dian Fossey en 1986, un an après son assassinat, dans un cimetière de gorilles au Rwanda ; les os d’un fossile antique, reconstitués comme étant ceux de la grand-mère de l’humanité, et disposés comme des joyaux sur du velours rouge dans le laboratoire d’un paléontologue, selon un modèle destiné à fonder, une fois de plus, une théorie sur l’origine de la « monogamie » ; les bébés singes du laboratoire de Harry Harlow, dans les années 1960, s’accrochant aux vêtements de leurs « mères de substitution », à un moment historique où les images de la maternité de substitution commençaient à faire surface dans les politiques américaines de reproduction5 ; l’étreinte émotionnellement déchirante entre une jeune scientifique blanche de classe moyenne et un chimpanzé adulte parlant la langue des signes américaine, sur une île du fleuve Gambie, où des femmes blanches apprennent aux singes captifs à « retourner » à l’état « sauvage » ; une carte de vœux Hallmark inversant l’image de King Kong, où l’on voit une femme blonde gigantesque et un gorille à dos argenté qui se recroqueville dans un lit, la scène étant intitulée « Getting Even » (« prendre sa revanche ») ; des femmes et des hommes ordinaires d’Afrique, des États-Unis, du Japon, d’Europe, d’Inde et d’ailleurs, muni·es de magnétophones et de presse-papiers, transcrivant la vie des singes dans des textes spécialisés, qui deviendront des éléments contestés au sein des controverses politiques de multiples cultures.

J’écris sur les primates parce qu’ils sont populaires, importants, merveilleusement variés et controversés. Et tou·tes les membres de l’ordre des Primates – singes comme humain·es – sont menacé·es. La primatologie de la fin du 20e siècle peut être considérée comme faisant partie d’une littérature complexe de la survie, au sein de la culture nucléaire mondialisée. La production et la stabilisation des connaissances concernant l’ordre des Primates comportent des enjeux émotionnels, politiques et professionnels pour de nombreuses personnes, y compris moi-même. Il ne s’agira donc pas ici d’une étude objective et désintéressée, ni d’une étude exhaustive – en partie parce que de telles études sont impossibles pour qui que ce soit, et en partie parce qu’il y a des enjeux que je tiens à rendre visibles (et probablement d’autres encore). Je veux que ce livre puisse intéresser de nombreux publics, et qu’il soit à la fois agréable et dérangeant pour chacun et chacune d’entre nous. En particulier, je veux que ce livre remplisse son devoir à la fois vis-à-vis des primatologues, des historien·nes des sciences, des théoricien·nes de la culture, des vastes mouvements de gauche, antiracistes, anticoloniaux et féministes, des animaux, et de celles et ceux qui aiment les histoires sérieuses. Il n’est peut-être pas toujours possible de rendre des comptes à ces différents publics, mais c’est grâce à eux que ce livre a pu voir le jour. Ils sont tous présents dans ce texte. Les primates, qui existent aux frontières de tant d’espoirs et d’intérêts, sont des sujets merveilleux avec lesquels on peut explorer la perméabilité des murs, la reconstitution des frontières et le dégoût des dualismes interminables imposés par la société.
J’écris sur les primates parce qu’ils sont populaires, importants, merveilleusement variés et controversés. Et tou·tes les membres de l’ordre des Primates – singes comme humain·es – sont menacé·es.
Donna Harraway
Fait et fiction
La science et la culture populaire sont toutes deux inextricablement tissées de faits et de fictions. Il semble naturel, et même moralement obligatoire, d’opposer fait et fiction ; pourtant, leurs similarités sont profondément ancrées dans les cultures et les langues occidentales. Les faits peuvent être imaginés comme des nœuds, originaux et irréductibles, à partir desquels une compréhension fiable du monde peut être construite. On pense généralement que les faits doivent être découverts, et non pas fabriqués ou construits. Mais l’étymologie du mot « fait » nous renvoie à l’action humaine, à la performance, voire aux exploits humains. Les faits naissent des actes, par opposition aux mots. Autrement dit, aussi bien d’un point de vue linguistique qu’historique, l’action humaine est à la racine de tout ce que nous pouvons considérer comme étant un fait. Un fait est une chose faite, un participe passé neutre issu du latin, notre langue parente commune. Dans ce sens originel, les faits sont ce qui s’est réellement passé. De telles choses sont connues via l’expérience directe, via le témoignage et via l’interrogation – des voies d’accès à la connaissance extraordinairement privilégiées en Occident.
La fiction, elle, peut être envisagée comme une version dérivée et fabriquée du monde et de l’expérience, comme une sorte de double perverti des faits, ou comme une évasion imaginaire vers un monde meilleur que « ce qui s’est réellement passé ». La variété des tonalités au sein de la fiction nous laisse penser que son origine se trouve dans la vision, l’inspiration, la perspicacité, le génie. Nous entrevoyons la racine de la fiction dans la poésie et nous croyons, avec un certain romantisme, que c’est par une bonne fiction que se révèlent les natures originelles. En d’autres termes, la fiction peut être vraie, ou du moins reconnue comme telle, du fait de son attrait pour la nature. Et comme la nature est prolifique – elle est la mère de la vie dans nos principaux systèmes de mythes –, la fiction semble être une vérité intérieure qui donne naissance à nos vies réelles. Il s’agit là aussi d’une voie d’accès à la connaissance très privilégiée dans les cultures occidentales, y compris aux États-Unis. Enfin, l’étymologie de la fiction nous renvoie à nouveau à l’action humaine, à l’acte de façonner, de former ou d’inventer, ainsi qu’à celui de feindre. La fiction s’inscrit donc inéluctablement dans une dialectique du vrai (naturel) et du faux (artefact). Mais dans toutes ses significations, la fiction concerne l’action humaine. De même, tous les récits de la science – fictions et faits – concernent l’action humaine.
La fiction est proche des faits, sans qu’ils soient des jumeaux identiques. Les faits s’opposent aux opinions, aux préjugés, mais pas à la fiction. La fiction et les faits sont tous deux ancrés dans une épistémologie qui fait appel à l’expérience. Cependant, il existe une différence importante : le mot fiction est une forme active, qui renvoie à un acte présent de façonnage, tandis que le mot fait provient d’un participe passé, une forme verbale qui masque l’acte générateur ou la performance. Un fait semble achevé, immuable, apte seulement à être enregistré ; la fiction, elle, semble toujours inventive, ouverte à d’autres possibilités, à d’autres façonnements de la vie. Mais dans cette ouverture réside la menace d’une simple feinte, celle de ne pas dire la vraie forme des choses.
La pratique scientifique est avant tout une pratique narrative – entendue comme une pratique historiquement spécifique d’interprétation et de témoignage.
Donna Haraway
D’un certain point de vue, les sciences naturelles semblent offrir des outils qui permettent de distinguer les faits de la fiction, de remplacer l’invention par son participe passé, et de préserver ainsi l’expérience vraie de toute contrefaçon. Par exemple, l’histoire de la primatologie a été racontée à maintes reprises comme une clarification progressive de l’observation des singes et des êtres humains. Il y a d’abord eu les premiers indices de l’existence d’une forme commune « primate », suggérés, dans les brumes préscientifiques, par les récits inventifs de chasseurs, de voyageurs et d’indigènes. Peut-être ces indices datent-ils de l’Antiquité, ou peut-être du 16e siècle, lors de la tout aussi mythique époque des Découvertes et de la naissance de la Science moderne. Puis, progressivement, la vision claire et éclairée est apparue, sur la base de dissections et de comparaisons anatomiques. L’histoire de ce qu’est la vision correcte de la forme sociale propre aux primates suit d’ailleurs la même trame : le passage d’une vision brumeuse et encline à l’invention, vers une connaissance quantitative et perçante, enracinée dans ce type particulier d’expérience qu’on appelle experiment en anglais. C’est l’histoire du passage d’une science immature, fondée sur la simple description et la libre interprétation qualitative, vers une science mature, fondée sur des méthodes quantitatives et des hypothèses falsifiables, et aboutissant à une reconstruction scientifique synthétique de la réalité des primates. Mais ces histoires (histories) sont des histoires (stories) à propos d’autres histoires ; elles sont des récits qui se terminent bien – c’est-à-dire les faits rassemblés, la réalité scientifiquement reconstruite. Et ces histoires ont une esthétique particulière (le réalisme) et une politique particulière (l’engagement pour le progrès).
Depuis une perspective très légèrement différente, l’histoire des sciences apparaît comme un récit sur l’histoire des moyens techniques et sociaux utilisés pour produire les faits. Les faits eux-mêmes sont des types d’histoires, des types de témoignages relatant des expériences. Mais provoquer une expérience scientifique requiert une technologie élaborée – comprenant des outils physiques, une tradition d’interprétation accessible et des relations sociales spécifiques. Ce n’est pas n’importe quoi qui peut devenir un fait ; ce n’est pas n’importe quoi qui peut être vu ou produit, et ainsi être raconté. La pratique scientifique peut ainsi être considérée comme une sorte de pratique narrative – un art de raconter l’histoire de la nature, qui est régi par des règles, qui est soumis à des contraintes et qui évolue historiquement. La pratique scientifique et les théories scientifiques produisent des types particuliers d’histoires, et sont intégrées dans des types particuliers d’histoires. Toute déclaration scientifique sur le monde dépend intimement du langage, de la métaphore. Les métaphores peuvent être mathématiques ou culinaires ; dans tous les cas, elles structurent la vision scientifique. La pratique scientifique est avant tout une pratique narrative – entendue comme une pratique historiquement spécifique d’interprétation et de témoignage.
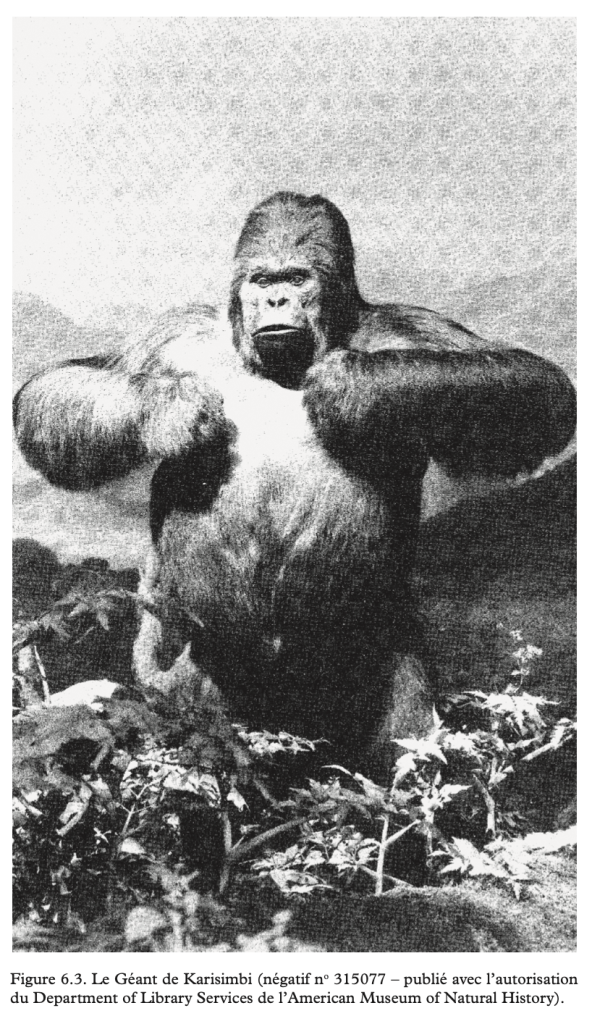
Regarder la primatologie, une branche des sciences de la vie, comme une fabrique narrative peut s’avérer particulièrement approprié. Premièrement, le discours de la biologie, qui a débuté aux alentours des premières décennies du 19e siècle, s’est intéressé aux organismes, aux êtres ayant une histoire de vie – c’est-à-dire une trame possédant une structure et une fonction6. La biologie est intrinsèquement historique, et la forme de son discours est intrinsèquement narrative. La biologie, comme manière de connaître le monde, s’apparente à la littérature romantique et à son discours sur les formes et les fonctions organiques. La biologie est la fiction appropriée pour les objets qu’on appelle « organismes » ; la biologie modèle les faits « découverts » au sujet des êtres organiques. Les organismes accomplissent une performance pour les biologistes, qui la transforment en une vérité attestée par une expérience disciplinée – c’est-à-dire en un fait, qui est l’acte ou la prouesse conjointement accomplie par le scientifique et l’organisme. Le romantisme se mêle au réalisme, et le réalisme au naturalisme ; le génie se mêle au progrès, et l’idée au fait. Les scientifiques autant que les organismes sont des acteurs au sein d’une pratique narrative.
Deuxièmement, les singes et les êtres humains apparaissent, dans la primatologie, à l’intérieur de narrations élaborées, sur les origines, les natures et les possibilités. La primatologie concerne l’histoire vivante d’un ordre taxonomique qui inclut les êtres humains. Et ce sont tout particulièrement les humains occidentaux qui produisent des histoires à propos des primates, tout en racontant simultanément des histoires à propos des relations entre nature et culture, animal et humain, corps et esprit, origine et futur. En effet, depuis son apparition, au milieu du 18e siècle, l’ordre des Primates a été construit sur des récits à propos de ces dualismes et de leur résolution scientifique.
Traiter une science comme un discours narratif n’est pas signe de mépris, c’est même plutôt le contraire. Mais il ne s’agit pas non plus d’avoir une attitude mystifiée et adoratrice face à un participe passé. Je m’intéresse aux narrations sur les faits scientifiques – ces puissantes fictions de la science – prises à l’intérieur d’un champ complexe que j’identifierai avec le signifiant « SF ». À la fin des années 1960, la critique littéraire de science-fiction Judith Merril a commencé à utiliser, de façon singulière, le signifiant SF pour désigner un champ narratif complexe et émergent, au sein duquel les frontières entre science-fiction (qu’on appelle par convention « sf », en minuscules) et fantasy devenaient perméables dans une propension déroutante, tant d’un point de vue commercial que linguistique. Son appellation, SF, se trouva être largement adoptée par les critiques, les lect·rices, les aut·rices, les fans ; et les maisons d’édition ont peiné à comprendre cet éventail de plus en plus hétérodoxe de pratiques d’écriture, de lecture et de marketing, repérables par une prolifération d’expressions correspondant à l’acronyme « sf » en anglais : fiction spéculative, science-fiction, science-fantasy, futurs spéculatifs, fabulation spéculative.
➤ Lire aussi | L’ère de la standardisation : conversation sur la Plantation・Anna Tsing et Donna Haraway (2024)
La SF est un territoire de reproduction culturelle controversée au sein des mondes technologisés. Placer les récits de faits scientifiques à l’intérieur de l’espace hétérogène de la SF transforme tout un champ. Ce champ transformé crée alors des résonances entre toutes ses régions et toutes ses composantes. Aucune région ou composante n’est « réduite » à aucune autre, mais les pratiques de lecture et d’écriture se répondent les unes les autres à travers un espace structuré. La fiction spéculative révèle des tensions différentes lorsque son champ contient également les pratiques d’inscription qui constituent le fait scientifique. Les sciences sont liées à des histoires complexes, en ce qui concerne la constitution des mondes imaginatifs comme la constitution des corps réels au sein des cultures modernes et postmodernes du « premier monde ». Teresa De Lauretis a avancé l’idée que le travail de création de sens impliqué par le terme SF était « potentiellement créateur de nouvelles formes sociales d’imagination – créateur, dans le sens où il peut permettre de révéler l’existence d’espaces où le changement culturel pourrait avoir lieu ; d’envisager un ordre différent des relations entre les gens, et entre les gens et les choses, c’est-à-dire une conceptualisation différente de l’existence sociale, incluant à la fois l’existence physique et matérielle » (1980 : 161). Or cela est aussi l’une des tâches du « travail de création de sens » qu’est la primatologie.
Ainsi, du moins en partie, ce livre propose de lire tout texte sur les primates comme une science-fiction – où les mondes possibles sont constamment réinventés, dans le cadre de la lutte pour des mondes présents et bien réels. Toutefois, la conclusion de l’ouvrage proposera une lecture alternative d’une histoire de sf – sur une espèce extraterrestre intervenant dans la politique de reproduction humaine –, comme s’il s’agissait d’une monographie sur les primates. Le présent ouvrage – enraciné dans les mythes, les sciences et les pratiques sociales historiques qui ont placé les singes dans l’Éden puis dans l’espace (au commencement et à la fin de la culture occidentale) – implante des étrangers (aliens) dans le texte comme un moyen de comprendre ce que sont l’amour et le savoir parmi les primates, sur notre fragile Terre contemporaine.

Quatre tentations
Analyser un discours scientifique, la primatologie, comme un récit au sein de plusieurs champs narratifs contestés est un moyen d’entrer dans les débats actuels sur la construction sociale du savoir scientifique, sans succomber complètement à aucune des quatre positions suivantes (pourtant très tentantes), qui sont néanmoins aussi des ressources majeures pour les méthodes utilisées dans ce livre. J’utilise l’image de la tentation car je trouve que ces quatre positions sont persuasives, fécondes mais aussi dangereuses, particulièrement si l’une de ces positions réduit finalement les autres au silence, créant ainsi une fausse harmonie au sein de l’histoire primate.
La première tentation, pleine de ressources, provient de la tendance la plus active au sein des études sociales sur la science et la technologie. Par exemple, l’éminent analyste des sciences Bruno Latour rejette radicalement toutes les formes de réalisme épistémologique, et analyse la pratique scientifique comme totalement sociale et interprétative. Réfutant la distinction entre le social et le technique, il décrit la pratique scientifique comme le raffinement de « dispositifs d’inscription » – c’est-à-dire des dispositifs permettant de retranscrire l’immense complexité et l’immense chaos des interprétations concurrentes sous forme de traces, d’écrits, qui marquent l’émergence d’un fait, d’un cas de réalité. S’intéressant à la fois à la science en tant que nouvelle forme de pouvoir dans le monde social-matériel, et aux scientifiques comme investissant « leur capacité politique au cœur de la pratique de la science », Bruno Latour et son collègue Stephen Woolgar ont puissamment décrit comment les processus de construction sont faits pour s’inverser et apparaître sous forme de découverte (1979 : 213). Les comptes rendus des scientifiques à propos de leurs propres processus deviennent des données ethnographiques, sujettes à une analyse culturelle.
Depuis la perspective de leur ouvrage La Vie de laboratoire, la pratique scientifique est fondamentalement une pratique littéraire, une pratique d’écriture qui repose sur le fait de se disputer le pouvoir de stabiliser des définitions et des normes permettant d’affirmer que quelque chose est vrai. Gagner, c’est rendre trop élevé le coût de la déstabilisation d’un récit donné. Cette approche peut expliquer les luttes scientifiques autour du pouvoir de clore le débat, et elle peut rendre compte des succès et des échecs de ces luttes. La pratique scientifique est faite de négociations, de déplacements stratégiques, d’inscription et de traduction. Il y a beaucoup à dire sur la science comme croyance effective, ainsi que sur son pouvoir à renforcer et incarner une telle croyance7. Que peut-on demander de plus à une théorie de la pratique scientifique ?
La seconde tentation importante vient d’une branche de la tradition marxiste, qui défend la supériorité historique de certains points de vue dans la connaissance du monde social – et possiblement du monde « naturel » également. D’un point de vue fondamental, les adeptes de cette tradition considèrent que le monde social est structuré par les relations sociales de production et de reproduction de la vie quotidienne, de sorte qu’il n’est possible de voir clairement ces relations que depuis certains points de vue. Il ne s’agit pas d’une affaire individuelle, et la bonne volonté n’est pas en cause. Depuis le point de vue des groupes sociaux en position de domination et de pouvoir systématiques, la véritable nature de la vie sociale sera opaque ; ils ont trop à perdre de la clarté.
Ainsi, les propriétaires des moyens de production vont voir de l’équité dans un système d’échange, là où le point de vue de la classe ouvrière révélera la nature dominatrice d’un système de production fondé sur le salariat, et donc sur l’exploitation et la déformation du travail humain. Celles et ceux pour qui la définition sociale de l’identité prend racine dans le système raciste ne pourront pas voir que la définition de l’humain n’a jamais été neutre, et ne le sera pas tant que de profonds changements matériels et sociaux ne se produiront pas à l’échelle mondiale. De la même manière, pour celles et ceux dont la possibilité même d’accéder au statut d’adulte repose sur le pouvoir de s’approprier l’« autre » au sein d’un système socio-sexuel genré, le sexisme n’apparaîtra pas comme un obstacle fondamental à une connaissance correcte en général. La tradition redevable à l’épistémologie marxiste est en mesure de rendre compte de la plus grande adéquation de certains modes de connaissance, et elle est en mesure de montrer que la race, le sexe et la classe sociale déterminent fondamentalement les détails les plus intimes de la connaissance et de la pratique, en particulier là où l’apparence est celle de la neutralité et de l’universalité8.
Pour l’observateur d’animaux, les peuples autochtones d’Afrique et d’Asie étaient une nuisance, une menace à la protection, jusqu’à ce que la décolonisation oblige les scientifiques occidentaux blancs à restructurer leur biopolitique du soi et de l’autre, du natif et de l’étranger.
Donna Haraway
Ces questions sont loin d’être sans rapport avec la primatologie, une science qui, aux États-Unis, est pratiquée presque exclusivement par des personnes blanches, et même jusqu’à très récemment par des hommes blancs, et toujours en grande majorité par des personnes économiquement privilégiées. Une part importante de ce livre examine les conséquences, pour la primatologie, des relations sociales de race, de sexe et de classe impliquées dans la construction du savoir scientifique. Par exemple, la plupart des primatologues des premières décennies après la Seconde Guerre mondiale n’ont probablement pas compris que les interrelations entre les gens, la terre et les animaux en Afrique et en Asie sont, au moins en partie, dues aux positions des chercheurs eux-mêmes au sein des systèmes racistes et impérialistes. Nombre d’entre eux ont recherché une nature « pure », vierge de tout contact humain ; et donc aussi des espèces intactes – de façon analogue aux « indigènes » autrefois recherchés par les anthropologues coloniaux. Mais pour l’observateur d’animaux, les peuples autochtones d’Afrique et d’Asie étaient une nuisance, une menace à la protection – en fait des « étrangers » (aliens) envahissants –, jusqu’à ce que la décolonisation oblige les scientifiques occidentaux blancs à restructurer leur biopolitique du soi et de l’autre, du natif et de l’étranger. Ainsi, les frontières entre animaux et êtres humains se déplacent lors de la transition d’un point de vue colonial à un point de vue postcolonial ou néocolonial. En insistant sur le fait qu’on peut trouver des contenus et des méthodes moins déformatrices dans les sciences naturelles comme dans les sciences sociales, les approches marxistes, féministes et antiracistes rejettent le relativisme propre à l’étude sociale des sciences. Les approches explicitement politiques prennent parti quant à la question de savoir ce qu’est une connaissance plus adéquate, et plus humainement acceptable. Mais ces analyses ont aussi leurs limites pour ce qui est de guider une exploration des études sur les primates. Le travail salarié, l’appropriation sexuelle et reproductive et l’hégémonie raciale sont des aspects structurants du monde social humain. Il n’y a aucun doute sur le fait qu’ils affectent la connaissance de façon systématique, mais on ne sait pas dire précisément comment ils se relient aux savoirs sur les modèles d’alimentation des singes patas, ou sur la réplication des molécules d’ADN.
Cependant, un autre pan de la tradition marxiste a fait des avancées significatives dans les méthodes pour répondre à ce genre de questions. Dans les années 1970, des personnes associées au Radical Science Journal britannique ont développé l’idée de la science comme processus de travail, cela afin d’étudier et de modifier les médiations scientifiques perpétuant des dominations de classe dans les relations de production et de reproduction de la vie humaine9. Tout comme Bruno Latour, ces personnes n’ont laissé aucune place pour des épistémologies réalistes ou positivistes – qui sont pourtant les versions préférées de la plupart des scientifiques en exercice. Chaque aspect de la pratique scientifique peut être décrit à travers le concept de médiation : le langage, les hiérarchies de laboratoire, les liens industriels, les doctrines médicales, les préférences théoriques de base, et les histoires à propos de la nature. Malgré cela, le concept de « processus de travail » peut sembler cannibale, car il fait passer les relations sociales de tous les autres processus basiques comme des choses qui dériveraient de ce processus premier. Par exemple, les systèmes complexes de domination, de complicité, de résistance, d’égalité et de soin au sein des pratiques genrées de gestation et d’éducation des enfants ne peuvent pas répondre au seul concept de travail. Pour autant, ces pratiques reproductives affectent clairement un certain nombre de contenus et méthodes au sein des études sur les primates. D’ailleurs, même un concept élargi de médiation au sein de processus sociaux systémiques – qui n’insisterait pas sur la réduction de toute chose au travail, dans un sens marxiste classique – laisserait encore trop de pans de l’équation de côté.
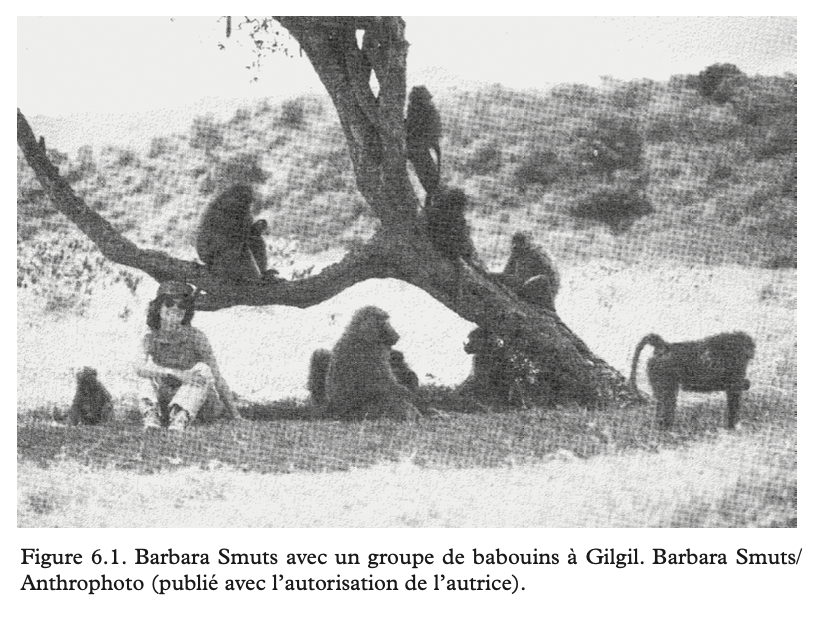
La troisième tentation vient du chant des sirènes des scientifiques eux-mêmes, qui ne cessent de rappeler que, parmi d’autres choses, ils et elles observent des singes. En un sens, plus ou moins nuancé, ils et elles insistent sur le fait que la pratique scientifique est « au contact » du monde. Ils et elles affirment que la connaissance scientifique n’est pas simplement une question de pouvoir et de contrôle. Et que leurs connaissances traduisent en quelque sorte la voix active de leurs sujets – qui sont les objets de la connaissance. Sans être nécessairement forcée de suivre leur esthétique du réalisme ou leurs théories de la représentation, je les crois dans la mesure où ma vie imaginative et intellectuelle ainsi que mes engagements professionnels et politiques dans le monde répondent à ces récits scientifiques. Les scientifiques sont habiles à fournir de bonnes raisons de croire en leurs récits et d’agir sur la base de ceux-ci. Mais la question de savoir comment la science est « en contact » avec le monde est loin d’être résolue. Ce qui semble résolu, cependant, c’est que la science se développe à partir de modes de vie concrets, et crée des modes de vie concrets – y compris des constructions particulières de l’amour, de la connaissance et du pouvoir. C’est là le cœur de son instrumentalisme, et la limite de son universalisme.
Je souhaite trouver un concept pour raconter une histoire de la science qui ne dépende pas des dualismes entre actif et passif, culture et nature, humain et animal, social et naturel.
Donna Haraway
Les preuves sont toujours une question d’interprétation ; et les théories sont des récits depuis et pour des types spécifiques de vies. Je cherche donc une façon de raconter une histoire de la production d’une branche des sciences de la vie, branche qui inclut les êtres humains de façon centrale – qui eux-mêmes écoutent ces histoires très attentivement. Ainsi, mon histoire se doit d’écouter les pratiques d’interprétation de l’ordre des Primates, au sein desquels les primates eux-mêmes et elles-mêmes – singes comme humain·es – exercent toutes et tous une sorte d’« autorat ». Je voudrais donc suggérer que la notion de « récit contraint et contesté » permet d’apprécier la construction sociale de la science, tout en guidant le lecteur ou la lectrice vers la recherche des autres animaux participant activement à la primatologie. Je souhaite trouver un concept pour raconter une histoire de la science qui ne dépende pas des dualismes entre actif et passif, culture et nature, humain et animal, social et naturel.
La quatrième tentation recoupe chacune des trois autres ; et cette tentation principale consiste à toujours regarder les constructions des sciences modernes, aux quatre coins du monde, à travers le prisme des histoires complexes de genre et de race. Cela signifie qu’il faut examiner les productions culturelles, y compris les sciences des primates, depuis les perspectives permises par les politiques et les théories féministes et antiracistes. Le défi est de se remémorer sans cesse la particularité aussi bien que la puissance de cette façon-là de lire et d’écrire. Mais c’est le même défi qui devrait être intégré à toute lecture ou écriture d’un texte scientifique. La race et le genre ne sont pas des catégories sociales universelles premières – et encore moins des réalités naturelles ou biologiques. La race et le genre sont les produits d’histoires spécifiques, mais très vastes et durables, qui ont changé le monde. Et il en va de même pour la science. Le champ de vision de ce livre dépend d’un triple filtre : la race, le genre et la science. C’est le filtre qui retient le mieux les corps marqués par l’histoire, afin de les examiner de plus près10.
Les histoires sont toujours des productions complexes, comprenant de nombreux conteurs et auditeurs, et de nombreuses conteuses et auditrices, mais qui ne sont pas toutes et tous visibles et audibles. La narration est une notion sérieuse, mais heureusement dépourvue du pouvoir de revendiquer des lectures uniques ou fermées. La primatologie semble être une science composée d’histoires, et le but de ce livre est d’entrer dans les contestations liées à la construction de ces histoires. Le prisme de la narration définit une ligne ténue entre réalisme et nominalisme – même si les primates semblent être des scolastiques naturels, ayant tendance à devenir équivoques lorsqu’on les presse. Aussi, je pense qu’il y a une esthétique et une éthique dans le fait de considérer la pratique scientifique comme un art de raconter les histoires – une esthétique et une éthique différentes de la capitulation devant le « progrès », et différentes de la croyance dans la connaissance comme reflet passif de « la façon dont les choses sont », et différentes également du scepticisme ironique et de la fascination pour le pouvoir si fréquents dans les études sociales sur la science. L’esthétique et l’éthique latentes dans l’examen de l’art de raconter les histoires pourraient procurer plaisir et responsabilité dans le tissage des contes. Les histoires sont des moyens d’accéder à des modes de vie. Les histoires sont des technologies permettant d’incarner des primates.
➤ Lire aussi | L’invasion silencieuse. La primatologie d’Imanishi et les préjugés culturels dans les sciences・Frans de Waal (2022)
La primatologie est une science (judéo-)chrétienne
Les juifs et les chrétiens occidentaux, ou les post-judéo-chrétiens, ne sont pas les seuls à pratiquer les sciences des primates. Mais ce livre se concentre avant tout sur l’histoire des études sur le comportement social des singes réalisées aux États-Unis ou par des Euro-Américain·es au cours du 20e siècle. Dans ces histoires, on retrouve un refrain tiré de l’histoire du salut : la primatologie concerne à la fois les histoires primales (l’origine et la nature de « l’homme ») et les histoires de réformation (la réforme et la reconstruction de la nature humaine). Implicitement et explicitement, l’histoire du jardin d’Éden apparaît dans les sciences des singes, à côté de diverses versions de l’origine de la société, du mariage et du langage.

Dès ses débuts, la primatologie a eu ce caractère en Occident. Si Linné, le « père » moderne de la classification biologique au 18e siècle, est constamment cité par les scientifiques du 20e siècle, c’est pour avoir placé les êtres humains dans un ordre taxonomique de la nature aux côtés d’autres animaux – c’est-à-dire pour avoir fait un grand pas de côté par rapport aux hypothèses chrétiennes. Linné a placé l’« homme » en tant qu’Homo sapiens au sein de son ordre taxonomique des primates ; dans le même genre qu’Homo troglodytes, une créature intéressante mais douteuse, illustrée comme une femme poilue. Le nouvel ordre des Primates de la dixième édition du Systema naturae (1758) comprenait également un genre pour les singes et les grands singes, un pour les lémuriens, et un pour les chauves-souris. Mais l’activité de Linné, considéré comme le « père » d’un discours sur la nature, peut aussi être perçue d’une tout autre manière. Il parlait de lui-même comme d’un second Adam, ou comme « l’œil » de Dieu, pouvant donner de vraies représentations et de vrais noms, et réformant ainsi – ou restaurant – la pureté des noms perdus à cause du premier péché d’Adam11. La nature était un théâtre, une scène où se jouaient l’histoire naturelle et l’histoire du salut. Le rôle de celui qui a renommé les animaux était d’assurer un ordre de la nature vrai et fidèle, de purifier à la fois l’œil et le mot. « L’équilibre de la nature » était en partie maintenu par le rôle d’un nouvel « homme » qui pourrait voir clairement et nommer correctement – une identité loin d’être anodine en regard de l’expansion européenne du 18e siècle. C’est d’ailleurs là l’identité du sujet-auteur moderne, pour qui écrire le corps de la nature est l’assurance de pouvoir la maîtriser.
Implicitement et explicitement, l’histoire du jardin d’Éden apparaît dans les sciences des singes, à côté de diverses versions de l’origine de la société, du mariage et du langage.
Donna Haraway
La science de l’histoire naturelle, chez Linné, était une science intimement chrétienne. Sa tâche première, accomplie dans l’œuvre de Linné et de ses correspondants, a été d’annoncer la parenté de l’« homme » et de la bête au sein de l’ordre moderne d’une Europe en expansion. L’homme naturel ne se trouvait pas seulement parmi les « sauvages », mais aussi parmi les animaux – qui ont été nommés « primates » en conséquence, eux le premier Ordre de la nature. Ceux qui étaient en mesure de donner de tels noms avaient une vocation moderne puissante : ils devenaient des scientifiques. La taxonomie a eu une fonction séculaire sacrée. L’« appel » à pratiquer la science a maintenu ce caractère sacralisé jusqu’à aujourd’hui – même si nous verrons que son apogée était au début du 20e siècle. Les histoires produites par de tels praticiens ont un statut spécial au sein d’une culture biblique protestante réprimée comme celle des États-Unis.
Pour Linné, la nature ne devait pas être comprise de façon « biologique », mais de façon « représentative ». Au cours du 19e siècle, la biologie est devenue un discours à propos de la nature productive et expansive. La biologie a été construite comme un discours sur la nature entendue comme un système de production et de reproduction, et comprise sur le modèle d’une division fonctionnelle du travail, selon des critères d’efficacité mentale, agissante et sexuelle des organismes. Dans ce contexte, au 20e siècle, les primates ont été intégrés au sein d’un « théâtre écologique » et d’un « jeu évolutif » (Hutchinson, 1965). L’intrigue a porté sur l’origine et le développement de nombreux thèmes mythiques persistants : le sexe, le langage, l’autorité, la société, la compétition, la domination, la coopération, la famille, l’État, la subsistance, la technologie et la mobilité.
Dans ce livre, deux lectures principales de cette pièce de théâtre ont été retenues. La première s’intéresse aux significations symboliques, aux sciences des primates comme une certaine forme d’art faisant un usage répété des ressources narratives des systèmes de mythes judéo-chrétiens. La seconde accorde une attention particulière aux façons dont la biologie au sujet des primates est théorisée en tant que système matériel de production et de reproduction – une sorte de lecture « matérialiste ». Ces deux interprétations sont à l’écoute des échos et des déterminants de race, de sexe et de classe au sein de ces histoires. Le corps primate, en tant que partie du corps de la nature, peut être lu comme une carte du pouvoir. La biologie et la primatologie sont des discours intrinsèquement politiques, dont les principaux objets de connaissance, tels que les organismes et les écosystèmes, sont des icônes (des condensations) de l’ensemble de l’histoire et des politiques de la culture qui les a construits pour la contemplation et la manipulation. Le corps primate lui-même est un type intrigant de discours politique.
La primatologie est un orientalisme simien
L’argument de ce livre est que la primatologie s’intéresse à un Ordre, un ordre taxonomique et par conséquent politique, qui fonctionne à travers la négociation de frontières obtenues par l’ordonnancement des différences. Ces frontières démarquent des territoires sociaux importants (tels que la norme d’une famille correcte) et sont établies par des pratiques sociales (telles que le développement de programmes de recherche, des politiques de santé mentale, des politiques de protection, la réalisation de films et la publication de livres). Les deux axes majeurs qui structurent ces puissants récits scientifiques de la primatologie – élaborés au sein de toutes ces pratiques – sont définis par des dualismes en interaction : sexe/genre et nature/culture. Le sexe et l’Occident sont des axiomes de la biologie comme de l’anthropologie. Dans la logique qui guide ces dualismes complexes, la primatologie occidentale se révèle comme un orientalisme simien [figure ci-dessous].

Edward Saïd (2015 [1978]) a affirmé que les chercheurs occidentaux (européens et nord-américains) ont participé à une longue histoire d’acceptation des pays, des peuples et des cultures du Proche-Orient et de l’Extrême-Orient, qui s’appuie sur la place particulière de l’Orient dans l’histoire occidentale – le lieu des origines de la langue et de la civilisation, des riches marchés, de la possession et de la pénétration coloniale, et celui de la projection des imaginaires. L’Orient a été une ressource troublante dans la production de l’Occident – lui, l’autre de « l’Est », sa périphérie, qui devint matériellement son dominateur. L’Occident est placé en dehors de l’Orient, et cette extériorité fait partie des pratiques de représentation de l’Occident. Saïd cite Marx : « Ils ne peuvent se représenter eux-mêmes ; ils doivent être représentés. » Ces représentations sont des miroirs complexes de l’évolution du moi occidental à des moments historiques spécifiques. L’Occident s’est aussi placé de manière flexible : les Occidentaux pouvaient se trouver là avec relativement peu de résistance de la part de l’autre. La différence s’est donc située au niveau du pouvoir. Cette structure a été limitante, bien sûr, mais, plus important encore, elle a été productive. Cette productivité s’est opérée au sein des pratiques et des discours structurés de l’orientalisme – où ces structures étaient une condition pour avoir quelque chose à dire. Il n’est jamais question d’avoir quelque chose de vraiment original à dire sur les origines. Une partie de l’autorité des pratiques quant aux récits des origines réside précisément dans leurs relations intertextuelles.
La primatologie est un discours occidental, et c’est un discours sexualisé. Symboliquement, la nature et la culture, aussi bien que le sexe et le genre, se construisent mutuellement (mais pas équitablement) : un pôle d’un dualisme ne peut exister sans l’autre.
Donna Haraway
Sans pousser la comparaison trop loin, les signes du discours orientalistes marquent la primatologie. Mais ici, la scène des origines n’est pas le berceau de la civilisation : elle est le berceau de la culture, de l’être humain se distinguant de l’existence animale. Si l’orientalisme concerne l’imagination occidentale sur les origines de la cité, la primatologie, elle, met en scène l’imagination occidentale sur les origines de la socialité elle-même, et en particulier sur cette icône si chargée symboliquement qu’est « la famille ». Les origines sont par principe inaccessibles par témoignage direct ; toute voix provenant de l’époque des origines est structurellement la voix de l’autre, et qui donc génère le soi. C’est pourquoi, dans les représentations et les simulations au sujet des primates, l’esthétique réaliste et l’esthétique postmoderne ont toutes deux été des modes de production d’illusions complexes, qui fonctionnent comme des générateurs féconds de faits scientifiques et de théories scientifiques. Et il ne faut pas mépriser l’« illusion » lorsqu’elle fonde des vérités si puissantes.
L’idée d’orientalisme simien signifie que la primatologie occidentale concerne : la construction du moi à partir de la matière première de l’autre ; l’appropriation de la nature dans la production de la culture ; le mûrissement de l’humain à partir du sol de l’animal ; la clarté du blanc à partir de l’obscurité du coloré ; l’homme (man) sorti du corps de la femme ; l’élaboration du genre à partir de la ressource sexuelle ; et l’émergence de l’esprit par l’activation du corps. Pour rendre effectives de telles opérations de transformation, l’« orientaliste » simien doit d’abord en construire les termes : animal, nature, corps, primitif, femelle. Les singes – traditionnellement associés à des significations obscènes, à la luxure sexuelle et au corps sans retenue – ont reflété les humains, dans un jeu complexe de distorsions, à travers des siècles de commentaires occidentaux au sujet de ces doubles troublants. La primatologie est un discours occidental, et c’est un discours sexualisé. Elle traite du potentiel et de sa réalisation. Nature/culture et sexe/genre ne sont pas des paires de termes vaguement liés : leur forme spécifique de relation est une appropriation hiérarchique, connectée (comme l’enseignait Aristote) à la logique actif/passif, forme/matière, forme achevée/ressource, homme/animal, finalité/cause matérielle. Symboliquement, la nature et la culture, aussi bien que le sexe et le genre, se construisent mutuellement (mais pas équitablement) : un pôle d’un dualisme ne peut exister sans l’autre.
La critique de Saïd envers l’orientalisme devrait nous alerter sur un autre point important : ni le sexe ni la nature ne sont la vérité sous-jacente du genre et de la culture ; pas plus que l’« Orient » n’est réellement l’origine et le miroir déformant de l’« Occident ». La nature et le sexe sont tout autant fabriqués que leur « autre », les pôles dominants. Mais leurs fonctions et leurs pouvoirs sont différents. La tâche de ce livre est de participer à montrer comment l’ensemble de l’édifice dualiste est construit, quels sont les enjeux liés à ses architectures, et comment cet édifice peut être redessiné. Il importe de savoir précisément comment le sexe et la nature deviennent des objets de connaissance naturels-techniques ; et il importe tout autant d’expliquer leurs doubles – le genre et la culture. Il n’est pas vrai qu’aucune histoire ne pourrait être racontée sans ces dualismes, ni qu’ils font partie de la structure de l’esprit ou du langage. D’ailleurs, il existe des histoires alternatives au sein de la primatologie. Mais ces binarités ont été à la fois particulièrement productives et particulièrement problématiques pour les constructions des corps femelles et des corps marqués par la race ; il est crucial de voir comment ces binarités peuvent être déconstruites et peut-être redéployées.
➤ Lire aussi | Aux sens large : comment l’éthologie agrandit le monde・Thibault De Meyer et Vinciane Despret (2025)
Pour celles et ceux qui gagnent leur vie en produisant les sciences naturelles et en les commentant, il semble pratiquement impossible de croire qu’il n’y a pas de réalité donnée en deçà des écritures de la science, qu’il n’y a pas de centre sacré intouchable permettant de fonder et d’autoriser un ordre de la connaissance innocent et progressiste. Peut-être que dans les « humanités », il n’y a pas d’échappatoire à la représentation, à la médiation, à la narration et à la saturation sociale. Mais les sciences naturelles l’emportent sur cet autre ordre défectueux que sont les « humanités » – comme le prouve leur pouvoir de convaincre et de réordonner le monde entier, et non pas juste une culture locale. Les sciences naturelles sont l’« autre » des sciences humaines, avec tous leurs tragiques orientalismes. Pour autant, un tel édifice ne résiste pas à l’examen.
Ce n’est pas seulement parce que les sciences naturelles sont présentées comme cet « autre » que les plaidoyers des scientifiques convainquent. Leurs assertions sont prévisibles et semblent plausibles à celles et ceux qui les formulent parce qu’elles sont intégrées dans les taxonomies du savoir occidental, et parce que les besoins sociaux et psychologiques des chercheu·ses sont satisfaits par les affirmations persistantes de la division entre sciences naturelles et humaines – par cette division du travail et de l’autorité au sein de la production des discours. Sauf que de telles observations quant aux assertions prévisibles et aux besoins sociaux ne réduisent pas les sciences naturelles à un « relativisme » cynique qui n’aurait aucune norme au-delà de son pouvoir arbitraire. Mon argumentation ne prétend pas non plus que le monde dont les gens s’efforcent de rendre compte n’existe pas, qu’il n’y a pas de référent dans le système de signes et de productions des savoirs, ni de progrès dans l’élaboration de meilleurs récits au sein de ces traditions de pratiques. Cela reviendrait précisément à réduire un champ complexe à l’un des pôles des dualismes ici analysés : le pôle désigné comme idéal par rapport à un matériau impossible, celui désigné comme apparence par rapport à un réel interdit.

Le cœur de mon argumentation est plutôt que les sciences naturelles, tout comme les sciences humaines, se trouvent inextricablement prises au sein des processus qui leur donnent naissance. Et donc, comme les sciences humaines, les sciences naturelles sont culturellement et historiquement spécifiques, modifiées, impliquées. Elles importent pour des personnes réelles. Il est alors logique de se demander quels sont les enjeux, les méthodes et les genres d’autorités impliqués dans les récits des sciences naturelles – et comment ils diffèrent, par exemple, de la religion ou de l’ethnographie. En retour, il n’est par contre pas logique de chercher une forme d’autorité qui échapperait au réseau de ces champs culturels si productifs, et qui, au commencement, rendent les récits possibles. L’œil détaché de la science objective est une fiction idéologique, et elle est puissante. Mais c’est une fiction qui cache – et qui est conçue pour cacher – combien les puissants discours des sciences naturelles opèrent sur le réel. Là encore, les limites sont ici productives, et non pas réductrices et invalidantes.
L’une des conséquences désagréables de mon argument est que les sciences naturelles sont légitimement sujettes à la critique, et ce au niveau des « valeurs », et pas seulement des « faits ». Elles sont sujettes à une évaluation culturelle et politique « de l’intérieur », et pas seulement « en extérieur ». Mais l’évaluation, elle aussi, est impliquée, liée, pleine d’enjeux et d’intérêts croisés, et fait partie du champ de pratiques qui créent du sens pour des personnes réelles en rendant compte de vies situées – et y compris de ces choses hautement structurées que l’on appelle « observations scientifiques ». Les évaluations et les critiques ne peuvent pas enjamber les normes fabriquées pour produire des récits crédibles au sein des sciences naturelles, car ni les critiques ni les objets dont elles parlent n’ont de place « en dehors » qui permettrait de légitimer une vue d’ensemble aussi arrogante. Insister sur le fait que la production du savoir scientifique est fondamentalement chargée de valeurs et d’histoires n’équivaut pas à se tenir nulle part en ne parlant de rien d’autre que de ses propres préjugés – c’est même plutôt le contraire. Seule la façade d’une objectivité désintéressée rend impossible une « objectivité concrète ».
La nature n’est que la matière première de la culture ; et, dans la logique du colonialisme capitaliste, elle doit être appropriée, préservée, esclavagisée, exaltée ou rendue flexible afin d’être mise à la disposition de la culture.
Donna Haraway
Une partie de la difficulté à approcher les constructions intégrées, intéressées et passionnées de la science d’une façon non réductrice nous vient d’une tradition analytique – que nous héritons notamment d’Aristote et de l’histoire transformative du « patriarcat capitaliste blanc » (comment bien nommer cette chose scandaleuse ?) – et qui fait de toute chose une ressource à s’approprier. En tant que « ressource », un objet de connaissance n’est finalement qu’une matière pour le pouvoir séminal, et donc pour l’acte du sachant. Ici, l’objet à la fois garantit et revigore le pouvoir du sachant ; mais tout statut d’agent doit être dénié à l’objet dans les productions de savoir. Le monde doit, en somme, être objectivé en chose, pas en agent ; il doit être de la matière pour la formation de soi du seul être social au sein des productions de savoir, le sachant humain. La nature n’est que la matière première de la culture ; et, dans la logique du colonialisme capitaliste, elle doit être appropriée, préservée, esclavagisée, exaltée ou rendue flexible afin d’être mise à la disposition de la culture. De la même manière, le sexe est seulement la matière de l’acte de genre ; la logique productionniste semble inéluctable au sein des traditions dualistes occidentales. Cette logique narrative analytique et historique explique ma nervosité à propos de la distinction sexe/genre lorsqu’elle est vue, au sein de l’histoire récente des théories féministes, comme un moyen d’aborder les reconstructions de ce qui peut compter comme étant « femelle » ou « nature » dans la primatologie – et de pourquoi ces reconstructions importent au-delà des frontières des études sur les primates. Il a semblé pratiquement impossible d’éviter le piège d’une logique de domination appropriationniste, enchâssée dans la binarité nature/culture et dans sa lignée générative, ce qui inclut la distinction sexe/genre.
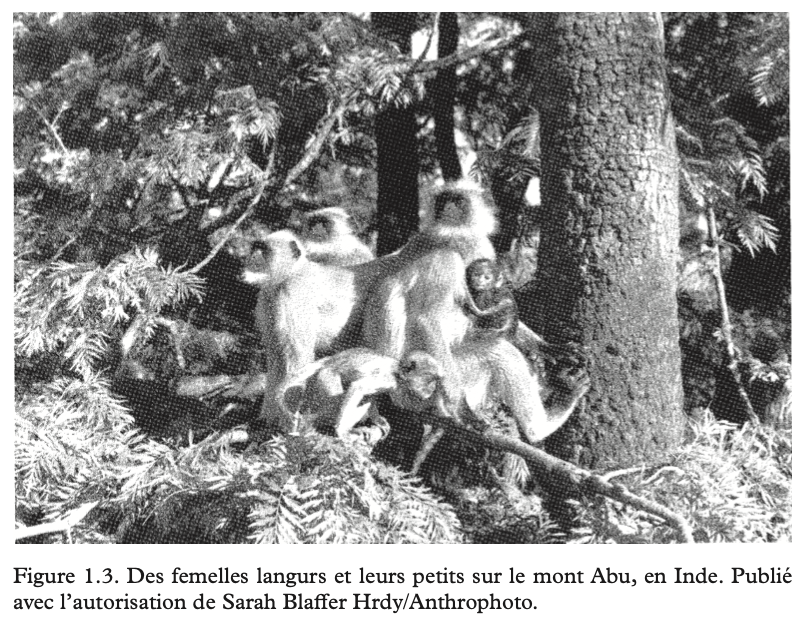
Lire dans les zones frontières
De nombreux sujets dans l’histoire de la biologie et de l’anthropologie pourraient venir nourrir les thèmes discutés dans cette introduction : alors pourquoi ce livre a-t-il choisi d’explorer les sciences des primates en particulier ? La raison principale est que les singes, et les êtres humains considérés comme leurs descendants taxonomiques, existent aux frontières d’une myriade de luttes pour déterminer ce qui comptera comme étant du savoir. Les primates ne se sont pas gentiment enfermés dans une discipline ou un champ spécialisé et sécurisé. Même en cette fin de 20e siècle, de nombreux types de personnes peuvent prétendre connaître les primates, suscitant la consternation et le grand dam de nombreux autres candidats à l’expertise officielle. La possibilité de déstabiliser les savoirs à propos des primates reste à la portée non seulement des praticien·nes de divers champs des sciences de la vie et des sciences humaines, mais aussi à la portée de personnes en marge de toute science – des écrivain·es scientifiques, des philosophes, des historien·nes, comme des visiteu·ses de zoos. De surcroît, raconter des récits à propos des animaux est une pratique si profondément populaire que le discours produit au sein des spécialités scientifiques est approprié par d’autres personnes, à leurs propres fins. La frontière entre discours technique et discours politique est aussi fragile que perméable. Même en cette fin de 20e siècle, le langage de la primatologie est mobilisé au sein de débats politiques controversés sur la nature humaine, son histoire et son avenir. Et cela reste vrai malgré la transformation des discours spécialisés de la primatologie en d’autres langages : mathématiques, théorie des systèmes, analyses ergonomiques, théorie des jeux, stratégies au sein de l’histoire de la vie, et biologie moléculaire.
En plaçant ce récit de primatologie au sein de la SF, j’invite les lecteurs et lectrices à redessiner les frontières entre nature et culture.
Donna Haraway
Parmi les conflits frontaliers intéressants à propos des primates – qui et que sont-ils (et qui et à quoi servent-ils) –, il y a ceux qui opposent : la psychiatrie et la zoologie ; la biologie et l’anthropologie ; la génétique et la psychologie comparée ; l’écologie et la recherche médicale ; l’agriculture et les industries touristiques dans le « tiers-monde » ; les chercheu·ses de terrain et les scientifiques de laboratoire ; les défenseu·ses de l’environnement et les multinationales de l’exploitation forestière ; les braconniers et les gardes-chasse ; les scientifiques et les administrateurs au sein des zoos ; les féministes et les antiféministes ; les spécialistes et les profanes ; l’anthropologie physique et la biologie éco-évolutionnaire ; les scientifiques confirmé·es et les récent·es titulaires de doctorat ; les étudiant·es en études de genre et les professeur·es en comportement animal ; des linguistes et des biologistes ; des responsables de fondation et des demandeu·ses de subvention ; des écrivain·es scientifiques et des chercheu·ses ; des historien·nes des sciences et des vrai·es scientifiques ; des marxistes et des libéraux ; des libéraux et des néo-conservateurs. Et toutes ces intersections apparaissent dans ce livre.
Comment différent·es lectrices et lecteurs pourraient-ils voyager avec plaisir dans ces zones frontières ? Chaque chapitre relève à la fois de l’histoire des sciences, des études culturelles, de l’exploration féministe et d’une intervention engagée pour la constitution d’amour et de connaissance au sein de la fabrique disciplinée de l’ordre des Primates. J’espère que les lecteurs et lectrices n’y seront pas un « public », dans le sens de la réception d’une histoire finie. Les conventions au sein du champ narratif qu’est la SF semblent exiger des lectrices et lecteurs qu’ils réécrivent radicalement les histoires par l’acte même de les lire. En plaçant ce récit de primatologie au sein de la SF – les narrations de la fiction spéculative comme des faits scientifiques –, j’invite les lecteurs et lectrices (historien·nes, critiques culturel·les, féministes, anthropologues, biologistes, antiracistes et amoureu·ses de la nature) à redessiner les frontières entre nature et culture. Je souhaite que les lecteurs et lectrices trouvent ici un « ailleurs » à partir duquel envisager un ordre de relations différent et moins hostile entre les gens, les animaux, les technologies et la terre. Tout comme les acteurs et actrices des histoires qui suivent, je souhaite également proposer de nouveaux termes qui nous aident à circuler entre ce que nous avons historiquement appris à connaître comme nature et culture.
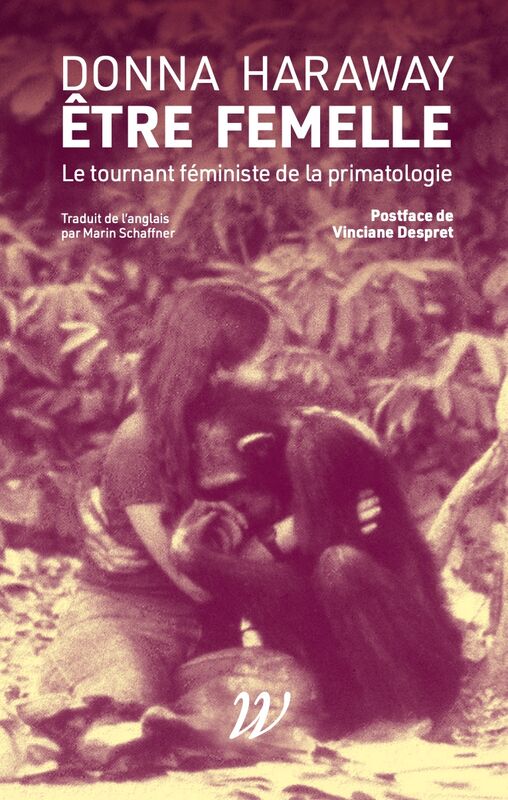
Image principale : « Les singes dans l’orangeraie », Henri Rousseau, 1910. Wikiart.
L’ensemble des images en noir et blanc de cet article sont tirées des divers chapitres du livre Être femelle – les autres sont libres de droits.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
Notes
- Le premier, Crystals, Fabrics and Fields (non traduit), paru en 1976, était la publication de sa thèse en biologie.
- Traduit en 2002 par Marie-Hélène Dumas, Charlotte Gould et Nathalie Magnan, dans Connexions : art, réseaux, média, anthologie établie par Nathalie Magnan et Annick Bureaud, Paris : éditions Ensba.
- Une nouvelle traduction de « Savoirs situés » est à paraître aux Éditions Wildproject en mars 2026 – accompagnée d’un entretien avec Jeanne Burgart Goutal.
- La nouvelle de science-fiction de John Varley, The Persistence of Vision, est en partie à l’origine de ce livre. Dans cette nouvelle, Varley décrit une communauté utopique conçue et construite par des personnes sourdes et aveugles. Il explore ensuite les technologies et autres moyens de communication de ces personnes, ainsi que leurs relations avec les enfants voyants et les visiteu·ses (Varley, 1978). L’interrogation sur les limites et la violence de la vision fait partie de la politique d’apprentissage de la révision.
- NdT : Tout au long de l’ouvrage, l’expression « politiques de reproduction » (reproductive politics) renverra au terme forgé par les féministes dans les années 1970 pour décrire les luttes de pouvoir contemporaines sur la contraception, l’avortement, l’adoption, la gestation pour autrui, et les questions qui leur sont corollaires.
- Foucault (1963) ; Albury (1977) ; Canguilhem (2013 [1966]) ; Figlio (1976).
- Voir aussi Latour (1983, 2005 [1987], 2012 [1984]) ; Bijker et al. (1987) ; Gallon et Latour (1981) ; Knorr-Cetina (1983) ; Knorr-Cetina et Mulkay (1983) ; Traweek (1988).
- Voir Hartsock (1983) ; Harding (1986) ; Rose (1983).
- Voir Young (1977, 1985a) ;Yoxen (1981, 1983) ; Figlio (1977).
- Voir Fee (1986) ; Gould (1981) ; Hammonds (1986) ; Hubbard, Henifin et Fried (1982) ; Gilman (1985) ; Lowe et Hubbard (1983) ; Keller (1985).
- Je dois cette analyse de Linné comme Œil/Je (Eye/I) de Dieu à Camille Limoges, de l’université de Québec à Montréal.
L’article Le tournant féministe de la primatologie est apparu en premier sur Terrestres.
16.12.2025 à 16:28
La bactérie et la goutte de pluie : une autre histoire des cycles de l’eau
Le saviez-vous ? Souvent, c’est une bactérie qui donne naissance à une goutte de pluie. Mais ce processus est menacé. Pire : l’ensemble des cycles de l’eau est fortement perturbé. Dans un article saisissant, l’hydrologue Emma Haziza appelle à être à la hauteur des bouleversements. Tour d’horizon de l’état des aquifères, entre sècheresses et (méga)bassines.
L’article La bactérie et la goutte de pluie : une autre histoire des cycles de l’eau est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (9339 mots)

Ce texte est extrait du livre Vers des politiques des cycles de l’eau, dirigé par Marin Schaffner et Mathias Rollot, paru en 2025 aux éditions Le bord de l’eau dans la collection « En Anthropocène ».
En premier lieu, je voudrais témoigner d’une tendance de fond que j’observe au niveau mondial sur la façon d’approcher aujourd’hui une vision plus systémique de la science, plus appliquée également. La science doit venir résoudre des problèmes concrets du quotidien. Les enjeux liés à la cinétique rapide du changement climatique font partie de ces sujets qui nécessitent une recherche-action opérationnelle. J’observe de plus en plus de chercheur·es à l’échelle internationale prendre cette tangente vers plus de pluridisciplinarité, et qui font évoluer la recherche scientifique par des voies disruptives. Les approches en silo – depuis les grandes disciplines héritées – apparaissent à un nombre croissant de scientifiques comme un modèle en train de s’épuiser, car il ne répond plus aux problématiques immédiates de notre monde moderne, qui n’a plus le temps de collecter des données sur un temps long pour affirmer des tendances et engager des prises de consciences. Dans un monde en mouvement, dont la bascule est à la fois extrêmement rapide et parfois même violente, si l’on veut répondre aux enjeux de vulnérabilité territoriale, il y a une nécessité de plus en plus flagrante à travailler avec des approches pluridisciplinaires et transversales. Au fond, il s’agit peut-être de pouvoir approcher un territoire un peu comme on approche un être vivant.
Dans ce contexte, la question du cycle de l’eau qui nécessiterait une approche systémique (du fait de la complexité des enjeux en place) nous est enseignée dès le primaire de manière simpliste, comme un cycle renouvelable, sans intervention humaine au sein de chaque processus. Et quelque part, c’est cette image qui reste ensuite dans la conscience collective empêchant de se confronter à une réalité qui nécessite des actions de fonds comme d’urgence. À titre d’exemple, dès qu’il pleut, tout le monde est persuadé que le problème de sécheresse est résolu.
L’une des découvertes les plus incroyables de ces dernières décennies est que le cycle de l’eau n’existe et ne se renouvelle que grâce au vivant.
On oublie à quel point la nature est bien plus complexe que cela. L’une des découvertes les plus incroyables de ces dernières décennies – et qui illustre cette complexité – est le fait que le cycle de l’eau n’existe et ne se renouvelle que grâce au vivant. Ce ne sont pas simplement des molécules d’eau qui précipitent, s’évaporent, ruissellent ou s’infiltrent, mais une symbiose entre un microbiote atmosphérique composé de spores et de bactéries pathogènes de végétaux capables de générer les pluies. Une goutte de pluie ne prend donc naissance que grâce à un support et dans de nombreux cas, celui-ci est un organisme vivant, en l’occurrence une bactérie dont la stratégie de colonisation s’appuie sur sa capacité à fabriquer la pluie. On change alors de paradigme, ce n’est plus la forêt qui a besoin de la pluie mais la pluie qui se met à avoir besoin de la forêt pour exister.
Nos représentations générales sont formées de telle manière qu’on ne pense généralement qu’aux molécules d’eau et à leur changement d’états. L’approche de la complexité des systèmes naturels nous embarque dans une histoire merveilleuse dont on ne perçoit qu’une infime partie avec l’état actuel de nos connaissances. Or, de la même manière que nous-mêmes sommes fait·es de 100 000 milliards de bactéries et de seulement 37 milliards de cellules humaines, le cycle de l’eau est en interaction permanente avec de nombreux organismes vivants, et n’existe que grâce à eux.
De l’importance de regarder correctement les nuages
Pour poursuivre cette idée, j’aimerais prendre l’exemple de « l’ensemencement » des nuages. C’est un terme que l’on entend généralement pour qualifier une pratique humaine – et donc artificielle – qui consiste à provoquer des pluies en envoyant des molécules chimiques dans l’atmosphère. Cela se pratique depuis des décennies, que ce soit en Chine, en Australie, à Dubaï, ou encore au Mexique. Je précise ici qu’au niveau mondial est actuellement en train de se dérouler une chasse à cellui qui va récupérer l’eau de l’autre – et cette guerre de l’eau se joue sur trois plans, les eaux souterraines, les réseaux de surface, mais également au niveau de nos eaux atmosphériques.
Si on s’intéresse tout particulièrement à « l’ensemencement » naturel des nuages, en dehors de toute interaction avec les humains, cette phase est plus que nécessaire, puisque c’est la fonction intégrante de création de la pluie. Pour que la goutte d’eau puisse se former et passer ainsi de l’état de vapeur à l’état liquide, il faut un support, une sorte de « graine » (et c’est bien pour cela qu’on utilise le terme d’ensemencement comme on pourrait l’utiliser sur le plan agricole). À l’échelle de la planète, la majorité de ces « graines » sont des grains de sel arrachés aux mers et océans par les vents et transportés en haute altitude pour contribuer à la formation des pluies. C’est ce qui explique que 80 % des pluies se trouvent au-dessus des océans. Une partie de ces pluies formées (20 à 21 %) arrive sur les continents. S’opère alors ce qu’on appelle un recyclage continental, c’est-à-dire que ces pluies vont se renouveler au-dessus des terres émergées.
« L’ensemencement » naturel des nuages est largement dû à une bactérie qui peut former de la glace sur sa capsule et attirer ainsi la vapeur d’eau pour la condenser sous forme de microgouttelettes de pluie.
En 1982, un chercheur a mis en évidence le fait qu’une majeure partie de cette « graine » était en fait une bactérie (du genre Pseudomonas) qui a la faculté sur sa capsule d’être glaçogène, c’est-à-dire de former de la glace et d’attirer ainsi la vapeur d’eau en la condensant sous la forme de microgouttelettes de pluie. Une fois que celles-ci ont atteint un poids suffisant sur le plan gravitaire, les gouttes d’eau tombent et forment ainsi la pluie. Or cette bactérie est un pathogène sur l’ensemble du monde végétal. Elle a donc besoin des couverts végétaux pour proliférer, et être ensuite emportée en haute altitude pour contribuer à la formation de pluies. La nature nous a donc offert une bactérie capable de régénérer les pluies continentales.

Comprendre cela, c’est comprendre que, si l’on veut pouvoir régénérer des pluies en temps de sécheresse, nous avons besoin à la fois d’un maximum de couvert végétal (des forêts, mais aussi des champs) et du moins d’intrants chimiques possibles (car des tests montrent que ces bactéries sont tuées par les pesticides et meurent au-dessus de 30°C). À l’heure actuelle, dans le sud de l’Espagne, de grands problèmes de lutte contre les sécheresses se concentrent massivement sur la coupe d’arbres – car on estime qu’un arbre pompe 1 000 litres d’eau par jour, et que cela entre en concurrence avec les besoins humains. Des réflexions similaires existent aussi sur certains massifs forestiers en France. Les arbres, par leur évapotranspiration, sont pourtant aujourd’hui les meilleurs des climatiseurs – puisqu’ils répartissent la vapeur d’eau. Méconnaître le rôle de chaque élément du système et conserver une logique en silo conduit à des prises de décisions absurdes.
A-t-on donc vraiment bien compris la complexité et la magie extraordinaire de ces cycles de l’eau ? Les respecte-t-on ? Ne sommes-nous pas en train de regarder un problème plus vaste par des bouts de lorgnettes ? Les décisions qui sont prises en rapport avec la ressource en eau – toujours dans des logiques de production, de rentabilité et de concurrence – ont-elles encore un sens ?
Personne ne dit jamais qu’il n’y a pas de cycle du carbone sans cycle de l’eau : si vous n’avez pas d’eau dans vos sols, vous n’aurez jamais de captation de carbone.
Je pose ces questions car l’eau est au fondement de l’alimentation de tous les systèmes économiques. Il n’y a pas un seul système économique dans le monde qui ne s’appuie pas sur de l’eau. Si vous voulez de l’énergie, par exemple, il vous faut de l’eau – que ce soit pour aller chercher du pétrole, extraire du charbon, faire de l’hydroélectricité ou refroidir des centrales1. La question énergétique, qu’on dit être centrale dans la « lutte contre le changement climatique », cache donc de multiples usages de l’eau. Dans l’approche dominante, on a l’impression que ce qui risque de mettre la Terre dans un état d’inhabitabilité, ce sont absolument et uniquement les émissions de carbone. Ce qui est terrible, pourtant, c’est que personne ne dit jamais qu’il n’y a pas de cycle du carbone sans cycle de l’eau (alors que c’est la base de la bio-géochimie) : si vous n’avez pas d’eau dans vos sols, vous n’aurez jamais de captation de carbone. On ne se pose donc jamais la question de la restauration des terres et de la restauration des cycles – et du fait que ces cycles fonctionnent tous ensemble (avec celui du soufre, du phosphate, du magnésium, etc.). Simple chiffre en passant : pour récupérer 2 molécules de carbone dans l’atmosphère, il faut 12 molécules d’eau dans le sol – car tout cela est directement lié à la vapeur d’eau2. C’est le principe de base de la photosynthèse.
➤ Lire aussi | Face à la bataille de l’eau, l’hypothèse biorégionaliste・Mathias Rollot (2023)
Le réchauffement n’est qu’un épouvantail
On nous raconte également très souvent que tous les désastres climatiques en cours (ces inondations et ces sécheresses qui témoignent d’une accélération du cycle de l’eau) sont liés au réchauffement climatique. Pourtant, la majeure partie du dérèglement des cycles de l’eau est directement liée aux pratiques humaines – et aux manières dont iels perçoivent ces cycles, les gèrent et les exploitent. Dès le début du XXe siècle, on a ainsi assisté à une course – de la part des grands dictateurs comme des grandes puissances capitalistes – au contournement massif des cours d’eau. Cette tentative de domination de la nature était une manière de montrer que l’ingénierie humaine peut dompter et maîtriser les cycles ; et les États-Unis comme la Russie ont commencé à détourner leurs grands fleuves. D’ailleurs, le détournement des fleuves russes vers le Turkménistan et l’Ouzbékistan (avec 1,2 million de prisonniers de guerre – les fameux goulags), en vue de transformer d’immenses steppes désertiques en plaines luxuriantes de coton (celles-là même qui aujourd’hui permettent d’obtenir les volumes gigantesques nécessaires à la fast fashion), c’est ce qui amène aujourd’hui à la disparition de la mer d’Aral : et l’on voit que cela n’est en rien directement lié, de prime abord, au changement climatique. On voit donc bien avec cet exemple comment les systèmes économiques existants sont directement liés aux manières dont on a dominé l’eau et dont on a empêché toute possibilité de restauration de ces cycles entravés.
La majeure partie du dérèglement des cycles de l’eau est directement liée aux pratiques humaines – et aux manières dont les humains perçoivent ces cycles, les gèrent et les exploitent.
Partout sur la planète, il n’y a quasiment plus aucun endroit dans lequel cette eau n’a pas été pillée en surface. Mais l’autre mouvement corollaire, c’est celui du pillage en profondeur. En Inde, où l’eau affleurait historiquement à moins de 4 mètres quasiment partout, il y a désormais certaines régions où, même à 500 mètres de profondeur, on ne trouve plus d’eau. Un nouveau marché est même en train de naître en Inde, où les petit·es propriétaires terrien·es ne vendent désormais plus leur production agricole, mais leur eau (voyant passer tous les jours des dizaines de camions-citernes chez eux, pour emmener l’eau vers des endroits où il n’y en a déjà plus). Cela conduit à des désastres, absolument cruciaux à comprendre, car on assiste à des migrations massives, vers les grands centres urbains – en Inde mais aussi en Ouzbékistan ou en Chine –, de personnes qui ne peuvent plus rien faire pousser et parfois même qui n’ont plus à boire. Là encore, ces migrations ne sont pas directement liées au changement climatique, mais plutôt à nos modèles de consommation et à nos modèles d’aménagement. De la même manière, la majeure partie de l’effondrement massif de la biodiversité découle de la déstabilisation des chaînes trophiques, par la disparition des habitats et par les pollutions. En cela, le changement climatique n’est qu’un accélérateur de problématiques préexistantes. Nos émissions de CO2 ne sont qu’une couche supplémentaire sur des dérèglements plus profonds, découlant de nos modèles de sociétés.

Restaurer au lieu de bouleverser
Comprendre ces cycles de l’eau de façon systémique, cela permet en retour de pouvoir envisager de restaurer ces cycles, et de les ralentir. Ce que cela veut dire, c’est qu’une fois que la goutte d’eau tombe sur le sol, il va falloir lui faire suivre le chemin le plus long possible, pour qu’elle ait le temps au maximum de réussir à s’infiltrer. Car sur 100 % de pluie qui tombe, dans un cadre idéal, ce sont seulement 9 à 10 % qui pénètrent à l’intérieur des sols et rejoignent une nappe phréatique. On est donc dans un contexte où il faut envisager toute une série de solutions et de moyens pour parvenir à cela : jouer avec l’ombre et la limitation de l’érosion (c’est pour cela que l’on parle beaucoup d’agroforesterie et de haies), jouer avec des phénomènes de rétention naturelles ou biomimétiques (afin de recréer un maximum de verticalité dans ces cycles de l’eau accélérés), etc. Par exemple, dans la ville de Montpellier (où j’ai longtemps vécu), nous avions fait une étude sur tous les puits anciens, afin de retrouver les endroits où l’eau peut rejoindre la nappe ; et nous avons découvert que la seule zone encore restante d’impluvium, c’était le jardin des plantes historique de la ville. Sans ce jardin municipal qui est protégé, il n’y aurait plus un seul endroit aujourd’hui, dans une ville de cette taille, pour permettre une verticalité du cycle de l’eau.
Sur ces cinq dernières années en France, plus de 50 % des personnes qui ont été inondées l’ont été en dehors de zones inondables.
Or tout cela commence à se voir de façon flagrante. Sur ces cinq dernières années en France, plus de 50 % des personnes qui ont été inondées l’ont été en dehors de zones inondables. Cela ne veut pas dire que l’on mesure mal les zones inondables. C’est juste que les cartographies existantes s’appuient sur les tracés des lits mineur et majeur des cours d’eau, alors que l’eau aujourd’hui n’a même plus le temps de rejoindre les lits des rivières et des fleuves – et qu’elle prend donc d’autres chemins, non prévus par les cartographies existantes. Dans une telle situation de déshydratation des sols, le moindre axe d’écoulement préférentiel se transforme en véritable cours d’eau – par exemple une rue. Commencer à comprendre cela, c’est donc comprendre que le risque change, qu’il se modifie.
➤ Lire aussi | Inondations et barrages dans la vallée de la Vesdre : l’aménagement du territoire en question ・Marie Pirard (2023)
En 2024, il a beaucoup plu (peut-être trop même, comme a pu le démontrer le nombre de sinistré·es d’inondations dans les Hauts-de-France), et on pourrait donc avoir l’impression que les problèmes de sécheresses des années précédentes sont résolus, et que nos nappes sont à nouveau bien pleines. Mais, c’est là où il est important de regarder ces enjeux à l’échelle de plusieurs années. Par exemple, l’année 2018 a beaucoup ressemblé à l’année 2024 (avec une crue majeure de la Seine, pour celleux qui s’en souviennent, et des nappes bien rechargées) ; et, pour autant, on a eu trois semaines de canicule en juillet qui nous ont fait rebasculer, presque sans transition, dans un état de sécheresse historique. Ce phénomène porte aujourd’hui un nom scientifique, et il est constaté partout à travers le monde : ce sont des « sécheresses éclairs ». Et nous ne sommes pas habitué·es à cela. Pour rappel, la grande sécheresse de 1976 (qui avait conduit à la création d’un « impôt sécheresse » pour tous les habitants – ce qui avait coûté son poste de Premier ministre à Jacques Chirac à l’époque) était une « sécheresse froide ». Il y avait eu alors une forte absence de précipitations, mais pas d’anomalie de température à la hauteur de ce que nous enregistrons ces dernières années.
Au début des années 2000, les zones de crise pouvaient correspondre à 2 % du territoire national ; à partir de 2017, quasiment chaque année, près de 90 % du territoire est en crise.
Or aujourd’hui, on peut avoir des sécheresses moins importantes en termes de manque de pluie, mais les températures de plus en plus caniculaires (qui peuvent dorénavant atteindre 42°C dès le mois de juin à Paris et 46°C dans le Sud, comme en 2019) génèrent des sortes de « sèche-cheveux » massifs, qui peuvent entraîner des bascules extrêmement rapides. Il va donc assurément falloir restaurer ces cycles rapidement, mais il va aussi falloir de l’agilité. Ça devient une urgence pour nos territoires. Ce sont pourtant des questions qui sont encore très loin de se poser, dans nos institutions, à la hauteur de ces urgences. Par exemple, en France, nous n’avons quasiment aucun·e expert·e sécheresse – car la question ne se posait que très rarement dans des climats tempérés comme les nôtres. Et donc, personnellement, j’ai dû me former sur le tas, à partir de 2017, en travaillant à partir de toute la littérature existante ; puis en essayant de modéliser, au plus près des territoires ce qui est en train de se passer, année après année. Tout cela demande de la recherche-action, mais aussi de « disrupter » les modèles scientifiques habituels.

Remettre les pieds dans les bassines
Pour finir, ce tour d’horizon, j’aimerais revenir sur les enjeux et les controverses des bassines – qui me paraissent être une autre très bonne porte d’entrée pour comprendre les problématiques et les enfermements systémiques qui sont aujourd’hui les nôtres. Mon enjeu ici sera de reposer le décor de manière globale.
Ainsi, si cette question des bassines existe, c’est d’abord parce que nous avons eu la crise de sécheresse de 1976 (que j’évoquais précédemment) et qui a fait très peur au gouvernement à l’époque. Gouvernement qui avait alors choisi l’option de préserver les cours d’eau et les nappes, plutôt que les autres usages, lorsque celles-ci se retrouvent dans des états de tension extrêmes. Une réglementation avait été mise en place, qui fait que – aujourd’hui encore – dès lors que l’on atteint un scénario qui ressemble à celui de 1976, des arrêtés préfectoraux sont pris dans les zones en crise, interdisant tous les usages qui ne sont pas considérés comme « prioritaires ». Ce qui est priorisé, c’est la salubrité publique, les hôpitaux et les eaux domestiques. L’irrigation agricole devient donc strictement interdite dans de telles périodes de crise. Au début des années 2000, il arrivait ainsi, certaines années, d’avoir des zones de crise qui correspondait à 2 % du territoire national ; puis 10 % du territoire au début des années 2010 ; et, à partir de 2017, quasiment chaque année, près de 90 % du territoire en phase de crise. On demande donc à une profession agricole – qui s’est appuyée sur un modèle d’irrigation massive comme on l’y a incitée durant des décennies – de stopper net son activité en été. Les agriculteur·es se retrouvent ainsi à devoir stopper des productions énormes en termes de volumes, qui sont destinées à l’export et qui représentent donc, en cumulé, des milliards d’euros. À noter au passage, en outre, que beaucoup de pays sont totalement dépendants de certaines de nos productions : le Maroc par exemple, avec notre blé. Les questions sont donc d’ordre économique mais aussi géopolitique, et elles sont extrêmement complexes.
Dans les bassines, l’eau stagne et avec l’apport aérien de matières organiques, croupit. Cette eau croupissante engendre un développement algaire et un risque de prolifération, notamment de salmonelle et de cyanobactéries.
Quand de telles décisions de crise sont prises, les instances agricoles se questionnent donc sur les manières de contourner ce schéma-là. Or, quand on regarde dans les textes, on voit qu’il est possible d’irriguer lorsque vous êtes dans une zone où il existe une retenue collinaire (c’est-à-dire, une sorte de mini-barrage qui permet de retenir des eaux d’écoulement qu’on utilisera avec un effet retard) – les retenues naturelles pouvant aussi être utilisées durant ces phases de crise. C’est ainsi que dans des zones complètement plates, telles que les Deux-Sèvres, où il n’y a absolument aucune possibilité de créer des retenues collinaires, on a eu l’idée de venir pomper dans les nappes, durant la phase hivernale, avant les arrêtés sécheresse du printemps. Ce qu’on appelle une « bassine », c’est l’équivalent de jusqu’à 260 piscines olympiques remplies avec de l’eau extrêmement pure – de l’eau souterraine protégée jusque-là tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Cette eau est stockée dans une sorte d’immense bassin avec un fond plastifié en attendant l’été et la période de risque de restriction maximale. Sauf que dans ces bassines, il se passe un phénomène à la fois tellement logique et prévisible, et un danger connu par les humains depuis la nuit des temps : l’eau stagne et avec l’apport aérien de matières organiques, croupit. C’est un danger qui a particulièrement marqué les consciences collectives dans notre pays. Les épidémies de choléra ont engendré une défiance sur la relation entre l’eau et les humains. Et c’est une des raisons majeures qui a poussé la France à assécher une grande partie de ses marais et de ses zones humides, et d’éloigner l’eau des villes en endiguant les cours d’eau.
Pour en revenir aux bassines, cette eau croupissante engendre le développement algaire et le risque de prolifération, notamment de salmonelle et de cyanobactéries. Cela semble pourtant être du bon sens : on a tous déjà vu de l’eau stagnante dehors et constaté un changement de couleur et le développement de bactéries. À l’heure du changement climatique, d’autres risques comme le développement de moustiques-tigres s’additionnent. Certains témoignages de développement algaire dans certaines retenues de substitutions (dites « bassines ») sont tels que des plongeurs ont été envoyés pour décolmater les stations de pompage d’irrigation bouchées par les algues. Pour conclure, ces bassines représentent des systèmes qui ne servent même pas leur cause initiale, c’est-à-dire l’assurance d’un stockage d’eau efficace et de qualité. Il s’agit purement et simplement d’une appropriation de l’eau souterraine impliquant des grands exploitants, dont principalement des céréaliers, pour une eau qui au final n’est même pas assez qualitative pour être exploitée de manière sûre.
➤ Lire aussi | Depuis le delta du Pô, regarder en face la crise climatique・Un groupe d’amis du Delta (2025)
Ces bassines sont donc le reflet d’un contournement de la réglementation, mais d’un contournement bien particulier, car ce sont les préfets qui à la fois interdisent les usages non prioritaires, tout en autorisant le pompage des bassines. Un double discours qui sert à essayer d’empêcher que certaines économies fragiles ne se retrouvent piégées face à un changement climatique trop rapide et trop violent. La France, d’ailleurs, fait partie des pays qui se réchauffent le plus rapidement dans le monde – on ne s’en rend pas forcément compte, mais notre territoire se réchauffe 20 % plus rapidement que la moyenne planétaire. Nous sommes donc, de fait, sur un temps de bascule qui est du même ordre que celui de la zone arctique ou du Canada. Sur l’Amérique du Nord et sur l’Europe du nord, les bascules sont particulièrement rapides ; et les systèmes agricoles ne peuvent pas réussir à s’adapter.
Avec cette controverse des bassines, on fait fi d’une véritable prise de conscience de ce qu’est le cycle de l’eau, et des problèmes profonds qu’il est en train de rencontrer. En pompant, on déconnecte la nappe de la rivière, ce qui déconnecte ensuite tout le vivant des cours d’eau, créant des à-secs plus rapidement…

Le problème mondial des aquifères
La bascule mondiale en cours tend ainsi vers une perte de l’eau continentale – cette eau qui était dans nos cours d’eau et dans nos nappes. Une récente mission de la NASA (la mission « GRACE ») a montré, via deux satellites, que la variation de la gravité terrestre entre 2002 et 2017 est directement liée au niveau d’extraction des nappes d’eau souterraines, à l’échelle planétaire.
À ce jour, 21 des 37 plus grands aquifères du monde sont en voie d’extinction et de tarissement. Tout cela va poser des questions géopolitiques majeures dans les années et les décennies à venir. Des questions de migrations hydriques aussi, nécessairement. Car, par exemple, l’un de ces grands aquifères est en Chine et 1 milliard de personnes sont en train de se nourrir de riziculture directement dépendante de cette gigantesque nappe qui atteint des niveaux critiques. Ou encore, dans le Middle West américain, vaste région de plaines agricoles, il faudrait 2 700 ans de pluie pour restaurer les aquifères profonds. Il semble donc aujourd’hui impossible de résoudre les choses avec des solutions simples.
Rappelons que l’eau douce représente 2 % de l’eau mondiale, les nappes 1 % et nos cours d’eau 0,00028 %. Nos fleuves et nos rivières sont donc extrêmement fragiles.
À travers cet état des lieux, l’idée était de permettre une prise de conscience de cette nécessité d’une approche systémique par plusieurs prismes, qui s’avère fondamentale pour notre avenir. En se mettant de nouveau à respecter le cycle de l’eau, nous allons nous remettre à restaurer tous les cycles. Ensuite nous devons intégrer à quel point l’eau a des capacités exceptionnelles, c’est une vraie surdouée – elle est en effet à la fois solvant extraordinaire, elle refroidit, réchauffe et nous l’utilisons dans tous nos systèmes industriels sans exception. C’est aussi une eau (souvent invisible) qui fait qu’aujourd’hui nous sommes tout·es habillé·es et que nous nous nourrissons (notre bol alimentaire étant en moyenne composé de 3 000 litres d’eau par jour). Tout cela rend la problématique de préservation quantitative et qualitative de l’eau continentale cruciale pour le devenir de l’humanité.
Rappelons pour finir que l’eau douce représente 2 % de l’eau mondiale. Les nappes 1 %. Nos cours d’eau, eux, 0,00028 %. Nos fleuves et nos rivières sont donc extrêmement fragiles. Nos nappes sont en train d’être pillées. C’est notre avenir qui se joue devant nous. Alors gardons en tête que les cycles de l’eau sont non renouvelables et vivants ; et que sans eux, il n’y a plus rien.
Image d’accueil : « La Sienne à la sortie du barrage du Gast ». Toutes les photographies qui illustrent cet article sont issues du projet de recherche-création « À la recherche de Constantia – Une itinérance de bassin-versant », de l’auteur Marin Schaffner et des photographes et architectes du collectif GANG.

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
Notes
- Au sujet des centrales, il est important de noter que sur les 32 milliards de millions de m3 d’eau utilisés chaque année en France, la moitié environ passe dans des conduites de centrales thermiques et nucléaires. Sachant en outre que les processus de « nettoyage » de cette eau (car les conduites doivent rester pures) sont similaires à ce que l’on dénonce par ailleurs pour la désalinisation. Et que cette eau, également, est restituée entre 2 et 3°C plus chaude qu’à l’entrée – ce qui a des conséquences écologiques destructrices pour les milieux aquatiques (sans parler des molécules toxiques qui n’ont pas pu être nettoyées). Si l’on ne regarde que le CO2, le nucléaire semble en effet être la solution la plus décarbonée, mais c’est sans compter ses impacts profonds sur les cycles de l’eau. Et je ne parle pas là, d’ailleurs, des contaminations massives des eaux partout autour des mines d’uranium de la planète – à côté desquelles vivent, en cumulé, des millions de personnes. Là encore, une vision globale est nécessaire.
- Vapeur d’eau qui est d’ailleurs le principal gaz à effet de serre sur la planète : en termes de quantité 95 % (contre 4,1 % pour le CO2) ; et en termes d’effet à proprement parler, plutôt entre 40 et 60 %.
L’article La bactérie et la goutte de pluie : une autre histoire des cycles de l’eau est apparu en premier sur Terrestres.
25.11.2025 à 17:22
Décoloniser nos assiettes
Universelle, la viande ? Pas du tout : c’est la colonisation et le capitalisme qui ont imposé le carnisme. Dans la plupart des cultures, l’alimentation de base est largement végétale. Même en France, on pourrait composer un véritable “véganisme populaire” avec d’anciennes recettes. Tour d’horizon des coutumes, pour mieux liquider nos héritages impérialistes.
L’article Décoloniser nos assiettes est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (15712 mots)
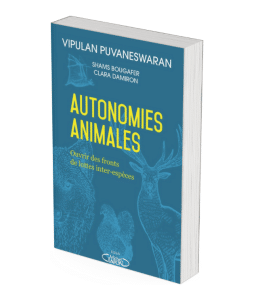
Ce texte est extrait du livre Autonomies animales – Ouvrir des fronts de luttes inter-espèces (Michel Lafon, 2023), écrit par Vipulan Puvaneswaran, Clara Damiron et Shams Bougafer.
Comprendre, raconter ou écrire l’histoire des mécanismes d’oppression a souvent été un outil pour lutter contre ceux-ci. Dès lors qu’on cherche à comprendre les faits et gestes de notre quotidien, la plupart des choses qui composent nos journées, ce que l’on mange notamment, se révèlent fondées sur des représentations symboliques ou des rapports de domination. L’hégémonie et l’omniprésence actuelle de certaines pratiques sont donc le résultat de rapports de force, de circonstances historiques précises, et parfois d’un peu de hasard, qui ont favorisé et généralisé une chose plutôt qu’une autre. Les plantations bananières n’auraient peut-être pas recouvert et asservi les Antilles si un « explorateur » espagnol n’avait pas eu l’idée d’emporter, en 1516, des plants de bananiers africains dans son navire, et si les plantations n’avaient pas par la suite été encouragées par l’empire colonial. Sur un autre plan, c’est la viande des vaches de race limousine qui est la deuxième la plus convoitée sur le marché français aujourd’hui. Pourtant, cette race, fabriquée à l’origine par la sélection humaine pour sa force au travail, a manqué de peu de s’éteindre au lendemain de la guerre : sa descendance a tenu à peu de choses. Et on ne servirait pas de tartiflette dans les restaurants savoyards de toutes les grandes villes françaises si un restaurateur, à La Clusaz, n’avait pas baptisé ainsi cette vieille recette régionale en 1970, lors d’une crise de surproduction du reblochon. Ces choses, qui font aujourd’hui partie de notre quotidien, auraient pu ne pas arriver, ou arriver autrement, ou à un autre moment, si les rapports de force avaient été différents.
Enquêter sur l’évolution des pratiques alimentaires – que ce soit la composition de l’alimentation, les façons de cuisiner, les habitudes populaires, et les imaginaires qui y sont rattachés – peut nous permettre de cerner le rôle que l’impérialisme et la colonisation ont joué dans la diffusion massive du régime carné, et des rapports au monde qu’il véhicule sans pour autant affirmer que toute alimentation carnée est le fait de la colonisation européenne.
Retrouver nos héritages végétaux, inventer des pratiques conviviales
Nos héritages sont la marque d’autres rapports aux mondes animaux et d’autres manières de vivre, nous pouvons apprendre de ceux-ci et nous en inspirer. Aujourd’hui, l’idée que la chair des animaux terrestres ou aquatiques, le lait ou les œufs sont des « choses », des produits consommables, est très fortement répandue. L’estomac humain est effectivement adapté à une grande diversité de régimes1, mais c’est la « norme carnée » (celle qui dit qu’il est normal de consommer quotidiennement des produits d’origine animale : chair, produits laitiers, œufs, etc.) qui domine à présent presque partout dans le monde. Faudrait-il donc systématiquement exploiter, enfermer, tuer pour se nourrir ? Et, si la colonisation et le racisme sont allés jusque dans nos assiettes, comment s’en défaire ? A-t-on d’autres héritages sur lesquels s’appuyer ?
Nous avons choisi d’utiliser le terme de carnisation, formé à partir du terme « carnisme2 » qui désigne le système de valeurs qui accompagne et légitime la consommation de produits issus d’animaux. La carnisation, pour nous, est un processus de transformation des sociétés qui les amène à utiliser les corps d’animaux pour leur subsistance d’une certaine manière : plus systématique, plus banalisée, plus marchandisée. Cela se traduit notamment par l’adoption d’un régime alimentaire de plus en plus carné, au sein de sociétés qui n’avaient pas ce régime auparavant – c’est-à-dire que leur alimentation reposait principalement sur des produits d’origine végétale3. Lorsqu’on parle de carnisation, cela ne veut pas seulement dire qu’il arrive de manger de la viande, mais que cela devient la norme. C’est un nouveau régime alimentaire car, si on lui soustrayait ses aliments issus d’animaux, il serait largement admis qu’il lui « manque » quelque chose, en termes nutritifs mais aussi symboliques ; plutôt qu’une diversification de l’alimentation, on assiste davantage à l’abandon et l’oubli progressif des autres pratiques qui le précédaient : on perd de vue les plats de base qui contenaient des protéines végétales, et donc aussi le savoir-faire pour les cultiver et les cuisiner. Bien souvent, la diversité des végétaux consommés diminue car cette carnisation, nous l’avons vu, est allée de pair avec le développement de la monoculture. Au-delà de ce que l’on plante et de ce que l’on met dans son estomac, la carnisation met aussi en jeu (et c’est peut-être le plus important) une transformation des relations entre humains et non-humains, avec la mise en place de moyens de domestication, de domination et de contrôle plus approfondis et plus systématiques, la transformation du travail dont nous avons parlé précédemment et la mise à mort systématique. La carnisation implique donc un nouveau gouvernement du vivant, tourné vers la marchandisation des corps et des produits animaux. Sans le processus de carnisation à l’échelle mondiale, des scientifiques n’auraient pas établi par exemple que les ossements de poules (70 milliards de poules d’élevage tuées dans le monde en seulement une année) sont si nombreux dans le sol, que cela constituera l’un des principaux marqueurs de l’anthropocène au niveau géologique4. Le terme de carnisation sert ainsi à s’appuyer sur l’impact matériel et la transformation du quotidien, de l’intime qu’implique l’exploitation animale. Ce mot insiste aussi sur le fait qu’il s’agit bien d’un processus historique (progressant par étapes, parfois freiné ou interrompu) lié à l’action de certains groupes sur la société : nous verrons que des colons européens ont souvent joué ce rôle de carnisateurs, en fonction de leurs intérêts économiques, politiques et territoriaux.

➤ Lire aussi | Vivre avec les animaux : une proposition politique・Pierre Madelin (2019)
La bétaillisation des Amériques
À nouveau, commençons notre récit en Amérique centrale. Au second voyage de Christophe Colomb, celui qui marque le début de la conquête des Amériques, les colonisateurs espagnols transportèrent 34 chevaux et un grand nombre d’animaux de bétail. Les navires qui suivirent continuèrent à disperser le bétail européen dans toutes les Antilles5. Au cours du xvie siècle, l’invasion du Mexique fut l’occasion pour les conquistadors d’y introduire à leur tour chevaux et bétail. Une fois les Aztèques vaincus, les colons espagnols s’emparèrent des terres de l’empire mexicain pour y installer des animaux exploités pour leur viande et leur peau. Le décalage avec les façons de vivre et d’habiter des Aztèques est saisissant. En effet, l’alimentation aztèque reposait beaucoup sur la culture du maïs, des haricots, de la courge (ces plantes sont d’ailleurs surnommées les « trois sœurs ») et de quelques insectes. Il arrivait aux Aztèques de manger de la viande mais il semble que c’était très rare. Ils n’ont domestiqué que deux types d’animaux avec lesquels ils partageaient leur espace de vie : des dindes et des canards (outre les chiens, mais leur domestication n’est pas le fruit de la civilisation aztèque)6. Alors que la conquête coloniale avançait, les Espagnols étaient surpris du faible nombre d’animaux domestiqués (et mangés) en Amérique du Sud, et ce malgré l’existence d’espèces qui auraient pu l’être (comme le capybara, l’agouti doré ou le tapir du Brésil)7. Aussi, les colons ont démarré l’élevage d’animaux du continent déjà domestiqués, tels que les dindes, canards et lamas, leur donnant une nouvelle dimension.

La bétaillisation a profondément transformé les territoires et les sociétés, comme le montre par exemple l’introduction de bovins et de chevaux au xvie siècle dans la région du Rio de la Plata (située entre l’actuelle Argentine, le Paraguay et l’Uruguay). Celle-ci a créé de nombreux groupes d’animaux marron qui ont suscité l’intérêt des gauchos (des colons espagnols et enfants « mixtes » issus d’Espagnols et d’indigènes). Ceux-ci chassaient le bétail sauvage et combattaient les indigènes qui résistaient à la colonisation. Leur gagne-pain provenait essentiellement de la traite des peaux de chevaux et du bétail marron. Le marché des peaux et du cuir, qui explosa, attirait toujours plus de colons venus tenter leur chance en Argentine. Alors que 150 000 peaux étaient exportées du port de Buenos Aires en 1778 à destination de l’Europe, pas moins de 1 400 000 peaux (presque dix fois plus) transitèrent vers le Vieux Continent cinq ans plus tard. À la fin du xviiie siècle, les colons installèrent des usines de salaison qui permettaient également d’exporter la viande argentine. Les clôtures finirent par structurer le paysage. Le développement de ces activités économiques a considérablement favorisé l’immigration d’Européens et d’Européennes, en même temps que les populations amérindiennes disparaissaient, si bien qu’en 1890, l’Argentine est devenue l’un des principaux exportateurs de viande à l’échelle mondiale. Sur des terres qui ont connu des peuples dont les rapports de domesticité étaient peu nombreux et non systématiques, les populations européennes ont établi l’une des plaques tournantes de l’élevage industriel. Sous les effets de la colonisation, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont connu pareilles trajectoires.
Nulle part ailleurs, on ne mange autant d’animaux qu’en Amérique. Cette société carniste s’est pourtant fondée sur des terres où le spécisme moderne n’existait pas.
La bétaillisation des Amériques se fonde donc sur une violente prise de terres, qui organise un nouveau rapport au monde. Nous pouvons parler ici, comme dans le cas des monocultures généralisées qui vont recouvrir les Antilles, d’un « habiter colonial8 », c’est-à-dire une nouvelle organisation de la vie qui s’impose par la violence à ceux qui peuplaient le territoire auparavant (humains comme non-humains) : monocultures, prés privés, routes sur lesquelles on convoie les animaux vers les abattoirs. On parle ici d’une façon violente d’habiter le monde, en s’appropriant les corps et la terre. Cet habiter colonial n’a pas disparu avec la soi-disant fin des impérialismes, car c’est bien cette façon de se rapporter à la terre et aux corps (comme des propriétés) qui conditionne encore nos façons de vivre aujourd’hui. Nulle part ailleurs, on ne mange autant d’animaux qu’en Amérique. Cette société carniste s’est pourtant fondée sur des terres où le spécisme moderne n’existait pas : il a été imposé par la conquête coloniale, et a occupé la terre jusqu’à faire disparaître presque tous ceux et celles qui vivaient autrement. La bétaillisation des Amériques, accompagnée de sa carnisation, se répand encore partout où l’habiter colonial continue sa course, notamment au Brésil où la déforestation de la forêt amazonienne et la spoliation des terres paysannes par l’agro-industrie et pour l’élevage avancent plus vite que jamais sous l’action de puissants lobbys9. Cette façon d’habiter signe aussi la fin de nombreux liens entre humains et animaux, et poursuit la transformation des corps et des terres en « machines à produire ». Ces trajectoires historiques donnent lieu à des luttes partagées, notamment au Brésil où les paysans et paysannes dépossédés et les mal-logés (les « sans-terre » et les « sans-toit ») font alliance avec les animalistes contre les lobbys de l’élevage et de la malbouffe : la carnisation a aussi ouvert des fronts de lutte communs.
La carnisation des plats en Afrique de l’Ouest
Le véganisme est souvent associé et défendu par ses militants et militantes comme un horizon de progrès : après avoir aboli l’esclavage et donné le droit de vote aux femmes, il serait dans la suite naturelle de l’histoire de libérer les animaux de l’exploitation. Le véganisme serait la suite logique du progrès des sociétés occidentales. Mais la carnisation contredit cette lecture « progressiste » de l’évolution des régimes alimentaires. Elle montre, au contraire, que c’est l’avènement des sociétés capitalistes modernes qui a conduit à une augmentation sans précédent du nombre d’animaux tués pour les sociétés humaines ; engendrant une crise profonde des rapports que l’on entretient aux animaux et au vivant, de façon générale. Cette lecture ouvre aussi la voie à un « racisme de l’assiette », qui consiste à associer les personnes racisées à certaines viandes qu’elles mangeraient, une généralité (dépréciative) qui sous-entend aussi que les colonisés et leurs descendants ne seraient pas « arrivés » au stade moral avancé du « devenir végane ». En multipliant les clichés, sur l’abattage rituel, les fêtes religieuses, le traitement des animaux dans les pays du Sud, on déforme la réalité et on en vient à penser que les plus cruels avec les animaux sont les personnes non blanches. Il est pourtant inutile de « blanchir » le régime végétalien en prétendant qu’il serait une invention occidentale, de même que d’essayer d’en faire une marque de distinction ou le signe d’une moralité plus avancée. Au contraire, nous voulons rappeler que les traditions alimentaires végétales ont souvent été bien plus puissantes dans des histoires non occidentales.
La carnisation montre que c’est l’avènement des sociétés capitalistes modernes qui a conduit à une augmentation sans précédent du nombre d’animaux tués pour les sociétés humaines.
En effet, nous connaissons tous des stéréotypes sur l’alimentation des personnes racisées. KFC a abusé de ces représentations10 en ciblant, dans une publicité australienne pour la viande de poulet, les populations noires que l’on assigne à la malbouffe et au fast-food. En parallèle, en Afrique de l’Ouest, on assiste à une forme de néocolonisation de l’assiette avec l’importation massive de ce que les Béninois appellent le « poulet morgue » : de la volaille à très bas prix congelée et importée d’Europe, des États-Unis ou du Brésil, élevée avec des intrants (antibiotiques, farines, hormones), à l’origine de problèmes de santé et de zoonoses (maladies ou infections qui se transmettent des animaux vertébrés à l’humain et vice versa). Cette viande fait concurrence aux « poulets bicyclette » : une viande issue d’animaux rustiques à croissance lente, vivant en plein air, dans la nature ou dans les rues, et se nourrissant des restes de récoltes ou de maisons. Des campagnes citoyennes parlent même de « nutricide », un terme inventé aux États-Unis, qui désigne la façon dont l’industrie agroalimentaire produit une alimentation à destination des populations pauvres, noires en particulier, qui augmente les risques de problèmes cardio-vasculaires, de diabète et d’obésité11.

Pourtant, jusqu’à la colonisation, nombre de régimes alimentaires africains, ceux de l’Afrique de l’Ouest plus particulièrement, reposaient essentiellement sur les plantes et les végétaux. La flore luxuriante de ces pays (notamment en zone tropicale) y était propice. Des spiritualités africaines et plusieurs mythes fondateurs sont emplis d’histoires d’animaux ayant rendu service à leur communauté, au point de marquer des interdits de consommation de leur chair. Par exemple, pour les Nyabwa de Côte-d’Ivoire, les interdits qui varient de village en village concernent la chair de la panthère, de la gazelle, du chien, du bouc, de la chèvre, du bœuf (mêlant donc animaux domestiques et animaux dits « de brousse »), des poissons de certaines rivières, de l’aigle, du poulet, etc.12. Historiquement, quantité de plats « africains » étaient entièrement basés sur le végétal. Il en reste d’ailleurs des traces : que ce soit l’attiéké de Côte-d’Ivoire, l’atassi du Bénin ou le mafé du Mali, ces plats bien connus portent tous des noms de plantes. La viande est secondaire, voire n’y a été ajoutée que très récemment. Chaque fois que l’on mange de la viande dans l’un de ces plats, il semble qu’il s’agit de plats « carnisés », c’est- à-dire détachés de leurs contextes végétaux pour n’être plus envisagés autrement qu’avec de la viande. Nous manquons de données et de recherches pour mieux comprendre qui a joué quel rôle dans ce processus : les colons, les élites locales ? Ou encore les diasporas ? Quoi qu’il en soit, ce processus s’est accompagné d’une valorisation culturelle du fait de manger un animal ou de boire du lait. Un fait marquant à ce sujet concerne le nombre de personnes intolérantes au lactose, très élevé dans l’ensemble des pays africains (70-90 %)13, alors que ce taux est de 21 % chez les populations d’origine britannique en Amérique du Nord, et descend en dessous de 20 % en Italie, en Autriche ou en Angleterre, par exemple. Nos microbiotes intestinaux portent ainsi la marque des différentes époques de la carnisation : les intolérances alimentaires révèlent, entre autres choses, que la consommation de lait est plus ou moins récente d’une population à l’autre. Malgré cela, de grandes firmes européennes exportent chaque année sur le continent africain des milliers de litres de lait pour écouler la surproduction européenne, en particulier du lait en poudre enrichi en graisses végétales, ce qui selon le réseau IFBAN constituerait l’une des causes majeures de la dénutrition des enfants dans les pays concernés. Le réseau accuse 27 fabricants de violer l’interdiction prononcée par l’OMS en 1981 en faisant de la publicité pour leurs laits de substitution, en incitant les femmes à stopper l’allaitement, et en corrompant les professionnels de santé à qui ils distribuent des échantillons gratuits14.
Pour déconstruire cette idée que le véganisme serait « un truc de Blanc », ou quelque chose d’essentiellement nouveau, des communautés noires revendiquent l’afro-véganisme.
La carnisation, nous commençons à le comprendre, ne s’opère pas que dans les assiettes et les estomacs. Elle a également lieu dans les esprits : l’interdit des Nyabwa doit paraître aujourd’hui ridicule à bien des afrodescendants. Il n’y a pourtant pas si longtemps, ces manières de se rapporter aux vies animales étaient encore majoritaires sur le continent.
Pour déconstruire cette idée que le véganisme serait « un truc de Blanc », ou quelque chose d’essentiellement nouveau, des communautés noires revendiquent l’afro-véganisme15. L’afrovéganisme, pour des communautés afrodescendantes, consiste à revaloriser un véganisme en lien avec une histoire particulière que l’on se réapproprie. Il s’agit de dire que le véganisme n’entre pas en opposition avec le fait de revendiquer un attachement à sa terre d’origine. Il n’est évidemment pas question de dire qu’avant la colonisation, personne ne mangeait d’animal ou n’avait quelque geste violent que ce soit à leur égard. Il s’agit de simplement rappeler que le véganisme peut trouver ses sources en dehors du référentiel occidental. Comme nous l’avons vu plus haut, le véganisme est aussi un choix de solidarité entre personnes qui subissent racisme et animalisation. Cela peut aussi être un choix politique : faire tout son possible pour refuser les produits carnés importés, souvent mauvais à long terme pour la santé (volaille et poisson congelés, viande cuisinée, lait en poudre16) et se reposer au maximum sur les cultures locales végétales – évidemment, si on en a la possibilité. Se rendre compte que ses ancêtres avaient, peut-être, des rapports aux mondes animaux différents avant la colonisation, s’en faire les héritiers et les renouveler, voilà qui donne de la puissance à d’autres récits. Des récits sans aucun doute plus mobilisateurs que l’imaginaire d’un végétarisme sans histoire, aseptisé, qui fabrique de la viande cellulaire en laboratoire.
➤ Lire aussi | Cuisine et politique : les recettes d’une anthropologue・Gaëlle Ronsin (2024)

Les héritages végétaux de l’Inde et du Sri Lanka
La cuisine indienne est l’un des exemples les plus utilisés pour penser les héritages végétaux dans des mondes non occidentaux. On peut d’ores et déjà démentir cela, car il n’existe pas une cuisine indienne, qui serait uniforme : il serait plus juste de parler de pratiques alimentaires qui diffèrent en fonction des régions et sont d’ailleurs aussi à la source de conflits ethnico-religieux récents (comme entre les musulmans et les hindous).
Il est vrai que la présence de protéines végétales a été, et est encore très importante dans beaucoup de plats typiques de cette région du monde, avec notamment une large proportion de légumineuses, associées aux céréales : le dahl qui accompagne le riz tous les midis, par exemple (le plat porte d’ailleurs le nom de son ingrédient principal, la lentille). Même dans les plats avec viande, les protéines végétales font toujours partie du fondement de la préparation : on peut considérer que la carnisation n’a pas, dans ce cas précis, effacé les héritages végétaux. Au contraire, ceux-ci sont encore mis en avant aujourd’hui comme des marqueurs de cette cuisine. Il existe aussi un héritage culturel et historique qui permet de savoir cuisiner des légumes savoureux grâce à la forte présence d’épices. Historiquement, c’est aussi lié à des conditions matérielles car l’utilisation d’épices dans les pays chauds permettait une meilleure conservation des aliments : cela fait aujourd’hui partie de ce qui rend ces préparations aussi appréciées.
En Inde et au Sri Lanka, la carnisation n’a pas effacé les héritages végétaux. Au contraire, ceux-ci sont mis en avant comme des marqueurs de cette cuisine.
Cependant, ces héritages viennent aussi en partie de pratiques de distinctions sociales des classes dominantes : les brahmanes, qui ne mangeaient pas de viande, constituaient l’élite socioreligieuse du pays, et leurs pratiques étaient donc aussi en partie perçues comme des moyens de se distinguer du reste de la population. Le fait de ne pas manger de viande était ainsi considéré comme un gage de pureté morale, de « maîtrise de soi » (c’est-à-dire de son appétit pour la viande), mais aussi un signe de bienveillance et de cohérence (c’est l’idée que, puisque les humains perçoivent aussi la souffrance animale, il est paradoxal qu’ils mangent des animaux17). La distinction sociale recherchée à travers ces régimes n’est pas propre à cette région du monde : elle fait écho à bien d’autres18. En Inde ou au Sri Lanka, les personnes dont les grands-parents (et leurs parents avant eux) mangeaient de la viande viennent plutôt des castes les plus basses : le travail « souilleur » de tuer les animaux non humains leur était en outre confié, pour que les hautes castes ne soient pas atteintes dans leur pureté morale.

Cependant, c’est la colonisation et l’entrée dans le marché capitaliste qui a « carnisé » cette région à plus grande échelle. Cela s’est traduit par la substitution d’aliments végétaux par des aliments carnés : par exemple, l’abandon progressif du lait de coco pour un usage plus généralisé du lait de vache (les vaches étant considérées comme sacrées, il était jusqu’alors inconcevable de tuer leurs petits pour prendre le lait, mais cela est de plus en plus massivement pratiqué aujourd’hui). On observe un usage plus important de lait et d’œufs, y compris dans les gâteaux et pâtisseries qui étaient pour beaucoup traditionnellement entièrement végétaliens. En parallèle, la présence plus importante de firmes capitalistes et de chaînes de fast-food comme McDonald’s, Pizza Hut ou KFC parvient à attirer de nombreuses personnes vers la consommation de viande.
C’est la colonisation et l’entrée dans le marché capitaliste qui a « carnisé » la région à plus grande échelle.
En dépit de ces considérations historiques, c’est la persistance d’une culture matérielle végétale, également présente dans les classes populaires aujourd’hui, qui montre les possibilités de retrouver des assiettes végétales tout en les vidant de leurs stigmates passés. En outre, ces moyens de distinction sociale par le biais de l’alimentation végétale sont en réalité déjà en partie tombés dans l’oubli, le végétarisme n’est plus autant une pratique qui confère un statut moral spécifique ni particulièrement associée à un statut social : le végétarisme est un « fait social » beaucoup plus diffus. De nombreux militants et militantes antispécistes indiens ou issus de la diaspora s’en inspirent et y trouvent un appui pour lutter contre la carnisation des pratiques alimentaires de leurs communautés. On pourrait trouver bien d’autres situations similaires en Asie, qui montrent que là aussi des héritages végétaux ont subsisté, par exemple au Vietnam où la consommation de soja est quotidienne et procure une partie du lait et des protéines à la population. Reste à assurer une alimentation saine et suffisamment riche à tout le monde, et à redonner leur autonomie aux producteurs et productrices19 – mais déjà, les savoir-faire et les ancrages culturels sont présents et largement partagés.
➤ Lire aussi | Freedom Farmers : la résistance agriculturelle noire aux États-Unis・Flaminia Paddeu et Monica M. White (2025)

Carnisme, nation et tradition en France
Il nous paraît à présent essentiel de revenir là où nous sommes, à ce qui est propre au territoire que l’on habite et sur lequel nous pouvons avoir prise. De prime abord, le processus de carnisation paraît moins évident, moins lisible en France. Lorsque l’on pense à la cuisine française, nous viennent spontanément en tête des menus de bistrots qui regorgent de plats à la viande, au poisson, à la crème, aux lardons, au fromage. Mais malgré cela, il serait faux de penser que la « norme carnée » a toujours dominé les assiettes.
La cuisine française renvoie généralement à la gastronomie. Or, celle-ci ne reflète pas (parce que ce n’est pas son but) les manières dont mange la population vivant en France : la gastronomie est bien plus le reflet de ce que mange une élite sociale donnée. D’ailleurs, le « repas français » (inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2010) est défini non pas comme une pratique populaire mais comme un « art » de manger, une « cuisine », transmise de maîtres en apprentis, qui se déroule selon un schéma ritualisé : apéritif, entrée, poisson et/ou viande, légumes, fromage, dessert, généralement accompagné d’un digestif. Les produits issus d’animaux y occupent une place centrale. Et pourtant, ce schéma est bien loin du quotidien du plus grand nombre : il s’agit davantage d’une forme rituelle reflétant les habitudes des classes sociales les plus élevées. Les débuts de la « cuisine française » comme patrimoine remontent à la Révolution française, où des écrivains et notables, en exil, vantent ce qu’ils estiment être les spécialités de leur pays et, empreints de nostalgie, contribuent à créer des identités culinaires régionales. Les cuisines bourguignonne, provençale, bretonne ou bordelaise ont ainsi chacune leur réputation, que d’autres voyageurs commenteront ensuite. La Révolution industrielle, avec son lot d’émigration rurale, alimente aussi la nostalgie des produits du pays qui donneront, ensuite, les produits du terroir : la nourriture « du pays » fait office de refuge d’identité pour les populations prises dans le tumulte de la grande ville. La cuisine comporte, comme ailleurs, un aspect collectif et est donc un marqueur d’identité – ce qui n’a d’ailleurs pas échappé à certains nationalistes qui ont fait du couple vin/viande un instrument de propagande culturelle et politique20. Ce patrimoine ainsi constitué est aussi devenu un atout pour le secteur du tourisme, de la restauration et de la grande distribution.
Lorsque l’on pense à la cuisine française, nous viennent en tête des menus de bistrots avec viande, poisson, crème, lardons, fromage. Il serait pourtant faux de penser que la « norme carnée » a toujours dominé les assiettes.
De même, ce qui est considéré comme la cuisine traditionnelle de France et les spécialités régionales, plus communément partagées que ne l’est la gastronomie, relève également d’une construction sociale. Ce qui ne veut pas dire que les traditions sont « fausses » mais qu’elles sont toujours fabriquées, pour répondre à une situation nouvelle. C’est ce que l’on appelle la « tradition inventée21 », une pratique rituelle et symbolique qui fait office de « référence au passé au cœur du présent », alors même que sa continuité avec le passé est largement fictive. Son rôle est symbolique, et non pas historique. Les États-nations et tous les mouvements nationalistes ont eu besoin de ces traditions inventées pour créer un imaginaire national, et faire qu’on puisse se « sentir Français » avant d’être Normand ou Berrichon. La cuisine traditionnelle fait amplement partie de cela, car le repas partagé est un moment de consolidation du groupe – et l’on y mange notamment du cochon, ce qui a permis à certains de justifier de ne pas traiter des juifs ou des musulmans comme des citoyens à part entière, au motif qu’ils dérogent au « grand banquet fraternel de la République22 » en raison de leur régime halal ou casher.

L’État a joué un rôle notable dans le développement de ces traditions inventées : comme nous l’avons vu précédemment, les transformations des sociétés paysannes avec la centralisation de l’État, l’exode rural, puis les politiques agricoles d’après-guerre, et enfin la politique agricole commune (PAC) européenne ont favorisé l’essor d’un « capitalisme carné ». L’agriculture française est la plus subventionnée de toute l’Europe, et 71 % des élevages de « volailles », 89 % des élevages de cochons et quasiment l’intégralité des élevages de moutons, chèvres et vaches bénéficient d’argent public. On produit donc plus de viande qu’on ne le pourrait s’il n’y avait pas ces politiques publiques : on estime que 53 % des élevages ne s’en sortiraient pas sans les subventions. En comparaison, les producteurs et productrices de fruits et grandes cultures sont 37 % dans cette situation, et les maraîchers et maraîchères 17 % : leur autonomie est plus grande. Il faut en outre compter dans le budget du spécisme à la française l’argent des impôts versé pour permettre, par exemple, le transport par camion, la prise en charge des coûts en matière de santé publique et d’environnement et, comme si ça ne suffisait pas, la publicité aux produits carnés23. En parallèle, l’État a contribué à la carnisation des imaginaires depuis plusieurs siècles : au travers du soutien des municipalités à l’organisation des foires à bestiaux (xviiie-xixe siècle), puis la création des premiers concours généraux agricoles (à partir de 1870), des salons de l’agriculture régionaux, nationaux puis internationaux (à partir du milieu du xixe siècle), la concentration des « tueries » dans de gigantesques abattoirs (comme ceux de La Villette à Paris, en 1867), et la recherche agronome (génétique et autres techniques). En somme, l’investissement de l’État dans le développement d’un marché national alimentaire a permis d’outrepasser les limites techniques, économiques, spatiales et animales qu’aurait rencontrées la carnisation dans les sociétés paysannes.
La spécialisation des régions s’est accrue continuellement : dans certains territoires, comme en Bretagne, on retrouve aujourd’hui une densité inédite d’élevages (55 % des cochons, 43 % des poules pondeuses, 21 % des vaches laitières du pays) et d’abattoirs (40 % des animaux abattus dans les 960 abattoirs de France le sont en Bretagne, où se trouvent les plus grands établissements du pays). Le plus souvent cette spécialisation ne s’est pas faite selon la volonté ni dans l’intérêt économique des éleveurs et éleveuses : au contraire, ceux-ci comptent parmi la population agricole la moins aisée et la plus dépendante des subventions. Ce sont les grandes industries qui, en créant des situations de monopole local, ont même fini par inventer leur « tradition » pour écouler la surproduction : le camembert de Normandie, le foie gras d’Aquitaine, les sardines du Finistère, les huîtres et moules du Nord, chaque territoire a un exemple à fournir. La dévitalisation des savoirs, dans les campagnes qui se vident, a conduit à fabriquer un « patrimoine », c’est-à-dire, « un passé que l’on peut vendre24 ». Ainsi, on ne vend plus seulement un produit mais un imaginaire de terroir ou de spécialité régionale, qui prétend être hérité du passé, ce qui permet… d’augmenter les prix. Mais comme, très vite, la demande créée par cette publicité excède de loin les capacités (tant vantées) de productions locales, et pour rendre ces produits moins chers (afin d’en vendre plus), le camembert est désormais produit à partir de laits importés du monde entier, les escargots de Bourgogne viennent de Grèce, le foie gras de Hongrie, les sardines du Maroc, et ainsi de suite. En plus de néocoloniser des millions d’hectares de terres et de territoires marins pour procurer à chacun son morceau de viande, ce système de concentration-spécialisation-importation fait miroiter l’idée qu’il serait possible de « démocratiser » le carnisme. Pourtant, c’est au prix d’une exploitation toujours plus grande des animaux, des terres, des classes dominées et des énergies fossiles que l’on peut manger de la viande à quasiment toutes les tables en France. En parallèle, cela a conduit au déclin de tout un tas d’autres productions notamment celles de légumineuses, légumes anciens, blés et autres céréales cultivées depuis le Moyen Âge, les terres servant désormais au fourrage et à l’élevage25.
En plus de néocoloniser des millions d’hectares de terres et de territoires marins pour procurer à chacun son morceau de viande, ce système de concentration-spécialisation-importation fait miroiter l’idée qu’il serait possible de « démocratiser » le carnisme.
Tant que cette tradition arrivera à se confondre avec la norme, on pourra faire passer le végétalisme pour une mode, un lifestyle importé sans aucune continuité avec nos héritages, donc en quelque sorte, une chose illégitime et/ou vouée à rester marginale. C’est d’ailleurs tout dans l’intérêt de l’agro-industrie de le faire passer pour « tendance » et moderne, car cela permet là aussi de vendre plus cher des produits estampillés véganes à celles et ceux qui cherchent une distinction sociale via l’alimentation. Au-delà du fait qu’on peut trouver la « tradition carnée » violente, elle est surtout surreprésentée et fantasmée.
L’alimentation des gens en France n’est pas nécessairement – et n’a pas toujours été – carnée : il y eut des périodes avec, d’autres sans, des spécialités basées sur le végétal et d’autres qui se sont constituées autour des ressources de la mer, de la chasse et de l’élevage. Au début du Moyen Âge, période dite « d’abondance », même les familles paysannes pouvaient chasser du gibier et l’on servait couramment plusieurs viandes à table.

Dès le milieu du xvie siècle, la chair animale se fait bien plus rare, tant à la chasse que dans les fermes, en raison notamment d’une pression accrue sur les ressources et de la suppression de plusieurs droits coutumiers. C’est alors qu’elle devient un signe de richesse. En revanche, on utilise depuis très longtemps le fromage et les œufs comme sources de protéines : les œufs sont un aliment de base quasiment au même titre que le pain, et le fromage très commun et pratique pour avoir accès aux protéines et graisses du lait en dehors des périodes de lactation (il se conserve et se transporte). Dans le Sud-Est, bénéficiant d’un climat plus clément pour les cultures tout au long de l’année, l’alimentation provençale ou méditerranéenne est moins carnée : ratatouille, tian de légumes, socca, estouffade, fougasse, châtaignes, noix, tomates et autres ingrédients sont cuisinés aux condiments frais et à l’huile végétale (d’olive, notamment) au lieu de la crème ou du beurre26. À partir du Moyen Âge et jusqu’à ce que la modernisation agricole et l’urbanisation lissent ces différences régionales, au nord de la France, on mangeait couramment de la flamiche aux poireaux, des betteraves, de l’ail et des galettes de sarrasin ; dans le centre, de nombreux plats de lentilles et autres légumineuses ; et dans le sud-ouest, ce n’est pas tant du canard et de la brebis que l’on mange au quotidien, quoiqu’il y en ait, qu’un ensemble de légumes et légumineuses assaisonnés, piperade27 et autres spécialités.
Il est dans l’intérêt de l’agro-industrie de le faire passer le véganisme pour « tendance » et moderne.
Du fait de ces héritages, il existe de réelles bases pour développer un « véganisme populaire » en France. Certains produits, tels que le soja (sous toutes ses formes) ou le seitan (gluten extrait du blé), sont certes récemment apparus dans nos champs ou nos assiettes, mais bien d’autres y sont présents et produits dans les différentes régions depuis des siècles. On regorge d’exemples de recettes et de préparations plus ou moins anciennes qui ont été oubliées, ou carnisées : le cassoulet, le « plat du pauvre » dans le Languedoc, a longtemps été constitué de fèves sans confits d’animaux (ces derniers n’étaient incorporés qu’à de rares occasions), contrairement à aujourd’hui. Nombre de ces plats sont davantage représentatifs d’une culture populaire transmise et appropriée par de nombreuses générations que ne l’est la gastronomie française traditionnelle. Il peut s’agir du pain, dont l’histoire est à peu près aussi vieille que l’installation des premiers villages28, et plus généralement d’un ensemble de préparations typiques à base de céréales (galettes de blé noir, tourteaux) qui formaient la base de l’alimentation paysanne. Mais on peut citer aussi l’emploi des protéines végétales, qui fut bien plus avancé à des époques passées : la consommation de pois, fèves et lentilles, arrivés dans la région il y a plus de 2 000 ans, était proportionnellement plus répandue au Moyen Âge qu’aujourd’hui29. La carnisation n’a pas effacé toutes ces façons de manger : la soupe au pistou, le plat de lentilles, les galettes de céréales complètes, les graines, les jeunes pousses, les fruits à coque, les aliments lactofermentés30, la choucroute et bien d’autres demeurent. La plupart de ces aliments sont peu coûteux, moins que la viande ou les produits laitiers, et il est relativement facile de les préparer soi-même.
Nous avons donc maintenant en tête différentes formes de carnisation : aux Amériques, avec la prise de terres par et pour le bétail et la création d’un imaginaire pionnier fortement attaché à la consommation de viande ; en Afrique de l’Ouest, où elle relève à la fois de la destruction coloniale et esclavagiste des pratiques et spiritualités incompatibles avec l’exploitation intensive des animaux, et de l’économie néolibérale (« dumping » pratiquée par les firmes étrangères importatrices, et création d’un marché africain de la viande et du lait souvent soutenu par les institutions internationales). En Inde et au Sri Lanka, on voit que la carnisation est plus avancée que l’image fantasmée de « l’Inde végétarienne » ne nous le laisse penser. Mais si le régime alimentaire fut au cœur d’intenses conflits de classe et de religion, et si l’industrie carnée y a trouvé un nouveau marché à conquérir, le végétarisme a laissé un héritage conséquent. En France enfin, cela relève d’une multitude de facteurs liés à des enjeux de classe, d’urbanisation, d’imposition de l’État et de nationalisme, mais tout cela n’a pas effacé la possibilité de se nourrir autrement : au contraire, l’insoutenabilité de la production alimentaire actuelle l’a rendue d’autant plus urgente.
➤ Lire aussi | Instituer le droit à l’alimentation en France au XXIe siècle・Tanguy Martin (2021)

Renverser la carnisation : instituer des coutumes végétales conviviales
Force est de constater qu’on ne pourra pas revenir à des alimentations végétales en nous appuyant sur des héritages impérialistes ni sur le modèle extractiviste qui se perpétue dans nos assiettes. Car si l’on peut se procurer lait de coco, noix de cajou, café, chocolat, avocat, arachides et autres en abondance pour des recettes « véganes », c’est aussi parce que l’on jouit du privilège économique de manger des richesses d’ailleurs, à un prix qui ne rémunérera jamais ce qu’elles coûtent réellement. Une alimentation même exclusivement végétale qui repose sur ce type de produits ne nous intéresse pas : nous pouvons, tout comme pour les aliments carnés, « faire tout notre possible » pour les éviter. Sans perspective d’autonomie alimentaire, sans la constitution de sociétés paysannes véganes, nous n’aurons pas fait le travail de décoloniser nos assiettes, nous continuerons de manger ce qui porte la marque de l’exploitation.
Il existe en France de réelles bases pour développer un « véganisme populaire ». On regorge d’exemples de recettes et de préparations plus ou moins anciennes qui ont été oubliées, ou carnisées.
Seulement voilà, trop souvent, les mouvements militants « progressistes » négligent l’importance de la tradition : surtout conservatrice, on n’y accorde donc pas d’importance (« Du passé, faisons table rase »). Pour nous, cette question est un peu plus compliquée. Nous reconnaissons la dimension sociale et le rôle d’identification collective que joue l’alimentation. Les manières de se nourrir sont vectrices d’un rapport aux autres et aux mondes non humains, et c’est précisément pour cela qu’elles nous intéressent. Nous ne voulons pas d’une révolution qui efface tout le rituel, le familier, le spécifique, mais au contraire qui le multiplie. Même si nous la critiquons, ce que nous proposons n’est pas une croisade absolue contre la tradition, mais l’instauration de nouvelles pratiques. Beaucoup des mouvements politiques qui sont parvenus à transformer des espaces ne l’ont pas fait en débattant ou en votant, mais en créant une culture matérielle au fil de la lutte, une pratique de résistance quotidienne.
Nous voulons que les luttes contre l’exploitation animale, mais aussi toutes les autres formes de luttes sociales et écologistes puissent participer à renverser le processus de carnisation en se dotant de nouvelles pratiques d’autonomie conviviales et qui ne reposent pas sur de l’exploitation animale. Par « convivialité », nous entendons non seulement qu’elles soient collectives mais surtout, au sens d’Ivan Illich31, qu’elles soient largement appropriables et accessibles, qu’elles ne soient pas contrôlées par en haut, ou encore que la production demeure suffisamment mesurée pour ne pas devenir aliénante ou écraser toutes les autres. Que faire, alors, de la tradition ? Ce terme renvoie à quelque chose de figé et d’invariable, donc nécessairement détaché de son contexte : nous lui préférons le terme de « coutumes », qui désigne ce qui s’instaure par la pratique. Les coutumes ne sont jamais exécutées à l’identique, même si elles font appel à une forme d’expérience et de transmission : elles ne peuvent pas être figées dans le marbre, tout simplement parce que la vie ne l’est pas. C’est donc une manière de créer des pratiques qui convient mieux à ce que nous voulons : des communautés de vies autonomes, en mouvement, et aussi horizontales que possible. Ces coutumes peuvent être de toutes sortes : cantines véganes, soupes populaires, récoltes et cueillettes, mais aussi éducation à la cohabitation avec les non-humains en ville, veillées en forêt, réparation des milieux de vie endommagés, célébration des naissances et des morts non humaines et autres pratiques ritualisées… Sauf qu’elles ne célébreront pas une victoire sur les mondes animaux (comme c’est le cas aujourd’hui) mais plutôt l’invention de nouveaux rapports avec eux, la fragilisation du système spéciste, le grain de sable jeté dans l’engrenage. Pour que ces coutumes adviennent, qu’elles soient fortes et vivantes, il nous faut amorcer une rupture avec le monde spéciste et carniste qui nous enferme, et faire de la question de l’autonomie alimentaire une priorité de la lutte contre l’exploitation animale.
Vipulan Puvaneswaran, Clara Damiron et Shams Bougafer sont toustes trois issu·es de milieux politisés par un mélange de luttes écologistes, sociales et décoloniales, par des questions agricoles et par des enjeux liés aux questions animales, et inspirés par l’autonomie des mouvements sociaux, particulièrement ceux de 2018-2020. Leur livre Autonomies animales est le fruit de discussions collectives plus larges que les trois auteur·ices.
Image d’accueil : four à pain à l’ancienne, Fuerteventura, Îles Canaries, 2012. Wikimedia.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
Notes
- À ce sujet : Thomas Lepeltier, « Petite litanie des arguments anti-végétaliens », Sens-dessous, vol. 12, n° 2, 2013, p. 31-42.
- Melanie Joy est à l’origine de la définition de ce terme : Melanie Joy, Why We Love Dogs, Eat Pigs and Wear Cows. An Introduction to Carnism, Conari Press, 2010.
- On peut comprendre « végétalienne » ou « végane » ici, mais le terme serait anachronique.
- Jan Zalasiewicz et al., « Et l’os de poulet devient le symbole de l’anthropocène », The Conversation, 30 décembre 2018.
- Charles Patterson, Un éternel Treblinka, 2002, trad. Dominique Letellier, Calmann-Lévy, 2008, p. 92.
- Michael E. Smith, The Aztecs, Wiley Blackwell, 2002.
- Valérie Chansigaud, Histoire de la domestication animale, Delachaux et Niestlé, 2020, p. 126.
- L’habiter colonial est une notion développée par Malcolm Ferdinand dans Une écologie décoloniale, Seuil Anthropocène, 2019.
- À ce sujet : « La patte de la vache : récit de luttes antispécistes au Brésil », podcast Avis de tempête, épisode 7, 2022.
- En 2010, une pub australienne de KFC avait mis en scène un supporter blanc à côté d’une foule déchaînée de supporters noirs. Pour les calmer, la personne blanche sort un pot de poulet frit qu’il se met à distribuer.
- Pour en savoir davantage sur cette notion, voir le livre de Llaila Afrika, Nutricide The Nutritional Destruction of the Black Race, EWorld Inc., 2013.
- P. Zézé Béké, « Les interdits alimentaires chez les Nyabwa de Côte-d’Ivoire », Journal des Africanistes, 1989, p. 229-237.
- Selon le Centre d’information et de recherche sur les intolérances et l’hygiène alimentaires, l’intolérance au lactose se retrouve aussi dans les pays d’Asie de l’Est (90-100 %), Asie centrale (80 %), ainsi que dans des minorités en Amérique du Nord : populations ashkénazes juives (60-80 %), populations indigènes (80-100 %).
- Rapport « Breaking the rule, stretching the rules », GIFA, 16 mai 2014.
- Pour en savoir plus sur l’afrovéganisme : Syl Ko, « Qu’est-ce que le black veganism », L’Amorce, 2019.
- Un rapport récent de la FAO détaille cela : « Croissance agricole en Afrique de l’Ouest : facteurs déterminants de marché et de politique ».
- Cette sensibilité « innée » à la souffrance animale, conjuguée à un régime qui se base sur la mort ou l’exploitation d’animaux, est ce que Rob Percival appelle le « meat eating paradox ». Nous remercions Nicolas Baumard pour les informations précises qu’il nous a fournies à ce sujet et plus largement sur l’alimentation en Inde.
- Par exemple au sein du christianisme, le « vendredi maigre », jour sans viande (mais avec poisson…), est associé à la « vertu chrétienne de sobriété ».
- En 2020-2021, un gigantesque mouvement social (la « révolte des paysans ») a fédéré dix des onze syndicats agricoles principaux et jusqu’à 250 millions de grévistes qui ont bloqué les accès des villes d’Haryana et Delhi, pour lutter contre la nouvelle politique agricole nationale. Il s’agirait de la plus grande grève de l’histoire du pays.
- Marie Aline et Nicolas Santolaria, « Viande, digestif et extrême droite, bienvenue dans la mangeosphère », Le Monde, 29 janvier 2022.
- Eric Hobsbawm, L’Invention de la tradition, trad. Christine Vivier, Éditions Amsterdam, 2006.
- Dans La République et le cochon (Seuil,2013), Pierre Birnbaum explique que le cochon serait un marqueur identitaire de la nation française « célébré par les représentants de la nation les plus divers comme un emblème qui unifie les manières de faire, de sentir, de se réjouir de tous les citoyens » (p. 25). Ainsi, le « retour en force du cochon » dans des banquets sert aujourd’hui de « réaffirmation identitaire » contre la présence du halal ou du casher.
- Au niveau européen, 252 millions d’euros de fonds publics ont été dépensés entre 2016 et 2020 pour financer à hauteur de 80 % les publicités des plus grands acteurs des filières viande et lait.
- Merci à Damien Darcis pour son travail d’enquête et de synthèse sur la question : Pour une écologie libertaire, Eterotopia, 2021.
- En France, on estime que 70 % des terres agricoles sont consacrées au bétail, et parmi celles-ci, au moins la moitié serait cultivable en l’état pour la production de fruits, légumes, grandes cultures et céréales. C’est sans compter le fait qu’une large partie des céréales fourragères est importée : l’occupation réelle des terres et la déforestation engendrées par l’élevage français s’étendent donc au-delà des chiffres annoncés.
- D’ailleurs, les intolérances au lactose sont bien plus fréquentes chez les personnes originaires du sud de la France (65 %) que du nord (17 %), selon une étude du CIRIHA.
- Spécialité basque à base de tomates et de piment.
- Adam Maurizio, Histoire de l’alimentation végétale, depuis la préhistoire jusqu’à nos jours, Ulmer, 2019.
- Ibid.
- La lactofermentation est obtenue par fermentation des légumes dans une eau de saumure, sans intrant animal.
- La Convivialité d’Ivan Illich (Seuil, 1973) propose une critique de la technique qui peut aussi guider des pratiques alimentaires.
L’article Décoloniser nos assiettes est apparu en premier sur Terrestres.
12.11.2025 à 00:35
Face au pétromasculinisme, une paysannerie écoféministe
Pour le philosophe Léo Coutellec, l’agriculture est progressivement devenue une pétroculture patriarcale, caractérisée par la domination masculine et la dépendance aux fossiles. À l’autre bout du spectre, on voit pourtant naître une paysannerie féministe et émancipatrice, qui conteste la subordination des paysannes et renouvelle les pratiques.
L’article Face au pétromasculinisme, une paysannerie écoféministe est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (6916 mots)
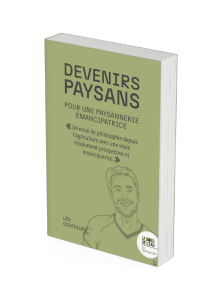
Extrait du livre de Léo Coutelec, Devenirs paysans. Pour une paysannerie émancipatrice, paru en 2025 aux éditions Le Bord de l’eau dans la collection « En Anthropocène », 192 pages.
« J’entends les silences et je pense aux arbres ; ils sont là, nus, ils ne plastronnent pas, ils ne sont pas glorieux, ils sont tenaces, accrochés dans la pente des hivers et du temps. Je ne sépare pas les arbres et les paysannes. » Marie-Hélène Lafon1
« Prendre la pétromasculinité au sérieux signifie prêter attention aux désirs contrariés des patriarcats privilégiés, à mesure que s’étiolent leurs fantasmes fossiles. » Cara New Daggett2
« Nous saluons toutes les femmes qui, à partir de différents territoires, soutiennent la vie, l’alimentation, les soins et les transformations sociales. (…) Nous, les femmes, continuons à marcher, à dénoncer la violence et les crimes environnementaux et sociaux, à lutter contre le pillage de nos richesses et le massacre des peuples. Nous continuons à tisser des réseaux et des alliances pour démasquer le patriarcat, le capitalisme et le néolibéralisme qui menacent la vie sur la planète. » La Via Campesina3
Mesurer la réussite d’une ferme à la taille de ses tracteurs, organiser un concours de labour ou une course de moiss’batt-cross, porter des habits de travail à l’effigie d’une marque de machines agricoles, manifester à coups de gros tracteurs pour faire démonstration de puissance mécanique, assumer sa dépendance aux combustibles fossiles par la consommation ostentatoire de carburants ou d’engrais chimiques, sont autant d’indices que l’agriculture est progressivement devenue une pétroculture. Et que cette dernière est avant tout une « pétromasculinité4 », concept forgé par la politologue Cara New Dagett. La domination masculine et l’affirmation d’une virilité autoritaire trouvent dans la mécanisation démesurée de l’agriculture un point d’appui, avec une identification du travail « à l’expérience virile du contact avec la machine5 ». Le refus d’admettre l’évidence de la crise climatique par la continuation assumée d’une agriculture pétro-dépendante est l’une des manifestations de cette pétromasculinité. La responsabilité des hommes dans le désastre agricole en cours est évidente, et pas simplement parce qu’ils sont numériquement bien plus nombreux que les femmes, mais aussi et surtout parce qu’ils dominent la « profession » par l’adhésion sans réserve au mythe fossile qui assure leurs privilèges.
C’est une lecture que l’on peut faire des mouvements récents d’agriculteurs des syndicats de droite (FNSEA [Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles], JA [Jeunes Agriculteurs] et Coordination rurale), dont le centre revendicatif était le refus des normes environnementales, l’arme principale une ribambelle de gros tracteurs et les visages médiatiques essentiellement masculins. Ce qui était défendu au fond, au-delà des slogans creux de diversion distillés par les directions syndicales, c’était une forme de pétromasculinisme agricole que nous définissons comme la domination masculine dans l’agriculture s’affirmant par la défense du régime fossile. Selon cette approche, épuiser la terre, polluer les sols et les eaux, homogénéiser les paysages, détruire la biodiversité ne sont pas les objectifs principaux de l’agriculture productiviste, ce sont des conséquences d’une finalité bien plus insidieuse, celle qui consiste à maintenir et à défendre les privilèges d’une culture patriarcale basée sur l’autoritarisme fossile. Dagett définit le régime fossile comme la « logique de gouvernement qui dépend matériellement et psychologiquement de la consommation intensive de combustibles fossiles6 ». La deuxième dimension de cette dépendance, la dimension psychologique, bien que moins souvent mise en avant, est pour autant déterminante en cela qu’elle permet de justifier une posture d’autorité, là où « le pouvoir explosif de la combustion s’est trouvé grossièrement assimilé à la virilité7 ». Dans un contexte où la responsabilité de la combustion d’énergies fossiles dans la crise climatique est avérée, défendre le régime fossile et le faire de façon ostentatoire peut être considéré comme une forme de violence, que certains qualifient de « carbofasciste8 », dont le but est de réaffirmer et conserver le pouvoir masculin blanc. C’est pourquoi Daggett parle d’une « convergence catastrophique » entre masculinité, combustion fossile et autoritarisme.
Une paysannerie émancipatrice passe donc nécessairement par un refus de cette pétroculture patriarcale. En contrepoint, c’est un écoféminisme paysan que l’on voit naître et s’intensifier9. De nombreuses paysannes s’installent hors du cadre dominé par la démonstration d’une puissance mécaniste et viriliste, et dans une conscience du caractère systémique des dominations de la terre et du corps des femmes pour penser et vivre l’activité paysanne différemment, sans pour autant faire sécession. Prendre soin de la terre et des animaux autrement, revendiquer des pratiques de subsistance10 pour se défaire de la dépendance au système productif masculin, gagner en autonomie décisionnelle et pratique, refuser la division sexuelle du travail agricole11, adapter le travail pour qu’il ne soit plus aliénant, se former et se renforcer au sein de collectifs non mixtes12 sont autant de visées pour sortir des pétrocultures qui renforcent la domination masculine dans l’agriculture.
Dans une telle perspective, il ne s’agit pas « d’inclure les femmes dans l’agriculture » ou d’affirmer que « leur place est différente », ce serait encore accorder du crédit à la conception patriarcale de l’agriculture, car ces politiques « paternalistes d’empowerment des femmes », devenues à la mode, ne contribuent qu’à accélérer « la destruction des bases matérielles de leur pouvoir, les privent de la joie de l’autonomie13 ». Plutôt que l’instrument d’une soi-disant diversité au sein du corporatisme agricole, la perspective écoféministe dans l’agriculture s’invente en autonomie et dans la pluralité des expériences14, elle renouvelle profondément les pratiques et les imaginaires, elle est le cœur et le moteur d’une paysannerie émancipatrice qui cherche à défaire les dominations. Et elle reste le rempart et l’alternative la plus solide au pétromasculinisme agricole en cela qu’elle ne cherche pas seulement à proposer des ajustements techniques ou des pratiques différentes, mais propose un renouvellement profond de la culture de l’agriculture par la construction de relations écologiques au vivant humain et autre qu’humain qui permettent de rompre simultanément avec la domination masculine, l’asservissement au régime fossile et à l’autoritarisme qui les accompagne. La façon dont les femmes paysannes ont investi de façon autonome La Via Campesina, le plus grand mouvement de paysannes et paysans au niveau mondial, et qui défend un « féminisme paysan et populaire », est illustratif de ce devenir écoféministe de la paysannerie.

S’ouvrir à ce devenir pourrait aussi être une forme de mise à distance de l’emprise d’un autre mouvement de fond qui structure, et parfois sclérose, les pensées et pratiques paysannes, le familialisme. Ce dernier fait de la famille l’unité élémentaire de la société politique et se comprend comme « un mode d’organisation de la cité qui articule la détention de l’autorité politique et la position dans la famille15 ». Dans l’agriculture, le familialisme se loge derrière l’idée que le modèle à défendre et à promouvoir est celui de l’exploitation agricole familiale, où le travail agricole s’organise en famille et où se confondent les sphères privées et professionnelles. Cette défense d’une agriculture familiale, souvent réduite à une agriculture de couple, est assez transversale au sein du syndicalisme agricole, de droite comme de gauche. La cohérence et l’intrication entre le travail domestique et les tâches agricoles sont ainsi régulièrement valorisées, tout comme le souhait d’une vie pleine qui puisse dépasser la séparation entre les dimensions familiales, professionnelles et sociales. L’influence historique de la JAC (Jeunesse agricole catholique), mouvement créé dans les années 1920, dans la formation des cadres des mouvements syndicaux en est sûrement un facteur déterminant bien que cette organisation ait aussi été un vecteur important de la prise en compte de la cause des femmes paysannes16.
La perspective écoféministe dans l’agriculture renouvelle profondément les pratiques et les imaginaires. Elle est le cœur et le moteur d’une paysannerie émancipatrice qui cherche à défaire les dominations.
Malgré des avancées dans la reconnaissance de certains droits sociaux pour les paysannes, l’invisibilité du travail féminin, la non-déclaration de la conjointe au sein de la ferme, les différentes formes de violences subies17 ou encore la division sexuelle des tâches persistent. Et l’on observe que ces phénomènes ne sont pas l’apanage d’une vision traditionaliste de l’agriculture, ils traversent toutes les visions de l’agriculture, y compris chez les « néoruraux » ou au sein des mouvements d’agriculture biologique18. Le rôle subordonné des femmes dans l’agriculture, notamment en termes de reconnaissance de droits, a des racines profondes et s’apparente à la situation des femmes en général sous la IIIe République : « si elles ne sont pas admises dans la citoyenneté électorale, c’est parce qu’en tant que membres subordonnés de la famille, on les suppose présentes dans le vote émis par les hommes au nom de l’intérêt général19 ». C’est parce que la famille est considérée comme l’unité de base de l’organisation d’une activité agricole, au sein de la laquelle est supposée une unité d’intérêts et d’opinions, que « ses membres subordonnés sont privés du droit de vote. (…) lorsque le pater familias s’exprime à travers le vote, c’est toute la famille qui s’exprime derrière lui20 ». C’est pourquoi aussi, les femmes n’ont été reconnues comme agricultrices qu’en tant que membre d’une famille, fille, mère ou épouse ; et que les termes de « chef de famille » et de « chef d’exploitation » se sont souvent confondus. La défense d’une agriculture familiale est intenable si elle ne s’oblige pas à cet examen critique.
Il ne s’agit pas de dire qu’il faut abolir la famille ou qu’une paysannerie émancipatrice serait obligatoirement une paysannerie hors du cadre de la famille. Ce que l’écoféminisme paysan apporte c’est un questionnement sur les modalités de faire famille d’une part – notamment en libérant celle-ci de son emprise patriarcale et hétéronormée21 – et sur la place de celle-ci au sein de l’activité paysanne – par une mise à distance de sa centralité pour donner plus d’espaces d’autonomie aux femmes paysannes et ouvrir à des formes collectives plus diversifiées ; pour désimbriquer les enjeux de patrimoine, de famille et travail. C’est pourquoi l’expression « hors cadre familial » devrait avoir, selon moi, un sens bien plus générique, et porter non plus seulement sur l’absence d’une filiation agricole mais sur toutes les dimensions de la vie paysanne lorsque celle-ci n’est plus centrée sur une logique familiale de production22, autrement dit lorsque la paysannerie n’est plus soumise à l’emprise du familialisme.
➤ Lire aussi | Ils ont 20 ans pour sauver le capitalisme・Léo Coutellec (2019)
Image d’accueil : Jerry Kavan sur Unsplash.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
Notes
- LAFON Marie-Hélène, VETTORETTI Alexis, 2024, Paysannes, Ulmer, Paris.
- DAGGET Cara New, op. cit., p. 52.
- LA VIA CAMPESINA, 2025, Appel à l’action antifasciste.
- DAGGET Cara New, op. cit.
- JARRIGE François, Techno-critiques. Du refus des machines à la contestation des technosciences, La Découverte, 2014, p. 154.
- DAGGET, op. cit., p. 26.
- Ibid, p. 29.
- Antoine DUBIAU définit le « carbofascisme » comme la convergence d’intérêts entre le capitalisme fossile, les grandes entreprises productrices d’hydrocarbures et les forces politiques d’extrême droite.
- Le concept d’écoféminisme paysan a notamment émergé à l’occasion des rencontres, en non-mixité choisie, des travailleuses de la terre qui se sont déroulées les 17 et 18 septembre 2022 à Vezin-le-Coquet. Il sera aussi utilisé dans la déclaration des 84 paysannes de la Confédération paysanne réunies les 16 et 17 novembre 2023 à Montreuil : « Notre féminisme est écologique, paysan et populaire. Il se veut solidaire des personnes opprimées et exploitées et comprend profondément que l’exploitation des femmes et de leurs corps est intrinsèquement liée à l’exploitation industrielle de la nature et de ses ressources par le capitalisme et le patriarcat. L’écoféminisme paysan et populaire veut avant tout célébrer la vie, notre rapport sensible au monde et nous reconnaître comme vivantes parmi le Vivant, pour amener à une entière valorisation d’une agriculture paysanne, autonome, durable, nourricière, qui régénère les sols et mise sur les alliances et les coopérations interespèces » (consultable en ligne sur le site de la Confédération Paysanne).
- PRUVOST Geneviève, 2021, Quotidien politique. Féminisme, écologie, subsistance, La Découverte, Paris.
- DEMATHIEU Agathe, 2022, « Comprendre la division sexuelle du travail agricole : comment les techniques contribuent à la perpétuer ? », AgriGenre. Source en ligne, consulté le 13 avril 2025 : <https://agrigenre. hypotheses.org/11345>.
- WEILER Nolwenn, 2024, « Agriculture et féminisme, une alliance heureuse », Basta.
- AZAM Geneviève, 2023, « Penser et agir depuis la subsistance : une perspective écoféministe », Revue Terrestres.
- À ce titre, je conseille vivement la lecture de l’enquête sociologique de Constance Rimlinger sur les expériences de vie en lien avec la terre de personnes féministes et non hétérosexuelles : RIMLINGER Constance, 2024, Féministes des champs. Du retour à la terre à l’écologie queer, PUF, Paris.
- VERJUS Anne, 2013, « Familialisme » in : ACHIN Catherine et BERENI Laure, Dictionnaire. Genre et science politique : Concepts, objets, problèmes, Presses de Sciences Po, Paris, p. 251-262.
- MARTIN Jean-Philippe, Histoire de la nouvelle gauche paysanne. Des contestations des années 1960 à la Confédération paysanne, 2005, La Découverte, collection « Cahiers libres », p. 37-38.
- SALMONA, Michèle, 2003, « Des paysannes en France : violences, ruses et résistances », Cahiers du Genre, 35 (2), p. 117-140.
- SAMAK Madline, 2017, « Le prix du “retour” chez les agriculteurs “néo-ruraux”. Travail en couple et travail invisible des femmes », Travail et emploi, 150.
- VERJUS Anne, op. cit.
- Ibid.
- CHOLLET Mona, 2021, Réinventer l’amour. Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles, La Découverte, Paris.
- Logique qui reste bien présente, y compris dans les mouvements d’agricultrices qui revendiquent une reconnaissance économique de leur travail. Voir : COMER Clémentine, 2022, « Luttes d’agricultrices ou d’épouses au travail ? Retour sur l’histoire d’un féminisme paradoxal (1970-2010) », Entreprises et histoire, 107(2), p. 110-123.
L’article Face au pétromasculinisme, une paysannerie écoféministe est apparu en premier sur Terrestres.
09.10.2025 à 11:27
« Au diable l’environnement, donnez‑moi l’abondance ! » : pourquoi le backlash est structurel
Et si ce que nous appelons backlash écologique n'était que la manifestation brutale d'un mouvement plus profond ? C’est la thèse défendue par l’historien Jean-Baptiste Fressoz dans ce court texte : ce qui nous revient en boomerang, c’est l’incompatibilité structurelle entre l’organisation matérielle de nos sociétés et toute perspective écologique.
L’article « Au diable l’environnement, donnez‑moi l’abondance ! » : pourquoi le backlash est structurel est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (6059 mots)
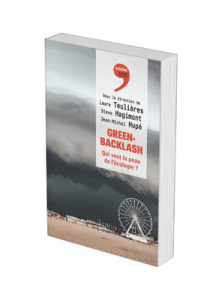
Ce texte est extrait du livre collectif Greenbacklash : qui veut la peau de l’écologie ?, sous la direction de Laure Teulières, Steve Hagimont et Jean-Michel Hupé, à paraître le 10 octobre 2025 aux éditions du Seuil.
Le 25 mai 1970, un mois à peine après le premier Jour de la Terre qui vit des millions d’Américains manifester pour la défense de l’environnement, le New York Times évoquait déjà l’hypothèse d’un ecological backlash, d’un retour de bâton contre l’écologie. La menace n’était pas prise au sérieux. La vague environnementaliste semblait portée par la démocratie américaine elle‑même. « Tant que des millions d’Américains ont l’usage de leurs yeux, de leurs oreilles, de leur nez, la position du personnel politique est prévisible », expliquait l’éditorialiste. « Les habitants de Santa Barbara, dont beaucoup sont conservateurs, n’ont pas eu besoin d’être sermonnés pour s’indigner de la pollution de leurs plages. Les habitants de New York et de Los Angeles n’ont pas besoin d’être informés des dangers de la pollution de l’air. »
Dans la perspective des élections de novembre 1970, le New York Times plaignait « le député qui n’aurait pas de mesures environnementales à présenter à ses électeurs ». La défense de l’environnement était alors consensuelle, portée à la fois par une jeunesse éduquée votant démocrate et par le Parti républicain défendant son passé conservationniste (les parcs nationaux, Theodore Roosevelt). L’Environmental Protection Agency (EPA) et le Clean Air Act furent d’ailleurs adoptés sous la présidence du républicain Richard Nixon avec d’écrasantes majorités. Le backlash, expliquait le journal, venait de « conservateurs obtus […] qui n’accepteraient pas d’être sauvés d’un incendie sans demander avec suspicion où ils sont emmenés et si le danger des flammes n’a pas été exagéré ». Certes, quelques industriels « de moindre envergure » s’opposeraient à l’écologie, mais ils « seraient balayés par ceux dotés d’une vision plus large ».
Avec le recul, 1970 semble marquer l’apogée de l’écologie politique aux États‑Unis. La décennie qui s’ouvrait, annoncée par Nixon comme celle de l’environnement, fut surtout celle de la « crise énergétique » et de la recherche tous azimuts de la souveraineté par le nucléaire, par le gaz et par le charbon. Dès 1970, le journal Science prévoyait que la crise énergétique allait engloutir les préoccupations environnementales : « quand l’air conditionné et les télévisions s’arrêteront le public se dira “au diable l’environnement donnez‑moi l’abondance” ». En 1980, l’élection de Ronald Reagan et plus encore le score de Barry Commoner à la même élection (0,25 %) confirmeraient ce sombre pronostic. À l’époque, comme aujourd’hui, l’idée de « backlash écologique » est trop optimiste. Elle suggère une réaction temporaire, une résistance agressive, mais passagère, émanant des franges conservatrices de la société face à un mouvement d’écologisation et de transition. Les reculs observés ne seraient que tactiques : des contretemps fâcheux sur la voie du progrès. Le problème est qu’en matière écologique, le backlash est structurel, il reflète des intérêts liés à la totalité ou presque du monde productif. La lutte contre la pollution touche au fondement de l’activité économique, au volume et à la nature de la production, à la rentabilité des investissements, à la compétitivité des entreprises et des nations et à la place de l’État dans la régulation de l’économie. La nature structurelle du backlash est particulièrement visible pour le cas des États‑Unis et du réchauffement climatique sur lequel se limite ce texte.
La résignation climatique sous couvert de « transition »
À la fin de la décennie 1970, quand la question du réchauffement apparaît dans l’arène politique aux États‑Unis, personne ne mettait en cause la réalité du phénomène. Sa compréhension n’était entravée ni par les fausses controverses (le climatoscepticisme) ni par les fausses solutions (la capture du carbone par exemple). La nature du défi était bien perçue par les experts de l’EPA et de la National Academy of Science. Les experts soulignaient le rôle central du carbone dans le système productif mondial et l’énorme difficulté qu’aurait l’humanité à sortir des fossiles à temps pour éviter un réchauffement de 3 °C avant 2100. En 1979, le météorologue américain Jule Charney parlait du réchauffement comme du « problème environnemental ultime » : il fallait agir immédiatement, avant même sa détection, pour espérer limiter les dégâts à la fin du XXIe siècle.
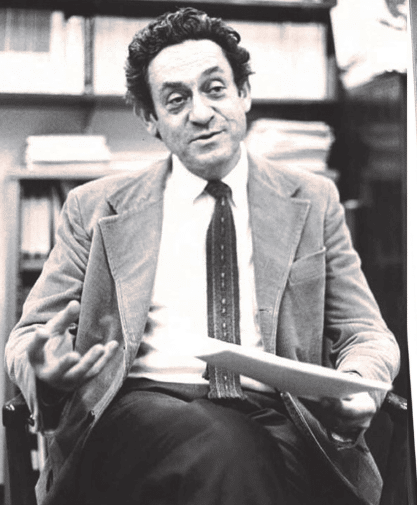
Très vite, la résignation l’emporta. En 1979, la Chine annonçait aux pays du G7 ses prévisions de production de charbon : 2 milliards de tonnes par an d’ici l’an 2000, soit les deux tiers de la production mondiale à l’époque. Si on ajoute à cela l’échec de l’énergie nucléaire — lié à ses risques et ses surcoûts —, l’urbanisation et l’électrification du monde pauvre, la poursuite du consumérisme dans le monde riche et la montée du néolibéralisme, on comprend pourquoi l’idée de stopper le réchauffement fut promptement abandonnée.
En 1983, la National Academy of Science publiait un rapport dont le titre Changing Climate signale à lui seul le parti pris de la résignation. La conclusion défendait rationnellement l’idée de ne rien faire. Il était plus que probable que les grandes puissances de ce monde, prises dans un dilemme du prisonnier, ne parviendraient pas à restreindre leur consommation énergétique et matérielle. L’essentiel des stocks de carbone étant réparti entre les États‑Unis, l’URSS et la Chine, c’est‑à‑dire entre deux superpuissances rivales et un pays en voie de développement, il était illusoire de penser qu’un de ces acteurs puisse y renoncer. On pourrait certes ralentir le phénomène, en introduisant une taxe carbone, mais, concluait le rapport, l’expérience des chocs pétroliers récents dissuaderait n’importe quel gouvernement d’opter pour un renchérissement volontaire des prix de l’énergie. Il faudrait donc s’adapter à un climat plus chaud, ce qui, au dire des agronomes, des forestiers et des ingénieurs consultés sur ce sujet était tout à fait envisageable pour un pays comme les États‑Unis. Quant aux pays pauvres, leur meilleure option était encore de brûler les fossiles nécessaires à leur développement et donc à l’augmentation de leur « résilience ». Il y aurait bien sûr des perdants — le Bangladesh est souvent cité à l’époque — mais imaginer que les pays industriels ou ceux qui aspiraient à le devenir puissent sacrifier leur économie pour le bien‑être des plus pauvres était une illusion. Au pire, il resterait la possibilité de déménager des zones entières de la planète.
➤ Lire aussi | « Les plus pessimistes étaient beaucoup trop optimistes »・Jean-Baptiste Fressoz (2023)
À l’échelle internationale, les grandes conférences commencèrent à se succéder, mais sans modifier les bases économiques et géostratégiques du problème. L’une des premières du genre se tient à Toronto en 1988. La déclaration finale fait preuve d’une réelle ambition : réduire de 20 % les émissions mondiales de CO2 d’ici à 2005 par la mise en place d’une taxe sur les combustibles fossiles dans les pays riches, destinée à financer le développement et l’adaptation des pays pauvres. Mais des contre‑feux sont rapidement allumés. En 1988, une nouvelle institution est créée, le GIEC, dont le but explicite était de remettre les gouvernements au cœur du processus d’expertise. Parmi les trois groupes composant le GIEC, deux sont présidés par des climatosceptiques. Le groupe III, celui chargé des « solutions », est dirigé par l’Américain Robert Reinstein. Comme il l’expliquera plus tard, cette affaire de réchauffement n’est selon lui qu’un faux-nez des négociations commerciales. Les Européens, jaloux des ressources énergétiques américaines, cherchent à nuire à la compétitivité des États‑Unis en invoquant des objectifs de réduction d’émissions illusoires. En tant que chef de la délégation américaine à la conférence de Rio en 1992, il est chargé par son gouvernement de mettre en avant les solutions technologiques au réchauffement — même si lui-même n’y croyait guère. Cette « carte technologique » — c’est son expression — fut largement reprise tant elle arrangeait tout le monde : elle permettait de repousser à plus tard et dans des progrès futurs les efforts de décarbonation.
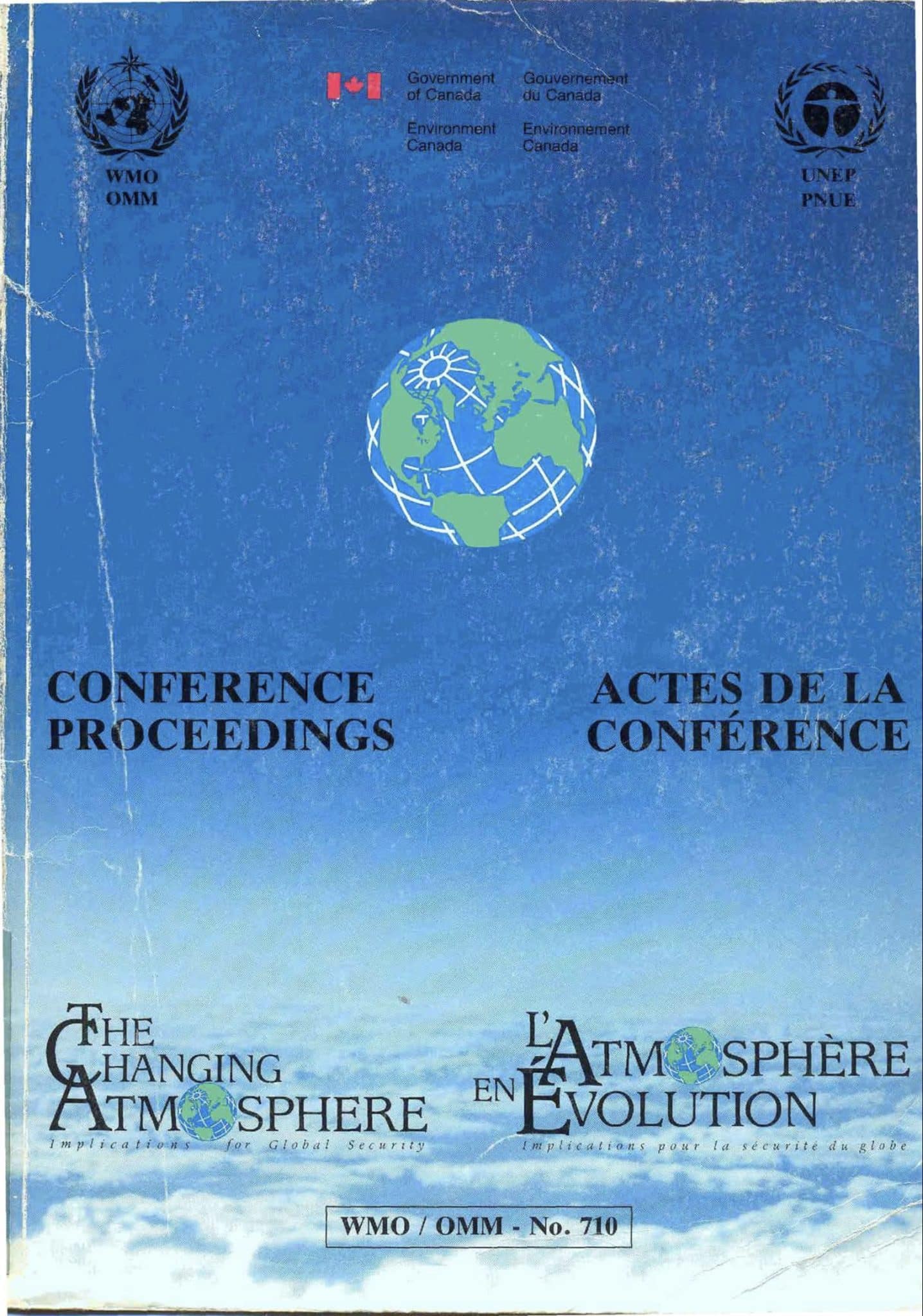
Transitionisme et climatoscepticisme sont loin d’être contradictoires. En 2002, un mémo de Franz Luntz qui est alors le principal communiquant au service du Parti républicain montre comment ces deux tactiques dilatoires peuvent fonctionner en tandem. Selon lui, les Républicains proches des intérêts pétroliers sont perçus comme vulnérables sur la question climatique. Ils ont besoin de modifier leur langage. Il leur faut par exemple employer le terme « énergie » en lieu et place de « pétrole », dire « energy company » pour désigner Exxon et consorts. De même, mieux vaut éviter « drilling for oil », qui évoque « une bouillasse noire et gluante », mais dire plutôt « energy exploration » qui paraît plus propre et renvoie à la technologie. Sur la question du climat, Luntz reprend la boîte à outils des marchands de doute et y ajoute l’idée de transition en cours. « Le débat scientifique est en train de se clore contre nous » écrit‑il, mais il reste « une fenêtre de tir ». Les Américains respectent la science et donc il faut insister sur le besoin de faire plus de science ou de la meilleure science. Et surtout, il faut parler d’innovation, souligner les baisses d’émissions déjà réalisées par le secteur privé et insister sur les progrès technologiques à venir. L’opposition aux normes et aux traités internationaux n’est pas contre le climat ou l’environnement. Au contraire : ces règles imposées par les étrangers entraveront la prospérité nationale et l’inventivité technologique américaines. C’est aussi à ce moment, sous la présidence de George W. Bush, que sont poussées les propositions de capture et de stockage du carbone, solutions impraticables à grande échelle, mais qui jouent un rôle clé dans les scénarios de neutralité carbone mis en avant par le GIEC.
Quelle « écologisation » au regard des dynamiques matérielles ?
Depuis que le monde se préoccupe officiellement du changement climatique, depuis 1992 et la conférence de Rio, les techniques — dont les énergies renouvelables — ont beaucoup progressé : il faut émettre presque deux fois moins de CO2 pour produire un dollar de PIB. Mais ce rapport entre deux agrégats est bien trop grossier pour comprendre les dynamiques matérielles. La baisse de l’intensité carbone de l’économie mondiale cache le rôle presque inexpugnable des énergies fossiles dans la fabrication d’à peu près tous les objets, un rôle qu’elles remplissent, il est vrai, de manière plus efficace. Depuis les années 1980, l’agriculture mondiale a accru sa dépendance au pétrole et au gaz naturel (ingrédient essentiel des engrais azotés) avec les progrès de la mécanisation et l’usage croissant d’intrants chimiques. L’extraction minière et la métallurgie deviennent plus gourmandes en énergie. L’urbanisation du monde pauvre a conduit à remplacer des matières peu émettrices comme le pisé ou le bambou par du ciment. L’extension des chaînes de valeur, la sous‑traitance et la globalisation accroissent les kilomètres parcourus par chaque marchandise ou composant de marchandise et donc le rôle du pétrole dans la bonne marche de l’économie. Tous ces phénomènes sont masqués par l’efficacité croissante des machines et le poids des services dans le PIB mondial (d’où l’impression de découplage), mais ils n’en sont pas moins des obstacles essentiels sur le chemin de la décarbonation.
➤ Lire aussi | Défataliser l’histoire de l’énergie・François Jarrige & Alexis Vrignon (2020)
Car la « transition énergétique » présentée comme la solution au réchauffement concerne surtout l’électricité, soit 40 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pour l’aviation, le transport maritime, l’acier, le ciment, les plastiques, les engrais, l’agriculture, le bâtiment ou encore l’armement, les perspectives de décarbonation restent encore assez fantomatiques. Le déploiement des renouvelables va alimenter en électricité décarbonée une économie dont la constitution matérielle dépendra encore longtemps des fossiles. D’où la nécessité de quantités colossales « d’émissions négatives » après 2050 sous forme de BECCS, pour « bioénergie couplée à la capture et au stockage de carbone ». C’est sur cette promesse technologique sans fondement que reposait l’Accord de Paris.
En 1970, l’éditorialiste du New York Times qui avait inventé le terme d’« ecological backlash» se moquait d’une rumeur colportée par la droite américaine, celle d’une collusion entre socialisme et environnementalisme. Peut‑être aurait‑il fallu explorer cette idée plus loin : lutter contre le réchauffement et la destruction des écosystèmes nécessite une transformation extraordinairement profonde du monde matériel et donc de notre société. Cela requiert non seulement le déploiement de nouvelles techniques, mais aussi et surtout le démantèlement accéléré de secteurs entiers de l’économie qui dépendent et dépendront longtemps des fossiles. Il s’agit bien d’une rupture avec le capitalisme industriel fondé sur la propriété privée des moyens de production. Denis Hayes, l’organisateur du premier Jour de la Terre, le reconnaissait volontiers : « Je soupçonne que les politiciens et les hommes d’affaires qui sautent dans le train de l’écologie n’ont pas la moindre idée de ce à quoi ils s’engagent […] Ils parlent de projets de traitement des eaux usées alors que nous contestons l’éthique d’une société qui, avec seulement 6 % de la population mondiale, représente plus de la moitié de la consommation annuelle mondiale de matières premières. »
L’idée de backlash a ceci de confortable qu’elle tend à naturaliser l’écologisation des sociétés. Elle donne l’impression que les revers actuels ne sont que temporaires. La transition serait en marche, il suffirait de l’accélérer. En fait, les ennemis de l’écologie — qu’ils soient populistes ou néolibéraux — ne sont que la face visible et grimaçante d’une force colossale, celle qui se trouve derrière l’anthropocène : non seulement le capitalisme, mais tout le monde matériel tel qu’il s’est constitué depuis deux siècles.
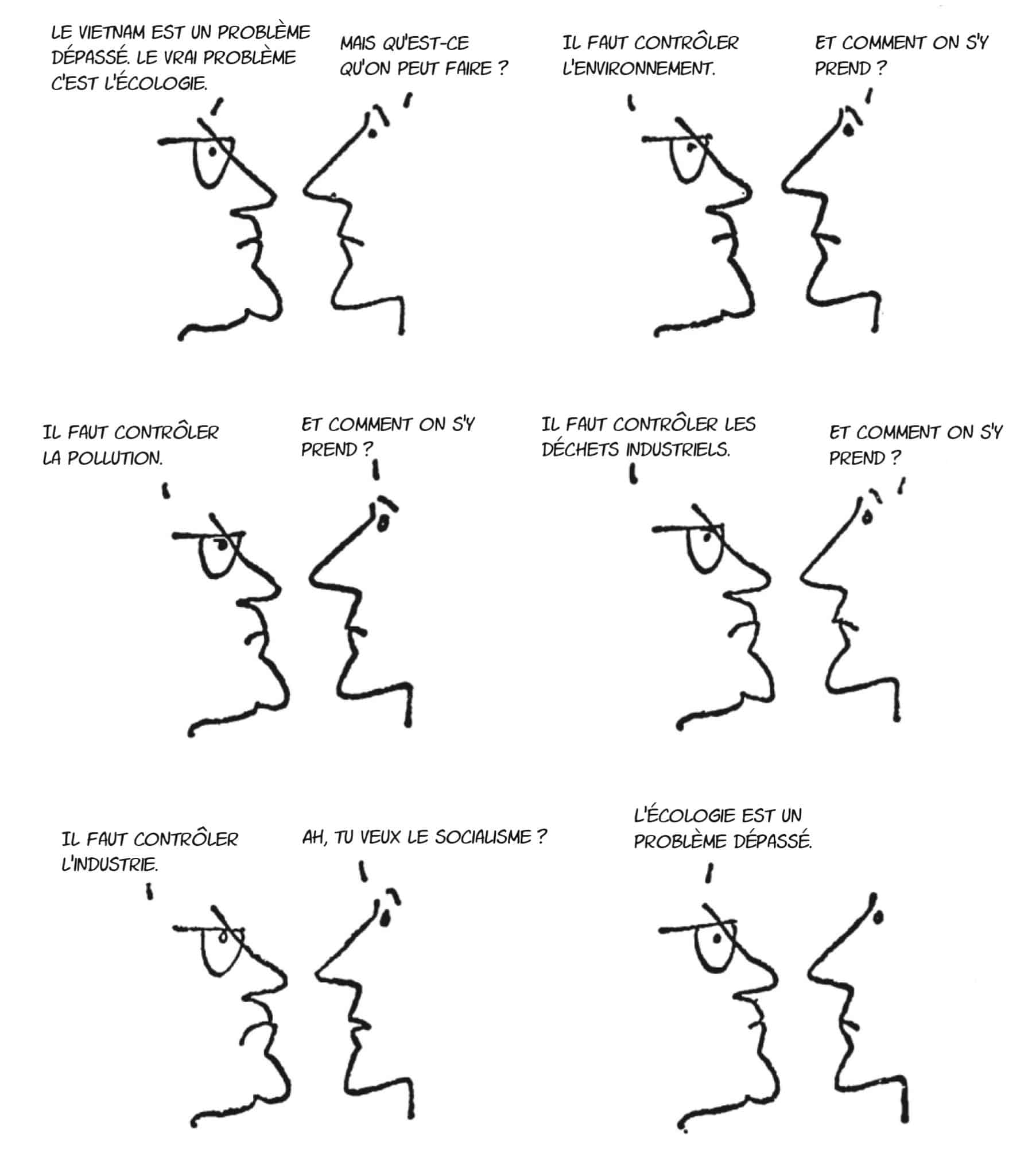
Sunday Telegraph, 26 avril 1970 (traduit en français)
➤ Lire aussi | Portrait du capitalisme en économie régénérative・Quentin Pierrillas (2020)

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
L’article « Au diable l’environnement, donnez‑moi l’abondance ! » : pourquoi le backlash est structurel est apparu en premier sur Terrestres.
07.10.2025 à 18:47
Gaza et la défaite de l’humanité
97 % des cultures arboricoles ont été détruites par deux ans de guerre alors que 78 % des immeubles et 97 % des écoles ont été rasés ou endommagés. Face à cet anéantissement délibéré, l'essayiste franco-libanaise Dominique Eddé offre dans son livre « La mort est en train de changer » des réflexions très justes sur l'engrenage mortifère de cette guerre. Extraits choisis.
L’article Gaza et la défaite de l’humanité est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (7322 mots)
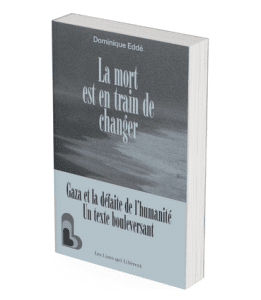
Ce texte est composé de deux extraits du livre de Dominique Eddé La mort est en train de changer paru en septembre 2025 aux éditions Les Liens qui Libèrent.
La peur de soi, la peur de l’autre
Quand la souffrance dépasse le seuil du tolérable, le peu de force qui reste est employé à la supporter. Il suffit de regarder les visages des enfants amputés, affamés à Gaza, des porteurs de cadavres, de leurs parents, de leurs proches, des prisonniers au sortir de la torture : ils sont tous inatteignables. Leur colère est comme asséchée par leur douleur ; et leur douleur, privée d’identité, traitée en masse. J’imagine ce même degré d’épuisement chez les otages israéliens. Chez les torturés des prisons syriennes à la brusque apparition du jour… Je l’ai vu sur les visages des Libanais brûlés par les bombardements du Sud. Tous ces êtres ont habité au même endroit : là où vivre consiste à mourir en vie.
Écrire pendant ce temps est une épreuve à la limite de l’obscénité. Ne pas écrire, alors que l’on peut donner du fil à retordre à la haine, est encore moins glorieux. Je vais donc essayer d’écrire. Et, en écrivant, d’écarter les mots qui ne servent plus à rien, sinon à retarder le moment d’en inventer peut-être d’autres.
L’interdiction de nommer le génocide en cours à Gaza, sous peine d’être taxé d’antisémitisme, est un verrou qui a tenu durant des mois, mois qui, pourtant, ne cessaient d’en donner la preuve. Notamment en Allemagne, en France, en Europe : dans les pays qui ont permis, à des degrés divers, que le nazisme organise la mort de six millions de juifs. Ce verrou vient de sauter. Ce ne sont plus seulement quelques esprits lucides, ou dissidents israéliens de longue date, qui le disent haut et fort. À présent, des ONG et des responsables israéliens, anciens ministres ou ambassadeurs, conviennent du processus d’extermination de la population de Gaza.
L’interdiction de nommer le génocide en cours à Gaza, sous peine d’être taxé d’antisémitisme, est un verrou qui a tenu durant des mois, mois qui, pourtant, ne cessaient d’en donner la preuve.
Pour ma part, je me suis bornée à remplacer un mot par un autre : abattoir, par exemple. Ce fut troublant de constater qu’il ne soulevait pas d’objections. Les esprits aveuglés en seraient-ils au point où il leur suffit que l’horreur absolue soit nommée d’un mot plutôt que d’un autre pour la leur rendre acceptable ? Surtout, comment comprendre qu’il ait fallu attendre si longtemps pour prendre au sérieux le ministre de la Défense israélien qui traitait impunément les Palestiniens d’« animaux humains » au lendemain du 7 octobre 2023 ? Faut-il que les territoires de la surdité et du mensonge soient faits de la même étoffe pour que la crédulité et la mauvaise foi se soient trouvées en même temps, au même endroit. En bloc, juifs et musulmans ont été désignés, menacés, en lieu et place des chefs de guerre qui, juifs ou musulmans, les mettaient en danger. Tout s’est passé comme si le langage ne servait plus qu’à écraser la pensée. On a entendu dire que l’armée israélienne était « l’armée la plus éthique du monde ». On a entendu dire par d’autres que les enfants palestiniens étaient des cibles légitimes, étant, par nature, de futurs terroristes. On a fait le procès de l’antisionisme au moment où le sionisme faisait naufrage. On a mis les mémoires en demeure de choisir chacune son pré carré dans le champ des cimetières. On a entendu des militants de la cause palestinienne douter de l’étendue du massacre du 7 octobre. On a surtout entendu un silence dévastateur, plein de sous-entendus et de réflexes coloniaux, confier à la peau blanche le pouvoir inné de mater la brune, la sauvage.

Un réfugié palestinien porte ses deux petits enfants blessés après le bombardement du camp de Nuseirat dans la bande de Gaza, 29 octobre 2023. Crédits : Ashraf Amra, UNRWA CC BY-SA 4.0.
Dès lors, l’être humain, blanc ou brun, perdait ses droits, au profit de la masse. Les régimes arabes ont excellé dans leurs vieilles habitudes : s’allier en douce à l’ennemi, simuler la désapprobation, réduire leurs peuples au silence. En France et en Allemagne, toute objection était passible de procès médiatique. Aux États-Unis, si la censure fut moins drastique dans un premier temps, elle est maintenant sans pitié. Les universités, pour ne citer qu’elles, payent d’un prix exorbitant leur quart d’heure de liberté. Celles et ceux qui tiennent, envers et malgré tout, n’ont plus de mots pour dire la suffocation. Ils regardent la mort achever son travail sur les visages exsangues d’une population cadavérique.
Aucune des lignes que je viens d’écrire ne dédouane le Hamas de ses crimes. Aucune. Vivement le jour où il sera vu du même œil par ceux qui s’entêtent à le protéger et par ceux qui y voient un diable sorti de nulle part. Sachant que sa part « diabolique » fut méthodiquement entretenue par le pouvoir israélien. Il s’agit maintenant d’essayer de réfléchir dans l’ordre, c’est-à-dire hors symétrie, car il n’y en a pas, à l’étendue d’un désastre programmé par les répétitions infernales de notre espèce : la cécité, le mensonge et les moyens qu’elle se donne pour les avaliser. Israël est un État qui n’a pas attendu Netanyahou pour humilier, coloniser, déposséder le peuple palestinien. À quel titre devrait-on oublier que les colonies ont prospéré sous les gouvernements travaillistes au lendemain des accords d’Oslo ? Il n’y aura pas de perspective d’apaisement possible tant que la défense de soi passera par la négation de l’autre, par la mise à l’écart de l’histoire, par l’injustice dans le traitement de l’injustice.
Israël aura beau assurer sa supériorité militaire, recommencer encore et encore, il ne parviendra à assurer la pérennité de sa population qu’en renonçant à l’emmurer. Sans quoi l’avenir l’expulsera comme il est en train d’expulser les habitants de Gaza et déjà, de Cisjordanie. La reconnaissance est le mot clé de ce qui reste à sauver : la reconnaissance officielle par Israël du mal sans nom que ce pays a causé au peuple palestinien.
Il n’y aura pas de perspective d’apaisement possible tant que la défense de soi passera par la négation de l’autre, par la mise à l’écart de l’histoire, par l’injustice dans le traitement de l’injustice.
(…)
Israël : récapitulation
Étant de ceux qui, à 20 ans, ne pouvaient accepter l’existence d’Israël et qui, cinquante ans plus tard, défend sa survie dans le cadre d’un changement de cap, je voudrais commencer par me servir de moi, qui ne représente personne, comme on se sert d’un cobaye dans une expérience médicale. D’abord préciser les termes de mon cheminement. Ne pas confondre les mots. Que signifie de mon point de vue défendre la survie d’Israël ? S’agit-il de souscrire à un État juif ? Non. Pas plus que je ne peux souscrire à un État musulman ou chrétien. Il tombe sous le sens que cette région actuellement gangrenée par la fusion du religieux et du politique n’entrera en convalescence que le jour où elle y renoncera. Sachant par ailleurs que plus de 20 % de la population israélienne n’est pas juive, je ne vois pas selon quelle logique cet État pourrait se définir comme juif. S’agit-il de considérer Israël comme un principe de réalité ? Oui. S’agit-il de défendre l’avenir du peuple israélien sur cette terre et de réfléchir aux conditions pouvant assurer sa sécurité ? Oui.
Ce point crucial appelle un effort d’imagination considérable qui, pour l’heure, n’a été fait à grande échelle ni par les Israéliens, ni par les pouvoirs palestiniens, ni par les Arabes. Moins encore par les puissances étrangères. Une mauvaise foi réciproque entretient en cet endroit un tabou qui permet aux uns d’œuvrer activement au Grand Israël, au prix d’un génocide et de dégâts régionaux considérables, aux autres d’entretenir le double langage de la reconnaissance d’Israël d’un côté et du fantasme de voir ce pays disparaître de l’autre. Les régimes arabes misent sur la reconnaissance, les fondamentalistes islamistes misent sur le fantasme, les uns comme les autres ont l’autre moitié de l’équation en tête. Tous empoisonnent l’avenir. Les Palestiniens n’en finissent pas d’en mourir.

Aucun processus de paix n’a pris en compte la pression des non-dits qui la rendent impossible, aucun n’a désamorcé les bombes que fabriquent les inconscients. Plus le temps passe, plus il est dicté par le couple infernal de la prédation et de la haine. Ceci n’est qu’un début. Il faut oser continuer à creuser là où ça fait mal si l’on veut ramener tous ces corps moribonds à la vie. La région a payé trop cher l’entretien des arrière-pensées. Elle ne sortira de l’ornière que le jour où l’on aura entamé, de tous côtés, un travail simultané de récapitulation, de renoncement et de redéfinition de la réalité. Ceci implique du fait même un changement de représentation de soi et de l’autre. La tâche ne concerne pas que le Moyen-Orient. Les peuples du monde entier, toutes identités de naissance confondues, sont appelés à faire ce que l’intelligence mécanique ne peut pas faire : renoncer au miroir pour survivre. Plus exactement, troquer le miroir contre la fenêtre. Il est vrai qu’en cette première moitié du XXIe siècle, le triomphe de l’argent et celui des dictatures rendent la figure du miroir écrasante, celle de la fenêtre improbable.
➤ Lire aussi | Pendant ce temps, l’insupportable quotidien de Gaza・Rami Abou Jamous (2025)
À l’heure où j’écris ces lignes, des enfants palestiniens courent dans tous les sens à Gaza, tombent comme des oiseaux, gisent ensanglantés dans les bras de leurs parents. L’incapacité de la grande majorité de la société israélienne à en prendre conscience, à voir au-delà d’elle-même, incarne tragiquement la figure du miroir. Elle ne date pas d’aujourd’hui. Mais le degré de cécité n’a jamais connu un tel pic. Le point aveugle remonte au moment où le sionisme, pour s’installer et se construire, a eu recours à un gigantesque mensonge : il s’est inventé « une terre sans peuple pour un peuple sans terre ». Il a feint de croire – ou voulu croire à force de s’en convaincre – que le Palestinien n’existait pas. Il a donc fallu lui inventer un sens au moment où sa réalité s’est imposée. Le mot « terrorisme » a rempli le vide, il a soufflé sur les peurs et soulagé les consciences. Ce n’est pas un hasard si, parmi les voix occidentales que ce mensonge délivrait d’une culpabilité écrasante, ce sera plus tard celle du général de Gaulle, à la pointe du combat contre le nazisme, qui fera entendre sans détours sa résistance à l’injustice, son attachement au droit international ; sans laisser tomber pour autant le droit d’Israël, désormais constitué en État à dominante juive, à exister et à assurer sa sécurité.
Dans la mesure où je suis depuis toujours une irréductible de la liberté, dépourvue de fibre nationaliste, je crois pouvoir affirmer que j’aurais été farouchement antisioniste si j’étais née juive. J’y aurais vu, outre l’injustice flagrante envers les Palestiniens, une perte pour la richesse culturelle juive qui se situe bien au-delà de la fabrication d’une identité nationale. En ce sens, j’aurais sans doute dit ce qui ne peut être dit que par des juifs et que formule notamment l’historien Ilan Pappé : « Les juifs ont une contribution au monde beaucoup plus importante en tant que peuple sans État, qu’en tant que peuple doté d’un État. » J’y aurais vu par ailleurs le trop commode remboursement de la dette européenne envers les juifs. J’y aurais surtout vu le signe d’une reconduction insidieuse de l’antisémitisme, du fait même que des juifs français, allemands ou hongrois ne recevaient pas, au lendemain de l’horreur nazie, les raisons et les preuves d’une véritable réparation : l’obtention d’une entière sécurité et reconnaissance dans leurs pays de naissance. À présent que le fait accompli israélien est un principe de réalité, il revient à ses amis comme à ses ennemis déclarés de procéder à ce que j’ai appelé « le deuil de l’idéal ». Là où l’avenir reprend ses droits sur les répétitions machinales du passé, là où le goût de la paix l’emporte sur le goût exclusif de soi, des « siens ».
« Les juifs ont une contribution au monde beaucoup plus importante en tant que peuple sans État, qu’en tant que peuple doté d’un État. »
Ilan Pappé
L’antisémitisme refait des ravages depuis le 7 octobre 2023. On ne cessera de répéter qu’il ne s’agit en aucun cas du même phénomène en Occident et en Orient. L’actuelle poussée de haine envers les juifs, parmi les peuples arabes, est à voir sous un angle foncièrement différent de ce qu’elle fut, de ce qu’elle est en Europe. On ne peut pas déclarer Israël État juif, coloniser le peuple palestinien, annexer Jérusalem, et programmer la disparition de la Palestine sans prendre le risque – le mot est faible – de créer le pire des amalgames dans l’esprit de ceux que l’on humilie, que l’on dresse ainsi contre soi. Il est compréhensible que de nombreux juifs aient vécu le massacre du 7 octobre comme un pogrom antisémite, cela ne signifie pas que c’en était un. Ce massacre s’est déroulé dans le cadre d’une région démolie, livrée au chaos ; il a été mené par des hommes enragés par une colonisation sans pitié, vieille de 70 ans. Les responsabilités de cette barbarie – qui dévaste par ailleurs la région, toutes communautés confondues depuis un demi-siècle – sont largement partagées. Ignorer ce fait, s’en tenir à la version d’une agression antisémite, obstrue la pensée, bloque les issues. Que la haine envers les juifs ait terriblement augmenté ces deux dernières années dans le monde arabe, c’est indéniable. Mais se borner à la condamner, hors contexte, sans prendre en compte ce qui la cause et l’enflamme, ce n’est pas la combattre, c’est y contribuer.

De l’autre côté, force est de constater – exceptions mises à part – une tragique panne de pensée au sein des sociétés civiles arabes. Gagnés par la frustration et la colère, un nombre considérable de personnes ne raisonnent plus. Au prétexte du carnage en cours à Gaza, elles renoncent à l’autocritique, dédouanent le Hamas, relativisent le traitement infligé aux otages, cèdent au sinistre argument du chiffre et de la comparaison : « Ce n’est rien par rapport au génocide en cours. » Quand l’ennemi devient une aubaine pour se blottir dans un camp et se borner à la récrimination, alors la défaite est double : elle est physique, infligée par la force militaire de l’ennemi, et morale, infligée par soi.
Il n’y a jamais eu de société arabe plus riche qu’en temps de mixité. La perte de la présence juive dans les pays arabes est incommensurable.
Il n’y a jamais eu de société arabe plus riche qu’en temps de mixité. La perte de la présence juive dans les pays arabes est incommensurable. La plupart des esprits le savent et le regrettent. Ignorer ce que l’on sait équivaut à se couper de ce qui reste à inventer, à découvrir. Il va de soi que la lutte contre le mépris, l’ostracisme et la haine dont sont victimes les populations d’origine arabe ou musulmane, les militants, les étudiants en faveur de la Palestine, où qu’ils se trouvent, va de pair avec la lutte contre l’antisémitisme. C’est la même. Amputée de sa moitié, l’équation est une bombe.
La tragédie a acté, à Gaza, la fin d’un mensonge
La tragédie a acté, à Gaza, la fin d’un mensonge. Les États qui ont soutenu le gouvernement de Netanyahou se savent désormais coupables devant l’histoire de collaboration active avec un partenaire sanguinaire. Ils lui ont fourni des armes, des alibis, et – plus cher que tout – le temps qu’il fallait pour accomplir le boulot. Le Hamas a certes largement contribué au désastre. Les régimes arabes, n’en parlons pas. C’est pourquoi nous sommes à présent sommés de penser l’ennemi comme un monstre à mille têtes, accouché par un monde détraqué. Nous sommes très loin du nazisme, qui nous donnait à voir le mal, en un seul bloc, derrière des barreaux. Le mal, comme le monde, est liquéfié à l’heure qu’il est. Nos vieilles certitudes flottent sans avenir à la surface des eaux. Nous n’en sommes pas moins témoins, en direct, d’un mal innommable que les gouvernants de la plupart des pays démocratiques ont laissé faire – et, pour certains, alimenté. Comment comprendre que dans un pays tel que la France, ni les gouvernants, ni la majorité des médias et des intellectuels n’aient jugé utile de s’alarmer de l’interdiction des médias étrangers sur les lieux du crime ?
➤ Lire aussi | En Palestine, « l’huile qu’on attend un an, les soldats la jettent en un instant »・Forum palestinien d’agroécologie (2025)
La mise à mort de la Palestine a mis Israël au pied du mur. Le judaïsme n’entre plus dans le gant déformé de ce pays emmuré. Pas plus que d’être chrétien, musulman ou athée, le fait d’être juif n’est un passeport d’humanité. Je ne cesse de m’étonner d’entendre des phrases convenues telles que « un juif ne tue pas des enfants » ou « c’est contraire à la pensée juive d’affamer un peuple ». Il est un postulat qui vaut pour l’humanité tout entière : elle n’est jamais à l’abri, quelle que soit l’identité en jeu, du meilleur et du pire. Sans compter qu’à partir du moment où un peuple se constitue en nation avec des moyens militaires écrasants, il s’expose, quel qu’il soit, à tout ce que ces armements impliquent. Pas plus que Bach n’est responsable d’Hitler, Einstein n’est responsable de Smotrich, ou Ibn Arabi des talibans. Il appartient en revanche à tous les esprits dits libres, provenant de ces cultures, de s’interroger sur ce que les inconscients fabriquent pour mener à de tels extrêmes.
Comment comprendre que dans un pays tel que la France, ni les gouvernants, ni la majorité des médias et des intellectuels n’aient jugé utile de s’alarmer de l’interdiction des médias étrangers sur les lieux du crime ?
Ainsi, s’agissant d’Israël, qui nous fera croire que le fantasme du Grand Israël date de Netanyahou et de ses sbires ? Qui nous fera croire que c’est par inadvertance qu’année après année les terres palestiniennes ont été colonisées ? Qui, d’entre les adeptes du processus d’Oslo, nous expliquera logiquement comment la paix pouvait avoir lieu sans une restitution des territoires ? La mauvaise foi, dont Sartre disait qu’elle est une manière de mimer le rôle que l’on s’est assigné, est bel et bien au cœur de la politique israélienne, gauche et droite confondues. Sachant bien sûr que quelques personnalités politiques israéliennes, dont Yitzhak Rabin, ont souhaité la combattre et frayer une autre voie à l’avenir. Une partie de leur effort, dicté par une douloureuse conversion au réalisme, a été freinée par leur méfiance. Leur méfiance envers les Palestiniens découlant de leur méfiance envers eux-mêmes : de leur incapacité à affronter l’étendue des dégâts causés depuis 1948. Car ce n’était pas tant l’OLP qu’il fallait reconnaître en 1993, que la souveraineté du territoire palestinien.
Il est vrai qu’Israël est adossé à une mémoire terrifiante dont on peut comprendre qu’elle ait eu besoin de mentir pour survivre. Encore faut-il que ce mensonge soit un jour reconnu s’il veut se faire oublier. La question que tout le monde élude et qui engage l’avenir de millions de vies est la suivante : que veut Israël pour Israël ? Mais aussi, que veut Israël pour les juifs ? Que veulent les juifs pour Israël et pour eux-mêmes ? Sachant que le mot « juifs » recouvre un océan de différences qui leur ferait perdre le sens même de leur existence s’ils étaient condamnés à y renoncer. Et du côté arabe, se pose la question cruciale de savoir comment, sous quelle forme, les élites conçoivent-elles leur lutte contre l’invasion du champ politique par l’Islam ?
Autant dire que, pour l’heure, la catastrophe spirituelle est générale.
Photo d’ouverture : Déplacés palestiniens retournant vers la ville de Gaza et le nord de l’enclave par la rue al-Rashid, le 28 janvier 2025. Crédits : Ashraf Amra, UNRWA CC BY-SA 4.0.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
L’article Gaza et la défaite de l’humanité est apparu en premier sur Terrestres.
27.09.2025 à 11:37
Le fleuve mangé par son lit : l’extractivisme du sable au Cambodge
Endiguer, pomper, assécher, convoyer, remblayer. Dans une belle enquête graphique, l’urbaniste Dolorès Bertrais retrace la filière du sable à Phnom Penh. À mesure qu’on l’extrait du Mékong pour édifier la ville et ses mégaprojets capitalistes, le lit du fleuve se vide… et les inégalités au sein de la société cambodgienne s’aggravent. Extraits choisis.
L’article Le fleuve mangé par son lit : l’extractivisme du sable au Cambodge est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (10353 mots)

Ce texte est composé d’extraits du livre de Dolorès Bertrais Sur la piste minérale. Enquête sur la filière du sable en Asie du Sud Est, paru en 2025 chez Métis Presses dans la collection « Vues D’ensemble Essais ».
Ancien comptoir fluvial cosmopolite installé au confluent de quatre rivières navigables, Phnom Penh jouit d’une situation géographique privilégiée1. Sous protectorat français pendant près d’un siècle, ce dernier joue un rôle majeur dans la transformation d’une ville vers une certaine forme de « modernité2 ». L’extension physique de la ville, portée à ce moment par les autorités publiques, devient possible à l’aide de techniques de génie urbain. Endiguer, assécher, remblayer, soit autant d’actions pour permettre le passage « des villes sur l’eau aux villes sur terre3 ». Autrement dit, la fabrique de la ville s’organise à l’aide de remblais hydrauliques réalisés grâce aux instruments issus de l’ingénierie française. La géographe Céline Pierdet mentionne qu’entre 3000 et 4000m3 d’alluvions sont dragués chaque jour dans les années 1920 pour alimenter les casiers, c’est-à-dire des parcelles de terrain délimitées par des digues. Ces casiers, une fois remblayés, permettent de surélever le niveau altimétrique du sol, générant ainsi des terres à bâtir hors d’eau. Toutefois, à l’intérieur de certains casiers, la vie avec l’eau se poursuit, puisque Phnom Penh dénombre encore de nombreux lacs. La planification urbaine repose alors sur la concordance entre les juxtapositions hydrauliques et les fonctions urbaines qui cohabitent4. Cette méthode de remblais hydraulique, perçue comme la plus « rationnelle » à cette période5, reste synonyme d’instrument de contrôle hors pair pour développer la ville. Ces casiers s’accompagnent de systèmes d’ingénierie hydraulique complexes composés de digues, de stations de pompage et de vannes qui, successivement, redessinent le paysage naturel hydrique afin de préserver le territoire urbain de ces inondations.
Ces infrastructures nécessitent une maintenance constante et une attention particulière aux phénomènes météorologiques intenses présents dans la sous-région. À la saison sèche, de novembre à avril, les vannes ouvertes permettent à l’eau de s’écouler vers le fleuve. À la saison des pluies, de mai à octobre, ces mêmes vannes doivent être refermées pour éviter aux eaux des crues de pénétrer dans les terres. La planification urbaine de Phnom Penh repose sur ce legs colonial, qui reste un jalon essentiel pour comprendre les dynamiques urbaines contemporaines et l’extension de la ville.
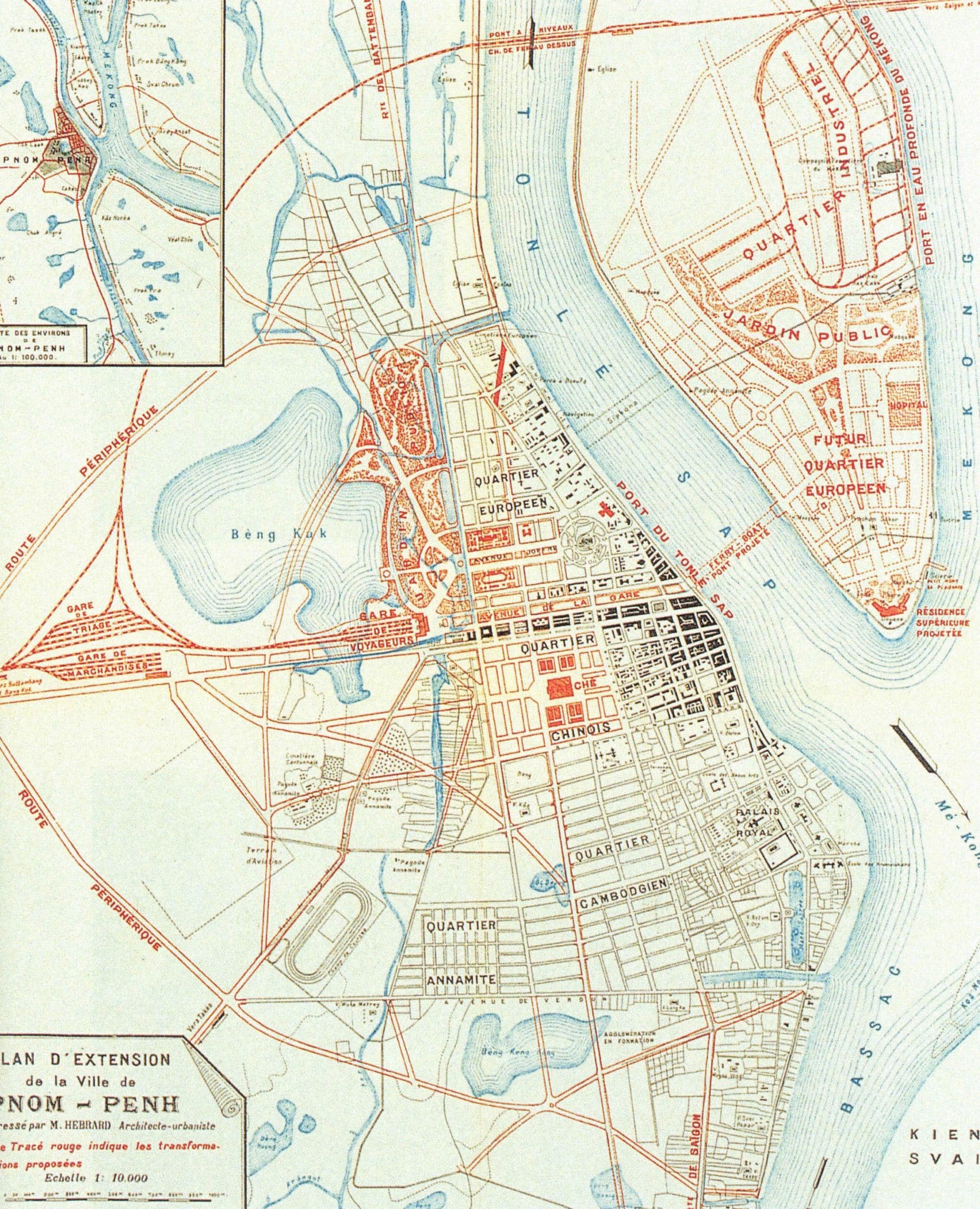
Certes, ces prémices suggèrent que la composante hydraulique alimente une spatialité en interaction avec son environnement. Cependant, les instigateurs de la planification urbaine « moderne » de Phnom Penh encouragent progressivement la ville à se déconnecter, voire à s’affranchir du site géomorphologique singulier où elle s’est bâtie. L’eau « dans la ville » passe progressivement à l’eau « sous la ville6 ». Le remblai hydraulique annonce le début d’une nature instrumentalisée pour servir les intérêts du développement urbain dans la capitale. Ce dispositif, hérité du protectorat et toujours à l’œuvre, constitue le socle actuel et concret de la production de l’espace, profondément influencée par des décisions politiques. Des travaux en sciences politiques ont analysé la « politique de patronage » au Cambodge7 et révèlent que l’imbrication du Cambodian People’s Party (CPP), principal parti politique, avec l’État a initialement fourni au parti un mécanisme permettant de contraindre les électeurs et de restreindre les activités des partis d’opposition8. Le CPP et le Premier ministre (Hun Sen jusqu’en août 2023 et désormais Hun Manet, son fils aîné) ont utilisé leur pouvoir pour développer un système où ils offrent des avantages à certaines personnes en échange de leur soutien. Cela crée des liens entre le parti au pouvoir, les électeurs, les représentants du gouvernement et les grandes entreprises, entraînant souvent des pratiques de corruption.
Cette politique de patronage a joué un rôle prépondérant dans la distribution des ressources naturelles, leur exploitation et l’octroi du foncier urbain. La nature, autrefois considérée comme un héritage précieux, est devenue une marchandise à vendre, et les sédiments, en particulier le sable, sont désormais extraits et commercialisés à grande échelle, contribuant à la transformation radicale des paysages, notamment pour consolider les métabolismes d’une « urbanisation planétaire9 ».
Agencements techniques : extraire le sable du Mékong
Le sable du Mékong, dans l’aire d’étude arpentée, s’extrait de quatre manières différentes, dont trois d’entre elles transitent par un dépôt de sable. Ces méthodes ont toutes été identifiées grâce aux observations directes.
La première technique d’extraction s’opère à l’aide d’une pelle à câble équipée d’un godet en « pince » ou benne preneuse d’une capacité de 2m3 installée sur une barge au mouillage. Des va-et-vient s’opèrent entre la collecte du sable au fond du fleuve et l’action de déverser ce sable attrapé – avec certainement bien d’autres vivants captés lors de cette collecte – dans une barge qui attend d’être remplie, accostée sur ces barges au mouillage. Le bruit des moteurs des pelles mécaniques vrombit et à mesure que le godet plonge et ressort de l’eau, le fracas du métal dissone au contact de la masse d’eau. Il est possible d’observer l’eau saisie par la même occasion qui s’écoule le long du godet 10.
Une deuxième technique d’extraction s’opère directement depuis la barge à remplir. Sans intervention de barges annexes, un moteur et des tuyaux de pompage sont directement installés sur la barge. Un tronçon de tuyau plonge dans les eaux et aspire à l’aide d’un moteur le sable présent au fond du lit et le déverse par ce même tuyau directement dans l’aire de stockage sur la barge. D’un aspect boueux, le trop-plein d’eau est évacué à mesure que la masse de sable prend place dans la barge.
La troisième manière d’extraire le sable du Mékong s’effectue à l’aide de ce que nous nommerons dans cette recherche une « barge-machine ». Souvent accostées sur les rives du fleuve, ces barges-machines sont reliées par un système de tuyaux au dépôt de sable. Elles pompent directement le sable depuis le fleuve. Elles peuvent aussi servir de relais pour les barges qui arrivent pleines de sable pour le transférer de la barge au dépôt.
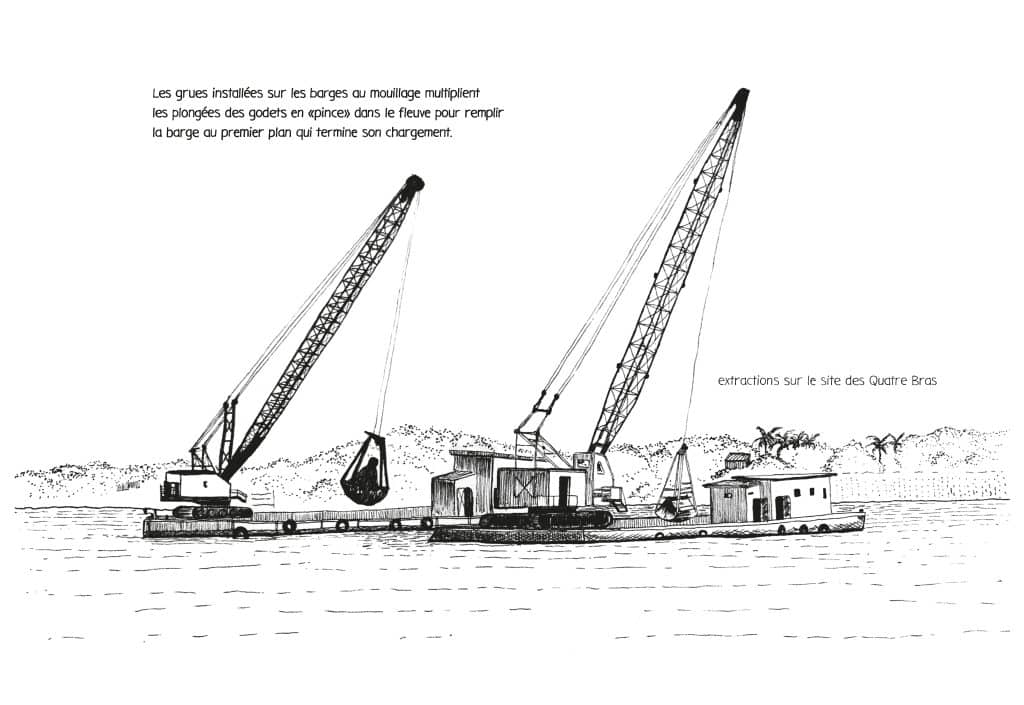
Enfin, la dernière technique déployée est celle qui, sans transiter par un dépôt de sable, aspire le sable depuis le fleuve à l’aide de moteurs (sur les barges-machines) et l’envoie par un système de tuyaux imbriqués les uns aux autres. Ce système se rapproche de la troisième technique développée précédemment. Elle est surtout mobilisée lorsque les sites à remblayer se trouvent à « proximité » du fleuve. Une partie du remplissage du Boeng Cheung Ek, en cours de remblais, s’effectue à l’aide de cette technique, tout comme le Prek Pnov, au nord de la ville, qui se jette dans le Boeng Tamok (en cours de remblais également)11. Cette technique échappe au « contrôle » du ministère des Mines et de l’Énergie puisque ce sable ne transite pas par un dépôt.
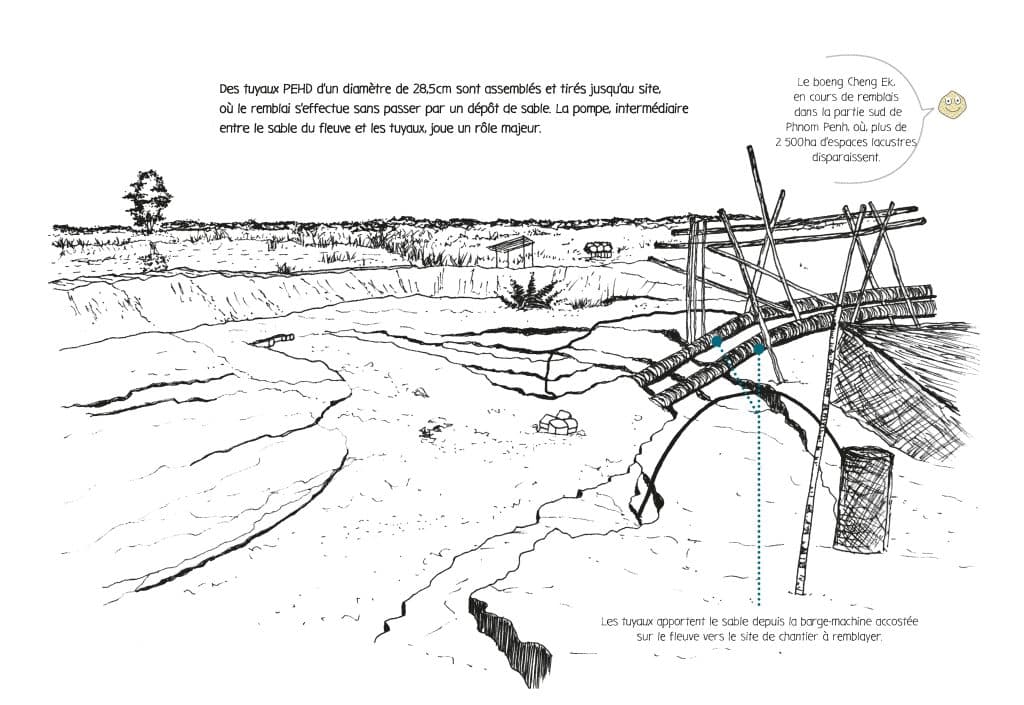
Cartographier les mouvements du sable
À Phnom Penh et dans les périphéries en construction, le sable de plus en plus prisé pour le secteur de la construction s’amoncelle dans les rues. Si la plupart des dépôts distribuent le sable à Phnom Penh et aux alentours, pour subvenir à une « demande locale », l’un des dépôts nous explique que le sable peut parfois être livré dans les autres provinces comme à Kampot, Kampong Speu et Preah Vihea 12. Si certains tas de sable destinés à des constructions individuelles revêtent des allures de petits monticules qui n’excèdent pas un mètre de hauteur, d’autres prennent de faux airs de dunes du désert de hauteurs variables et s’étendent à perte de vue sur des centaines de mètres. Ces énormes amas de sable attendent d’être nivelés.
L’un des projets les plus consommateurs de sable à Phnom Penh est actuellement celui situé au sud de la capitale sur les Boeng Tumpun et Boeng Cheung Ek pour le projet [immobilier] ING City13. Le sable s’amoncelle le long du Boulevard Hun Sen, en attendant de permettre d’aplanir le sol. En 2020, l’ONG Sahmakum Teang Tnaut (STT) écrivait à propos de ces remblais en cours :
La quantité de sable nécessaire pour remblayer les zones humides est estimée, de manière prudente, à 77 000 000m3. Ce remblai des zones humides devrait nécessiter une quantité de sable supérieure à tout autre projet dans l’histoire du Cambodge14.
L’artiste Khvay Samnang a immortalisé la présence de ces lacs en perdition dans une série de photographies intitulée « Untitled » où il se met en scène, à nu, dans les lacs, un pot rempli de sable en main, le déversant sur sa tête. Hommage à toutes ces personnes et autres qu’humains qui seront ensevelis métaphoriquement et réellement sous ces remblais. Certains citoyens utilisent donc des matériaux tels que le sable pour illustrer que le remblai inscrit le politique dans l’espace physique, alors qu’il est quasiment impossible d’engager une discussion politique à ce sujet.

ING City n’est pas un cas isolé. Ces projets de grande envergure se multiplient dans la capitale. Le schéma qui les accompagne, la plupart du temps, implique une quantité de sable qui atteint des records pour produire du foncier à partir de remblais sur des terres ou des eaux. Dès 2008, le remblai du Boeng Kak révélait l’accélération du développement urbain au détriment de l’environnement naturel et des populations vulnérables, notamment celles privées de titres fonciers15.
Les injustices spatiales et environnementales augmentent à mesure que le sable sort de son lit.
L’envergure de ces remblais en cours dans le Boeng Cheung Ek présage une issue bien pire, menaçant la sécurité de tous les habitants de la ville de Phnom Penh. Lorsque les lacs disparaissent sous ces millions de mètres cubes de sable, les agriculteurs urbains et leurs familles, en particulier, subissent en première ligne ces transformations socio-écologiques en cours qui façonnent la ville16. Le gouvernement royal contribue à la disparition de ces Boeng en procédant à l’acquisition forcée de terres, créant ainsi des opportunités pour les investisseurs privés de spéculer sur la transformation des terres agricoles en propriétés immobilières, comme l’explique Beng Huat Chua dans un contexte singapourien17. Ces opérations, dans le cas cambodgien, profitent principalement à la classe aisée. Les inégalités s’accroissent au sein de la société cambodgienne, alors qu’une classe moyenne émergente donne l’illusion d’une redistribution de la richesse. Les injustices spatiales et environnementales augmentent à mesure que le sable sort de son lit.
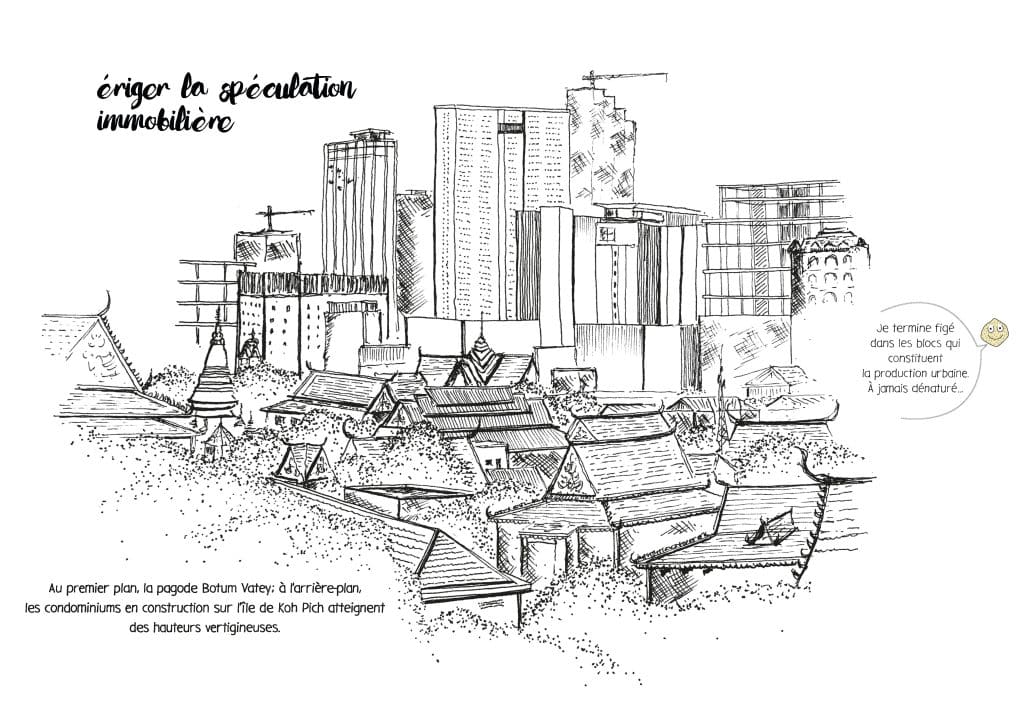
Koh Norea : un tas de sable qui vaut de l’or
À l’instar de Singapour et de Dubaï, la capitale cambodgienne poldérise pour créer de la valeur foncière. Si les deux premières capitales s’appuient largement sur le sable marin dans leur expansion urbaine, Phnom Penh mobilise le sable de rivière. (…)
[En] 2020, les remblais gigantesques pour la création de l’île de Koh Norea débutent. Le développeur de ce projet, l’Overseas Cambodian Investment Corporation Ltd (OCIC18), qui développe également le nouvel aéroport au sud de la ville, estime qu’il faudrait environ 60 millions de m3 de remblais (ici de sable) pour façonner cette île de 125 hectares19. Les remblais se sont étalés sur 2020 et 2021 selon les images satellites Google Maps. (…)
Koh Norea ou le ballet des camions [extrait du carnet de terrain de l’autrice]
« Après une bonne demi-heure de vélo portée par un vent fort, j’atteins le site de Koh Norea localisé à Chbar Ampov. Je trouve le site idéal : un terrain vague, fraîchement remblayé avec une vue imprenable sur le chantier du projet Koh Norea.
8h21 : en position d’affût, je guette les va-et-vient de quatre camions de 20 m3 qui se trouvent à 200 ou 300 mètres. Je chronomètre leur temps de chargement et à vue d’œil tente de suivre leurs trajectoires. Ces quatre camions se relayent sans interruption auprès de la pelle mécanique hydraulique, stationnée près d’un tuyau qui crache ce mélange de sable et d’eau : telle une chaîne de production où, à la ligne, des gestes répétitifs socio-matériels s’instaurent. L’un des camions (jaune orangé), que j’identifierai comme le 1er camion, vient d’être chargé et part. Il est aussitôt remplacé par un deuxième camion à 8h23. Le 1er camion ne roulera que quelques centaines de mètres avant de décharger sa cargaison près des pieux, nouvellement mis en place au sud du projet Koh Norea. Dans cette scène, plusieurs actants entrent en jeu : les tuyaux, les pelleteuses, les camions et les bulldozers (pour tasser et niveler).
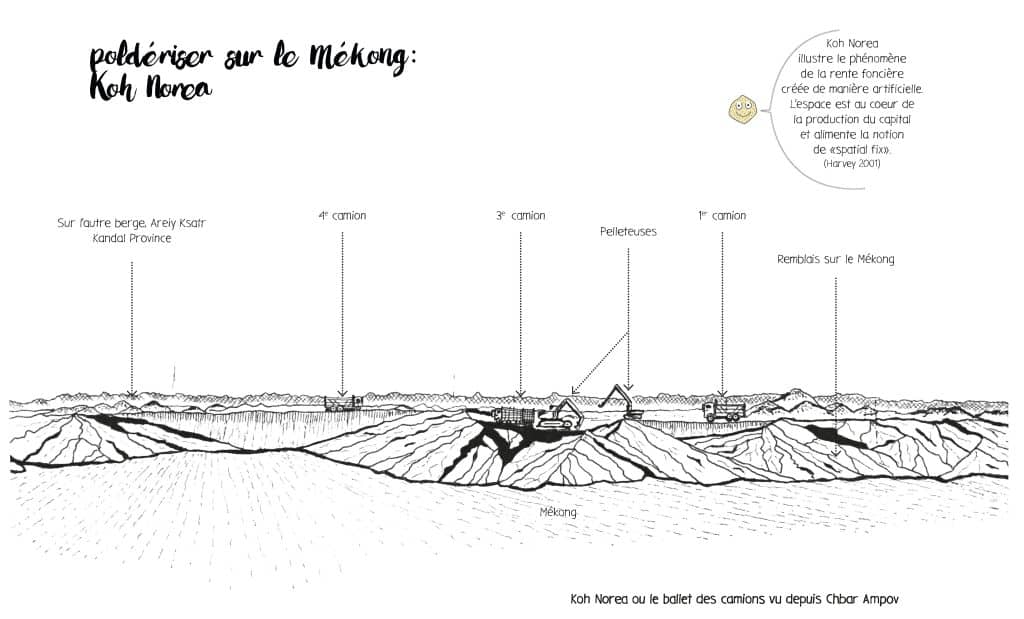
8h27 : fin du chargement du 2e camion qui part en direction du nord du site du projet Koh Norea, contrairement au 1er camion observé.
8h30 : le 3e camion, plus facilement identifiable car il est de couleur blanche, se met en place et le chargement commence.
8h35, fin du chargement, il partira au même endroit que le 1er camion y déposer le sable au niveau des pieux qui permettent de stabiliser la future berge. Dans le même temps, un camion-citerne rempli d’eau humidifie le chemin emprunté par ces camions pour faciliter la tenue de la « route » et éviter la poussière. Le 1er camion est de retour à la « base » lorsque le 4e camion patiente que le chargement de sable se termine. À ce moment, les seuls bruits environnants proviennent des sons émis par les moteurs de ces différents engins et d’un frappement régulier perceptible au loin.
3 minutes et 27 secondes, c’est le temps nécessaire à la pelleteuse pour remplir la remorque du 4e camion-benne. Je remarque alors un pêcheur sur le filet d’eau du Mékong conservé entre la berge où je suis et le remblai de Koh Norea. Ce dernier dans l’eau, torse nu, équipé d’une bouée, nage et tire son filet de manière répétitive. Une scène surréaliste que d’observer ce pêcheur, seul, qui paraît minuscule au milieu de ces monstres remblais…

Puis, je distingue au-dessus de ma tête le vol d’un drone. Une personne fraîchement arrivée sur le terrain vague où je me trouve pilote ce petit engin. Je patiente 15/20minutes et m’assure que le drone revienne pour entamer la discussion. Ce trentenaire travaille pour le Groupe B.I.C20. Il explique que le drone sert à prendre des photos et vidéos pour son entreprise afin de faire du repérage. Les terrains où nous nous trouvons appartiennent au groupe B.I.C et un développement immobilier se profile sur ses emprises. Il ajoute que les terrains où nous sommes étaient à l’origine un dépôt de sable, qui permettait de dispatcher les différents amas dans le quartier pour les futurs projets ; ces terrains étaient loués par B.I.C. Puis, j’oriente la conversation au sujet de Koh Norea, sur les extractions de sable et les coûts associés. Il me précise alors en souriant que « rien n’est trop cher pour eux [NDLA : en parlant des millions de mètres cubes de sable indispensable aux remblais], nous les appelons les millionnaires au Cambodge ».21
(…) Koh Norea illustre particulièrement la production capitaliste de la ville et le processus de financiarisation associé qui s’implantent aux quatre coins du monde, devenant de plus en plus marquants dans des villes qui étaient jusqu’alors considérées en « marge » de ce processus22. Koh Norea et plus largement Phnom Penh avec ses marchés résidentiels s’insèrent ainsi dans ce que Gabriel Fauveaud décrit comme étant « l’évolution plus globale de la géopolitique de l’immobilier en Asie du Sud-Est et de sa financiarisation »23. Cette financiarisation se met en œuvre grâce notamment à la « mise au travail du sable ».
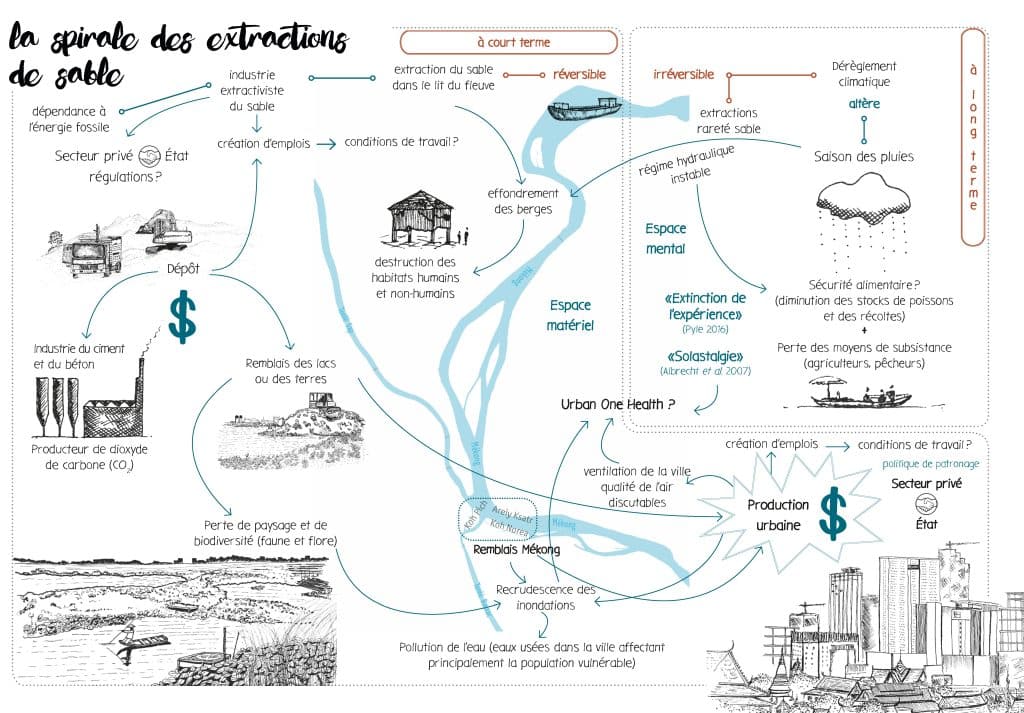
Ainsi, ce que je nomme la production urbaine néolibérale granulaire pourrait se concevoir sous deux aspects.
D’un côté, elle interrogerait dans quelle mesure le faible coût des grains de sable contribue à davantage de financiarisation, c’est-à-dire comment le sable, en tant que ressource naturelle, par son processus de vie hors de l’eau, est transformé en un objet de spéculation et d’investissement par la matérialité de ses productions. Cela soulève des questions sur la manière dont la valeur du sable est augmentée à travers sa transformation en composante clé des infrastructures urbaines et des mégaprojets, reflétant ainsi les mécanismes du marché et les politiques de développement urbain qui favorisent cette utilisation.
Le sable extrait dans le lit du Mékong au Cambodge traverse désormais les frontières, notamment pour rejoindre la Chine.
De l’autre, le sable, ressource naturelle à la rareté annoncée, au-delà d’être un matériau de base nécessaire pour la construction et donc moteur de la croissance économique, deviendrait essentiellement spéculation sur les marchés financiers et favoriserait davantage son exportation hors du Cambodge. Cette transformation pourrait avoir d’importantes implications, notamment en termes d’exploitation accrue des ressources de sable, de modifications des politiques environnementales et de création de tensions dans les communautés locales et au niveau international. Si les observations réalisées témoignent de l’extraction en cours pour une demande locale, les sollicitations venues de l’étranger sont nombreuses et le sable extrait dans le lit du Mékong au Cambodge traverse désormais les frontières pour rejoindre la Chine notamment24. Les demandes croissantes sur le marché international pourraient intensifier la pression sur les ressources de sable au Cambodge, exacerbant ainsi les problèmes environnementaux et sociaux existants.
Image d’accueil : « Untitled », 2011. © Khvay Samnang (détail).

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
Notes
- Historiquement, la ville de Phnom Penh est connue sous le nom de « Krong Chaktomuk » (littéralement « la ville aux quatre visages ») qui fait référence au réseau hydraulique formé par le Tonlé Sap, le Bassac et le Mékong. C’est à Phnom Penh que le delta du Mékong se forme. Le fleuve, long de plus de 4000 km, se sépare en deux branches, le Bassac et le Mékong, avant de s’écouler vers le Vietnam.
- Slocomb, Margaret. 2010. An economic history of Cambodia in the twentieth century. NUS Press, p. 43
- Pierdet, Céline. 2008. « Les temporalités de la relation ville-fleuve à Phnom Penh : la fixation d’une capitale fluviale par la construction d’un système hydraulique (1865-2005) », thèse de doctorat, Université Paris 1, p. 18.
- Pierdet, Céline, op. cit., p. 341.
- APUR. 1997. Phnom Penh, développement urbain et patrimoine, p. 37.
- Stetten, Guillaume. 1997. « La ville et l’eau ». Dans Phnom Penh, développement urbain et patrimoine, APUR. Paris, p. 20.
- Un, Kheang. 2005. « Patronage politics and hybrid democracy : Political change in Cambodia, 1993-2003 ». Asian Perspective n°29 (2) : pp. 203–230 ; Hughes, Caroline. 2006. « The Politics of Gifts : Tradition and Regimentation in Contemporary Cambodia ». Journal of Southeast Asian Studies, pp. 469–489.
- Un, Kheang. 2005. « Patronage politics and hybrid democracy : Political change in Cambodia, 1993-2003 ». Asian Perspective n°29 (2) : pp. 203–230.
- Brenner, Neil, et Christian Schmid. 2014. Implosions/explosions. Towards a study of planetary urbanization. Berlin, Germany : Jovis.
- Phnom Penh, le 7 avril 2021.
- Le Boeng est une dépression formant un lac ou un étang vaste. Il est alimenté par des canaux naturels ou artificiels durant la saison des pluies et sert éventuellement de réserve d’eau pour les cultures durant la saison sèche (APUR 2019 : 19). Un prek est un bras d’eau naturel ou artificiel sans source qui met en relation, à la saison des pluies, le fleuve, les étangs et les lacs. Il est alimenté par la crue du fleuve et le ruissellement des eaux de pluies » (APUR 2019: 19).
- Phnom Penh, le 30 juin 2022.
- En2019, l’Atelier parisien d’urbanisme a rédigé un ouvrage intitulé Phnom Penh extension et mutations qui couvre les enjeux de planification attenants à ce projet et aux risques associés de voir disparaître ces lacs indispensables à la gestion des eaux pluviales.
- LICADHO et al. 2020 : 3.
- Schneider, Helmut. 2011. The Conflict for Boeng Kak Lake in Phnom Penh, Cambodia. n°7.
- Beckwith, Laura. 2020. « When Lakes Are Gone : The Political Ecology of Urban Resilience in Phnom Penh », thèse de doctorat, Ottawa, Université d’Ottawa.
- Chua, Beng Huat. 2011. « Singapore as Model : Planning Innovations, Knowledge Experts ». In Worlding Cities, édité par Ananya Roy et Aihwa Ong. Wiley-Blackwell.
- L’OCIC est une filiale de la Canadia Bank, l’une des plus importantes banques privées du pays. Son fondateur et actuel dirigeant, Neak Oknha Dr. Pung Kheav Se, est considéré comme l’un des plus riches et influents magnats économiques du pays, très proche de l’ancien premier Ministre Hun Sen. Il se démarque notamment dans le développement de mégaprojets immobiliers à l’exemple de Koh Pich ou actuellement de Koh Norea.
- Haffner, Andrew et Mech Dara : « Island of the Rich : As Sand Dune Rises, Old Neighborhood Upturned », VOD (blog), 10 novembre 2021.].
- Le promoteur B.I.C. Group, qui est présidé par Yim Leak, fils du député Yim Chhay Ly est un beau-frère du plus jeune fils de Hun Sen, Hun Many. B.I.C propose également des services bancaires (Haffner et Dara 2021).
- Phnom Penh, le 18 mars 2021.
- Shatkin, Gavin (1998) : « “Fourth World” Cities in the Global Economy : The Case of Phnom Penh, Cambodia », International Journal of Urban and Regional Research, no 22(3), pp. 378‑393.
- Fauveaud, Gabriel (2020) : « Les nouvelles géopolitiques de l’immobilier en Asie du Sud-Est : financiarisation et internationalisation des marches immobiliers a Phnom Penh, Cambodge », Hérodote, no 176(1), pp. 169‑184.
- Notes de terrain de l’autrice, 7 novembre 2023.
L’article Le fleuve mangé par son lit : l’extractivisme du sable au Cambodge est apparu en premier sur Terrestres.
12.09.2025 à 15:30
Élisée Reclus, l’Anthropocène avant l’heure
Dès 1860, alors que le carbone n’a pas encore envahi l’atmosphère et que le plastique n’existe pas, le géographe et militant anarchiste Élisée Reclus décrit les humains comme des agents géologiques qui modifient le climat. Tout au long de son œuvre monumentale, il parvient à rendre le monde plus familier tout en déployant l’idée d’une condition terrestre.
L’article Élisée Reclus, l’Anthropocène avant l’heure est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (4358 mots)
Ce texte est un extrait du livre « Élisée Reclus & la solidarité terrestre », de Roméo Bondon, qui vient de paraître dans la collection « Précurseurs de la décroissance » des éditions du Passager clandestin.
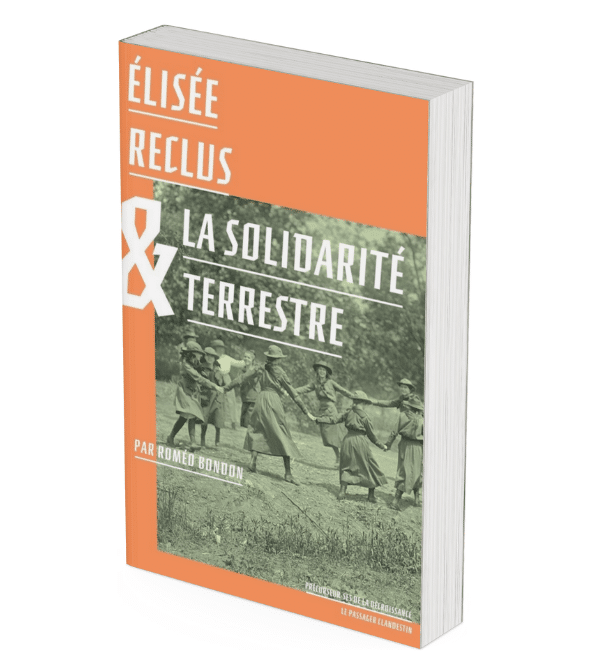
Interagir avec la Terre
Au moment de saluer son ami et camarade, mort quelques jours plus tôt, Pierre Kropotkine a ces mots pénétrants : c’était « l’un de ceux qui avaient le mieux senti et vécu la liaison qui rattache l’homme à la Terre entière, ainsi qu’au coin du globe où il lutte et jouit de la vie1 ». Tout est dit. Des premiers articles publiés dans la Revue des Deux Mondes jusqu’à L’Homme et la Terre, en passant par La Terre et les dix-neuf volumes de la Nouvelle géographie universelle, Élisée Reclus n’aura de cesse de répéter, préciser, démontrer que les actions humaines sur la planète ne sont pas sans effets et, dès lors, qu’elles impliquent des responsabilités2.
Dans un article publié en 1864 à propos de Man and Nature, un ouvrage du diplomate américain et tenant de la préservation de la nature George Perkins Marsh3, Reclus note que les humains, « devenus, par la force de l’association, de véritables agents géologiques, […] ont transformé de diverses manières la surface des continents, changé l’économie des eaux courantes, modifié les climats eux-mêmes4 ». Inaugurant une conception dialectique du progrès n’allant jamais sans sa part de « régrès » qu’il conservera jusque dans ses derniers textes5, il détaille à partir de plusieurs exemples la diversité des modalités que recoupe l’action humaine sur la nature. « D’un côté elle détruit, de l’autre elle détériore » suivant l’état social et les progrès de chaque peuple, elle contribue tantôt à dégrader la nature, tantôt à l’embellir6 ». Et d’ajouter que, devenue « conscience de la terre », l’humanité se civilise à mesure qu’elle comprend que « son intérêt propre se confond avec l’intérêt de tous et celui de la nature elle-même7 ».
Difficile de ne pas penser à la notion désormais bien connue d’anthropocène pour décrire cette ère dans laquelle nous serions désormais entrés :
Sans qu’il soit nécessaire d’admettre un changement d’axe et la variation des latitudes terrestres, on peut affirmer que l’époque actuelle, comme les époques antérieures, offre aussi, dans ses climats, toute une série de changements successifs, et déjà l’histoire nous prouve que, dans ces modifications si importantes du régime de notre globe, les travaux de l’humanité entrent pour une très large part8.
Évidemment, il ne s’agit pas pour Reclus de trouver le « clou d’or » datant précisément le début de cette nouvelle période géologique. Le carbone contenu dans l’atmosphère commence tout juste à augmenter sous les coups d’une industrialisation féroce, tandis que le plastique, qui est la marque de notre temps, n’est pas encore connu. Néanmoins, sa conscience des effets planétaires produits par des modifications localisées qui s’ajoutent les unes aux autres a de quoi nous interpeller.
Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Enquêter, s’émerveiller et se révolter avec Élisée Reclus » de Roméo Bondon, septembre 2023.
Miroir de cette conception originale, Reclus n’hésite pas à conférer aux éléments ou à des milieux naturels une personnalité, voire une capacité d’action. Ainsi, sous sa plume, les montagnes sont « des êtres doués de vie9 » qui se révèlent composés d’« individus géographiques modifiant de mille manières les climats et tous les phénomènes vitaux des régions environnantes par le seul fait de leur position au milieu des plaines10 ». Dès lors, c’est bel et bien « l’action combinée de la Nature et de l’Homme lui-même, réagissant sur la Terre qui l’a formé11 », qu’il s’agit de décrire sur toutes les parties du monde et dans le moindre des phénomènes observés.

Rendre le monde plus familier
Les deux Histoires, d’un ruisseau et d’une montagne, publiées respectivement en 1869 et en 1880, sont peut-être ses textes qui illustrent le mieux cette démarche. Ils font ainsi écho à sa conviction selon laquelle « la science doit être une chose vivante12 ». Les deux récits paraissent aux éditions Hetzel, qui publient également Jules Verne, dans une collection intitulée « Bibliothèque d’éducation et de récréation », ce qui donne une bonne indication de la teneur des ouvrages : deux promenades informées, l’une au sein d’un bassin hydrographique, de la source à l’océan, l’autre dans un massif montagneux, auprès des animaux et des humains qui le peuplent. Au moment où il commence à travailler sur ce second opus, Élisée confie son intention à son éditeur, mais aussi ses doutes : « Mon livre est à la fois science et poésie, mais il vaudrait mieux qu’il fût l’un ou l’autre ; je crains bien que le genre lui-même ne soit faux13. » C’est pourtant bien ce mélange qui a assuré aux deux Histoires une postérité que n’ont pas démentie les plus récentes rééditions, ce à quoi il faut ajouter un engagement de l’auteur dans son texte, n’hésitant pas à mobiliser son expérience, à convoquer les sens des lecteurs et des lectrices, à conclure, comme toujours, sur un horizon émancipateur, celui d’une fraternité universelle14.
Aussi, quelle que soit l’échelle à laquelle il se situe et qu’importe le pas de temps considéré, Élisée Reclus tente de saisir les phénomènes terrestres avec une certaine familiarité. En cela, les évolutions de l’époque en matière de transport l’y ont sans doute aidé. Comme il l’écrit en ouverture d’un article publié en 1866,
[Il] se manifeste depuis quelque temps une véritable ferveur dans les sentiments d’amour qui rattachent les hommes d’art et de science à la nature. Les voyageurs se répandent en essaims dans toutes les contrées d’un accès facile, remarquables par la beauté de leurs sites ou le charme de leur climat9.
Le monde, nous dit Reclus, subit une forme d’amoindrissement à mesure que les voies de communication se multiplient. Son usage n’en est devenu que plus accessible et son usure, diraient aujourd’hui certains critiques du tourisme, que plus rapide15.
Dans le dernier tome de la Nouvelle géographie universelle, Élisée adopte un regard rétrospectif sur les évolutions dont il a été le contemporain durant les vingt années qu’ont nécessitées la fabrication et la publication exhaustive de son grand-œuvre : « Partout, le réseau des voyages couvre la planète comme un filet aux mailles rétrécies. […] Chaque année, se raccourcit la durée du tour du monde, devenu maintenant pour quelques blasés une fantaisie banale16. »

Sa longue et continue pratique de la Terre l’a évidemment rendu sensible aux façons de la représenter17. Il fait un usage abondant de la cartographie et a pu s’appuyer pour cela sur les compétences de l’anarchiste suisse Charles Perron18. Ensemble, ils développent des cartes non seulement de localisation, mais également économiques, statistiques et géopolitiques, ce qui constitue une véritable nouveauté pour l’époque.
Mais ça n’est pas tout. La tentative la plus originale, sans doute, pour « dépouiller l’État du monopole de la production des images du monde19 » a été le projet de construction de globe terrestre pour l’Exposition universelle de 1900, qui s’est tenue à Paris. Son but, alors : « Faire entrer la géographie dans la cité20. » Il partage des préoccupations pédagogiques avec l’ensemble du milieu anarchiste, ainsi qu’avec l’urbaniste écossais Patrick Geddes, qui travaille avec le neveu d’Élisée, Paul Reclus, ce « constructeur de globes, de reliefs et de dispositifs de représentation du monde les plus divers21 », à produire une représentation à échelle réduite de la surface terrestre de l’Écosse.
La planète, cette « grande patrie », est donc pour Élisée un lieu familier, aussi bien parce qu’il en connaît de nombreuses régions que parce qu’il tente, à défaut, par l’imagination et la connaissance, de se situer parmi les sociétés qu’il évoque, pleinement imprégné par les paysages qu’il décrit, en se plaçant « du point de vue de la solidarité humaine22 ».
Enfin, la description de la Terre, cet « ensemble merveilleux de rythme et de beauté23 », ne serait pas complète sans accorder une place de choix aux autres animaux – en un mot, à tout ce qui vit. Cette inclusion, assez banale pour les végétaux à une époque où la géographie botanique prend son essor, l’est beaucoup moins pour la faune, sauvage et domestique, qui est abordée dans chaque tome de la Nouvelle géographie universelle et devient un thème et une préoccupation à part dans les derniers textes d’Élisée Reclus. La mention de tel ou tel animal se double à la fin de sa vie d’une valorisation de la coopération interspécifique, notamment dans « La grande famille24 », ou de prises de position éthiques, comme dans « À propos du végétarisme25 ».
À écouter, un épisode des Sons Terrestres : « Histoire d’un ruisseau, d’Élisée Reclus », des extraits lus par la compagnie Le rouge et le vert, 2021.
Image d’ouverture : Photographie Jean Reutlinger, vers 1907-1914, Wikimedia.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
Notes
- Pierre Kropotkine, « Élisée Reclus », Les Temps nouveaux, 15 juillet 1905.
- C’est ce dont témoigne, entre autres textes, ceux réunis dans Libre nature (op. cit.), une anthologie à laquelle le livre « Élisée Reclus et la solidarité terrestre » doit beaucoup.
- Philippe Pelletier, « Élisée Reclus et George Perkins Marsh, convergence et rupture », Annales de géographie, vol. 732, no 2, 2020, p. 104-127.
- « De l’action humaine sur la géographie physique », Revue des Deux Mondes, vol. 54, 1864, repris dans Libre nature, op. cit., p. 49. Voir, dans la partie « Textes choisis », l’extrait 3 de « La libre nature ».
- Voir, dans la partie « Textes choisis », les extraits de « Cause animale et progrès social ».
- « De l’action humaine sur la géographie physique », art. cit., p. 50.
- Ibid.
- La Terre. Description des phénomènes de la vie du globe, t. II, Hachette, 1868-1869, p. 502.
- Du sentiment de la nature…, op. cit.
- La Terre, t. I, op. cit., p. 157.
- « Préface », dans L’Homme et la Terre, t. I, Librairie universelle, 1905-1908, p. II.
- « Lettre à M. de Gerandol », 11 janvier 1877, dans Correspondance, t. II, op. cit., p. 182.
- « Lettre à P.-J. Hetzel », 26 juin 1872, citée dans Federico Ferretti, Élisée Reclus. Pour une géographie nouvelle, éditions du CTHS, 2014, p. 90.
- Benoît Bodlet, Les histoires d’Élisée Reclus. Divulgation scientifique et émancipation, Presses universitaires de Lyon, 2024.
- Rodolphe Christin, L’usure du monde. Critique de la déraison touristique, L’échappée, 2014.
- « Dernier mot », dans Nouvelle géographie universelle. Tome XIX. L’Amérique du Sud : l’Amazonie et la Plata, Hachette, 1894, repris dans Libre nature, Héros-Limite, 2022, p. 137.
- Écrits cartographiques, Héros-Limite, 2016.
- Federico Ferretti, « Charles Perron et la juste représentation du monde », visionscarto.net, 5 février 2010.
- Federico Ferretti, « Globes, savoir situé et éducation à la beauté : Patrick Geddes géographe et sa relation avec les Reclus », Annales de géographie, vol. 706, no 6, 2015, p. 687.
- Soizic Alavoine-Muller, « Un globe terrestre pour l’Exposition universelle de 1900. L’utopie géographique d’Élisée Reclus », L’Espace géographique, vol. 32, no 2, 2003, p. 156-170.
- Federico Ferretti, « Globes, savoir situé et éducation à la beauté », art. cit., p. 686.
- « Dernier mot », op. cit., p. 137.
- Ibid., p. 139.
- Voir l’extrait 2 de « Cause animale et progrès social » dans la partie « Textes choisis » du livre « Élisée Reclus & la solidarité terrestre ».
- Voir l’extrait 1 de « Cause animale et progrès social » dans la partie « Textes choisis » du livre « Élisée Reclus & la solidarité terrestre ».
L’article Élisée Reclus, l’Anthropocène avant l’heure est apparu en premier sur Terrestres.
03.09.2025 à 11:58
Pour une écologie de la libération : antiracisme et écologie politique
Alors que la possibilité du fascisme prend corps à grande vitesse, il ne s’agit plus de convaincre, mais d’organiser le camp de l’émancipation, observe Fatima Ouassak dans ce texte incisif, qui ouvre le livre collectif « Terres et liberté ». Elle appelle à assumer la radicalité et à construire un front commun écologiste et antiraciste : l’écologie de la libération.
L’article Pour une écologie de la libération : antiracisme et écologie politique est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (4563 mots)
Ce texte est l’introduction par Fatima Ouassak du livre collectif qu’elle a coordonné : Terres et Liberté. Manifeste antiraciste pour une écologie de la libération, paru en mai 2025 aux éditions Les Liens qui Libèrent. L’ouvrage est la première parution de la collection « Écologies de la libération », que dirige Fatima Ouassak.
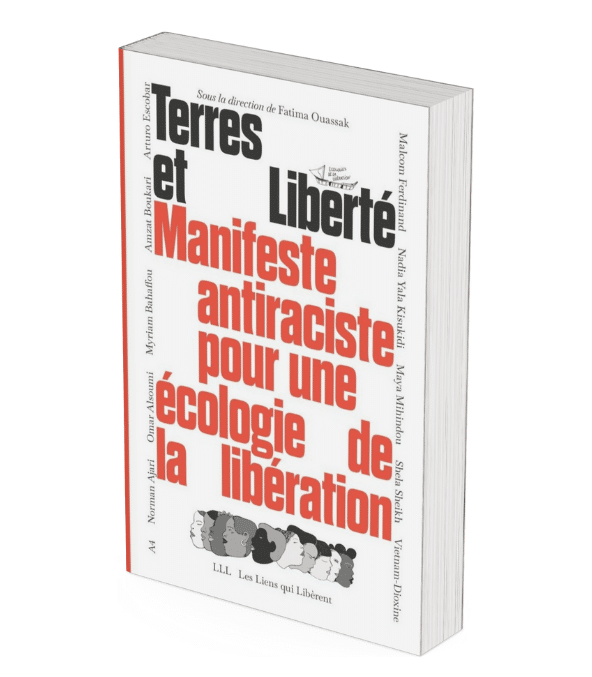
« Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir, ou la trahir. »
Frantz Fanon, Les Damnés de la terre, 1961
Nous vivons à l’aube d’un basculement historique en Occident. Mille bruits de fond le laissent entendre : l’idée même de changement structurel — vers plus de justice — rendu nécessaire par l’urgence climatique est abandonnée par les grandes puissances mondiales, et le fascisme allié au néolibéralisme gagne partout du terrain. L’horizon s’obscurcit d’une possible gestion fasciste de l’urgence climatique : plus question de partager l’eau, l’air, la terre, la possibilité de vivre bien, de vivre tout court, avec celleux décrété·es indignes d’appartenir à l’humanité. Cette possibilité du fascisme prend corps — l’air de rien — très vite.
Dans le même temps — pour partie en réaction — grandit dans le camp de l’émancipation une exigence radicale de justice : la domination des un·es sur les autres n’est plus supportable. Cette exigence est le fruit d’une prise de conscience collective : celle de militant·es, d’intellectuel·les, de syndicalistes, de paysan·nes, d’avocat·tes, d’artistes, d’éditeur·ices, de journalistes engagé·es qui partagent l’ambition de construire un front commun contre ce qui ravage le monde.
En France, ce souffle radical pointe son nez aux portes de l’écologie politique. Le terrain est favorable : depuis une dizaine d’années se tisse un début d’alliance entre luttes écologistes et antiracistes, et on voit arriver une production théorique d’une écologie décoloniale. Un travail qui s’est ancré dans des luttes locales pour les soutenir et s’en inspirer, et qui a mené, en 2020, à un mot d’ordre partagé entre écologistes et antiracistes : « On veut respirer ! ».
La question est stratégique. La lutte continue, nous sommes d’accord. Mais avec qui ? Pour quoi faire ? S’agit-il de monter en radicalité dans une course contre la montre face au grand capital acoquiné avec l’extrême droite et d’adopter une stratégie révolutionnaire ? S’agit-il au contraire d’arrondir les angles pour freiner le train qui risque de tous·tes nous précipiter dans le ravin et de se ranger derrière une stratégie de repli ? Foncer et faire feu de tout bois ? Ou se terrer et se protéger des vents mauvais ? Nous considérons ici qu’il faut en écologie, comme en tout, résister corps et âme au fascisme. Face aux possibles basculements mortifères, nous n’avons plus le temps de prendre des pincettes en faisant le dos rond.
Va donc pour la course contre la montre et le feu
Partant de là, remplir notre mission, c’est assumer notre radicalité, la revendiquer. Cela risque de provoquer des controverses ? Tant mieux, vive la controverse ! Cela risque de cliver ? Encore heureux : il ne s’agit pas de convaincre les partisan·nes de la suprématie blanche de rejoindre le camp de l’émancipation. Il s’agit d’organiser le camp de l’émancipation, où nous sommes suffisamment nombreux·ses, et de construire des maquis — physiques, intellectuels et culturels. Remplir notre mission, c’est, malgré les critiques que nous pouvons lui adresser, ne pas rompre avec le champ de l’écologie. Le rapport critique à l’écologie ne doit pas viser à nous en débarrasser, mais au contraire à nous l’approprier. Répondre à notre mission, c’est aussi, dans un contexte d’extrême-droitisation des champs politique et médiatique, refuser de mettre la question raciale sous le tapis. Alors que l’antiracisme est diabolisé et que la défense de la liberté de circuler est taxée de haute trahison, du courage, il en faut. Mais personne n’a dit que notre mission était facile.
Depuis, nous sommes nombreux·ses à avoir découvert la mission de notre génération : travailler à un projet écologiste où l’égale dignité humaine est à la fois le centre et l’horizon. Reste à savoir si nous nous apprêtons à la remplir ou à la trahir. Voilà très précisément où nous en sommes aujourd’hui.
Il s’agit d’analyser précisément la singularité coloniale, islamophobe et anti-migrant·es du fascisme qui se répand aujourd’hui en Europe. Et comprendre que tout se tient : ce qui ravage la Terre ravage les populations non blanches, ce qui ravage les populations non blanches ravage la Terre.
Terres et Liberté est le premier point de ralliement que nous proposons, entre écologie et antiracisme. À l’heure où, en France, la terre se soulève aussi bien pour empêcher l’accaparement de l’eau au profit de quelques-un·es que pour dénoncer le meurtre d’un adolescent tué par la police, à l’heure où ce qui agite en silence les populations non blanches concerne l’enterrement des parents, quelle est la terre où reposer en paix ? Ici ou là-bas ? C’est une question derrière laquelle se cachent mille autres. Quelle est la terre où se reposer et vivre en paix ? Celle où faire grandir ses enfants ? Ces questionnements sont à la fois singuliers et universels. La terre ne concerne pas seulement les conditions de subsistance. Elle est aussi affaire de dignité car la libération de la terre est une condition à l’émancipation de celleux qui l’habitent.
C’est précisément cet enjeu que nous cherchons ici à explorer. Terres au pluriel car toutes ne se valent pas : elles sont souvent traitées comme le sont leurs habitant·es. Et Liberté au singulier pour rappeler que personne n’est libre si tout le monde ne l’est pas. Premier ouvrage de la collection « Écologies de la libération », Terres et Liberté vise à introduire les principaux enjeux, sujets de débat, champs d’action et luttes menées, dans une perspective croisée écologiste et antiraciste.
Une conviction nous anime : si nous y travaillons sérieusement, l’antiracisme peut devenir le nouveau souffle de l’écologie politique, et l’enrichir de joies militantes, de savoirs académiques, d’espérance, et d’une histoire pleine de détermination à vivre libres.
Terres au pluriel car toutes ne se valent pas : elles sont souvent traitées comme le sont leurs habitant·es. Et Liberté au singulier pour rappeler que personne n’est libre si tout le monde ne l’est pas.
Le maquis où il est désormais possible de verser dans un pot commun les héritages antiracistes et les héritages écologistes, c’est l’écologie de la libération. La pensée de Frantz Fanon, celle de Maria Lugones, la vision politique d’Abdelkrim El Khattabi, celle de Thomas Sankara, la libération de l’Algérie malgré cent trente-deux ans de destruction, la lutte pour protéger la terre guyanaise, la résistance en Kanaky, la résilience en Palestine… forment ce maquis où l’on peut résister pour contrer « l’écologie des frontières » mobilisée par les dirigeant·es d’extrême droite. Et où renouveler nos imaginaires, préciser nos horizons idéologiques, dans le détail. Qu’entendons-nous exactement par « racisme environnemental », « écocide », « extractivisme », « effondrement » et « fin du monde », « habiter colonial », « réparation », « justice climatique », « éthique du soin », « rhizome », « libération animale », « ancrage territorial »… ? Autant de définitions nécessaires pour déployer des outils d’émancipation.
L’écologie de la libération, c’est notre réponse à l’urgence que constituent les conséquences du dérèglement climatique et la montée en puissance des fascismes alliés au néolibéralisme en France et en Europe. C’est l’ensemble des grilles d’analyse, projets politiques et mouvements sociaux qui visent à libérer les animaux humains et non humains d’un système d’exploitation et de domination : les grilles d’analyse permettent de comprendre les ravages écologiques sur les êtres et les terres produits par la combinaison de systèmes d’oppression patriarcale, capitaliste et coloniale ; les projets politiques ouvrent des horizons écologistes à la fois anticapitalistes et anticolonialistes ; les mouvements sociaux se composent de collectifs d’habitant·es, d’associations culturelles, de tiers-lieux, d’entreprises, de syndicats, qui luttent contre le système responsable du dérèglement climatique et ses conséquences, avec au centre, les enjeux d’égale dignité humaine. Tout notre travail ici consiste à donner de la voix et du coffre à cette écologie de la libération. Se saisir des impensés et des angles morts de l’écologie politique — suprématie blanche et occidentale, rapports de domination coloniale et racisme environnemental entre autres — pour développer de nouveaux outils critiques. Une manière d’ouvrir un véritable espace antiraciste, et de participer ainsi aux ruptures et au renouvellement nécessaires dans l’écologie, en France et en Europe. La mission de notre génération est de travailler à un front commun écologiste, radicalement antiraciste. Travaillons-y vite, partout, nombreux·ses.
Image d’accueil : « Bush Babies » de Njideka Akunyili Crosby, 2017. Wikiart.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
L’article Pour une écologie de la libération : antiracisme et écologie politique est apparu en premier sur Terrestres.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Time [Fr]
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- L'Autre Quotidien
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- Gauche.Media
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
