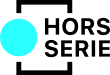08.01.2026 à 16:25
Du militarisme à gauche. Réponse à Usul et à Romain Huët
Texte intégral (8944 mots)
Le réarmement serait-il la solution miracle ? Dans un contexte de crise de surproduction du capitalisme, de baisse tendancielle du taux de profit et de tensions grandissantes pour l’accès aux ressources, la stratégie belliciste peut sembler un moyen de relancer la croissance autant qu’une manière de se préparer aux prochains conflits. En Ukraine, la Russie tente d’annexer les territoires conquis et d’organiser un changement de régime. Les pays membres de l’OTAN, concurrents les uns des autres, y visent l’exploitation des ressources agricoles et minières ainsi que l’obtention des chantiers de reconstruction dans le cadre d’un traité de paix. Si les tensions entre la France et la Russie sont aussi fortes, c’est autant du fait de l’occupation d’une partie de l’Ukraine par la Russie et de ses menaces envers les pays baltes que de la concurrence que l’impérialisme russe entend imposer aux pratiques néo-coloniales de la France en Afrique.
Dans les médias dominants, les mobilisations populaires qui ont entraîné la perte des positions économiques de la France et le départ de son armée du Sahel sont souvent résumées à « l’arrivée au pouvoir de juntes pro-russes ». À l’inverse, Donald Trump se montre pressé de conclure la paix avec Vladimir Poutine et de voir renforcée la participation des puissances européennes à l’OTAN. Cette politique vise, dit-on, à mieux préparer un affrontement avec la Chine. Aujourd’hui, le réarmement de tous côtés et la recomposition du monde en blocs pourraient entraîner la planète dans une guerre généralisée.
Pour Usul, la défense européenne au service de la démocratie
Pour certains, y compris à gauche, la production massive d’armes, le retour du service militaire en France et le rétablissement « d’un lien entre l’armée et la nation » s’expliqueraient principalement par la nécessité de se défendre face à ceux, soutiens de Trump et Poutine, qui cherchent à faire triompher le fascisme dans une Europe décrite comme « le dernier foyer des démocraties libérales ». Ces propos étaient tenus fin novembre puis courant décembre sur le plateau de Backseat1, par Usul, qui assumait envisager la possibilité d’«une confrontation militaire pour la survie de notre modèle démocratique ». En décrivant une Europe guidée par la défense de la démocratie dont il faudrait soutenir la guerre contre la Russie au nom du progressisme, Usul a laissé pantoises un grand nombre des personnes qui d’ordinaire apprécient ses analyses. Certes, comme Usul et son acolyte Lumi l’ont démontré dans un numéro de Rhinocéros2, les réseaux de l’État russe aident leurs alliés d’extrême-droite en Europe via leurs relais médiatiques et diverses manœuvres de déstabilisation. Pour autant, s’ils manifestent un mouvement de fond au sein de la gauche, ces propos décrivant le retour du service militaire comme un rempart au fascisme peuvent, au premier abord, sembler étonnants de la part d’une personnalité qui se revendique marxiste, et documente avec une grande vigueur critique depuis de nombreuses années le durcissement autoritaire du capitalisme libéral, notamment dans sa forme macroniste.
Si certaines organisations européennes d’extrême-droite sont en effet appuyées par le pouvoir russe, elles sont aussi soutenues, dans un contexte de crise du capitalisme et de montée des tentations autoritaires, par une partie du patronat de leur propre pays. En France, en plus du soutien de Vincent Bolloré et de Pierre-Édouard Stérin, l’extrême-droite bénéficie désormais de l’oreille attentive du Medef et de la complaisance des médias dominants. Peu après la réélection de Donald Trump, Bernard Arnault, de retour des États-Unis, louait le soutien aux entreprises dont il disait avoir été témoin3. Des enquêtes journalistiques ont documenté les pressions sur les candidats macronistes lors des dernières élections législatives, le président de la République demandant de ne pas se désister au bénéfice des Insoumis face à un Rassemblement National proche du pouvoir4. Comme l’écrivait en 1915 le révolutionnaire allemand Karl Liebnecht dans un tract qui lui valut d’être exclu du parti social-démocrate et incarcéré du fait de son antimilitarisme, « L’ennemi principal de chaque peuple est dans son propre pays »5.
Quelle démocratie européenne ?
Du fait de l’impérialisme russe, de la montée du fascisme aux États-Unis et des rivalités avec la Chine, Usul appelle à renforcer « la solidarité européenne » et accepte qu’elle puisse « prendre des formes qu’on ne va pas aimer ». La dichotomie présente dans le discours d’Usul entre « solidarité européenne » et montée de l’autoritarisme ne résiste pourtant pas à l’examen des faits. L’Union Européenne et la coopération entre ses membres ne sont aucunement des garanties contre l’extrême-droite et les atteintes aux droits humains. Jusqu’alors, la solidarité européenne qu’Usul invoque comme une notion abstraite a pris la forme concrète des garde-frontières et garde-côtes de Frontex, des milliers de cadavres dans la Méditerranée et dans la Manche ou des accords de Dublin qui empêchent la libre circulation des migrants. La solidarité européenne a aussi débouché sur l’accord d’association avec Israël ou sur les accords miniers de 2024 entre l’UE et le Rwanda, prévoyant la livraison en Europe de minerais spoliés par le Rwanda en République Démocratique du Congo sur fond de génocide6.
Aussi, contrairement à ce qu’affirme Usul, le maintien relatif de principes démocratiques au sein des États occidentaux ne signifie d’aucune façon que la défense de la démocratie serait le moteur des guerres à venir. Au-delà des « valeurs » et des « principes » souvent invoqués, les opérations militaires visent généralement à défendre des positions économiques ; et les effets d’une guerre sur un système politique sont rarement positifs. Rappelons que la constitution de la Vème République, dont il est coutumier de dénoncer les pouvoirs exorbitants accordés au président, comme la possibilité de décréter l’état d’urgence ou l’état de siège, est issue d’un coup d’État militaire survenu dans le contexte de la guerre d’Algérie. En outre, un État peut, dans certaines conditions, garantir certains droits sociaux et quelques libertés démocratiques à ses citoyens tout en niant la dignité des populations hors de ses frontières ou en les surexploitant. Les Indiens affamés par Churchill, les Algériens massacrés le 8 mai 1945 et ceux torturés par la police française (surnommée la « Gestapo d’Alger ») en étaient particulièrement informés.
S’il peut être rassurant d’imaginer son État guidé par la seule défense de la démocratie, à y regarder de plus près, on observe que les accords économiques ont souvent peu à voir avec les options idéologiques des uns et des autres. Viktor Orban, soutien de Vladimir Poutine, est lui-même soutenu par l’Union européenne et l’Allemagne, dont les usines de production automobile reçoivent des pièces fabriquées en Hongrie à moindre coût. En Italie, Giorgia Meloni, proche de Donald Trump, a bénéficié de plus de 200 milliards d’euros de crédits de l’Union européenne. Les blocs géopolitiques non plus ne se superposent pas aux divisions idéologiques. Boris Johnson, ancien premier-ministre britannique favorable au Brexit et peu avare de compliments envers Donald Trump, fut, par exemple un fervent défenseur d’une aide militaire à l’armée ukrainienne. Aujourd’hui, l’Ukraine est à la fois soutenue par la majorité des gouvernements libéraux européens, par les extrêmes-droites polonaises et baltes, par Israël et, au nom de la liberté des peuples à disposer d’eux-mêmes, par une partie de l’extrême-gauche européenne. La Russie est quant à elle appuyée par la Corée du Nord, la République islamique d’Iran, des groupes néo-nazis et, au nom de l’opposition à l’OTAN, par une large part de la gauche sud-américaine, dont celle incarnée par Lula.
L’atlantisme persistant de la France
Sur le plateau de Backseat, Usul oppose le développement d’une défense européenne ou la « montée en puissance » de l’armée française au « lien transatlantique » et à un alignement sur la politique étrangère américaine. Cette analyse, formulée entre le « soutien inconditionnel » de la France à Israël, et un communiqué d’Emmanuel Macron relatif à l’attaque du Venezuela par les États-Unis dont le contenu a tellement plu à Donald Trump qu’il l’a partagé sur son propre réseau social, a de quoi laisser perplexe. Rappelons que c’est sur injonction américaine que les États européens ont accepté d’augmenter leurs budgets militaires de 2% à 5% du PIB. Au printemps dernier, dans la déclaration résumant le cadre commun négocié par la Commission européenne avec les États-Unis, on pouvait lire que « L’Union européenne prévoit d’augmenter considérablement ses achats d’équipements militaires et de défense auprès des États-Unis, avec le soutien et la facilitation du gouvernement américain »7. C’est dans ce contexte et pour défendre ses choix budgétaires que le discours relatif à la menace russe est mobilisé par le gouvernement français.
Usul décrit en outre une situation analogue « à celle de la guerre d’Espagne dans les années 30 », pour souligner la nécessité du soutien à apporter à « un régime ami, un régime qui partage un certain nombre de nos valeurs démocratiques, qui est attaqué par le modèle d’en face ». Le parallèle entre les raisons du soutien des États européens à l’armée ukrainienne et celui que le Front populaire aurait dû manifester vis-à-vis des républicains espagnols n’est pas pertinent : l’Espagne de 1936-1937 était en proie à une révolution puis à une guerre civile opposant deux camps sociaux et politiques. Une victoire des républicains espagnols aurait entraîné un affaiblissement du fascisme à l’échelle européenne et servi d’appui aux luttes ouvrières. Aujourd’hui, l’Ukraine fait face à une invasion en même temps qu’à toutes les convoitises relatives à sa position géostratégique, à ses terres rares, son agriculture et ses chantiers de reconstruction. Si l’Ukraine est défendue par la majorité des États membres de l’Union Européenne, ce n’est ni au nom de « valeurs démocratiques » communes ni d’une solidarité entre égaux, mais parce que son territoire est envisagé, en tant que périphérie européenne, comme un champ d’investissement pour le capital européen.
Pourtant, Usul, d’ordinaire attaché à l’analyse des faits matériels, n’évoque pas les intérêts en jeu en Ukraine et se borne à invoquer des « valeurs », ce qui le conduit à répéter le discours éculé qui justifie les guerres menées par l’Occident par la défense de la démocratie et de la liberté. Il légitime le retour du service militaire et le développement d’un « lien entre l’armée et la nation » par le fait que l’armée rencontre des difficultés à recruter « pour les besoins de la France ». Les « besoins » définis par l’État français ne sont à aucun moment questionnés ou même explicités dans son discours. Aussi, la nécessité que l’armée française « sécurise un traité de paix en Ukraine » qu’il reprend à son compte semble décorrellée des diverses convoitises des entreprises européennes. Quant à la présence continue de troupes en Afrique pour appuyer les dictatures qui protègent encore les intérêts du capitalisme français, il ne l’évoque tout simplement pas. La même occultation de la réalité matérielle est présente dans les prises de position récentes du sociologue Romain Huët8.
Romain Huët, réserviste de l’armée française en lutte contre l’antiaméricanisme
Ce dernier va cependant plus loin qu’Usul, tant dans sa reprise des discours atlantistes que dans la forme prise par son engagement. En effet, le maître de conférences à l’université Rennes 2 a récemment annoncé, dans une tribune publiée par Le Nouvel Obs9, avoir candidaté auprès de la réserve de l’armée de terre. Avec la publication de cette tribune, l’hebdomadaire semble renouer avec une partie de son histoire, celle du soutien aux nouveaux philosophes, qui s’exprimèrent dans ses colonnes à partir des années 1970. En effet, alors que le champ lexical auquel le sociologue a recours pour désigner l’impérialisme russe est celui de l’invasion et de la menace, les guerres d’Irak et d’Afghanistan lui inspirent uniquement le constat selon lequel « nous savons qu’il n’existe pas de « guerres propres » ». Quant à la dénonciation de l’impérialisme américain, elle est renvoyée à un « antiaméricanisme » qu’il qualifie de « stupide ». Depuis 2001, quatre millions et demi de personnes ont été tuées lors des guerres menées par les États-Unis. En 2025, les États-Unis ont bombardé sept pays. Aujourd’hui, après avoir armé et soutenu le génocide à Gaza, les États-Unis organisent la mise sous tutelle de la Palestine par le développement d’une coalition internationale à leur service. Lorsque Romain Huët faisait paraître sa tribune, Donald Trump ne cachait déjà pas sa volonté d’attaquer le Venezuela pour, selon ses propres mots, « récupérer notre (sic) pétrole » et le Groenland était déjà menacé d’invasion. Ces éléments ne sont pourtant pas mentionnés. Quant aux génocides en Palestine et au Soudan, ils sont évoqués une seule fois aux côtés de la situation ukrainienne, pour être qualifiés de « tragédies du temps », dont il regrette qu’elles « glissent devant nos yeux ».
Alors que les gouvernements occidentaux viennent de démontrer à la face du monde qu’ils peuvent s’accommoder d’un génocide s’il est commis par leur allié israélien, tandis que les jeunesses d’Afrique se soulèvent contre la présence française dans leurs pays respectifs, le sociologue préfère asséner que « Face aux nouvelles polarités du monde, le camp de l’Ouest demeure de loin le plus désirable ». Pourtant, l’alignement avec les intérêts occidentaux n’est aucunement le signe d’une adhésion à de quelconques principes qui uniraient l’Occident. Rappelons que la monarchie saoudienne est protégée par l’armée américaine en échange de l’accès au pétrole, alors que la totalité des gouvernements de gauche d’Amérique latine ont été menacés par Donald Trump dès les heures qui ont suivi l’enlèvement de Nicolas Maduro. En Amérique latine, l’élection de gouvernements favorables au « camp de l’Ouest » n’est pas seulement le fruit d’un « désir » mais aussi le résultat d’ingérences, comme en attestent les propos de Donald Trump, menaçant de suspendre les aides américaines en Argentine et au Honduras en cas de défaite de ses candidats1011.
Si Romain Huët concède que « le drame de l’influence américaine s’est logé dans nos têtes, nos formes de vie, notre culture » c’est pour mieux affirmer que « l’antiaméricanisme », en plus d’être « stupide », ignorerait cette « défaite irréversible ». Il est difficile de comprendre en quoi le fait d’être influencé par des aspects de la culture américaine rendrait caduque toute dénonciation de la vassalisation opérée par les États-Unis, et surtout, on s’étonne qu’un intellectuel qui aime se présenter comme critique et non-dupe des discours en circulation dans l’espace public discrédite par avance toute lutte contre le pouvoir dominant.
Solidarité avec l’Ukraine… au service de quels intérêts ?
Romain Huët se dit solidaire de l’Ukraine. Il « refuse une position morale qui ne « prend pas position », par désir de tranquillité » et accuse ceux qui oseraient tenir des discours pacifistes de lancer « un appel à « déserter » ». Son courage ne le conduit tout de même pas à mentionner les intérêts économiques des puissances occidentales. En mars dernier, Elon Musk suggérait la possibilité de couper l’accès de l’armée ukrainienne au réseau Starlink pour forcer Volodymyr Zelensky à signer un contrat de 500 milliards de dollars relatif à l’accès des États-Unis aux terres rares12.
Deux jours après la publication de sa tribune, Romain Huët était récompensé d’une invitation dans l’émission C ce soir13 pour échanger doctement, dans un pluralisme dont le service public a le secret, avec un journaliste du Point (lui aussi réserviste), une historienne spécialiste de l’armée, un ancien colonel de marine, un maire divers gauche pacifiste mais favorable au retour d’un service militaire obligatoire, et un ancien secrétaire d’État à la Défense.
Ce soir-là, sur France 5, Romain Huët déclare ne pas être doté des compétences nécessaires pour se prononcer à propos du retour du service militaire. La question est dépolitisée et réduite à l’évaluation des « besoins de l’armée ». Romain Huët précise peu après n’avoir « pas de problème avec le fait que la France doit se défendre ». Tout au long de l’échange, rien n’est débattu des buts poursuivis en dehors des frontières de l’hexagone, des intérêts économiques défendus, de l’accaparement des ressources, des répercussions de la présence de l’armée française sur les populations et de la protection de régimes peu défendables d’un point de vue éthique dans ce que la France considère comme son pré-carré.
L’une des critiques exprimées par Romain Huët ne porte pas sur la politique étrangère de la France, mais sur l’usage de l’armée à des fins d’ordre et de disciplinarisation de la jeunesse. Dans ce qu’il semble considérer comme un contraste, il cite positivement des Ukrainiens qui travaillent la semaine « et qui le week-end ont fabriqué des drones ». Usul, quant à lui, opposait le risque d’« aller mourir dans les tranchées » à la volonté de « détecter les jeunes talents qui pourraient être les pilotes de drones de demain s’il y a la guerre ». Dans la mesure où l’usage de cette technologie particulièrement meurtrière pour les civils banalise l’acte de tuer via la distance induite entre le lieu de l’action et le théâtre des opérations, il faut s’interroger devant cette description favorable de la place prise par les drones tueurs au sein des guerres contemporaines. Aussi, à ceux qui décrivent une Europe uniquement préoccupée par la défense de son territoire, rappelons que l’Union européenne et la France ont financé l’équipement de drones armés israéliens utilisés dans le génocide à Gaza14.
La guerre sans l’aimer, de Bernard-Henri Lévy à Romain Huët
Romain Huët, spécialiste des sciences de l’information et de la communication, semble n’avoir rien à redire quant aux actions de l’armée française. Il critique cependant les discours, les « envolées lyriques qui ressemblent franchement aux années 30 » et tout ce qui semble relever d’une « romantisation de la guerre ». À propos du général Mandon appelant à se préparer à la mort de certains de « nos enfants », le sociologue écrit dans sa tribune qu’il lui « manque une compréhension sociologique élémentaire : cette préparation morale à la guerre, rabâchée depuis quelques années, du « réarmement démographique » à l’envoi de troupes au sol en Ukraine, ne correspond à aucune aspiration collective. » Le sociologue dit défendre « une approche domestiquée des conflits, qui refuse le romantisme sacrificiel ». En conclusion de son texte, après une description vague des vies ukrainiennes et syriennes qui « refusent la passivité, la résignation et les accommodements », Romain Huët, qui vient donc de s’engager auprès de l’armée française, appelle à « soutenir sans s’enthousiasmer, aider sans sanctifier la guerre ».
Nous laissons au sociologue la responsabilité du parallèle qu’il dresse entre son engagement dans une armée chargée de protéger à l’international les intérêts du capitalisme français et celui qui consiste à défendre sa ville contre un envahisseur ou une dictature. Par ailleurs, en dénonçant une « romantisation de la guerre » dont il ne donne aucune preuve de l’omniprésence, Romain Huët se constitue un homme de paille face auquel il tente d’endosser les habits de l’intellectuel critique. En présentant l’engagement militaire et le soutien à la politique de l’OTAN comme une nécessité face à une guerre imposée par la seule Russie, il se trouve pourtant en phase avec la doxa contemporaine. En 2011, quelques mois après l’intervention en Libye déclenchée par Nicolas Sarkozy, Bernard-Henri Lévy, incarnation médiatique de cette campagne militaire, intitulait son livre La guerre sans l’aimer. En 2025, Romain Huët annonce sa candidature auprès de la réserve de l’armée de terre en affirmant « Je déteste la guerre, mais je l’arpente. » En 2026, Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, décrit « un monde soumis à la loi du plus fort » auquel « la France [se] prépare », même si « elle ne peut s’y résoudre et continuera de défendre ses principes »15.
Comme le faisaient récemment remarquer les militants de Révolution Permanente Vincent Rissier et Joachim Bertin, dans le cadre d’une réponse à Usul16, le discours actuel d’une partie de la gauche, qui, de la même façon que le gouvernement, décrit la guerre comme un mal auquel se résout une République française guidée par la défense du progrès et la démocratie, prolonge une longue histoire de renoncement à gauche. Ainsi, le 10 août 1914, dix jours après l’assassinat de Jean Jaurès et le début de la première guerre mondiale, l’éditorial de l’Humanité, sobrement intitulé Au nom de la patrie républicaine, soutenait lui aussi l’entrée dans la guerre mondiale mais, comme Romain Huët, « sans s’enthousiasmer ». Son rédacteur mentionnait « la vieille mère pleurant l’époux », « la fiancée se demandant si elle reverra celui qu’elle avait choisi pour être le compagnon de sa vie », les « enfants dont les derniers baisers ont été donnés dans un sanglot. » À propos des soldats français, on lisait « qu’ils ont conscience du grand et noble devoir qu’ils sont appelés à remplir » et que « ce n’est pas en agresseurs qu’ils se dressent contre les armées impériales » ni « en conquérants qu’ils foulent le sol allemand ».
Aujourd’hui, en Ukraine, certains militants internationalistes, notamment ceux de Kharkiv qui se désignent comme « l’Assemblée », développent une solidarité envers les déserteurs, tant Russes qu’Ukrainiens, et tentent de coordonner les luttes sociales entre les deux pays17. D’autres mouvements ukrainiens, anarchistes ou d’extrême-gauche, sont engagés dans la lutte armée contre l’envahisseur russe18. Tout en critiquant leur propre État, ils considèrent qu’empêcher l’annexion de leur territoire par la Russie est un préalable à la conduite de luttes sociales19. En Europe, les organisations de la gauche radicale appellent à la libération des prisonniers politiques russes et s’opposent à l’industrie française de l’armement qui a maintenu ses exportations de composants vers la Russie malgré les interdictions officielles20. Les Amis de la Terre dénoncent le fait que, malgré les sanctions économiques officielles, la France finance l’effort de guerre russe par l’importation massive de gaz naturel liquéfié et d’engrais azotés pour l’agriculture21. Ce n’est pourtant pas l’une de ces campagnes que Romain Huët a décidé de rejoindre au nom de la solidarité internationale mais celle de l’armée française, dans un contexte de tensions grandissantes et sans savoir dans quelles opérations extérieures elle sera prochainement engagée.
L’armée française au service d’intérêts économiques
Usul et Romain Huët feignent d’oublier que la guerre prolonge la politique par d’autres moyens. Il est contradictoire de dénoncer en France l’exploitation et la destruction de la planète, tout en masquant le fait que notre État se bat pour l’exploitation des ressources ou l’accès des entreprises françaises aux marchés internationaux. Si la guerre est un désastre pour les classes populaires souvent en première ligne, pour d’autres, l’adoption de postures bellicistes peut s’avérer très rentable sur le plan de la visibilité médiatique et de la reconnaissance institutionnelle. Reste qu’une telle ascension ne va pas sans une importante contradiction. De la même manière que des Ukrainiens travaillent la semaine et fabriquent des drones le week-end, certains entendent probablement la semaine, décrire la souffrance au travail en régime capitaliste, alerter sur les dangers de l’extrême-droite, évoquer positivement les mondes qui s’inventent au cœur des luttes écologiques ; et le week-end, se mettre au service d’une armée dont la principale fonction sera de protéger les chantiers de Vinci, les bateaux de la CMA-CGM, les conteneurs de Bolloré et les pipelines de Total.
En 2023 et 2024, l’Allemagne peinait à vendre ses voitures et ses panneaux solaires. Le pays a connu deux années de récession du fait d’une crise de surproduction. Son économie a depuis été relancée par la production d’armes et de matériel militaire. Deux usines de Volskwagen dont la fermeture était programmée produisent désormais des véhicules pour l’armée. La valeur des actions de Rheinmetall a été multipliée par douze depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. L’entreprise se trouve être le plus grand fabricant de munitions d’Europe, en plus d’être à l’origine des chars d’assaut Léopard. Sous sa tutelle, des usines de Bosch, Continental et ZF Friedrichshafen réorientent leur activité de la production de pièces automobiles vers l’armement. Ce secteur aux bénéfices record se situe désormais au cœur de l’industrie allemande. En cas de cessez-le-feu en Ukraine, il est peu probable que les actionnaires n’exigent pas de nouveaux débouchés pour ces productions.
Des « fonds verts »… kaki
En France, ce sont les « fonds verts » des banques qui ont récemment été réorientés vers l’armement. Comme l’écrivait récemment Mediapart : «Cinquante milliards d’euros issus de fonds dits « verts » des banques françaises et européennes ont été récemment investis dans la défense, avec le soutien de la Commission européenne, qui a cédé au lobbying des marchands d’armes». Cinquante milliards d’euros ont ainsi bénéficié à une centaine d’entreprises de l’industrie militaire. Avec 5,6 milliards d’euros d’investissement, Safran, entreprise française qui fabrique notamment des bombes de précision, des drones et les moteurs du Rafale, en est le premier bénéficiaire. « Ce scandale des « armes vertes », écrit Mediapart, a notamment contribué à financer la guerre à Gaza. »22. Voxeurop, co-auteur de cette enquête, précise : «les actions d’Elbit Systems, le plus grand fabricant d’armes israélien (qui participe directement à la guerre de Gaza, notamment à la destruction des terres agricoles) sont désormais incluses dans des fonds au service de la “transition climatique” ou labellisés “ESG”. Il n’est donc pas impossible que certains petits épargnants européens aient financé sans le savoir ce qu’une commission des Nations Unies a qualifié de génocide. (…) Parmi les dix entreprises qui ont attiré la plupart des capitaux verts, on compte l’entreprise allemande MTU Aero Engines, l’italienne Leonardo, la filiale néerlandaise d’Airbus, la française Thales, l’espagnole Indra, la suédoise Saab, ainsi que les britanniques Rolls Royce et BAE Systems. D’après des études récentes, cette dernière produit un grand nombre d’armes utilisées par l’armée israélienne dans le cadre de ses opérations militaires à Gaza, notamment l’obusier automoteur M109, fabriqué en collaboration avec Rheinmetall. Rolls Royce, qui contrôle la filiale allemande MTU, fournit des composants techniques pour les chars israéliens, y compris ceux utilisés à Gaza.»23
Si Usul et Romain Huët taisent les objectifs du réarmement, comme des opérations militaires occidentales, ils éludent aussi la question de son coût pour les classes populaires. Pourtant, les conséquences sociales de la marche à la guerre se font déjà sentir via les coupes budgétaires dans les allocations et les services publics. Aussi ne suffit-il pas de dénoncer le masculinisme ou de proclamer que l’on s’oppose à l’usage de l’armée à des fins d’encadrement de la jeunesse pour faire disparaître les effets de la guerre sur les corps et les esprits. Dans la France des années 2020, la nécessité de rétablir ce qu’Usul appelle le « lien entre l’armée et la nation », ou la volonté de répondre aux « besoins de l’armée » invoqués par Romain Huët, prend notamment la forme des classes de défense, qui selon le ministère de l’Éducation nationale « s’adressent en priorité à des établissements situés en réseau d’éducation prioritaire (REP ou REP+) ou en zone rurale isolée ». Ces 855 classes, dont le nombre a été multiplié par deux entre 2021 et 2023, s’appuient sur le soutien financier de Dassault, Naval Group et Safran, et permettent à une unité de l’armée d’intervenir plusieurs fois par an. Dans ce cadre, sont assurés des ateliers aux noms explicites, tels que « repousser des manifestants hostiles », « fouille d’une cellule carcérale », « zéro-tolérance », « tir au pistolet laser » ou « vivre le quotidien d’un surveillant de prison »24.
Contre le militarisme, la lutte sociale plutôt que le pacifisme
Au début de l’année 1938, un an et demi après les mesures concédées aux grévistes par le Front populaire, les réductions du temps de travail furent suspendues et la semaine de 48 heures rétablie dans l’industrie militaire. Aujourd’hui, en Ukraine, le code du travail est lui aussi suspendu. Les intérêts économiques au cœur de chaque guerre sont immenses et nombreux. Récemment, des ministres, ex-ministres et hommes d’affaires proches de Volodymyr Zelensky, liés au marché de l’énergie et de l’armement, ont été accusés de corruption. En septembre 2023, le New York Times décrivait une ligne de front relativement stable en Ukraine25. L’article établissait que des milliers de vies avaient été sacrifiées dans des offensives et contre-offensives menées dans le seul but d’annoncer la reprise d’une position qui, quand bien même elle allait être perdue peu après, permettrait de légitimer les demandes d’armement et de financement.
Il y a un siècle, le fascisme, dernière carte d’un capitalisme en crise, s’est développé dans la concurrence pour l’accès aux colonies et la course au réarmement. Sur décision de Staline, les partis communistes alignés sur l’URSS cessèrent de s’inscrire dans une perspective révolutionnaire internationale pour s’engager chacun dans la défense des institutions de son pays. Cette stratégie s’est avérée perdante. Pire, elle déboucha sur la stigmatisation de l’internationalisme en tant qu’«hitléro-trotskisme».
Aujourd’hui, face aux tensions internationales, à l’accentuation de l’exploitation, à la destruction de la planète et aux durcissements autoritaires, il ne s’agit évidemment pas de défendre un pacifisme abstrait. Comme le constatait déjà Rosa Luxemburg en 1911 dans un texte intitulé Utopies pacifistes26, dans le monde capitaliste, la possibilité de la négociation est maintenue par les armées et les rapports de force. Dans le contexte de l’impérialisme, on ne peut espérer mieux qu’une « paix armée », toujours provisoire. Si l’on souhaite sincèrement la paix, il s’agit donc de désarmer les fondements de la guerre, à savoir la politique commerciale et la politique étrangère des États chargés de défendre les intérêts de leur propre bourgeoisie.
En outre, il est fort probable qu’émergent prochainement des mouvements sociaux qui, dans plusieurs pays, articuleront l’opposition à la destruction du système social, la dénonciation de la surenchère militaire et la lutte contre le recul des libertés. L’opposition entre les nations s’étant accentuée au fur et à mesure du développement du capitalisme, seule la lutte contre l’ordre économique peut répondre à la nécessité d’éviter la guerre. Comme l’écrivait Rosa Luxemburg, l’horizon de la révolution sociale constitue un projet bien plus sérieux que « toutes les singeries autour du désarmement, qu’elles soient arrangées à Saint-Pétersbourg, à Londres ou à Berlin ».
- https://www.youtube.com/watch?v=Ej7YU4H99WA, https://www.youtube.com/watch?v=0A6mxkq9jOs
 ︎
︎ - Emission de la chaîne Blast, https://www.youtube.com/watch?v=eXKFQczmyIk
 ︎
︎ - https://www.radiofrance.fr/franceinfo/podcasts/le-decryptage-eco/remonte-contre-le-projet-de-hausse-des-impots-sur-les-societes-bernard-arnault-signale-le-contraste-avec-les-etats-unis-3064018
 ︎
︎ - https://www.lemonde.fr/politique/article/2025/06/09/un-an-apres-la-dissolution-de-l-assemblee-nationale-que-reste-t-il-du-front-republicain_6611732_823448.html
 ︎
︎ - https://www.marxists.org/francais/liebknec/1915/liebknecht_19150500.htm
 ︎
︎ - https://www.novethic.fr/economie-et-social/droits-humains/minerais-de-sang-le-parlement-europeen-demande-a-lue-de-suspendre-son-accord-avec-le-rwanda
 ︎
︎ - https://www.blast-info.fr/articles/2025/sommet-de-lotan-trump-force-leurope-et-la-france-a-depenser-beaucoup-plus-eCEM-fAvQl23lYOpF0pShw
 ︎
︎ - Romain Huët s’est auparavant fait connaître pour ses ouvrages traitant des souffrances psychiques engendrées par l’ordre social, des révoltes en France et de l’engagement armé de Syriens contre la dictature de Bachar Al-Assad et d’Ukrainiens face à l’invasion russe
 ︎
︎ - https://www.nouvelobs.com/opinions/20251125.OBS110069/je-refuse-l-appel-au-sacrifice-de-nos-enfants-mais-j-ai-candidate-pour-etre-reserviste-de-l-armee-de-terre.html
 ︎
︎ - https://www.lemonde.fr/international/article/2025/10/14/donald-trump-conditionne-la-poursuite-de-l-aide-a-l-argentine-a-la-survie-politique-de-javier-milei_6646651_3210.html
 ︎
︎ - https://www.franceinfo.fr/monde/usa/presidentielle/donald-trump/la-victoire-du-nouveau-president-du-honduras-symbole-de-l-avancee-de-la-droite-trumpiste-en-amerique-latine_7701820.html
 ︎
︎ - https://fr.euronews.com/next/2025/07/16/a-quel-point-lukraine-depend-elle-de-starlink-pour-ses-communications
 ︎
︎ - https://www.france.tv/france-5/c-ce-soir/7959888-defense-nationale-l-affaire-de-tous.html
 ︎
︎ - https://disclose.ngo/fr/article/en-pleine-guerre-a-gaza-la-france-equipe-des-drones-armes-israeliens, https://disclose.ngo/fr/article/la-france-et-leurope-financent-sans-le-dire-lindustrie-militaire-israelienne
 ︎
︎ - https://www.franceinfo.fr/monde/venezuela/attaque-americaine-sur-le-venezuela/la-france-se-prepare-pour-un-monde-durci-affirme-jean-noel-barrot-ministre-des-affaires-etrangeres_7720075.html
 ︎
︎ - https://www.youtube.com/watch?v=XodPOjRHLw4
 ︎
︎ - https://libcom.org/article/self-demobilization-abolition-ukraine-late-autumn-2025-interview-assembly
 ︎
︎ - https://lundi.am/L-organisation-des-anarchistes-sur-le-front-ukrainien
 ︎
︎ - https://lundi.am/Anarchistes-et-guerre
 ︎
︎ - https://www.obsarm.info/spip.php?article651
 ︎
︎ - https://larevuedestransitions.fr/2025/02/17/la-dependance-de-lagriculture-francaise-aux-engrais-chimiques-un-financement-indirect-de-la-guerre-en-ukraine/
 ︎
︎ - https://www.mediapart.fr/journal/economie-et-social/171225/avec-l-argent-des-fonds-verts-des-banques-financent-les-entreprises-d-armement
 ︎
︎ - https://voxeurop.eu/fr/europe-fonds-investissement-verts-financent-industrie-armement/
 ︎
︎ - https://positions-revue.fr/face-a-la-crise-du-capitalisme-la-militarisation-de-lenseignement/
 ︎
︎ - https://www.nytimes.com/interactive/2023/09/28/world/europe/russia-ukraine-war-map-front-line.html
 ︎
︎ - https://www.marxists.org/francais/luxembur/works/1911/05/utopies.htm
 ︎
︎
19.12.2025 à 16:27
Militer depuis l’Assemblée : entretien avec Arnaud Saint-Martin
Texte intégral (8372 mots)
Manuel Cervera-Marzal (MCM) : Vous êtes sociologue des sciences. Votre thèse porte sur l’histoire de l’astronomie française au début du XXe siècle. Comment en êtes-vous arrivé à ce métier de sociologue, et pourquoi avoir choisi d’étudier l’astronomie ?
Arnaud Saint-Martin (ASM) : La sociologie s’est imposée pour moi dès le lycée. J’étais un cancre, soyons clair, mais c’était une des rares matières que j’aimais ; avec le sport (rires). J’ai découvert Bourdieu en première, à travers l’affrontement Bourdieu/Boudon1 : il y avait un côté un peu héroïque. Ça m’a passionné et ça m’a amené à m’interroger sur moi-même, comme produit de déterminismes sociaux, moi qui avais été socialisé dans un milieu populaire de droite.
Et sur un malentendu, je me suis inscrit en licence de sociologie à l’université de Rouen après un bac ES péniblement obtenu (avec mention « passable »). Le cancre est devenu un passionné : à la façon de l’autodidacte de Sartre, je passais mes journées à la bibliothèque de Rouen. Ça m’a dévoré. J’ai découvert l’anthropologie, l’histoire, la philosophie : ça m’a ouvert plein de portes.
Rouen avait l’avantage d’une formation très généraliste. Puis, à Paris 5, j’ai basculé vers la sociologie des sciences grâce à Jean-Michel Berthelot. Les débats sur la vérité, l’objectivité, les querelles épistémologiques, ça m’a happé. J’ai fait un mémoire sur la vulgarisation de l’astronomie, en 1999, puis, l’année suivante, un travail sur l’affaire Sokal.
MCM : Impostures intellectuelles, de Bricmont et Sokal2…
ASM : Oui, le canular de Sokal… C’était mon sujet de maîtrise en sociologie des sciences, en 2000. À l’époque, c’était une spécialité de niche : il y avait plus de philosophes et d’historiens des sciences que de sociologues des sciences. La sociologie était la portion congrue. Mais il existait quand même des foyers : Paris 5, EHESS, Nanterre, Nantes, Strasbourg… Et c’est le moment où le domaine se structure, avec des débats intenses sur le constructivisme, sur le statut des énoncés scientifiques, leur inscription dans l’histoire, les études de laboratoire. Avec aussi les discussions critiques autour de l’anthropologie des savoirs de Bruno Latour. Ça, ça a été ma formation.
MCM : Et pourquoi avoir pris l’astronomie pour objet d’étude ? Pourquoi pas la biologie, ou la physique ?
ASM : Parce que la physique et la biologie étaient déjà très défrichées. Moi, l’astronomie m’attirait. Mon DEA portait sur la vulgarisation de l’astronomie : j’y analysais le marché de la diffusion des sciences, à partir d’entretiens avec des cosmologistes et des astrophysiciens qui écrivaient des livres ou donnaient des conférences, mais aussi des éditeurs et des journalistes scientifiques. C’était une façon d’observer concrètement la frontière entre science et société, sous l’angle de la diffusion des savoirs.
En thèse à Paris 4, j’ai ensuite quitté la vulgarisation pour faire une sociologie historique de l’astronomie entre 1880 et 1940. Je me suis intéressé aux effets de l’émergence de la théorie de l’expansion de l’univers sur la communauté des astronomes, et aux résistances – épistémologiques et culturelles – qu’elle a suscitées. Ça ne s’est pas fait « en douceur ».
Le travail reposait surtout sur des archives : observatoires, correspondances, documents administratifs. Certaines archives n’étaient même pas classées. C’était une sociologie historique d’un champ professionnel et de ses organisations.
Ce que j’ai trouvé passionnant, c’est de voir ce que signifiait concrètement « faire de l’astronomie » vers 1900. C’était par exemple… donner l’heure ! Les astronomes étaient chargés de l’heure civile, via l’Observatoire de Paris, et aussi de la météorologie, alors intégrée à l’astronomie. On voit alors se jouer la professionnalisation du métier, avec l’exigence progressive de diplômes, mais aussi les réactions qu’elle suscite, notamment à travers l’astronomie populaire et la vulgarisation. C’est tout cela que j’ai mis au jour dans cette thèse, soutenue en 2008 en Sorbonne.

MCM : Le 8 juillet 2024, vous entrez à l’Assemblée nationale. Vous vous mettez en disponibilité du CNRS. Comment avez-vous vécu ce passage du métier de sociologue à celui de député ? Est-ce une manière de passer de la théorie à l’action ?
ASM : C’est une question difficile, j’y réfléchis encore. Ça fait une dizaine d’années que je fais de la politique “un peu sérieusement”, c’est-à-dire au-delà du canapé et du bulletin de vote. Et assez vite, j’ai vu que ce n’était pas du tout la même chose de faire de la politique et de faire mon boulot de sociologue au CNRS. Pour moi, ces deux répertoires d’action sont disjoints et je fais tout pour les maintenir à distance. J’ai été conseiller municipal d’opposition à Melun, avant d’être député, pendant quatre ans. Et je me suis rendu compte, comme le dit Goffman, qu’il y a des ruptures de cadre. Ça m’est arrivé de faire des argumentations académiques en conseil municipal : je déroulais un truc pendant dix minutes, “Savez-vous ce que la science politique nous apprend sur cette question, Monsieur le Maire ?” Et je voyais les gens : “Mais qu’est-ce qu’il fait ?” (rires)
Ce n’était pas du tout efficace. Le conseil municipal n’a rien à voir avec la science : il faut convaincre, élaborer une ligne, on est dans le registre normatif, dans la bataille souvent. Le travail de diagnostic me sert, oui : je continue à lire les sciences sociales, c’est un réflexe quand j’ai un problème. Même en commission Défense nationale et des forces armées, où je siège : je vais voir ce que produisent les collègues sociologues sur le fait militaire, je lis les war studies. Ça m’aide à comprendre. Mais à un moment, tu fais de la politique : tu prends position, avec tout le vertige de la prise de position. La politique, c’est moins subtil. Elle a ses formats propres. Et ici à l’Assemblée, c’est encore pire : les cadres s’imposent à toi via le règlement intérieur et la bienséance ordinaire. Dans l’hémicycle ou en commission, tu as en général deux minutes pour les interventions ; sur une défense d’amendement, parfois juste une minute. Si tu dépasses, micro coupé, souvent sans possibilité de rebond. Donc non : tu ne fais pas une argumentation ultra sophistiquée avec notes de bas de page. Il y a un format.
Par ailleurs, tu fais partie d’un groupe parlementaire, qui se caractérise par une sociabilité, une ligne politique. Moi j’y contribue sur mes secteurs de compétence. Mais j’importe aussi des éléments de ma socialisation professionnelle : capacité à analyser vite, comprendre les textes. Et parfois ramener de la littérature scientifique quand on en a besoin – c’est fréquent, y compris sur l’environnement.
Je suis aussi membre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, l’OPECST. Instance bicamérale : 18 députés, 18 sénateurs, depuis 1983. On se réunit tous les jeudis. On auditionne des spécialistes, on fait des notes. Là, ma formation est utile. J’ai fait une note sur les neurosciences avec une sénatrice. Et j’ai eu entre autres une audition assez serrée avec Stanislas Dehaene, le neuroscientifique qui préside le conseil scientifique de l’Éducation nationale. Il y a d’ailleurs pas mal de parlementaires scientifiques : physiciens, biologistes… Les débats, sur ces questions-là, sont souvent de bonne tenue.
Ensuite, le travail ordinaire au Parlement, c’est deux grandes compétences : la production de la loi, et l’évaluation des politiques publiques – commissions d’enquête, missions d’information. Cette année, j’ai fait une mission d’information avec une députée macroniste, Corinne Vignon, sur l’industrie des satellites. Là, on auditionne, on évalue. Et évidemment, j’ai amené mon expérience de sociologie du spatial dans l’analyse. Ça a beaucoup servi la compréhension des enjeux. Après, il y a la recommandation, et là on revient au politique.
MCM : Il y a aussi d’autres sociologues à l’Assemblée, surtout dans votre groupe…
ASM : Oui : Hadrien Clouet, Marie Mesmeur, les politistes Claire Lejeune et Pierre-Yves Cadalen… On a des gens formés aux sciences sociales et ça infuse dans nos prises de position. C’est important : ça donne une attention à la déconstruction des prénotions, qui sont très fréquentes au Parlement.
MCM : Avez-vous encore le temps de lire ? Et d’écrire ?
ASM : Il y a un épuisement cognitif et physique de la fonction. On est coincé en séance ou en commission, et sinon on est en circonscription : marchés, inaugurations, rendez-vous en permanence parlementaire, repas des aînés… C’est matériel, tu ne peux pas consacrer ce temps à autre chose. Pendant l’examen budgétaire, on est retenu 15 heures par jour, parfois 7 jours sur 7. Moi je vis à une heure porte à porte, donc je peux rentrer voir ma famille, mais c’est bref et pour tout dire frustrant.
Lire, c’est devenu plus difficile. J’ai des collègues qui lisent dans l’hémicycle – souvent de la sociologie, d’ailleurs – moi je n’y arrive pas. Il y a un brouhaha permanent. Donc je lis moins qu’avant ce genre de littérature, alors que c’était mon métier. Je lis surtout des textes qui servent directement mon travail parlementaire. C’est très instrumental. L’écriture en revanche, je la maintiens à fond, je m’oblige : tribunes, une ou deux par mois. J’en ai publié une dizaine à L’Obs depuis mon élection, sur des sujets divers. Et puis il y a le livre Les astrocapitalistes que j’ai publié au printemps dernier : je l’ai fini pendant les vacances de fin d’année 2024, en étant déjà député. Je n’avais pas le choix, j’avais déjà repoussé la parution.
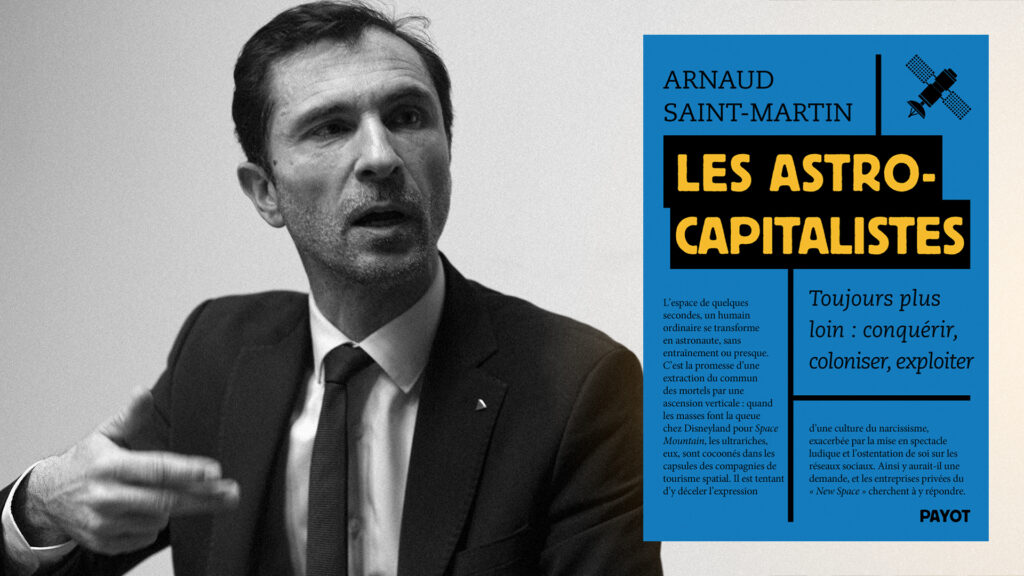
Mais je me suis rendu compte que je n’arrivais plus à écrire “en sociologue” : argumenter, prendre le temps, mettre des points-virgules, ne pas mettre des points d’exclamation partout… (rires) Pendant trois-quatre jours, tout ce que j’ai écrit était franchement nul. J’ai tout jeté. Puis d’un coup, c’est revenu. Et j’ai conscientisé à quel point j’avais perdu l’habitude de l’écriture sociologique. À tel point que la conclusion du livre est assumée comme très politique. Je l’ai écrite le 20 janvier 2025 – jour de l’investiture de Trump et du double salut nazi de Musk – et pour moi, c’était une confirmation de ce que j’avais anticipé. Là, j’ai matérialisé la distinction sociologie/politique : j’avais du mal à revenir à ce que je faisais avant.
Par exemple, je suis officiellement toujours co-directeur de la revue Zilsel. On sort un nouveau gros numéro de plus de 400 pages. Et c’est une douleur de ne pas être de l’aventure : j’ai reçu le PDF, mais je n’ai rien fichu. C’est notre bébé commun avec Jérôme Lamy, mon frère d’arme intellectuel, et je n’ai même pas relu les épreuves. Le pire, c’est que ça ne m’intéresse même pas sur le moment, tellement j’ai de trucs sur le feu. On est pris par le métier de député. Il y a toujours un coup politique à faire, une réunion, un débat… et c’est beaucoup de stress. Et c’est ça tous les jours : tu joues ta vie politiquement. À la fin, évidemment, tu oublies la sociologie.
Raphaël Schneider (RS) : Vous avez parlé d’une mission d’information que vous avez menée avec une députée macroniste. Comment ça se passe ? Vous travaillez ensemble malgré les désaccords ?
ASM : Oui, ça s’est bien passé. Corinne Vignon fait partie des députés avec qui on peut travailler. Il faut préciser : il y a un droit de tirage. Elle avait suggéré l’idée d’une mission pour faire un état des lieux de l’industrie satellite. Mon groupe a proposé d’en être, mon nom a été suggéré, validé par le bureau de la commission de la Défense où nous ne sommes pas majoritaires. La commission est présidée par un collègue macroniste, Jean-Michel Jacques. Donc on s’est rencontrés. Sa circonscription, à Corinne Vignon, est à Toulouse, elle couvre le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES), Airbus… donc elle a un enjeu électoral, de relais des inquiétudes industrielles. Moi, j’avais un intérêt presque “de recherche”, en plus de la nécessité de faire le point politique sur la crise des satellites, mais avec des accès que je n’avais pas avant.
MCM : Des portes qui s’ouvrent ?
ASM : Oui. Beaucoup plus facilement. Maintenant ce sont les PDG qui frappent à ma porte. C’est le jour et la nuit. En tant que sociologue, j’avais un mal fou à ouvrir certaines portes. Là, les gens viennent, invitent, proposent.
On a fait une réunion de cadrage, sur la problématisation. J’ai dit ce que j’attendais, et on était assez d’accord. Et sur la critique de la stratégie industrielle de Macron – un des axes – j’ai trouvé mon homologue macroniste finalement assez offensive : dans les auditions, elle fut critique du programme “France 2030”.
On a été très gourmands. Normalement une mission d’information, c’est trois mois. Les administrateurs de l’Assemblée bossent énormément : invitations, questionnaires, rédaction du rapport… nous on amende. Moi, j’ai copieusement amendé, mais tu peux aussi rester “sur des rails”. De mon côté, je ne suivais pas toujours les questions préparées. Et surtout j’ai invité beaucoup de gens que je voulais entendre : experts de politique spatiale, économistes de l’innovation, sociologues… J’ai amené un cadrage par la science, et ça a “biaisé favorablement” la mission dans ce sens-là. On a réussi à obtenir deux mois de plus. On a rencontré 85 personnes – c’est énorme. Et malgré tout, le rapport est plutôt court.
On a réussi à poser un diagnostic commun. Il y a une cinquantaine de recommandations, et seulement une dizaine sur lesquelles on n’est pas d’accord. On a été reçus à Toulouse, au ministère des Armées, par des généraux… J’ai appris plein de choses. Et je n’aurais jamais eu ces accès comme sociologue. Il y a une rétroaction, clairement.
On a présenté le rapport en commission de la Défense, salle remplie, deux anciens ministres… discussion longue. J’ai pu dire des trucs importants, notamment sur la soutenabilité des activités spatiales. Et le mois suivant, j’ai participé aux assises du spatial de la CGT à Toulouse, avec des camarades syndicalistes de Thales, Airbus, ArianeGroup. J’ai pu rappeler que la politique spatiale, ce n’est pas que les PDG, c’est aussi la base, les travailleurs. Et ça, je l’ai aussi dit en commission. Aujourd’hui, certaines recommandations comptent. On a même fait des recommandations très techniques sur des capacités radar, des “trous” capacitaires… qui se retrouveront prochainement discutées dans le cadre de l’actualisation de la loi de programmation militaire.
Donc oui, on a travaillé en transpartisan. Je n’aurais pas accepté si c’était avec le RN – hors de question, la répulsion est aussi politique que physique. Là, ça a été passionnant. Et on continue d’échanger sur les actualités du spatial.
RS : Vous dites que vous n’avez plus le temps de lire de livres, mais est-ce que vous lisez la presse ? Comment vous informez-vous ?
ASM : On est saturés d’informations. On a une revue de presse quotidienne faite par le groupe insoumis : sur l’actualité, sur ce qui circule, et aussi une veille pour la semaine le lundi matin. Et il y a des boucles Telegram où tu peux demander tel ou tel article. Ensuite, selon nos spécialisations, on reçoit les infos des commissions. On est bombardés. Et après, il y a les abonnements : j’ai Le Monde, Libération, Le Parisien, Mediapart, et des revues de sciences (Cosmos, Epsilon, Ciel & Espace, L’Astronomie, La Recherche, Air & Cosmos,etc.). Je me fais ma revue de presse.
RS : Et les réseaux sociaux ?
ASM : Oui, je passe beaucoup de temps dessus, comme tous les députés. Ça pop-up tout le temps, il y a toujours un truc à partager, et nous on produit aussi des contenus. On participe de la bulle.
Je donne un exemple : récemment j’ai présenté à l’Institut La Boétie notre stratégie spatiale, en réponse à celle de Macron. J’ai proposé ça aux camarades députés, et ça intéressait aussi Jean-Luc Mélenchon. Et au même moment, j’étais auditionné à Matignon dans le prolongement de la mission d’information. Donc j’ai commencé à écrire en mai dernier, et j’ai publié une tribune dans L’Obs : “Misère du macronisme spatial”. Je désosse la stratégie très paresseuse de Macron.
On a élaboré notre document : 30 pages, mais pensé à la ligne près. Et ça a été de la politique pure : arbitrages, formulations, ce qu’on dit et ce qu’on ne dit pas. Par exemple, sur le vol habité : Jean-Luc Mélenchon et Bastien Lachaud y tiennent, moi pas du tout. On a eu des discussions longues et passionnées là-dessus. Et finalement, on a décidé que pour l’instant, on n’en parlait plus : pas parce que ce n’est pas intéressant (au contraire, c’est un révélateur très instructif sur le passé et le devenir du spatial), mais parce qu’il y a d’autres priorités. Sauf que cette absence, c’est des mois de discussion. Ça aussi, c’est de la politique : prendre très au sérieux des questions doctrinales, arbitrer sur des fins, etc.
Et évidemment, dès qu’un journaliste attrape une divergence interne, ça devient “la crise”. Quand on est tous d’accord : “secte”. Quand on discute : “schisme”. Moi, j’ai découvert cette écriture politique, doctrinale, où il faut produire de l’adhésion, de l’inspiration. Sur l’espace, on en fait une “nouvelle frontière de l’humanité” avec la mer et le numérique. Et j’assume aussi des passages plus inspirés : on a une page sur les exoplanètes, la recherche de la vie dans l’univers… c’est à la fois scientifique et politique.
RS : Pourquoi publiez-vous dans L’Obs ?
ASM : J’y ai des contacts. Xavier de La Porte, et Rémi Noyon, qui me donnent carte blanche : j’envoie des textes parfois assez durs, ils me disent “parfait”, ils ne corrigent quasiment rien. En ce moment, c’est presque tous les mois.
MCM : Question qui fâche : comment fait-on pour ne pas se couper du monde réel lorsqu’on gagne 5000 euros par mois, voire plus ? Raoul Hedebouw dit : “quand on ne vit pas comme on pense, on finit par penser comme on vit”. À LFI, les salaires des députés ne sont pas plafonnés, contrairement au Parti du Travail de Belgique.
ASM : C’est une question que je me pose. On entend souvent que les députés gagnent 7000, mais c’est du brut. Moi je suis à environ 5000 net une fois retranchés les impôts sur le revenu, et ensuite il y a la cotisation au parti, aux assos, les contributions quand il y a des caisses de grève… Au final, je suis à peu près à l’équivalent de ce que je gagnais avant en cumulant CNRS, édition, droits d’auteur. J’étais arrivé à 4000, et là je suis autour de 4500. C’est beaucoup, j’en suis conscient. Je ne sais pas jusqu’à quel point c’est justifiable, mais c’est comme ça. Et moi ce que j’observe, c’est l’investissement dans le travail : parfois j’ai envie de dire “mais vas-y… prends le salaire, fais pareil”. Je ne dis pas ça pour héroïser : juste, il faut mesurer l’intensité.
Pour moi, la politique n’est pas une carrière. J’y passerai le temps qu’il faudra, mais je ne vais pas y faire ma vie. Ça demande beaucoup de sacrifices. Et je n’ai même pas le temps de dépenser l’argent : le peu que j’économise, c’est du matériel d’astronomie, d’ailleurs j’ai tout déclaré – j’ai vérifiable sur le site de la HATVP dans la section patrimoine.

Je ne fais pas ça pour l’argent et je ne vois personne faire ça pour l’argent dans mon groupe. Ce que je vois, c’est surtout l’usure physique, les sacrifices personnels et familiaux. Quand tu es là 15 heures par jour, 7 jours sur 7, et que tu n’as pas vu ta fille de douze ans depuis quinze jours… ambiance. Ce n’est pas pour faire pleurer, mais la critique du parlementarisme peut être démagogique. Oui, il y a des députés qui n’en foutent pas une. Mais moi, je ne cumule pas. J’aurais pu garder des mandats locaux, 500 euros de plus : je les ai confiés à des camarades insoumis qui ont pris le relais – avec efficacité en plus. Je suis en disponibilité du CNRS : carrière gelée. J’aurais pu demander un détachement. Et je continue à diriger des thèses, à participer à des comités, gratuitement. Donc ce n’est pas à moi qu’on fera la critique d’un investissement intéressé !
RS : Mais est-ce que le problème n’est pas mal posé ? On sent que vous n’êtes pas un individu cupide… Mais est-ce que des gens comme vous ne sont pas conduits à se dire qu’ils y passent trop de temps, que l’organisation de la vie de député n’est pas normale, trop chronophage, et donc veulent lâcher l’affaire ?
ASM : En effet, on nous en demande beaucoup. C’est un boulot pas possible. On attend de moi que je sois en circonscription samedi, dimanche : je suis allé au marché. Les administrés sont contents de me voir, mais aussi : “Ah, ça fait longtemps qu’on ne vous a pas vu… Ah, vous êtes là ?” On te demande d’être partout. Et moi je réponds : “Vous m’avez élu pour quoi ? Pour voter des lois ! Pour être au Parlement !”
Et à La France insoumise, on s’en colle un peu plus : il y a le travail parlementaire, mais il y a aussi tout ce qu’on se colle à côté. Je suis par exemple député référent dans le Cher. Je dois développer le mouvement à Vierzon, Bourges, dans des villages. J’ai fait ma tournée cet été en voiture. Et en même temps, je suis député de Seine-et-Marne. Donc oui, c’est très haché, il y a des urgences permanentes. L’agenda parlementaire évolue tout le temps. On a des votes solennels, il faut être là pour presser le bouton. J’ai des rendez-vous que j’ai décalés quatre fois. L’agenda est constamment réactualisé.
Et puis il y a l’organisation matérielle. J’ai l’enveloppe de 12 000 euros pour constituer mon cabinet : une directrice de cabinet, une attachée en circo, un attaché com, un alternant… mais ce n’est jamais suffisant. Quand c’est le PLF (projet de loi de finances), on reçoit 400 mails par jour. Tous les lobbys écrivent, tout le monde sollicite. Et en circo tu reçois aussi des demandes de rendez-vous, souvent sur des sujets qui ne relèvent pas de ta compétence : régularisations, logement, dossiers inextricables. On intervient auprès du préfet, on écrit à la région pour aider un maire à obtenir une subvention… tout un travail de coulisses.
Et puis il y a la représentation : être sur les marchés, les cérémonies… Moi je le fais, j’adore même aller sur les marchés avec mon écharpe : je sors la table, les tracts, je vais parler aux gens. Mais c’est du temps que je ne consacre pas aux tâches ici à l’Assemblée. Il faut arbitrer en permanence. Et le danger, c’est de se faire aspirer : burn-out. Il y en a. Ou alors les substances dopantes pour tenir – je n’y ai pas recours. Il y a une usure physique du mandat.
Aujourd’hui on est aspirés par des flux d’informations : on est constamment “sur le grill”. Injonction à être présent, à être pertinent, à rendre des comptes. Moi je le fais : j’ai une page Facebook qui est un journal de bord, j’écris tous les jours ce que j’ai fait. Certains disent que je “tartine” trop, mais je préfère ça à l’inverse.
RS : Ça, c’est votre effet chercheur, votre capital culturel.
ASM : Oui, peut-être. Mais je vois aussi que des gens aiment qu’on prenne la politique au sérieux. Je me souviens des discussions avec un militant qui a connu Solférino dans les années 80. Il me dit : “Tout ce que tu fais, tout ce que tu écris…” Il m’encourage et ça fait plaisir – notamment dans les moments de doute, parce qu’il y en a. Les “initiés” voient quand tu fais un travail sérieux, quand tu endosses le rôle à fond et avec une certaine sincérité d’engagement. Pour moi, c’est un ressort fondamentalement éthique. Je suis élu pour servir l’intérêt général : je pèse mes mots.
Et je ne vais pas faire semblant : je suis député, je suis dans la classe politique. Et si on veut faire bien le boulot, c’est impossible et ingrat. Et oui, j’en vois qui font un travail de fond énorme depuis des années, au point d’y laisser parfois leur famille.
MCM : Comment votre milieu professionnel a accueilli votre élection ? En tant qu’insoumis ? La bourgeoisie culturelle aime bien critiquer Mélenchon, mais finalement elle vote pour lui : il y a quelque chose d’hypocrite…
ASM : Déjà, ça fait longtemps que je fais de la politique : conseiller municipal, je ne l’ai jamais caché. Mon employeur le savait. J’ai toujours porté les couleurs de LFI, sans dissimulation. Et surtout, j’ai toujours travaillé une division claire entre science et politique, par honnêteté : ça nuit au mouvement politique si tu mélanges tout, et ça nuit à la science aussi. Quand je fais de l’expertise, des débats publics, c’est le sociologue qui intervient – ce que Michael Burawoy appelle la sociologie publique. Et quand j’étais sur un plateau de France Culture ou Inter (enfin, ça c’était avant : je ne suis hélas plus invité), je reformulais souvent : “Vous vous adressez à qui ? Au sociologue ?” Et selon ça, j’aménageais ma réponse.
Ce qui me frappe, dans les discussions avec des collègues et amis, c’est le niveau de méconnaissance du champ politique. Y compris chez des gens dont c’est le métier d’étudier la politique ! Il y a des approximations, des projections… une méconnaissance de la matérialité politique. Plus je m’approche des cercles du pouvoir, plus ça “dédramatise” la politique. Tu vas à la buvette, et tu as Marine Le Pen à un mètre : coprésence vertigineuse. Interagir avec un ministre, je sais faire désormais, ça ne m’impressionne plus. Matignon, je vois ce que c’est. L’Élysée aussi.
Et il y a des lieux où c’est encore plus frappant : l’IHEDN par exemple (Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale) où je suis auditeur cette année. Je fréquente des colonels, des généraux, des gens qui ont pris de grandes décisions. Franchement, ça dédramatise complètement. À l’école militaire, ça a “défrisé” d’avoir un député insoumis dans une section souvent perçue comme à droite : je suis devenu une sorte de curiosité, voire de mascotte (rires). On passe de bons moments, et il y a des gens passionnants.
Donc j’ai maintenant une connaissance approchée du pouvoir, très empirique, mais pas comme un sociologue qui ferait un terrain : comme quelqu’un qui est dans le game. Et quand j’entends certains universitaires parler de politique, je me dis parfois : “bof”. Ils n’ont pas les éléments d’un insider. Moi, par exemple, le mardi à 11h, j’ai la réunion du groupe parlementaire LFI. Je sais ce qu’il s’y passe, et je ne dirai pas ce qu’il s’y passe, évidemment : c’est le fight club (rires). Mais de l’intérieur, ce n’est pas ce que racontent certains dans des essais mal fichus et mensongers sur une inscrutable “meute”. Et tant mieux si ça ne sort plus. Parce que parmi les points communs entre science et politique, il y a la discipline. Pas au sens autoritaire : au sens de ce qu’on construit ensemble, avec de la confiance, pour pouvoir se dire les choses franchement sans que ça se retrouve dans la presse, et pour avancer ensemble selon une ligne travaillée collectivement.
MCM : Parce qu’il n’y a pas la crainte que ça se retrouve dans les colonnes du Canard enchaîné ou du Monde…
ASM : Exactement. Et donc on peut avoir des débats durs, des débats de fond. Sur la stratégie spatiale, ça a été sportif : on n’était pas toujours d’accord sur tel ou tel point, ou à tout le moins il fallait préciser. Ça a pris du temps. Et moi j’ai bougé sur ma ligne, j’ai accueilli celle d’autres camarades. La ligne finale est bien plus intéressante que ce que j’avais proposé initialement. La friction produit de bonnes choses !
Et puis il y a aussi des cadres très concrets : quand tu es briefé DGSE ou DGSI, ou avec l’état-major, ton téléphone reste à l’entrée. Ça, en tant que sociologue, je n’y avais pas accès. Comme député, ma connaissance est plus fine.
Donc oui : ça donne envie d’écrire une sociologie de l’intérieur. C’est en négociation avec un éditeur, je n’en dis pas plus. Mais évidemment que je vais mettre à profit cette connaissance.
MCM : Il y a régulièrement des attaques contre Mélenchon : antidémocratisme, antisémitisme supposé… Mais j’ai l’impression qu’aujourd’hui l’argument principal, ce n’est même plus le fond : c’est le sondage. Et l’idée qu’il perdrait automatiquement face à Bardella au second tour. Qu’en pensez-vous ?
ASM : C’est le bruit de fond médiatique, on ne va pas faire semblant que ça n’existe pas. Moi je vais répondre de façon empirique, donc forcément biaisée. Je le connaissais de loin avant d’être député, comme militant insoumis depuis 2017, j’avais déjeuné avec lui une fois en 2023. Depuis que je suis à l’Assemblée, on s’est vus plusieurs fois. Je l’ai fait venir à Toulouse pour un colloque de l’Institut La Boétie sur l’espace. Je l’ai fait venir aussi aux Rencontres du Ciel et de l’Espace. On échange beaucoup sur l’astronomie, la science, le spatial. Il me demande mon avis. On a des discussions riches sur les trous noirs, l’univers, les technologies spatiales… C’est rare chez un responsable politique !
Moi, je l’admire très sincèrement : sa capacité de travail, sa curiosité, sa capacité d’étonnement. Quand j’écris une tribune, il veut qu’on lui envoie : ça l’intéresse. Et il fait ça avec beaucoup de députés et de militants. Il avance, y compris sur sa propre ligne.
À Toulouse, c’était la première fois que j’organisais un colloque en tant que député : il y avait du monde, beaucoup de panels J’ai mis l’événement sur notre plateforme Action Populaire le mardi pour le samedi : la salle était blindée. Juste avant, on a parlé une heure d’astronomie. Et la “Nuit des étoiles” aux Amfis d’été en août 2025 : c’est son idée, moi je l’ai mise en œuvre. Il a une vraie appétence intellectuelle.
Et ensuite, tu le ramènes dans la salle : tu vois l’effet Mélenchon. Je n’ai pas vu ça avec d’autres. Aux Rencontres du Ciel et de l’Espace, à la Villette, je lui dis : “Viens, je vais te montrer l’astronomie amateur.” Il reste cinq heures, je lui fais rencontrer tout le monde : Association Française d’Astronomie, Société astronomique de France, rédactions, astronomes amateurs, vendeurs d’instruments… Il trouve ça génial. Et personne ne s’est plaint. Au contraire : selfies en continu !
Après, oui, on tracte souvent vent de face. En 2021, tout le monde disait qu’il fallait qu’il se retire, qu’il avait fait son temps… Et au premier meeting présidentiel, c’était énorme. Personne ne fait ça à gauche. Je discute avec des socialistes, des écolos : ils voient l’Institut La Boétie, ils jalousent. Ils copient même : l’académie Léon Blum du PS, c’est une copie conforme, mais sans les intellos (rires).
Jean-Luc Mélenchon, c’est un chef d’orchestre. Je vais souvent au “moment politique”, je suis bluffé : 1h30, il met en intrigue, il fait de l’éducation populaire, il commence large, resserre, redécolle, finit sur l’espoir, avec de l’humour, beaucoup de savoir, des références savantes. À son âge, quelle machine ! Moi, quand je fais des meetings je m’épuise au bout d’une demi-heure.
Et Bardella… comment dire… pour moi c’est une tranche de jambon sous cellophane. Comme Glucksmann. À gauche, il n’y a pas de concurrence à ce niveau-là : ils se feront atomiser. Et en plus, il y a une relève très forte à LFI : Bompard, Guetté, Clouet… des valeurs sûres et un énorme potentiel. Et il y a aussi des gens pas encore visibles : des collaborateurs du groupe parlementaire qui se forment, des militants partout dans les groupes d’action, beaucoup d’envie et de savoir-faire. Si on gagne en 2027, il faudra un gouvernement, un groupe 2.0… tout ça se prépare. Nous y sommes prêts.
Donc je refuse l’effet “oracle”, le fatalisme, les prophéties autoréalisatrices neurasthéniques (j’ai trop lu Merton pour m’y faire prendre). Moi, je ne devais pas être député : ma circo était à droite depuis 40 ans. Campagne dure, triangulaire… et j’ai gagné. Je n’ai pas dormi pendant des semaines. Si j’avais écouté les oiseaux de mauvais augure, je n’y serais pas allé. Donc aujourd’hui, quand on me dit : “en cas de dissolution ça va être compliqué”… je réponds : forcément ! Livrons bataille de bon cœur et en conviction ! Quoi qu’il arrive, il va falloir venir nous chercher. C’est le couteau entre les dents.
MCM : Avant la présidentielle, il y a d’abord les municipales en mars prochain. En 2020, les insoumis avaient enjambé ces élections. Cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. Et il y a des victoires de gauche dans des métropoles états-uniennes : Zohran Mamdani à New York, Katie Wilson à Seattle… Est-ce que ça nous apprend quelque chose ou le contexte est trop différent ?
ASM : Je pense que c’est “bon à penser”. Ça existe. Et c’est une mine radicale et joyeuse. Ça donne envie – et ça, c’est la clé. Il ne suffit pas de produire de l’adhésion rationnelle, de l’adhésion sur le fond : il faut que les gens aient envie d’y aller, qu’ils puissent convaincre autour d’eux. Il faut élargir et susciter de l’enthousiasme.
Moi, les campagnes qui marchent chez moi, c’est des campagnes offensives, combatives et joyeuses. Je chambre les adversaires, et je fonctionne beaucoup à l’auto-dérision. Les militants ne se privent pas de se moquer de moi quand je fais une connerie. Hier, j’ai reçu un détournement où j’apparais en curé sur une photo, parce que j’avais pris en photo la crèche de Melun. Une copine a fait un montage, je l’ai relayé. Ça participe de la distance au rôle. Le jour où je n’arrive plus à rire de moi, ce sera mauvais signe. Je déteste l’esprit de sérieux.
MCM : Vous faites beaucoup de porte-à-porte aussi.
ASM : Oui. Et beaucoup pensent que tout se passe sur les réseaux. Mais là, par exemple, j’accompagne Rémy Béhagle, le candidat LFI aux municipales à Melun : samedi après-midi, porte-à-porte dans un quartier populaire où je suis bien reçu, où les gens me connaissent, parce que j’ai mené des combats “en désintéressement”. J’ai fait le lien entre journalistes et habitants, avec les autorités administratives, sans apparaître : je ne fais pas ma retape. Et les gens le voient : ils me disent que je n’instrumentalise pas. Pour moi, c’est un critère moral important.
J’adore le porte-à-porte. Tu entres dans la vie des gens. Certains ouvrent en short, claquettes. Moi j’y vais en cravate : je suis député (rires). Et tu as de tout : des sourires, des discussions, du désarroi, de la souffrance. Quand tu visites une tour de 15 étages, c’est long et fastidieux, mais tu auras vu tout le monde. Et surtout, ça produit des effets durables. Il y a des gens aujourd’hui militants à Melun qui ont découvert LFI comme ça, parce qu’on a toqué chez eux. On a un jeune de 19 ans, génial : des Insoumis ont toqué chez lui pendant ma campagne, c’était la première fois qu’une force politique venait jusqu’à lui. La politique est venue à lui. Et maintenant il est dans l’équipe. Donc oui, on amène des gens à la politique et on en est fiers. Pas à des fins électoralistes : il faut construire au ras du sol un lien politique, parce qu’on croit à une cause, et entretenant le lien. C’est de la haute couture politique.
Et on ne va pas seulement dans les endroits où c’est facile. Ma circo c’est 130 000 habitants. À Melun je fais des scores… très hauts. À Barbizon, je fais 16 voix. Eh bien j’y vais. Je vois les maires, souvent de droite. Et on parle service public, transport scolaire, etc. Tu peux parfois atténuer des problèmes concrets.
Sur les municipales, il y a un enjeu : on a fait la convention LFI à Aubervilliers. J’ai trouvé ça super beau. Et le mouvement réfléchit : on a théorisé le communalisme insoumis, on travaille avec des politistes – des collègues que je côtoyais naguère à l’EHESS où j’ai mon bureau. On actualise le programme. Et localement, c’est à géométrie variable : parfois on y va seuls, parfois en alliance, selon les configurations. Quand on peut y aller seuls, on met la pression en “mouillant la chemise”. Les habitants nous voient faire.
Moi, ce que je constate, c’est que d’autres partis de gauche ne savent plus militer. J’ai fait des négociations interpartis : “Vous amenez quoi ?” À part la soupe de logos, ta place sur la liste… c’est quoi votre plus-value en termes d’actions et d’apport d’idées ? Souvent, rien : tambouille. Ça me déprime et c’est la raison pour laquelle je ne m’étais pas mouillé en politique. Le PS et le PCF, comme j’ai pu le constater dans des négociations, ne veulent qu’une place pour pouvoir peser aux sénatoriales… Bon. Après, il y a aussi des endroits où ça se passe bien : à Dammarie-les-Lys, dans ma circo, on est derrière le PCF, et je l’ai fait valider par notre comité électoral.
Mais une chose est sûre : il faut se développer dans les mairies. En tant qu’ancien élu local, je peux dire que c’est passionnant : éducation, voirie… La voirie, ça paraît chiant, mais c’est super intéressant : pistes cyclables, bancs, éclairage, maintenance – c’est hyper politique, en fait. J’ai même déposé une proposition de loi pour préserver l’environnement nocturne. Et j’ai fait venir à l’Assemblée Patrick Proisy, le maire de Faches-Thumesnil, une des rares mairies insoumises. Ils font l’extinction partielle, ils appellent ça des “radicalités concrètes”. Dans une ville de 20 000 habitants, ils font des trucs super.
Et c’est dommage de laisser toutes ces communes aux socialistes qui font une gestion interchangeable avec la droite. Moi je l’ai vu dans les structures intercommunales, les EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) : le clivage droite-gauche s’efface, on fait de l’“attractivité économique”, des compétences techniques, des acronymes… et ça tue la politique. Ça a puissamment détruit le lien des citoyens avec la chose publique au niveau local.
Quand j’étais élu d’opposition, je prenais la parole pour dire : “si j’étais au pouvoir, on démonterait cette structure”, et j’argumentais. Il faut repolitiser ces espaces, remettre les pieds dans le plat, conquérir des mairies, pour transformer concrètement la vie des gens.
C’est aussi pour ça qu’on n’enjambe pas les municipales cette fois-ci : on a affiné la ligne, y compris sur des sujets très techniques. La gestion d’une commune peut être chiantissime, le défi c’est de rendre ça intéressant — et de faire revenir les gens en politique.

Entretien réalisé par Manuel Cervera-Marzal et Raphaël Schneider, à l’Assemblée nationale, le 1er décembre 2025.
Pour prolonger
- Pour Bourdieu, beaucoup de choix « personnels » (école, goûts, culture) sont en réalité socialement fabriqués et reproduisent des hiérarchies ; pour Boudon, ces choix s’expliquent par des calculs raisonnables dans une situation donnée. En simplifiant, Bourdieu décrit la façon dont le social façonne les individus, quand Boudon montre comment les individus raisonnables façonnent du social – et la querelle tourne autour du poids relatif de ces deux niveaux.
 ︎
︎ - En 1996, le physicien Alan Sokal publie un article volontairement absurde dans la revue Social Text. Truffé de références savantes mal comprises et de jargon postmoderniste, le texte visait à montrer que certains discours relativistes pouvaient être acceptés sans véritable contrôle scientifique, dès lors qu’ils flattaient une orientation idéologique. Dans la foulée, Sokal publie avec le physicien Jean Bricmont le livre Impostures intellectuelles (1997). L’ouvrage critique l’usage abusif ou métaphorique de concepts issus des sciences dures (mathématiques, physique) par certains intellectuels français (Lacan, Kristeva, Deleuze, Baudrillard, etc.). Leur thèse centrale est que cet usage confus brouille la frontière entre rigueur scientifique et rhétorique, et affaiblit la crédibilité des sciences humaines et sociales.
 ︎
︎
17.12.2025 à 17:34
Les états désunis du dollar
Texte intégral (5663 mots)
« Dans les événements historiques, écrivait Tolstoï, les prétendus grands hommes ne sont que des étiquettes qui doivent leur nom à l’événement ». C’est aussi vrai des hommes grotesques que l’histoire appelle parfois à la rescousse lorsque les grandes issues sont bouchées. Ainsi la publication en novembre 2024 du Guide de l’utilisateur pour la restructuration du commerce mondial1par Stephen Miran, futur conseiller économique de Donald Trump, nous révèle qu’avec sa personnalité brutale et imprévisible, l’homme d’affaires est, avant de provoquer des situations politiques nouvelles, l’homme de la situation. Car dans la conduite d’une guerre tarifaire débutée déjà de longue date par les États-Unis, « l’incertitude quant à savoir si, quand et dans quelle mesure cela se produira renforce le pouvoir de négociation en suscitant la peur et le doute »2. Mais de quelle négociation s’agit-il ?
Le dollar : du privilège exorbitant au fardeau exorbitant
Le rapport de Miran s’appuie sur un constat désormais classique sur la position commerciale des États-Unis. Le dollar étant demandé comme monnaie de réserve internationale en plus de ses fonctions domestiques, il est surévalué relativement à l’état de la balance commerciale des États-Unis. Or cette surévaluation ne cesse d’aggraver son déséquilibre avec le reste du monde, étant donné qu’un dollar fort grève la compétitivité de l’industrie domestique et rend meilleur marché les produits importés. C’est pourquoi le privilège exorbitant du dollar, qui permet à son émetteur de financer indéfiniment ses déficits courants – par l’émission de bons du Trésor –, s’est transformé selon Miran en un fardeau exorbitant, à mesure que décline la part des États-Unis dans la croissance du PIB mondial.

Car plus cet écart de croissances s’élargit, plus la demande de dollar comme monnaie de réserve augmente relativement à la part déclinante des États-Unis dans le commerce mondial, et plus aussi se creusent les déficits courants3. Or avec cet écart, augmente du même coup le risque d’une perte de confiance dans le dollar, et surtout dans le bon du Trésor, placement favori de l’épargne mondiale, grâce auquel l’État finance son déficit. Il s’agit donc de prendre les mesures qui restaurent la compétitivité des États-Unis, mais sans affaiblir le dollar dans son statut d’actif de réserve. Bref : un dollar fort pour sa fonction de réserve de valeur, et faible pour sa fonction de moyen d’échange.
L’impossible répétition de l’Accord Plaza
N’est-ce pas ce qu’avait su faire Reagan en 1985, en faisant signer à l’hôtel Plaza de New York un accord des pays du G5 sur une action concertée de dépréciation du dollar sur le marché des changes ? Le dollar pouvait bien baisser, il était en ce temps-là la monnaie de réserve incontestée du capitalisme mondial. Mais surtout, Miran sait bien que la Chine de 2025 n’a pas les dispositions conciliantes du Japon de 1985, que l’UE n’a plus l’aisance commerciale de l’Allemagne d’hier.
À défaut de nouveaux Accords du Plaza4 avec les grandes puissances économiques du moment, Miran appelle au lancement d’une guerre commerciale ouverte frappant leurs exportations, et les forçant à s’ouvrir aux produits états-uniens. Bien plus, cette offensive tiendrait lieu de guerre préventive avant la signature d’un nouvel accord, cette fois sous les ornements douteux de la résidence floridienne de Trump à Mar-a-lago. Les experts ont beaucoup ironisé sur la malheureuse comparaison entre les Accords du Plaza et d’hypothétiques Accords de Mar-a-Lago : non seulement les États-Unis ne sont plus entourés de leurs bons alliés de l’après seconde-guerre mais, surtout, Reagan voulait justement éviter, par ses Accords, des mesures tarifaires agressives que les Démocrates du Congrès réclamaient contre le Japon et l’Europe. En 1985, les États-Unis ménageaient leurs alliés pour consolider un marché mondial dont ils étaient le grand commissaire-priseur : quelques jours après leur signature, Reagan lançait en effet les négociations de l’Uruguay Round dans le cadre du GATT, en vue d’abaisser les barrières douanières dans la perspective de la création de l’Organisation Mondiale du Commerce.
Quarante ans plus tard, c’est avec le pistolet commercial sur la tempe que les États-Unis arracheraient un accord, avec cette fois l’OTAN comme institution d’appui : « Supposons que les États-Unis imposent des droits de douane à leurs partenaires de l’OTAN et menacent d’affaiblir leurs obligations de défense commune au sein de l’OTAN s’ils sont frappés par des droits de douane de rétorsion »5. Si bien que les motifs avancés pour une guerre des douanes se contredisent entre eux : les taxes doivent servir tantôt de moyen de pression, voire de rétorsion, contre les partenaires commerciaux des États-Unis, tantôt à financer durablement les déficits budgétaires et les réductions d’impôts aux entreprises, et l’abaissement des charges sociales, qui sont pour Trump les deux piliers du MAGA. Or avec des droits de douane sur les importations, il faudra s’attendre à une hausse de l’inflation du fait du renchérissement des biens étrangers (les derniers chiffres le confirment6) qui poussera la Fed à relever les taux d’intérêt. Mais des taux élevés stimulent la demande de dollar et donc la hausse du taux de change – et un dollar plus fort qui s’ensuivra augmentera à son tour le déficit commercial des États-Unis.
Et si l’on imagine un instant que les mesures produisent l’effet attendu d’une baisse du dollar, Miran admet qu’elle entraînerait une baisse massive de la valeur de l’épargne mondiale investie en bons du Trésor et donc aussi une vente massive de ces titres qui précipitera davantage encore la baisse de leur valeur. Comme cette vente entraînera une hausse des taux d’intérêt sur ces bons7 et donc une hausse du déficit courant, on forcera les détenteurs étrangers à les échanger contre des obligations à cent ans « zéro coupon », c’est-à-dire ne portant pas intérêt. « Afin d’atténuer les conséquences financières indésirables potentielles (telles que la hausse des taux d’intérêt), la vente de réserves peut s’accompagner d’un allongement de la durée des réserves restantes. La demande accrue de dette à long terme par les gestionnaires de réserves contribuera à maintenir les taux d’intérêt à un niveau bas […] Si l’allongement de la durée se fait sous la forme d’obligations spéciales à cent ans, […] la pression financière sur les contribuables américains pour le financement de la sécurité mondiale s’en trouve considérablement allégée. Le Trésor américain peut effectivement racheter la durée sur le marché et remplacer cet emprunt par des obligations à cent ans vendues au secteur officiel étranger [banques centrales, agences publiques, fonds souverains, etc.]. De tels accords de Mar-a-Lago donnent forme à une version du XXIe siècle d’un accord monétaire multilatéral »8. Mais il faudrait d’abord prendre la mesure XXIe siècle où ce ne sont pas seulement les supposés signataires des accords, mais le dollar lui-même qui a changé de résidence. Aujourd’hui seuls 16 % des réserves en dollars sont entre les mains des banquiers centraux étrangers, contre plus de 60 % circulant entre les comptes des institutions privées du système financier international9. C’est que le dollar n’est plus seulement la grande devise des réserves des institutions officielles de l’axiomatique capitaliste, il s’impose comme le premier véhicule du capitalisme mondial.
Le nouveau dilemme de Triffin
On a beaucoup critiqué Miran pour ses incohérences et simplifications10. Mais ses détracteurs lui font un mauvais procès, car il se débat au milieu d’une contradiction plus profonde, qu’ils feignent d’ignorer plus que lui encore, entre le degré d’autonomie relative du dollar par rapport à son pays émetteur et le niveau de déclin relatif du rôle économique des États-Unis eux-mêmes. En un sens, le dollar est devenu le problème des États-Unis parce qu’il n’est plus seulement, et depuis longtemps, la monnaie des États-Unis. Ainsi dans le commerce, 54 % des transactions sont toujours facturées en dollars, soit 5 fois plus que la part des États-Unis dans le commerce mondial, tandis que sa part dans le PIB mondial n’est plus que de 15 %. Dans les coffres des banques centrales, plus de 60 % des réserves sont déclarées en dollars et ces chiffres sous-estimeraient la réalité du phénomène selon le FMI. En outre, plus de la moitié des pays de notre globe ancrent leur monnaie au dollar et 50 % environ du PIB mondial est ancré au dollar11. Par cet arrimage universel, que le marché des changes manifeste par l’usage du dollar dans près de 90 % des transactions, le dollar jouit plus d’un privilège d’insularité (privileged insularity) que d’un privilège exorbitant : une variation du taux de change n’affecte pas les prix des biens importés libellés dans des monnaies ancrées au dollar. C’est bien cette autonomie qui explique la tournure embarrassée du plaidoyer de Miran, c’est elle qui joue comme un retour du refoulé à chaque objection qu’il fait à ses propres propositions. Il le reconnaît en un sens, en qualifiant la situation des États-Unis de « monde de Triffin » dans lequel « les actifs de réserve constituent une espèce de masse monétaire mondiale, et leur demande dépend du commerce mondial et de l’épargne mondiale, et non de la balance commerciale intérieure ou des caractéristiques de rendement du pays détenteur des réserves »12.
Mais que ce monde a changé depuis que l’économiste Robert Triffin a énoncé son fameux dilemme en 196013 ! Il remarquait que le système monétaire international ne pouvait fonctionner que si le pays émetteur de la monnaie de réserve, les États-Unis donc, créait une quantité suffisante de liquidités pour le commerce mondial. Mais créer de la liquidité, cela revient à financer son commerce sans contrepartie, c’est donc créer des déficits extérieurs (c’est-à-dire des déficits commerciaux et plus généralement des déficits de la balance des paiements du pays émetteur) en alimentant le marché mondial en dollars créés par la planche à billets. Or ces déficits continuels risquaient de saper la confiance dans la monnaie de réserve, car les autres pays se mettraient à douter de la capacité de l’émetteur à garantir la convertibilité du billet vert en or (sur laquelle reposait la valeur du dollar, en tant que monnaie pivot du système de Bretton Woods). Donc, si le pays émetteur ne fournit pas assez de liquidités, le commerce et la croissance mondiaux sont freinés ; s’il en fournit trop en accumulant des déficits, la valeur et la stabilité de sa monnaie sont remises en cause.
La variable ultime : le travailleur états-unien
Triffin ne craignait donc pas tant les déficits (la balance commerciale des États-Unis était excédentaire à son époque) que la convertibilité d’un dollar surabondant sur les marchés mondiaux. Pourtant, la fin de la convertibilité du dollar décidée par Nixon en 1971 n’a pas fait disparaître le dilemme : elle l’a déplacé au niveau de la capacité fiscale des États-Unis à soutenir leur dette publique, et honorer leurs obligations vis-à-vis de ses créanciers. Et ce déplacement tient au rôle nouveau des obligations du Trésor des États-Unis. C’est que, non seulement les banques centrales conservent des dollars sous la forme de bons du Trésor, mais cette quasi-monnaie portant intérêt constitue désormais l’actif sûr pour toutes les opérations financières intervenant aussi bien sur les marchés financiers que dans les systèmes de paiements des banques onshore et offshore dans lesquels le dollar est la monnaie véhiculaire. Aussi le dilemme de Triffin trouve-t-il à s’exprimer désormais dans la contradiction entre l’accroissement des déficits de la balance des paiements (nécessaire à la fourniture de liquidité en dollars pour le reste du monde), et la capacité fiscale des États-Unis à émettre de la dette (pour garantir au dollar sa fonction de réserve de valeur).
D’où l’équation impossible de Miran : baisser la valeur du dollar, c’est affaiblir le statut d’actif sûr qu’est le bon du Trésor, c’est donc augmenter son prix et par là-même le déficit budgétaire des États-Unis. Mais augmenter le déficit, c’est provoquer plus d’inflation et donc baisser la compétitivité des produits domestiques. Miran reconnaît ces difficultés et, devant la fragilité de ses propres mesures, finit toujours par recourir à la seule variable économique encore aux mains du politique en matière de dollar : la force de travail. Si le taux de change augmente par suite de la hausse des tarifs – du fait de la hausse de la demande de dollar qui s’ensuivra, « [l]es décideurs politiques peuvent en partie atténuer les freins aux exportations par un programme de déréglementation agressif, qui contribue à rendre la production américaine plus compétitive »14. Et même si, comme l’espère Miran, le taux de change n’augmente pas, ce sera au travailleur américain de payer pour la hausse des tarifs en achetant plus cher ses biens de consommation, d’où, là aussi, une baisse de son salaire réel.
Les fissures chinoises du mur tarifaire
Jusqu’ici nous avons à peine évoqué la Chine. C’est elle pourtant qui justifie la tournure martiale du commerce extérieur voulue par Miran : « Les pays qui souhaitent bénéficier du parapluie militaire doivent être aussi sous le parapluie du commerce équitable. Un tel outil peut être utilisé pour faire pression sur d’autres nations afin qu’elles se joignent à nos droits de douane contre la Chine, créant ainsi une approche multilatérale en matière de droits de douane »15. Dix-huit siècles après que la Chine a débuté la construction de la Grande Muraille pour repousser les menaces de ses voisins barbares, c’est au tour de ces derniers d’ériger autour d’elle un « Mur tarifaire mondial ». On dirait que l’administration Trump a inventé une nouvelle variante de la formule de Clausewitz qui fait du commerce l’anticipation de la guerre par d’autres moyens que la politique. Pour le secrétaire au Trésor Scott Bessent, une segmentation plus claire de l’économie internationale en zones fondées sur des systèmes économiques et de sécurité communs contribuerait à mettre en évidence la persistance des déséquilibres et à introduire davantage de points de friction pour y remédier »16. C’est au fond la seule certitude de Miran : quels qu’en soient les effets, ses mesures dessineront une démarcation plus nette entre amis et ennemis, et élèveront les risques de sécurité.
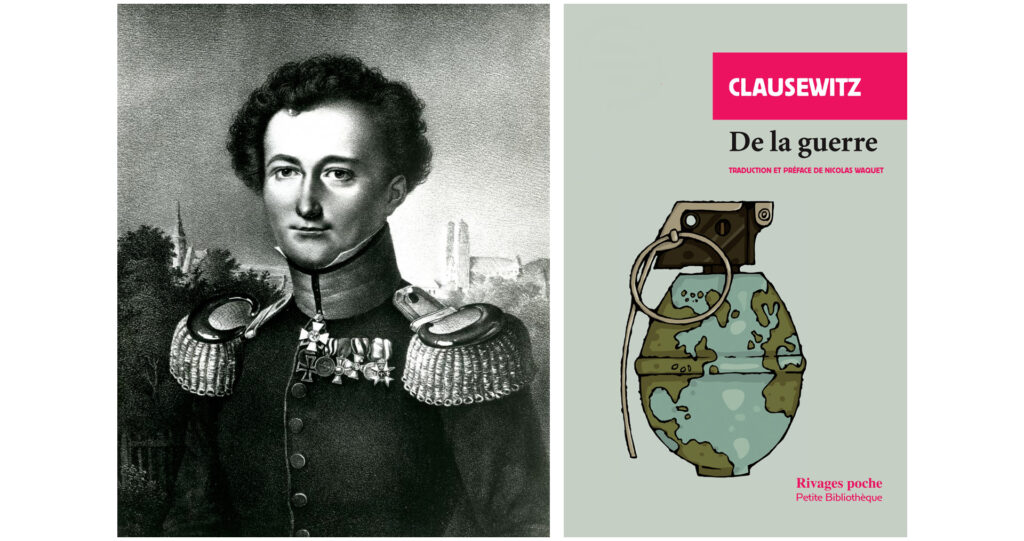
Mais Miran s’attend aussi à ce que ces grandes manœuvres précipitent la recherche d’alternatives au dollar, déjà en marche avec le yuan qui, même s’il ne représente encore que 4% des paiements internationaux et 2% des réserves de change mondiales, a vu sa part doubler depuis 2022. Dans le commerce chinois, son usage dans le règlement des transactions est passé de 14% en 2019 à plus de 30% aujourd’hui, et plus de 50% des flux transfrontaliers sont désormais effectués dans cette devise, contre moins de 1% en 2010. Si l’on veut savoir pourquoi Trump cherche à sortir du bourbier ukrainien, il faut moins consulter les chiffres du Trésor états-unien que les statistiques du système bancaire chinois : la Banque centrale chinoise a fourni 4,5 trillions de yuans (environ 630 milliards de dollars) de lignes de swap à 32 banques centrales, et le système de paiement CIPS, l’équivalent chinois de SWIFT, accueille désormais plus de 1 700 banques, soit une augmentation de 3% depuis 2022 et gère un volume de paiements qui ont grimpé de 43% en 2024, atteignant 175 trillions de yuans (environ 24 trillions de dollars). Quant aux prêts extérieurs des banques chinoises en yuan, ils ont triplé depuis 202217. La Chine ne s’oppose pas à la mondialisation par une réorganisation sino-centrée du marché mondial18, elle relance la mondialisation de tous les marchés en renouvelant les institutions de la finance mondialisée.
Le retour du réel après le Liberation Day
Près de huit mois après le « Liberation Day » dont Trump espérait surtout qu’il libèrerait les États-Unis des lois du commerce international, son administration semble admettre au moins que, si la hausse des droits de douanes a des effets incertains sur les prix, une baisse de ces droits doit assurément diminuer les prix des biens concernés. Aussi face à un pouvoir d’achat qui ne cesse de s’éroder, elle s’est résolue à une baisse drastique des droits de douane sur certains produits alimentaires, textiles, et même pharmaceutiques, importés d’Amérique latine.
Mais ce n’est pas tout : le « Liberation Day » devait aussi, grâce au recours à la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux (IEEA), libérer Trump du droit de regard du Congrès dans la conduite de sa guerre commerciale. Il a sans doute touché ici aux limites institutionnelles que même ses plus fervents partisans à la Cour suprême ne sont pas prêts à voir repousser. Ainsi la Cour a récemment émis un avis plus que réservé sur cet expédient, manière de mettre en doute l’urgence sécuritaire de la balance commerciale de la première puissance mondiale19. C’est pourtant bien à l’Est de l’Occident que se découvrent les grandes différences avec l’époque des Accords du Plaza : en 1985, Gorbatchev jetait, avec la perestroïka, l’URSS dans les bras sauvages du capitalisme ; en 2025, Xi Jinping invite tous les chefs d’État du Sud Global à contempler la grande armée chinoise qui bientôt montera la garde partout où transitera son commerce universel. Tandis qu’à la Maison Blanche, aujourd’hui, la spéculation immobilière a remplacé la conquête du Far West.
- Stephen Miran, « A User’s Guide to Restructuring the Global Trading System », Hudson Bay Capital, Novembre 2024 : https://www.hudsonbaycapital.com/documents/FG/hudsonbay/research/638199_A_Users_Guide_to_Restructuring_the_Global_Trading_System.pdf
 ︎
︎ - Stephen Miran, Op. Cit., p. 22.
 ︎
︎ - Un déficit courant signifie qu’un pays importe plus qu’il n’exporte de biens et services, même s’il faut inclure dans la balance courante les revenus nets comme les intérêts et dividendes, ainsi que l’aide à l’étranger.
 ︎
︎ - Les pays signataires des Accords du Plaza s’étaient engagés à stimuler la demande intérieure pour favoriser leurs importations et à intervenir sur le marché des changes par des ventes de dollars et des achats d’autres devises.
 ︎
︎ - Stephen Miran, Op. Cit., p. 26.
 ︎
︎ - https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm
 ︎
︎ - Les rendements obligataires étant fixes, une baisse du cours des obligations fait monter le taux d’intérêt et inversement.
 ︎
︎ - Stephen Miran, Op. Cit., p. 29.
 ︎
︎ - Michael Bordo et Robert McCauley, “Miran, we’re not in Triffin land anymore”, VoxEU.org, 7 avril 2025 : https://cepr.org/voxeu/columns/miran-were-not-triffin-land-anymore
 ︎
︎ - Kenneth Rogoff, « Trump’s Misguided Plan to Weaken the Dollar », Project Syndicate, 6 Mai 2025 : https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-administration-mar-a-lago-plan-to-weaken-dollar-is-deeply-flawed-by-kenneth-rogoff-2025-05
 ︎
︎ - https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/the-international-role-of-the-u-s-dollar-2025-edition-20250718.html
 ︎
︎ - Stephen Miran, Op. Cit., p. 6.
 ︎
︎ - Robert Triffin, The gold and the dollar crisis: the future of convertibility, Princeton University Press, 1960.
 ︎
︎ - Stephen Miran, Op. Cit., p. 17.
 ︎
︎ - Ibid., p. 23.
 ︎
︎ - Ibidem.
 ︎
︎ - https://www.economist.com/china/2025/09/10/china-is-ditching-the-dollar-fast
 ︎
︎ - Benjamin Bürbaumer, Chine/États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation, La Découverte, 2024.
 ︎
︎ - https://www.ft.com/content/f4420b48-0ed3-4f32-9b72-7ff90365ff93
 ︎
︎
- GÉNÉRALISTES
- Le Canard Enchaîné
- La Croix
- Le Figaro
- France 24
- France-Culture
- FTVI
- HuffPost
- L'Humanité
- LCP / Public Senat
- Le Media
- La Tribune
- Time France
- EUROPE ‧ RUSSIE
- Courrier Europe Centrale
- Desk-Russie
- Euractiv
- Euronews
- Toute l'Europe
- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient
- Haaretz
- Info Asie
- Inkyfada
- Jeune Afrique
- Kurdistan au féminin
- L'Orient - Le Jour
- Orient XXI
- Rojava I.C
- INTERNATIONAL
- CADTM
- Courrier International
- Equaltimes
- Global Voices
- I.R.I.S
- The New-York Times
- OSINT ‧ INVESTIGATION
- OFF Investigation
- OpenFacto°
- Bellingcat
- Disclose
- Global.Inv.Journalism
- MÉDIAS D'OPINION
- Au Poste
- Cause Commune
- CrimethInc.
- Hors-Serie
- L'Insoumission
- Là-bas si j'y suis
- Les Jours
- LVSL
- Politis
- Quartier Général
- Rapports de force
- Reflets
- Reseau Bastille
- StreetPress
- OBSERVATOIRES
- Armements
- Acrimed
- Catastrophes naturelles
- Conspis
- Culture
- Curation IA
- Extrême-droite
- Human Rights Watch
- Inégalités
- Information
- Justice fiscale
- Liberté de création
- Multinationales
- Situationnisme
- Sondages
- Street-Médics
- Routes de la Soie