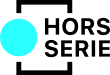04.12.2025 à 17:45
Bugonia : la soupe au miel
Texte intégral (2880 mots)

Parmi les mythes classiques de l’Antiquité grecque figure l’histoire du demi-dieu Aristaeus. Connu comme l’Apollon « pastoral », il était célèbre pour avoir instauré un rituel appelé « bugonia ». Ce rituel vit le jour après qu’Aristaeus eut remarqué que ses abeilles mouraient lentement et s’adressa aux dieux afin de repeupler ses ruches. La réponse exigeait qu’il sacrifie plusieurs taureaux, draine leur sang et laisse leurs carcasses se décomposer. Trois jours plus tard, il retourna aux autels pour y trouver de nouvelles abeilles bourdonnant autour de la chair en décomposition. Une telle épreuve était probablement inspirée par la croyance ancienne selon laquelle des créatures vivantes pouvaient surgir spontanément de la chair morte.

Les fausses croyances et les abeilles sont précisément le sujet du dernier film du réalisateur grec Yórgos Lánthimos, Bugonia, un remake du film sud-coréen de 2003 Save the Green Planet!. Mais contrairement à la notion ancienne de bugonia – tirée de l’observation directe des mouches émergeant de la chair en décomposition – les fausses croyances du protagoniste du film proviennent de l’intuition inverse. Pour Teddy, travailleur solitaire et apiculteur, le monde n’est pas ce qu’il semble être. Derrière les apparences se cache une vérité plus profonde, ce qu’il appelle un « principe organisateur plus large » qui explique tout : du coma de sa mère à la mort lente de ses abeilles. La cause de son désespoir est donc hors de son contrôle, dans une économie dirigée par de grandes entreprises impersonnelles. « Ce n’est pas nous qui dirigeons le navire, dit-il à son cousin Don, c’est eux. »

Politique à l’ère de Trump
Mais « eux », selon Teddy, ne sont pas seulement des capitalistes, mais des extraterrestres appelés Andromédiens, venus d’une autre planète pour contrôler les humains. Afin de négocier le retrait des extraterrestres de la Terre, Teddy décide d’enlever Michelle Fuller, la PDG de la société pharmaceutique pour laquelle il travaille – et qu’il croit être une Andromédienne de haut rang. Enfermée et torturée dans un sous-sol, elle reçoit l’ordre d’organiser une rencontre avec les envahisseurs avant la prochaine éclipse lunaire. Le film se transforme alors en un huis clos claustrophobe, formellement intensifié par le format étroit de l’image et l’utilisation de gros plans pendant les scènes de dialogue. Les deux personnages incarnent clairement deux types de la société américaine contemporaine : un « déplorable » paranoïaque opposé à une femme brillante, carriériste et passée maître dans l’art du double langage des relations publiques. Il est un « looser » et elle est une « winner », comme l’indiquent les dialogues. Dans ce contexte, la communication entre eux est impossible. Teddy ne s’informe plus à travers les médias classiques, mais à partir de sites web marginaux et de podcasts, tandis que Michelle lit The New York Times et suppose qu’il est mentalement malade. « Je ne peux pas te faire changer d’avis« , lui dit-elle, après avoir réalisé que tout ce qu’elle dit ne fait que confirmer sa conviction qu’elle est bel et bien une extraterrestre.

Le rebondissement le plus surprenant du film survient avec son dénouement final. Dans un revirement inattendu, nous apprenons que les extraterrestres existent bel et bien et que ce que nous pensions être les délires de Teddy, inventés pour faire face à sa vie tragique, étaient en fait réels. Michelle, le personnage joué par Emma Stone, se révèle être l’impératrice d’Andromède. Elle explique que son espèce a créé l’humanité, mais que « l’expérience » a clairement échoué, étant donné la violence et la soif de pouvoir dont font preuve les humains. Selon elle, le problème réside dans leur « gène suicidaire ». Pour y remédier, les Andromédiens ont même essayé de mettre au point un traitement destiné à reprogrammer l’ADN humain, le même traitement qui a plongé la mère de Teddy dans le coma. Mais après avoir découvert que Teddy avait torturé et tué des dizaines d’autres personnes, dont deux extraterrestres, et que le projet visant à changer la nature humaine avait échoué, Michelle retourne au vaisseau mère et décide d’exterminer l’humanité.

Allégories de la totalité
Le film s’inscrit manifestement dans le genre plus large des films conspirationnistes tels que The Parallax View d’Alan Pakula (1974), Invasion of the Body Snatchers de Philip Kauffman (1978) et They Live de John Carpenter (1988). Dans ces films, les extraterrestres ou les conspirateurs sont généralement dépersonnalisés afin de pouvoir les faire fonctionner efficacement comme métaphores du « système ». On peut considérer ces films comme une tentative de thématiser le conflit dans le capitalisme tardif, c’est-à-dire une contradiction qui ne peut plus s’exprimer en termes de lutte des classes. Pour les travailleurs atomisés, la théorie du complot fournit une « fiction utile » pour saisir la totalité sociale elle-même. Il s’agit, comme l’a si bien écrit Fredric Jameson, de « la cartographie cognitive des pauvres à l’ère postmoderne« . Comme Teddy le déclare lui-même dans Bugonia, il n’est pas un « activiste » et il n’y a pas de « mouvement » : il a mené seul « une tonne de recherches » prouvant que « tout est lié ».

À une époque où la fragmentation sociale s’est considérablement intensifiée et où la capacité des travailleurs à agir collectivement a été radicalement sapée, les théories du complot apparaissent comme des tentatives désespérées d’individus impuissants pour représenter la logique abstraite du capital. Elles doivent être considérées comme le symptôme du fait que les individus sont submergés d’informations mais ne disposent pas d’une théorie leur permettant de donner un sens à l’ensemble disparate d’événements qui façonnent leur vie.
Comme Theodor Adorno l’avait lui-même observé en analysant la diffusion de l’astrologie, les sociétés capitalistes avancées présentent « d’une part, une richesse matérielle et intellectuelle, mais la relation est davantage celle d’un ordre formel et d’une classification que celle qui permettrait d’éclairer les faits par l’interprétation et la compréhension« . En d’autres termes, l’astrologie comble ce vide en offrant un moyen de donner un sens aux « faits ». Jacques Rivette a un jour fait remarquer que « le changement le plus crucial qui touche notre civilisation est qu’elle est en train de devenir une civilisation de spécialistes ». « Chacun d’entre nous », a-t-il ajouté, « est de plus en plus enfermé dans son petit domaine et incapable d’en sortir« . Dans un tel contexte, la tâche de l’humanité consiste précisément à lutter contre cette tendance et à essayer « de rassembler les fragments épars de la culture universelle qui est en train de se perdre ». Le récit conspirationniste dans les films des années 70 et 80 avait, de ce point de vue, une double fonction : d’une part, il représente une forme dégradée de conflit de classe dans le capitalisme tardif ; d’autre part, il indique la tentative du récit ou du film lui-même de sauver l’idée même de totalité. Le héros assume généralement le rôle de détective, permettant au public d’imaginer ce que pourrait signifier le fait de rassembler ce qui a été fragmenté. En d’autres termes, le film va à l’encontre de la logique du capital en allégorisant le sens de l’ensemble.
Platitudes libérales
Mais c’est là que Lánthimos s’écarte sérieusement d’une telle ambition. La structure du film inverse la logique habituelle : le rebondissement final révèle que, plutôt que de fonctionner comme une métaphore de la totalité sociale, la conspiration ne renvoie qu’à elle-même, comme un effet de l’effondrement de la confiance et de la corruption de la sphère publique par les fausses nouvelles. Comme Lánthimos l’a indiqué aux critiques, « la dystopie (…) n’est pas vraiment fictive », mais « reflète plutôt le monde réel ». Si la fin rend la conspiration réelle, et place donc le film dans ce genre, elle sert en fin de compte un objectif externe : tromper le spectateur. Fidèle aux platitudes libérales sur la désinformation et la polarisation, Lánthimos utilise le film comme un dispositif moral pour nous confronter à nos propres préjugés. Comme il l’explique, il « remet en question tous ces préjugés que nous avons sur les gens, qui sont renforcés par la technologie et la compartimentation ». En d’autres termes, en rendant la conspiration réelle, il veut que nous reconnaissions en nous-mêmes les mécanismes psychologiques qui poussent Teddy à y croire. Le fait de penser qu’il était paranoïaque révèle nos propres préjugés. Mais ce faisant, plutôt que de transcender une analyse psychologique de notre présent (tout provient de nos préjugés psychologiques innés et des algorithmes), le film l’embrasse.

De plus, l’opposition entre Teddy, le personnage solitaire joué par Jesse Plemons, et l’extraterrestre a un objectif ambigu. D’une part, elle fonctionne clairement comme une métaphore du conflit de classes dans une société démobilisée. D’autre part, Lánthimos sape cette idée même en dépeignant les deux personnages comme assez similaires, afin de servir son propre message pessimiste. Tous deux sont en fait des créatures sans pitié, marquées par un manque d’empathie et de remords. Teddy se « castre » chimiquement pour se débarrasser de ses « compulsions psychiques », tandis que le personnage d’Emma Stone traite les humains comme de simples rats de laboratoire.

Un cinéma misanthrope
La scène finale – qui s’écarte de la version sud-coréenne où la planète entière est détruite – montre une Terre paisible sans humains vivants, accompagnée de la chanson de 1962 Where Have All the Flowers Gone? : « Quand apprendront-ils enfin ? », interroge la chanson, transformant ce qui aurait pu être une fiction utile sur les conspirations et le capitalisme en une série de platitudes sur la nature humaine. Elle nous offre une fin misanthrope mais incohérente, car l’idée même d’une planète mieux lotie sans les humains est déjà une façon de l’humaniser. En d’autres termes, de lui appliquer un jugement proprement humain. Et c’est peut-être là que réside la véritable limite du cinéma de Lánthimos. Son esthétique désormais caractéristique et son engagement envers l’absurde servent généralement à dissimuler des banalités que l’on pourrait acheter dans n’importe quelle librairie d’aéroport. La surcharge visuelle, la théâtralité stylistique et la mise en scène exagérée ne parviennent guère à masquer le fait qu’il n’a pas grand-chose à dire : l’extravagance est une piètre alternative à l’originalité.
Une version initiale de ce texte a été publiée en anglais sur Sabzian
Pour prolonger
01.12.2025 à 21:15
Contre un maccarthysme à la française – pour tous les Julien Théry à venir
Texte intégral (9723 mots)
À la suite d’un communiqué mensonger paru le 21 novembre sur le compte X de la LICRA, repris dans une publication du journal Lyon Capitale (et depuis, par de très nombreux médias), l’historien Julien Théry est l’objet depuis plusieurs jours d’une violente campagne de diffamation et de harcèlement, d’insultes et de menaces de mort. Une situation d’autant plus préoccupante que l’adresse précise de son lieu de travail a été divulguée par Lyon Capitale, constituant un risque pour sa sécurité. Son Université de rattachement s’est immédiatement désolidarisée de lui publiquement et a effectué un signalement au Procureur de la République
La publication de la LICRA est un montage d’un post Facebook réalisé par Julien Théry le 20 septembre dernier, où il relayait la longue analyse faite par Sophie Trégan de la « lettre de la honte », cette tribune de 20 personnalités publiée dans le Figaro demandant au Président Emmanuel Macron de « ne pas reconnaître un État palestinien sans conditions préalables ». Rappelant un certain nombre de faits avérés et reconnus par les instances internationales, Sophie Tregan concluait ainsi : « quand on conditionne la reconnaissance d’un État à la libération de 49 otages au mépris de la vie de plus de 1,5 million de personnes en proie à un génocide, c’est ni plus ni moins qu’une hiérarchisation des vies humaines selon leur origine ethnique, du suprémacisme ». Julien Théry a reposté le texte, en copiant-collant la liste des signataires de la tribune, qui circulait alors partout à ce moment-là, et a ajouté « génocidaires à boycotter ». La LICRA a soigneusement omis le post initial, donnant ainsi l’impression que l’historien avait « fait une liste » de noms, au hasard, sans raison particulière. Et elle a ajouté ce commentaire : « On peut être professeur d’Université, se croire progressiste et faire des listes de noms comme sous l’Occupation ». L’effet de ce montage irresponsable de la LICRA a été de déclencher une campagne de harcèlement.
Mais pourquoi une telle démarche de la LICRA, maintenant, alors que le post initial qu’elle a tronqué avant de le diffuser est vieux de deux mois ? Réponse : cette offensive de la LICRA semble intervenir en représailles à la publication, sur le site Hors-Série.net le 23 octobre dernier, d’un chapitre de son livre intitulé En finir avec les idées fausses sur l’histoire de France paru le 17 octobre dernier aux éditions de l’Atelier. L’article en question – dont le rédacteur en chef du journal de la LICRA, Emmanuel Debono, a rapidement tenté une dénonciation sur le site Conspiracy Watch – est une réfutation de l’idée selon laquelle il existerait aujourd’hui un « antisémitisme de gauche », menée à partir d’une synthèse approfondie de l’histoire de l’antisémitisme, en particulier depuis le début du XIXe siècle. La conclusion en est (sans originalité) qu’il peut évidemment y avoir des cas d’antisémitisme de la part d’individus qui appartiennent à la gauche (antisémitisme à gauche, selon la distinction de Michel Dreyfus), mais que, depuis le tournant de l’Affaire Dreyfus, la gauche a abandonné l’antisémitisme pour des raisons structurelles, alors que la droite nationaliste, à l’inverse, a été et demeure structurellement antisémite. Plus douloureux : le texte conclut aussi que l’irruption de l’idée d’un « antisémitisme de gauche » dans le débat public depuis à peine plus de deux décennies est liée à la radicalisation de l’entreprise sioniste en Palestine depuis l’assassinat d’Itzhak Rabin et l’abandon des accords d’Oslo. La notion d’« antisémitisme de gauche » vise ainsi en réalité à neutraliser les oppositions à cette entreprise en les rabattant sur le judéocide européen de 1941-1945.
Depuis l’ébullition médiatique provoquée par la tribune des 20 signataires, moment où paraissent l’analyse de Sophie Trégan et le post de Julien Théry, les otages israéliens ont tous été libérés. Force est de constater que la guerre ne s’est pas terminée pour autant. Chaque jour, des dizaines de Palestinien.nes continuent de mourir, sous les bombes ou les balles des snipers, ce qui montre bien que l’enjeu dépassait les otages et concerne le nettoyage ethnique en vue de ce qui serait une colonisation totale de la Palestine. Quiconque souligne sérieusement cet état de fait se voit systématiquement exposé à l’accusation d’antisémitisme.
L’article de Julien Théry, qui démonte cette idée d’un « antisémitisme de gauche », est donc dérangeant pour les soutiens à l’État d’Israël et leurs stratégies de communication.
Nous assistons depuis quelques semaines à une nouvelle offensive générale contre la liberté des universitaires d’étudier et analyser la situation en Palestine. La LICRA et notamment Emmanuel Debono sont parvenus à faire annuler la tenue au Collège de France du colloque organisé par Henry Laurens. La campagne lancée contre Julien Théry par la LICRA poursuit cette attaque. Il est particulièrement inquiétant de constater que l’ensemble des grands médias reprend à son compte les accusations mensongères de la LICRA sans effectuer la moindre vérification.
Faute de réaction rapide de la communauté universitaire, cette vague de censure et de Maccarthysme à la française (voir également l’entreprise annoncée par le ministère revenant à ficher les universitaires sous couvert d’ « enquête nationale sur l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur et la recherche ») posera une chape de plomb sur la recherche et la vie intellectuelle. Le risque est alors de réduire les universitaires et les chercheurs à des agents d’une propagande d’État.
Signataires
Cette tribune dépasse désormais les 1500 signatures. Seules les 800 premières figurent ici. Pour une liste à jour, consulter la version publiée par le site de l’Union Juive Française pour la Paix ; elle est par ailleurs toujours ouverte à signature ; pour signer, envoyez un mail à soutienthery@gmail.com
* : personnalité politique
Signatures individuelles
Géraldine A Tagi
Samy Abbes, Mathématicien, MCF, Université Paris Cité
Kamil Abderrahman
Pierre Abécassis, Médecin, membre de l’Union juive française pour la paix
* Nadège Abomangoli, Première vice-présidente de l’Assemblée nationale
Albert Achten, Ingénieur
Éloïse Adde, Associate Professor, Historienne
Bernard Aghina
Najat Aguidi, écrivain
Sara Angeli Aguiton, Chargée de recherche CNRS, PHEEAC, Université des Antilles
Bérénice Alaterre
Michel Albagnac
Pierre Albertini, Historien, professeur de khâgne
Gérard Alegre, Illustrateur
Gadi Algazi, Historien, Dept of History, Tel Aviv University
Benjamn Alison
Eric Alliez, Philosophe, Professeur, Université Paris 8
Matthieu Allingri, Maître de conférences en histoire médiévale, université d’Aix-Marseille
Sarah Al-Matary, Professeur des Universités, Lettres, Le Havre
Tuna Altınel, MCF en Mathématiques, Université Lyon 1
Bruno Alonso, CNRS, Montpellier
Sabia Amar
* Gabriel Amard, Député du Rhône
Anne-Laure Amilhat Szary, Université Grenoble Alpes
Daniel Amoros
* Farida Amrani, Députée de l’Essonne
Aurélie Dianara Andry, Historienne
Jean-Christophe Angaut, Maître de conférences de philosophie, École Normale Supérieure de Lyon
Celine Aranjo, infirmière
Fabien Archambault, Historien, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Fanette Arnaud, Médiatrice
Alain Arnaudet
Mathieu Arnoux, Historien, Professeur à l’université Paris Cité
Isabelle d’Artagnan, Présidente de l’IRELP, Historienne associée à Sorbonne Université
Florent Arthaud, OFB – USMB – INRAE
* Raphaël Arnault, Député du Vaucluse
Loïc Artiaga, Professeur en histoire contemporaine, Université de Pau
Jean Asselmeyer, Réalisateur
Simon Assoun, militant décolonial
Agnès Astrup
Marie-Andrée Auclair, retraitée Éducation Nationale
Samuel Autexier, Éditeur, Forcalquier
Azadî
Igor Babou, Professeur à l’université Paris Cité
Danielle Bailly-Salins, Enseignante retraitée
Christophe Baixas, Ingénieur Architecte dans l’industrie navale
Viviane Baladier, Mathématicienne, Directrice de recherches au CNRS à la retraite
Étienne Balibar, Philosophe
Bernard Barthalay, Économiste, Enseignant-chercheur à la retraite
Marie-Joëlle Barthuet, retraitée
Vincent Basabe
Isabelle Beaurepaire, Professeur
Jean-Luc Becquaert, Retraité, Syndicaliste, Tarn-et-Garonne
François Bégaudeau, écrivain
Gabriel Bellego, étudiant
Marina Belney-Ruiz
Leïla Benabed, Travailleuse sociale
Malika Benarab Attou, Ex-Eurodéputée
Yazid Ben Hounet, Anthropologue, Chargé de recherche-HDR CNRS, Lab. d’Anthropologie Sociale
Maxime Benatouil, Militant à Tsedek !, enseignant
Omar Benderra, Économiste, membre d’Algeria Watch
Laila Benderra, Pédiatre
Yassir Benhima, Professeur, Université Lyon 2
Christian Benedetti, Acteur et metteur en scène
Christophe Benoit, professeur agrégé d histoire
Fabrice Bensimon, Sorbonne Université
Souad BENT-ABBES, chargée d’études au MEN
Badis BENYAHIA, Chef d’établissement scolaire public retraité
Philippe Bérard, Ingénieur
Bertrand Berche, EC, Université de Lorraine
Daniel Beretz, Retraité recherche publique
Jean Berger, enseignant et Historien
Judith Bernard, Enseignante
Noël Bernard, MCF Mathématiques retraité, poète.
Bertand Bernier, Chargé de production
Eric Berr, Économiste, Université de Bordeaux
Nathalie Berriau
Vincent Berthelier, MCF Lettres, Université Paris Cité
Arno Bertina, écrivain
Antoine Bertrand, Attaché de presse indépendant
Florian Besson
Philippe Besson
Magali Bessone, Professeure de philosophie politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Lorenzo Bianchi, Cinéaste, Producteur, Enseignant à l’Université Gustave Eiffel
Giuseppe Bianco, Philosophe, maitre de conférences à l’Université Ca’ Foscari de Venise
Gaëlle Bidan, directrice des Éditions de l’Atelier
Alain Bihel, journaliste
Alain Bihr, Sociologue, Professeur honoraire, Université de Bourgogne Franche-Comté
Sylvain Billot, statisticien économiste
Bertrand Binoche, Professeur émérite, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Antonia Birnbaum, Professeure de philosophie, Université Paris 8
Daphné Bitchatch, artiste peintre, auteure
Magali Bizot, écrivain occitan, enseignante retraitée
Julien Blanc, Anthropologue, Maitre de Conférences du Muséum National d’Histoire Naturelle
Max Blechman, Directeur de programme, Collège International de Philosophie
Alexia Blin, MCF en Histoire des États-Unis, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3
Étienne Bloc, Scénariste
Suzette Bloch, petite fille de Marc Bloch, ancienne journaliste à l’AFP
Erick Boiron, Ancien étudiant à l’Univ. Lyon 2
Livio Boni, psychanalyse, ancien dir. de programme au Collège international de philosophie
Christophe Bonneuil, Historien, DR CNRS
Arminé Boranian
Rachele Borghi, Sorbonne Université
Sylviane Borie, Retraitée
Yannick Bosc, Historien, Université de Rouen Normandie
Véronique Bontemps, Anthropologue, CR CNRS, IRIS
Najla Bouakline, Normalienne, étudiante en Histoire Médiévale, ENS de Lyon
Saïd Bouamama, Sociologue
Abdel. H. Boudoukha, Pr. Psychologie clinique, Psychopathologie et Psychothérapie
Fadila Boucherak
Jean-Christophe Boucly, Professeur de lettres modernes en lycée, docteur de l’École Pratique des Hautes Études
Sylvie Bouffartigue, Professeure des universités, études culturelles latino-américanistes et caribéennes. UVSQ-Paris Saclay.
Jean-Claude Bourdin, Professeur émérite de philosophie à l’Université de Poitiers
Vincent Bourdin, Ingénieur de recherches, CNRS – GeePs – Centrale – Supélec
Jérôme Boutin, gestionnaire de contrat de prévoyance
Boris Bove, Professeur d’Histoire médiévale, Université de Rouen Normandie
Gérard Bras, Philosophe, ancien professeur de classes préparatoire
Rony Brauman, Ancien président de Médecins sans frontières
Mark Bray, Assistant Teaching Professor, History Department, Rutgers University-New Brunswick
Jean Paul Brenelin, Chef d’entreprise, militant assiciatif
Thierry Brésillon, journaliste
Iléna Briday, Étudiante
Charlotte Brives, Directrice de Recherche CNRS, Anthropologue
Déborah V. Brosteaux, Chercheuse et enseignante à l’Université Libre de Bruxelles
Michel Broué, Mathématicien, professeur émérite à l’Université Paris Cité
Guy Bruit
Anne Brunswic, Journaliste et écrivaine
Déborah Bucchi, Université de Lorraine
Sebastian Budgen, Éditeur
Emmanuel Burdeau, Critique
Pascal Buresi, Historien, Directeur de Recherche CNRS
Julien Bugli
Laurence Burger, enseignante dans le secondaire
* Pierre-Yves Cadalen, député du Finistère
Séverine Cadier, artiste
Michel Calvès, retraité SNCF, syndicaliste
Monique Calvi
Pascale Camuset, citoyenne
Daniel Candas
Viviane Candas, cinéaste
Marco Candore, comédien, auteur
François Cansell, Professeur des universités, Bordeaux INP
Rémy Cardinal, Artiste musicien, militant Réseau salariat
*Aymeric Caron, Député
Damien Carraz, Historien, Professeur à l’Université de Toulouse Jean-Jaurès
Lucette Castarlenas
Thierry Caruana, instituteur retraité
Arthur Casas, ENS Lyon
Irène Catach, Directrice de recherches émérite au CNRS
Simonetta Cerrini, Historienne
Myriam Chaabane
Gaëtane Chammas-Breysse, étudiante
Alexis Charansonnet, Historien à la retraite, Université Lumière Lyon 2
Marc Chavassieux
Catherine Chavichvily, Collectif Palestine 69
Christine Charretton, Maîtresse de Conférences Honoraire
Denis Chartier, Géographe, Professeur des universités à l’Université Paris Cité
Francis Chateauraynaud, Sociologue, Directeur d’études à l’EHESS
Claire Chatelain, Chargée de recherches, habilitée,CNRS, Centre R. Mousnier/Sorbonne Université
Estelle Chauvey, IDE en hôpital psychiatrique
Sébastien Chauvin, Sociologue, Université de Lausanne
Sylvie Chazalette
Jean-François Chazerans, Professeur de philosophie
Farah Cherif Zahar, Maîtresse de conférences, Université Paris 8
Jean-Jacques Cheval, Professeur émérite des Universités, Université Bordeaux Montaigne
Sylvie Chevallier
Lucien Chich
Jacques Chiffoleau, Historien
Lounes Chiki, DR1 CNRS, Évolution et diversité biologique, UMR5300, Toulouse, UT3
* Sophia Chikirou, députée de Paris
Yves Chilliard, chercheur INRAE retraité
Mona Chollet, journaliste, essayiste
Guillaume Cingal, Maître de conférences en littératures africaines et traducteur.
Jocelyne Clavelloux
Jean-François Clopeau, Retraité de l’enseignement
* Hadrien Clouet, député de la Haute-Garonne
Isabelle Cochelin, Historienne, Université de Toronto
Deborah Cohen, MCF, histoire, Université de Rouen
James Cohen, Sciences politiques, Professeur émérite, Sorbonne Nouvelle
Sandra Cohuet, Médecin
Chrystel Colomb, professeure de lettres modernes, retraitée
Sonia Combe, historienne, Berlin
Marie-Hélène Congourdeau, Historienne
Pascal Connan, Instituteur retraité
Marie Constant, Pair aidante familiale
Anne Coppel, sociologue
Natacha Coquery, Historienne, Professeure émérite à l’université Lumière Lyon 2
Laurent Cordonnier, économiste, Professeur à l’Université de Lille
Jonathan Cornillon, Maître de conférences en Histoire romaine, Sorbonne Université
Christophe Cornut, CR / CNRS en Mathématiques
Bryan Cosman
Marie Cosnay, écrivaine
Christian Coudène, Professeur de Sciences Economiques et Sociales
Céline Coudreau
*Jean-François Coulomme, Député de la Savoie
Magali Coumert, Professeure d’Histoire, Université de Tours
Julien Cranskens, Libraire
Julien Crépieux, Artiste
Alexis Cukier, Maître de conférences en philosophie, Université de Poitiers
Benoit Cursente, Dir. de recherche CNRS retraité- UMR FRAMESPA, Université Jean Jaurès Toulouse
André Curtillat
François Cusset, Historien
Thomas Cuvelier, Doctorant en Sociologie, Université de Paris 8 Vincennes Saint Denis
Philippe Cuziol
Xavier Czapla, Comédien et metteur en scène
Jeanne Da Col Richert, Strasbourg
Maxime Da Silva, Co-Président du Réseau national des élu·es insoumis·es et citoyen·nes
Nicolas Da Silva, Économiste
Ahmed Dahmani, militant des droits humains
Jocelyne Dakhlia, historienne et anthropologue
Marie-Émilie Dalby, Libraire
Olivia Martina Dalla Torre, PhD
Anne Dauphiné
Sonia Dayan Herzbrun, Professeur émérite, Université Paris Cité
Hélène Débax, Professeur d’histoire médiévale, Université Toulouse 2 Jean-Jaurès
Régine Dejour, Professeur d’EPS, retraitée
Yann Dejugnat, Maître de conférences, Historien, Université Bordeaux Montaigne
Christian Delacroix, Historien
Alexis Delahaye, réalisateur
Frédéric Delarue, Docteur en histoire contemporaine
Sameh Dellaï, MCF
Irène Delorme, Étudiante
Guillaume Delteil, Professeur agrégé d’Histoire, Montpellier
Camille Deltombe, Éditrice
Thomas Deltombe, Éditeur
Marc Demyttenaere, retraité
Laurent Denave, Chercheur indépendant en sciences sociales
Camille Descombes, Professeur des écoles dans les Alpes-de-Haute-Provence
Vinciane Despret, Philosophe, Professeur associé émérite, Université de Liège
Pierre-Marie Dessaint, retraité
Rosa Maria Dessi, Historienne, Professeur, Université de Nice
Yveline Dévérin, MCF géographie, retraitée Université Toulouse 2
Issahnane Djamal, Militant antiraciste, syndicat Solidaires.
Adrien Delespierre, MCF de sociologie,Université de Tours
Emmanuel Deragne
Karima Direche, Historienne, directrice de recherche CNRS
Sophie Djigo, Philosophe, directrice de recherche au Collège international de Philosophie
Alain Dontaine, retraité Université Grenoble Alpes, enseignant en géopolitique
Françoise Doray, Professeure d’Histoire retraitée
Charles Doron, Retraité
Coline Dottin, étudiante de l’ENS de Lyon
Yann Dourdet, Enseignant en Philosophie
Ariane Dreyfus, poète
Bruno Drweski, Professeur d’université, responsable de la Commission internationale de l’Union pour la Reconstruction Communiste.
Quentin Dubois, Doctorant et enseignant vacataire. Département de philosophie Paris 8
Nicolas Duffour, Journaliste
Yoann Dumel-Vaillot, Docteur en philosophie, Université Lyon III
Stéphane Dumouchy, syndicaliste, SUD PTT
Olivier Dumoulin, historien, Professeur des Universités
Dominique Dupart, MCF Littérature française, Lille
Alexandre Dupont, MCF en histoire contemporaine, Université de Strasbourg
Laure Dupuis, Éducatrice spécialisée
Cédric Durand, Professeur Associé d’Économie Politique, Université de Genève
Marie Duret-Pujol, MCF d’Études Théâtrales, Université Bordeaux Montaigne
Vincent Édin, Journaliste et esssayiste
Ivar Ekeland, ancien Président de l’Université Paris-Dauphine
Ilias El Faris – Scénariste, réalisateur
Lina El Soufi, Doctorante en sociologie
Jean-Christophe Eon, écrivain
Camille Escudero, libraire
Frédéric Espi, militant insoumis
Marine Etchecopar, Libraire
Sylvain Excoffon, Maître de Conférences, Université Jean Monnet, Saint-Etienne
Isabelle Fakra
Jules Falquet, Professeure, Université Paris 8 St Denis
Marie Fare, Maitresse de Conférences en Économie, Université Lyon 2
Pierre Fargeton, Enseignant-chercheur, Musicologie, Université Jean-Monnet
Éric Fassin, Sociologue, Professeur à l’Université Paris 8 Saint-Denis
Sonia Fayman, porte-parole de l’Union Juive Française pour la Paix
Georges Yoram Federmann, Psychiatre Gymnopédiste, Strasbourg
* Mathilde Feld, députée de la Gironde
Mohamed Chérif FERJANI, Professeur Honoraire Université Lyon2, Président du Haut Conseil Scientifique de Timbuktu Institute, African Center for Peace Studies
Mathieu Ferradou, MCF en Histoire Moderne, Université Paris Nanterre
Elvire Ferrand Testoni, Éducatrice
Jérémy Ferrer, Bron
Olivier Filleule, Dir. de recherches au CNRS, Prof. ordinaire en sc. pol. à l’Université de Lausanne
Aline Fintz, Ingénieure d’étude, Univ. de Savoie Mont Blanc
Karin Fischer, Professeure des Universités en études irlandaises et britanniques, Université d’Orléans
Virginie Foloppe, Sorbonne Nouvelle
Jacques Fontaine, MCF honoraire de Géographie, Université de Besançon
Arnaud Fossier, Historien, MCF Université de Bourgogne
Maryline Fouché
Isabelle Fouquay, Professeure agrégée d’anglais retraitée
Benoît Fourchard, Écrivain
Françoise Fressonnet, anthropologue
Bernard Friot, Économiste
Marie-Paule Fristot-Rousselot, retraitée de l’Éducation Nationale
Yves Fruchon, Humaniste, consultant retraité
Nora Galland, ATER, Université de Bretagne Occidentale
Davide Gallo Lassere, MCF en Politique Internationale, Université de Londres
Fanny Gallot, Historienne
Michelle Garcia, UJFP
Blanche Gardin, Humoriste, Actrice
Jocelyne Garnier
Julie Garnier, Historienne
Sébastien Garnier, MCF Paris 1
Isabelle Garo, Philosophe
Marina Garrisi, Éditrice
Aurore Gathérias, enseignante
Frank Gaudichaud, Professeur, Hist. et études latino-américaines à l’Univ. Toulouse Jean-Jaurès
Guillaume Gaudin, Professeur d’Histoire moderne, Université Toulouse Jean Jaurès
Jean-Luc Gautero, Maître de conférences émérite en Philosophie des sciences, Université Côte d’Azur
Florence Gauthier, Historienne de la Révolution française
Siegfried Gautier, enseignant
Xavier Gautier
Marylène Gauvin
Andrée Gaye, Retraitée Éducation nationale
Vincent Gayon, Universitaire
David Geoffroy, Auteur – réalisateur
Sylvain George, Cinéaste
Christakis Georgiou, MCF contractuel, Institut d’Études Européennes, Université Sorbonne Nouvelle
Isabelle Gérard, Enseignante retraitée
Valérie Gérard, professeure de philosophie en CPGE
Catherine Ghidaoui
Pascale Gillot, MCF-HDR en philosophie, Université de Tours
Carlo Ginzburg, Historien
Marc Girod, retraité
Éric Gobe, politiste, directeur de recherche au CNRS
Jean-Christophe Goddard, Professeur des Universités, Université de Toulouse 2 Jean Jaurès
François Godicheau, Historien, Professeur à l’Université de Toulouse Jean-Jaurès
Catherine Goldstein, DRCE émérite, Histoire des sciences mathématiques
Lionel Goutelle, retraité de l’éducation nationale
Isabelle Goutmann, directrice d’un média local & indépendant
Massimo Granata, Ingénieur de recherche CNRS
Corinne Grassi, chargée de projets socio-culturelle
Jordi Grau, Citoyen et Professeur de philosophie
Jean-Guy Greilsamer
Patrice Grevet, Professeur honoraire de sciences économiques à l’Université de Lille
Haud Guéguen,
Nacira Guénif, Professeure des Universités, Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, LEGS
* Clémence Guetté, Vice-présidente de l’Assemblée nationale
Claude Guilbaud, Enseignant retraité
Mourad Guichard, Journaliste indépendant
Georges Günther, militant associatif
Patrick Guyot Bitchatch, ancien administrateur de l’État dans les ministères sociaux
Emilie Hache, Maîtresse de conférences HDR
Olivier Hache
Gérard Haddad, Psychiatre, Psychanalyste, Écrivain
Rachid Hadjij, Consultant
Jean-Louis Haguenauer, pianiste, Professor Emeritus, Indiana University Jacobs School of Music
Ouassim Hamzaoui, MCF Science politique, Avignon Université
Sari Hanafi, Prof. de Sociologie, American University of Beirut
Colette Hasne, Doctorante
Fabrice Hauet, masseur bien-être
Clémence Hébert, Cinéaste
Xavier Hélary, Historien, Professeur, Sorbonne-Université
Frédéric Hélein, Professeur (Mathématiques), Université Paris Cité
Annick Hemon, Chanteuse Comédienne
Antoine Hennion, École des Mines, Paris
Odile Henry, Sociologue, Professeure à Paris 8
Nicolas Hensel, assistant d’enseignement artistique
Marie Hesse, enseignante
Thomas Hippler, Professeur d’Histoire contemporaine à l’Université de Caen Normandie
Géraldine Hornberg, membre de l’Union juive française pour la paix
François Houbart, Psychologue
Jean-Claude Houdry, artiste auteur
Arnaud Houte, Professeur d’histoire contemporaine, Sorbonne université
Etienne Hubert, Historien, Directeur d’études retraité de l’EHESS
ANNE Huck, Enseignante
Quentin Humbert, étudiant ENS Lyon, étudiant du master Mondes médiévaux
Benoit Huou, enseignant à TSE, Université Toulouse Capitole
Cassandre Hypeau, Étudiante
Sébastien Ibanez, Enseignant-chercheur, Université Savoie Mont Blanc
Nicole Ion, éducatrice retraitée
Georges Jablonski-Sidéris, Maître de conférences en histoire médiévale, Sorbonne Université
Laure Jabrane, enseignante de philosophie, retraitée, membre de la CAALAP
Ronan Jacquin, chercheur, Institut de hautes études internationales et du développement (Genève)
Armand Jamme, Historien, Directeur de recherches au CNRS
Chantal Jaquet, Philosophe, Professeure émérite à l’université Paris 1 Panthéon -Sorbonne
Ghislaine Jarrige, LFI Saint Etienne
Jacques Jaudon, enseignant
Sylvain Jean, Enseignant
Anne Jollet, Maîtresse de conférences émérite en Histoire moderne
Philippe Josserand, Historien, Professeur, Université de Nantes
Pierre Yves Joubaud, Directeur d’usine
Maïwenn Jouquand
Emmanuelle Jourdan-Chartier, Enseignante en histoire, Université de Lille
Nolwenn Joyaut , enseignante et scénographe
Alain Jugnon, Philosophe
Cathy Jurado, Autrice, enseignante
Nicole Kahn, membre de l’Union juive française pour la paix
Yannis Karakos, Auteur et Parolier
Razmig Keucheyan, Professeur de Sociologie, Université Paris Cité
Khalil Khalsi, Chercheur
Anna Knight, traductrice
Aurore Koechlin, MCF de Sociologie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Marianne VL Koplewicz, Éditions du Souffle
Théophile Kouamouo, Journaliste
Stathis Kouvelakis, Philosophe
Abir Kréfa, Maîtresse de Conférences en Sociologie, Université Lyon 2
Thierry Labica, MCF Civilisation britannique
* Abdelkader Lahmar, Député du Rhône
* Bastien Lachaud, Député de la Seine-Saint-Denis
Annie Lacroix-Riz, Professeur émérite d’hist.contemporaine, Paris-Cité, petite-fille de Benjamin Arbessman, déporté et assassiné à Auschwitz
Annie Lafarge, Militante LFI
Danielle Lafont
Claire Lagraula
* Maxime Laisney, Député LFI de Seine-et-Marne
Elisabeth Lalou, Professeur d’Histoire médiévale, Université de Rouen
Claire Lamy, MCF Histoire du Moyen âge, Sorbonne Université
Emilie Lanciano, Professeur des Universités, Sciences de gestion, Université Lyon 2
Diego Landivar, Enseignant – Chercheur, HDR, Origens Media Lab et Esc Clermont
Hervé Langlois, militant à l’AFPS
Yann Lardeau, cinéaste.
Galatée de Larminat, Chercheuse indépendante en Philosophie et Journaliste
Ramdane Lasheb, membre associé LIAgE
Maurice Latapie
* Pierre Laurent, Sénateur Honoraire
Sabine Laurent, Enseignante retraitée
Michel Lauwers, Historien, Professeur, Université de Nice
Christian Lavault, Professeur de Universités
Vincenzo Lavenia, Historien, Professeur d’hist. moderne, Univ. de Bologne, Italie
Cécile Lavergne, MCF en Philosophie université de Lille
Clément Lavis, étudiant
Isabella Lazzarini, Professeure d’Histoire médiévale, Université de Turin
Judith le Blanc, Maîtresse de conférences, Université de Rouen Normandie
Olivier Le Cour Grandmaison, Historien, politiste, universitaire
Anne Le Guennec, Libraire
Joëlle Le Marec, Professeure, Muséum National d Histoire Naturelle
Vincent Le Texier, Artiste lyrique
Sébastien Lebonnois, Planétologue, Directeur de Recherche CNRS
Jean-Jacques Lecercle, Philosophe, Linguiste, Ancien Prof. à l’Univ. Nanterre
Michelle Lecolle
Xavier Lecoq, Enseignant
Jérémy Lefebvre, Écrivain et Musicien
Julien Lefevre, Photographe
* Sarah Legrain, députée de Paris
* Jérôme Legrave, député de Seine-Saint-Denis
Jean-Marc Lelièvre, CR INRAE
Yves Lemarié, Maître de conférences à l’Université de Bretagne Occidentale
Claire Lemercier, Directrice de recherche en histoire, CNRS
Benjamin Lemoine, Chercheur, CNRS
Jean-Michel Lemoine, ingénieur CNES
Clément Lenoble, Historien
François Lescure, ancien Professeur à l’Université de Lille
Didier Lestrade, co-fondateur d’Act Up-Paris
Laurent Lévy, Avocat à la retraite
Cathy Liminana-Dembélé
Pierre Linguanotto, Cinéaste
Thomas Lienhard, MCF en histoire, Université Panthéon-Sorbonne
Chantal Locatelli
Henri Lombardi, MC en Mathématiques, retraité, à l’Université Marie et Louis Pasteur
Élisabeth Longuenesse, Sociologue arabisante, CNRS (retraitée)
Frédérique Longuet Marx, Anthropologue, Cetobac, Ehess
Helios Lopez
Isabelle Lorand, Chirurgienne
Françoise Lorcerie, DRE science politique, Aix-Marseille Université
Yannick Louesdon, Psychanalyste retraité
Michael Lowy, Sociologue
Viviana Lipuma, Postdoctorante à UFF Brésil, Docteure en philosophie de l’Univ. Paris Nanterre
Arnaud Le Gall, député du Val d’Oise
Katia Le Mentec, Anthropologue, chargée de recherche au CNRS
Frédéric Le Roux, Mathématicien, Professeur à Sorbonne Université
Frédéric Lordon, Philosophe
Jean-Pierre Loustau, Ingénieur
Sandra Lucbert, écrivaine
Marie-Christine Luparello, membre de la Libre Pensée 79 et du Collectif Palestine 79
Armelle Mabon, Historienne
Fanny Madeline, Historienne, MCF, Université Panthéon-Sorbonne
Marta Madero, Ancien professeur de l’Universidad de Buenos Aires et de l’Universidad Nacional de General Sarmiento
Elisabeth Magnin
Eliana Magnani, Directrice de recherche au CNRS
Olivier Maheo, Enseignant
Alain Maire, Retraité humaniste, écologiste et naturaliste
Guilaine Maisse, Professeure d’allemand retraitée
Ziad Majed, écrivain et Professeur, The American University of Paris.
Jean Malifaud, MCF retraité Mathématiques, Paris 7
Kamila Mamadnazarbekova, doctorante, Sorbonne Université
Brigitte Mancel, Professeure de lettres retraitée
Marianne Mangeney, chercheuse au CNRS
Odile Mangeot, association Alliance pour l’Emancipation Sociale Nord Franche-Comté
Philippe Mangeot, professeur de littérature
Patrice Maniglier, Philosophe, Université Paris Nanterre
Danielle Manoukian, psychologue/psychanalyste
Cathy Maquart, Enseignante retraitée
Olivier Marboeuf, Écrivain, Commissaire d’exposition, Producteur
Audrey Marc, Professeur
Joelle Marelli, traductrice, autrice
Ivan Marin, Professeur des Universités, Amiens
Anne-Marie Marteil-Oudrer Syndicat National des Médecins Hospitaliers FO
Céline Martin, Historienne, Maîtresse de conférences à l’Université Bordeaux Montaigne
Gilles Martin, médecin retraité
Miguel Martinez, Maître de Conférences en Mathématiques, Université Gustave Eiffel
Joseph Martinod, Professeur
Robert Mascarell, Journaliste en retraite
Geneviève Massard-Guilbaud, historienne, directrice d’études émérite à l’EHESS
Arnaud Massin, Doctorant à l’Université de Liège
Isabelle Mathieu, MCF Histoire du Moyen Âge – VP Formation et vie universitaire, Université d’Angers
Mickaël Matusinski, MCF Maths Université de Bordeaux
Florence Mauger, enseignante
Danielle Maurice, doctorante, Université Lyon 2
Jean-Yves Maximilien
Annie Mayar-Poteau, Infirmière scolaire retraitée
Nicolas Mayard, Journaliste
Gérard Médioni
Maria-Alice Médioni, formatrice, militante pédagogique
Anne-Lise Mege
Miriem Méghaïzerou, Doctorante, Sorbonne Nouvelle
Eliane Meillier
Hacene Mekhnache
Graziella Melis Roussel
Marion Ménard, pair aidante TSA/TDAH
Marie Menaut
Sophie Mendelsohn, Psychanalyste
Franck Mercier, Historien, Professeur, Université de Rennes
François Mérel, Médecin retraité
Daniel Mermet, Journaliste
* Marie Mesmeur, Députée d’Ille et Vilaine
Germain Meulemans, Anthropologue, CR CNRS
Gilles Meyer, bibliothécaire
Najoua Mhamedi
Alain Migus, Citoyen retraité
Christophe Mileschi, Professeur, Université Paris Nanterre
Pierre Millien, Chargé de Recherche en mathématiques, CNRS
Virginie Milliot, Anthropologue, Maitresse de conférences, Université Paris Nanterre
Chantal Mirail
Estelle Miramond, Maîtresse de conférences en sociologie – Institut Humanités Sciences Sociétés, Université Paris Cité
Adlene Mohammedi, Chercheur et enseignant en géopolitique
Jacques Moisan, Retraité de l’enseignement
Olga Moll, Agrégée, MCF musique et musicologie, Université Paris 8, retraitée
Frank Moll, Dirigeant d’entreprise
Sylvie Monchatre, Sociologue, Professeur, Université Lumière Lyon 2
Mathilde Monge, Maître de Conférences en Histoire Moderne
Lucile Mons, Psychanalyste et psychologue
*Bénédicte Monville, Élue municipale et communautaire à Melun, ancienne Conseillère Régionale d’île de France
René Monzat, Chercheur indépendant
José-Luis Moragues, Dr en Psychologie, Maître de Conférences – Université Paul Valéry
Nathalie Morales
Gérard Mordillat
Éric Moreau, Université de Poitiers
Leonardo Moreira, MCF Philosophie, Université de Paris 8
Anne Morelli, Professeure honoraire de l’ULB
Haude Morvan, MCF Histoire de l’art médiéval
Marianne Morvan, Professeure agrégée d’anglais, UFR Médecine
Aimée Mouchet retraitée de l’EN, agrégée d’histoire
Damase Mouralis, Professeur des Universités, Université de Rouen-Normandie & CNRS
Guillaume Mouralis, Historien, Directeur de recherche au CNRS, CESSP, Paris
Jean-Noël Moureau
Marie-Hélène Mourgues, Maitre de Conférence, UPEC
Bertrand Müller, Historien, DR émérite, CNRS (historien de Marc Bloch et Lucien Febvre)
Marwan NACIRI – Post-doctorant CNRS
Dominique Natanson, animateur du site Mémoire Juive & Éducation
Philippe Naud, Professeur certifié d’Histoire Géographie
Fabien Navarro, Maître de Conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Ron Naiweld, Chargé de recherches en études juives, CNRS
Annliese Nef, Historienne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Josselin Neveux, diffusion de supports de communication concerts
Kim Vu Ngoc, étudiant
Jean-Philippe Nicolas, enseignant
Brigitte Nicolet, retraitée
Massimiliano Nicoli, Psychanalyste, Philosophe
Dominique Noly, retraité
Yannick Nué
Norbert Nusbaum, Assistant social retraité à Besançon
Joseph Oesterlé, Professeur émérite, Sorbonne Université
Christophe Oberlin, Chirugien, professeur
Christian Oillic
Josiane Olff-Nathan, Ingénieur d’Etude retraitée, Université de Strasbourg
Béatrice Orès, Union Juive Française pour la Paix
Martine Ostorero, Historienne, Professeur, Université de Lausanne
Nilton Ota, Directeur de programme du Collège international de Philosophie
Michel Ouaknine, Ingénieur semiconducteurs, militant MRAP & UJFP
Mohamed Ouerfelli, Maître de conférences en histoire médiévale, Université d’Aix-Marseille
Louis-Gilles Pairault, Conservateur en chef du Patrimoine, adhérent du parti Les Républicains
Ugo Palheta, Sociologue, Université de Lille
Julien Pallotta, Philosophe et traducteur
Stefano Palombarini, Économiste, MCF Paris 8
Luca Paltrinieri, Maître de conférences Philosophie, Université de Rennes
Bruno Paoli, Professeur des Universités, Université Lumière Lyon 2
Ilan Pappé, Historien israélien, Professeur à l’Université d’Exeter
Corentin Parent
Pierre Parent, Maître de conférence, Université de Bordeaux
Frédéric Pasquet
Christophe Pébarthe, Historien, Université Bordeaux Montaigne
Julien Peccoud, enseignant de SVT en lycée, éducation nationale
Thierry Pécout, Historien, Professeur à l’Université de Saint-Etienne
Francis Peduzzi, directeur de scène nationale
Rodny Pélage
Michele Pellegrini, Historien, Professore associato, Université de Sienne (Italie)
Willy Pelletier, Sociologue, université de Picardie
Fernand Peloux, historien, CNRS
Maëlle Pennéguès, Doctorante en histoire moderne, Sorbonne Université
Charles Pennequin, écrivain
Catherine Perret, Professeure émérite, Université Paris 8
Lucien Perrin, Éditions Amsterdam
Marc Perrin, Écrivain, Éditeur
Annick Peters-Custot, Professeure d’Histoire médiévale, Nantes Université
Jean-François Pétillot, PRCE, Université Paul-Valéry Montpellier, retraité
Thomas Petitbon, Union Juive Française pour la Paix & France Insoumise
Nathalie Peyre, Prof de lettres
Roland Pfeffenkorn, Sociologie, Professeur émérite, Strasbourg
MICHEL Philippo, Coordinateur livret planification écologique
Emmanuelle Picard, Professeure d’histoire contemporaine, ENS de Lyon
Caecilia Pieri, PhD Associate Researcher, Ifpo Institut français du Proche-Orient, Erbil, Kurdistan irakien
Alexandre Piettre, Docteur en Sociologie politique et Professeur de Philosophie
Laure Piguet, Historienne, Université de Fribourg/Centre Marc Bloch
Brigitte Pignard
Philippe Pignarre, éditeur
Michel Pinault, Historien, retraité
Jean-Daniel Piquet, Historien
Marie Plassart, maîtresse de conférences, Université Lyon 2
Jacques Pochard, Pédiatre
Christopher Pollmann, Prof. des Universités agrégé de Droit public, Université de Lorraine – Metz
Hugues Poltier, philosophe
Jean-Pierre Poly, ex-professeur, Histoire du droit, Université Paris-Nanterre
Julien Ponceblanc, Professeur de Français et d’Histoire & Géographie, CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon
Alan Popelard, Enseignant
François Portefaix, retraité de l’éducation nationale
Raphaël Porteilla, Professeur de sciences politiques, Université de Bourgogne
* Thomas Portes, député de Seine-Saint-Denis
Elio Possoz, écrivain
Clément Poullet, Secrétaire général de la FNEC FP-FO Angers
Franck Poupeau, sociologue, DR CNRS, éditions Raisons d’agir.
* Philippe Poutou, militant NPA
Sébastien POYARD, Professeur agrégé d’Histoire-Géographie, Vesoul
Plínio W. PRADO Jr, Professeur émérite de Philosophie, Université de Paris 8
Renée Prangé, Directeur de recherches CNRS retraitée
Stefanie Prezioso, Historienne, Suisse
Nicolas Prignot, Enseignant et chercheur en philosophie, ERG/ ESA St-Luc, Bruxelles
Klervi Propice, Doctorante en psychologie
François Provansal
* Loïc Prud’homme, député de la Gironde
Serge Quadruppani, auteur et traducteur
Christelle Rabier, MCF EHESS
Geneviève Rail, Ph.D., Professeure émérite distinguée, Institut Simone-De Beauvoir, Canada
François Ralle Andreoli,conseiller des Français-es d’Espagne – 2e circonscription d’Espagne
Nordine Raymond, tête de liste « Faire Mieux pour Bordeaux », La France insoumise
Antoine de Raymond, Sociologue
Eva RAYNAL, Maîtresse de conférences en Littérature comparée, Université de Mayotte, Dembéni
Isabelle Réal, Historienne, MCF, Université de Toulouse Jean-Jaurès
Thierry Reboud, UJFP
Gianfranco REBUCINI, anthropologue, Chargé de recherche au CNRS
Fanny Rebuffat, Psychiatre
Manuel Rebuschi, Enseignant-chercheur en Philosophie, Université de Lorraine
Myrto Reiss, Médiatrice culturelle
Yannick Reix, Directeur festival de cinéma de Douarnenez
Mathieu Renault, Philosophe, Professeur à l’Univ. de Toulouse Jean-Jaurès
Jean-Paul Renoux
Eugenio Renzi, Enseignant
Jordan Rezgui, pensionnaire de la Comédie-Française
Nassim Rezzoug
Fabrice Riceputi, Historien
Mathieu Rigouste, Sociologue
Laurent Ripart, Historien, Professeur à l’Univ. de Chambéry
Manu Riquier
Nathalie Rivoire
Agathe Roby, docteure en histoire médiévale, toulouse
Odile Rollet, Pédopsychiatre, Lyon
Françoise Romand, Cinéaste
Isabelle Rosé, Historienne, Professeur, Université de Rennes
André Rosevègue, membre de l’Union juive française pour la paix et de la CAALAP
André Rougier, blagueur
Marie-Jeanne Royer enseignante retraitée
Jérémy Rubenstein, Historien
Damien Ruiz, Historien
Catherine Ruph
Alain Ruscio, Historien
Alain Rustenholz, Auteur
Gabriel Sabbagh, Professeur de logique mathématique (retraité) et Historien en activité, Université Paris Cité
Oreste Sacchelli, Professeur émérite, Université de Lorraine
* Arnaud Saint-Martin, député de la Seine-et-Marne
Marie-Claude Saliceti, psychologue clinicienne en retraite
Grégory Salle, sociologue, Directeur de Recherche CNRS.
Jean Salque, Cadre de la Fonction publique retraité
Victoria Saltarelli, retraitée de l’Éducation nationale
Akiko Sameshima, Traductrice pour La fabrique, Japon
Emilia Sanabria, Anthropologue, Directrice de recherche au CNRS
Alexandre Sanchez, éditrice
Thibault Sans, salarié du Média
Renaud-Selim Sanli, Éditions-librairie Météores
Jérôme Santolini, Directeur de Recherche, Biochimie
Ismahen Saouci
Catherine Sauvage
Pierre Sauve, Professeur retraité de l’université Paris 12
Sbeih Sbeih, ATER, Lyon 2, chercheur associé Iremam
Dimitris Scarpalezos, retraité M.C de mathematiques et membre du snesup
Valentin Schaepelynck, Maître de conférences en sciences de l’éducation (Université Paris 8), Directeur de programme au Collège international de philosophie.
Matthieu Scherman, historien
Jean-Marc Schiappa, Historien, Prix Guizot de l’Académie française (2023)
Nathalie Schlatter-Milon, Psychologue Clinicienne
Alain Schnapp, archéologue, Ancien professeur à l’Univ. Panthéon-Sorbonne
Joël Schnapp, Enseignant, Historien
Raphaël Schneider, Co-fondateur de Hors-Série
Peter Schöttler, Directeur de recherche honoraire au CNRS (biographe de Marc Bloch)
Tod Shepard, Historien, Professeur, John Hopkins University
Guillaume Sibertin-Blanc, Philosophe, Professeur à l’Univ. Paris 8
Bernard Sibieude, Retraité, Strasbourg
Michèle Sibony, Union juive française pour la paix
Aude Signoles, MCF Sciences Po, AMU MESOPOLHIS
Stéphane Simard-Fernandez Réseau Salariat
Yves Sintomer, Professeur de Science politique, Université de Paris 8
Stéphane Sirot, Historien
Tahar Si Serir, membre du mouvement “Les Humanistes”, co-fondateur du collectif “Libérons l’Algérie’”
Jean-Claude Slyper
Jérôme Soldeville, conseiller municipal délégué Grenoble
Gabriela Solis, Collectif 69 Palestine
Jon Solomon, Professeur en littérature chinoise, Université Lyon 3
Marco Spagnuolo, Doctorant, Université Paris 8/LLCP
Cornelie Statius Muller, Comédienne et metteure en scène, marionnettiste et machiniste
Isabelle Stengers, Philosophe, Professeur émérite de l’Université Libre de Bruxelles
Mélanie Stravato, Editrice à Avignon
Alina Surubaru, Sociologue, Université de Bordeaux
Annick Suzor-Weiner, Professeure émérite Université Paris-Saclay
Julien Syren, Ingénieur
Stéphane Tabourin, Professeur des écoles, en REP+, conseiller syndical FSU-SNUipp54, militant LFI, militant associatif
Claire Talon, Psychanalyste, Docteure en Sociologie Politique
Julien Talpin, Directeur de recherche au CNRS
Moufida Tamou, Parente d’étudiants
Cécile Tannier, Directrice de recherche CNRS
*Andrée Taurinya, Députée de la Loire
Romain Telliez, MCF histoire, Sorbonne Université
Laurence Terk, Historienne
Anne Texier, Professeure de Philosophie
Pierre Thévenin Chargé de recherche au CNRS
Daniel Thin, Sociologue, Professeur Honoraire des Universités (Lyon 3)
Charlotte Thomas, Politiste, Chercheure indépendante associée au programme Asie de l’IRIS
François Thoreau, Chercheur qualifié et Professeur associé, FNRS – Université de Liège (Belgique)
Mirabelle Thouvenot, militante décoloniale
Hervé Tiberghien, Auteur, réalisateur de films documentaires
Mathieu Tilllier, Professeur d’Histoire de l’Islam médiéval, Sorbonne Université
Sylvie Tissot, Professeure au département de science politique, Université Paris 8
John Tolan, Historien, Professeur à l’Université de Nantes
Valentina Toneatto, Historienne
Armando Torres Fauaz, Historien, Universidad Nacional de Costa Rica
Rémi Toulouse, Éditeur
Mireille Touzery Le Chenadec, Professeur émérite d’Histoire moderne, UPEC
Enzo Traverso, Historien, Cornel University (États-Unis)
Brigitte Trincard Tahhan, Retraitée éducation nationale
Alessia Trivellone, Historienne, Université de Montpellier 3
Véronique Troyas
Françoise de Turckheim, Médecin
Jean-Christophe TURPIN
Martine Ullmann, Femmes en Noir Lyon, UJFP
Sébastien Ulrich, Menuisier
Maude Vadot, Maitresse de conf. en sciences du langage, Univ. Savoie Mont Blanc
Stanley Valbrun, Docteur en Sciences de l’éducation, travailleur social
Massimo Vallerani, Professore ordinario di Storia medievale, Université de Turin (Italie)
Stéphane Valter, Professeur en langues et civ. Arabes, Univ. Lyon 2
Yves Vargas, Philosophe
Amandine Vautaret, étudiante
Mélanie Vay, Docteure en Science politique
Graziella Vella, Anthropologue, U Mons
Manolo Vella, Enseignant
Anne Verjus, DR CNRS, laboratoire Triangle
Françoise Vergès, Autrice, militante féministe décoloniale
Joël Vernet, Écrivain
Jean-Baptiste Vérot, MCF en Histoire moderne, Université Marie & Louis Pasteur
Victor Verwaerde, étudiant, ENS de Lyon
Thomas Vescovi, Doctorant (Ehess/ULB)
Baptiste Veyssy, Éditeur
Camille Viallon
Jérôme Vidal, Éditeur, traducteur
Nicolas Vieillescazes, Éditeur
Fanny Vincent, MCF à l’Université de Saint-Etienne.
Léonard Vincent, Écrivain
Gilles Vinçon, Chercheur en Entomologie
Christiane Vollaire, Philosophe, Chercheure associée au CNAM et au LCSP de l’Université Paris Cité Fellow de l’Institut Convergences Migrations
Eric Vuoso
Dror Warschawski, Chercheur CNRS, Sorbonne Université, Paris
Jean-Marc Warszawski, musicologue, directeur du magazine musicologie.org
Abdourahman Waberi, écrivain
Tim Wandriesse
Laurent De Wangen, enseignant
Laurent Weill, Médecin retraité, LFI, UJFP
Françoise Weill-Ponsin, Médecin retraitée, LFI, UJFP
Charles Wolfe, Professeur des Universités, Dépt de Philosophie, Université Toulouse Jean-Jaurès
Yahya Yachaoui, Professeur retraité, Poète, Écrivain, Traducteur
Hèla Yousfi, Maître de conférences, Université PSL-Dauphine
Louisa Yousfi, Autrice, militante décoloniale
Nassera Zaidi, Coordinatrice du CNRCC (collectif national pour la reconnaissance des crimes coloniaux)
Barbara Zauli, Enseignante-chercheuse, Philosophie, Université Paris 8, vice-présidente du Collège International de Philosophie.
Mathilde Zederman, MCF Université Paris-Nanterre
Caroline Zekri, MCF, Université Paris-Est Créteil
Afifa Zenati IGE, ENS de Lyon
Laurick Zerbini, MCF – HDR, Université Lyon 2
Dominique Ziegler, Auteur, Metteur en scène
Alexis Zimmer, Professeur, Histoire environnementale, Université de Liège (Belgique).
Institutions :
CAALAP (Coordination Antifasciste pour l’Affirmation des Libertés Académiques et Pédagogiques)
Collectif 69 Palestine
Collectif Education Avec Gaza
Éditions La Fabrique
Éditions Terre de feu
FNEC FP-FO Angers
La France Insoumise
Librairie La Gryffe, Lyon
Librairie Les 400 Coups, Bordeaux
Institut La Boétie
Union Juive Française pour la Paix
27.11.2025 à 15:31
Malcolm X à l’épreuve du cinéma hollywoodien
Texte intégral (8146 mots)
Quand Spike Lee fait sienne la figure mythique de Malcolm X, la lettre qui aura servi de patronyme au leader prophétique a été phagocytée par le Capital : le « X » révolutionnaire des Black Muslims figure sur des bonnets, casquettes, T-shirts mais aussi, comme le rappelle le théologien James H. Cone, sur des « cadrans de montres, ventilateurs, réfrigérateurs et cartes à jouer ». Lee envisagera lui aussi de tirer profit de cette récupération en développant un merchandising autour du film, tout comme il n’aura pas hésité à lancer un commerce à son effigie, la boutique Spike’s Joint, toujours en activité.

Le réalisateur a le sens des affaires, c’est le moins qu’on puisse dire. Sa place de maître d’oeuvre du biopic Malcolm X, il l’aura gagnée en ruant dans les brancards, hurlant au tout Hollywood qu’il est le mieux placé pour mettre en scène le parcours du porte-parole charismatique de la Nation of Islam. Il a le capital symbolique pour en imposer. Il ne peste pas en outsider. Lee s’accommode d’ailleurs parfaitement du système : « there’s nothing like it in the world ! »1 a-t-il déclaré. Son « coup » ne déstabilise pas l’industrie qui y voit, après tout, l’opportunité de s’adresser à un public plus large – et tant mieux. Le canadien Norman Jewison, premier choix de la Warner pour tourner Malcolm X, se retire.

Loin de la classe ouvrière
Pour le réalisateur de Do the Right Thing, aucun blanc n’est assez « sensible » pour servir la cause. On tient là l’une des fameuses sorties de « premier concerné » de Lee, ce produit de l’élite sociale déguisé en homme de la rue, ce revendeur de militantisme didactique qui fait la leçon sur qui peut ou ne peut pas prendre en charge la blackness à l’écran. Sait-il que l’un des films préférés de Malcolm X est réalisé par Michael Roemer, un cinéaste allemand, juif, exilé aux États-Unis ? Son superbe Nothing but a man représente la classe ouvrière noire comme Spike Lee ne l’a encore jamais fait.
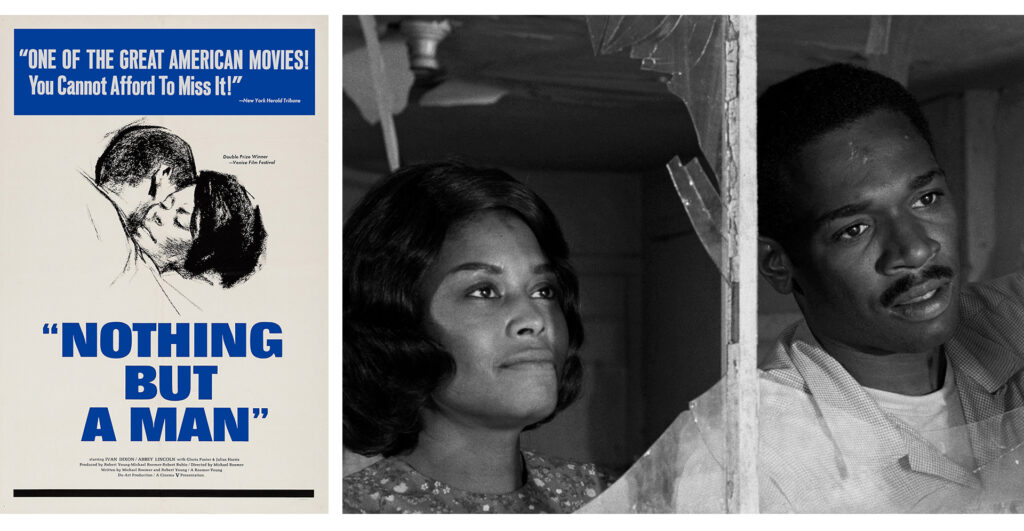
Il est tentant de spéculer sur les raisons de l’engouement de Malcolm : une romance entre un cheminot et une enseignante afro-américains (loin, donc, de l’horizon libéral-progressiste de l’amour interracial), une intrigue qui se construit autour de la question de la dignité, un regard aiguisé sur les disparités entre Noirs prolétaires et Noirs embourgeoisés, conservateurs, chrétiens, en cheville avec des blancs voulant maintenir le statu quo racial – ces « Oncle Tom » que Malcolm avait en horreur ! En 1964, une telle fibre marxiste ne pouvait s’exprimer que depuis les marges du cinéma indépendant. Si Lee vient de cette frange, il ne lui aura pas appartenu longtemps.
Une servilité au canon hollywoodien
L’ouverture de Malcolm X est éloquente. Spike Lee, qui a pris l’habitude de jouer dans ses films, est le premier à apparaître à l’écran. On aurait pu s’attendre à ce que sa star, Denzel Washington, le précède. Quand on le découvre, Lee se fait cirer les pompes : il est clair, à travers ce premier plan, que c’est lui qui mène la danse et donne le tempo. L’ample mouvement d’appareil qui nous mène à lui ne reprend que lorsqu’il quitte son jeune shoeshiner pour traverser une grande artère de Boston, haut en couleurs, sapé comme un zoot (zazou, une mode à laquelle le jeune Malcolm sacrifie dans les années 1940). On peut se pâmer devant le lustre de ce plan-séquence. On peut aussi dire qu’il annonce une servilité au canon hollywoodien. Ici, la « vie de réinventions »2 de Malcolm est indexée sur l’histoire du cinéma américain. Un temps fort est associé à un genre. La jeunesse de « Detroit Red », noceur, dealer et cambrioleur, a le côté flamboyant du musical des années 1940-50 ; son Purgatoire avant son éveil spirituel reprend les codes du film de prison, en vogue dans les années 1980-90 ; quant à la représentation de la Nation of Islam, elle flirte avec l’imaginaire du Parrain, avec ses tractations, ses « soldats » tout en abnégation, ses meurtres fratricides.

Dans la deuxième partie du film, Lee trouve un moyen frappant d’évoquer la stature divine d’Elijah Muhammad : celui-ci fait une apparition surnaturelle dans la cellule de Malcolm. On comprend que c’est une vue de l’esprit, qui confirme que le dialogue religieux entre le maître et le disciple est engagé, même s’ils ne se sont pas rencontrés. Cette vision ressemble à une théophanie de fresque biblique dispendieuse façon Les Dix Commandements : elle est au futur prophète Malcolm X ce que le buisson ardent est à Moïse. Drôle d’idée quand on connaît la détestation de Malcolm pour le judéo-christianisme, synonyme pour lui d’aliénation, de soumission à une divinité complice de l’esclavage et de l’effacement culturel des Noirs. Il est vrai qu’il n’aura pas pu se familiariser avec une théologie de la libération née à la fin des années 1960 – il meurt au milieu de la décennie. Elle introduit la radicalité du Black Power au sein de l’Église noire, elle refaçonne la divinité à l’aune de l’expérience noire américaine, en en faisant une alliée politique, une compagne de lutte. Même si l’on pourrait rétorquer que Moïse (Moussa) est une figure centrale du Coran, Spike Lee convoque une imagerie plus proche de la Bible, l’un des livres qui aura contribué à établir le canon hollywoodien, avec Shakespeare et la littérature populaire et feuilletonesque du XIXe siècle.

Une image peut en cacher une autre

On peut y voir un symptôme de son époque : Malcolm X est sorti en 1992, soit la même année que Postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif. Fredric Jameson y parle du congé donné à l’idée de profondeur, que ce soit dans la peinture, le cinéma ou l’architecture. L’image appelle l’image et dans le cas du cinéma, le real se confond avec le reel3. Une intuition géniale incitera Jameson à voir dans le monolithe de 2001, l’Odyssée de l’Espace la prophétisation d’une nouvelle ère culturelle où tout n’est que surface, platitude, dephtlessness. Le plus grand nom du pop art abonde dans son sens : « Si vous voulez tout savoir sur Andy Warhol, vous n’avez qu’à regarder la surface de mes peintures, de mes films, de moi. Me voilà. Il n’y a rien dessous. ». L’imagerie marchande de ses Diamond Dust Shoes se substitue à la glaise des Souliers de Van Gogh, usés, encore lestés du poids du réel, chargés d’un hors-champ : la vie de dur labeur, le travail harassant de la terre.

Tout se passe comme si Spike Lee avait lui aussi cédé aux sirènes de cette postmodernité fin de siècle. En définitive, il n’y a pas loin entre Malcolm X et la manière dont Forrest Gump traversera (en courant) le récit national un an plus tard – son aïeul, dont il est le portrait craché, sort tout droit de Naissance d’une nation de D.W. Griffith, la Guerre du Vietnam est ici moins un fait historique qu’une réminiscence des films sur le sujet, avec leur bande-son rock à l’avenant (Jimmy Hendrix, les Rolling Stones et cie). Ce qui était marquant dans Forrest Gump, c’était aussi cette manière inédite d’intégrer le héros aux archives télévisuelles et, à partir de là, de faire basculer le récit dans l’uchronie. Le film de Spike Lee ne se livre pas à une telle réécriture mais il pense la trajectoire de Malcolm comme une somme d’éléments iconiques que le public aura tout le loisir de reconnaître : les déclarations à la presse, le langage corporel qui accompagne les prises de parole d’un monstre d’éloquence (regard concentré, index levé et posé près de l’oreille), le pèlerinage à la Mecque, Malcolm armé d’un M1 Carabine quand sa vie est en danger. Les agents du FBI qui prennent « le démagogue irresponsable » en filature jusque sur le continent africain sont eux aussi des faiseurs d’images : ils « shootent » Malcolm de loin. Ce sont des filmeurs embusqués.
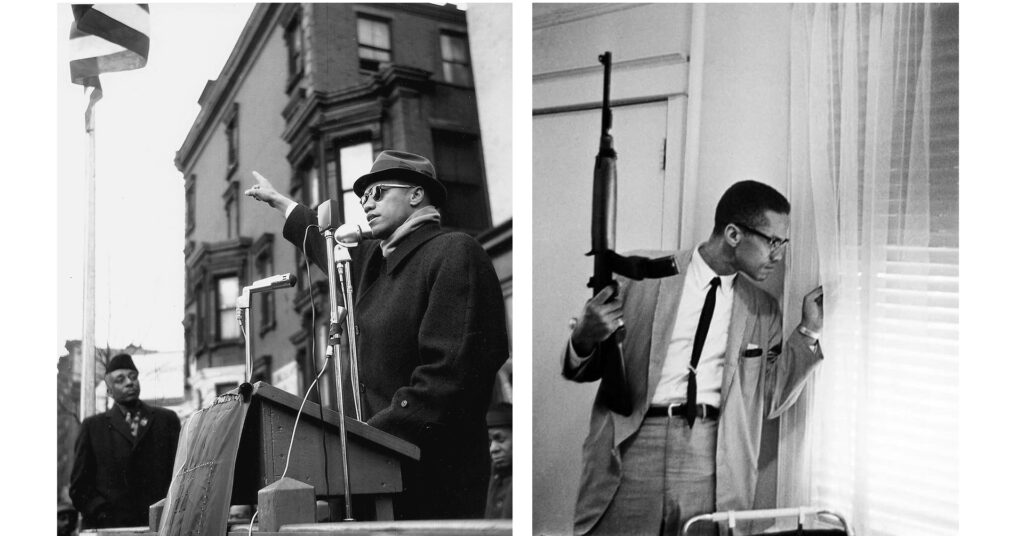
La rivalité entre les mastodontes Malcolm X et JFK d’Oliver Stone, dont on a tant parlé à l’époque, se joue aussi sur ce terrain : celui du pastiche, de la refabrication mimétique. Il faut se demander avec Baudrillard s’il n’y a pas là une sorte de « crime parfait » dont ces œuvres se sont rendues complices alors même que le meurtre était leur grande affaire, le dossier qu’elles entendaient instruire. Le meurtre en question, le voici : le cinéma a supplanté le réel, il l’imite si bien que nous pouvons continuer de croire à son existence, sans savoir que sous la chair du plan, sous sa surface, gît un cadavre. En un sens, James Baldwin ne se trompait pas : toute adaptation hollywoodienne de L’Autobiographie de Malcolm X équivaudrait à un « deuxième assassinat ». Dans l’imaginaire collectif, le visage du leader n’a-t-il pas fini par se confondre avec celui de la star de cinéma Denzel Washington ?

Pacte faustien
En définitive, Malcolm X rend compte de la montée en puissance de Spike Lee mais aussi de l’embourgeoisement – voire de l’essence bourgeoise – de son cinéma. L’extraction sociale du réalisateur se devine d’ailleurs dans l’ambiance « Ivy League » de School Daze, son deuxième long métrage, tout comme dans la bohème chic dans laquelle grandit le saxophoniste de Mo’ Better Blues. Mais on ne peut pas le lui contester : au début des années 1990, Lee est en effet bien placé pour réaliser Malcolm X ; on pourrait même penser qu’il s’y préparait depuis longtemps. Le début de sa filmographie est émaillé de références à Malcolm. On voit ce dernier en photo et on le mentionne dans School Daze. Le carton final de Do the Right Thing réunit les propos « non-violents » de Martin Luther King Jr, et les déclarations de sa (supposée) Némésis sur la nécessité pour les Noirs de se défendre, de réaffirmer leur dignité « par tous les moyens nécessaires ». Pour Lee, il s’agit moins de renvoyer ces deux approches dos à dos que de les mettre en tension, avec l’idée que Martin et Malcolm formeraient une sorte de Janus de la révolution noire américaine des années 50-60. Mais il y a le revers de la médaille : plus on avance dans l’oeuvre de Lee avant Malcolm X, plus il s’entiche de la grande forme hollywoodienne, plus les aspirations et enjeux s’individualisent – art, amour et argent forment la sainte trinité des héros de Lee. La révolution que l’Amérique noire appelait de ses vœux peut attendre…
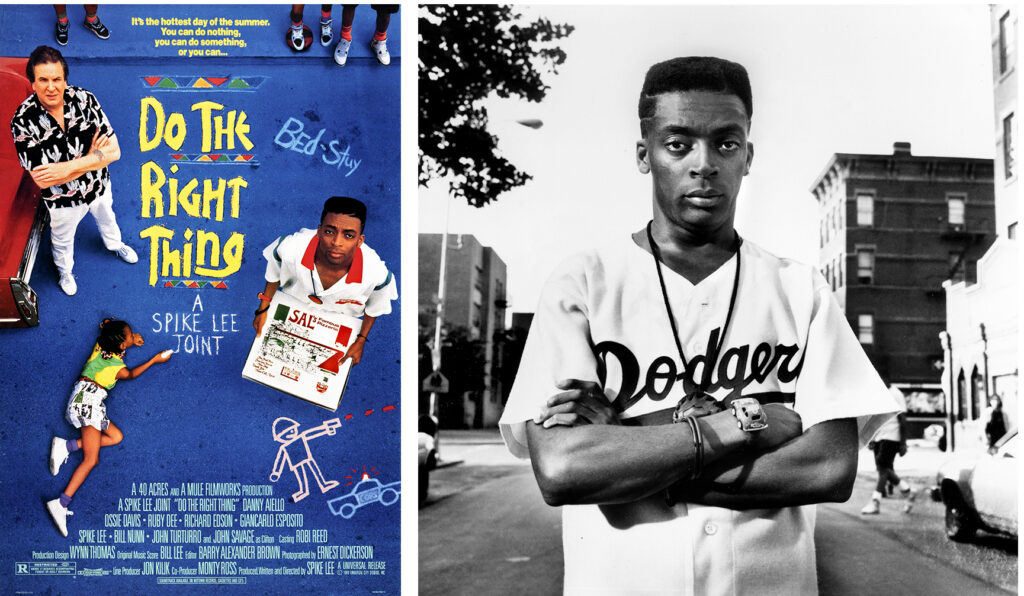
Dans Malcolm X, les masses se résument à une clameur anonyme, à une horde de figurants mettant en valeur le luxe de la production value. Lee n’aspire à rien d’autre qu’à donner chair à la figure héroïque et humaniste qui se dessine en filigrane dans L’Autobiographie co-écrite avec Alex Haley4 : du pain béni pour cette « usine à rêves » dans laquelle Malcolm voyait une manufacture de mensonges, une fabrique de personnages noirs oncletomisés. A ce titre, l’entente entre Lee et le producteur Marvin Worth, le propriétaire des droits L’Autobiographie à partir de 1967, est révélatrice : le réalisateur chante les louanges de son collaborateur dans un documentaire consacré à la genèse du film.
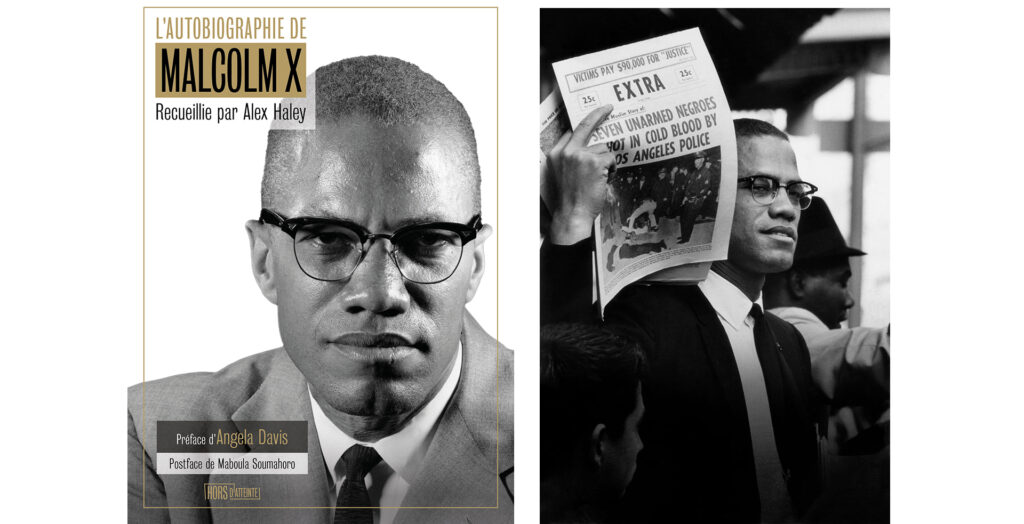
Malcolm par Baldwin : le biopic impossible
Worth est l’homme qui découragea James Baldwin dans ses efforts de porter la vie de Malcolm à l’écran. Ce dernier pressentit la nature diabolique, faustienne de cette expérience avant même d’écrire une seule ligne. Comme il l’écrit dans Chassés de la lumière : « L’idée que Hollywood puisse faire une œuvre honnête sur Malcolm ne pouvait que paraître saugrenue. Et pourtant – je ne voulais pas passer le restant des mes jours à me dire : ça aurait pu être fait si t’avais pas été si froussard. Je sentais que Malcolm ne m’aurait jamais pardonné pour ça. Vivant, il avait confiance en moi et j’estimais qu’il me faisait encore confiance, mort, et cette confiance, en ce qui me concerne, m’obligeait. ».
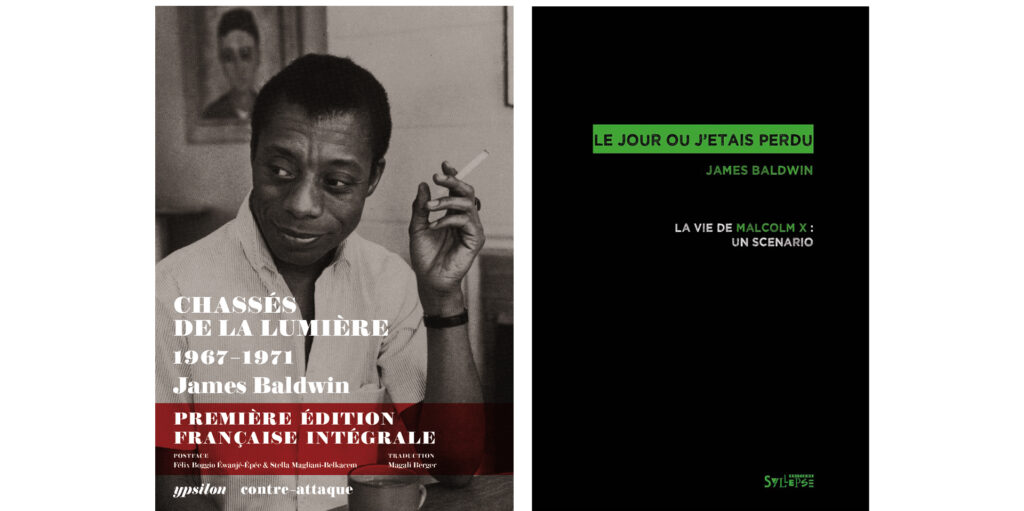
Dans son scénario, Baldwin organise une structure complexe, faite d’enchâssements successifs, d’allers-retours dans le temps. Elle est anti-hollywoodienne, plus proche des cinémas de la modernité européenne ou du Nouvel Hollywood que du classicisme adopté par Lee. Le montage aurait parachevé l’image diffractée de Malcolm et en cela représentative de sa complexité. Il avait « tant de noms » rappelle Baldwin à plusieurs reprises : Malcolm Little, Detroit Red, Malcolm X, Omowale (« le fils qui est revenu »), Al-Hâjj Mâlik al-Shabazz الحاج مالك الشباز . Ce récit deviendra l’ouvrage Le jour où j’étais perdu. A l’instar de Worth, Spike Lee trouve lui aussi la chose confuse. Il en fait cas mais il veut la retravailler. Il privilégiera la linéarité, l’approche chronologique, malgré quelques flash-backs inclus ici et là. D’une durée ogresque, comparable à celle de JFK, Malcolm X est une courbe instable avec ses creux et ses pics. Le film souffre des travers inhérents au biopic, ce compromis entre la page Wikipédia et la nécro – le genre rappelle que le récit d’une vie n’a d’extrémités que celles que la mort peut offrir. Paradoxe du biopic : il opère depuis la tombe et, depuis vingt ans, il est l’un des genres les plus vivants qui soit.
Le patrimoine au détriment de la vérité
Il y a un monde entre un James Baldwin qui a vécu dans le ghetto et fréquenté les sommités de la révolution noire américaine et un Spike Lee issu des classes aisées qui gère la chose en business man, en cinéaste-notaire garant des intérêts moraux et financiers des héritiers. En se plaçant sous l’autorité de Betty Shabazz, créditée comme consultante, il se préoccupe moins de cinéma que de patrimoine. Cela relèverait de l’anecdotique si la mainmise de l’épouse n’engendrait pas deux choix significatifs : le couple Betty-Malcolm s’en trouve idéalisé, tandis que la sœur Ella Collins est reléguée dans le hors-champ, alors qu’elle fut un soutien moral et financier de premier plan. C’est elle qui fut la mécène du Hajj de Malcolm, que le film reconstitue avec grandeur, en marchant sur les traces de l’immense fresquiste David Lean. Si Ella est absente du film, c’est parce que Betty la déteste : « Je n’ai aucun respect pour cette femme » déclarera-t-elle au Boston Globe en 1992. De son côté, Ella pense que « Spike Lee ne recherche que l’argent et le prestige. Il n’y connaît rien ».

La mésaventure baldwinienne nous enseigne que tout commerce entre la question « Malcolm X » et Hollywood doit susciter la plus grande méfiance. C’était le cas dans les années 1960, quand l’industrie envisagea un Charlton Heston tout en blackface pour le rôle principal.

à la Marche sur Washington pour l’emploi et la liberté (1963)
C’est encore le cas trente ans plus tard, quand Lee donne l’illusion de retravailler l’image de Malcolm à l’aune des luttes présentes : dans le générique de début, le tabassage de Rodney King par la police se juxtapose à la rhétorique incendiaire du « brillant prince noir ». En alternance, le « X » légendaire se forme à la faveur de l’embrasement du drapeau américain. La prochaine fois le feu ! semble promettre cette ouverture saisissante, quand en réalité elle se contente d’attraper l’actualité brûlante au vol, pour créer un choc de courte portée5.
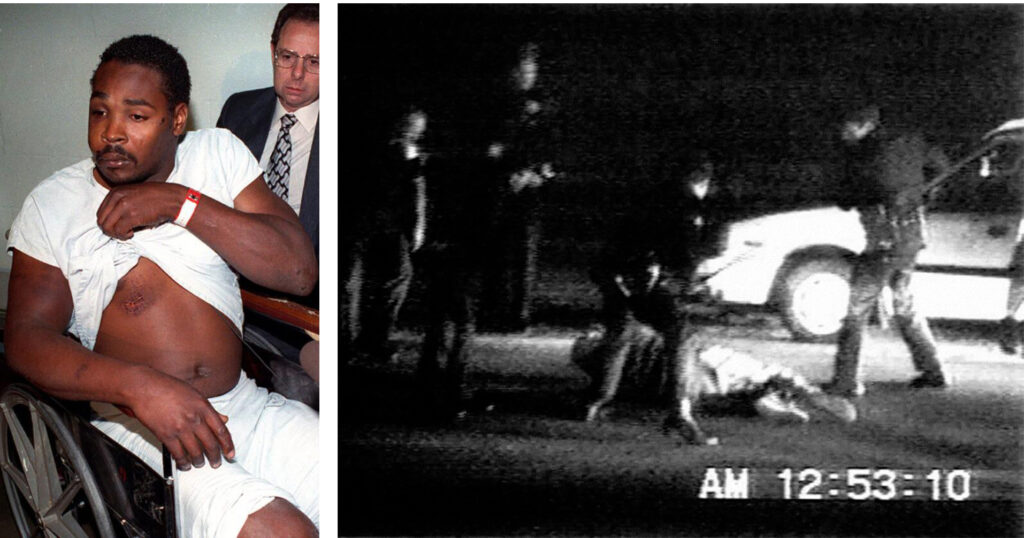
Pendant ce temps, l’Amérique noire s’enflamme, le conservatisme de l’administration Bush père tente de saccager le Civil Rights Act de 1964, arguant que la minorité a droit à moins d’égards que la majorité, et ce après huit années de reaganisme délétère pour les couches les plus pauvres de la communauté noire. C’est cette indignité permanente qui relança l’intérêt pour Malcolm X du côté des classes populaires, tandis que celui pour Martin Luther King Jr. déclinait. La deuxième insurrection de Watts, déclenchée par les violences suprémacistes subies par Rodney King, est le signe que l’Amérique n’a pas les moyens de s’offrir la color-blindness dont rêvent les hautes instances, au prétexte que des icônes comme Michael Jordan ou Michael Jackson arrivent bien, elles, à transcender les barrières raciales.
Quand il fait appel à des stars de cet acabit pour boucler le budget de Malcolm X, Spike Lee est héroïque parce qu’il peut se le permettre. Il vit dans un luxe auquel Malcolm lui-même n’aura pas goûté, si ce n’est au cours de ses voyages visant à internationaliser la lutte. Portée devant l’ONU, la cause avait une autre gueule : il n’était plus question de « droits civiques » mais de droits humains et, en se rapprochant des pays africains libérés, il s’agissait de subvertir la ligne de partage. Dans la perspective du panafricanisme, les Noirs des États-Unis ne forment plus une humanité minoritaire, et l’Islam, pratiqué dans les nations-sœurs, n’est plus une spiritualité de troisième catégorie. Le film ne dit rien de cette révolution aux accents décoloniaux qui n’a pu ou n’a su se matérialiser. La mort de Malcolm est passée par là, et le soutien qu’on lui apporta fut tout relatif. Son retour sous les traits d’un autre acteur dans un autre film pose toutefois une question à laquelle il faut tenter de répondre : à défaut d’une révolution en acte, pourrait-on envisager une manière proprement révolutionnaire de faire du cinéma ?
Malcolm nouveau millénaire
Si le film de Spike Lee ne représente pas l’alpha et l’oméga du cinéma de Malcolm X (ce n’est pas ce qu’on lui demande), il s’impose comme une étape majeure dans la grande séquence de « reconstruction de l’image posthume » du leader prophétique, initiée dès les années 1960 avec le jazz. Ne remettons pas en question son statut de monument culturel : c’est grâce à Spike Lee que, pour la plupart, nous avons découvert une telle figure, non en lisant des ouvrages sur le sujet.
Revenons maintenant sur la timeline du cinéma de Malcolm X : il y a le précédent baldwinien déjà évoqué, il existe un documentaire réalisé en 19726 et il y aura en 2001 le Malcolm X figurant dans le biopic Ali. Cette présence appelle quelques commentaires. La démarche relève à la fois de la rupture et de la continuité : Ali ne serait pas ce qu’il est sans Malcolm X. Ce qui est fait n’est plus à faire ; c’est parce que Spike Lee a pavé le chemin que Michael Mann a les coudées franches et peut réinventer Malcolm, l’éclairer sous une autre lumière.

Ali, c’est d’abord une scène d’exposition aussi longue qu’époustouflante. Elle est bâtie autour d’une « sainte trinité ». Chaque pilier de cette trinité fait ce qu’il sait faire : Mohammed Ali court et boxe, Malcolm X prêche de ne pas tendre l’autre joue, Sam Cooke chante et fait chavirer les coeurs. En s’appuyant sur la musique du soulman, en pleine performance au Copacabana, Mann dessine un portrait vibrant et incarné de l’Amérique noire des années 1960. A l’ivresse procurée par la soul music et le montage, d’une extrême fluidité, s’ajoute cette idée folle consistant à insérer des plans tournés en caméra DV. Ils montrent les foulées d’Ali sous un ciel nocturne presque hostile, en adéquation avec le sentiment provoqué par le passage d’une voiture de police (l’un des deux flics interpelle l’athlète d’un « son»7 bien paternaliste). Ici, la texture numérique fait l’effet d’un coup de tonnerre, d’une greffe inhabituelle et qui prend instantanément. Le concentré de Black History imaginé par Mann se présente sous une forme hybride que personne n’avait osé proposer.

assassiné par balle dans des conditions mystérieuses en 1964 dans un motel californien
A nouveaux siècle et millénaire, nouveau cinéma ? Il est permis de le penser tant le geste de Mann est radical : d’un côté, réaliser une œuvre à l’effigie d’un Black Muslim et membre de la Nation of Islam dans l’immédiat après-11 septembre, alors qu’on entre dans un nouvel âge de l’islamo-arabophobie, et, de l’autre, imaginer un dispositif de mise en scène révolutionnaire qui célèbre la culture noire américaine dans toutes ses strates – spirituelle, sociale, artistique, politique. Quand il aspirait à être un documentariste et non ce styliste que l’on connaît désormais, Mann a filmé mai 68 (Insurrection, toujours invisible), il s’est imprégné de la pensée des Black Panthers. Plus tard, la blackness fera partie intégrante de son oeuvre. Mann ne pouvait pas ignorer la postmodernité – ou ne pouvait pas être ignoré d’elle – mais il la prendrait par le col, en pointant l’accès à la fortune comme une aliénation de classe. Chez Mann, on s’enrichit à la manière de Faust, au détriment du principe de réalité. Mann donnerait à ses « mirages contemporains » (Jean-Baptiste Thoret) une couleur marxiste, nourrie par ses lectures et par une culture politique qui est celle de sa jeunesse – les années 1960-70. Aussi, à bien des égards, Ali apparaît comme un retour aux sources.
Comme l’annonce la séquence d’ouverture, l’une des arches narratives d’Ali est la relation entre Malcolm X et Mohammed Ali, alors qu’elle était l’un des angles morts du biopic de Spike Lee. Ce lien fraternel est connu du public mais il trouve ici une expression renouvelée, grâce à la présence magnétique de l’acteur qui interprète de Malcolm, Mario Van Peebles, lui-même légataire d’une histoire au confluent du cinéma et des luttes noires (il est le fils de Melvin Van Peebles, réalisateur de Sweet Sweetback’s Baad Asssss Song et musicien). Le Malcolm de Lee prenait forme laborieusement, sur la durée, par accumulation. Pour donner une identité forte à celui d’Ali, il s’agit cette fois de procéder par soustraction, en faisant beaucoup en peu de temps. Mario Van Peebles apparaît durant les cinquante premières minutes, jusqu’au moment où Mann se confronte à son tour à la reconstitution de la tragédie du 21 février 1965. Elle ne souffre pas de la comparaison avec le film de Spike Lee. Mann est rivé à Malcolm, à son point de vue, à son corps, à son regard. Il saisit avec force le moment où la vie le quitte, il a l’intelligence de reléguer hors-champ la préparation du meurtre et l’identité des tueurs, encore incertaine. Ce point aveugle est une belle manière de rendre compte de l’inachevé de l’oeuvre politique de Malcolm, en même temps qu’elle laisse entrevoir la vaste trame dans laquelle fut prise sa mort précoce8. Le cinéma de Mann baigne dans l’imaginaire du film de complot post-JFK et Ali ne déroge pas à la règle.

Une figure centrale
On se souvient que James Baldwin ouvrait son adaptation de l’Autobiographie avec la mort de Malcolm. Dans la première page, il précisait qu’on entend une « musique soul ». Laquelle ? Avait-il en tête l’hymne « A Change is Gonna Come » ? C’est ce que laissent penser les choix de Spike Lee et de Michael Mann, frappants dans leur similitude autant que par leur différence. Lee intègre l’original de Sam Cooke lorsque Malcolm se rend en voiture vers une mort certaine (l’Audubon). Le moment est solennel. Éteint, épuisé, l’homme n’est déjà plus. Mann opte, lui, pour une reprise live d’Al Green. Le contexte d’apparition du morceau est légèrement différent : il saisit les réactions, le contrechamp émotionnel du drame. Informé par un piéton en furie, Mohamed Ali immobilise son véhicule. Même s’il avait tourné le dos à un Malcolm tombé en disgrâce, le boxeur Black Muslim est envahi par la tristesse et la colère.
Les résonances entre les deux films appellent une dernière remarque : depuis les années 1990, l’univers audiovisuel autour de Malcolm X a généré ses propres patterns. Angela Bassett, qui interprète Betty Shabazz chez Lee, remet ça dans Panther de Mario Van Peebles. Chez Mann, le rôle d’Elijah Muhammad est confié à Albert Hall, lequel jouait Baines, l’homme qui éveille Malcolm Little à la sagesse islamique dans Malcolm X. Plus récemment, c’est l’excellent Nigel Thatch qui prête ses traits et sa voix rauque idoine au porte-parole de la Nation of Islam dans la série Godfather of Harlem, après avoir convaincu dans Selma d’Ava DuVernay. La création de Thatch est remarquable, et elle gagne en profondeur en s’inscrivant dans la répétition du récit sériel. Difficile de savoir s’il faut s’agacer ou se réjouir de ces doublons. Ils figent les représentations, ils se situent à l’opposé de ce que l’homme incarnait – la réinvention de soi. En même temps, ces doublons donnent chair à l’idée qu’il avait plusieurs visages, ils témoignent de l’intérêt renouvelé pour Malcolm.

Son centenaire ainsi que la nouvelle traduction française de son Autobiographie arrivent dans un moment d’intense islamophobie et arabophobie, et de centralité de la lutte palestinienne. Il faut combattre l’une et il faut embrasser l’autre, il en va de notre âme : « A travers Malcolm X, nous reconnaissons ce que nous sommes et nous reconnaissons nos espérances. Chaque indigène partage un peu de sa fierté retrouvée et recouvre sa dignité. Le portrait de Malcolm X accroché à un mur incite à la résistance. Et à ce titre, la figure mythique de Malcolm X est essentielle. » écrit Sadhi Khiari. Il faut réinvestir Malcolm. Nous avons encore besoin de lui.
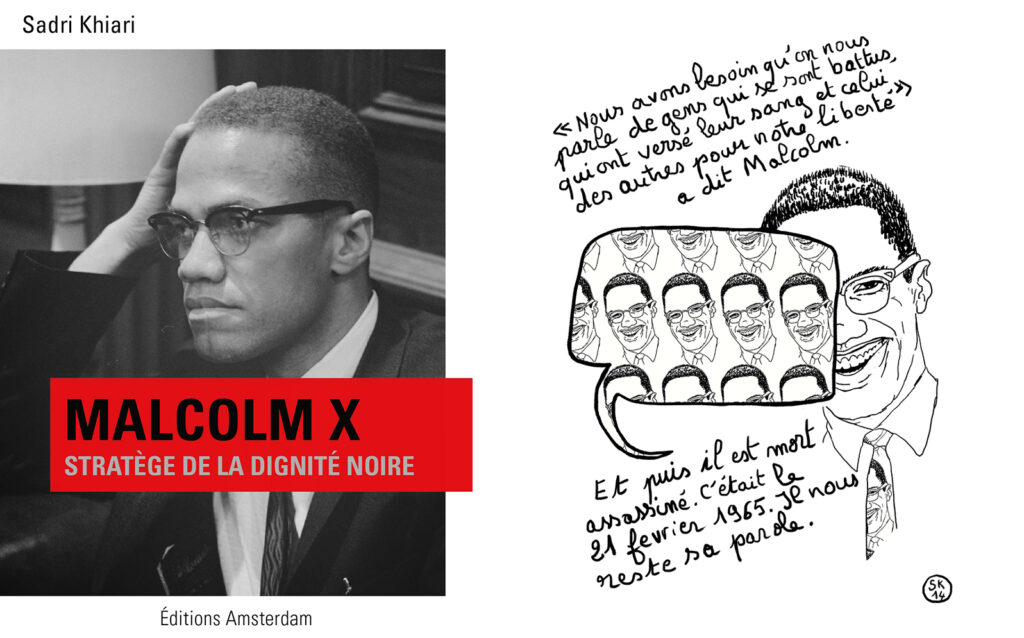
Pour prolonger
- « Il n’y a rien de comparable au monde ! »
 ︎
︎ - J’emprunte l’expression à Manning Marable, à qui je dois également la formule de « reconstruction posthume de son image », mobilisée dans cet article.
 ︎
︎ - En anglais, ces deux mots désignent respectivement la « réalité » et la « bobine de film ». bell hooks reprendra cette confusion à son compte en intitulant son premier ouvrage sur le cinéma Reel to Real. Race, Class and Sex at the Movies.
 ︎
︎ - Il faut préciser que cet auteur républicain n’a été ni un compagnon de lutte, ni un complice pour Malcolm. Il est moins mû par des convictions politiques que persuadé de collaborer à un ouvrage au fort potentiel commercial.
 ︎
︎ - Les événements surviennent le jour d’une projection-test de Malcolm X. Lee prendra acte sur la table de montage.
 ︎
︎ - Malcolm X d’Arnold Perl est constitué exclusivement d’images d’archives. Le résultat est concis, efficace et au final poignant. Car l’éloquence jazzy, les discours incendiaires, les traits amaigris, l’humour et le large sourire même dans la pire des adversités sont ceux du vrai Malcolm. Qui peut rivaliser avec ça ? Il est évident que cette adaptation purement documentaire de l’Autobiographie a constitué une base de travail pour Spike Lee (et pour un Denzel Washington plus investi que jamais). Les deux films privilégient la linéarité et ils se terminent avec la superbe oraison funèbre d’Ossie Davis qualifiant Malcolm de « brillant prince noir ».
 ︎
︎ - « Fils », en anglais, qu’on peut traduire ici par « petit »
 ︎
︎ - Le mystère autour de la mort de Malcolm X perdure. Elle ne se résumerait pas à des représailles sanglantes de la part de la Nation of Islam ou de quelques-uns de ses membres ayant agi de manière isolée, dévorés par le ressentiment. En 2024, ses filles ont porté plainte contre le FBI, la CIA et la police de New-York pour complicité de meurtre. Il semble que l’herméneutique de son martyr ait encore de beaux jours devant elle.
 ︎
︎
- GÉNÉRALISTES
- Alternatives Eco.✝
- L'Autre Quotidien
- Le Canard Enchaîné
- La Croix
- Le Figaro
- France 24
- France-Culture
- FTVI
- HuffPost
- L'Humanité
- LCP / Public Senat
- Le Media
- La Tribune
- EUROPE ‧ RUSSIE
- Courrier Europe Centrale
- Desk-Russie
- Euractiv
- Euronews
- Toute l'Europe
- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient
- Haaretz
- Info Asie
- Inkyfada
- Jeune Afrique
- Kurdistan au féminin
- L'Orient - Le Jour
- Orient XXI
- Rojava I.C
- INTERNATIONAL
- CADTM
- Courrier International
- Equaltimes
- Global Voices
- I.R.I.S
- The New-York Times
- OSINT ‧ INVESTIGATION
- OFF Investigation
- OpenFacto°
- Bellingcat
- Disclose
- Global.Inv.Journalism
- MÉDIAS D'OPINION
- Au Poste
- Cause Commune
- CrimethInc.
- Hors-Serie
- L'Insoumission
- Là-bas si j'y suis
- Les Jours
- LVSL
- Politis
- Quartier Général
- Rapports de force
- Reflets
- Reseau Bastille
- StreetPress
- OBSERVATOIRES
- Armements
- Acrimed
- Catastrophes naturelles
- Conspis
- Culture
- Curation IA
- Extrême-droite
- Human Rights Watch
- Inégalités
- Information
- Internet actu ✝
- Justice fiscale
- Liberté de création
- Multinationales
- Situationnisme
- Sondages
- Street-Médics
- Routes de la Soie