26.02.2026 à 15:27
Le « rôle prophétique » de l’Église catholique face à la crise en RDC : fake news, polarisation et controverses
Annélie Delescluse, Socio-anthropologue, FNRS/Université de Liège, Université de Liège
Texte intégral (3261 mots)

Le 24 décembre 2025, lors de la messe de minuit, l’archevêque de Lubumbashi (le chef-lieu de la province du Haut-Katanga, au sud-est de la République démocratique du Congo) a prononcé une homélie à teneur très politique, comprenant des reproches véhéments à l’encontre du gouvernement de Kinshasa. Peu après, une fake news annonçant sa suspension s’est propagée sur les réseaux sociaux. Cet épisode en dit long à la fois sur le clivage Est-Ouest dans le pays, sur les tensions entre le gouvernement et l’Église catholique, et sur l’impact que les réseaux sociaux ont aujourd’hui sur la société congolaise.
Cet article a été co-écrit avec Marcel Ngandu Mutombo. Professeur d’histoire à l’Université de Lubumbashi, ses travaux portent principalement sur la vie sociale, les mouvements sociaux et les relations intercommunautaires au Katanga, thématiques auxquelles il a consacré plusieurs ouvrages.
En République démocratique du Congo, les relations entre l’Église et la politique ont été de longue date marquées par une tension permanente entre collaboration et confrontation, de la période coloniale où l’Église accompagnait l’État, au régime autoritaire de Mobutu Sese Seko où elle est devenue une voix critique, jusqu’aux crises récentes sous Joseph Kabila, où elle s’est imposée comme médiatrice et autorité morale influente dans le débat démocratique. Aujourd’hui, les Églises catholiques et protestantes proposent une initiative controversée qui permettrait de mettre fin à la guerre qui déchire le pays depuis plus de trente ans tout en refondant le lien social et politique en RDC.
Le 13 janvier 2026, un post intitulé « Séisme au sein de l’Église catholique (RDC) » circule sur les réseaux sociaux congolais. Le message annonce la suspension de Mgr Fulgence Muteba, président de la Conférence nationale épiscopale du Congo (CENCO), une institution religieuse qui joue un rôle crucial en RDC comme autorité morale et spirituelle, mais aussi comme médiatrice lors des crises politiques.
Le lendemain, l’archidiocèse de Lubumbashi publie un communiqué dénonçant cette fausse information, appelant les fidèles à pardonner aux « frères égarés qui ne comprendraient pas le fonctionnement de l’Église catholique, ni ses structures institutionnelles » alors que « le pays s’efforce de trouver des voies de sortie de crise ».
Rappelons que les récents accords signés à Doha en novembre 2025 et à Washington en décembre de la même année n’ont réussi ni à faire taire les armes ni à mettre un terme à l’occupation des villes de Goma et de Bukavu par la rébellion (coalition entre l’AFC/M23 et l’armée rwandaise).
Or cette fake news survient moins d’un mois après une polémique suscitée par l’homélie prononcée par l’archevêque métropolitain lors de la messe de la nuit de Noël dans la cathédrale de Lubumbashi. Elle est à relier de façon plus globale aux différentes controverses autour du « Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble » mis en place par la CENCO et l’Église du Christ au Congo (ECC). Comment ce pacte est-il perçu par les membres du clergé et par les fidèles catholiques ? Et que révèlent ces polémiques sur l’institution et sur la bataille de l’information qui se déroule au sein dans la société congolaise ?
La messe de Noël
Dans son homélie du 24 décembre, Mgr Muteba peint un tableau sombre de l’état du pays, en proie au pillage de ses ressources. Il cite ces propos du Pape François, tenus en 2023 : « Retirez vos mains de la République démocratique du Congo ! Retirez vos mains de l’Afrique ! Arrêtez d’étouffer l’Afrique, ce n’est pas une mine à dépouiller ou un terrain à piller ! »
Enfin, il interpelle les fidèles sur les accords signés entre Kinshasa et les États-Unis, leur demandant s’ils savent que ces derniers ont été signés pour une durée de 99 ans :
« Il est inimaginable de gager ou de brader les minerais de toute une nation pour sauver un régime ou un système politique. De toute évidence, cela revient à sacrifier le développement de la population et à confisquer le bonheur des générations à venir. »
À la fin de l’homélie, quelques applaudissements se font entendre, mais l’atmosphère s’est alourdie. Le lendemain, les réactions des fidèles sont mitigées. Sur WhatsApp, les critiques fusent : « C’est pas une homélie de Noël ça » ; « Déjà, la cathédrale n’était pas pleine » ; « Les gens ne le supportent plus » ; « Hier, il n’était pas du tout dans la célébration… à part sa haine ».
Interrogés sur le parvis de l’église, d’autres voix défendent l’archevêque, qui aurait eu le courage de dire la vérité. Pour Kevin (33 ans, servant de messe), ceux qui critiquent l’archevêque sont des fanatiques du parti présidentiel (affiliés ou sympathisants de l’Union pour la démocratie et le progrès social, l’UDPS). Il dénonce la mauvaise gestion du pays – une critique du régime qui prend une coloration particulière dans l’ex-province du Katanga, fief des principaux opposants au régime.
De plus, l’homélie survient dans un contexte de fortes tensions dans la ville minière de Kolwezi (manifestations, affrontements violents, morts) suite à une décision administrative limitant l’accès des mineurs artisanaux aux marchés de traitement et de vente. Parallèlement à ce climat d’insécurité sociale, des accusations, soupçons et procédures judiciaires qui portent sur des enrichissements illicites dans les carrés miniers de la région pèsent sur des proches du président Félix Tshisekedi.
Deux jours après l’homélie, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya parle de « contre-vérités » au sujet de la durée du contrat signé et verse lui aussi dans le registre spirituel en citant le verset biblique d’Éphésiens 4 :25 : « Renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. »
Mgr Muteba représente une génération d’évêques congolais hautement formés, combinant rigueur académique en théologie morale et engagement pastoral dans la sphère publique, dans la continuité de la tradition d’intervention sociale de l’Église catholique en RDC. Depuis qu’il est archevêque de Lubumbashi, il influence fortement l’espace politique local en dénonçant la gestion des ressources minières et la pauvreté du peuple katangais, malgré la richesse de son sous-sol.
Interviewé en juillet 2025, il relie directement une tentative d’enlèvement de la garde républicaine dont il a été victime en 2023 à l’initiative de réconciliation qu’il avait initiée en 2022 entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila, les deux poids lourds politiques de la région.

Dans un contexte de migrations internes et de tensions communautaires, l’Église locale avait fait du « vivre ensemble » un axe pastoral central (le thème de l’année liturgique 2021-2022) en organisant un Forum sur la réconciliation entre les Katangais et un Colloque sur le vivre ensemble. Pour les Lushois (habitants de Lubumbashi) interrogés, la première initiative était la bienvenue afin de réconcilier les Katangais fragilisés par le redécoupage territorial et la fin de l’unité administrative du Katanga.
L’ascendance morale de l’Église sur la société congolaise lui donnerait la légitimité de traiter des affaires publiques : c’est le « rôle prophétique » de l’Église catholique, une expression régulièrement utilisée par les fidèles.
Le Pacte social
Cette orientation dite prophétique s’est prolongée à l’échelle nationale et régionale avec le lancement, début 2025, du Pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs, porté conjointement par les Églises catholique et protestante, dans un contexte de recrudescence du conflit en Ituri et dans les Kivus.
Cette initiative propose un dialogue inclusif avec la rébellion armée, les forces politiques et celles issues de la société civile pour trouver une sortie de crise et réformer l’État congolais. Mais en dépit de sa bonne réception à l’international (ONG internationales de paix et de médiation, chancelleries occidentales et milieux diplomatiques) et de l’espoir qu’elle a suscité au sein de la société civile congolaise, notamment dans les Kivus, elle ne fait pas forcément l’unanimité.
Ces divergences ne sont pas perceptibles au niveau du clergé local de Lubumbashi. Les prêtres et religieuses interrogés disent avoir été informés en amont, avoir prié pour sa bonne réalisation et ne pas être surpris des consultations menées à Goma ou à Kigali. L’argument est pragmatique : le pays étant acculé militairement, il n’y aurait pas d’autre solution que d’ouvrir des canaux de négociation pour arrêter l’effusion de sang. Cette position coïncide avec celles d’une partie de l’opinion internationale et de plusieurs figures de l’opposition.
Au niveau de la société civile, la première critique est liée à l’ingérence politique. Des voix questionnent l’efficacité de l'initiative et soupçonnent les évêques d’avoir un agenda politique caché. Des désaccords s’expriment sur le financement du Pacte social et sur les voyages de ses membres. Certains minimisent les soutiens extérieurs et insistent sur l’esprit du projet, tandis que d’autres rappellent que l’origine des appuis (y compris rwandais) est devenue un point de contestation majeur.
La lecture de la guerre est elle-même polarisée : des enquêtés relativisent les violences des rebelles en opposant leurs pratiques à celles des milices alliées aux Forces armées de la République démocratique du Congo, voire décrivent l’occupation comme productrice d’« ordre ». À l’inverse, d’autres jugent la démarche du Pacte social incompréhensible si elle passe par Kigali : ils y voient une normalisation de l’agresseur présumé et une contradiction avec les appels pontificaux à « ôter les mains du Congo ».
Si à l’époque de Kabila, les évêques engagés dans la contestation et la médiation étaient qualifiés d’« extrémistes » ou d’« opposants », l’Église ayant joué un rôle majeur dans la mobilisation pour lui faire quitter le pouvoir en 2018, un pas a été encore franchi : sous Tshisekedi, ces derniers sont qualifiés de « traîtres », de « rebelles » et même de « diables en soutane » tandis que des images circulent sur les réseaux sociaux pour nourrir la polémique (poignée de main entre Mgr Muteba et Paul Kagame, sourire et bénédiction de Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) devenu leader du mouvement rebelle AFC/M23).
Une des explications avancées par les sympathisants du pouvoir de Kinshasa aux critiques formulées à leur encontre par les hommes d’église est la décision, prise en 2019, de rendre l’enseignement primaire gratuit, ce qui aurait provoqué une perte financière pour l’Église catholique. Une autre est le tribalisme. Serge (42 ans, avocat) a quitté l’Église lorsque l’initiative du Pacte Social a été présentée aux fidèles :
« L’archevêque est dans une posture d’un homme politique, il est plus politique que religieux. Il est membre de l’opposition radicale contre le pouvoir en place. Le mal est dans l’Église. »
Pour ce dernier, l’opinion de l’archevêque est façonnée par la haine tribale et non portée par des raisons objectives vis-à-vis de l’appareil d’État congolais. Il fait ici référence à la tension entre Katangais et Kasaïens qui se trouve réactivée par l’élection d’un président kasaïen en 2018 et par l’arrivée massive des migrants kasaïens dans les 4 provinces de l’ex-Katanga.
Comme une bonne partie de la classe politique affiliée à l’UDPS, ce témoin qualifie les Katangais de traîtres acquis au gouvernement rwandais. Deux prêtres congolais interrogés en France soupçonnent certains évêques d’avoir été corrompus par les membres de la rébellion politico-militaire. Pour d’autres, la raison du soutien plus ou moins avoué de membres de la CENCO à la rébellion n’est pas économique mais plutôt morale ou idéologique. Benoît (68 ans, professeur) estime ainsi que « le Rwanda domine psychologiquement beaucoup de personnes parmi les élites congolaises ».
Ceux qui ne sont pas corrompus « pêcheraient » par naïveté et par soif du pouvoir, plusieurs d’entre eux avouant aimer la politique ou avoir hésité entre la vocation religieuse et une carrière politique ou militaire. Un autre fidèle laisse entendre que dans le contexte de redécoupage territorial et de perte de l’unité administrative et de l’identité katangaise, Mgr Muteba cherche à devenir le leader qu’ont pu incarner autrefois Gabriel Kyungu wa Kumwanza (mort en 2021) ou Moïse Katumbi, aujourd’hui en exil.
Une tension palpable
Que retenir de ces polémiques ? Sur le continent africain, l’Église catholique a souvent joué un rôle de médiation clé en période de stabilisation ou de guerre, de crise post-électorale ou encore lors des tensions post-apartheid en Afrique du Sud. Dans différents contextes, les initiatives du clerge étaient souvent ciblées et acceptées par les parties, voire mandatées par le gouvernement. En RDC, la crise est politique, sociale et institutionnelle, donc plus diffuse – et l’ambition du Pacte ECC-CENCO est très large, ce qui fait à la fois sa force et sa principale fragilité.
Ces controverses révèlent toutefois deux dynamiques majeures. D’un côté, une polarisation de l’opinion publique entre deux camps supposés : les pro-régime qui se qualifient de patriotes, et ceux soupçonnés d’être pro-M23-Rwanda. À Lubumbashi, ce clivage s’observe parmi les fidèles catholiques et revêt une coloration ethnico-régionale entre Kasaiens et Katangais. De l’autre, la désinformation comme arme politique.
En RDC comme ailleurs, la guerre n’est pas seulement militaire ; elle est aussi informationnelle, et les réseaux sociaux sont devenus le principal champ de bataille politique. L’absence de contrôle des énoncés diffusés sur WhatsApp pose, à cet égard, une question centrale, les agences de fact-checking congolaises se concentrant davantage sur les contenus diffusés sur TikTok et Instagram.
Annélie Delescluse ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
25.02.2026 à 16:53
Lignes du front : les soldats poètes qui défendent l’Ukraine
Hugh Roberts, Professor of Languages, Cultures and Visual Studies, University of Exeter
Texte intégral (1682 mots)
En Ukraine, dans le contexte de la guerre lancée par la Russie en février 2022, la poésie joue un rôle essentiel dans le traitement des traumatismes subis par la population, tout en renforçant sa capacité de résistance.
Selon des experts occidentaux du renseignement – et sans doute aussi les forces russes –, Kiev était censée tomber dans les jours qui ont suivi le début de l’invasion à grande échelle le 24 février 2022. Ils n’avaient pas pris en compte la résilience d’une société qui défend depuis longtemps sa langue et sa culture, et dans laquelle les poètes ont pendant des siècles résisté aux tentatives russes d’effacer l’identité ukrainienne.
Dire qu’il y a eu une renaissance de la poésie en Ukraine est un euphémisme. Depuis la Première Guerre mondiale, on n’avait plus vu d’œuvres d’une telle qualité et en telle quantité, écrites par des poètes qui sont également des combattants. La société civile a répondu à cet élan par des séances de lecture de poésie qui ont fait salle comble dans les abris anti-bombes des villes situées en première ligne, mais aussi par des initiatives telles que le portail Poetry of the Free (« Poésie des gens libres ») du ministère ukrainien de la culture, qui a reçu plus de 43 500 contributions depuis février 2022.

La poésie de guerre ukrainienne n’est pas d’un abord facile. En effet, elle s’exprime actuellement sous des formes anciennes et primitives : prière, témoignage, cri de ralliement et de malédiction. Au milieu du bruit des actualités géopolitiques, des commentaires, de la désinformation et du brouhaha des réseaux sociaux, elle revient avec insistance sur l’élément le plus important de tous : les gens.
Comme l’écrivait le célèbre poète Maksym Kryvtsov (1990-2024) dans son recueil Poèmes des tranchées (2024) :
« Quand on me demande ce qu’est la guerre, je réponds sans hésiter : des noms. »
Kryvtsov était lui-même mitrailleur et défendait l’Ukraine bien avant l’invasion à grande échelle. Il a été tué par un obus russe en janvier 2024, quelques jours seulement après la publication de son premier et dernier livre.
Les poètes de la résistance
Il y a trop de poètes ukrainiens importants pour tous les citer, mais pour l’heure deux noms se distinguent tout particulièrement dans le mouvement de renaissance poétique ukrainienne : Yaryna Chornohouz et Artur Dron.
Ces deux poètes ont servi leur pays. Chornohouz est toujours opératrice de drone au sein du Corps des Marines ukrainiens dans la ville de Kherson, située en première ligne. Dron s’est engagé en février 2022, quatre ans avant d’atteindre l’âge de la conscription, et est aujourd’hui un vétéran après avoir été gravement blessé. Tous deux ont vu leurs poèmes publiés en anglais, en français et dans d’autres langues, et ont remporté d’importants prix littéraires en Ukraine.
La poésie et la vie de Chornohouz sont étroitement liées à la défense de l’Ukraine contre la menace existentielle que représente la Russie. Ses écrits sont également empreints de lamentations et de témoignages.
Son poème « Les fruits de la guerre » s’inspire de son expérience en tant que secouriste depuis 2019. C’est un cri pour que les vies d’une valeur inestimable perdues sur le champ de bataille ne tombent pas dans l’oubli, malgré tout.
Dron parle de ces pertes invisibles et oubliées dans son recueil Hemigway ne sait rien en 2025. Sa poésie et celle de Chornohouz et d’autres poètes de guerre ukrainiens offrent une forme puissante de commémoration qui peut être d’autant plus universelle qu’elle est intensément personnelle. « La première lettre aux Corinthiens », dernier poème du recueil de Dron intitulé We Were Here (Nous étions là, 2024), évoque l’amour qui anime son choix de défendre l’Ukraine.
Les jeunes hommes de la compagnie de Dron étaient très proches d’un soldat plus âgé qu’eux, leur médecin, Oleksandr « Doc » Kobernyk, qu’ils considéraient comme leur professeur.
Dans Hemingway ne sait rien, Dron revient à plusieurs reprises sur une histoire qui s’est déroulée lorsque leur position dans une forêt a été soumise à des bombardements russes soutenus. Désorienté par une lésion cérébrale, il part à la recherche de Doc, mais apprend par son commandant qu’il a été tué. Chargé d’évacuer son corps et ne disposant pas de civière, il l’enveloppe dans un sac de couchage. Alors que le corps de Doc est encore chaud, le poète ressent l’amour qui émane de son professeur.
Le jour où Olena, la femme de Doc, a appris sa mort, elle a écrit un poème. Sa lecture a déclenché l’écriture de Dron que la guerre avait bloquée.
Si nous y prêtons attention, la poésie de guerre ukrainienne peut nous transmettre au moins une partie de l’amour et du souvenir de ce qui compte vraiment. La poésie, la langue, la culture et l’identité sont des questions essentielles pour la sécurité de l’Ukraine. Pour ceux qui se trouvent dans une relative sécurité au-delà des frontières ukrainiennes, mais qui sont néanmoins confrontés à la menace russe, le moment est peut-être venu, comme pour l’Ukraine, de s’inspirer des traditions poétiques.
Même si, comme l’a écrit le poète britannique Alfred Tennyson, nous sommes « affaiblis par le temps et le destin », nous pouvons encore trouver en nous
« la volonté
De chercher, lutter, trouver et ne rien céder ».
En France, les éditions du Tripode ont publié C’est ainsi que nous demeurons libres, de Yaryna Chornohouz. Les poèmes d’Artur Dron ont été publiés par les éditions Bleu et Jaune.
Hugh Roberts bénéficie d'un financement provenant d'une bourse Curiosity Award du Conseil de recherche en arts et sciences humaines (numéro de subvention UKRI3524), d'une bourse Talent Development Award de la British Academy (référence de subvention TDA25\250282) et d'une subvention Connections through Culture du British Council (numéro de subvention 5143).
25.02.2026 à 16:49
Realpolitik et fiabilité : le dilemme des négociations avec la République islamique d’Iran
Djamchid Assadi, Professeur associé au département « Digital Management », Burgundy School of Business
Texte intégral (2749 mots)
Négocier avec l’Iran sur son programme nucléaire est possible, mais il convient, pour obtenir des résultats tangibles, de s’appuyer sur les leçons du passé et sur les réflexions théoriques conduites par divers politologues majeurs des dernières décennies.
Le dilemme est ancien et pourtant intact : négocier est parfois nécessaire pour éviter le pire. Mais les démocraties peuvent-elles, sans affaiblir les principes mêmes qu’elles prétendent défendre, négocier avec des régimes régulièrement mis en cause par des organisations internationales pour violations des droits fondamentaux de la même façon qu’elles négocient entre elles ?
Des compromis signés seront-ils respectés ?
Le régime auquel nous pensons ici en premier lieu est la République islamique d’Iran, et les mises en cause évoquées ci-dessus ne relèvent pas d’une appréciation polémique : elles sont régulièrement documentées par des organisations indépendantes comme Amnesty International ou Reporters sans frontières, par des think tanks comme Freedom House, ainsi que par divers indicateurs internationaux sur la démocratie et l’État de droit.
Chez Raymond Aron, la tension entre valeurs démocratiques et possibilité de négocier avec des régimes autoritaires n’oppose pas naïvement morale et intérêt, mais deux exigences constitutives de la politique étrangère : la prudence stratégique – éviter la guerre dans un monde anarchique – et la fidélité à des normes sans lesquelles l’ordre international ne serait qu’un rapport de forces dépourvu de légitimité.
La question n’est donc pas de savoir s’il faut dialoguer avec des régimes à faible redevabilité institutionnelle et à structure décisionnelle opaque. Mais si l’on admet que la négociation peut être nécessaire pour prévenir des risques majeurs, encore faut-il s’interroger sur les conditions de fiabilité des engagements qui en résultent. Comment s’assurer que les compromis conclus ne restent pas des promesses réversibles ?
L’histoire offre des illustrations concrètes de ce risque de réversibilité. En 1938, la France et le Royaume-Uni négocient avec l’Allemagne nazie d’Adolf Hitler les accords de Munich, acceptant l’annexion des Sudètes – région frontalière de la Tchécoslovaquie majoritairement peuplée d’Allemands – dans l’espoir de préserver la paix européenne. Faute de mécanismes contraignants de mise en œuvre et de garanties crédibles, les accords offrent simplement un répit stratégique à Hitler, qu’il exploite pour consolider son réarmement et poursuivre son expansion territoriale, avant d’envahir la Pologne en 1939.
Dans les années 1990, les Nations unies, l’Union européenne (UE) et les États-Unis négocient avec le président serbe Slobodan Milosevic plusieurs cessez-le-feu destinés à mettre fin aux opérations coercitives en Bosnie. Ces engagements restent seulement partiellement appliqués tant qu’ils ne sont pas adossés à un dispositif contraignant, celui des accords de Dayton de 1995, soutenus par une présence militaire de l’Otan chargée d’en garantir l’exécution. Dans les deux cas, la leçon est claire : sans dispositifs de vérification et de contrainte capables de rendre la défection coûteuse, la négociation risque de demeurer un levier tactique plutôt qu’un instrument de stabilisation durable.
La question centrale devient alors celle de la crédibilité des engagements issus d’une négociation destinée à prévenir un risque stratégique majeur : comment s’assurer que les promesses formulées ne demeurent pas réversibles ? Les penseurs libéraux des relations internationales ont précisément analysé cette question.
L’éclairage de la science politique
Dans After Hegemony (1984, sorti en français en 2015 aux éditions de l’Université de Bruxelles sous le titre Après l’hégémonie, Coopération et désaccord dans l’économie politique internationale), Robert Keohane n’aborde pas directement la négociation, mais les conditions institutionnelles qui rendent des engagements internationaux crédibles dans un système anarchique, dépourvu d’autorité centrale. Il montre qu’un accord ne devient fiable que lorsque des mécanismes institutionnels rendent observable et coûteuse la défection des engagements pris. Transparence, inspections, répétition des interactions : ces dispositifs permettent de vérifier le respect des engagements et de transformer un compromis politique en obligation crédible. Keohane prolonge cette réflexion dans Power and Governance in a Partially Globalized World (2002), confirmant le rôle central des institutions dans la fiabilité des engagements internationaux.
Andrew Moravcsik, dans The Choice for Europe (1998), met l’accent sur l’ancrage domestique des engagements. Selon son approche libérale intergouvernementale, un accord international ne devient solide que s’il est soutenu, à l’intérieur même du régime signataire, par des acteurs ayant intérêt à son maintien. Lorsque le coût politique interne d’un abandon des engagements augmente, la crédibilité externe de ces engagements s’en trouve renforcée.
Anne-Marie Slaughter, dans A New World Order (2004), insiste pour sa part sur la mise en œuvre transgouvernementale des engagements. Un compromis ne devient robuste que s’il s’inscrit dans des réseaux d’autorités administratives, de régulateurs et d’agences spécialisées capables d’en assurer l’application concrète et la continuité au-delà des alternances politiques. À défaut de tels relais institutionnels, un engagement obtenu au sommet demeure fragile.
Il ressort de ces analyses qu’un engagement issu de négociations internationales n’est crédible que s’il réunit plusieurs conditions complémentaires : être vérifiable par des mécanismes de transparence et d’inspection ; s’inscrire dans des interactions répétées qui rendent la défection stratégiquement coûteuse ; être soutenu à l’intérieur du régime signataire par des acteurs ayant intérêt à son maintien ; et être relayé par des réseaux transgouvernementaux – administratifs, régulatoires ou judiciaires – capables d’en assurer l’application et la continuité au-delà des alternances politiques.
Hannah Arendt apporte un éclairage complémentaire. Dans les Origines du totalitarisme (1951), elle montre que dans certains systèmes politiques, la responsabilité décisionnelle se dilue dans des structures bureaucratiques et idéologiques peu transparentes. Lorsque les centres effectifs de décision sont difficiles à identifier et que les mécanismes de redevabilité sont limités, la logique même de l’engagement politique s’en trouve fragilisée. La question n’est plus seulement celle de la volonté déclarée, mais celle de la capacité institutionnelle à garantir la continuité et l’imputabilité des décisions prises.
Les négociations sur le nucléaire iranien et leurs faiblesses
Le dossier du programme nucléaire de la République islamique d’Iran peut être relu à l’aune de ces critères. En novembre 2004, sous la présidence de Mohammad Khatami, présenté comme modéré par rapport aux radicaux du régime, l’accord de Paris formalise une suspension volontaire d’activités sensibles sous vérification internationale. Le dispositif répond partiellement à l’exigence de vérifiabilité. Toutefois, l’élection en 2005 d’un président nettement plus radical, Mahmoud Ahmadinejad, modifie la trajectoire : certaines activités reprennent dès 2005, puis l’enrichissement est relancé en 2006. L’épisode suggère que l’engagement n’est pas suffisamment soutenu par des acteurs internes capables d’en garantir la continuité, et que le coût politique domestique d’une révision apparaît limité.
La dynamique se rejoue avec le Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA) de 2015, dit Accord de Vienne. L’accord prévoit des mécanismes de contrôle détaillés sous supervision de l’Agence internationale de l’énergie atomique et s’inscrit dans un cadre multilatéral. Jusqu’en 2018, l’AIEA certifie à plusieurs reprises que la République islamique respecte les obligations techniques prévues par le texte. En mai 2018, lors du premier mandat de Donald Trump, les États-Unis annoncent pourtant leur retrait unilatéral, l’administration estimant que l’accord ne traitait ni du programme balistique iranien ni des clauses dites « sunset » – dispositions prévoyant l’expiration progressive de certaines limitations nucléaires après un délai déterminé. À la suite de ce retrait, Téhéran engage des dépassements progressifs des seuils d’enrichissement fixés par le JCPOA. La réversibilité apparaît alors des deux côtés : retrait américain d’un engagement multilatéral d’une part, non-respect graduel de certaines clauses par Téhéran d’autre part.
Cette fragilité tient aussi au faible ancrage institutionnel transversal de l’accord : contesté par une partie du Congrès américain et par des acteurs influents au sein du système politico-stratégique iranien, il ne créait pas de coûts domestiques suffisamment élevés pour rendre la défection politiquement dissuasive.
Le dossier des arrestations de ressortissants binationaux éclaire plus spécifiquement le cas de la République islamique d’Iran. Ces dernières années, plusieurs binationaux – notamment Nazanin Zaghari-Ratcliffe (britannique-iranienne) ou Fariba Adelkhah (franco-iranienne) – ont été arrêtés et détenus en Iran dans des contextes de tension diplomatique. Parallèlement, des échanges de prisonniers ont eu lieu, comme celui impliquant le chercheur américain Xiyue Wang en 2019 ou l’accord d’échange conclu avec Washington en 2023. Cette coexistence d’un dialogue diplomatique et de mesures coercitives suggère que les interactions ne sont pas pleinement encadrées par des mécanismes stabilisés et réciproques comparables à ceux existant entre États liés par des accords formalisés d’extradition. Dans ces différents domaines – nucléaire et détentions – la négociation demeure exposée aux variations du rapport de forces plutôt qu’inscrite dans une architecture institutionnelle consolidée.
La question n’est donc pas de qualifier moralement ces séquences, mais d’évaluer si les engagements pris répondent aux critères de crédibilité précédemment établis.
Les conditions d’une négociation fiable
Si l’on souhaite maintenir la négociation tout en renforçant sa fiabilité, plusieurs pistes peuvent être envisagées dans le cadre théorique esquissé plus haut.
Premièrement, renforcer les dispositifs de vérification et inscrire les engagements dans des interactions réellement répétées et conditionnelles, de manière à accroître le coût stratégique d’une défection.
Deuxièmement, structurer les accords de manière à créer des incitations internes à leur continuité. Il ne faut pas se leurrer : les négociateurs occidentaux ne peuvent « fabriquer » des relais domestiques au sein de la République islamique d’Iran. En revanche, ils peuvent concevoir des engagements qui s’inscrivent dans des lignes de différenciation déjà présentes au sein du système politico-institutionnel. Les séquences nucléaires conduites sous la présidence de Mohammad Khatami (1997-2005), puis lors de la négociation du JCPOA en 2013-2015, ont reposé sur l’existence de sensibilités plus favorables à l’ouverture internationale.
Lorsque des bénéfices économiques, scientifiques ou techniques sont clairement identifiables, ils tendent à renforcer ces segments administratifs et économiques ayant intérêt à la stabilité des engagements. Des dynamiques comparables ont été observées ailleurs : les accords d’Helsinki de 1975 ont offert des points d’appui normatifs aux réformateurs d’Europe de l’Est dans les années 1980 ; l’ouverture économique de la Chine à partir de 1978, puis son accession à l’OMC en 2001 ont consolidé des coalitions technocratiques favorables à l’intégration internationale ; la normalisation américano-vietnamienne engagée en 1995 a accompagné des réformes économiques internes. Toutefois, plus les fractions conservatrices et radicales deviennent prédominantes, plus cette condition devient difficile à satisfaire : la crédibilité d’un accord dépend alors de sa capacité à produire des coûts politiques internes suffisants pour dissuader les radicaux de le remettre en cause.
Troisièmement, élargir les réseaux transgouvernementaux au-delà du seul niveau exécutif. Certes, des mécanismes existent déjà : l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) assure un contrôle technique central. Mais l’expérience montre que ces dispositifs ne suffisent pas toujours à dissiper durablement la défiance. La révélation tardive de certains sites nucléaires non déclarés – comme Natanz en 2002 ou Fordow en 2009 – a illustré les limites d’un système reposant principalement sur la déclaration et l’inspection encadrée.
En outre, la robustesse d’un accord nucléaire dépend aussi de son articulation avec d’autres préoccupations stratégiques, notamment les capacités balistiques ou le soutien logistique et financier à certains groupes armés désignés comme terroristes par plusieurs États. Lorsque ces dimensions restent en dehors du cadre négocié, elles alimentent la contestation politique de l’accord. D’où l’intérêt d’une architecture plus dense associant autorités de régulation, réseaux techniques et canaux académiques – y compris au sein de la diaspora iranienne – afin de renforcer l’environnement institutionnel dans lequel les engagements sont appliqués.
Une telle approche ne relève ni du contournement ni de l’ingérence. Elle vise à inscrire la négociation dans une profondeur institutionnelle susceptible d’en réduire la fragilité.
La realpolitik, chez Aron, n’est pas l’abandon des principes ; elle est l’acceptation lucide des contraintes. Mais lorsqu’elle se limite à des arrangements temporaires sans architecture institutionnelle capable d’en garantir la continuité, elle risque d’affaiblir la crédibilité normative qu’elle cherche précisément à préserver.
La question n’est donc pas de savoir s’il faut négocier avec la République islamique d’Iran. Elle est de déterminer si la négociation peut être structurée de manière à rendre les engagements vérifiables, coûteux à violer et institutionnellement consolidés – condition pour que la prudence stratégique ne se transforme pas, malgré elle, en normalisation fragile.
Djamchid Assadi ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
25.02.2026 à 16:49
Le rôle des entreprises dans le processus de paix colombien
Frédéric Martineau, PhD - Relations Internationales. Spécialisation en Diplomatie des affaires, Centre d'études diplomatiques et stratégiques (CEDS)
Texte intégral (2433 mots)
Les entreprises colombiennes se sont impliquées dans le processus de paix, depuis les premiers tâtonnements des années 1980 jusqu’aux négociations de La Havane avec les FARC en 2016. Cet engagement a fait du secteur privé un acteur désormais incontournable mais loin d’être homogène. Malgré l’accord de 2016, la paix demeure inachevée et la pérennité de l’engagement entrepreneurial dépend en bonne partie de l’environnement institutionnel.
À l’approche de l’élection présidentielle qui se déroulera en mai 2026, et alors que le président en exercice Gustavo Petro ne peut pas se représenter, le candidat de son parti (la coalition Pacto Historico, classée à gauche), Ivan Cepeda, se trouve actuellement en tête des sondages.
Les menaces exprimées par Donald Trump à l’encontre du gouvernement colombien, qui se sont renforcées dans la foulée de l’enlèvement de Nicolas Maduro au Venezuela voisin, participent sans doute de la désaffection populaire pour le principal candidat de la droite, Abelardo de la Espriella. Il n’en reste pas moins que les intentions de vote témoignent également de l’indulgence de la population colombienne à l’égard du parti au pouvoir, en dépit de l’échec de l’initiative de « paix totale » du président actuel.
Cette politique ambitieuse visait à négocier simultanément avec tous les groupes armés encore actifs dans le pays (guérillas, paramilitaires ou organisations criminelles) afin de parachever le processus de paix sur l’ensemble du territoire colombien. Rappelons que les autorités de Bogota et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) ont signé en 2016 à La Havane un accord historique censé mettre fin à des décennies de guerre civile sanglante dont le bilan humain est évalué à au moins 450 664 morts, 121 768 disparus et 7,7 millions de déplacés.
Une paix inachevée
Depuis 2016, en dépit de l’accord, la violence continue de gangrener le pays. Elle est entretenue par l’Armée de libération nationale (ELN), groupe armé de gauche non signataire de l’accord de 2016 ; par des factions dissidentes des FARC, lesquelles ont été majoritairement démobilisées ; mais surtout par des organisations mafieuses devenues multicartes (drogue, trafic d’êtres humains, minerais) et de véritables multinationales du crime.
Le Clan del Golfo, héritier des groupes paramilitaires très à droite du spectre politique qui avaient pris part à la guerre civile contre les FARC, gère un chiffre d’affaires annuel de près de 18 milliards de dollars (plus de 15 milliards d’euros). C’est la plus grande organisation criminelle du pays ; elle cohabite avec une multitude de gangs locaux et avec les groupes armés dissidents. Les idéologies marxistes qui animaient les guérillas au début des années 1960 se sont progressivement transformées en un pragmatisme mêlant collaboration avec les cartels et prébendes du trafic de cocaïne. Le narratif révolutionnaire a disparu au profit du dieu Dollar.
Face à cette réalité persistante, il est instructif de retracer l’évolution du rôle joué par les entreprises dans ce processus de paix inachevé. En effet, dès le début des pourparlers et jusqu’à la signature des accords de La Havane, les entreprises ont joué un rôle important dans le processus de construction de la paix.
Aujourd’hui encore, elles demeurent des acteurs clés. Cependant, leur engagement n’est ni homogène, ni linéaire, ni constant. Les fondements structurels ou idéologiques de cette participation répondent à des intérêts économiques, territoriaux et politiques variés et complexes, comme le montre l’étude empirique menée par Rettberg et Aceros.
La diplomatie des affaires au service de la consolidation de la paix
Les modèles conceptuels de la diplomatie ont largement évolué. Le constat de l’inefficacité de la seule médiation gouvernementale pour la résolution des conflits avait conduit l’ancien diplomate américain Joseph Montville à développer dans les années 1980 la notion de « diplomatie parallèle ». Elle traduit la partie informelle qui sous-tend les relations internationales.
Dans les années 1990, le modèle à voies multiples proposé par Louise Diamond et complété par l’ambassadeur John McDonald reflète mieux la complexité des diplomaties alternatives et l’augmentation des parties prenantes qui y participent. Les entreprises et la diplomatie des affaires deviennent une voie possible et crédible pour la résolution des conflits.
Le début de la décennie suivante offre une reconnaissance internationale du rôle accru des entreprises dans la bonne marche du monde. Le programme Global Compact des Nations unies tient compte de la puissance économique des multinationales – dont le chiffre d’affaires dépasse parfois le PIB de certains États – et les considère comme des acteurs essentiels pour atteindre certains objectifs de développement durable de l’Agenda 2030, notamment l’ODD 16, qui consiste à s’engager pour la paix, la justice et des institutions efficaces. Le plan stratégique (2024-2025) embarque les PME dans le programme.
Ce n’est pas seulement la philanthropie qui incite les entreprises à s’impliquer dans un processus de consolidation de la paix. Surtout lorsque le pays en conflit est riche en ressources renouvelables (terres agricoles fertiles, potentiel hydroélectrique, forêts…) ou en réserves épuisables (pétrole, gaz, charbon, or, diamants…).
Néanmoins, quel que soit l’intérêt qu’elles y trouvent (marges conséquentes, parts de marché, avantage concurrentiel, croissance rapide, RSE), les entreprises jouent indéniablement un rôle. Celui-ci peut être positif ou négatif. Elles ne sont en effet ni facilitatrices de la résolution d’un conflit par nature ni a contrario nécessairement alimentatrices de tensions existantes. Leur implication est toujours nuancée, elle dépend du contexte dans lequel elles opèrent. Les ONG documentent autant de cas montrant leurs apports à la construction de la paix que leurs comportements prédateurs.
Dans le cas de la Colombie, des acteurs du secteur privé ont participé aux négociations et à la signature des accords de paix avec les FARC en 2016. Ce succès représentait l’espoir de mettre fin au conflit le plus long du monde occidental, impliquant à partir des années 1990, la communauté internationale, qui apporta soutien et coopération aux autorités du pays.
Un référendum rejeta dans un premier temps le traité de paix. Mais, il fut révisé et approuvé par le Congrès colombien (plutôt que soumis à une autre validation populaire), sous le nom d’accord du théâtre Colón le 24 novembre 2016.
Une implication progressive des entreprises
L’engagement des entreprises colombiennes dans le processus de paix s’inscrit dans une trajectoire marquée par une intensification progressive et une professionnalisation croissante.
La période 1982-1998 constitue une phase d’apprentissage timide. En 1984, dans un discours télévisé, le président Belisario Betancur évoque l’importance des milieux d’affaires dans la recherche d’une solution pacifique au conflit. Cette reconnaissance marque le début d’une action accrue des entrepreneurs au sein des sphères publique et politique, dans un contexte marqué par des processus de négociation avec les groupes armés. Des personnalités du monde des affaires sont directement impliquées : Nicanor Restrepo, alors à la tête du Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), un conglomérat regroupant près de 125 entreprises, est nommé Haut Commissaire pour la paix. À partir de 1992, le gouvernement prélève des impôts pour financer le processus de paix, une contribution largement acceptée par les entreprises.
Le tournant survient au milieu des années 1990 lorsque l’explosion de la violence multiplie les coûts pour les entreprises. Celles-ci soutiennent alors les marches citoyennes et le Mandat pour la paix, un vote symbolique non officiel lors des élections locales d’octobre 1997, qui recueille dix millions de voix. Les Colombiens expriment ainsi leur désir de voir la fin du conflit armé, faisant de ce geste l’une des plus grandes mobilisations citoyennes pour la paix de l’histoire latino-américaine. Néanmoins, peu d’entrepreneurs désirent faire partie intégrante de l’effort national pour la paix. Le conflit épargnant la majeure partie du tissu économique, qui est concentré dans les quatre grandes métropoles (Bogota, Barranquilla, Cali, Medellin), nombre d’entre eux adoptent une position prudente ou attentiste.
L’administration Pastrana (1998-2002) marque un changement radical. Le conflit affecte désormais directement les entreprises avec l’explosion du nombre d’enlèvements, dont près de 15 % touchent la communauté des affaires. Les FARC imposent, sur les territoires qu’elles contrôlent directement ou indirectement, une taxe de 10 % sur les actifs dépassant un million de dollars (849 000 euros environ), tandis que les dépenses de sécurité privée explosent pour représenter de 4 à 6 % des budgets d’entreprise. Les entrepreneurs participent activement aux négociations de San Vicente del Caguán, créent des think tanks et multiplient les actions locales.
Des initiatives structurées émergent et essaiment, comme le réseau national de programmes régionaux de développement et de paix. Elles tentent de s’attaquer aux causes structurelles de la violence que sont la pauvreté, l’accès à l’éducation et à la santé en associant les entreprises, l’Église (souvent la plus légitime à l’échelon territorial), les organisations internationales et les communautés locales.
Toutefois, l’échec du processus et l’escalade de la violence érodent progressivement ce soutien.
L’illusion d’une victoire militaire
Sous l’administration Uribe (2002-2010), l’approche se durcit. Le président privilégie la stratégie sécuritaire et la lutte armée. Le secteur privé soutient massivement cette orientation en acceptant une réforme fiscale sévère, payant simultanément pour la paix et la guerre. La réduction des homicides et des enlèvements améliore la perception de sécurité, conduisant certains entrepreneurs à envisager une solution purement militaire. Mais ils réalisent finalement qu’une paix durable ne peut résulter d’une politique exclusivement sécuritaire. Une étude de l’Université de Los Andes auprès de 1 113 entreprises révèle qu’en l’absence de violence, les entreprises investiraient davantage, confirmant l’existence d’un important « dividende de la paix ».
L’administration Santos (2012-2016) représente l’apogée de l’implication entrepreneuriale. Le gouvernement consulte régulièrement la communauté des affaires dès la phase exploratoire secrète. Les entreprises financent discrètement les contacts préliminaires et participent directement aux négociations. Une délégation de huit organisations patronales se rend à La Havane en novembre 2015, aboutissant à la création du Conseil d’entreprises pour la paix durable. Néanmoins, cette implication ne fait pas consensus. Certains entrepreneurs, craignant des concessions excessives, financent la campagne du « Non » au référendum d’octobre 2016.
La période post-accord, une occasion ratée ?
Un travail de recherche publié en 2019 montre que peu d’entreprises perçoivent un changement majeur dans leurs opérations. Le secteur minier constate que les groupes illégaux ont simplement remplacé les FARC. L’avantage principal reste l’accélération de projets déjà prévus et l’accès à de nouvelles zones d’opération qui bénéficient d’un classement spécial – les programmes de développement avec approche territoriale (PDET) et les zones les plus affectées par le conflit armé (ZOMAC) – qui donnent droit à des exonérations fiscales en contrepartie d’investissements notamment dans les infrastructures.
Ainsi, à travers ces quatre décennies, le secteur privé colombien est devenu un acteur incontournable du processus de paix, tout en restant fondamentalement hétérogène dans ses motivations, ses perceptions et ses actions. Cette trajectoire illustre la façon dont l’intensification du conflit, la perception croissante des coûts économiques, le développement de la culture RSE et l’apprentissage institutionnel ont transformé des entrepreneurs initialement distants en parties prenantes essentielles de la construction de la paix colombienne.
L’engagement du secteur privé, bien que motivé par des intérêts économiques, peut constituer un levier puissant pour la consolidation de la paix – à condition qu’il s’inscrive dans un cadre institutionnel solide et qu’il soit accompagné d’une véritable volonté politique et d’une collaboration entre l’ensemble des parties prenantes à une situation de conflit. La question qui se pose désormais est celle de la durabilité : comment maintenir cet engagement entrepreneurial dans la durée, particulièrement lorsque les « dividendes de la paix » tardent à se matérialiser ?
Frédéric Martineau est président de l'AMAEPF.
25.02.2026 à 12:48
Autrefois dissimulés, les « assassinats ciblés » sont devenus des instruments assumés du pouvoir d’État
Kevin Foster, Associate Professor, School of Languages, Literatures, Cultures and Linguistics, Monash University
Texte intégral (3598 mots)
Frappes de drones, annonces sur les réseaux sociaux, revendications publiques : l’assassinat n’est plus une opération clandestine honteuse mais un message politique. Dans son nouveau livre, l’historien Simon Ball enquête sur la normalisation d’une violence d’État.
En novembre 2012, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont utilisé Twitter – comme on l’appelait alors – pour annoncer qu’elles avaient tué Ahmed al-Jabari, chef des Brigades al-Qassam, la branche militaire du Hamas, à Gaza.
Cette annonce, accompagnée d’un lien vers une vidéo pixellisée de la frappe aérienne visant la voiture d’al-Jabari, marquait le début d’une nouvelle incursion des FDI à Gaza. Comme l’ont noté les historiennes Adi Kuntsman et Rebecca L. Stein dans leur livre Digital Militarism, elle a fait de l’opération « Pilier de défense » d’Israël « la première campagne militaire à avoir été déclarée via Twitter ».
Ce qui frappait également dans cette annonce, c’était la fierté et l’audace avec lesquelles les FDI célébraient ce qu’elles avaient fait. À peine une décennie plus tôt, Israël, comme les États-Unis, le Royaume-Uni et les puissances européennes, aurait éludé les questions sur sa responsabilité dans l’attaque ou nié avec ténacité. Les gouvernements n’assassinaient pas des personnes – c’était le fait de fanatiques politiques et d’extrémistes religieux.
Les choses avaient changé. Et profondément. La même année, le président Barack Obama demanda à John Brennan, son conseiller adjoint à la sécurité intérieure et à la lutte contre le terrorisme, de faire une déclaration publique sans ambiguïté sur la politique des États-Unis concernant l’usage de frappes de drones pour cibler des ennemis nommément désignés des États-Unis. Dans un discours au Wilson Center, Brennan déclara :
en totale conformité avec la loi, et afin de prévenir des attaques terroristes contre les États-Unis et de sauver des vies américaines, le gouvernement des États-Unis mène des frappes ciblées contre des terroristes spécifiques d’al-Qaida.
Le fait que les Américains, ainsi qu’un certain nombre de leurs alliés, tuaient – ou tentaient de tuer – leurs ennemis était, observa Brennan, « le secret le moins bien gardé du monde ». Il était temps que la « mascarade » prenne fin, d’appeler les choses par leur nom – ou, plus précisément, d’appeler une mise à mort ciblée un assassinat.
La nouvelle, cette semaine, selon laquelle le dissident russe Alexeï Navalny est mort après avoir prétendument ingéré du poison provenant d’une grenouille sud-américaine alors qu’il était emprisonné dans l’Arctique, rappelle que la Russie possède elle aussi une longue histoire d’assassinats de critiques du régime.
Dans Death to Order : A Modern History of Assassination (non traduit en français), Simon Ball propose une histoire de l’assassinat au cours du dernier siècle environ, fondée sur des recherches minutieuses et d’une lecture particulièrement captivante. Ball est professeur d’histoire et de politique internationales, et ces spécialités structurent l’approche du livre.
En conséquence, son livre s’intéresse moins à l’évolution des armes ou aux changements tactiques nécessaires aux mises à mort ciblées – jusqu’au développement du drone, ceux-ci sont restés en grande partie inchangés pendant plus d’un siècle – qu’à l’assassinat en tant qu’instrument de la politique d’État.
Dans une comparaison particulièrement imagée, Ball affirme que l’étude de l’assassinat « revient à faire glisser une lame de rasoir le long de l’histoire de la politique internationale ». La coupure qui en résulte peut être étroite, mais elle est longue et profonde. Elle révèle « l’exercice réel du pouvoir dans la politique internationale ».
Assauts déterminés
Si nombre des assassinats les plus marquants du siècle dernier – Mahatma Gandhi, John F. Kennedy, Martin Luther King Jr., Robert Kennedy, le Premier ministre suédois Olof Palme – sont évoqués, ils ne constituent pas le cœur de l’ouvrage.
Chacun de ces assassinats a donné lieu à des enquêtes approfondies et souvent prolongées, visant à établir un mobile politique et à identifier la main cachée d’une puissance hostile. Ainsi, l’enquête officielle sur le meurtre de Palme, en février 1986, n’a été close qu’en 2020.
Dans une affaire plus célèbre encore, l’assassinat du président Kennedy à Dallas en novembre 1963, les enquêteurs américains se sont employés avec ténacité à établir une éventuelle implication soviétique, d’abord au sein de la Commission Warren, puis de la Commission spéciale de la Chambre des représentants sur les assassinats, convoquée treize ans après les faits.

Malgré la soif du public et du monde politique pour des révélations de complots dignes de romans d’espionnage, Ball rappelle avec constance qu’aucune preuve n’est venue étayer une telle thèse. Ces assassinats furent le fait d’individus isolés, animés par des vendettas personnelles, des haines intimes ou des troubles psychiques.
Ils ne sont donc pas au cœur de son propos. Les victimes qu’il étudie sont moins des chefs d’État que leurs serviteurs loyaux. Son enquête révèle à quel point proconsuls, diplomates et responsables de la sécurité des grandes puissances étaient exposés aux attaques résolues de leurs adversaires.
Ne pas paraître faible
Pendant près d’un siècle, les partisans de l’émancipation face à la domination étrangère et à l’oppression économique ont fait exploser des bombes, parfois poignardé, mais le plus souvent abattu à bout portant, à l’arme légère, des représentants des puissances occupantes. Des assassinats ciblés ont eu lieu en Inde, en Irlande, en Algérie, en Malaisie, au Vietnam, en Palestine, en Égypte – bref, dans presque toutes les régions du monde passées sous la coupe d’un empire. La violence a même gagné les capitales des puissances coloniales.
L’une des révélations les plus frappantes du livre tient au temps qu’il fallut aux Britanniques surtout – mais aussi aux Français et aux Américains – pour admettre que la menace pesant sur leurs agents en poste à l’étranger, dans des environnements instables, était démesurément élevée. Pendant des décennies, le prestige impérial interdisait à ses représentants toute manifestation visible d’inquiétude pour leur sécurité personnelle. À Londres, bien après la Seconde Guerre mondiale, on estimait encore qu’une attention excessive portée à la sécurité risquait d’entamer la mystique d’autorité de la puissance dominante et de donner le sentiment d’un aveu de faiblesse.
Sur le terrain, les agents ne partageaient pas cet état d’esprit. Des dizaines d’entre eux furent poignardés ou abattus avant de convaincre leurs ministres de revoir leur position et de mettre en place des dispositifs de protection adéquats.
Si ce tournant se fit tant attendre, c’est que, tout en reconnaissant en privé la menace que des oppositions bien organisées faisaient peser sur leur domination, les gouvernements s’astreignaient publiquement à minimiser la portée d’actes de violence politique présentés comme isolés – ainsi que l’ampleur du soutien dont ces mouvements bénéficiaient parmi les populations occupées ou opprimées.
Le règlement de ces questions, plus larges, de légitimité et d’autorité reposait sur un dialogue prolongé entre les administrations coloniales et les élites politiques émergentes dans les territoires occupés. Il exigeait des négociations minutieuses et des compromis douloureux, impossibles à arracher dans la fournaise d’un soulèvement populaire. D’où la nécessité d’entretenir l’illusion du calme.
Le « script libéral » qui a façonné, pendant une grande partie du XXe siècle, la réponse du gouvernement britannique aux assassinats de ses représentants a pris forme sous le gouvernement de H.H. Asquith (1908-1916). Il s’articulait autour de trois principes essentiels :
1) Il existait des preuves d’un complot organisé visant à commettre des assassinats.
2) Très peu de personnes étaient impliquées dans ce complot.
3) Ce complot était dangereux en raison de la violence de ses méthodes, et non parce qu’il constituait la partie émergée d’un mouvement plus large.
En soutenant que ces meurtres étaient le fait d’un petit nombre de fanatiques – et non l’expression d’une opposition vaste et structurée –, les autorités pouvaient circonscrire, voire étouffer, l’agitation politique. Dans le même temps, les négociations se poursuivaient lentement, à huis clos.
« Assassins d’honneur » et activités clandestines
L’assassinat n’a eu aucune influence significative sur le cours, la conduite ou l’issue de la Seconde Guerre mondiale. En revanche, la guerre a profondément transformé l’assassinat en tant qu’outil d’État.
L’action des deux Tchèques qui tuèrent le général nazi Reinhard Heydrich, les multiples tentatives avortées d’assassinat contre Hitler, ou encore le geste de l’aristocrate irlandaise, troublée ou animée de principes inébranlables, Violet Gibson, qui, en avril 1926, tira sur Mussolini au « museau » (« In the snout », selon la formule inimitable de la chanteuse folk Lisa O’Neill) sans parvenir à le tuer, ont offert de nombreux exemples – plus souvent morts que vivants – de ce que l’on a appelé « l’assassin d’honneur ».

Pour ceux attachés à la démocratie libérale, il n’y avait qu’un pas entre la figure du tueur agissant par principe et l’idée que des puissances démocratiques fortes devaient elles aussi se doter de la capacité de procéder à des éliminations ciblées. Il s’agissait de prévenir la montée de l’intolérance en supprimant ses porte-voix, de combattre le feu par le feu.
Dans les années 1950 et 1960, certains gouvernements démocratiques, au premier rang desquels la France et les États-Unis, ont supervisé – ou laissé faire – des assassinats politiques de représailles contre leurs ennemis. Cette pratique a fini par être admise au point que les conflits militaires de grande ampleur en Algérie et au Vietnam ont été menés, pour une part non négligeable, à travers des programmes d’assassinats conduits à l’échelle industrielle.
Les questions d’autorité et de protocole devinrent centrales. Au début des années 1960, la branche spécialisée de la CIA chargée des « opérations exécutives » s’employait à déstabiliser des régimes en Amérique centrale, en organisant et en armant des insurrections, et en appuyant des opérations d’assassinat. D’autres services de l’agence rédigeaient les textes nécessaires – un véritable manuel d’assassinat à l’usage de l’homme de terrain – et définissaient la doctrine encadrant ces activités clandestines. En somme, il s’agissait de décider qui était habilité à autoriser un assassinat.
À mesure que cette responsabilité remontait progressivement jusqu’au bureau du président, l’assassinat s’imposa comme un instrument explosif de l’art de gouverner – un outil susceptible de faire voler en éclats la façade du gouvernement en place et de mettre en cause son discours sur la défense des principes démocratiques.
Assassinats ciblés
Au fil des années 1970 et jusque dans les années 1980, les troubles en Irlande du Nord se sont progressivement étendus au territoire britannique. À mesure que le conflit gagnait le continent, les efforts du gouvernement pour maintenir le scénario « asquithien » se sont effondrés. L’idée implicite selon laquelle un certain niveau d’assassinats constituait le prix à payer pour exercer le pouvoir dans une société libérale, ouverte et démocratique n’était plus tenable.
À mesure que les attaques de l’IRA contre l’élite politique britannique devenaient plus sophistiquées, plus ciblées et plus meurtrières, un tournant décisif s’est opéré dans les cercles dirigeants en matière de sécurité. En 1982, la « Protection » est devenue un commandement permanent au sein de la Metropolitan Police, la police de Londres.
Alors que des débouchés lucratifs s’ouvraient pour d’anciens membres des forces spéciales dans les nouvelles industries de la sécurité, les chercheurs américains en matière de défense continuaient d’affiner les capacités permettant de frapper des ennemis avec une précision accrue, à des distances toujours plus grandes.
Avec l’entrée en service des premiers drones armés, l’administration de George W. Bush a redéfini la notion d’assassinat afin d’en exclure les frappes « défensives » préventives visant des individus nommément désignés et considérés comme une menace pour les États-Unis ou leurs personnels. De là, il n’y eut qu’un pas vers le recours massif aux assassinats ciblés en Asie centrale, au Moyen-Orient et en Afrique de l’Ouest.
Alors que d’anciens membres des forces spéciales trouvaient des débouchés très rémunérateurs dans les nouvelles entreprises privées de sécurité, les chercheurs américains travaillant pour la défense perfectionnaient, eux, des technologies permettant de viser leurs ennemis avec une précision croissante, à des distances toujours plus grandes.
Avec l’entrée en service des premiers drones armés, l’administration de George W. Bush a redéfini la notion d’assassinat afin d’en exclure les frappes « défensives » préventives visant des individus nommément désignés et considérés comme une menace pour les États-Unis ou leurs personnels. De là, il n’y eut qu’un pas vers le recours massif aux assassinats ciblés en Asie centrale, au Moyen-Orient et en Afrique de l’Ouest.
En 2007, l’armée américaine disposait de 24 drones dédiés aux opérations d’élimination ciblée. Deux ans plus tard, ce chiffre atteignait 180 appareils, dotés d’une capacité d’emport quinze fois supérieure à celle des modèles précédents. En 2025, le département américain de la Défense – récemment rebaptisé « département de la Guerre » – comptait plus de 11 000 aéronefs sans pilote dans son arsenal. Tous ne sont pas destinés à des missions d’élimination, certes. Mais les ordres de grandeur parlent d’eux-mêmes.
Autrefois arme privilégiée des combattants de la liberté, des mouvements d’indépendance et de leurs branches insurrectionnelles, l’assassinat est devenu aujourd’hui un instrument assumé de l’État et une composante à part entière de l’arsenal de ses forces armées.
Death to Order regorge d’épisodes saisissants et d’anecdotes frappantes – notamment celle d’une jeune Elizabeth II s’étonnant que personne n’ait glissé quelque chose dans le café du turbulent dirigeant nationaliste égyptien, le général Gamal Abdel Nasser.
Mais l’apport le plus marquant de l’ouvrage de Ball tient sans doute à la manière dont il retrace avec précision la sortie progressive de l’assassinat des coulisses du secret gouvernemental et militaire pour son exposition en pleine lumière, au cœur de la communication et de la propagande.
Depuis les attentats du 11 septembre 2001 – et plus encore au cours de la dernière décennie – la mise en scène de l’assassinat comme symbole concentré de la puissance étatique et de sa volonté implacable est devenue un puissant instrument de dissuasion contre toute opposition active, ainsi qu’un levier majeur de guerre informationnelle.
Doté d’un pouvoir de surveillance quasi divin, de son œil omniscient dans le ciel, le drone sait ce que vous avez fait et où vous vous trouvez. Nul n’échappe à sa vengeance. Les ides de mars sont là.
Kevin Foster ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
24.02.2026 à 17:00
L’Australie : puissance régionale, dépendance globale ?
Pierre-Christophe Pantz, Enseignant vacataire et chercheur associé à l'Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC), Université de la Nouvelle-Calédonie
Gilles Pestana, Maître de conférences en géographie et aménagement, Université de la Nouvelle-Calédonie
Texte intégral (1698 mots)
Il y a cinq ans, l’Australie dénonçait l’« accord du siècle » qu’elle avait signé avec la France sur la livraison de 12 sous-marins traditionnels, optant à la place pour une alliance avec les États-Unis et le Royaume-Uni – AUKUS – devant lui permettre de recevoir des sous-marins nucléaires fournis par Washington. Ce projet prend déjà du retard. Sans sortir d’AUKUS, Canberra se rapproche d’autres pays de l’Indo-Pacifique pour renforcer sa défense dans un contexte sur lequel plane toujours le risque de la déflagration que constituerait une invasion de Taïwan par la Chine.
Les doutes formulés fin janvier par le Congressional Research Service (CRS) sur la capacité des États-Unis à livrer des sous-marins à l’Australie ravivent le sentiment de vulnérabilité stratégique de Canberra.
Alors que la rivalité s’intensifie dans l’Indo-Pacifique, l’Australie renforce ses partenariats de sécurité dans son voisinage immédiat, comme en témoignent les récents accords conclus avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée (2025) et l’Indonésie (2026) dans une tentative de limiter sa dépendance à l’égard de Washington et de renforcer sa marge d’autonomie stratégique.
AUKUS : une stratégie finalement incertaine pour l’Australie
L’alliance AUKUS, pacte de sécurité tripartite signé en 2021 entre l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, a marqué un tournant pour la défense australienne. Par ce partenariat, Canberra rompait le « contrat du siècle » précédemment signé avec la France, qui prévoyait la livraison par Paris de douze sous-marins conventionnels, pour se tourner vers une flotte à propulsion nucléaire de conception américaine. Le pilier n°1 de cette alliance, le « transfert de sous-marins nucléaires », devait moderniser la flotte australienne et garantir l’accès aux technologies avancées.
Près de cinq ans après la signature, la mise en œuvre accuse des retards importants et des coûts croissants. Aucun sous-marin australien de nouvelle génération ne sera probablement opérationnel avant le début des années 2040, ce qui place l’Australie dans une situation de dépendance et de vulnérabilité stratégique. Plusieurs experts expriment leur scepticisme quant à la capacité des États-Unis à respecter leurs engagements de livraison.
Ces incertitudes se sont aggravées depuis 2025 avec le retour à la présidence de Donald Trump et de sa doctrine America First, qui tend à concevoir les alliances sous un angle plus transactionnel, évaluées à l’aune des intérêts immédiats et révisés des États-Unis. En effet, lors de la visite du premier ministre Anthony Albanese à la Maison Blanche en octobre 2025, les discussions sur AUKUS avaient été largement éclipsées par un accord sur les terres rares australiennes, prioritaire pour Washington face aux initiatives chinoises en la matière.
Trump a néanmoins tenté de rassurer Canberra sur la livraison des sous-marins, promettant le respect des engagements du « pilier 1 », mais ces assurances apparaissent en partie intéressées, s’inscrivant avant tout dans le contexte du traité sur les terres rares. Dans ce contexte, et comme le confirme la récente National Security Strategy publiée par la Maison Blanche, le Pacifique Sud semble relégué au second plan dans les priorités américaines, ce qui nourrit les interrogations australiennes quant à la solidité de l’engagement de Washington.
Les inquiétudes australiennes se trouvent renforcées par un rapport du CRS publié en janvier 2026. Le document souligne que les sous-marins promis pourraient rester sous commandement américain tout en opérant depuis des bases australiennes, les États-Unis souhaitant conserver le contrôle de ces appareils en vue d’un hypothétique conflit avec la Chine au sujet de Taïwan. Expression du rapport, cette « division du travail militaire » confirmerait que l’Australie pourrait rester un simple relais stratégique sans pleine autonomie opérationnelle. Bien que le CRS n’engage pas la position officielle de l’administration américaine, ce rapport renforce les doutes sur la fiabilité de l’alliance.
Renforcer l’influence régionale pour sécuriser son voisinage
Face à ce contexte incertain et les avancées de la présence chinoise dans le Pacifique – notamment à travers les Nouvelles Routes de la soie – l’Australie mène une contre-offensive diplomatique et sécuritaire destinée à préserver ce qui relève, de son point de vue, de sa sphère d’influence.
Ces toutes dernières années, Canberra a ainsi consolidé un réseau d’accords sécuritaires avec plusieurs États du Pacifique, à l’image du traité Falepili signé avec Tuvalu en 2023 ou de l’accord bilatéral conclu avec Nauru en 2024. Cette stratégie de verrouillage vise, sans les nommer, à limiter les ingérences chinoises et à réaffirmer l’influence australienne dans son environnement régional. Cette évolution traduit une évolution notable de la culture stratégique australienne, longtemps marquée par une dépendance assumée au parapluie américain.
Dans cette continuité, le traité Pukpuk signé avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée (octobre 2025) et l’accord, encore plus récent, conclu avec l’Indonésie (février 2026) constituent deux accords sécuritaires majeurs, scellés à quelques mois d’intervalle, révélant une priorité stratégique désormais assumée : faire du voisinage septentrional un glacis destiné à tenir la rivalité sino-occidentale à distance du sanctuaire australien.
Ces dispositifs associent coopération militaire, intégration des forces et structuration d’un réseau régional destiné à sécuriser ses « marches » mélanésiennes et au-delà. Ils s’inscrivent dans un espace où d’autres acteurs conservent également des intérêts structurants, au premier rang desquels la France, présente en Nouvelle-Calédonie, dont la permanence stratégique contribue, elle aussi, à la configuration sécuritaire du Pacifique insulaire.
Toutefois, derrière le discours de partenariat « d’égal à égal », ils traduisent aussi un équilibre délicat entre protection et contrôle : pour les États insulaires du Pacifique, qui ne peuvent que constater la persistance d’une asymétrie de puissance, ces dispositifs constituent une garantie de sécurité face aux pressions chinoises, tout en ravivant le risque de dépendance à l’égard de l’Australie.
Le paradoxe d’une puissance moyenne : leadership régional sous dépendance américaine
À ce jour, une rupture avec l’AUKUS demeure toutefois très improbable tant les interdépendances militaires et technologiques sont profondes. Pourtant, les incertitudes entourant l’exécution du traité rappellent que les priorités de Washington peuvent évoluer au risque de cantonner Canberra à un rôle de « partenaire subordonné ».
À ce titre, si l’Australie ne cherche pas une autonomie stratégique complète vis-à-vis des États-Unis, elle s’efforce en revanche de compenser cette dépendance par sa capacité à regagner une influence régionale érodée par les initiatives de Pékin. En effet, en consolidant son ancrage (diplomatique, politique, sécuritaire, économique) dans le Pacifique, elle ambitionne moins de s’émanciper des États-Unis que de devenir un acteur régional incontournable capable de concurrencer et de contenir l’influence spectaculaire et multiforme de la Chine.
Cette posture reflète la condition classique d’une puissance moyenne : assez influente pour structurer son environnement immédiat, mais trop dépendante pour s’affranchir des rapports de force imposés par les grandes puissances, en l’occurrence chinoise et américaine. Canberra se trouve par ailleurs dans un exercice d’équilibriste : contenir la Chine tout en préservant avec elle une relation économique et commerciale essentielle et, dans le même temps, affirmer son leadership sans apparaître comme un simple relais de la nouvelle stratégie américaine de l’administration Trump.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
24.02.2026 à 17:00
L’audition des Clinton peut-elle faire basculer l’affaire Epstein ?
Frédérique Sandretto, Adjunct assistant professor, Sciences Po
Texte intégral (1973 mots)
L’ancien président des États-Unis (1993-2001) et son épouse, ancienne secrétaire d’État (2009-2013) et candidate démocrate à la présidence en 2016, vont témoigner devant la Chambre des représentants dans le cadre de la commission d’enquête sur Jeffrey Epstein. Une audience choc qui pourrait se dérouler selon plusieurs scénarios différents.
Les auditions de Bill et Hillary Clinton devant la commission d’enquête de la Chambre des représentants sur l’affaire Epstein, les 26 et 27 février prochain, s’annoncent comme un moment politique et médiatique majeur aux États-Unis. Jeffrey Epstein, financier déchu condamné pour infractions sexuelles, est au cœur d’un vaste scandale mêlant exploitation de mineures, réseaux d’influence et complaisances au sommet de l’État, qui continue de produire des répliques bien après sa mort en détention en 2019.
Bill Clinton a effectué plusieurs vols à bord du jet privé d’Epstein et la publication de photos le montrant aux côtés de Ghislaine Maxwell a nourri soupçons et théories, faisant de son nom l’un des plus scrutés dans ce dossier. Hillary est, elle, convoquée car elle doit préciser ce qu’elle sait des relations entre son mari et Epstein.
Pourquoi les Clinton ont-ils fini par accepter de témoigner ?
Pendant des mois, le couple Clinton a opposé une résistance frontale à la commission de contrôle de la Chambre, arguant que les convocations étaient juridiquement contestables et politiquement motivées.
Rappelons que la « commission sur l’affaire Epstein » n’est pas une institution permanente ; elle a été créée spécialement pour le dossier Epstein. Il s’agit d’une enquête conduite par des commissions existantes, principalement la commission de contrôle (Oversight), qui disposent du pouvoir d’assigner des témoins et d’organiser des auditions.
Les Clinton estiment que la commission de la Chambre des représentants chargée d’enquêter sur l’affaire Epstein leur est hostile parce qu’elle est contrôlée par la majorité républicaine, politiquement opposée à leur camp, notamment sous la présidence du républicain James Comer, à la tête de la House Committee on Oversight and Accountability. Ils dénoncent une focalisation jugée excessive sur les relations passées entre Bill Clinton et Jeffrey Epstein, estimant que d’autres personnalités liées à Epstein ne font pas l’objet de la même attention, ce qui selon eux révèle un ciblage politique.
Ils critiquent également des méthodes d’enquête qu’ils jugent agressives, comme les assignations à comparaître, les auditions sous serment à huis clos et la menace de poursuites pour entrave en cas de refus de coopérer, considérant que ces procédés suggèrent une présomption de culpabilité. Enfin, ils affirment que la convocation de Hillary Clinton s’inscrit dans un contexte de polarisation politique intense aux États-Unis, où certaines commissions parlementaires sont utilisées pour affaiblir des adversaires médiatiquement, alors même qu’elle n’est pas inculpée dans cette affaire et qu’elle est entendue comme témoin.
Le ton des échanges s’est durci jusqu’à la menace explicite d’un vote pour outrage au Congrès, signe que le bras de fer dépassait le simple cadre procédural. Sous cette pression, Bill et Hillary Clinton ont finalement accepté de témoigner dans des dépositions distinctes mais coordonnées, transformant un affrontement institutionnel en événement national.
Ce basculement s’explique aussi par la déclassification progressive des dossiers Epstein par le département de la Justice. Des dizaines de milliers de pages mêlant dossiers judiciaires, relevés bancaires, photographies et notes internes ont été rendues publiques, sous forme partiellement caviardée pour protéger les victimes. Cette mise à nu d’un système de prédation et de connivences a intensifié la demande de transparence. Chaque publication a relancé spéculations et appels à rendre des comptes. Dans ce contexte, le refus persistant des Clinton de se présenter à une audition devenait politiquement intenable. Lors d’un vote au Congrès lié à leur refus initial de témoigner, plusieurs élus démocrates ont voté avec les républicains pour les sanctionner pour outrage au Congrès, affirmant privilégier la responsabilité et la justice pour les victimes plutôt que la loyauté partisane.
La déclassification a fourni à la commission des éléments documentaires et créé un climat où l’absence des témoins les plus exposés devenait toxique sur le plan politique.
Une audience ouverte
Au-delà du cas Epstein, la convocation d’un ancien président et d’une ancienne secrétaire d’État soulève une question historique. Des présidents ont déjà été confrontés à des enquêtes lourdes ou à des procédures de destitution, mais voir un ex-président appelé comme témoin dans une commission parlementaire focalisée sur un scandale d’abus sexuels et de compromission d’élites constitue une situation quasi inédite par sa charge symbolique. La combinaison d’un ancien couple présidentiel, d’une affaire criminelle devenue symbole de l’impunité des puissants et d’un climat politique polarisé confère à cette audition une dimension exceptionnelle.
Initialement, les discussions sur les modalités du témoignage relevaient d’une gestion classique des risques : huis clos, temps de parole encadré, protocole strict pour limiter les fuites. Les avocats des Clinton plaidaient pour une audition technique et non spectaculaire. La stratégie a toutefois connu une rupture lorsque Hillary Clinton a demandé publiquement que l’audience soit ouverte et retransmise. Ce choix vise à renverser l’accusation d’opacité et à empêcher la diffusion d’extraits partiels susceptibles d’être instrumentalisés. L’audition devient ainsi une scène politique autant qu’un exercice de reddition de comptes.
Cette revendication de transparence répond à la crainte d’une instrumentalisation partisane. Hillary Clinton cherche à apparaître comme une témoin volontaire, exposée à la lumière pour éviter toute manipulation. En rendant la séance publique, elle oblige ses interrogateurs à assumer leurs questions devant l’opinion et tente de déplacer l’attention vers les défaillances institutionnelles qui ont permis à Epstein d’agir. Elle ambitionne ainsi de transformer une position défensive en posture offensive, en se plaçant du côté des victimes et de la vérité.
Au cœur de cette stratégie figure la promesse de révélations importantes sur la manière dont l’État et certaines élites ont géré le cas Epstein. Hillary Clinton a évoqué des documents accablants et des défaillances systémiques, laissant entendre que le scandale dépasse la question des relations personnelles pour toucher à des choix institutionnels et à des signaux d’alerte ignorés. La question demeure de savoir jusqu’où elle est prête à aller dans la mise en cause d’un système dont elle a elle-même fait partie.
L’audition autour de l’affaire Epstein pourrait se dérouler selon quatre scénarios clés, chacun susceptible de produire un impact concret sur la perception publique et l’évolution judiciaire du dossier.
Quatre scénarios
Le premier scénario reste celui du choc maîtrisé. Les Clinton pourraient reconnaître certaines relations sociales ou financières jugées aujourd’hui discutables, tout en niant toute connaissance des crimes d’Epstein. Dans ce cadre, l’audition se transformerait en un exercice de clarification : le public et les enquêteurs obtiendraient quelques confirmations sur les fréquentations et les rendez-vous, mais aucune révélation explosive ne viendrait bouleverser les positions déjà établies. L’effet immédiat serait limité : la couverture médiatique serait intense mais essentiellement centrée sur les contradictions mineures ou sur la perception de sincérité des Clinton.
Le second scénario plausible serait celui de la mise en cause institutionnelle. L’audition pourrait révéler que certains manquements au sein des agences fédérales, des forces de l’ordre ou des structures judiciaires ont permis à Epstein de continuer ses activités sans véritable sanction. Ce scénario élargirait l’enquête au-delà des Clinton, mettant sous pression d’autres responsables politiques ou financiers et déclenchant des appels à des réformes structurelles. Les documents et témoignages mis en avant pourraient révéler un système de protection indirecte ou de négligence, redessinant la compréhension publique des défaillances institutionnelles.
Un troisième scénario envisageable serait l’audition comme affrontement politique. Dans ce cas, chaque camp chercherait à instrumentaliser les déclarations pour déstabiliser l’adversaire, transformant le moment judiciaire en bataille idéologique. Les Clinton, mais aussi leurs opposants, pourraient chercher à utiliser chaque mot à des fins de communication politique, détournant l’attention du cœur du dossier. Ce scénario risquerait de brouiller le récit central de l’affaire, mais pourrait aussi révéler des stratégies de manipulation et d’influence autour du scandale.
Enfin, un scénario complémentaire mais non négligeable serait celui de révélations inédites ou confirmations de défaillances systémiques. L’audition pourrait mettre au jour des documents jusque-là confidentiels ou des témoignages de victimes, donnant une dimension criminelle renouvelée au dossier. Dans ce cas, l’affaire Epstein ne se limiterait plus à un scandale médiatique ou à une controverse politique : elle deviendrait le symbole d’un échec généralisé des institutions à protéger les victimes et à sanctionner les auteurs.
Un grand moment de vérité ?
Dans tous ces scénarios, le point commun est la mise en lumière de la fragilité d’un système où le pouvoir et le réseau social peuvent, dans certains cas, prévaloir sur la justice. L’audition des Clinton, qu’elle soit prudente ou révélatrice, pourrait donc devenir un moment de vérité national : elle a le potentiel de transformer le scandale Epstein d’affaire privée en affaire systémique, exposant non seulement les acteurs directs mais aussi les complicités et défaillances qui ont permis à ces crimes de perdurer.
Dans la presse, cette audience sera scrutée comme un révélateur du fonctionnement réel du pouvoir, un moment où les lignes partisanes pourraient s’effacer devant l’urgence de la transparence et de la vérité judiciaire.
Frédérique Sandretto ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
24.02.2026 à 16:59
Le Mexique à feu et à sang après l’élimination par l’armée d’un baron de la drogue
Raul Zepeda Gil, Research Fellow in the War Studies Department, King's College London
Texte intégral (1638 mots)
« El Mencho », chef d’un puissant cartel, a été abattu pendant une opération militaire le 22 février. Immédiatement, son organisation a semé la terreur dans de nombreux États du pays. On dénombre déjà plusieurs dizaines de morts. Ce type d’épisode intervient fréquemment, notamment sous la pression de Washington, qui exige des autorités mexicaines qu’elles s’en prennent aux trafiquants locaux, dont la production est en large partie destinée aux États-Unis. Mais l’efficacité des éliminations physiques des parrains reste à démontrer.
Le chef du cartel Jalisco New Generation (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, plus connu sous le nom d’« El Mencho », a succombé à ses blessures le 22 février, peu après avoir été capturé par les autorités mexicaines dans l’État de Jalisco (ouest du pays) pendant une opération au cours de laquelle il avait été touché par des tirs. Cette opération, qui s’est déroulée sur fond d’exigences états-uniennes quant à des « résultats tangibles » du Mexique dans la lutte contre le trafic de fentanyl, semble avoir bénéficié du soutien des services de renseignement de Washington.
Il s’agit de l’intervention la plus importante des forces de l’ordre mexicaines contre les cartels depuis la capture de l’ancien baron de la drogue Joaquín « El Chapo » Guzmán en 2016. Le CJNG est l’une des organisations criminelles les plus puissantes du Mexique et est accusé par les États-Unis, de même que le cartel de Sinaloa, de jouer un rôle clé en matière de production et de trafic de fentanyl.
Éliminer des individus n’entraîne pas la disparition ni même l’amoindrissement du marché de la drogue
L’élimination d’« El Mencho » a peut-être permis aux autorités mexicaines de remporter une victoire politique auprès de Washington. Mais le pays paie déjà un tribut élevé pour cette opération. Lorsque l’État mexicain élimine une figure importante d’un cartel, s’ensuit souvent une longue période de violence et d’instabilité. Dès l’annonce du décès du trafiquant, une vague de violences commises par ses hommes a balayé le pays.
Dans mes recherches sur les conflits criminels dans la région de Tierra Caliente, dans l’ouest du Mexique, je retrace la façon dont les premières vagues d’arrestations et d’éliminations par l’État ont remodelé les groupes criminels locaux, brisé des alliances et ouvert la voie à de nouveaux acteurs et dirigeants. C’est grâce à ce cycle de répression étatique et de réorganisation des cartels qu’El Mencho s’est fait connaître.
El Mencho a démarré dans sa carrière de criminel en tant que membre opérationnel lié au cartel Valencia, une organisation basée dans l’État de Michoacán. Le groupe a perdu du terrain à la fin des années 2000 sous la pression soutenue des autorités. Après le démantèlement des éléments clés du réseau Valencia vers 2010, El Mencho et d’autres membres restants du groupe se sont déplacés vers Jalisco, plus au nord, et ont fondé le CJNG.
Les conditions qui ont permis l’ascension du CJNG proviennent du même répertoire de mesures répressives que les autorités déploient aujourd’hui contre lui. Ce schéma est important, car il remet en cause une hypothèse courante parmi les décideurs politiques, y compris au sein d’agences états-uniennes telles que la Drug Enforcement Administration, selon laquelle éliminer un « chef » équivaut à démanteler un marché criminel.
En réalité, l’élimination des parrains mexicains n’entraîne pas la disparition du marché de la drogue, ni celle des routes de trafic. Ce qui change, c’est l’équilibre des pouvoirs entre les groupes qui se disputent le territoire, la main-d’œuvre et l’accès aux ports, aux routes et aux autorités locales.
Des études de la stratégie dite « kingpin », qui consiste pour les forces de l’ordre à cibler délibérément les chefs de cartels, ont montré que les arrestations et les éliminations entraînent souvent une augmentation à court terme des homicides et de l’instabilité au Mexique. Certaines études suggèrent que la violence augmente pendant plusieurs mois après l’élimination d’un chef, tandis que d’autres recherches montrent que l’assassinat d’un parrain peut provoquer une augmentation des violences plus forte qu’une arrestation.
Cela s’explique par le fait qu’un cartel touché est confronté à une succession soudaine et recourt à la violence pour empêcher – ou contrer – ses rivaux qui testent la nouvelle direction et tentent de renégocier les zones de contrôle. Les groupes criminels ne pouvant pas recourir au système judiciaire officiel pour résoudre leurs différends, ils ont tendance à le faire par le biais de violences ouvertes ou de négociations imposées par la force.
Cette logique se manifeste une nouvelle fois après la mort d’El Mencho. Les rapports faisant état de membres armés du cartel bloquant les routes, commettant des incendies criminels et semant le chaos dans plusieurs États correspondent à un scénario familier : une organisation touchée signale que sa capacité demeure intacte, punit l’État et avertit ses rivaux locaux qu’ils n’ont pas intérêt à chercher à profiter de la situation.
Même si l’État parvient à contenir cette vague de violence, le risque le plus grave réside dans ce qui suivra. Un vide au niveau du leadership favorise les divisions internes et l’opportunisme externe de la part de rivaux qui attendaient une occasion pour tester les limites et régler leurs comptes.
Par exemple, en 2024, l’arrestation du chef du cartel de Sinaloa, Ismael « El Mayo » Zambada, a provoqué une vague de violence dans l’État de Sinaloa, les différentes factions de l’organisation se disputant le pouvoir.
La politique de lutte contre la drogue des États-Unis
Un autre cycle qui se répète sans cesse en Amérique latine : la politique états-unienne en matière de drogues façonne les programmes de sécurité dans toute la région. Une augmentation du nombre de décès par overdose aux États-Unis, par exemple, peut y provoquer une panique politique et inciter Washington à faire pression sur les gouvernements latino-américains pour qu’ils prennent des mesures, généralement par le biais d’une répression militarisée.
Ces gouvernements réagissent par des mesures répressives, des raids et des arrestations très médiatisées. S’ensuit alors une recrudescence de la violence à mesure que les organisations criminelles se fragmentent ; puis, après un certain temps, les gouvernements tentent de désamorcer la situation. Le cycle recommence un peu plus tard, lorsque les États-Unis placent de nouveau le trafic de drogue en tête de leurs priorités.
L’interdiction des drogues perpétue ce cycle en excluant toute réponse autre que la force ou le droit pénal, sans pour autant produire de résultats significatifs. La plupart des pays ont criminalisé les drogues. Mais malgré les rapports des gouvernements faisant état d’une augmentation des saisies de drogues chaque année, les décès liés à la consommation de drogues dans le monde continuent d’augmenter.
Mêmes causes, mêmes effets
Les forces de sécurité mexicaines ne peuvent mettre fin à un marché transnational largement financé par la demande états-unienne, quel que soit le nombre d’arrestations spectaculaires qu’elles effectuent. Les opérations qui aboutissent à l’élimination ou à la détention de figures importantes des cartels ne font que rediriger et réorganiser le trafic de drogue, tout en intensifiant souvent la violence.
Si le Mexique et les États-Unis veulent réduire le nombre de décès liés aux cartels, ils doivent cesser de considérer l’élimination des barons de la drogue comme le principal indicateur de réussite. Si une opération très médiatisée satisfait temporairement Washington, ce sont les citoyens mexicains qui doivent trop souvent en subir les conséquences.
Raul Zepeda Gil ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
23.02.2026 à 17:13
L’affaire Epstein et « la révolte des élites »
Frédérique Sandretto, Adjunct assistant professor, Sciences Po
Texte intégral (2101 mots)
Ce qui transparaît à tort ou à raison derrière les révélations liées à l’affaire Epstein, c’est une forme de solidarité interne propre à l’ensemble des « élites mondialisées », et leur conviction d’exister au-dessus de la loi commune. Chaque nouvel élément de preuve renforce le sentiment, auprès de très nombreux citoyens de divers pays, que ces élites se seraient révoltées contre les règles censées s’imposer à tout un chacun, et auraient ainsi trahi le contrat démocratique – ce qui souligne une fois de plus la justesse de l’analyse formulée par Christopher Lasch dans la Révolte des élites et la trahison de la démocratie, un ouvrage paru il y a déjà près de trente ans…
L’affaire Epstein apparaît aujourd’hui comme le révélateur d’une crise profonde de légitimité des élites occidentales. Au-delà de l’horreur des crimes commis et du système de prédation sexuelle mis au jour, ce scandale a surtout exposé l’existence d’un entre-soi où richesse extrême, influence politique et prestige social semblent avoir constitué, sinon une protection absolue, du moins un amortisseur face aux mécanismes ordinaires de la justice.
L’image qui en résulte est celle d’une élite mondialisée évoluant dans des espaces séparés, disposant de ressources juridiques, relationnelles et symboliques inaccessibles au commun des citoyens.
Des personnalités de premier plan citées dans les archives Epstein
La déclassification de nouvelles pièces judiciaires le 30 janvier 2026 a ravivé cette perception. Dans ces documents, largement commentés mais juridiquement hétérogènes – témoignages, dépositions, correspondances, carnets d’adresses –, sont mentionnées de nombreuses personnalités issues du monde politique, économique et culturel. Il convient de rappeler que la simple présence d’un nom dans ces archives ne constitue pas en soi une preuve de culpabilité ni même d’implication criminelle : il s’agit souvent de personnes ayant croisé Epstein dans des contextes mondains ou professionnels. Néanmoins, l’effet symbolique est considérable, car il renforce l’idée d’une proximité structurelle entre les sphères du pouvoir et un individu devenu l’incarnation de la corruption morale.
Parmi les figures dont l’évocation est le plus commentée figurent l’ancien président des États-Unis Bill Clinton, dont les contacts avec Epstein étaient déjà connus et documentés, ainsi que l’ex-prince britannique Andrew, dont les liens avec le pédocriminel ont donné lieu à une procédure civile conclue par un accord financier en 2022, ce qui ne l’a pas empêché d’être brièvement arrêté par la justice de son pays ce 19 février.
Le nom de Donald Trump apparaît également dans certains témoignages historiques relatifs à la sociabilité mondaine new-yorkaise des années 1990 et 2000, sans que ces mentions n’aient débouché sur des poursuites. D’autres personnalités du monde des affaires et de la technologie, telles que Bill Gates, ont été citées pour des rencontres ou échanges passés, déjà reconnus publiquement par les intéressés. La médiatisation de ces noms contribue à construire une cartographie imaginaire du pouvoir global, où se croiseraient dirigeants politiques, magnats financiers et figures de la philanthropie.
L’image d’un « État profond » mondial
C’est dans ce contexte que s’est imposée, dans certains segments de l’opinion, l’idée d’un « deep state », c’est-à-dire d’un État parallèle informel composé de réseaux politiques, administratifs, financiers et sécuritaires capables d’échapper au contrôle démocratique. L’affaire Epstein apparaît dans cette vision des choses comme la preuve de l’existence d’un système de protection mutuelle au sommet, où les élites se préserveraient collectivement des conséquences judiciaires de leurs actions.
Si cette lecture relève souvent d’une extrapolation conspirationniste, elle traduit néanmoins une défiance radicale envers la transparence des institutions. L’absence perçue de responsabilités clairement établies alimente l’hypothèse d’un pouvoir occulte plutôt que celle, plus prosaïque, de dysfonctionnements institutionnels et judiciaires.
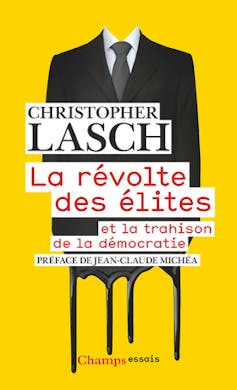
Ce phénomène illustre la thèse développée par l’historien américain Christopher Lasch en 1995 dans un ouvrage qui a eu un important retentissement, la Révolte des élites : la sécession progressive des classes dirigeantes vis-à-vis du reste de la société. Selon Lasch, les élites contemporaines ne se définissent plus par leur responsabilité envers la nation ou la communauté, mais par leur capacité à circuler dans des réseaux transnationaux fondés sur la richesse, l’éducation et l’influence.
L’affaire Epstein incarne cette mondialisation des élites, dont les liens personnels transcendent les frontières politiques et idéologiques. La fréquentation d’un même individu par des responsables issus de camps opposés alimente l’idée d’une homogénéité sociale au sommet, par-delà les clivages publics.
Un soupçon généralisé à l’égard des dominants
L’impact sur l’opinion est majeur. La publication des documents a renforcé la conviction d’un système à deux vitesses, où les puissants bénéficieraient d’une indulgence structurelle. Même en l’absence de preuves pénales contre la plupart des personnalités citées, la simple association symbolique suffit à nourrir la défiance. Dans un contexte déjà marqué par les inégalités économiques et la crise de la représentation démocratique, l’affaire agit comme un catalyseur du ressentiment populaire. Elle offre un récit simple et puissant : celui d’élites perçues comme moralement corrompues, protégées par leurs réseaux et déconnectées des normes qu’elles imposent au reste de la société.
Dans les discours politiques populistes et sur les réseaux sociaux, l’affaire est ainsi devenue la preuve narrative d’une collusion entre pouvoir économique, appareil d’État et sphères d’influence internationales. Le « deep state » y est décrit comme un mécanisme d’autoprotection des élites, capable d’étouffer des scandales, de ralentir les enquêtes ou de discréditer les accusations. Pourtant, aucune démonstration empirique solide n’est venue confirmer l’existence d’une structure coordonnée de cette nature. Ce décalage entre absence de preuve et persistance de la croyance révèle surtout l’ampleur de la défiance envers les institutions représentatives et judiciaires. Lorsque la confiance disparaît, l’explication conspirationniste devient psychologiquement plus satisfaisante que l’hypothèse de dysfonctionnements bureaucratiques, d’erreurs humaines ou de contraintes procédurales.
L’affaire Epstein illustre ainsi un phénomène plus large : la transformation du soupçon en grille de lecture dominante du pouvoir. Dans un contexte de polarisation politique et de circulation accélérée de l’information, chaque zone d’ombre tend à être interprétée comme la trace d’une intention cachée. Les élites apparaissent alors non seulement comme privilégiées, mais comme fondamentalement étrangères au corps social, évoluant dans un univers de règles implicites distinctes.
En définitive, l’invocation du « deep state » dans le contexte de l’affaire Epstein fonctionne moins comme une description empirique du réel que comme un symptôme politique et culturel. Elle exprime l’angoisse d’un monde perçu comme gouverné par des forces invisibles et irresponsables, ainsi que la conviction que les mécanismes démocratiques ne suffisent plus à garantir l’égalité devant la loi. L’affaire agit donc comme un miroir grossissant des fractures contemporaines : fracture de confiance, fracture sociale et fracture cognitive entre ceux qui adhèrent encore aux explications institutionnelles et ceux qui privilégient une lecture systémique du pouvoir.
Cette perception est amplifiée par la logique médiatique contemporaine, où la circulation fragmentée des informations favorise les interprétations maximalistes. Les documents judiciaires, complexes et souvent ambigus, sont réduits à des listes de noms, transformées en preuves supposées de l’existence d’un système occulte. Ainsi se construit une vision quasi mythologique du pouvoir, où l’idée d’une collusion généralisée remplace l’analyse des responsabilités individuelles et des défaillances institutionnelles concrètes.
Un moment de vérité
L’affaire Epstein révèle en définitive moins une conspiration structurée qu’une crise de confiance radicale envers les élites. Elle met en lumière la fragilité de leur légitimité dans des sociétés où l’exigence d’exemplarité est devenue centrale.
Lorsque ceux qui incarnent la réussite économique, politique ou culturelle apparaissent liés – même indirectement – à des scandales majeurs, c’est l’ensemble du pacte social qui vacille. La perception d’élites immorales protégées par un système opaque devient alors un prisme interprétatif global, susceptible d’alimenter le populisme, la défiance institutionnelle et les théories complotistes.
En ce sens, le scandale Epstein dépasse largement la chronique judiciaire. Il constitue un moment de vérité sur la relation entre pouvoir et responsabilité dans les démocraties contemporaines. La question centrale n’est plus seulement celle des crimes d’un individu, mais celle des conditions sociales et politiques qui ont rendu possible sa longévité au cœur des réseaux d’influence. Tant que cette interrogation demeurera sans réponse pleinement satisfaisante, l’affaire continuera d’alimenter l’idée d’une fracture irréversible entre les élites et le reste de la société.
Frédérique Sandretto ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
23.02.2026 à 17:13
Comment Andrew Mountbatten-Windsor pourrait être retiré de la ligne de succession au trône
Anne Twomey, Professor Emerita in Constitutional Law, University of Sydney
Texte intégral (2037 mots)
Le 30 octobre 2025, le roi Charles III retirait à son frère cadet Andrew le titre de prince, du fait de la révélation de l’étroite proximité entre ce dernier et le pédocriminel Jeffrey Epstein (Andrew avait notamment accepté de verser une forte somme à Virginia Giuffre, l’une des victimes du trafic sexuel mis en place par Epstein). L’ex-prince s’appelle donc désormais « simplement » Andrew Mountbatten-Windsor, mais reste à ce jour présent dans l’ordre de succession de la couronne britannique. De nouveaux documents relatifs à l’affaire Epstein récemment rendus publics poussent aujourd’hui la monarchie à l’exclure de cet ordre de succession, ce qui aurait aussi un impact direct sur les autres entités du royaume au sein du Commonwealth, à commencer par l’Australie.
La place d’Andrew Mountbatten-Windsor dans la succession au trône britannique semble être menacée.
Mountbatten-Windsor est actuellement huitième dans l’ordre de succession (après le prince William et ses trois enfants, puis le prince Harry et ses deux enfants) à la couronne du Royaume-Uni et de l’ensemble des quinze royaumes du Commonwealth. Il est donc assez improbable qu’il devienne un jour monarque, mais sa répudiation serait avant tout un acte symbolique.
Est-il possible de le retirer de l’ordre de succession ? La réponse est oui – mais cela demanderait du temps, et nécessiterait l’adoption de décisions en ce sens par de nombreux Parlements. Ce questionnement est particulièrement vivace aujourd’hui en Australie, l’un des quinze royaumes du Commonwealth.
Ordre de succession au trône actuel.
La ligne de succession s’applique-t-elle aux couronnes britannique et australienne ?
Quand l’Australie accède à l’indépendance, en 1901, la Couronne britannique est qualifiée d’ une et indivisible ». La reine Victoria exerce des pouvoirs constitutionnels sur toutes ses colonies, s’appuyant sur les conseils de ministres britanniques.
Mais après la Première Guerre mondiale, cette dynamique change, à la suite d’une série de conférences impériales. En 1930, les « dominions » autonomes (Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, État libre d’Irlande et Terre-Neuve) obtiennent leurs propres couronnes. Ainsi, le premier ministre australien a désormais le droit de conseiller le monarque sur la nomination du gouverneur général d’Australie et sur d’autres questions fédérales australiennes.
Cependant, les lois de succession à ces diverses couronnes restent les mêmes. Il s’agit d’un mélange hétéroclite de lois anglaises, comprenant des règles générales relatives à l’héritage et des documents tels que la Charte des droits de 1689 et l’Acte d’établissement de 1701.
Ces lois sont devenues partie intégrante du droit australien au XVIIIe siècle mais, longtemps, les Parlements australiens n’avaient eu aucune possibilité de les modifier. L’adoption du Statut de Westminster en 1931 vient toutefois changer les choses. Cette charte donne aux dominions le pouvoir d’abroger ou de modifier les lois britanniques applicables dans leur pays.
Cependant, étant donné que cela pourrait engendrer des complications concernant la succession à la Couronne, un passage est inclus dans le préambule du texte, établissant que « toute modification du droit relatif à la succession au trône » devait recevoir l’assentiment des Parlements de tous les dominions ainsi que du Royaume-Uni. L’article 4 du Statut maintient le pouvoir du Parlement britannique de légiférer pour un dominion, mais uniquement à la demande et avec le consentement de celui-ci.
En 1936, lorsque le roi Édouard VIII abdique, le Parlement britannique adopte une loi modifiant les règles de succession afin d’en exclure tout enfant que le roi pourrait avoir. L’Australie consent à ce que cette loi britannique s’applique également sur son territoire.
Depuis l’adoption de l’article 1 de l’Australia Act de 1986, aucune loi du Parlement britannique ne peut désormais faire partie du droit du Commonwealth, d’un État ou d’un territoire australien. Toute modification de règles sur la succession à la Couronne d’Australie doit donc être effectuée en Australie.
Comment l’Australie pourrait-elle modifier la loi sur la succession ?
Lors de l’adoption de la Constitution du Commonwealth, la Couronne était encore considérée comme « une et indivisible ». Il n’a donc pas été prévu de disposition donnant au Parlement du Commonwealth le pouvoir de légiférer sur la succession à la Couronne. Toutefois, les rédacteurs de la Constitution ont prévu un mécanisme permettant de faire face à ce type d’évolution imprévue.
L’article 51(xxxviii) de la Constitution prévoit que le Parlement du Commonwealth australien peut exercer un pouvoir qui, en 1901, relevait uniquement du Parlement britannique, à condition d’en recevoir la demande ou l’accord de tous les États concernés. Cela signifie que les Parlements du Commonwealth et des États peuvent coopérer pour modifier les règles de succession à la Couronne d’Australie.
La question s’est posée en 2011, lorsque les différents royaumes du Commonwealth (c’est-à-dire les pays qui reconnaissaient toujours la reine Elizabeth II comme chef d’État) sont convenus de modifier les règles de succession afin de supprimer la préférence masculine et l’exclusion des héritiers ayant épousé un (ou une) catholique.
Le Parlement britannique a adopté le Succession to the Crown Act en 2013 pour donner effet à cette réforme. Il en a toutefois différé l’entrée en vigueur jusqu’à ce que les autres royaumes aient adopté des dispositions similaires. La loi britannique ne modifiait la succession que pour la Couronne du Royaume-Uni.

Certains royaumes ont estimé devoir modifier leur propre droit interne. D’autres ont considéré que cela n’était pas nécessaire, leur Constitution désignant automatiquement comme souverain la personne qui est roi ou reine du Royaume-Uni. Finalement, des lois ont été adoptées en Australie, à la Barbade, au Canada, en Nouvelle-Zélande, à Saint-Christophe-et-Niévès et à Saint-Vincent-et-les-Grenadines.
En Australie, chacun des États fédérés a adopté une loi intitulée Succession to the Crown Act 2015. Le processus australien a été long, en raison de priorités législatives différentes, de calendriers parlementaires et de périodes électorales dans les États.
L’Australie a été le dernier pays à adopter sa loi. La modification de la succession est ensuite entrée en vigueur simultanément dans tous les royaumes concernés.
Comment le processus fonctionnerait-il aujourd’hui ?
Si l’on envisageait aujourd’hui de retirer Mountbatten-Windsor de l’ordre de succession, le gouvernement britannique chercherait probablement d’abord à obtenir l’accord des autres royaumes du Commonwealth. Même si ce n’est pas juridiquement obligatoire, une consultation est importante pour maintenir un monarque commun.
Le Parlement britannique préparerait ensuite un projet de loi servant de modèle aux autres juridictions, afin d’assurer l’uniformité des règles. Le texte préciserait si l’exclusion de Mountbatten-Windsor concernerait aussi bien ses héritières, les princesses Beatrice et Eugenie, ainsi que leurs enfants. Sous l’ancienne loi, une personne de la famille royale qui épousait un ou une catholique était considérée juridiquement « morte » afin que les droits héréditaires de ses descendants ne soient pas affectés. Une solution comparable pourrait être retenue dans le cas de Mountbatten-Windsor.
Les mêmes Parlements qui avaient adopté les lois lors de la précédente réforme (à l’exception de la Barbade, devenue république) devraient voter une loi équivalente s’ils souhaitent conserver des règles identiques. Toutefois, présenter un tel texte pourrait ouvrir un débat plus large sur le rôle de la monarchie dans ces différents États.
L’Australie pourrait-elle agir seule ?
L’Australie pourrait, en théorie, adopter seule une loi retirant Mountbatten-Windsor de la succession à la Couronne d’Australie. Il est cependant peu probable qu’elle le fasse.
D’abord, cela supposerait un processus législatif complexe, mobilisant sept Parlements pour adopter une mesure qui aurait probablement peu d’effet concret, compte tenu de la place éloignée de Mountbatten-Windsor dans l’ordre de succession.
Ensuite, la clause 2 des dispositions introductives de la Constitution du Commonwealth prévoit que les références à « la Reine » s’étendent à « ses héritiers et successeurs dans la souveraineté du Royaume-Uni ». Mais s’agit-il seulement d’une règle d’usage ou cette disposition produit-elle des effets juridiques substantiels ?
Pour beaucoup, maintenir les mêmes règles de succession en Australie et au Royaume-Uni évite d’ouvrir la boîte de Pandore.
Anne Twomey a reçu des financements de l'Australian Research Council et effectue occasionnellement des missions de conseil pour des gouvernements et des organismes intergouvernementaux.
23.02.2026 à 11:43
Trump désavoué par la Cour suprême sur les droits de douane : et maintenant ?
Anne E. Deysine, Professeur émérite juriste et américaniste, spécialiste des États-Unis, questions politiques, sociales et juridiques (Cour suprême), Université Paris Nanterre
Texte intégral (2454 mots)
La décision était très attendue : la Cour suprême vient de juger que la promulgation d’une grande partie des droits de douane imposés par Donald Trump à de nombreux pays du monde relevait d’un abus de pouvoir. Il s’agit certes d’un net désaveu infligé au président par une Cour dont il semblait estimer qu’elle lui était totalement acquise ; il n’en demeure pas moins que le président des États-Unis dispose d’autres leviers pour poursuivre dans cette même voie.
Donald Trump a placé au cœur de sa politique économique les droits de douane qu’il impose de façon aléatoire à titre de représailles, en invoquant le plus souvent « une situation d’urgence » pour justifier ses actes. On l’a notamment constaté, dès les premières semaines de son second mandat, pour la Chine, le Mexique et le Canada, à qui il reprochait des efforts insuffisants pour combattre la circulation du fentanyl, puis le 2 avril 2025 – le fameux « Jour de la libération ».
Ce jour-là, invoquant l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA, texte de 1977 autorisant le président à réglementer le commerce après avoir déclaré une situation d’urgence nationale en réponse à une menace inhabituelle, extraordinaire et de source étrangère pour les États-Unis), Trump a promulgué des droits de douane tous azimuts, qui allaient ensuite être suspendus et modifiés à plusieurs reprises, en fonction du comportement de ses interlocuteurs ou des cadeaux apportés (que l’on songe à la récente controverse provoquée par le don au président d’une Rolex et d’un lingot d’or de la part de patrons suisses).
Retour sur l’histoire judiciaire et la question de droit
Plusieurs États et entreprises, conscients que ces mesures allaient renchérir leurs coûts et affecter leur activité économique, ont contesté ces décisions, certains devant une juridiction fédérale classique (qui n’était pas compétente), d’autres devant le Tribunal du commerce international des États-Unis (CIT) qui, en mai 2025, a conclu à l’illégalité du décret et suspendu sa mise en œuvre.
Le 29 août 2025, saisie par l’administration, la Cour d’appel pour le circuit fédéral (CAFC), qui a compétence en matière de commerce international sur tout le territoire états-unien, a confirmé la décision de première instance : s’appuyant sur « l’histoire législative » (les motivations du Congrès pour voter la loi IEEPA) et la séparation des pouvoirs, elle conclut que la promulgation des droits de douane au nom de l’IEEPA par Trump relève d’un abus de pouvoir du président.
Tous les droits de douane sont illégaux, sauf ceux imposés en vertu de la section 232 du Trade Expansion Act (TEA). Pourtant, malgré la décision de la CAFC, les droits de douane contestés sont entrés en vigueur et ont continué de s’appliquer… jusqu’à la décision que la Cour suprême vient de rendre le 20 février 2026.
En septembre 2025, l’administration Trump a demandé à la Cour d’intervenir en procédure d’urgence pour sauver ses droits de douane. Il faut souligner que la Cour a accepté nettement plus de recours en urgence sous Trump que sous ses prédécesseurs, ce qui traduit bien la conviction de l’actuel président que la Cour suprême (dont il a nommé trois juges, durant son premier mandat) est à son service pour lui permettre de faire ce qu’il veut, sans aucun contrôle ni contre-pouvoir. Pour autant, il lui a fallu suivre le processus normal et demander un examen au fond (merits case) en faisant une demande de certiorari que la Cour a acceptée.
La loi sur les pouvoirs économiques d’urgence (IEEPA) et la décision de la Cour suprême
Il s’est trouvé une majorité de six juges sur les neuf que compte la Cour suprême pour affirmer que le recours du président à la loi IEEPA est contraire à la séparation des pouvoirs, car la loi permet au président de « réguler » et d’« interdire » mais pas d’imposer des droits de douane, qui sont de la compétence du Congrès. Mais c’est une opinion fragmentée, avec quatre opinions convergentes et deux opinions dissidentes, chacun des juges tentant de justifier et d’ancrer ses préférences en matière d’interprétation de la loi et de la Constitution.
La loi IEEPA invoquée par Donald Trump pour imposer des droits de douane tous azimuts à quasiment tous les pays du monde est prévue pour les situations d’urgence, mais l’objectif du Congrès à l’époque de son adoption, en 1977, était de limiter les pouvoirs du président par rapport à une autre loi existante (Trading with the Enemy Act, datant de 1917). C’est ce qu’il est possible de comprendre en recherchant l’« intention du législateur » – une méthode prônée par la juge progressiste Ketanji Brown Jackson dans son opinion convergente, mais les juges « conservateurs » s’y refusent.
Le texte de l’IEEPA prévoit en cas d’urgence la possibilité pour le président de « réguler » ou de déclarer un embargo, par exemple, mais ne mentionne nulle part les droits de douane. Quant à considérer que le « dramatique déficit commercial » invoqué par Trump constitue une urgence, ce serait oublier que celui-ci n’est pas nouveau et existe depuis plusieurs décennies.
Les enjeux constitutionnels
Les enjeux économiques et constitutionnels étaient importants, ainsi qu’en témoigne le nombre élevé de pétitions amicus curiae (« ami de la cour ») que les personnes physiques (un économiste, un professeur de droit) ou morales (des groupes divers) ont la possibilité de déposer afin d’éclairer la cour sur leur lecture de l’affaire, les dangers ou le bien-fondé des positions défendues par l’administration et la solution qu’ils préconisent.
Presque toutes défendaient des arguments allant à l’encontre de la position de l’administration Trump, y compris les groupes de droite comme le Cato Institute (libertarien) ou la Washington Legal Foundation (qui défend généralement les causes de la droite, mais qui argumentait ici pour l’inconstitutionnalité du recours à la législation d’urgence).
Certains invoquaient des arguments économiques et plusieurs professeurs de droit soulignaient les dangers si la Cour ne met pas un coup d’arrêt aux velléités de cumul des pouvoirs par le président. Si la Cour ne sanctionne pas cet empiètement, expliquaient-ils, le risque est réel que le Congrès ne puisse jamais voter une loi, non seulement à la majorité simple mais, en cas de veto quasi certain, à la majorité des deux tiers.
Les juges avaient semblé conscients lors de l’audience de la quasi-impossibilité pour le Congrès de recouvrer ses pouvoirs et avaient posé de nombreuses questions sur ce sujet.
Que dit exactement la décision de la Cour suprême ?
La décision Learning Resources, Inc. v. Trump, traite de deux catégories de droits de douane : ceux qui ont été imposés sur le Mexique et le Canada pour lutter contre l’importation d’opiacés ; et les droits de douane plusieurs fois modifiés, instaurés le 2 avril 2025 dit « Jour de la libération ». Elle laisse en place les autres droits de douane imposés sur d’autres fondements, tels que les droits de douane de 25 % placés par la première administration Trump en vertu de la section 301 de la loi Trade Act de 1971, maintenus par le président Biden, qui ont ajouté des droits de douane de 100 % sur les véhicules électriques chinois.
Comme prévu, l’opinion de la majorité est rédigée par le Chief Justice et, comme largement anticipé après l’audience, elle statue contre le président, mais après avoir laissé les droits de douane en vigueur pendant près d’un an.
Le président de la Cour rédige une opinion courte dont la première partie, signée par lui-même et cinq autres juges, repose sur l’atteinte à la séparation des pouvoirs : la Constitution attribue au Congrès (et au Congrès seul) le pouvoir de lever l’impôt et d’imposer droits de douane et droits indirects.
Les juges progressistes ont voté avec la majorité sur le premier fondement parce que la décision permet d’interdire au président d’utiliser la loi IEEPA (qui, nous l’avons dit, prévoit interdictions ou embargos mais pas les droits de douane) et renforce la séparation des pouvoirs et la primauté du droit (Rule of Law). Mais pas sur le deuxième fondement, qui ne recueille l’adhésion que des juges conservateurs Gorsuch et Barrett (tous deux nommés par Trump).
Cette opinion de pluralité se fonde sur la doctrine de la question majeure (Major Questions Doctrine, MQD) en vertu de laquelle les décrets qui entraînent une modification majeure d’un secteur doivent être autorisés par une délégation de pouvoir précise et spécifique par le Congrès. Ici, l’imposition de droits de douane a causé une modification majeure de l’économie du pays et ne peut être autorisée. La question est développée sur près de 50 pages par le juge Gorsuch dans son opinion convergente.
Quelle signification et quelles suites ?
C’est un net revers pour Donald Trump, qui a placé les droits de douane au cœur de sa politique économique, mais la Cour ne se prononce pas sur les pouvoirs du président (et leurs limites) ni sur les multiples recours aux législations d’urgence, pas nécessairement motivés. C’est une décision limitée à la signification de la loi IEEPA et à ce qu’elle autorise (déclarer un embargo) et interdit (imposer des droits de douane).
Ce n’est pas l’annonce que la Cour suprême va dorénavant s’opposer à Trump, sauf sans doute sur le limogeage de la gouverneure de la Réserve fédérale (FED), ce qui accréditera la thèse que la majorité de droite à la Cour est du côté du business et protège l’économie du pays contre les politiques dangereuses du président.
Par ailleurs, la décision ne dit rien sur un éventuel remboursement qui serait versé aux entreprises lésées et ne prévoit aucun mécanisme en ce sens. Beaucoup soulignent que les entreprises n’ont aucun droit à un remboursement dans la mesure où elles ont répercuté l’augmentation des coûts sur les consommateurs finaux. Le gouverneur de Californie propose que chaque Américain reçoive un chèque de 1 700 dollars (1 420 euros environ) ; le gouverneur de l’Illinois a envoyé sa facture (8,4 milliards de dollars, soit plus de 7 milliards d’euros) à l’administration Trump. En d’autres termes, d’autres contentieux sont à prévoir. D’autant que les mesures ne sont pas parvenues à diminuer le déficit commercial en 2025 et que rembourser les quelque 140 milliards de dollars (plus de 118,6 milliards d’euros) indûment perçus creuserait un peu plus le déficit budgétaire.
Que peut faire Trump maintenant ?
Une autre question est elle aussi passée sous silence. Donald Trump dispose-t-il d’autres outils pour imposer d’autres droits de douane ? La réponse est oui, car, dans les années 1970, le Congrès a voté plusieurs lois (Trade Acts) déléguant de nombreux pouvoirs au président pour lui permettre de répliquer à des mesures discriminatoires prises par les partenaires commerciaux des États-Unis.
Trump, furieux de la décision de la Cour suprême, a immédiatement annoncé des droits de douane étendus à l’ensemble du monde de 10 %, puis de 15 % en recourant à la section 122 de la loi Trade Act de 1974. Dans ce cas, les droits ne peuvent dépasser 15 % et sont censés expirer au bout de 150 jours si le Congrès n’a pas voté pour confirmer la mesure. Connaissant le peu de cas que Trump fait des règles et du droit, il n’est pas impensable d’imaginer qu’il renouvellera les droits de douane pour d’autres périodes de 150 jours – en violation peut-être non pas de la lettre de la loi mais de son esprit. Ou bien il tentera d’utiliser d’autres outils (les sections 232 ou 301, par exemple).
En conclusion, la décision de la Cour ne clarifie guère la situation économique et, à ce jour, l’état du commerce international est toujours aussi instable et chaotique.
Anne E. Deysine ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
23.02.2026 à 11:38
En Europe, les politiques sociales limitent l’appauvrissement des travailleurs en situation de handicap
Justine Bondoux, Responsable de la production de l'enquête SHARE en France, Université Paris Dauphine – PSL
Jusot Florence, Professeure en Sciences Economiques, Université Paris Dauphine – PSL
Thomas Barnay, Full Professor in Economics, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
Texte intégral (1889 mots)

La survenue d’un handicap grave après 50 ans entraîne une dégradation significative des revenus à court terme pour tous les salariés européens. Cette perte peut être largement amortie dans les pays où les systèmes de protection sociale sont généreux et les politiques d’intégration professionnelle efficaces. Alors, quelles disparités entre les pays européens ? Les femmes et les hommes ? Les différents revenus de compensation ?
Selon Eurostat, dans l’ensemble de l’Union européenne, l’écart de taux d’emploi entre les personnes en situation de handicap et celles sans handicap atteint 24 points de pourcentage (pp) en 2024. Derrière cette moyenne se cachent de fortes disparités. L’écart n’est que de 8 pp au Luxembourg et de 14 pp en Slovénie, mais dépasse 40 pp en Roumanie et en Croatie – un point de pourcentage correspond à l’écart absolu entre deux taux exprimés en pourcentage.
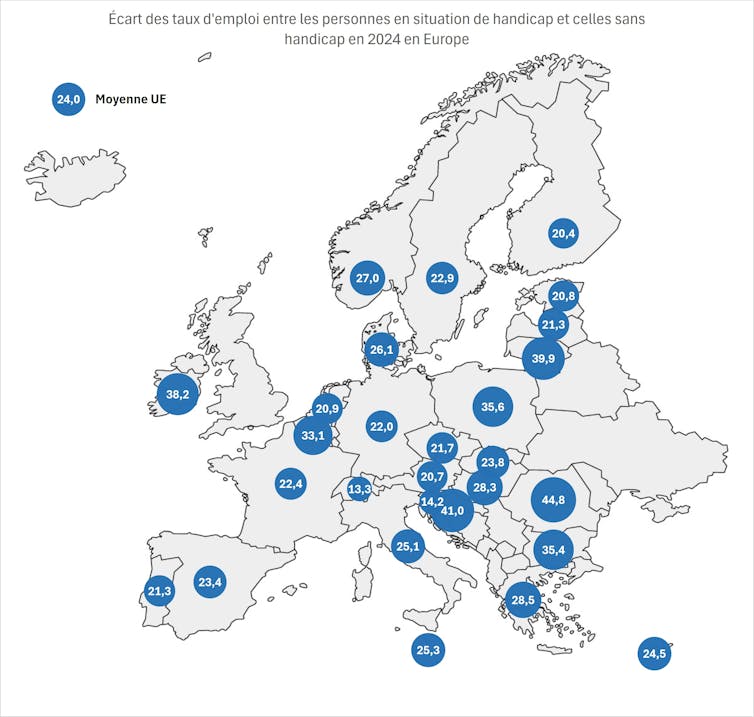
Sur le marché du travail, le désavantage des personnes en situation de handicap s’explique par plusieurs facteurs : la nécessité de soins réguliers, l’insuffisante adaptation des postes, une baisse de productivité perçue ou réelle, mais aussi des phénomènes de discrimination. Les caractéristiques du handicap telles que son intensité, son type – physique, cognitif, etc. – ou encore le moment de sa survenue – naissance, enfance, âge adulte – peuvent également jouer un rôle crucial.
Alors, que se passe-t-il lorsqu’un handicap survient en deuxième partie de carrière, chez des personnes initialement en emploi et sans limitation déclarée ? Comment cet événement affecte-t-il leurs revenus globaux deux années après ? C’est précisément la question que nous abordons dans une étude publiée dans la revue Annals of Economics and Statistics.
À partir de l’enquête Survey on Health Ageing and Retirement in Europe (SHARE), menée entre 2011 et 2015 auprès de plus de 2 500 individus âgés de 50 ans et plus, dans 12 pays européens, nous analysons l’effet de la survenue d’un handicap grave sur le revenu global. Nous distinguons ensuite les différents canaux à l’œuvre, en décomposant ce revenu entre salaires d’activité et revenus de remplacement, tels que les pensions ou les allocations.
Concrètement, quelles différences entre les pays européens ?
Chute de près de 79 % des salaires
À partir d’individus initialement en emploi et sans handicap en 2011, nous isolons l’effet du handicap sur le revenu global en combinant deux méthodes économétriques : le Propensity Score Matching et la méthode des différences de différences.
Cette approche permet de comparer, entre 2011 et 2015, les trajectoires de revenus d’individus déclarant un handicap en 2013 (qui perdure en 2015) à celle des individus ne déclarant pas de handicap en 2013 et 2015, tout en homogénéisant leurs caractéristiques initiales de 2011. La méthode permet de tenir compte non seulement des caractéristiques observables – âge, sexe, niveau d’éducation –, mais aussi de l’hétérogénéité non observée, comme la capacité des individus à faire face à leur handicap ou la discrimination des employeurs face aux individus en situation de handicap.
Nous postulons ensuite que cet événement va détériorer la situation sur le marché du travail comme la perte de productivité due au handicap, la réduction subie du temps de travail, voire du chômage. Tout en activant potentiellement des mécanismes de compensation. Pour tester ces hypothèses, nous décomposons le revenu global en salaire d’activité et en revenus de remplacement. Après l’apparition du handicap, les deux hypothèses sont bien confirmées : les salaires chutent fortement, tandis que les revenus de remplacement augmentent. Dans de nombreux cas, cette compensation reste insuffisante pour maintenir le revenu global.
L’apparition d’un handicap entraîne, en moyenne, une chute de près de 79 % des salaires. Malgré une augmentation massive – 200 % en moyenne – des revenus de remplacement tels que les pensions d’invalidité, le revenu global diminue en moyenne d’environ 20 %.
Différentes générosités des systèmes sociaux
Ces chiffres masquent de grandes inégalités entre pays. Dans les systèmes sociaux les plus généreux – Allemagne, Belgique, Danemark, France, Suède et Suisse –, la baisse des salaires est compensée par les revenus de remplacement comme les pensions d’invalidité. Résultat : le revenu global reste stable.
À l’inverse, dans les pays les moins généreux – Autriche, Espagne, Estonie, Italie, République tchèque et Slovénie –, ils ne suffisent pas à endiguer la perte de salaire, entraînant un appauvrissement marqué par une chute du revenu global de 27 %.
Cette hétérogénéité souligne l’importance de la générosité des systèmes sociaux et de leur capacité à protéger les individus face aux risques financiers liés au handicap. Les politiques publiques – allocations, pensions, mesures d’intégration et anti-discrimination – peuvent, par conséquent, couvrir l’intégralité de la perte de revenu lié au handicap.
Les pays nordiques combinent facilité d’accès aux prestations, mesures d’intégration sur le marché du travail et cumul des revenus de remplacement et d’un salaire. À l’inverse, certains pays d’Europe de l’Est faiblement généreux imposent, de surcroît, des conditions strictes pour cumuler pension et autres prestations, ce qui réduit fortement la protection des personnes en situation de handicap.
« Double peine » pour les femmes
Le handicap n’affecte pas les hommes et les femmes de la même manière. Chez les hommes, la baisse des salaires est souvent compensée par les revenus de remplacement, si bien que le revenu global n’est pas significativement affecté. Chez les femmes, les allocations compensent moins la chute des salaires, ce qui entraîne une diminution notable du revenu global de 32 %.
Cette « double peine » des femmes illustre des inégalités persistantes dans l’emploi et les revenus, confirmant des travaux antérieurs sur le sujet, comme ceux des économistes Morley Gunderson et Byron Lee, William John Hanna et Betsy Rogovsky ou Lisa Schur.
Vers une meilleure protection
Nos résultats montrent que la survenue d’un handicap grave après 50 ans entraîne une dégradation significative des revenus à court terme. Cette perte n’est pas inéluctable. Elle peut être largement amortie dans les pays où les systèmes de protection sociale sont généreux et où les politiques d’intégration professionnelle permettent de limiter les sorties du marché du travail.
Ils soulignent plusieurs leviers d’action pour les pouvoirs publics :
renforcer les dispositifs de maintien dans l’emploi ;
améliorer l’adaptation des postes de travail ;
ajuster les mécanismes de compensation financière lorsque l’activité professionnelle devient impossible.
Autrement dit, il ne s’agit pas seulement de compenser la perte de revenu, mais aussi de prévenir la rupture avec l’emploi, qui constitue un facteur majeur de fragilisation économique. Notre étude comporte néanmoins certaines limites. Elle porte exclusivement sur des Européens âgés de 50 ans et plus ; l’impact économique d’un handicap pourrait différer chez les actifs plus jeunes.
La durée de suivi, limitée à deux ans, ne permet pas de saisir pleinement les conséquences de moyen et long termes, notamment en matière de trajectoires professionnelles et de cumul des désavantages. Malgré ces réserves, les résultats apparaissent robustes : la générosité des systèmes sociaux et la capacité à intégrer durablement les personnes handicapées sur le marché du travail sont des déterminants essentiels de leur sécurité économique. À ce titre, les politiques publiques disposent de marges de manœuvre réelles pour protéger les individus face aux aléas de la santé et réduire les inégalités de revenus.
Cette étude a bénéficié d'un financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) dans le cadre du projet “Programme Handicap et Perte d’Autonomie - Session 8” de l'Institut de Recherche en Santé Publique (IReSP). Elle a également reçu le soutien du projet SHARE-France.
21.02.2026 à 16:29
La Stratégie de sécurité nationale des États-Unis : 2022 contre 2025, continuités et ruptures
Olivier Sueur, Enseigne la compétition stratégique mondiale et les enjeux transatlantiques, Sciences Po
Texte intégral (1481 mots)
Aux États-Unis, chaque président a l’obligation de publier une Stratégie de sécurité nationale (National Security Strategy, NSS). Celle que l’administration Trump a rendue publique en novembre 2025 – un texte ouvertement partisan et centré sur les intérêts de Washington conformément à la doctrine « America First » – a heurté de front de nombreux responsables européens, qui se remémorent avec une certaine nostalgie l’époque de Joe Biden. Or, la comparaison de la NSS « Made in Trump » avec celle de l’administration Biden montre qu’il existe entre les deux documents plus de continuité qu’on le croit, même si une distinction majeure apparaît sur la question de l’idéologie sous-jacente.
La Stratégie de sécurité nationale des États-Unis publiée en novembre 2025 par l’administration Trump a déjà fait couler beaucoup d’encre, allant jusqu’à parler à propos de la relation à l’Europe d’un « divorce consommé, en attendant la séparation des biens ». Or, sa version précédente, publiée en octobre 2022 par l’administration Biden, constituait déjà une rupture sur bien des points : l’article que j’y avais consacré en janvier 2023 s’intitulait « Prendre acte de la fin d’un monde ».
Naturellement, le ton joue beaucoup : le document de l’administration de Joe Biden – « le bon » – était bien plus lissé et, soyons francs, plus aimable que celui de l’administration de Donald Trump – « la brute ». Néanmoins, si l’on cherche à dépasser la forme et à analyser le fond, ruptures et continuités s’affichent sous des couleurs nettement plus nuancées.
Des visions géopolitiques en réalité très proches
Les deux présidents démocrate et républicain, avec leurs administrations, font preuve d’une très grande continuité quant à, d’une part, la fin de la mondialisation économique et du libre-échange et, d’autre part, la priorisation des intérêts états-uniens à l’échelle mondiale.
La NSS 2022 était porteuse d’une virulente charge à l’encontre du bilan de la mondialisation des échanges économiques des trente dernières années et en tirait les conséquences : selon Jake Sullivan, conseiller à la Sécurité nationale de Joe Biden tout au long du mandat de celui-ci, « l’accès au marché a été pendant trente ans l’orthodoxie de toute politique commerciale : cela ne correspond plus aux enjeux actuels ».
L’enjeu clé est à présent la sécurité des chaînes d’approvisionnement, qui implique pour un certain nombre de produits stratégiques un découplage entre la Chine et les États-Unis : la sécurité économique redevient partie intégrante de la sécurité nationale.
Sur le plan domestique, le message était le grand retour de l’État dans l’économie avec la promotion d’« une stratégie industrielle et d’innovation moderne », la valorisation des investissements publics stratégiques et l’utilisation de la commande publique sur les marchés critiques afin de préserver la primauté technologique. La NSS 2025 ne dit pas autre chose en soulignant que « la sécurité économique est fondamentale pour la sécurité nationale » et reprend chaque sous-thème. La continuité est ici parfaite.
La priorisation géographique entre les deux NSS est également remarquable de continuité : 1) affirmation de la primauté de l’Indopacifique sur l’Europe ; 2) importance accordée aux Amériques, passées de la dernière place d’intérêt en 2015, derrière l’Afrique, à la troisième en 2022 et à la première en 2025.
Le premier point implique une concentration des efforts de Washington sur la Chine, et donc que le continent européen fasse enfin l’effort de prendre en charge sa propre sécurité afin de rétablir un équilibre stratégique vis-à-vis de la Russie. Le deuxième point se manifeste dans la NSS 2022 par la remontée des Amériques à la troisième place, devant le Moyen-Orient, et dans la NSS 2025 l’affirmation d’un « corollaire Trump à la doctrine Monroe », consistant à dénier à des compétiteurs extérieurs aux Amériques la possibilité d’y positionner des forces ou des capacités ou bien d’y contrôler des actifs critiques (tels que des ports sur le canal de Panama).
Dissensions idéologiques
Les deux présidents divergent sur deux points de clivage idéologique, à savoir la conception de la démocratie et le système international, y compris les questions climatiques.
La NSS 2022 avait réaffirmé le soutien sans ambiguïté des États-Unis à la démocratie et aux droits humains de par le monde, en introduisant néanmoins une nuance dans leurs relations internationales : sur le fondement du vote par 141 États de la résolution de l’ONU condamnant l’agression russe de l’Ukraine en mars 2022, l’administration Biden se montrait ouverte au partenariat avec tout État soutenant un ordre international fondé sur des règles telles que définies dans la Charte des Nations unies, sans préjuger de son régime politique.
La NSS 2025, au contraire, ne revendique rien de semblable : elle affirme avec force qu’elle se concentre sur les seuls intérêts nationaux essentiels des États-Unis (« America First »), proclame une « prédisposition au non-interventionnisme » et revendique un « réalisme adaptatif » (« Flexible Realism ») fondé sur l’absence de changement de régime politique, preuve en étant donnée avec le Venezuela, où le système chaviste n’a pas été renversé après l’enlèvement par les États-Unis de Nicolas Maduro.
De plus, la NSS 2025 redéfinit la compréhension même de la notion de démocratie autour d’une conception civilisationnelle aux contours très américains (liberté d’expression à la « sauce US », liberté religieuse et de conscience).
Second point de divergence : la NSS 2022 avait réaffirmé l’attachement de Washington au système des Nations unies, citées à huit reprises, et faisait de l’Union européenne (UE) un partenaire de choix dans un cadre bilatéral UE-États-Unis. C’est l’exact inverse dans la NSS 2025 : non seulement les Nations unies ne sont pas mentionnées une seule fois, mais les organisations internationales sont dénoncées comme érodant la souveraineté américaine.
En revanche, la primauté des nations est mise en exergue, et présentée comme antagoniste aux organisations transnationales. De plus, la notion d’allié est redéfinie à l’aune de l’adhésion aux principes démocratiques tels qu’exposés plsu haut. Cette évolution s’exprime plus particulièrement à l’égard de l’Europe.
La NSS 2025 et l’Europe
La partie de la NSS 2025 consacrée à l’Europe a été vivement critiquée dans les médias du Vieux Continent pour sa tonalité méprisante ; or le sujet n’est pas là. En effet, l’administration Trump opère une distinction fondamentale entre, d’une part, des nations qu’il convient de discriminer selon leur alignement avec la vision américaine de la démocratie et, d’autre part, l’UE, qu’il convient de détruire car elle constitue un contre-pouvoir nuisible. En d’autres termes, elle ne s’en prend pas à l’Europe en tant qu’entité géographique, mais à l’Union européenne en tant qu’organisation supranationale, les États-Unis se réservant ensuite le droit de juger de la qualité de la relation à établir avec chaque gouvernement européen en fonction de sa trajectoire idéologique propre.
La NSS 2025 exprime donc un solide consensus bipartisan sur les enjeux stratégiques auxquels sont confrontés les États-Unis et les réponses opérationnelles à y apporter, s’inscrivant ainsi dans la continuité du texte publié par l’administration Biden en 2022. Mais elle souligne aussi une divergence fondamentale sur les valeurs à mobiliser pour y faire face. C’est précisément ce que le secrétaire d’État Marco Rubio a rappelé dans son intervention lors de la conférence de Munich du 14 février 2026.
Olivier Sueur est chercheur associé au sein de l'Institut d'études de géopolitique appliquée (IEGA).
20.02.2026 à 13:09
Escroqueries en ligne : au Cambodge, des victimes torturées dans des « usines à arnaques » se retrouvent sans protection
Ivan Franceschini, Lecturer, Chinese Studies, The University of Melbourne
Charlotte Setijadi, Lecturer in Asian Studies, The University of Melbourne
Ling Li, PhD Candidate in Technology Facilitated Modern Slavery, Ca' Foscari University of Venice
Texte intégral (1679 mots)
L’offensive contre les réseaux d’arnaques au Cambodge a libéré des milliers de travailleurs étrangers. Elle a aussi provoqué une crise humanitaire silencieuse : aujourd’hui, des victimes de traite dorment dans la rue en attendant une aide qui tarde à venir.
« Je fuyais la guerre, et je me suis retrouvé à nouveau en guerre. » C’est ainsi qu’Éric, un jeune homme originaire d’Afrique centrale, nous décrit la manière dont il s’est retrouvé dans une scam factory (un centre organisé où des personnes sont contraintes d'effectuer des arnaques en ligne à grande échelle) au Cambodge, avant d’y être bloqué, sans aucune issue possible.
L’histoire d’Éric (nous utilisons un pseudonyme et ne révélons pas son pays d’origine afin de le protéger) ressemble à celle de nombreux travailleurs piégés dans l’industrie des arnaques. Après avoir fui le conflit dans son pays et vécu dans une extrême précarité, Éric a reçu un courriel lui proposant un emploi au Cambodge rémunéré 2 000 dollars américains par mois (1700 euros). Le recruteur l’a rapidement convaincu d’accepter.
Lorsqu’il a tenté de prévenir l’une de ses cibles qu’elle était victime d’une arnaque, les responsables l’ont découvert et l’ont roué de coups avec une telle violence qu’il a cru qu’il allait mourir. Dans les semaines suivantes, il a été témoin de sévices graves infligés à d’autres et de la disparition de plusieurs collègues. L’un d’eux a sauté par une fenêtre, dans ce qui semblait être une tentative de suicide, et n’a jamais été revu.
Un mois plus tard, Éric est parvenu à s’échapper lorsque l’armée thaïlandaise a commencé à bombarder le Cambodge lors d’affrontements le long de leur frontière commune. Sa liberté a toutefois été de courte durée. Il a de nouveau été victime de traite et transféré vers un autre complexe, où il a passé un mois supplémentaire en captivité avant de réussir à fuir définitivement à la mi-janvier.
Offensive gouvernementale
Éric est désormais bloqué au Cambodge, comme des milliers d’autres étrangers libérés ces dernières semaines de scam factories, alors que circulent des rumeurs d’une vaste offensive des autorités contre ce secteur.
Cette répression a commencé le mois dernier après l’arrestation du magnat chinois Chen Zhi, que le département américain de la Justice a présenté comme « le cerveau d’un vaste empire de cyberfraude ».
L’arrestation de Chen a accentué la pression internationale croissante sur le Cambodge pour qu’il assume enfin son rôle dans l’essor de l’industrie mondiale des arnaques en ligne, qui génère chaque année des milliards de dollars de revenus illicites et a conduit à la traite de centaines de milliers de travailleurs vers des « scam factories » sordides en Asie du Sud-Est et au-delà.
Les autorités cambodgiennes ont déjà mené des descentes dans ces complexes par le passé, mais ces opérations sont restées limitées et ont souvent semblé relever davantage du geste symbolique que d’une réelle volonté d’éradication.
Coincés dans l’impasse
L’exode massif de travailleurs hors de ces complexes, dont beaucoup n’ont ni passeport, ni argent, ni destination d’accueil, conduit à ce qu’Amnesty International qualifie de « crise humanitaire en pleine expansion ».
Deux d’entre nous (Ling et Ivan) se trouvaient au Cambodge pour surveiller les scam factories lorsque l’offensive a été lancée. Nous avons vu des personnes désespérées, sans papiers, faire la queue devant leurs ambassades à Phnom Penh, tentant d’obtenir de l’aide pour rentrer chez elles.
L’ambassade d’Indonésie a indiqué que plus de 3 400 personnes ont sollicité une assistance consulaire. D’après nos échanges avec des responsables d’ambassades, l’Ouganda et le Ghana comptent chacun environ 300 ressortissants bloqués, et le Kenya en dénombre plus de 200.
Les ambassades de Chine et d’Indonésie sont parvenues à convaincre le gouvernement cambodgien de placer leurs citoyens dans des centres d’accueil en attendant leur expulsion. Le Kenya, de son côté, a obtenu une exemption des amendes encourues pour absence de documents ou dépassement de visa, et les Kényans bloqués tentent désormais de réunir les fonds nécessaires pour payer leurs billets d’avion.
Les personnes originaires d’autres pays, en revanche, se heurtent à un mur de la part de la bureaucratie cambodgienne.
La plupart des Africains que nous avons rencontrés se trouvent dans une situation dramatique. Ils viennent de pays qui ne disposent pas de représentation diplomatique au Cambodge et ont été éconduits par des agences internationales et par leurs partenaires locaux, invoquant un « manque de ressources » et des restrictions liées à la réglementation locale.
Nombre de survivants ont mis en commun leurs maigres moyens pour louer des chambres dans des pensions acceptant les personnes sans papiers, tandis que d’autres sont contraints de dormir dans la rue ou de dépendre de la générosité de bons samaritains. Beaucoup vivent dans la crainte d’une arrestation, la police procédant à des contrôles dans les habitations et les hôtels pour vérifier les documents d’identité.
Éric fait partie des relativement chanceux qui ont pu trouver un hébergement temporaire, mais son avenir reste profondément incertain. Il n’a ni passeport, ni famille, ni pays vers lequel retourner. Interrogé sur ses espoirs, il répond simplement qu’il veut un endroit où recommencer sa vie – peu importe lequel. Il est aussi désespéré à l’idée de partir à la recherche de sa famille restée au pays, ne sachant même pas si elle est encore en vie.
La fin d’une industrie ?
Les autorités cambodgiennes présentent ces opérations comme une rupture décisive avec le passé. Elles se sont engagées à éradiquer les puissants réseaux d’arnaques en ligne présents dans le pays d’ici avril.
Reste à savoir si ces raids traduisent un véritable changement de cap durable ou s’ils constituent une réponse ponctuelle à un regain de pressions diplomatiques. Bien qu’il s’agisse de l’action la plus vaste menée à ce jour par le Cambodge, ce n’est pas la première offensive du gouvernement. L’industrie, jusqu’à présent, y a toujours survécu.
Et des poches d’activité subsistent. D’après notre veille sur Telegram et nos échanges avec des acteurs du secteur, nombre d’entre eux continuent d’opérer dans des zones comme Koh Kong et Poipet.
En outre, des réseaux d’arnaques poursuivent le recrutement de travailleurs toujours piégés dans le pays. Plusieurs victimes bloquées nous ont confié avoir été approchées avec des offres d’emploi présentées comme un moyen simple de gagner assez d’argent pour financer leur billet de retour.
Par ailleurs, les réseaux continuent de recruter parmi les travailleurs coincés dans le pays. De nombreuses victimes bloquées nous ont raconté avoir été démarchées avec des offres d’emploi présentées comme une solution rapide pour réunir l’argent nécessaire à un billet d’avion et rentrer chez elles.
Des annonces d’emploi circulent également sur Telegram, visant ces mêmes personnes avec de prétendues « opportunités » précisément au moment où elles sont les plus vulnérables. Beaucoup ont subi de graves violences et ont un besoin urgent d’un soutien psychologique.
À ce stade, les appels des survivants à la communauté internationale sont restés largement sans réponse. Faute d’une intervention rapide et coordonnée pour leur venir en aide, les perspectives sont sombres – et l’avantage risque, une fois encore, de revenir aux escrocs.
En 2024, Ivan a cofondé EOS Collective, une organisation à but non lucratif consacrée à l’analyse des mécanismes de l’industrie des arnaques en ligne et des réseaux criminels qui l’alimentent, ainsi qu’au soutien des survivants contraints de participer à ces activités illégales.
Charlotte Setijadi a précédemment bénéficié de financements de recherche du ministère de l’Éducation de Singapour et du Singapore Social Science Research Council. Elle est actuellement l’une des co-responsables de l’Indonesia Forum de l’Université de Melbourne.
En 2024, Ling Li a cofondé EOS Collective, une organisation à but non lucratif dédiée à l’étude des mécanismes de l’industrie des arnaques en ligne et des réseaux criminels qui la structurent, ainsi qu’au soutien des survivants contraints de participer à ces activités illégales.
19.02.2026 à 16:59
Quand la commémoration entre en piste : la neutralité olympique à l’épreuve
Carine Duteil, Maître de Conférences en linguistique et sciences de l'information & de la communication, Université de Limoges
Arnaud Richard, Professeur des universités en sciences du langage, Université de Toulon
Texte intégral (2712 mots)
La libre expression est normalement garantie à chaque individu, mais le Comité international olympique (CIO) limite les manifestations d’idéologie politique par les sportifs durant les compétitions. Mais représenter des compatriotes tués durant une guerre en cours, comme l’a fait durant les Jeux olympiques actuels l’Ukrainien Vladyslav Heraskevych, ce qui lui a valu d’être disqualifié, relève-t-il d’une « démonstration ou propagande politique, religieuse ou raciale », comme l’a décidé le CIO ? Derrière ces questionnements casuistiques, il y a une interrogation constante, qui revient régulièrement dans le monde du sport : qu’est-ce que la neutralité dont se prévalent les institutions sportives internationales ?
Aux Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026, l’un des épisodes les plus commentés n’a pas eu lieu sur la glace, mais autour d’un casque.
Le skeletoneur ukrainien Vladyslav Heraskevych, 27 ans, a été disqualifié après avoir refusé de concourir avec un autre équipement que son « helmet of remembrance », un casque portant les visages et noms de quelques-uns des nombreux sportifs et entraîneurs ukrainiens morts depuis l’invasion russe. Le Comité international olympique (CIO) a considéré que ce casque constituait une violation de la règle 50 de la Charte olympique, qui interdit toute « démonstration ou propagande politique, religieuse ou raciale » sur les lieux de compétition.
Le 11 février, le CIO propose un compromis : l’athlète peut montrer le casque avant ou après la course et porter un brassard noir pendant l’épreuve. Heraskevych refuse, déclarant qu’« une médaille ne vaut rien comparée aux vies et à la mémoire de ces athlètes ».
Le 12 février, la Fédération internationale de bobsleigh et skeleton (IBSF) le retire de la liste de départ.
Le 13 février, sa requête devant la chambre ad hoc du Tribunal arbitral du sport (CAS) est rejetée.
Le communiqué du CAS est central : il reconnaît la légitimité de l’hommage, mais rappelle que la liberté d’expression, bien que protégée, est limitée sur le field of play. D’autres espaces – zone mixte, conférences de presse, réseaux sociaux – restent davantage ouverts à l’expression des opinions personnelles des sportifs.
Cette phrase du porte-parole du CIO, Mark Adams résume la doctrine : « It’s not the message, it’s the place that counts. » : ce n’est pas le message qui est en cause, mais l’endroit où il apparaît.
Une neutralité territoriale
La version 2026 de la règle 50 consolide la logique interprétative issue des Athlete Expression Guidelines adoptées après les controverses de 2020–2021. La règle 50.2 avait déjà été assouplie avant les JO de Tokyo 2020 (organisés en 2021 pour cause de Covid), ouvrant une porte encadrée à l’expression hors podium.
Comme nous l’indiquions alors à FrancsJeux : « Nous ne sommes plus au temps de Pierre de Coubertin, où les athlètes devaient s’exprimer par leurs gestes sportifs. »
Cette territorialisation ne surgit pas ex nihilo. Aux Jeux de Tokyo 2020, le CIO avait déjà assoupli la règle 50, autorisant certaines formes d’expression sur le terrain, tout en maintenant l’interdiction stricte sur les podiums et lors des cérémonies protocolaires. Des genoux posés à terre, des gestes symboliques ou des signes portés par des athlètes avaient alors suscité un débat mondial.
Ce moment a marqué un tournant : la neutralité olympique n’apparaît plus comme une interdiction absolue, mais comme un équilibre délicat entre liberté d’expression et protection de la scène cérémonielle. La règle 50 s’est progressivement transformée, passant d’un régime disciplinaire à une logique d’encadrement différencié selon les espaces.
L’affaire Heraskevych s’inscrit dans cette évolution. Elle ne signale pas un retour à l’interdit total, mais révèle la persistance d’une frontière : celle qui sépare l’expression tolérée de la visibilité prohibée sur l’aire de compétition.
Le cœur normatif est désormais spatial : l’expression est possible, mais pas sur l’aire de compétition. La neutralité olympique ne se définit plus comme absence de politique, mais comme gestion organisée de la visibilité, reposant sur une distinction nette entre la scène compétitive et les espaces périphériques.
Lors de ces mêmes Jeux, le skieur Gus Kenworthy a publié sur Instagram une image formant le slogan « FUCK ICE », visant la politique migratoire des États-Unis. Aucun rappel à l’ordre n’a suivi, ni par son comité olympique britannique, ni par le CIO. Le message, clairement politique, et pourtant provocateur sur sa mise en forme, circulait hors de l’aire de compétition et avant le début des épreuves.
Cette territorialisation a été justifiée par le CIO au nom d’un possible « effet domino » : « Avec 130 conflits dans le monde, nous ne pouvons pas permettre à chaque athlète d’envoyer des messages politiques pendant leurs épreuves » (Mark Adams, cité dans FrancsJeux, 12 février 2026). La neutralité devient ainsi un dispositif de gouvernement des surfaces.
Mémoire, commémoration ou propagande ?
La controverse tient à la qualification même du geste. Un slogan revendicatif entre sans ambiguïté dans la catégorie de la protestation. Mais un hommage aux morts relève-t-il d’une propagande ?
Le casque d’Heraskevych ne formulait pas de demande politique explicite. Il présentait des visages, des noms. Il matérialisait une mémoire dans un espace conçu pour n’accueillir que la performance.
Or la règle 50 ne distingue pas entre revendication et commémoration. Toute inscription visible susceptible d’être interprétée comme politique relève de l’interdit. La neutralité protège la cohérence formelle du spectacle. Mais elle se heurte ici à l’irruption d’une vulnérabilité historique.
Une controverse internationale
L’épisode a suscité une vive polémique. La présidente du CIO, Kirsty Coventry, a tenté personnellement de convaincre l’athlète de changer de casque, s’expliquant ensuite devant les médias les larmes aux yeux.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a publiquement soutenu Heraskevych, dénonçant une décision incompréhensible dans un contexte de guerre. Des voix critiques se sont fait entendre, soulignant que les Jeux excluent ou encadrent strictement la participation russe et biélorusse – décisions déjà éminemment politiques – tout en qualifiant un hommage mémoriel de geste politique interdit, mesure jugée incohérente.
Sur les réseaux sociaux, l’image du casque a massivement circulé, accompagnée de hashtags comme #RemembranceIsNotAViolation (#LaCommémorationN’EstPasUneViolation) ou #HelmetOfDignity (#CasqueDeLaDignité). Des athlètes ukrainiens ont réagi par des micro-gestes de solidarité : Olena Smaha (luge) montrant un gant portant l’inscription « remembrance is not a violation », Dmytro Shepiuk brandissant un message « UKR heroes with us ».

Ces gestes épousent précisément la frontière tracée par le CIO : expression hors du field of play, sans inscription directe sur l’équipement en course. La neutralité est contournée, sans être frontalement violée.
L’illusion d’équivalence
Au-delà du cas individuel, la controverse met en lumière une asymétrie plus profonde. Les Jeux reposent sur une fiction d’équivalence : tous les athlètes entrent dans l’arène sous les mêmes règles. Mais la guerre introduit une dissymétrie radicale : certains concourent pendant que d’autres meurent.
Exiger que cette dissymétrie reste invisible revient à préserver l’eurythmie du spectacle – cette harmonie réglée des corps, des signes et des surfaces qui garantit la lisibilité de l’événement – au prix d’un lissage de la vulnérabilité. La neutralité olympique protège la continuité narrative de l’événement. Mais lorsque la mémoire entre sur la piste, elle révèle un angle mort normatif : l’olympisme sait encadrer la propagande ; il peine à penser le deuil.
En 2024, lors des Jeux olympiques de Paris 2024, deux athlètes afghanes ont connu des sorts différents après avoir exprimé leur soutien aux droits des femmes en référence à leur pays. Le 2 août, la sprinteuse Kimia Yousofi retourne son dossard pour laisser apparaître un message manuscrit : « Education, Sports, Our rights ». Aucune sanction n’est prononcée. Le 9 août, la danseuse Manizha Talash dévoile un tissu, une cape, portant l’inscription « Free Afghan Women » lors de la compétition de breaking : elle est disqualifiée le lendemain.
Comme dans l’affaire Heraskevych, la question ne porte pas tant sur la cause défendue que sur la visibilité qu’elle prend sur la scène compétitive.
La différence ne tient pas uniquement au contenu des messages, mais à leur intensité et à leur scène d’apparition. Dans le cas des deux sportives afghanes, le premier message énonce des valeurs ; le second formule une injonction explicite. Dans les deux cas, la cause défendue est la même. Mais sur la scène compétitive, l’expression directe d’une revendication est considérée comme une rupture de la grammaire symbolique des Jeux.
La neutralité olympique ne supprime pas le politique. Elle en régule les formes, les degrés et les lieux d’apparition.
Une question qui dépasse le skeleton
L’affaire Heraskevych ne remet pas seulement en cause l’interprétation d’une règle. Elle interroge la capacité du modèle olympique à intégrer des vulnérabilités historiques dans un espace conçu comme harmonisé.
L’olympisme ne s’est pas seulement construit par des textes normatifs, mais aussi par des énoncés performatifs. Le serment olympique, dont la formulation a évolué au fil du XXe siècle, engage les athlètes dans une scène ritualisée où l’honneur, la loyauté et désormais l’inclusion sont proclamés collectivement. L’olympisme ne se contente pas d’interdire : il met en forme une parole et une visibilité communes.
La règle 50 participe de cette même logique. Elle ne vise pas uniquement à empêcher des messages politiques ; elle protège une cohérence symbolique, une continuité des signes sur l’aire de compétition. Elle contribue à préserver une scène centrée sur la performance, où les corps sont censés se rencontrer dans une forme d’équivalence symbolique.
L’apparition d’un « casque de la mémoire » ne rompt donc pas seulement une règle. Elle introduit un signe qui n’appartient pas à la grammaire cérémonielle habituelle des Jeux.
La règle 50 interdit toute « propagande » politique. Or le terme n’est pas neutre dans l’histoire olympique. Dans ses écrits fondateurs, Pierre de Coubertin revendiquait explicitement une « propagande pour l’idée de la paix » et concevait la diffusion du néo-olympisme comme une entreprise pédagogique destinée à transformer les mentalités. L’olympisme n’a jamais été indifférent : il a toujours été porteur d’un projet normatif.
La neutralité contemporaine ne correspond donc pas à une absence d’idéologie. Elle constitue une modalité particulière de cette ambition. Elle organise la visibilité afin de préserver une scène commune.
Mais cette équivalence est fragile. Lorsque des athlètes sont directement affectés par une guerre en cours, lorsque des noms et des visages de disparus entrent sur la piste, la séparation entre le sport et le monde devient plus difficile à maintenir.
L’affaire du casque de Milan-Cortina ne contredit pas l’idéal olympique ; elle en révèle la tension constitutive. L’olympisme cherche à produire une unité symbolique. Reste à savoir comment cette unité peut coexister avec la visibilité de fractures qui ne relèvent pas d’une opinion, mais d’une expérience vécue.
La question n’est plus simplement de savoir si le sport est politique.
Elle consiste à déterminer jusqu’où peut aller la neutralité lorsque la mémoire est rendue visible – et si l’eurythmie des surfaces peut intégrer la vulnérabilité des corps qui les traversent.
Carine Duteil est membre élue de l'Académie Nationale Olympique Française (ANOF) et du Comité Français Pierre de Coubertin.
Arnaud Richard est président de l'Association francophone des académies olympiques.
19.02.2026 à 16:58
La Cour suprême des États-Unis est-elle « trumpiste » ?
Michael Nafi, Enseignant-chercheur, philosophie, droit, science politique, Université Paris Cité
Texte intégral (2371 mots)
La Cour suprême, dont le jugement sur la légalité des tarifs douaniers imposés par l’actuel président des États-Unis est très attendu, est souvent vue comme étant pleinement acquise au trumpisme (parce que six des neuf juges nommés à vie qui la composent sont conservateurs et parce que trois d’entre eux ont été personnellement nommés par Trump durant son premier mandat). Pourtant, cette lecture largement politique fait abstraction des contraintes institutionnelles et procédurales qui encadrent les décisions de la Cour – des contraintes fondées sur des arguments et des doctrines juridiques bien éloignés des controverses.
Depuis le début du second mandat de Trump, l’administration américaine a déposé des requêtes d’urgence auprès de la Cour suprême bien plus fréquemment que celles qui l’ont précédée. Selon un décompte effectué en juin dernier, l’administration Trump 2 avait alors, en quelques mois, déjà déposé autant de requêtes (19) que l’administration Biden en quatre ans et largement dépassé les chiffres cumulés des administrations Obama et George W. Bush sur seize ans (8 au total).
L’urgence devant la Cour suprême : un problème structurel, pas un biais trumpiste
Contrairement aux affaires jugées au fond, les requêtes d’urgence ne nécessitent généralement ni dossiers exhaustifs ni plaidoiries. Lorsqu’elles portent sur la suspension d’une décision d’une juridiction inférieure, elles sont adressées au juge chargé du circuit fédéral concerné (région relevant d’une cour d’appel donnée), qui peut statuer seul ou saisir la formation collégiale. La Cour n’accompagne généralement pas ses décisions d’une opinion motivée ; lorsqu’elle le fait, les motivations sont brèves et les positions dissidentes rarement explicitées, même si certains juges signalent parfois leur désaccord.
Ainsi, lors de la paralysie du gouvernement fédéral entre le 1er octobre et le 12 novembre 2025, une cour du district de Rhode Island avait enjoint à l’administration de verser les subventions promises au programme d’aide alimentaire fédéral Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), destiné aux ménages à faibles revenus. C’est la juge « progressiste » Ketanji Brown Jackson, en charge du district, qui a accordé une suspension administrative temporaire à cette décision, donc favorable à l’administration Trump, en attendant l’avis de la cour d’appel. Cet exemple montre bien que les réponses de la Cour aux requêtes d’urgence traduisent moins une orientation idéologique qu’une logique conservatoire conforme aux règles de procédure.
Cependant, ces requêtes suscitent des inquiétudes légitimes. En 2015, l’éminent constitutionnaliste William Baude a forgé l’expression « rôle de l’ombre » (shadow docket) pour désigner collectivement ces dossiers, même s’ils ne sont pas consignés dans un rôle ou registre distinct. Il mettait ainsi en lumière une part occultée mais structurante de l’activité de la Cour, indispensable pour comprendre sa pratique réelle au-delà des seuls arrêts au fond. Depuis 2020, Stephen Vladeck a prolongé cette critique. Selon lui, à travers ces requêtes, la Cour n’agirait plus comme une juridiction de dernier ressort statuant après maturation des litiges, mais souvent comme un arbitre d’urgence. Plus récemment, Erwin Chemerinsky a souligné qu’un contrôle insuffisamment exigeant des critères du sursis fait courir le risque de transformer des décisions provisoires en précédents.
Mais ce phénomène n’est pas nouveau. En 2006, dans l’affaire Purcell vs Gonzalez, par un arrêt de suspension à l’unanimité – incluant la juge progressiste Ruth Bader Ginsburg – dans le cadre d’une procédure d’urgence, la Cour a posé un principe contre la modification des règles électorales à l’approche d’un scrutin. Ce principe, dit « de Purcell », fait jurisprudence auprès des cours inférieures. À titre d’exemple, il a été récemment appliqué au Texas au bénéfice des républicains, mais également, en août 2020, pour refuser la suspension de l’assouplissement des conditions du vote par correspondance dans le Rhode Island, au détriment du Parti républicain.
De nombreuses requêtes en urgence sont aujourd’hui traitées par le biais de la règle 22 des règles et procédures de la Cour suprême. Cette règle, remontant aux réformes de 1925, comporte deux zones de fragilité : d’une part, une appréciation élastique des « chances de succès au fond », souvent réduites à la simple existence d’une question juridique « non dénuée de sérieux » ; d’autre part, une tendance à confondre l’intérêt public avec l’intérêt de l’exécutif lorsque celui-ci est partie au litige, ce qui incline structurellement la balance en sa faveur.
À lire aussi : Vers la fin du droit à l’avortement aux États-Unis ?
Dernièrement, la Cour suprême a peut-être réagi aux critiques visant le contentieux d’urgence en ajustant ses pratiques. Dans Trump vs Wilcox (2025), elle a autorisé provisoirement la mise à l’écart de responsables d’agences indépendantes (Conseil national des relations du travail, NLRB ; Conseil de protection du système de mérite, MSPB), tout en prenant soin de préciser, dans l’opinion accompagnant cette décision, que la Réserve fédérale constitue un cas institutionnel distinct.
Une telle pratique est inhabituelle en procédure d’urgence. Elle a été lue comme un indice destiné à borner l’extension de la logique présidentielle de révocation, au-delà des seules agences en cause dans le litige. La Cour a également franchi un pas supplémentaire en organisant des audiences publiques dans des affaires relevant de la procédure d’urgence (notamment affaire Trump vs Cook, gouverneure de la Réserve fédérale), ou en faisant basculer une demande de sursis vers un examen au fond accéléré (affaire Trump vs Slaughter, commissaire au sein de la Commission fédérale du commerce, FTC).
Une Cour conservatrice : une convergence morale avec le trumpisme ?
La Cour suprême est aujourd’hui dominée, à six contre trois, par des juges qualifiés de conservateurs. Pour autant, est-elle acquise au président actuel du pays et le soutient-elles dans toutes ses initiatives ?
Rien ne permet de l’affirmer. Certes, les effets sociaux de Dobbs vs Jackson (2022), qui a renversé Roe vs Wade en jugeant que la Constitution fédérale ne protégeait pas un droit à l’avortement, sont considérables. Cependant, comme l’a rappelé le sociologue Éric Fassin, l’histoire de l’avortement aux États-Unis est complexe et ne saurait se réduire à un récit de progrès brutalement interrompu.
Même Ruth Bader Ginsburg, pourtant défenseure du droit à l’avortement, jugeait Roe juridiquement fragile, car la décision rattachait la protection de l’avortement à un droit implicite à la vie privée, faiblement ancré dans le texte constitutionnel. Elle regrettait que la Cour n’ait pas plutôt été conduite à se prononcer dans l’affaire Struck vs Secretary of Defense – Susan Struck était une militaire contrainte en 1970 de choisir entre sa grossesse et sa carrière – qui aurait permis de poser la question en termes d’égalité constitutionnelle et de contraintes disproportionnées pesant sur les femmes.
Inversement, la Cour n’a pas remis en cause le mariage homosexuel, protégé constitutionnellement depuis le cas Obergefell vs Hodges, 2015, malgré les attentes de certains milieux conservateurs du mouvement MAGA (Miller vs Davis du district de l’est du Kentucky, rejeté en appel). Il est plausible que le principe de reliance interest – la protection d’attentes durablement et contractuellement établies – ait joué ici un rôle déterminant.
Ces exemples rappellent que la Cour ne tranche pas des débats de société, mais des questions de compétence et de normes constitutionnelles encadrant l’action publique.
À titre d’illustration récente, la Cour a entendu, en janvier 2026, deux affaires distinctes relatives à la participation d’athlètes transgenres dans les équipes féminines (fondées sur le Titre IX, la loi fédérale relative à la non-discrimination dans l’éducation, et sur la clause constitutionnelle d’égalité de protection du 14ᵉ amendement) – des litiges dont l’issue devra être lue, là encore, non comme un arbitrage moral, mais comme une interprétation de normes constitutionnelles et législatives.
Pouvoir présidentiel : le test décisif des affaires en cours
La décision de juillet 2024 sur l’immunité dont peut jouir un président des États-Unis (Trump vs United States) a souvent été lue comme ayant consacré un privilège personnel. En réalité, elle formalise surtout une architecture déjà admise : distinction entre actes officiels (protégés par une immunité fonctionnelle) et actes privés (justiciables) ; poursuites possibles après le mandat ; centralité de l’impeachment. Comparée à d’autres systèmes constitutionnels, cette protection n’a rien d’exorbitant.
D’autres dossiers encore pendants, examinés seulement en audiences au fond, offrent toutefois un terrain d’observation plus révélateur.
Le plus emblématique concerne les droits de douane fondés sur l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationale) (audience du 5 novembre 2025). L’enjeu n’est pas l’opportunité économique de ces droits de douane, mais la nature exacte de la délégation consentie par le Congrès : peut-on lire cette loi comme autorisant, sans mandat explicite, des mesures assimilables à des prélèvements fiscaux, domaine traditionnellement réservé au législateur ?
Une telle lecture entrerait en tension avec la lettre et l’histoire du texte, mais aussi avec des doctrines et méthodes revendiquées par la majorité conservatrice elle-même – major questions doctrine, textualisme, originalisme – qui constituent autant de contraintes que de leviers. La Cour devra ainsi arbitrer un équilibre classique entre pouvoirs exécutif et législatif, tel qu’il découle de la répartition constitutionnelle des compétences (article I et article II). Un rejet de cette interprétation n’épuiserait d’ailleurs pas les moyens juridiques du président en matière tarifaire.
Les échanges ont enfin porté sur le sort des droits déjà perçus : des solutions pragmatiques sont envisageables, mais sans pouvoir s’appuyer sur un reliance interest, inapplicable à l’État. Une option intermédiaire consisterait à limiter d’éventuels remboursements aux seules parties au litige.
Le second dossier porte sur la question de savoir si le président peut révoquer librement les dirigeants d’agences indépendantes (audience du 8 décembre 2025) ou si le Congrès peut subordonner de telles révocations à un motif valable. Lors des débats, les juges ont exprimé une inquiétude structurelle : la multiplication d’agences indépendantes dotées de pouvoirs normatifs, exécutifs et quasi juridictionnels pourrait permettre au Congrès de contourner l’exécutif, au risque d’une fragmentation administrative de l’exécutif fédéral.
Si, dans ces deux affaires, la Cour devait retenir l’argumentation du gouvernement, la question d’un renforcement excessif de l’exécutif se poserait. À défaut, l’image demeurerait celle d’une Cour conservatrice, mais encore arrimée à ses contraintes doctrinales et institutionnelles.
Michael Nafi ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
18.02.2026 à 22:34
Les revendications éphémères de la France en mer de Chine méridionale (1930-1956)
Paco Milhiet, Visiting fellow au sein de la Rajaratnam School of International Studies ( NTU-Singapour), chercheur associé à l'Institut catholique de Paris, Institut catholique de Paris (ICP)
Texte intégral (2501 mots)

Puissance coloniale en Indochine (1862–1954), la France a pendant un temps revendiqué la souveraineté sur les îles Paracels et Spratleys. Les bouleversements géopolitiques de la Seconde Guerre mondiale puis le processus de décolonisation ont progressivement sapé ses ambitions, conduisant à son éviction régionale. Retour sur cet épisode éphémère, qui préfigure les tensions actuelles en mer de Chine méridionale.
Épicentre des tensions géopolitiques en Asie du Sud-Est, la mer de Chine méridionale est un espace maritime stratégique et contesté. Voie de communication essentielle pour le commerce mondial, notamment pour le transit des hydrocarbures, ce bassin maritime recèle d'importantes ressources halieutiques, ainsi que des gisements de matières premières.
Elle est également constellée de structures marines (îles, îlots, rochers, hauts-fonds, récifs, cayes), principalement regroupées en trois archipels : les Paracels à l'ouest, les Spratleys au sud et les Pratas au nord. Ces poussières insulaires ne représentent qu'une quinzaine de kilomètres carrés de terres émergées. Dépourvues d'intérêts économiques propres, peu propices à l'implantation durable de communautés humaines, elles ont longtemps suscité le désintérêt, voire la méfiance, des États riverains, en raison des risques qu'elles représentaient pour la navigation.
Pourtant, depuis la signature de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer en 1982, les convoitises étatiques s'aiguisent autour de la supposée juridiction que ces structures confèrent aux espaces maritimes environnants. En résulte une course à l'occupation, des revendications souveraines qui se superposent, et des accrochages réguliers entre marines de guerre, garde-côtes et pécheurs. La République populaire de Chine, particulièrement, y développe un irrédentisme assertif et décomplexé, via la poldérisation de nombreuses entités insulaires, transformées en bases militaires.
Puissance influente et souveraine dans la zone au temps de l'Indochine française (1862-1954), la France s'est elle aussi intéressée à ces îles et y a même revendiqué la souveraineté. Prises dans les tumultes géopolitiques du XXe siècle, les ambitions de Paris n'auront pas résisté à son éviction de la région.
Lieu microcosmique de la grande histoire asiatique, ces quelques îlots dispersés en mer de Chine racontent à leur échelle les ambitions impériales, les illusions de puissance et le désengagement inéluctable de la France en Extrême-Orient.
Indochine française et mer de Chine méridionale
L'influence française dans la péninsule indochinoise se développe au début du XIXe siècle, animée par une triple ambition : religieuse d'abord, par l'entremise de missionnaires catholiques ; commerciale ensuite, pour conquérir de nouveaux marchés tout en diversifiant les sources d'approvisionnement ; stratégique enfin, dans un contexte de concurrence coloniale qui voit le Royaume-Uni affermir ses ambitions dans la région.
À la recherche d'un débouché sur le sud de la Chine, la politique active française sur le Mékong, puis le Fleuve rouge, entraîne une colonisation progressive de l'ensemble de la péninsule indochinoise : la Cochinchine devient une colonie en 1862, le royaume du Cambodge, un protectorat en 1863, suivi de l'Annam et du Tonkin en 1884, de l'enclave chinoise de Kouang-Tchéou-Wan en 1898 et enfin du Laos en 1899.
Largement méconnus des cartographes, et craints des navigateurs, les territoires insulaires de mer de Chine méridionale n'intéressent pas les administrateurs français, accaparés par des sujets prioritaires : bail de Fort-Bayard, construction de la ligne de chemin de fer reliant le Yunnan et le Tonkin, influence japonaise sur l'île chinoise de Hainan.
C'est d'ailleurs l'activisme nippon dans la zone qui va inciter les autorités françaises à reconsidérer l'intérêt de ces îles. Implanté à Taïwan depuis la guerre sino-japonaise de 1894-1895, le Japon soutient officieusement des sociétés qui investissent les îles de mer de Chine pour y exploiter le guano.
Alors que les équilibres géopolitiques pré-Seconde guerre mondiale se mettent en place en Asie, la France revendique ouvertement sa souveraineté sur les îles Paracels et Spratleys à partir de 1930.
Les Paracels, une revendication française au titre des droits «historiques» de l'empire d'Annam
Situées à environ 300 km au sud-est de l'île de Hainan, les îles Paracels regroupent 130 structures marines. Connues des pécheurs annamites et hainanais, ces îles ne sont néanmoins pas occupées de manière permanente, car inhospitalières et dangereuses pour la navigation. Elles suscitent d'abord l'indifférence des autorités coloniales. Alors qu'aucun État ne revendique officiellement l'archipel, la dynastie Qing, au crépuscule de son règne, y réalise une prise de possession officielle en 1909, mais n'occupe pas l'île de manière permanente.
Entre le déclin chinois et l'assertivité croissante du Japon, les autorités françaises vont progressivement formuler une revendication sur l'archipel. Paris se réfère alors aux droits historiques de l'empire d'Annam pour justifier ses ambitions. En effet, des documents vietnamiens, antérieurs à la période coloniale, font mention de visites régulières de ces archipels par des pêcheurs annamites. Une administration effective se serait même matérialisée sous l'empereur Gia Long à partir de 1816.
La Chine refusant une reconnaissance des droits annamites et opposant son propre récit historique, la diplomatie française soumet en 1937 une proposition d’arbitrage international au gouvernement national de Chang Kai Chek, lequel rejette l'initiative. La même année, alors que le Japon entreprend l'invasion de la Chine continentale, la France dépêche aux Paracels un navire chargé d'établir une prise de possession officielle.
À quelques centaines de kilomètres plus au sud, dans l'archipel des Spratleys, des dynamiques similaires sont à l'œuvre, à quelques détails près…
Les Spratleys : une prise de possession au nom de la France seule
Les îles Spratleys regroupent une vingtaine de structures émergées et une centaine de récifs. Excentrées par rapport à la route Singapour-Hongkong, les autorités françaises s'y intéressent encore moins que les Paracels. Les Britanniques y avaient bien exploité le phosphate à la fin du XIXe siècle depuis leur colonie de Labuan, sans pour autant y avoir effectué une prise de possession officielle.
Ici encore, c'est la présence croissante des Japonais qui va inciter les autorités françaises à reconsidérer la zone. À l'instar des autres archipels de la mer de Chine, des entrepreneurs japonais exploitent le guano, notamment à Itu Aba, depuis le début du XXe siècle.
En 1930, la canonnière La Malicieuse prend officiellement possession de l'île Spratley. En 1933, les navires Alerte et Astrolabe réitèrent l'opération sur cinq autres îles. Détail important, contrairement aux Paracels, la revendication est faite au titre de la France seule, et les Spratleys sont rattachées administrativement à Baria en Cochinchine, colonie dont le statut juridique diffère de celui de l'Annam (protectorat).
La publication au Journal officiel provoque une protestation de Tokyo et l'archipel devient un sujet de contentieux franco-japonais. La France propose de soumettre le litige à une juridiction internationale, mais les Japonais ont d'autres projets.
Occupation japonaise et éviction française
En 1939, les forces japonaises envahissent Hainan, les Paracels et les Spratleys. Alors que la France capitule, la situation est confuse en Indochine, où les Japonais arrivent à partir de 1940. L'amiral Decoux, gouverneur général resté fidèle à Vichy, collabore avec les forces japonaises tout en maintenant un semblant d'autonomie. Déclinaison surprenante de cette situation ambiguë aux Paracels, travailleurs japonais et militaires franco-annamites cohabiteront tant bien que mal sur l'île Boisée pendant la durée de la guerre.
À la fin des hostilités, si le Japon est hors-jeu, le contentieux sino-français sur les Paracels reprend brièvement. En 1947, à quelques jours d'intervalle, Chinois et Français occupent les îles Boisée et Pattle. Finalement, en vertu de l'accord franco-vietnamien du 8 mars 1949, Paris remet officiellement le contrôle de l'île Pattle à Saigon.
Aux Spratleys, la situation diverge. Si les accords de Genève de 1954 consacrent la pleine indépendance du Vietnam, certains considèrent à Paris que ces îles n'ont jamais fait partie de l'empire d'Annam et pourraient donc juridiquement être distinguées du Vietnam. La France garderait ainsi un semblant d'influence régionale en maintenant des troupes et une base.
Cette position ne tiendra pas. Le président Ngo Dinh Diem exige le retrait des 30 000 soldats français. Les dernières escales françaises aux Paracels et aux Spratleys ont lieu en 1956. Il faudra attendre plus d'un demi-siècle pour que la France reformule des ambitions régionales.
Géopolitique-fiction : et si la France était restée souveraine en mer de Chine ?
Depuis 2018, Emmanuel Macron a développé une stratégie indo-pacifique devenue progressivement un objectif prioritaire de la politique étrangère française. L'exercice de la souveraineté dans les collectivités d'outre-mer en constitue le pilier principal. La ZEE qu'elle confère représente un attribut de puissance incontournable : plus de 90 % de l'espace maritime français, le deuxième plus important au monde, se trouve en Indo-Pacifique.
En repensant à la mer de Chine méridionale, il est alors tentant d'imaginer que la France ait maintenu sa souveraineté sur les Paracels et/ou les Spratleys. Si les propositions d'arbitrage soumises à la Chine et au Japon avaient été acceptées et la souveraineté française confirmée par une juridiction, comme ce fut le cas avec l'atoll de Clipperton en 1931, la France disposerait aujourd'hui d'une « tête de pont » souveraine au cœur de la zone la plus contestée du globe.
Paris aurait pu alors jouer pleinement son rôle de «puissance d'équilibre», jouissant d'une «autonomie stratégique», pour défendre «la liberté de souveraineté». Autant de vocables que le président Macron aime associer à la stratégie Indo-Pacifique française.
Une lecture réaliste invite toutefois à la modestie.
Confettis d'empire ou pépites géopolitique ?
D'abord, un jugement d'un tribunal arbitral, rendu le 12 juillet 2016, précise que les îles Spratley ne peuvent pas prétendre à une ZEE, car elles ne disposent pas de capacité objective à accueillir une activité économique ou des habitations humaines. De quoi tempérer le caractère stratégique réel de ces îlots, juridiquement considérés comme des rochers. Ensuite, les puissances riveraines de la zone, Pékin et Hanoi en tête, n'auraient probablement jamais reconnu la souveraineté d'un acteur occidental — qui plus est, ancienne puissance coloniale en Asie.
Côté français, la fin des revendications souveraines a probablement épargné bien des contraintes géopolitiques. Car ce que la France a abandonné en mer de Chine, elle a continué à le revendiquer ailleurs. Ainsi, d'autres îles ou rochers inhabités sont aujourd'hui l'objet de contentieux.
Les îles Éparses par exemple, détachées administrativement de Madagascar trois mois avant l'indépendance en 1960, sont aujourd'hui activement revendiquées par Madagascar et l'île Maurice (Tromelin), Port Louis et Antananarivo étant d'ailleurs soutenus dans leur démarche par des résolutions non contraignantes de l'Assemblée générale de l'ONU.
À l'autre bout de l'Indo-Pacifique, le Vanuatu conteste la souveraineté française sur les îles Matthew et Hunter.
Des querelles lancinantes qui compromettent parfois l'intégration régionale de la France. À l'heure où Paris cherche à renforcer ses partenariats en Asie du Sud-Est, il est peu probable qu'une revendication souveraine dans une région déjà sous haute tension eut été bénéfique pour les ambitions françaises en Indo-Pacifique.
Horizon de puissance bordé d'écueils diplomatique, la géopolitique des îles désertes s'avère souvent à double tranchant.
Paco Milhiet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
18.02.2026 à 16:59
Reform UK, le parti d’extrême droite qui bouscule la politique britannique
Laëtitia Langlois, Maître de conférences en études politiques britanniques, Université d’Angers
Texte intégral (2598 mots)
Alors que le gouvernement travailliste de Keir Starmer est en pleine tourmente et que le Parti conservateur peine à trouver un nouveau souffle après des années de pouvoir difficiles, la formation d’extrême droite Reform UK caracole en tête des sondages et son leader, Nigel Farage, pourrait bien devenir le prochain premier ministre britannique.
Nigel Farage a de quoi avoir le sourire. Le leader de l’extrême droite britannique est aujourd’hui à la tête du parti le plus populaire du Royaume-Uni. Depuis des mois, Reform UK connaît une progression considérable. Il fait actuellement la course en tête dans les sondages, bien loin devant le Parti travailliste, au pouvoir depuis juillet 2024 et en grande difficulté depuis les révélations fracassantes des liens entre Peter Mandelson –ancien ambassadeur du Royaume-Uni à Washington – et le pédocriminel américain Jeffrey Epstein.
Le scandale ne profite guère aux Tories : le Parti conservateur, dirigé depuis novembre 2024 par Kemi Badenoch, est à la traîne dans les intentions de vote et connaît des défections massives vers Reform UK. En quelques mois, ce sont une vingtaine de députés et trois anciens ministres conservateurs qui ont rallié Reform UK, notamment Suella Braverman, ancienne ministre de l’intérieur (septembre 2022-novembre 2023) de Liz Truss puis de Rishi Sunak, qui déclarait lors de son premier discours en tant que nouvelle membre de Reform UK : « J’ai l’impression d’être rentrée à la maison ! »
Chose impensable il y a encore quelques années, l’hypothèse d’une arrivée de Farage au 10 Downing Street n’est plus du tout perçue comme une idée farfelue : aux prochaines législatives, Reform UK, qui ne dispose aujourd'hui que de 8 sièges à la Chambre des communes, pourrait en gagner plus de 300 de plus, et donc devenir le premier parti du pays, son chef étant alors naturellement voué à être nommé premier ministre.
Une extrême droite britannique longtemps marginalisée
L’essor de ce jeune parti créé en 2019 est un phénomène sans précédent au Royaume-Uni. Longtemps, le pays s’est cru imperméable aux extrêmes et a pu s’enorgueillir d’être l’un des rares États européens où l’extrême droite était quasiment inexistante.
Le British National Party (BNP), créé en 1982 et équivalent du Front national français, n’a jamais réussi à percer alors que non loin de là, au même moment, la France voyait s’enraciner le parti de Jean-Marie Le Pen jusqu’à le porter au second tour de l’élection présidentielle en 2002. Si le Royaume-Uni a longtemps été capable de tenir l’extrême droite aux marges de la vie politique, il le doit tout autant à son histoire singulière qu’à son système électoral. La résistance des Britanniques à l’Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale a fait de la lutte contre le fascisme un principe cardinal des valeurs du pays. Pendant des décennies, tout discours extrémiste a été banni de la sphère publique.
C’est ainsi qu’Enoch Powell, figure majeure du Parti conservateur d’après-guerre, fut mis au ban de la vie politique après avoir prononcé un discours très controversé dans lequel il prônait l’arrêt de l’immigration non blanche au Royaume-Uni ainsi que la remigration des étrangers vers leur pays d’origine. Le tollé suscité par ce discours dit des « fleuves de sang » marqua profondément la classe politique britannique, qui se refusa longtemps à organiser un débat sur les questions d’immigration et de multiculturalisme au Royaume-Uni.
L’autre raison pour laquelle les extrêmes ont longtemps été tenus à l’écart vient du système électoral en vigueur pour désigner les députés de la Chambre des communes, le « first-past-the-post » (littéralement « le premier qui passe la ligne d’arrivée »), un scrutin majoritaire à un tour où le parti qui remporte le plus de voix à la majorité relative remporte l’élection. Ce mode de scrutin explique pourquoi depuis plus d’un siècle maintenant ce sont les deux grands partis traditionnels qui gouvernent et pourquoi les petits partis peinent tant à avoir des députés au Parlement.
Avec, depuis 2024, huit députés sur les 650 que compte la Chambre des communes, Reform UK réalise une performance inédite, certes bien loin du Parti travailliste (404) ou du Parti conservateur (116), mais démontrant néanmoins sa pénétration croissante des institutions britanniques. Cette performance est largement due à Nigel Farage qui, depuis trois décennies maintenant, incarne l’extrême droite britannique.
Nigel Farage, la figure iconique de l’extrême droite britannique
Reform UK est un tout jeune parti mais son leader, Nigel Farage, 61 ans aujourd’hui, est loin d’être un novice en politique. Membre fondateur de l’United Kingdom Independence Party (UKIP) en 1993, parti eurosceptique qui s’érige contre la signature du traité de Maastricht et demande la sortie de l’Union européenne, Nigel Farage perce sur la scène nationale, en 2010, en adoptant une nouvelle stratégie pour sa formation.

La critique de l’UE est désormais associée à un discours anti-immigration virulent afin de dénoncer le laxisme des élites européennes qui encouragent une immigration massive en soutenant les principes de frontières ouvertes et de libre circulation des personnes. Dans un pays où l’immigration arrive régulièrement en tête des préoccupations des Britanniques, la formule Farage est gagnante.
Grâce à lui, le UKIP passe d’un petit parti quasiment invisible à une force politique majeure capable de devancer le Parti conservateur et le Parti travailliste aux élections européennes de 2014. Quand, deux ans plus tard, les Britanniques votent à 51,9 % en faveur du retrait de l’Union européenne, Farage est largement vu comme le grand artisan de cette victoire historique et s’impose comme la figure dominante et iconique de l’extrême droite britannique.
Après son départ inattendu du UKIP en décembre 2018, qu’il justifia par les dérives islamophobes du parti, Farage crée en 2019 le Parti du Brexit (Brexit Party), qui est rebaptisé Reform UK en 2021. Il faut à peine trois ans à ce nouveau parti pour devenir un acteur majeur de la scène politique britannique. En juillet 2024, Reform UK arrive troisième des élections générales avec 14,3 % des voix, et remporte une centaine de siège aux élections locales de 2025. Dès lors, une dynamique en faveur de Reform UK s’enclenche et fait de Nigel Farage le véritable leader de l’opposition au Royaume-Uni.
L’immigration : raison première de l’essor de Reform UK
La progression de Reform UK dans la vie politique britannique s’inscrit dans une dynamique plus générale de montée des droites populistes et nationalistes dans de nombreux pays occidentaux. En Europe, ces partis réalisent des scores historiques et l’élection de Donald Trump en 2024 a donné du carburant à la progression de ces partis.
Le Royaume-Uni, comme bon nombre de sociétés occidentales, est traversé par des sentiments – ou plutôt, devrait-on dire, des ressentiments – à l’égard de la mondialisation, du cosmopolitisme, de l’immigration et du multiculturalisme qui longtemps ont été érigés en modèles mais qui sont considérés par une partie importante de la population britannique comme responsables de son déclassement et du déclin du pays. Le déclin dans la lexicologie d’extrême droite est à entendre comme un déclin identitaire et civilisationnel où tout ce qui fait l’essence de l’identité britannique – les traditions, les valeurs, la culture – se trouve menacé par des populations immigrées venues en masse d’Afrique et du Moyen-Orient.
Dans le sillage d’Enoch Powell, Nigel Farage a capitalisé sur la question identitaire et civilisationnelle pour attirer à lui un électorat fier de son identité britannique et attaché à la célébrer. Aujourd’hui encore, il martèle que seul Reform UK est capable de protéger la culture et les traditions britanniques en mettant fin à l’immigration illégale et en procédant à l’expulsion systématique des immigrés clandestins. C’est ce discours volontariste et radical sur l’immigration qui séduit de nombreux électeurs du Parti conservateur, mais aussi du Parti travailliste lassés de constater que, malgré les promesses, les chiffres de l’immigration restent très élevés : pour l’année 2025, les statistiques indiquaient que 898 000 immigrés étaient entrés sur le sol britannique, ce qui représente une baisse de près de 20 % par rapport au chiffre record d’1,5 million d’immigrés enregistré en 2023, mais qui est toujours perçu comme bien trop élevé par une proportion importante de Britanniques, qui considèrent que leur pays ne peut plus se permettre d’accueillir d’étrangers sur son sol.
Aussi, les émeutes racistes qui ont secoué le pays à l’été 2024 après le meurtre de trois fillettes à Southport, ainsi que les manifestations chaque semaine devant des hôtels abritant des réfugiés ont mis en lumière l’hostilité violente d’une partie de la population britannique à l’égard des immigrés. Dans ce contexte hautement inflammable et polarisé, Reform UK continue de siphonner des voix au Parti conservateur et force le premier ministre travailliste Keir Starmer à durcir sa politique d’immigration et à déclarer, par exemple, que « sans des règles strictes en matière d’immigration, le pays risque de devenir une île d’étrangers ».
L’immigration est le sujet phare de Reform UK, mais d’autres thèmes viennent compléter le programme du parti, notamment en matière de politique économique, sociale ou industrielle. Reform UK se présente comme une formation résolument pro-business qui veut relancer la croissance économique par l’adoption de mesures fiscales très favorables aux entreprises. En matière d’accès aux aides sociales, Farage est clair sur ce point : seuls les Britanniques pourront y prétendre et aucun étranger ne se verra attribuer d’aides. Les réductions d’impôts ainsi que les limitations d’accès aux aides participent de sa vision d’un État minimaliste qui réduit massivement l’administration centrale et les déficits publics.
Si le discours économique et social a des accents thatchériens, il n’en va pas de même dans le secteur industriel, où Farage appelle depuis des mois à la nationalisation de British Steel – l’entreprise de sidérurgie britannique, en grande difficulté – afin de sauver des milliers d’emplois.
Ce manque de cohérence idéologique se retrouve dans la politique étrangère où tout d’abord Farage affirma une ligne pro-russe avant un revirement spectaculaire début 2025, quand il s’est dit favorable à l’entrée de l’Ukraine dans l’Otan.
Sur les questions sociétales, il est là aussi difficile de définir une ligne claire : le parti revendique fièrement son attachement à des valeurs conservatrices telles que « la famille traditionnelle », mais il se pose aussi en champion de la cause des femmes dont la liberté et l’émancipation seraient menacées par des populations étrangères qui ne partagent pas les mêmes valeurs.
Les errances idéologiques et programmatiques ne semblent en rien déstabiliser les électeurs qui lui montrent une loyauté indéfectible tant que le parti se montre ferme sur les questions qui comptent le plus à leurs yeux : la défense des valeurs, de la culture et de l’identité britanniques face à la menace d’une « invasion migratoire ».
À lire aussi : Royaume-Uni : quand l’extrême droite pousse Keir Starmer à durcir son discours sur l’immigration
Ainsi, l’essor de Reform UK entraîne une recomposition politique sans précédent et bouscule une vie politique britannique habituée à un bipartisme synonyme de stabilité et de modération. Sous la pression irrésistible de Reform UK, c’est aussi une certaine idée de la politique « à la britannique » qui se fissure et qui laisse entrevoir la possibilité que le prochain premier ministre du Royaume-Uni appartienne pour la première fois de son histoire à l’extrême droite.
Laëtitia Langlois ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
17.02.2026 à 17:12
Midterms 2026 : le logement, talon d’Achille de Trump
Élisa Chelle, Professeure des universités en science politique, Université Paris Nanterre
Texte intégral (2281 mots)
La crise du logement aux États-Unis – il en manque 4 millions actuellement – a été aggravée par la politique de Donald Trump, en 2025. L’expulsion massive de migrants prive le secteur du bâtiment d’une main-d’œuvre indispensable, et les décisions erratiques en matière de droits de douane ainsi que les tensions avec l’Union européenne font planer une incertitude au long cours sur l’économie du pays, ce qui incite les investisseurs à la prudence. Ce dossier pourrait jouer un rôle central dans les élections de mi-mandat de novembre prochain, d’autant que plusieurs États supposés acquis aux républicains sont particulièrement touchés.
Une réforme « agressive » du logement : c’est ce qu’a promis Donald Trump pour 2026. Depuis la pandémie de Covid-19, les États-Unis traversent en effet une crise du logement sans précédent. Il s’agit d’un enjeu électoral majeur à l’approche des élections de mi-mandat du mois de novembre prochain. Trump avait bâti une partie de sa campagne de 2024 sur la promesse de résoudre cette « crise de l’accessibilité » (affordability crisis). En 2025, il manquait 4 millions de logements à l’échelle du pays.
Un an après le retour à la Maison-Blanche du « président du peuple », les politiques mises en œuvre révèlent les profondes tensions entre objectifs économiques, impératifs sécuritaires et contraintes géopolitiques. Le logement n’est plus seulement une question sociale : il est devenu un terrain d’affrontement entre protectionnisme commercial, rivalités internationales et équilibres budgétaires.
Une crise locative qui frappe les grandes villes, les jeunes… et les républicains
Entre 2021 et début 2023, les loyers aux États-Unis ont explosé, avec un pic à + 16 % au cœur de la crise pandémique. Ils sont, depuis, revenus à une inflation ordinaire, autour de 4 %. Les prix n’ont pas baissé pour autant. Ils ne font qu’augmenter moins rapidement. Résultat : les loyers n’ont jamais été aussi chers.
Tous les Américains ne sont pas affectés de la même manière. Les habitants des petits logements (studios, deux-pièces) subissent une hausse supérieure à la moyenne. Les jeunes se mettent en ménage de plus en plus tard, préférant le domicile parental ou la colocation pour faire des économies.
Paradoxe : les États « rouges » sont ceux qui sont le plus… dans le rouge. Le Montana et l’Idaho, deux bastions républicains du nord-ouest, ont connu des hausses de loyers de respectivement 20,7 % et 20,3 % en 2024 et 2025, soit plus de quatre fois la moyenne nationale, qui s’élève à 4,8 %. L’ironie ? Cette explosion est notamment due aux Californiens (souvent des démocrates) qui fuient un coût de la vie devenu exorbitant pour emménager dans ces zones moins tendues.
D’autres États plutôt conservateurs, comme la Virginie, le Tennessee ou l’Utah, figurent parmi les plus concernés. Pour les résidents, cela représente jusqu’à plusieurs centaines de dollars supplémentaires sur leur quittance de loyer. Ces hausses dépassent les 30 % dans les grandes villes.
Droits de douane et chasse aux migrants : un secteur de la construction au ralenti
Plusieurs facteurs freinent la construction de nouveaux logements. L’imposition de taxes douanières de 25 % sur l’acier et l’aluminium, ainsi que sur le bois d’œuvre canadiens se répercute sur le coût des projets résidentiels. La dévaluation du dollar est, de plus, défavorable aux importations. Le prix des matériaux augmente en moyenne de 7 %, ce qui représente plusieurs milliers de dollars par maison.
Les tensions géopolitiques mondiales perturbent la logistique internationale, déjà complexe et fragilisée par la période du Covid. Les équipements de chantier mettent plus de temps à être acheminés. Les calendriers de livraison sont perturbés. Les promoteurs, et par conséquent les acheteurs, doivent payer plus pour obtenir moins.
Parallèlement, les politiques migratoires restrictives de l’administration Trump ont réduit la main-d’œuvre disponible dans le secteur du bâtiment, qui souffrait déjà d’un déficit d’ouvriers qualifiés. Selon un sondage réalisé par une organisation professionnelle du secteur, environ 1 entreprise sur 10 et 1 sous-traitant sur 5 auraient perdu du personnel à la suite des raids, ou des menaces de raids, de la police de l’immigration (Immigration and Customs Enforcement, ICE). Les retards sur les chantiers sont en partie dus à cette pénurie de main-d’œuvre. Et ce, malgré une politique de recrutement volontariste des employeurs qui ont doublé les augmentations de salaire par rapport à la moyenne nationale (+ 8 %).
À lire aussi : Tout comprendre à l’ICE, la police de l’immigration au cœur des polémiques aux États-Unis
L’administration Trump affirme que les expulsions massives de migrants ont contribué à faire baisser les prix de l’immobilier dans certaines villes. Selon la Maison-Blanche, les prix médians affichés ont baissé d’une année sur l’autre de 7,3 % à Austin (Texas), de 6,7 % à San Diego (Californie) et de 4,3 % à Miami (Floride). Le président attribue ces baisses à la réduction de la population immigrée clandestine dans les grandes villes. Pourtant, ce sont des États républicains, comme le Texas ou la Floride, qui demeurent disproportionnellement atteints par les hausses des loyers, par rapport aux terres démocrates de Californie ou du New Jersey.
Le moindre nombre de logements disponibles maintient les prix de l’immobilier (achat ou location) à un niveau élevé. Et la tendance est appelée à se poursuivre en 2026.
Les menaces sur le Groenland pourraient coûter cher aux acheteurs américains
La volatilité des droits de douane – avec les exemptions et reports à répétition – place les investisseurs dans une position attentiste. L’immobilier américain reste, certes, perçu comme un actif relativement sûr par comparaison avec d’autres régions du monde plus instables, comme l’Europe de l’Est ou le Moyen-Orient. Mais le style trumpien prive les détenteurs de capitaux de la prévisibilité essentielle à leurs calculs.
La rhétorique expansionniste au sujet du Groenland a des conséquences sur l’économie réelle américaine. Le 20 janvier 2026, lorsque Donald Trump brandit la menace de nouveaux tarifs douaniers contre l’Europe dans le cadre de ses ambitions d’acquisition du territoire autonome danois, les marchés financiers réagissent immédiatement. Le taux d’intérêt des prêts immobiliers à trente ans (le plus courant aux États-Unis) a augmenté de 14 points de base, passant par exemple de 6,50 % à 6,64 %. Cette hausse apparemment minime rend pourtant l’achat d’une maison plus coûteux : pour un prêt de 400 000 dollars (environ 337 700 euros), cela représente environ 40 dollars (33,7 euros) de plus à payer chaque mois, soit près de 14 400 dollars (plus de 12 000 euros) supplémentaires sur la durée totale du prêt.
Pourquoi cette réaction ? Les analystes de la Deutsche Bank ont rappelé un fait crucial : les pays européens (Allemagne, France, Royaume-Uni…) détiennent ensemble plus de 8 000 milliards de dollars (soit 6 750 milliards d’euros) d’actifs américains, dont une part importante en bons du Trésor. Ces bons du Trésor sont des prêts que les États étrangers accordent aux États-Unis. Si l’Europe décidait de vendre massivement ces bons en représailles aux menaces de Trump, cela ferait grimper les taux d’intérêt américains dans tous les domaines, y compris pour les prêts immobiliers.
À lire aussi : Donald Trump et le Groenland, quand géopolitique et économie s’entremêlent
En d’autres termes, une dispute géopolitique sur le Groenland peut directement affecter le portefeuille des Américains qui souhaitent devenir propriétaires, illustrant le degré d’interdépendance entre politique étrangère et marché immobilier. C’est le facteur qui peut in fine freiner Donald Trump : la protestation dans les urnes des acquéreurs mécontents.
Loger la génération Z sans ruiner les boomers : une équation sans solution ?
Acheter une maison est la composante de base du « rêve américain ». Une accélération de la construction de nouveaux logements pourrait théoriquement permettre à plus d’Américains de le réaliser. En plus des obstacles pratiques déjà évoqués, cette augmentation poserait un inconvénient majeur : diminuer mécaniquement la valeur des biens immobiliers par la hausse de l’offre. Or la résidence principale est la première source de richesses des ménages. Si son prix diminue, c’est un manque à gagner pour tous les propriétaires actuels, de la génération des « boomers » pour la plupart. Aucune majorité n’a intérêt à se les mettre à dos.
Dans le même temps, l’âge médian du premier achat immobilier a atteint un record de 40 ans en 2025, contre 33 ans en 2020 et 29 ans en 1981. La part des primo-accédants est tombée à un niveau historiquement bas de 21 %. C’est un recul du niveau de vie pour plusieurs générations d’Américains. Cette évolution reflète les obstacles croissants à l’entrée sur le marché immobilier et contribue à retarder d’autres étapes importantes de la vie des jeunes adultes.
La solution proposée par l’administration Trump est de tirer vers le bas les intérêts d’emprunt tout en maintenant, voire en augmentant, la valeur des biens immobiliers. Les acquéreurs sont soutenus par deux principales mesures. Un décret du 20 janvier 2026 interdit aux investisseurs l’acquisition de maisons individuelles destinées à la location. L’État fédéral a par ailleurs acquis des titres hypothécaires en masse, ce qui a pour effet de diminuer les taux d’intérêt par une augmentation artificielle de la demande.
Mais, les budgets publics étant contraints, le président a ordonné en janvier 2026 à Fannie Mae et Freddie Mac – les deux agences hypothécaires sauvées par l’État fédéral lors de la crise financière de 2007-2008 – d’acheter pour 200 milliards de dollars de titres adossés à des créances hypothécaires. C’est une intervention très forte dans les mécanismes de marché. L’État se substitue à la Réserve fédérale (Fed), pour des effets encore incertains.
Un référendum sur le pouvoir d’achat
Un an et demi après son retour triomphal à la Maison-Blanche, Donald Trump s’apprête à affronter un test électoral crucial : les élections de mi-mandat de novembre 2026. Le logement pourrait bien devenir le talon d’Achille des Républicains. Les bastions conservateurs du Montana, de l’Idaho, du Tennessee et du Texas – ces États « rouges » où les prix du logement ont explosé –risquent de sanctionner une administration qui a promis l’accessibilité mais n’a pu contenir l’inflation immobilière.
Le risque politique est majeur. Si Trump s’aliène les jeunes générations qui ne peuvent plus acheter une résidence principale et entrent plus tard dans l’emploi du fait des transformations de l’IA, celles-ci pourraient bouder les urnes, ou préférer le camp d’en face. Les démocrates l’ont bien compris après l’élection de Zohran Mamdani à New York, mais surtout avec les deux victoires dans le New Jersey et la Virginie.
Dans les quelques États clés où se joueront les majorités au Congrès, le logement abordable est devenu leur principal argument de campagne. Si les taux d’intérêt et les loyers continuent leur ascension, novembre 2026 pourrait marquer un tournant. La géopolitique trumpiste – avec sa politique commerciale erratique et ses menaces sur l’Europe – aura alors produit son effet le plus inattendu : transformer la crise du logement en crise politique, et faire de l’immobilier le champ de bataille décisif des Midterms.
Élisa Chelle est l’auteure de La Démocratie à l’épreuve du populisme. Les leçons du trumpisme, (Odile Jacob, 2025).
Elisa Chelle a reçu des financements de l'Institut universitaire de France.
17.02.2026 à 17:10
Des États-Unis ébranlés par leur offensive de « domination énergétique » ?
Patrice Geoffron, Professeur d'Economie, Université Paris Dauphine – PSL
Texte intégral (2324 mots)
Cela pourrait bien être la quadrature du cercle énergétique : peut-on à la fois être une puissance mondiale exportatrice et promettre à ses électeurs de baisser le prix de l’énergie ? Si on ajoute le frein mis sur les renouvelables, on se retrouve dans la situation des États-Unis de Donald Trump. Les promesses et les actions contradictoires ne touchent pas de la même façon tous les États. Si les gagnants se frottent les mains, les perdants se rebelleront-ils ? Et, dans ce cas, comment dit-on « gilet jaune » du côté du Dakota ?
Un an s’est écoulé depuis que Donald Trump a prêté serment pour son second mandat. Sa campagne de 2024 s’était construite sur la promesse du « retour de l’abondance ». L’un des engagements était de diviser par deux les factures énergétiques des Américains en douze à dix-huit mois, en « libérant » les hydrocarbures des réglementations de l’administration Biden. Un an après, le bilan d’étape de cette politique énergétique révèle un contraste saisissant entre promesses et réalités.
L’exploitation massive des énergies fossiles a effectivement battu des records, faisant des États-Unis le premier producteur et exportateur mondial de pétrole et de gaz. Mais cette « domination énergétique » se construit aux dépens des ménages et des entreprises américaines, qui font face à des coûts en nette hausse, à rebours des espoirs suscités. Analyse d’un piège économique qui se referme sur la base électorale du président républicain et résonne mal avec les promesses de l’America First.
Le retour de l’inflation
Le 20 janvier 2025, jour de son investiture, le nouveau président signait une déclaration d’« urgence énergétique nationale ». Ce texte a activé des leviers d’exception, notamment pour contourner les études d’impact environnemental. L’offensive s’est poursuivie avec le One Big Beautiful Bill Act, promulgué en juillet 2025, qui a enclenché le démantèlement de l’Inflation Reduction Act (IRA), ciblant les subventions à l’éolien et au solaire.
À lire aussi : États-Unis : les promesses de Trump d’un âge d’or (noir) sont-elles tenables ?
L’idée maîtresse de ces trumponomics était que la suppression de ces subventions, couplée à une dérégulation massive, permettrait de baisser le prix des « vraies énergies », c’est-à-dire les fossiles. Pourtant, le ruissellement de cette abondance vers les ménages s’est brisé sur deux écueils : l’intégration mondiale des marchés et la révolution de l’IA.
Les chiffres de l’inflation publiés par le Bureau of Labor Statistics pour l’année 2025 dessinent un tableau problématique. Une baisse est certes enregistrée sur les carburants liquides (- 7,5 % sur 12 mois), mais sans rapport avec ce qui avait été promis (passer de 3 à 2 $, entre 2,54 et 1,69 €, le gallon, soit une baisse d’un tiers). L’administration Trump ne manque évidemment pas de mettre en scène la baisse (même timide) de cet indicateur qui s’affiche en lettres néon au bord des routes. Mais, dans l’intimité des foyers, l’inflation énergétique est douloureusement ressentie. Sur la même période, l’électricité a augmenté de 6,3 % et le gaz naturel de 9,8 %.
Les États républicains en première ligne
L’organisation Public Citizen estime que, sur les neuf premiers mois de 2025, les consommateurs américains ont payé 12 milliards de dollars (plus de 10 milliards d’euros) de plus pour leur gaz par rapport à 2024. Ce choc frappe de plein fouet les États du Nord et du Midwest, souvent des bastions électoraux clés pour les républicains, où l’hiver 2025-2026 est particulièrement rude.
Ces tensions sont d’autant plus aiguës que la Maison-Blanche a également rendu plus difficile l’accès des Américains aux aides, avec la suppression de crédits d’impôt pour les améliorations énergétiques des logements visant à réduire les coûts. Elle a également restreint le programme d’aide énergétique aux ménages à faibles revenus (LIHEAP), qui soutenait chaque année 6 millions de familles américaines pour le paiement de leurs factures. Le programme a survécu, mais il a été considérablement entravé après que l’administration avait licencié l’ensemble du personnel du LIHEAP, dès le début du mandat.
L’importation de la volatilité mondiale
La politique d’exportation produit des effets mécaniques, à rebours des promesses présidentielles de baisse des factures énergétiques. Sous l’administration précédente, un moratoire et des contraintes logistiques limitaient les exportations de gaz naturel liquéfié (GNL). Donald Trump, en levant tous les freins à l’exportation dès janvier 2025 et en inaugurant de nouveaux terminaux sur la côte du Golfe du Mexique, a contribué au bond des exportations de près de 25 % en un an. Mais, cela a une conséquence : le prix du gaz américain ne dépend plus seulement de facteurs locaux, mais de la demande à Paris, Berlin ou à Shanghai.
En voulant faire des États-Unis la « superpuissance énergétique », l’administration a importé la volatilité mondiale sur le sol américain. Et le pire est à venir, car si l’Energy Information Administration (EIA) prévoit une pause en 2026, les prix de gros du gaz pourraient croître de… 33 % en 2027 (avec la mise en service de nouvelles infrastructures d’exportation).
Ce dilemme révèle l’impossibilité à maximiser la rente d’exportation des producteurs et tout en protégeant les consommateurs locaux d’une hausse de prix. Entre les profits de l’industrie gazière (soutiens majeurs du Parti républicain) et le pouvoir d’achat des ménages, la politique a tranché en faveur des premiers, créant une tension interne au sein même de la coalition trumpiste, entre les « globalistes » de l’énergie et les « localistes » du pouvoir d’achat.
Voracité électrique des data centers
Le prix de l’électricité est à la fois tiré vers le haut par celui du gaz et par les besoins de l’IA, qui a cessé d’être virtuelle pour devenir un problème d’infrastructure physique lourde. Les data centers nécessaires pour faire tourner les modèles de langage et le cloud computing sont devenus de nouveaux ogres énergétiques, de sorte que la demande électrique de ce secteur est en train de doubler, voire de tripler dans certaines régions. Et le réseau électrique américain, déjà vieillissant, sature par endroits. La loi de l’offre et de la demande joue à plein face à une capacité de production qui peine à suivre et des goulets d’étranglement dans les lignes à haute tension, de sorte que les prix de gros s’envolent. Selon l’EIA, la moyenne des prix de gros régionaux a augmenté de 23 % en 2025, progression qui pourrait se poursuivre à hauteur de 8 % en 2026.
La responsabilité de l’administration Trump est, a minima, engagée par omission. En supprimant les incitations aux énergies renouvelables, elle a réduit le déploiement de nouvelles capacités rapides à installer (solaire, éolien, batteries). Et le One Big Beautiful Bill Act a créé un attentisme chez les investisseurs verts, alors même que la demande explosait. Pour combler le trou, le réseau s’est tourné vers les solutions de dernier recours, souvent les plus chères à opérer dans un contexte de prix du gaz croissant.
Le retour du charbon
Face à la pénurie, les États-Unis ont également réactivé leur assurance-vie du XXe siècle : la production électrique charbonnière a augmenté de 13 % en 2025, une première après des années de déclin. Des centrales thermiques qui devaient fermer ont été prolongées par décrets. Si cela a permis d’éviter des black-out majeurs, ce choix a un coût, car le charbon n’est plus l’énergie « bon marché » d’antan. Extraire, transporter et brûler du charbon dans des centrales en fin de vie, coûte cher, surtout comparé au coût marginal nul du solaire. D. Trump, habile à orchestrer les symboles, a même obligé le Pentagone à signer un contrat d’approvisionnement en électricité produite au charbon. Sans surprises, ce retour du charbon a fait repartir les émissions de CO₂ à la hausse (+ 2,4 % en 2025).
Autre contradiction : la promesse de réindustrialisation reposait sur un avantage compétitif majeur : une énergie abondante et à prix cassé par rapport à l’Europe ou l’Asie. Or, cet avantage s’érode avec un gaz plus cher et une électricité volatile, les secteurs électro-intensifs (acier, aluminium, pétrochimie, engrais) voient leurs atouts érodés, d’autant que les droits de douane rehaussent le coût de certaines matières premières importées. L’incertitude réglementaire créée par l’abolition de l’IRA réduit, en outre, la capacité des industriels à signer des contrats d’achat d’énergie verte à long terme, qui leur offrent une visibilité sur quinze ou vingt ans.
Des gagnants et des perdants
Cette crise énergétique ne frappe pas les États-Unis de manière uniforme. Une géographie des tensions sur les prix émerge, débouchant sur des tensions politiques régionales. Les États du Sud-Est (comme la Floride ou la Géorgie), très dépendants du gaz naturel pour leur électricité et historiquement réticents aux renouvelables, subissent les hausses les plus fortes. À l’inverse, des États comme l’Iowa ou le Kansas, qui ont massivement investi dans l’éolien au cours de la décennie précédente, ou la Californie avec vaste parc solaire, amortissent mieux le choc. Bien que l’électricité californienne reste chère dans l’absolu, ses prix ont tendance à se stabiliser voire à baisser légèrement grâce à la pénétration massive des renouvelables, à rebours de la tendance nationale.
Cette disparité met à mal le récit national unifié de D.Trump. Les gouverneurs républicains des États producteurs (Texas, Louisiane) se félicitent du boom économique local lié aux exportations. Simultanément, les élus du même parti dans les États consommateurs doivent répondre à la colère de leurs électeurs, confrontés aux factures qui flambent.
Vers une « gilet-jaunisation » états-unienne ?
À l’orée de 2026, l’administration Trump se trouve face à une impasse stratégique. Le pari de la baisse des prix par la seule production fossile a échoué car il a ignoré le levier de la demande (sobriété et efficacité énergétique) et la réalité des marchés internationaux. Politiquement, le danger est réel, car l’inflation énergétique nourrit un sentiment de déclassement et d’injustice. Tyson Slocum, directeur du programme énergie de l’organisation Public Citizen, résume la situation :
« La priorité donnée par Trump aux exportations de GNL est directement en contradiction avec les efforts pour rendre l’énergie abordable. Les coûts énergétiques des ménages ont grimpé trois fois plus vite que l’inflation générale. »
Même si le pouvoir cherche à reporter la responsabilité sur les responsables démocrates, le slogan « Drill, baby, drill » risque de virer au « Pay, baby, pay »…
Pour sortir du piège, Donald Trump devra peut-être commettre l’impensable pour son camp : admettre que dans un monde globalisé et numérisé, l’indépendance énergétique et les prix bas ne passent plus seulement par des puits de pétrole et de gaz, mais aussi par la maîtrise de la demande, la modernisation des réseaux et, ironiquement, ces énergies renouvelables qu’il met toute son énergie à démanteler.
Sous pression, le pouvoir trumpiste pourrait également décider de réduire les volumes d’exportation de gaz, notamment vers l’Europe qui en est la principale destination, revenant aux racines de l’America First. Motivation essentielle de l’effort de décarbonation dans l’Union européenne (UE), pour réduire ces menaces sur la sécurité d’approvisionnement, et sortir de la zone de domination énergétique américaine.
Patrice Geoffron est membre fondateur de l'Alliance pour la Décarbonation de la Route. Il siège dans différents conseils scientifiques: CEA, CRE, Engie.
17.02.2026 à 17:08
Quand la Coupe d’Afrique des nations réactive les tensions au sein de l’Afrique
Jean-Loup Amselle, Anthropologue et ethnologue, directeur d'études émérite à l'EHESS, chercheur à l'Institut des mondes africains (IRD-CNRS-Panthéon Sorbonne-Aix-Marseille-EHESS-EPHE), Institut de recherche pour le développement (IRD)
Texte intégral (2214 mots)
La finale Maroc‑Sénégal a tourné au chaos. La suite des événements a vu une large mobilisation des imaginaires opposant Afrique du Nord « blanche » et Afrique subsaharienne « noire ».
Dans un article rédigé à l’époque des faits, j’avais tenté de montrer que le refus du footballeur du PSG et de l’équipe du Sénégal Idrissa Gana Gueye de porter le maillot LGBTQIA+ lors de la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie en mai 2022 avait cristallisé les tensions entre les milieux footballistiques français et sénégalais, et au-delà, entre une partie des opinions publiques de ces deux pays, au point de faire apparaître cette affaire comme l’expression d’un antagonisme foncier entre la culture sénégalaise et la culture française.
Le scénario de la crise survenue lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qui s’est déroulée au stade Moulay-Abdellah de Rabat au Maroc le 18 janvier 2026 est en principe différent puisqu’elle met aux prises deux pays africains – même si, on le verra, le fantôme de l’ancienne puissance coloniale conserve un certain rôle en arrière-plan.
Rappelons tout d’abord le cadre général de cette finale dont la victoire était en quelque sorte programmée pour revenir au pays hôte, le Maroc. En effet, Rabat a dépensé des sommes considérables pour accueillir cet événement, ce qui a provoqué une éruption populaire de jeunes qui auraient préféré voir les crédits affectés à l’organisation de la compétition aller à des équipements scolaires ou à des hôpitaux.
Le tournoi a vu s’affronter de multiples équipes africaines, mais ce qui retient l’attention sur le plan symbolique, perspective choisie ici, ce sont les matchs qui ont opposé des équipes du nord et du sud de l’Afrique, autrement dit du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne.
« La Société archaïque », un ouvrage de référence et une grille de lecture pour la finale
Des tensions avaient déjà été observées dès avant la finale : les Algériens étaient sortis furieux contre l’arbitre sénégalais après leur quart de finale perdu contre le Nigeria, l’accusant de partialité et ajoutant que l’un de ses assistants aurait tenu des propos racistes à leur égard ; durant la demi-finale entre le Maroc et le Nigeria, le gardien nigérian avait vu des ramasseurs de balles locaux voler sa serviette – un épisode qui annonçait l’épisode de la serviette du gardien sénégalais durant la finale que des remplaçants marocains allaient chercher à subtiliser.
C’est bien cette finale entre le Maroc et le Sénégal qui a cristallisé le plus de sanctions, et l’on voudrait ici replacer ce match dans un cadre anthropologique emprunté à Lewis H. Morgan, l’un des pères fondateurs de cette discipline.
Dans la Société archaïque (1877), Morgan retrace l’évolution de l’histoire de l’humanité en définissant trois stades successifs : d’abord la sauvagerie, puis la barbarie (entendue comme une phase intermédiaire, où commencent à naître des structures relativement complexes) et enfin la civilisation. Ce paradigme temporel peut être transformé en un syntagme géographique s’appliquant au climat dans lequel s’est déroulée la finale de cette compétition.
Mais commençons par un bref rappel des faits. Dans le temps additionnel de la rencontre, à la 92ᵉ minute, alors que le score est toujours de 0-0, un but est refusé – à tort ou à raison – au Sénégal par l’arbitre Jean-Jacques Ndala (République démocratique du Congo), suscitant l’incompréhension des Lions de la Teranga. Quelques instants plus tard, deuxième moment de tension, bien plus intense, celui-là : à la toute dernière minute du temps additionnel, toujours à 0-0, l’arbitre accorde un pénalty au Maroc. Cette décision – tout aussi discutable que le but sénégalais annulé quelques instants plus tôt – provoque, cette fois, une véritable fureur de l’équipe sénégalaise. Suivant son entraîneur Pape Thiaw, elle quitte alors le terrain et ouvre véritablement la crise, puisque ce départ contrevient à la réglementation du football et fait donc peser le risque de lourdes sanctions à l’encontre de la sélection.
Un seul joueur sénégalais, le capitaine Sadio Mané, reste sur le terrain et, après avoir pris conseil auprès de l’entraîneur français Claude Le Roy, 78 ans, qui a exercé en Afrique pendant des décennies, obtient le retour de ses coéquipiers sur la pelouse. Le match reprend après un gros quart d’heure d’interruption.
L’attaquant marocain Brahim Diaz peut enfin tirer le pénalty qui a entraîné l’incident… et le manque. Le match se poursuit donc avec des prolongations, et le Sénégal finit par remporter la rencontre et donc la compétition.
Dans la présentation des choses souvent faite au Maroc à la suite de cette soirée traumatisante pour le pays hôte, l’équipe du Sénégal, par son comportement sans précédent consistant à quitter massivement le terrain, ainsi que par l’explosion de colère de ses supporters, a représenté le premier des stades défini par Morgan, celui de la « sauvagerie » ; le capitaine sénégalais Sadio Mané, par sa volonté constructive de ramener « ses » joueurs vers le terrain, a représenté le second, celui de la « barbarie », étape intermédiaire vers la « civilisation » qui, elle, incombe au Maroc, aussi bien en sa qualité d’équipe nationale stoïque durant les turbulences de la fin de match et, au-delà, de pays organisateur d’une CAN vouée à devenir un modèle pour l’ensemble du continent.
Derrière cette vision est réactivée la division coloniale entre une Afrique du Nord « blanche », perception relevant plutôt de l’orientalisme, et une Afrique subsaharienne « noire », davantage interprétable dans le cadre de l’ethnographie.
Mais à cette triangulation, il faut ajouter un quatrième élément : celui de l’ombre de l’ancienne puissance coloniale représentée par celui qui a entraîné de nombreuses équipes de football africaines, Claude Le Roy, véritable parrain de la résolution partielle de la crise intervenue sur le terrain.
Accusations réciproques
Le résultat de la finale provoque une sorte de déflagration non seulement entre le Maroc et le Sénégal, mais également au sein de l’Afrique tout entière. « Chaos », « fiasco », entre autres, sont les qualificatifs donnés à ce match par les journalistes tandis que les commentaires vont bon train dans toute l’Afrique et notamment au Maghreb. C’est que le football, dans ce cas comme dans d’autres, est le révélateur de tensions entre pays et entre portions du continent africain.
En dépit des sommes considérables dépensées par le Maroc, les Sénégalais se sont plaints d’avoir été mal hébergés, d’avoir été obligés de s’entraîner sur des terrains ne leur convenant pas, de ne pas avoir bénéficié d’un service de sécurité efficace, etc. Bref, d’avoir été traités avec condescendance.
Plus grave, le défenseur sénégalais Ismaël Jakobs a affirmé que le forfait quelques heures avant la finale de trois de ses coéquipiers avait été dû à un empoisonnement. En outre, les Sénégalais ont accusé l’arbitre de partialité puisqu’il leur a refusé un but et accordé un pénalty aux Marocains ; et ils se sont émus du vol de la serviette de leur gardien de but.
Parallèlement, certains spectateurs maghrébins se sont moqués de supposées tentatives sénégalaises de peser sur l’issue du match en ayant recours à des pratiques magiques issues de traditions animistes, tandis qu’eux-mêmes n’avaient d’autre repère religieux que le Coran. On retrouve ainsi une opposition tranchée entre magie africaine subsaharienne et religion maghrébine, et donc une nouvelle fois entre « sauvagerie » et « civilisation ».
La victoire des nationalismes
En définitive, à une certaine rancœur envers un hégémonisme attribué au Maroc a correspondu un certain mépris à l’égard du Sénégal, voire un racisme déclaré comme en témoignent, entre autres exemples, les propos d’une enseignante de l’Université internationale de Casablanca qui a qualifié les Sénégalais d’« esclaves ».
À l’issue de cette compétition, l’image de l’unité de l’Afrique a donc une nouvelle fois été profondément fragilisée — de même que, dans une certaine mesure, les ambitions dominatrices du Maroc sur le sud du continent. Mais cela n’a pas concerné seulement l’opposition entre un Nord « blanc » et un Sud « noir » puisqu’à cette occasion a aussi été révélé le fossé entre le Maroc et le reste du Maghreb : une partie des opinions tunisienne et algérienne ont « joué » de façon fantasmatique la défaite de l’équipe marocaine et, à travers cette défaite l’affaiblissement du royaume chérifien, accusé non seulement de refuser l’indépendance au Sahara occidental (projet soutenu par l’Algérie et la Tunisie), mais aussi d’entretenir des liens étroits avec Israël. À travers les fantasmes africains qui se sont déployés autour de la CAN, ce sont donc aussi la tragédie de Gaza et la double articulation du Maghreb tiraillé entre l’Afrique subsaharienne et le Moyen-Orient qui se sont invitées dans la compétition.
En définitive, si à l’occasion de la finale de cette compétition le Maroc a fait preuve d’un hégémonisme contrarié comme en témoigne le fait que le frère du roi Moulay Rachid ait refusé de remettre la coupe au capitaine de l’équipe du Sénégal Sadio Mané, ce dernier pays n’est pas en reste pour affirmer sa supériorité par rapport à ses voisins de l’intérieur du continent – on y observe souvent la manifestation d’un sentiment de supériorité intellectuelle par rapport au Mali, au Burkina Faso, ou encore au Niger, dont les habitants sont considérés comme des « ploucs » plus ou moins animistes ou moins islamisés que les Sénégalais. Les fantasmes de l’Afrique n’opposent pas seulement l’Afrique « blanche » à l’Afrique « noire », mais sont aussi internes à l’Afrique subsaharienne elle-même. Les véritables vainqueurs de cette finale de la CAN 2026 sont en réalité les nationalismes marocain et sénégalais.
Jean-Loup Amselle ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
17.02.2026 à 17:05
Too little, too concentrated: why AI start-up funding in Africa needs rethinking
Claire Zanuso, PhD, économiste du développement, chargée de recherche et d'évaluation / Development economist, research and evaluation officer, Agence Française de Développement (AFD)
Texte intégral (3384 mots)
One year after the AI Summit in Paris, the international community will meet again this week in New Delhi for the Global Summit on Artificial Intelligence, whose objective will notably be to support the diffusion of AI uses in developing countries. In Africa, AI and Tech investment remains concentrated in the “Big Four” – South Africa, Egypt, Kenya and Nigeria – at the expense of other countries across the continent. This analysis explores the causes of this imbalance and the levers that could be used to better direct capital.
Between 2015 and 2022, investment in African start-ups experienced unprecedented growth: the number of start-ups receiving funding increased more than sevenfold, driven by the expansion of mobile technologies, fintech and a massive inflow of international capital. However, from 2022 onwards, tighter economic conditions led to a “funding squeeze” (a reduction in venture capital investment) that was more severe for African start-ups than in other regions of the world. This trend further reinforced the concentration of capital in the countries with the most developed start-up ecosystems, namely South Africa, Egypt, Kenya and Nigeria.
There is, however, a strong case for ensuring that these investments are more evenly distributed across the continent. Beyond stimulating economic activity, the technological innovations developed by these start-ups represent a significant lever for development, as they offer solutions tailored to local contexts: targeted financial solutions, improved agricultural productivity, strengthened health and education systems, and responses to priority climate challenges, etc.
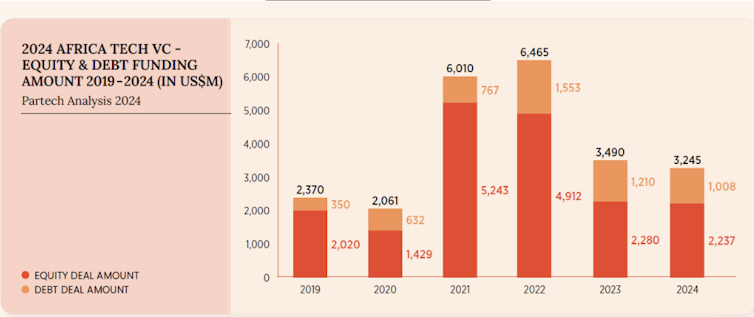
Concentration of investment in the Big Four
In the early 2020s, the expression “Big Four” emerged to describe Africa’s main tech markets: South Africa, Egypt, Kenya and Nigeria. The notion, likely inspired by the term Big Tech, suggests the existence of “champion countries” in the technology sector.
In 2024, the Big Four captured 67% of equity tech funding (investments made in exchange for shares in technology companies). In detail, the shares captured by each country were distributed as follows: around 24% for Kenya, 20% for South Africa, and 13.5% each for Egypt and Nigeria.
This funding cluster is not only geographical; it also has a strong sectoral dimension. Capital is largely directed toward sectors perceived as less risky, such as digital finance or “fintech”, often at the expense of areas such as edtech and cleantech – that is, technologies dedicated to education and to environmental solutions, respectively.
An estimated 60%-70% of funds raised in Africa come from international investors, particularly for funding rounds over 10-20 million dollars. These investments, often concentrated in more structured markets, represent the most visible transactions, but also those considered the least risky.
Emerging peripheral ecosystems and potential that remains insufficiently converted into investment
While the Big Four concentrate the majority of investment, several African countries now demonstrate proven potential in AI and a pool of promising start-ups, without capturing investment volumes commensurate with that potential.
Countries such as Ghana, Morocco, Senegal, Tunisia and Rwanda form an emerging group whose members have favourable AI fundamentals but remain underfunded. This gap is all the more striking given that Ghana, Morocco and Tunisia, all of which have dynamic start-up pools, together account for around 17% of African technology companies outside the Big Four. At the same time, local financial structures struggle to meet these funding needs in geographies perceived as peripheral.
This difficulty in attracting investment can be explained in particular by institutional and business ecosystems that still need strengthening, as the performance of technology companies relies on the existence of structured entrepreneurial ecosystems that enable access to knowledge, skilled labour, and support mechanisms (accelerators, incubators and investors).
Finally, it is important to recall that these weaknesses are part of a broader context: in 2020, the entire African continent accounted for only 0.4% of global venture capital flows and currently represents just 2.5% of the global AI market. Emerging countries outside the Big Four are therefore mechanically disadvantaged in a competition that is already highly concentrated.
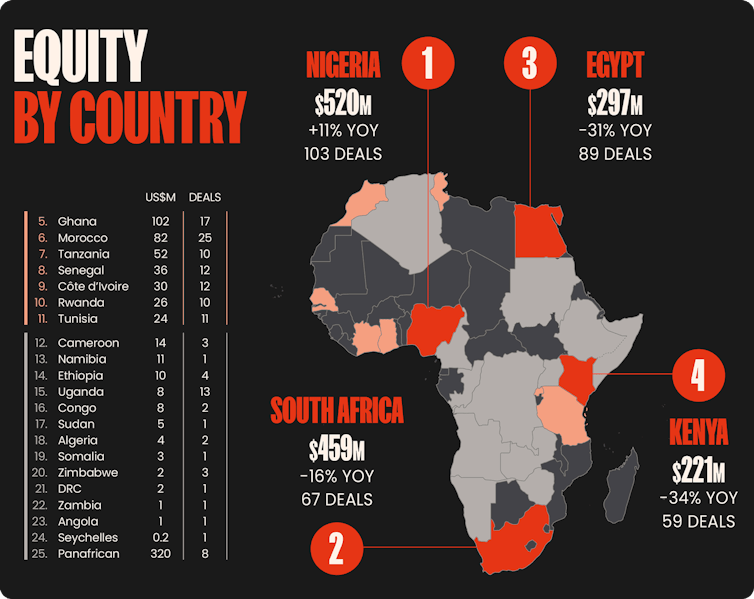
Steering investment to prepare countries for AI
To attract capital toward AI start-ups, a country must itself be ready for AI. The adoption of AI at the national level does not depend solely on technological factors. The AI Investment Potential Index (AIIPI), a research initiative, highlights that this adoption also relies on economic, political and social factors. As a result, increasing a country’s AI potential requires not only strengthening energy and connectivity infrastructure, but also improving governance standards, public sector effectiveness and human capital.
Priority actions vary depending on countries’ level of advancement in AI. In more advanced countries, such as South Africa or Morocco, the challenge is more about supporting research, optimising AI applications and attracting strategic investment. In countries with more moderate scores, priorities tend to focus on strengthening connectivity infrastructure, human capital and regulatory frameworks.
The platform aipotentialindex.org enables, among other things, to visualise the index’s results at a global level and to identify the areas in which countries can invest to increase their AI investment potential (research, government effectiveness, connectivity, human capital, AI strategies, etc.). The AIIPI helps investors not only identify countries that are already advanced in AI, but also those with untapped potential. For public decision-makers and development actors, it provides a framework for prioritising reforms and investment.
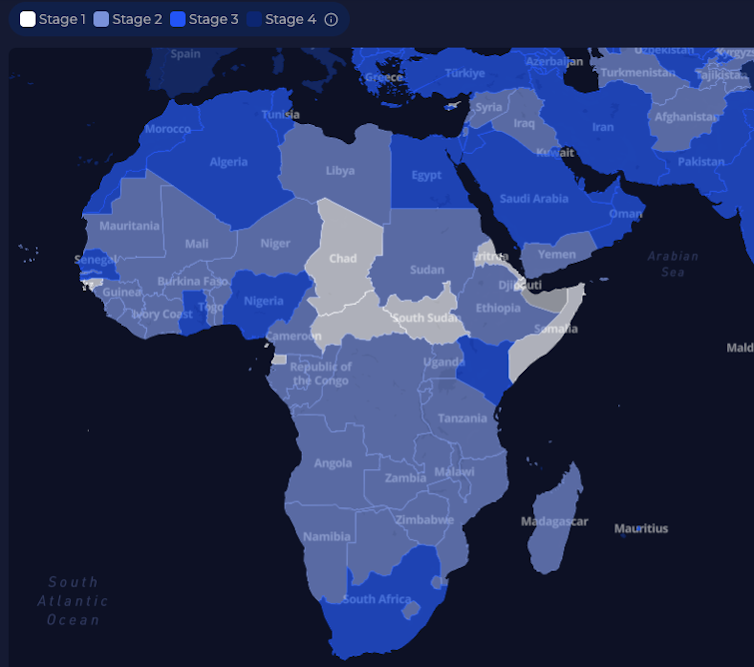
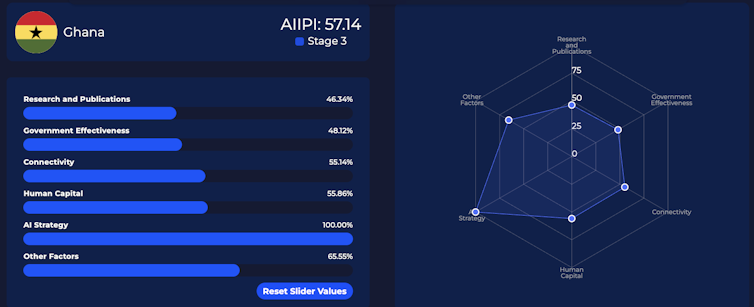
Sovereign funds and instruments dedicated to new technologies
Once a country’s AI investment strategy has been defined, the question of AI financing instruments arises. At the continental level, several instruments dedicated to technology and AI are emerging. Development finance institutions, such as the African Development Bank or the West African Development Bank, are launching initiatives aimed at supporting the growth of the continent’s digital economy.
At national level, African Sovereign Wealth Funds (SWFs) provide an additional channel to support AI and start-up financing across the continent. These funds, such as the Mohammed VI Fund in Morocco or the Pula Fund in Botswana, mobilise public savings for long-term economic development and work in partnership with development banks.
Partnerships as powerful levers for start-up financing
Financing digital and AI infrastructure alone is not enough to build start-up ecosystems capable of driving economic growth. International public-private partnerships also play a significant role. The Choose Africa 2 initiative, led by AFD and Bpifrance, aims to address financing constraints facing entrepreneurship across the continent, particularly at the earliest stages. Support mechanisms, like Digital Africa, bringing together public actors and local partners enable small-ticket investments in early-stage “Tech for Good” start-ups, whose technologies generate strategic, social and environmental impact.
While these mechanisms are not enough on their own to correct investment imbalances, they can nevertheless help broaden access to financing beyond the ecosystems that are traditionally best resourced.
Central political, strategic and legal leadership
Financial investment alone is not sufficient and must be supported by strong political ambition. Legislative and strategic frameworks put in place at national and continental levels are key structural levers for the growth of digital start-ups in Africa.
On the one hand, strategies led by the African Union, including the Digital Transformation Strategy for Africa, the Continental Artificial Intelligence Strategy and the African Digital Compact, provide roadmaps enabling states to accelerate digital transformation. There are also national-level instruments, such as Tunisia’s “Start-up Act” law or national AI strategies, such as the one published by Ghana, which sets out the country’s ambition to become Africa’s “AI Hub.”
Finally, a major political commitment was made at last April’s Global AI Summit in Kigali, where 52 African countries announced the creation of a 60-billion-dollar African AI Fund combining public, private and philanthropic capital. This initiative illustrates a strategic ambition across the continent: positioning Africa around these emerging technological challenges. However, these AI-focused funds may face governance and financial structuring challenges. There remains a risk that they could reproduce asymmetries already observed in sovereign wealth funds if transparency mechanisms are not put in place. Their impact will, therefore, depend on the establishment of standards and governance tools adapted to emerging technological challenges.
These frameworks create the initial conditions needed for the emergence of local AI solutions and provide a structuring strategic framework. Their impact on investor confidence will, however, depend on how effectively they are aligned with appropriate financing mechanisms and strengthened local capacities.
This article was co-written with Anastesia Taieb, Innovation Officer at AFD, and Emma Pericard, Digital Africa’s representative to the EU.

A weekly e-mail in English featuring expertise from scholars and researchers. It provides an introduction to the diversity of research coming out of the continent and considers some of the key issues facing European countries. Get the newsletter!
Claire Zanuso ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
16.02.2026 à 16:57
De l’art du deal à l’art de la diplomatie : comment gérer Donald Trump ?
Maxime Lefebvre, Permanent Affiliate Professor, ESCP Business School
Texte intégral (2452 mots)
Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump multiplie les actions d’éclat et les déclarations explosives sur la scène internationale. Les partenaires traditionnels de Washington ont globalement su, au cours de cette année extrêmement tendue, trouver un modus operandi dans leur relation avec le très combatif – mais aussi, en maintes occasions, pragmatique – président des États-Unis.
Les adjectifs ne manquent pas pour caractériser Donald Trump dans son action internationale : narcissique et transgressif, imprévisible et erratique, fanfaron, maladroit, voire grossier, malhonnête, brutal… Sa communication à base de tweets et de « petites phrases », à usage autant interne qu’externe, place les dirigeants et les diplomaties du monde devant un défi redoutable, par exemple lorsqu’il publie sans vergogne des échanges censés rester privés et confidentiels (récemment un SMS d’Emmanuel Macron). Ce comportement déroutant multiplierait les incidents diplomatiques s’il n’émanait du leader de la première puissance mondiale, obligeant les partenaires des États-Unis à s’adapter et à faire bonne figure.
La diplomatie, dans les rapports des leaders étrangers avec Trump, reste nécessaire, de la même façon que le droit international conserve une valeur intrinsèque dans les rapports entre les nations. Malgré ses multiples violations, y compris par l’actuel président des États-Unis, la diplomatie reste l’art indispensable de communiquer, et parfois de compromettre, entre des acteurs qui ne partagent pas la même vision du monde, surtout lorsqu’ils se trouvent en désaccord sur tel ou tel dossier.
« L’art du deal » : une forme disruptive de politique étrangère
Le livre The Art Of the Deal (co-écrit par Donald Trump et le journaliste Tony Schwartz) remonte à 1987, bien avant que l’homme d’affaires ne se lance en politique. Le magnat de l’immobilier y décrit sa méthode disruptive de négociation, consistant à voir grand, à demander beaucoup, et à utiliser les médias à son avantage. C’est à la même époque qu’il commence à réclamer publiquement que les États-Unis instaurent des tariffs (c’est-à-dire des droits de douane), dans un contexte marqué par les succès économiques du Japon et le creusement du déficit commercial américain.
Donald Trump n’avait pas pu pleinement mettre en œuvre sa politique durant son premier mandat, car il était mal préparé et avait été freiné par son administration, par exemple, dans ses velléités de rapprochement avec la Corée du Nord. Son second mandat a démarré avec une politique plus réfléchie et plus résolue : par des mesures commerciales agressives (la salve de tariffs annoncée lors du « Liberation Day » du 2 avril) ; par les menaces sur la souveraineté du Canada et du Groenland ; par l’exigence que les États latino-américains se plient à ses ordres en matière de contrôle de l’immigration, de lutte contre le narcotrafic ou de rapports avec la Chine ; par le retrait des États-Unis de certaines organisations multilatérales (déjà entamé en 2017-2020) ; et par la négociation à la hussarde de plusieurs accords de paix (notamment à Gaza).
À lire aussi : Le « Board of Peace » pour Gaza de Donald Trump : diplomatie de façade et remise en cause de l’ordre international
Cette attitude, si elle détonne par rapport aux administrations précédentes, n’est pas totalement exempte d’une certaine tradition américaine dans le rapport au monde. Les pressions sur les alliés, les sanctions unilatérales, l’extraterritorialité du droit américain, l’emploi unilatéral de la force, le rejet de certaines normes multilatérales (les États-Unis n’ont jamais ratifié la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer ni le statut de Rome créant la Cour pénale internationale, et ils se sont retirés de l’Unesco entre 1984 et 2003) ne sont pas des pratiques nouvelles. Mais Donald Trump y ajoute une brutalité, un égoïsme et un systématisme qui lui sont propres, au nom de l’idéologie « America First ».
Des limites pratiques
Le président américain a dit qu’il ne se fixait comme limites que celles de sa « propre morale ». Il y a cependant deux limites pratiques qui transparaissent de son action, et qui peuvent un peu rassurer ses partenaires.
En premier lieu, il n’aime pas les aventures militaires. D’une part, du fait de son tempérament (il n’a pas fait son service militaire et croit plus au business qu’à la guerre). D’autre part, à cause du rejet des engagements militaires par sa base électorale. Il entend garantir « la paix par la force », mais l’objectif est bien la paix. Il a démontré sa nette préférence pour des frappes et des opérations ciblées (en Syrie en 2017 et 2018, en Iran et au Nigeria en 2025, au Venezuela en 2026) au lieu d’engagements prolongés au sol.
Il confirme ainsi que la page de la « guerre contre le terrorisme », qui aurait coûté 8 000 milliards de dollars (soit 6 750 milliards d’euros) aux États-Unis entre 2001 et 2021, est tournée, sans renoncer à la poursuite de frappes militaires qui sont devenues, depuis les deux mandats de Barack Obama, le moyen d’action privilégié contre les groupes terroristes. L’opération au Venezuela est une bonne illustration d’une politique économe dans ses objectifs (en l’occurrence, l’enlèvement de Maduro et la lutte contre le narcotrafic et l’emprise chinoise, plutôt que le changement de régime) comme dans ses moyens.
En second lieu, Donald Trump a montré plus d’une fois son grand pragmatisme, n’hésitant pas à reculer quand il s’est engagé trop loin. C’est le corollaire de sa méthode disruptive. Les réactions de l’opinion américaine, celles de la Bourse, mais aussi les limites posées par ses partenaires, finissent par influencer une administration où le président, entouré de fidèles, ne néglige pas les avis de prudence. Les tariffs promulgués lors du « Liberation Day » ont aussitôt été suivis d’une mise en pause, sous l’effet notamment de la réaction des marchés, au point que le Wall Street Journal a évoqué un « moment Mitterrand », traçant un parallèle entre la marche arrière enclenchée par Trump à cette occasion et le fameux tournant de la rigueur enclenché par le président socialiste français en 1983.
Dans le dossier Russie/Ukraine, le président américain a entendu les Européens et fait évoluer sa position dans un sens moins favorable à Moscou, jusqu’à accepter une forme d’engagement américain dans les futures garanties de sécurité à l’Ukraine. Sur le Groenland, il a reculé à Davos en renonçant à l’option militaire. Sur l’Iran, il a pris ses distances avec certaines velléités de renverser le régime pour se concentrer sur l’objectif de la négociation nucléaire.
Ces volte-faces lui ont été reprochées (la formule TACO, « Trump Always Chickens Out », soit « Trump se dégonfle toujours » a un grand succès sur les réseaux sociaux) et il n’est pas sûr qu’ils soient payants auprès de l’électorat américain au moment des midterms. Mais ils montrent qu’il y a une place pour la diplomatie dans l’art de gérer Trump.
L’art de gérer Trump
Les dirigeants mondiaux sont désarçonnés et leurs nerfs soumis à rude épreuve. Beaucoup ont fait les frais de ses moqueries et de ses foucades, en particulier les dirigeants occidentaux ou ceux considérés comme hostiles, mais pas directement les dirigeants « forts » comme Xi Jinping et Vladimir Poutine. Certains n’ont pas craint de se ridiculiser, comme le secrétaire général de l’Otan Mark Rutte qui l’aurait appelé « Daddy ».
Néanmoins, les partenaires de l’administration américaine ont réussi avec le temps à établir une relation de travail avec elle et à obtenir des résultats. Emmanuel Macron a été le premier à organiser une rencontre entre Trump et le président ukrainien Zelensky, lors de la cérémonie de réouverture de Notre Dame en décembre 2024. La Commission européenne a conclu un « deal » commercial avec les États-Unis en juillet 2025, critiqué notamment en France, mais souhaité par de nombreux États qui voulaient préserver avant tout les liens économiques et commerciaux avec Washington. Le cap du sommet de l’Otan à La Haye en juin 2025 a été passé sans accroc, évitant le désengagement américain.
Alors que les relations avec le Canada se tendaient avec l’accumulation des contentieux (tarifs, revendications territoriales, relation à la Chine), la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum montrait au contraire son habileté dans ses relations avec le président américain. Emmanuel Macron, jusqu’à la confrontation récente sur le Groenland, a su aussi amadouer l’hôte de la Maison-Blanche, ce que ce dernier a reconnu à Davos (« J’aime beaucoup Emmanuel Macron ») tout en lui envoyant plusieurs piques.
Il en ressort une certaine méthode dans l’art de traiter le chef d’État américain. D’abord, la nécessité de garder la tête froide. Cela ne doit pas devenir une froideur, au moins de la part des partenaires et alliés. Il s’agit de garder son calme, de ne pas entrer dans la surenchère verbale, d’opposer aux foucades l’autorité du sérieux. Ensuite le dialogue et la coopération : parler, prendre les demandes américaines au sérieux, essayer de les comprendre, tenter d’y répondre, accepter et même rechercher le dialogue, rechercher et accepter des compromis. Enfin, la fermeté : marquer et énoncer les limites, rappeler les positions de principe, agir ou réagir avec mesure, renforcer sa position en cherchant des alliés.
La manière dont les Européens ont géré Donald Trump jusqu’ici est assez exemplaire : l’acceptation d’un compromis tarifaire évitant une guerre commerciale (l’accord de Turnberry) ; les lignes rouges marquées sur la régulation numérique ; la diplomatie appuyée sur des outils de puissance sur l’Ukraine (le renforcement de l’aide et la mise en place d’une « coalition des volontaires » pour apporter des garanties de sécurité à Kiev) ; la fermeté dans l’affaire du Groenland (la déclaration du 6 janvier et l’envoi d’une mission militaire) ; le report de la ratification de l’accord commercial. Mais les Européens ont toujours évité d’entrer dans une vaine confrontation, cherchant surtout à ménager l’avenir et à préserver le lien transatlantique, malgré les nombreux appels (surtout en France) à une attitude intransigeante.
Le rapport avec la Russie et la Chine apparaît plus formel, plus froid et plus égalitaire, car Trump les ménage davantage. Xi Jinping a pu apparaître comme dominant son partenaire par sa maîtrise de lui-même, lors de leur rencontre en Corée, même si certains ont voulu voir une tentative de Donald Trump de prendre l’ascendant. Sans doute la culture chinoise, qui accorde une grande importance aux apparences et au fait de ne pas perdre la face, est-elle difficilement compatible avec les excentricités du président yankee. Une situation similaire s’est produite lors de la rencontre avec Vladimir Poutine à Anchorage.
Derrière les tractations et les péripéties diplomatiques, ce qui se joue est évidemment plus profond, entre rapports de force mondiaux et avenir du camp occidental et de ses valeurs. Mais quelles que soient les évolutions à venir, la diplomatie restera plus que jamais nécessaire à la stabilité du monde. Elle doit s’articuler avec les rapports de puissance, et il est heureux qu’elle produise encore des résultats.
Maxime Lefebvre ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
16.02.2026 à 16:57
Trop peu, trop concentré : pourquoi l’investissement dans les start-up IA doit être repensé en Afrique
Claire Zanuso, PhD, économiste du développement, chargée de recherche et d'évaluation / Development economist, research and evaluation officer, Agence Française de Développement (AFD)
Texte intégral (3654 mots)
Un an après le Sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle de Paris, la communauté internationale se réunira cette semaine, à New Delhi, dans le cadre du Sommet mondial sur l’intelligence artificielle, dont l’objectif sera notamment de favoriser la diffusion des utilisations de l’IA dans les pays en développement. En Afrique, les investissements Tech et IA restent concentrés dans les « Big Four » – Afrique du Sud, Égypte, Kenya et Nigeria –, au détriment des autres pays du continent. Cette analyse explore les causes de ce déséquilibre et les leviers qu’il est possible d’employer pour mieux orienter les capitaux.
Cet article a été co-écrit avec Anastesia Taieb, chargée de projets innovation à l’AFD, et Emma Pericard, représentante de Digital Africa auprès de l’UE.
Entre 2015 et 2022, les investissements dans les start-up africaines ont connu une croissance sans précédent : le nombre de start-up recevant des financements a été multiplié par plus de sept, portés par l’essor du mobile, de la fintech et par un afflux massif de capitaux internationaux. Cependant, à partir de 2022, le resserrement des conditions économiques a entraîné un funding squeeze (diminution des investissements en capital-risque) qui a été plus important pour les start-up africaines que dans les autres régions du monde. Ce phénomène a renforcé la concentration des capitaux dans les pays où l’écosystème des start-up était le plus développé, à savoir l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Kenya et le Nigeria.
Il y aurait cependant tout intérêt à ce que ces investissements soient mieux répartis sur le continent. Au-delà de la stimulation des économies, les innovations technologiques de ces start-up représentent un important levier de développement car elles proposent des solutions adaptées au contexte local : solutions financières spécifiques, amélioration de la productivité agricole, renforcement des systèmes de santé et d’éducation, réponse aux enjeux climatiques prioritaires, etc.
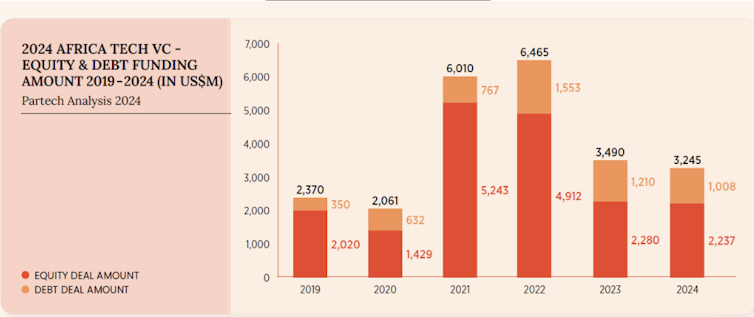
Concentration des investissements dans les Big Four
Au début des années 2020 émerge l’expression de « Big Four » pour qualifier les principaux marchés tech africains : Afrique du Sud, Égypte, Kenya et Nigeria. Cette notion, certainement inspirée du terme Big Tech, implique qu’il existerait des « pays champions » dans le domaine des technologies.
En 2024, les Big Four ont capté 67 % des financements en equity tech (investissements contre des parts d’entreprises technologiques). Dans le détail, les pourcentages captés par chaque pays se répartissaient ainsi : environ 24 % pour le Kenya, 20 % pour l’Afrique du Sud et 13,5 % respectivement pour l’Égypte et le Nigeria.
Cette concentration des financements n’est pas seulement géographique : elle présente également une forte dimension sectorielle. On observe que les capitaux sont majoritairement dirigés vers des secteurs perçus comme moins risqués tels que la finance numérique « fintech », au détriment, par exemple des edtech ou cleantech, c’est-à-dire, respectivement, les technologies consacrées à l’éducation et à l’environnement.
Environ 60 à 70 % des montants levés en Afrique proviendraient d’investisseurs internationaux, notamment pour les tours de financement supérieurs à 10-20 millions de dollars. Ces investissements, souvent concentrés dans les marchés structurés, constituent les transactions les plus visibles mais aussi les moins risquées.
Des écosystèmes périphériques naissants et un potentiel insuffisamment converti en investissements
Si les « Big Four » concentrent la majorité des investissements, plusieurs pays africains disposent aujourd’hui d’un potentiel avéré en matière d’IA et d’un vivier de start-up prometteuses, sans pour autant capter des volumes d’investissement à la hauteur de ce potentiel.
Des pays comme le Ghana, le Maroc, le Sénégal, la Tunisie ou le Rwanda forment un groupe émergent dont les membres disposent de fondamentaux favorables à l’IA mais restent sous-financés. Ce décalage est d’autant plus frappant que le Ghana, le Maroc et la Tunisie, qui possèdent tous un vivier de start-up dynamique, regroupent à eux seuls environ 17 % des entreprises technologiques africaines hors « Big Four ». Par ailleurs, les structures financières locales ne parviennent pas à couvrir ces besoins dans ces géographies perçues comme périphériques.
Cette difficulté à attirer les investissements s’explique notamment par des écosystèmes institutionnels et d’affaires qui doivent être renforcés, la performance des entreprises technologiques reposant sur l’existence d’écosystèmes entrepreneuriaux structurés qui permettent l’accès à la connaissance, à une main-d’œuvre qualifiée, ainsi qu’à des dispositifs d’accompagnement (accélérateurs, incubateurs et investisseurs).
Enfin, il est nécessaire de rappeler que ces faiblesses s’inscrivent dans un contexte plus large : en 2020, l’ensemble du continent africain ne représentait que 0,4 % des flux mondiaux de capital-risque et ne pesait que 2,5 % du marché mondial de l’IA ; les pays émergents hors « Big Four » se trouvent donc mécaniquement pénalisés dans cette compétition déjà très concentrée.
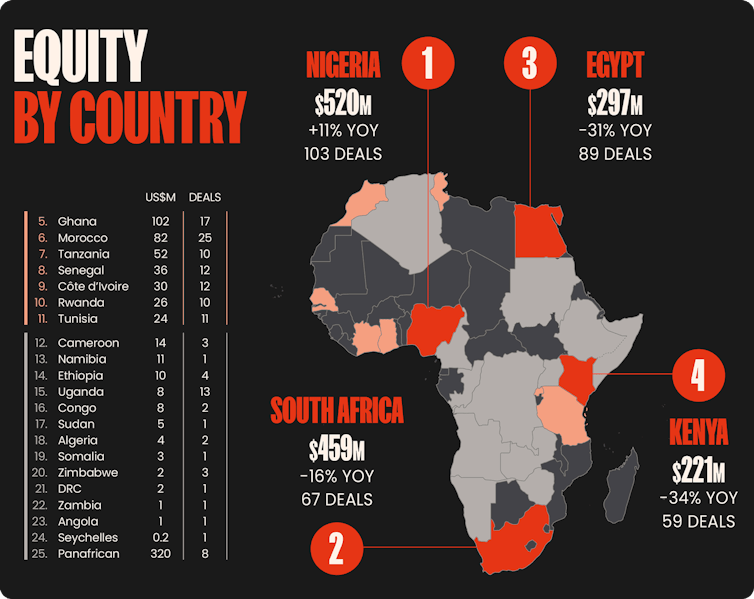
Orienter les investissements pour préparer les pays à l’IA
Afin d’attirer des capitaux vers ces start-up IA, un pays doit lui-même être prêt pour l’IA. L’adoption de l’IA au niveau d’un pays ne dépend pas seulement de facteurs technologiques : L’AI Investment Potential (AIIPI) est un travail de recherche qui souligne que cette adoption repose également sur des facteurs économiques, politiques et sociaux. Ainsi, pour augmenter son potentiel en IA, un pays devra non seulement renforcer ses infrastructures énergétiques et de connectivité mais également son niveau de gouvernance, l’efficacité de ses pouvoirs publics et son capital humain.
Les actions à privilégier varient selon le stade d’avancement en IA des pays. Dans les pays plus avancés, comme l’Afrique du Sud ou le Maroc, l’enjeu est davantage de soutenir la recherche, d’optimiser les applications de l’IA et d’attirer des investissements stratégiques. Dans des pays avec un score plus modéré, les priorités portent sur la consolidation des infrastructures de connectivité, du capital humain et des cadres réglementaires.
La plate-forme aipotentialindex.org permet, entre autres, de visualiser les résultats de l’index au niveau mondial et les domaines dans lesquels les pays peuvent investir pour augmenter leur potentiel d’investissement en IA (recherche, efficacité de l’action publique, connectivité, capital humain, stratégies IA, etc.). L’AIIPI permet aux investisseurs non seulement de repérer les pays avancés en IA mais également ceux où le potentiel est sous-exploité. Pour les décideurs publics et les acteurs du développement, il offre un cadre de priorisation des réformes et des investissements.
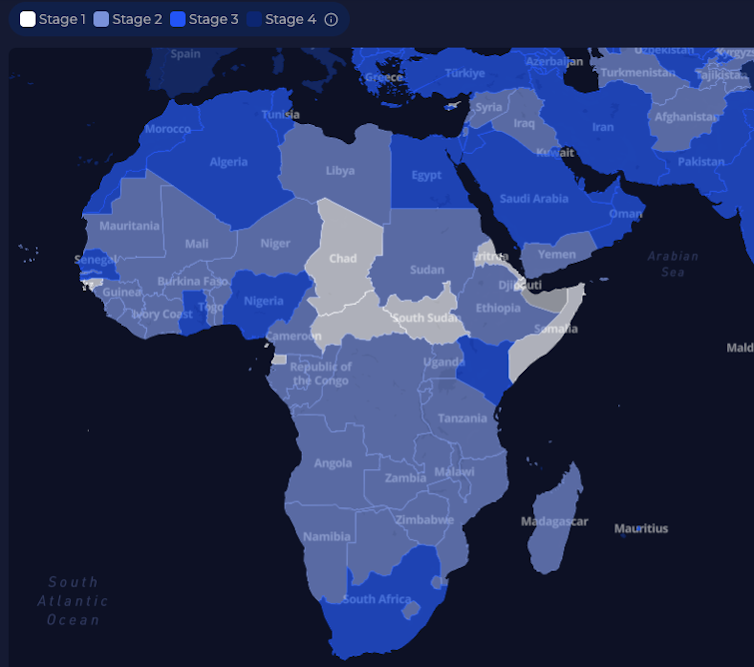
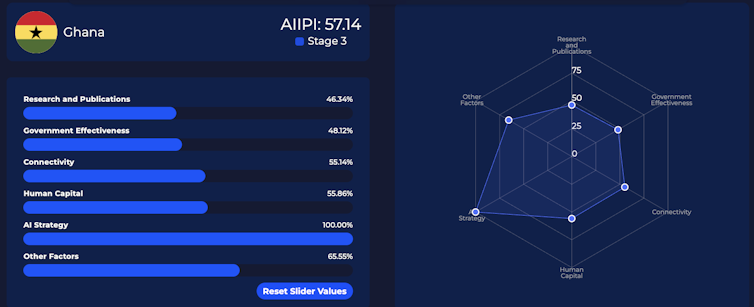
Fonds souverains et dispositifs dédiés aux nouvelles technologies
Une fois la stratégie d’investissement en IA d’un pays définie, se pose la question des instruments de financement de l’IA. À l’échelle continentale, plusieurs instruments dédiés aux technologies et à l’IA émergent. Des établissements financiers de développement, tels que la Banque africaine de Développement ou encore de la Banque ouest-africaine de Développement lancent des initiatives visant à soutenir la croissance de l’économie numérique du continent.
À l’échelle nationale, les fonds souverains africains (Sovereign Wealth Funds, SWFs) constituent une voie supplémentaire permettant de soutenir le financement de l’IA et des start-up sur le continent. Ces fonds, comme le Fonds Mohammed VI au Maroc ou le Pula Fund au Botswana mobilisent l’épargne publique pour le développement économique à long terme et travaillent en partenariat avec des banques de développement.
Les partenariats, des leviers puissants pour le financement de start-up
Financer les infrastructures numériques et IA ne suffit pas pour avoir un écosystème de start-up capables de stimuler l’économie. Les partenariats public-privé internationaux jouent aussi un rôle notable : l’initiative Choose Africa 2, portée par l’AFD et Bpifrance, vise à répondre aux contraintes de financement de l’entrepreneuriat sur le continent, en particulier lors des phases les plus précoces. À ce stade, des dispositifs de soutien, comme ceux de Digital Africa, associant acteurs publics et partenaires locaux, permettent des investissements de faibles montants de jeunes start-up « Tech for Good », dont les technologies génèrent un impact social et environnemental stratégique.
Des partenariats entre institutions africaines et européennes, tels que l’initiative Choose Africa 2 portée par l’AFD et Bpifrance, visent à répondre aux contraintes de financement de l’entrepreneuriat sur le continent, en particulier lors des phases les plus précoces. À ce stade, des dispositifs d’amorçage associant acteurs publics et partenaires locaux, dont Digital Africa, permettent des investissements de petits montants afin de financer des start-up contribuant à la diffusion d’infrastructures numériques et s’inscrivant dans une approche « Tech for Good », dont les technologies génèrent un impact social et environnemental positif essentiel pour le continent.
Ces mécanismes, sans suffire à corriger les déséquilibres d’investissement, peuvent néanmoins contribuer à élargir l’accès au financement au-delà des écosystèmes traditionnellement les mieux dotés.
Un portage politique, stratégique et juridique central
Les investissements financiers ne suffisent pas et doivent être portés par une ambition politique. Les dispositifs législatifs et stratégiques mis en place au niveau national et continental constituent des leviers structurants pour l’essor des start-up digitales en Afrique.
D’une part, les stratégies portées par l’Union africaine – la Stratégie de transformation numérique pour l’Afrique, la Stratégie continentale d’intelligence artificielle ou encore le Pacte numérique africain – fournissent des feuilles de route pour que les États puissent accélérer la transformation numérique des pays. Il existe également des dispositifs nationaux, comme en Tunisie avec la loi Startup, ou les stratégies nationales sur l’IA, comme celle publiée par le Ghana qui affiche son ambition de devenir le « Hub IA de l’Afrique ».
Enfin, un engagement politique majeur a été pris en avril dernier, lors du Global AI Summit de Kigali où 52 pays africains ont annoncé la création d’un Fonds africain pour l’IA de 60 milliards combinant des capitaux publics, privés et philanthropiques. Cette initiative illustre une volonté stratégique de l’Afrique : se positionner sur ces nouveaux enjeux technologiques. Néanmoins, ces fonds IA pourraient rencontrer des défis de gouvernance et de structuration financière. En effet, le risque demeure qu’ils puissent reproduire des asymétries déjà existantes dans les fonds souverains si des mécanismes de transparence ne sont pas mis en place. Leur impact dépendra donc de l’instauration de normes et d’outils de pilotage adaptés aux défis technologiques émergents.
Ces dispositifs créent les premières conditions nécessaires à l’émergence de solutions d’IA locales ainsi qu’un cadre stratégique structurant. Leur impact sur la confiance des investisseurs dépendra toutefois de leur articulation avec des financements adaptés et les capacités locales.
Claire Zanuso ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
16.02.2026 à 16:54
Financer la santé mondiale : ce que la baisse de la contribution française au Fonds mondial dit de sa politique étrangère et de son rapport au multilatéralisme
Stéphanie Tchiombiano, Maitresse de conférence associée dans le département de science politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Texte intégral (2153 mots)
La France devrait cette année, pour la première fois, diminuer sa contribution au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Une décision qui souligne le fossé grandissant entre ses déclarations officielles en faveur du multilatéralisme sanitaire et la réalité de ses engagements financiers.
Malgré une forte mobilisation des ONG et des acteurs de la santé mondiale, le gouvernement français devrait diminuer de 58 % sa contribution au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, provoquant l’effroi général du monde du VIH. Le financement trisannuel français passerait de 1‚6 milliard d’euros à 660 millions d’euros jusqu’en 2028.
Cette décision s’inscrit dans un double contexte de diminution continue de l’aide publique au développement de la France depuis 2023 et de baisse drastique des financements de la santé mondiale depuis le début du deuxième mandat de Donald Trump (quasi-suppression de l’Agence des États-Unis pour le développement international USAID, fin du financement à Gavi, l’Alliance du vaccin, retrait de 66 organisations internationales dont l’Organisation mondiale de la santé, OMS, et des accords de Paris). Jusqu’alors, les États-Unis représentaient le tiers de l’aide publique internationale en matière de santé.
À lire aussi : La France, championne de la lutte mondiale contre le VIH/sida ? Retour sur 40 ans de diplomatie face à la pandémie
Certes, quelques pays comme l’Espagne ou le Luxembourg ont augmenté leur contribution au Fonds mondial, mais ces efforts restent très insuffisants pour compenser le retrait partiel des financeurs historiques : États-Unis, France, Royaume-Uni, Allemagne.
Les ressources du Fonds mondial sont en effet très concentrées : près de 33 % provenaient jusqu’alors des États-Unis, une part comparable de l’Union européenne, et environ 40 % si l’on inclut le Royaume-Uni. Dans ce contexte, la décision française constitue un signal politique fort, aux conséquences multiples : pour les populations des pays bénéficiaires avant tout, pour le Fonds mondial lui-même, mais aussi pour la place de la France dans la gouvernance mondiale de la santé.
Un désengagement en rupture avec une histoire politique
La décision est d’autant plus marquante que la France a été, depuis la création du Fonds mondial en 2002, l’un de ses soutiens les plus constants. Elle n’avait jusqu’ici jamais diminué sa contribution. Premier contributeur public européen et deuxième mondial, la France a cumulé près de 9,5 milliards d’euros de promesses de dons en vingt-cinq ans. Depuis 2011, une partie de cet engagement finance également L’Initiative, facilité complémentaire qui fournit des assistances techniques et des financements additionnels destinés à renforcer l’impact des programmes du Fonds mondial sur le terrain.
Au-delà des montants, cet engagement relevait d’un choix politique. La France s’est longtemps positionnée comme un acteur important de la santé mondiale, défendant l’idée d’une nécessaire solidarité mondiale en matière de santé, et déclarant notamment que certains produits de santé devaient être considérés comme des biens communs mondiaux, depuis le discours de Jacques Chirac sur l’accès aux antirétroviraux en 1997 jusqu’aux discours d’Emmanuel Macron à propos des vaccins contre le Covid-19.
La lutte contre le sida constitue l’un des principaux « marqueurs » de son action internationale. La baisse de la contribution française rompt donc avec une continuité historique et affaiblit une symbolique politique forte, notamment vis-à-vis des pays à revenu limité et des partenaires européens.
Le Fonds mondial, une organisation pas comme les autres
Ce désengagement interroge d’autant plus que le Fonds mondial n’est pas une organisation internationale ordinaire. Dans les pays où il a investi, les décès liés au sida ont été réduits d’environ 74 % entre 2002 et 2024 et on sait aujourd’hui à quel point les progrès liés aux maladies infectieuses ont contribué à l’augmentation de l’espérance de vie mondiale, grâce. Ces acquis restent toutefois fragiles : l’histoire des épidémies montre à quel point les reculs sont rapides lorsque les financements se tarissent.
Sur le plan institutionnel, le Fonds mondial incarne une forme originale de gouvernance. Il ne dispose pas de représentations nationales, fonctionne sur une gouvernance hybride associant États, ONG et secteur privé, et redistribue une partie du pouvoir décisionnel au niveau des pays, à travers les Country Coordinating Mechanisms. Si ses marges d’améliorations sont encore grandes, il constitue ainsi un modèle singulier entre souveraineté des États et gouvernance globale, dans un moment historique d’appel à la décolonialisation de la santé mondiale. Son approche communautaire, intégrant les organisations de la société civile et les personnes concernées, met également au cœur de l’action les droits humains – une dimension aujourd’hui directement menacée par la contraction des ressources et l’offensive idéologique états-unienne.
Dans ce contexte, la baisse généralisée des contributions révèle un affaiblissement silencieux de la solidarité internationale en santé et une fragilisation du multilatéralisme au profit de logiques plus transactionnelles (on pense évidemment à la nouvelle « America First Global Health Strategy » et à toutes les conventions bilatérales que les États-Unis sont en train de signer avec des États africains. Le débat dépasse largement la question budgétaire : il met en lumière des arbitrages politiques et une redéfinition du rôle de l’État donateur. Le gouvernement français utilise quasi textuellement les mêmes mots que Donald Trump : la politique de la France doit dorénavant « répondre davantage à ses valeurs et à ses intérêts ». Mais l’intérêt même de la France n’est-il pas justement de financer le Fonds mondial ?
Une erreur sanitaire aux effets globaux
Sur le plan sanitaire, les risques sont bien documentés. Cette diminution s’ajoute aux réductions massives des programmes bilatéraux américains (tels que les programmes présidentiels de lutte contre le sida, PEPFAR ou le paludisme, PMI), et menacent d’inverser des progrès durement acquis. Selon une étude du Lancet, les progrès réalisés contre le VIH, la tuberculose et le paludisme sont conditionnés à un financement conséquent et durable, et risquent de s’effriter rapidement si les investissements sont insuffisants dans les prochaines années.
Les pays à revenu faible ou intermédiaire, en particulier en Afrique qui concentre près des deux tiers de l’épidémie mondiale de VIH, sont les premiers concernés. Le modèle communautaire, pilier de l’efficacité des réponses aux trois maladies, est directement fragilisé. En l’absence de sursaut des autres acteurs, les chercheurs du Barcelona Institute for Global Health estiment que plus de 22,6 millions de décès supplémentaires pourraient survenir d’ici à 2030 dans les pays à faible et moyen revenu du fait de la baisse concomitante des aides américaines, britanniques, allemandes et françaises en matière de santé.
Mais les pays riches ne sont pas à l’abri. La reprise des épidémies ailleurs a des effets globaux : le VIH progresse désormais davantage hors d’Afrique, notamment en Europe de l’Est, en Asie centrale et au Moyen-Orient ; la tuberculose, y compris multirésistante, réapparaît en France.
Par ailleurs, ce désengagement intervient paradoxalement à un moment d’innovations majeures, comme la PrEP injectable de longue durée ou les nouveaux vaccins contre le paludisme, qui pourraient transformer durablement la santé mondiale à un coût relativement maîtrisé.
Un signal politique préoccupant
Au-delà de la santé, la baisse de la contribution française révèle un désalignement croissant entre le discours en faveur des biens publics mondiaux et les pratiques budgétaires. Elle affaiblit l’influence diplomatique et normative de la France, ainsi que son soft power en santé mondiale.
Le financement du Fonds mondial n’est effectivement pas un simple transfert financier : c’est un acte de politique étrangère. Il conditionne la capacité à peser sur les orientations stratégiques, à construire des coalitions et à défendre un multilatéralisme normatif face à des logiques plus bilatérales. Pour une puissance moyenne comme la France, l’investissement dans le multilatéralisme – et plus spécifiquement dans la santé, domaine dans lequel elle dispose d’une expertise reconnue – constitue un levier central d’influence internationale.
C’est ce qu’on appelle en science politique la « diplomatie de niche » : les puissances moyennes ont tout intérêt à concentrer leur attention sur les domaines dans lesquels elles disposent d’un niveau élevé de ressources et de réputation, en mettant l’accent sur leur leadership technique et leur rôle de facilitateur dans les négociations internationales ou la formation de coalitions.
Un révélateur des transformations en cours
La baisse de la contribution française au Fonds mondial apparaît ainsi comme un arbitrage révélateur : contraintes budgétaires, priorisation accrue, passage d’une solidarité politique à une solidarité conditionnelle et instrumentalisée. Elle pose une question fondamentale : que reste-t-il du multilatéralisme lorsque même les instruments sur lesquels un État a le plus investi deviennent des variables d’ajustement ?
Au-delà de la santé mondiale, cette décision engage la crédibilité de la France dans la gouvernance globale. Elle marque une occasion manquée de montrer que, dans un contexte de crises multiples, certains pays restent des partenaires fiables. Le débat sur le Fonds mondial devient ainsi un test politique majeur du rapport de la France au multilatéralisme – et de la solidité de ses engagements dans la tempête.
Stéphanie Tchiombiano est membre du think tank Santé mondiale 2030
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Time [Fr]
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- L'Autre Quotidien
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- Gauche.Media
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
