03.12.2025 à 16:53
Le retour de la puissance en géopolitique : le cas de l’Ukraine
Laurent Vilaine, Docteur en sciences de gestion, ancien officier, enseignant en géopolitique à ESDES Business School, ESDES - UCLy (Lyon Catholic University)
Damien Afonso, Enseignant en géopolitique à l'ESDES, ESDES - UCLy (Lyon Catholic University)
Texte intégral (1397 mots)
Et si, au-delà des horreurs, la guerre entre la Russie et l’Ukraine, intensifiée en 2022, n’était pas l’événement « nouveau » que l’on dépeint, mais le révélateur brutal de lois géopolitiques fondamentales que l’Occident avait choisi d’oublier ?
La guerre qui ravage actuellement l’Ukraine est un concentré de géopolitique, qui mobilise toutes les grilles d’analyse élaborées depuis plus d’un siècle, rappelant que les grands drames du monde contemporain (Bosnie, Tchétchénie, Géorgie, pour ne s’en tenir qu’au continent européen) ne sont que les itérations d’un jeu de puissance aux règles immuables.
Au-delà de l’anxiété du court terme, c’est cette approche qu’il convient d’avoir à l’esprit pour décrypter les constantes militaires, économiques, numériques et narratives qui commandent la géopolitique moderne.
L’empreinte indélébile de la géographie et de l’histoire
La guerre en Ukraine est, avant tout, une affaire de temps long. Elle réactive deux forces primaires que la modernité avait cru dissoudre : la géographie et l’histoire.
Ce conflit nous rappelle brutalement ce qu’est la guerre de haute intensité, un concept que l’on pensait relégué aux archives de la guerre froide (Corée, Vietnam, Iran-Irak…).
Le fleuve Dniepr redevient un obstacle stratégique ; le relief naturel dicte les fonctions défensives ; la mer Noire, une artère vitale pour l’évacuation du blé, est une zone de friction économique et militaire.
Les villes ne sont pas de simples coordonnées numériques, mais des bastions à conquérir, des symboles dont la perte ou la conquête influe directement sur le moral des belligérants. La technologie a beau innover (l’usage massif des drones), elle ne fait que s’adapter à la réalité implacable du sol. Cette réalité réaffirme une constante que les débats sur la guerre cyber et hybride tendaient à occulter : le terrain façonne les opérations.
Le poids des récits
Le rapport de force, lui, est indissociable des récits. L’Ukraine se définit par sa souveraineté, tandis que la Russie se considère toujours comme l’héritière légitime d’un espace impérial qu’elle n’accepte pas de perdre. Ce choc de représentations historiques, où l’un refuse de perdre et l’autre d’être absorbé, est une constante tragique de la géopolitique.
Vladimir Poutine, comme tant d’autres avant lui, a commis l’erreur classique d’ignorer qu’un rapport de force ne s’évalue pas à l’aune du mépris que l’on a pour son adversaire, mais se mesure au regard des forces et faiblesses réelles. La résistance ukrainienne, soutenue mais non dirigée par ses alliés, est la preuve amère que les Russes ont sous-estimé leur adversaire de manière caricaturale.
L’incapacité d’anticiper
L’un des enseignements les plus cinglants de ce conflit tient à l’incapacité d’anticiper dont ont fait preuve les acteurs occidentaux. Malgré les signaux constants de la géopolitique, il a fallu l’événement, le choc de 2022, pour forcer un réarmement accéléré de l’Europe et une révision de ses dépendances.
En Ukraine, la guerre est un laboratoire d’innovations (drones, adaptation tactique en temps réel), mais cette innovation ne saurait cacher le retour d’une autre constante : la masse.
Malgré le numérique et la guerre électronique, le qualitatif ne remplace pas le quantitatif. Le nombre de chars, de pièces d’artillerie, et de soldats compte plus que jamais. Les modes d’action russes le confirment tragiquement : une approche où la préservation du capital humain est subordonnée à l’idée d’un capital jugé quantitativement inépuisable.
L’Occident découvre, sidéré, la primauté du stock sur la sophistication, alors que cette logique est un pilier de la stratégie militaire depuis l’aube des guerres.
La gesticulation nucléaire
L’escalade doit être évitée à tout prix, et cette retenue est dictée par la constante la plus terrifiante de la modernité : la dissuasion nucléaire.
La logique de la « destruction mutuelle assurée » est plus vivante que jamais, expliquant la frilosité relative des Américains et des Européens. La Russie use et abuse de la gesticulation nucléaire – déclarations ambiguës, annonces de nouveaux matériels – pour dissuader tout engagement occidental trop important. Cette démonstration est à la fois une force et une faiblesse, mais elle réaffirme le rôle central de l’atome comme arbitre suprême des conflits de haute intensité.
Intérêts permanents, nouvelles alliances
Si le conflit semble géographiquement circonscrit, ses effets sont mondiaux, mais surtout, ils révèlent la nature profonde et intéressée des alliances globales.
Pour Vladimir Poutine, la guerre a engendré des échecs stratégiques aux conséquences durables :
la transformation de l’Organisation du traité Atlantique Nord (Otan) avec l’incorporation de la Finlande et de la Suède ;
le découplage durable avec l’Europe, forçant la Russie à orienter son énergie à prix réduit vers l’Asie (Chine, Inde), augmentant ainsi sa dépendance à un nombre réduit de pays ;
la mutation du « Sud Global », sur lequel la Russie compte tant.
L’échec le plus cruel est de constater que le soi-disant « Sud Global » ne soutient la Russie qu’à l’aune de ses propres intérêts. Ces pays profitent des sanctions occidentales pour acheter du pétrole russe à bas coût, démontrant une forme de non-alignement formel et l’une des plus grandes constantes de la géopolitique : l’intérêt prime toujours l’idéologie.
Le temps long contre la peur
En Ukraine, la guerre mobilise à elle seule de nombreuses constantes de la géopolitique contemporaine.
C’est ce que cherche à restituer le Retour de la puissance en géopolitique. Bienvenue dans le vrai monde (L’Harmattan, 2025) au travers de ses 20 thématiques indépendantes, visant à couvrir une grande partie du spectre de la géopolitique dont les maîtres mots sont la puissance, le rapport de force et l’intérêt. Comprendre cette guerre, c’est accepter que le monde obéît à des règles anciennes et que la seule véritable surprise réside dans notre incapacité chronique à les anticiper.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
03.12.2025 à 12:19
La longue histoire du despotisme impérial de la Russie
Sabine Dullin, Professeur en histoire contemporaine de la Russie et de l'Union soviétique, Sciences Po
Texte intégral (2129 mots)

Dans son nouvel essai Réflexions sur le despotisme impérial de la Russie qui vient de paraître aux éditions Payot, Sabine Dullin, professeure en histoire contemporaine de la Russie et de l’Union soviétique à Sciences Po, examine la formation et la persistance à travers le temps de l’identité impériale russe. Avec la précision de l’historienne, elle montre comment ce modèle s’est établi puis s’est construit dans la longue durée, a évolué selon les périodes et les natures des régimes, et continue à ce jour de peser lourdement sur la politique de la Russie contemporaine. Nous publions ici des extraits de l’introduction, où apparaît cette notion de « despotisme impérial » qui donne son titre à l’ouvrage et qui offre un angle d’analyse inédit des cinq derniers siècles de l’histoire du pays.
Un despote et une vision impériale : telle est la prison dans laquelle l’identité russe est enfermée depuis des siècles. Au pouvoir depuis vingt-cinq ans et artisan de la guerre en Ukraine, Poutine en donne hélas une confirmation éclatante.[…]
Les représentations extérieures de la Russie comme despotique et impériale ont repris de l’importance dans le débat public à la suite de l’invasion de l’Ukraine. Elles relient despotisme interne et guerre extérieure en redessinant la frontière orientale de l’Europe comme nouvelle barrière de civilisation.
L’acronyme « Rashistes », de la contraction entre « Russia » et « fascistes », né sous la plume d’un journaliste ukrainien au moment de la guerre en Géorgie en 2008, a été repris à partir de 2014 quand Poutine lança, à la suite de l’annexion de la Crimée, sa guerre non déclarée au Donbass. Son usage devint viral après l’invasion de l’Ukraine fin février 2022 et quand le président Volodymyr Zelensky l’utilisa en avril pour exprimer le retour de la barbarie fasciste en Europe, près de quatre-vingts ans plus tard.
Mais au moment des massacres de civils à Boutcha, en Ukraine, la présence dans l’armée russe d’unités non russes de Sibérie, d’ethnicité turcique ou mongole (Bouriates, Touva, Sakha), provoqua aussi dans les médias européens la réapparition d’une autre image de la Russie, plus asiatique qu’européenne.
Si l’envoi prioritaire au front des non-Russes pauvres de Sibérie ressemblait fort à de la discrimination raciste en Fédération de Russie, le descriptif d’une civilisation européenne blanche attaquée en Ukraine par les hordes barbares en provenance de Russie relevait quant à lui d’une longue histoire des stéréotypes occidentaux du despotisme oriental. Le despotisme avait notamment servi à décrire la Russie du tsar Nicolas Ier au milieu du XIXe siècle.
Dans sa comparaison entre les États-Unis et la Russie, Alexis de Tocqueville faisait alors de la servitude et de la conquête militaire les clés du gouvernement et du dynamisme des Russes. Pour lui, le peuple russe concentrait dans un seul homme toute la puissance de la société. Karl Marx, qui prit fait et cause pour les insurgés polonais en 1830 comme en 1863, dénonçait le danger que faisait peser la « sombre puissance asiatique sur l’Europe », dont l’art de la servitude, qu’il jugeait hérité des Mongols, servait une conquête sans fin.
Ainsi, soit le despotisme russe entrait dans une typologie des régimes politiques allant de la liberté et de la démocratie jusqu’à la tyrannie et l’absolutisme, soit il était essentialisé sous les traits d’un régime oriental et non européen. La grille de lecture orientaliste d’une Russie irréductiblement différente de l’Europe servit à nouveau, dans le contexte de la guerre froide, pour combattre l’adversaire communiste, son tout-État sans propriété privée et son expansionnisme rouge.
Le despotisme est une notion négative que les dirigeants russes eux-mêmes n’assumeraient pas. Elle est le plus souvent utilisée par les détracteurs du pouvoir russe. Pour vanter les mérites de leur système en regard de la démocratie occidentale, les gouvernants de la Russie ont préféré et préfèrent d’autres termes, comme absolutisme et autocratie à l’époque des tsars, dictature du prolétariat et démocratie populaire après la révolution russe, dictature de la loi ou verticale du pouvoir dans la Russie de Poutine.
Chaque terme peut se comprendre en miroir du système politique européen de l’époque. Ainsi, l’autocratie répond à la monarchie constitutionnelle, la dictature du prolétariat s’oppose à la démocratie formelle bourgeoise, la dictature de la loi remplace l’État de droit. Ce livre voudrait tester la notion de despotisme impérial, montrer à quel point les représentations du despotisme et de l’Empire se nourrirent l’une l’autre dans l’histoire russe.
Le concept est évidemment contestable et sera contesté. Mais dans son flou sémantique, il a la vertu heuristique d’étudier des usages et des récurrences. Depuis la Moscovie du XVIe siècle, il s’agira donc de comprendre comment despotisme et Empire ont pu former dans leur association un nœud coulant enserrant l’identité russe et bloquant son épanouissement, aussi bien comme nation que comme démocratie.
Dans les scénarios du pouvoir en Russie, on constate la personnalisation du pouvoir, sa dimension religieuse ou sacrée, la faiblesse des contre-pouvoirs, le service du souverain comme source principale de richesse. L’Empire, comme idée et comme pratique, relève pour l’État russe de l’ordre naturel des choses. En son sein s’est forgée une identité russe impériale englobante (rossiïski), différente de l’ethnicité russe (russki). L’Empire fut cependant l’objet de la critique acerbe des marxistes qui prirent le pouvoir en 1917. Mais l’immensité et la multinationalité, qui en étaient les traits positifs, et la Puissance qui en découlait furent – y compris en Union soviétique – valorisées, au contraire de l’impérialisme dont il fallait se dissocier.
Ni le despotisme ni l’Empire ne disparurent, malgré des idéologies contraires et les récits radicalement nouveaux d’après 1917. La figure du despote a pu prendre les traits d’un tyran sanguinaire ou d’un despote éclairé, il a pu se présenter comme le garant de l’ordre établi ou, au contraire, comme un modernisateur. Le régime despotique a été le pouvoir sans limites du tsar ou de Staline, mais aussi celui d’une bureaucratie civile et militaire pesant de tout son poids sur les multiples communautés et peuples composant l’Empire. Le despotisme impérial a provoqué violence, asservissement, mais aussi consensus et collaboration.
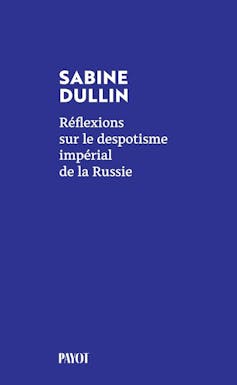
La notion de despotisme impérial offre également la possibilité de penser le pouvoir absolu et impérial en Russie en comparaison avec d’autres : l’Empire ottoman, la Chine, mais aussi les monarchies absolues, les Empires et les impérialismes occidentaux. Dans l’histoire russe, beaucoup de notions utilisées ne sont pas transposables ailleurs. Le dilemme du pouvoir russe est ainsi très souvent posé en termes d’occidentalisme (imitation de l’Occident) ou de slavophilie (recherche d’une voie spécifique). L’autocratie, lorsqu’elle conquiert des territoires, serait moins impérialiste que panslave (quand il s’agit de conquérir à l’ouest) ou eurasiste (quand il s’agit de coloniser vers l’est et le sud).
La notion de totalitarisme entendait insister sur la nouveauté des régimes communiste et fasciste issus de la Première Guerre mondiale et des révolutions qui ont suivi. « Despotisme impérial » évite de brouiller les systèmes de reconnaissance du régime politique par des caractérisations trop spécifiques dans le temps et l’espace. Utiliser la notion de despotisme impérial pour comprendre la Russie d’aujourd’hui a une valeur d’analyse critique, mais aussi de prospective. En soulignant les récurrences autocratiques de l’État russe et les ressorts d’une identité russe adossée à l’Empire, on est amené à se demander comment sortir de cette apparente fatalité du despotisme impérial en Russie.
Il ne faudrait pas se leurrer. Le jeu de miroirs est multidirectionnel. Pour critiquer la monarchie absolue française, Montesquieu analysait les régimes lointains de despotisme oriental. L’analyse du despotisme impérial de la Russie peut relever d’un exercice similaire de fausse altérité et de vigilance, comme un miroir tendu à l’Europe, lui renvoyant ce qu’elle fut : coloniale, impérialiste et fasciste, et ce qu’elle pourrait bien redevenir : antidémocratique.
Copyright : éditions Payot & Rivages, Paris, 2025.
Sabine Dullin ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
02.12.2025 à 15:58
Les deux grands enjeux derrière la demande de grâce de Benyamin Nétanyahou
Michelle Burgis-Kasthala, Professor of International Law, La Trobe University
Texte intégral (1612 mots)
Le président d’Israël Isaac Herzog a quelques semaines pour décider s’il gracie ou non le premier ministre Benyamin Nétanyahou, empêtré dans plusieurs affaires de corruption… pour lesquelles il n’a d’ailleurs pas encore été condamné, ce qui rend sa demande de grâce particulièrement exceptionnelle. Ce qui est en jeu ici, c’est à la fois l’avenir personnel et politique du chef du gouvernement, qui espère être reconduit à son poste aux élections de l’année prochaine, et l’indépendance du système judiciaire israélien.
Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou, poursuivi pour corruption depuis plusieurs années, a adressé une demande de grâce au président du pays Isaac Herzog. Cette demande a alarmé ses détracteurs, qui y voient une tentative de contourner l’État de droit.
Dans un message vidéo, Nétanyahou affirme que, du fait de la situation « sécuritaire et politique » actuelle d’Israël, il est impossible pour lui de comparaître devant le tribunal plusieurs fois par semaine.
Sa demande de grâce n’est que le dernier rebondissement d’une affaire qui dure depuis des années. Elle pourrait avoir des implications importantes aussi bien pour le système judiciaire israélien que pour l’avenir politique de Nétanyahou, alors que des élections sont prévues l’année prochaine.
Quelles sont les accusations qui pèsent contre lui ?
Nétanyahou, 76 ans, est incontestablement la figure politique la plus importante de la politique israélienne moderne. Il a été élu premier ministre pour la première fois en 1996 et en est aujourd’hui à son sixième mandat.
Il est mis en examen pour « corruption, fraude et abus de confiance », dans le cadre d’une série d’enquêtes qui remontent à 2016. Il fait l’objet de poursuites dans trois affaires distinctes identifiées par des numéros : l’« affaire 1 000 », l’« affaire 2 000 » et l’« affaire 4 000 ». Le procès a débuté en 2020.
Dans l’« affaire 1 000 », le premier ministre est soupçonné d’avoir reçu l’équivalent d’environ 200 000 dollars américains (172 000 euros) de cadeaux, notamment des cigares et du champagne, de la part du producteur hollywoodien Arnon Milchan et du milliardaire australien James Packer.
L’« affaire 2 000 » concerne des rencontres présumées entre Nétanyahou et Arnon Mozes, le propriétaire du célèbre journal Yediot Ahronot. L’accusation affirme que Mozes a proposé au chef du gouvernement une couverture médiatique favorable en échange de restrictions imposées à l’un de ses journaux concurrents.
Enfin, l’« affaire4 000 » concerne un conglomérat de télécommunications Bezeq. La procureure générale allègue l’existence d’un autre accord réciproque : Nétanyahou serait présenté sous un jour favorable sur un site d’informations en ligne géré par Bezeq, en échange de son soutien à des modifications réglementaires qui profiteraient à l’actionnaire majoritaire du conglomérat.
Nétanyahou a toujours nié toute malversation dans ces affaires, affirmant être victime d’une « chasse aux sorcières ». En 2021, il a qualifié les accusations de « fabriquées et ridicules ». Lorsqu’il a témoigné à la barre en 2024, il a déclaré :
« Ces enquêtes sont nées du péché. Il n’y avait pas d’infraction, alors ils en ont trouvé une. »
Des experts en droit israélien ont souligné qu’une grâce ne peut être accordée qu’une fois qu’une personne a été condamnée pour un crime. Mais Nétanyahou ne propose pas de reconnaître sa responsabilité ou sa culpabilité dans ces affaires, et il ne le fera probablement jamais. Il demande simplement une grâce afin de pouvoir continuer à exercer ses fonctions.
L’indépendance du système judiciaire israélien
Depuis le début du procès en 2020, de nombreuses personnes ont témoigné devant la justice, notamment d’anciens collaborateurs de Nétanyahou qui ont conclu des accords avec l’accusation et ont été interrogés en tant que témoins à charge. Des éléments assez accablants ont donc été présentés contre le premier ministre.
Il a toutefois su se montrer extrêmement habile et politiquement intelligent en utilisant à chaque occasion d’autres sujets, en particulier la guerre à Gaza, pour tenter de reporter ou d’interrompre la procédure.
Après le 7 octobre 2023, le nombre de jours d’audience a été limité pour des raisons de sécurité. Selon les médias, Nétanyahou a fréquemment demandé l’annulation de ses audiences, justifiant ces demandes par le fait qu’il avait une guerre à gérer.
Les partisans du premier ministre soutiennent sa demande de grâce, mais celle-ci met en lumière des questions plus larges concernant l’indépendance du système judiciaire israélien.
Au début de l’année 2023, le gouvernement a présenté des plans visant à réformer le système judiciaire, ce qui, selon ses détracteurs, affaiblirait la Cour suprême et le système israélien de contrôle et d’équilibre des pouvoirs. Nétanyahou n’a pas participé à cette initiative, car la procureure générale a déclaré que son implication constituerait un conflit d’intérêts en raison de son procès pour corruption, mais plusieurs ministres de son cabinet s’y sont associés.
Des manifestations massives ont eu lieu partout en Israël en réponse à ce projet. Les contestataires y ont vu une attaque frontale contre les fondements mêmes du système juridique israélien.
La demande de grâce s’inscrit donc dans ce contexte plus large, même si les deux questions ne sont pas formellement liées. Les opposants à Nétanyahou affirment que sa requête représente une nouvelle preuve du fait que lui et sa coalition ont une conception fondamentalement différente de la leur de ce que doit être l’État de droit.
La survie politique de Nétanyahou
Quand le premier ministre a été réélu à la tête du parti Likoud le 7 novembre 2025, il a annoncé son intention de se présenter à nouveau aux élections l’année prochaine – et souligné qu’il s’attendait à être désigné premier ministre une fois de plus.
La loi fondamentale israélienne suggère que Nétanyahou ne pourrait pas se présenter s’il était condamné pour une infraction grave, mais il n’est pas certain qu’il serait effectivement empêché de se présenter à ce stade.
Selon l’agence de presse Anadolu, Nétanyahou souhaiterait avancer les élections de novembre à juin dans l’espoir de pouvoir conclure d’ici là des accords visant à normaliser les relations avec l’Arabie saoudite et l’Indonésie. Cela correspond à son habitude d’utiliser les succès en matière de politique étrangère pour compenser ses problèmes intérieurs.
À l’approche des élections, le premier ministre israélien tente désormais toutes les manœuvres possibles pour améliorer sa position, et la grâce présidentielle n’est que l’une d’elles. C’est probablement la seule option qu’il lui reste pour faire disparaître l’affaire, car le procès dure depuis si longtemps que, tôt ou tard, le tribunal devra prendre une décision.
Michelle Burgis-Kasthala ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
01.12.2025 à 16:47
Terreur, viols, meurtres… Le quotidien épouvantable des femmes qui migrent du Soudan vers le Soudan du Sud
Sabine Lee, Professor in Modern History, University of Birmingham
Heather Tasker, Assistant Professor of Political Science, Dalhousie University
Susan Bartels, Clinician-Scientist, Queen's University, Ontario
Texte intégral (4548 mots)
Une enquête conduite auprès de centaines de personnes ayant fui la guerre au Soudan vers le Soudan du Sud met en évidence l’ampleur des violences – agressions, viols systématiques, assassinats – que les milices infligent à ceux et surtout à celles qui prennent la route en quête de sécurité.
« Je me trouvais à Khartoum lorsque le conflit a éclaté. Des soldats arabes armés sont venus chez nous pour piller nos arachides, mais ma mère a refusé de leur ouvrir la porte. Aussitôt, l’un des soldats lui a tiré dessus. J’ai crié, mais trois soldats m’ont encerclée. Ils m’ont attrapée et emmenée derrière un bâtiment où dix soldats m’ont violée. Personne n’est venu à mon secours, car ma mère était morte et les voisins s’étaient enfuis. Deux jours plus tard, après l’enterrement de ma mère, j’ai rejoint d’autres personnes pour aller au Soudan du Sud. »
C’est à proximité du poste-frontière d’Aweil, entre le Soudan du Sud et le Soudan, que cette jeune fille nous a raconté son histoire, qui rappelle bien d’autres témoignages que nous avons entendus de la part de nombreuses autres personnes. Sous la chaleur étouffante de juillet 2024, les pieds dans la boue et l’eau de pluie accumulées le long de la route, les membres sud-soudanais de notre équipe internationale ont demandé aux gens de partager leurs récits sur les expériences des femmes et des filles qui ont entrepris le périlleux voyage entre les deux pays.
Nous avons discuté avec près de 700 rapatriés et migrants forcés – femmes et hommes, filles et garçons – dont beaucoup ont partagé des expériences similaires, ayant été terrorisés par les soldats et les milices armées des deux camps pendant la guerre civile au Soudan. La guerre déchire le pays depuis 2023 et a causé la mort de plus de 150 000 personnes.
La lutte armée pour le pouvoir qui oppose l’armée soudanaise à un puissant groupe paramilitaire, les Forces de soutien rapide (FSR a provoqué une famine et des accusations de génocide visant les FSR dans la région occidentale du Darfour. Les FSR ont été créées en 2013 et trouvent leur origine dans la tristement célèbre milice Janjawid qui a combattu les rebelles au Darfour, où elle a été accusée de génocide et de nettoyage ethnique contre la population non arabe de la région. De nouveaux témoignages faisant état de massacres et d’atrocités continuent régulièrement d’apparaître.
Alors que la crise s’approfondit, nos recherches ont révélé que les violences sexistes et sexuelles sont un facteur majeur de migration vers le Soudan du Sud. Plus de la moitié des personnes que nous avons interrogées ont déclaré que c’était la principale raison pour laquelle elles avaient cherché refuge de l’autre côté de la frontière, les adolescentes âgées de 13 à 17 ans étant beaucoup plus susceptibles d’affirmer que la violence sexuelle était la raison pour laquelle elles avaient dû migrer.
Cette étude, récemment publiée dans Conflict and Health, a révélé de nombreux témoignages poignants de viols collectifs et de meurtres, dont certains ont été commis sur des enfants âgés d’à peine 12 ans.
Que se passe-t-il au Soudan du Sud et au Soudan ?
Depuis son indépendance en 2011, le Soudan du Sud reste l’un des États les plus fragiles au monde, en proie à une instabilité politique chronique et à des crises humanitaires à répétition. À la suite de divisions internes, une guerre civile dévastatrice, avant tout de nature ethnique, a éclaté en 2013. Ce conflit a fait près de 400 000 morts et à déplacé de force environ 2,3 millions de personnes, dont 800 000 vers le Soudan. Deux millions de personnes supplémentaires ont été déplacées à l’intérieur du Soudan du Sud, ce qui a gravement compromis les efforts de construction de l’État. Le pays reste sur le fil du rasoir et l’ONU déclarait en octobre qu’il était au bord de retomber dans une guerre civile totale.
Le déclenchement de la guerre au Soudan en 2023 a encore exacerbé les fragilités et les vulnérabilités du Soudan du Sud, compromis les efforts de paix et aggravé la crise humanitaire existante. Le conflit soudanais a provoqué un afflux massif, cette fois-ci de plus de 1,2 million de réfugiés et de rapatriés qui ont traversé la frontière vers le Soudan du Sud, exerçant une pression considérable sur des ressources et des services déjà surexploités.
En 2024, plus de 9,3 millions de personnes au Soudan du Sud, soit plus de 70 % de la population, avaient besoin d’une aide humanitaire, et 7,8 millions d’entre elles étaient confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. Plus de 2,3 millions d’enfants étaient menacés de malnutrition, certaines régions étant proches de la famine.
Même avant 2023, le Soudan du Sud figurait parmi les pays les plus touchés en matière de violences sexuelles et sexistes à l’échelle mondiale, avec le deuxième taux le plus élevé en Afrique subsaharienne.
La frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud est depuis longtemps un corridor de déplacements cycliques, façonné par des décennies de guerre, de famine et d’instabilité politique. Cependant, l’ampleur et la complexité de la crise actuelle ont accru les vulnérabilités, en particulier pour les femmes et les filles. Les effets se sont manifestés sous la forme de viols, d’abus sexuels, de traite et de prostitution forcée, des deux côtés de la frontière.
Fuir les violences sexuelles et la terreur
Nous avons concentré notre étude sur cette frontière et sur les personnes qui la franchissaient pour fuir. Nous avons utilisé la méthodologie dite « sensemaking » (basée sur le principe selon lequel le récit est un moyen intuitif de transmettre des informations complexes et aide les gens à donner un sens à leurs expériences) pour documenter ce qui est arrivé aux femmes au cours de leurs périples et les risques auxquels elles ont été confrontées dans les camps de réfugiées au Soudan du Sud. Nous avions adopté une approche similaire pour examiner les témoignages relatifs aux actes d’exploitation sexuelle commis par les Casques bleus de l’Organisation des Nations unies (ONU) en Haïti et en République démocratique du Congo (RDC).
L’équipe de terrain, composée de trois chercheuses et trois chercheurs de l’organisation à but non lucratif Stewardwomen, a travaillé pendant deux semaines à la frontière nord d’Aweil afin de recueillir ces témoignages. Stewardwomen est une organisation sud-soudanaise dirigée par des femmes qui lutte contre les violences faites aux femmes, notamment les violences sexuelles.
Notre équipe a recueilli 695 témoignages auprès de 671 personnes. La grande majorité d’entre elles étaient des Soudanais du Sud qui retournaient dans un pays qu’ils avaient autrefois fui (98 %), et la plupart étaient des femmes en âge de procréer (88 %). Plus de la moitié des témoignages étaient des récits à la première personne de leur propre migration, tandis que d’autres étaient des récits d’hommes concernant des femmes de leur famille.
L’objectif était de faire en sorte que les gens se sentent en sécurité et libres de s’exprimer ouvertement. Josephine Chandiru Drama, avocate sud-soudanaise spécialisée dans les droits humains et ancienne directrice de Stewardwomen, a déclaré :
« En invitant les femmes et les filles à partager leurs expériences migratoires avec leurs propres mots, les collecteurs de données ont honoré leur capacité d’action et leur voix. Cette approche a favorisé la confiance, réduit les risques de retraumatisation et permis d’obtenir des récits plus riches et plus authentiques qui reflètent les réalités vécues du déplacement. »
« Ils ont emmené les filles de force »
Si la violence oblige les familles à fuir le Soudan, le risque n’est pas réparti de manière égale. Nos conclusions montrent que les adolescentes sont exposées à un risque disproportionné.
Les filles sont confrontées à un danger grave que les familles peinent souvent à prévenir. Des groupes armés effectuent des raids dans les maisons et les camps, enlevant des filles ou les capturant sur les routes et aux postes de contrôle. Les filles sont prises pour cible et soumises à des agressions sexuelles et à des viols.
Les parents peuvent essayer de voyager en groupe, de changer d’itinéraire ou de cacher leurs filles, mais lorsque des hommes armés arrêtent un bus ou pénètrent dans un village pendant la nuit, leurs moyens de protection sont limités. Ces risques s’intensifient à mesure que la pauvreté s’aggrave et que les moyens de transport sûrs se font rares. Ces conditions rendent les filles visibles, isolées et vulnérables. Une femme nous a raconté comment elles ont été attaquées :
« […] La voiture des rebelles s’est approchée de nous. Ils ont emmené les filles de force et nous ont violées, les hommes n’ont rien pu faire pour nous protéger. Ce qui fait particulièrement mal, c’est d’être violée en plein air alors que les hommes nous regardent… Ce que les Arabes ont fait aux femmes et aux filles était terrible, et je ne suis pas la seule à avoir vécu cela. »
Une autre femme a raconté une histoire extrêmement traumatisante, celle du viol et du meurtre de sa fille. Elle a déclaré :
« Ma fille de 12 ans a été violée par un groupe de soldats et est morte sur le coup. C’est une histoire très triste à raconter, mais je dois le faire pour que le monde sache ce qui arrive aux femmes et aux filles au Soudan […]. Les soldats ont ensuite violé les cinq filles […]. Malheureusement, ma petite fille violée est morte sur le bord de la route[…]. Ce fut un moment très douloureux. »
Les données que nous avons collectées ont confirmé cette réalité terrifiante. Lorsque nous avons examiné les réponses par âge, une tendance statistiquement significative est apparue : les adolescentes âgées de 13 à 17 ans étaient beaucoup plus susceptibles que les femmes plus âgées de déclarer que la violence sexuelle était la raison pour laquelle elles avaient dû migrer.
Nous avons demandé aux participantes de situer leur expérience sur un spectre : la violence sexuelle était-elle la raison de leur migration, ou était-elle une conséquence de celle-ci ? Pour les adolescentes, les réponses se sont massivement regroupées à une extrémité : la violence sexuelle était le déclencheur, et non une conséquence de leur décision de quitter leur foyer.
Il est possible que parmi les femmes plus âgées, la violence sexuelle soit devenue quelque peu normalisée après qu’elles ont survécu à des conflits antérieurs dans la région, où les jeunes filles célibataires sont spécifiquement ciblées pour être enlevées et mariées de force. Une jeune femme a raconté ce qui était arrivé à sa sœur :
« Alors que nous voyagions pour trouver refuge dans notre pays natal, le Soudan du Sud […], toutes les femmes et les filles ont reçu l’ordre de sortir de la voiture […] et ont été violées par un groupe de cinq soldats. Jeune fille innocente, ma sœur de 15 ans a tenté de résister […] et elle a été violemment battue, violée par les cinq soldats, puis tuée […]. On nous a ordonné de partir, et ma sœur n’était plus. »
« Je suis venue ici pour changer de vie »
Une jeune femme à peine sortie de l’adolescence a déclaré avoir ressenti de la honte et de la gêne lorsqu’elle nous a raconté comment le groupe dont elle faisait partie avait été attaqué alors qu’il fuyait vers le Soudan du Sud.
« […] Nous avons soudain été attaqués par une milice et j’ai fait partie des huit filles qui ont été enlevées. J’ai été violée à plusieurs reprises par quatre hommes pendant deux jours[…]. Le viol m’a fait perdre mon bébé alors que j’étais enceinte de trois mois et j’ai contracté la syphilis. »
Si la violence n’est pas inattendue en temps de guerre, l’analyse des témoignages a révélé une tendance frappante : au total, 53 % des participants ont spécifiquement identifié la violence sexuelle et sexiste comme l’une des principales raisons de leur fuite, et dans toutes les tranches d’âge, il s’agissait du principal facteur déterminant. Pour beaucoup, il ne s’agissait pas simplement d’une conséquence de la guerre, mais du facteur décisif qui les a poussés à quitter le Soudan.
Les récits ont donné vie à ces données. Une mère a raconté la mort de son enfant sur la route de la migration, conséquence directe de la violence qu’ils fuyaient. Un homme a décrit comment sa femme et sa fille avaient été enlevées en chemin, le laissant seul pour s’occuper de ses quatre autres enfants et se demandant si elles étaient encore en vie. Il a déclaré :
« Cela me fait beaucoup souffrir car je ne sais pas si elles sont encore en vie. Selon certaines informations, la plupart des femmes et des filles qui ont été enlevées ont été victimes de viols collectifs et beaucoup sont mortes. Peut-être que ma femme et sa fille font partie des victimes. »
Ces récits, comme ceux d’innombrables autres femmes et de leurs familles, montrent clairement que les violences sexuelles n’étaient pas un simple bruit de fond de la guerre, mais bien le point de rupture qui les a poussées à prendre la route. Comme nous l’a confié une femme, les violences sexuelles qu’elle redoutait ont incité sa famille à migrer vers le Soudan du Sud :
« Mon mari a été emmené par les Forces de Soutien rapide et j’ai été poignardée lorsque j’ai refusé d’être violée par ces hommes. J’en garde encore la cicatrice. Je suis venue ici [au Soudan du Sud] pour changer de vie. »
Dans le camp provisoire d’Aweil Nord, Kiir Adem, conçu comme un refuge temporaire, où des gens pouvaient passer quelque temps avant leur réinstallation ailleurs par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’équipe a découvert des conditions choquantes. De nombreuses personnes y vivaient depuis trois mois ou plus. Certaines avaient été enregistrées comme réfugiés ou rapatriés, d’autres non. Toutes luttaient pour survivre sans nourriture ni abri adéquats, et sans accès aux soins de santé dont elles avaient désespérément besoin.
Chandiru Drama a constaté :
« En raison des pillages et des vols généralisés tout au long du voyage, d’innombrables personnes sont arrivées à destination dépouillées de l’essentiel : sans nourriture, sans vêtements, sans provisions. »
La réalité de l’autre côté de la frontière
Après avoir traversé la frontière pour rejoindre la relative sécurité du Soudan du Sud, les rapatriés et les réfugiés ont été confrontés à une nouvelle série de difficultés : manque d’infrastructures, accès limité aux soins médicaux et insuffisance de l’aide humanitaire en termes de provisions.
Contrairement aux centres d’accueil mieux dotés situés ailleurs le long de la frontière, Kiir Adem ne disposait que de peu de moyens d’aide. Le centre de santé le plus proche se trouvait à plus de deux heures de route en voiture, un trajet souvent impossible à parcourir pour des femmes et des filles épuisées, blessées et dépouillées de tout leur argent et de toutes leurs provisions. Une femme nous a confié :
« Il m’a fallu six jours pour atteindre la frontière du Soudan du Sud. À la frontière, j’ai signalé le viol, mais je n’ai reçu aucun traitement. Les agents de l’OIM m’ont orientée vers des établissements de santé à Gok Marchar, à environ 50 kilomètres, mais c’était trop loin pour que je puisse m’y rendre et je n’avais pas d’argent pour le transport. »
Il est essentiel que les victimes de viol reçoivent dès que possible après l’agression des traitements prophylactiques et d’autres soins de santé sexuelle et reproductive d’urgence. Certaines participantes ont décrit des blessures physiques dévastatrices résultant de violences sexuelles, tandis que d’autres étaient enceintes au moment du viol ou sont tombées enceintes à la suite de celui-ci. Dans ces cas, l’absence de soins médicaux peut avoir des conséquences désastreuses.
Dans de nombreux cas, les rapatriés ont dû construire eux-mêmes des abris de fortune et chercher de la nourriture dans les forêts. La région était sujette aux inondations, et les chercheurs devaient patauger dans l’eau pour atteindre les populations. Une femme a déclaré :
« Je me suis rendue au Soudan du Sud en avril 2024 avec mes deux enfants. Je me retrouve aujourd’hui bloquée ici avec eux, car mon mari s’est enfui lorsque les Arabes ont commencé à agresser sexuellement les femmes de manière effrénée […]. Je ne sais pas s’il est encore en vie. Deux autres filles ont également été enlevées pendant notre migration vers le Soudan du Sud. Je vis désormais dans un camp de rapatriés, où je dors dans une hutte au toit de chaume, sous une pluie battante, sans tente ni nourriture. »
Lorsqu’on leur a demandé à quelle fréquence elles avaient du mal à joindre les deux bouts, plus de 80 % des femmes et des filles ont répondu « tout le temps ou la plupart du temps ». Des lieux d’habitation informels, comme celui où nous avons recueilli des données, se sont développés le long de la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud.
La porosité de la frontière, les déplacements réguliers à travers celle-ci en période de paix relative et les difficultés d’accès aux points de passage officiels rendent presque impossible l’acheminement efficace des personnes déplacées vers des points de passage officiels et vers des camps relativement bien équipés. Il est urgent d’améliorer les services dans la région frontalière, notamment les transports vers les camps officiels et les soins médicaux, afin de répondre aux immenses besoins des rapatriés, où qu’ils se trouvent.
La nécessité d’une réponse urgente
Il faut désormais réorienter l’action humanitaire, qui doit passer d’une prestation de services réactive à des stratégies de protection proactives centrées sur les survivants. Par exemple, les ONG devraient multiplier leurs activités le long des routes migratoires connues et des frontières, et les gouvernements donateurs devraient augmenter leur financement de l’aide humanitaire. La mission de maintien de la paix des Nations unies pourrait également renforcer la protection des activités civiles dans les régions frontalières du Soudan du Sud, en partenariat avec les organisations de la société civile sud-soudanaise.
La violence sexuelle n’est pas simplement un dommage collatéral de la guerre au Soudan. Pour de nombreuses filles et leurs familles, elle est la principale cause de leur fuite. La menace omniprésente d’enlèvement et de viol est un facteur clé de la migration, déterminant qui fuit, quand ils fuient, et contraignant les femmes et les filles à prendre des risques inimaginables pour avoir une chance de trouver la sécurité au Soudan du Sud.
Depuis notre collecte de données à l’été 2024, la situation au Soudan ne s’est pas améliorée et le contexte sécuritaire au Soudan du Sud s’est détérioré. Au sud de la frontière, l’intensification des conflits entre les groupes armés ethniques et la montée des tensions politiques entre le président Salva Kiir et le premier vice-président Riek Machar, notamment l’assignation à résidence puis le procès pour trahison de Machar, ont attisé les craintes d’un possible retour à la guerre au Soudan du Sud.
Conjuguée à des pressions économiques accrues et aux répercussions de la guerre au Soudan, la situation politique et sécuritaire du Soudan du Sud est de plus en plus précaire. Le risque de retour à la guerre au Soudan du Sud rend d’autant plus urgente la réinstallation des rapatriés et la satisfaction de leurs besoins immédiats. Les risques d’intensification du conflit et de la violence auront un impact disproportionné sur les personnes déjà déplacées et vulnérables. Le personnel des ONG ayant une formation juridique pourrait apporter son aide en faisant avancer les enquêtes criminelles, dont les conclusions pourraient à leur tour avoir un impact sur la façon dont les ONG travaillent sur le terrain.
Le droit international a également été très lent à réagir. Ce n’est qu’en octobre de cette année que les juges de la Cour pénale internationale ont prononcé la première condamnation pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis au Darfour en 2003 et 2004. Les victimes et les survivants de la guerre actuelle ne devraient pas avoir à attendre plus de 20 ans pour que justice soit faite.
La communauté internationale devrait collaborer avec les organisations de femmes, les avocats soudanais et sud-soudanais et les défenseurs des droits humains afin de faire progresser la justice dès maintenant, par tous les moyens possibles.
Cela pourrait inclure des enquêtes centrées sur les survivants et la collecte de preuves, des initiatives de justice communautaire et des espaces sûrs où les survivantes pourraient commencer leur processus de guérison.
Les organisations de la société civile dirigées par des femmes sont bien placées pour répondre aux besoins immédiats des femmes et des filles, mais elles ont besoin d’aide. Les coupes budgétaires ont durement touché ces organisations à travers le monde, et beaucoup d’entre elles risquent de fermer leurs portes.
Chandiru Drama insiste :
« Si les organisations de la société civile veulent continuer à accomplir leur travail vital, elles doivent bénéficier d’un financement à la hauteur de leur tâche. Il ne s’agit pas seulement d’une question de financement, mais aussi d’une question de justice […]. Car face à une violence inimaginable, ces groupes ne sont pas seulement des prestataires de services, ils sont des bouées de sauvetage. »
Les femmes et les filles que nous avons rencontrées ont été claires : ce sont les violences sexuelles qui les ont poussées à fuir. Pour qu’elles puissent enfin cesser de fuir, une réponse urgente s’impose : la réinstallation, l’aide humanitaire et la justice doivent être prioritaires.
Sabine Lee a reçu des financements des programmes de recherche XCEPT Cross-Border Research et du Cross-Border Conflict Evidence, Policy and Trends (XCEPT), qui ont financé les recherches décrites dans le présent document.
Heather Tasker a reçu des financements du Social Science and Humanities Research Council (SSHRC), de l’International Development Research Council (IDRC), et des programmes de recherche XCEPT Cross-Border Research et Cross-Border Conflict Evidence, Policy and Trends. XCEPT a financé les recherches décrites dans le présent document.
Susan Bartels a reçu des financements ud programme de recherche Cross-Border Conflict Evidence, Policy and Trends (XCEPT), qui a financé les recherches présentées dans cet article. Elle reçoit également des financements du Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) et des Canadian Institutes of Health Research (CIHR).
30.11.2025 à 20:37
En Afrique de l’Ouest, les services de prise en charge du VIH sous pression après la baisse des financements états-uniens
Sophie Desmonde, Chargé de Recheche Inserm (CRCN) en santé publique - Centre d'Epidémiologie et de Recherche en santé des POPulations (CERPOP), Inserm UMR 1295, Université de Toulouse, Inserm
Antoine Jaquet, Chercheur, Université de Bordeaux
Kiswend-Sida Thierry Tiendrebeogo, Médecin épidémiologiste et coordinateur IeDEA Afrique de l'ouest, Université de Bordeaux
Valériane Leroy, Research Director
Texte intégral (1923 mots)
Réorganisations voire interruptions d’activités de soins, difficultés à assurer la continuité des traitements par antirétroviraux, stress pour les équipes soignantes et les malades… les conséquences de la réduction des fonds alloués à la lutte contre le VIH par l’administration Trump 2 se font déjà sentir. C’est ce que révèle une étude menée au sein de sites de prise en charge d’enfants et d’adultes vivant avec le VIH, répartis dans sept pays d’Afrique de l’Ouest. Nous dévoilons ses résultats en primeur, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida du 1er décembre 2025.
Depuis janvier 2025, le gouvernement des États-Unis d’Amérique a changé ses priorités en matière de santé. Cela s’est traduit par une réduction brutale de l’aide internationale fournie par le « Plan présidentiel américain d’aide d’urgence à la lutte contre le sida » (PEPFAR), programme clé du renforcement des systèmes de santé dans la lutte contre le VIH, ainsi que le démantèlement de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), qui était le principal bailleur de fonds américain pour l’aide sanitaire à l’échelle mondiale.
L’apport de ces programmes a été largement démontré et a sauvé des vies. En Afrique de l’Ouest, une partie importante des programmes de prise en charge du VIH dépend de ces soutiens.
Une enquête auprès de sites pour adultes et enfants, dans sept pays d’Afrique de l’Ouest
Pour mieux comprendre l’impact direct de ces coupes budgétaires, nous avons mené une étude descriptive détaillant l’organisation administrative, les ressources humaines, la distribution des traitements antirétroviraux, le suivi virologique, et le vécu au quotidien des patientes, des patients et des équipes soignantes de 13 sites cliniques adultes et enfants participant à la collaboration de recherche International Epidemiologic Database to Evaluate AIDS in West Africa. Ces résultats ont été acceptés en communication orale à la 9e édition des Rencontres des études africaines en France.
En 2024, l’Afrique de l’Ouest et du Centre comptait plus de 5 millions de personnes vivant avec le VIH, dont 37 % d’enfants. Face à la dette publique, la région n’a que peu de marge budgétaire pour financer les services de santé et de lutte contre le VIH. Il en résulte une forte dépendance aux financements extérieurs, en particulier au « Plan présidentiel américain d’aide d’urgence à la lutte contre le sida » (PEPFAR) qui contribue à garantir la disponibilité des médicaments antirétroviraux, indispensables à la survie des personnes vivant avec le VIH.
De plus, les ONG et associations locales, majoritairement financées pour leur part par l’agence USAID, ont un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH en apportant un soutien logistique et humain. Pour mieux comprendre les conséquences à court terme de cette nouvelle situation de rupture budgétaire, et comment les équipes soignantes et les malades s’y adaptent, nous avons mené une enquête dans 13 sites cliniques répartis dans sept pays d’Afrique de l’Ouest, avec lesquels nous collaborons depuis vingt ans dans le cadre de nos recherches sur le VIH au Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Nigeria et Togo. Ces sites suivent chacun en médiane plus de 3 000 malades adultes et enfants chaque année.
Entre avril et mai 2025, un questionnaire en ligne a été transmis aux responsables de sites. Le questionnaire comportait cinq volets : organisation du partenariat avec les bailleurs, ressources humaines, distribution des médicaments antirétroviraux, suivi de la charge virale, et ressenti des malades et des équipes soignantes vis-à-vis de la prise en charge globale.
Interruptions de soins communautaires, licenciements et autres impacts de la baisse des financements
Au total, 10 des 13 sites contactés ont complété le questionnaire. Parmi eux, cinq étaient directement financés par le plan PEPFAR et les autres par des ONG soutenues par l’agence USAID. La moitié des sites avaient déjà reçu des consignes de leur gouvernement pour adapter leurs activités en mode dégradé, démontrant une capacité de réponse rapide de la part des programmes nationaux de lutte contre le VIH.
Six sites sur dix ont dû suspendre ou supprimer des postes, touchant aussi bien des médecins que du personnel infirmier ou des conseillers techniques. Dans l’un des centres, une réduction de 25 % des primes a été décidée pour éviter des licenciements. Comme ces primes constituent l’essentiel du revenu pour les emplois associatifs, cette mesure a entraîné la démission de quatre médiateurs.
Dans un autre site, toutes les activités communautaires (groupes de soutien, séances d’éducation, conseil, dépistage) ont dû être interrompues entraînant le licenciement des personnes impliquées. Or ces activités jouent un rôle central dans la prise en charge du VIH : elles aident les malades à suivre leur traitement, assurent le suivi et renforcent le lien entre les équipes de soins et les communautés. Leur suspension fragilise l’accompagnement des personnes vivant avec le VIH.
À lire aussi : L’éducation par les pairs dans la lutte contre le VIH menacée par les réductions de l’aide publique au développement
À la suite de ces suspensions et licenciements, les sites ont été obligés de revoir leur organisation. Ainsi ils ont mis en place des astreintes pour le personnel fonctionnaire, redéployé le personnel hospitalier, et redistribué les tâches afin d’éviter le surmenage du personnel soignant encore en poste, tout en assurant la continuité des soins VIH. En conséquence, s’ajoutent à la suspension des activités communautaires, des temps d’attente en salle de consultation rallongés, avec un impact direct sur la qualité globale de la prise en charge des patients.
La continuité du traitement à vie par antirétroviraux mise à mal
Dans huit des dix sites, tous les antirétroviraux restaient disponibles mais n’étaient plus délivrés pour une durée de six mois selon le calendrier habituel, mais seulement pour des périodes allant d’un à trois mois, ce qui a augmenté la fréquence des visites et la charge de travail pour les équipes comme pour les patientes et patients. Dans deux autres sites, des ruptures de stock déjà présentes avant les coupes budgétaires, persistaient et concernaient plusieurs antirétroviraux utilisés chez l’adulte.
Dans un centre, une situation particulièrement préoccupante et non éthique a été signalée : comme les contrats nationaux avec le plan PEPFAR imposent de garantir la continuité des soins à vie pour les personnes déjà sous traitement antirétroviral, les équipes ont eu pour instruction de prioriser ces malades en raison du risque de pénurie, et de ne pas commencer le traitement antirétroviral chez les adultes nouvellement diagnostiqués comme infectés par le VIH, contrairement aux recommandations universelles qui préconisent de tester et de traiter.
Cinq sites ont indiqué qu’il leur manquait des réactifs indispensables pour faire les tests de charge virale. Plusieurs sites ont reprogrammé les mesures de charge virale, alors que d’autres ont dû les faire réaliser par d’autres plateformes. Or, le suivi de la charge virale est un indicateur clé de la prise en charge du VIH : il permet de vérifier l’efficacité du traitement, de détecter les échecs thérapeutiques et de réduire le risque de transmission. Ces interruptions ou retards ont fragilisé le suivi clinique des patients les exposant à un risque accru de complications.
Trois sites ont rapporté une augmentation des interruptions de traitement ou des abandons de la part des patientes ou patients alors que deux sites n’ont pas constaté d’impact notable au moment de l’enquête.
Augmentation du stress et baisse de la satisfaction professionnelle
Ailleurs, les cliniciens ont observé une montée de l’anxiété des malades, liée à l’incertitude sur la disponibilité future des médicaments, de la frustration face aux examens retardés ou impossibles à réaliser, et la crainte que le traitement devienne moins efficace. Certains malades s’inquiètent de « ce qu’il adviendra si les financements américains s’arrêtent complètement ».
Dans les sites pédiatriques, les équipes rapportent un stress accru chez les enfants, lié notamment à l’arrêt de certaines activités récréatives qui jouaient un rôle important dans leur accompagnement.
Six sites sur dix rapportent un impact direct sur leurs équipes soignantes, avec un sentiment d’impuissance face aux restrictions, une baisse de la satisfaction professionnelle, et une augmentation du stress, notamment face à l’agressivité des malades dans ce contexte d’incertitude.
Et se profile un désengagement des pays donateurs au Fonds mondial de lutte contre le sida
Ces mesures documentent l’impact à court terme des réductions de financement dans un contexte géopolitique évolutif, et montrent que la dépendance aux financements extérieurs fragilise la continuité des soins.
D’autres pays, dont la France, ont déjà annoncé qu’ils allaient diminuer leur aide internationale, réduisant ainsi leurs engagements au profit du Fonds mondial de lutte contre le VIH.
À lire aussi : La France, championne de la lutte mondiale contre le VIH/sida ? Retour sur 40 ans de diplomatie face à la pandémie
Les conséquences à long terme pour les personnes vivant avec le VIH sont malheureusement déjà prévisibles, mais nous devrons les documenter en tenant compte de la résilience des systèmes de santé face à un tel événement.
Sophie Desmonde a reçu des financements de l'ANRS-MIE, Sidaction, et NICHD
Antoine Jaquet a reçu des financements de l'ANRS-MIE et des NIH.
Kiswend-Sida Thierry Tiendrebeogo a reçu des financements de l'ANRS-MIE.
Valériane Leroy a reçu des financements de l'ANRS-MIE, Expertise France, Sidaction, Europe-EDCTP, NICHD, UNITAID.
30.11.2025 à 15:27
Droits de douane américains : en attente d’une décision historique de la Cour suprême
Antoine Bouët, Directeur, CEPII
Texte intégral (1965 mots)
Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier 2025, Donald Trump ne cesse de jouer des droits de douane afin d’obtenir les conditions les plus avantageuses possible pour les États-Unis dans leurs rapports commerciaux avec leurs nombreux partenaires. Mais le président dispose-t-il réellement de telles prérogatives ? La plus haute juridiction du pays, la Cour suprême, va devoir trancher. Et contrairement à ce qu’on croit souvent, bien que sa composition penche nettement à droite, elle ne va pas nécessairement aller dans le sens de la présidence…
Parmi tous les droits de douane appliqués par l’administration Trump depuis le début de l’année, une bonne partie ont été promulgués par décret présidentiel au nom de la loi des pouvoirs économiques liés à une urgence internationale (IEEPA, pour International Emergency Economic Power Act). Ce sont les droits de douane imposés en février sur le Canada, la Chine et le Mexique pour que ces pays fassent davantage d’efforts pour arrêter le trafic de fentanyl et le flux de migrants illégaux (« trafficking tariffs »), mais aussi les tarifs « réciproques » annoncés le 2 avril 2025 sur la pelouse de la Maison Blanche pour combattre les déficits commerciaux « inéquitables » que les États-Unis enregistrent avec certains de leurs partenaires.
Si ces décisions ont provoqué la stupeur et l’indignation dans de nombreux pays, un certain nombre d’entreprises et de secteurs d’activité aux États-Unis ont aussi réagi en déposant plainte auprès de juridictions inférieures sur l’utilisation de l’IEEPA par le président des États-Unis pour imposer des droits de douane.
La Cour suprême, acquise à Trump ? Pas si sûr…
L’IEEPA est une loi fédérale américaine autorisant le président à réguler le commerce après avoir déclaré l’état d’urgence nationale en réponse à toute menace inhabituelle et extraordinaire pesant sur les États-Unis et provenant d’une source étrangère.
Ce printemps, la Cour du district de Columbia et la Cour internationale du commerce ont conclu que cette utilisation de l’IEEPA n’était pas constitutionnelle. Elles ont cependant permis que les droits de douane en question continuent d’être appliqués, tout en faisant, à la demande de l’administration Trump, appel à un jugement de la Cour suprême des États-Unis. Celle-ci a procédé à une audition des plaignants et d’un certain nombre de personnalités de l’administration le 5 novembre 2025.
La Cour suprême va-t-elle remettre en cause les droits de douane imposés par Donald Trump au nom de l’IEEPA ?
Sachant qu’elle est composée de six juges réputés républicains (dont trois nommés par Donald Trump durant son premier mandat) et de trois démocrates, on pourrait penser que la réponse sera négative. Cependant, une majorité républicaine parmi les juges n’est pas la garantie d’une décision favorable à Donald Trump, et il semble aujourd’hui possible que la Cour suprême déclare ces droits de douane illégaux. Les arguments juridiques en faveur d’une telle décision sont solides.
Que disent les textes en vigueur ?
Aux États-Unis, comme dans de nombreux pays, c’est le Congrès qui a le pouvoir de décider des taxes. Et les droits de douane en sont. L’article 1 section 7 de la Constitution stipule que tout projet de loi comportant une levée d’impôt doit émaner de la Chambre des représentants, avec possibilité d’amendement par le Sénat.
Le terme de « droit de douane » (tariff) n’est pas contenu dans le texte de l’IEEPA. Celui-ci mentionne soit une régulation, soit un gel d’actifs ou une confiscation de propriété, soit un blocage de transactions. L’IEEPA a d’ailleurs été utilisé pour imposer des sanctions internationales à des individus ou des nations : par exemple, le gel des actifs financiers et immobiliers de personnes ayant gêné les efforts de stabilisation politique et la reconstruction en Irak en 2007 ou la prohibition d’importation de diamants bruts de Sierra Leone en 2001. Un droit de douane peut-il être considéré comme une régulation ? Si tel était le cas, alors toutes les agences en charge d’une régulation pourraient imposer des taxes.
Ensuite, il est difficile de considérer que le déficit commercial de biens des États-Unis constitue une urgence internationale, sachant que cette situation prévaut depuis 1975 et qu’un excédent substantiel est dégagé dans les services.
Enfin et surtout peut-être, les membres républicains de la Cour suprême se sont, ces dernières années, prononcés en faveur de la doctrine des « questions majeures » qui spécifie que lorsque le Congrès délègue une autorité sur une question majeure, il ne peut le faire qu’à condition d’énoncer clairement les conditions de cette délégation, c’est-à-dire les limites et les principes de son application. Or cela n’a pas été fait pour les droits de douane.
Bien sûr, la Cour suprême n’a jamais utilisé cet argument contre un président républicain, mais la doctrine des « questions majeures » est une doctrine républicaine ! Et, lors des premières auditions, les juges de la Cour suprême – notamment trois juges républicains, à savoir Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch et le président de la Cour John Roberts – sont apparus soucieux de ne pas concéder un pouvoir trop important au président, soucieux aussi de l’incertitude créée par la politique commerciale de Donald Trump.
Les deux options possibles
Bien qu’il soit difficile d’anticiper le verdict de la Cour suprême, examinons les conséquences qu’auraient les deux réponses possibles.
Si la Cour suprême désavoue l’administration Trump, alors l’administration pourra chercher d’autres outils législatifs pour imposer ses droits de douane.
La première solution serait de faire voter une loi sur le commerce (Trade Act) par le Congrès américain. Mais ce processus est long. En novembre 2026, la Chambre des représentants sera renouvelée dans son intégralité, le Sénat au tiers. Un an, c’est peu de temps pour faire passer une telle loi. En outre, il y a de plus en plus d’opposition, y compris parmi les républicains, aux mesures protectionnistes. Quatre sénateurs républicains se sont en 2025 alliés plusieurs fois aux démocrates pour adopter une résolution annulant des tarifs de Donald Trump. Et si cette résolution n’a pas eu force de loi, cela montre tout de même qu’un projet de loi protectionniste pourrait être refusé par le Sénat.
Les sections 232 et 301 des Trade Acts, respectivement de 1962 et 1974, attribuent au président le pouvoir d’imposer des droits de douane pour, respectivement, un objectif de sécurité nationale et en réponse à des pratiques déloyales. Mais l’application de ces droits doit être précédée d’une enquête du département du Commerce, enquête qui peut être longue. Et les droits de douane doivent concerner des secteurs spécifiques, alors que ceux mis en place au titre de l’IEEPA taxent tous les biens. Toutefois, les avantages de ces sections sont qu’elles n’incluent aucune limite de temps d’imposition ou de niveau de taxe.
La section 122 du Trade Act de 1974 donne le pouvoir au président d’imposer des droits pour corriger un problème « majeur et sérieux » de déficit de la balance des paiements. Mais ces droits ne doivent pas dépasser 15 % et 150 jours, et sont soumis à l’autorisation préalable du Congrès.
La section 338 du Trade Act de 1930 autorise le président des États-Unis à imposer des droits de douane sur des pays qui ont pris des mesures déraisonnables ou discriminatoires à l’encontre des États-Unis. Le rapport du US Trade Representative publié en début d’année, « 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers », pourrait fournir toute la matière nécessaire. Deux contraintes rendent cette option un peu moins intéressante que l’IEEPA : le droit maximum est de 50 % et la collecte de droits ne peut commencer que 30 jours après la publication du décret exécutif. Par rapport aux autres options, ce pourrait toutefois être l’outil législatif que l’administration Trump utiliserait en cas d’invalidation par la Cour suprême de l’utilisation de l’IEEPA.
Néanmoins, ce serait un désaveu pour l’administration Trump, qui pourrait, en plus, avoir à rembourser les recettes douanières perçues en 2025 au titre de l’IEEPA, soit 140 milliards de dollars (0,5 % du PIB), selon une estimation de la banque d’investissement Piper Sandler. La suspension des tarifs de l’IEEPA pourrait aussi remettre en cause les « deals » négociés depuis août avec de nombreux pays, dont l’Union européenne, puisque les négociations se sont appuyées sur ce texte.
Si, en revanche, la Cour suprême confirme l’administration dans son utilisation de l’IEEPA, cela créera évidemment un précédent dont l’importance ne peut être minorée. À l’avenir, sans rendre le moindre compte au Congrès américain et sans limites, le président des États-Unis pourra taxer des produits importés « en réponse à toute menace inhabituelle et extraordinaire ».
La décision que va rendre la Cour suprême sera véritablement historique ! Il faudra attendre la fin de l’année 2025 ou le début de 2026 pour la connaître.
Antoine Bouët ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
27.11.2025 à 17:08
Négociations sur l’Ukraine : le scandale Witkoff, fausses révélations et vrai symptôme
Cyrille Bret, Géopoliticien, Sciences Po
Texte intégral (2189 mots)
Alors que l’administration Trump a récemment présenté un plan en 28 points sur l’Ukraine, très favorable aux intérêts de Moscou, on vient d’apprendre que, le mois dernier, le conseiller du président des États-Unis Steve Witkoff avait affiché lors d’une conversation téléphonique avec un conseiller de Vladimir Poutine une grande proximité à l’égard de la position du Kremlin. Ces fuites ont suscité un scandale artificiel : en écoutant cet échange de quelques minutes, on n’a rien appris que l’on ne savait déjà sur la posture réelle de l’administration Trump… laquelle demeure pourtant, qu’on le veuille ou non, le seul véritable médiateur entre Moscou et Kiev.
Que de bruit autour de demi-révélations et de secrets éventés ! Que d’émois autour du « scandale Witkoff » !
Et que de commentaires indignés suscités par la retranscription intégrale, publiée par Bloomberg le 26 novembre, de la conversation téléphonique entre l’envoyé spécial du président Trump, Steve Witkoff, et le conseiller diplomatique du président Poutine, Iouri Ouchakov, le 14 octobre dernier !
Aux États-Unis comme en Europe, on crie à la trahison de l’Ukraine. On met en cause l’honnêteté du magnat de l’immobilier, ami proche de Donald Trump. Et on met en question sa capacité à mener une médiation entre Moscou et Kiev.
Que les propos échangés ne soient pas à l’honneur du milliardaire américain, on peut en convenir. Que sa connivence surjouée avec un membre éminent de l’administration présidentielle russe choque, c’est l’évidence.
Mais invoquer ces fuites comme autant de raisons pour récuser Witkoff comme émissaire atteste d’une naïveté idéaliste qui n’a pas sa place dans la géopolitique contemporaine de l’Europe. Et qui, paradoxalement, dessert la cause ukrainienne.
Fausses confidences et évidences usées
Quelles sont ces prétendues révélations que les opinions publiques occidentales feignent de découvrir ? Quels secrets ces propos livrent-ils ? Et quels mystères ces fuites mettent-elles à jour ?
Le négociateur américain cultive une familiarité avec la Russie, entretient la flagornerie à l’égard du Kremlin, développe des relations d’affaires avec des businessmen proches de lui et affiche sa condescendance pour les Ukrainiens comme pour les Européens. II suggère à son interlocuteur de demander à Vladimir Poutine de flatter l’ego légendaire de l’actuel locataire de la Maison Blanche. Et il accepte la proposition d’Ouchakov quand celui-ci dit vouloir organiser un entretien téléphonique entre les deux présidents avant la visite à Washington de Volodymyr Zelensky, qui allait avoir lieu deux jours plus tard.
La belle affaire ! Ces secrets sont de notoriété publique, et ces fuites, bien inutiles.
Toutes les déclarations publiques de l’univers MAGA le proclament urbi et orbi, autrement dit sur les réseaux sociaux : l’administration Trump veut se débarrasser de la guerre en Ukraine à tout prix, établir des coopérations fructueuses avec la Russie, tenir les Ukrainiens comme les Européens sous la pression et régler le conflit à son seul profit. Elle professe depuis longtemps une admiration non feinte pour le style de gouvernement Poutine. À l’est, rien de nouveau !
L’entourage de Donald Trump ne veut éviter ni les conflits d’intérêts, ni la servilité envers les chefs, ni l’intrigue, ni même de prendre des décisions concernant des États souverains sans consulter leurs autorités légales. Ses représentants officiels, du vice-président J. D. Vance au secrétaire d’État Marco Rubio, ont déjà montré, dans la guerre en Ukraine comme dans le conflit à Gaza, ce qu’était « la paix selon Trump » : un accord précaire, court-termiste et publicitaire. Le succès personnel, rapide et médiatisable compte bien plus que le règlement durable des conflits. Là encore, rien de nouveau sous le soleil de Bloomberg.
Comme on dit en anglais : « Old news ! » Autrement dit, le scoop est éventé depuis longtemps.
Le monopole américain du dialogue avec la Russie
Les critiques formulées à l’égard de Witkoff par les démocrates et les républicains classiques, comme par les Européens, sont sans doute causées par une indignation sincère. Mais, au fond, elles attestent d’une ignorance coupable à l’égard du rapport de force géopolitique actuel en Europe. Et de la nature d’une médiation internationale.
Peut-on crier à la déloyauté quand un médiateur établit une proximité personnelle avec ses interlocuteurs désignés ? Doit-on s’indigner qu’il ait intégré dans son équation des revendications de la partie adverse, comme base de discussion ? Là encore, ces protestations – certes moralement légitimes – ne tiennent pas compte de la réalité du travail de la médiation américaine concernant l’Ukraine.
En rejetant le rôle de protecteur de l’Ukraine et en endossant celui de médiateur, les États-Unis ont rempli la fonction laissée orpheline par les Européens. À tort ou à raison, ceux-ci ont estimé que la défense de l’Ukraine exigeait de couper les canaux de communication avec la Russie. C’est une réalité dérangeante : un médiateur a précisément ce rôle ambigu de dialoguer avec les deux ennemis, l’agresseur et la victime. Il doit réaliser une opération quasi alchimique, transformer les ennemis en interlocuteurs.
Que le plan en 28 points de l’équipe Trump soit profondément favorable aux intérêts russes, c’est l’évidence.
Mais on ne peut pas non plus nier le fait que seul l’entourage du président américain est aujourd’hui en position géopolitique de parler aux deux parties, de leur proposer des documents de travail, d’exercer sur les deux la pression nécessaire à l’ouverture de discussions et ainsi d’esquisser les conditions d’une fragile suspension des combats, dont, répétons-le, les Ukrainiens sont les victimes sur leur propre territoire.
Aujourd’hui, volens nolens, l’équipe Trump a pris le monopole de la discussion avec la Russie et avec l’Ukraine. Les Européens sont (provisoirement) réduits à se faire les avocats de l’Ukraine à l’égard des États-Unis, pas vis-à-vis de la Russie.
Les négociations internationales selon Donald Trump
La discussion entre Witkoff et Ouchakov atteste de l’amateurisme diplomatique du premier et de l’habileté tactique du second, du moins durant ces quelques minutes. La fuite à l’origine de la retranscription souligne que la méthode Trump ne fait pas l’unanimité aux États-Unis et que certains essaient d’entraver la politique que l’administration actuelle met en œuvre.
Mais ce faux scoop doit servir d’alerte aux Européens. Les règles du jeu diplomatique sont bouleversées par le conflit en Ukraine car celui-ci est bloqué : la paix par la victoire militaire de l’une ou de l’autre partie est impossible ; la reconquête par Kiev des territoires illégalement occupés et annexés par Moscou est plus qu’incertaine ; quant aux négociations directes entre belligérants, elles semblent irréalistes. Pour sortir (même provisoirement) du cycle des offensives et contre-offensives et pour donner à l’Ukraine le répit dont elle a besoin, les outils classiques sont momentanément inopérants.
L’administration Trump, dans son style fait de compromissions, de provocations, de revirements, de vulgarité et de coups de pression, essaie de sortir de l’impasse. C’est sur ce point que les révélations Witkoff sont éclairantes : la lutte existentielle de l’Ukraine peut soit se prolonger dans une guerre sans fin, soit être suspendue par une diplomatie non orthodoxe qui choquera moralement les consciences au nom des résultats espérés. Ceux-ci sont bien incertains : ils peuvent être ruinés en un instant par un dédit du Kremlin, par un succès militaire tactique d’un des deux ennemis ou encore par un nouveau scandale en Ukraine.
Quand la victoire paraît hors de portée, quand les négociations sont impensables et quand la paix paraît impossible, comment récuser la seule médiation actuellement possible, aussi biaisée soit-elle ? Quand la paix est lointaine et la négociation impensable, les méthodes non orthodoxes sont nécessaires pour briser le cercle indéfiniment vicieux du conflit.
Plutôt que de s’indigner d’un faux scoop, les Européens devraient le voir comme le symptôme de leur propre conformisme diplomatique. Plutôt que de réagir avec retard comme intercesseurs de l’Ukraine auprès de l’administration Trump, ils devraient innover, dans leur propre intérêt et dans celui de l’Ukraine. Reprendre directement contact avec le Kremlin, proposer un plan de paix qui ne soit pas le simple rappel du droit international, veiller à ce que la reconstruction de l’Ukraine ne se fasse pas à leurs dépens leur permettrait de s’affirmer pour ce qu’ils sont : la première puissance du continent et non pas de simples spectateurs de leur propre sécurité.
Le dilemme des Européens
L’orientation pro-russe de la médiation américaine et le « confort » stratégique de la Russie (combats et négociations lui sont favorables) placent les Européens devant un dilemme épineux.
D’un côté, ils sont devenus les seuls avocats du droit international et de la souveraineté ukrainienne alors que pour Moscou comme pour Washington, seul le rapport de force compte désormais. Mais ce rôle louable leur lie les mains et ruine par avance leur efficacité géopolitique : s’en tenir au droit international les empêche de présenter un plan de paix sous forme de compromis ; il leur interdit de rétablir des canaux de négociation directe avec le Kremlin et il les marginalise dans le rapport de force global avec la Russie comme avec les États-Unis. Et, suprême paradoxe, l’intransigeance morale et juridique de l’Europe (bien légitime) place l’Ukraine dans l’obligation — impossible à réaliser — de vaincre la Russie non seulement dans l’Est de l’Ukraine mais aussi sur le plan idéologique.
D’un autre côté, la conversion des Européens à l’« alchimie réaliste » de la médiation diplomatique entre Ukraine et Russie est en butte à plusieurs écueils : les opinions publiques occidentales sont très critiques envers la politique intérieure et l’agressivité stratégique de l’administration Poutine ; les autorités politiques et militaires hésitent à s’engager dans une voie qui paraîtrait cautionner la vision du monde selon Trump ; elles redoutent en outre, en cas d’accord de paix, la démobilisation du sursaut stratégique causé par l’invasion illégale de l’Ukraine. Enfin, elles sont embarrassées par le démantèlement même progressif et conditionnel de leur propre stratégie des sanctions.
Entre fidélité aux principes et loyauté envers l’Ukraine d’un côté et efficacité géopolitique de l’autre, la voie est étroite pour les Européens. C’est pour cette raison que des initiatives créatives, des modes non conventionnels de médiation et la volonté de peser directement sur la Russie sont indispensables. Il en va du statut des Européens sur leur propre continent : y seront-ils des spectateurs réduits à l’incantation sur les principes ou des acteurs prêts à prendre des risques pour définir eux-mêmes les rapports de force ?
Cyrille Bret ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
27.11.2025 à 17:05
Les Mémoires de l’ancien roi Juan Carlos suscitent la polémique en Espagne
Sabrina Grillo, Maîtresse de conférences en civilisation de l'Espagne contemporaine, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
Texte intégral (1692 mots)
Le livre de Juan Carlos, ancien roi d’Espagne (1975-2014), publié en France en novembre, a vu sa sortie nationale en Espagne retardée au 3 décembre 2025 afin d’éviter de perturber les commémorations officielles des cinquante ans de la mort du dictateur Franco et de la fin du franquisme. En effet, certains passages de ces Mémoires font polémique…
La polémique actuelle en Espagne, centrée sur la publication des Mémoires de l’ancien roi Juan Carlos Ier, Réconciliation, survient à un moment symbolique : le cinquantième anniversaire de la mort de Francisco Franco (20 novembre 1975) et du couronnement du monarque (22 novembre 1975), mais aussi l’anniversaire du retour de la démocratie (Constitution de 1978).
Autour du 50ᵉ anniversaire…
Le livre a été publié en France en novembre 2025 tandis que sa sortie en Espagne a été retardée au 3 décembre 2025 pour éviter de perturber les commémorations officielles, boycottées par les oppositions de droite et d’extrême droite. L’extrême gauche fustige quant à elle l’insuffisance des mesures prises par le gouvernement actuel pour réparer la mémoire des victimes.
Force est de constater que la parution des Mémoires de Juan Carlos est relayée tout autant – si ce n’est plus – que le cinquantenaire de la mort de Franco ; et de nombreux articles et podcasts traitent déjà largement du sujet.
L’ancien souverain espagnol – exilé aux Émirats arabes unis depuis 2020 à la suite de scandales financiers et personnels, et dont le fils, Felipe VI, cherchant à sauver l’institution en se distançant de son père, en lui avait notamment retiré son allocation – n’a pas été invité aux commémorations officielles.
Cette tentative de retour en grâce se heurte donc à la volonté de la Maison royale et du gouvernement de maintenir leurs distances avec l’ancien monarque, qui a abdiqué en 2014. Juan Carlos a fait part de la nécessité pour lui de délivrer « sa version de l’histoire » et entend clairement se réapproprier une histoire qui est aussi la sienne.
Une réécriture de l’histoire ?
Il s’emploie à revendiquer son héritage : le retour de la démocratie en Espagne depuis la transition qu’il assure avoir menée à bien, notamment par son rôle décisif lors de la tentative de coup d’État du 23 février 1981. Et le roi de rappeler que « la démocratie n’est pas tombée du ciel ». Ses Mémoires sont d’ailleurs peut-être une autre part de l’héritage qu’il entend laisser aux plus jeunes générations qui, parfois, méconnaissent l’histoire récente de leur pays.
Juan Carlos parle abondamment de Franco dans l’ouvrage ; c’est ce qui constitue le cœur de la polémique. Il le décrit de manière positive (respect, sens politique, affection), affirmant l’avoir « respecté » et parle de leur relation comme quasi paternelle. Il rapporte également que la dernière volonté du dictateur était de maintenir « l’unité du pays ».
Ces propos ont suscité l’indignation en Espagne où, rappelons-le, des familles recherchent encore les restes de leurs proches dans des fosses communes. Pedro Sánchez, chef du gouvernement socialiste, a déclaré qu’il lui semblait « douloureux » que Juan Carlos Ier fasse l’éloge de Franco :
« L’actuel roi émérite devrait être respectueux de la mémoire démocratique de ce pays et ne pas exalter un dictateur comme Franco. »
L’Association pour la récupération de la mémoire historique (ARMH) a demandé une sanction contre l’ancien roi pour violation de la loi de Mémoire démocratique espagnole. Son président Emilio Silva a qualifié les propos de Juan Carlos d’« intolérables ». Ce dernier peut encourir une amende s’élevant jusqu’à 150 000 euros.
Une tentative de réhabilitation dans un contexte tendu
Juan Carlos cherche manifestement sa réhabilitation après son exil, consécutif à des scandales financiers majeurs – notamment l’acceptation d’un don de 100 millions de dollars du roi d’Arabie saoudite, qu’il qualifie de « grave erreur » dans ses Mémoires – et des révélations sur sa vie privée, comme le voyage de chasse à l’éléphant au Botswana en 2012.
Selon lui, l’Espagne actuelle est fragilisée, car l’esprit de la transition – la « réconciliation » incarnée par la loi d’amnistie de 1977, que l’histoire a qualifiée de Pacte d’oubli ou de silence – s’est perdu.
L’ancien roi se positionne dans ses mémoires en défenseur de la Constitution et de la démocratie.
Cette publication intervient à un moment où les tensions mémorielles et politiques en Espagne ne sont pas résolues entre débats sur l’héritage de la dictature, la transition et l’avenir de la monarchie. Elle s’inscrit dans une conjoncture marquée par diverses fractures institutionnelles ; sociale et idéologique, autour de la légitimité du système politique issu de la transition de 1978.
L’analyse de ce contexte permet de mesurer l’écart entre la volonté de réhabilitation de l’ancien monarque et la réalité d’une société espagnole qui est divisée sur la question monarchique.
Cette publication vient contredire la stratégie de rupture institutionnelle menée par Felipe VI pour préserver la monarchie et survient au moment même où la contestation républicaine s’ancre doucement dans le calendrier social.
L’accession au trône de Felipe VI en 2014 marquait une rupture sans précédent dans l’histoire démocratique de la monarchie espagnole. Le nouveau roi héritait d’un contexte de crise multidimensionnelle : fatigue sociale après les années d’austérité consécutives à la crise économique de 2008, contestation de la légitimité monarchique portée par le mouvement des Indignés avec le slogan « Transición real, sin rey » (« Transition réelle, sans roi »), et actualité dominée par les affaires de corruption touchant directement la famille royale.
Face à cette situation critique, Felipe VI s’était assigné comme priorité de regagner la confiance des Espagnols en adoptant une posture d’austérité, de discrétion et de transparence accrue. La mesure la plus spectaculaire de cette stratégie de dissociation intervient en 2020, quand Felipe VI annonce publiquement sa renonciation à l’héritage de son père et la suppression de l’indemnité annuelle versée à Juan Carlos par les budgets de la Maison royale.
La publication des Mémoires de Juan Carlos en 2025 est donc en contradiction avec la stratégie de rupture menée par Felipe VI. Cette tentative de réhabilitation risque de remettre au centre du débat public les questions de corruption et de légitimité que la Couronne s’est efforcée de reléguer au second plan.
L’année 2025 voit la consolidation d’une contestation antimonarchique structurée dans le calendrier social espagnol. La deuxième édition de la Marcha Republicana, organisée le 15 juin 2025 à Madrid, s’impose comme la protestation antimonarchique la plus importante depuis 2014. Ce mouvement, qui a bénéficié du soutien de partis politiques, tels que Podemos, Izquierda Unida ou encore le Parti communiste espagnol, affiche un objectif explicite : faire de Felipe VI le dernier roi d’Espagne.
La Marcha Republicana del Norte, regroupant les Asturies, la Galice, la Cantabrie et le Pays basque, a par ailleurs organisé une manifestation en octobre dernier à Oviedo, en marge de la remise des Prix Princesa de Asturias, pour relancer la réflexion publique sur la place de la monarchie dans un système démocratique et prévoit de renforcer son travail commun avec la coordination nationale de la Marche républicaine.
Sabrina Grillo ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
27.11.2025 à 10:22
How Catholic women in 18th-century Italy defied sexual harassment in the confessional
Giada Pizzoni, Marie Curie Research Fellow, Department of History, European University Institute
Texte intégral (1548 mots)
The European Institute for Gender Equality defines sexual harassment as follows: “any form of unwanted verbal, non-verbal or physical conduct of a sexual nature occurs, with the purpose or effect of violating the dignity of a person, in particular when creating an intimidating, hostile, degrading, humiliating or offensive environment”. Harassment stems from power, and it is meant to control either psychologically or sexually. In both instances, victims often feel confused, alone, and uncertain about whether they caused the abuse.
As a historian, I aim to understand how women in the past experienced and tackled intimidating behaviour. Particularly, I am looking at harassment during confession in 18th-century Italy. Catholic women approached this sacrament to share doubts and hopes about subjects ranging from reproduction to menstruation, but at times were met with patronising remarks that unsettled them.
A power imbalance
The Vatican archives show us that some of the men who made these remarks dismissed them as emerging from sheer camaraderie or from curiosity, or as boastfulness, and that they belittled women who remained upset or resentful. The women were often younger, they had less power, and they could be threatened to comply. Yet, the archives also show us how some women deemed these exchanges inappropriate and stood up to such abuse.
The archives hold the records of the trials of the Inquisition tribunals, which all over the Italian peninsula handled reports of harassment and abuse in the confessional booth. For women, confession was paramount because it dictated morality. A priest’s duty was to ask women if they were abiding Christians, and a woman’s morals were bound to her sexuality. Church canons taught that sex was to be only heterosexual, genital, and within marriage. Sexuality was framed by a moral code of sin and shame, but women were active sexual agents, learning from experience and observation. The inner workings of the female body were a mystery, but sex was not. While literate men had access to medical treatises, women learned through knowledge exchanged within the family and with peers. However, beyond their neighbourhoods, some women saw the confessional box as a safe space where they could vent, question their experiences, and seek advice on the topic of sexuality. Clergymen acted as spiritual guides, semi-divine figures that could provide solace – a power imbalance that could lead to harassment and abuse.
Reporting instances of harassment
Some women who experienced abuse in the confessional reported it to the Inquisition, and those religious authorities listened. In the tribunals, notaries put down depositions and defendants were summoned. During trials, witnesses were cross-examined to corroborate their statements. Guilty convictions varied: a clergyman could be assigned fasting or spiritual exercises, suspension, exile, or the galleys (forced labour).
The archives show that in 18th-century Italy, Catholic women understood the lurid jokes, the metaphors and the allusions directed at them. In 1736 in Pisa, for example, Rosa went to her confessor for help, worried her husband did not love her, and was advised to “use her fingers on herself” to arouse his desire. She was embarrassed and reported the inappropriate exchange. Documents in the archives frequently show women were questioned if a marriage produced no children: asked if they checked whether their husbands “consumed from behind”, in the same “natural vase”, or if semen fell outside. In 1779 in Onano, Colomba reported that her confessor asked if she knew that to have a baby, her husband needed to insert his penis in her “shameful parts”. In 1739 in Siena, a childless 40-year-old woman, Lucia, was belittled as a confessor offered to check up on her, claiming women “had ovaries like hens” and that her predicament was odd, as it was enough for a woman “to pull their hat and they would get pregnant”. She reported the exchange as an improper interference into her intimate life.
Records from the confessional show examples of women being told, “I would love to make a hole in you”; seeing a priest rubbing rings up and down his fingers to mimic sex acts; and being asked the leading question if they had “taken it in their hands” – and how each of these women knew what was being insinuated. They understood that such behaviour amounted to harassment. Acts the confessor thought of as flirting – such as when a priest invited Alessandra to meet him in the vineyard in 1659 – were appalling to the women who reported the events (Vatican, Archivio Dicastero della Fede, Processi vol.42)“.
The bewildering effect of abuse
It was also a time when the stereotype of older women no longer being sexual beings was rife. Indeed, it was believed that women in their 40s or 50s were no longer physically fit for intercourse, and their sexual drive was mocked by popular literature. In 1721, Elisabetta Neri, a 29-year-old woman seeking advice about her fumi (hot flushes) that knocked her out, was told that by the time women turned 36 they no longer needed to touch themselves, but that this could help let off some steam and help with her condition.
Women were also often and repeatedly asked about pleasure: if they touched themselves when alone; if they touched other females, or boys, or even animals; if they looked at their friends’ "shameful parts” to compare who “had the largest or the tightest natura, with hair or not” (ADDF, CAUSE 1732 f.516). To women, these comments were inappropriate intrusions; to male harassers, they could be examples of titillating curiosity and advice, such as when a Franciscan friar, in 1715, dismissed intrusive comments about a woman’s sexual life (ADDF, Stanza Storica, M7 R, Trial 3)
Seeking meaningful guidance, women had entrusted these learned figures with their most intimate secrets, and they could be bewildered by the attitudes confessors often displayed. In 1633, Angiola claimed she “shivered for 3 months” after the verbal abuse (ADDF, Vol.31, Processi). The unsolicited remarks and unwanted physical touch struck them.
The courage to speak up
It is undeniable that sexuality has always been cultural, framed by moral codes and political agendas that are constantly being negotiated. Women have been endlessly policed; with their bodies and behaviour under constant scrutiny. However, history teaches us that women could be aware of their bodies and their sexual experiences. They discussed their doubts, and some stood up to harassment or abusive relationships. In the 18th century in Italy, Catholic women did not always have the language to frame abuse, but they were aware when, in the confessional, they did not experience an “honest” exchange, and at times they did not accept it. They could not prevent it, but they had the courage to act against it.
A culture of sexual abuse is hard to eradicate, but women can be vocal and achieve justice. The events of past centuries show that time was up then, as it still is now.
Author’s note: the parenthetical references in the text refer to physical records in the Vatican archives.

A weekly e-mail in English featuring expertise from scholars and researchers. It provides an introduction to the diversity of research coming out of the continent and considers some of the key issues facing European countries. Get the newsletter!
Giada Pizzoni has received a Marie Skłodowska-Curie Fellowship from the European Commission.
26.11.2025 à 16:29
Ce que l’univers de la mode nous dit de la Russie en 2025
Polina Talanova, Doctorante en marketing de la mode, IAE Paris – Sorbonne Business School; Institut Français de la Mode (IFM)
Texte intégral (2196 mots)
Le secteur de la mode a été profondément affecté par les sanctions décrétées à l’encontre de la Russie au cours de ces dernières années. La plupart des marques occidentales ont quitté le pays, et les marques locales n’ont plus accès aux marchés occidentaux. Contournement des sanctions via le recours à des importations en passant par des pays tiers, développement des compagnies locales et arrivée sur le marché russe d’acteurs issus de pays qui y étaient auparavant peu présents : à l’instar des autres secteurs économiques, l’univers de la mode se transforme, mais le modèle occidental continue de fasciner en Russie.
En 2022, la maison Valentin Yudashkin a été exclue de la programmation de la semaine de mode parisienne. Ce créateur russe réputé, né en 1963, est décédé l’année suivante, en mai 2023.
En attendant un éventuel retour de la Russie dans la communauté des nations, la vie de la mode continue dans le pays. Avant 2022, la Fashion Week de Moscou était sponsorisée par Mercedes-Benz. Depuis trois ans, le gouvernement de Moscou a repris l’organisation d’une semaine de la mode désormais indépendante des partenaires occidentaux (dernière édition en août 2025). Par ailleurs, une Fédération internationale de la mode des BRICS+ a vu le jour, suite au sommet de Moscou de l’organisation, tenu en octobre 2024. Dans un contexte de fortes tensions, la mode devient un objet politique à part entière – bien au-delà de sa dimension artistique ou économique.
La fin d’une période dorée pour les marques occidentales en Russie
Les enseignes occidentales ont rapidement investi la Russie (auparavant fermée) lors de son ouverture démocratique dans les années 1990. Le nouveau millénaire a été marqué par une certaine forme de glamour et d’extravagance, tant dans les vêtements que dans les attitudes. C’était une époque de nouveaux riches et de paillettes à tout-va. Une époque résumée par le mot russe de perebor (« faire sonner toutes les cloches de l’église en même temps »), autrement dit l’idée d’un style qui n’hésitait pas à « en faire trop » – une esthétique que décrit la journaliste Evelina Khromtchenko en 2008 dans son ouvrage « Russian Style ».
Aujourd’hui, toute cette insouciance est bien loin. Deux exemples parmi d’autres le démontrent. Pendant l’hiver 2023, des jeunes filles en Europe occidentale et aux États-Unis ont lancé une tendance sur TikTok et Instagram, celle de la Slavic Girl, devenue rapidement très populaire. Fourrure, diamants, talons hauts et maquillage flamboyant : ce phénomène a provoqué des remous un peu partout dans le monde. Une partie des internautes y a vu la propagation d’un imaginaire russe honni.
En novembre 2022, la maison Dior a été critiquée pour avoir adopté dans une de ses campagnes une scénographie qui incorporait des éléments d’inspiration russe, présentés dans un décor de type slave avec de la neige et des bouleaux. Ces éléments ont entraîné une série de commentaires négatifs sur Instagram. Peu après, la façade d’une boutique Dior à Kiev a été recouverte de graffitis accusant la marque de soutenir la Russie.
Départs définitifs ou temporaires et contournement des sanctions
En parallèle du recul du soft power de la mode russe, l’écosystème de la mode et de l’habillement en Russie a été profondément modifié par le conflit.
Les sanctions occidentales ont entraîné le départ temporaire ou permanent de nombreuses marques internationales. Uniqlo, Marks & Spencer ou encore H&M ont complètement quitté le marché, résiliant leurs partenariats avec les franchisés et leurs baux commerciaux en Russie.
Beaucoup de marques occidentales ont vendu leurs parts russes à des entreprises locales. Le groupe Inditex (Zara) a revendu ses filiales opérationnelles russes à une société émiratie, Daher Group. Les marques ont changé de nom (Zara est devenue MAAG, Bershka est devenue Ecru, Pull&Bear est devenue DUB). Ces nouvelles boutiques ne vendent plus les produits d’Inditex, mais commercialisent désormais leurs propres lignes de vêtements, fabriquées notamment en Chine et au Pakistan.

Dans le segment du luxe, le choix des grandes marques occidentales a plutôt été de suivre une stratégie du gel que de partir complètement. Les sanctions européennes contre la Russie interdisent la vente, le transfert et l’exportation d’articles de luxe d’une valeur supérieure à 300 euros vers la Russie. « Nous vous informons que notre boutique est temporairement fermée pour des raisons techniques. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre compréhension. Nous attendons avec impatience de pouvoir vous accueillir de nouveau et restons toujours à votre disposition », peut-on lire depuis trois ans sur les vitrines des boutiques de luxe à Moscou, dont les grandes maisons européennes continuent à payer le loyer.
En outre, l’enjeu ne se limite pas au marché russe lui-même. En septembre 2025, Brunello Cucinelli a vu son action chuter de 15 % après qu’un fonds activiste spécialisé dans la vente à découvert (Morpheus Research) a publié une enquête affirmant que la marque continuait d’opérer en Russie malgré les sanctions – des allégations immédiatement contestées par la maison.
Les grands acteurs du luxe ne vendent plus rien en Russie, mais conservent leurs emplacements dans les zones commerciales les plus convoitées. La rue Stoletchnikov Pereoulok, équivalent moscovite de la rue du Faubourg Saint-Honoré, est encore remplie de boutiques Chanel, Hermès, Gucci, etc. Le soir, plusieurs s’illuminent. Dans la vitrine d’Hermès, une belle scénographie est même toujours visible.
Les autorités russes favorisent désormais les importations parallèles, permettant de vendre des produits importés sur le territoire russe sans forcément disposer de l’autorisation de la marque. Les entreprises russes s’adressent pour cela à des intermédiaires turcs, chinois, voire d’Europe de l’Est.
Certaines marques occidentales ont conservé leurs boutiques, ainsi que l’activité commerciale via des partenaires indépendants, sous licence de fabrication. Parmi elles, citons Benetton, Guess, Giorgio Armani… ou encore Cacharel Paris et Lacoste, présents dans une dizaine de boutiques ou points de vente à Moscou.
La nature a horreur du vide
De nouvelles marques arrivent également sur le marché russe. En deux ans et demi, les marques turques sont ainsi devenues les leaders parmi les nouveaux arrivants sur le marché russe, tandis que la Chine et l’Italie se partagent la deuxième place.
La décision de plusieurs grandes maisons européennes de restreindre l’accès à leurs produits pour les citoyens russes a été très mal perçue par la clientèle russe. Chanel, par exemple, a exigé auprès de certaines clientes russes de signer une déclaration attestant qu’elles n’emporteraient pas leurs achats en Russie, condition nécessaire pour finaliser la vente.
Toutefois, les plus aisés peuvent toujours contourner les sanctions grâce à des services de conciergerie. Mais la disparition de l’expérience en boutique, essentielle dans l’univers du luxe, a conduit une partie de la clientèle à se tourner vers les marques locales.
En effet, de nombreuses marques russes tirent parti du vide laissé par les enseignes occidentales. Les premières sanctions, en 2014, ont poussé les entrepreneurs et créateurs russes à prendre conscience de la nécessité de développer la production locale en substitution aux importations. En 2022, avec le départ des géants de la mode étrangère, les entrepreneurs locaux, qui ont l’avantage de bien connaître la demande de la clientèle dans leur propre pays, ont été prêts à prendre le relais. Un exemple marquant : la marque Lime connaît une expansion rapide et occupe la niche laissée par Zara, avec un chiffre d’affaires qui a triplé entre 2021 et 2023. Toutefois, les exemples de succès économiques les plus frappants concernent surtout le segment du mass market.
Quel avenir pour les marques de créateurs ?
La reconfiguration du marché a plutôt favorisé l’essor de labels qualifiés de « niches », tels que Choux, Walk of shame, Rogov, Glumkimberly, Lesyanebo, Monochrome ou Ushatava, entre autres. Avant les événements de 2022, la top-model Bella Hadid portait les ensembles de Lesyanebo, et Monochrome collaborait avec Reebok. Aujourd’hui, ces marques profitent de leur succès en Russie tout en espérant le retour du pays sur la scène mondiale. La véritable question est de savoir si ces labels seront capables de rivaliser avec les grandes maisons européennes si celles-ci reviennent un jour sur le marché russe.
Malgré le contexte actuel, les esprits russes restent tournés vers l’Occident. Les Russes continuent de considérer les diplômes internationaux, du moins dans le domaine des études de mode, comme les plus prestigieux. Et même si les Russes se sont vite adaptés à la consommation locale disponible, ils n’ont pas décidé de tourner le dos à l’Occident ni à sa culture.
Polina Talanova ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
26.11.2025 à 16:29
Le Timor-Leste rejoint l’Asean : les enjeux d’une intégration régionale
Paco Milhiet, Visiting fellow au sein de la Rajaratnam School of International Studies ( NTU-Singapour), chercheur associé à l'Institut catholique de Paris, Institut catholique de Paris (ICP)
Texte intégral (2480 mots)
L’adhésion du jeune et petit État à la grande organisation régionale est porteuse de promesses mais aussi d’incertitudes. À l’échelle internationale, le Timor-Leste restera sans doute tiraillé entre l’influence de Pékin et celle de Washington, tandis que d’autres acteurs, notamment la France, cherchent également à y développer leur présence.
Le Timor-Leste, plus jeune État d’Asie, situé à l’extrémité sud-orientale de l’archipel indonésien, à moins de 1 000 kilomètres au nord des côtes australiennes, vient de franchir une étape historique sur la voie de son intégration régionale. Le 26 octobre 2025, ce petit pays de 15 000 km2 et d’à peine 1,3 million d’habitants est devenu le onzième membre de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (Asean) – organisation fondée en 1967 qui promeut la paix, le développement économique et la stabilité régionale –, parachevant un processus d’intégration entamé il y a près de vingt ans.
Colonie portugaise pendant plus de quatre cents ans, le Timor-Leste s’engage sur la voie de l’indépendance à l’issue de la révolution des Œillets au Portugal en 1974. Une déclaration d’indépendance est proclamée le 28 novembre 1975, mais est suivie quelques jours plus tard d’une invasion de l’Indonésie (7 décembre 1975). Cette période d’occupation, qui durera vingt-quatre ans (1975-1999), sera particulièrement sanglante, causant la mort, selon certaines sources, de près de 200 000 personnes, soit environ un quart de la population. Si le pays accède finalement à l’indépendance en 2002, il porte encore les stigmates de cette tragédie et reste l’État le moins développé d’Asie du Sud-Est. Son PIB (1,63 milliard d’euros en 2023, selon la Banque mondiale) représente à peine 15 % de celui du Laos, et 40 % de la population vit sous le seuil de pauvreté.
À Dili (la capitale du Timor-Leste), l’adhésion à l’Asean est donc perçue comme une opportunité inédite de développement et d’intégration régionale. Pour l’Asean, l’arrivée de ce nouveau membre confirme le rôle central que l’association souhaite jouer dans l’architecture régionale, tout en posant de nouveaux défis, notamment économiques. Pour les acteurs de la communauté internationale, en premier lieu la Chine et les États-Unis, l’accession à une organisation régionale clé renforce l’attrait géopolitique du Timor-Leste.
Une intégration régionale gage de développement ?
« Il est plus facile d’entrer au paradis que d’intégrer l’Asean », ironisait le président (2007-2012, et de nouveau depuis 2022) et Prix Nobel de la Paix (1996) José Ramos-Horta, tant le processus d’adhésion fut long et semé d’embûches. Envisagée dès 2002, la candidature fut officiellement soumise en 2011 et mit près de quinze ans à aboutir.
L’accession tant attendue présente pour ce jeune État une opportunité de développement sans précédent, en lui ouvrant un accès préférentiel à un marché régional de près de 700 millions de consommateurs et 4 000 milliards de dollars (soit 3 500 milliards d’euros) de PIB en cumulé. En alignant ses politiques économiques et réglementaires sur les standards de l’Asean, le pays espère stimuler les réformes institutionnelles, diversifier son économie en élargissant les débouchés commerciaux, créer des emplois et faciliter les investissements étrangers.
A contrario, et même si l’Asean est loin d’être un modèle d’ensemble économique intégré (le commerce de bien intra-régional ne représente que 21 % de la totalité des échanges régionaux), l’impact des traités de libre-échange qui lient désormais le Timor-Leste risque d’exposer le secteur agricole du pays à une concurrence étrangère accrue, dans un pays où plus de 60 % de la population dépend encore d’une agriculture de subsistance.
Diplomatiquement, l’adhésion à l’Asean offre au Timor-Leste une plate-forme pour faire entendre sa voix dans les forums régionaux et internationaux, mais implique également de respecter ses règles et cadres institutionnels. Cela peut restreindre certaines prises de positions politiques. Ainsi, Dili, ouvertement critique de la junte birmane, et entretenant des liens avec le NUG (le gouvernement d’unité nationale, actuellement en exil) – ce qui avait conduit, en 2023, à l’expulsion du représentant du Timor-Leste à Naypyidaw –, a finalement rétabli des contacts officiels avec les autorités militaires du Myanmar. Une démarche nécessaire pour accéder formellement à l’Asean, mais peut-être aussi un gage de bonne volonté visant à convaincre ses voisins qu’il ne serait pas un facteur de déséquilibre régional.
À lire aussi : L’Asean face au coup d’État militaire en Birmanie : impuissance ou complicité ?
Asean : un nouveau membre et de nouveaux défis
En 1967, l’Asean réunissait initialement cinq pays fondateurs : l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande. Après Brunei en 1984, ses derniers élargissements remontaient aux années 1990 : Vietnam en 1995, Laos et Myanmar en 1997, Cambodge en 1999.
L’adhésion du Timor-Leste, dernier pays de la région non intégré à l’organisation, démontre la capacité de l’Association à prendre des décisions collectives dans une logique d’intégration et de construction régionale cohérente et unie. Mais le processus d’intégration constitue également, pour l’Asean, un défi complexe.
Micro-nation insulaire, catholique, lusophone et démocratique, le Timor-Leste ajoute une nouvelle strate à l’extrême diversité géographique, culturelle et politique qui caractérise déjà l’organisation. Fondée sur le principe du consensus et de la concertation, l’Asean peine déjà à adopter des positions communes sur des dossiers sensibles tels que la mer de Chine méridionale ou la crise au Myanmar. L’arrivée d’un nouveau membre pourrait encore complexifier l’équation.
À l’échelle bilatérale, si la politique étrangère officielle du pays vise à n’avoir « pas d’alliés, pas d’ennemis, seulement des amis », le passé douloureux de l’occupation indonésienne (1975–1999) a forcément laisse des traces, dont certaines encore visibles. En dépit d’un apaisement progressif et d’un processus de réconciliation perçu comme un modèle dans la région, des tensions entre Dili et Jakarta subsistent notamment autour de l’enclave timoraise d’Oecusse.
Les relations avec l’Australie, principal pourvoyeur d’aide publique au développement au Timor-Leste et partenaire important de l’Asean, sont également marquées par un contentieux frontalier dans la mer de Timor et le partage des revenus du gisement gazier « Greater Sunrise ». Autant de potentiels points de discorde qui pourraient mettre à mal l’harmonie de l’Asean.
Mais c’est surtout sur le plan économique que cette intégration interroge et suscite des réserves.
Le Timor-Leste présente l’un des PIB par habitant les plus faibles de la région (avant-dernier, juste devant le Myanmar), une balance commerciale structurellement déficitaire, la majeure partie des biens devant être importée et une dépendance quasi totale aux exportations d’hydrocarbures (75 % du budget de l’État), désormais en déclin.
L’intégration du petit pays risque d’élargir davantage le fossé économique entre les membres, compliquant la mise en œuvre de projets comme la Communauté économique de l’Asean, qui vise notamment à réduire les disparités. Ainsi, Singapour s’est longtemps prononcée contre l’entrée du Timor-Leste dans l’organisation. Par solidarité régionale et en reconnaissance des progrès significatifs accomplis, la cité-État a depuis changé de posture et se présente désormais comme un soutien actif, prête à accompagner le petit État dans les lourdes obligations administratives et bureaucratiques qu’implique une adhésion à l’Asean (plusieurs centaines de réunions par an).
Perspectives internationales… et françaises
À l’échelle internationale, l’accession du Timor-Leste à l’Asean devrait renforcer l’intérêt des partenaires régionaux pour ce petit pays, situé au carrefour stratégique des couloirs de navigation reliant l’Océanie à l’océan Indien. Si Dili revendique une politique étrangère de neutralité et de non-alignement, le pays n’échappe pas aux tensions régionales croissantes. Ici aussi, la rivalité sino-américaine est à l’œuvre.
La présence chinoise est bien visible, à travers la construction de nombreux édifices publics et d’infrastructures stratégiques (centrale électrique, autoroute, port en eaux profondes). Dans le cadre d’un partenariat stratégique compréhensif signé entre les deux pays en 2023, la coopération militaire a été renforcée. Les passages réguliers de navires chinois dans les détroits de Wetar et d’Ombai témoignent d’un intérêt croissant.
En réponse, Washington a intensifié sa présence diplomatique et militaire, matérialisée par un accord bilatéral signé en 2021. En sus d’une aide au développement conséquente, les efforts états-uniens portent sur la réhabilitation d’infrastructures aéroportuaires et sur une coopération opérationnelle renforcée, avec des exercices conjoints et multilatéraux. D’autres acteurs montrent également un intérêt croissant : le Japon, le Brésil, le Vatican, ainsi que l’Union européenne et plusieurs de ses États membres, dont la France.
Paris n’a certes pas d’ambassade à Dili (l’ambassadeur de France en Indonésie est néanmoins accrédité auprès des autorités est-timoraises), mais dispose d’un bureau de coopération avec un attaché sur place. Certaines entreprises françaises ont investi ou opèrent déjà dans le pays, notamment Bolloré, pour la conception, la réalisation et la maintenance du port en eaux profondes de la Baie de Tibar, ou Alcatel Submarine Network pour l’installation du câble sous-marin Timor-Leste South Submarine Cable (TLSSC).
En 2024, le président José Ramos-Horta a été reçu par Emmanuel Macron à l’Élysée, un signal politique fort au moment où le président français réaffirme ses ambitions en Asie du Sud-Est. Pour la France, le statut de partenaire de développement de l’Asean, ainsi qu’une présence souveraine dans les océans Indien et Pacifique offrent un cadre d’opportunité pour développer des coopérations ciblées : économie portuaire, résilience climatique, gestion de l’eau et de l’agriculture durable. Ces domaines correspondent à des besoins concrets et offrent des pistes de coopération civile et technique.
Enfin, la coopération de défense peut constituer un vecteur d’influence significatif. Si des liens distants existaient depuis la participation française à la Force internationale pour le Timor oriental (INTERFET, 1999-2000), les escales de bâtiments français à Dili en 2019 et en 2024 témoignent d’un intérêt réciproque plus récent. Aussi, l’armée française propose régulièrement des formations à l’armée du Timor-Leste à travers le programme de l’académie militaire du Pacifique.
Les capacités navales est-timoraises restent modestes et insuffisantes pour assurer une surveillance efficace des eaux territoriales, ce qui ouvre un champ d’assistance possible en matière de sécurité maritime, de formation ou d’assistance humanitaire. La participation du Timor-Leste aux principaux forums régionaux de sécurité – tels que l’ADMM+ et le Shangri-La Dialogue – offre à la France de nouvelles occasions de renforcer les liens bilatéraux, et in fine, de consolider sa relation avec l’Asean.
Paco Milhiet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
