05.12.2025 à 13:08
L’intelligence collective : cette symphonie invisible des grandes équipes de football
Yoann Drolez, Maître de conférences en Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), Université de Pau et des pays de l’Adour (UPPA)
Texte intégral (1753 mots)
Pourquoi certaines équipes de football semblent-elles réciter une partition savamment orchestrée, « jouant en harmonie » et enchaînant les actions fluides comme si chaque joueur lisait dans les pensées des autres ? Et pourquoi d’autres, pourtant remplies de stars, donnent parfois l’impression de ne jamais réussir à se connecter ou à se comprendre ? Derrière ces scènes familières pour tout amateur du ballon rond se cache un concept clé : l’intelligence collective.
Alors que le football est aujourd’hui un phénomène culturel mondial, il n’est pas seulement un sport promouvant les talents individuels, mais une véritable aventure cognitive collective pour les joueurs. Concrètement, la cognition décrit l’ensemble des mécanismes nous permettant de produire des pensées et des comportements. Elle englobe notamment la perception, la mémoire, le langage, l’apprentissage, le raisonnement, la résolution de problème ou encore la prise de décision. Une équipe de football est un système cognitif complexe, dont peut émerger une forme d’intelligence collective. Un postulat illustré par le documentaire réalisé en 2006 par Jean-Christophe Ribot.
L’intelligence collective reflète la capacité d’un collectif à produire une performance supérieure à la somme des performances individuelles, à trouver des solutions à des problèmes que les individus ne pourraient résoudre seuls, que ces problèmes soient connus ou inédits. Elle permet au collectif d’être plus fiable (stabilité et régularité des performances dans le temps), plus flexible (il peut faire face à davantage de situations ou à des problèmes plus variés) et plus fort (de meilleures performances absolues). Selon la thèse avancée par Joseph Henrich, la formidable intelligence collective des êtres humains est le fruit de nos compétences culturelles. Seulement, elle n’est pas la propriété exclusive de notre espèce.
L’intelligence collective, un phénomène universel
Pour Émile Servan-Schreiber, l’intelligence collective peut concerner tout groupe, dès lors qu’il est constitué d’entités capables de traiter de l’information et d’interagir entre elles.
Il est important de préciser qu’une telle conception suppose que la conscience de ses actions n’est pas indispensable. Ainsi, l’intelligence collective ne se limite pas à l’être humain : elle est un phénomène universel que l’on observe partout dans la nature. On la retrouve chez de nombreuses espèces animales, voire végétales. Même certains microorganismes « rudimentaires » (le blob ou l’amibe Dictyostelium, par exemple) sont capables de comportements fascinants, mais surtout collectivement intelligents.
Au sein de cette grande variété, Jean-François Noubel différencie plusieurs types d’intelligence collective. La plus parlante est probablement l’intelligence collective « en essaim ». Aussi appelée swarm intelligence, elle est présente chez les insectes sociaux (fourmis, abeilles, termites), ainsi que dans les bancs de poissons et les nuées d’oiseaux. Un nombre important d’individus agit sans plan préétabli, sans que chaque membre ait une vision complète de la situation et sans chef pour coordonner le tout. Leurs interactions reposent alors sur des règles très simples, produisant des comportements collectifs complexes.
Mais celle qui nous intéresse en premier lieu est l’intelligence collective « originelle », présente dans les petits groupes (jusqu’à une dizaine d’individus). Elle nécessite une proximité spatiale et s’appuie généralement sur un objet/lien symbolique ou matériel : la proie dans les meutes de loups en chasse, la mélodie dans un groupe de musique, le ballon dans une équipe de football.
Les multiples facettes de l’intelligence collective
À l’échelle collective comme individuelle, l’intelligence présente de multiples facettes. Elle décrit diverses capacités émergeant des interactions de groupe, produisant des comportements extrêmement variés, qui dépendent à la fois des caractéristiques du collectif (taille, types et fréquence d’interaction, diversités, expérience commune, etc.) et de l’environnement dans lequel il agit. James Surowiecki, auteur de la Sagesse des foules (2008), distingue trois catégories de problèmes que les collectifs peuvent résoudre.
Premièrement, des problèmes de cognition, consistant à estimer, prédire ou identifier une valeur objective. Par exemple : deviner le poids d’un objet, prévoir un résultat électoral, localiser quelque chose.
Deuxièmement, des problèmes de coordination, pour lesquels les membres du collectif doivent adapter leurs actions sans chef pour commander. Nous en faisons régulièrement l’expérience en conduisant une voiture, en circulant à vélo ou en sortant d’une salle de concert.
Enfin, des problèmes de coopération, impliquant des individus dont les intérêts individuels peuvent diverger de ceux du collectif. Il s’agit alors de mettre son action au service du bien commun, à l’instar d’une campagne de vaccination ou des gestes de tri sélectif.
Dans notre thèse, nous avons cherché à démontrer que, pour les équipes de football, l’intelligence collective prend une dimension particulièrement originale, mêlant prise de décision, coordination des mouvements et anticipation des actions.
Une projection collective dans le temps
Imaginez pouvoir vous projeter dans un futur plus ou moins proche, pouvoir deviner ce qui va se produire sous vos yeux. Cette capacité, que l’on nomme anticipation, est déterminante au football. En effet, les joueurs doivent constamment interpréter les actions de leurs adversaires et partenaires pour agir en conséquence. Collectivement, comprendre et deviner ce qui va advenir donne un avantage déterminant aux équipes qui s’adaptent dans l’instant, sans recourir à une communication verbale.
L’exemple des marchés prédictifs montre que les foules sont particulièrement habiles dans l’exercice de prédire certains événements. En agrégeant des informations et des pensées dispersées, cette forme de « pari collectif » peut produire des résultats dépassant les performances d’experts isolés.
Un tel phénomène repose en partie sur la diversité cognitive, autrement dit la combinaison de multiples façons de voir le monde, d’interpréter les choses. C’est l’idée du « théorème de la diversité » formulé par le sociologue américain Scott E. Page : un groupe cognitivement diversifié obtient souvent de meilleurs résultats qu’un groupe composé uniquement d’individus très compétents mais homogènes dans leur façon de penser. Or, qu’en est-il pour les petits groupes qui ne pourraient pas s’appuyer sur le nombre ?
L’étude que nous avons menée sur les équipes de football a montré que, pour des groupes de taille identique, l’expertise individuelle restait un facteur déterminant. En clair, une équipe de débutants est moins performante dans l’anticipation du jeu qu’une équipe d’experts, même si elle dispose d’une certaine diversité cognitive. En parallèle, nous avons observé qu’à expertise moyenne équivalente, une dose de diversité cognitive était bénéfique.
Concrètement, les équipes composées d’une minorité de joueurs « pensant différemment » étaient plus performantes pour deviner collectivement ce qui allait se produire dans un futur immédiat. Sans se concerter, ces dernières prédisaient avec réussite environ deux fois sur trois, ce qui leur conférerait un avantage indéniable sur le terrain.
Un atout dans les situations « critiques »
Compétences individuelles et diversité cognitive semblent bien liées à l’intelligence collective, y compris dans des groupes de petites tailles, confrontés à des situations « critiques ».
Au-delà du plaisir du sport, anticiper collectivement pour agir dans l’urgence est le quotidien de nombreux professionnels : pompiers, urgentistes, militaires. Comprendre les ressorts de leurs interactions, et des facteurs les rendant plus performants est alors déterminant. À ce titre, d’autres études ont souligné l’importance des compétences sociales, comme l’écoute ou la capacité à lire dans les yeux. Autant de pistes à creuser pour former à l’intelligence collective demain.
Cet article est publié dans le cadre de la Fête de la science (qui a lieu du 3 au 13 octobre 2025), dont The Conversation France est partenaire. Cette nouvelle édition porte sur la thématique « Intelligence(s) ». Retrouvez tous les événements de votre région sur le site Fetedelascience.fr.
Yoann Drolez ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
04.12.2025 à 16:19
Comment l’Iran en est arrivé à la faillite hydrique et pourquoi déplacer la capitale ne changera rien
Ali Mirchi, Associate Professor of Water Resources Engineering, Oklahoma State University
Amir AghaKouchak, Professor of Civil & Environmental Engineering and Earth System Science, University of California, Irvine
Kaveh Madani, Director of the United Nations University Institute for Water, Environment and Health, United Nations University
Mojtaba Sadegh, Associate Professor of Civil Engineering, Boise State University; United Nations University
Texte intégral (2064 mots)
Face à l’une des pires sécheresses de son histoire, l’Iran se retrouve au bord de la « faillite hydrique » : Téhéran, sa capitale de 15 millions d’habitants, pourrait devenir inhabitable.
L’automne marque le début de la saison des pluies en Iran, mais de vastes régions du pays n’ont quasiment pas vu une goutte alors que la nation affronte l’une de ses pires sécheresses depuis des décennies. Plusieurs réservoirs essentiels sont presque à sec et Téhéran, la capitale, se rapproche d’un « Day Zero », le moment où la ville n’aura plus d’eau.
La situation est si grave que le président iranien Massoud Pezeshkian a relancé un projet envisagé de longue date visant à déplacer la capitale, une métropole où vivent aujourd’hui 15 millions de personnes.
Des gouvernements précédents avaient déjà évoqué l’idée d'installer la capitale ailleurs, sans jamais la mettre en œuvre. De fait, l’expansion incontrôlée de Téhéran a généré une série de problèmes, allant du stress hydrique chronique et de l’affaissement des sols aux embouteillages et à une pollution atmosphérique sévère, tout en accentuant les inquiétudes concernant la vulnérabilité de la ville aux risques sismiques majeurs. Cette fois, Pezeshkian présente le déménagement comme une obligation, non comme un choix. Il a averti en novembre 2025 que si rien ne change, la ville pourrait devenir inhabitable.
Comment l’Iran en est arrivé à la faillite hydrique
La sécheresse est une préoccupation dans cette région du monde depuis des millénaires. Une prière du roi perse Darius le Grand, gravée dans la pierre il y a plus de 2 000 ans, demandait à son dieu de protéger la terre des envahisseurs, de la famine et du mensonge.
Aujourd’hui, toutefois, l’aggravation des problèmes hydriques et environnementaux de l’Iran est la conséquence prévisible de décennies durant lesquelles les ressources limitées de la région ont été gérées comme si elles étaient infinies.
L’Iran s’est largement reposé sur une irrigation très consommatrice d’eau pour cultiver des terres arides, tout en subventionnant l’usage de l’eau et de l’énergie, ce qui a entraîné une surexploitation des nappes phréatiques et une baisse des réserves souterraines. La concentration des activités économiques et de l’emploi dans les grands centres urbains, en particulier Téhéran, a également provoqué une migration massive, aggravant encore la pression sur des ressources hydriques déjà sursollicitées.
Ces dynamiques, parmi d’autres, ont conduit l’Iran vers une forme de « faillite hydrique » – un point où la demande en eau dépasse durablement l’offre et où la nature ne peut plus suivre.
L’approche centralisée et verticale de la gestion de l’eau en Iran s’est révélée incapable d’assurer la durabilité des ressources et de maintenir un équilibre entre l’offre renouvelable et une demande qui ne cesse de croître.
Depuis la révolution de 1979, le pays s'est lancé dans une véritable « mission hydraulique », construisant barrages et dérivations de rivières pour soutenir l’expansion urbaine et agricole. Poussée par des ambitions idéologiques, la quête d’autosuffisance alimentaire, combinée aux sanctions internationales et à l’isolement économique, a lourdement pesé sur l’environnement, en particulier sur les ressources hydriques. Assèchement des lacs, épuisement des eaux souterraines et salinisation croissante sont désormais des phénomènes répandus dans tout le pays, présentant des risques majeurs pour la sécurité hydrique.
En tant que spécialistes des ressources en eau (l’un de nous est un ancien directeur adjoint du Département iranien de l’environnement), ingénieurs environnementaux et scientifiques, nous suivons depuis des années les défis hydriques auxquels le pays est confronté. Nous voyons des solutions possibles à ses problèmes chroniques d’eau, bien qu’aucune ne soit simple.
La baisse des réserves expose l’Iran
Des experts alertent depuis des années : l’absence de stratégie pour traiter la faillite hydrique du pays le rend de plus en plus vulnérable aux conditions climatiques extrêmes. Les Iraniens en font de nouveau l’expérience avec la dernière sécheresse.
Les précipitations ont été largement inférieures à la normale lors de quatre années hydrologiques depuis 2020. Cela a contribué à une chute marquée du niveau des réservoirs. L’automne 2025 a été le plus chaud et le plus sec enregistré à Téhéran depuis 1979, mettant à l’épreuve la résilience de son système d’approvisionnement en eau.
La ville subit une pression croissante sur des réserves d’eaux souterraines déjà réduites, sans véritable perspective d’amélioration en l’absence de précipitations significatives. La diminution du manteau neigeux et la modification des régimes de pluie rendent plus difficile l’anticipation du volume et du calendrier des apports fluviaux. La hausse des températures aggrave encore la situation en augmentant la demande et en réduisant la quantité d'eau disponible dans les cours d’eau.
Il n’existe aucune solution rapide pour résoudre l’urgence hydrique de Téhéran. À court terme, seule une augmentation significative des précipitations et une réduction de la consommation peuvent apporter un soulagement.
Les mesures précipitées visant à accroître les transferts inter-bassins, comme le transfert Taleqan‑Téhéran pour pomper l’eau du barrage de Taleqan, situé à plus de 160 kilomètres, sont non seulement insuffisantes, mais risquent d’aggraver le déséquilibre entre offre et demande à long terme. L’Iran a déjà expérimenté le transfert d’eau entre bassins, et dans de nombreux cas, ces transferts ont alimenté une croissance non durable plutôt qu’une réelle conservation, aggravant les problèmes hydriques tant dans les bassins donneurs que dans les bassins récepteurs.
Au cœur du problème de Téhéran se trouve un déséquilibre chronique entre l’offre et la demande, alimenté par une croissance rapide de la population. Il est très douteux que le déplacement de la capitale politique, comme le suggère Pezeshkian, puisse réellement réduire la population de la ville et donc sa demande en eau.
La région peu peuplée du Makran, dans le sud-est du pays, le long du golfe d’Oman, a été évoquée comme une option possible, présentée comme un « paradis perdu », bien que les détails sur la proportion de la ville ou de la population qui serait déplacée restent flous.
Parallèlement, d’autres grandes villes iraniennes connaissent des tensions hydriques similaires : le stress hydrique est une menace à l’échelle nationale.
Des solutions pour un pays sec
Le pays doit commencer à dissocier son économie de la consommation d’eau en investissant dans des secteurs générant valeur et emplois avec un usage minimal de l’eau.
La consommation d’eau agricole peut être réduite en cultivant des produits à plus forte valeur ajoutée et moins gourmands en eau, tout en tenant compte de la sécurité alimentaire, du marché du travail et des aspects culturels. Les économies d’eau ainsi réalisées pourraient servir à reconstituer les nappes phréatiques.
S’ouvrir davantage au commerce mondial et importer des produits alimentaires dont la culture implique une forte consommation d’eau, plutôt que les produire localement, permettrait également à l’Iran de consacrer ses terres et son eau à un ensemble plus restreint de cultures stratégiques indispensables à la sécurité alimentaire nationale.
Cette transition ne sera possible que si le pays évolue vers une économie plus diversifiée, réduisant ainsi la pression sur ses ressources limitées, ce qui semble peu réaliste dans le contexte actuel d’isolement économique et international. La demande en eau urbaine pourrait être réduite en renforçant l’éducation du public à la conservation, en limitant les usages très consommateurs comme le remplissage des piscines privées, et en modernisant les infrastructures de distribution pour réduire les fuites.
Les eaux usées traitées pourraient être davantage recyclées à des fins potables et non potables, notamment pour maintenir les débits des rivières, actuellement négligés. Lorsque c’est possible, d’autres solutions, telles que la gestion des crues pour la recharge des nappes ou la dessalination des eaux souterraines intérieures, peuvent être explorées pour compléter l’approvisionnement tout en minimisant les impacts environnementaux.
Prises dans leur ensemble, ces mesures nécessitent une action audacieuse et coordonnée plutôt que des réponses fragmentaires. Les discussions renouvelées sur le déménagement de la capitale montrent comment les pressions environnementales s’ajoutent au puzzle complexe de la sécurité nationale de l’Iran. Cependant, si les causes profondes de la faillite hydrique du pays ne sont pas traitées, un éventuel déplacement de la capitale visant à alléger les problèmes d’eau restera inutile.
Mojtaba Sadegh a reçu des financements de l'US National Science Foundation, de la NASA et du Joint Fire Science Program.
Ali Mirchi, Amir AghaKouchak et Kaveh Madani ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.
03.12.2025 à 16:53
Combiner préservation de la biodiversité et développement économique : leçons indonésiennes
Emmanuel Fourmann, Chargé de recherche, Agence Française de Développement (AFD)
Muhammad Syukri Fadil, Senior Researcher, SMERU Research Institute; Universitas Andalas
Oskar Lecuyer, chargé de recherche climat-énergie, Agence Française de Développement (AFD)
Texte intégral (2185 mots)
Surexploitation des ressources marines et halieutiques, déchets abandonnés dans la nature, tourisme de masse… comment préserver les écosystèmes côtiers locaux des conséquences néfastes du tourisme et des activités humaines intensives ? Des recherches menées en Indonésie démontrent que les « aires protégées » et, dans le cas de l’Indonésie, les « aires marines protégées » (AMP) en particulier offrent des pistes prometteuses afin d’allier préservation de la biodiversité et développement économique – à condition d’y associer les populations locales. Cet article fait le point sur les dispositifs « d’aires » existants et offre un retour d’expérience sur leur efficacité en Indonésie.
La mise en place d’une aire protégée demeure l’un des principaux outils pour conserver la biodiversité. Mais les restrictions d’usage associées (selon les zones concernées : interdiction de prélèvement ou de circulation, itinéraires ou calendriers imposés, défense de faire un feu ou de bivouaquer) sont généralement contraignantes pour les riverains ou les touristes, et souvent mal acceptées.
Des travaux de recherche menés en Indonésie montrent qu’associer les communautés voisines à la conservation est généralement un gage d’efficacité écologique : les règles établies sont alors mieux comprises, voire co-construites, et, dès lors, mieux admises et respectées.
Ainsi, les bénéfices attendus de la mise en protection se concrétisent du point de vue écologique et il est possible d’y adjoindre des co-bénéfices pour les populations riveraines.
Périmètres et restrictions d’usage
La stratégie nationale des aires protégées (SNAP) donne la définition suivante de la notion d’« aire protégée » : « Un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés. »
C’est donc une zone géographique définie par la loi, dont l’usage est restreint par rapport au droit commun.
Plusieurs catégories de protection ont été définies par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), un lien étant clairement établi entre, d’une part, le degré de rareté et de menace pesant sur les écosystèmes, les animaux et les plantes et, d’autre part, le niveau des restrictions d’usage.
L’arsenal habituel est un périmétrage de la zone et la sécurisation légale du foncier ; la détermination d’une « zone cœur » et de zones tampons ; une régulation des accès et des pratiques ; l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de gestion écologique ; des activités de police de l’environnement et de valorisation des connaissances.
Pour ce qui est des espaces côtiers et maritimes, une aire marine protégée correspond à un « volume délimité en mer, sur lequel les instances gouvernantes attribuent un objectif de protection de la nature à long terme. Cet objectif est rarement exclusif et soit souvent associé à un objectif local de développement socio-économique, soit encore avec une gestion durable des ressources ».
Compte tenu des interactions entre faunes marine et terrestre (ponte des tortues, habitat des crabes et oiseaux de mer), de nombreuses aires protégées côtières sont mixtes, incluant une zone en mer et une partie terrestre pour garantir une continuité écologique entre les deux milieux.
Une tension entre biodiversité et développement économique
Aujourd’hui, la biodiversité est la plus riche dans les zones faiblement peuplées et faiblement développées (moindre pression anthropique, moindre pollution) et c’est naturellement dans ces zones que l’on est le plus susceptible de créer des aires protégées pour sécuriser les écosystèmes.
Dès lors, l’objectif de conservation peut entrer en tension avec celui du développement économique local.
Si les personnes les plus pauvres et les plus éloignées de l’économie mondiale sont les plus dépendantes de la nature pour leur subsistance, il faut aussi noter que la création d’une aire protégée se traduit pour les populations riveraines par de nouvelles contraintes pesant sur leurs pratiques productives (agriculture, cueillette, élevage, châsse, pêche), leurs itinéraires (zones interdites de manière temporaire ou permanente, nomadisme), leurs comportements (gestion des déchets). Il existe une tension traditionnelle entre droits des riverains et droits de la nature.
Les logiques de conservation sont parfois déployées dans des contextes d’inégalités importantes, car faisant se côtoyer des populations très pauvres et isolées, avec des opérateurs économiques plus riches alignés sur d’autres standards (tourisme, pêcheries industrielles, mines). En Indonésie, certains villages côtiers, situés dans des zones très touristiques, figurent parmi les plus riches du pays, mais aussi parmi les plus inégaux : les modes de vie traditionnels (pauvres) coexistent avec ceux, davantage empreints de consommation, d’un petit groupe de personnes qui profitent plus directement des revenus issus du tourisme.
Par ailleurs, les villages proches d’aires protégées ont souvent un accès plus limité aux équipements, infrastructures (près de la moitié des populations proches des aires protégées n’a pas accès au réseau téléphonique) et soutiens financiers (la moitié des ménages n’a pas accès au crédit).
De manière générale, ces villages proches d’aires protégées affichent en moyenne de plus hauts niveaux de pauvreté et d’inégalité qu’ailleurs dans le pays, et si l’on y observe une lente augmentation des revenus des plus pauvres, le niveau des inégalités, lui, a plutôt tendance à augmenter.
Dès lors, est-il possible de concilier conservation et développement juste des populations locales ?
Associer les populations locales
Des travaux menés sur une série d’aires marines protégées en Indonésie montrent que l’association directe des populations à la création puis à la gestion des aires protégées (information des populations sur les enjeux, création de groupe de parole, représentation des populations voisines dans les instances de décision, intégration des riverains dans la surveillance ou le guidage, etc.) est un garant de l’efficacité écologique et de l’acceptation sociale. Chaque restriction d’usage, si elle est comprise, nourrie de la connaissance des populations locales et confrontée à leurs contraintes existantes, sera mieux respectée et les coûts de coercition réduits. De même, si l’exercice de la surveillance écologique est exercée par un ou une voisine, elle n’est pas vécue comme exogène.
Les travaux soulignent notamment :
L’importance du volet social de la conservation écologique : il est nécessaire d’associer au maximum les populations riveraines au processus de création puis de gestion des aires marines, notamment lors de l’élaboration des règles. Celles-ci doivent être construites en tenant compte des besoins locaux et des connaissances des habitants. Il est par exemple très important que des enquêtes préalables soient effectuées avant la création de nouvelles aires protégées, pour en limiter l’impact et s’assurer de l’existence de solutions alternatives ou de compensations adaptées. Cette économie non monétaire, fondée sur la nature, n’est toutefois pas bien connue ni appréhendée par les décideurs.
La nécessité d’une diversification des profils de recrutement des gestionnaires et écogardes (ne pas se limiter aux formations purement biologiques et écologiques). Il convient de former les gestionnaires en place aux approches économiques et sociales et de les doter d’outils pratiques pour les aider à mieux intégrer les populations et mieux prendre en compte leurs points de vue.
La biodiversité, garantie de subsistance et atout de développement
Concilier objectifs socio-économiques et environnementaux n’est donc pas impossible, même si l’objectif principal d’une aire protégée est généralement prioritairement biologique, visant à maintenir durablement des écosystèmes.
La biodiversité protégée peut être un facteur particulièrement attractif pour le tourisme (plongée, randonnée, pêche sportive, grande chasse) et devenir un atout économique pour un pays, le tourisme étant dans la comptabilité nationale une exportation de services, pourvoyeuse de devises, d’emplois et d’activité économique. Tout en rappelant aussi qu’un tourisme intense, mal contrôlé et mal canalisé, peut évidemment devenir une menace additionnelle pour la biodiversité des milieux fragiles.
Les aires marines protégées offrent par ailleurs de nombreux bénéfices environnementaux. En conservant la biodiversité et le paysage, elles favorisent la pêche durable et le tourisme côtier. En protégeant les zones d’habitat de la faune sauvage, elles facilitent la reproduction des poissons. En zone intertropicale, elles augmentent également la résilience des communautés humaines face au changement climatique, car les mangroves et les barrières de corail atténuent les effets du changement climatique comme la montée du niveau des mers et l’érosion côtière, et l’impact des phénomènes extrêmes, notamment les tsunamis dans les pays à forte activité sismique comme l’Indonésie (entre 5 000 et 10 000 séismes enregistrés chaque année).
Les conditions de l’efficacité des aires marines protégées
Les études menées sur l’Indonésie montrent que la plupart des aires marines protégées souffrent d’une gouvernance médiocre, mais que des améliorations sont possibles et déjà à l’œuvre.
Prévue par le Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal, l’extension ou la création d’aires protégées, si elle est conduite en lien avec les populations, peut se traduire par une amélioration des conditions de vie des riverains, avec notamment une amélioration des captures de pêche, un meilleur accès des communautés à l’information, un accès à des emplois dans le tourisme, notamment pour les femmes. Une extension des aires marines protégées, si elle s’accompagne d’une démarche consultative et inclusive, peut donc conjuguer intérêt écologique et économique.
Dans cette perspective, les travaux de recherche en matière de mesure de la biodiversité (comptabilité écologique et océanique, Blue ESGAP, comptabilité des écosystèmes côtiers) sont très attendus, car ils devraient permettre à moyen terme un meilleur suivi des effets écologiques et sociaux des aires marines protégées et de documenter ainsi la contribution au développement durable des politiques de conservation de la nature.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
03.12.2025 à 16:53
Le retour de la puissance en géopolitique : le cas de l’Ukraine
Laurent Vilaine, Docteur en sciences de gestion, ancien officier, enseignant en géopolitique à ESDES Business School, ESDES - UCLy (Lyon Catholic University)
Damien Afonso, Enseignant en géopolitique à l'ESDES, ESDES - UCLy (Lyon Catholic University)
Texte intégral (1397 mots)
Et si, au-delà des horreurs, la guerre entre la Russie et l’Ukraine, intensifiée en 2022, n’était pas l’événement « nouveau » que l’on dépeint, mais le révélateur brutal de lois géopolitiques fondamentales que l’Occident avait choisi d’oublier ?
La guerre qui ravage actuellement l’Ukraine est un concentré de géopolitique, qui mobilise toutes les grilles d’analyse élaborées depuis plus d’un siècle, rappelant que les grands drames du monde contemporain (Bosnie, Tchétchénie, Géorgie, pour ne s’en tenir qu’au continent européen) ne sont que les itérations d’un jeu de puissance aux règles immuables.
Au-delà de l’anxiété du court terme, c’est cette approche qu’il convient d’avoir à l’esprit pour décrypter les constantes militaires, économiques, numériques et narratives qui commandent la géopolitique moderne.
L’empreinte indélébile de la géographie et de l’histoire
La guerre en Ukraine est, avant tout, une affaire de temps long. Elle réactive deux forces primaires que la modernité avait cru dissoudre : la géographie et l’histoire.
Ce conflit nous rappelle brutalement ce qu’est la guerre de haute intensité, un concept que l’on pensait relégué aux archives de la guerre froide (Corée, Vietnam, Iran-Irak…).
Le fleuve Dniepr redevient un obstacle stratégique ; le relief naturel dicte les fonctions défensives ; la mer Noire, une artère vitale pour l’évacuation du blé, est une zone de friction économique et militaire.
Les villes ne sont pas de simples coordonnées numériques, mais des bastions à conquérir, des symboles dont la perte ou la conquête influe directement sur le moral des belligérants. La technologie a beau innover (l’usage massif des drones), elle ne fait que s’adapter à la réalité implacable du sol. Cette réalité réaffirme une constante que les débats sur la guerre cyber et hybride tendaient à occulter : le terrain façonne les opérations.
Le poids des récits
Le rapport de force, lui, est indissociable des récits. L’Ukraine se définit par sa souveraineté, tandis que la Russie se considère toujours comme l’héritière légitime d’un espace impérial qu’elle n’accepte pas de perdre. Ce choc de représentations historiques, où l’un refuse de perdre et l’autre d’être absorbé, est une constante tragique de la géopolitique.
Vladimir Poutine, comme tant d’autres avant lui, a commis l’erreur classique d’ignorer qu’un rapport de force ne s’évalue pas à l’aune du mépris que l’on a pour son adversaire, mais se mesure au regard des forces et faiblesses réelles. La résistance ukrainienne, soutenue mais non dirigée par ses alliés, est la preuve amère que les Russes ont sous-estimé leur adversaire de manière caricaturale.
L’incapacité d’anticiper
L’un des enseignements les plus cinglants de ce conflit tient à l’incapacité d’anticiper dont ont fait preuve les acteurs occidentaux. Malgré les signaux constants de la géopolitique, il a fallu l’événement, le choc de 2022, pour forcer un réarmement accéléré de l’Europe et une révision de ses dépendances.
En Ukraine, la guerre est un laboratoire d’innovations (drones, adaptation tactique en temps réel), mais cette innovation ne saurait cacher le retour d’une autre constante : la masse.
Malgré le numérique et la guerre électronique, le qualitatif ne remplace pas le quantitatif. Le nombre de chars, de pièces d’artillerie, et de soldats compte plus que jamais. Les modes d’action russes le confirment tragiquement : une approche où la préservation du capital humain est subordonnée à l’idée d’un capital jugé quantitativement inépuisable.
L’Occident découvre, sidéré, la primauté du stock sur la sophistication, alors que cette logique est un pilier de la stratégie militaire depuis l’aube des guerres.
La gesticulation nucléaire
L’escalade doit être évitée à tout prix, et cette retenue est dictée par la constante la plus terrifiante de la modernité : la dissuasion nucléaire.
La logique de la « destruction mutuelle assurée » est plus vivante que jamais, expliquant la frilosité relative des Américains et des Européens. La Russie use et abuse de la gesticulation nucléaire – déclarations ambiguës, annonces de nouveaux matériels – pour dissuader tout engagement occidental trop important. Cette démonstration est à la fois une force et une faiblesse, mais elle réaffirme le rôle central de l’atome comme arbitre suprême des conflits de haute intensité.
Intérêts permanents, nouvelles alliances
Si le conflit semble géographiquement circonscrit, ses effets sont mondiaux, mais surtout, ils révèlent la nature profonde et intéressée des alliances globales.
Pour Vladimir Poutine, la guerre a engendré des échecs stratégiques aux conséquences durables :
la transformation de l’Organisation du traité Atlantique Nord (Otan) avec l’incorporation de la Finlande et de la Suède ;
le découplage durable avec l’Europe, forçant la Russie à orienter son énergie à prix réduit vers l’Asie (Chine, Inde), augmentant ainsi sa dépendance à un nombre réduit de pays ;
la mutation du « Sud Global », sur lequel la Russie compte tant.
L’échec le plus cruel est de constater que le soi-disant « Sud Global » ne soutient la Russie qu’à l’aune de ses propres intérêts. Ces pays profitent des sanctions occidentales pour acheter du pétrole russe à bas coût, démontrant une forme de non-alignement formel et l’une des plus grandes constantes de la géopolitique : l’intérêt prime toujours l’idéologie.
Le temps long contre la peur
En Ukraine, la guerre mobilise à elle seule de nombreuses constantes de la géopolitique contemporaine.
C’est ce que cherche à restituer le Retour de la puissance en géopolitique. Bienvenue dans le vrai monde (L’Harmattan, 2025) au travers de ses 20 thématiques indépendantes, visant à couvrir une grande partie du spectre de la géopolitique dont les maîtres mots sont la puissance, le rapport de force et l’intérêt. Comprendre cette guerre, c’est accepter que le monde obéît à des règles anciennes et que la seule véritable surprise réside dans notre incapacité chronique à les anticiper.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
03.12.2025 à 12:19
La longue histoire du despotisme impérial de la Russie
Sabine Dullin, Professeur en histoire contemporaine de la Russie et de l'Union soviétique, Sciences Po
Texte intégral (2129 mots)

Dans son nouvel essai Réflexions sur le despotisme impérial de la Russie qui vient de paraître aux éditions Payot, Sabine Dullin, professeure en histoire contemporaine de la Russie et de l’Union soviétique à Sciences Po, examine la formation et la persistance à travers le temps de l’identité impériale russe. Avec la précision de l’historienne, elle montre comment ce modèle s’est établi puis s’est construit dans la longue durée, a évolué selon les périodes et les natures des régimes, et continue à ce jour de peser lourdement sur la politique de la Russie contemporaine. Nous publions ici des extraits de l’introduction, où apparaît cette notion de « despotisme impérial » qui donne son titre à l’ouvrage et qui offre un angle d’analyse inédit des cinq derniers siècles de l’histoire du pays.
Un despote et une vision impériale : telle est la prison dans laquelle l’identité russe est enfermée depuis des siècles. Au pouvoir depuis vingt-cinq ans et artisan de la guerre en Ukraine, Poutine en donne hélas une confirmation éclatante.[…]
Les représentations extérieures de la Russie comme despotique et impériale ont repris de l’importance dans le débat public à la suite de l’invasion de l’Ukraine. Elles relient despotisme interne et guerre extérieure en redessinant la frontière orientale de l’Europe comme nouvelle barrière de civilisation.
L’acronyme « Rashistes », de la contraction entre « Russia » et « fascistes », né sous la plume d’un journaliste ukrainien au moment de la guerre en Géorgie en 2008, a été repris à partir de 2014 quand Poutine lança, à la suite de l’annexion de la Crimée, sa guerre non déclarée au Donbass. Son usage devint viral après l’invasion de l’Ukraine fin février 2022 et quand le président Volodymyr Zelensky l’utilisa en avril pour exprimer le retour de la barbarie fasciste en Europe, près de quatre-vingts ans plus tard.
Mais au moment des massacres de civils à Boutcha, en Ukraine, la présence dans l’armée russe d’unités non russes de Sibérie, d’ethnicité turcique ou mongole (Bouriates, Touva, Sakha), provoqua aussi dans les médias européens la réapparition d’une autre image de la Russie, plus asiatique qu’européenne.
Si l’envoi prioritaire au front des non-Russes pauvres de Sibérie ressemblait fort à de la discrimination raciste en Fédération de Russie, le descriptif d’une civilisation européenne blanche attaquée en Ukraine par les hordes barbares en provenance de Russie relevait quant à lui d’une longue histoire des stéréotypes occidentaux du despotisme oriental. Le despotisme avait notamment servi à décrire la Russie du tsar Nicolas Ier au milieu du XIXe siècle.
Dans sa comparaison entre les États-Unis et la Russie, Alexis de Tocqueville faisait alors de la servitude et de la conquête militaire les clés du gouvernement et du dynamisme des Russes. Pour lui, le peuple russe concentrait dans un seul homme toute la puissance de la société. Karl Marx, qui prit fait et cause pour les insurgés polonais en 1830 comme en 1863, dénonçait le danger que faisait peser la « sombre puissance asiatique sur l’Europe », dont l’art de la servitude, qu’il jugeait hérité des Mongols, servait une conquête sans fin.
Ainsi, soit le despotisme russe entrait dans une typologie des régimes politiques allant de la liberté et de la démocratie jusqu’à la tyrannie et l’absolutisme, soit il était essentialisé sous les traits d’un régime oriental et non européen. La grille de lecture orientaliste d’une Russie irréductiblement différente de l’Europe servit à nouveau, dans le contexte de la guerre froide, pour combattre l’adversaire communiste, son tout-État sans propriété privée et son expansionnisme rouge.
Le despotisme est une notion négative que les dirigeants russes eux-mêmes n’assumeraient pas. Elle est le plus souvent utilisée par les détracteurs du pouvoir russe. Pour vanter les mérites de leur système en regard de la démocratie occidentale, les gouvernants de la Russie ont préféré et préfèrent d’autres termes, comme absolutisme et autocratie à l’époque des tsars, dictature du prolétariat et démocratie populaire après la révolution russe, dictature de la loi ou verticale du pouvoir dans la Russie de Poutine.
Chaque terme peut se comprendre en miroir du système politique européen de l’époque. Ainsi, l’autocratie répond à la monarchie constitutionnelle, la dictature du prolétariat s’oppose à la démocratie formelle bourgeoise, la dictature de la loi remplace l’État de droit. Ce livre voudrait tester la notion de despotisme impérial, montrer à quel point les représentations du despotisme et de l’Empire se nourrirent l’une l’autre dans l’histoire russe.
Le concept est évidemment contestable et sera contesté. Mais dans son flou sémantique, il a la vertu heuristique d’étudier des usages et des récurrences. Depuis la Moscovie du XVIe siècle, il s’agira donc de comprendre comment despotisme et Empire ont pu former dans leur association un nœud coulant enserrant l’identité russe et bloquant son épanouissement, aussi bien comme nation que comme démocratie.
Dans les scénarios du pouvoir en Russie, on constate la personnalisation du pouvoir, sa dimension religieuse ou sacrée, la faiblesse des contre-pouvoirs, le service du souverain comme source principale de richesse. L’Empire, comme idée et comme pratique, relève pour l’État russe de l’ordre naturel des choses. En son sein s’est forgée une identité russe impériale englobante (rossiïski), différente de l’ethnicité russe (russki). L’Empire fut cependant l’objet de la critique acerbe des marxistes qui prirent le pouvoir en 1917. Mais l’immensité et la multinationalité, qui en étaient les traits positifs, et la Puissance qui en découlait furent – y compris en Union soviétique – valorisées, au contraire de l’impérialisme dont il fallait se dissocier.
Ni le despotisme ni l’Empire ne disparurent, malgré des idéologies contraires et les récits radicalement nouveaux d’après 1917. La figure du despote a pu prendre les traits d’un tyran sanguinaire ou d’un despote éclairé, il a pu se présenter comme le garant de l’ordre établi ou, au contraire, comme un modernisateur. Le régime despotique a été le pouvoir sans limites du tsar ou de Staline, mais aussi celui d’une bureaucratie civile et militaire pesant de tout son poids sur les multiples communautés et peuples composant l’Empire. Le despotisme impérial a provoqué violence, asservissement, mais aussi consensus et collaboration.
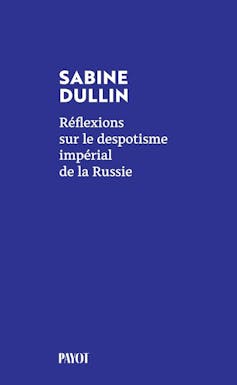
La notion de despotisme impérial offre également la possibilité de penser le pouvoir absolu et impérial en Russie en comparaison avec d’autres : l’Empire ottoman, la Chine, mais aussi les monarchies absolues, les Empires et les impérialismes occidentaux. Dans l’histoire russe, beaucoup de notions utilisées ne sont pas transposables ailleurs. Le dilemme du pouvoir russe est ainsi très souvent posé en termes d’occidentalisme (imitation de l’Occident) ou de slavophilie (recherche d’une voie spécifique). L’autocratie, lorsqu’elle conquiert des territoires, serait moins impérialiste que panslave (quand il s’agit de conquérir à l’ouest) ou eurasiste (quand il s’agit de coloniser vers l’est et le sud).
La notion de totalitarisme entendait insister sur la nouveauté des régimes communiste et fasciste issus de la Première Guerre mondiale et des révolutions qui ont suivi. « Despotisme impérial » évite de brouiller les systèmes de reconnaissance du régime politique par des caractérisations trop spécifiques dans le temps et l’espace. Utiliser la notion de despotisme impérial pour comprendre la Russie d’aujourd’hui a une valeur d’analyse critique, mais aussi de prospective. En soulignant les récurrences autocratiques de l’État russe et les ressorts d’une identité russe adossée à l’Empire, on est amené à se demander comment sortir de cette apparente fatalité du despotisme impérial en Russie.
Il ne faudrait pas se leurrer. Le jeu de miroirs est multidirectionnel. Pour critiquer la monarchie absolue française, Montesquieu analysait les régimes lointains de despotisme oriental. L’analyse du despotisme impérial de la Russie peut relever d’un exercice similaire de fausse altérité et de vigilance, comme un miroir tendu à l’Europe, lui renvoyant ce qu’elle fut : coloniale, impérialiste et fasciste, et ce qu’elle pourrait bien redevenir : antidémocratique.
Copyright : éditions Payot & Rivages, Paris, 2025.
Sabine Dullin ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
02.12.2025 à 15:58
Les deux grands enjeux derrière la demande de grâce de Benyamin Nétanyahou
Michelle Burgis-Kasthala, Professor of International Law, La Trobe University
Texte intégral (1612 mots)
Le président d’Israël Isaac Herzog a quelques semaines pour décider s’il gracie ou non le premier ministre Benyamin Nétanyahou, empêtré dans plusieurs affaires de corruption… pour lesquelles il n’a d’ailleurs pas encore été condamné, ce qui rend sa demande de grâce particulièrement exceptionnelle. Ce qui est en jeu ici, c’est à la fois l’avenir personnel et politique du chef du gouvernement, qui espère être reconduit à son poste aux élections de l’année prochaine, et l’indépendance du système judiciaire israélien.
Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou, poursuivi pour corruption depuis plusieurs années, a adressé une demande de grâce au président du pays Isaac Herzog. Cette demande a alarmé ses détracteurs, qui y voient une tentative de contourner l’État de droit.
Dans un message vidéo, Nétanyahou affirme que, du fait de la situation « sécuritaire et politique » actuelle d’Israël, il est impossible pour lui de comparaître devant le tribunal plusieurs fois par semaine.
Sa demande de grâce n’est que le dernier rebondissement d’une affaire qui dure depuis des années. Elle pourrait avoir des implications importantes aussi bien pour le système judiciaire israélien que pour l’avenir politique de Nétanyahou, alors que des élections sont prévues l’année prochaine.
Quelles sont les accusations qui pèsent contre lui ?
Nétanyahou, 76 ans, est incontestablement la figure politique la plus importante de la politique israélienne moderne. Il a été élu premier ministre pour la première fois en 1996 et en est aujourd’hui à son sixième mandat.
Il est mis en examen pour « corruption, fraude et abus de confiance », dans le cadre d’une série d’enquêtes qui remontent à 2016. Il fait l’objet de poursuites dans trois affaires distinctes identifiées par des numéros : l’« affaire 1 000 », l’« affaire 2 000 » et l’« affaire 4 000 ». Le procès a débuté en 2020.
Dans l’« affaire 1 000 », le premier ministre est soupçonné d’avoir reçu l’équivalent d’environ 200 000 dollars américains (172 000 euros) de cadeaux, notamment des cigares et du champagne, de la part du producteur hollywoodien Arnon Milchan et du milliardaire australien James Packer.
L’« affaire 2 000 » concerne des rencontres présumées entre Nétanyahou et Arnon Mozes, le propriétaire du célèbre journal Yediot Ahronot. L’accusation affirme que Mozes a proposé au chef du gouvernement une couverture médiatique favorable en échange de restrictions imposées à l’un de ses journaux concurrents.
Enfin, l’« affaire4 000 » concerne un conglomérat de télécommunications Bezeq. La procureure générale allègue l’existence d’un autre accord réciproque : Nétanyahou serait présenté sous un jour favorable sur un site d’informations en ligne géré par Bezeq, en échange de son soutien à des modifications réglementaires qui profiteraient à l’actionnaire majoritaire du conglomérat.
Nétanyahou a toujours nié toute malversation dans ces affaires, affirmant être victime d’une « chasse aux sorcières ». En 2021, il a qualifié les accusations de « fabriquées et ridicules ». Lorsqu’il a témoigné à la barre en 2024, il a déclaré :
« Ces enquêtes sont nées du péché. Il n’y avait pas d’infraction, alors ils en ont trouvé une. »
Des experts en droit israélien ont souligné qu’une grâce ne peut être accordée qu’une fois qu’une personne a été condamnée pour un crime. Mais Nétanyahou ne propose pas de reconnaître sa responsabilité ou sa culpabilité dans ces affaires, et il ne le fera probablement jamais. Il demande simplement une grâce afin de pouvoir continuer à exercer ses fonctions.
L’indépendance du système judiciaire israélien
Depuis le début du procès en 2020, de nombreuses personnes ont témoigné devant la justice, notamment d’anciens collaborateurs de Nétanyahou qui ont conclu des accords avec l’accusation et ont été interrogés en tant que témoins à charge. Des éléments assez accablants ont donc été présentés contre le premier ministre.
Il a toutefois su se montrer extrêmement habile et politiquement intelligent en utilisant à chaque occasion d’autres sujets, en particulier la guerre à Gaza, pour tenter de reporter ou d’interrompre la procédure.
Après le 7 octobre 2023, le nombre de jours d’audience a été limité pour des raisons de sécurité. Selon les médias, Nétanyahou a fréquemment demandé l’annulation de ses audiences, justifiant ces demandes par le fait qu’il avait une guerre à gérer.
Les partisans du premier ministre soutiennent sa demande de grâce, mais celle-ci met en lumière des questions plus larges concernant l’indépendance du système judiciaire israélien.
Au début de l’année 2023, le gouvernement a présenté des plans visant à réformer le système judiciaire, ce qui, selon ses détracteurs, affaiblirait la Cour suprême et le système israélien de contrôle et d’équilibre des pouvoirs. Nétanyahou n’a pas participé à cette initiative, car la procureure générale a déclaré que son implication constituerait un conflit d’intérêts en raison de son procès pour corruption, mais plusieurs ministres de son cabinet s’y sont associés.
Des manifestations massives ont eu lieu partout en Israël en réponse à ce projet. Les contestataires y ont vu une attaque frontale contre les fondements mêmes du système juridique israélien.
La demande de grâce s’inscrit donc dans ce contexte plus large, même si les deux questions ne sont pas formellement liées. Les opposants à Nétanyahou affirment que sa requête représente une nouvelle preuve du fait que lui et sa coalition ont une conception fondamentalement différente de la leur de ce que doit être l’État de droit.
La survie politique de Nétanyahou
Quand le premier ministre a été réélu à la tête du parti Likoud le 7 novembre 2025, il a annoncé son intention de se présenter à nouveau aux élections l’année prochaine – et souligné qu’il s’attendait à être désigné premier ministre une fois de plus.
La loi fondamentale israélienne suggère que Nétanyahou ne pourrait pas se présenter s’il était condamné pour une infraction grave, mais il n’est pas certain qu’il serait effectivement empêché de se présenter à ce stade.
Selon l’agence de presse Anadolu, Nétanyahou souhaiterait avancer les élections de novembre à juin dans l’espoir de pouvoir conclure d’ici là des accords visant à normaliser les relations avec l’Arabie saoudite et l’Indonésie. Cela correspond à son habitude d’utiliser les succès en matière de politique étrangère pour compenser ses problèmes intérieurs.
À l’approche des élections, le premier ministre israélien tente désormais toutes les manœuvres possibles pour améliorer sa position, et la grâce présidentielle n’est que l’une d’elles. C’est probablement la seule option qu’il lui reste pour faire disparaître l’affaire, car le procès dure depuis si longtemps que, tôt ou tard, le tribunal devra prendre une décision.
Michelle Burgis-Kasthala ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
