25.11.2025 à 15:46
Combien de CO₂ votre voyage en avion a-t-il vraiment émis ? Comment vérifier les calculs d’empreinte carbone de l’aérien
Finn McFall, KTP Associate, University of Surrey
Xavier Font, Professor of Sustainability Marketing, University of Surrey
Texte intégral (2360 mots)

D’un outil à l’autre, l’empreinte carbone évaluée pour un vol en avion peut varier considérablement. Cela tient aux hypothèses de calcul, au périmètre exact de celui-ci et à la source des données, qui peuvent être à l’origine de nombreuses incertitudes. Pour un usage éclairé de ces calculateurs, utiles mais approximatifs, par les voyageurs aériens, il est indispensable de mieux en cerner les limites.
Lorsque deux personnes réservent le même vol, elles peuvent penser avoir une empreinte carbone très différente, si elles sont passées par deux calculateurs en ligne différents. En effet, de nombreux calculateurs d’empreinte carbone passent sous silence une large partie de l’impact climatique du transport aérien – ou encore, s’appuient sur des hypothèses trop simplifiées.
Le point sur leurs limites et pourquoi elles sont importantes. Malgré tout, quelques précautions de bon sens peuvent vous aider à évaluer les estimations fournies.
Le CO₂ ne suffit pas
Si un outil en ligne ne rend compte d’un résultat qu’en kilogramme de dioxyde de carbone (CO2), il omet deux autres groupes d’émissions importants.
En effet, l’équivalent CO2 est une unité de mesure qui convertit l’impact des autres gaz à effet de serre, tels que le méthane, en équivalent dioxyde de carbone à l’aide de données scientifiques qui montrent leur potentiel de réchauffement climatique. Si un calculateur n’affiche que le CO2, il sous-estime donc l’empreinte carbone.
Un calculateur qui fait référence à des émissions équivalent CO2 inclut ainsi le CO2 ainsi que les autres émissions de gaz à effet de serre, ce qui le rend plus complet. Les bonnes pratiques citent le chiffre utilisé et renvoient au tableau des métriques utilisées pour le calcul. (par exemple, la valeur retenue pour le potentiel de réchauffement global du gaz considéré, ou PRG, ndlr).
Les impacts non liés au CO2 doivent également être pris en compte. Concrètement, il s’agit de l’effet sur le climat des oxydes d’azote, de la vapeur d’eau et des traînées de condensation émis par les avions. Ceux-ci emprisonnent la chaleur et agissent comme une couverture qui réfléchit la chaleur de la Terre vers le sol. Des recherches montrent que ces effets non liés au CO2 peuvent être comparables, voire supérieurs à ceux du CO2 seul, sur des horizons temporels moyens.
Cela signifie qu’un calcul basé uniquement sur les émissions de CO2 sous-estime l’impact climatique total du transport aérien, car il ne tient pas compte de l’effet des oxydes d’azote, de la vapeur d’eau et des traînées de condensation. L’ampleur des impacts non liés au CO2 varie en fonction de l’altitude, de la latitude, des conditions météorologiques et de l’heure de la journée, mais elle est trop importante pour être ignorée.
Les calculateurs devraient les quantifier de manière plus transparente, quitte à fournir un résultat avec un niveau d’incertitude chiffré. Les meilleurs calculateurs réalisent à la fois un calcul en équivalent CO2, puis prennent en compte les effets non liés au CO2.
À lire aussi : Impact du transport aérien sur le climat : pourquoi il faut refaire les calculs
Les avions ne volent pas vraiment en ligne droite
Une autre source de sous-estimation de l’empreinte carbone de l’aérien est le calcul des distances. De nombreux outils supposent un trajet dit « orthodromique » (c’est-à-dire, la distance la plus courte entre les aéroports de départ et d’arrivée compte tenu de la courbure de la Terre), auquel s’ajoute une petite distance fixe. Or, les vols réels sont influencés par les vents, les tempêtes, la congestion aérienne, les zones militaires à éviter et les fermetures d’espace aérien qui obligent à faire de longs détours. Même les itinéraires réguliers entre une ville A et une ville B peuvent changer quotidiennement en raison de ces variables.
Des études montrent que ces détours peuvent, en moyenne, atteindre un allongement de plus de 7,5 % de la distance totale, même en temps « normal » et sans parler de la situation géopolitique actuelle dans le monde. Or, une distance plus longue implique une consommation de carburant et des émissions plus importantes. Ainsi, si une calculatrice ne tient pas compte des déviations d’itinéraire, elle sous-estimera la consommation de carburant.
En utilisant les données historiques récentes observées sur un itinéraire donné, on peut ajuster ces estimations. De quoi mieux refléter la façon dont cet itinéraire est vraiment parcouru dans la pratique, et non pas dans des conditions idéales.
Quel périmètre les compagnies aériennes doivent-elles prendre en compte ?
Même lorsque la distance et les émissions de gaz à effet de serre sont correctement prises en compte, de nombreux outils éludent d’indiquer clairement le périmètre du calcul et ses limites, sans préciser ce qui est inclus ou exclus. Ainsi, de nombreux outils ne tiennent pas compte des émissions liées à l’extraction des matériaux pour construire les avions et aux activités pétrolières permettant de produire du carburant.
Une empreinte carbone complète et conforme aux normes en vigueur comprendrait les émissions « du puits au réservoir » (well-to-tank, ce qui intègre les étapes d’extraction, de raffinage et de transport du carburant), les services en vol et le cycle de vie des avions et même des aéroports.

La norme internationale ISO 14083 de 2023, qui porte sur la quantification et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre provenant des chaînes de transport, établit pourtant des règles communes. Les bons calculateurs s’alignent sur cette norme afin de rendre leur champ d’application explicite et comparable.
Mais les meilleurs calculateurs vont au-delà de ces exigences et couvrent l’ensemble des émissions liées au vol. Si un calcul d’empreinte carbone exclut les émissions en amont ou celles liées aux infrastructures aériennes, on peut s’attendre à ce que le résultat soit inférieur à celui qu’une analyse complète du cycle de vie livrerait.
L’allocation des émissions de l’appareil au passager
Le calcul des émissions par passager consiste à répartir l’impact climatique de l’avion entre les sièges occupés par les passagers et le fret (transport en soute). Or, la classe de cabine et la densité des sièges modifient l’espace disponible par passager. Les sièges en classe affaires ou en première classe peuvent donc avoir un impact par passager plusieurs fois supérieur à celui de la classe économique dans le même avion.
Les coefficients de remplissage (c’est-à-dire, le taux d’occupation d’un avion) modifient également ce calcul. Les passagers d’un avion à moitié plein devraient se voir attribuer deux fois plus d’émissions.
Les bonnes méthodes de calcul devraient utiliser des coefficients de remplissage et les plans de sièges spécifiques à chaque trajet, en fonction de la compagnie aérienne et de la saison, plutôt que des hypothèses globales généralisées.
Bagages en soute et transport de fret
Du point de vue du voyageur, il semble injuste qu’un passager voyageant uniquement avec un bagage à main bénéficie se voit allouer la même empreinte carbone qu’une personne ayant enregistré 30 kg de bagages. De fait, la plupart des calculateurs se basent sur un poids moyen unique pour les bagages. Le calcul est donc surestimé pour les voyageurs légers et sous-estimé pour les voyageurs lourds.
De meilleures approches permettraient aux utilisateurs de déclarer leurs bagages lors du calcul, ou d’appliquer des facteurs spécifiques à leur itinéraire.
De plus, la plupart des vols passagers transportent également du fret en soute. Si un calculateur attribue toutes les émissions de l’avion aux passagers, il surestime les chiffres par passager. Une pratique plus équitable consisterait à répartir les émissions entre les passagers et le fret aérien.
Comment faire mieux ?
Sur la base de récents travaux de recherche évalués par les pairs, voici une liste de contrôle que vous pouvez appliquer à tout calculateur de vol.
La prochaine fois que vous lirez une estimation de l’empreinte carbone de votre vol, demandez-vous si elle est :
complète : inclut-elle uniquement le CO2, un équivalent CO2 et les émissions hors CO2 ? Est-elle conforme à la norme ISO 14083 ou supérieure et couvre-t-elle l’ensemble des émissions générées par un passager aérien ?
précise : utilise-t-elle des méthodes modernes basées sur des données réelles régulièrement actualisées pour prédire la trajectoire de vol et la consommation de carburant ? Prend-elle en compte toutes les variables, y compris les facteurs de charge de l’appareil et les configurations des sièges à bord ?
transparente : les méthodes et les sources de données utilisées sont-elles indiquées avec leurs limites ? Ont-elles fait l’objet d’une évaluation par des pairs ?
communiquée efficacement : fournit-elle une ventilation claire des sources d’émissions de votre vol ? Est-elle facile à comprendre et à utiliser pour prendre des décisions ciblées en matière de climat ?
Lorsque les calculateurs cochent toutes ces cases, on peut faire passer le débat de l’examen d’un seul chiffre à l’action sur les principales causes. C’est à cette condition que le calcul de l’empreinte carbone, plutôt que de simples chiffres sur un écran, peut devenir un outil de changement.
À lire aussi : L’insolent succès des jets privés, entre empreinte carbone et controverses
Finn McFall travaille sur un partenariat de transfert de connaissances entre Therme Group et l'université du Surrey, cofinancé par UKRI via Innovate UK.
Xavier Font travaille pour l'université du Surrey. Il fait partie de l'équipe universitaire qui travaille sur un partenariat de transfert de connaissances entre Therme Group et l'université du Surrey, cofinancé par UKRI via Innovate UK.
25.11.2025 à 15:46
Comment lutter contre le changement climatique sans creuser les inégalités entre Nords et Suds ?
Rihi Yanis, Doctorant en économie politique du développement, Université Paris-Saclay
Texte intégral (3716 mots)
Alors qu’à Belém, la COP30 a échoué à accélérer la lutte contre le changement climatique, une question demeure, abyssale : peut-on lutter contre le changement climatique sans accroître les inégalités entre populations ? En d’autres termes, peut-on œuvrer à une transition juste ? Pour répondre à cette question, il faut tout à la fois revenir en arrière et ausculter les différentes dimensions de la justice climatique.
Peut-on légitimement demander au Mozambique ou au Sénégal de renoncer à leurs ressources fossiles alors qu’ils remboursent chaque année davantage en dette extérieure qu’ils ne reçoivent d’aide climatique ? Comment construire une transition mondiale juste tandis qu’une partie des pays les plus vulnérables doivent s’endetter pour financer leur propre adaptation ? Et comment imaginer une trajectoire commune alors que les responsabilités historiques liées à l’exploitation des ressources des Suds continuent d’être ignorées ?
Voici quelques-unes des interrogations qui émergent lorsqu’on pense à une réponse globale au changement climatique dans un monde profondément inégal. Elles ont pour toile de fond une tension de plus en plus visible au cœur des politiques climatiques : la transition vers des économies décarbonées peine encore à se déployer sans reproduire les déséquilibres historiques, tant à l’intérieur des pays qu’à l’échelle internationale.
Dans ce contexte, l’idée de « transitions justes » prend de l’ampleur. Elle propose d’articuler l’action climatique autour de principes de justice, d’équité et de responsabilité historique. Pour de nombreux pays, notamment dans les Suds, les récits qui s’y rattachent deviennent un horizon éthique et politique essentiel pour penser les transformations écologiques à partir des réalités locales, des vulnérabilités propres et des capacités d’action inégales.
Des luttes ouvrières à l’agenda climatique mondial
Cette idée d’une transition juste n’est pourtant pas nouvelle. Elle puise ses origines dans les mouvements syndicaux états-uniens des années 1970, au moment où l’écologie politique émerge. À cette époque, Tony Mazzocchi, alors vice-président du syndicat des travailleurs du pétrole, de la chimie et de l’atome (Oil, Chemical and Atomic Workers Union, OCAW) défend un principe simple : les protections environnementales sont nécessaires, certes, mais leurs coûts ne doivent pas être supportés exclusivement par les travailleurs dans les secteurs les plus exposés.
Il propose donc la création du Superfund for Workers, destiné à indemniser les travailleurs affectés par les nouvelles régulations environnementales. Le fonds voit le jour en 1993, puis est rebaptisé Just Transition Fund en 1995, faisant entrer l’expression dans le vocabulaire politique.
Par la suite, dans les années 1990, la Confédération syndicale internationale (CSI) internationalise le concept. En amont de la COP15 de Copenhague (2009), elle mobilise syndicats et ONG pour rappeler que la transition écologique ne peut se faire au détriment des plus vulnérables. La transition juste s’inscrit dès lors au croisement du développement durable et de la lutte contre le changement climatique. Elle vise une reconnaissance claire de la nécessité de garantir la justice sociale dans les processus de transition et les stratégies de résilience climatique.
Mais à mesure qu’il circule entre institutions, gouvernements et organisations internationales, le concept se transforme. Avec son inscription subséquente dans le préambule de l’accord de Paris (2015), il glisse vers des cadres plus technocratiques, au risque de s’éloigner de sa dimension contestataire initiale.
Une même transition pour tous ?
Dans les Nords, les transitions justes sont généralement envisagées comme des mécanismes d’accompagnement social : reconversion professionnelle, soutien aux territoires dépendants des énergies fossiles, garanties sociales. L’enjeu est essentiellement domestique, le concept servant à limiter les effets sociaux de la décarbonation, sans remettre en question les fondements extractivistes et énergivores du modèle économique actuel.
Dans les Suds, la signification tend à être radicalement différente. En Amérique latine, en Afrique ou en Asie du Sud-Est, universitaires, mouvements sociaux et représentants gouvernementaux s’en saississent comme d’un objet de discours critique, parfois explicitement décolonial, pour questionner les règles du jeu global. Ici, les transitions justes incluent les dimensions internationales : les injonctions extérieures, la cohérence des politiques climatiques globales, les impacts socio-économiques transnationaux, les conditionnalités financières et la répartition mondiale des coûts et des opportunités.
Selon cette dynamique, les transitions justes apparaissent alors comme une rupture possible avec le paradigme dominant actuel. Là où depuis les années 1990 le développement durable s’est construit dans des cadres descendants, les propositions issues des Suds s’appuient plutôt sur des démarches ascendantes, portées par des syndicats, des mouvements sociaux ou des collectifs comme la Pan African Climate Justice Alliance ou Climate Strategies. Certaines coalitions comme Just Transition Africa, revendiquent, à titre d’exemple, une réappropriation souveraine des trajectoires de développement, fondée sur les besoins locaux et affranchie des conditionnalités financières internationales.
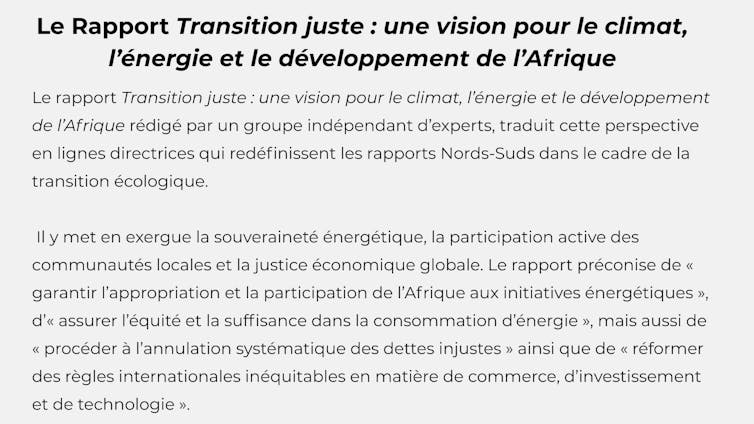
Ces voix posent, en creux, une interrogation essentielle : à qui profite réellement la transition, et qui en définit les règles ?
Les pays des Suds doivent-ils choisir entre développement et climat ?
Ce débat met également au jour un dilemme d’éthique climatique majeur : comment concilier le droit au développement des pays des Suds avec les contraintes globales de la décarbonation ? Les pays industrialisés ont bâti leur croissance sur l’exploitation massive des ressources naturelles, notamment dans les Suds, au prix d’une importante dette carbone. Les Suds, eux, sont aujourd’hui invités à limiter leur industrialisation, alors même que beaucoup n’ont pas encore atteint des niveaux de développement humain fondamentaux. Une situation inégale qui, encore aujourd’hui, demeure un facteur majeur de sous-développement et d’accroissement des inégalités à l’échelle mondiale.
Cela nous renvoie d’ailleurs au principe des « responsabilités communes mais différenciées », inscrit dans la déclaration de Rio (1992). Mais aussi, plus clairement, au bagage normatif de la notion même de développement. Réduire celui-ci à la seule croissance économique revient en effet à occulter sa dimension sociale, politique et environnementale, et crée des tensions avec d’autres droits essentiels.
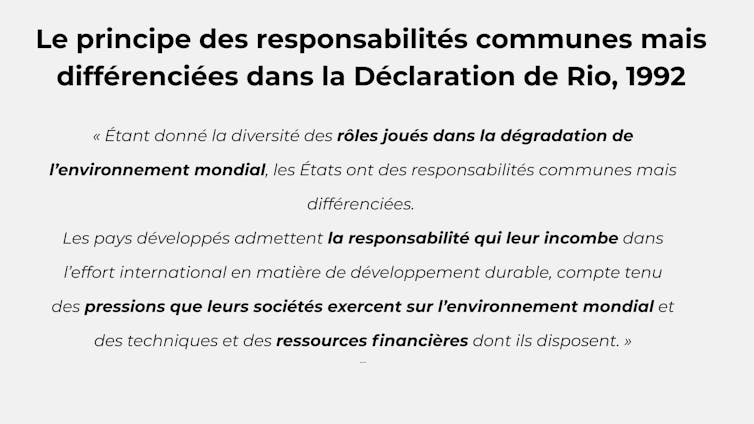
Comme le rappelle le philosophe camerounais Thierry Ngosso, un « droit au développement » compris dans une perspective strictement productiviste peut devenir paradoxal dans la mesure où il risque de nuire précisément aux populations qu’il prétend protéger, en sacrifiant leurs conditions de vie ou leur environnement au nom de la croissance.
Or ce sont les groupes les plus pauvres, aux Suds comme aux Nords, qui subissent déjà le plus fortement les impacts du dérèglement climatique. L’enjeu consiste donc à articuler justice sociale et soutenabilité écologique en concevant des trajectoires de développement adaptées à la pluralité de société des Suds, plutôt que de reproduire des modèles hérités et inadaptés.
À lire aussi : Mesurer le bonheur pour mieux penser l’avenir : l’initiative du Bonheur Réunionnais Brut
La finance climatique perpétue-t-elle l’injustice ?
Penser des transitions justes, c’est aussi se pencher sur le financement climatique, qui cristallise une grande partie des tensions internationales. À la COP29, les négociations ont abouti, dans le cadre du New Collective Quantified Goal on Climate Finance à un compromis non contraignant prévoyant de tripler les financements climatiques publics destinés aux pays en développement, pour atteindre 300 milliards de dollars (un peu moins de 260 milliards d’euros) d’ici 2035, par rapport à ceux fixés en 2009.
L’accord prévoit également de mobiliser jusqu’à 1 300 milliards de dollars (soit plus de 1 125 milliards d’euros) par an à la même échéance, en combinant ressources publiques et privées. En outre, l’absence d’engagements fermes, ainsi que l’élusion de la question des modalités d’application et de fonctionnement du Fonds de réponse aux pertes et préjudices (Fund for responding to Loss and Damage), élément pourtant central de la justice climatique, ont suscité de vives critiques, notamment de la part de négociateurs africains et d’organisations de la société civile.

Mais au-delà des montants, c’est la nature même du financement qui pose problème. La majorité des fonds destinés aux pays en développement prennent la forme de prêts, souvent conditionnés à des projets d'atténuation jugés sur des critères de rentabilité. À l’inverse, l’adaptation, la résilience ou les réparations reçoivent des financements limités.
Cette logique entretient un cercle vicieux : en 2023, les pays en développement ont consacré plus de 1 400 milliards de dollars (soit plus de 1 210 milliards d’euros) au service de leur dette, bien davantage que les fonds reçus pour faire face à la crise climatique. Ainsi, loin de réduire les vulnérabilités, la finance climatique contribue souvent à les renforcer, limitant au passage leur marge de manœuvre pour investir dans des politiques écologiques transformatrices.
Dans la continuité, le Fund for responding to Loss and Damage créé à l’issue de la COP27, et temporairement géré par la Banque mondiale depuis 2024, est lui aussi illustratif de certaines tensions. Peut-on parler de justice climatique lorsque les créanciers, pour la plupart rattachés aux Nords, déterminent les modalités de financement des victimes du changement climatique ? Pour de nombreux acteurs des Suds, ces mécanismes perpétuent ainsi les logiques de dépendance et de domination, donnant lieu à des inégalités reproductives, tout en éludant les questions fondamentales d’équité et de responsabilité.
Penser les transitions à la lumière de quelques principes de justice
Au fil des dernières années, l’idée de transitions justes s’est progressivement élargie. Désormais pensée au pluriel, elle désigne moins un modèle clé en main qu’un ensemble de principes visant à garantir que les politiques climatiques engagent et protègent les personnes et les communautés les plus vulnérables.
Ainsi, mobiliser la notion de justice ne consiste pas à établir une norme singulière de ce que devrait être une « bonne » transition, mais plutôt à ouvrir une grille de lecture critique pour interroger les modalités concrètes du changement : les effets sociaux, économiques, territoriaux et politiques de la transition.
À ce titre, quatre dimensions de la justice permettent d’éclairer la profondeur, ou les limites, des transformations en cours :
La justice distributive : elle interroge la répartition équitable des coûts, opportunités et risques liés aux politiques climatiques et à leurs effets. Qui paie, qui bénéfice ? Dans de nombreux cas, les mesures climatiques produisent des impacts très inégaux, renforçant les déséquilibres existants.
La justice procédurale : elle concerne la capacité réelle des personnes affectées à participer aux décisions qui les touchent. Qui a voix au chapitre ? Qui décide, et selon quelles règles ? Dans la pratique, les politiques climatiques sont souvent élaborées par des experts ou des institutions éloignées du terrain, laissant de côté les communautés les plus concernées.
La justice corrective, restaurative ou réparatrice : elle met l’accent sur la reconnaissance et la réparation des dommages historiques liés au changement climatique et aux modèles de développement à l’origine de la crise écologique. Comment reconnaître et réparer les inégalités issues de l’exploitation, de la pollution, de la dette écologique ou de la dépossession foncière ?
La justice de reconnaissance : elle porte sur les formes de domination symbolique et sur la manière dont elles influencent les trajectoires de transition. Quels savoirs, quelles visions du monde sont prises en compte ? Lesquelles sont ignorées, minorées ou rendues invisibles ? Elle vise ainsi à ouvrir la voie à des transformations sociétales réellement inclusives.
Ces dimensions invitent à se pencher sur les conflits de valeurs, les asymétries de pouvoir, et les rapports de domination enracinés dans l’histoire coloniale et postcoloniale du capitalisme. Comme le montre une partie croissante de la recherche issue des Suds, ignorer ces registres de justice revient à passer sous silence les rapports de force qui structurent les transitions, au risque, parfois même, de reproduire des dynamiques extractivistes sous couvert d’écologie.
Plus clairement, appréhender les transitions à l’aune de ces quatre modalités relève moins d’une prescription normative que d’une invitation à questionner les conditions mêmes du changement.
Une transition est-elle possible sans justice ?
Dans les pays des Suds, les transitions justes demeurent largement expérimentales. Si le concept s’est installé dans les discours, il peine encore à se traduire en politiques publiques du fait de certaines réalités structurelles, comme l’informalité des marchés du travail, l’insécurité foncière, la précarité énergétique ou la dépendance aux financements extérieurs.
Des initiatives existent, mais elles rappellent surtout combien la justice reste une condition centrale de toute transformation durable dans l’espace et le temps. Qu’il s’agisse de partenariats Nords-Suds ou de coopérations Sud-Sud, leur réussite dépend moins des montants mobilisés que de leur capacité à renforcer la souveraineté des pays concernés et à inscrire les décisions dans les besoins sociaux et écologiques réels.
En définitive, les transitions justes ouvrent un espace où se confrontent tensions, contradictions et aspiration autour de la justice climatique. D’un côté, elles ont le mérite de mettre au jour les conflits entre impératifs climatiques, justice sociale et rapports de pouvoir internationaux. De l’autre, elles interrogent en profondeur notre conception même du développement, des responsabilités et des éthiques censées orienter les transformations à venir.
Reste alors une question ouverte, celle de savoir si la transition sera un projet réellement collectif, pensé aussi depuis les Suds, ou bien une nouvelle déclinaison des logiques qui ont façonné les inégalités passées ?
Rihi Yanis ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
24.11.2025 à 16:30
Peut-on réparer ailleurs la nature détruite ici ? Comment libérer la compensation écologique des influences politiques
Stéphanie Barral, Sociologue de l'économie et chargée de recherches, Inrae
Christine Jez, Ingénieur de recherche, Inrae
Texte intégral (2055 mots)
La compensation écologique, qui consiste à restaurer des écosystèmes ailleurs pour compenser une perte de biodiversité ici, a le vent en poupe auprès des décideurs. Elle n’a pourtant rien d’une solution miracle : son efficacité réelle reste très débattue dans la communauté scientifique. Surtout, elle dépend de rapport de force où s’opèrent des arbitrages entre développement économique et protection de la nature. Une plus grande prise en compte des sciences sociales permettrait une meilleure appropriation de ces influences qui pèsent sur les politiques environnementales.
Depuis les années 1990, la compensation de la biodiversité s’est imposée à travers le monde comme un outil de politique environnementale. Son principe est de contrebalancer les pertes écologiques causées par les projets d’aménagement. L’idée est simple : lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement affecte un écosystème, des mesures de compensation doivent être mises en place pour restaurer ou protéger une zone équivalente ailleurs.
Adoptée dans de nombreux pays, l’efficacité de ce mécanisme est toutefois insuffisante. Derrière cette idée comptable d’un équilibre que l’on pourrait restaurer se cache un processus complexe, soumis à de multiples arbitrages, contraintes techniques et enjeux temporels, comme le révèle une étude que nous avons publiée dans Nature Sustainability.
Dans celle-ci, nous avons mené une revue de publications scientifiques et institutionnelles internationales pour répondre à une question : comment les politiques de compensation de la biodiversité sont-elles conçues et influencées ?
Multiples acteurs, multiples influences
Les études en écologie scientifique postulent généralement que de meilleures connaissances scientifiques conduisent à de meilleures politiques environnementales, mais nous montrons la nécessité de prendre en compte les rapports de force structurels qui les affaiblissent.
En effet, la gouvernance de la compensation de la biodiversité, loin de reposer uniquement sur des données scientifiques et des métriques écologiques, est aussi marquée par les interactions entre différents acteurs – États, entreprises, ONG environnementales, institutions scientifiques et citoyens – qui cherchent à façonner les règles du jeu selon leurs intérêts. Parfois au risque de saper les fondements de ces programmes.
La compensation est souvent présentée comme une solution pragmatique conciliant développement économique et conservation de la nature, mais elle suscite en réalité de nombreux débats.
D’un côté, les gouvernements, les institutions internationales et les grandes ONG environnementales (comme l’Union internationale pour la conservation de la nature, UICN) la défendent comme un outil pragmatique permettant de concilier conservation et développement économique.
De l’autre, les lobbies industriels et les entreprises cherchent à encadrer ce dispositif de manière à maximiser leur flexibilité et à minimiser leurs coûts.
Les débats ne sont pas seulement techniques, ils touchent à des questions politiques sensibles. Par exemple, la compensation doit-elle être une obligation réglementaire ou un engagement volontaire ? Qui doit en assurer le contrôle ? Peut-elle être confiée à des acteurs privés à travers des marchés de crédits environnementaux ?
À lire aussi : Histoire des crédits carbone : vie et mort d'une fausse bonne idée ?
Mise à l’agenda, élaboration et mise en œuvre
Les auteurs identifient trois grandes étapes à travers lesquelles tous ces acteurs tentent d’orienter les politiques de compensation écologique.
D’abord la mise à l’agenda, qui est le moment où la compensation devient un enjeu de politique publique. Cette phase est marquée par des discussions sur la nécessité de compenser les dommages causés à la biodiversité et sur les méthodes à adopter.
Différents acteurs y participent, notamment les gouvernements, les institutions internationales, les scientifiques et les ONG qui militent pour des mesures de conservation plus strictes. L’implication croissante d’acteurs privés à cette étape s’accompagne, depuis quelques décennies, d’un recours plus affirmé aux mécanismes de marché plutôt que réglementaires.
La deuxième étape est l’élaboration des politiques en elles-mêmes, lorsque la compensation est traduite en lois et en règlements. Des questions cruciales sont débattues, comme le type d’impacts environnementaux à compenser, les obligations imposées aux entreprises ou encore le mode de financement de ces mesures.
C’est aussi un moment où les lobbyistes interviennent pour orienter la réglementation dans un sens plus ou moins contraignant. Aux États-Unis, par exemple, la National Environmental Banking Association a plaidé pour des règles plus cohérentes afin de réduire l’incertitude pour les entreprises. En France, des représentants d’intérêts comme ceux des carrières participent activement aux discussions sous l’égide du ministère de l’écologie.
Les décisions et orientations des politiques de compensation reposent donc à la fois sur des considérations scientifiques (quels sont les écosystèmes à protéger, quels sont les impacts les plus importants, quels sont les meilleurs indicateurs pour piloter les politiques) et la participation de représentants sectoriels. Cela peut conduire à une politisation de l’écologie scientifique au profit d’intérêts particuliers.
Enfin, cette influence intervient aussi au moment de la mise en œuvre sur le terrain. En effet, l’application des politiques de compensation implique une multitude d’interactions entre les acteurs locaux, les entreprises et les agences environnementales. L’interprétation des règles, la définition des critères écologiques et la surveillance des compensations sont autant de points négociés qui influencent les résultats concrets des programmes.
En Australie, une étude montre que la compensation est appliquée différemment selon les États, certains adoptant une approche plus flexible, ce qui peut limiter les résultats écologiques.
À lire aussi : Objectif ZAN : comment tenir les comptes ?
Les limites à une compensation efficace
Malgré son potentiel, la compensation de la biodiversité suscite donc des interrogations sur son efficacité réelle. Nous avons relevé plusieurs points critiques :
Le manque de transparence Les négociations sur la mise à l’agenda et sur la mise en œuvre des compensations se déroulent souvent dans des espaces peu accessibles au public, limitant la possibilité de vérifier leur pertinence et leur inscription dans un débat ouvert.
Le déséquilibre des pouvoirs Les entreprises et coalitions d’acteurs économiques privés disposent de ressources importantes pour influencer la conception des politiques, ce qui peut entraîner des compromis moins favorables à la biodiversité.
La science peut être un objet d’influence Des connaissances écologiques sont mobilisées dans la décision lors de toutes les étapes de la politique publique, y compris dans les contentieux administratifs. Les études peuvent être produites par des acteurs publics, privés ou encore associatifs, et la multiplicité des critères facilite l’instrumentalisation des connaissances au service d’intérêts particuliers.
La fragilité des résultats au plan écologique Certaines études montrent que les compensations ne parviennent pas toujours à restaurer les écosystèmes de manière équivalente, ce qui pose la question de leur efficacité à long terme. En France par exemple, une étude sur des sites restaurés a révélé que leur biodiversité restait inférieure à celle des sites naturels d’origine, malgré les efforts de compensation.
La définition du périmètre de la compensation C’est un enjeu majeur mais pourtant peu appréhendé dans les études scientifiques. Quels types d’écosystèmes et d’espèces doivent être protégés ? Certains pays, comme les États-Unis, se concentrent sur les espèces menacées, tandis que d’autres, comme la France, intègrent des approches basées sur les habitats. Ces choix ne sont jamais neutres : ils reflètent des arbitrages entre des exigences écologiques et des impératifs économiques qui ne sont pas uniquement guidés par la science et résultent généralement de négociations entre parties prenantes.
Une gouvernance à améliorer
Pour améliorer la gouvernance de la compensation de la biodiversité, nous suggérons plusieurs pistes et plaidons pour une meilleure intégration des sciences sociales dans l’action publique environnementale.
Il convient d’abord de mener davantage d’études comparatives pour évaluer comment les politiques sont mises en place dans différents pays. Cela permettrait de mieux comprendre les stratégies de contournement et d’obstruction dont elles font l’objet.
Pour renforcer l’indépendance des instances de régulation et assurer une plus grande transparence sur les relations entre entreprises, décideurs publics et experts scientifiques, nous appelons également à mieux encadrer l’influence du secteur privé afin de limiter les conflits d’intérêts.
Enfin, nous estimons qu’il est nécessaire de capitaliser sur les savoirs des sciences sociales. Une meilleure circulation de ces derniers renforcerait l’évaluation des politiques environnementales.
En définitive, la compensation de la biodiversité ne peut pas être considérée comme une solution miracle. Elle repose sur des compromis entre développement économique et préservation de la nature, ce qui en fait un domaine où les enjeux politiques et financiers sont omniprésents. Jusqu’à présent, elle n’a pas témoigné de sa capacité à enrayer l’érosion de la biodiversité et les études en écologie attestant ses limites s’accumulent.
Face à cela, les sciences sociales peuvent apporter une meilleure compréhension des stratégies d’influence d’acteurs engagés dans la protection de leurs intérêts particuliers. Elles ne se substitueront pas à un portage politique ambitieux, mais pourront certainement l’accompagner.
Stéphanie Barral a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche et de la Fondation Jefferson pour enquêter sur les politiques de compensation écologique.
Christine Jez ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
