05.01.2026 à 17:56
Vivre dans un logement trop froid : la réalité sociale de la précarité énergétique
Bérangère Legendre, Professor, Université Savoie Mont Blanc
Dorothée Charlier, Maîtresse de conférences en économie de l’énergie et de l’environnement, IREGE, IAE Savoie Mont Blanc
Texte intégral (2227 mots)
La précarité énergétique est un fléau qui concerne de plus en plus de personnes du fait de la volatilité des prix de l’énergie. Elle a des répercussions sur la santé physique et mentale, sur la vie sociale et même sur la scolarité des enfants.
Alors que l’hiver s’installe, environ 3 millions de ménages en France sont de nouveau confrontés à une difficulté majeure : celle de la précarité énergétique.
Elle se matérialise par des privations, mais également par un sentiment de honte et une exclusion sociale qui en résultent. Ses effets peuvent être multiples, allant même jusqu’à augmenter l’absentéisme scolaire. Les conséquences sociales et sanitaires, longtemps sous-estimées, sont aujourd’hui mieux documentées par la recherche.
Ce que signifie « être en précarité énergétique » au quotidien
La définition française du phénomène est large : une personne est en précarité énergétique lorsqu’elle rencontre des difficultés à disposer, dans son logement, de l’énergie nécessaire pour répondre à ses besoins de base, du fait de faibles ressources ou de conditions de logement inadéquates. Cela signifie vivre dans un logement trop froid l’hiver, trop chaud l’été, souvent mal isolé, où l’on chauffe une seule pièce pour réduire la facture, où l’on évite d’allumer la lumière, où la présence de moisissures ou d’humidité peut devenir chronique. Ces conditions entraînent fréquemment des comportements de restriction d’énergie, c’est-à-dire consommer volontairement moins que ce qui serait nécessaire au confort ou à la santé. Parfois, cela signifie également passer sous le radar des politiques publiques, car les dépenses en énergie sont volontairement modérées.
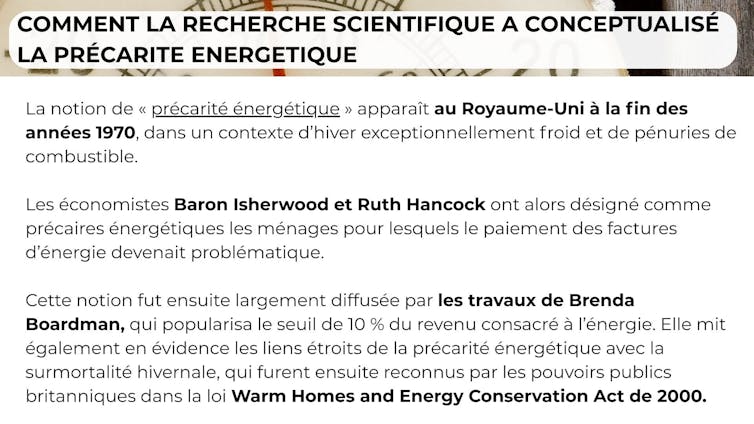
Cette situation est d’autant plus fréquente que les prix de l’énergie sont volatiles ces dernières années. En 2018 déjà, 34 millions d’Européens déclaraient ne pas pouvoir chauffer correctement leur logement. Les tensions énergétiques depuis 2021 ont encore accentué ce phénomène : les ménages les plus modestes ont consacré une part croissante de leur budget à leurs factures, réduisant leurs marges de manœuvre.
Les conditions de logement jouent également un rôle central : mauvaise isolation, appareils de chauffage vétustes, infiltrations d’eau, ventilation insuffisante, autant de facteurs qui rendent impossible le maintien d’un confort minimal à un coût acceptable.
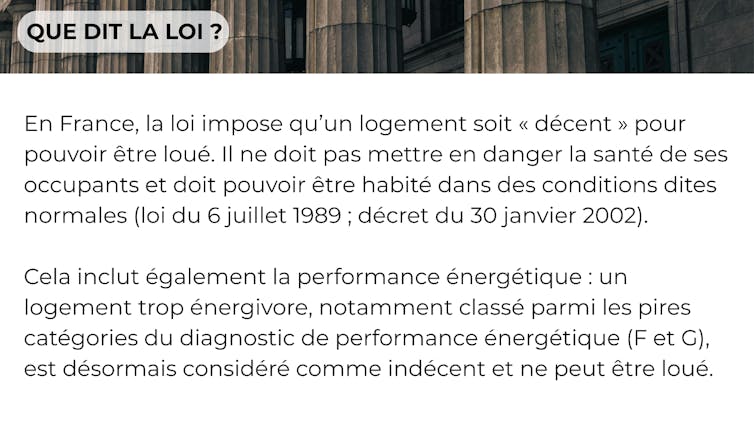
Qui sont les ménages les plus touchés ?
La recherche en économie identifie de manière cohérente trois déterminants de la précarité énergétique : bas revenus, mauvaise performance énergétique du logement et prix élevés de l’énergie. Mais au-delà de ce triptyque, les recherches récentes en la matière apportent des précisions essentielles.
En France sont particulièrement exposés :
les personnes âgées, davantage présentes dans des logements anciens, peu isolés, et disposant de faibles revenus ;
les ménages isolés, notamment les femmes seules ou les familles monoparentales, dont les dépenses fixes pèsent plus lourd dans le budget ;
les locataires du parc privé, souvent logés dans des habitats moins performants que le parc social qui est susceptible de bénéficier d’une meilleure qualité énergétique ;
les ménages vivant dans des logements anciens qui n’ont pas fait l’objet de rénovation et qui utilisent plus fréquemment du gaz ou du fioul et qui font donc face à un coût de l’énergie plus important.
Par ailleurs, les ménages « énergétiquement vulnérables », qui ne sont pas définis comme étant en précarité énergétique mais peuvent basculer en cas de choc (hausse de prix, panne d’équipement, baisse de revenu), sont souvent ignorés des politiques publiques, car mal identifiés. Ces ménages représentent un enjeu majeur pour les politiques publiques, car ils n’entrent pas dans les seuils traditionnels utilisés pour mesurer le phénomène.
Les effets de la précarité énergétique dépassent largement l’inconfort thermique. Ils touchent la santé, la vie sociale et les perspectives économiques.
Les impacts sur la santé physique
Un logement trop froid augmente les risques de maladies respiratoires et cardiovasculaires, aggrave les symptômes des personnes souffrant de maladies chroniques, comme l’arthrose ou la polyarthrite rhumatoïde, et favorise l’apparition de moisissures responsables d’allergies ou d’asthme. Être en précarité énergétique multiplierait par sept le risque de mauvaise santé pour les personnes déjà fragiles.
Les coûts associés pour la collectivité sont considérables : près d’un milliard d’euros de dépenses médicales directes en France, et plus de 20 milliards si l’on inclut les coûts indirects liés à la perte de productivité ou aux arrêts maladie.
Une dégradation marquée de la santé mentale
Un résultat central a été établi pendant la crise sanitaire du Covid-19 : la précarité énergétique a un effet causal fort et significatif sur la santé mentale, dégradant les scores d’anxiété, de dépression et de santé sociale. Être en situation de précarité énergétique aurait réduit en moyenne le score de santé mentale de 6,3 points sur 100 et augmenté le score de dépression de 5,35 points et celui d’anxiété de 6,48 points pendant cette période durant laquelle la majeure partie de la population française et européenne a été confinée à domicile à intervalles réguliers.
La situation était encore plus grave pour les personnes déjà fragilisées : pour le tiers le plus vulnérable de la population, l’effet négatif sur la santé mentale atteignait 20 points. L’utilisation des scores permet de quantifier les effets de la précarité énergétique : un score de santé de 100 indique la meilleure santé qui soit, tandis qu’un score de dépression de 100 indique le niveau le plus élevé de dépression.
Une spirale d’isolement et de honte
Plusieurs travaux sociologiques montrent également que les personnes vivant dans des logements froids ou dégradés évitent d’inviter des proches, se replient sur elles-mêmes, et peuvent éprouver un sentiment de honte ou d’échec. Les difficultés à payer les factures conduisent parfois à des coupures d’énergie ou au risque d’endettement, renforçant encore la vulnérabilité sociale.
La précarité énergétique devient ainsi un facteur d’exclusion, au même titre que la pauvreté monétaire, mais en partie invisible car liée à l’espace privé du logement.
Noel Longhurst et Tom Hargreaves, deux chercheurs en sciences de l’environnement, rapportent ainsi dans une de leur publication de 2019 les propos de Barbara, une trentenaire britannique qui souffre de précarité énergétique :
« Je ne reçois personne. Je ne reçois pas d’amis… Personne. Je ne pense pas avoir reçu d’amis depuis environ trois ans… Je n’aime pas la condensation, et c’est très important pour moi. C’est embarrassant. Je suis gênée quand je sors le matin et que je vois qu’on ne peut pas voir à travers les fenêtres. »
Des répercussions sur les trajectoires scolaires
La précarité énergétique affecte également la scolarité des enfants. Vivre dans un logement froid ou mal chauffé complique le travail scolaire à domicile, perturbe le sommeil et accroît la fatigue, avec des effets potentiels sur l’attention et l’apprentissage.
En France, le défenseur des droits souligne que ces conditions de vie dégradées portent atteinte au droit des enfants à un environnement propice aux études et peuvent peser sur leurs résultats scolaires. Ces constats rappellent que la précarité énergétique est aussi un enjeu éducatif et d’égalité des chances.
Un enjeu européen majeur, des réponses encore insuffisantes
Si la France a développé plusieurs outils (chèques énergie, aides à la rénovation, développement du parc social), la littérature montre que les politiques purement financières ont des effets limités, alors que les actions structurelles – rénovation thermique, construction de logements sociaux performants – ont un impact durable sur la réduction de la précarité énergétique.
À l’échelle européenne, la Commission a inscrit la lutte contre la précarité énergétique au cœur de la directive sur l’efficacité énergétique révisée adoptée en 2024. Mais les disparités restent fortes, et la crise énergétique a rappelé la nécessité d’une stratégie plus ambitieuse, combinant protection des ménages, transition énergétique et amélioration massive du parc résidentiel.
Bérangère Legendre a reçu des financements de la Chaire de l'Economie Environnementale (Fondation Université Savoie Mont Blanc).
Dorothée Charlier est membre de la SOLAR ACADEMY.
05.01.2026 à 17:51
La hausse du prix du carbone conduit-elle à supprimer des emplois ?
Jana Boeckx, Assistant Professor of Finance, IÉSEG School of Management
Texte intégral (1374 mots)

Une étude met en lumière le lien entre hausse du prix du carbone et suppressions d’emplois. Depuis 2017, une augmentation significative du prix des émissions est en cours, désormais 17 fois plus élevé en 2025 qu’en 2017. Si toutes les entreprises affichent leur mécontentement, elles n’adoptent pas les mêmes stratégies selon qu’elles sont cotées en bourse ou non. Avec pour principaux perdants, les cols bleus.
En 2017, le Conseil européen a introduit des réformes majeures dans le système européen d’échange de quotas d’émission, provoquant une forte hausse du prix du carbone. Le prix d’une tonne d’émissions équivalentes en CO2 a doublé, passant de 5,15 euros par tonne d’émissions le 1er janvier 2017 à 11,06 euros le 1er janvier 2018, puis à 22,23 euros le 1er janvier 2019.
L’objectif est clair : rendre la pollution plus coûteuse, afin d’inciter les entreprises à réduire leurs émissions. Mais cette hausse des coûts a eu un effet inattendu, certaines entreprises ont réagi en supprimant des emplois.
Dans notre étude, nous mettons en évidence un lien clair entre la hausse des prix du carbone et les suppressions d’emplois et les ventes d’actifs de production (machines, équipements) par les entreprises.
Alors, la transition climatique se fait-elle au prix de l’emploi ?
Voici quelques entreprises bien connues qui relèvent de ce système : Carrefour, Sanofi, TotalEnergies, Engie, etc.
Hausse du prix du carbone
L’un des outils politiques largement utilisés pour atteindre cet objectif est le système de plafonnement et d’échange, ou cap-and-trade system. L’exemple le plus marquant est le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE-UE), souvent considéré comme une référence.
Malgré sa réputation mondiale, le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne a eu du mal pendant des années à fixer des prix significatifs pour le carbone. Au cours de sa phase initiale de 2005 à 2007, beaucoup de permis de pollution ont été distribués, ce qui a entraîné une faible demande et fait baisser les prix.
La période suivante de 2008 à 2012 a coïncidé avec la crise financière mondiale, qui a fortement réduit l’activité industrielle et, par conséquent, les besoins en quotas d’émission. Même si le plafond d’émissions a été réduit de 6,5 %, les prix sont restés obstinément bas. Pendant plus d’une décennie, le système n’a pas réussi à créer la pression financière nécessaire pour entraîner des réductions importantes des émissions.
En 2017, l’Union européenne a corrigé cette situation en réduisant l’offre de quotas (the cap) par 2,2 % annuelle. L’enjeu : doubler la canalisation des quotas vers une nouvelle réserve de stabilité du marché, ou Market Stability Reserve, jusqu’à 2023 et ajouter un mécanisme d’annulation pour supprimer définitivement les quotas inutilisés lors de la phase suivante. L’impact a été immédiat puisque le prix d’émission est passé d’un peu plus de 5 euros début 2017 à 11 euros un an plus tard, puis à environ 32 euros en 2020.
Les industriels du carburant vent debout
Cette intervention a suscité une opposition importante de la part des entreprises, des syndicats et des groupes d’intérêt industriels. Ils craignent que l’augmentation des coûts du carbone ne pousse la production et les emplois hors d’Europe. Par exemple FuelsEurope, qui représente l’industrie européenne des carburants, et les producteurs d’acier ont exprimé leurs préoccupations, avertissant que les coûts supplémentaires les rendraient moins compétitifs à l’échelle mondiale
Pourtant, il existe peu de preuves tangibles pour étayer ces affirmations. Les entreprises soumises au SEQE-UE sont 3,4 % plus susceptibles de réduire leurs effectifs que leurs homologues non soumises au SEQE-UE.
À lire aussi : Histoire des crédits carbone : vie et mort d'une fausse bonne idée ?
Distinction entre entreprises cotées et non cotées
Cette tendance est loin d’être uniforme. Les entreprises cotées en bourse ne réduisent pas leurs effectifs, tandis que les entreprises non cotées les diminuent de manière plus marquée, avec des baisses pouvant atteindre 3,5 % dans les entreprises les plus polluantes. Les petites entreprises cotées (en dessous de la moyenne de l’échantillon en termes d’actifs totaux) qui disposent d’une marge de manœuvre financière limitée réduisent également leurs effectifs, mais dans une moindre mesure que leurs homologues non cotées.
Qu’ajustent ces entreprises en réponse à la hausse des coûts liés au carbone ? Cherchent-elles à maintenir leur production à un niveau stable, mais avec moins de travailleurs et d’actifs ? Ou bien produisent-elles moins globalement, et ont donc besoin de moins de ressources ?
Nos conclusions révèlent une distinction nette. Les entreprises privées ont tendance à réduire leurs activités, en supprimant à la fois des emplois et des actifs, ce qui suggère une réduction délibérée de leur champ d’action global. En revanche, les petites entreprises cotées en bourse, qui disposent de peu de liquidités, réduisent principalement leurs effectifs, sans diminuer leur base d’actifs.
En d’autres termes, les entreprises privées non cotées réduisent leurs effectifs en faisant moins, tandis que les entreprises cotées en bourse réduisent leurs effectifs en essayant de faire la même chose avec moins de personnel.
Les cols bleus sont les plus touchés
Afin de mieux cerner les employés les plus touchés par ces changements, nous avons également examiné les conséquences de la flambée des prix du carbone dans le cadre du SEQE-UE en Belgique.
À partir de données administratives détaillées, nous avons constaté que l’impact est loin d’être réparti de manière uniforme. Les cols bleus, les hommes ayant un faible niveau d’éducation (généralement avec diplôme secondaire ou sans) sont les plus touchés. L’effet est particulièrement prononcé chez les personnes sous contrat à temps partiel.
Ces résultats ont des implications importantes pour les décideurs politiques qui pilotent la transition écologique en Europe. Bon nombre des nouveaux emplois verts créés exigent des employés hautement qualifiés. Ce décalage pourrait créer des déséquilibres sur le marché du travail, soulignant le besoin urgent de programmes de formation et de reconversion.
Jana Boeckx ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
05.01.2026 à 14:06
Pourquoi les fonds verts peinent à convaincre malgré une épargne record
Syrine Gacem, Docteur en sciences de gestion - Finance, Université Bourgogne Europe
Fabrice Hervé, Professeur en Finance, IAE Dijon - Université de Bourgogne
Sylvain Marsat, Professeur en Finance, Université Clermont Auvergne (UCA)
Texte intégral (1283 mots)

Alors que l’épargne des Françaises et des Français atteint 6,4 milliards d’euros au premier semestre 2025, elle n’est que peu dirigée vers la finance verte. Une étude, menée auprès de 2 215 investisseurs français âgés d’au moins 25 ans, cherche à comprendre les freins à l’investissement vert chez les ménages.
L’épargne des ménages français a atteint un niveau record au premier semestre de 2025, s’élevant à 6,4 milliards d’euros. Elle constitue un taux d’épargne de 18,9 % du revenu disponible. Un niveau si élevé qu’il attire désormais l’attention de l’État sur le financement de l’économie réelle.
Parallèlement, le vendredi 21 novembre 2025 a marqué la clôture de la COP30, où ont eu lieu des discussions rappelant l’ampleur des besoins de financement verts pour réussir la transition écologique. Les pays développés sont appelés à fournir au moins 1,1 milliard d’euros par an aux pays en développement d’ici 2035. « La finance est le levier d’accélération majeur », a rappelé le secrétaire exécutif d’ONU Climat, Simon Stiell, lors du Leaders’Summit au Brésil.
Malgré ce double constat d’abondance d’épargne des ménages et de besoin de financement des projets de transition écologique, l’investissement vert demeure une pratique marginale chez les ménages. Notre étude cherche à en comprendre les raisons.
Manque de transparence sur les fonds verts
Le manque de transparence sur l’impact écologique des fonds verts peut créer une ambiguïté chez les investisseurs particuliers quant à leur efficacité réelle à protéger l’environnement.
Un exemple emblématique est celui de DWS, filiale de Deutsche Bank, impliquée dans un scandale de dénomination environnementale trompeuse, après avoir exagéré les engagements verts de plusieurs de ses fonds. L’affaire s’est soldée par une amende de 25 millions d’euros infligée par la justice allemande en avril 2025.
Promesses écologiques non crédibles
Dans notre étude, nous avons mené une recherche auprès de 2 215 investisseurs français âgés d’au moins 25 ans, entre décembre 2021 et janvier 2022, via Panelabs.
L’échantillon est composé d’investisseurs âgés en moyenne de 47 ans, comprenant 47,3 % de femmes, disposant d’un revenu mensuel net moyen de 3 659 €, et ayant en moyenne un niveau d’éducation équivalent à bac+2. Afin d’évaluer leurs doutes sur l’efficacité réelle des fonds verts, nous leur avons posé la question suivante : « Les fonds verts sont un stratagème marketing pour vendre plus de fonds ». Les réponses étaient notées sur une échelle de 1 à 7, de « pas du tout d’accord » à « tout à fait d’accord ».
Les résultats sont clairs. Plus un investisseur estime que les fonds verts relèvent de promesses écologiques non crédibles, moins il est enclin à y investir. Concrètement, chaque point de hausse sur l’échelle de doute réduit la probabilité d’investir dans un fonds vert de 1,68 point de pourcentage. Mais ce n’est pas tout. Les investisseurs les plus méfiants allouent également des montants plus faibles à ces fonds.
Les jeunes plus sensibles à l’épargne verte
Ce frein n’impacte pas tous les investisseurs de la même manière. Deux profils s’avèrent moins sensibles à ces doutes : les plus jeunes, et ceux ayant un niveau d’éducation élevé. Ces derniers affichant des préférences environnementales très fortes ont tendance à accepter les fonds verts, sans trop les remettre en question, pour rester en accord avec leurs convictions écologiques. Ce phénomène s’explique notamment par la volonté d’éviter une dissonance cognitive entre leurs valeurs et leurs décisions financières.
Notre étude montre que ce frein affecte aussi bien les investisseurs conventionnels (qui n’ont jamais investi dans un fonds vert) que les investisseurs verts (ayant placé au moins 500 € dans un fonds vert). Chez les premiers, elle décourage l’intention d’investir dans des fonds verts. Chez les seconds, elle freine leurs investissements futurs.
Biais de négativité
L’effet dissuasif de la ruse marketing sur l’investissement vert peut s’expliquer à la lumière d’un mécanisme bien connu en psychologie comportementale : le biais de négativité. Ce phénomène décrit la tendance des individus à réagir plus fortement aux signaux négatifs qu’aux signaux positifs.
Nous constatons que les perceptions très négatives de la stratégie de communication verte réduisent significativement la probabilité d’investir. À l’inverse, une certaine confiance dans la communication environnementale ne suffit pas à stimuler l’investissement. Le doute pèse clairement plus lourd que la confiance.
Pourquoi cette asymétrie ? Parce qu’une perception négative de la stratégie marketing active deux leviers puissants. Elle déclenche des émotions négatives qui prennent souvent le dessus sur les raisonnements rationnels dans la prise de décision. En parallèle, ces émotions accentuent la perception du risque financier associé aux fonds verts, ce qui les rend moins attractifs aux yeux des investisseurs.
Renforcer la cohérence entre discours et réalité
Ces résultats appellent les décideurs publics et les acteurs financiers à recentrer leurs efforts sur le contrôle de la véracité de la communication des fonds verts. Tant que les inquiétudes des investisseurs individuels vis-à-vis du marketing des fonds verts ne sont pas levées, les politiques incitatives risquent de ne pas atteindre leur cible.
Ce constat fait écho aux évolutions récentes du cadre réglementaire européen. Ces dernières visent à réduire l’écart entre les promesses associées aux fonds verts et les projets réels dans lesquels ils investissent. Dans ce contexte, la mise en place de réglementations ciblées prend tout son sens. Des dispositifs comme le règlement SFDR ou la taxonomie verte visent à renforcer la transparence et à restaurer la confiance dans la finance verte, condition indispensable pour mobiliser l’investissement des citoyens au service de la transition écologique.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Time [Fr]
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- L'Autre Quotidien
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- AlterQuebec
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
