11.02.2026 à 16:22
Dogs and cats carry invasive land flatworms from garden to garden
Texte intégral (1053 mots)
What was discovered?
Domestic dogs and cats can carry invasive flatworms (Platyhelminthes) attached to their fur. Unwittingly, this is how they contribute to the spread of these invasive alien species. Our work on the subject has just been published in the scientific journal PeerJ.
Globally, invasive alien species represent one of the major threats to biodiversity. It is striking to discover that dogs and cats, our everyday companions, unwittingly contribute to the invasion of gardens by a species potentially dangerous to biodiversity.
How was the research conducted?
We were alerted by e-mails from individuals reporting the presence of worms attached to the fur of dogs and cats. We then re-examined over 6,000 messages received over 12 years and found that these observations were far from anecdotal: they represented approximately 7% of the reports. Remarkably, among the dozen or so species of exotic flatworms introduced into France, only one was affected: the yellow-striped flatworm, or Caenoplana variegata, a species from Australia whose diet consists of arthropods (woodlice, insects, spiders).

Why is this discovery important?
It has long been known that exotic flatworms are transported from their countries of origin to Europe through means linked to human activities: containers of plants shipped by boat, trucks then delivering them to garden centres, and finally transported by car to gardens. It was not well understood how flatworms, which move very slowly, could then infest surrounding gardens. The mechanism identified is quite simple: a dog (or cat) rolls in the grass, a worm sticks to its fur, and the animal then deposits it a short distance away. In some cases, it even takes it home, bringing it to owners’ attention.
Furthermore, it is surprising to note that only one species is affected in France, even though it is not the most abundant. Obama nungara is the most widespread species, both in terms of the number of districts affected and the number of worms found in gardens, but there were no reports of animal transport for this species. This difference is explained by their diet. Obama nungara feeds on earthworms and snails, while Caenoplana variegata eats arthropods, producing a very abundant and sticky mucus that traps its prey. This mucus can adhere to animal fur (or to shoes or trousers, for that matter). On top of that, Caenoplana variegata reproduces asexually by cloning itself: just one single, transported worm can infest an entire garden.
We then attempted to estimate the distances travelled by the ten million cats and sixteen million dogs in France each year. Based on existing data, we arrived at a spectacular estimate: several billion kilometres in total, which is many times the distance from the Earth to the Sun! Even if only a small fraction of domestic animals carry worms, this represents an enormous number of opportunities to spread these invasive species.
It is important to clarify that this is not parasitism, but a phenomenon called “phoresy”. This is a well-known mechanism in nature, particularly in plants with sticky or spiny seeds, which cling to animal fur and fall a short distance away. But here, it is a sticky animal that accidentally becomes attached to a domestic pet and is dislodged some distance away.
What’s next?
We hope this discovery will stimulate further observations, and we expect more reports of the same kind. Furthermore, our published results concern France, for which citizen science has provided a wealth of information, but some observations suggest that the same phenomenon exists in other countries, albeit with different species of flatworms. It is now necessary to expand this research internationally to better understand the extent of this dispersal method and the species involved.
_The Research Brief is a short three-minute take on interesting academic work with context and commentary from the academics themselves.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
11.02.2026 à 16:21
Thaïlande : l’horizon démocratique s’éloigne
Texte intégral (2906 mots)
**Les élections législatives et le référendum constitutionnel organisés le 8 février 2026 en Thaïlande ont conduit à une recomposition du paysage parlementaire. Le parti Bhumjaithai, avec Anutin Charnvirakul, le premier ministre sortant candidat à sa propre succession, s’impose comme la première force politique, devant le Parti du peuple, héritier du parti progressiste Move Forward, et Pheu Thai, formation issue du clan de l’ancien premier ministre Thaksin Shinawatra. Si le référendum, qui s’est tenu le même jour, a validé le principe d’une réforme constitutionnelle, sa mise en œuvre s’inscrit dans un cadre institutionnel fortement contraint par les rapports de force parlementaires et sénatoriaux.
¨¨
Le 8 février 2026, les électeurs thaïlandais ont été appelés aux urnes pour renouveler les 500 sièges de la Chambre des représentants et se prononcer simultanément sur un référendum constitutionnel. Le Parti de la fierté thaïe (Bhumjaithai) est arrivé en tête avec 193 sièges, devant le Parti du peuple (Phak Prachachon, 118 sièges) et Pour les Thaïs (Pheu Thai, 74 sièges).
Ces élections, qui se sont déroulées dans un contexte économique fragile et marqué par de fortes incertitudes régionales, notamment le conflit frontalier avec le Cambodge, confirment une recomposition du paysage politique thaïlandais et marquent un tournant symbolique. Anutin Charnvirakul, qui occupait le poste de premier ministre depuis seulement cinq mois au moment du scrutin, a su transformer une position gouvernementale fragile en victoire électorale décisive pour son parti.
Pour la première fois depuis plus d’une décennie, la stabilité et l’ordre se sont imposés comme valeurs centrales du débat électoral, dans un contexte où le nationalisme et la promesse de continuité institutionnelle ont primé sur les revendications réformistes.
Bhumjaithai, d’un parti à ancrage territorial à un pivot conservateur du système
La victoire de Bhumjaithai, qui n’avait obtenu que 71 sièges aux précédentes législatives, tenues en 2023, confirme la trajectoire d’un parti longtemps perçu comme périphérique. Fondé en 2008 par Newin Chidchob après sa rupture avec Thaksin Shinawatra, le parti s’est construit comme une organisation de pouvoir local fondée sur le patronage et les dynasties politiques, solidement ancrée à Buriram, dans l’Isan (Nord-Est du pays). Depuis ses bastions initiaux, Bhumjaithai a progressivement étendu son influence à l’ensemble de la région.
Le contrôle de ministères clés, notamment la santé publique, les transports puis l’intérieur, lui a permis de tisser des réseaux durables avec les administrations locales et les exécutifs provinciaux. Cette stratégie a été renforcée par une participation active aux élections des Provincial Administrative Organizations (PAO), organes décentralisés élus au niveau provincial qui gèrent le développement local, les infrastructures et les services publics, et constituent des relais essentiels du pouvoir dans les provinces. Elle explique la capacité du parti à transformer un soutien électoral diffus en victoires décisives.
Cette dynamique a culminé en septembre 2025 avec l’accession de Bhumjaithai au cœur du pouvoir parlementaire après la destitution par la Cour constitutionnelle de la première ministre Paetongtarn Shinawatra, et son remplacement par Anutin Charnvirakul.
Bhumjaithai s’est imposé comme l’acteur central de la recomposition conservatrice. L’effondrement progressif des partis pro-militaires issus du coup d’État de 2014 – qui avait renversé le gouvernement de Yingluck Shinawatra et instauré une junte dirigée par Prayut Chan-o-cha –, notamment le Palang Pracharath et le Ruam Thai Sang Chart, affaiblis par leurs divisions internes et leur perte de soutien populaire, a laissé un vide que le parti a su occuper. La domination de ses réseaux lors de l’élection sénatoriale de 2024 a débouché sur un Sénat largement aligné sur ses intérêts. Dans un système où la Chambre haute conserve un pouvoir décisif, toute stabilité gouvernementale passe désormais par Bhumjaithai.
Cette montée en puissance s’est accompagnée d’un travail ciblé en direction des classes moyennes et supérieures. Bhumjaithai a opéré ce repositionnement en s’entourant de figures technocratiques issues des élites administratives et économiques – Ekniti Nitithanprapas aux finances, Suphajee Suthumpun au commerce et Sihasak Phuangketkeow aux affaires étrangères –, ce qui a permis au parti de projeter une image de compétence économique et de crédibilité internationale. Cette configuration, explicitement assumée durant la campagne, a contribué à rendre Bhumjaithai politiquement acceptable pour un électorat jusque-là réticent.
La campagne électorale a combiné deux registres complémentaires. Sur le plan économique, le parti a promis le redressement de la croissance, la restauration de la confiance des investisseurs et une gestion budgétaire rigoureuse. Sur le plan sécuritaire, les tensions frontalières avec le Cambodge ont été instrumentalisées pour hiérarchiser les priorités autour de l’ordre et de la souveraineté nationale. Anutin a donné carte blanche à l’armée lors des affrontements de juillet et décembre 2025, présentant le conflit comme une « guerre contre l’armée des arnaques », visant les casinos cambodgiens utilisés pour la cybercriminalité.
Parallèlement, le parti a mobilisé le registre de la peur : instabilité politique chronique, risque d’ingérence étrangère (illustré par le scandale de l’appel entre Paetongtarn Shinawatra et Hun Sen), et menace supposée de bouleversement radical incarnée par le Parti du peuple. Le vote en faveur de Bhumjaithai s’est ainsi structuré autour d’une promesse de stabilité, de compétence technocratique et de fermeté face aux menaces extérieures.
Le Parti du peuple : le choix du pragmatisme
Le Parti du peuple arrive en deuxième position avec 118 sièges, ce qui constitue un recul par rapport aux 151 sièges gagnés en 2023 par Move Forward, auquel il a succédé après que celui-ci a été dissous par la Cour constitutionnelle en 2024. Ce résultat reflète une transformation de cette formation : née des mobilisations de rue et ancrée dans les mouvements sociaux, elle s’est progressivement tournée vers une approche plus pragmatique, au risque de perdre une partie de sa base militante.
En 2023, Move Forward promettait une transformation structurelle : réforme de l’article 112 du code pénal (qui punit de trois à quinze ans de prison toute critique, insulte ou menace envers le roi, la reine, l’héritier du trône ou le régent), démantèlement des monopoles, abolition de la conscription militaire. Trois ans plus tard, le Parti du peuple a opéré un virage stratégique. En septembre 2025, sa décision de soutenir Anutin Charnvirakul a déçu nombre de ses partisans.
Thanathorn Juangroongruangkit, cofondateur de Future Forward (dissous en 2020, dont Move Forward était l’héritier direct) devenu conseiller du parti, avait justifié ce choix par la nécessité de se montrer pragmatique. En échange, sa formation avait négocié un calendrier pour un référendum constitutionnel et une dissolution du Parlement dans les quatre mois.
Les dissolutions répétées ont affaibli les structures participatives. Le Parti du peuple s’est appuyé sur les réseaux sociaux et sur un leadership centralisé. Sur les listes de 2026, technocrates et entrepreneurs ont remplacé les militants. Le parti avait présenté trois candidats au poste de premier ministre : Natthaphong Ruengpanyawut, leader du parti, Sirikanya Tansakun, économiste et dirigeante adjointe du parti, et Veerayooth Kanchoochat, économiste. Aucun n’a réussi à recréer l’engouement de la campagne de 2023. Même le retour lors de la dernière semaine de Pita Limjaroenrat, ancien leader de Move Forward lors des élections de 2023, n’a pas suffisamment galvanisé l’électorat.
C’est Ruckchanok Srinok, 31 ans, qui a incarné l’énergie de la campagne. Candidate sur la liste proportionnelle nationale (100 sièges répartis entre les partis en fonction de leur score national, contrairement aux 400 sièges de circonscription attribués au candidat arrivé en tête localement), elle a exposé la corruption systémique, notamment les détournements de fonds au sein du Bureau en charge de la sécurité sociale, qui ont affecté 24,5 millions de personnes. Son comportement tranche avec les conventions politiques thaïlandaises : elle se déplace simplement à vélo, ne porte pas de vêtements de créateurs, ne provient pas d’une famille célèbre et n’a pas hérité d’une quelque fortune. Mais sa condamnation à six ans de prison pour lèse-majesté (elle est en liberté sous caution) incarne le dilemme du parti : comment réformer un système qui criminalise la réforme ?
Le résultat du 8 février 2026 est donc en deçà des espérances. Le Parti du peuple fait face à une question cruciale : né de la défiance contre l’establishment conservateur, peut-il s’appuyer sur le pragmatisme sans perdre son identité ?
Pheu Thai, l’échec d’une reconquête territoriale
Pheu Thai, parti populiste à l’identité idéologique aujourd’hui brouillée par ses alliances avec les conservateurs, arrive en troisième position avec 74 sièges, un recul très marqué par rapport aux 141 obtenus en 2023. Pour un parti qui se présentait encore récemment comme une force dominante, ce résultat constitue une défaite électorale nette. Il met en lumière l’échec de la stratégie de reconquête de ses bastions historiques dans le Nord du pays.
Le parti a mobilisé ses ressources habituelles, en s’appuyant sur des candidats sortants, des héritiers de dynasties politiques locales et des figures issues de ses réseaux traditionnels. Pheu Thai avait présenté trois candidats au poste de premier ministre : Yodchanan Wongsawat, neveu de Thaksin Shinawatra (premier ministre de 2001 à 2006, renversé par coup d’État, exilé pendant quinze ans, rentré en 2023 et actuellement incarcéré pour corruption), Julapun Amornvivat, le chef du parti, et Suriya Juangroongruangkit, ancien ministre des transports. Le parti a également cherché à élargir son audience par des politiques populistes, dont un projet de loterie quotidienne de 9 millions de bahts (près de 250 000 euros) adossée à un dispositif fiscal numérique. Cette mesure a suscité de nombreuses critiques et n’a pas produit les effets escomptés.
De plus, la campagne s’est déroulée dans un contexte politique fortement dégradé pour Pheu Thai. La divulgation d’une conversation téléphonique où Paetongtarn Shinawatra adoptait un ton informel et conciliant à l’égard de Hun Sen, ancien premier ministre cambodgien, aujourd’hui sénateur et père de l’actuel premier ministre Hun Manet, avait provoqué la chute du gouvernement en août 2025 et sérieusement ébranlé la crédibilité du parti. Tout au long de la campagne, cet épisode a été abondamment exploité par les adversaires de Pheu Thai. Cette fragilisation s’est trouvée accentuée par l’incarcération de Thaksin Shinawatra depuis le 9 septembre 2025, ce qui a privé le parti de sa figure tutélaire.
Le Parti démocrate survit et Kla Tham entre au Parlement
Au-delà des trois partis arrivés en tête, le scrutin de février 2026 a révélé deux évolutions importantes : le Parti démocrate a enregistré des résultats contrastés mais notables et Kla Tham a réalisé une percée lors de sa première participation électorale nationale d’ampleur.
Après plusieurs cycles de recul électoral, le Parti démocrate a opéré un repositionnement sous la direction d’Abhisit Vejjajiva. L’ancien premier ministre (2008-2011) avait quitté la direction du parti en 2019, à la suite d’une lourde défaite électorale et de divisions internes persistantes. Pour ces élections, il s’est entouré de figures technocratiques telles que Korn Chatikavanij, ancien ministre des finances, et Karndee Leopairote, spécialiste des politiques économiques. Leur stratégie s’est fondée sur la rigueur institutionnelle, la discipline budgétaire et la lutte contre la corruption.
En apparence, le résultat du Parti démocrate peut sembler décevant. Le parti a perdu des sièges par rapport à 2023. Avec seulement huit députés sortants au moment de la dissolution, il faisait face à un défi majeur pour remporter des sièges en circonscription. Mais ce résultat global masque une dynamique importante. Sur les listes proportionnelles, le parti a obtenu environ 3,6 millions de voix, un score très proche de sa performance de 2019. En quelques mois seulement après son retour à la tête du parti, Abhisit Vejjajiva est parvenu à reconquérir une part importante de l’électorat démocrate. Pour un parti en difficulté depuis plusieurs années, ce résultat constitue une forme de stabilisation.
Kla Tham a effectué une entrée marquante au Parlement avec 58 sièges de circonscription. Le parti n’a obtenu que deux sièges proportionnels. Thammanat Prompao dirige cette formation. Cette figure controversée possède un passé judiciaire chargé. Il a joué un rôle central dans les négociations de coalition sous Prayut Chan-o-cha. Le parti s’est structuré comme un véhicule électoral. Plus de la moitié de ses candidats avaient concouru sous d’autres étiquettes lors de scrutins précédents.
Sa campagne s’est appuyée sur l’implantation territoriale de ses candidats et sur une stratégie de continuité, faisant de la politique locale la racine d’une politique plus large. Les propositions programmatiques ont joué un rôle secondaire, l’accent étant mis sur le travail de terrain et l’ancrage dans les réseaux locaux. L’entrée de Kla Tham au Parlement s’opère dans un contexte de soupçons persistants liés aux financements politiques et aux liens de certains cadres avec des intérêts économiques controversés. Le soir du scrutin, Thammanat a souligné la position charnière de sa formation dans les négociations à venir.
Le référendum constitutionnel et ses contraintes politiques
Organisé simultanément aux élections législatives, le référendum constitutionnel portait sur l’ouverture d’un processus de réécriture de la Constitution de 2017. 58,3 % des votants se sont prononcés en faveur de ce processus, contre 30,8 % d’opposition et 8,3 % de votes blancs. Ce vote exprime une attente de réforme constitutionnelle, sans pour autant constituer un mandat précis sur la nature ou l’ampleur des changements à venir.
Le cadre institutionnel demeure particulièrement contraignant. La procédure implique plusieurs étapes successives, combinant un vote parlementaire à majorité qualifiée, la désignation d’un comité de rédaction, puis l’organisation de nouveaux référendums. Dans ce processus, le Sénat conserve un rôle central.
Le rapport de forces issu des élections législatives pèse directement sur l’interprétation politique du référendum. La victoire de Bhumjaithai et sa position dominante au Parlement et au Sénat orientent le processus vers une gestion étroitement encadrée de la réforme constitutionnelle. Les positions défendues par Bhumjaithai et par Kla Tham, favorables au maintien des principaux mécanismes institutionnels, suggèrent que les dispositifs centraux du système apparaissent peu susceptibles d’être substantiellement remis en cause.
Alors que la bataille des coalitions s’ouvre, le référendum de 2026 engage une séquence institutionnelle sans en déterminer l’issue. Il met en évidence un décalage entre une demande de réforme et les équilibres conservateurs qui dominent le système politique.
Alexandra Colombier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
11.02.2026 à 16:19
Catatumbo’s ‘Care-Land’: how local initiatives sustain humanitarian relief amid escalating violence in Colombia’s borderland with Venezuela
Texte intégral (1463 mots)
Drones hover low over coca fields in Catatumbo, a remote region in northeastern Colombia along the border with Venezuela, tracing invisible lines of control across the land. They are joined by rumours circulating on social media, naming alleged collaborators, announcing new allegiances, warning of imminent violence. Together, drones and rumours kill arbitrarily: they determine who can move, who must flee, and who disappears. This is the texture of war in Catatumbo today.
The fragile border region has experienced a sharp escalation of armed conflict since early 2025, as multiple illegal armed groups, including the ELN, dissident factions of the FARC, and elements linked to the Clan del Golfo, vie for control of territory long marked by weak state presence and lucrative illicit economies. Civilians have been displaced, confined, and threatened with violence, including forced recruitment and targeted attacks. Local communities report that armed actors’ actions have disrupted food production, limited mobility, and hindered access to basic services, while official humanitarian relief remains scarce. These conditions have left communities to rely on their own initiatives and networks for survival Norwegian Refugee Council (NRC).
Last year’s humanitarian emergency briefly pushed Catatumbo into the national spotlight. Slogans such as ‘Al Catatumbo Nada lo Tumba’ (nothing can strike down Catatumbo) were painted on walls across Colombia in a loud and clear show of solidarity. The government declared a ‘conmocion interior’ state of emergency allowing for exceptional humanitarian measures. By April 2025 it had ended, but the violence had not. On January 3 2026, the collapse of the Maduro regime in neighbouring Venezuela acted as a further trigger for unrest.
According to estimates by OCHA and the Norwegian Refugee Council, more than 100,000 people have been displaced from Catatumbo since January 2025. As armed actors continue to fight for territorial control, and exceptional humanitarian relief is shrinking, the responsibility for survival falls back onto those who live on and from the land itself.
Catatumbo’s ‘care-land’ history
Humanitarian relief is not delivered to Catatumbo; it is improvised from within the land. Here we trace the terrain of survival that shows how humanitarian care operates when merged into a land, fractured by violence and sustained through its connections.
In Catatumbo, care and land are inseparable. Access to food, health, protection, and dignity depends on the ability to inhabit, move through, and claim territory under conditions of violence. For the local Peasant Farmer Association Ascamcat, the guiding principle remains: “Life, dignity, land tenure, and permanence in the territory”.
Returning to care-land
Catatumbo sits at the crossroads of multiple crises. It is one of the world’s most productive coca-growing regions, a strategic corridor along the Venezuelan border, and a territory where state presence has long been fragile. It experienced egregious violence during the ongoing Colombian armed conflict, including mass executions and furnaces built to dispose of bodies. Left largely to its own devices, local institutions have long relied on a patchwork of humanitarian programmes, community organisations, and civil society platforms to fill persistent gaps.
As a result, responsibility for care and humanitarian relief has been returned to the land itself. Homegrown initiatives such as the Zona de Reserva Campesina- legally recognised rural reserve zones created under Colombian law to support small‑scale farming and campesino territoriality; and the Pacto Catatumbo have played a central role: stabilising rural livelihoods, formalising land rights, and anchoring development plans in community priorities. Human rights defenders and regional civil society organisations including Ascamcat, describe these arrangements as uneven and incomplete, yet indispensable; systems that made life bearable without ever delivering security or peace. In crises, these initiatives are the only option that enables humanitarian care to work at all. The fragile ‘care-land’ they sustain is now under acute strain. As fighting intensifies, it is at breaking point.
Fracturing care-land
In Catatumbo, armed clashes between the National Liberation Army (ELN) and dissident factions of the former FARC have escalated. Criminal groups, from the region-wide Tren de Aragua to local youth gangs, further fuel the violence. Drones and social media intensify these dynamics. In Catatumbo, bomb’s fall from the sky and mines are placed in the ground. The fractures ripple through care systems.
Access to medical and humanitarian supplies is increasingly blocked. Ambulances cannot reach remote areas, roads are mined, and infrastructure like schools, clinics, administrative offices is neglected or destroyed. Local contacts or staff from regional humanitarian networks report that billions of Colombian pesos are spent on arms while essential services languish. These blockages are embedded in the region’s topography, shaping who can survive.
Care networks are breaking down. Local, legally-recognised community organisations such as the Juntas de Acción Comunal (JAC) are disintegrating. Social leaders are fleeing or disappearing, and with them the work they sustained. Families abandon their homes with little more than the hope that aid awaits in shelters and registration centres in towns near the border with Venezuela such as El Tarra, Tibú, Ocaña, or the departmental capital, Cúcuta. Some remain to protect land, crops, or elderly relatives. The fractures run deep.
Connecting care-land
Yet continuity of care is patched together across Catatumbo. Families, neighbours, and local organisations improvise systems of mutual support that extend beyond village boundaries and displacement routes. Community leaders coordinate relief, share information, and maintain connections between rural areas and shelters in nearby cities. Care here is fragile and constantly renegotiated, yet it persists.
The Mesa Humanitaria, established in 2018, illustrates how such care is coordinated under these conditions. As a recognised governance platform in Colombia, it brings together Indigenous resguardos, women’s organisations, municipal authorities, and international observers to negotiate access to humanitarian aid, document violations, and coordinate relief in areas otherwise cut off. Through the Mesa, strategies emerge to distribute food and medicine, verify incidents of displacement or violence, and advocate for basic rights.
While formal, the Mesa depends on informal practices and social ties: neighbours checking on one another; connections between those who have fled and those who stayed; the sharing of scarce resources; exchanges of information about risks and safe passage; pooling medical supplies; or collectively monitoring landmines. These connections hold care-land together across fractures, weaving humanitarian action into the terrain itself. Any engagement in Catatumbo must work with these connections rather than around them.
Care-land at stake
Today, this care-land is under direct threat. Armed groups, shifting geopolitics along the Colombian border with Venezuela, where conflict dynamics between armed groups extend across the frontier, the shadow of US interventions, and a diminishing humanitarian presence erode the fragile conditions under which care can be sustained. What remains is not continuity secured by institutions, but care unevenly patched together across fractured territory. Humanitarian relief in Catatumbo is neither stable nor assured. It is living on the brink of violence and abandonment. Hanging on, as one human rights activist puts it, by little more than half a hope.
Silke Oldenburg a reçu des financements du Fonds National Suisse (FNS) de la recherche scientifique et fait partie du projet de recherche « The Future(s) of Humanitarian Design ».
Anna Leander a reçu des financements du Fond National Suisse pour le project 'The Future of Humanitarian Design' (CRSII5_213546)
Nora Doukkali a reçu des financements du Fonds National Suisse (FNS) de la recherche scientifique et fait partie du projet de recherche « The Future(s) of Humanitarian Design ».
10.02.2026 à 17:06
How Paris’ working-class dining experience is reshaping restaurant economics in France
Texte intégral (1981 mots)
In cities across France, a number of new bouillon soup-kitchen inspired restaurants are opening for business. Dating back to the 19th century and designed to feed Paris’ working-class masses, for some time these cheap and cheerful places to eat fell out of fashion. Why are they making a comeback today? What makes them so special and what’s the history behind these ‘old school’ eateries?
Offering nutritious, affordable meals to Paris’ many labourers was the avant-garde brainchild of the Dutch East India Company in the 19th century. In 1828, the firm opened a chain of small restaurants in the French capital to serve boiled beef bone broth (or “bouillon”) to a burgeoning working-class population. And thus, the bouillon concept was born along with an early form of the inexpensive ‘set meal’. In 1854, the company went out of business and it was at that moment in time that Baptiste-Adolphe Duval made History by becoming the founding father of the bouillon phenomenon.
In the 1850s, Baptiste-Adolphe Duval owned a butcher’s shop on rue Coquillière in Paris’ 1st arrondissement. Since his customers only bought the “prime cuts”, Duval looked for a way of using up all the poor cuts that he couldn’t sell. He came up with the idea of concocting a top quality broth with boiled beef and the cheaper cuts of beef. Hence, in 1854, he went on to open a place on rue de la Monnaie in the historic heart of the city. It was here that he dished up comforting yet simple, hot meals that wouldn’t burn a hole in even the most cash-strapped wallets of the likes of the workers at the local Les Halles wholesale market – formerly known as the “belly of Paris”, named after the title of the Emile Zola novel. Baron Haussmann’s citywide urban planning and renovation works drew thousands of labourers from across France to the capital for work. With all the more mouths to feed, Duval’s initiative was an instant success!
The forefather of fast food
Duval went on to open other canteens around the city including one in an extravagant, cast-iron hall in 1855, in an 800 square meter (approx. 8,610 square feet) warehouse location at number 6 rue de Montesquieu near the Louvre museum. The premises could cater for up to 500 people, offering non-stop service by waitresses dressed in distinctive black uniforms with white aprons and tulle caps. Coined les petites bonnes, these waitresses epitomised the Duval bouillon experience and became the subjects of many an artist or novelist such as Auguste Renoir and Joris-Karl Huysmans. A new clientele hungry for value for money, flexible opening hours and set-price menus formed. Customers hailed from middle-class backgrounds and the lesser bourgeoisie. The meals on offer evolved over time: oysters, poultry and fish were added alongside staple dishes of pot-au-feu, boeuf bourguignon or roast veal.
These places that came to be known as “bouillons” were spotlessly clean, and led the way for modern dining, pioneering a whole new restaurant model based on simple cuisine using quality produce. They were considered as one of the precursors of fast food.
A whole new business model
The economic success of Duval’s bouillons is mainly due to its stock management model. They run like a restaurant chain, using economies of scale to manage supply chain practices, breadmaking or their butcher’s shops, etc. In 1867, Duval founded the Compagnie anonyme des établissements Duval which included 9 outlets. In 1878, they grew to 16, with a dozen more opening across the capital by the end of the 19th century.
Duval’s success story has inspired many restaurateurs. While the capital counted around 400 of these restaurants in 1900, they actually encompassed a variety of diverse establishments serving different purposes from simple street food sellers to workers’ soup-kitchens in line with Duval like Boulant or Chartier.
Still in business today, Chartier, opened in 1896 in Paris’ Grands Boulevards area. Its huge dining room clad with sculpted woodwork and magnificent art nouveau chandeliers are listed as historical monuments. Not once has Chartier shut shop or changed its name; and unlike its counterparts, it has continuously stood the test of time and changing fashions, even despite fluctuations in ‘bums on seats’.
This is how the popular bouillon restaurant concept became a fully fledged Parisian institution. Its initial success ran up until the Interwar period before fizzling out. During France’s 30-year Post war boom (1945-1975), bouillons seemed passé and old-fashioned, and diners preferred brasseries which they saw as more modern and ‘upmarket’. Then came the fast food boom (Editorial note: from the 1960S onwards).

A weekly e-mail in English featuring expertise from scholars and researchers. It provides an introduction to the diversity of research coming out of the continent and considers some of the key issues facing European countries. Get the newsletter!
Bouillons: back by popular demand since 2017
The bouillon’s flame and surrounding legend never completely died out and in November 2017, as restaurateurs the Moussié brothers proved by opening le Bouillon Pigalle (Paris 18e) in Paris.
Their wish was to remix the essence of the bouillon dining experience: comfort food such as beef bourgignon, salted pork with lentils, sausage and mash or decadent desserts such like profiteroles drizzled with hot chocolate sauce, served at affordable prices in a retro setting with large, canteen style tables, in a relaxed atmosphere, with continuous service and a ‘no reservations’ policy.
The initiative was met with success, and gradually other restaurants were (re)opened in refurbished premises like Bouillon Julien in 2018, or Bouillon République in 2021; in the existing restaurant space that was once home to the old Alsatian brasserie Chez Jenny. These affordable restaurants attracted a lot of French and foreign customers who were delighted to eat out well and not too expensively during inflation time. Many of these eateries offer a 3-course meal for less than 20 euros. Simplicity and authenticity are the backbone supporting the renaissance of this dining experience.
Many bouillons insist on serving homemade food, working frequently with local producers and short supply chains.
A back to the future phenomenon that is now nationwide
These places that are inextricably linked with a convivial atmosphere and quintessentially French dining are also springing up outside the French capital. And while for the most part, their chefs continue to bank on comforting classic French cuisine staples, some restaurants are keeping it regional: “baked Maroilles cheese”, served at Petit Bouillon Alcide in Lille, or “traditional Savoy sausage with creamy polenta” on offer at Cantine Bouillon de Seynod, in Haute-Savoie, in the French Alps are both fine examples.
In the last two or three years, Michelin-starred chefs have also opened their own bouillon restaurants. This was the case of Christophe Aribert, a chef from Grenoble with 2 Michelin stars to his name, with Bouillon A, which opened in May 2022, where he showcases locally grown, organic and seasonal produce. 2-star chef Thierry Marx in 2024 also opened le Bouillon du Coq in Saint Ouen, where he serves herrings in oil with boiled potatoes or his signature dish coq au vin. He saw it as an opportunity to revamp dishes that were labelled outdated and make them extremely affordable.
Since early 2023 in France, it is estimated that a new bouillon restaurant opens every month. Customers are mainly drawn to the low prices.
Maintaining affordable prices is the first challenge for a number of restaurant owners. What’s their secret? A great deal of meal prep (particularly for cold dishes like egg mayonnaise or leeks in vinaigrette, whittling down the steps for each dish, keeping techniques minimal and plating uncomplicated), simple recipes, a menu that barely changes, and also saving money on purchasing volume and super fast table turnover.
The other thing that makes these restaurants a safe bet is that they remain a go-to for classic meals served in record time, in a perfectly pleasant, convivial setting.
Nathalie Louisgrand ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
10.02.2026 à 16:51
Tout sauf l’Ehpad ? Les ambiguïtés de la politique du grand âge
Texte intégral (2030 mots)

En France, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) font figure de repoussoirs. En 2001, 53 % des Français déclaraient en ne pas souhaiter vivre dans un établissement pour personnes âgées dans le futur, ce pourcentage s’élève aujourd’hui à 74 %. Les pouvoirs publics cherchent à promouvoir d’autres formes d’hébergement moins médicalisées. Est-ce une bonne approche ?
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) constituent aujourd’hui le mode dominant d’accueil pour les personnes âgées ne pouvant pas rester à leur domicile. Fin 2023, sur les 700 000 personnes fréquentant un établissement d’hébergement pour personnes âgées, près de 80 % vivent en Ehpad. Compte tenu du vieillissement démographique, si les pratiques d’entrée en institution restent inchangées, il faudra ouvrir 108 000 places en Ehpad d’ici à 2030, puis 211 000 places entre 2030 et 2050. Cela reviendrait à un peu plus que doubler, dans la durée, le rythme d’ouverture de places observé depuis 2012.
Or, une telle projection se heurte à l’image dégradée dont bénéficient les Ehpad en France. Ceux-ci font office de repoussoir pour un grand nombre de personnes âgées et de familles, encore plus depuis l’affaire Orpea et la parution du livre Les fossoyeurs du journaliste Victor Castanet. La crainte de perdre sa liberté en établissement d’hébergement, voire d’être maltraité, conduit à plébisciter le maintien à domicile pour ses vieux jours. Ainsi, selon le baromètre de la DREES, alors que 53 % des Français déclaraient en 2001 de ne pas souhaiter vivre dans un établissement pour personnes âgées dans le futur, ce pourcentage s’élève aujourd’hui à 74 %. 44 % des Français feraient en sorte de s’occuper de son parent âgé à son domicile, 21 % seraient prêts à l’accueillir chez eux et 16 % les soutiendraient financièrement afin qu’il puisse bénéficier d’aides à domicile. Entre 2014 et 2023, la proportion de personnes qui privilégient de s’occuper de leur proche à son domicile a augmenté de presque 20 points, passant de 25 % en 2014 à 44 % en 2023.
Une politique domiciliaire en panne
Dans ce contexte, quelles sont les orientations de la politique vieillesse ? Depuis quelques années, l’État s’engage à promouvoir une approche domiciliaire pour tenir compte des réticences croissantes manifestées à l’égard des institutions d’hébergement. Cette approche est confortée par les projections des attentes des nouvelles générations de personnes âgées, qui correspondront aux baby-boomers (nés entre 1946 et 1964) atteignant le grand âge au cours des prochaines décennies. Ainsi, il est attendu que ces nouvelles générations soient plus enclines à vouloir préserver leur pleine et entière citoyenneté et à moins dépendre de décisions leur échappant.
Schématiquement, la politique domiciliaire engagée par l’État se structure autour de deux axes. Le premier consiste à renforcer les capacités du domicile pour que les gens puissent s’y maintenir plus nombreux et dans de bonnes conditions. Le second axe vise à transformer le fonctionnement des Ehpad pour qu’ils deviennent des lieux de vie ouverts sur la cité et où les résidents puissent y être « comme chez eux ». En réalité, cette politique relativement consensuelle se situe dans le prolongement des orientations antérieures. Mais de sérieux doutes ont été émis par l’Inspection générale des affaires sociales quant à la capacité de l’État à la mettre réellement en œuvre. Le coût budgétaire de la politique domiciliaire de même que la faible attractivité des métiers du grand âge en constituent autant de freins.
Une volonté politique d’encourager les habitats intermédiaires
D’un côté, l’Ehpad comme mode d’hébergement des personnes âgées n’a plus le vent en poupe, et de l’autre, le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie présente des limites. C’est pourquoi, pour mettre en œuvre l’approche domiciliaire, les pouvoirs publics misent fortement sur le développement de « l’habitat intermédiaire ».
Par habitat intermédiaire, il faut entendre toutes les formes d’habitat qui se situent entre le domicile historique et les établissements proposant un hébergement collectif. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) estime qu’il y aurait aujourd’hui 275 000 places en habitat intermédiaire (résidences autonomie, résidences services seniors, habitats inclusifs, accueil familial, résidences intergénérationnelles…). Compte tenu des besoins liés au vieillissement de la population, elle projette la nécessité de créer 500 000 solutions de logement en habitat intermédiaire d’ici 2050.
La justification de cette incitation publique en faveur de l’habitat intermédiaire est qu’il s’agit d’une formule qui répond au souhait des personnes de vivre chez elles sans êtres seules, tout en préservant leur intimité et leur liberté de choix.
Une autre de ses caractéristiques est que le public visé est plutôt constitué de personnes ayant une perte d’autonomie modérée, dont l’isolement ou les problèmes de santé les inciteraient à rejoindre un cadre de vie plus sécurisant. De fait, l’habitat intermédiaire apparaît comme une formule aux antipodes de l’Ehpad. Ce dernier accueille en effet des personnes plus dépendantes et représente un coût plus important pour les finances publiques compte tenu de la présence de personnels soignants.
Les Ehpad condamnés à faire figure de repoussoir
Cette politique en faveur de l’habitat intermédiaire contient un implicite : demain, encore plus qu’aujourd’hui, les Ehpad auront vocation à accueillir les personnes âgées très dépendantes. Malgré toute l’énergie que mettent les directions d’Ehpad pour ouvrir leurs établissements sur la vie de la cité, l’image repoussoir risque de se renforcer : la moitié des résidents en Ehpad a plus de 88 ans et 85 % sont en perte d’autonomie (classés en GIR 1 à 4) ; 38 % sont atteint d’une maladie neurodégénérative, soit 4 points de plus qu’en 2019. Parallèlement, le nombre de personnes autonomes qui intègrent un établissement a encore reculé en l’espace de quatre ans.
Pourtant, cette évolution n’est pas inéluctable. Les Ehpad ont toujours accueilli des personnes en situation de perte d’autonomie modérée. En effet, l’entrée en établissement d’hébergement ne résulte pas d’un processus linéaire qui rendrait le maintien à domicile impossible à partir d’un certain seuil de dépendance. De multiples facteurs entrent en ligne de compte dans ce processus, mêlant tant des éléments subjectifs (la perception individuelle de la situation) que des éléments objectifs comme la qualité de son cadre de vie ou la présence d’aidants mobilisables pour intervenir à domicile.
Une approche alternative aurait été possible
En favorisant le développement d’un habitat intermédiaire, quoi qu’il s’en défende, l’État contribue à segmenter l’offre en fonction du degré de dépendance. Toute catégorisation qui se veut positive tend à produire son contraire, à savoir une catégorie qui concentre les éléments négatifs. Que va-t-il advenir des personnes dont l’état de santé ne permettra plus de rester en habitat intermédiaire si ce dernier est amené à se développer ?
Un modèle alternatif était pourtant possible. Il a été défendu à partir des années 1980 par la Fondation de France qui encourageait la création de « lieux de vie jusqu’à la mort ». Contre l’idée de segmentation, il s’agissait de promouvoir des petites unités de vie, bien insérées dans le tissu social local, où les personnes auraient pu être accompagnées par des services d’aide et de soins à domicile jusqu’à la fin de leur vie. Ces structures, de petite taille, reposaient sur un mode de vie et d’accompagnement familial, prenant le contre-pied des grands établissements hospitaliers et médicalisés.
À la différence de beaucoup d’habitats intermédiaires actuels, leur ambition était de pouvoir accompagner jusqu’au bout des personnes âgées en perte d’autonomie. C’est sur ce modèle que se sont développées ces dernières années, par exemple, des colocations accueillant des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Mais, pour l’essentiel, cette option a peu été soutenue par les pouvoirs publics et beaucoup d’opérateurs sont restés prisonniers de cadres organisationnels et économiques favorables à la réalisation d’économies d’échelle, aboutissant à la constitution de lieux de relégation. Dans les faits, il s’est avéré plus aisé de produire une offre segmentée avec, d’un côté, des Ehpad ou des unités spécialisées hébergeant des personnes très dépendantes et, de l’autre, des habitats intermédiaires accueillant une population fragilisée mais encore peu dépendante. Ce processus de segmentation s’est opéré avec l’assentiment des élus locaux soucieux de proposer une offre non stigmatisée sur leur territoire, qui est elle-même valorisée par les familles.
Il n’est toutefois pas certain que le mot d’ordre « tout sauf l’Ehpad » contribue à rendre la société plus inclusive pour faire face au vieillissement de la population. Alors que les lieux de vie visent à accompagner l’ensemble des « gens du coin » dans leur vieillissement, le paysage gérontologique tend au contraire à spécialiser les réponses d’hébergement, enfermant un peu plus la figure du « vieux dépendant » dans son rôle de repoussoir.
Dominique Argoud ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
10.02.2026 à 16:50
« Si j’avais su » : la phrase qui absout les élites dans l’affaire Epstein ?
Texte intégral (2250 mots)
La plupart des personnalités citées dans les archives Epstein qui viennent d’être révélées affirment que si elles avaient été au courant de ses crimes, elles n’auraient en aucun cas entretenu la moindre forme de contact avec le milliardaire, qui avait été condamné en 2008 pour trafic de prostituées mineures. Ce procédé rhétorique est toutefois loin de suffire à répondre à toutes les interrogations que suscite la pérennité de leurs relations avec un homme dont le passé judiciaire était, en réalité, de notoriété publique. Au contraire, ce type de défense est de nature à alimenter, auprès des simples citoyens, l’idée que les élites estiment appartenir à une caste à part.
Depuis la divulgation progressive de près de trois millions de documents judiciaires, de dépositions sous serment et de pièces issues de procédures civiles et pénales liées à Jeffrey Epstein, une réponse revient avec une régularité presque mécanique chez les personnalités citées ou associées à son réseau : « Je ne savais pas. Si j’avais su, je ne l’aurais jamais fréquenté. »
Cette formule, reprise par des responsables politiques, des membres de familles royales, des figures centrales du monde économique, s’est imposée comme la ligne de défense dominante du scandale. Caroline Lang tout comme la princesse héritière Mette-Marit de Norvège, qui affirme que ses échanges avec le financier relevaient d’« une erreur de jugement », ont récemment mobilisé cet argument, affirmant avoir ignoré la réalité des crimes d’Epstein au moment de leurs interactions avec lui.
À première vue, ces déclarations semblent relever d’une posture morale minimale. Elles permettent de condamner les faits sans ambiguïté et d’ériger une frontière claire entre le criminel et ceux qui l’ont côtoyé. Pourtant, replacée dans son contexte historique, judiciaire et médiatique, cette ignorance revendiquée pose un problème de crédibilité majeur. Elle interroge moins la sincérité individuelle que le fonctionnement collectif des élites face à une information abondante, accessible et durablement documentée.
Une condamnation judiciaire qui était tout sauf un secret bien gardé
Jeffrey Epstein n’a jamais été un prédateur invisible. Dès la fin des années 1990, des signalements circulent dans les cercles policiers de Floride. En 2005, la plainte déposée par la famille d’une mineure de 14 ans déclenche une enquête officielle de la police de Palm Beach. En 2006, Epstein est arrêté. En 2008, il conclut un accord judiciaire exceptionnel avec le bureau du procureur fédéral du district sud de la Floride. Ce « non-prosecution agreement » lui permet d’éviter des poursuites fédérales pour trafic sexuel de mineures, crimes passibles de peines très lourdes, en échange d’un plaidoyer de culpabilité limité à des infractions de niveau étatique.
Les faits sont publics, précis et chiffrés. Epstein est condamné à dix-huit mois de prison, n’en purge que treize dans un régime de semi-liberté extrêmement favorable, comprenant jusqu’à douze heures de sortie quotidienne, six jours sur sept. Il est officiellement enregistré comme délinquant sexuel. En 2020, l’enquête du Miami Herald, intitulée « Perversion of Justice », met en lumière l’ampleur des protections institutionnelles dont il a bénéficié et identifie au moins trente-six victimes mineures citées dans le cadre de l’accord de 2008.
Malgré cette condamnation, Epstein continue à évoluer dans les cercles de pouvoir pendant plus d’une décennie. Entre 2008 et 2018, il fréquente des universités prestigieuses, finance des programmes de recherche, entretient des relations avec d’anciens chefs d’État, des membres de familles royales, des investisseurs influents et des intellectuels médiatisés. Ses donations à des institutions académiques se chiffrent en centaines de milliers de dollars, parfois après sa condamnation. Ce maintien au sommet après une reconnaissance officielle de culpabilité constitue le cœur du scandale.
La formule « Si j’avais su » fonctionne alors comme un mécanisme central de dissociation sociale. Elle permet de séparer artificiellement la relation entretenue avec Epstein de la connaissance de sa trajectoire judiciaire. Elle repose sur l’idée implicite que la sociabilité des élites évoluerait dans un espace parallèle, partiellement soustrait aux normes pénales ordinaires. Cette dissociation n’est pas un accident individuel. Elle est structurelle et collectivement tolérée.
Redevabilité : la mécanique silencieuse du système Epstein
L’un des ressorts essentiels du système Epstein réside dans la production systématique de redevabilité. Epstein ne se contente pas d’acheter des relations par l’argent. Il crée des situations d’endettement symbolique. Il offre, finance, héberge, soutient, facilite. Chaque geste est présenté comme désintéressé, mais aucun n’est neutre. La redevabilité n’est jamais contractualisée, ce qui la rend d’autant plus efficace.
Epstein cible des individus disposant d’un capital symbolique élevé. En retour, il leur offre des ressources rares : accès à des résidences d’exception à Manhattan, Palm Beach ou dans les îles Vierges, usage de jets privés, financement de projets académiques, soutien à des trajectoires professionnelles ou familiales. Il héberge des proches, facilite des parcours éducatifs ou offre une visibilité institutionnelle.
Le cas de Caroline Lang illustre cette logique de manière particulièrement éclairante. Le fait qu’Epstein ait hébergé l’une de ses filles en son absence, et aussi elle-même en compagnie de ses deux filles, dans des propriétés lui appartenant ne relève pas d’un simple service ponctuel. Il s’agit d’un acte à forte valeur symbolique, qui engage une dette morale durable. Cette redevabilité n’implique pas une complicité active, mais elle rend la rupture socialement coûteuse. Elle crée un inconfort moral à l’idée de dénoncer, d’interroger ou de s’éloigner publiquement.
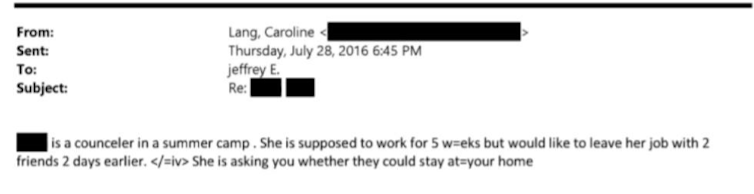
La redevabilité fonctionne ici comme un mécanisme de neutralisation. Celui qui a reçu hésite à questionner. Celui qui a bénéficié hésite à rompre. Celui qui est redevable hésite à savoir. La proximité devient un frein cognitif. Dans ce cadre, l’ignorance n’est pas une absence d’information, mais une posture rendue possible par la dette symbolique.
La recevabilité sociale d’Epstein repose sur cette accumulation de relations redevables. Chaque figure prestigieuse qui le fréquente renforce l’illusion de normalité. Ce cercle autoréalisateur transforme la condamnation judiciaire en détail marginal, absorbé par le poids du réseau.
Le « Si j’avais su » permet ensuite d’effacer cette dynamique. Il transforme une relation structurée par des échanges matériels et symboliques en simple erreur de jugement. Il neutralise la question des bénéfices reçus. Il évite surtout d’interroger la responsabilité collective d’un système fondé sur l’évitement du savoir.
Le « Si j’avais su » et la théorie du complot
La posture du « Si j’avais su » ne se limite pas à une stratégie individuelle de protection réputationnelle. Elle produit des effets politiques et cognitifs profonds sur la perception du pouvoir et alimente directement la défiance contemporaine envers les élites. En affirmant qu’ils ignoraient des faits pourtant publics, documentés et accessibles, les acteurs concernés installent un décalage troublant entre leur position sociale et leur responsabilité informationnelle. Cette dissonance nourrit un soupçon durable : si ceux qui disposent du plus fort capital culturel, médiatique et relationnel disent ne pas savoir, alors soit ils mentent, soit ils bénéficient d’un régime d’exception.
C’est dans cet espace de flou que prospèrent les théories complotistes. Le « Si j’avais su » crée une zone d’indétermination discursive, dans laquelle l’absence d’explication systémique laisse place à des récits alternatifs. En refusant de reconnaître les mécanismes ordinaires de complaisance, de silence et de redevabilité, cette posture alimente l’idée d’un mensonge organisé et d’une vérité volontairement dissimulée au public. Là où une analyse sociologique mettrait en évidence des logiques de réseau et de protection mutuelle, l’opinion perçoit un système opaque, intentionnellement dissimulé.
La défiance envers les puissants s’en trouve renforcée. Plus le statut de celui qui invoque l’ignorance est élevé, plus cette ignorance devient suspecte. Le « Si j’avais su » ne rassure pas ; il confirme l’idée que les élites vivent dans un monde séparé, soustrait aux contraintes morales ordinaires. En ce sens, cette posture ne désamorce pas la crise de confiance démocratique : elle l’aggrave. En l’absence de reconnaissance claire des angles morts et des responsabilités collectives, le discours officiel laisse le champ libre aux interprétations complotistes, qui trouvent dans cette ignorance proclamée l’un de leurs principaux arguments de crédibilité.
Comment peut-on ne pas savoir ?
Reste enfin une question centrale, rarement abordée frontalement : comment peut-on réellement ne pas savoir, à l’ère d’Internet et des réseaux sociaux ? Depuis le milieu des années 2000, les informations sur Epstein sont accessibles en quelques clics. Articles de presse, archives judiciaires, bases de données publiques, moteurs de recherche, réseaux sociaux : jamais l’accès à l’information n’a été aussi large, aussi rapide, aussi durable.
Ne pas savoir suppose alors un choix implicite. Celui de ne pas chercher. Celui de ne pas vérifier. Celui de considérer que certaines informations, bien que disponibles, ne méritent pas d’être intégrées. L’ignorance devient active. Elle repose sur une hiérarchisation des savoirs dans laquelle la respectabilité sociale l’emporte sur la vigilance morale.
Dans ce contexte, l’argument de l’ignorance perd sa dimension défensive pour devenir un révélateur. Il ne dit pas ce que les acteurs ignoraient, mais ce qu’ils acceptaient de ne pas vouloir savoir. À l’ère numérique, l’ignorance n’est plus un manque. Elle est une stratégie.
L’affaire Epstein ne révèle donc pas seulement des crimes, mais une culture du non-savoir partagée, rendue possible par la redevabilité, la proximité avec le pouvoir et la dissociation morale. Le « Si j’avais su » n’est pas une excuse. C’est le symptôme d’un système.
Frédérique Sandretto ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
10.02.2026 à 16:50
La Chine serait-elle déjà la première puissance militaire mondiale ?
Texte intégral (3234 mots)
La supériorité militaire apparente d’une armée peut devenir une faiblesse lorsqu’elle nourrit un excès de confiance et une rigidité organisationnelle. L’exemple de la France vaincue en 1940 par une armée allemande reconstituée de fraîche date met en évidence le rôle décisif de l’adaptation, de l’innovation et de la capacité industrielle. Transposé à la rivalité sino‑américaine, ce précédent montre que la Chine, portée par une base industrielle très puissante et une doctrine centrée sur les drones et les systèmes autonomes, pourrait en cas de conflit ouvert compenser l’avance technologique américaine.
Cet article est la suite d’un article publié en 2020 qui posait déjà la question de la puissance économique de la Chine.
Aujourd’hui, il ne semble faire aucun doute que les États-Unis sont, de très loin, la première puissance militaire mondiale, en raison de l’importance de leurs dépenses annuelles, de leur nombre de bases à l’étranger et de la taille de leur armée. Celle-ci est aussi reconnue pour son expertise opérationnelle et ses performances technologiques. Malgré cela, cette puissance a priori majeure se trouve, dans les faits, en situation d’infériorité industrielle vis-à-vis de la Chine.
Dans l’hypothèse d’un conflit entre Washington à Pékin, il est fréquent d’entendre que, si à court terme la Chine subirait des dommages catastrophiques pour son économie et sa population, à long terme sa victoire serait acquise. L’histoire montre pourtant que les ressorts d’une victoire sont plus subtils que la simple comparaison des capacités militaires des belligérants au début du conflit. Il est même fréquent que la supériorité militaire perçue par un acteur soit à l’origine de sa défaite.
L’étrange défaite de la France en 1940
Juste après la bataille de France, en juin 1940, Marc Bloch, qui a été pendant l’invasion allemande officier de l’armée française, rédige un ouvrage de référence sur cette question. Dans l’Étrange défaite, il donne de précieuses indications sur la manière dont une organisation militaire peut être vaincue lorsqu’elle surestime sa puissance.
Ce n’est pas le seul exemple d’une armée défaite alors qu’elle se croyait toute puissante. Mais la description que fait Bloch des dysfonctionnements de l’état-major et de la société française en 1940 permet de comprendre avec précision les causes de la défaite. On l’attribue aujourd’hui volontiers à une infériorité numérique, en oubliant qu’elle n’était pas perçue comme telle par les généraux français, ce qui les a conduits à de graves erreurs. On oublie aussi que, lors de la Première Guerre mondiale, la supériorité militaire de l’Empire allemand était évidente, ce qui ne l’a pas empêché d’être vaincu.
Marc Bloch montre comment l’excès de confiance de l’armée française a été la cause principale de son échec en 1940. Il décrit un mécanisme social par lequel une armée qui se considère comme puissante peut être vaincue par une armée nouvelle venant de se construire. Si l’on se réfère aux chiffres de l’époque, à l’exception de l’armée de l’air, la situation était plutôt favorable aux forces alliées : l’armée française disposait d’une supériorité en chars de combat et en véhicules, et les bombardements aériens n’étaient pas aussi efficaces que ceux de l’artillerie, même si leur effet psychologique était bien réel.
L’infériorité renforce les armées, la supériorité les affaiblit
Ce paradoxe d’une armée défaite par excès de confiance en sa propre puissance peut être transposé à l’actualité. Si l’on compare aujourd’hui l’état de l’armée américaine et celui de l’armée chinoise, on retrouve un phénomène similaire. Les Américains disposent d’une supériorité en avions de chasse, porte-avions et chars de combat, mais un paramètre nouveau rend ce critère de suprématie beaucoup moins pertinent : la transformation des guerres contemporaines, marquées par l’omniprésence des drones et l’usage croissant de systèmes militaires autonomes.
En 1940, l’armée française restait imprégnée de sa grande victoire de 1918. Elle avait alors été la première armée du monde, par sa performance technologique et organisationnelle. Très efficace, elle avait dirigé les armées alliées et appris aux Américains à mener une guerre de grande envergure avec les premiers chars réellement efficaces, comme les Renault FT.
Vingt-deux ans plus tard, la société et les militaires français n’ont pas compris que les méthodes de la guerre s’étaient complètement transformées. La victoire de 1918 tenait en partie à une certaine flexibilité et à une capacité d’innovation face à une armée allemande alors plus rigide. Paradoxalement, cette armée allemande, contrainte par le traité de Versailles à dissoudre une grande partie de ses effectifs et de son équipement, a dû, après l’avènement du nazisme, se reconstruire avec une grande flexibilité en tirant les enseignements de sa défaite. Lorsqu’une armée a le temps de comprendre les causes d’une défaite, elle en retire souvent des leçons décisives et peut devenir, quelques années plus tard, une force redoutable.
Devenue flexible et innovante sur le plan technologique, développant un nouvel art de la guerre fondé sur la rapidité et un système de communication très performant, l’armée allemande permet à des unités dotées d’une certaine autonomie d’agir avec une grande efficacité. À l’inverse, l’armée française souffre de graves problèmes de communication, aggravés par un management très centralisé. Au lieu de réagir immédiatement à une agression, il lui faut souvent deux ou trois jours pour donner des instructions pertinentes. Tandis que l’armée allemande a réellement innové, l’armée française reste figée dans un schéma hérité de la Première Guerre mondiale.
Si l’on compare aujourd’hui l’armée américaine et l’armée chinoise, on retrouve ces caractéristiques. La première tend à souffrir d’un sentiment de supériorité, persuadée que son expérience des combats lui confère une véritable flexibilité. La seconde se construit sur un sentiment d’infériorité qui l’amène à développer intensément ses capacités industrielles pour compenser ses faiblesses. Lorsque la Chine engage une guerre, en 1979 contre le Vietnam, les combats débutent d’ailleurs par une défaite, alors même que sa supériorité quantitative est avérée et que le Vietnam sort de quinze années de guerre contre les États-Unis.
Copier l’ennemi, puis innover
Cette expérience défavorable a pourtant un effet positif, renforcé par un sentiment d’infériorité à l’égard de la puissance américaine. Elle pousse la Chine à s’inspirer d’abord de l’armée américaine, à copier certains outils et systèmes, puis à se détourner de ce modèle pour construire sa propre logique militaire. Cette logique – copier, puis innover à partir de ce qui est copié – est d’ailleurs fréquente dans l’industrie. Après avoir débuté dans la production de voitures thermiques, la Chine est devenue leader dans la fabrication de voitures électriques.
À lire aussi : Véhicules électriques : la domination chinoise en 10 questions
Si l’on observe la remise en route de l’armée allemande entre 1919 et 1939, on est frappé par la similarité de cette logique. Il faut d’abord comprendre le fonctionnement de l’armée ennemie, puis s’en libérer pour concevoir son propre modèle, qui surprendra l’adversaire.
La Chine a pris grand soin d’étudier la guerre d’Ukraine et de développer des technologies militaires issues de ces observations. Elle a compris la spécificité d’un conflit où l’usage de drones, aujourd’hui automatisés, transforme profondément les logiques militaires. Elle en a tiré la certitude qu’il est nécessaire de disposer d’une industrie militaire innovante et très flexible. Chaque année, son industrie est ainsi en mesure de proposer des modèles d’armes améliorés ou nouveaux.
Comment la supériorité affaiblit la flexibilité managériale
À cette souplesse en matière d’innovation s’ajoute une autre dimension essentielle : l’efficacité de la supervision militaire. Incapable de reconnaître sa faiblesse, l’armée française, marquée par sa victoire de 1918, souffre en 1940 d’une réelle incompétence managériale. Elle illustre un biais récurrent : toute armée qui se perçoit comme très supérieure à son ennemi se fragilise. Elle ne déploie pas d’efforts frénétiques pour le vaincre et ne cherche pas à se transformer en permanence, convaincue de la solidité de son système de commandement.
Or, comme l’avait montré l’armée française en 1914, c’est la capacité à se réorganiser rapidement et à démettre les officiers incompétents qui fonde l’efficacité. Ce syndrome de supériorité affecte ensuite l’armée nazie qui, dès 1942, ne comprend plus la montée en puissance de l’armée soviétique et commet de nombreuses erreurs stratégiques, à commencer par la bataille de Stalingrad.
On manque d’éléments précis pour juger de l’efficacité managériale chinoise, sinon les purges militaires récentes, poursuivies encore en 2025 et 2026, qui témoignent d’une préoccupation réelle pour la discipline et la loyauté de l’armée. Du côté américain, plusieurs indices suggèrent que la supervision des forces reste marquée, comme lors de la guerre du Vietnam, par un fonctionnement administratif rigide et peu flexible.
Faut-il préférer la supériorité technologique à la supériorité industrielle ?
En 1944, l’armée allemande se trouve confrontée à une nouvelle forme d’art militaire conçue par les Américains. S’appuyant sur leurs capacités industrielles, ceux-ci assurent un renouvellement permanent de leur matériel grâce à un développement sans précédent de la logistique. Les ingénieurs allemands sont frappés par l’infériorité technique apparente de l’équipement américain, mais certains comprennent le véritable danger : un véhicule américain peut être réparé en quelques heures, voire remplacé dès le lendemain, alors que la perte d’un engin allemand a des conséquences lourdes.
Avec l’omniprésence d’armes automatisées comme les drones et les missiles, qui obéissent à une logique industrielle quantitative, et la flexibilité industrielle chinoise, c’est aujourd’hui la Chine qui assume ce rôle. Les Américains, comme les Allemands en 1944, misent sur la supériorité technologique et se heurtent à de réelles difficultés de production et donc de remplacement des engins perdus. La guerre d’Ukraine a montré que détruire un drone bon marché avec un missile antiaérien coûteux peut être problématique.
L’idée selon laquelle la Chine pourrait gagner une guerre contre les États-Unis sur le long terme, tout en subissant seule des dommages catastrophiques pour son économie et sa population, apparaît alors illusoire. En cas de conflit ouvert, l’armée et l’économie américaines devraient très probablement, elles aussi, supporter de terribles pertes. Au vu du grand défilé qui a eu lieu à Pékin, le 8 septembre dernier et de la nouvelle logique militaire chinoise, on peut s’interroger sur la capacité de l’armée américaine à résister à une attaque de la part de la RPC.
L’illusion de la supériorité
Si l’on considère l’armée américaine aujourd’hui, elle semble souffrir d’un syndrome de supériorité, nourri par des opérations conduites contre des États du tiers monde et par un fort investissement technologique. L’armée irakienne, qu’elle a aisément vaincue en 1990, était, au-delà de sa faiblesse matérielle, minée par de graves problèmes organisationnels. Plus récemment, des frappes contre des puissances militaires faibles comme l’Iran ou le Yémen peuvent entretenir l’idée qu’elle reste la première armée du monde. Or l’histoire montre que ce type de conflits ne renforce pas durablement une armée ; on peut penser, par exemple, à la déroute de 1870 d’une armée française pourtant aguerrie par de nombreuses campagnes antérieures, le plus souvent victorieuses.
À cela s’ajoute un élément quantitatif : le budget militaire américain est infiniment supérieur à celui des autres nations, tout comme le nombre de chars, d’avions, de navires et d’unités. Pourtant, la guerre d’Ukraine a mis en lumière les limites de certaines technologies américaines, comme les chars Abrams ou les systèmes antiaériens Patriot, qui ne sont pas toujours plus performants que ceux de leurs adversaires, même si l’armée américaine n’a pas été directement engagée.
L’incident militaire survenu au Pakistan en mai 2025 nous révèle que les militaires chinois bénéficient d’une grande variété d’armements et d’une capacité avérée à introduire chaque année des innovations. C’est ainsi que l’on découvre que la supériorité industrielle et la diversité des arsenaux deviennent déterminants pour tenir dans un conflit de haute intensité.
De leur côté, de par leur compréhension rapide des conséquences de la guerre d’Ukraine les Chinois ont développé un système de chars modernes assistés par des véhicules spécialisés dans la lutte anti-drones. L’armée américaine, en revanche, semble moins capable de transformer rapidement son système militaire. La capacité de la Chine à produire massivement des drones et à les intégrer dans sa doctrine laisse entrevoir une supériorité potentielle.
Enfin, les États-Unis restent profondément attachés à la guerre aérienne comme vecteur de supériorité globale et laissent ainsi à l’armée chinoise l’initiative du combat terrestre. Cette confiance excessive dans la puissance aérienne est en soi problématique. La guerre du Vietnam leur avait pourtant montré l’inefficacité d’un contrôle aérien massif pour emporter une victoire politique, tout en entretenant l’illusion de pouvoir infliger des dommages décisifs à l’ennemi. Comme durant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux indices suggèrent que cette foi dans la supériorité aérienne ne peut avoir, à terme, que des effets négatifs. La Chine a fait de sérieux efforts pour développer ses systèmes antiaériens et mettre en place des armées de drones capables de contester efficacement l’aviation américaine.
Suivant sa logique stratégique, il apparaît que l’armée chinoise ne montrera sa vraie puissance qu’une fois confrontée à un ennemi ayant perdu sa rationalité. En attendant, elle laisse son adversaire conserver sa supériorité illusoire.
Éric Martel-Porchier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
10.02.2026 à 16:50
Réseaux sociaux : aider les adolescents à protéger leur santé mentale en revisitant leurs usages numériques
Texte intégral (1718 mots)
Le dernier rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) l’a confirmé : les réseaux sociaux peuvent avoir des effets néfastes sur la santé mentale des adolescents et amplifier leurs vulnérabilités. Pour lutter contre cette spirale délétère, l’enjeu n’est pas de verser dans les discours moralisateurs ou de miser seulement sur la réglementation. Le marketing social permet de mieux connaître les motivations et les usages des jeunes pour les inviter à revisiter leurs pratiques. Explications.
Les adolescents sont aujourd’hui présents au quotidien sur les réseaux sociaux. Loin de n’être qu’un lieu d’expression ou de sociabilité, ces espaces numériques représentent un environnement saturé d’images idéalisées, de normes sociales et de mécanismes d’influence puissants.
Le rapport publié en décembre 2025 par l’Anses dresse un constat alarmant que notre projet ALIMNUM, financé par l’ANR, visant à identifier des leviers de prévention, avait déjà clairement identifié : les réseaux sociaux affectent de manière profonde l’image corporelle, l’estime de soi et la santé mentale des adolescentes. Et cette influence est suffisamment robuste pour être considérée comme un risque sanitaire avéré.
Les conclusions de l’Anses reposent sur des centaines d’études internationales. Elles établissent que les plateformes très visuelles (Instagram, Snapchat, TikTok) favorisent des mécanismes bien connus : intériorisation d’idéaux corporels irréalistes, auto-objectification, chute progressive de l’estime de soi…
Les effets apparaissent dès 9–11 ans et s’intensifient durant l’adolescence. Et les filles sont significativement plus touchées que les garçons par ces effets psychologiques délétères.
Une exposition massive à des images corporelles irréalistes
Cette confirmation survient dans un contexte où les usages numériques atteignent un niveau d’intensité sans précédent. Le Baromètre du numérique du Credoc montre que 75 % des internautes utilisent les réseaux sociaux chaque jour, et que cette pratique est particulièrement marquée chez les 12–17 ans, dont 58 % se connectent quotidiennement.
Les jeunes filles sont reconnues comme les utilisatrices les plus assidues : 48 % d’entre elles consultent les réseaux au moins une fois par jour, contre 41 % des garçons. Cette différence n’est pas anodine : elle détermine l’exposition à un environnement visuel et social qui, selon l’Anses, reconfigure durablement la manière dont les adolescentes perçoivent leur corps.
À lire aussi : « Dans la vraie vie aussi, j’aimerais bien porter un filtre » : les réseaux sociaux vus par les 8-12 ans
Cette dynamique expose les jeunes filles à un flot continu de contenus, présentant des corps répondant à des idéaux irréalistes, valorisant la retouche photo et les filtres, mettant en avant l’hypersexualisation, encourageant la comparaison ascendante (se comparer à plus « beau », plus mince, plus parfait), diffusant des conseils nutritionnels non vérifiés et des routines de « transformation » qui mélangent bien-être et injonction à la performance.
Une spirale algorithmique qui amplifie les vulnérabilités adolescentes
L’un des apports les plus importants du rapport Anses est de confirmer les effets des algorithmes dans l’exposition des adolescentes à des risques sanitaires. Celles-ci interagissent avec des contenus liés à la minceur, au fitness ou à l’alimentation restrictive et voient ces contenus se multiplier à l’instar d’un puits sans fond.
La tendance « healthy », omniprésente sur les réseaux sociaux, fabrique ainsi un idéal de discipline corporelle, de performance sportive et d’alimentation contrôlée. Une expérience citée par l’agence montre que d’ailleurs que TikTok recommande des contenus liés aux troubles alimentaires en moins de huit minutes lorsqu’un compte se comporte comme un adolescent de 13 ans.
Cette personnalisation algorithmique crée une spirale dans laquelle les insécurités physiques sont renforcées, parfois jusqu’à la détresse psychologique. Les études longitudinales montrent que ces usages sont liés à une augmentation des symptômes anxieux et dépressifs, à des troubles du sommeil et à une exposition accrue aux cyberviolences.
À cela s’ajoute un paradoxe mis en lumière par le CREDOC : bien que les jeunes soient très exposés aux interactions toxiques, seuls 34 % des 12–17 ans déclarent avoir déjà utilisé un dispositif de signalement. Les adolescentes restent donc vulnérables, sans recourir aux outils censés les protéger.
Comprendre les comportements pour mieux prévenir les risques
Face à ce faisceau de données, le marketing social apparaît comme un champ scientifique particulièrement utile pour identifier des leviers d’action. Il offre un cadre pertinent pour concevoir des stratégies de prévention ancrées dans les pratiques réelles des jeunes.
Contrairement aux discours moralisateurs ou purement réglementaires, le marketing social privilégie une démarche compréhensive fondée sur les motivations qui sous-tendent les comportements de consommation : pourquoi les adolescentes publient-elles des selfies ? Pourquoi recherchent-elles des « likes » ? Pourquoi passent-elles plusieurs heures par jour à se comparer aux autres ? Pourquoi les parents et les éducateurs peinent-ils à intervenir ?
Les travaux en marketing social apportent plusieurs éléments de réponse dans ce domaine. Les adolescents utilisent les réseaux sociaux pour appartenir à un groupe, contrôler leur image et obtenir une reconnaissance sociale qui leur fait parfois défaut dans la vie réelle. Ces motivations, naturelles à cet âge, deviennent problématiques lorsque l’environnement numérique les amplifie.
Face à ces enjeux, le marketing social insiste sur la nécessité de travailler avec – et non contre – ces motivations. En fait, le marketing social recommande d’accompagner plutôt que de contrôler en insistant sur certains leviers : co-construire les règles d’usage numérique, promouvoir l’esprit critique face aux images retouchées.
Il se fonde sur une segmentation fine des publics cibles : adolescentes très actives, utilisatrices passives, parents dépassés, enseignants, professionnels de santé. Chacun de ces publics suppose des messages adaptés et non une prévention uniforme, pour renforcer l’efficacité des actions à mener.
Créer un environnement social propice à l’éducation aux médias
L’approche ci-dessus est mobilisée dans le cadre du projet de sciences participatives MEALS, financé aussi par l’ANR, qui s’intéresse aux effets des réseaux sociaux sur les pratiques alimentaires des jeunes. Les jeunes n’y sont pas seulement des sujets d’étude, ils collaborent eux-mêmes à la recherche pour comprendre ce phénomène.
Avec cette méthode innovante, MEALS ambitionne de créer des outils pour développer un esprit critique face aux contenus numériques et de co-construire des messages de prévention adaptés aux jeunes, pour que les réseaux soient des alliés – et non des pièges – en matière de santé publique. Nous cherchons à identifier des comportements, à segmenter en fonction des motivations pour encourager non pas une déconnexion totale, peu réaliste, mais un usage réflexif des réseaux sociaux.
Dans ce contexte, nos jeunes co-chercheurs sont invités à proposer des activités alternatives offrant les mêmes bénéfices sociaux que les plateformes numériques : des espaces d’expression valorisants, des collectifs sportifs, des ateliers non compétitifs, des projets créatifs où le regard des pairs joue un rôle positif dans la construction identitaire.
Concrétement, au travers de ce projet, nous ne souhaitons pas évacuer les réseaux sociaux du quotidien des jeunes mais à revisiter leurs pratiques, en nous servant des contenus numériques qu’ils fréquentent pour les convertir en moments vecteurs de lien social. Il peut s’agir de réaliser une recette trouvée sur TikTok, de débattre d’une vidéo de TiboInschape ou de Louloukitchen, de créer une pièce de théâtre mettant en scène un influenceur, de rédiger un post dans le cadre d’un séminaire d’écriture…
Plus globalement, face aux risques sanitaires relevés par les publications scientifiques dans le cadre du rapport de l’Anses, l’enjeu est de créer des temps forts propices à une réflexion collective autour de l’utilisation des médias numériques. C’est une démarche à explorer pour éduquer les générations futures.
Les projets Alimentation et numérique – ALIMNUM et Manger avec les réseaux sociaux – MEALS sont soutenus par l’Agence nationale de la recherche (ANR), qui finance en France la recherche sur projets. L’ANR a pour mission de soutenir et de promouvoir le développement de recherches fondamentales et finalisées dans toutes les disciplines, et de renforcer le dialogue entre science et société. Pour en savoir plus, consultez le site de l’ANR.
Caroline Rouen-Mallet a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) ) pour le projet ALIMNUM.
Pascale Ezan a reçu des financements de Agence Nationale de la Recherche pour les projets ALIMNUM (Alimentation et Numérique) et MEALS (Manger ensemble avec les réseaux sociaux)
Stéphane Mallet a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) ) pour le projet ALIMNUM.
10.02.2026 à 16:49
Du plastique biodégradable pour pailler les sols agricoles : solution ou nouveau problème ?
Texte intégral (1857 mots)

Les films de paillage ont changé le quotidien de nombreux agriculteurs en facilitant la gestion des mauvaises herbes et de l’eau. Mais exposés au soleil, à l’humidité et au travail du sol, ces plastiques se fragmentent progressivement en micro et nanoplastiques qui s’accumulent dans les sols. Que deviennent ces particules invisibles ? Les plastiques biodégradables peuvent-ils réellement limiter cette pollution ?
En maraîchage et en arboriculture fruitière, les films plastiques de paillage sont devenus incontournables dans certains conditions de température, d’humidité et d’aération des sols. Posés à sa surface, ils empêchent les mauvaises herbes de se développer, conservent l’humidité et accélèrent le réchauffement du sol au printemps. Le résultat ? Des cultures plus productives et une moindre dépendance aux herbicides, notamment dans les sols en milieu tempéré soumis à un stress hydrique saisonnier.
Aujourd’hui, l’immense majorité des films de paillage – près de 90 % – sont fabriqués à partir de polyéthylène, un polymère dérivé du pétrole. Solide, bon marché et imperméable, ce matériau s’est imposé dans les champs. Mais il présente un inconvénient majeur : il ne se biodégrade pas et, une fois fragmenté, peut rester dans l’environnement pendant des siècles.
Une fois les cultures récoltées, ces films ne sont pas complètement retirés. Les fragments qui restent dans les sols se dégradent lentement sous l’effet du soleil, de l’humidité et du travail mécanique des terres. Ils se fragmentent progressivement en microplastiques (dont les dimensions vont de un micromètre à cinq millimètres), atteignant dans certaines exploitations plusieurs milliers de particules par kilogramme de sol. Avec le temps, ces fragments deviennent encore plus petits et forment ce que l’on nomme des nanoplastiques (dont la taille est inférieure à un micromètre).
Invisibles et pendant longtemps peu étudiées, ces particules soulèvent aujourd’hui de nombreuses questions. Comment se comportent-elles dans les sols agricoles ? Quels sont leurs effets potentiels sur l’environnement ? Surtout, les alternatives dites « biodégradables » constituent-elles réellement une solution pour limiter cette pollution ?
À lire aussi : Comment le plastique est devenu incontournable dans l’industrie agroalimentaire
L’agriculture européenne consomme 427 000 tonnes de plastique par an
Bien que les nano et microplastiques présents dans les sols agricoles aient des origines multiples, toutes les sources ne contribuent pas dans les mêmes proportions.
Parmi les apports externes figurent notamment les boues issues des stations d’épuration, parfois utilisées comme amendements organiques. Elles peuvent contenir jusqu’à près de 900 particules microplastiques par kilogramme de matière sèche. À l’échelle européenne, leur épandage représenterait chaque année l’introduction de 63 000 à 430 000 tonnes de microplastiques dans les sols agricoles.
Mais la contribution la plus importante se trouve souvent directement au champ. Les films plastiques de paillage constituent aujourd’hui la principale source de micro et nanoplastiques en agriculture. Chaque année, 427 000 tonnes de ces produits sont utilisées en Europe et 300 000 tonnes en Amérique du Nord. La Chine concentre, à elle seule, près de 30 % de la consommation mondiale, avec 2,6 millions de tonnes de films agricoles, dont 1,3 million de tonnes de films de paillage, soit environ les trois quarts de l’usage mondial.
À lire aussi : Peut-on se passer de plastique en agriculture ?
Des plastiques, du champ à l’assiette
Or, dans les sols agricoles, les nano et microplastiques ne se comportent pas comme de simples déchets inertes. Ils peuvent modifier les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols en affectant leur structure, leur porosité, leur capacité à retenir l’eau ou encore les cycles du carbone et de l’azote.
Ces particules peuvent aussi se fixer aux racines, freinant l’absorption de l’eau et la croissance des plantes. Certaines cultures, comme la laitue ou le blé, absorbent même des microplastiques depuis le sol, qui peuvent ensuite migrer vers les parties comestibles que nous mangeons.
Ce n’est pas tout : plus un fragment de plastique est petit, plus sa surface exposée au milieu environnant augmente par rapport à son volume. Or, les interactions entre le plastique et le sol se produisent principalement à sa surface. Ainsi, à quantité de plastique égale, les micro et surtout les nanoplastiques présentent une surface de contact beaucoup plus importante avec leur environnement que les fragments de plus grande taille.
Cette surface élevée les rend particulièrement réactifs : ils interagissent plus fortement avec les molécules présentes dans le sol. De nombreuses substances chimiques peuvent ainsi se fixer à la surface de ces particules, notamment des polluants organiques ou des métaux. En présence de pesticides, les plastiques peuvent alors se comporter comme de véritables « éponges chimiques », captant et concentrant localement des substances indésirables et potentiellement toxiques.
À lire aussi : Microplastiques, nanoplastiques : quels effets sur la santé ?
Plastique biodégradable ? Une promesse à nuancer
Pour répondre à cette problématique, des plastiques dits « biodégradables » ont été développés. Présentés comme une alternative aux films de plastique classiques, ils reposent sur un principe séduisant : après usage, ils seraient transformés par les microorganismes du sol en composés naturels, tels que l’eau et le dioxyde de carbone.
Mais cette promesse dépend fortement des conditions environnementales. En effet, la biodégradabilité est tributaire des conditions environnementales. Un plastique peut se dégrader rapidement dans une installation de compostage industriel, soumise à de fortes chaleurs, mais rester presque intact pendant longtemps dans un sol agricole plus frais.
C’est notamment le cas des polymères couramment utilisés dans les films de paillage biodégradables, comme le polybutylène adipate-co-téréphtalate (PBAT) ou le poly (butylène succinate) (PBS). Dans les conditions réelles des champs agricoles, leur dégradation peut rester incomplète.
Se pose alors la question de leur devenir à long terme et de leur capacité réelle à limiter l’accumulation de nano et microplastiques dans les sols.
Les vers de terre à la rescousse ?
Constatant ces échecs, des chercheurs s’attachent désormais à en comprendre les causes et à identifier les conditions environnementales et biologiques qui permettraient d’améliorer la dégradation de ces plastiques dans les sols agricoles. Il ne s’agit pas seulement de concevoir de nouveaux matériaux, mais aussi d’adapter les pratiques agricoles à leur présence dans les sols, en particulier dans les systèmes où l’usage des films de paillage est intensif.
Les scientifiques s’intéressent ainsi au rôle des amendements organiques, des biostimulants et des extraits microbiens, capables de modifier l’activité biologique des sols. Des études ont ainsi montré que le vermicompost – un compost produit par les vers de terre – peut fortement améliorer les performances de certains plastiques biodégradables en conditions agricoles. Cet effet s’expliquerait à la fois par l’apport de nutriments favorisant les microorganismes du sol et par la présence d’une flore microbienne spécifique, issue du tube digestif des vers de terre.
Pour mieux comprendre ces mécanismes, des expériences en laboratoire suivent la dégradation des plastiques à l’aide de systèmes respirométriques mesurant la transformation du carbone des plastiques en dioxyde de carbone par les microorganismes. Ces dispositifs permettent d’évaluer de manière quantitative dans quelles conditions cette dégradation est accélérée.
À lire aussi : Du slip troué aux sachets de thé, quelques indicateurs pour mesurer la santé des sols
Améliorer les plastiques et les pratiques
Si les plastiques dits biodégradables représentent une piste intéressante contre l’accumulation dans les sols de nano et de microplastiques, leur efficacité dépend étroitement des conditions réelles du milieu agricole et ils ne peuvent pas être considérés comme une solution systématique ou tenue pour acquise.
Les travaux de recherche montrent qu’améliorer leur biodégradation passe à la fois par une meilleure compréhension de l’interaction entre les matériaux, le fonctionnement biologique des sols et les pratiques culturales associées. Amendements organiques spécifiques, apports de souches exogènes et stimulation de l’activité microbienne autochtone constituent autant de leviers potentiels.
À terme, réduire la pollution plastique en agriculture nécessitera une approche globale, combinant innovation technologique, pratiques agronomiques adaptées et cadres réglementaires cohérents, afin de concilier performance agricole et protection durable des sols.
Jules Bellon a reçu des financements de la Région Normandie pour mener ses travaux de recherche.
Feriel Bacoup a reçu des financements de Région Normandie
Richard Gattin ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
10.02.2026 à 16:49
McDonald's : vers un retour des jouets en plastique dans le Happy Meal ?
Texte intégral (1782 mots)

Bannis des menus enfants depuis 2022, les jouets en plastique font leur retour chez McDonald’s par l’intermédiaire d’une collaboration avec Playmobil. Derrière l’argument du plastique végétal, que dit vraiment ce retour ? Et qu’omet-il de rappeler ?
Novembre 2025 marque, en France, un tournant symbolique chez le géant du fast-food McDonald’s. Après plusieurs années de « diète plastique » dans le menu enfant où il a fallu se contenter de cartes à collectionner, de coloriages ou d’autres livrets d’activité, les jouets en plastique ont fait leur grand retour dans le Happy Meal.
Grâce à une collaboration avec Playmobil, McDonald’s tourne la page du « tout-papier ». L’enseigne semble entonner le refrain d’Elmer Food Beat : « Le plastique, c’est fantastique. » Ce revirement s’appuie sur une mécanique redoutable mêlant nostalgie et vernis écologique.
À lire aussi : La nostalgie, un puissant levier du marketing
Du jouet jetable à l’objet patrimonial : la requalification morale du plastique
En France, depuis le 1er janvier 2022, la loi Agec (anti-gaspillage pour une économie circulaire) interdit, dans son article 81, la distribution de jouets en plastique dans les menus destinés aux enfants. Il s’agit, d’une part, de réduire les déchets à usage unique et, d’autre part, de limiter l’exposition des enfants à des objets à faible durée de vie. En filigrane, cette mesure interroge le rôle des jouets comme leviers d’attractivité des offres de restauration rapide auprès des plus jeunes, dans un contexte de préoccupations croissantes liées à la prévention de l’obésité infantile et à la promotion de pratiques alimentaires plus équilibrées. Pour les enseignes de restauration rapide à l’instar du géant McDonald’s, cette mesure a signé la fin d’un pilier historique du menu enfant, longtemps structuré autour de la promesse d’un jouet en plastique à collectionner.
Durant cette parenthèse, où le jouet enfant était principalement réduit à du papier ou carton, le plastique n’avait pas quitté l’écosystème de McDonald’s. Il s’était simplement déplacé vers la cible adulte. C’est là toute l’habileté de la stratégie du géant du fast-food. Alors que l’enfant apprenait la sobriété écologique, les opérations pour adultes remettaient l’objet en plastique au centre du désir. En France, ce déplacement s’est matérialisé en 2025 autour de deux opérations emblématiques.
Tout a commencé avec les collaborations menées avec des univers culturels fortement chargés en capital affectif à l’occasion d’une part de la sortie du film Minecraft en avril, puis de la nouvelle saison de Mercredi en juillet 2025. Des figurines en plastique à vocation de collection ont été intégrées à des menus et dispositifs promotionnels tournés vers une clientèle adulte.
Du jouet pour enfants à l’artefact pour « kidults »
L’objet change ainsi de statut : de jouet jetable pour enfant, il devient artefact culturel pour kidults. La contrainte environnementale n’a pas fait disparaître le plastique. Elle l’a requalifié, en l’inscrivant dans une économie de la nostalgie et de la collection, socialement plus acceptable.
La subtilité réside dans le changement de statut du jouet en plastique : dans le menu enfant, le plastique était devenu un déchet polluant à bannir ; dans le menu adulte, il est célébré comme un objet de collection. En réhabilitant le plastique auprès des parents, McDonald’s a préparé les esprits. Une fois que le plastique a été « relégitimé » par la culture pop, il devenait plus simple de le réintroduire dans le menu enfant. Encore fallait-il lui trouver une vertu morale.
Pour acter ce retour en arrière, le choix du partenaire était crucial. Il semble, dans ce contexte, que l’association avec Playmobil ait pu agir comme un bouclier. Contrairement aux jouets sous licence de films, séries ou autres dessins animés susceptibles d’être jetés une fois la mode passée, les figurines Playmobil bénéficient d’une aura de respectabilité.
Il s’agit de jouets robustes qui se transmettent de génération en génération. L’argument implicite est fort, il ne s’agit pas d’un déchet plastique mais d’un patrimoine ludique. En outre, la collection de dix figurines d’animaux sauvages s’inscrit dans un imaginaire largement associé à la préservation de la nature et à la protection du vivant, ce qui renforce la portée affective et symbolique de l’opération.
Le « plastique végétal » : fantastique ou cynique ?
Face à l’urgence climatique, pour que ce retour soit socialement acceptable, il fallait un argument technique imparable : le plastique végétal. C’est ici que l’analyse doit se faire critique, car le terme flirte avec le malentendu.
D’une part, dire qu’un plastique est végétal signifie qu’il est fabriqué à partir de biomasse (fibres de canne à sucre, amidon de maïs, etc.) et non de pétrole. S’il s’agit d’un progrès en termes d’empreinte carbone, un polymère végétal a toutefois des similitudes avec son cousin pétrolier. S’il est perdu dans la nature, il mettra des décennies à se désagréger.
D’autre part, fabriquer des millions de figurines en plastique végétal implique d’utiliser des ressources agricoles. La systématisation de cette production pour des objets considérés comme « gratuits » pose la question de l’allocation des terres arables dans un monde aux ressources contraintes.
Enfin, et c’est peut-être la critique fondamentale, le plastique végétal est une solution technologique qui permet de tout changer pour que rien ne change. Il valide la poursuite d’un modèle basé sur la distribution massive de petits objets manufacturés avec un repas, plutôt que de questionner la nécessité même de ce « cadeau » systématique. De là à parler d’habillage éthique, il n’y a qu’un pas…
Du Happy Meal au Happy Doggy : déplacer l’affect pour légitimer le plastique
Chez McDonald’s, les enjeux environnementaux n’ont pas fait disparaître le plastique. Ils l’ont rendu plus rare, plus scénarisé et de facto plus désirable. Dans le Happy Meal, les jouets en papier et carton demeurent ainsi la norme. Lorsque le jouet en plastique réapparaît, il est présenté comme un collector, pensé pour durer. La circulation de ces objets sur les plates-formes de vente en ligne, comme Vinted ou leboncoin, en témoigne. Le plastique se voit attribuer une seconde vie, socialement valorisée, qui le distingue du jetable.
In fine, le problème ne serait plus la matière, mais l’éphémère. Le jouet en soi n’est pas problématique, en revanche son absence de valeur affective l’est. Quid en ce sens des jouets en papier/carton ayant succédé à l’ère du plastique ? Ne sont-ils pas jetés bien plus rapidement que leurs homologues en plastique ? En requalifiant subtilement le plastique comme support de mémoire et de collection, McDonald’s transforme une pratique de consommation potentiellement dissonante en plaisir légitime.
L’introduction en novembre 2025 de jouets pour chiens (les Happy Doggy) dans le menu Best Of s’inscrit dans cette logique de déplacement symbolique. Le plastique trouve dans l’univers du pet marketing un nouvel espace de légitimation affective, moins exposé aux injonctions de sobriété adressées à la consommation enfantine.
Sophie Renault ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
10.02.2026 à 16:47
Comment deux amnésiques ont révolutionné nos connaissances sur la mémoire
Texte intégral (1531 mots)
Comment nous souvenons-nous des choses ? Paradoxalement, deux des personnes qui ont le plus aidé les neuroscientifiques à répondre à cette question étaient amnésiques. Retour sur les histoires exceptionnelles d’Henry Molaison et de Kent Cochrane, deux patients hors norme.
Et si perdre la mémoire n’était pas seulement une tragédie, mais aussi une clé pour comprendre ce que signifie se souvenir ? Deux patients, Henry Molaison et Kent Cochrane, ont marqué l’histoire des neurosciences au XXᵉ siècle.
Le premier, opéré en 1953 pour traiter une épilepsie sévère, a révélé le rôle crucial d’une structure cérébrale, l’hippocampe, dans la formation des souvenirs. Le second, victime d’un accident de moto en 1981 ayant provoqué une hémorragie cérébrale sévère, a montré que la mémoire du passé et la capacité à se projeter dans l’avenir reposent sur les mêmes réseaux cérébraux.
Leurs destins ont bouleversé notre compréhension de la mémoire humaine et, plus largement, de l’identité elle-même. Voici leurs histoires.
Henry Molaison, plongé à jamais dans l’oubli
Né en 1926, Henry Molaison souffrait depuis l’enfance d’une épilepsie résistante aux traitements médicamenteux. En 1953, le neurochirurgien William Scoville lui proposa une solution radicale : retirer une partie de ses lobes temporaux médians, situés à la base du cerveau et comprenant notamment les deux hippocampes (l’hippocampe est une structure présente de manière symétrique dans les deux hémisphères cérébraux).
L’intervention permit de réduire la fréquence des crises, mais bouleversa la vie du patient à jamais : Henry perdit la capacité de créer de nouveaux souvenirs, une amnésie dite « antérograde ».
La neuropsychologue Brenda Milner, de l’université McGill à Montréal, l’évalua dès 1955 et fit une découverte majeure : l’intelligence et les capacités langagières du patient semblaient intactes, mais toute nouvelle information s’effaçait au bout de quelques minutes. Chaque rencontre, chaque conversation disparaissait presque aussitôt. Henry ne parvint d’ailleurs jamais à se souvenir de ses entrevues répétées avec Brenda Milner, ignorant jusqu’à sa mort, en 2008, qui elle était.
Les observations menées sur Henry Molaison, révélèrent que l’hippocampe était une pièce maîtresse de la mémoire déclarative, celle qui permet de se souvenir des faits et des événements. Brenda Miller réalisa aussi que la mémoire n’est pas un processus global, mais une fonction composée de plusieurs systèmes, chacun reposant sur des structures cérébrales distinctes.
En effet, la neuropsychologue constata que, malgré son incapacité à enregistrer de nouveaux souvenirs, Henry conservait une certaine capacité d’apprentissage : il pouvait encore acquérir de nouveaux gestes moteurs, et par exemple apprendre à tracer une étoile dans un miroir. Ce type d’apprentissage, qui relève de la mémoire implicite, non consciente, dépend d’autres régions du cerveau que l’hippocampe. De ce fait, cette capacité restait, chez lui, préservée.
Les études menées sur le patient désigné par les initiales H. M., qui ont préservé son anonymat dans la littérature scientifique jusqu’à sa mort, ont été décisives pour montrer que la mémoire humaine n’est pas une fonction unique, mais repose en réalité sur des systèmes distincts, qui sont situés dans différentes régions du cerveau.
Elles ont également révélé le rôle central de l’hippocampe et des structures voisines des lobes temporaux médians dans la formation et la consolidation des souvenirs.
À ce jour, Henry Molaison reste l’un des patients les plus étudiés de l’histoire de la neuropsychologie.
Kent Cochrane, privé de passé et de futur
Quelques décennies après l’intervention chirurgicale subie par Henry Molaison, un Canadien allait devenir amnésique et, malgré lui, contribuer à enrichir encore nos connaissances sur le fonctionnement la mémoire.
Kent Cochrane, né en 1951, fut victime en 1981 d’un grave accident de moto. Le choc provoqua une hémorragie cérébrale et détruisit ses lobes temporaux médians. Comme le patient H. M., Kent Cochrane devint incapable d’enregistrer un quelconque nouveau souvenir de sa vie. Pire encore, il oublia de nombreux épisodes de sa vie passée. Cela incluait les moments les plus marquants sur le plan émotionnel, comme le jour où il apprit le décès de l’un de ses frères.
Le neuropsychologue Endel Tulving étudia le cas de Kent Cochrane pendant plus de vingt ans. Il constata que son patient conservait des connaissances sur lui-même et sur le monde, telles que les personnes qu’il côtoyait ou les lieux qu’il fréquentait ou avait visités. En revanche, il était incapable de revivre un souvenir personnel.
À partir de ces observations, Endel Tulving proposa la distinction entre deux formes de mémoire : la mémoire épisodique, qui concerne les événements vécus dans leur contexte spatial, temporel et émotionnel, et la mémoire sémantique, relative aux connaissances générales sans ancrage contextuel.
Par exemple, se souvenir du moment précis où l’on a rencontré la personne avec qui l’on partage sa vie relève de la mémoire épisodique : le lieu exact de cette première rencontre, les circonstances, les personnes présentes, les premiers mots échangés, ainsi que l’émotion ressentie à cet instant. La mémoire sémantique concerne quant à elle des informations plus générales, indépendantes de toute expérience vécue particulière. Elle inclut par exemple nos connaissances sur le monde et la société, le nom des artistes que nous apprécions, le nom des capitales de différents pays, ou encore la date de naissance de nos proches.
Chez Kent Cochrane, la mémoire sémantique demeurait intacte, alors que la mémoire épisodique était détruite. Ce contraste montrait que ces deux systèmes mnésiques reposent sur des réseaux cérébraux différents : les hippocampes pour la mémoire épisodique, et les pôles temporaux pour la mémoire sémantique.
Plus étonnant encore, Endel Tulving constata que la capacité à se projeter dans l’avenir mobilise les mêmes structures cérébrales que celle qui permet de se souvenir du passé. En effet, depuis l’accident qui l’avait privé de ses hippocampes, et donc de ses souvenirs, Kent Cochrane était incapable de s’imaginer dans l’avenir, même proche.
Le cas de ce patient a ainsi mis en lumière le fait que la mémoire ne sert pas seulement à évoquer le passé, mais aussi à anticiper le futur. Une faculté qui se situe au cœur de la conscience de soi, et de notre identité.
Au-delà de la science, une leçon d’humanité
En perdant la capacité de se souvenir des événements de leur propre vie, Henry Molaison et Kent Cochrane ont révélé à quel point la mémoire façonne notre rapport au monde et à nous-mêmes.
Ces deux destins, à la fois tragiques et éclairants, ont fait de la mémoire un miroir de notre identité. Ces deux cas cliniques posent une question essentielle : que reste-t-il de notre humanité lorsque notre mémoire s’efface ?
Au-delà de la reconnaissance de l’immense apport des études sur ces amnésies, les parcours de ces deux hommes nous invitent aussi à réfléchir sur notre empathie face à la vulnérabilité.
Enfin, ces deux histoires profondément humaines traduisent les liens singuliers qui unissent les chercheurs à ceux qui deviennent, souvent malgré eux, des figures majeures de la science.
Après la mort d’Henry Molaison, Brenda Milner confia que celles et ceux qui avaient travaillé auprès de lui avaient été profondément touchés par sa disparition. Elle ajoutait qu’il y a quelque chose de profondément paradoxal à être fortement ému par la mort d’un homme qui, toute sa vie durant, n’a jamais su qui vous étiez.
Olivier Després ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
10.02.2026 à 16:46
Le mystère de la « Dame à l’éventail », éclairé par une photo de Jeanne Duval
Texte intégral (1748 mots)
On sait très peu de choses au sujet de la comédienne haïtienne Jeanne Duval (1818-1868), compagne de Charles Baudelaire peinte par Manet, qui continue de fasciner les spécialistes de la littérature, de la peinture et du féminisme.
En mai 2025, je suis tombée sur une photographie extraordinaire sur le site Wikipedia anglais consacré à Jeanne Duval. Duval, originaire d’Haïti, était la maîtresse et muse de longue date, supposée n’avoir jamais été photographiée, du poète français Charles Baudelaire.
Le portrait, représentant une femme assise vêtue d’habits bourgeois raffinés, avait été publié sur Wikipédia par une étudiante de l’historienne de l’art Justine De Young. De Young évoque ce portrait comme un exemple d’auto-mise en scène dans son dernier ouvrage, The Art of Parisian Chic. Imprimée sur une petite carte (il s’agit d’un portrait-carte de visite, en vogue à l’époque) et datée du 18 août 1862, l’image a été découverte dans les archives françaises par une autre chercheuse, comme je l’ai mentionné dans un récent article publié par le Times Litterary Supplement, et documentée en ligne par elle en 2021.
Une photo redécouverte
Jeanne Duval fascine de nombreuses chercheuses et chercheurs experts du féminisme et du postcolonialisme, en partie parce que l’on sait très peu de choses précises à son sujet. Intriguée, je me suis rendue moi-même aux archives à l’été 2025, juste pour voir la photo. Là, j’ai remarqué une deuxième photo au format carte de visite à côté de la première. Elle portait le même nom, « Jeanne », la même date, et provenait du même studio de photographie, l’atelier Nadar. Les deux cartes avaient été inscrites au registre du dépôt légal sous la mention « idem ».
À lire aussi : Les femmes censurées des « Fleurs du mal »
Cette deuxième Jeanne se tient debout, dans une pose inhabituellement rigide pour une photographie de ce type. Elle porte une robe de soirée à épaules dénudées et ses cheveux tombent en cascade dans son dos, retenus sur le front par un simple bandeau.
Une inspiration pour Manet ?
Une version numérique haute résolution de cette image a révélé de fortes ressemblances avec le modèle de la première photographie, similitudes qui n’étaient pas immédiatement apparentes sur les petites cartes. Les deux photos révèlent une implantation capillaire similaire, une même imperfection sur le front et une bague au même doigt. Il était clair que si la première photographie représentait Duval, celle-ci aussi.
Cependant, le crucifix porté en pendentif sur une chaîne courte et les grandes boucles d’oreilles m’ont semblé particulièrement intéressants. Des bijoux très similaires sont en effet portés par le modèle dans le portrait d’Édouard Manet intitulé Dame à l’éventail (1862), également connu sous le nom de la Maîtresse de Baudelaire allongée. Ce dernier titre avait été inscrit au dos du tableau à un moment donné, soit pendant, soit avant l’inventaire posthume de l’atelier de l’artiste.
La pose maladroite et l’expression faciale impénétrable du modèle ont souvent été interprétées comme faisant référence aux difficultés et à la maladie que Duval endurait à l’époque. Elle se trouvait dans une situation financière désastreuse et souffrait d’une paralysie du côté droit depuis un accident vasculaire cérébral survenu en 1859. Cependant, l’identification du modèle de Manet comme étant Duval est parfois contestée par les chercheurs, pour plusieurs raisons.
Le portrait sur carte de « Jeanne » debout, réalisé la même année que le portrait à l’huile et son étude à l’aquarelle, présente des traits, une expression et des ombres très similaires. Les historiens de l’art Griselda Pollock et Therese Dolan ont émis l’hypothèse que Manet s’était inspiré d’une photographie ou d’une carte de visite de Duval pour réaliser Dame à l’éventail. Les liens entre la photographie de Jeanne debout et les portraits à l’huile et à l’aquarelle de Manet semblent confirmer que Duval est le sujet des deux peintures (aquarelle et huile) et des deux photographies.
Pourquoi ces photographies ont-elles été prises ?
Duval posait-elle donc pour Manet dans ces photographies ? Il convient de noter que Manet, Félix Nadar (le propriétaire du studio de photographie) et Baudelaire étaient tous des amis proches, et que Duval s’était séparée du poète, apparemment de manière définitive, en 1861.
Duval a peut-être proposé de poser, ou a été invitée à poser pour les photographies de Nadar (et indirectement pour Manet, qui travaillait souvent à partir de photographies) en échange d’argent. Nous savons qu’elle avait approché au moins un autre ami de Baudelaire en 1862 pour essayer de lui vendre les biens du poète. Le fait qu’elle tienne une cravache sur la photographie avec le crucifix vient étayer l’hypothèse de la monétisation. Peut-être espérait-elle, ou espéraient-ils, que le portrait sur carte de la muse sadique/angélique du recueil de poèmes de Baudelaire les Fleurs du mal (1857) aurait une valeur marchande.

Il est également possible que Baudelaire ait commandé des portraits de son ancienne maîtresse à des fins personnelles. Malgré sa colère et son ressentiment envers Duval après leur séparation, ses lettres et ses croquis témoignent de sa loyauté et de son affection persistantes.
Ou peut-être Duval souhaitait-elle rétablir la vérité sur qui elle était. Peut-être voulait-elle que le monde sache qu’elle n’était en fait pas la muse diabolique et sexualisée au centre du volume de poésie scandaleux de Baudelaire, mais plutôt quelqu’un qui s’habillait avec des vêtements élégants et respectables (probablement empruntés) comme on le voit sur la première photographie.
Peut-être que le crucifix et la bague visible à l’annulaire des deux photos avaient également pour but de témoigner de ses valeurs morales. Cependant, certains détails de la deuxième image, notamment la cravache, les épaules nues et les grandes boucles d’oreilles, suggèrent que sa volonté n’était pas de se donner une image « respectable ».
Il est probable que les portraits-cartes de visite, s’ils représentent bien Jeanne Duval, aient été motivées par des raisons financières, qu’elles aient été son idée ou celle de Nadar, Manet ou Baudelaire. Il est également possible que la mise en scène de soi ait fait partie de son objectif, mais si tel est le cas, le message qu’elle voulait faire passer n’est pas clair.
Des chercheurs français ont récemment découvert que Duval était morte dans un hospice six ans seulement après la réalisation de ces portraits. Jusqu’alors, personne ne semblait savoir ce qu’elle était devenue. Ces photographies témoignent, du moins à mes yeux, de la résistance de Duval à se laisser cataloguer et de sa dignité tranquille.
Maria C. Scott publiera prochainement un article universitaire sur ce sujet dans la revue French Studies.
10.02.2026 à 14:11
Les chiens et les chats transportent les vers plats envahissants de jardin à jardin
Texte intégral (1261 mots)
Les chiens et les chats domestiques peuvent transporter les vers plats (plathelminthes) collés sur leur pelage. Sans le vouloir, ils contribuent ainsi à la propagation de ces espèces exotiques envahissantes. Notre travail vient d’être publié dans la revue scientifique PeerJ.
Au niveau mondial, les espèces exotiques intrusives représentent un des dangers majeurs pour la biodiversité. Il est frappant de découvrir que les chiens et les chats, nos compagnons du quotidien, participent de manière involontaire à l’envahissement des jardins par une espèce potentiellement dangereuse pour la biodiversité.
Comment avons-nous fait cette découverte ?
Nous menons un projet de sciences participatives sur les invasions de vers plats.
Nous avons été interpellés par des courriels envoyés par des particuliers signalant la présence de vers collés au pelage de chiens et de chats. Nous avons alors réexaminé plus de 6 000 messages reçus en douze ans et avons constaté que ces observations étaient loin d’être anecdotiques : elles représentaient environ 15 % des signalements.
Fait remarquable, parmi la dizaine d’espèces de vers plats exotiques introduits en France, une seule était concernée : Caenoplana variegata, une espèce venue d’Australie dont le régime alimentaire est composé d’arthropodes (cloportes, insectes, araignées).

En quoi cette découverte est-elle importante ?
On sait depuis longtemps que les plathelminthes (vers plats) exotiques sont transportés de leur pays d’origine vers l’Europe par des moyens liés aux activités humaines : conteneurs de plantes acheminés par bateau, camions livrant ensuite les jardineries, puis transport en voiture jusqu’aux jardins.
Ce qu’on ne comprenait pas bien, c’est comment les vers plats, qui se déplacent très lentement, pouvaient ensuite envahir les jardins aux alentours. Le mécanisme mis en évidence est pourtant simple : un chien (ou un chat) se roule dans l’herbe, un ver se colle sur le pelage, et l’animal va le déposer un peu plus loin. Dans certains cas, il le ramène même chez lui, ce qui permet aux propriétaires de le remarquer.
Par ailleurs, il est surprenant de constater qu’une seule espèce est concernée en France, alors qu’elle n’est pas la plus abondante. C’est Obama nungara qui est l’espèce la plus répandue, tant en nombre de communes envahies qu’en nombre de vers dans un jardin, mais aucun signalement de transport par animal n’a été reçu pour cette espèce.
Cette différence s’explique par leur régime alimentaire. Obama nungara se nourrit de vers de terre et d’escargots, tandis que Caenoplana variegata consomme des arthropodes, produisant un mucus très abondant et collant qui piège ses proies. Ce mucus peut adhérer aux poils des animaux (ou à une chaussure ou un pantalon, d’ailleurs). De plus, Caenoplana variegata se reproduit par clonage et n’a donc pas besoin de partenaire sexuel : un seul ver transporté peut infester un jardin entier.
Nous avons alors tenté d’évaluer quelles distances parcourent les 10 millions de chats et les 16 millions de chiens de France chaque année. À partir des informations existantes sur les trajets quotidiens des chats et des chiens, nous avons abouti à une estimation spectaculaire : des milliards de kilomètres au total par an, ce qui représente plusieurs fois la distance de la Terre au Soleil ! Même si une petite fraction des animaux domestiques transporte des vers, cela représente un nombre énorme d’occasions de transporter ces espèces envahissantes.
Un point à clarifier est qu’il ne s’agit pas de parasitisme, mais d’un phénomène qui s’appelle « phorésie ». C’est un mécanisme bien connu dans la nature, en particulier chez des plantes qui ont des graines collantes ou épineuses, qui s’accrochent aux poils des animaux et tombent un peu plus loin. Mais ici, c’est un animal collant qui utilise ce processus pour se propager rapidement.
Quelles sont les suites de ces travaux ?
Nous espérons que cette découverte va stimuler les observations et nous attendons de nouveaux signalements du même genre. D’autre part, nos résultats publiés concernent la France, pour laquelle les sciences participatives ont fourni énormément d’informations, mais quelques observations suggèrent que le même phénomène existe aussi dans d’autres pays, mais avec d’autres espèces de vers plats.
Il est désormais nécessaire d’étendre ces recherches à l’échelle internationale, afin de mieux comprendre l’ampleur de ce mode de dispersion et les espèces concernées.
Tout savoir en trois minutes sur des résultats récents de recherches commentés et contextualisés par les chercheuses et les chercheurs qui les ont menées, c’est le principe de nos « Research Briefs ». Un format à retrouver ici.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
10.02.2026 à 12:55
« Trump est fou » : les effets pervers d’un pseudo-diagnostic
Texte intégral (3562 mots)
Qualifier Donald Trump de « fou », comme c’est régulièrement le cas ces derniers temps, tend à détourner l’attention de la cohérence de la politique conduite par l’intéressé depuis son retour à la Maison-Blanche et du fait qu’il constitue moins une anomalie individuelle qu’un produit typique d’un système économique, médiatique et culturel qui valorise la domination, la spectacularisation et la marchandisation du monde. Il convient de se détourner de cette psychologisation à outrance pour mieux se concentrer sur les structures sociales qui ont rendu possible l’accession au pouvoir d’un tel individu.
C’est devenu en quelques jours du mois de janvier 2026 la note la plus tenue de l’espace médiatique : Trump est fou. Une élue démocrate au Congrès des États-Unis tire la sonnette d’alarme sur X, le 19 janvier : le président est « mentalement extrêmement malade », affirme-t-elle. Fox News, média proche de Donald Trump sur le long terme, reprend les propos dès le lendemain sur un ton factuel. Le 22 janvier, lendemain du discours de Trump à Davos, durant lequel il a demandé « un bout de glace » (à savoir le Groenland) « en échange de la paix mondiale », l’Humanité fait le titre de sa une avec un magnifique jeu de mots : Trump « Fou allié ».

Le 23 janvier, des messageries relayent ce qui déjà se diffuse largement dans la presse : « Déclaration de représentants démocrates au Congrès US : la santé mentale de Donald Trump est altérée ; c’est pire que Joe Biden, c’est un cas de démence ».
Le 24 janvier, la une de l’hebdomadaire The Economist montre un Donald Trump torse nu à califourchon sur un ours polaire – message de folle divagation en escalade mimétique avec Poutine et ses clichés poitrine à l’air, l’animal du Grand Nord soulignant en l’occurrence les prétentions du locataire de la Maison Blanche sur le Groenland.

Même le premier ministre slovaque Robert Fico, pourtant un allié du milliardaire new-yorkais, l’aurait jugé « complètement dérangé » après l’avoir rencontré le 19 janvier à Mar-a-Lago. Le cas Trump est donc désormais régulièrement examiné à l’aune de la folie par des élus, des journalistes, mais aussi des psychiatres.
Il y a pourtant matière à être dubitatif sur les accusations de folie portées contre Trump. Non seulement elles n’ont guère contribué jusqu’ici à le neutraliser, mais elles ont même fait son succès et empêchent de penser le vrai problème. Les arguments en leur défaveur méritent un tour d’horizon.
Quelle légitimité du discours médicalisant ?
Il peut sembler contestable, même quand on est psychiatre et a fortiori quand on ne l’est pas, de déclarer quelqu’un malade mental sans l’avoir examiné selon des protocoles précis.
Quand le 5 mars 2025 le sénateur français Claude Malhuret, qui est médecin, traite Trump de « Néron » et de « bouffon » à la tribune du palais du Luxembourg – une intervention qui deviendra virale aux États-Unis –, le discours est de belle facture rhétorique, mais il n’est pas médical.
Le sénateur ne se réfère d’ailleurs pas à l’Académie. À ce stade, en l’absence d’examen effectué par des professionnels dont les résultats auraient été rendus publics, qualifier Trump de fou relève plus de la tournure politique que médicale.
Une rhétorique inefficace
Les déclarations sur la folie de Trump se succèdent sur le long cours sans avoir montré la moindre efficacité pour le combattre. Dès la première année de son premier mandat, la rumeur bruisse d’une possible destitution pour raison mentale sur la base d’avis d’experts qui n’ont pourtant pas eu d’entretiens avec le principal intéressé. Aucune procédure de destitution ne sera engagée sur ces bases.
Une nouvelle sortie collective de professionnels sur le déclin cognitif de Trump, lui trouvant un « désordre sévère et incurable de la personnalité », eut lieu en octobre 2024. Ce qui ne l’empêcha pas d’être élu assez aisément le mois suivant face à Kamala Harris. Quant à la défaite de 2020, elle arriva en pleine vague Covid et fut moins la conséquence des assertions selon lesquelles le président sortant était fou que de sa gestion désastreuse de la pandémie : sous-estimation de l’ampleur des contagions et de la mortalité, refus ostensible du port du masque.
Un jour, sans doute, Trump quittera-t-il le pouvoir, mais les effets des jugements de maladie mentale sur sa carrière politique – et en particulier sur sa victoire de 2024, qui se produisit alors que les électeurs avaient toute connaissance de son profil personnel – ont été nuls jusqu’à aujourd’hui.
Des attaques qui font le jeu de Trump
Pis encore : ces attaques ne sont pas seulement inefficaces, elles servent Trump. Le cœur de sa technique – qu’il a explicitée dès les années 1980 dans The Art of the Deal – consiste à semer la controverse pour faire parler de lui et de ses projets. Lui répondre sur ce terrain qui est le sien, en le traitant notamment de psychopathe (ou d’aberrant, de monstrueux, de stupide, ou de lunaire – le dernier vocable à la mode), c’est tomber dans le piège : il se pose ensuite en victime et ramasse les suffrages. Le sujet d’étonnement est que, depuis dix ans, aucune leçon n’ait été tirée de ces échecs à répétition dans la lutte contre Trump.
« Je fulmine et m’extasie comme un dément, et plus je suis fou, plus l’audimat grimpe »,
s’autopitchait Trump pour son émission de téléréalité, The Apprentice (source : Think Big and Kick Ass: In Business and Life, D. Trump et B. Zanker, 2007). Folie ? Non. Mise en scène éprouvée qui attire l’attention à son profit.
Mais le bénéfice s’enclenche aussi pour les commentateurs et les chambres d’écho. Et c’est là que le bât blesse : les « coups de folie » de Trump sont en réalité des diversions où les médias, les oppositions, les politiques et, souvent, les experts s’engouffrent pour le buzz.
Trump est à l’image de la société
Au-delà de la télé, les méthodes de Trump sont typiques de conseils de vie qui circulent largement dans la société, émanant de bien d’autres agents que lui. On pense, par exemple, aux classiques Swim With the Sharks Without Being Eaten Alive (1988), de Harvey Mackay, ou The Concise 33 Strategies of War (2006), de Robert Greene.
On pense aussi aux métaphores guerrières qui se glissent dans des ouvrages de management plus pondérés ; « les salles de commandement en temps de guerre » décrivent les réunions des équipes « successful », dans X-Teams (2007) ; donner plus de pouvoir au manager est recommandé pour qu’il ne se retrouve pas « face à dix ennemis avec une seule balle dans son fusil », dans Smart simplicity (2014).
De ce point de vue, Trump est « banal, trop banal ». Il est typique d’une « héroïcomanie hypermoderne », porté par une « trumpisation du monde » qui le dépasse. La conséquence de ce constat sociologique est que le problème est beaucoup plus profond qu’une folie idiosyncrasique, si perturbante soit-elle.
Déclarer Trump fou fait oublier à quel point le mode opératoire trumpiste est, pour une part non négligeable, partagé transversalement par la société. Ainsi, Trump privilégie-t-il les rapports de force. Il a toujours été sans équivoque sur ce point qui lui apporta la réussite dans le business, la télévision, le marché du leadership, et maintenant en politique. Mais cela ne se réalise pas contre la société américaine, comme par accident, mais en miroir d’un vaste spectre de celle-ci.
La négociation le revolver sur la tempe alimente quantité de traités de développement personnel, de management et de communication au travail. Elle est la matrice scénaristique assurant la popularité des films hollywoodiens (non seulement les westerns mais aussi les « propositions qui ne se refusent pas » du film le Parrain). Rien, là, de fou ou d’aberrant. Juste un éthos dominant qui a sa rationalité et qui n’a jamais été soft.
Aussi, aucune surprise si la rencontre d’un pouvoir fort est seule susceptible de faire fléchir Trump. Là encore, il est explicite sur ce point depuis longtemps. Lorsqu’il fut proche de la faillite dans les années 1990, il courbe l’échine devant les banquiers : « Quand vous devez de l’argent à des gens, vous allez les voir dans leur bureau […] Je voulais faire n’importe quoi sauf aller à des dîners avec des banquiers, mais je suis allé dîner avec des banquiers » (in Think big, 2007). Rationalité strictement instrumentale, certes, mais rationalité. L’article de fond « Ice and heat » récemment publié par The Economist sur l’affaire du Groenland relève que la menace européenne de déclencher l’instrument anti-coercition a joué, pour l’instant, dans le recul de Trump.
Révéler la structure pour mieux la combattre
Pour contrer l’Amérique de Trump, il conviendrait d’abord plutôt de se pencher sur la rationalité de ses lignes directrices. Son action, aussi bien en diplomatie qu’en politique intérieure, aussi bien en politique économique qu’en gestion des ressources naturelles, découle d’une stratégie claire et constante, pensée et volontariste. C’est sur ce terrain qu’il faut se battre pour défaire Trump, et non par des coups d’épée dans l’eau qui donnent bonne conscience à bon compte, sont repris en boucle, mais n’apportent rien de consistant face au fulminant showman.

Du discours de Trump à Davos, le 21 janvier 2026, ressortent plusieurs traits qui n’ont rien de mentalement dérangé. D’une part, il apporte un momentum aux extrêmes droites européennes déjà au pouvoir ou aux portes de celui-ci. D’autre part, une Europe qui se réarme et qui reste toujours globalement « alliée » des États-Unis débouche sur une situation stratégique plus favorable du point de vue américain : tel est le résultat, objectif, de la séquence historique actuelle.
Enfin, la demande d’avoir un « titre de propriété » sur le Groenland réussit à installer, même si elle n’aboutit pas, l’horizon indépassable du monde selon Trump : « La terre, comme les esclaves d’Ulysse, reste une propriété », comme l’écrivait Aldo Leopold, pionnier de la protection de la nature aux États-Unis, dans Almanach d’un comté des sables, publié en 1948 (traduction française de 2022 aux éditions Gallmeister). Trump est dans son élément, en parfaite maîtrise du vocabulaire pour fragiliser la transition ou bifurcation écologique. Comme l’exprime Estelle Ferrarese dans sa critique de la consommation éthique, « dans aucun cas la finalité n’est de mettre certaines choses (comme la terre) hors marché ».
Question ouverte pour l’Histoire
En insistant sur la supposée folie de Trump, les commentaires se rabattent sur un prisme psychologisant individuel. Peut-être Trump est-il fou. La sénilité peut le guetter – il en a l’âge. Des centaines de pathologies psychiatriques sont au menu des possibles qui peuvent se combiner.
Mais l’analyse et l’inquiétude ont à se pencher, en parallèle, sur le symptôme structurel de notre temps, sur ce système qui, depuis cinquante ans, propulse Trump au zénith des affaires, des médias, des ventes de conseils pour réussir, et deux fois au sommet du pouvoir exécutif de la première puissance mondiale.
La prise de distance avec l’accusation de folie portée contre Trump ouvre un chantier de réflexion où le problème n’est plus la folie personnelle du leader élu, mais une stratégie dont Trump est, en quelque sorte, un avatar extrême mais emblématique. Le regard se détache de l’événementiel chaotique – trumpiste ou non trumpiste – pour retrouver le fil d’une analyse structurelle. Sans conteste, Trump fragilise l’ONU et l’OMS, mais à l’aune de l’histoire longue, il ressort qu’une « impuissance structurelle » persévère, selon laquelle « dans le cas des États-Unis, c’est un grand classique que de bouder (au mieux) et de torpiller (autant que possible) toutes les démarches multilatérales dont ils n’ont pas pris l’initiative ou qu’ils ne sont pas (ou plus) capables de contrôler » (Alain Bihr, l’Écocide capitaliste, tome 1, 2026, p. 249).
Les psychés peuvent être « débridées », mais ce sont les « structures sociales » qui « sélectionnent les structures psychiques qui leur sont adéquates ». Trump n’est plus alors une anomalie foutraque, sénile, troublée, en rupture avec ce qui a précédé et à côté des structures sociales, mais la poursuite d’une marchandisation du monde à haut risque, dont le diagnostic est à mettre en haut des médiascans, pour discussion publique.
Olivier Fournout ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
10.02.2026 à 12:22
Pourquoi l’obésité progresse-t-elle depuis trente ans ?
Texte intégral (1915 mots)
Le ministère de la santé vient de lancer sa feuille de route 2026-2030 pour la prise en charge des personnes en situation d’obésité. Ce cadre stratégique invite à questionner un paradoxe : l’État a déployé dès 2001 un ensemble d’actions autour de l’activité physique et la nutrition en vue de réduire la prévalence de cette maladie, et, pourtant, celle-ci augmente régulièrement depuis une trentaine d’années.
L’obésité est une maladie dont les causes et conséquences sont désormais bien documentées par la littérature médicale comme sociologique. Sa prévalence n’a cessé d’augmenter depuis les années 1990 dans le monde. La France ne fait pas exception. De 8,5 % en 1997, la population adulte en situation d’obésité est passée à 15 % en 2012, puis à 17 % en 2020. Des écarts importants existent entre les personnes suivant leur âge, leur sexe, leur région, leur niveau d’éducation et leur catégorie socioprofessionnelle.
Ces données épidémiologiques et sanitaires ont participé à une prise de conscience (certes, partielle) des pouvoirs publics quant à la nécessité d’agir. Mais les politiques publiques menées contre l’obésité en France sont inefficaces. Comment l’expliquer ? Quelles stratégies sont mises à l’œuvre par les lobbies pour contrer les mesures ? Et comment concilier lutte contre l’obésité et lutte contre la grossophobie ? Faisons le point.
Les années 1990, ou la prise de conscience du lien entre alimentation et santé
La reconnaissance de l’obésité comme une « épidémie » par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1997 incite les autorités sanitaires nationales à se saisir de cet enjeu.
En France, il faut attendre la fin des années 1990 pour voir le ministère de la santé s’intéresser à la question. Plusieurs dynamiques politiques et sociales se croisent alors. Le débat sur la « malbouffe » s’impose dans l’espace médiatique à cette période, notamment après le démontage d’un restaurant d’une célèbre chaîne de fast-food à Millau en 1999.
Il s’insère dans une séquence plus large de préoccupations sur le lien entre santé et alimentation, amorcée dès le début de la décennie avec les épisodes liés au variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, surnommé « maladie de la vache folle ».
Un plan national nutrition santé depuis 2001
Pour que les différentes dynamiques se combinent, il faudra néanmoins attendre l’apparition d’une « fenêtre d’opportunité politique » en 2000.
Le gouvernement cherche alors des thèmes à proposer à ses partenaires européens, en vue de sa présidence de l’Union européenne en 2001. Le ministère de la santé suggère celui de la nutrition santé, et en profite pour lancer un plan national, le Plan national nutrition santé (PNNS). Cette mise à l’agenda discrète, à la croisée de préoccupations nutritionnelles, sanitaires et politiques, constitue sans doute la première inscription de l’obésité comme problème de santé publique en France. La version actuelle du PNNS se décline en dix mesures phares présentées sur le site MangerBouger.
Avec notamment des recommandations en direction des professionnels et du grand public, le PNNS a pour objectif d’améliorer l’état de santé de la population en agissant sur la nutrition, qui est l’un de ses déterminants majeurs. Le plan vise à réduire la prévalence de l’obésité chez les adultes – le même objectif de réduction sera intégré à la loi 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, sans que des moyens supplémentaires soient adoptés.
À lire aussi : Lutte contre l’obésité : deux nouvelles mesures efficaces
Plan obésité, taxe soda et autres mesures
« Problème fluide » par excellence, l’obésité fera l’objet après 2001 de nouvelles inscriptions régulières à l’agenda, sans que cet intérêt entraîne de diminution de la prévalence. Elle fera de nouveau l’objet d’une attention politique et sociale à travers les débats parlementaires sur la loi de santé publique de 2004 et ceux entourant les messages sanitaires dans les publicités alimentaires en 2007.
D’autres mesures seront prises, parmi lesquelles :
la mise en place d’un plan obésité en 2010 (pour améliorer la prise en charge),
le développement d’initiatives locales (villes-santé, santé-environnement, etc.), par exemple ici, dans les Hauts-de-France, et de plans autour de l’activité physique ou encore
Mais le poids des lobbies, et la complexité des actions à mener pour réduire la prévalence de l’obésité en font un problème insoluble – en tout cas sans changements sociaux structurels.
Alors, plus de vingt ans après le lancement du premier PNNS, le constat est sans appel : la prévalence de l’obésité continue de croître. Cet échec relatif s’explique par plusieurs facteurs structurels.
Une approche trop centrée sur la responsabilité individuelle
Tout d’abord, les politiques publiques françaises ont adopté une approche essentiellement comportementale, centrée sur la responsabilité individuelle : mieux manger, bouger davantage, équilibrer son alimentation.
Ce cadrage moral et sanitaire tend à négliger les déterminants sociaux de la santé, alors que les études montrent que l’obésité touche davantage les classes populaires, les femmes et les habitants de certaines régions. En ciblant les comportements sans agir sur les conditions de vie – précarité, urbanisme, accès à des aliments de qualité –, ces politiques ne font qu’effleurer les causes profondes du phénomène.
Ensuite, les politiques de lutte contre l’obésité se caractérisent par une forte dispersion institutionnelle (ministère de la santé, de l’éducation nationale, de la ville…). Les mesures se succèdent sans continuité, souvent diluées dans des programmes plus larges (nutrition, prévention, activité physique). L’obésité n’apparaît que comme un sous-thème, rarement comme une priorité politique autonome. Cette dilution empêche la mise en place d’une stratégie nationale cohérente et dotée de moyens pérennes.
Le poids de l’agro-industrie
Enfin, le poids des industries agroalimentaires constitue un frein structurel à l’effectivité des politiques nutritionnelles. Dotées de ressources économiques, juridiques et communicationnelles considérables, ces industries développent des stratégies d’influence visant à affaiblir, retarder ou contourner les mesures de santé publique adoptées par les pouvoirs publics.
L’un des exemples les plus emblématiques concerne les mobilisations contre le Nutri-Score, portées par des acteurs industriels (secteurs des huiles, des produits laitiers, des produits sucrés) et certains États membres de l’Union européenne, comme l’Italie, qui ont cherché à en contester la scientificité, à en limiter le caractère obligatoire ou à promouvoir des systèmes alternatifs moins contraignants auprès de la Commission européenne. Ces actions s’inscrivent dans une logique classique de lobbying réglementaire, visant à déplacer le débat du terrain de la santé publique vers celui de la liberté économique, du choix du consommateur ou de la protection des « traditions alimentaires ».
À lire aussi : Retour sur les principaux arguments des « anti-Nutri-Score »
Ces logiques se retrouvent également dans les tensions autour de la fiscalité nutritionnelle, en particulier la taxe sur les sodas ou sur la réticence à encadrer strictement la publicité alimentaire, notamment à destination des enfants et des adolescents. Dans ce contexte, les politiques publiques apparaissent souvent prises en étau entre injonctions à la prévention des maladies chroniques et pressions industrielles, ce qui limite la portée transformatrice des réformes engagées.
Ces impasses morales, institutionnelles et économiques contribuent à expliquer la difficulté persistante de la France à enrayer l’augmentation de l’obésité, malgré une mobilisation politique et médiatique récurrente.
Lutter aussi contre la grossophobie
Peut-être pourrions-nous également incriminer les préjugés et stéréotypes à l’égard des personnes grosses. Le relatif désengagement des politiques de santé et l’accent mis sur la responsabilité individuelle ne s’expliquent-ils pas, au moins en partie, par une vision stéréotypée de l’obésité, qui en fait avant tout une affaire de décisions personnelles ?
Dans la lutte contre la grossophobie, les pouvoirs publics demeurent en tous cas frileux, déléguant aux bonnes volontés associatives ou professionnelles la mise en place d’actions dont on peine à deviner les contours. À cet égard, l’absence du terme de « grossophobie » dans la dernière feuille de route obésité présentée par le gouvernement interroge fortement.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
10.02.2026 à 00:05
La fauconnerie comme outil de subversion des normes de genre au Moyen Âge
Texte intégral (2916 mots)

Dans deux films récents consacrés à la vie des femmes au Moyen Âge, on observe la présence de faucons, symboles de pouvoir et, au risque d’employer un anachronisme, d’émancipation avant l’heure.
Les faucons prennent leur envol au cinéma. Dans deux adaptations littéraires récentes — Hamnet et H is for Hawk —, ces oiseaux sont intimement liés à la vie et aux émotions de leurs héroïnes respectives : Agnes Shakespeare (née Hathaway) et Helen Macdonald.
La symbolique des rapaces est au cœur de ces deux nouveaux films : Hamnet, l’adaptation par Chloé Zhao du roman de Maggie O’Farrell paru en 2020, et H is for Hawk, tiré des mémoires de Macdonald publiés en 2014 et traduits en français par M pour Mabel. Dans ces films, les faucons deviennent des figures complexes et ambivalentes.
Si Hamnet se déroule à l’époque élisabéthaine, H is for Hawk prend place dans le monde contemporain. Mais une histoire encore plus ancienne retrace la relation entre femmes et oiseaux de proie. Mes recherches montrent qu’au Moyen Âge déjà, cette relation était multiforme. Bien plus qu’un accessoire de mode, les faucons offraient aux femmes un moyen d’affirmer leur genre, leur pouvoir et leur statut social dans un monde largement dominé par les hommes.

Au Moyen Âge, le dressage des faucons — subtil jeu d’équilibre entre contrôle et liberté — était fréquemment associé à la cour amoureuse entre hommes et femmes.
La dimension romantique de la fauconnerie transparaît dans les œuvres d’art, les objets et la littérature de l’époque. Des scènes d’hommes et de femmes chassant ensemble à l’aide de faucons figurent parmi un large éventail d’artéfacts médiévaux : tapisseries ornant murs de châteaux, étuis décorés servant à protéger les miroirs à main…
La plus grande tapisserie des Devonshire Hunthing Tapestries — un ensemble de quatre tapisseries du XVe siècle — est entièrement consacrée à la fauconnerie. Des amoureux y sont représentés en train de se promener bras dessus bras dessous, pendant que leurs oiseaux chassent le gibier.
Deux étuis à miroir du XIVe siècle, conservés au British Museum et au Metropolitan Museum of Art, représentent des couples à cheval, tenant des faucons. Ces miroirs ont probablement été offerts comme gages d’amour. La littérature médiévale regorge elle aussi de références à des femmes accompagnées de faucons, voire représentées comme tels.
Mais la figure de la femme-faucon qu’il faudrait « dompter et contrôler » ne renvoie toutefois pas à une soumission féminine. Au contraire, la fauconnerie et sa symbolique permettaient aux femmes de l’élite médiévale d’exprimer leur autorité et leur autonomie.
Se définir à travers l’image
Lorsque les femmes de haut rang avaient la possibilité de se représenter à travers la culture visuelle, elles choisissaient souvent d’y inclure des oiseaux de proie. Cela était notamment visible sur les sceaux, cachets officiels souvent utilisés à l’époque médiévale pour authentifier les documents juridiques. Le sceau constituait la marque d’identification de la personne qui l’apposait, et renvoyait à son statut social et à son autorité. L’iconographie des sceaux et les matrices servant à les produire reflétaient la manière dont les femmes de haut rang voulaient être perçues par le monde.
Elizabeth de Rhuddlan, la plus jeune fille du roi Edouard Ier d’Angleterre et d’Eleonore de Castille, a choisi pour la matrice de son sceau personnel, un motif particulièrement répandu chez les femmes du XIIIe siècle : une femme debout, corps légèrement tourné vers un rapace docile posé sur sa main gauche.
Une autre matrice du même siècle montre Elizabeth, dame de Sevorc, à cheval, assise en amazone, tenant un faucon dans une main et la serre d’un aigle dans l’autre.
À travers ces sceaux, les femmes médiévales affirmaient leur maîtrise des rapaces, mais surtout, leur appartenance à un cercle féminin puissant.

Des archives montrent par ailleurs que reines et dames ont créé et administré des parcs et domaines de chasse. Elles pratiquaient la fauconnerie ensemble, dressaient les rapaces et les offraient même parfois en cadeau.
Certaines petites espèces, comme le faucon merlin, étaient jugées plus convenables pour les femmes. Dans le film H is for Hawk, Helen (Claire Fory) refuse de se contenter d’un faucon merlin, qu’elle rejette comme « oiseau de dame ». Effectivement, les femmes du Moyen Âge n’acceptaient pas toujours, loin de là, de se plier aux règles prescrites par les manuels de bonne conduite.
Margaret Beaufort, la grand-mère paternelle d’Henry VIII, possédait de nombreux rapaces : faucons merlins, lanerets… mais aussi de grandes espèces comme des autours et des faucons lanier.
Le parc à daims qu’elle fit aménager autour de son palais de Collyweston, dans le Northamptonshire, se prêtait parfaitement à la fauconnerie. Sa belle-fille, la reine Elizabeth de York, qui disposait de ses propres appartements au palais, chassait quant à elle avec des autours.
Dans certains cas, les femmes semblent même avoir été reconnues comme de véritables expertes dans le domaine de la fauconnerie. Les Heures Taymouth, un livre d’heures enluminé du XIVe siècle, probablement destiné à une femme d’origine royale, montre des femmes coiffées de parures, chassant le colvert à l’aide de grands rapaces. Leur posture affirme leur autorité, leur savoir-faire et leur contrôle sur les oiseaux.
Au siècle suivant, Dame Juliana de Berners, prieure du monastère de Sopwell, est considérée comme l’autrice — en partie — du Boke of St Albans, un ouvrage traitant de la chasse et de la fauconnerie.

Des recherches menées par English Heritage ont par ailleurs révélé que certaines femmes pouvaient gagner leur vie grâce à leur expertise en matière de dressage de faucons. Au milieu du XIIIe siècle, une femme nommée Ymayna était la gardienne des faucons et des chiens du comte de Richmond. En échange de ses services, elle et sa famille obtinrent le droit d’exploiter des terres voisines.
Si Ymayna constitue une figure exceptionnelle dans un milieu largement masculin, son parcours laisse penser que d’autres femmes ont exercé des fonctions similaires, bien que leurs noms soient absents de tout document historique.
Certaines pourraient figurer parmi les propriétaires de couteaux dont les manches sont conservés dans des musées européens. L’un des plus remarquables, sur lequel est sculptée une femme noble serrant contre son cœur un petit rapace, date du XIVe siècle et est exposé à l’Ashmolean Museum d’Oxford.
Les textes littéraires révèlent que la fauconnerie favorisait la socialisation et la solidarité entre femmes. Dans le poème Sir Orfeo, écrit en moyen anglais, Orfeo aperçoit un groupe de soixante femmes à cheval, chacune tenant un faucon.

Dans Hamnet, Agnes explique à son mari William Shakespeare que son gant de fauconnerie lui a été offert par sa mère. Les femmes du Moyen Âge et du début de l’époque moderne s’offraient des cadeaux entre elles, y compris des gants. Mes recherches suggèrent toutefois que les oiseaux de proie étaient plus fréquemment offerts comme cadeaux entre femmes et hommes.
Margaret Beaufort donnait et recevait des rapaces de la part de parents et de proches masculins, parmi lesquels son jeune petit-fils, le futur Henri VIII. Les rapaces étaient considérés comme étant des cadeaux convenables lors d’occasions et évènements marquants. En 1525, Margaret Pole, comtesse de Salisbury, offrit par exemple trois faucons à son neveu Henry Courtenay pour célébrer son accession au titre de marquis d’Exeter.
Le fait que des femmes puissantes propriétaires de terres aient pris part aux échanges rituels de rapaces avec des hommes montre que la fauconnerie ne relevait pas uniquement d’une expression féminine du pouvoir. En possédant des domaines de chasse et en donnant ou recevant des oiseaux de proie, elles s’inscrivaient dans un univers traditionnellement masculin : celui de la chasse et de la générosité seigneuriale.
Rachel Delman a reçu des financements du Arts and Humanities Research Council (2013-2016) et du Leverhulme Trust (2019-2022).
10.02.2026 à 00:02
Épées, enfants et mémoire : ce que révèle un cimetière médiéval du Kent
Texte intégral (1895 mots)
Loin d’être de simples symboles guerriers, les épées, lances et boucliers mis au jour témoignent d’une société où les armes exprimaient autant la perte et le deuil que la force et le statut.
Lors d’une récente fouille archéologique à laquelle j’ai pris part, quatre épées anglo-saxonnes anciennes ont été mises au jour. Chacune éclaire la manière dont les armes étaient perçues à l’époque. Plus surprenant encore, un enfant a été retrouvé enterré avec une lance et un bouclier. Faut-il y voir la trace d’un combattant trop jeune pour l’être ? Ou ces objets revêtaient-ils une portée symbolique dépassant largement le seul cadre de la guerre ?
Les armes sont porteuses de valeurs. Les chevaliers Jedi de la franchise Star Wars incarneraient-ils la même noblesse s’ils maniaient des couteaux plutôt que des sabres laser ? Aujourd’hui, les armées modernes font la guerre à distance, à coups de missiles et de drones, ou s’appuient sur des dispositifs mécaniques mêlant armes à feu et blindage. Pourtant, dans de nombreux pays, l’épée demeure un attribut cérémoniel des officiers – au point que la porter de travers peut encore suffire à démasquer un imposteur.
La fouille, que j’ai menée avec l’archéologue Andrew Richardson, portait sur un cimetière du haut Moyen Âge, et les épées ont été découvertes dans des sépultures. Notre équipe, composée de chercheurs de l’Université du Lancashire et d’Isle Heritage, a fouillé au total une quarantaine de tombes. Cette découverte est visible dans l’émission de BBC2 Digging for Britain.
L’une des épées mises au jour se distingue par un pommeau en argent décoré (la partie arrière de la poignée) et par un anneau fixé à la poignée. Il s’agit d’un objet du VIe siècle prestigieux et d’une grande beauté, conservé dans un fourreau doublé de fourrure de castor. L’autre épée présente une petite garde en argent et une large embouchure de fourreau dorée et côtelée – deux éléments de styles artistiques différents, issus de périodes distinctes, réunis sur une même arme.
Ce mélange se retrouve également dans le trésor de Staffordshire, découvert en 2009, qui comprenait 78 pommeaux et 100 collerettes de poignée, datés sur une large période allant du Ve au VIIe siècle de notre ère. Au Moyen Âge, les épées – ou certaines de leurs parties – étaient conservées, transmises et entretenues par leurs propriétaires. Les armes anciennes étaient souvent plus estimées que les neuves.
Le poème en vieil-anglais Beowulf, probablement composé entre le VIIIe et le début du XIe siècle, offre un vocabulaire particulièrement riche pour parler des épées : il y est question de l’« épée ancienne » (ealdsweord), de l’« épée d’autrefois » (gomelswyrd), ou encore d’objets transmis en héritage (yrfelafe). Le texte évoque aussi des « armes durcies par les blessures » (waepen wundum heard), façonnées autant par l’usage que par le temps.
Deux énigmes consacrées à l’épée figurent également dans le Livre d’Exeter, un vaste recueil de poésie mis par écrit au Xe siècle, mais qui renvoie sans doute à des représentations plus anciennes. Dans l’énigme 80, l’arme se définit elle-même comme « a warrior’s shoulder-companion », « la compagne d’épaule du guerrier ». Une formule qui fait écho de manière frappante à nos découvertes du VIe siècle : dans chaque sépulture, la poignée de l’épée était placée contre l’épaule, tandis que le bras du défunt semblait enlacer l’arme.
Un geste comparable a déjà été observé dans des sépultures de Dover Buckland, également dans le Kent. Deux autres cas ont été recensés à Blacknall Field, dans le Wiltshire, et un à West Garth Gardens, dans le Suffolk. Notons qu’il est rare de voir quatre individus enterrés de cette manière au sein d’un même cimetière – d’autant plus qu’ils ont été découverts à très faible distance les uns des autres.
La zone du cimetière que nous avons fouillée comprend plusieurs tombes avec armes, disposées autour d’une sépulture profonde entourée d’un fossé circulaire. Un petit tertre de terre devait à l’origine recouvrir cette tombe, la rendant visible et la distinguant clairement dans le paysage funéraire.
La sépulture la plus ancienne – celle qui a servi de repère pour l’implantation des autres tombes avec armes – contenait un homme dépourvu de tout objet métallique ou armement. Les tombes armées sont surtout attestées dans les générations qui entourent le milieu du VIe siècle : il est donc probable que cet individu ait été enterré avant que ne s’impose l’usage de déposer des armes avec les morts. Peut-être parce que, durant la période troublée de la fin du Ve siècle et des toutes premières années du VIe, les armes étaient jugées trop précieuses pour être soustraites à la défense des vivants.
La découverte d’une tombe d’enfant âgé de 10 à 12 ans, accompagné d’une lance et d’un bouclier, vient renforcer cette interprétation. La courbure de sa colonne vertébrale rend peu probable qu’il ait pu manier ces armes de manière fonctionnelle.
Une seconde sépulture, celle d’un enfant encore plus jeune, contenait une large boucle de ceinture en argent. L’objet était manifestement trop grand pour un garçon de deux à trois ans. Ce type de dépôt est habituellement associé à des hommes adultes : les grandes boucles de ceinture constituaient un symbole de fonction dans les contextes de la fin de l’Antiquité romaine et du haut Moyen Âge, comme en témoignent, par exemple, les spectaculaires exemplaires en or de Sutton Hoo.
La découverte d’une tombe d’enfant âgé de 10 à 12 ans, comprenant une lance et un bouclier, vient compléter ce tableau. La courbure de sa colonne vertébrale rendait peu probable un usage aisé de ces armes.
Une deuxième tombe, celle d’un enfant encore plus jeune, a livré une large boucle de ceinture en argent. L’objet, de toute évidence, était bien trop grand pour un garçon âgé de deux à trois ans. De tels dépôts funéraires sont habituellement réservés à des hommes adultes : dans l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge, les grandes boucles de ceinture faisaient office de marqueurs de rang ou de fonction, comme l’illustrent les spectaculaires exemplaires en or découverts à Sutton Hoo.
Alors pourquoi ces objets ont-ils été déposés dans les tombes ? De récents résultats d’analyses ADN soulignent l’importance de la filiation masculine, en particulier celle transmise par le chromosome Y. À West Heslerton, dans l’est du Yorkshire, des analyses génétiques montrent l’existence de liens biologiques entre des hommes enterrés à proximité les uns des autres. Beaucoup d’entre eux étaient accompagnés d’armes, dont l’un inhumé avec une épée et deux lances. Plusieurs autres sépultures masculines ont été disposées autour de cet ancêtre fortement armé.
Nous n’affirmons pas pour autant que les armes anciennes étaient uniquement cérémonielles. Les entailles visibles sur les boucliers et l’usure des lames témoignent d’un usage réel, lié à l’entraînement comme au combat. Les blessures et les morts précoces observées sur les squelettes attestent de l’usage bien réel des armes dans la société du haut Moyen Âge. De son côté, la poésie anglaise ancienne parle autant de deuil que d’héroïsme.
Comme le montre Beowulf, le sentiment de perte était étroitement lié à la mise en scène des morts masculins et de leurs armes, mais aussi aux inquiétudes face à l’avenir :
The Geat people built a pyre for Beowulf, Beowulf’s funeral
(Le peuple des Goths érigea un bûcher pour Beowulf, pour les funérailles de Beowulf)
stacked and decked it until it stood four-square,
(l’empilant et l’ornant jusqu’à ce qu’il se dresse, solide et parfaitement carré,)
hung with helmets, heavy war-shields
(garni de casques, de lourds boucliers de guerre)
and shining armour, just as he had ordered.
(et d’armures étincelantes, comme il l’avait ordonné.)
Then his warriors laid him in the middle of it,
(Puis ses guerriers le déposèrent en son centre,)
mourning a lord far-famed and beloved.
(pleurant un seigneur illustre et aimé.)
Les armes déposées dans nos tombes relevaient autant de l’expression de la perte et du deuil que d’une affirmation matérielle de la force, de la masculinité et de la lignée masculine. Même des guerriers aguerris, endurcis par les combats et par l’âge, pleuraient leurs morts et les enterraient avec des armes – des épées notamment – porteuses d’histoires.
La lance, le bouclier et les boucles de ceinture découverts dans de petites tombes parlaient des hommes que ces enfants auraient pu devenir.
Duncan Sayer tient à remercier le Dr Andrew Richardson, codirecteur du projet de fouilles de l’est du Kent.
09.02.2026 à 23:08
En Mésopotamie, le rôle très important des personnes trans
Texte intégral (3000 mots)

Loin d’être marginalisées, certaines personnes de genre atypique jouaient un rôle central dans le culte, la politique et l’armée en Mésopotamie, montrant une forme ancienne de reconnaissance sociale.
Aujourd’hui, les personnes trans font face à une politisation de leur vie et à la diabolisation par des politiciens, certains médias et une partie de la société. Mais dans quelques-unes des premières civilisations de l’histoire, ces personnes étaient reconnues et comprises de manière totalement différente.
Dès 4 500 ans avant notre ère, en Mésopotamie dans le Proche-Orient ancien par exemple, des rôles sociaux importants, avec des titres professionnels majeurs, étaient dévolus aux personnes de genre atypique. Notamment les serviteurs cultuels de la grande divinité Ištar, appelés assinnu, et les hauts courtisans royaux appelés ša rēši. Des preuves antiques montrent que ces personnes occupaient des positions de pouvoir en raison de leur ambiguïté de genre, et non malgré elle.
La Mésopotamie
La Mésopotamie est une région qui correspond aujourd’hui principalement à l’Irak et à des régions de la Syrie, de la Turquie et de l’Iran. Faisant partie du Croissant fertile, le mot « Mésopotamie » vient du grec et signifie littéralement « terre entre deux fleuves », l’Euphrate et le Tigre.
Pendant des milliers d’années, plusieurs grands groupes culturels y ont vécu. Parmi eux, les Sumériens, puis plus tard les groupes sémitiques appelés Akkadiens, Assyriens et Babyloniens.
Les Sumériens ont inventé l’écriture en traçant des coins sur des tablettes d’argile. L’écriture, appelée cunéiforme, a été créée pour transcrire la langue sumérienne, mais les civilisations suivantes l’ont utilisée pour écrire leurs propres dialectes de l’akkadien, la plus ancienne langue sémitique.
Qui étaient les assinnu ?
Les assinnu étaient les serviteurs religieux de la grande déesse mésopotamienne de l’amour et de la guerre, Ištar.
Reine des cieux, Ištar a précédé Aphrodite et Vénus.

Connue des Sumériens sous le nom d’Inanna, cette déesse guerrière détenait le pouvoir politique ultime et conférait leur légitimité aux rois. Elle veillait également sur l’amour, la sexualité et la fertilité. Dans le mythe de son voyage aux Enfers, sa mort entraîne la fin de toute reproduction sur Terre. Pour les Mésopotamiens, Ištar était l’une des plus grandes divinités du panthéon. L’entretien de son culte officiel garantissait la survie de l’humanité.
Ses serviteurs, les assinnu, avaient la responsabilité de la satisfaire et de s’occuper d’elle par le biais de rituels religieux et de l’entretien de son temple. Le titre même d’assinnu est un mot akkadien lié à des termes signifiant « féminin », « homme-femme » ainsi que « héros » et « prêtresse ».

Leur fluidité de genre leur venait directement d’Ištar. Dans un hymne sumérien, la déesse est décrite comme ayant le pouvoir de :
transformer un homme en femme et une femme en homme,
changer l’un en l’autre,
habiller les femmes avec des vêtements d’hommes,
habiller les hommes avec des vêtements de femmes,
mettre des fuseaux dans les mains des hommes,
et donner des armes aux femmes.
Les assinnu ont d’abord été considérés par une partie des historiens comme un type de travailleur·se religieux·se sexuel·le. Une conception qui repose sur des hypothèses anciennes concernant les groupes transgenres et qui n’est pas fortement étayé par les preuves.
Le titre est aussi souvent traduit par « eunuque », bien qu’il n’existe aucune preuve claire qu’il se soit agi d’hommes castrés. Si le titre est principalement masculin, il existe des preuves d’assinnu féminines. En réalité, divers textes montrent une résistance à la binarité de genre.
Leur importance religieuse leur attribuait des pouvoirs magiques et de guérison. Une incantation dit :
Que ton assinnu se tienne à mes côtés et retire ma maladie. Qu’il fasse sortir par la fenêtre la maladie qui m’a saisi.
Un présage néo-assyrien indique également que des relations sexuelles avec un assinnu pouvaient procurer des avantages personnels :
Si un homme s’approche d’un « assinnu » pour avoir des relations sexuelles, les interdits à son égard seront assouplis.
En tant que dévots d’Ištar, ils exerçaient également une forte influence politique. Un almanach néo-babylonien indique :
le [roi] doit toucher la tête d’un « assinnu », il vaincra son ennemi
et son pays obéira à ses ordres.
Ayant vu leur genre transformé par Ištar elle-même, les assinnu pouvaient marcher entre le divin et le mortel tout en veillant au bien-être des dieux et de l’humanité.
Qui étaient les « ša rēši » ?
Généralement décrits comme des eunuques, les ša rēši étaient des serviteurs du roi. Les « eunuques » de cour ont été recensés dans de nombreuses cultures au fil de l’histoire. Cependant, le terme n’existait pas en Mésopotamie, et les ša rēši avaient leur propre titre distinct.
Le terme akkadien ša rēši signifie littéralement « un de la tête » et désigne les courtisans les plus proches du roi. Leurs fonctions au palais étaient variées, et ils pouvaient occuper plusieurs postes de haut rang simultanément.

Les preuves de leur ambiguïté de genre sont à la fois textuelles et visuelles. Plusieurs textes les décrivent comme infertiles, comme une incantation qui dit :
Comme un « ša rēši » qui n’engendre pas, que ton sperme se dessèche !
Les ša rēši sont toujours représentés imberbes, en contraste avec un autre type de courtisan appelé ša ziqnī (« celui qui a une barbe »), qui avait des descendants. Dans les cultures mésopotamiennes, la barbe symbolisait la virilité ; un homme imberbe allait donc directement à l’encontre de la norme. Pourtant, des bas-reliefs montrent que les ša rēši portaient les mêmes vêtements que les autres hommes royaux, leur permettant ainsi d’afficher leur autorité aux côtés des autres élites masculines.

L’une de leurs fonctions principales était de superviser les quartiers des femmes dans le palais – un lieu à accès très restreint – où le seul homme autorisé à entrer était le roi lui-même.
Étant si étroitement liés au roi, ils pouvaient non seulement occuper des fonctions martiales comme gardes et conducteurs de char, mais aussi commander leurs propres armées. Après leurs victoires, les ša rēši se voyaient attribuer des biens et la gouvernance de territoires nouvellement conquis, comme en témoigne l’inscription royale en pierre que l’un d’eux s’est fait ériger.
Grâce à leur fluidité de genre, les ša rēši pouvaient transcender non seulement les limites de l’espace genré, mais aussi celles séparant le souverain de ses sujets.
La fluidité de genre comme outil de pouvoir
Alors que les premiers historiens considéraient ces figures comme des « eunuques » ou des « travailleur·ses religieux·ses sexuel·les », les preuves montrent que c’est parce qu’ils vivaient en dehors de la binarité de genre que ces groupes pouvaient occuper des rôles puissants dans la société mésopotamienne.
Reconnaître aujourd’hui l’importance des personnes trans et de genre divers dans nos communautés, est, en quelque sorte, une continuité du respect accordé à ces figures anciennes.
Chaya Kasif ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
09.02.2026 à 23:08
René Cassin, un héritage moral très actuel
Texte intégral (2287 mots)

Le juriste et diplomate René Cassin, dont on s’apprête à commémorer le cinquantième anniversaire de la disparition, a consacré sa vie à la défense de la dignité humaine et de la paix, alliant idéalisme et réalisme. Résistant et proche de de Gaulle, il a joué un rôle clé au sein de la France libre puis contribué à la création de l’ONU et à l’élaboration de la Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948, ce qui lui vaudra le prix Nobel de la paix, vingt ans plus tard. Sa pensée et son action restent aujourd’hui une source d’inspiration pour relever les défis internationaux et renforcer la solidarité entre les peuples.
Le 20 février prochain, cela fera tout juste cinquante ans que disparaissait le juriste internationaliste René Cassin (1887-1976), prix Nobel de la paix 1968.
Alors que nous sommes confrontés à un monde devenu sans boussole autre que la force pour ce qui est de la conduite des relations internationales, il est rafraîchissant de revenir à la pensée et à l’action de cet universitaire passé par les universités d’Aix-Marseille, Lille et Paris, que François Mitterrand présenta comme un « professeur d’espoir » lors de son entrée au Panthéon le 5 octobre 1987.
Espoir, parce que, résilient, il a fait preuve d’optimisme de la volonté lors du déchaînement de l’hitlérisme. Ce grand blessé de la Première Guerre mondiale, qui a dû porter toute sa vie une ceinture abdominale, a cherché à se rendre utile en se faisant l’avocat à la fois idéaliste et réaliste de la dignité humaine et de la paix.
L’œuvre de celui qui a dirigé plusieurs des éminentes juridictions françaises et internationales (Conseil d’État, Conseil constitutionnel, Cour européenne des droits de l’homme…) rappelle assez qu’il est illusoire de croire en la force du droit. Elle n’est qu’une incantation. Le droit n’est fort que lorsqu’il est juste et qu’il se trouve des bonnes volontés pour le défendre.
La paix, grande affaire de tous
Que dit Cassin à nous autres du XXIe siècle ?
D’abord que quand la valeur « paix » cesse d’être la grammaire du monde, il est crucial de la rendre désirable aux peuples. C’est la raison pour laquelle, à la tête de mouvements d’anciens combattants, il s’est attaqué, d’abord officieusement, puis à partir de 1924 officiellement en tant que membre de la délégation française aux assemblées de la Société des Nations, à la « dernière tranchée », celle des droits sociaux, au sein du Bureau international du travail.
Son idée ? Mettre autour de la table les vétérans des ex-pays belligérants pour les faire travailler sur des problèmes concrets, tels que les emplois réservés pour les estropiés, l’accès aux prothèses et aux soins médicaux, la prise en charge des pupilles de la Nation, etc. C’est dire assez qu’il appartient présentement à la société civile de jeter les ponts au-dessus des océans et des autres frontières pour, en dépit du mauvais vouloir de certains grands de ce monde et de leurs idéologues, sauver ce qui peut l’être et bâtir de nouvelles coopérations.
Ensuite, face aux nouveaux « États-Léviathan », qui sont des concentrations de puissance n’ayant d’autre morale que la leur, et qui s’assoient sur le droit international dès lors qu’il s’agit de déchaîner leur force pour acquérir des ressources et des territoires, ou lorsqu’il leur plaît d’imposer sur un mode agressif leur politique commerciale aux pays tiers, il ne faut jamais renoncer à donner de la voix et à agir. Immédiatement après ce grand renoncement qu’ont été les accords de Munich, signés le 29 septembre 1938, Cassin, tout en reprenant son bâton de pèlerin du multilatéralisme et du droit international, en a appelé à la signature de partenariats stratégiques – y compris avec l’URSS – pour tenir en respect le Reich hitlérien. Et d’écrire, vu la tiédeur de certains partenaires de Paris :
« Le sort de la sécurité française est, en premier lieu, dans les mains des Français eux-mêmes. »
Une affirmation qui fait sens au moment où il est question du rétablissement partiel d’une forme de service militaire dans notre pays.
Qui plus est, l’expérience de la Société des Nations créée par le traité de Versailles en 1919 et des accords de Locarno, ratifiés le 1er décembre 1925, visant à assurer la sécurité collective en Europe, révèle à Cassin que les organismes et mécanismes internationaux, si audacieux soient-ils, restent lettre morte tant qu’ils n’obtiennent pas l’assentiment des opinions publiques nationales.
Face à des dirigeants ayant perdu le sens de la mesure, les peuples, prenant conscience du développement de la solidarité internationale dans les faits – parfois sous les radars de la politique et du droit –, doivent se prendre en main, mais aussi se tendre la main les uns aux autres. Il faut éduquer justement les peuples à la paix et aux droits de l’homme, leur inculquer ce qu’est la dignité humaine, et que les droits et libertés bénéficient à tous sans exception, donner à chacun le sens de ses responsabilités en tant que citoyen et en tant qu’homme ou femme. On comprend dès lors que René Cassin contribuera activement à la mise en place de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), institution onusienne spécialisée créée le 16 novembre 1945. Ce travail pédagogique est plus que jamais utile aujourd’hui. Il est de la responsabilité de tous, médias compris.
Les deux pôles du monde nouveau : la démocratie et les droits de l’homme
Par ailleurs, René Cassin, enfant des « trois frontières » (Pyrénées, Alpes, Rhin), n’a jamais opposé le patriotisme, qu’il avait chevillé au corps, à l’internationalisme (l’« esprit de Genève »).
La mondialisation des échanges commerciaux et des communications lui a fait augurer que dans le futur ce phénomène déboucherait sur une société mondiale fortement intégrée, dotée d’instances de gouvernement et d’une police commune chargées de punir les gouvernements agresseurs. Il a défendu de toutes ses forces la Société des Nations, ainsi que les traités internationaux sur le recours à l’arbitrage et la mise de la guerre hors-la-loi, en dépit de leurs imperfections. La communauté universelle aurait, selon l’universitaire juriste, un droit de regard sur l’application des droits de l’homme en tous points du globe. Mais il ne doutait pas que c’est au premier chef à chaque État qu’il appartient de garantir l’effectivité des droits fondamentaux. Il n’opposait pas, comme on a tendance parfois à le faire, l’État de droit aux droits du peuple, car il considérait que le premier est au service de la sécurité et du bien-être de tous.
Enfin, premier civil ayant rejoint de Gaulle à Londres en 1940, il a été le juriste du général, travaillant avec les armes du droit, la plume et le micro de Radio Londres à ce que la France libre soit reconnue par les Alliés. Le risque était que, compromis du fait du collaborationnisme, le régime de Vichy soit discrédité au point de signer l’effacement de la France et de ses intérêts de la scène internationale. Il s’agissait donc de garantir la restitution intégrale de son indépendance dans l’avenir.
Les accords Churchill-de Gaulle du 7 août 1940, négociés par Cassin, ont fait de la France libre la seule organisation qualifiée pour représenter la France restée au combat. Restait à convaincre les autres interlocuteurs internationaux, et notamment le président américain F. D. Roosevelt. Le professeur s’est employé pour cela à délégitimer le pouvoir maréchaliste au motif que celui-ci s’était asservi aux nazis et avait trahi les valeurs (la liberté, l’égalité, la fraternité, la justice, la démocratie et la République) et la mission historique (protéger les peuples opprimés) de la France.

L’embryon de gouvernement qui a trouvé refuge à Londres, à Brazzaville, puis à Alger a fonctionné dans le respect de ces principes éminents, d’où, par exemple, l’Ordonnance du 9 août 1944, portant rétablissement de la légalité républicaine, dont Cassin a été l’un des principaux artisans.
Chargé du portefeuille de la justice et de l’éducation au sein du cabinet gaulliste durant la guerre, il a convié des savants à réfléchir sur la régénération morale du monde une fois que celui-ci aura été libéré, et notamment sur les droits de l’homme, érigés en but de guerre par les Alliés dans la Déclaration des Nations unies du 1ᵉʳ janvier 1942.
La victoire sur les puissances de l’Axe obtenue, ce sera justement le rôle de l’Organisation des Nations unies d’articuler la paix avec les droits de l’homme ainsi que les progrès politiques et sociaux, toutes choses qui n’ont rien d’un luxe ou d’un élément accessoire. Aux côtés d’Eleanor Roosevelt et d’autres, René Cassin a pris une part très active à l’élaboration de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée solennellement à Paris, au Palais de Chaillot, le 10 décembre 1948.
Est ainsi vérifiée la locution qui dit qu’un travail acharné vient à bout de tout. C’est sans doute encore vrai aujourd’hui, quoique les informations qui nous parviennent quotidiennement soient décourageantes. Rendons alors grâce à René Cassin de nous inspirer par toute une vie consacrée aux valeurs de dignité et de solidarité humaines.
Julien Broch ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
09.02.2026 à 23:07
Au Moyen Âge, les femmes prenaient (aussi) la plume
Texte intégral (2058 mots)

Au Moyen Âge, l’alphabétisation se décline en une palette de situations : savoir lire ne signifie pas qu’on est capable de composer un texte. Seule une petite élite maîtrise l’écriture. Mais dans cette élite, il y a des femmes. Qui étaient-elles ? Et dans quels types d’écrits se sont-elles illustrées ?
Le Moyen Âge apparaît souvent comme une période sombre pour les femmes : cloîtrées dans d’obscurs monastères ou soumises à leur mari, elles auraient été tenues écartées du pouvoir et de toute forme de culture écrite.
Ce cliché, comme beaucoup d’autres, sur les prétendus temps obscurs, apparaît à la Renaissance et se développe dans l’esprit des Lumières. Or, durant les six siècles qui suivent la fin de l’Empire romain, la condition féminine est très éloignée de cet imaginaire collectif. Dans les sphères du pouvoir ou du savoir, certaines femmes tiennent alors une place éminente, qui n’est pas tout à fait la même que ce que l’on verra entre les XIIᵉ et XVᵉ siècles.
Le Moyen Âge est une longue période et de nombreuses reconfigurations politiques, économiques ou religieuses changent et affectent la condition des femmes : celles de la fin de la période sont plus connues car nous possédons davantage de sources, mais celles du début ont parfois accès à des ressources économiques ou culturelles inattendues.
Les femmes ont aussi pris part à la culture de leur temps, c’est que montrent les recherches mises en avant dans la Vie des femmes au Moyen Âge. Une autre histoire VIᵉ-XIᵉ siècle (Perrin, 2026). À une époque où l’alphabétisation était faible, c’est parfois par les femmes que se transmettait la maîtrise de la lecture et de l’écriture.
Apprendre à écrire
Pour écrire, il faut bien sûr avoir appris le geste technique qui consiste à tracer des lettres sur du parchemin. Aujourd’hui, lecture et écriture s’apprennent ensemble mais, au Moyen Âge, beaucoup de personnes savent lire sans pour autant être capables d’écrire, si ce n’est leur nom.
L’alphabétisation médiévale se pense d’ailleurs comme un spectre : il y a un monde de pratiques entre savoir lire et être capable de composer un texte complexe en latin. De ce fait, la maîtrise complète de l’écriture est réservée à une petite élite, laïque ou ecclésiastique, et de plus en plus à des professionnels de l’écrit comme les notaires qui gagnent en importance à partir du XIIᵉ siècle. Par ailleurs, les laïcs les plus susceptibles d’avoir appris à lire et à écrire disposent aussi de secrétaires : au début du Moyen Âge par exemple, les aristocrates n’écrivent pas eux-mêmes leurs lettres mais les dictent à des secrétaires, voire ne leur donnent que quelques indications.
Les femmes ne sont pas exclues de ces logiques, bien au contraire. Dans l’aristocratie laïque de la première moitié du Moyen Âge, il n’est pas rare qu’elles reçoivent une éducation poussée.
La raison en est simple : elles sont bien souvent elles-mêmes en charge de l’éducation de leurs enfants. La reine Mathilde, épouse du roi de Germanie Henri Ier (919-936), sait par exemple lire et écrire, ce qui n’est pas le cas de son royal époux et, dans la famille ottonienne (du nom de leur fils, le roi puis empereur Otton Ier), ce sont souvent les femmes qui sont les plus lettrées.
Copistes et autrices
Ce n’est pourtant pas chez les laïcs mais au sein des monastères féminins que l’on trouve le plus de femmes qui savent écrire. L’acte le plus courant est la copie de manuscrits : avant l’invention de l’imprimerie, c’est cet inlassable travail qui permet la diffusion des œuvres.
On estime qu’environ 1 % des manuscrits médiévaux ont été copiés par des femmes. Cela peut paraître infime, mais il faut avoir en tête que l’immense majorité des manuscrits ne sont pas signés par leurs copistes et qu’on ne peut donc en réalité que rarement connaître le genre du ou de la copiste. Le travail des moniales est en tout cas loin d’être déconsidéré : à la fin du VIIIᵉ siècle, les nonnes de Chelles sont les principales pourvoyeuses en copies d’Augustin d’Hippone, un des pères de l’Église les plus lus au Moyen Âge. Elles reçoivent notamment des commandes des évêques de Cologne et de Wurtzbourg.
Il est donc logique que ce soit aussi dans les monastères que l’on trouve le plus d’autrices, c’est-à-dire de femmes qui ne se contentent pas de copier des œuvres et en composent de nouvelles. Aucun genre littéraire ne leur est interdit : elles écrivent de l’hagiographie – la vie de saints, hommes et femmes –, des textes annalistiques, des traités, de la poésie et même du théâtre.
La dramaturge et poétesse Hrotsvita, qui vit au monastère de Gandersheim (en Saxe) autour de 960, est ainsi considérée comme la « première poétesse allemande » même si elle écrit, comme la plupart de ses contemporains, en latin.
Une écriture « féminine » ?

Ces textes de femmes ont été étudiés de diverses manières par les historiens, d’abord avec un brin de suspicion : quand les œuvres de Hrotsvita ont été redécouvertes au XIXᵉ siècle, d’éminents savants ont douté de leur attribution et ont cherché, en vain, à affirmer que la moniale n’avait jamais existé, ou jamais écrit…
Et ce n’est que dans les années 1980 que les spécialistes du Moyen Âge ont véritablement commencé à s’intéresser aux écrits des femmes médiévales d’avant Christine de Pizan. Ces travaux sont marqués par l’idée que l’écriture des hommes serait différente de celle des femmes. Il ne s’agit pas de l’écriture manuscrite, paléographique, puisque la différenciation genrée n’apparaît qu’au XVIIIᵉ siècle, mais du style.
Les femmes, même au Moyen Âge, parleraient plus facilement de leurs émotions et de leur famille. C’est sans doute vrai dans certains textes mais, en réalité, les textes écrits par des femmes montrent plus de similitudes que de différence avec ceux des hommes. Cela est dû, en partie, au poids des modèles anciens dans l’écriture médiévale : quand la moniale Baudonivie écrit la vie de la sainte reine Radegonde vers 600, elle a en tête le modèle par excellence qu’est la Vie de saint Martin, tout comme son contemporain Venance Fortunat qui consacre aussi un texte à la sainte.
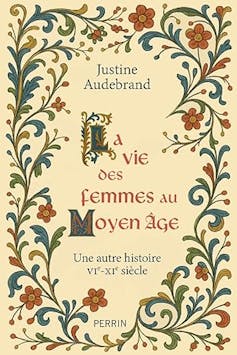
Pour autant, en particulier à partir des XIIᵉ et XIIIᵉ siècles, il semble que l’écriture des femmes soit de plus en plus contrainte et que cela les cantonne parfois à certains types d’écrits. La grande réforme de l’Église connue sous le nom de réforme grégorienne cherche à mieux encadrer les pratiques des fidèles et à redéfinir le lien des femmes au sacré. Le développement des universités – réservées aux clercs et donc aux hommes – exclut aussi les femmes de tout un pan du savoir.
C’est dans ce cadre que fleurissent les femmes mystiques, dont les écrits vantent une proximité particulière avec la divinité. Mais là encore, la réalité est complexe : les visions de ces femmes sont souvent mises par écrit par leur confesseur ou un homme qui peut retravailler la matière transmise par la mystique. Même Hildegarde de Bingen, grande savante et abbesse du XIIᵉ siècle, a recours à un secrétaire. Au Moyen Âge, l’idée d’un auteur ou d’une autrice unique fonctionne rarement, et l’écrit des femmes comme celui des hommes fait souvent appel à une multitude d’intervenants ou intervenantes.
Justine Audebrand ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Time [Fr]
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- L'Autre Quotidien
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- Gauche.Media
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
