27.01.2026 à 16:26
Qu’est-ce que l’intégrité scientifique aujourd’hui ?
Texte intégral (2405 mots)
Dans un contexte où la production scientifique est soumise à des pressions multiples, où les théories pseudoscientifiques circulent sur les réseaux sociaux, l’intégrité scientifique apparaît plus que jamais comme l’un des piliers de la confiance dans la science. Nous vous proposons de découvrir les conclusions de l’ouvrage L’intégrité scientifique. Sociologie des bonnes pratiques, de Catherine Guaspare et Michel Dubois aux éditions PUF, en 2025.
L’intégrité scientifique est une priorité institutionnelle qui fait consensus. Par-delà la détection et le traitement des méconduites scientifiques, la plupart des organismes d’enseignement supérieur et de recherche partagent aujourd’hui un même objectif de promouvoir une culture des bonnes pratiques de recherche.
Il est tentant d’inscrire cette culture dans une perspective historique : la priorité accordée aujourd’hui à l’intégrité n’étant qu’un moment dans une histoire plus longue, celle des régulations qui s’exercent sur les conduites scientifiques. Montgomery et Oliver ont par exemple proposé de distinguer trois grandes périodes dans l’histoire de ces régulations : la période antérieure aux années 1970 caractérisée par l’autorégulation de la communauté scientifique, la période des années 1970-1990 caractérisée par l’importance accordée à la détection et la prévention des fraudes scientifiques et, depuis les années 1990 et la création de l’Office of Research Integrity, première agence fédérale américaine chargée de l’enquête et de la prévention des manquements à l’intégrité dans la recherche biomédicale financée sur fonds publics, la période de l’intégrité scientifique et de la promotion des bonnes pratiques.
Cette mise en récit historique de l’intégrité peut sans doute avoir une valeur heuristique, mais comme tous les grands récits, celui-ci se heurte aux faits. Elle laisse croire que la communauté scientifique, jusque dans les années 1970, aurait été capable de définir et de faire appliquer par elle-même les normes et les valeurs de la recherche. Pourtant, la régulation qui s’exerce par exemple sur la recherche biomédicale est très largement antérieure aux années 1970, puisqu’elle prend forme dès l’après-Seconde Guerre mondiale avec le Code de Nuremberg (1947), se renforce avec la Déclaration d’Helsinki (1964) et s’institutionnalise progressivement à travers les comités d’éthique et les dispositifs juridiques de protection des personnes.
Elle laisse ensuite penser que la détection des fraudes scientifiques comme la promotion des bonnes pratiques seraient autant de reculs pour l’autonomie de la communauté scientifique. Mais, à y regarder de plus près, les transformations institutionnelles – l’adoption de la charte nationale de déontologie des métiers de la recherche en 2015, la création de l’Office français de l’intégrité scientifique en 2017, l’entrée de l’intégrité dans la loi en 2020 –, sont le plus souvent portées par des représentants de la communauté scientifique. Et ce qui peut paraître, de loin, une injonction du politique faite au scientifique relève fréquemment de l’auto-saisine, directe ou indirecte, de la communauté scientifique. L’entrée en politique de l’intégrité scientifique démontre la capacité d’une partie limitée de la communauté scientifique à saisir des fenêtres d’opportunité politique. À l’évidence, pour la France, la période 2015-2017 a été l’une de ces fenêtres, où, à la faveur d’une affaire retentissante de méconduite scientifique au CNRS en 2015, du rapport porté par Pierre Corvol en 2016, de la lettre circulaire de Thierry Mandon en 2017, ces questions passent d’un débat professionnel à un objet de politique publique structuré.
Enfin, ce récit historique de l’intégrité semble suggérer qu’à la culture institutionnelle de détection des fraudes scientifiques, caractéristique des années 1970-1990, viendrait désormais se substituer une culture, plus positive, des bonnes pratiques et de la recherche responsable. Certes, l’innovation et la recherche responsables sont autant de mots-clés désormais incontournables pour les grandes institutions scientifiques, mais la question de la détection des méconduites demeure plus que jamais d’actualité, et ce d’autant qu’il s’est opéré ces dernières années un déplacement de la détection des fraudes scientifiques vers celle des pratiques discutables. La question de la qualification des méconduites scientifiques comme celle de leur mesure n’ont jamais été autant d’actualité.
Si le sociologue ne peut que gagner à ne pas s’improviser historien des sciences, il ne peut toutefois rester aveugle face aux grandes transformations des sciences et des techniques. En particulier, la communauté scientifique du XXIᵉ siècle est clairement différente de celle du siècle dernier. Dans son rapport 2021, l’Unesco rappelait qu’entre 2014 et 2018 le nombre de chercheurs a augmenté trois fois plus vite que la population mondiale, avec un total de plus de huit millions de chercheurs en équivalent temps plein à travers le monde.
Cette densification de la communauté scientifique n’est pas sans enjeu pour l’intégrité scientifique. Avec une communauté de plus en plus vaste, il faut non seulement être en mesure de parler d’une même voix, normaliser les guides et les chartes, mais s’assurer que cette voix soit entendue par tous. Même si l’institutionnalisation de l’intégrité est allée de pair avec une forme d’internationalisation, tous les pays ne sont pas en mesure de créer les structures et les rôles que nous avons eu l’occasion de décrire.
Par ailleurs, la croissance de la communauté scientifique s’accompagne mécaniquement d’une augmentation du volume des publications scientifiques qui met à mal les mécanismes traditionnels de contrôle. D’où d’ailleurs le développement d’alternatives au mécanisme de contrôle par les pairs. On a beaucoup parlé de la vague de publications liées à la crise de la Covid-19, mais la vague souterraine, peut-être moins perceptible pour le grand public, est plus structurelle : toujours selon les données de l’Unesco, entre 2015 et 2019, la production mondiale de publications scientifiques a augmenté de 21 %. Qui aujourd’hui est capable de garantir la fiabilité d’un tel volume de publications ?
Qui dit enfin accroissement du volume de la communauté scientifique, dit potentiellement densification des réseaux de collaborations internationales, à l’intérieur desquels les chercheurs comme les équipes de recherche sont autant d’associés rivaux. La multiplication des collaborations internationales suppose de pouvoir mutualiser les efforts et de s’assurer de la qualité de la contribution de chacun comme de sa reconnaissance. Nous avons eu l’occasion de souligner l’importance de considérer les sentiments de justice et d’injustice éprouvés par les scientifiques dans la survenue des méconduites scientifiques : une contribution ignorée, un compétiteur qui se voit récompensé tout en s’écartant des bonnes pratiques, des institutions scientifiques qui interdisent d’un côté ce qu’elles récompensent de l’autre, etc., autant de situations qui nourrissent ces sentiments.
Par ailleurs, la multiplication des collaborations, dans un contexte où les ressources (financements, postes, distinctions, etc.) sont par principe contraintes, implique également des logiques de mise en concurrence qui peuvent être vécues comme autant d’incitations à prendre des raccourcis.
Outre la transformation démographique de la communauté scientifique, le sociologue des sciences ne peut ignorer l’évolution des modalités d’exercice du travail scientifique à l’ère numérique. La « datafication » de la science, à l’œuvre depuis la fin du XXᵉ siècle, correspond tout autant à l’augmentation du volume des données numériques de la recherche qu’à l’importance prise par les infrastructures technologiques indispensables pour leur traitement, leur stockage et leur diffusion. L’accessibilité et la diffusion rapide des données de la recherche, au nom de la science ouverte, ouvrent des perspectives inédites pour les collaborations scientifiques. Elles créent une redistribution des rôles et des expertises dans ces collaborations, avec un poids croissant accordé à l’ingénierie des données.
Mais, là encore, cette évolution technologique engendre des défis majeurs en termes d’intégrité scientifique. L’édition scientifique en ligne a vu naître un marché en ligne des revues prédatrices qui acceptent, moyennant paiement, des articles sans les évaluer réellement. Si les outils de l’intelligence artificielle s’ajoutent aux instruments traditionnels des équipes de recherche, des structures commerciales clandestines, les « paper mill » ou usines à papier, détournent ces outils numériques pour fabriquer et vendre des articles scientifiques frauduleux à des auteurs en quête de publications. Si l’immatérialité des données numériques permet une circulation accélérée des résultats de recherche, comme on a pu le voir durant la crise de la Covid-19, elle rend également possibles des manipulations de plus en plus sophistiquées. Ces transformations structurelles créent une demande inédite de vigilance à laquelle viennent répondre, chacun à leur manière, l’évaluation postpublication comme ceux que l’on appelle parfois les nouveaux détectives de la science et qui traquent en ligne les anomalies dans les articles publiés (images dupliquées, données incohérentes, plagiat) et ce faisant contribuent à la mise en lumière de fraudes ou de pratiques douteuses.
À lire aussi : Ces détectives qui traquent les fraudes scientifiques : conversation avec Guillaume Cabanac
Plus fondamentalement, cette montée en puissance des données numériques de la recherche engendre des tensions inédites entre l’intégrité scientifique et l’éthique de la recherche. À l’occasion d’un entretien, un physicien, travaillant quotidiennement à partir des téraoctets de données générés par un accélérateur de particules, nous faisait remarquer, avec une pointe d’ironie, qu’il comprenait sans difficulté l’impératif institutionnel d’archiver, au nom de l’intégrité scientifique, l’intégralité de ses données sur des serveurs, mais que ce stockage systématique d’un volume toujours croissant de données entrait directement en contradiction avec l’éthique environnementale de la recherche prônée par ailleurs par son établissement. Intégrité scientifique ou éthique de la recherche ? Faut-il choisir ?
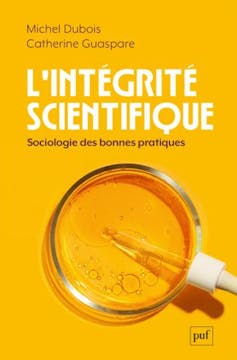
On touche du doigt ici la diversité des dilemmes auxquels sont quotidiennement confrontés les scientifiques dans l’exercice de leurs activités. La science à l’ère numérique évolue dans un équilibre délicat entre l’intégrité scientifique et l’éthique de la recherche. Et l’un des enjeux actuels est sans doute de parvenir à maximiser les bénéfices des technologies numériques tout en minimisant leurs impacts négatifs. D’où la nécessité pour les institutions de recherche de promouvoir une culture de l’intégrité qui puisse dépasser la simple exigence de conformité aux bonnes pratiques, en intégrant les valeurs de responsabilité sociale auxquelles aspire, comme le montrent nos enquêtes, une part croissante de la communauté scientifique.
Le texte a été très légèrement remanié pour pouvoir être lu indépendamment du reste de l’ouvrage en accord avec les auteurs.
Catherine Guaspare et Michel Dubois sont les auteurs du livre L'intégrité scientifique dont cet article est tiré.
Michel Dubois a reçu des financements de l'Agence nationale de la recherche (ANR). Il est directeur de l'Office français de l'intégrité scientifique depuis septembre 2025.
26.01.2026 à 15:01
Dans le cerveau des chevaux : comment le lien maternel affecte le cerveau et le comportement des poulains
Texte intégral (1629 mots)

Une nouvelle étude montre comment la présence prolongée de la mère façonne le développement comportemental, physiologique et cérébral des poulains.
Chez les mammifères sociaux, les relations sociales jouent un rôle déterminant dans le développement. On sait depuis longtemps que la période autour de la naissance est cruciale, lorsque le nouveau-né dépend entièrement de son ou de ses parent(s) pour se nourrir et se protéger. En revanche, ce qui se joue après, lorsque le jeune n’est plus physiquement dépendant de sa mère mais continue de vivre à ses côtés, reste encore mal compris.
Dans une étude récente publiée dans Nature Communications, nous avons exploré chez le cheval cette période souvent négligée du développement. Nos résultats montrent que la présence prolongée de la mère façonne à la fois le cerveau, le comportement
– social en particulier – et la physiologie des poulains.
Pourquoi s’intéresser à l’« enfance » chez le cheval ?
Le cheval est un modèle particulièrement pertinent pour étudier le rôle du lien parental sur le développement des jeunes. Comme chez l’humain, les mères donnent généralement naissance à un seul petit à la fois, procurent des soins parentaux prolongés et établissent un lien mère-jeune fort sur le plan affectif, individualisé et durable.
Dans des conditions naturelles, les poulains restent avec leur groupe familial, et donc avec leur mère, jusqu’à l’âge de 2 ou 3 ans. En revanche, en élevage ou chez les particuliers, la séparation est le plus souvent décidée par l’humain et intervient bien plus tôt, autour de 6 mois. Ce contraste offre une occasion unique d’étudier l’impact de la présence maternelle sur le développement au-delà de la période néonatale.
Comment étudier de rôle d’une présence maternelle prolongée chez le cheval ?
Pour isoler l’effet de la présence maternelle, nous avons suivi 24 poulains de l’âge de 6 à 13 mois. Cette période peut être assimilée à celle de l’enfance chez l’être humain. En effet, durant cette période, les poulains ressemblent déjà physiquement à de petits adultes, apparaissent autonomes dans leurs déplacements et consomment très majoritairement des aliments solides, tout en étant encore sexuellement immatures. En d’autres termes, leur survie immédiate ne dépend plus directement de la mère.
Dans notre étude, tous les poulains vivaient ensemble dans un contexte social riche, avec d’autres jeunes et des adultes. La seule différence concernait la présence ou non de leurs mères respectives à partir de l’âge de 6 mois : ainsi, 12 poulains sont restés avec leur mère tandis que 12 autres en ont été séparés, comme c’est fréquemment le cas en élevage.
Durant les sept mois qui ont suivi, nous avons étudié le développement de ces poulains. En éthologie, les comportements sont étudiés de façon quantitative. Nous avons suivi le développement comportemental des poulains à l’aide d’observations et de tests comportementaux standardisés, puis analysé statistiquement ces données pour comparer leurs trajectoires développementales. Ces données ont été complétées par des mesures physiologiques régulières (par exemple, la prise de poids, les concentrations hormonales) et par une approche d’imagerie par résonance magnétique (IRM) pour visualiser les différences fonctionnelles et morphologiques entre nos deux groupes de poulains de manière non invasive.
À lire aussi : Les chevaux nous reconnaissent-ils ?
La présence de la mère favorise l’émergence des compétences sociales
Les résultats issus de nos observations répétées dans le temps montrent que les poulains bénéficiant de la présence de leur mère interagissaient davantage avec leurs congénères, notamment à travers des comportements positifs, comme le jeu ou le toilettage mutuel, que les poulains séparés de leurs mères. Ils se montraient aussi plus explorateurs et plus à l’aise face à des situations sociales nouvelles, suggérant une plus grande sociabilité.
Autre résultat intéressant, les poulains bénéficiant de la présence de leur mère passaient moins de temps à manger mais prenaient plus de poids, suggérant une croissance plus efficace.
Le lien maternel, moteur du développement du cerveau
Pour aller plus loin, nous avons combiné ces observations comportementales avec une approche encore rare chez les animaux d’élevage : l’imagerie médicale. Ici nous avons utilisé des techniques d’IRM, permettant d’observer le fonctionnement et l’organisation du cerveau vivant, sans douleur. Ainsi, nous avons pu caractériser le développement cérébral de nos poulains.
Cette approche nous a permis d’identifier, pour la première fois chez le cheval, un réseau cérébral appelé le réseau du mode par défaut. Bien connu chez l’humain et identifié chez une poignée d’autres espèces animales, ce réseau serait impliqué dans l’intégration des pensées introspectives, la perception de soi et des autres. Chez les poulains ayant bénéficié d’une présence maternelle prolongée, ce réseau était plus développé, faisant écho aux meilleures compétences sociales que nous avons observées.
En outre, nous avons observé des différences morphologiques dans une région fortement impliquée dans la régulation physiologique, l’hypothalamus, en lien avec les différences physiologiques et de comportement alimentaire mises en évidence.
Une phase clé du développement aux effets multidimensionnels
Pris dans leur ensemble, nos résultats soulignent l’importance de cette phase du développement, encore peu étudiée chez l’animal, située entre la petite enfance et l’adolescence.
Ils suggèrent que la présence maternelle prolongée induit un développement comportemental, cérébral et physiologique plus harmonieux, qui pourrait contribuer à équiper les jeunes pour leur vie adulte future, notamment dans le domaine de compétences sociales.
Quelles implications pour l’élevage… et au-delà ?
Notre travail ne permet pas de définir une règle universelle sur l’âge idéal de séparation chez le cheval. Il montre en revanche que la séparation précoce a des conséquences mesurables, bien au-delà de la seule question alimentaire.
Lorsque les conditions le permettent, garder plus longtemps le poulain avec sa mère pourrait donc constituer un levier simple et favorable au développement du jeune. Cependant, d’autres études sont nécessaires pour évaluer l’impact de ces pratiques sur les mères et les capacités de récupération des poulains après la séparation, par exemple.
Avec grande prudence, ces résultats font aussi écho à ce que l’on observe chez d’autres mammifères sociaux, y compris l’humain : le rôle du parent ou de la/du soignant·e (« caregiver ») comme médiateur entre le jeune et son environnement social et physique pourrait être un mécanisme largement partagé. Le cheval offre ainsi un modèle précieux pour mieux comprendre comment les premières relations sociales façonnent durablement le cerveau et le comportement.
Cette étude a été financée grâce à une bourse européenne HORIZON 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) (ref: 101033271, MSCA European Individual Fellowship, https://doi.org/10.3030/101033271) et au Conseil Scientifique de l'Institut Français du Cheval et de l’Equitation (IFCE) (ref: DEVELOPPEMENTPOULAIN).
David Barrière ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
24.01.2026 à 18:12
Pourquoi mon filtre antispam fonctionne-t-il si mal ?
Texte intégral (1221 mots)
Comment les spams passent-ils au travers des multiples couches de protection annoncées comme presque infranchissables par les entreprises et par les chercheurs en cybersécurité ?
Les escroqueries existent depuis fort longtemps, du remède miracle vendu par un charlatan aux courriers dans la boîte aux lettres nous promettant monts et merveilles plus ou moins fantasques. Mais le Web a rendu ces canaux moins intéressants pour les arnaqueurs.
Les e-mails de spam et le « phishing » (hameçonnage) se comptent aujourd’hui en millions d’e-mails par an et ont été la porte d’entrée pour des incidents majeurs, comme les fuites d’e-mails internes d’Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle en 2017, mais aussi le vol de 81 millions de dollars (plus de 69 millions d’euros) à la banque du Bangladesh en 2016.
Il est difficile de quantifier les effets de ces arnaques à l’échelle globale, mais le FBI a recensé des plaintes s’élevant à 2,9 milliards de dollars (soit 2,47 milliards d’euros) en 2023 pour une seule catégorie de ce type d’attaques – les pertes dues aux attaques par e-mail en général sont sûrement beaucoup plus élevées.
Bien sûr, la situation n’est pas récente, et les entreprises proposant des boîtes de messagerie investissent depuis longtemps dans des filtres antispam à la pointe de la technologie et parfois très coûteux. De même pour la recherche académique, dont les détecteurs atteignent des précisions supérieures à 99 % depuis plusieurs années ! Dans les faits pourtant, les signalements de phishing ont bondi de 23 % en 2024.
Pourquoi, malgré ces filtres, recevons-nous chaque jour des e-mails nous demandant si notre compte CPF contient 200 euros, ou bien nous informant que nous aurions gagné 100 000 euros ?
Plusieurs techniques superposables
Il faut d’abord comprendre que les e-mails ne sont pas si différents des courriers classiques dans leur fonctionnement. Quand vous envoyez un e-mail, il arrive à un premier serveur, puis il est relayé de serveur en serveur jusqu’à arriver au destinataire. À chaque étape, le message est susceptible d’être bloqué, car, dans cette chaîne de transmission, la plupart des serveurs sont équipés de bloqueurs.
Dans le cadre de ma thèse, j’ai réalisé une étude empirique qui nous a permis d’analyser plus de 380 e-mails de spams et de phishing ayant franchi les filtres mis en place. Nous avons ainsi analysé une dizaine de techniques exploitées dans des proportions très différentes.
La plus répandue de ces techniques est incroyablement ingénieuse et consiste à dessiner le texte sur une image incluse dans l’e-mail plutôt que de l’écrire directement dans le corps du message. L’intérêt est de créer une différence de contenu entre ce que voit l’utilisateur et ce que voient les bloqueurs de spams et de phishing. En effet, l’utilisateur ne fait pas la différence entre « cliquez ici » écrit dans l’e-mail ou « cliquez ici » dessiné avec la même police d’écriture que l’ordinateur. Pourtant, du point de vue des bloqueurs automatisés, cela fait une grosse différence, car, quand le message est dessiné, identifier le texte présent dans l’image demande une analyse très coûteuse… que les bloqueurs ne peuvent souvent pas se permettre de réaliser.
Une autre technique, plus ancienne, observée dans d’autres contextes et recyclée pour franchir les bloqueurs, est l’utilisation de lettres qui sont jumelles dans leur apparence pour l’œil humain mais radicalement différentes. Prenons par exemple un mail essayant de vous faire cliquer sur un lien téléchargeant un virus sur votre téléphone. Un hackeur débutant pourrait envoyer un mail malicieux demandant de cliquer ici. Ce qui serait vu du point de vue de votre ordinateur par 99 108 105 113 117 101 114. Cette suite de nombres est bien évidemment surveillée de près et suspectée par tous les bloqueurs de la chaîne de transmission. Maintenant, un hackeur chevronné, pour contourner le problème, remplacera le l minuscule par un i majuscule (I). De votre point de vue, cela ressemblera à cIiquer ici – avec plus ou moins de réussite en fonction de la police d’écriture. Mais du point de vue de l’ordinateur, cela change tout, car ça devient : 99 76 105 113 117 101 114. Les bloqueurs n’ont jamais vu cette version-là et donc laissent passer le message.
Tromper les filtres à spams basés sur l’IA
Parmi toutes les techniques que nous avons observées, certaines sont plus avancées que d’autres. Contre les bloqueurs de nouvelle génération, les hackers ont mis au point des techniques spécialisées dans la neutralisation des intelligences artificielles (IA) défensives.
Un exemple observé dans notre étude est l’ajout dans l’e-mail de pages Wikipédia écrites en blanc sur blanc. Ces pages sont complètement hors contexte et portent sur des sujets, tels que l’hémoglobine ou les agrumes, alors que l’e-mail demande d’envoyer des bitcoins. Ce texte, invisible pour l’utilisateur, sert à perturber les détecteurs basés sur des systèmes d’intelligence artificielle en faisant une « attaque adversariale » (montrer une grande quantité de texte anodin, en plus du message frauduleux, de telle sorte que le modèle de détection n’est plus capable de déterminer s’il s’agit d’un e-mail dangereux ou pas).
Et le pire est que la plupart des e-mails contiennent plusieurs de ces techniques pour augmenter leurs chances d’être acceptés par les bloqueurs ! Nous avons dénombré en moyenne 1,7 technique d’obfuscation par e-mails, avec la plupart des e-mails comportant au moins une technique d’obfuscation.
Cet article est le fruit d’un travail collectif entre le Laboratoire de recherche spécialisé dans l’analyse et l’architecture des systèmes (LAAS-CNRS) et le Laboratoire d’études et de recherches appliquées en sciences sociales (LERASS). Je tiens à remercier Guillaume Auriol, Pascal Marchand et Vincent Nicomette pour leur soutien et leurs corrections.
Antony Dalmiere a reçu des financements de l'Université de Toulouse et de l'Institut en Cybersécurité d'Occitanie.
21.01.2026 à 11:36
Des éclairs détectés sur Mars pour la toute première fois
Texte intégral (1727 mots)
Pour la première fois, un microphone placé sur le rover Perseverance de la Nasa a permis de découvrir l’existence de petites décharges électriques dans les tourbillons et les tempêtes martiennes de poussière. Longtemps théorisés, ces petits éclairs sur Mars deviennent une réalité grâce à des enregistrements acoustiques et électromagnétiques inédits que nous venons de publier dans la revue Nature. Cette découverte, aux conséquences multiples sur nos connaissances de la chimie et de la physique ainsi que sur le climat de la planète rouge, révèle de nouveaux défis pour les futures missions robotiques et habitées.
Un souffle de vent martien, et soudain, un claquement sec : les dust devils, ces tourbillons de poussière qui parcourent la planète rouge, viennent de nous livrer un secret bien gardé : ils sont traversés de petits arcs électriques ! Ils ont été vus, ou plutôt entendus, de manière totalement fortuite, grâce au microphone de l’instrument SuperCam sur le rover Perseverance qui sillonne Mars depuis 2020.
Ce microphone est notre oreille à la surface de Mars. Il alimente depuis 2021 une « playlist » de plus de trente heures composée de brefs extraits quotidiens du paysage sonore martien : le microphone est allumé environ trois minutes tous les deux jours, pour des raisons de partage du temps du rover avec les autres instruments.
Un jackpot scientifique
Parmi ses morceaux les plus écoutés ? Le ronflement basse fréquence du souffle du vent, le crépitement aigu des grains de sable et les grincements mécaniques des articulations du robot. Mais le dernier titre de cette compilation d’un autre monde est une pépite : un dust devil capté en direct alors qu’il passait au-dessus de notre microphone. Qu’un dust devil passe au-dessus de Perseverance, ce n’est pas forcément exceptionnel – ils sont très actifs dans le cratère de Jezero où est posé Perseverance. Mais, qu’il survole le rover à l’instant même où le microphone est allumé, cela relève du jackpot scientifique.
Au cœur de cet enregistrement se cachait un signal fort que nous avons peiné à interpréter. Notre première hypothèse fut celle d’un gros grain de sable ayant impacté la zone proche de la membrane du microphone. Quelques années plus tard, alors que nous assistions à une conférence sur l’électricité atmosphérique, nous avons eu une illumination : s’il y avait des décharges sur Mars, la façon la plus directe de les détecter serait de les écouter parce qu’aucun autre instrument à bord de Perseverance ne permet d’étudier les champs électriques.
Évidemment, l’enregistrement le plus favorable pour vérifier cette hypothèse était précisément celui-ci. Réexaminé à la lumière de cette interprétation, il correspondait bien au signal acoustique d’une décharge électrique. Ce n’était pas tout !
Cette onde de choc était précédée d’un signal étrange qui ne ressemblait pas à quelque chose de naturel mais qui provenait en réalité de l’interférence électromagnétique de la décharge avec l’électronique du microphone. Nous savions que celle-ci était sensible aux ondes parasites, mais nous avons tourné ce petit défaut à notre avantage. Grâce à la combinaison de ces deux signaux, tout était devenu clair : nous avions détecté pour la première fois des arcs électriques sur Mars. Pour en être absolument convaincus, nous avons reproduit ce phénomène en laboratoire à l’aide de la réplique de l’instrument SuperCam et d’une machine de Wimshurst, une expérience historiquement utilisée pour générer des arcs électriques. Les deux signaux – acoustique et électromagnétique – obtenus étaient rigoureusement identiques à ceux enregistrés sur Mars.
En soi, l’existence de ces décharges martiennes n’est pas si surprenante que cela : sur Terre, l’électrification des particules de poussière est bien connue, notamment dans les régions désertiques, mais elle aboutit rarement à des décharges électriques. Sur Mars, en revanche, l’atmosphère ténue de CO₂ rend ce phénomène beaucoup plus probable, la quantité de charges nécessaire à la formation d’étincelles étant beaucoup plus faible que sur Terre. Cela s’explique par le frottement de minuscules grains de poussière entre eux, qui se chargent en électrons puis libèrent leurs charges sous forme d’arcs électriques longs de quelques centimètres, accompagnés d’ondes de choc audibles. Le vrai changement de paradigme de cette découverte, c’est la fréquence et l’énergie de ces décharges : à peine perceptibles, comparables à une décharge d’électricité lorsqu’on touche une raquette à moustiques, ces étincelles martiennes sont fréquentes, en raison de l’omniprésence de la poussière sur Mars.
Des implications au niveau du climat martien
Ce qui est fascinant, c’est que cette découverte intervient après des décennies de spéculations sur l’activité électrique martienne, touchant une arborescence de phénomènes encore peu ou mal expliqués. Par exemple, l’activité électrique de la poussière a longtemps été suspectée de fournir un moyen très efficace pour soulever la poussière du sol martien. Les champs électriques derrière les arcs électriques entendus sur Mars sont a priori suffisamment forts pour faire léviter la poussière.
En absorbant et en réfléchissant la lumière solaire, la poussière martienne contrôle la température de l’air et intensifie la circulation atmosphérique (les vents). Et parce que les vents contrôlent en retour le soulèvement de la poussière, la boucle de rétroactions poussière-vent-poussière est à l’origine des tempêtes globales qui recouvrent intégralement la planète de poussière tous les 5 ou 6 ans. Vu l’importance de la poussière dans le climat martien, et alors que les meilleurs modèles ne savent pas encore prédire correctement son soulèvement, les forces électrostatiques ne pourront plus être ignorées dans le cycle global de la poussière sur Mars.
Expliquer la disparition du méthane
L’autre sujet qui attire les regards des scientifiques concerne le très controversé méthane martien. La communauté débat depuis plus de vingt ans à son sujet en raison de ses implications potentielles, à savoir une activité géophysique ou biologique éventuelle sur Mars, deux hypothèses fascinantes.
Au-delà du caractère énigmatique de ses détections sporadiques, sa disparition – des centaines de fois plus rapide que ce que prédisent les modèles de chimie atmosphérique les plus sophistiqués – a longtemps laissé les experts circonspects. L’un des mécanismes de destruction du méthane les plus prometteurs, proposé il y a une vingtaine d’années, fait précisément intervenir l’action de champs électriques intenses sur la chimie atmosphérique. En accélérant ions et électrons, ces champs permettent de casser les molécules de méthane, mais surtout celles de la vapeur d’eau, produisant ainsi de puissantes espèces réactives capables de détruire le méthane bien plus efficacement encore.
Qui plus est, la présence d’arcs électriques à l’échelle planétaire pourrait s’avérer déterminante dans la préservation de la matière organique. Des expériences de laboratoire ont montré la destruction brutale de biomarqueurs causée par le recyclage d’espèces chlorées induite par l’activité électrostatique de la poussière.
On le voit, la portée de ces nouveaux sons martiens dépasse largement le seul cadre de la communication grand public. Ils redessinent plusieurs pans de notre compréhension de Mars et ouvrent un nouveau champ d’investigations, qui nécessitera un nombre accru d’observations.
Peut-être lors de futures missions ? L’Agence spatiale européenne (ESA) avait déjà tenté l’expérience – sans succès – avec l’atterrisseur Schiaparelli, qui devait réaliser les premières mesures des champs électriques martiens avant de s’écraser à la surface de la planète. L’exploration future, humaine ou non, se devra de mieux caractériser ces champs pour mieux cerner leurs implications. D’ici là, Perseverance restera l’unique témoin in situ de ce phénomène qui est sans doute loin de nous avoir tout révélé.
Franck Montmessin a reçu des financements de l'ANR et du CNES.
Baptiste Chide ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Time [Fr]
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- L'Autre Quotidien
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- Gauche.Media
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
