Abonnés Hebdo Articles
22.11.2025 à 19:42
Concours : sous l’arc de la Défense, la tombe de l’architecte inconnu ?

Texte intégral (1978 mots)
Avec les films « The Brutalist » et « L’inconnu de la Grande Arche » successivement à l’affiche, il est question d’architecture dans les gazettes grand public. Lequel public ne verra pas cependant que le premier est une imposture* et le second l’expression d’une nostalgie, quand de grands bâtiments publics de la République apparaissaient à l’issue d’un concours d’idées (bon pas tous, pour I.M. Pei, la Pyramide, c’était cadeau).

Le grand public comprend pourtant, même confusément, que la Grande Arche et Beaubourg sont certainement les bâtiments contemporains de Paris les plus connus et célébrés dans le monde, deux ouvrages imaginés par des architectes alors inconnus au bataillon. Nostalgie donc car chaque architecte français sait que la construction, la conception même, de la Grande Arche et du Centre Pompidou serait impossible aujourd’hui en France car tant Johan Otto von Spreckelsen que les jeunes Renzo Piano et Richard Rogers seraient bien en peine de témoigner de quelconques références, à part deux ou trois églises pour le premier et des croquis d’étudiants pour les deux autres. Le génie, par définition, arrive toujours dans l’angle mort des habitudes et discours compassés.
Aujourd’hui, dans les règlements de concours, la multiplication des critères et l’exigence de références toujours plus extravagantes rendent caduque l’idée même de sélection, donc de choix éclairé. Encore moins du choix éclairé d’un projet à partir de l’esquisse d’un concours anonyme.
Déjà en 2019, le règlement du concours pour le futur Hôpital universitaire du Grand Paris Nord (HUGPN) – un équipement qui doit être mis en service au troisième trimestre 2028, « au plus tard » (sic) – n’imposait rien de moins que six conditions. La première : « avoir déjà conçu une opération hospitalière en activité de Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO), avec plateau technique, d’une surface dans œuvre d’au moins 65 000 m², dont l’avancement sera au minimum au stade du PC déposé, le candidat fournira le formulaire PC justifiant de la Surface de plancher (SDP) du projet, ou achevée depuis moins de 5 ans ». Ce n’est plus une demande de références, c’est une grande faucheuse !

Les cinq autres références sont à l’avenant, toutes « de moins de 5 ans ». C’est vrai qu’à la vitesse à laquelle sont construits les projets en ce pays, une référence valable aujourd’hui ne l’est déjà plus demain. Vu ainsi, il est clair que l’architecte un peu audacieux et imaginatif a plus de chance de devenir footballeur professionnel ou d’aller sur la lune que de gagner un gros hôpital en France !
Admettons que pour un équipement hospitalier, qui demande une grande technicité et qui engage la vie ou la mort des usagers, il est compréhensible que le maître d’ouvrage veuille faire appel à qui maîtrise déjà les règles de l’art. Sauf que ces critères se sont depuis largement généralisés. À preuve, l’agence espagnole RCR, prix Pritzker 2017, serait bien en peine de construire un nouveau musée en France, le remarquable musée Soulage datant de 2014 ! S’il ne s’agissait que des musées… C’est désormais la même tambouille improbable qui décide de n’importe quel projet, et ce n’est pas la taille qui compte comme on dit chez Dorcel ! Certes, concevoir et construire une école de trois classes n’est évidemment plus à la portée du premier architecte venu n’ayant pas déjà livré dix groupes scolaires lors des trois dernières semaines avant noël.
Autrement dit, soit l’agence cartonne à grande échelle – depuis cinq ans au moins – dans son domaine particulier et exclusif, soit ce n’est pas la peine de faire perdre du temps à tout le monde. En clair, si vous avez l’habitude des musées, il ne sert à rien d’aller embêter les spécialistes des écoles, des gymnases ou des usines de retraitement des déchets. Chacun chez soi et les projets seront bien gardés. Et quelles agences cartonnent ? En tout cas, la plupart des Grands Prix français de l’architecture ne peuvent prétendre concourir, ni à un hôpital ni à un musée, un groupe scolaire ou un gymnase en province. Trop d’imagination peut-être en regard de critères qui in fine ne visent qu’à l’uniformisation et la répétition de la médiocrité, sans ressort et sans imprévu.
D’ailleurs, histoire de bien calmer l’ardeur des impétrants créatifs et iconoclastes, demeure toujours la mention du bilan financier. Ainsi, il suffit au maître d’ouvrage d’estimer que, pour pouvoir concourir, l’agence doit faire montre d’un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 1, ou 2 ou 3 ou 14 millions d’euros selon affinités – depuis cinq ans au plus pour faire bonne mesure – pour régler leur sort aux insolents.
Il fut un temps pas si lointain – d’aucuns s’en souviennent – quand pour un concours, le maître d’ouvrage recevait, disons, entre 50 et 300 candidatures. Ensuite des fonctionnaires, compétents et motivés, armés d’un jury de sachants, passaient des jours entiers à décortiquer les dossiers, plus ou moins bien et plus ou moins vite certes en fonction de leurs propres préjugés et des désirs du maître d’ouvrage et/ou du maire mais, à la fin, au moins deux ou trois, sinon les quatre, des équipes sélectionnées étaient le résultat d’un choix construit, débattu, argumenté et assumé. Il fallait des femmes architectes, il fallait des jeunes, il fallait des stars, etc. Il s’agissait en tout cas d’un acte intellectuel que le maire ou maître d’ouvrage pouvait plus tard expliquer et justifier à ses administrés. À défaut de concours d’idées, c’était déjà ça !
Aujourd’hui, si la maîtrise d’ouvrage prend des mois à annoncer le lauréat, en réalité, aujourd’hui, de critère 1 à critère 6, en trois heures, il ne reste aux fonctionnaires indolents que six ou sept candidatures à examiner et, en fonction des désirs du maître d’ouvrage, l’affaire est pliée en une après-midi. Avec l’IA, ce sera désormais réglé en 30 secondes chrono ! Paresse des services ? En tout cas, pour les politiciens pusillanimes, voilà l’architecture passée d’une logique de choix éminemment politique à une logique d’élimination tandis qu’une démarche intellectuelle, aussi fragile soit-elle, est devenue un algorithme aussi dénué d’intelligence que possible.
Même les promoteurs agissent par choix, pour de bonnes ou mauvaises raisons, parce qu’ils apprécient cet architecte ou parce qu’ils savent que cet autre sera un béni-oui-oui, mais au moins c’est un choix et, le plus souvent, ils se fichent comme d’une guigne de savoir combien il y a de gens à l’agence du moment que ça tourne.
S’agit-il donc simplement pour les maîtres d’ouvrage publics de gagner du temps ? Parce que trois jours de réflexions un peu sérieuses pour étudier cent dossiers au lieu de six, pour un projet qui mettra de cinq à dix ans à se construire, serait trop demander aux services évidemment débordés ?
Ou peut-être manque-t-on désormais de fonctionnaires et d’élus compétents ? Ce qui expliquerait pourquoi ceux incapables de mesurer le sens de l’architecture dans un projet préfèrent s’en remettre de façon obtuse et prudente aux tableaux de références qui ont cours partout, quel que soit le lieu où sera construit l’ouvrage et sa dimension. Prise de risque = 0 et vivons heureux. Pas étonnant que les bâtiments eux-mêmes finissent par ressembler à des tableaux Excel.
Christophe Leray, le 25/11/2025
22.11.2025 à 19:31
Bonampak, une archéologie mexicaine sans paquet cadeau

Texte intégral (3491 mots)
Dans les plis et replis de l’histoire de la « découverte » d’un site archéologique célèbre au Mexique, des visions du monde qui se heurtent et se déchirent. Un roman alerte et passionnant.
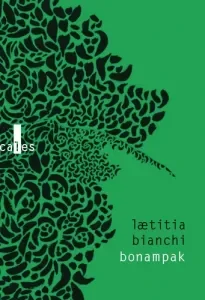
Qui trouve les pyramides et les trésors à l’intérieur des pyramides ? La réponse m’a longtemps semblé évidente : les explorateurs, les aventuriers, les archéologues – une limite floue entre ces catégories –, les Indiana Jones. Un homme à pied ou à cheval, parlant toutes les langues, maniant toutes les épées, ouvrant tous les chemins, disposant d’assez d’intuition pour tomber sur les stèles, et d’assez de générosité pour les remettre au musée du coin – le British Museum.
J’étais naïve. De cette naïveté qui n’est pas seulement ignorance. De cette naïveté qui est flemme aussi, absence de questionnement, tranquillité du visiteur charmé et repu qui vient voir ce qu’il y a à voir, comme si la géographie et l’histoire étaient un panier de pommes sur une table. Il y a quoi à faire, dans le coin ? – et les innombrables guides de voyage répondent.
Souvenir d’un cours d’histoire : on nous racontait le voyage officiel d’une reine ; de hauts murs avaient été construits le long de son passage pour cacher ce qu’elle ne devait ni voir ni savoir. Tous, du haut de nos dix ans, on s’esclaffait : comment n’avait-elle rien vu, la reine ? Etait-elle bête, cette reine ! Ne pas reconnaître des murs montés à la hâte, croire aux slogans de bienvenue ! Quelle idiote, cette reine ! Mais les murs du regard chacun se les bâtit, les œillères sont intérieures et nous voilà notre propre voyageur officiel, accueilli en grande pompe, et désireux de beaux clichés, parmi la vacance du questionnement.
Les lendemains de ma première visite de Bonampak – ces lendemains furent des années –, j’ai fait l’idiote. À chacune de mes phrases, je mettais un point d’interrogation. J’eus longtemps l’âge du pourquoi.
Pourquoi Bonampak ? Pourquoi m’étais-je retrouvée un matin à Bonampak, seule, éblouie, dans la lumière blanche de la forêt lacandone ? Parce que Bonampak était un site archéologique maya digne d’être vu. Pourquoi digne d’être vu ? Parce qu’on pouvait y voir des peintures extraordinaires. Pourquoi pouvait-on y voir ces peintures ? Parce qu’un certain Giles Greville Healey les avait découvertes. Pourquoi Giles Healey les avait-il découvertes ? Parce qu’il se trouvait là en 1946. Pourquoi se trouvait-il là en 1946 ? Parce qu’il tournait un documentaire sur les Mayas. Pourquoi tournait-il un documentaire sur les Mayas ? Parce que la United Fruit Company le lui avait demandé. Pourquoi la United Fruit Company, entreprise bananière,la plus puissante multinationale des Etats-Unis, finançait-elle un documentaire sur les Mayas ? Je n’avais pas de réponse. Alors je reprenais. Pourquoi étais-je à Bonampak, où un Lacandon assis sur les marches du temple aux fabuleuses peintures pianotait sur son téléphone portable, gardant vaguement l’entrée ? Parce que Giles Healey avait découvert Bonampak. Pourquoi Healey avait-il découvert Bonampak ? Parce que ses amis lacandons l’y avaient conduit – c’était écrit dans les guides. Pourquoi Giles Healey avait-il des amis lacandons ? Je n’avais pas de réponse.
Le site mexicain de Bonampak (« murs peints » en maya, nom donné par l’archéologue Sylvanus Morley), ensemble relativement modeste de vestiges de la civilisation maya, est situé à une trentaine de kilomètres de celui de Yaxchilán, beaucoup plus imposant, près de la frontière du Guatemala. Il doit sa notoriété mondiale à ses fresques, « découvertes » par l’Occident moderne en 1946. Au cœur de la jungle lacandone de l’État du Chiapas (chère aux néo-zapatistes de l’EZLN et à l'(ex-)sous-commandant Marcos, le site était bien connu des indigènes avant d’être remis au goût du jour archéologique dans des circonstances à la fois terribles et rocambolesques, dans lesquelles les rivalités entre scientifiques professionnels ou sensationnalistes, coureurs de jungle, aventuriers et proto-beatniks ne le cèdent en rien aux menées plus ou moins souterraines de factions politiques et, surtout, de la multinationale tentaculaire à l’époque qu’était United Fruit, véritable empereur économique de l’Amérique Centrale sous domination yankee (ainsi que le rappelait comme incidemment le grand Hans Magnus Enzensberger dans son « Politique et crime » de 1964). C’est à l’histoire de cette redécouverte, et aux vertiges qu’elle ne peut qu’occasionner, que nous convie l’autrice et éditrice franco-mexicaine Lætitia Bianchi, avec ce « Bonampak » publié en mars 2025 aux éditions Verticales.

Vous êtes à l’orée de la forêt lacandone, page 1, comme dans ces Livres dont vous êtes le héros que l’on ouvrait enfant, les dés serrés dans la paume, pressentant le danger et la chance, impatients de la présence de créatures malfaisantes ou amies que l’on savait tapies entre les pages. Vous marchez dans la forêt. Mais quel étranger marcherait ainsi, seul, dans la forêt lacandone ? Pas de carte, pas de wifi, pas de panneaux indicateurs de trésors. Et le boire, et le manger ? Et le matériel, si matériel il y a ? Et les mules pour le transporter, si mules il y a ? Et l’argent pour payer les mules ? Et les sentiers ? Et d’ailleurs, pourquoi y aurait-il des sentiers ? Qui aurait l’idée de tracer des sentiers en pleine jungle ? La métaphore de l’aiguille dans la botte de foin, transposée sous d’autres tropiques, devient celle de la pyramide dans la botte de jungle : la proportion est-elle la même. Nul besoin de calculs pour comprendre qu’on ne butte pas au hasard sur une pyramide. La probabilité, pour un explorateur étranger, de trouver Bonampak au hasard d’une promenade n’est pas dérisoire : elle est nulle. Il faut donc des guides. Des informateurs. Des fixeurs, comme dit le jargon journalistique. Des indigènes à qui on enlève trois lettres : des Indiens. Des gens du coin. Des sauvages. Mais des sauvages suffisamment peu sauvages pour vous répondre. Il faut de l’intuition (un peu), de la patience (beaucoup), du courage (évidemment), du cynisme (parfois), le désir de gloire (sans doute), et des relations dans le monde (of course). Après seulement on fait la Une des journaux.
Les fresques avaient été étudiées, analysées, interprétées. Il y avait eu des dizaines de livres. Des sommes archéologiques sagement rangées dans les bibliothèques les plus prestigieuses d’Amérique. Des articles de magazines (Mayas ! explorateurs ! Indiens ! trésors !), étayés de citations tronquées et de sources hasardeuses. Des guides et des écrans touristiques avecleurs étoiles, leurs enthousiasmes (incontournable !) ou leur mépris (si on a le temps). Les à-côté des guides, les avis des uns (grosse déception, on voit mal les peintures) et les avis des autres (formidable ! super trip dans la jungle). Carte postale sur frigidaire ou livre d’art sur étagère.
Il y avait même eu ce mot, bonampakitis, affublant du nom d’une maladie imaginaire les passions déclenchées par Bonampak, par le fait que tout un chacun ait son mot à dire sur la découverte de Bonampak et sur la mort – non : sur l’assassinat, on le savait peut-être, on le savait sans doute, on ne le disait pas encore – de Carlos Frey. Bonampakitis. Le mot avait été créé en 1952 par un autre protagoniste de cette histoire, l’archéologue Frans Blom. La bonampakitis, disait Frans Blom, était une maladie littéraire, hautement contagieuse. Et voici que sur un autre continent, de l’autre côté de l’Atlantique et plus de soixante-dix ans après les faits, j’avais contracté une forme virulente de bonampakitis. La sensation que des pans entiers de l’histoire convergeaient dans ces quelques mètres carrés de jungle en était le symptôme le plus évident. J’aurais pu laisser passer cette fièvre exotique de savoir, manger des cédrats et des pistaches et ranger parmi mes souvenirs personnels l’émoi de ma première visite de Bonampak, à l’aube – mais.

Dans les plis et replis de la saga Indiana Jones de Steven Spielberg, la conception romantique et héroïque de l’archéologie occidentale conduite en forêt vierge, derrière le film d’aventures à gros budget et les prouesses de Harrison Ford dans le rôle-titre, est déjà fortement questionnée, pour qui sait regarder entre les plans principaux. À propos de Bonampak, Lætitia Bianchi pousse les curseurs de démythification quasiment au maximum possible.
À travers les parcours de (re-)découvreurs, professionnels ou accidentels, de Frans Blom, de Carlos Frey, de Gilles Healy et de John Bourne, c’est toute une économie souterraine et une formidable instrumentalisation de l’art et de son histoire, du regard porté sur la colonisation réputée ancienne et sur l’exploitation économique déterminée et parfaitement contemporaine (des questions qui se trouvent d’ailleurs, sans aucun hasard, à l’un des points névralgiques des revendications néo-zapatistes au Chiapas) qui sont mises à jour, elles aussi. Ruines d’avant 1946 aux gigantesques ombres portées et aux conséquences interprétatives plus que jamais actuelles, les fresques de Bonampak, baignant dans le jus extractiviste de l’acajou, du pétrole et du latex spécifiquement destiné au chewing-gum (mis en évidence dans un flashback des plus tristement savoureux), deviennent un marqueur et un témoin de quelque chose de profondément ancré, les englobant et les dépassant, du côté de la domination froide et, de facto, quasiment automatisée.
Et c’est en dissimulant tout le sérieux de son investigation historique sous une tonalité frisant joliment le bucolique et le burlesque (le Julien Blanc-Gras de « Gringoland » n’est parfois pas si loin, surtout au début du roman, non plus, presque paradoxalement, que le Paco Ignacio Taibo II de « Jours de combat ») que Lætitia Bianchi nous offre ici une œuvre politique et socio-économique de tout premier ordre.
xk xk xkiii. Il y a un oiseau, mais il n’y a pas dans les lettres de notre alphabet de quoi écrire le cri de cet oiseau. Il pleut, mais il ne pleut pas de la pluie. Les gouttes sont larges comme la paume de nos mains, parfois plus. Parfois les gouttes ont des doigts, parfois elles sont rondes et jaunes. Elles tombent de très haut. Elles tombent de plus haut que la hauteur du premier building des États-Unis, elles tombent de douze étages ; le treizième étage c’est le ciel. Ce n’est pas de la pluie, non. Qu’est-ce que c’est ? C’est la pluie qui n’est pas la pluie. Ce sont les feuilles. Ce sont les feuilles les plus hautes qui tombent et qui en tombant sur les branches des étages inférieurs de la forêt, font ce bruit de pluie épaisse. Xk xxk. Les arbres sont plus hauts que les plus hauts des buildings qui n’existent pas encore. Xk xxk kkkx. Sur les troncs des arbres il y a des traces de doigts, et ces doigts bougent lentement : c’est la lumière bercée par les feuilles. Les feuilles sont vitraux de cathédrales mais les cathédrales n’existent pas encore. Les rayures de soleil peignent et repeignent les feuilles, et les feuilles se laissent peigner et peindre de leurs doigts entrelacés. Xk xxk kkhha xk. Une fourmi au cul doré grand comme un pépin de sapotillier avance, chantant l’ampleur du tableau. Kkhha xk. Le soleil n’est pas seul. Sous le soleil que nous appelons soleil, deux soleils volent en contre-bas, au troisième étage du ciel, dans la pluie qui n’est pas la pluie. L’un se pose sur une branche. Il a plongé sa bouche dans du rouge vif. xk xkii xkiii. Dans nos mots, il n’y a pas de quoi nommer ses couleurs. On appelle cela un toucan.
Le Mexique ne s’appelle pas encore le Mexique. La forêt lacandone ne s’appelle pas encore la forêt lacandone. Bonampak ne s’appelle pas encore Bonampak. Et pourtant tout cela existe, et les soleils, et les couleurs, et les toucans, xk xk xkiii. Nos pauvres lettres de l’alphabet ne savent rien de cela encore.
Hugues Charybde, le 25/11/2025
Laetitia Bianchi - Bonampak - éditions Verticales
l’acheter chez Charybde, ici

18.11.2025 à 09:23
Passé sous le radar : les vibes de Khan Jamal

Texte intégral (1102 mots)
Si, en parlant vibraphone jazz, les premiers noms qui viennent à l’esprit depuis les 60’s sont plutôt Bobby Hutcherson, Roy Ayers ou Gary Burton, après Lionel Hampton, Milt Jackson ou Cal Tjader, il s’agirait aussi, dans le registre spiritual, de ne pas oublier Khan Jamal dont la ressortie de Give the Vibes some au Souffle Continu remonte d’une pile. Avec l’idée de base du Give the drummer some adaptée aux lamelles qui swinguent. Un genre de perle à la résonance aussi métallique que spatiale. Rentrez les tobogans !
Sur ‘’Cold Sweat’’, James Brown lançait son légendaire “give the drummer some.’’ En 1974, le vibraphoniste de Philadelphie Khan Jamal lui emboîtait le pas avec Give the Vibes Some et le résultat est saisissant. Le label PALM, fondé par le pianiste et compositeur Jef Gilson, offre à Jamal le terrain idéal pour explorer en profondeur les possibilités du vibraphone contemporain. Créé en 1973, PALM s’impose vite comme un label qui ne publie que des enregistrements atypiques. Give the Vibes Some, dixième sortie du label, en est une éclatante illustration.
Originaire de Philadelphie, Khan Jamal se tourne vers le vibraphone en 1968, après deux années passées dans l’armée, entre la France et l’Allemagne. Séduit à la fois par l’instrument et par le style de Milt Jackson, figure emblématique du Modern Jazz Quartet, il étudie auprès de Bill Lewis, légende locale du vibraphone. Il fait ensuite ses premiers pas sur la scène jazz de Philadelphie, où il s’impose rapidement.
Début 1972, Khan Jamal enregistre pour la première fois avec le groupe Sounds of Liberation, qui propose une singulière fusion entre le groove des congas et l’improvisation issue du jazz d’avant-garde. Le saxophoniste Byard Lancaster, figure clé dans le parcours artistique de Jamal, apporte une contribution essentielle à ses explorations en solo. Quelques mois plus tard, toujours en 1972, Jamal signe ses débuts en tant que leader avec Drum Dance to the Motherland, une performance live audacieuse, marquée par un traitement spécifique, autour des réverbérations et des saturations des sons, une expérience unique, qui n'a jamais été reproduite par la suite. Ces deux enregistrements paraissent sur Dogtown, un petit label indépendant géré par des musiciens.
‘’Nous ne pouvions décrocher aucun engagement, ni concerts, ni sessions d’enregistrement, rien du tout. Alors, je suis parti pour Paris’’, raconte Jamal dans une interview accordée à Cadence avec Ken Weiss. ‘’En quelques semaines, j’avais publié quelques articles et obtenu une séance d’enregistrement. Une situation qui n'améliore pas mon sentiment vis-à-vis de l’Amérique.’’ C’est en 1974, à l’époque où Byard Lancaster enregistre la musique aujourd’hui rassemblée dans The Complete PALM Recordings (1973-1974) publié par Souffle Continu.
La séance d’enregistrement de Jamal donne naissance à Give the Vibes Some. À l’origine, il s’agit d’un album d'exploration du vibraphone en solo, mais deux titres sont enrichis (grâce à une astuce technologique ?) par la participation d’un célèbre batteur français, habituellement audible au piano ou derrière les fûts à chanter en kobaien… . Sur un autre morceau, Jamal délaisse le vibraphone pour son ancêtre en bois, le marimba, et invite le jeune trompettiste texan Clint Jackson III. Durant ce séjour en France, l’article le plus marquant consacré à Jamal paraît dans Jazz Magazine, sous forme d’interview. Ses derniers mots sont : “The Creator has a master plan / drum dance to the motherland.” On peut y ajouter comme formule programmatique : “Give the vibes some.”
On ajoute que, pour un album méconnu ( de nous jusqu’ici…), il sonne comme pierre angulaire. de ce jazz développé par les 70’s que le terme “spiritual” ne recouvre qu’en partie et, comme un album qui aurait du faire partie de toute bonne discothèque. Et ce, dès sa sortie. C’est (peu) dire !
Jean-Pierre Simard, le 18/11/2025
Khan Jamal - Give the Vibes some - Palm Redux Serie - Souffle Continu

- GÉNÉRALISTES
- Basta
- Blast
- L'Autre Quotidien
- Alternatives Eco.
- Le Canard Enchaîné
- La Croix
- Le Figaro
- France 24
- France-Culture
- FTVI
- HuffPost
- L'Humanité
- LCP / Public Senat
- Le Media
- Le Monde
- Libération
- Mediapart
- La Tribune
- EUROPE ‧ RUSSIE
- Courrier Europe Centrale
- Desk-Russie
- Euractiv
- Euronews
- Toute l'Europe
- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient
- Haaretz
- Info Asie
- Inkyfada
- Jeune Afrique
- Kurdistan au féminin
- L'Orient - Le Jour
- Orient XXI
- Rojava I.C
- INTERNATIONAL
- CADTM
- Courrier International
- Equaltimes
- Global Voices
- I.R.I.S
- The New-York Times
- OSINT ‧ INVESTIGATION
- OFF Investigation
- OpenFacto°
- Bellingcat
- Disclose
- Global.Inv.Journalism
- MÉDIAS D'OPINION
- AOC
- Au Poste
- Cause Commune
- CrimethInc.
- Hors-Serie
- L'Insoumission
- Là-bas si j'y suis
- Les Jours
- LVSL
- Médias Libres
- Politis
- Quartier Général
- Rapports de force
- Reflets
- Reseau Bastille
- Rézo
- StreetPress
- OBSERVATOIRES
- Armements
- Acrimed
- Catastrophes naturelles
- Conspis
- Culture
- Curation IA
- Extrême-droite
- Human Rights Watch
- Inégalités
- Information
- Internet actu ✝
- Justice fiscale
- Liberté de création
- Multinationales
- Situationnisme
- Sondages
- Street-Médics
- Routes de la Soie
