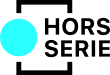22.01.2026 à 18:20
Potere al Popolo : la gauche qui monte (part.2)
Texte intégral (8475 mots)
Judith Bernard : Tu parlais précédemment des contradictions du capitalisme et tu as mentionné les propriétaires des médias et ceux qui ne le sont pas, et là tu es en train de parler des réseaux sociaux qui ont l’air d’être un média que vous pour mobilisez énormément. Ce sont donc les seuls « médias » que vous mobilisez ? Il n’y a pas un investissement du côté des médias alternatifs ? Parce que pour massifier une audience, il faut à un moment des médias capables de diffuser et de faire connaître votre activité à grande échelle…
Salvatore Prinzi : Là encore, c’est une chose qui nous différencie beaucoup du passé, et c’est à mettre en perspective avec la mouvance antagoniste italienne qui est très méfiante vis-à-vis des journalistes et des médias, parce que « ce sont les outils du système ». Mais à un moment donné, si tu veux sortir de ta niche, il faut se poser la question. Premièrement, nous, on a construit – même si on n’a pas des professionnels qui travaillent sur ça, on a appris à le faire – et donc on a construit des médias.
La communication de l’ex OPG1 était pensée pour créer une communauté. Les slogans étaient très connectés à l’histoire du lieu, donc à l’imaginaire des puissances et des dynamiques de la libération : le symbole de l’ex OPG, c’est la clé, parce que c’était la clé qui enferme tout (dans la prison psychiatrique), et c’est quelque chose qui ouvre aussi. Donc nous, on disait « on a trouvé la clé » : la clé, c’est la constitution de la communauté. On disait : « Où il y avait une prison, nous on a fait la liberté », en jouant sur le motif du passage ; on mettait par exemple les photos d’une salle comme on l’avait trouvée, et comme on l’avait transformée. On donnait tout le temps l’idée qu’on peut gagner, même des petites victoires, parce que les petites victoires, c’est ce qui permet d’arriver à la grande victoire. On communiquait beaucoup à ce sujet sur Facebook à cette époque-là.

Aujourd’hui, si on observe les statistiques d’activité sur les réseaux sociaux, cette semaine, on voit que Potere al popolo arrive en 4ème position dans la liste des partis qui suscitent le plus d’interactions, alors qu’on ne paie rien pour ça – contrairement aux partis qui nous devancent. En 4ème position alors qu’en termes de résultats électoraux on est autour de 1% !
J.B : Là, tu parles des réseaux sociaux : Instagram, Facebook, Tik Tok… Alors que les algorithmes ne sont pas tellement favorables a priori à la visibilité des contenus de gauche…
S.P : Oui, surtout, nos contenus sont placés dans le shadowban. Dans le cadre de la mobilisation pour la Palestine, on a subi plusieurs fois des censures de nos contenus, donc ça reste un terrain disputé. Mais tu peux trouver des stratégies de contournement…
J.B : Tu parles des réseaux existants où vous diffusez vos contenus, mais donc vous n’avez pas de média dédié ?
S.P : La situation des médias alternatifs en Italie est tragique. Je connais la situation espagnole, je connais la situation française évidemment. En fait c’est terrible, en Italie on n’a pas de médias alternatif…
J.B : Il n’y a pas de média indépendant en Italie ?
S.P : Aujourd’hui, c’est de l’ordre du blog. Il y avait L’Unità, c’était le quotidien du Parti communiste ; depuis le changement du Parti communiste, pratiquement, c’est un journal qui n’existe plus. Donc L’Unità, on l’a perdue. C’était l’équivalent de l’Humanité, le quotidien le plus important à gauche pendant 50 ans. Il y avait Liberazione, ce n’était pas Libération, c’était le quotidien de Rifondazione comunista, après la scission au début des années 90 : aujourd’hui c’est fini, comme le parti auquel le journal était lié. Et il y avait Il Manifesto, le grand quotidien de référence pour les intellectuels ; il s’est peu à peu atrophié, n’a pas pris le virage internet, personne parmi les jeunes ne lit le Manifeste. En ce moment, ils percent à nouveau un peu, ils ont toujours un problème d’argent, mais surtout ils sont très alignés avec le centre gauche. Même si c’est marqué « Quotidien communiste », personne parmi les rédacteurs ne vote communiste : ils sont sur la ligne de l’alliance avec le parti démocratique. Ce qui fait qu’ils parlent très mal de nous, ou le plus souvent, ils n’en parlent pas du tout – alors qu’ils nous connaissent très bien.

J.B : Vous les embarrassez ?
S.P : C’est juste qu’ils soutiennent AVS2, donc qu’ils ne peuvent pas parler de nous, parce que nous sommes une menace pour AVS. Donc si on fait une grande manifestation, ils en parlent à peine, aussi parce qu’ils savent que nous, on n’achète pas le Manifeste – en tant que génération, en tant que composition sociale, on n’est pas la vieille gauche qui paie pour ce journal. Il y a Il Fatto quotidiano, c’est une création des années 2000, mais c’est un quotidien assez bizarre. D’un côté, on pourrait dire que c’est le seul grand quotidien « de gauche », et c’est vrai sur beaucoup de questions, mais sa référence constante, c’est le Mouvement Cinq étoiles, c’est la petite bourgeoisie légaliste. Sur les questions internationales, le journal tient d’assez bonnes positions, mais sans aucune attention aux mouvements sociaux. Il y a des journalistes chez eux avec qui on parle, donc le journal parle un peu de Potere al popolo, mais la direction reste fidèle au mouvement Cinq étoiles.
Sur Internet il y a des petites choses intéressantes, par exemple il y a la version italienne de Jacobin, mais qui ne parle pas de Potere al popolo, parce que c’est des gens qui soutiennent AVS, avec une audience de 1000 à 2000 personnes par semaine – nous c’est autour de 1 million. Les quotidiens qui parlent le plus de nous, c’est les journaux de droite, et même de la droite fasciste : ils nous consacrent des articles nous identifiant désormais à « l’islamo-gauchisme » – ça y est, le concept arrive en Italie !
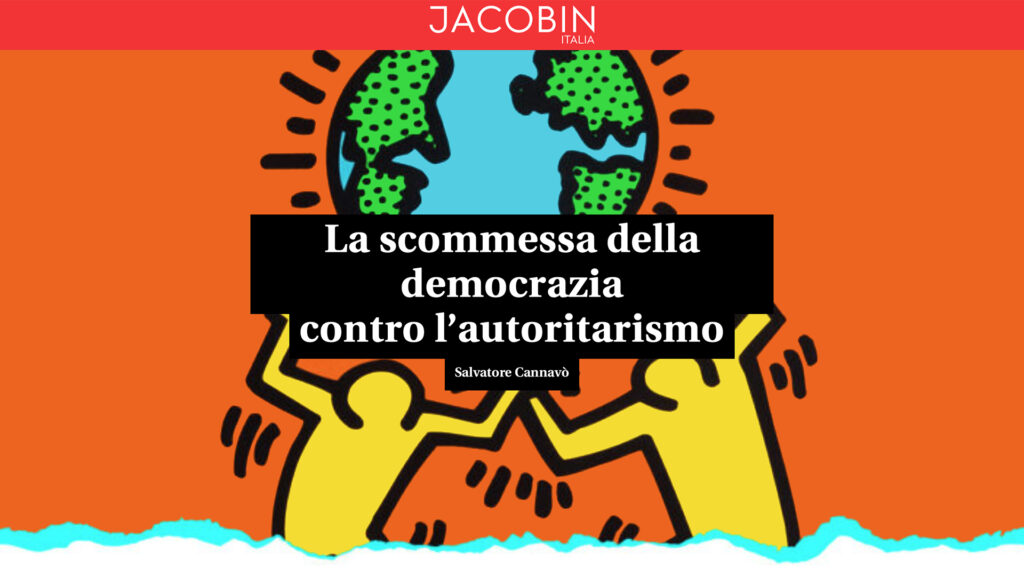
Nous, on a fait le choix d’aller la télé. Il faut dire que le service public de l’audiovisuel italien est dégoûtant. Les chaînes privées, ce sont les chaînes de Berlusconi, ce sont des chaînes de droite. A côté, il y a les trois chaînes publiques, qui se répartissent normalement entre « gauche », centre et droite. Chaque nouveau gouvernement peut déterminer l’orientation politique de ces chaînes, en s’emparant de deux chaînes sur trois, et donc pour nous c’est un espace bloqué : ils ne nous appellent jamais. Les seules chaînes qui nous appellent, ce sont les chaînes privées, parce qu’ils font la même chose que les quotidiens de droite : ils ont besoin de quelqu’un qui soit communiste pour pouvoir l’engueuler…
Raphaël Schneider : Pour vous diaboliser…
S.P : Pour nous diaboliser, oui. Mais pour nous, c’est très bon ! C’est comme ça qu’on construit des figures médiatiques et qu’on recadre les faits, parce qu’il y a une interaction entre les réseaux sociaux et la télé. Si tu mets sur les réseaux sociaux ton passage télé, pour les gens c’est beaucoup plus crédible, ça nous donne beaucoup de légitimité !
R.S : Mais tu ne crois pas que le risque, et il y a ça aussi en France, c’est que, comme la droite est dans le show et dans l’irréel, vous soyez complètement aspirés dans le spectacle ? Que la société du spectacle vous présente complètement détachés de vos activités, de votre projet ?
S.P : Ça correspond à l’analyse critique qu’on a faite du populisme de gauche, et j’en ai beaucoup discuté avec Clara (Clara Serra, autrice de La Doctrine du consentement, NDA) qui était parmi les fondatrices de Podemos. Clara mène une réflexion très critique à ce sujet. Podemos, c’était pensé comme une espèce de catapulte pour propulser Pablo Iglesias, et permettre à la gauche radicale de dépasser le parti socialiste : l’idée était de former un gouvernement et d’être en position de renégocier les relations avec le parti socialiste. Donc le terrain médiatique était privilégié, et tout ce qui venait des territoires, de l’échelon local, était négligé parce que ça pouvait remettre en question cette stratégie : il y avait une décision, à Podemos, de ne pas construire le niveau local.

C’est exactement l’inverse de notre stratégie à Potere al popolo ; ce qu’on a fait ici à Naples, avec l’ex OPG, est fait aussi ailleurs en Italie. L’ex OPG c’est l’expérience la plus complète, notamment parce que le soutien de la mairie nous a donné un certain élan, et c’est lié aussi à la formation des personnalités qui ont participé à la création de ce lieu. Mais ailleurs, on trouve des choses très puissantes : il y a un groupe qui s’occupe de l’école, bien meilleur que nous, parce qu’il s’appuie sur un collectif d’enseignants progressistes qui mènent un travail phénoménal. Il y a un collectif très fort sur l’environnement, qu’on a très peu traité ici parce que le contexte ne s’y prête pas du tout. Il y a dans le Nord de l’Italie des collectifs contre le TGV, contre le TAV, qui est beaucoup plus important que nous par rapport à ces questions là…
Notre analyse, en 2017, c’était qu’on n’avait pas la possibilité de prendre l’espace électoral du populisme, parce que le Mouvement Cinq étoiles occupait la place. Il fallait les laisser brûler, consumer cet espace, quitte à voir remonter ensuite l’abstention, et, après dix ans, le temps d’une génération, motiver les gens à participer à nouveau.
C’est pour ça qu’on n’est pas pressés, du point de vue électoral : aujourd’hui, on est une réponse à une question qui n’existe pas. Actuellement, il n’y a pas de demande pour le communisme en tant que projet politique, en tant que vision, en tant qu’imaginaire. Il n’y a pas une demande de communisme dans la société. Il y a une demande un peu confuse de justice, mais qui prend les voies les plus diverses : par exemple, le Mouvement Cinq Etoiles s’est fait le porte-voix de la critique selon laquelle « les politiciens, c’est des privilégiés ». La droite aussi parle de la justice, en affirmant que pour le citoyen, la « justice », c’est que l’immigré ne pisse pas au bas de son immeuble, et qu’il faut que les gens soient punis. Il y a un « sentiment d’injustice » dans les classes populaires, qui peuvent se sentir maltraitées par la société, mais sans savoir comment y répondre. Mais personne aujourd’hui ne dirait que la justice, c’est l’égalité des revenus ; même les gens « de gauche » te diront qu’ils méritent plus que tel ou tel autre. Donc il y a une demande confuse de justice, il y a un certain désir de solidarité, qui peut prendre la voie du catholicisme, mais qui prend aussi souvent la forme du petit groupe enfermé dans des logiques clientelistes, qui peuvent être perçues comme des pratiques de solidarité – « si tu m’élis, je t’aide », c’est perçu comme une forme d’aide réciproque, de « solidarité ». Ces demandes de justice et de solidarité sont donc très confuses parce qu’elles ont perdu toute orientation politique. Et du point de vue du marché électoral, il n’y a pas de demande de communisme ou de socialisme en Italie.
J.B : Et pourtant vous faites le choix de vous lancer dans la bataille électorale dès maintenant ! Et il faut d’autant plus que tu l’expliques que vous êtes dans une perspective révolutionnaire, communiste, donc dans un espace politique qui a un rapport extrêmement critique avec la politique de la représentation, avec les élections. Comment se fait-il que Potere al popolo ait fait le choix d’investir le champ de bataille électoral ?
S.P : Nous, on ne fait pas partie de la société du spectacle ; on part du territoire, notre premier sujet est là : il faut être dans les quartiers populaires, il faut être sur les lieux du travail. Deuxièmement, ce n’est pas un sujet qui est condamné à perdre : on peut gagner – c’est la théorie des petites victoires, qui construit une mentalité, un esprit gagnant, pour rompre avec le défaitisme historique de la gauche, qui a tendance à s’essouffler au premier échec. On racontait sur la page de l’ex OPG l’histoire de Fidel (Castro) qui rate complètement la Moncada3, sa première tentative pour prendre le pouvoir à Cuba ; mais il analyse son échec et il continue ! Rater, c’est la condition pour pouvoir gagner. Troisièmement, l’idée que les choses qui se passent à Naples se passent aussi dans d’autres lieux ; donc, il faut fédérer tous les centres sociaux, toutes les associations, tous les comités de base. Il faut les mettre ensemble, pas parce que ça produit déjà un résultat électoral, mais parce que ça produit un résultat organisationnel. C’est le passage difficile, qu’on avait tenté pendant la période de 2011-2014, avec le livre, en allant un peu partout pour dire « Il faut se mettre ensemble »… et ça n’avait pas marché. Il faut la force de l’exemple, et construire une dynamique qui contraint à la création de liens. Dans le strict plan paritaire de la parole, on ne peut convaincre personne ; en produisant un exemple concret, le monde militant parle moins, il est contraint à prendre position, pour ou contre, et là on crée une dynamique.
Il faut mesurer la différence entre représentation électorale et représentation politique. Certes, on ne peut pas mobiliser la représentation électorale en ce moment parce que nous sommes une réponse à une une demande qui n’existe pas. Mais il y a une demande de représentation politique : il y a un espace politique qui n’est pas couvert, il y a une rage sociale, il y a un désir de solidarité, vécus par des gens qui ne sont pas représentés. Il n’y a pas d’espace électoral pour nous, mais il y a un espace politique – il faut bien distinguer ces deux espaces, ça ne se superpose pas : vous l’avez bien vu en France en mai 68 !
Nous, on travaille sur le territoire avec les assemblées des territoires, sur des choses très concrètes. Mais pour amener les autres à nous rejoindre, on a besoin de la verticalisation politique. C’est à ça que sert l’espace médiatique de la télévision : il ne s’agit pas pour nous de participer à la société du spectacle. Il s’agit de parler à ceux dont on suppose qu’ils attendent notre message, qu’ils attendent de nous reconnaître, et qui ne peuvent pas nous rencontrer sur des médias alternatifs qui n’existent pas, qui ne peuvent pas nous rencontrer puisqu’on n’existe pas sur tous les territoires, pour leur dire : « Nous on est là. Et nous, on fait ça ».
Après les émissions où on envoie Giuliano4 pour parler 30 secondes ou une minute – parce qu’ils ne te laissent pas plus que ça, on travaille très précisément pour utiliser au mieux cet espace de parole – on reprend son passage télé, on le poste sur les réseaux sociaux, et en regardant sur Google Analytics on voit qu’aussitôt, les gens nous cherchent sur Internet. Ces émissions de merde font des audiences d’un million de personnes ; avec le tractage, en une journée on n’atteint pas le millième… Sur un million de personnes qui nous voient à la télévision, il y en a 10 000 qui se mettent à nous chercher ! Nous, au bout de sept ans, on avoisine toujours 1 % au niveau électoral – on va voir ce que ça donne l’année prochaine – mais du point de vue militant on grandit : les gens qui nous découvrent adhèrent au parti, on ouvre de nouveaux lieux sur les territoires. Même si ça ne se répercute pas immédiatement en termes de résultats électoraux, c’est la condition pour faire de la politique : on grandit sur le plan de la représentation politique. Potere al popolo est devenue la chose la plus radicale en Italie : certes, on peut être vus comme des jeunes idéalistes qui ne vont nulle part, qui font 1%, mais on est perçus comme des gens qui, quand même, ont une position, font quelque chose, s’organisent. Des gens qui existent. Dans cette phase historique, notre tâche est de faire exister quelque chose de différent.

On ne pouvait pas rester coincés dans le centre social, on ne pouvait pas espérer convaincre les mouvements avec une petite fédération du bas. On a un peu étudié l’histoire du communisme : il y a trois modèles de formation des partis politiques. Le premier, c’est la fédération ; le deuxième, c’est la scission d’un organisme déjà formé ; le troisième, c’est les « franchisés », comme dans le cas du Black Panther Party. On n’avait pas de grand parti d’où faire une scission, on a essayé la fédération par le bas, qui n’a pas vraiment marché, alors on a fait une sorte de fédération en utilisant les mécanismes des « franchisés ».
Potere al popolo naît comme parti en novembre 2017, dans le constat que la gauche radicale n’arrive pas se présenter aux élections – alors qu’il y avait un grand désir de ces mondes de se présenter aux élections. Nous, on fait une vidéo dans le théâtre de l’ex OPG ; à ce moment on est bien connus en Italie, connus comme réalité politique et pas seulement comme un centre social. On voit bien que personne n’a le courage de construire une liste de gauche radicale, parce qu’on sait que les scores seront dérisoires, mais on sait aussi que personne ne nous représente. Donc, même si on est très pauvres, même si on est peu, nous on veut être représentés politiquement. Et nous, on a le courage de faire une liste, même juste à Naples, même juste dans notre région. Et on lance la question : « qui veut venir avec nous ? »
On savait très bien qu’il y avait un désir de ces gens de se présenter, mais les dirigeants n’avaient pas le courage de se présenter aux élections pour recueillir 1% des voix. Et les gens de gauche ont été enthousiastes. On a mobilisé une logique de « franchisés » : le modèle, c’est l’ex OPG, qui fait de la politique à partir de la folie, pas pour des intérêts électoraux. A l’ex OPG, on n’était pas très forts pour le franchising : l’ex OPG c’est un centre social avec cent personnes, ce n’est pas une lutte qui a marqué une époque. En même temps, le modèle de la stricte fédération, ça met tout le monde sur un plan de parité absolue qui empêche le projet de se développer, parce que la gauche radicale italienne est tellement fragmentée et haineuse que ça peut complètement piéger une organisation. Donc on a développé le « franchising » pour surmonter les blocages, et c’est à ça que sert de participer aux élections : ça donne de la visibilité médiatique et ça force les autres, qui ne veulent pas se fédérer, à bouger.
J.B : Alors, s’agissant des résultats électoraux, en 2017-2018, vous obtenez 1,2%
S.P : 300 705 voix.
J.B : Et là, sur des élections plus récentes, il y a un parti en Italie qui s’appelle Toscana Rossa, qui fait 5 %. C’est un « franchisé » Potere al popolo ?
S.P : Oui, en fait, c’est nous. Mais on a fait adhérer aussi ce qui restait de Rifondazione comunista, et d’autres associations du territoire, c’est pour ça que la liste ne s’appelle pas Potere al popolo, même si le symbole de Potere al Popolo était au centre de la communication visuelle.
J.B : Et donc là, on atteint 5 %, il y a quand même une dynamique spectaculaire.
S.P : On a doublé par rapport à il y a cinq ans.
J.B : Comment tu interprètes cette dynamique ? Est ce qu’il y a un « effet Palestine » qui joue dans cette montée en puissance des scores électoraux ?
On a beaucoup étudié ces résultats. Il faut savoir qu’en Italie, on vote souvent (c’est lié à une tradition démocratique, mais aussi aux intérêts de la classe politique), ce qui fait qu’il n’y a pas chez nous les « grands jours » du vote national, il y a constamment des échéances électorales de différents niveaux. C’est une difficulté, mais d’un autre côté, c’est ce qui fait que les gouvernements sont toujours sous la menace des votes régionaux. Ce qu’on observe d’une manière générale, c’est que les questions internationales, même si elles peuvent générer des mouvements importants, contre la guerre, contre le réarmement, pour la Palestine, ne semblent pas générer d’effet au niveau des votes. C’est le cas presque partout, et c’est un argument pour la droite.
Meloni ces derniers temps a été très en difficulté avec la mobilisation italienne pour la Palestine, parce que la majorité des gens, même de droite, sont contre la politique génocidaire d’Israël, ce qui a généré une crise dans son propre bloc. Dans la vie politique italienne, l’enjeu n’est pas de convaincre les autres votants, mais de garder sa propre base électorale : comme le contexte général est celui d’une tendance à la dépolitisation et à l’abstention, si tu gardes tes électeurs, tu gagnes les élections ; si tu essaies de convaincre les autres, et que tu fais un mouvement par rapport à ta position, tu perds. Donc Meloni, elle a gagné les élections en perdant des votes.
Celui qui gagne, c’est juste celui qui perd moins de votes que son concurrent. J’y insiste parce qu’en France vous n’avez pas compris la dynamique, vous avez tendance à penser que Meloni c’est un équivalent de Marine Le Pen, qui part avec un petit parti sectaire qui devient un parti de masse… Ce n’est pas du tout ça. Meloni recueille beaucoup moins de voix que la droite en 2018, et par rapport à Berlusconi, elle a perdu 5 à 6 millions de voix, c’est énorme ! Mais le centre droit et le centre gauche ont perdu encore plus. Elle arrive à gouverner, mais elle sait très bien qu’elle n’est pas soutenue par un consensus dans la société aussi fort que celui qui soutenait Berlusconi. Elle ne peut gouverner que sur la dépolitisation.
Elle a mobilisé un argument utilisé par tous les gens de droite, lié au fait que les consultations électorales qui se sont tenues dans trois régions différentes en Italie, après la mobilisation pour la Palestine, n’ont enregistré aucun effet politique lié à cette mobilisation. On l’explique parce qu’il n’y avait pas de liste de gauche capable de recueillir ces voix ; il y avait AVS, mais AVS c’est toujours très ambigu ; le mouvements Cinq étoiles est aussi ambigu sur cette question-là, donc, il n’y avait pas de parti qui pouvait clairement dire « Nous, on est du côté de la Palestine, on est les gens qui se sont mobilisés ». De plus, beaucoup des gens mobilisés pour la Palestine ne votent pas : c’est un engagement émotionnel, éthique, pas politique.
J.B : C’est presque plus humanitaire que politique, cette mobilisation pour la Palestine ?
S.P : Oui, mais aussi politique d’une manière très forte, trop forte pour le vote : « Il faut changer le système, ce ne sont pas les élections, surtout au niveau régional, au niveau local, qui font la différence… ». Donc il n’y a pas d’indication claire que la mobilisation pour la Palestine est en train d’amener des votes à la gauche d’une manière générale.
Mais le cas de la Toscane donne quand même à réfléchir (dans les autres régions concernées par ce scrutin, on ne s’est pas présentés, parce qu’il y avait un seuil de 10% de voix à atteindre pour obtenir un siège au conseil régional, c’était au dessus de nos forces, et inutile de gaspiller de l’énergie politique qu’on préfère employer sur le terrain, dans la mobilisation pour la Palestine, dans les maisons du peuple, auprès des syndicats…). En Toscane, on était présents à l’élection, et on peut dire que cette liste est la première et la seule qui a pu bénéficier d’un « effet Palestine ». Ce n’étaient pas des voix nouvelles ; c’étaient les voix de gens qui ont toujours voté à gauche, qui, dans les dernières années s’abstenaient ou votaient péniblement pour le centre gauche ; et comme en Toscane c’était joué d’avance, parce que tout le monde savait que le centre gauche allait gagner et que la droite allait perdre, les gens ont pu utiliser leur vote comme mode d’expression pour récompenser, dans le cadre de la mobilisation pour la Palestine, ceux qui l’avaient soutenue. Ces 5% qu’on a obtenus, je n’affirmerai pas qu’on peut les faire ailleurs.
Par exemple, là, on a les élections régionales à Naples : en Campanie, nonobstant une implantation très forte en Campanie, on n’est pas dans la configuration de la Toscane, qui a toujours été une région de gauche très forte, alors que la Campanie a toujours été une région de centre droite. Ici c’est très difficile, pour nous, de générer la même activation politique, parce qu’il n’y a pas ici comme en Toscane des gens typiquement de gauche, comme les vieux communistes qui vont voter pour nous soutenir parce qu’ils étaient mobilisés pour la Palestine. Il y a des jeunes qui vont peut-être se mobiliser dans ce cadre, mais on n’ambitionne pas un score équivalent ici. Quand en Toscane on faisait 2,5%, en Campanie on faisait 1,2%…
J.B : Actuellement, donc, vous travaillez sur la campagne régionale en Campanie…
S.P : On vote dans trois semaines5.
J. B : Et quel score serait une victoire pour Potere al popolo ?
S.P : La victoire incroyable, susceptible de changer le panorama politique et de faire la démonstration que toute notre stratégie des sept dernières années a fonctionné, ce serait de dépasser les 2,5%6 : c’est le seuil pour obtenir un siège de conseiller régional. Ce serait vraiment un retournement de la vie politique italienne : il n’y a plus de communiste dans les institutions régionales, nationales ou européennes depuis 2008, ce serait donc la première fois depuis presque 20 ans. En outre, les communistes étaient au parlement parce qu’ils avaient fait une alliance avec le centre gauche, c’était l’ensemble de la coalition qui se présentait aux élections. Là, ce serait les communistes qui entrent dans un lieu institutionnel avec leurs seules forces, d’une manière autonome – ce qui rend bien plus libre parce qu’il n’y a pas à négocier, on peut dire ce qu’on veut. De plus, les conseillers régionaux en Italie ont un poids politique plus important que les députés. En termes de niveau de salaire, c’est 12 000 €, plus qu’un député national. La relation avec le territoire est aussi beaucoup plus forte qu’avec les députés nationaux, qu’on ne voit jamais sur le terrain. Par rapport à notre propre logique de construction d’une organisation, avoir une relation avec le territoire, c’est évidemment très important. Enfin, c’est notre porte-parole, Giulano Granato, qu’on présente aux élections – ce n’est pas quelqu’un de l’extérieur qu’on aurait désigné et qui risquerait de nous trahir après, comme on l’a souvent vu à gauche ; là, il bénéficierait d’encore plus de force médiatique. Il sera sollicité médiatiquement pas seulement en tant que notre porte-parole, mais aussi en tant que conseiller régional ; il ne sera plus traité de la même manière par ses interlocuteurs médiatiques.
J. B : Ça crée une respectabilité…
S. P : Il va intervenir sur des questions nationales, et on ne pourra plus le traiter avec désinvolture. Il faut aussi ajouter que notre organisation est basée sur le bénévolat. Actuellement, seul Giuliano est payé, grâce à une auto-taxation interne, ainsi que Gianpiero Laurenzano, le président du parti, et Marta Collot, l’autre porte-parole (tous les rôles sont partagés entre un homme et une femme), qui sont payés grâce aux activités qu’on organise comme des fêtes . L’élection de Gianpiero au poste de conseiller régional permettrait de salarier deux personnes en tant qu’assistant.e.s, et jusqu’à six personnes payées sur cette enveloppe des 12 000€ mensuels.

En termes de message politique, pour tous les gens impliqués dans les mouvements sociaux qui ont renoncé à voter parce qu’ils pensent que ça ne sert à rien, ou qui votent pour le centre alors qu’ils sont d’accord avec nous, ça change la donne : ils pourront désormais parier sur nous, voter pour nous. Notre potentiel électoral est en réalité très au dessus de nos scores réel : dès lors qu’on accède à une position éligible, on devient une grande menace pour le centre et pour le mouvement Cinq Etoiles, qui reçoivent beaucoup de votes sans conviction. Mais le système électoral italien est conçu pour favoriser les coalitions au centre et exclure les forces politiques nouvelles ; pour les Européennes, on ne peut même pas se présenter, parce qu’il faut recueillir 150 000 signatures, et les collecter physiquement – ça ne peut pas passer par des procédures en ligne. Exister, c’est tout l’enjeu pour nous : parvenir à participer à des élections, c’est déjà une démonstration de force. C’est déjà une petite victoire.
Raphaël Schneider : Pour conclure cet entretien, quelques mots sur le contexte de fascisation qui est le nôtre. Depuis le point de vue français, on peut avoir l’impression que le gouvernement Meloni, c’est le fascisme au pouvoir. Est-ce que tu fais cette analyse-là ? Et est-ce que la présence de Meloni au pouvoir a donné des ailes aux groupuscules fascistes ? Sont-ils plus nombreux dans la rue, plus agressifs, contre les migrants ?
S.P : Je vous renvoie au long entretien que j’ai donné, avec Maurizio Coppola, à Ugo Palheta sur le podcast Minuit dans le siècle7. La situation italienne est très différente de la situation française. Meloni vient clairement d’un parti fasciste, elle est imprégnée d’une culture fasciste. Mais il faut se demander ce que sont les partis fascistes en Italie après la chute du fascisme.
La reconstitution du parti fasciste a généré deux courants au sein du même parti. Le courant majoritaire a dit : « Il faut pas renier le fascisme mais il faut assumer qu’on ne peut pas revenir au fascisme. Dans le jeu démocratique, notre rôle va changer, et passer de l’anti-impérialisme contre les Anglo-saxons à un rôle actif d’anticommunisme. Il faut faire passer le projet national italien d’autonomie, mussolinien, à l’anticommunisme organique de l’Occident ». Donc c’est des gens qui commencent à travailler avec les Américains.
La partie minoritaire du parti est issue des jeunesses radicalisées à droite pendant les années 70, qui a pu dans ces années poser des bombes, et qui avaient des relations avec les services secrets qui les instrumentalisaient, et voulait une nouvelle révolution fasciste sous la forme d’une troisième voie – ni capitaliste, ni socialiste.
Meloni a toujours fait partie du courant majoritaire. Après la chute du mur de Berlin, c’est devenu un parti libéral conservateur, tandis que les groupuscules se sont atomisés en petits partis voués à la disparition. Meloni a participé au gouvernement Berlusconi, dont elle était très proche et qui l’a nommée ministre de la jeunesse, à 30 ans : c’était la plus jeune ministre de l’histoire italienne. Elle est donc très berlusconienne, du point de vue de la communication politique comme des sujets sociaux qu’elle privilégie ; il n’y a rien de fasciste, au sens historique, dans sa politique. Il n’y a par exemple aucun souverainisme : c’est le gouvernement le plus atlantiste de notre histoire ! Comme elle se sait très faible au niveau de la politique intérieure, elle a besoin des Américains (en Italie il n’y a pas de gouvernement que les Américains ne veuillent pas ; si tu as le soutien des Américains, tu as le soutien la presse, des fonds d’investissement… Ce sont eux, le « chef » qui domine le pays).
S’agissant du rôle de l’État, qui doit, dans la tradition fasciste, protéger la population (pas d’une manière communiste, évidemment, mais d’une manière traditionaliste), Meloni a complètement abandonné ce principe du Welfare State : elle mise tout sur la privatisation et le libéralisme. Il y a bien sûr la question des immigrés : son gouvernement a tenté un geste symbolique, consistant à ouvrir un centre de rétention en Albanie, mais la magistrature s’y est opposée (c’était illégal), elle a donc échoué. Il y a aujourd’hui plus de migrants qui arrivent sur le sol italien que pendant les années précédentes – cela ne dépend d’ailleurs pas du gouvernement, mais de la pression migratoire des pays d’origine, des guerres, des catastrophes… Ces flux sont importants actuellement, et elle a été contrainte, par la classe entrepreneuriale, à accepter la légalisation d’un très grand nombre de migrants. Avec la crise démographique italienne, elle n’avait pas le choix, et s’est contentée de ne pas trop en parler. Bien sûr la presse de droite met en avant les faits divers liés à la question des migrants, mais du point de vue législatif, Meloni n’a rien fait. Elle a tenté d’attaquer la magistrature, ce qui constitue une bataille typique du fascisme, mais aussi de la droite en général, y compris berlusconienne : ça la situe plutôt du côté du conservatisme libéral.
Quant aux groupuscules fascistes actifs sur le terrain, dans une société aussi dépolitisée que la nôtre, ils ont tendance disparaître. Il en reste, mais beaucoup moins qu’il y a quinze ans. Récemment, à Parme, le jour de la commémoration de la mort de Benito Mussolini, des militants du parti de Meloni ont chanté des chœurs fascistes ; une vidéo a tourné sur les réseaux qui a fait polémique, et le ministre de la Défense, issu de la Démocratie Chrétienne, a annoncé leur expulsion du parti, à « coups de pieds aux fesses ». Le journal Fanpage8, le seul journal de gauche, dont j’aurais dû parler tout à l’heure, avait infiltré la direction romaine de Fratelli d’Italia9 : la journaliste a pu documenter la culture fasciste qui règne au sein de cette formation politique, l’antisémitisme de leurs propos contre une sénatrice juive… Mais comme c’est devenu un parti de gouvernement et qu’ils n’ont pas besoin en ce moment de ces thèmes identitaires, ils peuvent bien expulser du parti les gens qui sont pris en flagrant délit.
- Ancienne prison psychiatrique que Potere al popolo a investie pour en faire un centre social en plein cœur de Naples. Voir la première partie de l’entretien
 ︎
︎ - Alleanza Verdi e Sinistra, L’Alliance des Verts et de la Gauche : coalition de partis politiques de gauche lancée en 2022 en tant que fédération de deux partis politiques, la Gauche italienne (SI) et l’Europe verte-Les Verts (EV).
 ︎
︎ - L’attaque de la caserne de Moncada a lieu le 26 juillet 1953 à Santiago de Cuba. Elle est menée par un petit groupe de révolutionnaires menés par Fidel Castro. C’est un échec, mais on la considère comme fondatrice de la révolution cubaine qui triomphera en 1959.
 ︎
︎ - Giuliano Granato, porte parole national de Potere al Popolo
 ︎
︎ - Les élections régionales de Campanie ont eu lieu les 23 et 24 novembre 2025
 ︎
︎ - Finalement, sur ce scrutin régional 2025, Potere al Popolo a doublé son résultat dans la région, passant de 1 % (en 2020) à plus de 2 %, avec un total de 43 055 votes sur 2 millions d’électeurs. 9 000 voix ont manqué pour obtenir un siège, mais la dynamique est éloquente : alors que tous les partis ont perdu des voix par rapport aux régionales 2020, Potere al Popolo a réussi à en gagner 11 000. Dans le détail, les résultats varient beaucoup localement : moins de 1% des suffrages dans les secteurs où le parti n’est pas implanté sous la forme de « case del popolo » (maisons du peuple) contre 4,18 % à Naples, avec des pics de 8 à 10 % dans les quartiers proches de l’Ex OPG. La stratégie de l’implantation territoriale fait donc ses preuves, et réclame d’être approfondie et déployée.
 ︎
︎ - https://spectremedia.org/minuit-dans-le-siecle/?playing=2412
 ︎
︎ - https://larevuedesmedias.ina.fr/italie-investigation-fanpage-giorgia-meloni
 ︎
︎ - Parti d’extrême droite dirigé par Giorgia Meloni
 ︎
︎
20.01.2026 à 17:12
Le “capital gaze”, stade suprême de la star
Texte intégral (5794 mots)
Sur le papier, Jay Kelly donnait très envie : marmite de références qui remuent toute une tradition de films “backstage” (de Minnelli à Altman), miroir tendu à la masculinité triomphante en même temps que théorie de la star vieillissante George Clooney. Le récit suit les affres existentielles d’un grand acteur qui, au cours d’un voyage dans l’espace et dans le temps, va se confronter aux griefs de ses proches. Mieux vaut tard que jamais : Jay Kelly comprend que sa carrière s’érigea sur un petit tas d’égoïsme masculin et en est tout chamboulé. La crise est suivie de près par l’inévitable rédemption de la figure de la star, à laquelle George Clooney prête sa figure sympathiquement vide.
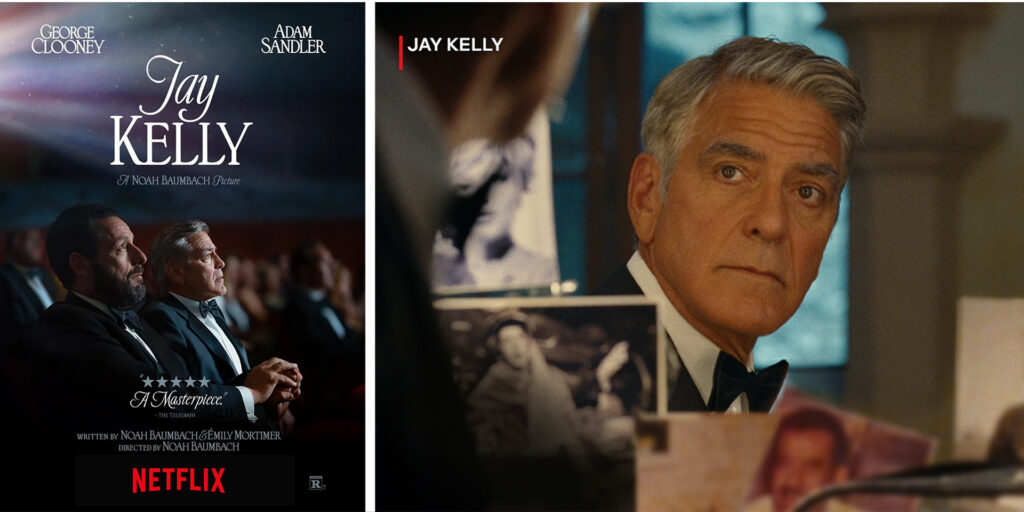
La meilleure partie se déroule à Los Angeles, dans la peinture atone d’ouvriers de luxe mi-blasés mi-sophistiqués qui font tourner la grande machine du divertissement hollywoodien. Puis, à la faveur d’une lubie scénaristique – Jay Kelly veut suivre sa fille en Europe -, le récit bascule et compulse les décors et les paysages. Les sympathiques obsessions (famille, couple, masculinité, et comment tout cela vieillit) de Baumbach sont invitées à se transformer en dispendieux grand spectacle, autre nom de cette peur du vide qui grippe tant de fictions contemporaines : il faut voir du paysage, faire défiler les pays, les personnages et les fils narratifs. Un crochet par Paris ne pourra, sur Netflix, que renvoyer au signifiant Emily in Paris. On pensera à La Mort aux trousses dans la longue séquence du train, et puis on échouera dans une Toscane faisant songer au cinéma de Sorrentino. Le grand train du post-cinéma fonce à toute allure, se remémore et retraverse sa splendeur passée : Woody Allen, Fellini, Altman, Hitchcock.

Ici, ce qui frappe, c’est que tout est simulation. Simulation d’auteurisme et de grand cinéma. On fait comme si tout n’était pas déjà zombifié. Comme si tout avait encore une âme, un cœur : l’auteur, mais aussi l’acteur. Baumbach s’époumone à conférer une profondeur, une chair, des souvenirs, des regrets, à un acteur sur qui, depuis toujours, les affects glissent comme sur du papier glacé.
Si Clooney a toujours été vide, il s’est aussi vidé une seconde fois, quelque part en 2006, lorsqu’il cède définitivement son image à la marque Nespresso qui allait, avec l’aide de la star, révolutionner “l’expérience” de la consommation de café. Impossible d’y échapper : à chaque nouveau (rare) film de Clooney, mon regard bute sur cette virtualité sans cesse présente : Clooney va-t-il boire du café ? Nous jeter un regard caméra en nous glissant “What else ?”. Dans Wolfs (Jon Watts, 2024), son film précédent, ça n’a pas manqué : dans la dernière séquence, il partageait une tasse face à Brad Pitt, ambassadeur Delonghi.

Cela arrive tout le temps, et de plus en plus, devant un film hollywoodien ; mais ici plus intensément qu’ailleurs : l’ouverture d’un espace fictionnel est parasitée par la possibilité du publicitaire. Certes, depuis qu’Hollywood existe, le star-system a toujours servi à écouler des stocks de camelote. Du temps du Hollywood classique, les contrats publicitaires faisaient partie intégrante des obligations des grandes vedettes sous contrat – leur image appartenait au studio, qui la marchandait. Puis, sans y être obligés par un contrat, Depardieu a (entre autres) vendu des pâtes Barilla, Delon des cigarettes, Joan Crawford du Pepsi… Réceptacle des désirs, la star de cinéma est censée, par ce désir même, en susciter plein d’autres à la chaîne, et parvenir à nous vendre à peu près n’importe quoi.

Malgré tout, une chose restait encore à peu près certaine : la hiérarchie des images. Publicité, tabloïds, magazines ne prétendaient jamais atteindre ou se mesurer aux images de cinéma, qui avaient leur propre grammaire, leur logique interne, une sacralité impossible à reproduire. C’était un monde clos, inatteignable, au-dessus des autres, et dont dépendaient toutes les autres images – profanes, marchandes, et donc forcément d’une nature appauvrie.
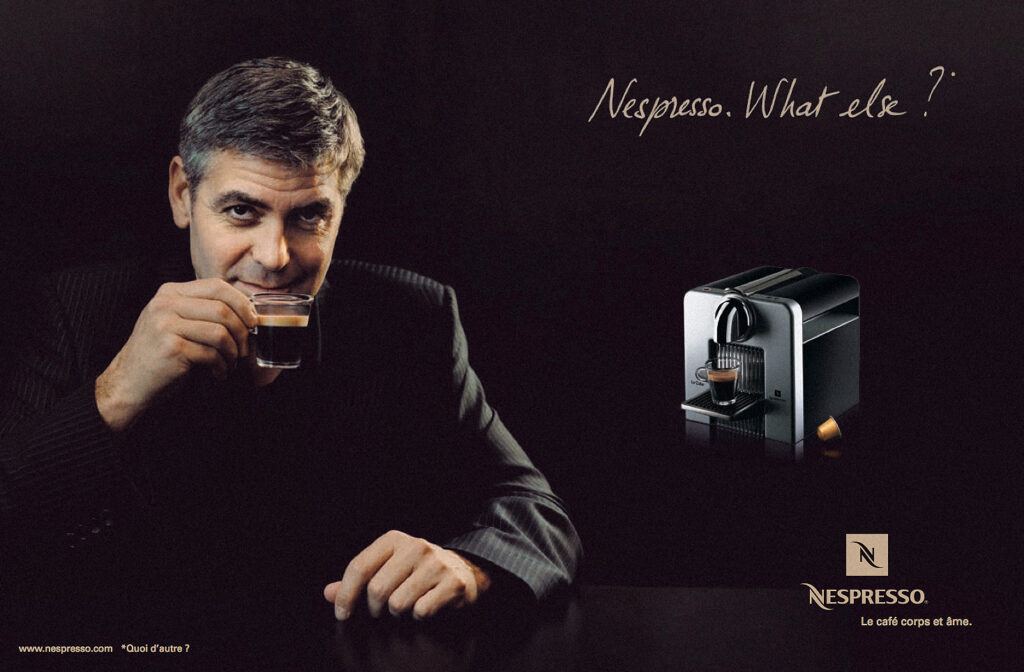
Clooney ou le cool publicitaire
A la Cinémathèque française se tenait une exposition Orson Welles qui vient tout juste de se terminer. Tout un coin était consacré aux publicités dans lesquelles s’est illustré l’acteur-cinéaste à la fin de sa carrière. Dans le merveilleux spot publicitaire pour le whisky japonais Nikka G&G (1979), Welles a l’air de se demander ce qu’il fout là, et offre avec une malice et un égarement non dissimulés le spectacle de sa déchéance – le voilà tombé dans un monde d’images dégradées, passant de Citizen Kane à ça.
Il ne cherche pas à masquer ce qu’il est en train de faire : vendre du whisky, repartir avec quelques bouteilles et empocher le chèque – pour ensuite financer son cinéma. Son attitude nous rappelle qu’en tant qu’artiste, il ne peut que dé-coïncider avec ce qu’il fait. Il y a d’un côté l’être humain ; de l’autre, le truc à vendre : et les deux n’ont pas encore tout à fait échangé leur salive. Sofia Coppola se souviendra de cette publicité pour Lost in Translation (2003) : l’histoire d’un acteur qui se rend au Japon pour honorer son contrat d’ambassadeur d’une marque de whisky.
La publicité met la star au travail : elle dit, « cet homme vend des cafés contre rémunération » ; elle l’humilie un peu et le replace au milieu de ce à quoi il semble s’arracher habituellement : les rapports de production, le fait de devoir gagner sa vie. Elle le démasque à l’endroit de ce qu’il est : un rouage de la grande circulation des marchandises.
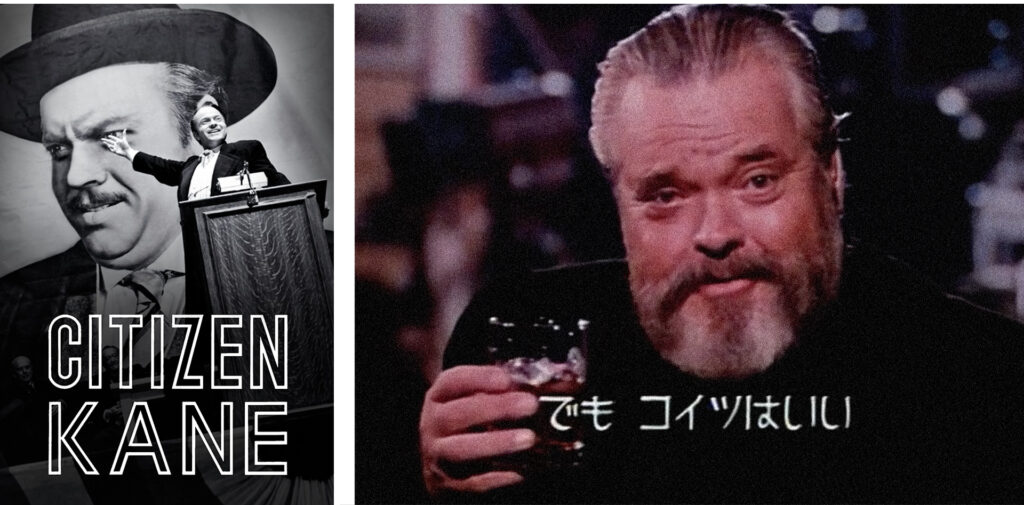
27 ans après, l’attitude de la vedette, la manière dont elle se comporte (et dont nous nous comportons ?) à l’égard de la marchandise à complètement changé. C’est comme si entre l’humain et la chose, un réservoir de jouissances illimitées était apparu.
Le partenariat entre Clooney et Nespresso est l’un des plus longs de l’histoire de la publicité : 20 ans déjà (2006) que Clooney vend des capsules. Tout le monde sentait, à l’époque, à quel point le premier spot publicitaire avait quelque chose de révolutionnaire : minimaliste, drôle, élégant, transformant, au passage, une expérience aussi quotidienne que boire du café en “instant premium”, une parenthèse de luxe parfaitement démocratique.
Qu’est-ce qui se jouait de révolutionnaire ici ? Dans sa grande décontraction dandy, Clooney fut le premier à donner le sentiment que livrer son image à la publicité contre de l’argent n’a rien de dégradant – c’est même très valorisant quand c’est bien fait. Son dandysme d’acteur (volé à Cary Grant puis régurgité en simulacre), cette manière de ne jamais se montrer au travail (même dans la série Urgences, c’était limite), ont définitivement fait fusionner l’acteur et la chose à vendre.
Je revisionne le tout premier spot publicitaire : dans une boutique Nespresso, deux femmes exultent en parlant du café qu’elles sont en train de boire, “brun, riche, intense”. Clooney débarque, glisse une capsule dans la machine (donnant ainsi le mode d’emploi d’un objet voué à coloniser nos cuisines et nos bureaux), et croit d’abord qu’on parle de lui, avant de comprendre, déçu mais bon perdant, que les éloges sont pour le breuvage. “Vous parlez bien de Nespresso, n’est-ce pas… mmmh… What Else ?”
Je me revois ado, hypnotisée par cette publicité sur laquelle on était toujours heureux de tomber : tout ici est smart, élève le téléspectateur dans le ciel des publicités d’art. Et puis, elle produit une analyse sémiologique assez fascinante : l’acteur confondu avec la marchandise. 20 ans après, cela se confirme : la seule présence de Clooney fait penser à une capsule Nespresso.
Léa Seydoux, Gerhard Richter et le sac Vuitton
L’étape d’après, c’est le luxe parti chasser sur les terres du cinéma, jusqu’à se confondre avec lui.
L’expansion sans limites du marché du luxe qui, depuis les années 80, s’est financiarisé et structuré comme une industrie partie à l’assaut des nouvelles classes fortunées et mondialisées – et fait rêver les autres, ceux qui n’ont que les moyens de se faire offrir un parfum ou un rouge à lèvres Chanel. Mais cette expansion ne serait rien sans une puissante force de frappe sur le terrain du symbolique. Pour ce faire, le luxe n’avait qu’à demander le secours de l’industrie du cinéma : son imaginaire, sa mémoire, ses corps, ses talents. Tout était déjà prêt à l’emploi, parfaitement codifié.
Ici encore, une petite histoire. J’étais allée voir Tromperie (2021) d’Arnaud Desplechin, en partie pour prendre des nouvelles du cinéaste, mais surtout pour Léa Seydoux : unique actrice française qui arrive à me faire me déplacer en salles. Bons comme mauvais films, la cinégénie d’une star a toujours lieu – c’est la promesse minimale qu’offre le cinéma.
La chose qui m’avait frappée, c’était que la sortie du film était précisément calée sur une nouvelle campagne publicitaire Louis Vuitton. Dans le métro comme sur la façade des kiosques à journaux, on pouvait contempler les très belles photos de l’actrice, “nouvelle femme Vuitton” depuis 2016, où le sac hors de prix devenait plus qu’un épiphénomène. L’objet siglé dialoguait en bonne intelligence avec d’autres œuvres d’art : il y avait Léa, splendide, mais aussi, juste derrière elle, des tableaux de Gerhard Richter ou de Joan Mitchell, à qui on n’avait rien demandé, pas même l’autorisation d’utiliser leurs œuvres dans une publicité – si les héritiers de Joan Mitchell ont demandé que l’on retire de la circulation les photos incriminées, Richter, lui, est resté silencieux. Il a aujourd’hui une grande rétrospective à la Fondation Vuitton.

Le luxe cannibale à l’assaut de la hiérarchie des images
Entre la publicité et le film, je sentais comme une unité esthétique qui avait été comme voulue : c’était le même monde, la même texture de l’image, le même somptueux défilé de vêtements. Qui était la bande-annonce de quoi ? Le sac vendait le film ou le film vendait le sac ? Qui était l’émanation de qui ? C’était le signe d’un changement déjà bien établi : la hiérarchie des images s’est effondrée pour devenir un même continuum spectaculaire : publicité, cinéma, séries, plateforme, paparazzades, reels, tout s’équivaut, qui plus est dans la grande marmite égalisatrice du numérique. Le cinéma ayant perdu sa primauté sur les autres images, il tombe de son piédestal et peut maintenant être vendu en morceaux, dépecé, contaminé.
Dans le même ordre d’idées, il y a cette pub Cartier (2023), parfaitement fascinante, réalisée par Guy Richie : l’acteur Rami Malek se balade sur le Pont des arts et croise une Catherine Deneuve démultipliée en avatars rajeunis qui campent les grands rôles de sa carrière. Ici, la technique du deepfake n’a rien d’une résurrection : elle est spectrale, funèbre. On ressuscite toute une mémoire cinématographique (qui, par essence, appartient à tout le monde donc à personne), mais pour s’accaparer et privatiser toute sa valeur symbolique – et donc, la détruire.

C’est presque devenu un lieu commun critique : le Dune (2021, 2024) de Denis Villeneuve nous avait tous fait penser à une publicité pour parfums : Dior, Hermès, Thierry Mugler, peu importe. Emmanuelle (2024) d’Audrey Diwan était lui aussi éclairé, lustré comme un fastueux spot publicitaire nimbé d’exotisme. J’oublie des dizaines d’autres exemples, car la question n’est pas de savoir ce qu’on nous vend exactement, mais plutôt cette sensation permanente que le plan vend quelque chose, profite de notre hypnose de spectateurs pour couler du subliminal marchand dans nos cerveaux. Et même quand on délire un placement de produits, l’effet est le même : comme un rappel que le capitalisme est voué à contaminer toutes nos expériences, nous rattrape jusqu’au fin fond du désert d’une fiction SF.
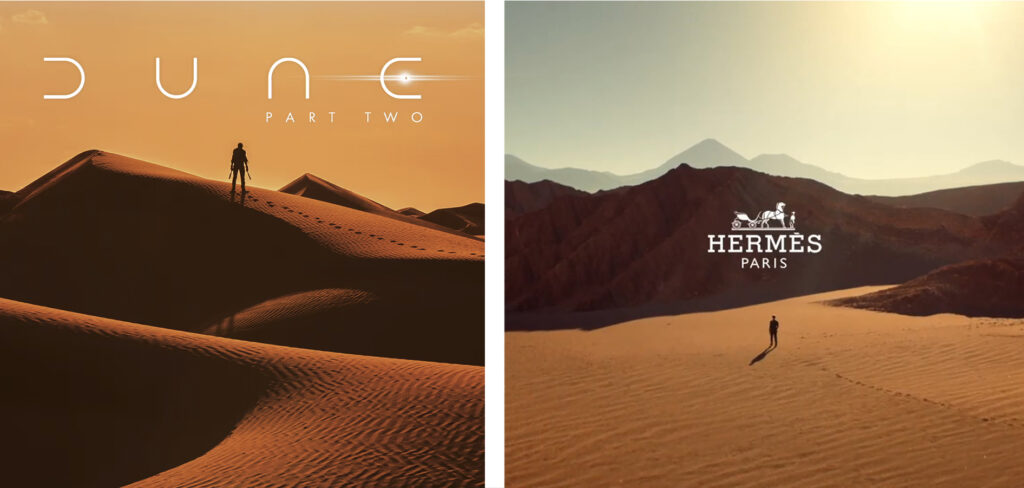

Certes, clips et publicités ont été pour beaucoup de grands cinéastes un très prolifique terrain de jeu : Michel Gondry, Jonathan Glazer, David Fincher, etc. Mais la génération d’après (Sofia Coppola, Luca Guadagnino, Wes Anderson…) a contribué à réduire le travail de mise en scène à un pur jeu de direction artistique – pour ensuite vendre leur travail de DA au luxe. On peut le formuler autrement : par pièces détachées, ils ont vendu l’auteurisme au luxe. Car c’est sur le terrain de l’auteurisme international (et zombie) que le luxe est devenu cinématographique ; et le cinéma, une luxueuse industrie.

Je passe très vite sur la question, déjà bien documentée, de la perversion du mécénat culturel : Chanel finance des institutions, des festivals, des revues, Saint-Laurent produit des cinéastes et maintenant des longs-métrages (le dernier Jarmusch). Tout un petit monde qui, par ailleurs, n’a pas d’autres choix que d’aller chercher des fonds privés : après Almodovar et Gaspar Noé, la cruelle ironie d’apercevoir le logo “Saint Laurent” avant le film posthume de Godard (Film annonce du film qui n’existera jamais : “Drôles de guerres”, 2023).
Les festivals, eux, valent moins comme lieux de cinéphilie que comme tapis rouges où dégueuler les dernières collections des grands créateurs. Les égéries Chanel posant devant le logo “Cahiers du cinéma” lors de la soirée de remise de prix André Bazin. On s’empare de la marque « Cahiers », mais on dissimule les seules choses censées la représenter : les critiques, leurs corps profanes d’intellos précaires et leurs textes. C’est là le nerf de la guerre : tout nom à forte charge symbolique est condamné à se transformer en marque – les « Cahiers du cinéma » est une marque, au même titre que Chanel. C’est sur le terrain d’une équivalence factice que le grand échange symbolique est permis.

Et c’est sur le territoire du luxe qu’il n’y a, enfin, plus aucun scrupule à danser avec le diable. Puisque l’industrie a travaillé à une synonymie désormais effective : le luxe, c’est l’art ; et l’art, c’est le luxe.
Du male gaze au capital gaze
Dans cette grande marmite d’indistinction entre art et luxe, les corps des acteurs sont au cœur de la transaction : les voici autant attirés par le fait d’être ambassadeurs Dior ou Courrèges que par celui de faire un film avec Quentin Dupieux ou Arnaud Desplechin.
Ce sont ces lignées d’acteurs et d’actrices qui se montrent à des défilés en acceptant d’être toutes habillés par la même marque. Moi qui pensais que le travail de l’acteur consistait, entre autres, à cultiver très subtilement cette petite différence qui nous distingue de nos rivaux, qui nous rend, dans l’ordre de l’imaginaire, parfaitement irremplaçable. Le vêtement, jusqu’ici, servait à cela : il devenait le signe irréductible de la star.
Les voilà qui assument pleinement leur caractère profondément interchangeable. Corps alignés, parfaitement semblables, sur une chaîne de montage, poupées habillées et domestiquées d’une toute nouvelle manière, bien plus agréable et insidieuse : par le vêtement, les stylistes, les agents, les réalisateurs et photographes de publicité, les directeurs artistiques. Ça contamine tout le reste : une égérie Dior fait attention à ce qu’elle dit, et ne dit plus rien.
Le capital gaze, une aliénation encore trop jouissive
Les stars amplifient et transforment en beau spectacle l’endroit de notre propre aliénation – mais par leurs privilèges, elles ont les moyens d’en jouir réellement, jusqu’au bout, sans contrepartie. Il faut donc identifier ce qu’elles nous désignent.
De mon poste, je vois les choses ainsi : MeToo a légitimement désigné l’exploitation et la fétichisation sexuelles des corps comme le paradigme aliénant à abattre. Et si l’industrie a si rapidement (non sans quelques hypocrisies et effets de surface) pris acte de MeToo, c’est que, de toute façon, et depuis longtemps, elle était passée à l’étape suivante : au regard prédateur du capital (le capital gaze). Une menace bien plus diffuse, impalpable, car dépourvue de centralité.
La puissance du cocktail luxe/cinéma (qui équivaut à l’intensification de la logique marchande à l’œuvre depuis toujours dans le cinéma) se mesure à ce qu’il produit, à tous les niveaux, une telle jouissance, une telle force d’attraction et une telle adhésion qu’il est difficile de la sentir comme aliénation. De sentir l’épuisement irréversible (des corps, des femmes, de l’imaginaire, des ressources, des affects) qu’il dissimule.
Barbie (2023) est, à ce titre, le film-pivot, la grand-messe qui annonçait cette nouvelle ère : dissolution (purement) symbolique du patriarcat au profit du capitalisme, où il est affirmé vaillamment que le regard masculin nous gênera toujours plus qu’une centaine de placements de produits et qu’une grande orgie de plastique. C’est un film assez inépuisable à analyser, et sur lequel je reviens souvent, parce qu’il énonce une nouvelle érotique pour l’industrie du cinéma : désormais, les corps cultivent une intimité, non plus avec un autre corps, mais avec la marchandise. Plus la star est étouffée d’objets, plus elle est en expansion, jouit d’elle-même : c’est le principe de la mode. Et c’est ce principe qui nous est édicté, d’abord aux femmes : recouvrez d’objets votre haine de vous-même.
Le devenir-plastique des stars
La star rêve d’objets, de vêtements dispendieux, de parfums – manière de rêver d’elle-même à travers les objets. Manière aussi de dire : tiens plèbe, achète ce sac que j’ai touché. Elle exalte ce nouvel érotisme de la marchandise. Et, en rêvant autant d’objets, elle finit par en devenir un, par acquérir les propriétés de la marchandise. Visuellement, esthétiquement, tout le monde remarquera que les célébrités n’ont jamais été si proches d’une consistance plastique.

Après le cool publicitaire, après le lubrifiant du luxe, il reste donc cette dernière étape : vouloir acquérir les propriétés de la marchandise, et finir par y parvenir – comme dans un rêve warholien. La “réification” du corps des femmes sous le “male gaze” n’est rien comparée à celle qu’est en train d’accomplir le capital gaze. Je suis frappée, aujourd’hui, par la texture des peaux, les coupes des vêtements, l’absence cruelle de défauts, la disparition des pores et des cernes, la perfection inhumaine des silhouettes et des visages – un monde propre, haute définition, aux contours effroyablement précis. Nos yeux, désormais impitoyables, s’abreuvent à un drôle d’érotisme de la perfection technique.
Le grand décharnement du monde opéré par le numérique profite d’abord aux corps glorieux des stars, autorisés à excéder ce qui est notre condition inaliénable : la chair. La star construit ses images contre notre monde informe, épuisé, illisible. Tandis que nous plongeons tous vers un grand burn-out collectif (politique, social), elle continue son ascension, creusant son écart esthétique avec le commun des mortels. La star, c’est une chose perpétuellement neuve dans un monde fatigué.
Les techniques de l’image numérique (adossées à toute une discipline physique, médicale et esthétique), en lustrant les corps, en supprimant tout ce qui s’apparente à un défaut, en rendant la réalité de l’écran parfaitement irréelle et lumineuse, rapprochent inéluctablement les corps du monde inanimé. Comme le sac, comme la veste Chanel (tout aussi retouchés que les visages), c’est le corps qui, à son tour, donne l’impression d’être fraîchement sorti de l’emballage. Le flambant neuf, la nouveauté, deviennent – je le sens au fond de mon œil – des catégories qu’on peut désormais appliquer au corps.

Dans les films, la star est reconnaissable par le fait qu’elle est le corps le plus retouché : elle se distingue en faisant l’objet d’un usage plus zélé (plus long et coûteux) de la digital beauty. Dans Jay Kelly, George Clooney, par sa seule apparence, se distingue des autres acteurs : costumes impeccablement taillés, dents blanches fluo, bronzage impeccable, visage imperceptiblement lissé – face à sa richesse, son vieillissement apparaît comme un épiphénomène résorbable.
Je me faisais cette réflexion l’autre jour, d’une évidence presque absurde : l’acteur de cinéma est le seul technicien du cinéma qui, tout en étant présent à l’écran (contrairement aux autres), ne montre jamais qu’il est au travail, en train de gagner sa vie – de fait, arrivé à un certain degré de notoriété, il n’est plus réellement en train de la gagner, il fait seulement fructifier la marque qu’il représente. Pour autant, l’acteur travaille devant nous sans pour autant donner le sentiment qu’il est au travail.
Les stars fascinent justement pour ça : parce qu’elles formulent un rêve d’existence délestée de la lourdeur du monde social. Une vie sans travail (au sens de labeur), ou d’un effort tellement valorisé, payé et récompensé qu’il en vaut largement la peine. Et malgré cette vie hors-monde, elles parviennent à agréger à elles, et comme sans effort, ce que nous voulons : tous les désirs et tous les beaux objets du monde.
Le capital gaze, ses valeurs et les techniques qui le sous-tendent, actualise et arme ce monde ensorcelé de la star pour en faire le tout dernier des (hors-)mondes possibles, la dernière chose à désirer.
De grâce : qu’on ne veuille plus rien nous vendre
Ce serait quoi alors, une star qui reste une star, mais travaille à contourner le capital gaze ?

Je repense souvent à cette phrase de Frances McDormand, rare actrice hollywoodienne qui refuse de prêter son image à une marque, et rare actrice à avoir fait de son vieillissement une posture politique. Preuve que, dans les thèmes abordés ici, tout se tient finalement : vieillir, ce serait refuser de vendre quoi que ce soit, à commencer par soi-même.
Dans un entretien donc, elle revenait sur son grand silence médiatique qui a suivi son Oscar pour Fargo (1996) : « J’ai fourni un effort très conscient pour ne pas faire de presse et de publicité pendant dix ans, alors que tout le monde me disait que cette période était très dangereuse dans la carrière d’une actrice, mais cela a porté ses fruits précisément pour les raisons qui motivaient cette décision. Cela m’a redonné du mystère, et j’ai pu emmener le public dans un endroit où quelqu’un qui vend des montres, des parfums et des magazines ne le pouvait pas. »
Ce mystère dont parle l’actrice, c’est l’endroit où nous voulons aller : l’endroit où l’on ne peut plus rien nous vendre.
15.01.2026 à 19:18
Potere al popolo : la gauche qui monte (part. 1)
Texte intégral (6841 mots)
Judith Bernard : La naissance de Potere al popolo, c’est d’abord un livre, publié en 2014, et puis à partir de 2015, c’est l’occupation de cette prison psychiatrique où nous sommes. Est ce que tu peux nous dire quel rôle joue ce lieu dans votre pratique et dans votre théorie politique ?
Salvatore Prinzi : Pour répondre à cette question, il faut remonter à la crise de 2008 : on a vu qu’une grande crise s’annonçait et que personne, du point de vue de la représentation politique, n’était capable de répondre aux besoins des classes populaires. Ça coïncide avec les élections de mai 2008, que Berlusconi gagne, en même temps que s’effondre ce qui restait du communisme. Nous, nous venons plutôt d’une idée du communisme révolutionnaire, des mouvements sociaux italiens. L’idée, c’était que face à ce gouvernement de droite et à cette crise économique, il y aurait la possibilité de créer de grandes manifestations, et au sein de ces grandes manifestations, de faire naître quelque chose de nouveau.
C’était un peu ingénu, mais grosso modo, l’idée, c’était ça. Donc on passe toute la période de 2008 à 2011 à s’organiser, à créer différents mouvements ; il y un mouvement étudiant qui est très important, et donc on fait beaucoup, beaucoup de mobilisations – un peu comme en France, et même plus qu’en France dans la même période. Sauf que ce qui nous manque, c’est une capacité de représentation politique, et la possibilité de transformer tout ça dans une organisation. Il y a une tentative de récupération politique du mouvement par la gauche réformiste, pour ramener sa composante la moins radicale dans le centre gauche. Cette tentative est contestée au sein du mouvement, ce qui génère de grands conflits internes, entre la partie la plus modérée, la partie « negriste » qui allait vers le centre gauche, et la composante plus antagoniste, où nous étions, nous, avec les autonomes et d’autres groupes…
J.B : Tu dis « nous » : à ce moment-là, vous vous situiez comme une organisation constituée ?
S.P : Non, pas du tout. On était issus de collectifs de base qui collaboraient beaucoup entre eux ; nous, on avait un autre centre social à l’époque, dans la banlieue de Naples, on avait créé un collectif à l’université en 2008 – qui existe toujours et qui a d’ailleurs été récemment infiltré par la police. Il y avait aussi des autonomes qui venaient du negrisme, mais plutôt du côté des expériences radicales des années 70… Il y avait toute une galaxie en fait. Et nous, on tentait toujours de fédérer cette galaxie pour empêcher que le mouvement soit récupéré par le centre gauche. Il y avait des conflits, des débats théoriques : la composante la plus à droite du mouvement postulait par exemple que les « travailleurs » n’existaient plus, que donc il fallait créer des mouvements d’opinion, ils parlaient beaucoup alors du « capitalisme cognitif »…
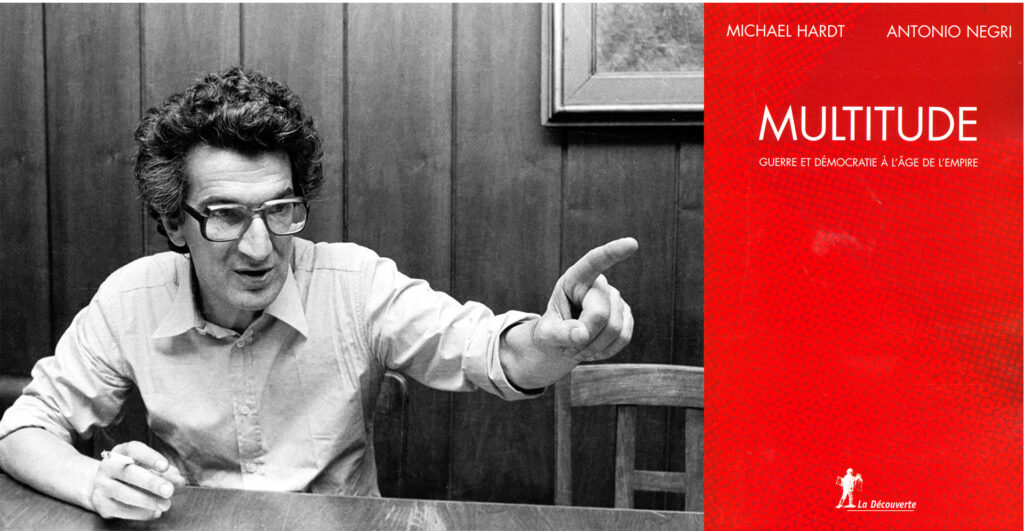
Il a fallu batailler, au côté des syndicats de base, et cette lutte a été assez forte pour empêcher la récupération du mouvement. Il y a eu deux manifestations qui ont signé l’impossibilité pour le centre gauche de récupérer ce mouvement : c’est le 14 décembre 2010, manifestation de l’université à Rome, où les réformistes ont tenté de mettre un terme à la manifestation avec des prises de parole des grandes figures du centre gauche, sauf que les étudiants ont débordé la place, et marché vers le parlement pour chasser Berlusconi, ce qui a donné lieu à des conflits énormes. Et un deuxième épisode, à Rome toujours, le 15 octobre 2011, où a lieu une bagarre énorme avec la police lors d’une véritable journée de révolte. Le centre gauche a fini par conclure que ces gens là étaient vraiment…
J.B : …Irrécupérables ?
S.P : Irrécupérables, oui. Mais j’ajouterai que toute notre histoire, c’est aussi l’histoire d’une auto-critique dans le sens où nous on était assez forts, en tant que mouvement social, pour empêcher la récupération par une gauche modérée historique, mais en même temps, on n’était pas capables de produire une subjectivation politique : on était dans la phase de destruction.
Et par ailleurs, il y avait le Mouvement Cinq étoiles qui avait commencé à grandir, et qui pouvait bénéficier du capital médiatique de Beppe Grillo, du capital économique de Casallegio1 et d’un discours très « antipolitique », qui disait que « le problème, c’est la politique, les politiciens… », idée assez présente dans le sens commun italien depuis toujours. C’est Cinq étoiles, au final, qui a profité de la crise. À un moment donné, les gens se sont dit : « Avec ces manifs, on n’arrive à rien. Il faut tenter la voie électorale avec Cinq étoiles parce que s’ils prennent le pouvoir, ils vont changer le système ». Donc en février 2013, aux élections italiennes, le Mouvement Cinq étoiles remporte 25 % des suffrages, et ça paralyse tout jusqu’en 2018 parce que les gens se disent qu’il faut attendre que ces gens-là arrivent au gouvernement.
Or, comme vous le savez, quand ils arrivent au gouvernement, ils trahissent tout ce qu’ils avaient promis – ce qui génère une deuxième déception. Il y a beaucoup de gens des classes populaires qui ont eu une première déception dans les années 90 avec le centre gauche, les anciens communistes qui ont rallié la doctrine libérale, et une deuxième déception, beaucoup plus courte et rapide, avec le mouvement Cinq étoiles. Le jeune parti « antipolitique » qui devait changer tout, et qui est finalement devenu comme les autres. C’est ça qui explique en partie l’abstention énorme qu’on a aujourd’hui en Italie.
De notre côté, on s’est mobilisé, et à un moment donné, on s’est trouvé avec cette situation politique bloquée. Il n’y avait plus de grands mouvements de masse : les mouvements rentraient dans des petites niches un peu identitaires, avec des petits soubresauts, de temps en temps, mais qui généraient toujours les mêmes débats – « Est-ce que les travailleurs existent ou pas ? ». C’est le moment où on a écrit ce livre que tu mentionnais2, qui consistait dans une enquête sur la classe travailleuse en Italie et les classes populaires en général. On y fait une analyse du système italien : une analyse quantitative d’un point de vue statistique et une analyse qualitative avec des entretiens, articulés à la question des luttes. C’est un petit livre de 230 pages qui démontre que la classe ouvrière, dans un sens certes beaucoup plus ouvert que précédemment, existe toujours, qu’elle mène même des luttes, mais des luttes de secteur, ou très localisées. Donc il faut commencer à fédérer tout ça. Ce moment de reflux politique, c’est aussi un moment où les gens se posent des questions et nous sollicitent pour venir parler : on va chez les negristes de droite, chez les autonomes, les associations de base, les syndicats un peu partout…
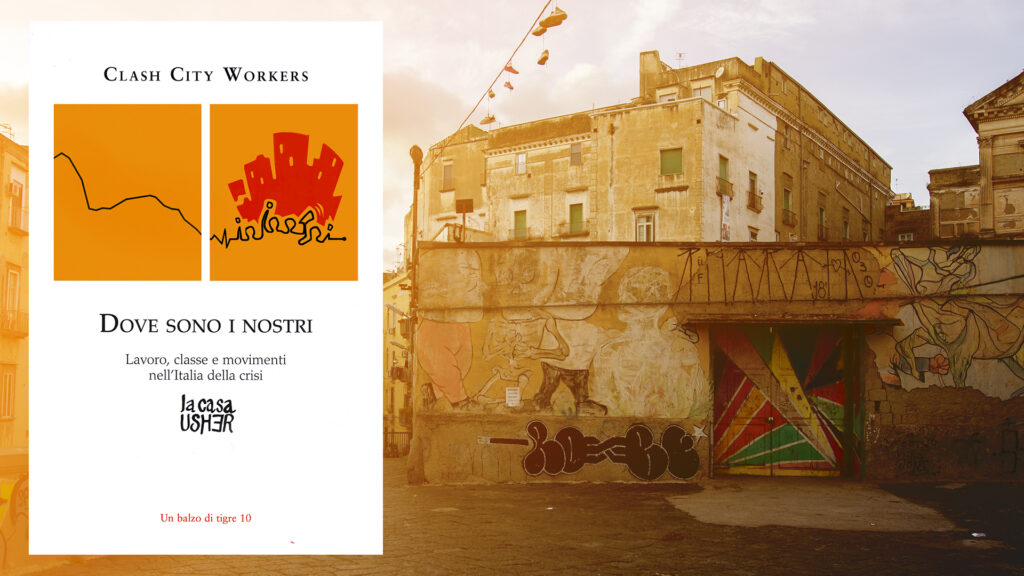
JB : Ils vous invitent à venir discuter sur la base de ce livre ?
S.P. Oui, on discute du livre : on a fait au total 83 présentations. J’ai fait 50 de ces 83 présentations et donc ça nous a permis de construire un premier réseau. Et pendant ce temps, au cours de 2014, il y a la première percée de Podemos, il y a évidemment Syriza qui monte, qui finalement gagne en janvier 2015 : pour nous à ce moment-là, toujours de manière un peu ingénue, la voie électorale devient une évidence. Mais pour les autres, ce n’est pas le cas : il y avait une résistance très identitaire par rapport aux élections de la part des mouvements sociaux du mouvement révolutionnaire. Et en plus, l’espace était déjà occupé par le mouvement Cinq étoiles. Donc nous à la fin de 2014, on est allé presque partout, on connaît beaucoup de gens, on est respectés parce qu’on a une « street credibility » pour toutes les luttes qu’on a faites, et en même temps un niveau théorique suffisant. Il nous semble alors qu’il faut créer une organisation qui joue un peu avec le populisme de gauche, mais qui reste très liée à l’histoire de la gauche, aux mouvements sociaux, et on a fait le calcul que le mouvement Cinq étoiles allait rater son opportunité parce que c’était la base même de son projet, d’un point de vue structurel, qui ne pouvait pas fonctionner.
On fait cette proposition à des gens qui, après, nous ont donné raison et sont entrés dans Potere al popolo, mais qui à ce moment-là ne faisaient pas confiance au principe des élections. Et tout ça, c’était janvier 2015, tout de suite après la victoire de Syriza : nous, on a dit : « Il se passe quelque chose au niveau européen. Il faut profiter de ça. » Beaucoup de gens nous donnaient raison, mais on n’a pas réussi à les convaincre de nous rejoindre. Alors on s’est dit qu’il fallait montrer que cette nouvelle approche, qui continue une histoire mais qui essaie d’être un peu plus dynamique, un peu plus « communicative », consistant à mettre au centre les besoins des gens, reposant sur l’écoute et l’aide directe, était la nouvelle forme de construction du parti. On s’est dit qu’il fallait l’expérimenter, parce qu’on ne peut pas convaincre les gens en parlant : il faut démontrer par la pratique. Donc on occupe l’ex OPG3 avec, dès l’origine, au cœur du projet, un but politique de construction de l’organisation. On y entre le 2 mars 2015, avec déjà pas mal d’expérience d’occupations à notre actif – moi j’ai commencé à treize ans ! – et on ne voulait surtout pas faire une occupation à la mode « politique », pour les jeunes, pour les antagonistes, pour les gens habillés en noir avec un imaginaire Che Guevara… On voulait faire quelque chose de populaire : « populaire », dans une ville comme Naples, ça signifie par exemple utiliser des mots en napolitain, parler d’une manière très compréhensible, donc pas trop idéologique, partir des besoins concrets des gens et surtout organiser les gens.
L’idée, c’était d’occuper un endroit assez grand (ici c’est 9000 mètres carrés, c’est énorme !) pour faire la démonstration que si l’État, surtout au Sud, n’est pas capable de répondre aux besoins des gens, il ne faut pas attendre d’être au pouvoir : il ne faut pas déléguer, parce que de toute façon la classe politique ne va pas résoudre les problèmes. Il faut être concret et commencer à organiser les gens. De cette manière, on pouvait aussi démontrer que le Mouvement Cinq étoiles ne servait à rien : c’était des gens dans les institutions, qui criaient beaucoup, mais qui n’étaient pas capables de résoudre les problèmes des gens.

L’idée pour nous était de commencer avec cette activité qu’on appelle le « mutualisme conflictuel ». C’est une idée qui comprend plusieurs niveaux : premier niveau, dans un moment où il n’y avait une grande politisation de la société : partir du concret, du quartier, par exemple d’une lutte sur la santé publique, qui permet de motiver les gens. Deuxièmement : gagner des petites choses. Il ne fallait surtout pas continuer avec ce discours de défaite de la gauche : « On a toujours perdu, on n’a pas réussi », d’autant plus déprimant qu’il n’y a jamais eu d’autocritique radicale pour se mettre dans la position de gagner.
Nous, on a fait notre autocritique, maintenant, c’est le moment de commencer à gagner. De toutes petites choses : par exemple les escaliers que vous voyez dehors, c’était fermé parce qu’ils avaient abandonné cet endroit et cessé d’entretenir l’escalier. Les arbres et la nature avaient envahi l’endroit, alors que l’escalier est très utile, il permet de gagner 7 minutes à pied pour rejoindre le centre du quartier, c’est essentiel, surtout pour les femmes d’un certain âge, qui portent les courses avec des sacs très lourds. Pour récupérer la rue, il ne fallait pas demander aux services publics de s’activer : de toute façon ça ne servait à rien. Nous, on s’est mis avec les gens du quartier, on a récupéré la rue et les gens étaient très contents : ça, c’est une petite victoire. Donc on commence à faire des petites luttes qui donnent l’impression qu’on peut gagner, on peut changer les choses, et ça va peu à peu motiver les gens. Pour nous, c’est aussi une manière de faire une enquête sociale concrète et de connaître mieux notre sujet. Et troisième niveau, c’était justement de développer la capacité des gens à résoudre eux-mêmes les problèmes.
Dans notre analyse des problèmes du socialisme réel, on identifiait qu’il activait un mécanisme qui descendait du haut vers le bas : il n’y avait pas de mécanisme de retour, pas de feed back, mais surtout il n’y avait pas l’activation des gens. C’est la chose bizarre du communisme historique : soit du fait de la peur, soit du fait que ce soit difficile, soit du fait de la pression des impérialismes de l’extérieur, la direction du parti a essayé de décourager la participation des gens, sauf exceptionnellement pour les activer dans des journées très précises…
J.B : Pour aller voter ?
S.P : Pour aller voter, mais aussi surtout, si je pense à l’Union soviétique, pour les journées « de la défense », « de la mémoire »… Mais en général, c’était des sociétés très peu politisées, ce qui est un paradoxe ! Notre modèle à nous, c’est assez gramscien : c’est un socialisme qui naît du bas, qui mène une activité pédagogique réciproque entre la direction politique qui doit apprendre du « bas » et le « bas » qui doit apprendre du parti les outils de la politique organisée.
Pour vous donner un exemple concret, on a mené la lutte sur l’escalier, mais on a fait aussi une lutte pour mettre un feu tricolore sur la rue parce qu’il y avait eu plusieurs accidents, des gens renversés par les voitures qui passent, et une femme de 63 ans qui en est morte. C’était une femme de l’église, qui organisait le catéchisme, très connue dans le quartier. Donc nous, on est allés parler avec les prêtres : on se connaissait, ils savaient qu’on faisait de « bonnes choses », qu’il n’y avait pas de drogue – toutes ces choses que la rhétorique de droite pourrait associer à notre centre, qui ne fonctionnent pas pour nous parce que nous, on fait du bricolage, on fait jouer gamins, on fait des présentations de livres… Avec cette bonne renommée, on va dire à ce prêtre qu’on va se mobiliser pour mettre un feu tricolore sur la rue, et le prêtre nous invite à venir parler à l’église. On y va très ouvertement, avec un tract, on fait une collecte de signatures – des choses que normalement la gauche a longtemps faites, qui ont peut-être été un peu oubliées : c’est le travail sur le terrain. Mais surtout l’idée, c’est que ce n’est pas nous qui allons faire la rencontre avec les interlocuteurs de la mairie ; bien sûr, on fait profiter de notre expérience, mais on amène tous les gens du quartier. Et quand la mairie ne veut pas nous recevoir, on se sert des tactiques des mouvements antagonistes, on entre dans les bureaux et on les occupe. Donc il y a une communication entre la force populaire et les techniques qu’on a apprises dans les mouvements sociaux : il y a cette jonction entre des tactiques d’agitation très radicales et une justification liée aux classes populaires, ce qui marche très bien. On a aussi fait nous-mêmes un feu…
J.B : Un feu tricolore ?
S.P : Oui, un faux feu, qu’on a fabriqué ; c’était un mode d’action un peu ironique qui affirmait « vous n’y arrivez pas, nous on le construit » ! Ce sont les gamins du quartier qui l’ont construit, et finalement on a gagné la bataille, on a obtenu un vrai feu, ce qui a fait que la mortalité sur cette rue a beaucoup diminué. Ainsi les gens ont pu constater que nous, on a fait ce que tous les conseillers de la municipalité n’ont pas su faire pendant longtemps, arguant toujours qu’il n’y avait pas l’argent pour le faire.
Bref, tous ces phénomènes d’expérimentation et ces luttes font qu’au niveau national, on commence à parler de l’ex OPG. Les gens sont très impressionnés par le fait que nous, qui étions vus comme les communistes durs, purs, marxistes, léninistes, maoïstes, on avait une capacité, à nouveau, à parler à des gens d’une manière beaucoup plus large, mais sans renier notre radicalité. Normalement, il y a toujours l’équation : « Soit tu dis les choses nettes et claires et tu parles avec très peu des gens, soit tu dis des choses un peu plus modérées, et tu peux parler avec des couches plus larges ». Nous on parlait simple – c’était un peu le populisme de gauche de cette période – mais on essayait de mener plus concrètement la lutte et de faire une expérimentation sur un territoire.
J.B : Mais du coup, du point de vue de la population locale, ce centre a pu être vécu comme un « prestataire de services » : ça procure des services, des aides, ça agit sur le territoire localement pour mettre un feu tricolore, etc. Mais comment se fait l’articulation avec le projet à visée révolutionnaire, la stratégie politique ? Comment on fait rentrer la population locale dans une vision plus large ?
S.P : Tout à fait…
J.B : Et aussi, comment vous vous défendez d’être perçu comme un organisme de charité ? Est-ce qu’il n’y a pas un peu ce risque-là, d’être vu comme un pourvoyeur d’actes de charité ?
S.P : C’est une très bonne question, et on n’a pas trouvé la solution magique. C’était une critique qu’on nous faisait souvent, émanant des autres groupuscules d’extrême gauche qui nous disaient : « Vous avez bien changé, maintenant vous faites de la charité rouge ». Et nous, on a bien montré que, historiquement, c’était ce que faisait le premier Parti socialiste en Italie quand il était révolutionnaire, que c’était ce que faisaient les communistes dans les Maisons du peuple… Nous on reprend tout l’imaginaire des Maisons du peuple qui s’étaient développées en Italie, et qui ont été abandonnées, et puis on renvoie surtout au Black Panther Party : ça c’est une référence majeure. C’est pour ça que le parti s’appelle Potere al popolo, parce que « Power to the People », c’était le slogan du Black Panther Party. Donc c’est une forme de maoïsme, mais moins idéologique, comme dans le BPP où ils avaient mis en œuvre le programme des petit-déjeûners pour les gamins du quartier ; notre idée c’était vraiment d’organiser les gens pour répondre aux problèmes, et montrer l’incurie de l’Etat.
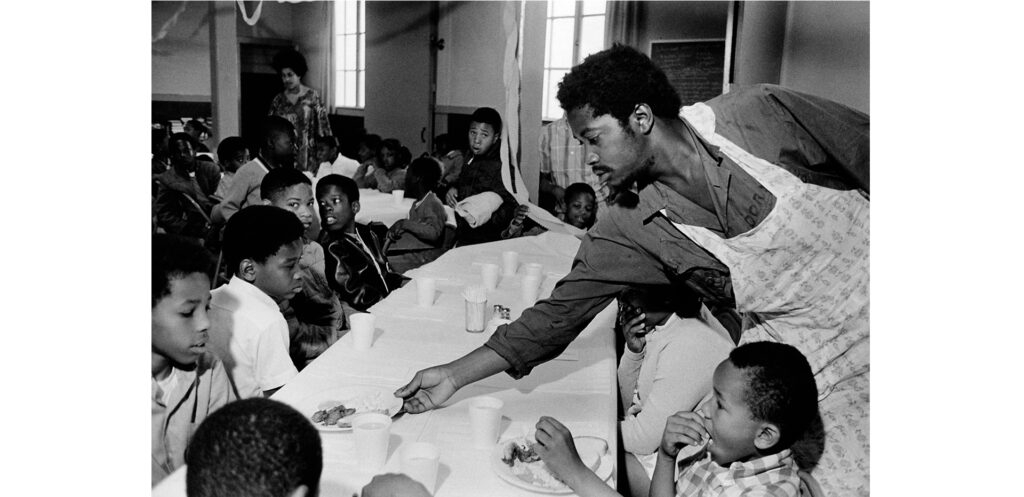
Le problème c’est qu’il y a des gens qui viennent juste pour profiter d’un service gratuit : c’est un risque, il faut le reconnaître. Tous les gens qui viennent faire de la gym – parce qu’on a de la gym, on a du théâtre, on a des choses plus détachées de la politique qui sont proposées ici – tous ces gens ne restent pas. Ce qu’on a remarqué, c’est que la manière de faire rester les gens, c’est de faire une activité qui débouche sur un aspect politique. Par exemple, on commence le périscolaire pour les enfants du quartier, parce qu’il y a un taux d’abandon scolaire énorme à Naples, surtout dans les quartiers populaires comme ici. Donc nous, on essaie de rattraper ces jeunes en leur proposant des petits cours après l’école, et ça fonctionne très bien. On pourrait s’arrêter là, comme beaucoup d’associations, catholiques ou autres, qui font ça. Mais nous, on dit : « on veut connaître votre contexte familial, on veut parler avec vos mères ». Donc on organise des rencontres avec les mères, pour les interroger sur les problèmes qu’elles rencontrent. L’enquête permet de comprendre que ces familles aux très faibles revenus ont le droit d’avoir les manuels scolaires gratuitement, donc ne les achètent pas, mais que les livres gratuits, du fait de retards et de négligences bureaucratiques, n’arrivent pas en septembre à l’école, mais en janvier de l’année suivante ! Les enfants n’ont donc pas de manuels pendant 3 à 4 mois, ils perçoivent une différence avec les autres qui les ont, ils utilisent aussi cette situation comme excuse pour ne pas travailler, et tout ça, ça contribue à déterminer les difficultés scolaires des enfants issus des classes populaires.
Donc là, on répond aux mères que c’est un droit, et qu’elles ont le droit de le faire respecter. Ces gens nous répondaient qu’ils ne savaient pas par où commencer, qu’ils ne savaient même pas à qui il faut demander ça. Et ça, nous on le savait, parce qu’on peut lire les règlements. Donc on a regroupé les mères, on est allés voir l’autorité scolaire napolitaine pour avoir les livres, et ça a fonctionné ! Parce que ces autorités ont peur que soit diffusée publiquement une mauvaise image de leur travail : nous on a la maîtrise des réseaux sociaux, on connaît les journalistes, parce qu’ils ont couvert les manifestations et qu’on a gardé les contacts… Et magiquement, les livres sont arrivés. Là, les gens ont dit : « ça sert de s’organiser sous la forme d’un collectif de base ».
Donc quand on a la force de mener ces petites batailles, les gens cessent de percevoir qu’ils sont dans une association qui procure « juste » de bons services. Quand tu laisses la chose un peu plus libre, par exemple pour la gym, eh bien les gens viennent juste faire de la gym gratuitement. Ce qu’on a mis en place pour limiter ce problème, comme aussi les problèmes liés à la gestion du bâtiment comme…
J.B : Comme s’il s’agissait juste d’une gestion copropriété…
S.P : Oui, voilà. Nous on ouvre les activités sociales quand on peut y associer des cadres politiques. Si on commence la gym, c’est parce qu’on a un cadre politique qui peut suivre l’activité. Si on ouvre l’activité théâtrale, c’est parce qu’on a des cadres politiques disponibles…
J.B : Mais comment ça ? Un cadre politique pour la gym par exemple, ce serait quoi ?
S.P : Par exemple, veiller au cadre, c’est organiser l’activité en étant sûrs que les gens s’occupent aussi de la propreté du lieu. Et donc, il y a des moments d’activités pour nettoyer l’espace…

J.B : Il y a une responsabilisation des participants…
S.P : Voilà, exactement : responsabilisation. Ça veut dire aussi, par exemple, organiser d’aller boire un verre avec les gens qui participent à l’espace pour se connaître mieux, et pour empêcher que ça soit juste un service. On dit aux gens qui viennent : « vous êtes là, vous n’allez pas payer, mais évidement vous n’êtes pas des clients. Si quelque chose ne marche pas ici, c’est aussi votre responsabilité. Vous ne pouvez pas vous plaindre, par exemple, parce qu’il y a un miroir qui est cassé. Il faut s’organiser pour changer le miroir, ou l’ampoule qui ne marche plus. » Il y a donc des moments de socialisation en dehors de la gym pour ceux qui viennent faire de la gym.
L’idée théorique à la base, c’est que le capitalisme aujourd’hui comprend trois niveaux – on pourrait dire beaucoup plus, mais disons basiquement : trois niveaux de contradiction. Le premier, c’est le niveau classique, économique, au sens où il y a des gens qui possèdent les moyens des production et des gens qui doivent vendre leur force de travail. Le deuxième est le niveau politique : il y a des gens qui ont le pouvoir médiatique et politique et qui peuvent imposer leur volonté à la majorité qui n’a pas les mêmes moyens et qui est exclue des décisions politiques. Mais il y a aussi un troisième niveau de contradiction, lié à la fragmentation que le capitalisme opère parmi les gens, à l’intérieur de la classe et même à l’intérieur de l’individu lui-même.
On s’est demandé : pourquoi ce qui fonctionnait dans le passé ne fonctionne plus aujourd’hui ? En Italie, il y avait des mouvements et des partis très forts, et même des syndicats très forts, parce qu’il y avait des terrains sociaux qui existaient et qui constituaient des préalables à l’action politique. Evidemment, l’activité politique a toujours été très dure, mais par exemple l’usine produisait une communauté de gens – après il fallait s’y disputer entre communistes, réformistes, conservateurs pour la direction du mouvement ouvrier, il y avait des conflits, mais il y avait un préalable. Autre exemple, les bars : en Italie, les bars ont été longtemps des lieux de socialisation, c’étaient des préalables. Les gens passaient des journées dans les bars des quartiers. L’église, évidemment, c’était un terrain, même pour les communistes, qui allaient faire du tractage sur le parvis de l’église. Il y avait donc des préalables. L’école, l’université sont encore ce type de préalable, il ne faut pas céder à la tentation de dire qu’il n’y a plus rien – on le voit d’autant mieux que le pouvoir essaie d’entraver ces espaces…

J.B : C’est un symptôme…
S.P : Oui : Trump, aux Etats-Unis, s’en prend même aux universités les plus néolibérales ! Et ici, en Italie, ce n’est pas un hasard si l’infiltration policière a commencé à l’université. Donc évidemment, il ne faut pas dire que tout ça est fini : il y a des continuités. Mais il y a une fragmentation telle dans certains secteurs, en particulier le travail, que les gens en viennent à penser que sur le terrain du travail, ils ne peuvent rien changer et en plus ils considèrent que ce n’est pas leur vraie vie, ce n’est pas quelque chose qui les définit. La chose qui les définit, c’est tout ce qui se passe à côté et là, peut-être, quelque chose peut être changé, au niveau de la qualité de la vie dans le monde. Nous on passe par cette perception, qui existe parmi les classes populaires ; si on la laisse comme ça, c’est un sentiment conservateur : « Je peux juste changer ma vie privée ». Je pense que ça détermine aussi beaucoup l’approche des questions du genre et de la sexualité. « J’ai perdu la possibilité de changer le monde »…

J.B : … »Donc je m’occupe de changer ma personne »
S.P : « Je peux me construire. Ma créativité, mon espace de liberté, ça peut être seulement à l’échelle de mon individualité ». Évidemment, il y a des raisons justes et concrètes à ces désirs, mais c’est aussi trompeur de penser que tu ne peux rien changer, et que la seule possibilité de changer la vie c’est la possibilité d’acheter une voiture, c’est juste de la consommation privée. Nous on essaie de répondre à cette aspiration en disant qu’il faut intervenir là, mais d’une manière collective. Donc par exemple, l’escalier, c’est quoi ? Ce n’est pas la classique bataille sur le travail, mais c’est un problème de qualité de la vie et donc on le traite collectivement, et ça fonctionne. Ça permet de générer un phénomène de participation politique qui va au delà du simple service. La gym aussi c’est pour améliorer la qualité de la vie ; ça coûte trop cher, donc on s’organise, on résout le problème collectivement et chacun prend sa part de responsabilité. On esquisse ainsi le passage du social au politique.
On ne peut pas prétendre diriger un terrain social qui n’existe plus. Notre activité politique, dans ce moment historique, consiste à reconstruire le terrain social, mais à le reconstruire d’emblée d’une manière politiquement orientée. C’est exactement ce qui se passe à droite, dans la manière dont les nouveaux fascismes, par exemple le trumpisme, reconstruisent le terrain social. C’est impossible pour nous d’entrer : le terrain est construit de telle manière qu’on en est déjà exclu. Et ça produit un résultat politique. Le simple fait de le construire, c’est déjà un résultat politique que tu peux cultiver. Pour nous, c’est très difficile d’entrer, et de faire la même chose que Trump, d’être par exemple sur certains réseaux, sur certaines questions, de tenter d’y être hégémoniques, parce que c’est déjà orienté, dans la manière même dont la relation est construite.
Ça ne veut pas dire que les réseaux sociaux, c’est un terrain qu’on ne peut pas investir. Nous, on l’a utilisé pour créer un cercle lié à nos activités en santé ambulatoire, pour le petit hôpital qu’on a ici, qui fournit des services médicaux. Là, par exemple, les réseaux sociaux étaient nécessaires : on avait des médecins qui travaillaient bénévolement, on faisait des actions dans les quartiers, et en faisant de la publicité sur les réseaux sociaux on a pu communiquer sur notre activité et faire savoir que ce qui manquait dans notre secteur c’était la cardiologie : « Est ce que par hasard, il y a des cardiologues qui veulent venir chez nous ? » Évidemment, ta visibilité sur les médias, ça compte pour que les gens viennent. Et on a pu ouvrir un service de cardiologie, et le faire savoir : les gens se sont dit : « Mais ça fonctionne! ». Ensuite on a fait un crowdfunding, pour ouvrir un service de gynécologie, on avait besoin d’un appareil à échographie : on a récolté 20 000€, et on l’a acheté. À chaque fois on communique sur les réseaux sociaux sur ce qu’on fait…
(Fin de la première partie ; à suivre…)
- Gianroberto Casaleggio était le responsable éditorial du blog de Beppe Grillo, et le cofondateur du Mouvement 5 étoiles, qualifié par certains de « gourou » en raison de son rôle d’idéologue du Mouvement
 ︎
︎ - Dove sono i nostri. Lavoro, classi e movimenti nell’Italia della crisi , 2014 [Où en sommes-nous? Travail, classes et mouvements dans l’Italie en crise] par le collectif politique Clash City Workers.
 ︎
︎ - L’ancien OPG « Je so’ pazzo » est un centre social autogéré situé dans le quartier Materdei à Naples. Le bâtiment qui l’abrite est un ancien couvent du XVIIe siècle ; entre 1925 et 1975, il est converti en hôpital psychiatrique médico-légal, des modifications architecturales adaptent la structure aux fonctions de détention et de contrôle propres à un pénitencier panoptique. Déclaré inadapté en 2000, l’OPG est resté officiellement en activité jusqu’en 2008, année de sa fermeture définitive. Les patients ont été transférés dans une aile extérieure de la prison de Secondigliano, tandis que le bâtiment Materdei a été abandonné et laissé à l’abandon. Le 2 mars 2015, le bâtiment est occupé par un groupe hétérogène composé d’étudiants et de militants de la CAU Naples, dont les fondateurs de Potere al popolo
 ︎
︎
08.01.2026 à 16:25
Du militarisme à gauche. Réponse à Usul et à Romain Huët
Texte intégral (8944 mots)
Le réarmement serait-il la solution miracle ? Dans un contexte de crise de surproduction du capitalisme, de baisse tendancielle du taux de profit et de tensions grandissantes pour l’accès aux ressources, la stratégie belliciste peut sembler un moyen de relancer la croissance autant qu’une manière de se préparer aux prochains conflits. En Ukraine, la Russie tente d’annexer les territoires conquis et d’organiser un changement de régime. Les pays membres de l’OTAN, concurrents les uns des autres, y visent l’exploitation des ressources agricoles et minières ainsi que l’obtention des chantiers de reconstruction dans le cadre d’un traité de paix. Si les tensions entre la France et la Russie sont aussi fortes, c’est autant du fait de l’occupation d’une partie de l’Ukraine par la Russie et de ses menaces envers les pays baltes que de la concurrence que l’impérialisme russe entend imposer aux pratiques néo-coloniales de la France en Afrique.
Dans les médias dominants, les mobilisations populaires qui ont entraîné la perte des positions économiques de la France et le départ de son armée du Sahel sont souvent résumées à « l’arrivée au pouvoir de juntes pro-russes ». À l’inverse, Donald Trump se montre pressé de conclure la paix avec Vladimir Poutine et de voir renforcée la participation des puissances européennes à l’OTAN. Cette politique vise, dit-on, à mieux préparer un affrontement avec la Chine. Aujourd’hui, le réarmement de tous côtés et la recomposition du monde en blocs pourraient entraîner la planète dans une guerre généralisée.
Pour Usul, la défense européenne au service de la démocratie
Pour certains, y compris à gauche, la production massive d’armes, le retour du service militaire en France et le rétablissement « d’un lien entre l’armée et la nation » s’expliqueraient principalement par la nécessité de se défendre face à ceux, soutiens de Trump et Poutine, qui cherchent à faire triompher le fascisme dans une Europe décrite comme « le dernier foyer des démocraties libérales ». Ces propos étaient tenus fin novembre puis courant décembre sur le plateau de Backseat1, par Usul, qui assumait envisager la possibilité d’«une confrontation militaire pour la survie de notre modèle démocratique ». En décrivant une Europe guidée par la défense de la démocratie dont il faudrait soutenir la guerre contre la Russie au nom du progressisme, Usul a laissé pantoises un grand nombre des personnes qui d’ordinaire apprécient ses analyses. Certes, comme Usul et son acolyte Lumi l’ont démontré dans un numéro de Rhinocéros2, les réseaux de l’État russe aident leurs alliés d’extrême-droite en Europe via leurs relais médiatiques et diverses manœuvres de déstabilisation. Pour autant, s’ils manifestent un mouvement de fond au sein de la gauche, ces propos décrivant le retour du service militaire comme un rempart au fascisme peuvent, au premier abord, sembler étonnants de la part d’une personnalité qui se revendique marxiste, et documente avec une grande vigueur critique depuis de nombreuses années le durcissement autoritaire du capitalisme libéral, notamment dans sa forme macroniste.
Si certaines organisations européennes d’extrême-droite sont en effet appuyées par le pouvoir russe, elles sont aussi soutenues, dans un contexte de crise du capitalisme et de montée des tentations autoritaires, par une partie du patronat de leur propre pays. En France, en plus du soutien de Vincent Bolloré et de Pierre-Édouard Stérin, l’extrême-droite bénéficie désormais de l’oreille attentive du Medef et de la complaisance des médias dominants. Peu après la réélection de Donald Trump, Bernard Arnault, de retour des États-Unis, louait le soutien aux entreprises dont il disait avoir été témoin3. Des enquêtes journalistiques ont documenté les pressions sur les candidats macronistes lors des dernières élections législatives, le président de la République demandant de ne pas se désister au bénéfice des Insoumis face à un Rassemblement National proche du pouvoir4. Comme l’écrivait en 1915 le révolutionnaire allemand Karl Liebnecht dans un tract qui lui valut d’être exclu du parti social-démocrate et incarcéré du fait de son antimilitarisme, « L’ennemi principal de chaque peuple est dans son propre pays »5.
Quelle démocratie européenne ?
Du fait de l’impérialisme russe, de la montée du fascisme aux États-Unis et des rivalités avec la Chine, Usul appelle à renforcer « la solidarité européenne » et accepte qu’elle puisse « prendre des formes qu’on ne va pas aimer ». La dichotomie présente dans le discours d’Usul entre « solidarité européenne » et montée de l’autoritarisme ne résiste pourtant pas à l’examen des faits. L’Union Européenne et la coopération entre ses membres ne sont aucunement des garanties contre l’extrême-droite et les atteintes aux droits humains. Jusqu’alors, la solidarité européenne qu’Usul invoque comme une notion abstraite a pris la forme concrète des garde-frontières et garde-côtes de Frontex, des milliers de cadavres dans la Méditerranée et dans la Manche ou des accords de Dublin qui empêchent la libre circulation des migrants. La solidarité européenne a aussi débouché sur l’accord d’association avec Israël ou sur les accords miniers de 2024 entre l’UE et le Rwanda, prévoyant la livraison en Europe de minerais spoliés par le Rwanda en République Démocratique du Congo sur fond de génocide6.
Aussi, contrairement à ce qu’affirme Usul, le maintien relatif de principes démocratiques au sein des États occidentaux ne signifie d’aucune façon que la défense de la démocratie serait le moteur des guerres à venir. Au-delà des « valeurs » et des « principes » souvent invoqués, les opérations militaires visent généralement à défendre des positions économiques ; et les effets d’une guerre sur un système politique sont rarement positifs. Rappelons que la constitution de la Vème République, dont il est coutumier de dénoncer les pouvoirs exorbitants accordés au président, comme la possibilité de décréter l’état d’urgence ou l’état de siège, est issue d’un coup d’État militaire survenu dans le contexte de la guerre d’Algérie. En outre, un État peut, dans certaines conditions, garantir certains droits sociaux et quelques libertés démocratiques à ses citoyens tout en niant la dignité des populations hors de ses frontières ou en les surexploitant. Les Indiens affamés par Churchill, les Algériens massacrés le 8 mai 1945 et ceux torturés par la police française (surnommée la « Gestapo d’Alger ») en étaient particulièrement informés.
S’il peut être rassurant d’imaginer son État guidé par la seule défense de la démocratie, à y regarder de plus près, on observe que les accords économiques ont souvent peu à voir avec les options idéologiques des uns et des autres. Viktor Orban, soutien de Vladimir Poutine, est lui-même soutenu par l’Union européenne et l’Allemagne, dont les usines de production automobile reçoivent des pièces fabriquées en Hongrie à moindre coût. En Italie, Giorgia Meloni, proche de Donald Trump, a bénéficié de plus de 200 milliards d’euros de crédits de l’Union européenne. Les blocs géopolitiques non plus ne se superposent pas aux divisions idéologiques. Boris Johnson, ancien premier-ministre britannique favorable au Brexit et peu avare de compliments envers Donald Trump, fut, par exemple un fervent défenseur d’une aide militaire à l’armée ukrainienne. Aujourd’hui, l’Ukraine est à la fois soutenue par la majorité des gouvernements libéraux européens, par les extrêmes-droites polonaises et baltes, par Israël et, au nom de la liberté des peuples à disposer d’eux-mêmes, par une partie de l’extrême-gauche européenne. La Russie est quant à elle appuyée par la Corée du Nord, la République islamique d’Iran, des groupes néo-nazis et, au nom de l’opposition à l’OTAN, par une large part de la gauche sud-américaine, dont celle incarnée par Lula.
L’atlantisme persistant de la France
Sur le plateau de Backseat, Usul oppose le développement d’une défense européenne ou la « montée en puissance » de l’armée française au « lien transatlantique » et à un alignement sur la politique étrangère américaine. Cette analyse, formulée entre le « soutien inconditionnel » de la France à Israël, et un communiqué d’Emmanuel Macron relatif à l’attaque du Venezuela par les États-Unis dont le contenu a tellement plu à Donald Trump qu’il l’a partagé sur son propre réseau social, a de quoi laisser perplexe. Rappelons que c’est sur injonction américaine que les États européens ont accepté d’augmenter leurs budgets militaires de 2% à 5% du PIB. Au printemps dernier, dans la déclaration résumant le cadre commun négocié par la Commission européenne avec les États-Unis, on pouvait lire que « L’Union européenne prévoit d’augmenter considérablement ses achats d’équipements militaires et de défense auprès des États-Unis, avec le soutien et la facilitation du gouvernement américain »7. C’est dans ce contexte et pour défendre ses choix budgétaires que le discours relatif à la menace russe est mobilisé par le gouvernement français.
Usul décrit en outre une situation analogue « à celle de la guerre d’Espagne dans les années 30 », pour souligner la nécessité du soutien à apporter à « un régime ami, un régime qui partage un certain nombre de nos valeurs démocratiques, qui est attaqué par le modèle d’en face ». Le parallèle entre les raisons du soutien des États européens à l’armée ukrainienne et celui que le Front populaire aurait dû manifester vis-à-vis des républicains espagnols n’est pas pertinent : l’Espagne de 1936-1937 était en proie à une révolution puis à une guerre civile opposant deux camps sociaux et politiques. Une victoire des républicains espagnols aurait entraîné un affaiblissement du fascisme à l’échelle européenne et servi d’appui aux luttes ouvrières. Aujourd’hui, l’Ukraine fait face à une invasion en même temps qu’à toutes les convoitises relatives à sa position géostratégique, à ses terres rares, son agriculture et ses chantiers de reconstruction. Si l’Ukraine est défendue par la majorité des États membres de l’Union Européenne, ce n’est ni au nom de « valeurs démocratiques » communes ni d’une solidarité entre égaux, mais parce que son territoire est envisagé, en tant que périphérie européenne, comme un champ d’investissement pour le capital européen.
Pourtant, Usul, d’ordinaire attaché à l’analyse des faits matériels, n’évoque pas les intérêts en jeu en Ukraine et se borne à invoquer des « valeurs », ce qui le conduit à répéter le discours éculé qui justifie les guerres menées par l’Occident par la défense de la démocratie et de la liberté. Il légitime le retour du service militaire et le développement d’un « lien entre l’armée et la nation » par le fait que l’armée rencontre des difficultés à recruter « pour les besoins de la France ». Les « besoins » définis par l’État français ne sont à aucun moment questionnés ou même explicités dans son discours. Aussi, la nécessité que l’armée française « sécurise un traité de paix en Ukraine » qu’il reprend à son compte semble décorrellée des diverses convoitises des entreprises européennes. Quant à la présence continue de troupes en Afrique pour appuyer les dictatures qui protègent encore les intérêts du capitalisme français, il ne l’évoque tout simplement pas. La même occultation de la réalité matérielle est présente dans les prises de position récentes du sociologue Romain Huët8.
Romain Huët, réserviste de l’armée française en lutte contre l’antiaméricanisme
Ce dernier va cependant plus loin qu’Usul, tant dans sa reprise des discours atlantistes que dans la forme prise par son engagement. En effet, le maître de conférences à l’université Rennes 2 a récemment annoncé, dans une tribune publiée par Le Nouvel Obs9, avoir candidaté auprès de la réserve de l’armée de terre. Avec la publication de cette tribune, l’hebdomadaire semble renouer avec une partie de son histoire, celle du soutien aux nouveaux philosophes, qui s’exprimèrent dans ses colonnes à partir des années 1970. En effet, alors que le champ lexical auquel le sociologue a recours pour désigner l’impérialisme russe est celui de l’invasion et de la menace, les guerres d’Irak et d’Afghanistan lui inspirent uniquement le constat selon lequel « nous savons qu’il n’existe pas de « guerres propres » ». Quant à la dénonciation de l’impérialisme américain, elle est renvoyée à un « antiaméricanisme » qu’il qualifie de « stupide ». Depuis 2001, quatre millions et demi de personnes ont été tuées lors des guerres menées par les États-Unis. En 2025, les États-Unis ont bombardé sept pays. Aujourd’hui, après avoir armé et soutenu le génocide à Gaza, les États-Unis organisent la mise sous tutelle de la Palestine par le développement d’une coalition internationale à leur service. Lorsque Romain Huët faisait paraître sa tribune, Donald Trump ne cachait déjà pas sa volonté d’attaquer le Venezuela pour, selon ses propres mots, « récupérer notre (sic) pétrole » et le Groenland était déjà menacé d’invasion. Ces éléments ne sont pourtant pas mentionnés. Quant aux génocides en Palestine et au Soudan, ils sont évoqués une seule fois aux côtés de la situation ukrainienne, pour être qualifiés de « tragédies du temps », dont il regrette qu’elles « glissent devant nos yeux ».
Alors que les gouvernements occidentaux viennent de démontrer à la face du monde qu’ils peuvent s’accommoder d’un génocide s’il est commis par leur allié israélien, tandis que les jeunesses d’Afrique se soulèvent contre la présence française dans leurs pays respectifs, le sociologue préfère asséner que « Face aux nouvelles polarités du monde, le camp de l’Ouest demeure de loin le plus désirable ». Pourtant, l’alignement avec les intérêts occidentaux n’est aucunement le signe d’une adhésion à de quelconques principes qui uniraient l’Occident. Rappelons que la monarchie saoudienne est protégée par l’armée américaine en échange de l’accès au pétrole, alors que la totalité des gouvernements de gauche d’Amérique latine ont été menacés par Donald Trump dès les heures qui ont suivi l’enlèvement de Nicolas Maduro. En Amérique latine, l’élection de gouvernements favorables au « camp de l’Ouest » n’est pas seulement le fruit d’un « désir » mais aussi le résultat d’ingérences, comme en attestent les propos de Donald Trump, menaçant de suspendre les aides américaines en Argentine et au Honduras en cas de défaite de ses candidats1011.
Si Romain Huët concède que « le drame de l’influence américaine s’est logé dans nos têtes, nos formes de vie, notre culture » c’est pour mieux affirmer que « l’antiaméricanisme », en plus d’être « stupide », ignorerait cette « défaite irréversible ». Il est difficile de comprendre en quoi le fait d’être influencé par des aspects de la culture américaine rendrait caduque toute dénonciation de la vassalisation opérée par les États-Unis, et surtout, on s’étonne qu’un intellectuel qui aime se présenter comme critique et non-dupe des discours en circulation dans l’espace public discrédite par avance toute lutte contre le pouvoir dominant.
Solidarité avec l’Ukraine… au service de quels intérêts ?
Romain Huët se dit solidaire de l’Ukraine. Il « refuse une position morale qui ne « prend pas position », par désir de tranquillité » et accuse ceux qui oseraient tenir des discours pacifistes de lancer « un appel à « déserter » ». Son courage ne le conduit tout de même pas à mentionner les intérêts économiques des puissances occidentales. En mars dernier, Elon Musk suggérait la possibilité de couper l’accès de l’armée ukrainienne au réseau Starlink pour forcer Volodymyr Zelensky à signer un contrat de 500 milliards de dollars relatif à l’accès des États-Unis aux terres rares12.
Deux jours après la publication de sa tribune, Romain Huët était récompensé d’une invitation dans l’émission C ce soir13 pour échanger doctement, dans un pluralisme dont le service public a le secret, avec un journaliste du Point (lui aussi réserviste), une historienne spécialiste de l’armée, un ancien colonel de marine, un maire divers gauche pacifiste mais favorable au retour d’un service militaire obligatoire, et un ancien secrétaire d’État à la Défense.
Ce soir-là, sur France 5, Romain Huët déclare ne pas être doté des compétences nécessaires pour se prononcer à propos du retour du service militaire. La question est dépolitisée et réduite à l’évaluation des « besoins de l’armée ». Romain Huët précise peu après n’avoir « pas de problème avec le fait que la France doit se défendre ». Tout au long de l’échange, rien n’est débattu des buts poursuivis en dehors des frontières de l’hexagone, des intérêts économiques défendus, de l’accaparement des ressources, des répercussions de la présence de l’armée française sur les populations et de la protection de régimes peu défendables d’un point de vue éthique dans ce que la France considère comme son pré-carré.
L’une des critiques exprimées par Romain Huët ne porte pas sur la politique étrangère de la France, mais sur l’usage de l’armée à des fins d’ordre et de disciplinarisation de la jeunesse. Dans ce qu’il semble considérer comme un contraste, il cite positivement des Ukrainiens qui travaillent la semaine « et qui le week-end ont fabriqué des drones ». Usul, quant à lui, opposait le risque d’« aller mourir dans les tranchées » à la volonté de « détecter les jeunes talents qui pourraient être les pilotes de drones de demain s’il y a la guerre ». Dans la mesure où l’usage de cette technologie particulièrement meurtrière pour les civils banalise l’acte de tuer via la distance induite entre le lieu de l’action et le théâtre des opérations, il faut s’interroger devant cette description favorable de la place prise par les drones tueurs au sein des guerres contemporaines. Aussi, à ceux qui décrivent une Europe uniquement préoccupée par la défense de son territoire, rappelons que l’Union européenne et la France ont financé l’équipement de drones armés israéliens utilisés dans le génocide à Gaza14.
La guerre sans l’aimer, de Bernard-Henri Lévy à Romain Huët
Romain Huët, spécialiste des sciences de l’information et de la communication, semble n’avoir rien à redire quant aux actions de l’armée française. Il critique cependant les discours, les « envolées lyriques qui ressemblent franchement aux années 30 » et tout ce qui semble relever d’une « romantisation de la guerre ». À propos du général Mandon appelant à se préparer à la mort de certains de « nos enfants », le sociologue écrit dans sa tribune qu’il lui « manque une compréhension sociologique élémentaire : cette préparation morale à la guerre, rabâchée depuis quelques années, du « réarmement démographique » à l’envoi de troupes au sol en Ukraine, ne correspond à aucune aspiration collective. » Le sociologue dit défendre « une approche domestiquée des conflits, qui refuse le romantisme sacrificiel ». En conclusion de son texte, après une description vague des vies ukrainiennes et syriennes qui « refusent la passivité, la résignation et les accommodements », Romain Huët, qui vient donc de s’engager auprès de l’armée française, appelle à « soutenir sans s’enthousiasmer, aider sans sanctifier la guerre ».
Nous laissons au sociologue la responsabilité du parallèle qu’il dresse entre son engagement dans une armée chargée de protéger à l’international les intérêts du capitalisme français et celui qui consiste à défendre sa ville contre un envahisseur ou une dictature. Par ailleurs, en dénonçant une « romantisation de la guerre » dont il ne donne aucune preuve de l’omniprésence, Romain Huët se constitue un homme de paille face auquel il tente d’endosser les habits de l’intellectuel critique. En présentant l’engagement militaire et le soutien à la politique de l’OTAN comme une nécessité face à une guerre imposée par la seule Russie, il se trouve pourtant en phase avec la doxa contemporaine. En 2011, quelques mois après l’intervention en Libye déclenchée par Nicolas Sarkozy, Bernard-Henri Lévy, incarnation médiatique de cette campagne militaire, intitulait son livre La guerre sans l’aimer. En 2025, Romain Huët annonce sa candidature auprès de la réserve de l’armée de terre en affirmant « Je déteste la guerre, mais je l’arpente. » En 2026, Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, décrit « un monde soumis à la loi du plus fort » auquel « la France [se] prépare », même si « elle ne peut s’y résoudre et continuera de défendre ses principes »15.
Comme le faisaient récemment remarquer les militants de Révolution Permanente Vincent Rissier et Joachim Bertin, dans le cadre d’une réponse à Usul16, le discours actuel d’une partie de la gauche, qui, de la même façon que le gouvernement, décrit la guerre comme un mal auquel se résout une République française guidée par la défense du progrès et la démocratie, prolonge une longue histoire de renoncement à gauche. Ainsi, le 10 août 1914, dix jours après l’assassinat de Jean Jaurès et le début de la première guerre mondiale, l’éditorial de l’Humanité, sobrement intitulé Au nom de la patrie républicaine, soutenait lui aussi l’entrée dans la guerre mondiale mais, comme Romain Huët, « sans s’enthousiasmer ». Son rédacteur mentionnait « la vieille mère pleurant l’époux », « la fiancée se demandant si elle reverra celui qu’elle avait choisi pour être le compagnon de sa vie », les « enfants dont les derniers baisers ont été donnés dans un sanglot. » À propos des soldats français, on lisait « qu’ils ont conscience du grand et noble devoir qu’ils sont appelés à remplir » et que « ce n’est pas en agresseurs qu’ils se dressent contre les armées impériales » ni « en conquérants qu’ils foulent le sol allemand ».
Aujourd’hui, en Ukraine, certains militants internationalistes, notamment ceux de Kharkiv qui se désignent comme « l’Assemblée », développent une solidarité envers les déserteurs, tant Russes qu’Ukrainiens, et tentent de coordonner les luttes sociales entre les deux pays17. D’autres mouvements ukrainiens, anarchistes ou d’extrême-gauche, sont engagés dans la lutte armée contre l’envahisseur russe18. Tout en critiquant leur propre État, ils considèrent qu’empêcher l’annexion de leur territoire par la Russie est un préalable à la conduite de luttes sociales19. En Europe, les organisations de la gauche radicale appellent à la libération des prisonniers politiques russes et s’opposent à l’industrie française de l’armement qui a maintenu ses exportations de composants vers la Russie malgré les interdictions officielles20. Les Amis de la Terre dénoncent le fait que, malgré les sanctions économiques officielles, la France finance l’effort de guerre russe par l’importation massive de gaz naturel liquéfié et d’engrais azotés pour l’agriculture21. Ce n’est pourtant pas l’une de ces campagnes que Romain Huët a décidé de rejoindre au nom de la solidarité internationale mais celle de l’armée française, dans un contexte de tensions grandissantes et sans savoir dans quelles opérations extérieures elle sera prochainement engagée.
L’armée française au service d’intérêts économiques
Usul et Romain Huët feignent d’oublier que la guerre prolonge la politique par d’autres moyens. Il est contradictoire de dénoncer en France l’exploitation et la destruction de la planète, tout en masquant le fait que notre État se bat pour l’exploitation des ressources ou l’accès des entreprises françaises aux marchés internationaux. Si la guerre est un désastre pour les classes populaires souvent en première ligne, pour d’autres, l’adoption de postures bellicistes peut s’avérer très rentable sur le plan de la visibilité médiatique et de la reconnaissance institutionnelle. Reste qu’une telle ascension ne va pas sans une importante contradiction. De la même manière que des Ukrainiens travaillent la semaine et fabriquent des drones le week-end, certains entendent probablement la semaine, décrire la souffrance au travail en régime capitaliste, alerter sur les dangers de l’extrême-droite, évoquer positivement les mondes qui s’inventent au cœur des luttes écologiques ; et le week-end, se mettre au service d’une armée dont la principale fonction sera de protéger les chantiers de Vinci, les bateaux de la CMA-CGM, les conteneurs de Bolloré et les pipelines de Total.
En 2023 et 2024, l’Allemagne peinait à vendre ses voitures et ses panneaux solaires. Le pays a connu deux années de récession du fait d’une crise de surproduction. Son économie a depuis été relancée par la production d’armes et de matériel militaire. Deux usines de Volskwagen dont la fermeture était programmée produisent désormais des véhicules pour l’armée. La valeur des actions de Rheinmetall a été multipliée par douze depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. L’entreprise se trouve être le plus grand fabricant de munitions d’Europe, en plus d’être à l’origine des chars d’assaut Léopard. Sous sa tutelle, des usines de Bosch, Continental et ZF Friedrichshafen réorientent leur activité de la production de pièces automobiles vers l’armement. Ce secteur aux bénéfices record se situe désormais au cœur de l’industrie allemande. En cas de cessez-le-feu en Ukraine, il est peu probable que les actionnaires n’exigent pas de nouveaux débouchés pour ces productions.
Des « fonds verts »… kaki
En France, ce sont les « fonds verts » des banques qui ont récemment été réorientés vers l’armement. Comme l’écrivait récemment Mediapart : «Cinquante milliards d’euros issus de fonds dits « verts » des banques françaises et européennes ont été récemment investis dans la défense, avec le soutien de la Commission européenne, qui a cédé au lobbying des marchands d’armes». Cinquante milliards d’euros ont ainsi bénéficié à une centaine d’entreprises de l’industrie militaire. Avec 5,6 milliards d’euros d’investissement, Safran, entreprise française qui fabrique notamment des bombes de précision, des drones et les moteurs du Rafale, en est le premier bénéficiaire. « Ce scandale des « armes vertes », écrit Mediapart, a notamment contribué à financer la guerre à Gaza. »22. Voxeurop, co-auteur de cette enquête, précise : «les actions d’Elbit Systems, le plus grand fabricant d’armes israélien (qui participe directement à la guerre de Gaza, notamment à la destruction des terres agricoles) sont désormais incluses dans des fonds au service de la “transition climatique” ou labellisés “ESG”. Il n’est donc pas impossible que certains petits épargnants européens aient financé sans le savoir ce qu’une commission des Nations Unies a qualifié de génocide. (…) Parmi les dix entreprises qui ont attiré la plupart des capitaux verts, on compte l’entreprise allemande MTU Aero Engines, l’italienne Leonardo, la filiale néerlandaise d’Airbus, la française Thales, l’espagnole Indra, la suédoise Saab, ainsi que les britanniques Rolls Royce et BAE Systems. D’après des études récentes, cette dernière produit un grand nombre d’armes utilisées par l’armée israélienne dans le cadre de ses opérations militaires à Gaza, notamment l’obusier automoteur M109, fabriqué en collaboration avec Rheinmetall. Rolls Royce, qui contrôle la filiale allemande MTU, fournit des composants techniques pour les chars israéliens, y compris ceux utilisés à Gaza.»23
Si Usul et Romain Huët taisent les objectifs du réarmement, comme des opérations militaires occidentales, ils éludent aussi la question de son coût pour les classes populaires. Pourtant, les conséquences sociales de la marche à la guerre se font déjà sentir via les coupes budgétaires dans les allocations et les services publics. Aussi ne suffit-il pas de dénoncer le masculinisme ou de proclamer que l’on s’oppose à l’usage de l’armée à des fins d’encadrement de la jeunesse pour faire disparaître les effets de la guerre sur les corps et les esprits. Dans la France des années 2020, la nécessité de rétablir ce qu’Usul appelle le « lien entre l’armée et la nation », ou la volonté de répondre aux « besoins de l’armée » invoqués par Romain Huët, prend notamment la forme des classes de défense, qui selon le ministère de l’Éducation nationale « s’adressent en priorité à des établissements situés en réseau d’éducation prioritaire (REP ou REP+) ou en zone rurale isolée ». Ces 855 classes, dont le nombre a été multiplié par deux entre 2021 et 2023, s’appuient sur le soutien financier de Dassault, Naval Group et Safran, et permettent à une unité de l’armée d’intervenir plusieurs fois par an. Dans ce cadre, sont assurés des ateliers aux noms explicites, tels que « repousser des manifestants hostiles », « fouille d’une cellule carcérale », « zéro-tolérance », « tir au pistolet laser » ou « vivre le quotidien d’un surveillant de prison »24.
Contre le militarisme, la lutte sociale plutôt que le pacifisme
Au début de l’année 1938, un an et demi après les mesures concédées aux grévistes par le Front populaire, les réductions du temps de travail furent suspendues et la semaine de 48 heures rétablie dans l’industrie militaire. Aujourd’hui, en Ukraine, le code du travail est lui aussi suspendu. Les intérêts économiques au cœur de chaque guerre sont immenses et nombreux. Récemment, des ministres, ex-ministres et hommes d’affaires proches de Volodymyr Zelensky, liés au marché de l’énergie et de l’armement, ont été accusés de corruption. En septembre 2023, le New York Times décrivait une ligne de front relativement stable en Ukraine25. L’article établissait que des milliers de vies avaient été sacrifiées dans des offensives et contre-offensives menées dans le seul but d’annoncer la reprise d’une position qui, quand bien même elle allait être perdue peu après, permettrait de légitimer les demandes d’armement et de financement.
Il y a un siècle, le fascisme, dernière carte d’un capitalisme en crise, s’est développé dans la concurrence pour l’accès aux colonies et la course au réarmement. Sur décision de Staline, les partis communistes alignés sur l’URSS cessèrent de s’inscrire dans une perspective révolutionnaire internationale pour s’engager chacun dans la défense des institutions de son pays. Cette stratégie s’est avérée perdante. Pire, elle déboucha sur la stigmatisation de l’internationalisme en tant qu’«hitléro-trotskisme».
Aujourd’hui, face aux tensions internationales, à l’accentuation de l’exploitation, à la destruction de la planète et aux durcissements autoritaires, il ne s’agit évidemment pas de défendre un pacifisme abstrait. Comme le constatait déjà Rosa Luxemburg en 1911 dans un texte intitulé Utopies pacifistes26, dans le monde capitaliste, la possibilité de la négociation est maintenue par les armées et les rapports de force. Dans le contexte de l’impérialisme, on ne peut espérer mieux qu’une « paix armée », toujours provisoire. Si l’on souhaite sincèrement la paix, il s’agit donc de désarmer les fondements de la guerre, à savoir la politique commerciale et la politique étrangère des États chargés de défendre les intérêts de leur propre bourgeoisie.
En outre, il est fort probable qu’émergent prochainement des mouvements sociaux qui, dans plusieurs pays, articuleront l’opposition à la destruction du système social, la dénonciation de la surenchère militaire et la lutte contre le recul des libertés. L’opposition entre les nations s’étant accentuée au fur et à mesure du développement du capitalisme, seule la lutte contre l’ordre économique peut répondre à la nécessité d’éviter la guerre. Comme l’écrivait Rosa Luxemburg, l’horizon de la révolution sociale constitue un projet bien plus sérieux que « toutes les singeries autour du désarmement, qu’elles soient arrangées à Saint-Pétersbourg, à Londres ou à Berlin ».
- https://www.youtube.com/watch?v=Ej7YU4H99WA, https://www.youtube.com/watch?v=0A6mxkq9jOs
 ︎
︎ - Emission de la chaîne Blast, https://www.youtube.com/watch?v=eXKFQczmyIk
 ︎
︎ - https://www.radiofrance.fr/franceinfo/podcasts/le-decryptage-eco/remonte-contre-le-projet-de-hausse-des-impots-sur-les-societes-bernard-arnault-signale-le-contraste-avec-les-etats-unis-3064018
 ︎
︎ - https://www.lemonde.fr/politique/article/2025/06/09/un-an-apres-la-dissolution-de-l-assemblee-nationale-que-reste-t-il-du-front-republicain_6611732_823448.html
 ︎
︎ - https://www.marxists.org/francais/liebknec/1915/liebknecht_19150500.htm
 ︎
︎ - https://www.novethic.fr/economie-et-social/droits-humains/minerais-de-sang-le-parlement-europeen-demande-a-lue-de-suspendre-son-accord-avec-le-rwanda
 ︎
︎ - https://www.blast-info.fr/articles/2025/sommet-de-lotan-trump-force-leurope-et-la-france-a-depenser-beaucoup-plus-eCEM-fAvQl23lYOpF0pShw
 ︎
︎ - Romain Huët s’est auparavant fait connaître pour ses ouvrages traitant des souffrances psychiques engendrées par l’ordre social, des révoltes en France et de l’engagement armé de Syriens contre la dictature de Bachar Al-Assad et d’Ukrainiens face à l’invasion russe
 ︎
︎ - https://www.nouvelobs.com/opinions/20251125.OBS110069/je-refuse-l-appel-au-sacrifice-de-nos-enfants-mais-j-ai-candidate-pour-etre-reserviste-de-l-armee-de-terre.html
 ︎
︎ - https://www.lemonde.fr/international/article/2025/10/14/donald-trump-conditionne-la-poursuite-de-l-aide-a-l-argentine-a-la-survie-politique-de-javier-milei_6646651_3210.html
 ︎
︎ - https://www.franceinfo.fr/monde/usa/presidentielle/donald-trump/la-victoire-du-nouveau-president-du-honduras-symbole-de-l-avancee-de-la-droite-trumpiste-en-amerique-latine_7701820.html
 ︎
︎ - https://fr.euronews.com/next/2025/07/16/a-quel-point-lukraine-depend-elle-de-starlink-pour-ses-communications
 ︎
︎ - https://www.france.tv/france-5/c-ce-soir/7959888-defense-nationale-l-affaire-de-tous.html
 ︎
︎ - https://disclose.ngo/fr/article/en-pleine-guerre-a-gaza-la-france-equipe-des-drones-armes-israeliens, https://disclose.ngo/fr/article/la-france-et-leurope-financent-sans-le-dire-lindustrie-militaire-israelienne
 ︎
︎ - https://www.franceinfo.fr/monde/venezuela/attaque-americaine-sur-le-venezuela/la-france-se-prepare-pour-un-monde-durci-affirme-jean-noel-barrot-ministre-des-affaires-etrangeres_7720075.html
 ︎
︎ - https://www.youtube.com/watch?v=XodPOjRHLw4
 ︎
︎ - https://libcom.org/article/self-demobilization-abolition-ukraine-late-autumn-2025-interview-assembly
 ︎
︎ - https://lundi.am/L-organisation-des-anarchistes-sur-le-front-ukrainien
 ︎
︎ - https://lundi.am/Anarchistes-et-guerre
 ︎
︎ - https://www.obsarm.info/spip.php?article651
 ︎
︎ - https://larevuedestransitions.fr/2025/02/17/la-dependance-de-lagriculture-francaise-aux-engrais-chimiques-un-financement-indirect-de-la-guerre-en-ukraine/
 ︎
︎ - https://www.mediapart.fr/journal/economie-et-social/171225/avec-l-argent-des-fonds-verts-des-banques-financent-les-entreprises-d-armement
 ︎
︎ - https://voxeurop.eu/fr/europe-fonds-investissement-verts-financent-industrie-armement/
 ︎
︎ - https://positions-revue.fr/face-a-la-crise-du-capitalisme-la-militarisation-de-lenseignement/
 ︎
︎ - https://www.nytimes.com/interactive/2023/09/28/world/europe/russia-ukraine-war-map-front-line.html
 ︎
︎ - https://www.marxists.org/francais/luxembur/works/1911/05/utopies.htm
 ︎
︎
19.12.2025 à 16:27
Militer depuis l’Assemblée : entretien avec Arnaud Saint-Martin
Texte intégral (8372 mots)
Manuel Cervera-Marzal (MCM) : Vous êtes sociologue des sciences. Votre thèse porte sur l’histoire de l’astronomie française au début du XXe siècle. Comment en êtes-vous arrivé à ce métier de sociologue, et pourquoi avoir choisi d’étudier l’astronomie ?
Arnaud Saint-Martin (ASM) : La sociologie s’est imposée pour moi dès le lycée. J’étais un cancre, soyons clair, mais c’était une des rares matières que j’aimais ; avec le sport (rires). J’ai découvert Bourdieu en première, à travers l’affrontement Bourdieu/Boudon1 : il y avait un côté un peu héroïque. Ça m’a passionné et ça m’a amené à m’interroger sur moi-même, comme produit de déterminismes sociaux, moi qui avais été socialisé dans un milieu populaire de droite.
Et sur un malentendu, je me suis inscrit en licence de sociologie à l’université de Rouen après un bac ES péniblement obtenu (avec mention « passable »). Le cancre est devenu un passionné : à la façon de l’autodidacte de Sartre, je passais mes journées à la bibliothèque de Rouen. Ça m’a dévoré. J’ai découvert l’anthropologie, l’histoire, la philosophie : ça m’a ouvert plein de portes.
Rouen avait l’avantage d’une formation très généraliste. Puis, à Paris 5, j’ai basculé vers la sociologie des sciences grâce à Jean-Michel Berthelot. Les débats sur la vérité, l’objectivité, les querelles épistémologiques, ça m’a happé. J’ai fait un mémoire sur la vulgarisation de l’astronomie, en 1999, puis, l’année suivante, un travail sur l’affaire Sokal.
MCM : Impostures intellectuelles, de Bricmont et Sokal2…
ASM : Oui, le canular de Sokal… C’était mon sujet de maîtrise en sociologie des sciences, en 2000. À l’époque, c’était une spécialité de niche : il y avait plus de philosophes et d’historiens des sciences que de sociologues des sciences. La sociologie était la portion congrue. Mais il existait quand même des foyers : Paris 5, EHESS, Nanterre, Nantes, Strasbourg… Et c’est le moment où le domaine se structure, avec des débats intenses sur le constructivisme, sur le statut des énoncés scientifiques, leur inscription dans l’histoire, les études de laboratoire. Avec aussi les discussions critiques autour de l’anthropologie des savoirs de Bruno Latour. Ça, ça a été ma formation.
MCM : Et pourquoi avoir pris l’astronomie pour objet d’étude ? Pourquoi pas la biologie, ou la physique ?
ASM : Parce que la physique et la biologie étaient déjà très défrichées. Moi, l’astronomie m’attirait. Mon DEA portait sur la vulgarisation de l’astronomie : j’y analysais le marché de la diffusion des sciences, à partir d’entretiens avec des cosmologistes et des astrophysiciens qui écrivaient des livres ou donnaient des conférences, mais aussi des éditeurs et des journalistes scientifiques. C’était une façon d’observer concrètement la frontière entre science et société, sous l’angle de la diffusion des savoirs.
En thèse à Paris 4, j’ai ensuite quitté la vulgarisation pour faire une sociologie historique de l’astronomie entre 1880 et 1940. Je me suis intéressé aux effets de l’émergence de la théorie de l’expansion de l’univers sur la communauté des astronomes, et aux résistances – épistémologiques et culturelles – qu’elle a suscitées. Ça ne s’est pas fait « en douceur ».
Le travail reposait surtout sur des archives : observatoires, correspondances, documents administratifs. Certaines archives n’étaient même pas classées. C’était une sociologie historique d’un champ professionnel et de ses organisations.
Ce que j’ai trouvé passionnant, c’est de voir ce que signifiait concrètement « faire de l’astronomie » vers 1900. C’était par exemple… donner l’heure ! Les astronomes étaient chargés de l’heure civile, via l’Observatoire de Paris, et aussi de la météorologie, alors intégrée à l’astronomie. On voit alors se jouer la professionnalisation du métier, avec l’exigence progressive de diplômes, mais aussi les réactions qu’elle suscite, notamment à travers l’astronomie populaire et la vulgarisation. C’est tout cela que j’ai mis au jour dans cette thèse, soutenue en 2008 en Sorbonne.

MCM : Le 8 juillet 2024, vous entrez à l’Assemblée nationale. Vous vous mettez en disponibilité du CNRS. Comment avez-vous vécu ce passage du métier de sociologue à celui de député ? Est-ce une manière de passer de la théorie à l’action ?
ASM : C’est une question difficile, j’y réfléchis encore. Ça fait une dizaine d’années que je fais de la politique “un peu sérieusement”, c’est-à-dire au-delà du canapé et du bulletin de vote. Et assez vite, j’ai vu que ce n’était pas du tout la même chose de faire de la politique et de faire mon boulot de sociologue au CNRS. Pour moi, ces deux répertoires d’action sont disjoints et je fais tout pour les maintenir à distance. J’ai été conseiller municipal d’opposition à Melun, avant d’être député, pendant quatre ans. Et je me suis rendu compte, comme le dit Goffman, qu’il y a des ruptures de cadre. Ça m’est arrivé de faire des argumentations académiques en conseil municipal : je déroulais un truc pendant dix minutes, “Savez-vous ce que la science politique nous apprend sur cette question, Monsieur le Maire ?” Et je voyais les gens : “Mais qu’est-ce qu’il fait ?” (rires)
Ce n’était pas du tout efficace. Le conseil municipal n’a rien à voir avec la science : il faut convaincre, élaborer une ligne, on est dans le registre normatif, dans la bataille souvent. Le travail de diagnostic me sert, oui : je continue à lire les sciences sociales, c’est un réflexe quand j’ai un problème. Même en commission Défense nationale et des forces armées, où je siège : je vais voir ce que produisent les collègues sociologues sur le fait militaire, je lis les war studies. Ça m’aide à comprendre. Mais à un moment, tu fais de la politique : tu prends position, avec tout le vertige de la prise de position. La politique, c’est moins subtil. Elle a ses formats propres. Et ici à l’Assemblée, c’est encore pire : les cadres s’imposent à toi via le règlement intérieur et la bienséance ordinaire. Dans l’hémicycle ou en commission, tu as en général deux minutes pour les interventions ; sur une défense d’amendement, parfois juste une minute. Si tu dépasses, micro coupé, souvent sans possibilité de rebond. Donc non : tu ne fais pas une argumentation ultra sophistiquée avec notes de bas de page. Il y a un format.
Par ailleurs, tu fais partie d’un groupe parlementaire, qui se caractérise par une sociabilité, une ligne politique. Moi j’y contribue sur mes secteurs de compétence. Mais j’importe aussi des éléments de ma socialisation professionnelle : capacité à analyser vite, comprendre les textes. Et parfois ramener de la littérature scientifique quand on en a besoin – c’est fréquent, y compris sur l’environnement.
Je suis aussi membre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, l’OPECST. Instance bicamérale : 18 députés, 18 sénateurs, depuis 1983. On se réunit tous les jeudis. On auditionne des spécialistes, on fait des notes. Là, ma formation est utile. J’ai fait une note sur les neurosciences avec une sénatrice. Et j’ai eu entre autres une audition assez serrée avec Stanislas Dehaene, le neuroscientifique qui préside le conseil scientifique de l’Éducation nationale. Il y a d’ailleurs pas mal de parlementaires scientifiques : physiciens, biologistes… Les débats, sur ces questions-là, sont souvent de bonne tenue.
Ensuite, le travail ordinaire au Parlement, c’est deux grandes compétences : la production de la loi, et l’évaluation des politiques publiques – commissions d’enquête, missions d’information. Cette année, j’ai fait une mission d’information avec une députée macroniste, Corinne Vignon, sur l’industrie des satellites. Là, on auditionne, on évalue. Et évidemment, j’ai amené mon expérience de sociologie du spatial dans l’analyse. Ça a beaucoup servi la compréhension des enjeux. Après, il y a la recommandation, et là on revient au politique.
MCM : Il y a aussi d’autres sociologues à l’Assemblée, surtout dans votre groupe…
ASM : Oui : Hadrien Clouet, Marie Mesmeur, les politistes Claire Lejeune et Pierre-Yves Cadalen… On a des gens formés aux sciences sociales et ça infuse dans nos prises de position. C’est important : ça donne une attention à la déconstruction des prénotions, qui sont très fréquentes au Parlement.
MCM : Avez-vous encore le temps de lire ? Et d’écrire ?
ASM : Il y a un épuisement cognitif et physique de la fonction. On est coincé en séance ou en commission, et sinon on est en circonscription : marchés, inaugurations, rendez-vous en permanence parlementaire, repas des aînés… C’est matériel, tu ne peux pas consacrer ce temps à autre chose. Pendant l’examen budgétaire, on est retenu 15 heures par jour, parfois 7 jours sur 7. Moi je vis à une heure porte à porte, donc je peux rentrer voir ma famille, mais c’est bref et pour tout dire frustrant.
Lire, c’est devenu plus difficile. J’ai des collègues qui lisent dans l’hémicycle – souvent de la sociologie, d’ailleurs – moi je n’y arrive pas. Il y a un brouhaha permanent. Donc je lis moins qu’avant ce genre de littérature, alors que c’était mon métier. Je lis surtout des textes qui servent directement mon travail parlementaire. C’est très instrumental. L’écriture en revanche, je la maintiens à fond, je m’oblige : tribunes, une ou deux par mois. J’en ai publié une dizaine à L’Obs depuis mon élection, sur des sujets divers. Et puis il y a le livre Les astrocapitalistes que j’ai publié au printemps dernier : je l’ai fini pendant les vacances de fin d’année 2024, en étant déjà député. Je n’avais pas le choix, j’avais déjà repoussé la parution.
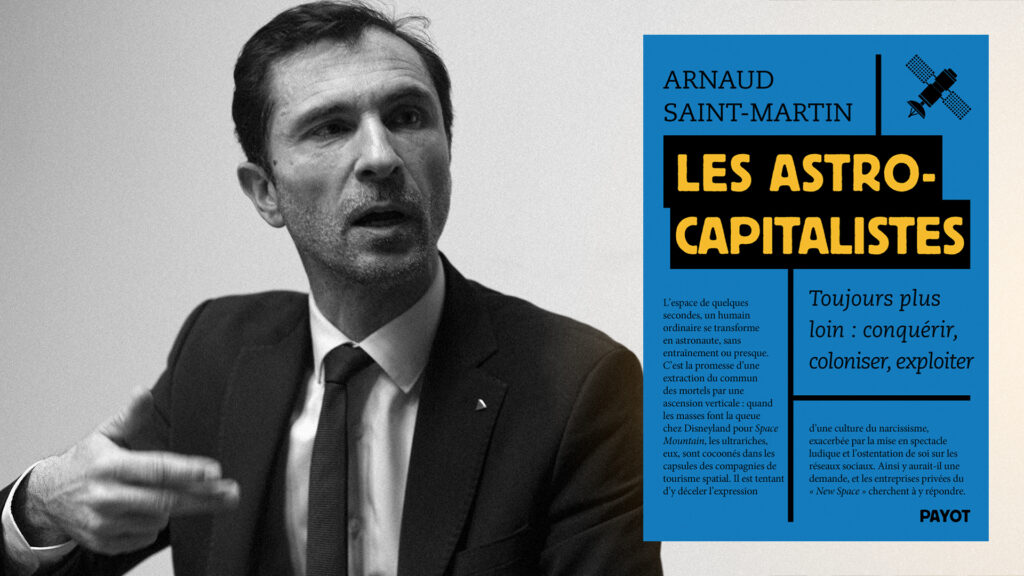
Mais je me suis rendu compte que je n’arrivais plus à écrire “en sociologue” : argumenter, prendre le temps, mettre des points-virgules, ne pas mettre des points d’exclamation partout… (rires) Pendant trois-quatre jours, tout ce que j’ai écrit était franchement nul. J’ai tout jeté. Puis d’un coup, c’est revenu. Et j’ai conscientisé à quel point j’avais perdu l’habitude de l’écriture sociologique. À tel point que la conclusion du livre est assumée comme très politique. Je l’ai écrite le 20 janvier 2025 – jour de l’investiture de Trump et du double salut nazi de Musk – et pour moi, c’était une confirmation de ce que j’avais anticipé. Là, j’ai matérialisé la distinction sociologie/politique : j’avais du mal à revenir à ce que je faisais avant.
Par exemple, je suis officiellement toujours co-directeur de la revue Zilsel. On sort un nouveau gros numéro de plus de 400 pages. Et c’est une douleur de ne pas être de l’aventure : j’ai reçu le PDF, mais je n’ai rien fichu. C’est notre bébé commun avec Jérôme Lamy, mon frère d’arme intellectuel, et je n’ai même pas relu les épreuves. Le pire, c’est que ça ne m’intéresse même pas sur le moment, tellement j’ai de trucs sur le feu. On est pris par le métier de député. Il y a toujours un coup politique à faire, une réunion, un débat… et c’est beaucoup de stress. Et c’est ça tous les jours : tu joues ta vie politiquement. À la fin, évidemment, tu oublies la sociologie.
Raphaël Schneider (RS) : Vous avez parlé d’une mission d’information que vous avez menée avec une députée macroniste. Comment ça se passe ? Vous travaillez ensemble malgré les désaccords ?
ASM : Oui, ça s’est bien passé. Corinne Vignon fait partie des députés avec qui on peut travailler. Il faut préciser : il y a un droit de tirage. Elle avait suggéré l’idée d’une mission pour faire un état des lieux de l’industrie satellite. Mon groupe a proposé d’en être, mon nom a été suggéré, validé par le bureau de la commission de la Défense où nous ne sommes pas majoritaires. La commission est présidée par un collègue macroniste, Jean-Michel Jacques. Donc on s’est rencontrés. Sa circonscription, à Corinne Vignon, est à Toulouse, elle couvre le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES), Airbus… donc elle a un enjeu électoral, de relais des inquiétudes industrielles. Moi, j’avais un intérêt presque “de recherche”, en plus de la nécessité de faire le point politique sur la crise des satellites, mais avec des accès que je n’avais pas avant.
MCM : Des portes qui s’ouvrent ?
ASM : Oui. Beaucoup plus facilement. Maintenant ce sont les PDG qui frappent à ma porte. C’est le jour et la nuit. En tant que sociologue, j’avais un mal fou à ouvrir certaines portes. Là, les gens viennent, invitent, proposent.
On a fait une réunion de cadrage, sur la problématisation. J’ai dit ce que j’attendais, et on était assez d’accord. Et sur la critique de la stratégie industrielle de Macron – un des axes – j’ai trouvé mon homologue macroniste finalement assez offensive : dans les auditions, elle fut critique du programme “France 2030”.
On a été très gourmands. Normalement une mission d’information, c’est trois mois. Les administrateurs de l’Assemblée bossent énormément : invitations, questionnaires, rédaction du rapport… nous on amende. Moi, j’ai copieusement amendé, mais tu peux aussi rester “sur des rails”. De mon côté, je ne suivais pas toujours les questions préparées. Et surtout j’ai invité beaucoup de gens que je voulais entendre : experts de politique spatiale, économistes de l’innovation, sociologues… J’ai amené un cadrage par la science, et ça a “biaisé favorablement” la mission dans ce sens-là. On a réussi à obtenir deux mois de plus. On a rencontré 85 personnes – c’est énorme. Et malgré tout, le rapport est plutôt court.
On a réussi à poser un diagnostic commun. Il y a une cinquantaine de recommandations, et seulement une dizaine sur lesquelles on n’est pas d’accord. On a été reçus à Toulouse, au ministère des Armées, par des généraux… J’ai appris plein de choses. Et je n’aurais jamais eu ces accès comme sociologue. Il y a une rétroaction, clairement.
On a présenté le rapport en commission de la Défense, salle remplie, deux anciens ministres… discussion longue. J’ai pu dire des trucs importants, notamment sur la soutenabilité des activités spatiales. Et le mois suivant, j’ai participé aux assises du spatial de la CGT à Toulouse, avec des camarades syndicalistes de Thales, Airbus, ArianeGroup. J’ai pu rappeler que la politique spatiale, ce n’est pas que les PDG, c’est aussi la base, les travailleurs. Et ça, je l’ai aussi dit en commission. Aujourd’hui, certaines recommandations comptent. On a même fait des recommandations très techniques sur des capacités radar, des “trous” capacitaires… qui se retrouveront prochainement discutées dans le cadre de l’actualisation de la loi de programmation militaire.
Donc oui, on a travaillé en transpartisan. Je n’aurais pas accepté si c’était avec le RN – hors de question, la répulsion est aussi politique que physique. Là, ça a été passionnant. Et on continue d’échanger sur les actualités du spatial.
RS : Vous dites que vous n’avez plus le temps de lire de livres, mais est-ce que vous lisez la presse ? Comment vous informez-vous ?
ASM : On est saturés d’informations. On a une revue de presse quotidienne faite par le groupe insoumis : sur l’actualité, sur ce qui circule, et aussi une veille pour la semaine le lundi matin. Et il y a des boucles Telegram où tu peux demander tel ou tel article. Ensuite, selon nos spécialisations, on reçoit les infos des commissions. On est bombardés. Et après, il y a les abonnements : j’ai Le Monde, Libération, Le Parisien, Mediapart, et des revues de sciences (Cosmos, Epsilon, Ciel & Espace, L’Astronomie, La Recherche, Air & Cosmos,etc.). Je me fais ma revue de presse.
RS : Et les réseaux sociaux ?
ASM : Oui, je passe beaucoup de temps dessus, comme tous les députés. Ça pop-up tout le temps, il y a toujours un truc à partager, et nous on produit aussi des contenus. On participe de la bulle.
Je donne un exemple : récemment j’ai présenté à l’Institut La Boétie notre stratégie spatiale, en réponse à celle de Macron. J’ai proposé ça aux camarades députés, et ça intéressait aussi Jean-Luc Mélenchon. Et au même moment, j’étais auditionné à Matignon dans le prolongement de la mission d’information. Donc j’ai commencé à écrire en mai dernier, et j’ai publié une tribune dans L’Obs : “Misère du macronisme spatial”. Je désosse la stratégie très paresseuse de Macron.
On a élaboré notre document : 30 pages, mais pensé à la ligne près. Et ça a été de la politique pure : arbitrages, formulations, ce qu’on dit et ce qu’on ne dit pas. Par exemple, sur le vol habité : Jean-Luc Mélenchon et Bastien Lachaud y tiennent, moi pas du tout. On a eu des discussions longues et passionnées là-dessus. Et finalement, on a décidé que pour l’instant, on n’en parlait plus : pas parce que ce n’est pas intéressant (au contraire, c’est un révélateur très instructif sur le passé et le devenir du spatial), mais parce qu’il y a d’autres priorités. Sauf que cette absence, c’est des mois de discussion. Ça aussi, c’est de la politique : prendre très au sérieux des questions doctrinales, arbitrer sur des fins, etc.
Et évidemment, dès qu’un journaliste attrape une divergence interne, ça devient “la crise”. Quand on est tous d’accord : “secte”. Quand on discute : “schisme”. Moi, j’ai découvert cette écriture politique, doctrinale, où il faut produire de l’adhésion, de l’inspiration. Sur l’espace, on en fait une “nouvelle frontière de l’humanité” avec la mer et le numérique. Et j’assume aussi des passages plus inspirés : on a une page sur les exoplanètes, la recherche de la vie dans l’univers… c’est à la fois scientifique et politique.
RS : Pourquoi publiez-vous dans L’Obs ?
ASM : J’y ai des contacts. Xavier de La Porte, et Rémi Noyon, qui me donnent carte blanche : j’envoie des textes parfois assez durs, ils me disent “parfait”, ils ne corrigent quasiment rien. En ce moment, c’est presque tous les mois.
MCM : Question qui fâche : comment fait-on pour ne pas se couper du monde réel lorsqu’on gagne 5000 euros par mois, voire plus ? Raoul Hedebouw dit : “quand on ne vit pas comme on pense, on finit par penser comme on vit”. À LFI, les salaires des députés ne sont pas plafonnés, contrairement au Parti du Travail de Belgique.
ASM : C’est une question que je me pose. On entend souvent que les députés gagnent 7000, mais c’est du brut. Moi je suis à environ 5000 net une fois retranchés les impôts sur le revenu, et ensuite il y a la cotisation au parti, aux assos, les contributions quand il y a des caisses de grève… Au final, je suis à peu près à l’équivalent de ce que je gagnais avant en cumulant CNRS, édition, droits d’auteur. J’étais arrivé à 4000, et là je suis autour de 4500. C’est beaucoup, j’en suis conscient. Je ne sais pas jusqu’à quel point c’est justifiable, mais c’est comme ça. Et moi ce que j’observe, c’est l’investissement dans le travail : parfois j’ai envie de dire “mais vas-y… prends le salaire, fais pareil”. Je ne dis pas ça pour héroïser : juste, il faut mesurer l’intensité.
Pour moi, la politique n’est pas une carrière. J’y passerai le temps qu’il faudra, mais je ne vais pas y faire ma vie. Ça demande beaucoup de sacrifices. Et je n’ai même pas le temps de dépenser l’argent : le peu que j’économise, c’est du matériel d’astronomie, d’ailleurs j’ai tout déclaré – j’ai vérifiable sur le site de la HATVP dans la section patrimoine.

Je ne fais pas ça pour l’argent et je ne vois personne faire ça pour l’argent dans mon groupe. Ce que je vois, c’est surtout l’usure physique, les sacrifices personnels et familiaux. Quand tu es là 15 heures par jour, 7 jours sur 7, et que tu n’as pas vu ta fille de douze ans depuis quinze jours… ambiance. Ce n’est pas pour faire pleurer, mais la critique du parlementarisme peut être démagogique. Oui, il y a des députés qui n’en foutent pas une. Mais moi, je ne cumule pas. J’aurais pu garder des mandats locaux, 500 euros de plus : je les ai confiés à des camarades insoumis qui ont pris le relais – avec efficacité en plus. Je suis en disponibilité du CNRS : carrière gelée. J’aurais pu demander un détachement. Et je continue à diriger des thèses, à participer à des comités, gratuitement. Donc ce n’est pas à moi qu’on fera la critique d’un investissement intéressé !
RS : Mais est-ce que le problème n’est pas mal posé ? On sent que vous n’êtes pas un individu cupide… Mais est-ce que des gens comme vous ne sont pas conduits à se dire qu’ils y passent trop de temps, que l’organisation de la vie de député n’est pas normale, trop chronophage, et donc veulent lâcher l’affaire ?
ASM : En effet, on nous en demande beaucoup. C’est un boulot pas possible. On attend de moi que je sois en circonscription samedi, dimanche : je suis allé au marché. Les administrés sont contents de me voir, mais aussi : “Ah, ça fait longtemps qu’on ne vous a pas vu… Ah, vous êtes là ?” On te demande d’être partout. Et moi je réponds : “Vous m’avez élu pour quoi ? Pour voter des lois ! Pour être au Parlement !”
Et à La France insoumise, on s’en colle un peu plus : il y a le travail parlementaire, mais il y a aussi tout ce qu’on se colle à côté. Je suis par exemple député référent dans le Cher. Je dois développer le mouvement à Vierzon, Bourges, dans des villages. J’ai fait ma tournée cet été en voiture. Et en même temps, je suis député de Seine-et-Marne. Donc oui, c’est très haché, il y a des urgences permanentes. L’agenda parlementaire évolue tout le temps. On a des votes solennels, il faut être là pour presser le bouton. J’ai des rendez-vous que j’ai décalés quatre fois. L’agenda est constamment réactualisé.
Et puis il y a l’organisation matérielle. J’ai l’enveloppe de 12 000 euros pour constituer mon cabinet : une directrice de cabinet, une attachée en circo, un attaché com, un alternant… mais ce n’est jamais suffisant. Quand c’est le PLF (projet de loi de finances), on reçoit 400 mails par jour. Tous les lobbys écrivent, tout le monde sollicite. Et en circo tu reçois aussi des demandes de rendez-vous, souvent sur des sujets qui ne relèvent pas de ta compétence : régularisations, logement, dossiers inextricables. On intervient auprès du préfet, on écrit à la région pour aider un maire à obtenir une subvention… tout un travail de coulisses.
Et puis il y a la représentation : être sur les marchés, les cérémonies… Moi je le fais, j’adore même aller sur les marchés avec mon écharpe : je sors la table, les tracts, je vais parler aux gens. Mais c’est du temps que je ne consacre pas aux tâches ici à l’Assemblée. Il faut arbitrer en permanence. Et le danger, c’est de se faire aspirer : burn-out. Il y en a. Ou alors les substances dopantes pour tenir – je n’y ai pas recours. Il y a une usure physique du mandat.
Aujourd’hui on est aspirés par des flux d’informations : on est constamment “sur le grill”. Injonction à être présent, à être pertinent, à rendre des comptes. Moi je le fais : j’ai une page Facebook qui est un journal de bord, j’écris tous les jours ce que j’ai fait. Certains disent que je “tartine” trop, mais je préfère ça à l’inverse.
RS : Ça, c’est votre effet chercheur, votre capital culturel.
ASM : Oui, peut-être. Mais je vois aussi que des gens aiment qu’on prenne la politique au sérieux. Je me souviens des discussions avec un militant qui a connu Solférino dans les années 80. Il me dit : “Tout ce que tu fais, tout ce que tu écris…” Il m’encourage et ça fait plaisir – notamment dans les moments de doute, parce qu’il y en a. Les “initiés” voient quand tu fais un travail sérieux, quand tu endosses le rôle à fond et avec une certaine sincérité d’engagement. Pour moi, c’est un ressort fondamentalement éthique. Je suis élu pour servir l’intérêt général : je pèse mes mots.
Et je ne vais pas faire semblant : je suis député, je suis dans la classe politique. Et si on veut faire bien le boulot, c’est impossible et ingrat. Et oui, j’en vois qui font un travail de fond énorme depuis des années, au point d’y laisser parfois leur famille.
MCM : Comment votre milieu professionnel a accueilli votre élection ? En tant qu’insoumis ? La bourgeoisie culturelle aime bien critiquer Mélenchon, mais finalement elle vote pour lui : il y a quelque chose d’hypocrite…
ASM : Déjà, ça fait longtemps que je fais de la politique : conseiller municipal, je ne l’ai jamais caché. Mon employeur le savait. J’ai toujours porté les couleurs de LFI, sans dissimulation. Et surtout, j’ai toujours travaillé une division claire entre science et politique, par honnêteté : ça nuit au mouvement politique si tu mélanges tout, et ça nuit à la science aussi. Quand je fais de l’expertise, des débats publics, c’est le sociologue qui intervient – ce que Michael Burawoy appelle la sociologie publique. Et quand j’étais sur un plateau de France Culture ou Inter (enfin, ça c’était avant : je ne suis hélas plus invité), je reformulais souvent : “Vous vous adressez à qui ? Au sociologue ?” Et selon ça, j’aménageais ma réponse.
Ce qui me frappe, dans les discussions avec des collègues et amis, c’est le niveau de méconnaissance du champ politique. Y compris chez des gens dont c’est le métier d’étudier la politique ! Il y a des approximations, des projections… une méconnaissance de la matérialité politique. Plus je m’approche des cercles du pouvoir, plus ça “dédramatise” la politique. Tu vas à la buvette, et tu as Marine Le Pen à un mètre : coprésence vertigineuse. Interagir avec un ministre, je sais faire désormais, ça ne m’impressionne plus. Matignon, je vois ce que c’est. L’Élysée aussi.
Et il y a des lieux où c’est encore plus frappant : l’IHEDN par exemple (Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale) où je suis auditeur cette année. Je fréquente des colonels, des généraux, des gens qui ont pris de grandes décisions. Franchement, ça dédramatise complètement. À l’école militaire, ça a “défrisé” d’avoir un député insoumis dans une section souvent perçue comme à droite : je suis devenu une sorte de curiosité, voire de mascotte (rires). On passe de bons moments, et il y a des gens passionnants.
Donc j’ai maintenant une connaissance approchée du pouvoir, très empirique, mais pas comme un sociologue qui ferait un terrain : comme quelqu’un qui est dans le game. Et quand j’entends certains universitaires parler de politique, je me dis parfois : “bof”. Ils n’ont pas les éléments d’un insider. Moi, par exemple, le mardi à 11h, j’ai la réunion du groupe parlementaire LFI. Je sais ce qu’il s’y passe, et je ne dirai pas ce qu’il s’y passe, évidemment : c’est le fight club (rires). Mais de l’intérieur, ce n’est pas ce que racontent certains dans des essais mal fichus et mensongers sur une inscrutable “meute”. Et tant mieux si ça ne sort plus. Parce que parmi les points communs entre science et politique, il y a la discipline. Pas au sens autoritaire : au sens de ce qu’on construit ensemble, avec de la confiance, pour pouvoir se dire les choses franchement sans que ça se retrouve dans la presse, et pour avancer ensemble selon une ligne travaillée collectivement.
MCM : Parce qu’il n’y a pas la crainte que ça se retrouve dans les colonnes du Canard enchaîné ou du Monde…
ASM : Exactement. Et donc on peut avoir des débats durs, des débats de fond. Sur la stratégie spatiale, ça a été sportif : on n’était pas toujours d’accord sur tel ou tel point, ou à tout le moins il fallait préciser. Ça a pris du temps. Et moi j’ai bougé sur ma ligne, j’ai accueilli celle d’autres camarades. La ligne finale est bien plus intéressante que ce que j’avais proposé initialement. La friction produit de bonnes choses !
Et puis il y a aussi des cadres très concrets : quand tu es briefé DGSE ou DGSI, ou avec l’état-major, ton téléphone reste à l’entrée. Ça, en tant que sociologue, je n’y avais pas accès. Comme député, ma connaissance est plus fine.
Donc oui : ça donne envie d’écrire une sociologie de l’intérieur. C’est en négociation avec un éditeur, je n’en dis pas plus. Mais évidemment que je vais mettre à profit cette connaissance.
MCM : Il y a régulièrement des attaques contre Mélenchon : antidémocratisme, antisémitisme supposé… Mais j’ai l’impression qu’aujourd’hui l’argument principal, ce n’est même plus le fond : c’est le sondage. Et l’idée qu’il perdrait automatiquement face à Bardella au second tour. Qu’en pensez-vous ?
ASM : C’est le bruit de fond médiatique, on ne va pas faire semblant que ça n’existe pas. Moi je vais répondre de façon empirique, donc forcément biaisée. Je le connaissais de loin avant d’être député, comme militant insoumis depuis 2017, j’avais déjeuné avec lui une fois en 2023. Depuis que je suis à l’Assemblée, on s’est vus plusieurs fois. Je l’ai fait venir à Toulouse pour un colloque de l’Institut La Boétie sur l’espace. Je l’ai fait venir aussi aux Rencontres du Ciel et de l’Espace. On échange beaucoup sur l’astronomie, la science, le spatial. Il me demande mon avis. On a des discussions riches sur les trous noirs, l’univers, les technologies spatiales… C’est rare chez un responsable politique !
Moi, je l’admire très sincèrement : sa capacité de travail, sa curiosité, sa capacité d’étonnement. Quand j’écris une tribune, il veut qu’on lui envoie : ça l’intéresse. Et il fait ça avec beaucoup de députés et de militants. Il avance, y compris sur sa propre ligne.
À Toulouse, c’était la première fois que j’organisais un colloque en tant que député : il y avait du monde, beaucoup de panels J’ai mis l’événement sur notre plateforme Action Populaire le mardi pour le samedi : la salle était blindée. Juste avant, on a parlé une heure d’astronomie. Et la “Nuit des étoiles” aux Amfis d’été en août 2025 : c’est son idée, moi je l’ai mise en œuvre. Il a une vraie appétence intellectuelle.
Et ensuite, tu le ramènes dans la salle : tu vois l’effet Mélenchon. Je n’ai pas vu ça avec d’autres. Aux Rencontres du Ciel et de l’Espace, à la Villette, je lui dis : “Viens, je vais te montrer l’astronomie amateur.” Il reste cinq heures, je lui fais rencontrer tout le monde : Association Française d’Astronomie, Société astronomique de France, rédactions, astronomes amateurs, vendeurs d’instruments… Il trouve ça génial. Et personne ne s’est plaint. Au contraire : selfies en continu !
Après, oui, on tracte souvent vent de face. En 2021, tout le monde disait qu’il fallait qu’il se retire, qu’il avait fait son temps… Et au premier meeting présidentiel, c’était énorme. Personne ne fait ça à gauche. Je discute avec des socialistes, des écolos : ils voient l’Institut La Boétie, ils jalousent. Ils copient même : l’académie Léon Blum du PS, c’est une copie conforme, mais sans les intellos (rires).
Jean-Luc Mélenchon, c’est un chef d’orchestre. Je vais souvent au “moment politique”, je suis bluffé : 1h30, il met en intrigue, il fait de l’éducation populaire, il commence large, resserre, redécolle, finit sur l’espoir, avec de l’humour, beaucoup de savoir, des références savantes. À son âge, quelle machine ! Moi, quand je fais des meetings je m’épuise au bout d’une demi-heure.
Et Bardella… comment dire… pour moi c’est une tranche de jambon sous cellophane. Comme Glucksmann. À gauche, il n’y a pas de concurrence à ce niveau-là : ils se feront atomiser. Et en plus, il y a une relève très forte à LFI : Bompard, Guetté, Clouet… des valeurs sûres et un énorme potentiel. Et il y a aussi des gens pas encore visibles : des collaborateurs du groupe parlementaire qui se forment, des militants partout dans les groupes d’action, beaucoup d’envie et de savoir-faire. Si on gagne en 2027, il faudra un gouvernement, un groupe 2.0… tout ça se prépare. Nous y sommes prêts.
Donc je refuse l’effet “oracle”, le fatalisme, les prophéties autoréalisatrices neurasthéniques (j’ai trop lu Merton pour m’y faire prendre). Moi, je ne devais pas être député : ma circo était à droite depuis 40 ans. Campagne dure, triangulaire… et j’ai gagné. Je n’ai pas dormi pendant des semaines. Si j’avais écouté les oiseaux de mauvais augure, je n’y serais pas allé. Donc aujourd’hui, quand on me dit : “en cas de dissolution ça va être compliqué”… je réponds : forcément ! Livrons bataille de bon cœur et en conviction ! Quoi qu’il arrive, il va falloir venir nous chercher. C’est le couteau entre les dents.
MCM : Avant la présidentielle, il y a d’abord les municipales en mars prochain. En 2020, les insoumis avaient enjambé ces élections. Cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. Et il y a des victoires de gauche dans des métropoles états-uniennes : Zohran Mamdani à New York, Katie Wilson à Seattle… Est-ce que ça nous apprend quelque chose ou le contexte est trop différent ?
ASM : Je pense que c’est “bon à penser”. Ça existe. Et c’est une mine radicale et joyeuse. Ça donne envie – et ça, c’est la clé. Il ne suffit pas de produire de l’adhésion rationnelle, de l’adhésion sur le fond : il faut que les gens aient envie d’y aller, qu’ils puissent convaincre autour d’eux. Il faut élargir et susciter de l’enthousiasme.
Moi, les campagnes qui marchent chez moi, c’est des campagnes offensives, combatives et joyeuses. Je chambre les adversaires, et je fonctionne beaucoup à l’auto-dérision. Les militants ne se privent pas de se moquer de moi quand je fais une connerie. Hier, j’ai reçu un détournement où j’apparais en curé sur une photo, parce que j’avais pris en photo la crèche de Melun. Une copine a fait un montage, je l’ai relayé. Ça participe de la distance au rôle. Le jour où je n’arrive plus à rire de moi, ce sera mauvais signe. Je déteste l’esprit de sérieux.
MCM : Vous faites beaucoup de porte-à-porte aussi.
ASM : Oui. Et beaucoup pensent que tout se passe sur les réseaux. Mais là, par exemple, j’accompagne Rémy Béhagle, le candidat LFI aux municipales à Melun : samedi après-midi, porte-à-porte dans un quartier populaire où je suis bien reçu, où les gens me connaissent, parce que j’ai mené des combats “en désintéressement”. J’ai fait le lien entre journalistes et habitants, avec les autorités administratives, sans apparaître : je ne fais pas ma retape. Et les gens le voient : ils me disent que je n’instrumentalise pas. Pour moi, c’est un critère moral important.
J’adore le porte-à-porte. Tu entres dans la vie des gens. Certains ouvrent en short, claquettes. Moi j’y vais en cravate : je suis député (rires). Et tu as de tout : des sourires, des discussions, du désarroi, de la souffrance. Quand tu visites une tour de 15 étages, c’est long et fastidieux, mais tu auras vu tout le monde. Et surtout, ça produit des effets durables. Il y a des gens aujourd’hui militants à Melun qui ont découvert LFI comme ça, parce qu’on a toqué chez eux. On a un jeune de 19 ans, génial : des Insoumis ont toqué chez lui pendant ma campagne, c’était la première fois qu’une force politique venait jusqu’à lui. La politique est venue à lui. Et maintenant il est dans l’équipe. Donc oui, on amène des gens à la politique et on en est fiers. Pas à des fins électoralistes : il faut construire au ras du sol un lien politique, parce qu’on croit à une cause, et entretenant le lien. C’est de la haute couture politique.
Et on ne va pas seulement dans les endroits où c’est facile. Ma circo c’est 130 000 habitants. À Melun je fais des scores… très hauts. À Barbizon, je fais 16 voix. Eh bien j’y vais. Je vois les maires, souvent de droite. Et on parle service public, transport scolaire, etc. Tu peux parfois atténuer des problèmes concrets.
Sur les municipales, il y a un enjeu : on a fait la convention LFI à Aubervilliers. J’ai trouvé ça super beau. Et le mouvement réfléchit : on a théorisé le communalisme insoumis, on travaille avec des politistes – des collègues que je côtoyais naguère à l’EHESS où j’ai mon bureau. On actualise le programme. Et localement, c’est à géométrie variable : parfois on y va seuls, parfois en alliance, selon les configurations. Quand on peut y aller seuls, on met la pression en “mouillant la chemise”. Les habitants nous voient faire.
Moi, ce que je constate, c’est que d’autres partis de gauche ne savent plus militer. J’ai fait des négociations interpartis : “Vous amenez quoi ?” À part la soupe de logos, ta place sur la liste… c’est quoi votre plus-value en termes d’actions et d’apport d’idées ? Souvent, rien : tambouille. Ça me déprime et c’est la raison pour laquelle je ne m’étais pas mouillé en politique. Le PS et le PCF, comme j’ai pu le constater dans des négociations, ne veulent qu’une place pour pouvoir peser aux sénatoriales… Bon. Après, il y a aussi des endroits où ça se passe bien : à Dammarie-les-Lys, dans ma circo, on est derrière le PCF, et je l’ai fait valider par notre comité électoral.
Mais une chose est sûre : il faut se développer dans les mairies. En tant qu’ancien élu local, je peux dire que c’est passionnant : éducation, voirie… La voirie, ça paraît chiant, mais c’est super intéressant : pistes cyclables, bancs, éclairage, maintenance – c’est hyper politique, en fait. J’ai même déposé une proposition de loi pour préserver l’environnement nocturne. Et j’ai fait venir à l’Assemblée Patrick Proisy, le maire de Faches-Thumesnil, une des rares mairies insoumises. Ils font l’extinction partielle, ils appellent ça des “radicalités concrètes”. Dans une ville de 20 000 habitants, ils font des trucs super.
Et c’est dommage de laisser toutes ces communes aux socialistes qui font une gestion interchangeable avec la droite. Moi je l’ai vu dans les structures intercommunales, les EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) : le clivage droite-gauche s’efface, on fait de l’“attractivité économique”, des compétences techniques, des acronymes… et ça tue la politique. Ça a puissamment détruit le lien des citoyens avec la chose publique au niveau local.
Quand j’étais élu d’opposition, je prenais la parole pour dire : “si j’étais au pouvoir, on démonterait cette structure”, et j’argumentais. Il faut repolitiser ces espaces, remettre les pieds dans le plat, conquérir des mairies, pour transformer concrètement la vie des gens.
C’est aussi pour ça qu’on n’enjambe pas les municipales cette fois-ci : on a affiné la ligne, y compris sur des sujets très techniques. La gestion d’une commune peut être chiantissime, le défi c’est de rendre ça intéressant — et de faire revenir les gens en politique.

Entretien réalisé par Manuel Cervera-Marzal et Raphaël Schneider, à l’Assemblée nationale, le 1er décembre 2025.
Pour prolonger
- Pour Bourdieu, beaucoup de choix « personnels » (école, goûts, culture) sont en réalité socialement fabriqués et reproduisent des hiérarchies ; pour Boudon, ces choix s’expliquent par des calculs raisonnables dans une situation donnée. En simplifiant, Bourdieu décrit la façon dont le social façonne les individus, quand Boudon montre comment les individus raisonnables façonnent du social – et la querelle tourne autour du poids relatif de ces deux niveaux.
 ︎
︎ - En 1996, le physicien Alan Sokal publie un article volontairement absurde dans la revue Social Text. Truffé de références savantes mal comprises et de jargon postmoderniste, le texte visait à montrer que certains discours relativistes pouvaient être acceptés sans véritable contrôle scientifique, dès lors qu’ils flattaient une orientation idéologique. Dans la foulée, Sokal publie avec le physicien Jean Bricmont le livre Impostures intellectuelles (1997). L’ouvrage critique l’usage abusif ou métaphorique de concepts issus des sciences dures (mathématiques, physique) par certains intellectuels français (Lacan, Kristeva, Deleuze, Baudrillard, etc.). Leur thèse centrale est que cet usage confus brouille la frontière entre rigueur scientifique et rhétorique, et affaiblit la crédibilité des sciences humaines et sociales.
 ︎
︎
17.12.2025 à 17:34
Les états désunis du dollar
Texte intégral (5663 mots)
« Dans les événements historiques, écrivait Tolstoï, les prétendus grands hommes ne sont que des étiquettes qui doivent leur nom à l’événement ». C’est aussi vrai des hommes grotesques que l’histoire appelle parfois à la rescousse lorsque les grandes issues sont bouchées. Ainsi la publication en novembre 2024 du Guide de l’utilisateur pour la restructuration du commerce mondial1par Stephen Miran, futur conseiller économique de Donald Trump, nous révèle qu’avec sa personnalité brutale et imprévisible, l’homme d’affaires est, avant de provoquer des situations politiques nouvelles, l’homme de la situation. Car dans la conduite d’une guerre tarifaire débutée déjà de longue date par les États-Unis, « l’incertitude quant à savoir si, quand et dans quelle mesure cela se produira renforce le pouvoir de négociation en suscitant la peur et le doute »2. Mais de quelle négociation s’agit-il ?
Le dollar : du privilège exorbitant au fardeau exorbitant
Le rapport de Miran s’appuie sur un constat désormais classique sur la position commerciale des États-Unis. Le dollar étant demandé comme monnaie de réserve internationale en plus de ses fonctions domestiques, il est surévalué relativement à l’état de la balance commerciale des États-Unis. Or cette surévaluation ne cesse d’aggraver son déséquilibre avec le reste du monde, étant donné qu’un dollar fort grève la compétitivité de l’industrie domestique et rend meilleur marché les produits importés. C’est pourquoi le privilège exorbitant du dollar, qui permet à son émetteur de financer indéfiniment ses déficits courants – par l’émission de bons du Trésor –, s’est transformé selon Miran en un fardeau exorbitant, à mesure que décline la part des États-Unis dans la croissance du PIB mondial.

Car plus cet écart de croissances s’élargit, plus la demande de dollar comme monnaie de réserve augmente relativement à la part déclinante des États-Unis dans le commerce mondial, et plus aussi se creusent les déficits courants3. Or avec cet écart, augmente du même coup le risque d’une perte de confiance dans le dollar, et surtout dans le bon du Trésor, placement favori de l’épargne mondiale, grâce auquel l’État finance son déficit. Il s’agit donc de prendre les mesures qui restaurent la compétitivité des États-Unis, mais sans affaiblir le dollar dans son statut d’actif de réserve. Bref : un dollar fort pour sa fonction de réserve de valeur, et faible pour sa fonction de moyen d’échange.
L’impossible répétition de l’Accord Plaza
N’est-ce pas ce qu’avait su faire Reagan en 1985, en faisant signer à l’hôtel Plaza de New York un accord des pays du G5 sur une action concertée de dépréciation du dollar sur le marché des changes ? Le dollar pouvait bien baisser, il était en ce temps-là la monnaie de réserve incontestée du capitalisme mondial. Mais surtout, Miran sait bien que la Chine de 2025 n’a pas les dispositions conciliantes du Japon de 1985, que l’UE n’a plus l’aisance commerciale de l’Allemagne d’hier.
À défaut de nouveaux Accords du Plaza4 avec les grandes puissances économiques du moment, Miran appelle au lancement d’une guerre commerciale ouverte frappant leurs exportations, et les forçant à s’ouvrir aux produits états-uniens. Bien plus, cette offensive tiendrait lieu de guerre préventive avant la signature d’un nouvel accord, cette fois sous les ornements douteux de la résidence floridienne de Trump à Mar-a-lago. Les experts ont beaucoup ironisé sur la malheureuse comparaison entre les Accords du Plaza et d’hypothétiques Accords de Mar-a-Lago : non seulement les États-Unis ne sont plus entourés de leurs bons alliés de l’après seconde-guerre mais, surtout, Reagan voulait justement éviter, par ses Accords, des mesures tarifaires agressives que les Démocrates du Congrès réclamaient contre le Japon et l’Europe. En 1985, les États-Unis ménageaient leurs alliés pour consolider un marché mondial dont ils étaient le grand commissaire-priseur : quelques jours après leur signature, Reagan lançait en effet les négociations de l’Uruguay Round dans le cadre du GATT, en vue d’abaisser les barrières douanières dans la perspective de la création de l’Organisation Mondiale du Commerce.
Quarante ans plus tard, c’est avec le pistolet commercial sur la tempe que les États-Unis arracheraient un accord, avec cette fois l’OTAN comme institution d’appui : « Supposons que les États-Unis imposent des droits de douane à leurs partenaires de l’OTAN et menacent d’affaiblir leurs obligations de défense commune au sein de l’OTAN s’ils sont frappés par des droits de douane de rétorsion »5. Si bien que les motifs avancés pour une guerre des douanes se contredisent entre eux : les taxes doivent servir tantôt de moyen de pression, voire de rétorsion, contre les partenaires commerciaux des États-Unis, tantôt à financer durablement les déficits budgétaires et les réductions d’impôts aux entreprises, et l’abaissement des charges sociales, qui sont pour Trump les deux piliers du MAGA. Or avec des droits de douane sur les importations, il faudra s’attendre à une hausse de l’inflation du fait du renchérissement des biens étrangers (les derniers chiffres le confirment6) qui poussera la Fed à relever les taux d’intérêt. Mais des taux élevés stimulent la demande de dollar et donc la hausse du taux de change – et un dollar plus fort qui s’ensuivra augmentera à son tour le déficit commercial des États-Unis.
Et si l’on imagine un instant que les mesures produisent l’effet attendu d’une baisse du dollar, Miran admet qu’elle entraînerait une baisse massive de la valeur de l’épargne mondiale investie en bons du Trésor et donc aussi une vente massive de ces titres qui précipitera davantage encore la baisse de leur valeur. Comme cette vente entraînera une hausse des taux d’intérêt sur ces bons7 et donc une hausse du déficit courant, on forcera les détenteurs étrangers à les échanger contre des obligations à cent ans « zéro coupon », c’est-à-dire ne portant pas intérêt. « Afin d’atténuer les conséquences financières indésirables potentielles (telles que la hausse des taux d’intérêt), la vente de réserves peut s’accompagner d’un allongement de la durée des réserves restantes. La demande accrue de dette à long terme par les gestionnaires de réserves contribuera à maintenir les taux d’intérêt à un niveau bas […] Si l’allongement de la durée se fait sous la forme d’obligations spéciales à cent ans, […] la pression financière sur les contribuables américains pour le financement de la sécurité mondiale s’en trouve considérablement allégée. Le Trésor américain peut effectivement racheter la durée sur le marché et remplacer cet emprunt par des obligations à cent ans vendues au secteur officiel étranger [banques centrales, agences publiques, fonds souverains, etc.]. De tels accords de Mar-a-Lago donnent forme à une version du XXIe siècle d’un accord monétaire multilatéral »8. Mais il faudrait d’abord prendre la mesure XXIe siècle où ce ne sont pas seulement les supposés signataires des accords, mais le dollar lui-même qui a changé de résidence. Aujourd’hui seuls 16 % des réserves en dollars sont entre les mains des banquiers centraux étrangers, contre plus de 60 % circulant entre les comptes des institutions privées du système financier international9. C’est que le dollar n’est plus seulement la grande devise des réserves des institutions officielles de l’axiomatique capitaliste, il s’impose comme le premier véhicule du capitalisme mondial.
Le nouveau dilemme de Triffin
On a beaucoup critiqué Miran pour ses incohérences et simplifications10. Mais ses détracteurs lui font un mauvais procès, car il se débat au milieu d’une contradiction plus profonde, qu’ils feignent d’ignorer plus que lui encore, entre le degré d’autonomie relative du dollar par rapport à son pays émetteur et le niveau de déclin relatif du rôle économique des États-Unis eux-mêmes. En un sens, le dollar est devenu le problème des États-Unis parce qu’il n’est plus seulement, et depuis longtemps, la monnaie des États-Unis. Ainsi dans le commerce, 54 % des transactions sont toujours facturées en dollars, soit 5 fois plus que la part des États-Unis dans le commerce mondial, tandis que sa part dans le PIB mondial n’est plus que de 15 %. Dans les coffres des banques centrales, plus de 60 % des réserves sont déclarées en dollars et ces chiffres sous-estimeraient la réalité du phénomène selon le FMI. En outre, plus de la moitié des pays de notre globe ancrent leur monnaie au dollar et 50 % environ du PIB mondial est ancré au dollar11. Par cet arrimage universel, que le marché des changes manifeste par l’usage du dollar dans près de 90 % des transactions, le dollar jouit plus d’un privilège d’insularité (privileged insularity) que d’un privilège exorbitant : une variation du taux de change n’affecte pas les prix des biens importés libellés dans des monnaies ancrées au dollar. C’est bien cette autonomie qui explique la tournure embarrassée du plaidoyer de Miran, c’est elle qui joue comme un retour du refoulé à chaque objection qu’il fait à ses propres propositions. Il le reconnaît en un sens, en qualifiant la situation des États-Unis de « monde de Triffin » dans lequel « les actifs de réserve constituent une espèce de masse monétaire mondiale, et leur demande dépend du commerce mondial et de l’épargne mondiale, et non de la balance commerciale intérieure ou des caractéristiques de rendement du pays détenteur des réserves »12.
Mais que ce monde a changé depuis que l’économiste Robert Triffin a énoncé son fameux dilemme en 196013 ! Il remarquait que le système monétaire international ne pouvait fonctionner que si le pays émetteur de la monnaie de réserve, les États-Unis donc, créait une quantité suffisante de liquidités pour le commerce mondial. Mais créer de la liquidité, cela revient à financer son commerce sans contrepartie, c’est donc créer des déficits extérieurs (c’est-à-dire des déficits commerciaux et plus généralement des déficits de la balance des paiements du pays émetteur) en alimentant le marché mondial en dollars créés par la planche à billets. Or ces déficits continuels risquaient de saper la confiance dans la monnaie de réserve, car les autres pays se mettraient à douter de la capacité de l’émetteur à garantir la convertibilité du billet vert en or (sur laquelle reposait la valeur du dollar, en tant que monnaie pivot du système de Bretton Woods). Donc, si le pays émetteur ne fournit pas assez de liquidités, le commerce et la croissance mondiaux sont freinés ; s’il en fournit trop en accumulant des déficits, la valeur et la stabilité de sa monnaie sont remises en cause.
La variable ultime : le travailleur états-unien
Triffin ne craignait donc pas tant les déficits (la balance commerciale des États-Unis était excédentaire à son époque) que la convertibilité d’un dollar surabondant sur les marchés mondiaux. Pourtant, la fin de la convertibilité du dollar décidée par Nixon en 1971 n’a pas fait disparaître le dilemme : elle l’a déplacé au niveau de la capacité fiscale des États-Unis à soutenir leur dette publique, et honorer leurs obligations vis-à-vis de ses créanciers. Et ce déplacement tient au rôle nouveau des obligations du Trésor des États-Unis. C’est que, non seulement les banques centrales conservent des dollars sous la forme de bons du Trésor, mais cette quasi-monnaie portant intérêt constitue désormais l’actif sûr pour toutes les opérations financières intervenant aussi bien sur les marchés financiers que dans les systèmes de paiements des banques onshore et offshore dans lesquels le dollar est la monnaie véhiculaire. Aussi le dilemme de Triffin trouve-t-il à s’exprimer désormais dans la contradiction entre l’accroissement des déficits de la balance des paiements (nécessaire à la fourniture de liquidité en dollars pour le reste du monde), et la capacité fiscale des États-Unis à émettre de la dette (pour garantir au dollar sa fonction de réserve de valeur).
D’où l’équation impossible de Miran : baisser la valeur du dollar, c’est affaiblir le statut d’actif sûr qu’est le bon du Trésor, c’est donc augmenter son prix et par là-même le déficit budgétaire des États-Unis. Mais augmenter le déficit, c’est provoquer plus d’inflation et donc baisser la compétitivité des produits domestiques. Miran reconnaît ces difficultés et, devant la fragilité de ses propres mesures, finit toujours par recourir à la seule variable économique encore aux mains du politique en matière de dollar : la force de travail. Si le taux de change augmente par suite de la hausse des tarifs – du fait de la hausse de la demande de dollar qui s’ensuivra, « [l]es décideurs politiques peuvent en partie atténuer les freins aux exportations par un programme de déréglementation agressif, qui contribue à rendre la production américaine plus compétitive »14. Et même si, comme l’espère Miran, le taux de change n’augmente pas, ce sera au travailleur américain de payer pour la hausse des tarifs en achetant plus cher ses biens de consommation, d’où, là aussi, une baisse de son salaire réel.
Les fissures chinoises du mur tarifaire
Jusqu’ici nous avons à peine évoqué la Chine. C’est elle pourtant qui justifie la tournure martiale du commerce extérieur voulue par Miran : « Les pays qui souhaitent bénéficier du parapluie militaire doivent être aussi sous le parapluie du commerce équitable. Un tel outil peut être utilisé pour faire pression sur d’autres nations afin qu’elles se joignent à nos droits de douane contre la Chine, créant ainsi une approche multilatérale en matière de droits de douane »15. Dix-huit siècles après que la Chine a débuté la construction de la Grande Muraille pour repousser les menaces de ses voisins barbares, c’est au tour de ces derniers d’ériger autour d’elle un « Mur tarifaire mondial ». On dirait que l’administration Trump a inventé une nouvelle variante de la formule de Clausewitz qui fait du commerce l’anticipation de la guerre par d’autres moyens que la politique. Pour le secrétaire au Trésor Scott Bessent, une segmentation plus claire de l’économie internationale en zones fondées sur des systèmes économiques et de sécurité communs contribuerait à mettre en évidence la persistance des déséquilibres et à introduire davantage de points de friction pour y remédier »16. C’est au fond la seule certitude de Miran : quels qu’en soient les effets, ses mesures dessineront une démarcation plus nette entre amis et ennemis, et élèveront les risques de sécurité.
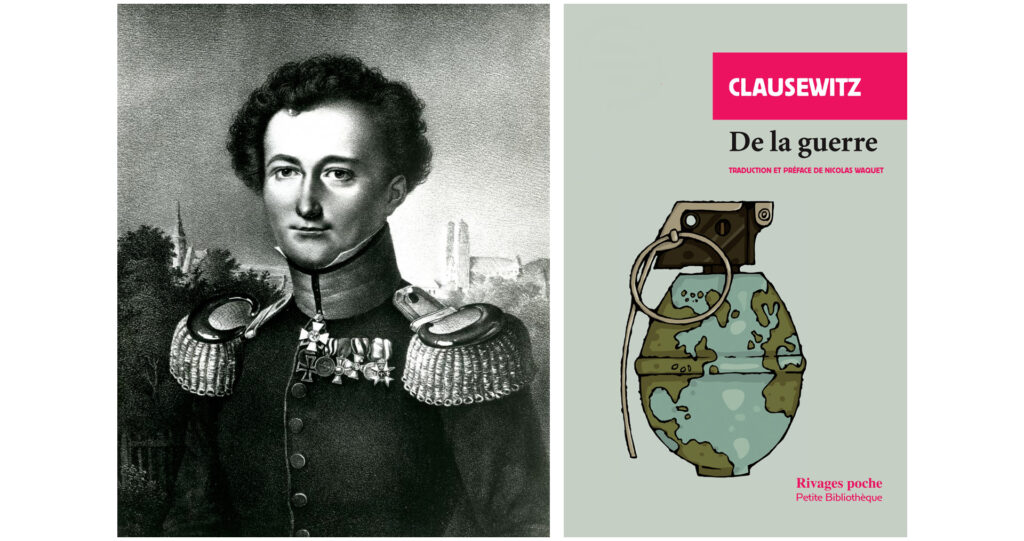
Mais Miran s’attend aussi à ce que ces grandes manœuvres précipitent la recherche d’alternatives au dollar, déjà en marche avec le yuan qui, même s’il ne représente encore que 4% des paiements internationaux et 2% des réserves de change mondiales, a vu sa part doubler depuis 2022. Dans le commerce chinois, son usage dans le règlement des transactions est passé de 14% en 2019 à plus de 30% aujourd’hui, et plus de 50% des flux transfrontaliers sont désormais effectués dans cette devise, contre moins de 1% en 2010. Si l’on veut savoir pourquoi Trump cherche à sortir du bourbier ukrainien, il faut moins consulter les chiffres du Trésor états-unien que les statistiques du système bancaire chinois : la Banque centrale chinoise a fourni 4,5 trillions de yuans (environ 630 milliards de dollars) de lignes de swap à 32 banques centrales, et le système de paiement CIPS, l’équivalent chinois de SWIFT, accueille désormais plus de 1 700 banques, soit une augmentation de 3% depuis 2022 et gère un volume de paiements qui ont grimpé de 43% en 2024, atteignant 175 trillions de yuans (environ 24 trillions de dollars). Quant aux prêts extérieurs des banques chinoises en yuan, ils ont triplé depuis 202217. La Chine ne s’oppose pas à la mondialisation par une réorganisation sino-centrée du marché mondial18, elle relance la mondialisation de tous les marchés en renouvelant les institutions de la finance mondialisée.
Le retour du réel après le Liberation Day
Près de huit mois après le « Liberation Day » dont Trump espérait surtout qu’il libèrerait les États-Unis des lois du commerce international, son administration semble admettre au moins que, si la hausse des droits de douanes a des effets incertains sur les prix, une baisse de ces droits doit assurément diminuer les prix des biens concernés. Aussi face à un pouvoir d’achat qui ne cesse de s’éroder, elle s’est résolue à une baisse drastique des droits de douane sur certains produits alimentaires, textiles, et même pharmaceutiques, importés d’Amérique latine.
Mais ce n’est pas tout : le « Liberation Day » devait aussi, grâce au recours à la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux (IEEA), libérer Trump du droit de regard du Congrès dans la conduite de sa guerre commerciale. Il a sans doute touché ici aux limites institutionnelles que même ses plus fervents partisans à la Cour suprême ne sont pas prêts à voir repousser. Ainsi la Cour a récemment émis un avis plus que réservé sur cet expédient, manière de mettre en doute l’urgence sécuritaire de la balance commerciale de la première puissance mondiale19. C’est pourtant bien à l’Est de l’Occident que se découvrent les grandes différences avec l’époque des Accords du Plaza : en 1985, Gorbatchev jetait, avec la perestroïka, l’URSS dans les bras sauvages du capitalisme ; en 2025, Xi Jinping invite tous les chefs d’État du Sud Global à contempler la grande armée chinoise qui bientôt montera la garde partout où transitera son commerce universel. Tandis qu’à la Maison Blanche, aujourd’hui, la spéculation immobilière a remplacé la conquête du Far West.
- Stephen Miran, « A User’s Guide to Restructuring the Global Trading System », Hudson Bay Capital, Novembre 2024 : https://www.hudsonbaycapital.com/documents/FG/hudsonbay/research/638199_A_Users_Guide_to_Restructuring_the_Global_Trading_System.pdf
 ︎
︎ - Stephen Miran, Op. Cit., p. 22.
 ︎
︎ - Un déficit courant signifie qu’un pays importe plus qu’il n’exporte de biens et services, même s’il faut inclure dans la balance courante les revenus nets comme les intérêts et dividendes, ainsi que l’aide à l’étranger.
 ︎
︎ - Les pays signataires des Accords du Plaza s’étaient engagés à stimuler la demande intérieure pour favoriser leurs importations et à intervenir sur le marché des changes par des ventes de dollars et des achats d’autres devises.
 ︎
︎ - Stephen Miran, Op. Cit., p. 26.
 ︎
︎ - https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm
 ︎
︎ - Les rendements obligataires étant fixes, une baisse du cours des obligations fait monter le taux d’intérêt et inversement.
 ︎
︎ - Stephen Miran, Op. Cit., p. 29.
 ︎
︎ - Michael Bordo et Robert McCauley, “Miran, we’re not in Triffin land anymore”, VoxEU.org, 7 avril 2025 : https://cepr.org/voxeu/columns/miran-were-not-triffin-land-anymore
 ︎
︎ - Kenneth Rogoff, « Trump’s Misguided Plan to Weaken the Dollar », Project Syndicate, 6 Mai 2025 : https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-administration-mar-a-lago-plan-to-weaken-dollar-is-deeply-flawed-by-kenneth-rogoff-2025-05
 ︎
︎ - https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/the-international-role-of-the-u-s-dollar-2025-edition-20250718.html
 ︎
︎ - Stephen Miran, Op. Cit., p. 6.
 ︎
︎ - Robert Triffin, The gold and the dollar crisis: the future of convertibility, Princeton University Press, 1960.
 ︎
︎ - Stephen Miran, Op. Cit., p. 17.
 ︎
︎ - Ibid., p. 23.
 ︎
︎ - Ibidem.
 ︎
︎ - https://www.economist.com/china/2025/09/10/china-is-ditching-the-dollar-fast
 ︎
︎ - Benjamin Bürbaumer, Chine/États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation, La Découverte, 2024.
 ︎
︎ - https://www.ft.com/content/f4420b48-0ed3-4f32-9b72-7ff90365ff93
 ︎
︎
10.12.2025 à 17:41
Pourquoi Mélenchon va gagner en 2027
Texte intégral (5105 mots)
Jean-Luc Mélenchon constitue, pour l’ordre établi, une menace d’une rare intensité. Les grandes fortunes, dont l’influence s’exerce bien au-delà de leurs entreprises, voient dans ses propositions fiscales et sociales une remise en cause frontale de leurs intérêts. Bernard Arnault ou Vincent Bolloré comprennent parfaitement qu’un gouvernement appliquant la lutte contre les oligopoles, la taxation massive des dividendes et la démocratisation des médias porterait atteinte à des positions héritées depuis des décennies. Les forces de l’ordre savent également que Mélenchon est l’un des rares responsables politiques à dénoncer explicitement les violences policières et à proposer des mécanismes institutionnels pour les prévenir et les sanctionner. Les tenants du productivisme et ceux qui profitent de l’écocide redoutent la planification écologique des insoumis, pensée pour rompre avec l’impunité climatique. Enfin, les partisans du macronisme – qu’il s’agisse des élites politiques qui ont bénéficié du quinquennat ou de ceux qui profitent de la casse sociale menée au nom de la raison – identifient en lui le seul adversaire capable de renverser l’ordre qu’ils ont patiemment construit.

Le candidat qui dérange
C’est pour ces raisons qu’il est depuis dix ans la cible de tentatives de disqualification systématiques : tantôt présenté comme un chef autoritaire, tantôt comme un agent d’influence poutinien, tantôt comme un antisémite qui s’ignore, il est aujourd’hui attaqué sur un tout autre terrain. On ne conteste plus ses idées, son programme, ni même sa stratégie. On affirme simplement qu’il serait battu d’avance au second tour face à Jordan Bardella.
Cet argument révèle moins la faiblesse supposée de Mélenchon qu’il ne dévoile la vacuité doctrinale de ses rivaux, incapables d’articuler une critique de fond et condamnés à répéter les prophéties de cabinets de sondage appartenant à des groupes possédés par des milliardaires ou par des individus dont l’accointance avec l’extrême droite est dûment documentée. Ces instituts se sont lourdement trompés pour les législatives de 2024 – sur 31 sondages réalisés, 31 donnaient le Rassemblement national vainqueur, devant le Nouveau Front Populaire. Aucun d’entre eux n’a présenté le début d’une excuse. Aucun n’a procédé à la moindre réforme de ses « méthodes » (les guillemets s’imposent à la lecture de la récente enquête d’Hugo Touzet, qui dévoile le vide abyssal sur lequel repose leurs données). Il serait naïf, et coupable, de leur accorder une autorité prédictive sur une configuration aussi inédite qu’un duel entre la gauche radicale et l’extrême droite.
Une progression électorale continue mais sous-estimée
Pour comprendre pourquoi l’hypothèse d’une victoire de Jean-Luc Mélenchon en 2027 est la plus probable, il faut revenir à la réalité des dynamiques électorales. En trois candidatures présidentielles, Mélenchon a constamment progressé, en nombre absolu de voix comme en pourcentage. De 11 % en 2012, il est passé à près de 20 % en 2017 puis 22 % en 2022, manquant le second tour d’un cheveu : 420 000 voix. Cette trajectoire ascendante résulte certes de facteurs exogènes – l’affaissement historique du Parti socialiste, la crispation identitaire du Parti communiste, l’absence de cohérence au sein d’EELV – mais aussi d’un travail stratégique extrêmement structuré. En 2017 comme en 2022, la majorité des électeurs se déclarant plus à gauche ou plus à droite que Mélenchon ont pourtant voté pour lui. Pour de vastes pans de l’électorat, Mélenchon est devenu le point d’agrégation, la figure centrale autour de laquelle se recompose l’espace de la gauche.
Ce phénomène, observé ailleurs en Europe, répond à une double dynamique : le discrédit des partis de gouvernement incapables de proposer une issue sociale à la crise économique, et la montée de nouvelles mobilisations syndicales, féministes, écologistes, populaires et antiracistes dont les revendications infusent aujourd’hui l’agenda politique. La France insoumise a capté cette énergie, elle a construit un corpus doctrinal et programmatique compatible avec ces attentes.

Le spécialiste de la remontada
À cette évolution structurelle s’ajoute un phénomène récurrent des campagnes mélenchonistes : sa montée en puissance tardive. Ce qu’il a lui-même théorisé sous le nom de « tortue sagace », et que les fans de football qualifient de remontada. Historiquement, Jean-Luc Mélenchon réalise l’essentiel de sa progression dans les six derniers mois précédant l’élection. Les courbes de 2017 et de 2022 montrent des hausses de quinze points sur cette période – ce que ne fait aucun autre candidat. Dans le dernier mois, il peut engranger presque dix points. Les ressorts sont connus : ses talents de débatteur, sa capacité à créer des contrastes nets lors des grands rendez-vous télévisés, l’inventivité et l’ampleur de ses meetings, et le recours au porte-à-porte de ses nombreux groupes d’action produisent une dynamique cumulative unique en France. Déjà en 2017, chaque débat majeur lui apportait deux à trois points. En 2022, malgré une concurrence accrue due à la candidature de Fabien Roussel, les tendances furent similaires. Les meetings ont été des dispositifs de mobilisation massifs et spectaculaires, de l’hologramme aux meetings olfactifs, répliquant une mécanique parfaitement maîtrisée.
Cette montée tardive s’explique aussi par la sociologie de son électorat. Les jeunes, les classes populaires, les abstentionnistes intermittents, n’apparaissent dans les sondages qu’à partir du moment où ils commencent à s’intéresser aux débats. Leur intensité participative est faible hors période électorale. Les enquêtes d’opinion les sous-représentent systématiquement. Ainsi, les mêmes enquêtes surestiment l’extrême droite et sous-estiment le vote insoumis. Rien d’étonnant donc à ce que Mélenchon démarre bas : son électorat est, en dehors des échéances électorales, statistiquement invisible. De là découle une évidence analytique : les sondages de décembre 2025 ne nous apprennent rien sur les dynamiques de mars-avril 2027.
Mélenchon est aujourd’hui placé à 13% par les sondeurs. A la même période, pour les deux précédentes présidentielles (c’est-à-dire 18 mois avant les scrutins de 2017 et de 2022), il était mesuré à 8% – soit cinq points de moins. Si sa trajectoire des dix-huit prochains mois suit la même courbe ascendante qu’en 2017 et 2022, il finira à environ 26% en mai 2027, un score synonyme de qualification assurée pour le second tour.
Au même (ca)niveau que les sondages erronés, il convient de rappeler les fausses prophéties journalistiques, qui sont moins des prévisions fondées sur des faits que l’expression de désirs à moitié avoués. Après l’épisode des perquisitions au siège de la France insoumise, en octobre 2018, les grands médias ont répété durant deux ans que la carrière politique de l’intéressé était définitivement enterrée ; à la présidentielle suivante, il surclassait une nouvelle fois le reste de la gauche. La même « mort » lui avait été annoncée lorsqu’avant la présidentielle de 2017 il avait émis l’hypothèse d’une sortie de l’UE.
La fragmentation du bloc macroniste, une fenêtre d’opportunité historique
Un autre élément, rarement analysé à sa juste mesure dans les prévisions actuelles, concerne la conjoncture politique, et plus précisément l’état d’effritement avancé du bloc central construit autour d’Emmanuel Macron depuis 2017. Ce bloc, qui avait rassemblé une partie de la droite, le centre et l’aile gestionnaire du Parti socialiste, n’a jamais constitué une force idéologiquement unifiée. Il reposait sur la conjonction improbable entre un rejet momentané des partis traditionnels, l’adhésion des élites économiques à un projet néolibéral décomplexé et la personnalisation extrême du pouvoir autour de la figure d’un président jeune, disruptif et au capital symbolique alors intact. Or ce capital s’est plus que dégradé. Il s’est abaissé à un niveau record dans l’histoire du pays : 11% de confiance en novembre 2025. Et contrairement à l’idée que cette usure serait simplement le produit d’une décennie d’exercice du pouvoir, tout indique que la fragmentation actuelle résulte aussi d’un calcul stratégique du président sortant.
Il est désormais établi – par une série d’enquêtes journalistiques convergentes – qu’Emmanuel Macron a souhaité et encouragé, directement ou indirectement, la victoire du Rassemblement national lors des législatives de 2024. La dissolution a été décidée dans des conditions qui, de l’aveu même de certains proches du président, avaient moins pour objectif de clarifier la situation parlementaire que de provoquer un choc politique dont le RN sortirait vainqueur. Les appels passés à des candidats pour qu’ils retirent leur candidature dans certaines circonscriptions stratégiques, la passivité assumée de la majorité présidentielle face aux triangulaires défavorables au camp progressiste, et les consignes contradictoires envoyées aux fédérations locales ont construit un scénario où le RN devenait le maillon d’une stratégie de long terme. L’hypothèse la plus plausible est désormais la suivante : Macron ne souhaite pas qu’un héritier naturel s’impose à la tête de son camp, que ce soit Édouard Philippe, Gabriel Attal, Gérald Darmanin ou François Bayrou. Il sait que toute figure trop solide, trop autonome, qui s’installerait à l’Elysée, serait susceptible de lui fermer la porte d’un retour. En favorisant l’éparpillement et l’affaiblissement de son propre bloc, il laisse ouverte la possibilité d’une recomposition ultérieure (en 2032) où il reviendrait comme recours face à une droite extrême arrivée au pouvoir mais en situation d’échec.
Dans ce contexte, l’extrême centre est plus fragmenté que jamais. Édouard Philippe, malgré une image d’homme d’État, n’a ni parti structuré ni base militante ; Gabriel Attal est prisonnier de son identification au macronisme ; Gérald Darmanin mise sur un électorat réactionnaire qui lui préfère déjà le RN ; et François Bayrou ne dispose plus d’aucun crédit depuis son passage à Matignon. Aucun de ces prétendants n’est en mesure d’incarner un pôle suffisamment large pour empêcher leur dispersion et forcer ses rivaux à se retirer. Le bloc central se présentera désuni en 2027, s’annihilant mutuellement et rendant extrêmement improbable la présence d’un candidat macroniste au second tour. Ajoutons à cela que tout candidat de ce camp portera le fardeau de son prédécesseur, désormais désavoué par ses soutiens les plus fidèles et, surtout, par les segments de la population qui constituèrent pourtant sa base électorale en 2017 et 2022. Cette absence d’un pôle centriste crédible et unifié constitue une des données les plus déterminantes pour l’élection à venir : elle ouvre mécaniquement un espace pour un duel Mélenchon–Bardella (ou Mélenchon – Le Pen).
Une concurrence inconsistante
Du côté de la gauche, les candidatures alternatives – Glucksmann, Tondelier, Ruffin, Autain – ou celles de fossiles que certains rêvent encore de ressusciter – Hollande, Cazeneuve, Royal, Duflot – bénéficieront d’une visibilité et d’une bienveillance médiatique certaines. Les grands groupes de presse, appartenant à des puissances économiques hostiles à LFI, ont tout intérêt à fabriquer une « gauche raisonnable », rassurante pour les marchés, inoffensive pour les oligarques, et docile sur les sujets européens et géopolitiques. Ce scénario n’est pas nouveau : on l’a vu en 2017 avec Benoît Hamon, porté un temps comme incarnation d’une social-démocratie combative avant de s’effondrer ; en 2022, avec Yannick Jadot ou Christiane Taubira, dont les dynamiques médiatiques n’ont jamais trouvé de traduction populaire. Les raisons sont les mêmes : ces candidatures manquent d’un programme structuré, d’un appareil militant robuste, d’une cohérence idéologique, et surtout de l’ancrage social nécessaire pour dépasser un public composé essentiellement de diplômés urbains. Elles ne disposent pas de l’infrastructure indispensable pour mener une campagne présidentielle dans la durée : pas de réseau territorial significatif, pas de corpus doctrinal travaillé, pas de capacité de mobilisation numérique ou physique. Même portées artificiellement par les médias mainstream, ces figures ne parviennent pas à transformer l’essai dans la durée.
En face, Mélenchon s’appuie sur un appareil qui, depuis 2016, a acquis une solidité sans équivalent dans le champ politique français. LFI n’est plus le mouvement « gazeux » des premiers temps, ni le parti en manque d’implantation territoriale qui enjambait à contre-cœur les élections municipales de 2020 : c’est désormais une organisation structurée, dotée d’un groupe parlementaire nombreux, d’équipes d’assistants rodées à la production législative et communicationnelle, d’un outil intellectuel – l’Institut La Boétie – capable de produire des notes doctrinales et programmatiques de haute qualité (outil que d’autres, à gauche, tentent d’imiter), d’un réseau de cadres formés, d’une stratégie numérique maîtrisée, et d’une capacité logistique impressionnante. L’élaboration du programme L’Avenir en commun, travaillée depuis dix ans et enrichie par des consultations régulières avec experts, ONG, associations et professionnels, a donné naissance à un document cohérent, reconnu y compris par ses adversaires comme le plus complet, le mieux chiffré, le plus sérieux de l’offre politique française. Cette base programmatique, pensée pour durer, assortie d’une quarantaine de livrets thématiques, confère à Mélenchon une longueur d’avance que ses concurrents auront du mal à combler.
Dans ces conditions, la qualification de Mélenchon pour le second tour apparaît comme un scénario très probable. L’impopularité et la fragmentation du centre, l’absence d’assise populaire de la gauche décaféinée et le savoir-faire accumulé par les insoumis offrent à leur leader un boulevard.
Reste la question du second tour lui-même.
Un second tour inédit et une dynamique démographique favorable
Les sondeurs affirment que Mélenchon serait écrasé par Bardella. Mais ces prédictions n’ont aucune validité scientifique. Les instituts se trompent régulièrement sur des élections simples, dans des configurations connues et maintes fois répétées. Ils seront encore plus démunis face à un duel totalement inédit : jamais dans l’histoire de la Ve République un candidat de gauche radicale n’a affronté un candidat d’extrême droite au second tour. Les comportements électoraux dans une telle situation ne relèvent d’aucune loi préexistante.
On peut craindre que les électeurs LR basculent massivement vers le RN : c’est déjà le cas aujourd’hui. On peut anticiper qu’une partie des dirigeants macronistes se rallient à Bardella ou appelle à « faire barrage à Mélenchon » ; ce qui revient au même. Mais les électeurs centristes sont moins alignés sur leurs élites qu’on ne le croit. Une part d’entre eux demeure attachée à l’État de droit, à la séparation des pouvoirs, à l’indépendance de la justice et aux libertés individuelles. Pour ces électeurs, Mélenchon représente, malgré la longue liste de reproches qu’ils lui adressent, une menace moins grande que l’arrivée au pouvoir d’un parti ouvertement illibéral. Quant à l’électorat social-démocrate ou libéral-libéral (culturellement et économiquement), celui qui se reconnaît dans Glucksmann, il peut détester Mélenchon, il peut le vouer aux gémonies lors des diners de famille et des afterworks entre collègues, mais dans l’isoloir, seul avec lui-même, face au risque d’un basculement autoritaire, il se comportera rationnellement : il votera pour la gauche, fût-elle bruyante, radicale, populiste ou même « poutinienne » ; il le fera par prudence autant que par intérêt.
Mélenchon devra impérativement recentrer son discours, peut-être aussi son programme, pour conquérir au second tour les orphelins de Glucksmann et de Macron. Ce recentrage, il l’a déjà amorcé. Le « bruit et la fureur » de 2010 se sont progressivement atténuées. Le dialogue a été renoué avec des représentants du patronat, l’attache a été prise avec des gradés de l’armée, des collaborations peu visibles mais bien réelles sont à l’œuvre avec un bataillon de hauts fonctionnaires. Mélenchon et ses lieutenants misent désormais sur le sérieux institutionnel, la compétence technique et la respectabilité étatique, tout en conservant la capacité à incarner la radicalité impulsée par les mouvements sociaux et désirée par leur électorat populaire. Concilier ces deux registres n’est pas chose facile. L’art de préserver l’ambiguïté n’est pas donné à tout le monde. Mais cet art caractérise la trajectoire politique du leader insoumis, ex-militant mitterrandien, ex-sénateur socialiste et ex-ministre de Jospin d’un côté, mais aussi tribun de la révolution citoyenne, théoricien du dégagisme et désormais pourfendeur des violences policières et du génocide à Gaza. La faculté caméléonesque de Jean-Luc Mélenchon – chacun voit en lui ce qu’il veut y voir – est un atout considérable.
Enfin, si la victoire de Mélenchon apparait plus probable que jamais, cela tient aussi au fait que la France ne s’est pas droitisée, en tout cas pas dans les proportions que la droite tente de nous faire croire. Les jeunes générations penchent massivement à gauche, et les valeurs de tolérance et d’égalité progressent y compris chez les segments les plus âgés dont le vote va pourtant à Macron ou Fillon. Mélenchon est le seul candidat dont la base s’appuie sur les classes d’âge en expansion démographique. Le temps joue pour lui.
Une France politiquement de droite mais sociologiquement de gauche
Depuis plusieurs décennies, un paradoxe travaille la France : le pays vote majoritairement à droite mais sa population pense de plus en plus à gauche. Si l’on se limite aux résultats électoraux et aux sondages mis en scène sur les plateaux télé, on croit assister à une inexorable droitisation du pays. Mais dès qu’on quitte ce regard myope pour observer les évolutions de long terme des valeurs – génération par génération, en suivant des dizaines d’enquêtes accumulées depuis les années 1980 – le décor se renverse. Sous la surface d’un paysage institutionnel et médiatique monopolisé par la droite, on voit se déployer une lente et puissante dynamique de « gauchisation par le bas » : l’attachement à l’égalité, à la redistribution, à la protection sociale, à la tolérance, aux libertés publiques progresse doucement mais surement. C’est l’enseignement principal du livre que le politiste Vincent Tiberj a consacré au mythe de la droitisation.
Sur le plan socio-économique, les données longitudinales produites par mon collègue montrent qu’une majorité de Français restent durablement favorables aux services publics et à la protection sociale. Si l’on construit un indice de préférences sociales allant de 0 (libéralisme pur, marché roi) à 100 (égalitarisme maximal), la moyenne ne bascule dans la moitié la plus libérale que sur une courte période, au milieu des années 1980, au moment du tournant austéritaire et de la contre-offensive idéologique menée contre le bref épisode social du début du mitterrandisme. Depuis le début des années 2000, la courbe remonte nettement : les préférences redistributives se renforcent, l’adhésion à l’État social se stabilise à un niveau élevé et la demande de régulation augmente après chaque crise financière ou sociale. Autrement dit, malgré quarante ans de propagande néolibérale, la population n’a pas intériorisé la doxa du « trop d’impôts », « trop de fonctionnaires », « trop d’État ». Elle reste, en moyenne, plus proche d’un imaginaire social-démocrate que du catéchisme patronal.
Extension du domaine progressiste
Sur le plan culturel, le mouvement est encore plus spectaculaire. L’indice d’ouverture sur les questions de mœurs et de libertés publiques qu’a créé Vincent Tiberj montre une progression continue depuis la fin des années 1970 : ce qui semblait minoritaire, voire scandaleux, à l’époque (égalité femmes-hommes, droits des minorités sexuelles, lutte contre l’antisémitisme et le racisme) est devenu, pour une large majorité, un horizon de normalité. L’exemple le plus parlant est celui de l’homosexualité. Au début des années 1980, moins d’un tiers des personnes interrogées considéraient que c’était une manière acceptable de vivre sa vie ; aujourd’hui, cette proportion frôle les 90 %. De même, sur les questions d’immigration, un indice de tolérance élargie montre une progression régulière de l’acceptation des étrangers et de leurs descendants. La part de ceux qui estiment qu’« il y a trop d’immigrés » baisse, tandis que progresse celle de ceux qui voient dans l’immigration un facteur d’enrichissement culturel et jugent légitime la revendication d’égalité des droits. Loin de la fable d’un pays saisi par une obsession identitaire, une majorité silencieuse accepte la diversité, rejette les politiques ouvertement discriminatoires et se montre réceptive à un discours d’hospitalité encadrée plutôt qu’à la rhétorique de la forteresse assiégée. Ces données sont confirmées par les travaux d’une autre politiste de renom, Nonna Mayer.

D’où vient alors cette impression oppressante d’une France « passée à droite » ? D’abord d’une droitisation « par le haut ». Le petit monde des responsables politiques, des fast thinkers et des grands groupes médiatiques exerce une guerre psychologique : il martèle, sondage après sondage, chronique après chronique, que le camp de l’égalité serait minoritaire, ringard, coupé du réel. Les sondages les plus anxiogènes – sur l’« insécurité culturelle », le « sentiment de submersion migratoire », la supposée lassitude face au féminisme ou au « wokisme » – sont commandés, mis en forme et commentés par des groupes qui ont tout intérêt à naturaliser l’idée d’une France droitisée. Cette mise en scène produit un effet d’optique : une minorité réactionnaire, mieux équipée médiatiquement, crie très fort et apparaît comme majoritaire, tandis qu’une majorité plus ouverte, plus égalitaire, moins bruyante, est reléguée à l’arrière-plan. L’extrême droite et l’extrême centre se servent de ce récit pour s’octroyer une légitimité démocratique ; la gauche molle s’en empare pour justifier ses renoncements ; et certains militants radicaux s’y réfugient pour expliquer leurs échecs sans avoir à interroger leur stratégie.
Majorité électorale et minorité sociale
Le cœur du paradoxe réside dans ce que les politistes appellent l’« abstention différenciée ». Le résultat des scrutins ne reflète pas ce que pense l’ensemble de la société, mais ce que pense une fraction socialement privilégiée et générationnellement située. Les bourgeois et les baby-boomers sont les fractions sociales les plus politisées au sens traditionnel du terme, c’est-à-dire les plus assidues pour se rendre aux urnes. Les générations plus jeunes, plus diplômées, plus précaires, plus tolérantes, plus égalitaristes, s’éloignent massivement du vote sans forcément décrocher de la politique. Elles se mobilisent sur les réseaux, sur les places publiques, sur les rond-point, dans les mobilisations féministes, écologistes ou antiracistes, mais boudent des élections perçues comme inutiles et/ou déconnectées de leurs préoccupations. Comment leur donner tort lorsqu’on voit comment le président traite le résultat des urnes en 2024, et lorsqu’on se souvient du sort qui a été fait au « non » du referendum de 2005 ? Résultat : la majorité électorale ne représente plus qu’une minorité sociale. Les partis qui dominent l’offre politique se calent sur les peurs et les intérêts de ce segment restreint. Les classes populaires, quant à elles, se réfugient dans l’abstention intermittente ou systématique. On obtient ainsi une configuration où des valeurs globalement de gauche cohabitent avec des institutions verrouillées par différentes nuances de droite.
Sur cet arrière-plan paradoxal, la possibilité d’une victoire mélenchoniste prend une autre portée. Elle ne serait pas le triomphe improbable d’une gauche « extrême » sur un pays massivement droitisé mais la résolution d’un paradoxe devenu intenable : celui d’une France sociologiquement de gauche mais politiquement gouvernée par la droite. En rassemblant les cohortes les plus jeunes, les classes populaires encore prêtes à voter, les secteurs attachés à l’État social et aux libertés publiques, Mélenchon a compris cette réalité que les élites préfèrent ne pas voir. Sa victoire en 2027 serait moins une rupture qu’un rattrapage. Pour la première fois depuis longtemps, les valeurs majoritaires – égalité, protection sociale, tolérance, démocratie – trouveraient enfin leur traduction dans les urnes.

Transformer l’essai
Au regard de ces éléments – progression constante de Mélenchon depuis quinze ans, savoir-faire inégalé pour les campagnes, les débats et les meetings, sous-évaluation systématique de son électorat par les sondeurs, usure du pouvoir, impopularité et fragmentation du bloc central, absence d’alternative crédible à gauche, supériorité organisationnelle, faculté caméléonesque du candidat, dynamique démographique favorable et gauchisation par le bas du pays – un constat s’impose : la victoire de Jean-Luc Mélenchon le 25 avril 2027 n’est pas seulement possible ; elle constitue le scénario le plus plausible.
Je ne le dis ni par volontarisme ni par militantisme, mais par analyse froide des tendances qui travaillent en profondeur la société française. Les seules certitudes auxquelles s’accrochent ses opposants – les sondages prématurés et les emballements médiatiques – relèvent de la panique plus que de la raison. Les faits, eux, dessinent un autre horizon. Mélenchon a déjà approché la victoire. Les conditions politiques, sociologiques et historiques sont plus alignées que jamais pour qu’il l’atteigne.
Pour prolonger :
Trois livres :
- Yves Déloye, Nonna Mayer (dir.), Analyses électorales, Bruxelles, Bruylant, 2017
- Vincent Tiberj, La droitisation française. Mythes et réalités, Paris, PUF, 2024
- Hugo Touzet, Produire l’opinion. Enquête sur le travail des sondeurs, Paris, Editions de l’EHESS, 2025
Trois émissions à (re)voir sur notre site :
- Enquête sur la France insoumise, émission Dans le texte, 20 septembre 2021
- Touche pas à Mélenchon, émission Dans le texte, 18 mars 2022
- Mélenchon à Matignon, émission Aux sources, 18 mars 2022
04.12.2025 à 17:45
Bugonia : la soupe au miel
Texte intégral (2880 mots)

Parmi les mythes classiques de l’Antiquité grecque figure l’histoire du demi-dieu Aristaeus. Connu comme l’Apollon « pastoral », il était célèbre pour avoir instauré un rituel appelé « bugonia ». Ce rituel vit le jour après qu’Aristaeus eut remarqué que ses abeilles mouraient lentement et s’adressa aux dieux afin de repeupler ses ruches. La réponse exigeait qu’il sacrifie plusieurs taureaux, draine leur sang et laisse leurs carcasses se décomposer. Trois jours plus tard, il retourna aux autels pour y trouver de nouvelles abeilles bourdonnant autour de la chair en décomposition. Une telle épreuve était probablement inspirée par la croyance ancienne selon laquelle des créatures vivantes pouvaient surgir spontanément de la chair morte.

Les fausses croyances et les abeilles sont précisément le sujet du dernier film du réalisateur grec Yórgos Lánthimos, Bugonia, un remake du film sud-coréen de 2003 Save the Green Planet!. Mais contrairement à la notion ancienne de bugonia – tirée de l’observation directe des mouches émergeant de la chair en décomposition – les fausses croyances du protagoniste du film proviennent de l’intuition inverse. Pour Teddy, travailleur solitaire et apiculteur, le monde n’est pas ce qu’il semble être. Derrière les apparences se cache une vérité plus profonde, ce qu’il appelle un « principe organisateur plus large » qui explique tout : du coma de sa mère à la mort lente de ses abeilles. La cause de son désespoir est donc hors de son contrôle, dans une économie dirigée par de grandes entreprises impersonnelles. « Ce n’est pas nous qui dirigeons le navire, dit-il à son cousin Don, c’est eux. »

Politique à l’ère de Trump
Mais « eux », selon Teddy, ne sont pas seulement des capitalistes, mais des extraterrestres appelés Andromédiens, venus d’une autre planète pour contrôler les humains. Afin de négocier le retrait des extraterrestres de la Terre, Teddy décide d’enlever Michelle Fuller, la PDG de la société pharmaceutique pour laquelle il travaille – et qu’il croit être une Andromédienne de haut rang. Enfermée et torturée dans un sous-sol, elle reçoit l’ordre d’organiser une rencontre avec les envahisseurs avant la prochaine éclipse lunaire. Le film se transforme alors en un huis clos claustrophobe, formellement intensifié par le format étroit de l’image et l’utilisation de gros plans pendant les scènes de dialogue. Les deux personnages incarnent clairement deux types de la société américaine contemporaine : un « déplorable » paranoïaque opposé à une femme brillante, carriériste et passée maître dans l’art du double langage des relations publiques. Il est un « looser » et elle est une « winner », comme l’indiquent les dialogues. Dans ce contexte, la communication entre eux est impossible. Teddy ne s’informe plus à travers les médias classiques, mais à partir de sites web marginaux et de podcasts, tandis que Michelle lit The New York Times et suppose qu’il est mentalement malade. « Je ne peux pas te faire changer d’avis« , lui dit-elle, après avoir réalisé que tout ce qu’elle dit ne fait que confirmer sa conviction qu’elle est bel et bien une extraterrestre.

Le rebondissement le plus surprenant du film survient avec son dénouement final. Dans un revirement inattendu, nous apprenons que les extraterrestres existent bel et bien et que ce que nous pensions être les délires de Teddy, inventés pour faire face à sa vie tragique, étaient en fait réels. Michelle, le personnage joué par Emma Stone, se révèle être l’impératrice d’Andromède. Elle explique que son espèce a créé l’humanité, mais que « l’expérience » a clairement échoué, étant donné la violence et la soif de pouvoir dont font preuve les humains. Selon elle, le problème réside dans leur « gène suicidaire ». Pour y remédier, les Andromédiens ont même essayé de mettre au point un traitement destiné à reprogrammer l’ADN humain, le même traitement qui a plongé la mère de Teddy dans le coma. Mais après avoir découvert que Teddy avait torturé et tué des dizaines d’autres personnes, dont deux extraterrestres, et que le projet visant à changer la nature humaine avait échoué, Michelle retourne au vaisseau mère et décide d’exterminer l’humanité.

Allégories de la totalité
Le film s’inscrit manifestement dans le genre plus large des films conspirationnistes tels que The Parallax View d’Alan Pakula (1974), Invasion of the Body Snatchers de Philip Kauffman (1978) et They Live de John Carpenter (1988). Dans ces films, les extraterrestres ou les conspirateurs sont généralement dépersonnalisés afin de pouvoir les faire fonctionner efficacement comme métaphores du « système ». On peut considérer ces films comme une tentative de thématiser le conflit dans le capitalisme tardif, c’est-à-dire une contradiction qui ne peut plus s’exprimer en termes de lutte des classes. Pour les travailleurs atomisés, la théorie du complot fournit une « fiction utile » pour saisir la totalité sociale elle-même. Il s’agit, comme l’a si bien écrit Fredric Jameson, de « la cartographie cognitive des pauvres à l’ère postmoderne« . Comme Teddy le déclare lui-même dans Bugonia, il n’est pas un « activiste » et il n’y a pas de « mouvement » : il a mené seul « une tonne de recherches » prouvant que « tout est lié ».

À une époque où la fragmentation sociale s’est considérablement intensifiée et où la capacité des travailleurs à agir collectivement a été radicalement sapée, les théories du complot apparaissent comme des tentatives désespérées d’individus impuissants pour représenter la logique abstraite du capital. Elles doivent être considérées comme le symptôme du fait que les individus sont submergés d’informations mais ne disposent pas d’une théorie leur permettant de donner un sens à l’ensemble disparate d’événements qui façonnent leur vie.
Comme Theodor Adorno l’avait lui-même observé en analysant la diffusion de l’astrologie, les sociétés capitalistes avancées présentent « d’une part, une richesse matérielle et intellectuelle, mais la relation est davantage celle d’un ordre formel et d’une classification que celle qui permettrait d’éclairer les faits par l’interprétation et la compréhension« . En d’autres termes, l’astrologie comble ce vide en offrant un moyen de donner un sens aux « faits ». Jacques Rivette a un jour fait remarquer que « le changement le plus crucial qui touche notre civilisation est qu’elle est en train de devenir une civilisation de spécialistes ». « Chacun d’entre nous », a-t-il ajouté, « est de plus en plus enfermé dans son petit domaine et incapable d’en sortir« . Dans un tel contexte, la tâche de l’humanité consiste précisément à lutter contre cette tendance et à essayer « de rassembler les fragments épars de la culture universelle qui est en train de se perdre ». Le récit conspirationniste dans les films des années 70 et 80 avait, de ce point de vue, une double fonction : d’une part, il représente une forme dégradée de conflit de classe dans le capitalisme tardif ; d’autre part, il indique la tentative du récit ou du film lui-même de sauver l’idée même de totalité. Le héros assume généralement le rôle de détective, permettant au public d’imaginer ce que pourrait signifier le fait de rassembler ce qui a été fragmenté. En d’autres termes, le film va à l’encontre de la logique du capital en allégorisant le sens de l’ensemble.
Platitudes libérales
Mais c’est là que Lánthimos s’écarte sérieusement d’une telle ambition. La structure du film inverse la logique habituelle : le rebondissement final révèle que, plutôt que de fonctionner comme une métaphore de la totalité sociale, la conspiration ne renvoie qu’à elle-même, comme un effet de l’effondrement de la confiance et de la corruption de la sphère publique par les fausses nouvelles. Comme Lánthimos l’a indiqué aux critiques, « la dystopie (…) n’est pas vraiment fictive », mais « reflète plutôt le monde réel ». Si la fin rend la conspiration réelle, et place donc le film dans ce genre, elle sert en fin de compte un objectif externe : tromper le spectateur. Fidèle aux platitudes libérales sur la désinformation et la polarisation, Lánthimos utilise le film comme un dispositif moral pour nous confronter à nos propres préjugés. Comme il l’explique, il « remet en question tous ces préjugés que nous avons sur les gens, qui sont renforcés par la technologie et la compartimentation ». En d’autres termes, en rendant la conspiration réelle, il veut que nous reconnaissions en nous-mêmes les mécanismes psychologiques qui poussent Teddy à y croire. Le fait de penser qu’il était paranoïaque révèle nos propres préjugés. Mais ce faisant, plutôt que de transcender une analyse psychologique de notre présent (tout provient de nos préjugés psychologiques innés et des algorithmes), le film l’embrasse.

De plus, l’opposition entre Teddy, le personnage solitaire joué par Jesse Plemons, et l’extraterrestre a un objectif ambigu. D’une part, elle fonctionne clairement comme une métaphore du conflit de classes dans une société démobilisée. D’autre part, Lánthimos sape cette idée même en dépeignant les deux personnages comme assez similaires, afin de servir son propre message pessimiste. Tous deux sont en fait des créatures sans pitié, marquées par un manque d’empathie et de remords. Teddy se « castre » chimiquement pour se débarrasser de ses « compulsions psychiques », tandis que le personnage d’Emma Stone traite les humains comme de simples rats de laboratoire.

Un cinéma misanthrope
La scène finale – qui s’écarte de la version sud-coréenne où la planète entière est détruite – montre une Terre paisible sans humains vivants, accompagnée de la chanson de 1962 Where Have All the Flowers Gone? : « Quand apprendront-ils enfin ? », interroge la chanson, transformant ce qui aurait pu être une fiction utile sur les conspirations et le capitalisme en une série de platitudes sur la nature humaine. Elle nous offre une fin misanthrope mais incohérente, car l’idée même d’une planète mieux lotie sans les humains est déjà une façon de l’humaniser. En d’autres termes, de lui appliquer un jugement proprement humain. Et c’est peut-être là que réside la véritable limite du cinéma de Lánthimos. Son esthétique désormais caractéristique et son engagement envers l’absurde servent généralement à dissimuler des banalités que l’on pourrait acheter dans n’importe quelle librairie d’aéroport. La surcharge visuelle, la théâtralité stylistique et la mise en scène exagérée ne parviennent guère à masquer le fait qu’il n’a pas grand-chose à dire : l’extravagance est une piètre alternative à l’originalité.
Une version initiale de ce texte a été publiée en anglais sur Sabzian
Pour prolonger
01.12.2025 à 21:15
Contre un maccarthysme à la française – pour tous les Julien Théry à venir
Texte intégral (9723 mots)
À la suite d’un communiqué mensonger paru le 21 novembre sur le compte X de la LICRA, repris dans une publication du journal Lyon Capitale (et depuis, par de très nombreux médias), l’historien Julien Théry est l’objet depuis plusieurs jours d’une violente campagne de diffamation et de harcèlement, d’insultes et de menaces de mort. Une situation d’autant plus préoccupante que l’adresse précise de son lieu de travail a été divulguée par Lyon Capitale, constituant un risque pour sa sécurité. Son Université de rattachement s’est immédiatement désolidarisée de lui publiquement et a effectué un signalement au Procureur de la République
La publication de la LICRA est un montage d’un post Facebook réalisé par Julien Théry le 20 septembre dernier, où il relayait la longue analyse faite par Sophie Trégan de la « lettre de la honte », cette tribune de 20 personnalités publiée dans le Figaro demandant au Président Emmanuel Macron de « ne pas reconnaître un État palestinien sans conditions préalables ». Rappelant un certain nombre de faits avérés et reconnus par les instances internationales, Sophie Tregan concluait ainsi : « quand on conditionne la reconnaissance d’un État à la libération de 49 otages au mépris de la vie de plus de 1,5 million de personnes en proie à un génocide, c’est ni plus ni moins qu’une hiérarchisation des vies humaines selon leur origine ethnique, du suprémacisme ». Julien Théry a reposté le texte, en copiant-collant la liste des signataires de la tribune, qui circulait alors partout à ce moment-là, et a ajouté « génocidaires à boycotter ». La LICRA a soigneusement omis le post initial, donnant ainsi l’impression que l’historien avait « fait une liste » de noms, au hasard, sans raison particulière. Et elle a ajouté ce commentaire : « On peut être professeur d’Université, se croire progressiste et faire des listes de noms comme sous l’Occupation ». L’effet de ce montage irresponsable de la LICRA a été de déclencher une campagne de harcèlement.
Mais pourquoi une telle démarche de la LICRA, maintenant, alors que le post initial qu’elle a tronqué avant de le diffuser est vieux de deux mois ? Réponse : cette offensive de la LICRA semble intervenir en représailles à la publication, sur le site Hors-Série.net le 23 octobre dernier, d’un chapitre de son livre intitulé En finir avec les idées fausses sur l’histoire de France paru le 17 octobre dernier aux éditions de l’Atelier. L’article en question – dont le rédacteur en chef du journal de la LICRA, Emmanuel Debono, a rapidement tenté une dénonciation sur le site Conspiracy Watch – est une réfutation de l’idée selon laquelle il existerait aujourd’hui un « antisémitisme de gauche », menée à partir d’une synthèse approfondie de l’histoire de l’antisémitisme, en particulier depuis le début du XIXe siècle. La conclusion en est (sans originalité) qu’il peut évidemment y avoir des cas d’antisémitisme de la part d’individus qui appartiennent à la gauche (antisémitisme à gauche, selon la distinction de Michel Dreyfus), mais que, depuis le tournant de l’Affaire Dreyfus, la gauche a abandonné l’antisémitisme pour des raisons structurelles, alors que la droite nationaliste, à l’inverse, a été et demeure structurellement antisémite. Plus douloureux : le texte conclut aussi que l’irruption de l’idée d’un « antisémitisme de gauche » dans le débat public depuis à peine plus de deux décennies est liée à la radicalisation de l’entreprise sioniste en Palestine depuis l’assassinat d’Itzhak Rabin et l’abandon des accords d’Oslo. La notion d’« antisémitisme de gauche » vise ainsi en réalité à neutraliser les oppositions à cette entreprise en les rabattant sur le judéocide européen de 1941-1945.
Depuis l’ébullition médiatique provoquée par la tribune des 20 signataires, moment où paraissent l’analyse de Sophie Trégan et le post de Julien Théry, les otages israéliens ont tous été libérés. Force est de constater que la guerre ne s’est pas terminée pour autant. Chaque jour, des dizaines de Palestinien.nes continuent de mourir, sous les bombes ou les balles des snipers, ce qui montre bien que l’enjeu dépassait les otages et concerne le nettoyage ethnique en vue de ce qui serait une colonisation totale de la Palestine. Quiconque souligne sérieusement cet état de fait se voit systématiquement exposé à l’accusation d’antisémitisme.
L’article de Julien Théry, qui démonte cette idée d’un « antisémitisme de gauche », est donc dérangeant pour les soutiens à l’État d’Israël et leurs stratégies de communication.
Nous assistons depuis quelques semaines à une nouvelle offensive générale contre la liberté des universitaires d’étudier et analyser la situation en Palestine. La LICRA et notamment Emmanuel Debono sont parvenus à faire annuler la tenue au Collège de France du colloque organisé par Henry Laurens. La campagne lancée contre Julien Théry par la LICRA poursuit cette attaque. Il est particulièrement inquiétant de constater que l’ensemble des grands médias reprend à son compte les accusations mensongères de la LICRA sans effectuer la moindre vérification.
Faute de réaction rapide de la communauté universitaire, cette vague de censure et de Maccarthysme à la française (voir également l’entreprise annoncée par le ministère revenant à ficher les universitaires sous couvert d’ « enquête nationale sur l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur et la recherche ») posera une chape de plomb sur la recherche et la vie intellectuelle. Le risque est alors de réduire les universitaires et les chercheurs à des agents d’une propagande d’État.
Signataires
Cette tribune dépasse désormais les 1500 signatures. Seules les 800 premières figurent ici. Pour une liste à jour, consulter la version publiée par le site de l’Union Juive Française pour la Paix ; elle est par ailleurs toujours ouverte à signature ; pour signer, envoyez un mail à soutienthery@gmail.com
* : personnalité politique
Signatures individuelles
Géraldine A Tagi
Samy Abbes, Mathématicien, MCF, Université Paris Cité
Kamil Abderrahman
Pierre Abécassis, Médecin, membre de l’Union juive française pour la paix
* Nadège Abomangoli, Première vice-présidente de l’Assemblée nationale
Albert Achten, Ingénieur
Éloïse Adde, Associate Professor, Historienne
Bernard Aghina
Najat Aguidi, écrivain
Sara Angeli Aguiton, Chargée de recherche CNRS, PHEEAC, Université des Antilles
Bérénice Alaterre
Michel Albagnac
Pierre Albertini, Historien, professeur de khâgne
Gérard Alegre, Illustrateur
Gadi Algazi, Historien, Dept of History, Tel Aviv University
Benjamn Alison
Eric Alliez, Philosophe, Professeur, Université Paris 8
Matthieu Allingri, Maître de conférences en histoire médiévale, université d’Aix-Marseille
Sarah Al-Matary, Professeur des Universités, Lettres, Le Havre
Tuna Altınel, MCF en Mathématiques, Université Lyon 1
Bruno Alonso, CNRS, Montpellier
Sabia Amar
* Gabriel Amard, Député du Rhône
Anne-Laure Amilhat Szary, Université Grenoble Alpes
Daniel Amoros
* Farida Amrani, Députée de l’Essonne
Aurélie Dianara Andry, Historienne
Jean-Christophe Angaut, Maître de conférences de philosophie, École Normale Supérieure de Lyon
Celine Aranjo, infirmière
Fabien Archambault, Historien, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Fanette Arnaud, Médiatrice
Alain Arnaudet
Mathieu Arnoux, Historien, Professeur à l’université Paris Cité
Isabelle d’Artagnan, Présidente de l’IRELP, Historienne associée à Sorbonne Université
Florent Arthaud, OFB – USMB – INRAE
* Raphaël Arnault, Député du Vaucluse
Loïc Artiaga, Professeur en histoire contemporaine, Université de Pau
Jean Asselmeyer, Réalisateur
Simon Assoun, militant décolonial
Agnès Astrup
Marie-Andrée Auclair, retraitée Éducation Nationale
Samuel Autexier, Éditeur, Forcalquier
Azadî
Igor Babou, Professeur à l’université Paris Cité
Danielle Bailly-Salins, Enseignante retraitée
Christophe Baixas, Ingénieur Architecte dans l’industrie navale
Viviane Baladier, Mathématicienne, Directrice de recherches au CNRS à la retraite
Étienne Balibar, Philosophe
Bernard Barthalay, Économiste, Enseignant-chercheur à la retraite
Marie-Joëlle Barthuet, retraitée
Vincent Basabe
Isabelle Beaurepaire, Professeur
Jean-Luc Becquaert, Retraité, Syndicaliste, Tarn-et-Garonne
François Bégaudeau, écrivain
Gabriel Bellego, étudiant
Marina Belney-Ruiz
Leïla Benabed, Travailleuse sociale
Malika Benarab Attou, Ex-Eurodéputée
Yazid Ben Hounet, Anthropologue, Chargé de recherche-HDR CNRS, Lab. d’Anthropologie Sociale
Maxime Benatouil, Militant à Tsedek !, enseignant
Omar Benderra, Économiste, membre d’Algeria Watch
Laila Benderra, Pédiatre
Yassir Benhima, Professeur, Université Lyon 2
Christian Benedetti, Acteur et metteur en scène
Christophe Benoit, professeur agrégé d histoire
Fabrice Bensimon, Sorbonne Université
Souad BENT-ABBES, chargée d’études au MEN
Badis BENYAHIA, Chef d’établissement scolaire public retraité
Philippe Bérard, Ingénieur
Bertrand Berche, EC, Université de Lorraine
Daniel Beretz, Retraité recherche publique
Jean Berger, enseignant et Historien
Judith Bernard, Enseignante
Noël Bernard, MCF Mathématiques retraité, poète.
Bertand Bernier, Chargé de production
Eric Berr, Économiste, Université de Bordeaux
Nathalie Berriau
Vincent Berthelier, MCF Lettres, Université Paris Cité
Arno Bertina, écrivain
Antoine Bertrand, Attaché de presse indépendant
Florian Besson
Philippe Besson
Magali Bessone, Professeure de philosophie politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Lorenzo Bianchi, Cinéaste, Producteur, Enseignant à l’Université Gustave Eiffel
Giuseppe Bianco, Philosophe, maitre de conférences à l’Université Ca’ Foscari de Venise
Gaëlle Bidan, directrice des Éditions de l’Atelier
Alain Bihel, journaliste
Alain Bihr, Sociologue, Professeur honoraire, Université de Bourgogne Franche-Comté
Sylvain Billot, statisticien économiste
Bertrand Binoche, Professeur émérite, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Antonia Birnbaum, Professeure de philosophie, Université Paris 8
Daphné Bitchatch, artiste peintre, auteure
Magali Bizot, écrivain occitan, enseignante retraitée
Julien Blanc, Anthropologue, Maitre de Conférences du Muséum National d’Histoire Naturelle
Max Blechman, Directeur de programme, Collège International de Philosophie
Alexia Blin, MCF en Histoire des États-Unis, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3
Étienne Bloc, Scénariste
Suzette Bloch, petite fille de Marc Bloch, ancienne journaliste à l’AFP
Erick Boiron, Ancien étudiant à l’Univ. Lyon 2
Livio Boni, psychanalyse, ancien dir. de programme au Collège international de philosophie
Christophe Bonneuil, Historien, DR CNRS
Arminé Boranian
Rachele Borghi, Sorbonne Université
Sylviane Borie, Retraitée
Yannick Bosc, Historien, Université de Rouen Normandie
Véronique Bontemps, Anthropologue, CR CNRS, IRIS
Najla Bouakline, Normalienne, étudiante en Histoire Médiévale, ENS de Lyon
Saïd Bouamama, Sociologue
Abdel. H. Boudoukha, Pr. Psychologie clinique, Psychopathologie et Psychothérapie
Fadila Boucherak
Jean-Christophe Boucly, Professeur de lettres modernes en lycée, docteur de l’École Pratique des Hautes Études
Sylvie Bouffartigue, Professeure des universités, études culturelles latino-américanistes et caribéennes. UVSQ-Paris Saclay.
Jean-Claude Bourdin, Professeur émérite de philosophie à l’Université de Poitiers
Vincent Bourdin, Ingénieur de recherches, CNRS – GeePs – Centrale – Supélec
Jérôme Boutin, gestionnaire de contrat de prévoyance
Boris Bove, Professeur d’Histoire médiévale, Université de Rouen Normandie
Gérard Bras, Philosophe, ancien professeur de classes préparatoire
Rony Brauman, Ancien président de Médecins sans frontières
Mark Bray, Assistant Teaching Professor, History Department, Rutgers University-New Brunswick
Jean Paul Brenelin, Chef d’entreprise, militant assiciatif
Thierry Brésillon, journaliste
Iléna Briday, Étudiante
Charlotte Brives, Directrice de Recherche CNRS, Anthropologue
Déborah V. Brosteaux, Chercheuse et enseignante à l’Université Libre de Bruxelles
Michel Broué, Mathématicien, professeur émérite à l’Université Paris Cité
Guy Bruit
Anne Brunswic, Journaliste et écrivaine
Déborah Bucchi, Université de Lorraine
Sebastian Budgen, Éditeur
Emmanuel Burdeau, Critique
Pascal Buresi, Historien, Directeur de Recherche CNRS
Julien Bugli
Laurence Burger, enseignante dans le secondaire
* Pierre-Yves Cadalen, député du Finistère
Séverine Cadier, artiste
Michel Calvès, retraité SNCF, syndicaliste
Monique Calvi
Pascale Camuset, citoyenne
Daniel Candas
Viviane Candas, cinéaste
Marco Candore, comédien, auteur
François Cansell, Professeur des universités, Bordeaux INP
Rémy Cardinal, Artiste musicien, militant Réseau salariat
*Aymeric Caron, Député
Damien Carraz, Historien, Professeur à l’Université de Toulouse Jean-Jaurès
Lucette Castarlenas
Thierry Caruana, instituteur retraité
Arthur Casas, ENS Lyon
Irène Catach, Directrice de recherches émérite au CNRS
Simonetta Cerrini, Historienne
Myriam Chaabane
Gaëtane Chammas-Breysse, étudiante
Alexis Charansonnet, Historien à la retraite, Université Lumière Lyon 2
Marc Chavassieux
Catherine Chavichvily, Collectif Palestine 69
Christine Charretton, Maîtresse de Conférences Honoraire
Denis Chartier, Géographe, Professeur des universités à l’Université Paris Cité
Francis Chateauraynaud, Sociologue, Directeur d’études à l’EHESS
Claire Chatelain, Chargée de recherches, habilitée,CNRS, Centre R. Mousnier/Sorbonne Université
Estelle Chauvey, IDE en hôpital psychiatrique
Sébastien Chauvin, Sociologue, Université de Lausanne
Sylvie Chazalette
Jean-François Chazerans, Professeur de philosophie
Farah Cherif Zahar, Maîtresse de conférences, Université Paris 8
Jean-Jacques Cheval, Professeur émérite des Universités, Université Bordeaux Montaigne
Sylvie Chevallier
Lucien Chich
Jacques Chiffoleau, Historien
Lounes Chiki, DR1 CNRS, Évolution et diversité biologique, UMR5300, Toulouse, UT3
* Sophia Chikirou, députée de Paris
Yves Chilliard, chercheur INRAE retraité
Mona Chollet, journaliste, essayiste
Guillaume Cingal, Maître de conférences en littératures africaines et traducteur.
Jocelyne Clavelloux
Jean-François Clopeau, Retraité de l’enseignement
* Hadrien Clouet, député de la Haute-Garonne
Isabelle Cochelin, Historienne, Université de Toronto
Deborah Cohen, MCF, histoire, Université de Rouen
James Cohen, Sciences politiques, Professeur émérite, Sorbonne Nouvelle
Sandra Cohuet, Médecin
Chrystel Colomb, professeure de lettres modernes, retraitée
Sonia Combe, historienne, Berlin
Marie-Hélène Congourdeau, Historienne
Pascal Connan, Instituteur retraité
Marie Constant, Pair aidante familiale
Anne Coppel, sociologue
Natacha Coquery, Historienne, Professeure émérite à l’université Lumière Lyon 2
Laurent Cordonnier, économiste, Professeur à l’Université de Lille
Jonathan Cornillon, Maître de conférences en Histoire romaine, Sorbonne Université
Christophe Cornut, CR / CNRS en Mathématiques
Bryan Cosman
Marie Cosnay, écrivaine
Christian Coudène, Professeur de Sciences Economiques et Sociales
Céline Coudreau
*Jean-François Coulomme, Député de la Savoie
Magali Coumert, Professeure d’Histoire, Université de Tours
Julien Cranskens, Libraire
Julien Crépieux, Artiste
Alexis Cukier, Maître de conférences en philosophie, Université de Poitiers
Benoit Cursente, Dir. de recherche CNRS retraité- UMR FRAMESPA, Université Jean Jaurès Toulouse
André Curtillat
François Cusset, Historien
Thomas Cuvelier, Doctorant en Sociologie, Université de Paris 8 Vincennes Saint Denis
Philippe Cuziol
Xavier Czapla, Comédien et metteur en scène
Jeanne Da Col Richert, Strasbourg
Maxime Da Silva, Co-Président du Réseau national des élu·es insoumis·es et citoyen·nes
Nicolas Da Silva, Économiste
Ahmed Dahmani, militant des droits humains
Jocelyne Dakhlia, historienne et anthropologue
Marie-Émilie Dalby, Libraire
Olivia Martina Dalla Torre, PhD
Anne Dauphiné
Sonia Dayan Herzbrun, Professeur émérite, Université Paris Cité
Hélène Débax, Professeur d’histoire médiévale, Université Toulouse 2 Jean-Jaurès
Régine Dejour, Professeur d’EPS, retraitée
Yann Dejugnat, Maître de conférences, Historien, Université Bordeaux Montaigne
Christian Delacroix, Historien
Alexis Delahaye, réalisateur
Frédéric Delarue, Docteur en histoire contemporaine
Sameh Dellaï, MCF
Irène Delorme, Étudiante
Guillaume Delteil, Professeur agrégé d’Histoire, Montpellier
Camille Deltombe, Éditrice
Thomas Deltombe, Éditeur
Marc Demyttenaere, retraité
Laurent Denave, Chercheur indépendant en sciences sociales
Camille Descombes, Professeur des écoles dans les Alpes-de-Haute-Provence
Vinciane Despret, Philosophe, Professeur associé émérite, Université de Liège
Pierre-Marie Dessaint, retraité
Rosa Maria Dessi, Historienne, Professeur, Université de Nice
Yveline Dévérin, MCF géographie, retraitée Université Toulouse 2
Issahnane Djamal, Militant antiraciste, syndicat Solidaires.
Adrien Delespierre, MCF de sociologie,Université de Tours
Emmanuel Deragne
Karima Direche, Historienne, directrice de recherche CNRS
Sophie Djigo, Philosophe, directrice de recherche au Collège international de Philosophie
Alain Dontaine, retraité Université Grenoble Alpes, enseignant en géopolitique
Françoise Doray, Professeure d’Histoire retraitée
Charles Doron, Retraité
Coline Dottin, étudiante de l’ENS de Lyon
Yann Dourdet, Enseignant en Philosophie
Ariane Dreyfus, poète
Bruno Drweski, Professeur d’université, responsable de la Commission internationale de l’Union pour la Reconstruction Communiste.
Quentin Dubois, Doctorant et enseignant vacataire. Département de philosophie Paris 8
Nicolas Duffour, Journaliste
Yoann Dumel-Vaillot, Docteur en philosophie, Université Lyon III
Stéphane Dumouchy, syndicaliste, SUD PTT
Olivier Dumoulin, historien, Professeur des Universités
Dominique Dupart, MCF Littérature française, Lille
Alexandre Dupont, MCF en histoire contemporaine, Université de Strasbourg
Laure Dupuis, Éducatrice spécialisée
Cédric Durand, Professeur Associé d’Économie Politique, Université de Genève
Marie Duret-Pujol, MCF d’Études Théâtrales, Université Bordeaux Montaigne
Vincent Édin, Journaliste et esssayiste
Ivar Ekeland, ancien Président de l’Université Paris-Dauphine
Ilias El Faris – Scénariste, réalisateur
Lina El Soufi, Doctorante en sociologie
Jean-Christophe Eon, écrivain
Camille Escudero, libraire
Frédéric Espi, militant insoumis
Marine Etchecopar, Libraire
Sylvain Excoffon, Maître de Conférences, Université Jean Monnet, Saint-Etienne
Isabelle Fakra
Jules Falquet, Professeure, Université Paris 8 St Denis
Marie Fare, Maitresse de Conférences en Économie, Université Lyon 2
Pierre Fargeton, Enseignant-chercheur, Musicologie, Université Jean-Monnet
Éric Fassin, Sociologue, Professeur à l’Université Paris 8 Saint-Denis
Sonia Fayman, porte-parole de l’Union Juive Française pour la Paix
Georges Yoram Federmann, Psychiatre Gymnopédiste, Strasbourg
* Mathilde Feld, députée de la Gironde
Mohamed Chérif FERJANI, Professeur Honoraire Université Lyon2, Président du Haut Conseil Scientifique de Timbuktu Institute, African Center for Peace Studies
Mathieu Ferradou, MCF en Histoire Moderne, Université Paris Nanterre
Elvire Ferrand Testoni, Éducatrice
Jérémy Ferrer, Bron
Olivier Filleule, Dir. de recherches au CNRS, Prof. ordinaire en sc. pol. à l’Université de Lausanne
Aline Fintz, Ingénieure d’étude, Univ. de Savoie Mont Blanc
Karin Fischer, Professeure des Universités en études irlandaises et britanniques, Université d’Orléans
Virginie Foloppe, Sorbonne Nouvelle
Jacques Fontaine, MCF honoraire de Géographie, Université de Besançon
Arnaud Fossier, Historien, MCF Université de Bourgogne
Maryline Fouché
Isabelle Fouquay, Professeure agrégée d’anglais retraitée
Benoît Fourchard, Écrivain
Françoise Fressonnet, anthropologue
Bernard Friot, Économiste
Marie-Paule Fristot-Rousselot, retraitée de l’Éducation Nationale
Yves Fruchon, Humaniste, consultant retraité
Nora Galland, ATER, Université de Bretagne Occidentale
Davide Gallo Lassere, MCF en Politique Internationale, Université de Londres
Fanny Gallot, Historienne
Michelle Garcia, UJFP
Blanche Gardin, Humoriste, Actrice
Jocelyne Garnier
Julie Garnier, Historienne
Sébastien Garnier, MCF Paris 1
Isabelle Garo, Philosophe
Marina Garrisi, Éditrice
Aurore Gathérias, enseignante
Frank Gaudichaud, Professeur, Hist. et études latino-américaines à l’Univ. Toulouse Jean-Jaurès
Guillaume Gaudin, Professeur d’Histoire moderne, Université Toulouse Jean Jaurès
Jean-Luc Gautero, Maître de conférences émérite en Philosophie des sciences, Université Côte d’Azur
Florence Gauthier, Historienne de la Révolution française
Siegfried Gautier, enseignant
Xavier Gautier
Marylène Gauvin
Andrée Gaye, Retraitée Éducation nationale
Vincent Gayon, Universitaire
David Geoffroy, Auteur – réalisateur
Sylvain George, Cinéaste
Christakis Georgiou, MCF contractuel, Institut d’Études Européennes, Université Sorbonne Nouvelle
Isabelle Gérard, Enseignante retraitée
Valérie Gérard, professeure de philosophie en CPGE
Catherine Ghidaoui
Pascale Gillot, MCF-HDR en philosophie, Université de Tours
Carlo Ginzburg, Historien
Marc Girod, retraité
Éric Gobe, politiste, directeur de recherche au CNRS
Jean-Christophe Goddard, Professeur des Universités, Université de Toulouse 2 Jean Jaurès
François Godicheau, Historien, Professeur à l’Université de Toulouse Jean-Jaurès
Catherine Goldstein, DRCE émérite, Histoire des sciences mathématiques
Lionel Goutelle, retraité de l’éducation nationale
Isabelle Goutmann, directrice d’un média local & indépendant
Massimo Granata, Ingénieur de recherche CNRS
Corinne Grassi, chargée de projets socio-culturelle
Jordi Grau, Citoyen et Professeur de philosophie
Jean-Guy Greilsamer
Patrice Grevet, Professeur honoraire de sciences économiques à l’Université de Lille
Haud Guéguen,
Nacira Guénif, Professeure des Universités, Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, LEGS
* Clémence Guetté, Vice-présidente de l’Assemblée nationale
Claude Guilbaud, Enseignant retraité
Mourad Guichard, Journaliste indépendant
Georges Günther, militant associatif
Patrick Guyot Bitchatch, ancien administrateur de l’État dans les ministères sociaux
Emilie Hache, Maîtresse de conférences HDR
Olivier Hache
Gérard Haddad, Psychiatre, Psychanalyste, Écrivain
Rachid Hadjij, Consultant
Jean-Louis Haguenauer, pianiste, Professor Emeritus, Indiana University Jacobs School of Music
Ouassim Hamzaoui, MCF Science politique, Avignon Université
Sari Hanafi, Prof. de Sociologie, American University of Beirut
Colette Hasne, Doctorante
Fabrice Hauet, masseur bien-être
Clémence Hébert, Cinéaste
Xavier Hélary, Historien, Professeur, Sorbonne-Université
Frédéric Hélein, Professeur (Mathématiques), Université Paris Cité
Annick Hemon, Chanteuse Comédienne
Antoine Hennion, École des Mines, Paris
Odile Henry, Sociologue, Professeure à Paris 8
Nicolas Hensel, assistant d’enseignement artistique
Marie Hesse, enseignante
Thomas Hippler, Professeur d’Histoire contemporaine à l’Université de Caen Normandie
Géraldine Hornberg, membre de l’Union juive française pour la paix
François Houbart, Psychologue
Jean-Claude Houdry, artiste auteur
Arnaud Houte, Professeur d’histoire contemporaine, Sorbonne université
Etienne Hubert, Historien, Directeur d’études retraité de l’EHESS
ANNE Huck, Enseignante
Quentin Humbert, étudiant ENS Lyon, étudiant du master Mondes médiévaux
Benoit Huou, enseignant à TSE, Université Toulouse Capitole
Cassandre Hypeau, Étudiante
Sébastien Ibanez, Enseignant-chercheur, Université Savoie Mont Blanc
Nicole Ion, éducatrice retraitée
Georges Jablonski-Sidéris, Maître de conférences en histoire médiévale, Sorbonne Université
Laure Jabrane, enseignante de philosophie, retraitée, membre de la CAALAP
Ronan Jacquin, chercheur, Institut de hautes études internationales et du développement (Genève)
Armand Jamme, Historien, Directeur de recherches au CNRS
Chantal Jaquet, Philosophe, Professeure émérite à l’université Paris 1 Panthéon -Sorbonne
Ghislaine Jarrige, LFI Saint Etienne
Jacques Jaudon, enseignant
Sylvain Jean, Enseignant
Anne Jollet, Maîtresse de conférences émérite en Histoire moderne
Philippe Josserand, Historien, Professeur, Université de Nantes
Pierre Yves Joubaud, Directeur d’usine
Maïwenn Jouquand
Emmanuelle Jourdan-Chartier, Enseignante en histoire, Université de Lille
Nolwenn Joyaut , enseignante et scénographe
Alain Jugnon, Philosophe
Cathy Jurado, Autrice, enseignante
Nicole Kahn, membre de l’Union juive française pour la paix
Yannis Karakos, Auteur et Parolier
Razmig Keucheyan, Professeur de Sociologie, Université Paris Cité
Khalil Khalsi, Chercheur
Anna Knight, traductrice
Aurore Koechlin, MCF de Sociologie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Marianne VL Koplewicz, Éditions du Souffle
Théophile Kouamouo, Journaliste
Stathis Kouvelakis, Philosophe
Abir Kréfa, Maîtresse de Conférences en Sociologie, Université Lyon 2
Thierry Labica, MCF Civilisation britannique
* Abdelkader Lahmar, Député du Rhône
* Bastien Lachaud, Député de la Seine-Saint-Denis
Annie Lacroix-Riz, Professeur émérite d’hist.contemporaine, Paris-Cité, petite-fille de Benjamin Arbessman, déporté et assassiné à Auschwitz
Annie Lafarge, Militante LFI
Danielle Lafont
Claire Lagraula
* Maxime Laisney, Député LFI de Seine-et-Marne
Elisabeth Lalou, Professeur d’Histoire médiévale, Université de Rouen
Claire Lamy, MCF Histoire du Moyen âge, Sorbonne Université
Emilie Lanciano, Professeur des Universités, Sciences de gestion, Université Lyon 2
Diego Landivar, Enseignant – Chercheur, HDR, Origens Media Lab et Esc Clermont
Hervé Langlois, militant à l’AFPS
Yann Lardeau, cinéaste.
Galatée de Larminat, Chercheuse indépendante en Philosophie et Journaliste
Ramdane Lasheb, membre associé LIAgE
Maurice Latapie
* Pierre Laurent, Sénateur Honoraire
Sabine Laurent, Enseignante retraitée
Michel Lauwers, Historien, Professeur, Université de Nice
Christian Lavault, Professeur de Universités
Vincenzo Lavenia, Historien, Professeur d’hist. moderne, Univ. de Bologne, Italie
Cécile Lavergne, MCF en Philosophie université de Lille
Clément Lavis, étudiant
Isabella Lazzarini, Professeure d’Histoire médiévale, Université de Turin
Judith le Blanc, Maîtresse de conférences, Université de Rouen Normandie
Olivier Le Cour Grandmaison, Historien, politiste, universitaire
Anne Le Guennec, Libraire
Joëlle Le Marec, Professeure, Muséum National d Histoire Naturelle
Vincent Le Texier, Artiste lyrique
Sébastien Lebonnois, Planétologue, Directeur de Recherche CNRS
Jean-Jacques Lecercle, Philosophe, Linguiste, Ancien Prof. à l’Univ. Nanterre
Michelle Lecolle
Xavier Lecoq, Enseignant
Jérémy Lefebvre, Écrivain et Musicien
Julien Lefevre, Photographe
* Sarah Legrain, députée de Paris
* Jérôme Legrave, député de Seine-Saint-Denis
Jean-Marc Lelièvre, CR INRAE
Yves Lemarié, Maître de conférences à l’Université de Bretagne Occidentale
Claire Lemercier, Directrice de recherche en histoire, CNRS
Benjamin Lemoine, Chercheur, CNRS
Jean-Michel Lemoine, ingénieur CNES
Clément Lenoble, Historien
François Lescure, ancien Professeur à l’Université de Lille
Didier Lestrade, co-fondateur d’Act Up-Paris
Laurent Lévy, Avocat à la retraite
Cathy Liminana-Dembélé
Pierre Linguanotto, Cinéaste
Thomas Lienhard, MCF en histoire, Université Panthéon-Sorbonne
Chantal Locatelli
Henri Lombardi, MC en Mathématiques, retraité, à l’Université Marie et Louis Pasteur
Élisabeth Longuenesse, Sociologue arabisante, CNRS (retraitée)
Frédérique Longuet Marx, Anthropologue, Cetobac, Ehess
Helios Lopez
Isabelle Lorand, Chirurgienne
Françoise Lorcerie, DRE science politique, Aix-Marseille Université
Yannick Louesdon, Psychanalyste retraité
Michael Lowy, Sociologue
Viviana Lipuma, Postdoctorante à UFF Brésil, Docteure en philosophie de l’Univ. Paris Nanterre
Arnaud Le Gall, député du Val d’Oise
Katia Le Mentec, Anthropologue, chargée de recherche au CNRS
Frédéric Le Roux, Mathématicien, Professeur à Sorbonne Université
Frédéric Lordon, Philosophe
Jean-Pierre Loustau, Ingénieur
Sandra Lucbert, écrivaine
Marie-Christine Luparello, membre de la Libre Pensée 79 et du Collectif Palestine 79
Armelle Mabon, Historienne
Fanny Madeline, Historienne, MCF, Université Panthéon-Sorbonne
Marta Madero, Ancien professeur de l’Universidad de Buenos Aires et de l’Universidad Nacional de General Sarmiento
Elisabeth Magnin
Eliana Magnani, Directrice de recherche au CNRS
Olivier Maheo, Enseignant
Alain Maire, Retraité humaniste, écologiste et naturaliste
Guilaine Maisse, Professeure d’allemand retraitée
Ziad Majed, écrivain et Professeur, The American University of Paris.
Jean Malifaud, MCF retraité Mathématiques, Paris 7
Kamila Mamadnazarbekova, doctorante, Sorbonne Université
Brigitte Mancel, Professeure de lettres retraitée
Marianne Mangeney, chercheuse au CNRS
Odile Mangeot, association Alliance pour l’Emancipation Sociale Nord Franche-Comté
Philippe Mangeot, professeur de littérature
Patrice Maniglier, Philosophe, Université Paris Nanterre
Danielle Manoukian, psychologue/psychanalyste
Cathy Maquart, Enseignante retraitée
Olivier Marboeuf, Écrivain, Commissaire d’exposition, Producteur
Audrey Marc, Professeur
Joelle Marelli, traductrice, autrice
Ivan Marin, Professeur des Universités, Amiens
Anne-Marie Marteil-Oudrer Syndicat National des Médecins Hospitaliers FO
Céline Martin, Historienne, Maîtresse de conférences à l’Université Bordeaux Montaigne
Gilles Martin, médecin retraité
Miguel Martinez, Maître de Conférences en Mathématiques, Université Gustave Eiffel
Joseph Martinod, Professeur
Robert Mascarell, Journaliste en retraite
Geneviève Massard-Guilbaud, historienne, directrice d’études émérite à l’EHESS
Arnaud Massin, Doctorant à l’Université de Liège
Isabelle Mathieu, MCF Histoire du Moyen Âge – VP Formation et vie universitaire, Université d’Angers
Mickaël Matusinski, MCF Maths Université de Bordeaux
Florence Mauger, enseignante
Danielle Maurice, doctorante, Université Lyon 2
Jean-Yves Maximilien
Annie Mayar-Poteau, Infirmière scolaire retraitée
Nicolas Mayard, Journaliste
Gérard Médioni
Maria-Alice Médioni, formatrice, militante pédagogique
Anne-Lise Mege
Miriem Méghaïzerou, Doctorante, Sorbonne Nouvelle
Eliane Meillier
Hacene Mekhnache
Graziella Melis Roussel
Marion Ménard, pair aidante TSA/TDAH
Marie Menaut
Sophie Mendelsohn, Psychanalyste
Franck Mercier, Historien, Professeur, Université de Rennes
François Mérel, Médecin retraité
Daniel Mermet, Journaliste
* Marie Mesmeur, Députée d’Ille et Vilaine
Germain Meulemans, Anthropologue, CR CNRS
Gilles Meyer, bibliothécaire
Najoua Mhamedi
Alain Migus, Citoyen retraité
Christophe Mileschi, Professeur, Université Paris Nanterre
Pierre Millien, Chargé de Recherche en mathématiques, CNRS
Virginie Milliot, Anthropologue, Maitresse de conférences, Université Paris Nanterre
Chantal Mirail
Estelle Miramond, Maîtresse de conférences en sociologie – Institut Humanités Sciences Sociétés, Université Paris Cité
Adlene Mohammedi, Chercheur et enseignant en géopolitique
Jacques Moisan, Retraité de l’enseignement
Olga Moll, Agrégée, MCF musique et musicologie, Université Paris 8, retraitée
Frank Moll, Dirigeant d’entreprise
Sylvie Monchatre, Sociologue, Professeur, Université Lumière Lyon 2
Mathilde Monge, Maître de Conférences en Histoire Moderne
Lucile Mons, Psychanalyste et psychologue
*Bénédicte Monville, Élue municipale et communautaire à Melun, ancienne Conseillère Régionale d’île de France
René Monzat, Chercheur indépendant
José-Luis Moragues, Dr en Psychologie, Maître de Conférences – Université Paul Valéry
Nathalie Morales
Gérard Mordillat
Éric Moreau, Université de Poitiers
Leonardo Moreira, MCF Philosophie, Université de Paris 8
Anne Morelli, Professeure honoraire de l’ULB
Haude Morvan, MCF Histoire de l’art médiéval
Marianne Morvan, Professeure agrégée d’anglais, UFR Médecine
Aimée Mouchet retraitée de l’EN, agrégée d’histoire
Damase Mouralis, Professeur des Universités, Université de Rouen-Normandie & CNRS
Guillaume Mouralis, Historien, Directeur de recherche au CNRS, CESSP, Paris
Jean-Noël Moureau
Marie-Hélène Mourgues, Maitre de Conférence, UPEC
Bertrand Müller, Historien, DR émérite, CNRS (historien de Marc Bloch et Lucien Febvre)
Marwan NACIRI – Post-doctorant CNRS
Dominique Natanson, animateur du site Mémoire Juive & Éducation
Philippe Naud, Professeur certifié d’Histoire Géographie
Fabien Navarro, Maître de Conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Ron Naiweld, Chargé de recherches en études juives, CNRS
Annliese Nef, Historienne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Josselin Neveux, diffusion de supports de communication concerts
Kim Vu Ngoc, étudiant
Jean-Philippe Nicolas, enseignant
Brigitte Nicolet, retraitée
Massimiliano Nicoli, Psychanalyste, Philosophe
Dominique Noly, retraité
Yannick Nué
Norbert Nusbaum, Assistant social retraité à Besançon
Joseph Oesterlé, Professeur émérite, Sorbonne Université
Christophe Oberlin, Chirugien, professeur
Christian Oillic
Josiane Olff-Nathan, Ingénieur d’Etude retraitée, Université de Strasbourg
Béatrice Orès, Union Juive Française pour la Paix
Martine Ostorero, Historienne, Professeur, Université de Lausanne
Nilton Ota, Directeur de programme du Collège international de Philosophie
Michel Ouaknine, Ingénieur semiconducteurs, militant MRAP & UJFP
Mohamed Ouerfelli, Maître de conférences en histoire médiévale, Université d’Aix-Marseille
Louis-Gilles Pairault, Conservateur en chef du Patrimoine, adhérent du parti Les Républicains
Ugo Palheta, Sociologue, Université de Lille
Julien Pallotta, Philosophe et traducteur
Stefano Palombarini, Économiste, MCF Paris 8
Luca Paltrinieri, Maître de conférences Philosophie, Université de Rennes
Bruno Paoli, Professeur des Universités, Université Lumière Lyon 2
Ilan Pappé, Historien israélien, Professeur à l’Université d’Exeter
Corentin Parent
Pierre Parent, Maître de conférence, Université de Bordeaux
Frédéric Pasquet
Christophe Pébarthe, Historien, Université Bordeaux Montaigne
Julien Peccoud, enseignant de SVT en lycée, éducation nationale
Thierry Pécout, Historien, Professeur à l’Université de Saint-Etienne
Francis Peduzzi, directeur de scène nationale
Rodny Pélage
Michele Pellegrini, Historien, Professore associato, Université de Sienne (Italie)
Willy Pelletier, Sociologue, université de Picardie
Fernand Peloux, historien, CNRS
Maëlle Pennéguès, Doctorante en histoire moderne, Sorbonne Université
Charles Pennequin, écrivain
Catherine Perret, Professeure émérite, Université Paris 8
Lucien Perrin, Éditions Amsterdam
Marc Perrin, Écrivain, Éditeur
Annick Peters-Custot, Professeure d’Histoire médiévale, Nantes Université
Jean-François Pétillot, PRCE, Université Paul-Valéry Montpellier, retraité
Thomas Petitbon, Union Juive Française pour la Paix & France Insoumise
Nathalie Peyre, Prof de lettres
Roland Pfeffenkorn, Sociologie, Professeur émérite, Strasbourg
MICHEL Philippo, Coordinateur livret planification écologique
Emmanuelle Picard, Professeure d’histoire contemporaine, ENS de Lyon
Caecilia Pieri, PhD Associate Researcher, Ifpo Institut français du Proche-Orient, Erbil, Kurdistan irakien
Alexandre Piettre, Docteur en Sociologie politique et Professeur de Philosophie
Laure Piguet, Historienne, Université de Fribourg/Centre Marc Bloch
Brigitte Pignard
Philippe Pignarre, éditeur
Michel Pinault, Historien, retraité
Jean-Daniel Piquet, Historien
Marie Plassart, maîtresse de conférences, Université Lyon 2
Jacques Pochard, Pédiatre
Christopher Pollmann, Prof. des Universités agrégé de Droit public, Université de Lorraine – Metz
Hugues Poltier, philosophe
Jean-Pierre Poly, ex-professeur, Histoire du droit, Université Paris-Nanterre
Julien Ponceblanc, Professeur de Français et d’Histoire & Géographie, CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon
Alan Popelard, Enseignant
François Portefaix, retraité de l’éducation nationale
Raphaël Porteilla, Professeur de sciences politiques, Université de Bourgogne
* Thomas Portes, député de Seine-Saint-Denis
Elio Possoz, écrivain
Clément Poullet, Secrétaire général de la FNEC FP-FO Angers
Franck Poupeau, sociologue, DR CNRS, éditions Raisons d’agir.
* Philippe Poutou, militant NPA
Sébastien POYARD, Professeur agrégé d’Histoire-Géographie, Vesoul
Plínio W. PRADO Jr, Professeur émérite de Philosophie, Université de Paris 8
Renée Prangé, Directeur de recherches CNRS retraitée
Stefanie Prezioso, Historienne, Suisse
Nicolas Prignot, Enseignant et chercheur en philosophie, ERG/ ESA St-Luc, Bruxelles
Klervi Propice, Doctorante en psychologie
François Provansal
* Loïc Prud’homme, député de la Gironde
Serge Quadruppani, auteur et traducteur
Christelle Rabier, MCF EHESS
Geneviève Rail, Ph.D., Professeure émérite distinguée, Institut Simone-De Beauvoir, Canada
François Ralle Andreoli,conseiller des Français-es d’Espagne – 2e circonscription d’Espagne
Nordine Raymond, tête de liste « Faire Mieux pour Bordeaux », La France insoumise
Antoine de Raymond, Sociologue
Eva RAYNAL, Maîtresse de conférences en Littérature comparée, Université de Mayotte, Dembéni
Isabelle Réal, Historienne, MCF, Université de Toulouse Jean-Jaurès
Thierry Reboud, UJFP
Gianfranco REBUCINI, anthropologue, Chargé de recherche au CNRS
Fanny Rebuffat, Psychiatre
Manuel Rebuschi, Enseignant-chercheur en Philosophie, Université de Lorraine
Myrto Reiss, Médiatrice culturelle
Yannick Reix, Directeur festival de cinéma de Douarnenez
Mathieu Renault, Philosophe, Professeur à l’Univ. de Toulouse Jean-Jaurès
Jean-Paul Renoux
Eugenio Renzi, Enseignant
Jordan Rezgui, pensionnaire de la Comédie-Française
Nassim Rezzoug
Fabrice Riceputi, Historien
Mathieu Rigouste, Sociologue
Laurent Ripart, Historien, Professeur à l’Univ. de Chambéry
Manu Riquier
Nathalie Rivoire
Agathe Roby, docteure en histoire médiévale, toulouse
Odile Rollet, Pédopsychiatre, Lyon
Françoise Romand, Cinéaste
Isabelle Rosé, Historienne, Professeur, Université de Rennes
André Rosevègue, membre de l’Union juive française pour la paix et de la CAALAP
André Rougier, blagueur
Marie-Jeanne Royer enseignante retraitée
Jérémy Rubenstein, Historien
Damien Ruiz, Historien
Catherine Ruph
Alain Ruscio, Historien
Alain Rustenholz, Auteur
Gabriel Sabbagh, Professeur de logique mathématique (retraité) et Historien en activité, Université Paris Cité
Oreste Sacchelli, Professeur émérite, Université de Lorraine
* Arnaud Saint-Martin, député de la Seine-et-Marne
Marie-Claude Saliceti, psychologue clinicienne en retraite
Grégory Salle, sociologue, Directeur de Recherche CNRS.
Jean Salque, Cadre de la Fonction publique retraité
Victoria Saltarelli, retraitée de l’Éducation nationale
Akiko Sameshima, Traductrice pour La fabrique, Japon
Emilia Sanabria, Anthropologue, Directrice de recherche au CNRS
Alexandre Sanchez, éditrice
Thibault Sans, salarié du Média
Renaud-Selim Sanli, Éditions-librairie Météores
Jérôme Santolini, Directeur de Recherche, Biochimie
Ismahen Saouci
Catherine Sauvage
Pierre Sauve, Professeur retraité de l’université Paris 12
Sbeih Sbeih, ATER, Lyon 2, chercheur associé Iremam
Dimitris Scarpalezos, retraité M.C de mathematiques et membre du snesup
Valentin Schaepelynck, Maître de conférences en sciences de l’éducation (Université Paris 8), Directeur de programme au Collège international de philosophie.
Matthieu Scherman, historien
Jean-Marc Schiappa, Historien, Prix Guizot de l’Académie française (2023)
Nathalie Schlatter-Milon, Psychologue Clinicienne
Alain Schnapp, archéologue, Ancien professeur à l’Univ. Panthéon-Sorbonne
Joël Schnapp, Enseignant, Historien
Raphaël Schneider, Co-fondateur de Hors-Série
Peter Schöttler, Directeur de recherche honoraire au CNRS (biographe de Marc Bloch)
Tod Shepard, Historien, Professeur, John Hopkins University
Guillaume Sibertin-Blanc, Philosophe, Professeur à l’Univ. Paris 8
Bernard Sibieude, Retraité, Strasbourg
Michèle Sibony, Union juive française pour la paix
Aude Signoles, MCF Sciences Po, AMU MESOPOLHIS
Stéphane Simard-Fernandez Réseau Salariat
Yves Sintomer, Professeur de Science politique, Université de Paris 8
Stéphane Sirot, Historien
Tahar Si Serir, membre du mouvement “Les Humanistes”, co-fondateur du collectif “Libérons l’Algérie’”
Jean-Claude Slyper
Jérôme Soldeville, conseiller municipal délégué Grenoble
Gabriela Solis, Collectif 69 Palestine
Jon Solomon, Professeur en littérature chinoise, Université Lyon 3
Marco Spagnuolo, Doctorant, Université Paris 8/LLCP
Cornelie Statius Muller, Comédienne et metteure en scène, marionnettiste et machiniste
Isabelle Stengers, Philosophe, Professeur émérite de l’Université Libre de Bruxelles
Mélanie Stravato, Editrice à Avignon
Alina Surubaru, Sociologue, Université de Bordeaux
Annick Suzor-Weiner, Professeure émérite Université Paris-Saclay
Julien Syren, Ingénieur
Stéphane Tabourin, Professeur des écoles, en REP+, conseiller syndical FSU-SNUipp54, militant LFI, militant associatif
Claire Talon, Psychanalyste, Docteure en Sociologie Politique
Julien Talpin, Directeur de recherche au CNRS
Moufida Tamou, Parente d’étudiants
Cécile Tannier, Directrice de recherche CNRS
*Andrée Taurinya, Députée de la Loire
Romain Telliez, MCF histoire, Sorbonne Université
Laurence Terk, Historienne
Anne Texier, Professeure de Philosophie
Pierre Thévenin Chargé de recherche au CNRS
Daniel Thin, Sociologue, Professeur Honoraire des Universités (Lyon 3)
Charlotte Thomas, Politiste, Chercheure indépendante associée au programme Asie de l’IRIS
François Thoreau, Chercheur qualifié et Professeur associé, FNRS – Université de Liège (Belgique)
Mirabelle Thouvenot, militante décoloniale
Hervé Tiberghien, Auteur, réalisateur de films documentaires
Mathieu Tilllier, Professeur d’Histoire de l’Islam médiéval, Sorbonne Université
Sylvie Tissot, Professeure au département de science politique, Université Paris 8
John Tolan, Historien, Professeur à l’Université de Nantes
Valentina Toneatto, Historienne
Armando Torres Fauaz, Historien, Universidad Nacional de Costa Rica
Rémi Toulouse, Éditeur
Mireille Touzery Le Chenadec, Professeur émérite d’Histoire moderne, UPEC
Enzo Traverso, Historien, Cornel University (États-Unis)
Brigitte Trincard Tahhan, Retraitée éducation nationale
Alessia Trivellone, Historienne, Université de Montpellier 3
Véronique Troyas
Françoise de Turckheim, Médecin
Jean-Christophe TURPIN
Martine Ullmann, Femmes en Noir Lyon, UJFP
Sébastien Ulrich, Menuisier
Maude Vadot, Maitresse de conf. en sciences du langage, Univ. Savoie Mont Blanc
Stanley Valbrun, Docteur en Sciences de l’éducation, travailleur social
Massimo Vallerani, Professore ordinario di Storia medievale, Université de Turin (Italie)
Stéphane Valter, Professeur en langues et civ. Arabes, Univ. Lyon 2
Yves Vargas, Philosophe
Amandine Vautaret, étudiante
Mélanie Vay, Docteure en Science politique
Graziella Vella, Anthropologue, U Mons
Manolo Vella, Enseignant
Anne Verjus, DR CNRS, laboratoire Triangle
Françoise Vergès, Autrice, militante féministe décoloniale
Joël Vernet, Écrivain
Jean-Baptiste Vérot, MCF en Histoire moderne, Université Marie & Louis Pasteur
Victor Verwaerde, étudiant, ENS de Lyon
Thomas Vescovi, Doctorant (Ehess/ULB)
Baptiste Veyssy, Éditeur
Camille Viallon
Jérôme Vidal, Éditeur, traducteur
Nicolas Vieillescazes, Éditeur
Fanny Vincent, MCF à l’Université de Saint-Etienne.
Léonard Vincent, Écrivain
Gilles Vinçon, Chercheur en Entomologie
Christiane Vollaire, Philosophe, Chercheure associée au CNAM et au LCSP de l’Université Paris Cité Fellow de l’Institut Convergences Migrations
Eric Vuoso
Dror Warschawski, Chercheur CNRS, Sorbonne Université, Paris
Jean-Marc Warszawski, musicologue, directeur du magazine musicologie.org
Abdourahman Waberi, écrivain
Tim Wandriesse
Laurent De Wangen, enseignant
Laurent Weill, Médecin retraité, LFI, UJFP
Françoise Weill-Ponsin, Médecin retraitée, LFI, UJFP
Charles Wolfe, Professeur des Universités, Dépt de Philosophie, Université Toulouse Jean-Jaurès
Yahya Yachaoui, Professeur retraité, Poète, Écrivain, Traducteur
Hèla Yousfi, Maître de conférences, Université PSL-Dauphine
Louisa Yousfi, Autrice, militante décoloniale
Nassera Zaidi, Coordinatrice du CNRCC (collectif national pour la reconnaissance des crimes coloniaux)
Barbara Zauli, Enseignante-chercheuse, Philosophie, Université Paris 8, vice-présidente du Collège International de Philosophie.
Mathilde Zederman, MCF Université Paris-Nanterre
Caroline Zekri, MCF, Université Paris-Est Créteil
Afifa Zenati IGE, ENS de Lyon
Laurick Zerbini, MCF – HDR, Université Lyon 2
Dominique Ziegler, Auteur, Metteur en scène
Alexis Zimmer, Professeur, Histoire environnementale, Université de Liège (Belgique).
Institutions :
CAALAP (Coordination Antifasciste pour l’Affirmation des Libertés Académiques et Pédagogiques)
Collectif 69 Palestine
Collectif Education Avec Gaza
Éditions La Fabrique
Éditions Terre de feu
FNEC FP-FO Angers
La France Insoumise
Librairie La Gryffe, Lyon
Librairie Les 400 Coups, Bordeaux
Institut La Boétie
Union Juive Française pour la Paix
27.11.2025 à 15:31
Malcolm X à l’épreuve du cinéma hollywoodien
Texte intégral (8146 mots)
Quand Spike Lee fait sienne la figure mythique de Malcolm X, la lettre qui aura servi de patronyme au leader prophétique a été phagocytée par le Capital : le « X » révolutionnaire des Black Muslims figure sur des bonnets, casquettes, T-shirts mais aussi, comme le rappelle le théologien James H. Cone, sur des « cadrans de montres, ventilateurs, réfrigérateurs et cartes à jouer ». Lee envisagera lui aussi de tirer profit de cette récupération en développant un merchandising autour du film, tout comme il n’aura pas hésité à lancer un commerce à son effigie, la boutique Spike’s Joint, toujours en activité.

Le réalisateur a le sens des affaires, c’est le moins qu’on puisse dire. Sa place de maître d’oeuvre du biopic Malcolm X, il l’aura gagnée en ruant dans les brancards, hurlant au tout Hollywood qu’il est le mieux placé pour mettre en scène le parcours du porte-parole charismatique de la Nation of Islam. Il a le capital symbolique pour en imposer. Il ne peste pas en outsider. Lee s’accommode d’ailleurs parfaitement du système : « there’s nothing like it in the world ! »1 a-t-il déclaré. Son « coup » ne déstabilise pas l’industrie qui y voit, après tout, l’opportunité de s’adresser à un public plus large – et tant mieux. Le canadien Norman Jewison, premier choix de la Warner pour tourner Malcolm X, se retire.
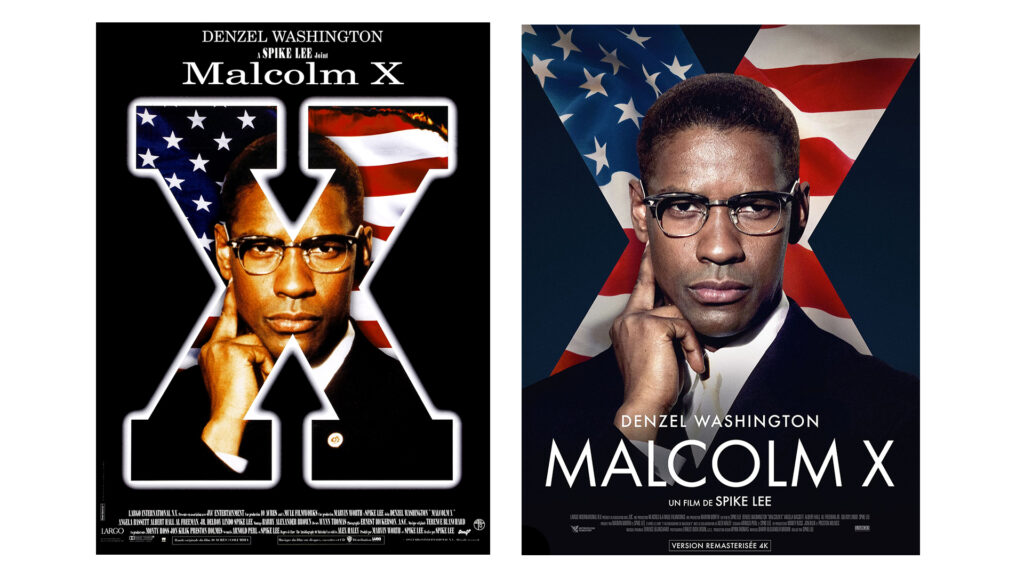
Loin de la classe ouvrière
Pour le réalisateur de Do the Right Thing, aucun blanc n’est assez « sensible » pour servir la cause. On tient là l’une des fameuses sorties de « premier concerné » de Lee, ce produit de l’élite sociale déguisé en homme de la rue, ce revendeur de militantisme didactique qui fait la leçon sur qui peut ou ne peut pas prendre en charge la blackness à l’écran. Sait-il que l’un des films préférés de Malcolm X est réalisé par Michael Roemer, un cinéaste allemand, juif, exilé aux États-Unis ? Son superbe Nothing but a man représente la classe ouvrière noire comme Spike Lee ne l’a encore jamais fait.
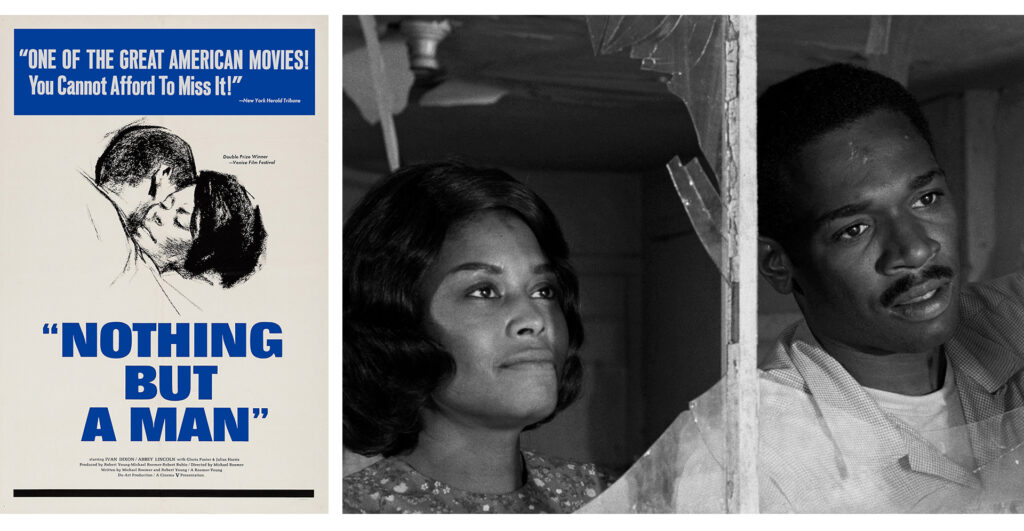
Il est tentant de spéculer sur les raisons de l’engouement de Malcolm : une romance entre un cheminot et une enseignante afro-américains (loin, donc, de l’horizon libéral-progressiste de l’amour interracial), une intrigue qui se construit autour de la question de la dignité, un regard aiguisé sur les disparités entre Noirs prolétaires et Noirs embourgeoisés, conservateurs, chrétiens, en cheville avec des blancs voulant maintenir le statu quo racial – ces « Oncle Tom » que Malcolm avait en horreur ! En 1964, une telle fibre marxiste ne pouvait s’exprimer que depuis les marges du cinéma indépendant. Si Lee vient de cette frange, il ne lui aura pas appartenu longtemps.
Une servilité au canon hollywoodien
L’ouverture de Malcolm X est éloquente. Spike Lee, qui a pris l’habitude de jouer dans ses films, est le premier à apparaître à l’écran. On aurait pu s’attendre à ce que sa star, Denzel Washington, le précède. Quand on le découvre, Lee se fait cirer les pompes : il est clair, à travers ce premier plan, que c’est lui qui mène la danse et donne le tempo. L’ample mouvement d’appareil qui nous mène à lui ne reprend que lorsqu’il quitte son jeune shoeshiner pour traverser une grande artère de Boston, haut en couleurs, sapé comme un zoot (zazou, une mode à laquelle le jeune Malcolm sacrifie dans les années 1940). On peut se pâmer devant le lustre de ce plan-séquence. On peut aussi dire qu’il annonce une servilité au canon hollywoodien. Ici, la « vie de réinventions »2 de Malcolm est indexée sur l’histoire du cinéma américain. Un temps fort est associé à un genre. La jeunesse de « Detroit Red », noceur, dealer et cambrioleur, a le côté flamboyant du musical des années 1940-50 ; son Purgatoire avant son éveil spirituel reprend les codes du film de prison, en vogue dans les années 1980-90 ; quant à la représentation de la Nation of Islam, elle flirte avec l’imaginaire du Parrain, avec ses tractations, ses « soldats » tout en abnégation, ses meurtres fratricides.

Dans la deuxième partie du film, Lee trouve un moyen frappant d’évoquer la stature divine d’Elijah Muhammad : celui-ci fait une apparition surnaturelle dans la cellule de Malcolm. On comprend que c’est une vue de l’esprit, qui confirme que le dialogue religieux entre le maître et le disciple est engagé, même s’ils ne se sont pas rencontrés. Cette vision ressemble à une théophanie de fresque biblique dispendieuse façon Les Dix Commandements : elle est au futur prophète Malcolm X ce que le buisson ardent est à Moïse. Drôle d’idée quand on connaît la détestation de Malcolm pour le judéo-christianisme, synonyme pour lui d’aliénation, de soumission à une divinité complice de l’esclavage et de l’effacement culturel des Noirs. Il est vrai qu’il n’aura pas pu se familiariser avec une théologie de la libération née à la fin des années 1960 – il meurt au milieu de la décennie. Elle introduit la radicalité du Black Power au sein de l’Église noire, elle refaçonne la divinité à l’aune de l’expérience noire américaine, en en faisant une alliée politique, une compagne de lutte. Même si l’on pourrait rétorquer que Moïse (Moussa) est une figure centrale du Coran, Spike Lee convoque une imagerie plus proche de la Bible, l’un des livres qui aura contribué à établir le canon hollywoodien, avec Shakespeare et la littérature populaire et feuilletonesque du XIXe siècle.

Une image peut en cacher une autre
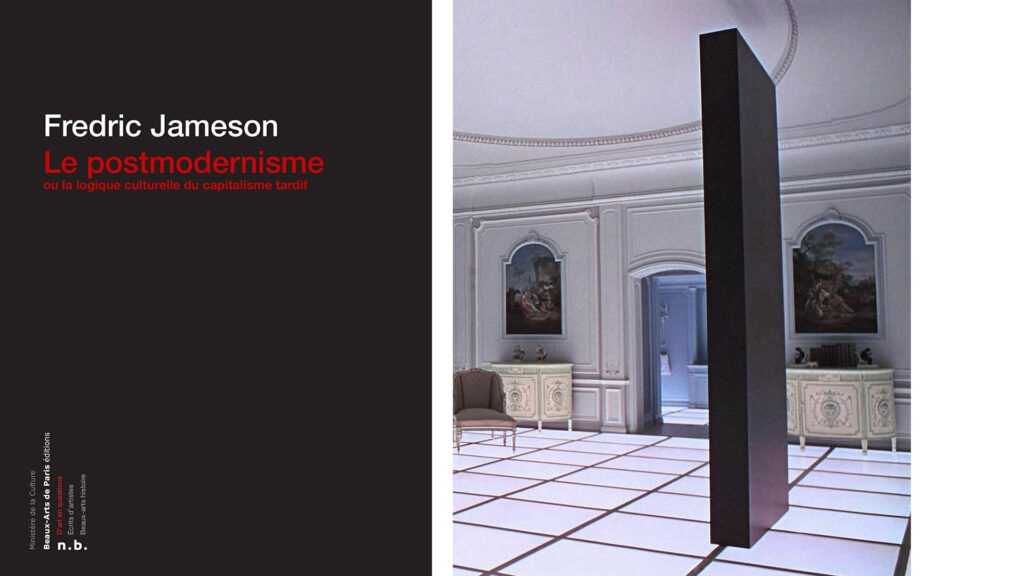
On peut y voir un symptôme de son époque : Malcolm X est sorti en 1992, soit la même année que Postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif. Fredric Jameson y parle du congé donné à l’idée de profondeur, que ce soit dans la peinture, le cinéma ou l’architecture. L’image appelle l’image et dans le cas du cinéma, le real se confond avec le reel3. Une intuition géniale incitera Jameson à voir dans le monolithe de 2001, l’Odyssée de l’Espace la prophétisation d’une nouvelle ère culturelle où tout n’est que surface, platitude, dephtlessness. Le plus grand nom du pop art abonde dans son sens : « Si vous voulez tout savoir sur Andy Warhol, vous n’avez qu’à regarder la surface de mes peintures, de mes films, de moi. Me voilà. Il n’y a rien dessous. ». L’imagerie marchande de ses Diamond Dust Shoes se substitue à la glaise des Souliers de Van Gogh, usés, encore lestés du poids du réel, chargés d’un hors-champ : la vie de dur labeur, le travail harassant de la terre.

Tout se passe comme si Spike Lee avait lui aussi cédé aux sirènes de cette postmodernité fin de siècle. En définitive, il n’y a pas loin entre Malcolm X et la manière dont Forrest Gump traversera (en courant) le récit national un an plus tard – son aïeul, dont il est le portrait craché, sort tout droit de Naissance d’une nation de D.W. Griffith, la Guerre du Vietnam est ici moins un fait historique qu’une réminiscence des films sur le sujet, avec leur bande-son rock à l’avenant (Jimmy Hendrix, les Rolling Stones et cie). Ce qui était marquant dans Forrest Gump, c’était aussi cette manière inédite d’intégrer le héros aux archives télévisuelles et, à partir de là, de faire basculer le récit dans l’uchronie. Le film de Spike Lee ne se livre pas à une telle réécriture mais il pense la trajectoire de Malcolm comme une somme d’éléments iconiques que le public aura tout le loisir de reconnaître : les déclarations à la presse, le langage corporel qui accompagne les prises de parole d’un monstre d’éloquence (regard concentré, index levé et posé près de l’oreille), le pèlerinage à la Mecque, Malcolm armé d’un M1 Carabine quand sa vie est en danger. Les agents du FBI qui prennent « le démagogue irresponsable » en filature jusque sur le continent africain sont eux aussi des faiseurs d’images : ils « shootent » Malcolm de loin. Ce sont des filmeurs embusqués.
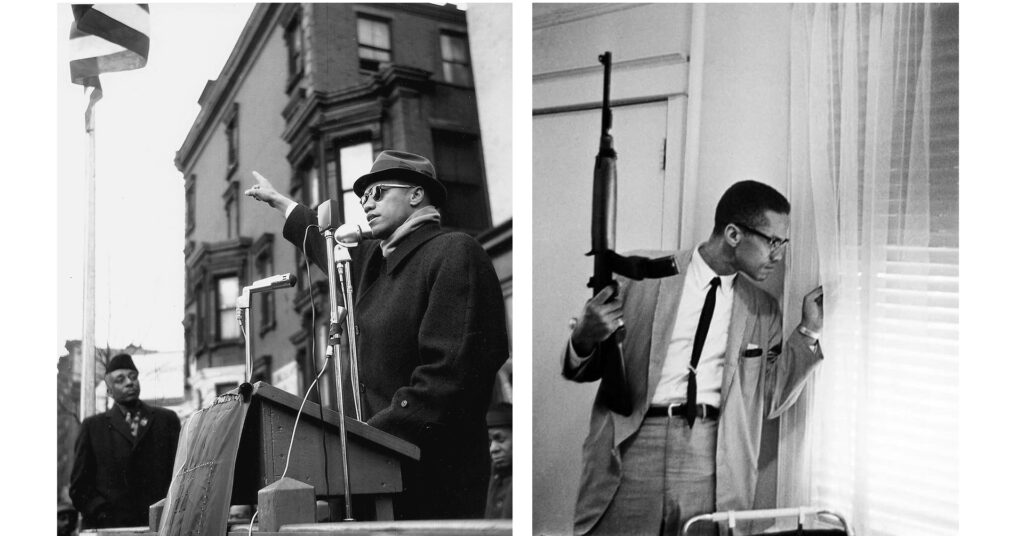
La rivalité entre les mastodontes Malcolm X et JFK d’Oliver Stone, dont on a tant parlé à l’époque, se joue aussi sur ce terrain : celui du pastiche, de la refabrication mimétique. Il faut se demander avec Baudrillard s’il n’y a pas là une sorte de « crime parfait » dont ces œuvres se sont rendues complices alors même que le meurtre était leur grande affaire, le dossier qu’elles entendaient instruire. Le meurtre en question, le voici : le cinéma a supplanté le réel, il l’imite si bien que nous pouvons continuer de croire à son existence, sans savoir que sous la chair du plan, sous sa surface, gît un cadavre. En un sens, James Baldwin ne se trompait pas : toute adaptation hollywoodienne de L’Autobiographie de Malcolm X équivaudrait à un « deuxième assassinat ». Dans l’imaginaire collectif, le visage du leader n’a-t-il pas fini par se confondre avec celui de la star de cinéma Denzel Washington ?

Pacte faustien
En définitive, Malcolm X rend compte de la montée en puissance de Spike Lee mais aussi de l’embourgeoisement – voire de l’essence bourgeoise – de son cinéma. L’extraction sociale du réalisateur se devine d’ailleurs dans l’ambiance « Ivy League » de School Daze, son deuxième long métrage, tout comme dans la bohème chic dans laquelle grandit le saxophoniste de Mo’ Better Blues. Mais on ne peut pas le lui contester : au début des années 1990, Lee est en effet bien placé pour réaliser Malcolm X ; on pourrait même penser qu’il s’y préparait depuis longtemps. Le début de sa filmographie est émaillé de références à Malcolm. On voit ce dernier en photo et on le mentionne dans School Daze. Le carton final de Do the Right Thing réunit les propos « non-violents » de Martin Luther King Jr, et les déclarations de sa (supposée) Némésis sur la nécessité pour les Noirs de se défendre, de réaffirmer leur dignité « par tous les moyens nécessaires ». Pour Lee, il s’agit moins de renvoyer ces deux approches dos à dos que de les mettre en tension, avec l’idée que Martin et Malcolm formeraient une sorte de Janus de la révolution noire américaine des années 50-60. Mais il y a le revers de la médaille : plus on avance dans l’oeuvre de Lee avant Malcolm X, plus il s’entiche de la grande forme hollywoodienne, plus les aspirations et enjeux s’individualisent – art, amour et argent forment la sainte trinité des héros de Lee. La révolution que l’Amérique noire appelait de ses vœux peut attendre…
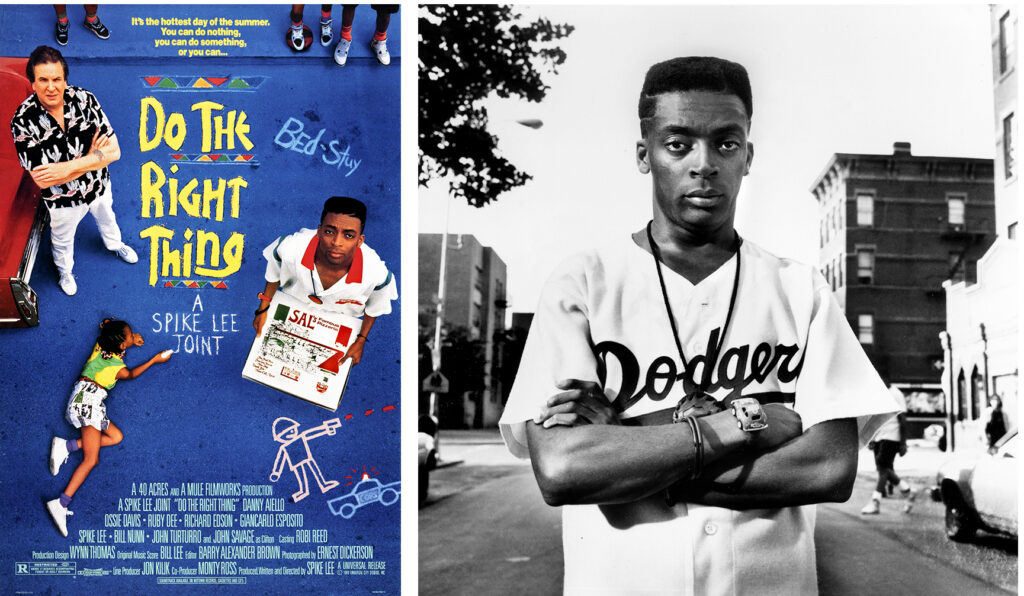
Dans Malcolm X, les masses se résument à une clameur anonyme, à une horde de figurants mettant en valeur le luxe de la production value. Lee n’aspire à rien d’autre qu’à donner chair à la figure héroïque et humaniste qui se dessine en filigrane dans L’Autobiographie co-écrite avec Alex Haley4 : du pain béni pour cette « usine à rêves » dans laquelle Malcolm voyait une manufacture de mensonges, une fabrique de personnages noirs oncletomisés. A ce titre, l’entente entre Lee et le producteur Marvin Worth, le propriétaire des droits L’Autobiographie à partir de 1967, est révélatrice : le réalisateur chante les louanges de son collaborateur dans un documentaire consacré à la genèse du film.
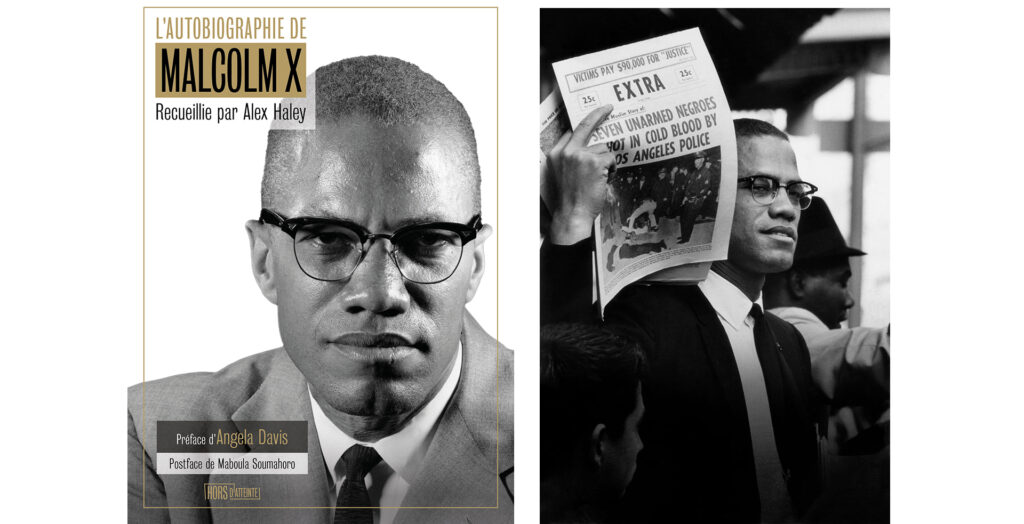
Malcolm par Baldwin : le biopic impossible
Worth est l’homme qui découragea James Baldwin dans ses efforts de porter la vie de Malcolm à l’écran. Ce dernier pressentit la nature diabolique, faustienne de cette expérience avant même d’écrire une seule ligne. Comme il l’écrit dans Chassés de la lumière : « L’idée que Hollywood puisse faire une œuvre honnête sur Malcolm ne pouvait que paraître saugrenue. Et pourtant – je ne voulais pas passer le restant des mes jours à me dire : ça aurait pu être fait si t’avais pas été si froussard. Je sentais que Malcolm ne m’aurait jamais pardonné pour ça. Vivant, il avait confiance en moi et j’estimais qu’il me faisait encore confiance, mort, et cette confiance, en ce qui me concerne, m’obligeait. ».
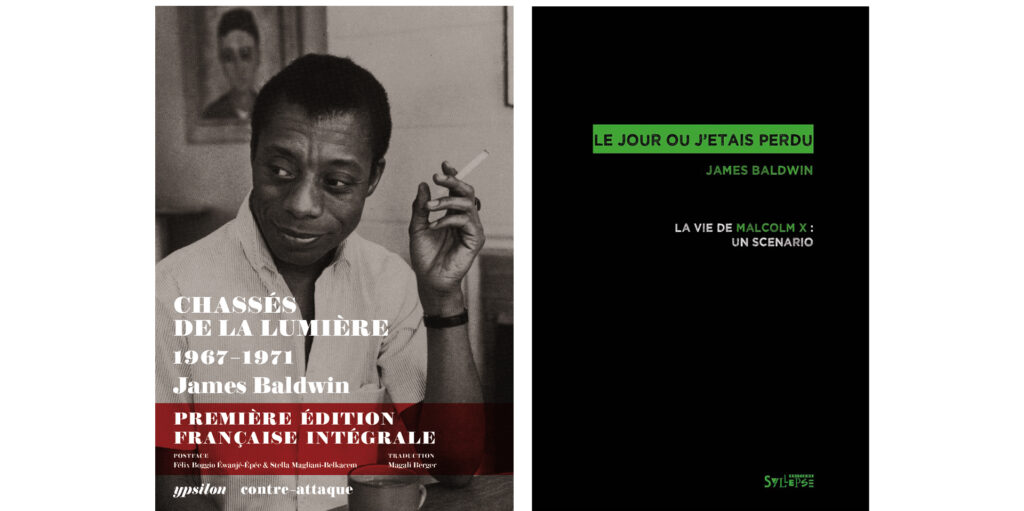
Dans son scénario, Baldwin organise une structure complexe, faite d’enchâssements successifs, d’allers-retours dans le temps. Elle est anti-hollywoodienne, plus proche des cinémas de la modernité européenne ou du Nouvel Hollywood que du classicisme adopté par Lee. Le montage aurait parachevé l’image diffractée de Malcolm et en cela représentative de sa complexité. Il avait « tant de noms » rappelle Baldwin à plusieurs reprises : Malcolm Little, Detroit Red, Malcolm X, Omowale (« le fils qui est revenu »), Al-Hâjj Mâlik al-Shabazz الحاج مالك الشباز . Ce récit deviendra l’ouvrage Le jour où j’étais perdu. A l’instar de Worth, Spike Lee trouve lui aussi la chose confuse. Il en fait cas mais il veut la retravailler. Il privilégiera la linéarité, l’approche chronologique, malgré quelques flash-backs inclus ici et là. D’une durée ogresque, comparable à celle de JFK, Malcolm X est une courbe instable avec ses creux et ses pics. Le film souffre des travers inhérents au biopic, ce compromis entre la page Wikipédia et la nécro – le genre rappelle que le récit d’une vie n’a d’extrémités que celles que la mort peut offrir. Paradoxe du biopic : il opère depuis la tombe et, depuis vingt ans, il est l’un des genres les plus vivants qui soit.
Le patrimoine au détriment de la vérité
Il y a un monde entre un James Baldwin qui a vécu dans le ghetto et fréquenté les sommités de la révolution noire américaine et un Spike Lee issu des classes aisées qui gère la chose en business man, en cinéaste-notaire garant des intérêts moraux et financiers des héritiers. En se plaçant sous l’autorité de Betty Shabazz, créditée comme consultante, il se préoccupe moins de cinéma que de patrimoine. Cela relèverait de l’anecdotique si la mainmise de l’épouse n’engendrait pas deux choix significatifs : le couple Betty-Malcolm s’en trouve idéalisé, tandis que la sœur Ella Collins est reléguée dans le hors-champ, alors qu’elle fut un soutien moral et financier de premier plan. C’est elle qui fut la mécène du Hajj de Malcolm, que le film reconstitue avec grandeur, en marchant sur les traces de l’immense fresquiste David Lean. Si Ella est absente du film, c’est parce que Betty la déteste : « Je n’ai aucun respect pour cette femme » déclarera-t-elle au Boston Globe en 1992. De son côté, Ella pense que « Spike Lee ne recherche que l’argent et le prestige. Il n’y connaît rien ».

La mésaventure baldwinienne nous enseigne que tout commerce entre la question « Malcolm X » et Hollywood doit susciter la plus grande méfiance. C’était le cas dans les années 1960, quand l’industrie envisagea un Charlton Heston tout en blackface pour le rôle principal.

à la Marche sur Washington pour l’emploi et la liberté (1963)
C’est encore le cas trente ans plus tard, quand Lee donne l’illusion de retravailler l’image de Malcolm à l’aune des luttes présentes : dans le générique de début, le tabassage de Rodney King par la police se juxtapose à la rhétorique incendiaire du « brillant prince noir ». En alternance, le « X » légendaire se forme à la faveur de l’embrasement du drapeau américain. La prochaine fois le feu ! semble promettre cette ouverture saisissante, quand en réalité elle se contente d’attraper l’actualité brûlante au vol, pour créer un choc de courte portée5.
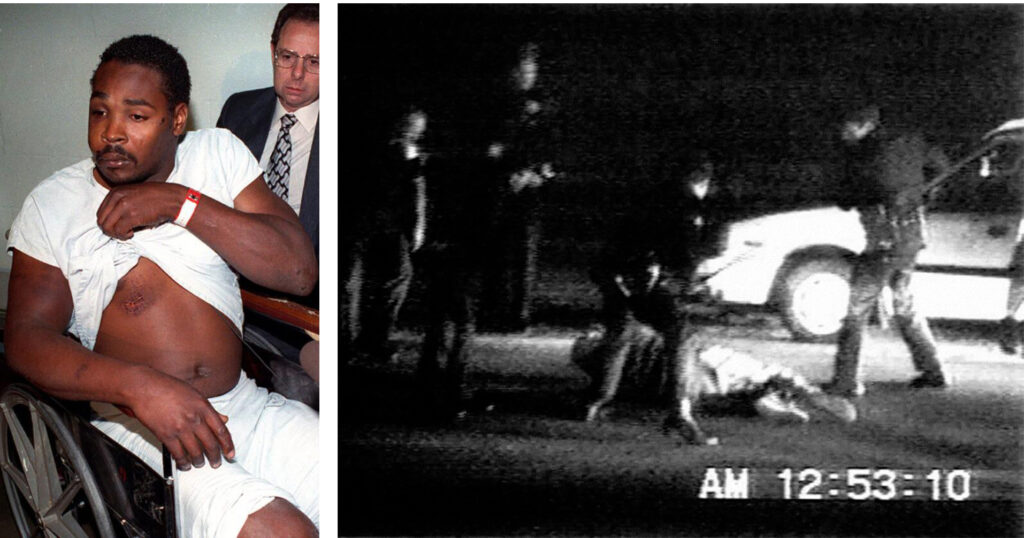
Pendant ce temps, l’Amérique noire s’enflamme, le conservatisme de l’administration Bush père tente de saccager le Civil Rights Act de 1964, arguant que la minorité a droit à moins d’égards que la majorité, et ce après huit années de reaganisme délétère pour les couches les plus pauvres de la communauté noire. C’est cette indignité permanente qui relança l’intérêt pour Malcolm X du côté des classes populaires, tandis que celui pour Martin Luther King Jr. déclinait. La deuxième insurrection de Watts, déclenchée par les violences suprémacistes subies par Rodney King, est le signe que l’Amérique n’a pas les moyens de s’offrir la color-blindness dont rêvent les hautes instances, au prétexte que des icônes comme Michael Jordan ou Michael Jackson arrivent bien, elles, à transcender les barrières raciales.
Quand il fait appel à des stars de cet acabit pour boucler le budget de Malcolm X, Spike Lee est héroïque parce qu’il peut se le permettre. Il vit dans un luxe auquel Malcolm lui-même n’aura pas goûté, si ce n’est au cours de ses voyages visant à internationaliser la lutte. Portée devant l’ONU, la cause avait une autre gueule : il n’était plus question de « droits civiques » mais de droits humains et, en se rapprochant des pays africains libérés, il s’agissait de subvertir la ligne de partage. Dans la perspective du panafricanisme, les Noirs des États-Unis ne forment plus une humanité minoritaire, et l’Islam, pratiqué dans les nations-sœurs, n’est plus une spiritualité de troisième catégorie. Le film ne dit rien de cette révolution aux accents décoloniaux qui n’a pu ou n’a su se matérialiser. La mort de Malcolm est passée par là, et le soutien qu’on lui apporta fut tout relatif. Son retour sous les traits d’un autre acteur dans un autre film pose toutefois une question à laquelle il faut tenter de répondre : à défaut d’une révolution en acte, pourrait-on envisager une manière proprement révolutionnaire de faire du cinéma ?
Malcolm nouveau millénaire
Si le film de Spike Lee ne représente pas l’alpha et l’oméga du cinéma de Malcolm X (ce n’est pas ce qu’on lui demande), il s’impose comme une étape majeure dans la grande séquence de « reconstruction de l’image posthume » du leader prophétique, initiée dès les années 1960 avec le jazz. Ne remettons pas en question son statut de monument culturel : c’est grâce à Spike Lee que, pour la plupart, nous avons découvert une telle figure, non en lisant des ouvrages sur le sujet.
Revenons maintenant sur la timeline du cinéma de Malcolm X : il y a le précédent baldwinien déjà évoqué, il existe un documentaire réalisé en 19726 et il y aura en 2001 le Malcolm X figurant dans le biopic Ali. Cette présence appelle quelques commentaires. La démarche relève à la fois de la rupture et de la continuité : Ali ne serait pas ce qu’il est sans Malcolm X. Ce qui est fait n’est plus à faire ; c’est parce que Spike Lee a pavé le chemin que Michael Mann a les coudées franches et peut réinventer Malcolm, l’éclairer sous une autre lumière.
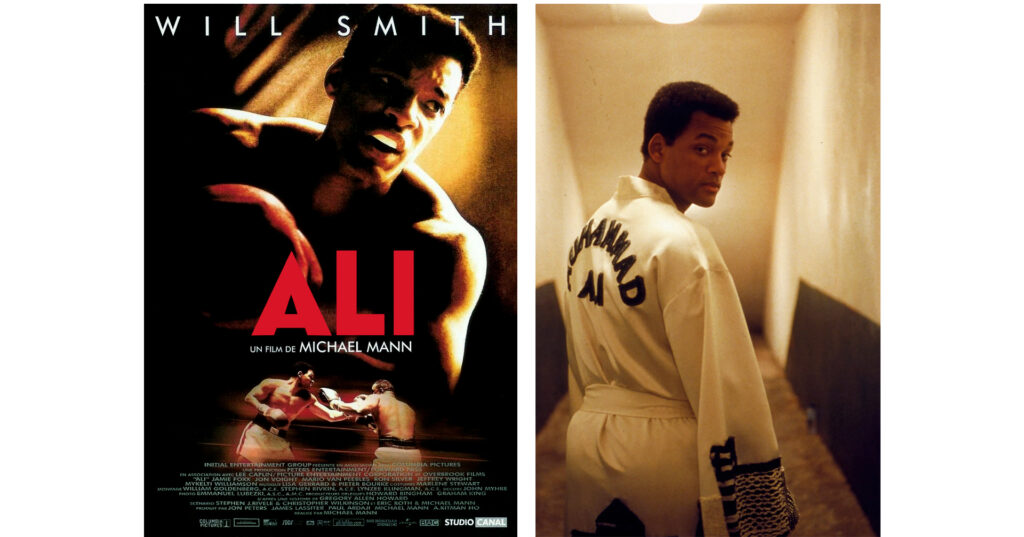
Ali, c’est d’abord une scène d’exposition aussi longue qu’époustouflante. Elle est bâtie autour d’une « sainte trinité ». Chaque pilier de cette trinité fait ce qu’il sait faire : Mohammed Ali court et boxe, Malcolm X prêche de ne pas tendre l’autre joue, Sam Cooke chante et fait chavirer les coeurs. En s’appuyant sur la musique du soulman, en pleine performance au Copacabana, Mann dessine un portrait vibrant et incarné de l’Amérique noire des années 1960. A l’ivresse procurée par la soul music et le montage, d’une extrême fluidité, s’ajoute cette idée folle consistant à insérer des plans tournés en caméra DV. Ils montrent les foulées d’Ali sous un ciel nocturne presque hostile, en adéquation avec le sentiment provoqué par le passage d’une voiture de police (l’un des deux flics interpelle l’athlète d’un « son»7 bien paternaliste). Ici, la texture numérique fait l’effet d’un coup de tonnerre, d’une greffe inhabituelle et qui prend instantanément. Le concentré de Black History imaginé par Mann se présente sous une forme hybride que personne n’avait osé proposer.

assassiné par balle dans des conditions mystérieuses en 1964 dans un motel californien
A nouveaux siècle et millénaire, nouveau cinéma ? Il est permis de le penser tant le geste de Mann est radical : d’un côté, réaliser une œuvre à l’effigie d’un Black Muslim et membre de la Nation of Islam dans l’immédiat après-11 septembre, alors qu’on entre dans un nouvel âge de l’islamo-arabophobie, et, de l’autre, imaginer un dispositif de mise en scène révolutionnaire qui célèbre la culture noire américaine dans toutes ses strates – spirituelle, sociale, artistique, politique. Quand il aspirait à être un documentariste et non ce styliste que l’on connaît désormais, Mann a filmé mai 68 (Insurrection, toujours invisible), il s’est imprégné de la pensée des Black Panthers. Plus tard, la blackness fera partie intégrante de son oeuvre. Mann ne pouvait pas ignorer la postmodernité – ou ne pouvait pas être ignoré d’elle – mais il la prendrait par le col, en pointant l’accès à la fortune comme une aliénation de classe. Chez Mann, on s’enrichit à la manière de Faust, au détriment du principe de réalité. Mann donnerait à ses « mirages contemporains » (Jean-Baptiste Thoret) une couleur marxiste, nourrie par ses lectures et par une culture politique qui est celle de sa jeunesse – les années 1960-70. Aussi, à bien des égards, Ali apparaît comme un retour aux sources.
Comme l’annonce la séquence d’ouverture, l’une des arches narratives d’Ali est la relation entre Malcolm X et Mohammed Ali, alors qu’elle était l’un des angles morts du biopic de Spike Lee. Ce lien fraternel est connu du public mais il trouve ici une expression renouvelée, grâce à la présence magnétique de l’acteur qui interprète de Malcolm, Mario Van Peebles, lui-même légataire d’une histoire au confluent du cinéma et des luttes noires (il est le fils de Melvin Van Peebles, réalisateur de Sweet Sweetback’s Baad Asssss Song et musicien). Le Malcolm de Lee prenait forme laborieusement, sur la durée, par accumulation. Pour donner une identité forte à celui d’Ali, il s’agit cette fois de procéder par soustraction, en faisant beaucoup en peu de temps. Mario Van Peebles apparaît durant les cinquante premières minutes, jusqu’au moment où Mann se confronte à son tour à la reconstitution de la tragédie du 21 février 1965. Elle ne souffre pas de la comparaison avec le film de Spike Lee. Mann est rivé à Malcolm, à son point de vue, à son corps, à son regard. Il saisit avec force le moment où la vie le quitte, il a l’intelligence de reléguer hors-champ la préparation du meurtre et l’identité des tueurs, encore incertaine. Ce point aveugle est une belle manière de rendre compte de l’inachevé de l’oeuvre politique de Malcolm, en même temps qu’elle laisse entrevoir la vaste trame dans laquelle fut prise sa mort précoce8. Le cinéma de Mann baigne dans l’imaginaire du film de complot post-JFK et Ali ne déroge pas à la règle.

Une figure centrale
On se souvient que James Baldwin ouvrait son adaptation de l’Autobiographie avec la mort de Malcolm. Dans la première page, il précisait qu’on entend une « musique soul ». Laquelle ? Avait-il en tête l’hymne « A Change is Gonna Come » ? C’est ce que laissent penser les choix de Spike Lee et de Michael Mann, frappants dans leur similitude autant que par leur différence. Lee intègre l’original de Sam Cooke lorsque Malcolm se rend en voiture vers une mort certaine (l’Audubon). Le moment est solennel. Éteint, épuisé, l’homme n’est déjà plus. Mann opte, lui, pour une reprise live d’Al Green. Le contexte d’apparition du morceau est légèrement différent : il saisit les réactions, le contrechamp émotionnel du drame. Informé par un piéton en furie, Mohamed Ali immobilise son véhicule. Même s’il avait tourné le dos à un Malcolm tombé en disgrâce, le boxeur Black Muslim est envahi par la tristesse et la colère.
Les résonances entre les deux films appellent une dernière remarque : depuis les années 1990, l’univers audiovisuel autour de Malcolm X a généré ses propres patterns. Angela Bassett, qui interprète Betty Shabazz chez Lee, remet ça dans Panther de Mario Van Peebles. Chez Mann, le rôle d’Elijah Muhammad est confié à Albert Hall, lequel jouait Baines, l’homme qui éveille Malcolm Little à la sagesse islamique dans Malcolm X. Plus récemment, c’est l’excellent Nigel Thatch qui prête ses traits et sa voix rauque idoine au porte-parole de la Nation of Islam dans la série Godfather of Harlem, après avoir convaincu dans Selma d’Ava DuVernay. La création de Thatch est remarquable, et elle gagne en profondeur en s’inscrivant dans la répétition du récit sériel. Difficile de savoir s’il faut s’agacer ou se réjouir de ces doublons. Ils figent les représentations, ils se situent à l’opposé de ce que l’homme incarnait – la réinvention de soi. En même temps, ces doublons donnent chair à l’idée qu’il avait plusieurs visages, ils témoignent de l’intérêt renouvelé pour Malcolm.
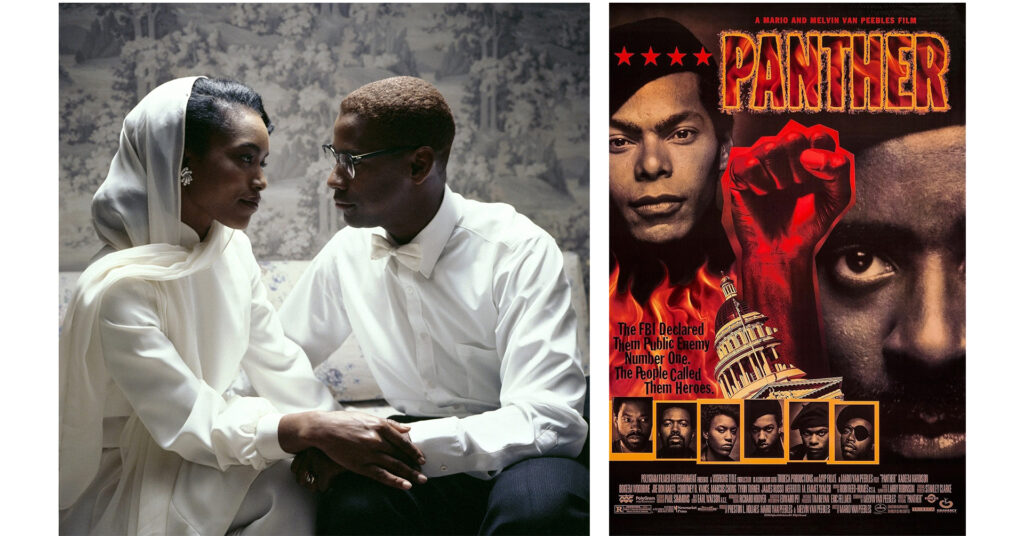
Son centenaire ainsi que la nouvelle traduction française de son Autobiographie arrivent dans un moment d’intense islamophobie et arabophobie, et de centralité de la lutte palestinienne. Il faut combattre l’une et il faut embrasser l’autre, il en va de notre âme : « A travers Malcolm X, nous reconnaissons ce que nous sommes et nous reconnaissons nos espérances. Chaque indigène partage un peu de sa fierté retrouvée et recouvre sa dignité. Le portrait de Malcolm X accroché à un mur incite à la résistance. Et à ce titre, la figure mythique de Malcolm X est essentielle. » écrit Sadhi Khiari. Il faut réinvestir Malcolm. Nous avons encore besoin de lui.
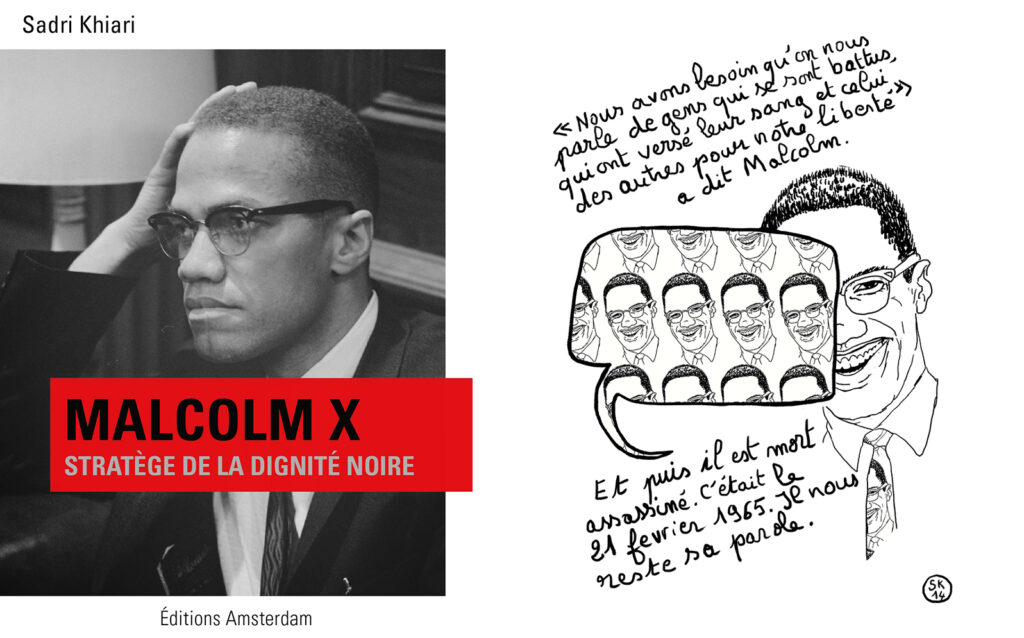
Pour prolonger
- « Il n’y a rien de comparable au monde ! »
 ︎
︎ - J’emprunte l’expression à Manning Marable, à qui je dois également la formule de « reconstruction posthume de son image », mobilisée dans cet article.
 ︎
︎ - En anglais, ces deux mots désignent respectivement la « réalité » et la « bobine de film ». bell hooks reprendra cette confusion à son compte en intitulant son premier ouvrage sur le cinéma Reel to Real. Race, Class and Sex at the Movies.
 ︎
︎ - Il faut préciser que cet auteur républicain n’a été ni un compagnon de lutte, ni un complice pour Malcolm. Il est moins mû par des convictions politiques que persuadé de collaborer à un ouvrage au fort potentiel commercial.
 ︎
︎ - Les événements surviennent le jour d’une projection-test de Malcolm X. Lee prendra acte sur la table de montage.
 ︎
︎ - Malcolm X d’Arnold Perl est constitué exclusivement d’images d’archives. Le résultat est concis, efficace et au final poignant. Car l’éloquence jazzy, les discours incendiaires, les traits amaigris, l’humour et le large sourire même dans la pire des adversités sont ceux du vrai Malcolm. Qui peut rivaliser avec ça ? Il est évident que cette adaptation purement documentaire de l’Autobiographie a constitué une base de travail pour Spike Lee (et pour un Denzel Washington plus investi que jamais). Les deux films privilégient la linéarité et ils se terminent avec la superbe oraison funèbre d’Ossie Davis qualifiant Malcolm de « brillant prince noir ».
 ︎
︎ - « Fils », en anglais, qu’on peut traduire ici par « petit »
 ︎
︎ - Le mystère autour de la mort de Malcolm X perdure. Elle ne se résumerait pas à des représailles sanglantes de la part de la Nation of Islam ou de quelques-uns de ses membres ayant agi de manière isolée, dévorés par le ressentiment. En 2024, ses filles ont porté plainte contre le FBI, la CIA et la police de New-York pour complicité de meurtre. Il semble que l’herméneutique de son martyr ait encore de beaux jours devant elle.
 ︎
︎
- GÉNÉRALISTES
- Le Canard Enchaîné
- La Croix
- Le Figaro
- France 24
- France-Culture
- FTVI
- HuffPost
- L'Humanité
- LCP / Public Senat
- Le Media
- La Tribune
- Time France
- EUROPE ‧ RUSSIE
- Courrier Europe Centrale
- Desk-Russie
- Euractiv
- Euronews
- Toute l'Europe
- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient
- Haaretz
- Info Asie
- Inkyfada
- Jeune Afrique
- Kurdistan au féminin
- L'Orient - Le Jour
- Orient XXI
- Rojava I.C
- INTERNATIONAL
- CADTM
- Courrier International
- Equaltimes
- Global Voices
- I.R.I.S
- The New-York Times
- OSINT ‧ INVESTIGATION
- OFF Investigation
- OpenFacto°
- Bellingcat
- Disclose
- Global.Inv.Journalism
- MÉDIAS D'OPINION
- Au Poste
- Cause Commune
- CrimethInc.
- Hors-Serie
- L'Insoumission
- Là-bas si j'y suis
- Les Jours
- LVSL
- Politis
- Quartier Général
- Rapports de force
- Reflets
- Reseau Bastille
- StreetPress
- OBSERVATOIRES
- Armements
- Acrimed
- Catastrophes naturelles
- Conspis
- Culture
- Curation IA
- Extrême-droite
- Human Rights Watch
- Inégalités
- Information
- Justice fiscale
- Liberté de création
- Multinationales
- Situationnisme
- Sondages
- Street-Médics
- Routes de la Soie