ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture
19.05.2024 à 19:16
« Pretty privilege » : faites-vous plus confiance à quelqu’un que vous trouvez beau ?
Astrid Hopfensitz, Professor in organizational behavior, EM Lyon Business School
Texte intégral (1994 mots)
Ce qui fait la beauté d’une personne fascine les artistes et les scientifiques depuis des siècles. La beauté n’est pas, comme on le croit souvent, « dans l’œil de celui qui regarde », mais suit bel et bien des règles prévisibles. La symétrie et les proportions jouent un rôle dans ce que l’on considère comme beau, et bien que la culture et les normes façonnent notre perception de la beauté, les chercheurs observent un large consensus sur les personnes qui sont considérées comme belles par la plupart des gens.
Il n’est donc pas surprenant que le marché de la beauté soit en constante augmentation (à l’exception d’une petite baisse en 2020, liée à la pandémie de Covid), atteignant 430 milliards de dollars de revenus en 2023, selon un récent rapport de McKinsey. La fascination pour le maquillage ou les soins cosmétiques est alimentée par l’image des visages « parfaits » qui pullulent sur les médias sociaux, artificiellement améliorés par le traitement d’image et les filtres. Mais tout cet argent est-il dépensé à bon escient ?
Privilège de la beauté
Pour le dire vite : oui. Dans le contexte actuel de concurrence acharnée sur le marché du travail, les avantages économiques liés à la beauté sont indéniables. De nombreuses études ont montré que les personnes séduisantes bénéficient d’un bonus et gagnent mieux leur vie en moyenne. Certaines professions bien rémunérées sont construites autour de la beauté (comme le show-business), mais ce qui est plus surprenant, c’est que pour presque n’importe quel type d’emploi, la beauté peut entraîner un effet de halo positif. On s’attend à ce que les personnes perçues comme belles soient plus intelligentes et elles sont considérées comme de meilleurs leaders, ce qui influe sur les trajectoires et les opportunités de carrière.
[Déjà plus de 120 000 abonnements aux newsletters The Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui pour mieux comprendre les grands enjeux du monde.]
Les personnes perçues comme belles seraient également plus susceptibles de bénéficier de la confiance des gens, ce qui leur permet d’obtenir plus facilement une promotion ou de conclure des accords commerciaux. Les personnes à l’apparence agréable sont supposées être en meilleure santé et/ou avoir eu des interactions sociales plus positives dans leur passé, ce qui peut influencer leur fiabilité aux yeux des autres.
Est-ce que le fait d’être séduisant rend plus digne de confiance ?
Mais cette théorie tient-elle la route ? Dans notre récent article, Adam Zylbersztejn, Zakaria Babutsidze, Nobuyuki Hanaki et moi-même avons cherché à le savoir. Dans des études antérieures, on présentait différents portraits à des observateurs et on leur demandait ce qu’ils pensaient de ces personnes. Cependant, ces images étaient souvent tirées de bases de données de portraits ou même générées par ordinateur, ce qui permet aux chercheurs d’étudier les perceptions, mais pas de savoir si ces croyances sont exactes. Pour le savoir, nous avons dû mettre au point un paradigme expérimental dans lequel nous pouvions observer la fiabilité de différentes personnes, prendre des photos d’elles et, plus tard, présenter ces photos à d’autres personnes pour qu’elles les évaluent. Voici comment nous avons procédé.
Comprenant un total de 357 volontaires, notre étude a débuté à Paris en octobre 2019, où nous avons demandé à un premier groupe de 76 volontaires de participer à une courte expérience sur la prise de décision. Dans le cadre de l’étude, les participants ont été répartis en paires de manière aléatoire, sans savoir avec qui ils jouaient. Certains jouaient un rôle qui nécessitait de faire confiance à un autre individu (groupe A), tandis que d’autres étaient en position de rendre la pareille ou de rompre la confiance qu’ils avaient reçue (groupe B), sachant qu’ils gagnaient toujours plus en rompant la confiance. Pour augmenter les enjeux, de l’argent réel était mis sur la table.
Les participants du groupe A pouvaient gagner jusqu’à 12 euros, mais seulement s’ils faisaient confiance à l’autre joueur. Pour ce faire, ils se sont vus présenter le scénario de choix abstrait expliqué ci-dessous, alors qu’ils étaient assis individuellement dans une cabine.
S’ils décidaient de ne pas faire confiance, ils étaient sûrs de recevoir un maigre paiement de 5 euros pour leur participation à l’étude. En revanche, lorsqu’un joueur A décidait de faire confiance à son partenaire B, son sort était entre les mains du joueur B. Ce dernier pouvait alors agir de manière à être digne de confiance en lançant un dé qui promettait de générer un gain de 12 euros pour le joueur A, ou de manière indigne de confiance en réclamant une récompense de 14 euros pour lui-même et en ne laissant rien au joueur A.
Ce type de jeu (appelé « jeu d’action cachée ») a déjà été développé pour mesurer l’attitude de confiance désintéressée des individus.
Il se déroulait comme suit : dans un premier temps, le joueur A devait choisir de faire confiance au joueur B (en disant « à droite ») ou de ne pas lui faire confiance (en disant « à gauche »). Dans un deuxième temps, le joueur B devait décider s’il lançait un dé ou non.
Le gain de chaque joueur dépend donc de ses propres actions et/ou des actions de l’autre joueur :
Si le joueur A choisit « à gauche » (ne pas faire confiance), quel que soit le choix du joueur B :
- le joueur A et le joueur B reçoivent tous deux un gain de 5 euros ;
Si le joueur A choisit « à droite » (faire confiance) et que le joueur B choisit « Ne pas lancer » :
- le joueur A ne reçoit rien et le joueur B reçoit 14 euros ;
Si le joueur A choisit « à droite » (faire confiance) et le joueur B choisit « Lancer » :
- Lorsque le chiffre du dé est compris entre 1 et 5, le joueur A reçoit 12 euros et le joueur B 10 euros ;
- Lorsque le chiffre du dé est 6, le joueur A ne reçoit rien et le joueur B reçoit 10 euros.
Nous avons non seulement observé comment les participants agissaient dans ce jeu, mais nous avons également pris des photos d’eux avec une expression neutre, avant qu’ils ne soient initiés à la tâche. Ces photos ont été présentées à 178 participants recrutés à Lyon. Nous nous sommes d’abord assurés qu’aucun de ces individus ne se connaissait. Nous avons ensuite donné aux participants de Lyon la tâche d’essayer de prédire comment la personne qu’ils voyaient sur la photo se comportait dans le jeu. S’ils tombaient juste, ils étaient récompensés en gagnant plus d’argent pour leur participation. Enfin, nous avons montré les mêmes photos à un troisième groupe de 103 personnes de Nice, dans le sud de la France. Ces personnes ont été invitées à évaluer la beauté des visages figurant sur les photos.
Le genre entre-t-il en ligne de compte ?
Nos résultats confirment que les personnes considérées comme plus belles par nos évaluateurs sont également jugées beaucoup plus dignes de confiance. Cela implique que dans notre échange économique abstrait, les personnes belles sont plus susceptibles de bénéficier de la confiance des autres. Toutefois, lorsque nous étudions les comportements réels, nous constatons que les belles personnes ne sont ni plus ni moins dignes de confiance que les autres. En d’autres termes, la confiance dépend des bonnes vieilles valeurs individuelles et de la personnalité, qui ne sont pas liées à l’apparence d’une personne.
Une prime à la beauté a déjà été observée aussi bien pour les hommes que pour les femmes. On pourrait toutefois penser que les femmes, dont on pense généralement qu’elles ont un degré d’intelligence sociale plus élevé, sont plus à même de déterminer la fiabilité de leur partenaire. Nos résultats ne le démontrent pas. Les femmes sont en moyenne jugées plus belles et jugent également les autres plus beaux. Cependant, les femmes n’agissent pas de manière plus honorable que les hommes dans le jeu. Enfin, les hommes et les femmes s’accordent sur leurs attentes quant à savoir qui sera digne de confiance ou non, et les femmes ne sont donc pas meilleures que les hommes pour prédire les comportements.
Les personnes perçues comme « belles » sont-elles plus méfiantes à l’égard de leurs semblables ?
L’adage selon lequel « tout ce qui brille n’est pas or » s’applique donc également à la beauté chez les humains. Cependant, on peut se demander qui est le plus susceptible d’être victime de ce biais. On pourrait penser que les personnes qui sont elles-mêmes souvent traitées favorablement en raison de leur apparence sont conscientes qu’il ne faut pas se fier à cette impression, qui résulte d’un biais d’appréciation.
Nous avons conçu notre étude de manière à pouvoir également étudier cette question. Plus précisément, les participants que nous avons recrutés à Lyon pour faire leurs prédictions ont également été pris en photo. Nous savions donc à quel point ils étaient influencés par l’apparence des autres, mais aussi à quel point ils étaient eux-mêmes conventionnellement beaux. Nos résultats sont clairs. Le biais de beauté existe pour tout le monde. Alors que nous pourrions penser que ceux qui bénéficient d’une belle apparence peuvent voir derrière le masque, ils sont tout autant influencés par l’apparence des autres lorsqu’ils décident à qui faire confiance.
L’industrie de la beauté a donc raison. Investir dans la beauté en vaut vraiment la peine, car cela apporte des avantages réels. Toutefois, les recruteurs ou les managers doivent se garder de se laisser abuser. Une façon de le faire est de rendre les CV anonymes et d’interdire les photos dans les candidatures. Mais dans de nombreuses interactions, nous devons décider d’accorder ou non notre confiance. Il est donc essentiel d’être conscient de ses propres biais. Nos résultats soulignent que ce biais est très difficile à surmonter, puisque même les personnes qui, de par leur propre expérience, devraient être conscientes du biais de jugement que confère la beauté en sont victimes.
Astrid Hopfensitz ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
19.05.2024 à 19:11
La géo-ingénierie, un enjeu géopolitique ? Pour les pays en surchauffe, la tentation de modifier le climat
Ben Kravitz, Assistant Professor of Earth and Atmospheric Sciences, Indiana University
Tyler Felgenhauer, Research Scientist in Civil and Environmental Engineering, Duke University
Texte intégral (2704 mots)

L’emblématique accord de Paris sur le climat a donné naissance à un nouveau slogan dans les pays en développement : « 1,5 pour rester en vie ». Il se réfère à l’objectif international de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle. Mais le monde dépassera probablement ce seuil d’ici une décennie, et le réchauffement climatique ne montre que peu de signes de ralentissement.
Le monde est déjà confronté à des catastrophes naturelles qui prennent des proportions épiques en raison de l’augmentation des températures. Les records de chaleur sont régulièrement battus. Les saisons des feux de forêt sont de plus en plus extrêmes. La violence des ouragans augmente. L’élévation du niveau de la mer, enfin, submerge lentement les petites nations insulaires et les zones côtières.
La seule méthode connue pour arrêter à court terme cette hausse des températures est l’ingénierie climatique. Elle recoupe des techniques appartenant à la géo-ingénierie. Certaines permettent de réduire artificiellement l’ensoleillement, ce qui est aussi connu sous le nom d’interventions solaires sur le climat. Il s’agit d’un ensemble d’actions visant à modifier délibérément le climat.
L’intention est d’imiter l’effet refroidissant des grandes éruptions volcaniques historiques, soit en plaçant dans l’atmosphère de grandes quantités de particules réfléchissantes, soit en éclaircissant les nuages bas au-dessus de l’océan. Ces deux stratégies permettraient de renvoyer une petite partie de la lumière du soleil vers l’espace afin de refroidir la planète.
De nombreuses questions restent toutefois sans réponse quant aux effets d’une modification délibérée du climat. Est-ce une bonne idée de seulement se poser la question ? Il n’y a pas de consensus scientifique.
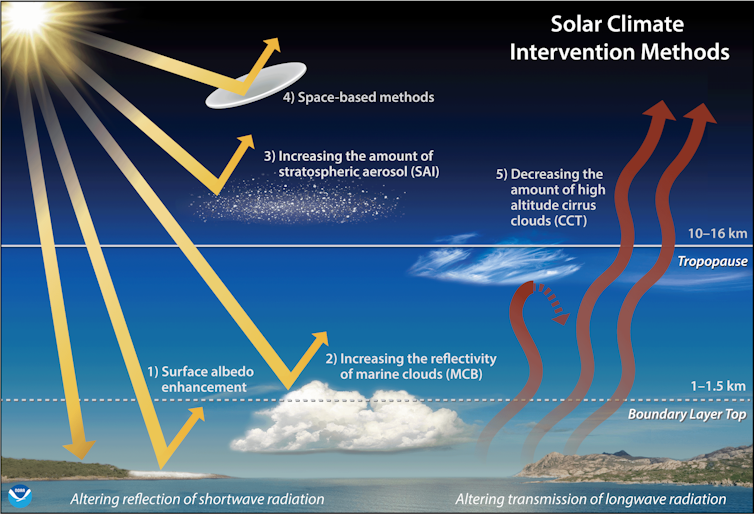
L’une des principales préoccupations de nombreux pays en matière de changement climatique est la sécurité nationale. Il ne s’agit pas seulement de guerres : les risques pour l’approvisionnement en nourriture, en énergie et en eau sont des questions de sécurité nationale, tout comme les migrations humaines provoquées par le climat.
L’ingénierie climatique pourrait-elle contribuer à réduire les risques du changement climatique pour la sécurité nationale, ou au contraire aggraverait-elle la situation ? Répondre à cette question n’est pas simple, mais les chercheurs qui, comme nous, étudient les liens entre changement climatique et sécurité nationale ont quelques idées sur les risques à venir.
Le changement climatique, un problème majeur
Pour comprendre à quoi pourrait ressembler l’ingénierie climatique à l’avenir, examinons d’abord les raisons pour lesquelles un pays pourrait vouloir l’essayer.
Depuis la révolution industrielle, l’homme a rejeté environ 1 740 milliards de tonnes de dioxyde de carbone (CO₂) dans l’atmosphère, principalement en brûlant des combustibles fossiles. Ce dioxyde de carbone emprisonne la chaleur et réchauffe la planète.
L’une des choses les plus importantes que nous puissions faire est de cesser de rejeter du carbone dans l’atmosphère. Mais la situation ne s’améliorera pas rapidement, car le CO2 met des siècles à être éliminé de l’atmosphère. La réduction des émissions ne fera qu’empêcher la situation de s’aggraver davantage.
Les pays pourraient extraire le dioxyde de carbone de l’atmosphère et le confiner quelque part, processus appelé élimination du dioxyde de carbone (en anglais, Carbon Dioxyde Removal, ou CDR). À l’heure actuelle, les projets d’élimination du dioxyde de carbone, notamment le fait de planter ou replanter des arbres et les dispositifs de capture directe du CO₂ de l’air, permettent de retirer de l’atmosphère environ 2 milliards de tonnes de CO₂ par an.
À lire aussi : La capture et le stockage du carbone, comment ça marche ?
Mais l’humanité rejette actuellement dans l’atmosphère plus de 37 milliards de tonnes de CO₂ par an du fait de la consommation de combustibles fossiles et des activités industrielles. Tant que la quantité de CO2 ajoutée dans l’atmosphère sera supérieure à la quantité éliminée, les sécheresses, les inondations, les ouragans, les vagues de chaleur et l’élévation du niveau de la mer, parmi les nombreuses autres conséquences du changement climatique, continueront de s’aggraver.
Il faudra sans doute beaucoup de temps pour réduire à zéro nos émissions nettes de CO2, c’est-à-dire pour ne plus augmenter les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. L’ingénierie climatique pourrait être utile dans cet intervalle.
À lire aussi : Éliminer le CO₂ grâce au puits de carbone océanique, une bonne idée ?
Qui veut s’essayer à l’ingénierie climatique ?
Différents organismes de recherche gouvernementaux dans élaborent déjà des scénarios examinant qui pourrait décider de mettre en œuvre l’ingénierie climatique et comment.
L’ingénierie climatique devrait être peu onéreuse par rapport au coût que représente l’élimination des émissions de gaz à effet de serre. Mais il faudrait tout de même des milliards de dollars et des années de développement et de fabrication pour obtenir une flotte d’avions capable de transporter, chaque année, des mégatonnes de particules réfléchissantes dans la stratosphère. Tout milliardaire envisageant une telle entreprise se retrouverait rapidement à court d’argent, en dépit de ce que la science-fiction pourrait suggérer.
Malgré tout, un seul pays ou une coalition de pays constatant les effets néfastes du changement climatique pourrait faire un calcul géopolitique et financier. Et décider de mettre en place des pratiques d’ingénierie climatique de sa propre initiative.
À lire aussi : Inondations à Dubaï : des orages trop violents pour être causés par l’ensemencement des nuages
C’est ce que l’on appelle le problème du « free driver », c’est-à-dire que si le coût de ces technologies n’est pas prohibitif, un pays moyennement riche pourrait décider unilatéralement de modifie le climat de la planète.
Par exemple, les pays confrontés à des vagues de chaleur de plus en plus dangereuses pourraient vouloir provoquer un refroidissement du climat.
Les pays qui dépendent des précipitations de la mousson pourraient vouloir rétablir une certaine fiabilité que le changement climatique a perturbée.
L’Australie étudie actuellement la possibilité de refroidir rapidement la Grande Barrière de Corail pour éviter sa disparition.
La création de risques pour les pays voisins
Sauf que le climat ne respecte pas les frontières nationales. Ainsi, un projet d’ingénierie climatique dans un pays serait susceptible d’affecter les températures et les précipitations dans les pays voisins. Cela pourrait être une bonne ou une mauvaise chose pour les cultures, l’approvisionnement en eau et les risques d’inondation. Cela pourrait également avoir des conséquences inattendues à large échelle.
Certaines études montrent qu’un niveau modéré d’ingénierie climatique aurait probablement des effets bénéfiques à grande échelle quant au changement climatique. Mais tous les pays ne seraient pas affectés de la même manière.
[Déjà plus de 120 000 abonnements aux newsletters The Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui pour mieux comprendre les grands enjeux du monde.]
Une fois les mesures d’ingénierie climatique déployées, les pays pourraient également être plus enclins d’accuser la géo-ingénierie d’être à l’origine des événements extrêmes tels que les ouragans, les inondations et les sécheresses, quelles que soient les preuves.
L’ingénierie climatique peut déclencher des conflits entre les pays, conduisant à des sanctions et à des demandes de compensation. Le changement climatique peut rendre les régions les plus pauvres plus vulnérables encore, et l’ingénierie climatique ne devrait pas exacerber ces dommages. Certains pays, en bénéficiant de l’ingénierie climatique, seraient plus résilients face aux conflits géopolitiques, tandis que d’autres seraient lésés – et d’autant plus vulnérables.
Certes, des expériences de faible échelle ont été menées, mais personne n’a encore pratiqué l’ingénierie climatique à vaste échelle. Cela signifie que beaucoup d’informations sur ses effets reposent sur des modèles climatiques. Or, si ces modèles sont d’excellents outils pour étudier le climat, ils ne permettent pas de répondre aux questions liées à la géopolitique et aux conflits. En outre, les effets physiques des mesures d’ingénierie climatique dépendraient aussi pour beaucoup de l’approche utilisée.
La prochaine étape
Pour l’instant, l’ingénierie climatique suscite plus de questions que de réponses. Il est difficile de dire si l’ingénierie climatique risque d’aggraver les conflits ou si elle pourrait désamorcer certaines tensions internationales en réduisant le changement climatique.
Il est toutefois probable que des décisions internationales sur l’ingénierie climatique seront bientôt prises. Lors de l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement de mars 2024, les pays africains ont demandé un moratoire sur l’ingénierie climatique, appelant à la prudence. D’autres nations, dont les États-Unis, ont insisté pour qu’un groupe formel de scientifiques étudie les risques et les avantages de ces technologies avant de prendre toute décision.
L’ingénierie climatique pourrait faire partie d’une solution équitable au changement climatique. Mais elle comporte aussi des risques. En résumé, l’ingénierie climatique ne saurait être ignorée, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour que les décideurs politiques puissent prendre des décisions en connaissance de cause.
Ben Kravitz a reçu des financements de la National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) américaine et de la National Science Foundation américaine.
Tyler Felgenhauer a reçu des financements de la National Science Foundation américaine et de Resources for the Future.
19.05.2024 à 19:10
Sciences Po : comment la crise dépolitise la parole étudiante ?
Olivier Akhamlich, Doctorant Sciences de l'Education et de la Formation, Université de Bordeaux
Texte intégral (2041 mots)
Le 7 mai 2024, une altercation survient devant Sciences Po Paris entre François-Xavier Bellamy (LR) et Louis Boyard (LFI). S’écharpant dans la tradition des logiques stratégique et politique, cette rencontre s’est inscrite dans le contexte de mobilisation étudiante à Sciences Po, rassemblés contre les attaques d’Israël sur les civils à Gaza. Mais cet « énième numéro de politique spectacle », semble surtout avoir pour conséquence une relative mise à l’écart et dépolitisation de la parole des étudiants.
Le 12 mars 2024, une occupation est lancée dans un amphithéâtre à Sciences Po Paris par le comité Palestine pour protester contre l’intervention de Tsahal à Gaza, et pour boycotter les partenariats entre Sciences Po et des universités israéliennes supportant l’armée israélienne.
Une polémique éclate suite à un témoignage d’une étudiante déclarant avoir été empêchée, pour raison antisémite, d’entrer dans l’amphithéâtre occupé. Les enquêtes administrative et pénale détermineront ce qui en a été réellement. Cet événement a déclenché un ensemble de réactions politiques et médiatiques.
Or la plupart de ces commentaires à chaud semblent ignorer les revendications politiques des étudiants.
Comme l’indique le chercheur Éric Darras :
« Politiser c’est généraliser. Dépolitiser c’est minimiser, minorer. […] Politiser c’est défataliser. Dépolitiser c’est essentialiser. »
Politiser, rendre politique, est une manière d’observer, de constater différents faits et de les désingulariser en les portant de façon plus générale à la connaissance de toutes et tous. À l’inverse, singulariser, dépolitiser c’est, d’une certaine façon, rendre obscur un fait ou un propos et, ainsi, de le soustraire à l’intérêt général. Politiser est l’affaire de toutes et tous.
Ce qui devient politique est de l’affaire de toutes et tous dans un souci de solidarité, de collectif, d’unité : ce qui porte à l’intérêt général. Or, nous observons que les réactions à n’en plus finir des politiques sont constitutives d’une manière de détourner la politique vers la polémique et ainsi produire une dépolitisation des revendications portées par les étudiants.
À lire aussi : Mouvement étudiant pour Gaza : entre mobilisation et polémiques
Jeunesses et politiques : les désunions
Les jeunes et la jeunesse ont été régulièrement mis à l’écart des considérations politiques. À ne pas considérer la jeunesse dans la politique et dans les politiques, le lien de confiance s’érode et la défiance à l’égard de la politique, de façon générale, se met en place. Il est aisé de méconsidérer la jeunesse sans jamais prendre le temps de s’y intéresser et de l’écouter sérieusement comme le relate la journaliste Salomé Saqué.
Alors même que la jeunesse est de plus en politisée au fil des décennies depuis les années 70-80, cette dernière se sent de moins en moins représentée, entendue et prise en compte. La succession des crises qui impacte les jeunesses et ne suscite que peu de réactions des politiques dans la mise en place de politiques publiques n’a fait qu’accroître un rejet et une défiance.
[Déjà plus de 120 000 abonnements aux newsletters The Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui pour mieux comprendre les grands enjeux du monde.]
La dégradation des conditions de vie de façon générale a progressivement amené une partie de la jeunesse vers une augmentation de l’abstention et une polarisation des votes où l’adhésion idéologique tend vers les extrêmes (entre la droite et la gauche). De même, ne constatant que peu de réactions de la part de la classe politique face aux revendications de la jeunesse, cette dernière tend à méconsidérer la politique institutionnelle pour son supposé hermétisme.
Comme l’écrivait Luc Rouban, en 2022, « c’est bien le sentiment d’une distance sociale avec les élites dirigeantes qui nourrit cette défiance » (p.21).
Cette négation de la jeunesse et de sa contribution indéniable à la société est partie prenante d’un dénigrement. Ce dernier vient à considérer que les jeunes seraient une sorte d’entité sujette à ses émotions, ses passions et qui aurait, par la même occasion, de grandes difficultés à être alors raisonnable parce que trop émotive.
Politique du mépris ?
À considérer la jeunesse de manière péjorative par différents qualificatifs emprunts de mépris tels que : « wokistes », « gauchistes », « islamo-bobos », etc. ; de manière indistincte et particulièrement caricaturale, notamment dans le cas de l’occupation d’un amphithéâtre à Sciences Po, les politiques participent au dénigrement des étudiants et peut-être in fine des études.
Certains politiques et médias pointent les institutions d’enseignement supérieur comme étant des laboratoires de thèses antirépublicaines et antidémocratiques par le « wokisme », voire même de « bunker islamo-gauchistes »“.
En faisant des étudiants des épouvantails, leurs détracteurs les « excommunient » de la citoyenneté. Cette forme d’anathème vient nier le pourquoi des actions. Elle dépolitise une mobilisation politique et jette l’opprobre, comme l’a démontré de façon particulièrement étayée, Olivier Beaud, sur les professions intellectuelles et les études.
L’intervention du premier ministre, Gabriel Attal, et de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, semble représenter des modérateurs moralisants d’une institution qui paraîtrait être à la dérive. Gabriel Attal indiquait, seulement quelques heures après l’événement, que « le poisson pourri par la tête » comme le rappelle Sonia Devillers.
Un « intérêt excessif » ?
Comme l’évoque Laurence Bertrand Dorléac, présidente de la Fondation nationale des sciences politiques, institution qui gère les orientations stratégiques et administratives de Sciences Po, lors de son audition au Sénat le 20 mars 2024, les événements survenus à Sciences Po ont probablement suscité un « intérêt excessif » porté par les médias « et par conséquent par l’opinion publique ».
Madame Bertrand Dorléac rappelle « qu’aucun autre établissement universitaire français n’a suscité autant d’articles de presse et de tweets » tout en précisant que d’autres établissements ont été traversés par des événements similaires sans avoir connu les mêmes conséquences médiatiques et politiques. Pourtant, la liberté académique semble reculer dans de nombreux pays sans susciter autant de remous au niveau politique et médiatique.
En présentant les étudiants comme étant des individus hors de contrôle et les dirigeants d’établissement d’enseignement supérieur comme soupçonnés de défaillances, les politiciens présentent ces derniers alors comme irresponsables, irraisonnables et inaptes à l’exercice même de la politique. L’exercice de la politique, ici, est entendu comme la possibilité de participer pleinement en tant que citoyen et citoyenne aux débats publics ; émettre des doutes, propositions, actions, objections, contradictions par exemple. Par cette polémique, les politiciens réaffirment l’illusion de la politique comme raison défaite de ses émotions. Or, les recherches montrent que c’est tout le contraire : sans émotion et sans conflit, la politique ne serait que dépolitisée.
Dépolitiser les étudiants : une stratégie politique ?
Les revendications premières des étudiants sont la révision des partenariats de l’institution avec des universités israéliennes, une solution à deux États, un arrêt immédiat du déploiement de l’intervention de Tsahal sur Gaza, un arrêt de la politique coloniale israélienne en violation de nombreuses résolutions à l’ONU, etc.
Quelques personnels se sont joints et ont proposé des débats quand, en même temps, d’autres se désintéressent, voire usent de propos désobligeants, en direction des étudiants et de la mobilisation étudiante.
En réduisant l’événement survenu à Sciences Po à une invective antisémite, ces derniers participent à supprimer du débat le pourquoi d’une telle mobilisation ayant amené des étudiants d’une institution d’enseignement supérieur prestigieuse à occuper un amphithéâtre. Dans les propos des politiques, l’événement devient une illustration d’une jeunesse étudiante sauvage et irrationnelle. Comment des étudiants « ensauvagés » pourraient-ils parler sereinement et rationnellement de politique ?
Cette dépolitisation, est une stratégie politique efficace puisque nombre de médias et d’opinions n’ont pas retenu les revendications au détriment des interventions de nos politiques.
Ces derniers convoquent et enjoignent des émotions tout en reprochant aux étudiants d’être émotifs. À écouter et à voir les politiques s’engouffrer dans la polémique, il peut-être légitime de se demander s’ils ne seraient pas les premiers dépolitisés ?
Olivier Akhamlich ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
19.05.2024 à 19:10
« L’envers des mots » : Narchomicide
Bérengère Denizeau, Maîtresse de conférences à l'Université Sorbonne-Nouvelle et chercheuse en traductologie au CLESTHIA, Université Paris Cité
Fabrice Rizzoli, Spécialiste des mafias et président de l'association Crim'HALT. Enseignant en géopolitique des criminalités., Sciences Po
Texte intégral (1116 mots)
Le néologisme narchomicide, contraction des mots narcotrafic et homicide, illustre la capacité dynamique de la langue à s’adapter et à refléter des réalités sociales complexes et, parfois, en mutation. Employé pour la première fois par Dominique Laurens, procureure de la République à Marseille, ce terme souligne la spécificité criminelle qui transcende les définitions traditionnelles dans le cas d’homicides directement liés aux trafics de drogue.
Dans le contexte marseillais, la présence de violents conflits entre clans de narcotrafiquants marque profondément le tissu social de la ville, particulièrement depuis 2021. Le trafic de drogue à Marseille est structuré par des bandes organisées, notamment en raison de la position stratégique de la ville comme port maritime et de la compétition territoriale pour le contrôle de ce marché.
À lire aussi : La France au cœur des trafics de drogue : un regard géopolitique
Selon un rapport mondial sur les drogues de 2023 de l’ONUDC (Office des Nations unies contre la drogue et le crime), ces conflits qui ont coûté la vie à plusieurs dizaines de personnes en 2023, dépassent les chiffres des années précédentes et ne concernent pas uniquement des acteurs de l’économie souterraine.
Les narchomicides liés au trafic de drogue, contrairement aux règlements de compte, ne se limitent pas aux acteurs impliqués dans ces réseaux criminels, mais touchent également des victimes innocentes, prises au piège de cette guerre urbaine : passants, habitants des quartiers touchés par ces luttes de pouvoir, ou proches de victimes, des enfants et des familles entières qui se voient plongés au cœur de conflits sanglants. Leur présence dans le décompte macabre des « narchomicides » permet d’observer combien les conséquences de ces affrontements dépassent les frontières des milieux criminels pour affecter l’ensemble de la société.
L’introduction de ce concept rappelle l’urgence qu’il y a à rechercher des solutions à grande échelle qui, au-delà de la répression, engagent également des politiques de prévention, d’éducation et de réinsertion sociale, par le biais de programmes de formation professionnelle, de soutien psychologique, et de mentorat, pour éviter que des citoyens ne soient sacrifiés sur l’autel d’une guerre dont ils ne sont ni les acteurs, ni les bénéficiaires, mais bien trop souvent les victimes oubliées.
À lire aussi : L’héroïne en milieu rural en France : une réalité ignorée
Si les néologismes naissent souvent en réponse à de nouveaux phénomènes sociaux pour lesquels le lexique existant ne suffit plus, l’apparition du terme « narchomicide » dans le débat public et son utilisation par les autorités judiciaires ne sont pas tant le reflet d’une évolution sémantique que la réponse à une nécessité communicative face à une réalité sociale alarmante. Dans une interview donnée sur France Info le 6 septembre 2023, Dominique Laurens explique que cette notion s’applique à des homicides liés au narcobanditisme pouvant frapper de simples passants :
« Ils ne sont pas visés pour leur participation spécifique aux trafics, mais parce qu’ils sont là simplement. C’est ce qui est très frappant dans les homicides actuellement. »
Dans la langue judiciaire, un règlement de compte est défini très précisément : il concerne des auteurs agissant en bande organisée avec préméditation dans le cadre d’un guet-apens et à l’aide d’armes à feu d’un certain calibre pour éliminer un concurrent criminel.
Les nouveaux mots contribuent à façonner la perception publique d’un phénomène. En dotant le discours sur la violence liée au narcotrafic d’un terme spécifique, on associe à la cité phocéenne l’idée d’une recrudescence de la violence qui dépasse le règlement de compte et apporte de l’eau au moulin de la rhétorique du « mauvais endroit au mauvais moment ».
Cet article s’intègre dans la série « L’envers des mots », consacrée à la façon dont notre vocabulaire s’étoffe, s’adapte à mesure que des questions de société émergent et que de nouveaux défis s’imposent aux sciences et technologies. Des termes qu’on croyait déjà bien connaître s’enrichissent de significations inédites, des mots récemment créés entrent dans le dictionnaire. D’où viennent-ils ? En quoi nous permettent-ils de bien saisir les nuances d’un monde qui se transforme ?
De « validisme » à « silencier », de « bifurquer » à « dégenrer », nos chercheurs s’arrêtent sur ces néologismes pour nous aider à mieux les comprendre, et donc mieux participer au débat public. À découvrir aussi dans cette série :
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
19.05.2024 à 19:09
Les mères chimpanzés continuent de jouer avec leurs petits même si elles sont mal nourries ou fatiguées
Zarin Machanda, Assistant Professor of Anthropology and Biology, Tufts University
Kris Sabbi, Fellow in Human Evolutionary Biology, Harvard University
Texte intégral (2003 mots)

Les chimpanzés sauvages sont étudiés depuis plus de 60 ans, mais ils continuent d’émerveiller et de surprendre les observateurs, comme nous l’avons constaté durant l’été 2017 dans le parc national de Kibale, en Ouganda.
Nous observions les jeux des jeunes chimpanzés pour mieux comprendre comment ils grandissent. Pour la plupart des animaux vivant en groupe, le jeu fait partie intégrante du développement. Au-delà du simple fait de s’amuser, le jeu social leur permet de mettre en pratique des compétences physiques et sociales essentielles dont ils auront besoin plus tard dans leur vie.
Mais cet été-là, nous avons réalisé que les jeunes n’étaient pas les seuls à jouer. Les adultes se joignaient au jeu plus souvent que nous ne l’avions vu auparavant, en particulier entre eux. Le fait de voir des femelles chimpanzés adultes se chatouiller et rire a surpris même les chercheurs les plus chevronnés de notre projet.
Ce n’est pas le fait que les chimpanzés adultes jouent qui est inhabituel, mais le fait qu’ils le fassent si fréquemment. Un comportement que l’on observe habituellement une fois toutes les semaines ou toutes les deux semaines devient quelque chose que l’on voit tous les jours et qui dure parfois des heures.
Qu’est-ce qui avait donc changé cet été-là ? Pour nous, en tant que primatologues, c’est là que les choses intéressantes ont commencé.
Pourquoi les adultes jouent-ils ?
Les scientifiques pensent que la principale raison pour laquelle le jeu diminue avec l’âge est que les individus finissent par s’en passer au fur et à mesure qu’ils maîtrisent leurs capacités motrices et sociales et qu’ils adoptent des comportements plus adultes. Selon cette logique, les adultes ne jouent que rarement parce qu’ils n’en ont plus besoin. La situation est différente pour les espèces domestiquées comme les chiens, car le processus de domestication lui-même préserve les comportements juvéniles comme le jeu jusqu’à l’âge adulte.
Aucune de ces raisons n’expliquerait pourquoi nos chimpanzés adultes écartaient les bébés pour jouer entre eux cet été-là. Au lieu de nous demander pourquoi les adultes jouaient, nous avons dû nous demander ce qui pouvait, dans d’autres circonstances, les empêcher de jouer. Pour ce faire, nous avons dû revenir aux bases de la primatologie et examiner les effets de la nourriture sur le comportement.
L’été 2017 a été marqué par un pic saisonnier inhabituellement élevé d’un fruit rouge appelé Uvariopsis, un des aliments préférés des chimpanzés et qui est riche en calories. Pendant les mois où ces fruits sont mûrs et abondants, les chimpanzés passent plus de temps à se retrouver en groupe.
Ce type de surplus énergétique a été associé à des activités qui demandent beaucoup d’énergie, telles que la chasse. Nous nous sommes demandé si l’abondance de fruits pouvait également être liée au jeu social. Peut-être que le jeu des adultes est limité parce que les chimpanzés adultes n’ont généralement pas le temps et l’énergie nécessaires pour s’y consacrer.

Quand la vie quotidienne empêche de jouer
Pour tester cette idée, nous nous sommes tournés vers les enregistrements du Kibale Chimpanzee Project, en extrayant près de 4 000 observations de jeux d’adultes sur une période de 10 ans.
Qu’il s’agisse de se battre avec un jeune chimpanzé ou de jouer à se courir après avec un autre adulte, la fréquence des jeux des adultes était fortement corrélée à la quantité de fruits mûrs dans le régime alimentaire au cours d’un mois donné. Lorsque la forêt regorgeait de nourriture de haute qualité, les chimpanzés adultes jouaient beaucoup.
Mais lorsque la quantité de fruits prisés diminuait, ce côté ludique disparaissait presque totalement, à l’exception des mères.
Chez les chimpanzés, les mâles sont beaucoup plus sociaux que les femelles. Ils investissent beaucoup de temps pour développer des amitiés et, en retour, ils récoltent les fruits de ces liens avec un rang de dominance plus élevé et plus de rapports sexuels. Pour les femelles, les coûts énergétiques élevés de la grossesse et de la lactation signifient que la socialisation se fait au prix du partage de la nourriture dont elles ont besoin pour elles-mêmes et leur progéniture.
Nous nous attendions à ce que le jeu, en tant que comportement social, suive d’autres modèles sociaux, les mâles jouant davantage et pouvant se permettre de jouer même lorsque l’abondance de nourriture était faible. À notre grande surprise, nous avons constaté le contraire. Les femelles jouaient plus, surtout pendant les mois où il y avait moins de fruits, parce que les mères continuaient à jouer avec leurs bébés même lorsque tous les autres chimpanzés avaient cessé de le faire.
Le coût caché de la maternité
Les chimpanzés vivent dans des sociétés multimâles et multifemmes qui présentent ce que les chercheurs appellent une fission-fusion. En d’autres termes, l’ensemble du groupe social est rarement, voire jamais, réuni. Au lieu de cela, les chimpanzés se divisent en sous-groupes temporaires, entre lesquels les individus se déplacent tout au long de la journée.
Lorsque la nourriture est rare, les groupes ont tendance à être plus petits et les mères sont souvent seules avec leurs petits. Cette stratégie réduit la compétition alimentaire avec les autres membres du groupe. Mais elle fait aussi des mères les seuls partenaires sociaux de leur progéniture. Le temps et l’énergie que les mères pourraient consacrer à d’autres tâches quotidiennes, telles que l’alimentation et le repos, sont plutôt consacrés au jeu.
Notre étude a non seulement révélé ce coût de la maternité jusqu’alors inconnu, mais elle a également mis en évidence l’importance pour ces jeunes chimpanzés que leurs mères acceptent ce coût.
Vous êtes peut-être curieux de savoir comment les pères des chimpanzés s’intègrent dans ce contexte. Les chimpanzés s’accouplent avec plusieurs individus, de sorte que les mâles ne savent pas quelle progéniture est la leur. Les mères doivent assumer seules les coûts de la parentalité.
Et chez les autres espèces de primates ?
Les chercheurs en développement de l’enfant savent que le jeu, et en particulier le jeu avec les parents, est d’une importance capitale pour le développement social de l’être humain.
Les chimpanzés étant l’un de nos plus proches parents vivants, ce type de similitudes comportementales entre nos espèces n’est pas rare.
Mais tous les parents primates n’ont pas recours à des jeux coûteux en énergie. En fait, il n’existe pratiquement aucune trace de mères singes jouant avec leurs bébés. La plupart des autres espèces de primates, comme les babouins et les capucins, ne se séparent pas pendant la journée, ce qui permet aux bébés de jouer entre eux et aux mères de se reposer.
Il reste à vérifier directement si le jeu maternel est le produit d’un groupe de fission-fusion ou s’il répond aux besoins de développement de la progéniture. Mais la responsabilité de jouer avec ses petits trouve certainement un écho chez de nombreux parents humains qui ont été soudainement amenés à devenir les principaux partenaires de jeu de leurs enfants lorsque Covid-19 a interrompu les activités normales.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
19.05.2024 à 19:08
Une citoyenneté européenne encore peu tangible
Anne-Sophie Lamblin-Gourdin, Professeur de droit public, Membre du LabLEX (Laboratoire de recherche en droit, UR 7480), Université Bretagne Sud
Texte intégral (1819 mots)
Du 6 au 9 juin 2024, les citoyens des 27 États membres de l’UE sont appelés à élire les 720 députés qui siégeront au Parlement européen pour un mandat de cinq ans. Ceux-ci sont élus au suffrage universel direct, libre et secret depuis une décision du 20 septembre 1976, mise en œuvre pour la première fois entre les 7 et 10 juin 1979. L’élection repose sur un scrutin de liste à un tour, les partis ayant obtenu plus de 5 % des suffrages bénéficiant d’un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix.
Ce scrutin constitue un temps fort de la démocratie européenne. Il permet aux citoyens de l’Union de participer au projet politique et à la contribution de l’UE à la gestion des principaux défis contemporains, parmi lesquels le changement climatique et la déstabilisation économique et sociale qu’il engendre, la défense du modèle démocratique européen face à des régimes politiques illibéraux et agressifs ou encore la pression migratoire.
En effet, doté des pouvoirs législatif et budgétaire qu’il partage avec le Conseil de l’Union européenne, et du pouvoir de contrôle politique exercé sur la Commission européenne, le Parlement européen incarne la démocratie représentative sur laquelle est fondée l’UE. Il constitue une institution unique au monde, aucune autre organisation internationale ne disposant d’une assemblée ainsi élue pour assurer la représentation directe des citoyens qu’elle unit.
Un scrutin avant tout perçu à travers le prisme national ?
Le sondage Eurobaromètre publié le 17 avril 2024 indique que 60 % des Européens se disent intéressés par ce scrutin, soit une hausse de 11 points par rapport à 2019. Les partis politiques nationaux ont également bien mesuré son importance et se sont, partout, franchement engagés dans la campagne électorale. Cependant, celle-ci reste fortement imprégnée de considérations nationales, notamment en France où le pouvoir d’achat et la sécurité nationale monopolisent les débats alors que ces sujets, certes importants, correspondent à des domaines qui relèvent principalement des compétences des États et dans lesquels l’action de l’UE ne peut être que réduite et indirecte.
Que les électeurs ne se trompent pas d’enjeu : ces élections sont le moment, pour eux, d’exercer leur citoyenneté européenne, en s’emparant des enjeux européens. Or, force est de constater que cette citoyenneté européenne, les Européens ne se la sont que peu appropriée.
En témoigne une enquête Eurobaromètre menée du 31 mai au 25 juin 2023 dans les 27 États membres de l’UE, mais aussi dans des États tiers (soit 39 pays au total). 58 % des personnes interrogées ont déclaré éprouver un attachement à l’égard de l’Union, pourcentage en diminution de 3 points par rapport à l’enquête précédente ; cela correspond à une faible identification en comparaison de l’identification nationale puisque 91 % des Européens se disent attachés à leur pays.
S’agissant du sentiment de citoyenneté européenne, 72 % se sentent citoyens de l’UE – seulement 58 % en France, l’une des plus faibles proportions parmi les États membres de l’UE. Quant aux domaines contribuant au sentiment de communauté, les citoyens européens ont cité les valeurs et l’économie pour 23 % d’entre eux, la culture pour 22 %, la solidarité pour 21 %, et 20 % ont évoqué l’État de droit. Enfin, s’agissant des droits conférés par la citoyenneté de l’UE, 58 % ont affirmé les connaître, quand 70 % ont exprimé le souhait d’en savoir plus.
La citoyenneté européenne existe depuis trente ans, mais les Européens le savent-ils ?
La citoyenneté de l’UE aurait-elle donc manqué sa cible ? Elle fut pourtant un concept prometteur. Instaurée par le traité de Maastricht en 1993, elle répond à la volonté des États membres de dépasser une intégration principalement économique en développant un sentiment d’appartenance à une entité politique en devenir, un « vouloir vivre ensemble » facteur d’émergence d’un espace public européen.
Formellement, la citoyenneté de l’UE est effective : elle consiste en un ensemble de droits civils et politiques, parmi lesquels le droit de vote et d’éligibilité au Parlement européen. Mais bien qu’elle ait fêté ses trente ans, elle reste peu tangible.
Il est certain que ses caractéristiques la rendent ambiguë et abstraite. En effet, et même si le traité invite à l’envisager comme une plus-value d’autant plus qu’elle n’est pas assortie de devoirs explicites, sa dépendance à la nationalité d’un État membre lui confère un caractère apparemment accessoire. Et la pratique démocratique favorise cette dimension subsidiaire, puisque les élections au Parlement européen sont organisées dans le cadre d’une circonscription nationale unique, avec des listes nationales, et non transnationales, et que les campagnes électorales sont structurées nationalement.
Quant aux droits qu’elle confère, ils sont peu perceptibles. Le droit de vote et d’éligibilité au Parlement européen existait avant l’instauration de la citoyenneté européenne. Surtout, plusieurs de ces droits se matérialisent principalement pour les Européens qui se trouvent, de façon temporaire ou permanente, dans un autre État membre. La citoyenneté européenne permet alors de combler la rupture, momentanée ou durable, de la relation avec l’État de nationalité, en reconnaissant le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans l’État membre de résidence ; dans un pays tiers où l’État membre de nationalité n’est pas représenté, elle accorde aussi la protection diplomatique et consulaire d’un autre État membre – une réelle plus-value juridique.
S’y ajoute que la plupart des droits qu’elle confère ne sont, en réalité, pas réservés aux seuls citoyens de l’Union, mais aussi ouverts aux ressortissants d’États tiers et aux agents économiques, tels les droits de pétition au Parlement européen et de saisine du médiateur européen ; il en va de même du droit à une bonne administration, ainsi que du droit d’accès aux documents qui concrétisent les principes démocratiques sur lesquels est fondée l’UE. Enfin, les principaux apports de la citoyenneté européenne, déduits du principe de non-discrimination à raison de la nationalité, sont le produit d’une construction jurisprudentielle, certes riche mais complexe et méconnue.
Rapprocher l’Europe des Européens
Peu incarnée, la citoyenneté européenne est singulière, reposant sur la théorie du patriotisme constitutionnel (étudiée en France par Jean-Marc Ferry, dans La question de l’État européen, Paris, Gallimard, 2000), selon laquelle les motifs d’adhésion à une communauté politique peuvent provenir non pas d’une proximité géographique ou de parentalité, mais de l’attachement à une culture politique partagée, fondée sur une histoire et des valeurs communes.
Pour autant, cette citoyenneté européenne n’est pas artificielle. Elle est ancrée dans un héritage religieux, intellectuel et culturel partagé dès le XIe siècle grâce aux échanges, notamment commerciaux, qui ont forgé des expériences communes, socle d’une culture européenne et berceau des grands principes que sont la liberté, l’égalité, la dignité humaine. Elle exprime ces valeurs fondatrices communes et participe à une culture politique commune basée sur les valeurs de l’UE, dont la démocratie et l’État de droit. C’est la raison pour laquelle la Cour de justice a qualifié la citoyenneté européenne de statut fondamental des ressortissants des États membres (CJCE, 20 septembre 2001, arrêt Grzelczyk). Car elle instaure non seulement une relation juridique et politique entre ceux-ci et l’Union, mais permet aussi d’offrir aux Européens une même condition juridique et politique.
L’histoire, la culture et les valeurs communes sont une réalité, qu’il faudrait rendre plus accessible à la conscience collective pour pallier la consistance juridique peu perceptible de la citoyenneté européenne. L’instauration de celle-ci a été audacieuse, mais sa matérialisation par des droits ne suffit pas à construire une communauté politique. Le droit ne peut à lui seul rapprocher l’Europe des Européens, d’autant plus que le fonctionnement de l’UE est peu intelligible. Et à trop mettre en avant les apports économiques de l’Union, les promoteurs de celle-ci rendent la citoyenneté européenne et sa substance démocratique moins perceptibles.
[Déjà plus de 120 000 abonnements aux newsletters The Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui pour mieux comprendre les grands enjeux du monde.]
La meilleure connaissance de la citoyenneté européenne est donc essentielle à l’éveil de la conscience européenne et à l’émergence d’un véritable espace public européen. Et toutes les initiatives visant à la promouvoir doivent être encouragées. Les simulations de Parlement européen et le séminaire d’immersion dans les institutions de l’UE portés par le Mouvement européen et auxquelles ont participé des lycéens du Morbihan et étudiants de l’Université Bretagne Sud y ont contribué. Les résultats sont éloquents : les participants ont tous éprouvé le sentiment d’« unité dans la diversité » et perçu la réalité de leur citoyenneté européenne.
Anne-Sophie Lamblin-Gourdin ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
19.05.2024 à 19:07
À Haïti, nommer aussi les violences obstétrico-gynécologiques en milieu hospitalier
Lukinson Jean, Docteur en Sciences sociales, LADIREP, Université d'État d'Haiti, GresCo, Université de Limoges
Texte intégral (1688 mots)
Haïti connaît une vague de violences sans précédent marquées par une escalade des attaques du fait de gangs qui souhaitaient renverser le premier ministre, Ariel Henry. Ce dernier a démissionné le 11 mars 2024. Il aura fallu attendre le 25 avril pour que le conseil présidentiel de transition soit officiellement investi pour le remplacer. Edgar Leblanc Fils a été désigné à sa tête.
Ce contexte de confusion et de chaos ne doit pas faire oublier toutes les formes de violence actuelles que subissent les femmes haïtiennes. Il en est une qui est souvent passée sous silence, voire méconnue, à savoir les violences obstétricales.
À lire aussi : Haïti s’est enfoncé dans la crise. Voici quatre solutions pour l’aider à s’en sortir – et cela prendra du temps
Des violences obstétricales invisibilisées
Celles-ci sont souvent invisibilisées au profit d’autres formes de violences contre les femmes, à tel point que la notion n’est guère utilisée dans le milieu médical et féministe, au profit de celles, plus générales, de maltraitances ou de violences basées sur le genre.
Cette invisibilisation est d’autant plus exacerbée que les violences obstétricales sont susceptibles de revêtir des formes variées. Des travaux menés dans d’autres contextes, par exemple à Dakar au Sénégal, indiquent que ces violences obstétricales posent, en tout cas pour certaines d’entre elles, « un véritable problème de reconnaissance par les victimes ». Ne sachant pas comment qualifier leur expérience, celles-ci préféreraient ne pas s’en plaindre ou tout simplement ne pas en parler, ce d’autant qu’elles n’ont pas toujours conscience du bénéfice qu’elles pourraient en tirer sur le court terme.
Un continuum avec les autres violences subies par les femmes
C’est dans cette perspective qu’ont été créées en Haïti les structures de soins obstétricaux et néonataux d’urgence de base (SONUB) en vue de donner aux usagères l’accès à des soins respectueux au sein des institutions et de leur permettre de bénéficier d’une prise en charge, entre autres, des cas de violences basées sur le genre.
De nombreux témoignages de victimes ainsi que des rapports officiels ont attiré l’attention sur l’ensemble des attitudes et comportements, « combinés ou séparés » (entre autres, mauvais accueils, injures, tapes et propos humiliants) qui forment la trame des violences obstétricales.
Recourir à la notion de violence obstétrico-gynécologique, plutôt qu’à celle de maltraitance ou encore à celle de violence de genre comporte des enjeux intellectuels et sociopolitiques de taille.
D’abord, cela permet, comme l’ont déjà rappelé de nombreux auteurs et de nombreuses autrices, d’inscrire ces violences dans le continuum des violences systémiques dont les femmes sont victimes au quotidien.
Ensuite, cette démarche a, en même temps, le mérite d’attirer l’attention sur la spécificité de cette forme de violence et sur la nécessité de lutter contre celle-ci dans un pays où la violence est endémique et protéiforme.
Enfin, il s’agit de dépasser l’usage de la notion en tant que simple « catégorie de pratique » dont la finalité serait, du point de vue des détracteurs, la délation et la remise en question des prestations de santé, mais de nous concentrer sur sa dimension analytique en vue de mieux appréhender le système de soins ainsi que le rapport au corps féminin dans le domaine de l’obstétrique-gynécologie.
Un tel concept permet d’apprécier à sa juste valeur le « vécu subjectif » des femmes face à une pratique médicale souvent présentée comme « un fait objectif incontestable » et au-dessus de la critique profane.
Mais des violences obstétrico-gynécologiques non solubles dans les autres
Par ailleurs, l’objectif est de donner à voir les violences obstétrico-gynécologiques comme relevant d’un genre spécifique et qui, bien que variant selon la position des femmes (ou des couples) dans la structure sociale, ne sont pas pour autant solubles dans la spirale des violences qui frappe la société haïtienne.
Une telle démarche n’est possible qu’à condition de prendre en compte la culture médicale locale ainsi que le contexte socio-économique et culturel dans lequel s’inscrivent ces propos, attitudes et comportements à l’égard des femmes.
Sous ce rapport, l’analyse est susceptible de mettre au jour et de mieux comprendre les violences obstétricales spontanées (hors urgence liée à l’accouchement), lesquelles ne sont pas toujours reconnues en tant que telles. Et quand elles le sont, elles sont souvent décrites comme imputables soit aux contraintes organisationnelles, soit aux contraintes inhérentes aux conditions d’exercice de la profession.
C’est pourquoi il importe de dépasser la logique manichéenne consistant à opposer la parole et le vécu subjectifs des femmes et la réalité médicale « objective » et de considérer que cette forme spécifique de violence est l’effet combiné autant d’habitus professionnel (entendu comme dispositions acquises tant au cours de la formation que dans l’exercice de la profession), que d’autres facteurs tels que les institutions, les normes et les valeurs ainsi que les systèmes de représentations en vigueur chez les experts obstétricaux, notamment chez le groupe professionnel des obstétriciens-gynécologues.
C’est à cette seule condition que les violences obstétricales ne seront pas traitées comme des violences subsidiaires et donc solubles dans les violences faites aux femmes en général.
Une spécialité médicale insuffisamment encadrée
Parmi toutes les violences faites aux femmes haïtiennes, les violences obstétricales font figure d’exception, d’autant qu’il n’existe à ce jour aucune loi à ce sujet, contrairement à ce qui se passe dans d’autres pays.
À cette absence de loi vient s’ajouter le problème de l’inexistence d’un ordre des médecins, à tel point que la spécialité obstétrique-gynécologie (familièrement appelée « ObGyn ») comme la plupart des autres spécialités médicales d’ailleurs, s’exerce dans un cadre le plus souvent informel et ne constitue pas, à ce titre, un marché du travail fermé stricto sensu.
On peut faire l’hypothèse que l’absence de loi sur les violences obstétrico-gynécologiques autant que l’inexistence d’un ordre des médecins ne font qu’accroître le caractère informel de la profession d’obstétricien-gynécologue.
Cela produit, ipso facto, des situations marquées par la discordance normative, en l’occurrence « des points de vue fondés sur des conceptions différentes » de la légitimité de certains faits et gestes. Ici, ils sont adaptés aux actes pratiqués en médecine gynécologique et obstétricale.
Les pratiques d’accouchements traditionnels également en question
Mais la question est plus vaste encore car les violences obstétricales sont loin d’être le fait des seuls professionnels de la médecine officielle.
À rebours de certaines analyses sous-tendues par une vision teintée de populisme idéologique,on peut supposer que les pratiques d’accouchements traditionnels, aussi répandues soient-elles surtout en milieu rural, n’en génèrent pas moins, elles aussi, leurs lots de maltraitances et de violences.
Cet article est co-écrit avec Mislor DEXAI (PhD., laboratoire LAngages DIscours REPrésentations – LADIREP – de l’Université d’État d’Haïti) et Marc-Félix CIVIL (MD-PhD., laboratoire LADIREP de l’Université d’État d’Haïti)
La recherche de Lukinson Jean a été financée par le Laboratoire Langages, Discours et Représentations (LADIREP) ainsi que la Fondation Connaissances et Liberté (FOKAL).
19.05.2024 à 19:07
Le Brésil, un nouveau modèle pour les banques publiques de développement ?
Jean-Baptiste Jacouton, Chargé de recherche, Agence française de développement (AFD)
Texte intégral (1692 mots)

La séquence internationale actuelle met le Brésil à l’honneur. En 2024, le pays préside le G20 et il accueillera la COP 30 sur le climat en 2025. En parallèle, l’élargissement des BRICS, un club d’économies émergentes dont fait partie le Brésil, intervient à un moment stratégique dans les discussions sur la gouvernance mondiale.
La réforme de l’architecture financière internationale figure parmi les priorités que le pays s’est fixées pendant sa présidence du G20. Son président, Lula, semble vouloir attirer l’attention sur la capacité des banques publiques de développement à intégrer les effets du changement climatique dans leurs financements, à lutter contre les inégalités et à répondre aux crises de toutes natures.
Grâce au travail de nombreux universitaires brésiliens, plus de 70 articles de recherche analysent le rôle des banques publiques de développement à travers l’expérience du Brésil. Ces travaux illustrent comment des institutions financières publiques, comme la Caisse des dépôts et consignations en France, peuvent accomplir leur mandat de développement tout en assurant la stabilité macro-financière des économies qu’elles servent.
Après les États-Unis et l’Inde, le Brésil est le 3e pays au monde au nombre de banques publiques de développement, notamment en raison de sa structure fédérale. Le pays dispose d’un réseau de 21 banques publiques locales et d’une banque publique nationale : la « Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social » (BNDES, Banque nationale pour le développement économique et social). Celle-ci publie le détail de ses opérations, ventilées selon la nature des bénéficiaires et de leur localisation. Elle contribue ainsi à faire avancer notre compréhension des banques publiques de développement.
Les activités de la BNDES et la place qu’elle occupera dans l’économie brésilienne au cours des prochaines années seront vraisemblablement déterminantes pour la crédibilité de l’ensemble des 533 banques publiques de développement réunies dans la coalition Finance en Commun (FiCS). À cet égard, l’évènement conjoint G20/FiCS qui se tient à Rio de Janeiro les 20 et 21 mai 2024 a pour objectif de repenser la place de ces institutions dans le système financier international, afin de renforcer leurs actions en faveur des objectifs de développement durable (ODD) et de la lutte contre le changement climatique.
Une nouvelle phase de développement
La BNDES est une des plus grandes banques publiques de développement au monde. Elle totalise environ 130 milliards de dollars d’actifs en 2022, soit l’équivalent de 7 % du produit intérieur brut brésilien. La banque finance des projets de long terme dans l’ensemble des secteurs de l’économie, tels que l’agriculture, les infrastructures, les services, et sert une pluralité d’acteurs économiques, allant des microentreprises aux entreprises multinationales. Afin de remplir son mandat, les opérations de la BNDES se déclinent principalement sous forme de prêts (67 %) et via d’autres instruments telles que la prise de participations au capital des entreprises, les garanties, et le crédit-export. Cette diversité d’activités, de clients et d’instruments, est représentative de l’action des banques nationales de développement.
L’histoire de la BNDES est intimement liée au contexte socio-économique du Brésil. La banque fut créée en 1952 dans un contexte d’intervention délibérée du gouvernement brésilien dans l’économie afin de servir ses objectifs de développement social et économique. Au regard des difficultés du pays au début des années 1980 (faible taux de croissance, inflation, accroissement de la dette publique), la politique économique brésilienne a pris un tournant néo-libéral, poussant la BNDES à accompagner la privatisation des entreprises publiques. Au début des années 2000, la première élection du président Lula (Parti des Travailleurs) a marqué une nouvelle phase de développement pour la banque : entre 2003 et 2016, ses actifs ont été multipliés par 6.
Divers travaux insistent sur le rôle contra-cyclique qu’a joué la BNDES durant cette période. Face à la crise financière globale de 2008, elle est devenue l’une des banques publiques de développement les plus interventionnistes au monde.
Durant les 3 années qui ont suivi, son volume d’engagements a augmenté de plus de 25 % par an. Cette dynamique s’est poursuivie de façon continue pendant une dizaine d’années, si bien que son activité de prêts équivalait à presque 12 % du PIB brésilien en 2015.
Ce volume était tel qu’il aurait incité la banque centrale du Brésil à augmenter ses taux d’intérêt afin de maîtriser l’inflation qu’il nourrissait. La BNDES a alors entamé un ralentissement de son activité depuis 2016, interrompu durant la crise du Covid-19 durant laquelle la banque a, une nouvelle fois, pleinement joué son rôle contra-cyclique.
Des engagements pour une finance solidaire et durable
Traditionnellement, les banques publiques de développement ont vocation à stimuler et soutenir les secteurs de l’économie généralement exclus des systèmes financiers. Dans de nombreuses économies émergentes et en développement, les petites et moyennes entreprises ont un accès limité aux sources de financement formelles pour investir et développer leurs activités.
De nombreux articles se sont intéressés à la valeur ajoutée de la BNDES dans ce secteur. Il ressort que les entreprises financées par la banque brésilienne ont tendance à investir plus que les autres. Entre 2002 et 2016, la BNDES aurait ainsi significativement contribué à la formation brute de capital fixe au Brésil. Plusieurs auteurs nuancent néanmoins cette contribution positive en indiquant que la BNDES a également financé des entreprises performantes qui auraient pu se financer directement auprès de banques commerciales privées. Ce mécanisme est connu sous le nom d’« effet d’éviction ».
Au cours des dernières années, la BNDES a vu son mandat évoluer pour intégrer de façon significative les enjeux environnementaux et le financement des biens publics mondiaux. En 2019, la banque a adopté une nouvelle politique de responsabilité sociale et environnementale qui intègre pleinement les enjeux extrafinanciers dans sa stratégie et ses opérations. La même année elle s’est faite accréditer par le Fonds Vert pour le Climat pour son engagement « à encourager les projets qui contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à atténuer les effets du changement climatique ».
La BNDES fut ainsi la première banque brésilienne à émettre, en 2017, une obligation verte sur les marchés internationaux à hauteur d’un milliard de dollars. Dans les faits, les engagements en matière de finance verte de la BNDES ont augmenté de 37 % entre 2018 et 2022. Si la littérature s’accorde sur le rôle moteur que joue la banque pour financer la transition énergétique du Brésil, il existe néanmoins peu d’études concernant ses impacts en matière de déforestation.
En définitive, l’expérience de la BNDES invite à repenser l’action des banques de développement en articulation avec l’ensemble des politiques publiques. Par définition, ces institutions constituent un instrument quasi fiscal de politique publique. Pour bien comprendre leur potentiel de développement dans l’économie, il s’agit donc de penser leurs activités en adéquation avec l’ensemble des politiques budgétaires, monétaires et industrielles. De façon générale, les travaux de recherche sur les banques publiques de développement devraient davantage tenir compte des interactions qu’elles entretiennent avec l’ensemble des acteurs économiques publics et privés.
Jean-Baptiste Jacouton ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
19.05.2024 à 14:38
Tentative d’assassinat de Robert Fico : quelles conséquences pour la Slovaquie ?
Jan Rovny, Professor of Political Science, Centre d’études européennes et de politique, Sciences Po
Texte intégral (2097 mots)
Mercredi 15 mai, dans la petite ville slovaque de Handlova, Robert Fico, 59 ans, redevenu premier ministre le 25 octobre dernier après avoir déjà exercé cette fonction – la plus importante dans son pays – pendant dix ans au total entre 2006 et 2018, a été victime d’une tentative d’assassinat. Touché par cinq balles à bout portant, il a été rapidement évacué vers son hôpital. Son état, un temps jugé critique, est désormais qualifié de « grave ». Le suspect, un homme de 71 ans aux motivations floues, a été arrêté.
Fico est un dirigeant qui détonne au sein de l’UE. Élu sur une ligne populiste, notamment marquée par un discours résolument hostile aux migrants et aux minorités sexuelles, connu pour sa proximité avec Moscou sur le dossier ukrainien, souvent présenté comme un tenant de l’illibéralisme à l’instar du premier ministre de la Hongrie voisine, Viktor Orban, dont il est proche, il est un personnage extrêmement clivant sur la scène politique de la Slovaquie, ce pays d’Europe centrale de quelque 5,5 millions d’habitants actuellement plongé, comme les 26 autres États membres de l’UE, en pleine campagne électorale dans la perspective des européennes du 9 juin prochain.
The Conversation France a demandé à Jan Rovny, professeur de science politique au Centre d’études européennes et de politique comparée à Sciences Po, de revenir sur la trajectoire et l’idéologie de Robert Fico, et d’évaluer les conséquences que pourrait avoir cet événement sans précédent en Slovaquie, et rarissime à l’échelle de l’Europe, où les deux derniers chefs de gouvernement à avoir été assassinés dans l’exercice de leurs fonctions sont le Serbe Zoran Djindjic en 2003 et le Suédois Olof Palme en 1986.
Comment qualifieriez-vous Robert Fico, sur le plan politique ? Son parcours et ses prises de position sont-ils ceux d’une personnalité inclassable, ou bien s’inscrivent-ils dans des mouvances politiques clairement définies ?
Tout d’abord, il me semble important de commencer par rappeler que toute forme de violence, et en particulier la violence politique, est un phénomène odieux. Ce qui s’est passé ce 15 mai, c’est d’abord une tentative de meurtre visant un être humain, et ensuite seulement une attaque contre une personnalité politique – une personnalité politique qui a remporté des élections équitables et compétitives, et qui a légitimement accédé aux fonctions qui sont les siennes. Cet acte est une atteinte à la vie humaine et, au-delà, du fait du poste de la personne visée, une atteinte à la démocratie libérale, et mérite donc une condamnation absolument univoque.
Robert Fico est un personnage incontournable de la politique slovaque depuis un quart de siècle. Initialement issu du parti social-démocrate modéré SDL (Parti de la gauche démocratique), qui était un parti post-communiste réformé, Fico a fondé en 1999 son propre parti, SMER (Direction), initialement inspiré par la politique dite de la troisième voie du Labour britannique de Tony Blair et opposé au gouvernement de droite en place à l’époque en Slovaquie.
Au début des années 2000, Fico parvient à dominer l’aile gauche de la politique slovaque en attirant dans l’orbite du SMER d’autres forces de gauche. Il est généralement soutenu par des électeurs socialement défavorisés, qui ont été les perdants de la transition économique de la Slovaquie vers une économie capitaliste – une transition dans l’ensemble plutôt réussie.
[Déjà plus de 120 000 abonnements aux newsletters The Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui pour mieux comprendre les grands enjeux du monde.]
Fico attire de plus en plus ces électeurs en insérant dans son discours un mélange de protectionnisme économique, de connotations nationalistes et de rhétorique hostile aux minorités. En 2006, il forme un gouvernement de coalition avec des forces nationalistes et de droite radicale, et continue à glisser vers un illibéralisme politique de plus en plus explicite.
Fico et ses gouvernements – il sera premier ministre de 2006 à 2010 puis de 2012 à 2018, avant de récupérer ce poste en 2023 – sont accusés d’approfondir les pratiques de corruption et de construire ce que certains analystes qualifient d’« État mafieux », associant les élites politiques du régime à des oligarques impliqués dans des pratiques commerciales douteuses.
Fico est contraint de démissionner à la suite de l’assassinat, en 2018, d’un journaliste politique, Ján Kuciak, qui enquêtait sur les liens de la SMER avec le crime organisé. Son retour au pouvoir à l’issue des élections législatives de 2023 est précédé par des apparitions publiques remarquées dans le contexte des protestations contre les mesures sanitaires prises par le gouvernement pendant la pandémie de Covid, et par sa vive opposition à l’envoi de nouvelles armes à l’Ukraine.
Après sa réélection en 2023, Fico et son gouvernement, qui comporte des ministres d’extrême droite, se sont lancés dans une rapide « dé-démocratisation » à la Viktor Orban, en abolissant le bureau spécial du procureur pour les affaires de corruption et de crime organisé, et en cherchant à fermer la chaîne de télévision publique slovaque. Le camp politique de Fico a obtenu la victoire de son ancien collaborateur, Peter Pellegrini, lors de la toute récente élection présidentielle (23 mars/6 avril), ce qui a renforcé l’emprise de Fico sur le pouvoir.
En bref, Fico ne verrait probablement rien à redire si on le qualifiait de « Viktor Orban de la Slovaquie ».
En Slovaquie, quelles sont les réactions à la tentative d’assassinat dont il a été la cible ?
La quasi-totalité des adversaires de Fico, à commencer par la présidente sortante Zuzana Caputova, qui est son adversaire de longue date, ainsi que de nombreux médias, ont fermement condamné la tentative d’assassinat et lancé un appel à l’unité politique et sociale, mettant en garde contre les effets néfastes de la violence politique et de son instrumentalisation opportuniste.
D’autre part, un certain nombre de membres du gouvernement ont réagi en critiquant l’opposition libérale et les médias traditionnels, allant jusqu’à affirmer que ceux-ci avaient le sang de Fico sur les mains en raison de leurs critiques à l’égard du premier ministre. Les mesures que le camp gouvernemental pourrait prendre dans les prochains jours et les prochaines semaines en matière de contrôle des médias, notamment, devront être scrutées de près.
Une chose semble sûre : un tel acte de violence politique, sans précédent dans la jeune histoire de la Slovaquie indépendante, n’est certainement pas de nature à favoriser une évolution harmonieuse vers une démocratie libérale apaisée. Le gouvernement avait déjà clairement indiqué que certains de ses objectifs étaient tout à fait illibéraux ; le contexte actuel va encore accroître sa détermination à agir dans ce sens.
S’achemine-t-on vers une prise de contrôle des médias slovaques par le pouvoir ?
Depuis que Fico est revenu aux affaires à l’automne 2023, le pays s’est précipité sur la voie d’un illibéralisme à la Orban. Fondamentalement, la tentative d’assassinat n’a pas changé la donne, si ce n’est qu’un tel épisode peut donner au gouvernement les coudées franches pour l’utiliser comme prétexte à de nouvelles restrictions de la liberté des médias et de l’indépendance de la justice.
Peut-on déjà prévoir l’impact de cet événement sur le résultat des élections européennes en Slovaquie ?
Nous ne disposons pas encore de sondages effectués après la tentative d’assassinat pour nous faire une idée plus précise de la façon dont cela a – ou non – incité les citoyens slovaques à modifier leurs intentions de vote. On peut s’attendre à ce que l’attentat contre le premier ministre génère un certain nombre de votes de sympathie et augmente ainsi les chances électorales de son parti, le SMER, qui, en avril, devançait l’opposition libérale d’un point de pourcentage dans les sondages. Simultanément, l’opposition libérale a déclaré – par respect – qu’elle suspendrait toutes ses manifestations politiques.
Dans quelle mesure la violence politique est-elle répandue dans les pays anciennement communistes ayant adhéré à l’UE en 2004 et 2007 ?
En Europe centrale, la violence politique est plutôt limitée. La Slovaquie a connu un assassinat qui a eu un grand retentissement et qui était clairement motivé par des considérations politiques, celui de Ján Kuciak en 2018 – un épisode qui, je l’ai évoqué, a contraint Fico à démissionner. En dehors de cela, la violence politique est rare à un niveau aussi élevé. Si l’on compare avec l’Europe occidentale et que l’on considère les assassinats politiques de personnalités telles que Pim Fortuyn aux Pays-Bas, Anna Lindh en Suède et Jo Cox ou David Amess au Royaume-Uni, il semble que les assassinats à motivation politique soient plus fréquents à l’ouest.
Quels sont les scénarios probables si Fico se remet de ses blessures ? Et s’il ne parvient pas à reprendre ses activités politiques ?
Si Robert Fico se rétablit et reprend son poste de premier ministre, il est difficile d’imaginer que sa rencontre rapprochée avec la mort lui apportera une forme d’épiphanie. Je m’attends à ce qu’il poursuive ses politiques illibérales – avec probablement encore moins de scrupules qu’auparavant. S’il succombe à ses blessures ou en tout cas ne parvient pas à retrouver l’intégralité de ses moyens et se retire de la vie politique, il sera probablement remplacé par l’un de ses proches collaborateurs – peut-être Robert Kalinak, ancien ministre de l’Intérieur et actuel ministre de la Défense. Je m’attends à ce que Fico lui-même et son parti utilisent l’assassinat à des fins politiques. Quoi qu’il arrive, la démocratie libérale en Slovaquie semble suspendue à un fil de plus en plus précaire.
Jan Rovny a reçu des financements de Horizon Europe.
17.05.2024 à 12:39
Quels droits pour les promeneurs, entre droit d’accès à la nature et propriété privée ?
BASSET Mégane, Avocat au Barreau de Grenoble - Chargée de travaux dirigés, Université Grenoble Alpes (UGA)
Texte intégral (2762 mots)

Se promener dans la nature, cela peut-être, selon le point de vue que l’on adopte, un droit, un loisir, un sport, un bienfait pour la santé, mais aussi, depuis une récente loi passée en février 2023, une infraction pénale. Car une grande majorité des forêts françaises ne sont pas publiques, et que l’accès aux espaces naturels et aux forêts privés est désormais sanctionné par une amende de 135 euros. Comment en est-on arrivé là et quel avenir se dessine pour l’accès à la nature ?
Depuis la loi du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée, le simple fait de pénétrer sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d’autrui dans le cas où le caractère privé du lieu est matérialisé physiquement, peut effectivement être sanctionné par une contravention de 4ème classe (amende forfaitaire de 135 euros). Certains propriétaires du massif de la Chartreuse en Isère, dans les Alpes maritimes ou encore un groupement forestier dans les Vosges, ont décidé d’utiliser cet outil afin d’empêcher tout accès à leurs propriétés. En riposte, de nombreuses personnes et des associations se sont alors mobilisées afin de défendre un droit d’accès à la nature.
Alors que 75 % des forêts françaises sont privées et appartiennent à plus 3,3 millions de citoyens, avec jusqu’à 90 % de forêts privées dans l’Ouest de la France qui bat tous les records dans les régions Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine et Bretagne, cette loi redessine le rapport que peuvent entretenir les citoyens avec leur environnement.
Jusqu’alors, se trouver dans un espace naturel privé pour n’importe quel usager (promeneur, randonneur, alpinistes, pratiquant de trail…) n’était pas sanctionnable en soi, le droit civil proposant des mécanismes permettant de réparer les éventuels dommages ou le droit pénal permettant de sanctionner les violations de domicile ou les dégradations. Seule exception : les pratiquants de VTT pouvaient eux déjà, être verbalisés pour la pratique du free-ride en forêt (articles R. 163-6 du code forestier et R. 362-2 du code de l’environnement).
Pourquoi en est-on venu à faire changer cela ?
Le souhait d’une conciliation entre protection de l’environnement et protection de la propriété privée
À l’origine, la loi du 2 février 2023 est le résultat d’un compromis entre d’une part, une nécessité de rendre les clôtures qui se multiplient dans les paysages français, moins dommageables pour la biodiversité, et de l’autre, en contrepartie, une volonté de rassurer les propriétaires.
Le premier objectif de cette loi a donc été de répondre à l’explosion récente de la pratique de l’engrillagement visant à clôturer des terrains privés avec des conséquences directes sur l’environnement et la biodiversité : impact sur les corridors écologiques, morcellement des habitats naturels…

Cette loi est ainsi venue modifier certaines dispositions du code de l’environnement afin d’y inscrire les nouvelles caractéristiques des clôtures : posées à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, hauteur limitée à 1m20, non vulnérantes pour la faune, réalisées en matériaux naturels définis par le SRADDET (Schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires).
Le code de l’environnement précise désormais que les clôtures existantes (sauf certaines exceptions comme les élevages équins ou les exploitations agricoles par exemple) implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par les règlements des plans locaux d’urbanisme, ou à défaut d’un tel règlement, dans les espaces naturels, doivent être mises en conformité avant le 1er janvier 2027 en ne portant pas atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques et aux activités agricoles ou forestières du territoire.
À lire aussi : L’animisme juridique : quand un fleuve ou la nature toute entière livre procès
La pénalisation de l’accès à la nature comme contrepartie radicale aux mesures de protection environnementale
En contrepartie de ces mesures visant à « combattre l’emprisonnement de la nature » et dans l’optique d’apaiser les propriétaires, le législateur a donc créé un nouvel article 226-4-3 dans le code pénal, qui prévoit une contravention de 4ème classe (amende forfaitaire de 135 euros) afin de sanctionner le simple fait de pénétrer sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d’autrui dans le cas où le caractère privé du lieu est matérialisé physiquement.
Mais depuis son entrée en vigueur, comment cette loi a-t-elle été appliquée ?
Si d’un côté les inspecteurs de l’Office français de la biodiversité, souvent sollicités par des associations et des riverains, interviennent davantage sur le terrain pour constater les éventuelles clôtures non conformes aux prescriptions de la loi du 2 février 2023, d’un autre côté, depuis l’entrée en vigueur de l’article 226-4-3 du code pénal, les agents assermentés pour le faire ont également pu verbaliser des promeneurs qui se seraient introduits dans la propriété privée rurale ou forestière d’autrui, matérialisée comme telle.
Plusieurs interrogations concrètes ont émergé à la suite de l’adoption de cette loi : que faut-il entendre par matérialisation physique d’une propriété privée ? Une trace de peinture rouge sur un rocher, par exemple, doit-elle être considérée comme une telle matérialisation physique ?
Les difficultés liées à l’application sur le terrain
Il faut noter que pour pouvoir être appliquée, c’est-à-dire donner lieu à une sanction, une infraction doit être prévue par la loi en vertu du principe de légalité des délits et des peines, c’est-à-dire que l’objet et la nature de l’infraction doivent être clairement mentionnés et explicités dans la loi. Mais si nul n’est censé ignorer la loi, et si on veut réellement pousser jusqu’au bout la rigueur du raisonnement juridique, comment savoir si on est en infraction quand la propriété privée est uniquement signalée par un panneau « Propriété privée – Défense d’entrer » sans autre délimitation claire des limites de la propriété en question ?
Peut-on sincèrement demander aux promeneurs, avant leur excursion, de s’informer sur l’étendue exacte des propriétés privées dans lesquelles ils ne pourront plus pénétrer comme avant l’adoption de la loi lorsqu’elles n’étaient pas davantage clôturées ? Et s’agissant des agents verbalisateurs, chaque propriétaire va-t-il faire appel à des gardes assermentés pour surveiller et verbaliser les éventuels contrevenants ?
Si l’intention peut paraître d’une certaine manière louable au regard des perturbations des écosystèmes, des risques pour la sécurité, des pollutions et autres dépôts sauvages, et donc des problèmes de responsabilités pour les propriétaires – difficiles à nier et en partie liés à la surfréquentation de certains sites – sa mise en pratique n’est pas dénuée de complications sur le terrain. Et la récente pénalisation n’a pas solutionné mais plutôt, dans certains cas, aggravé les conflits d’usage avec les chasseurs notamment lorsque des réserves naturelles sont paradoxalement mises à leur disposition par des propriétaires, au détriment des promeneurs.
À lire aussi : La désobéissance civile climatique : les États face à un nouveau défi démocratique
Une proposition de loi portant dépénalisation de l’accès à la nature retoquée
D’autres pays européens, notamment les pays scandinaves, consacrent le droit de tout un chacun d’accéder à la nature : l’allemansrätten est même inscrit dans la Constitution suédoise depuis 1994 :
« Nonobstant les dispositions antérieures [relatives au droit à la propriété]l’accès de tous à l’environnement naturel est garanti, conformément au droit d’accès au public. »
Ce droit fait partie intégrante de la culture suédoise et permet à tous et partout de camper, d’accéder aux plages, de se baigner, certaines cueillettes et même de pêcher gratuitement. En contrepartie, car il y en a une, les promeneurs doivent faire preuve de civisme et respecter les propriétaires des lieux, avec pour obligation de laisser l’endroit comme ils l’ont trouvé.
S’inspirant de ce modèle et alors que le préambule de la Charte de l’environnement précise que l’environnement est le « patrimoine commun des êtres humains », les députés écologistes Jérémie Iordanoff et Lisa Belluco ont déposé une proposition de loi visant à dépénaliser l’accès à la nature. Cette proposition avait pour objet de revenir sur le droit antérieur en abrogeant purement et simplement l’article L. 226-4-3 du Code pénal. Pour appuyer leur texte, ils mettent en avant les effets bénéfiques de la nature sur la santé physique et mentale et l’importance de la connaître pour être sensibilisé à sa défense.
Ces députés dénoncent ainsi l’inutilité de réprimer le simple fait de se promener en forêt, aucune offense n’étant alors commise, dans le cas où les promeneurs sont respectueux de la nature et des propriétaires évidemment. Tout système pénal répressif vise effectivement à protéger la société et les députés ont voulu souligner l’absence de danger, d’atteinte à la vie privée ou encore d’atteinte aux biens dans le cas d’activités de pleine nature.
[Déjà plus de 120 000 abonnements aux newsletters The Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd'hui pour mieux comprendre les grands enjeux du monde.]
Leur proposition de loi a ainsi été présentée à la commission des lois de l’Assemblée nationale le 27 mars 2024 mais rejetée malgré plusieurs amendements. Des parlementaires avaient ainsi proposé d’atténuer la sévérité de l’article L. 226-4-3 du Code pénal en établissant des exceptions à la sanction dans les cas où la loi le permet et dans le cas des sentiers de randonnées entretenus et balisés par une association reconnue d’utilité publique, même s’il traverse une propriété privée.
D’autres députés avaient également proposé d’ajouter un article L. 361-4 au code de l’environnement prévoyant que les voies et chemins balisés par un établissement public, une collectivité territoriale ou une fédération de randonneurs agréée et traversant une propriété privée sont grevés sur une bande de trois mètres de largueur destinée à assurer exclusivement le passage des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers, en vain.
Vers d’autres solutions plus équilibrées entre promeneurs, propriétaires et collectivités ?
Au Québec, où plus de 90 % du territoire fait partie du domaine de l’État, le médecin et professeur à la Faculté de médecine et des sciences de la santé
Isabelle Bradette prescrit désormais des sorties en nature de vingt minutes à ses patients pour les aider à réduire leur stress : baisse de l’anxiété, hausse du moral, baisse du cortisol, aide à réguler l’humeur, hausse de la créativité et de la concentration, renforcement du système immunitaire. Hippocrate aurait même dit : « La nature est la meilleure médecine pour l’homme. »
En France, le but est en réalité de trouver un équilibre entre protection de la propriété privée et liberté d’aller et venir tous deux constitutionnellement consacrés, équilibre dont la subtilité n’est cependant pas garantie avec l’outil répressif, négligeant d’autres instruments de gestion plus « démocratiques », qui, certes, nécessitent un réel suivi dans leur mise en œuvre.
Il existe en effet des conventions ou des plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) signalés par les députés dans le compte-rendu relatif à leur proposition de loi de dépénalisation de l’accès à la nature. Ces plans peuvent être signés entre les propriétaires volontaires et les départements afin de garantir un droit d’accès à la nature tout en veillant à l’encadrer.
BASSET Mégane ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
16.05.2024 à 18:31
« Réarmement démographique » : les séries dystopiques s’invitent dans le débat
Marine Malet, Researcher in Information sciences and media studies, University of Bergen
Texte intégral (2756 mots)

Le 16 janvier 2024, le président de la République Emmanuel Macron défendait l’idée d’un « réarmement démographique », tout en restant évasif sur les applications concrètes d’un tel projet. Cette prise de parole a entraîné de nombreuses réactions associant cette rhétorique guerrière et l’évocation de tests de fécondité à des dystopies comme le roman de Margaret Atwood La Servante écarlate, adapté en série à succès.
L’actualité et sa lecture à travers le prisme de la dystopie sont l’occasion d’interroger le succès des séries appartenant à ce genre et leurs éventuelles fonctions. À quels problèmes publics ou débats de société font-elles écho ? Mais surtout, à quelles réflexions sont-elles susceptibles de nous inviter ?
Des futurs sombres pour repenser nos sociétés
La dystopie n’est pas un genre nouveau. Le XXe siècle, tourmenté par des périodes de crises profondes, donne naissance à des œuvres qui se sont érigées en références littéraires du genre : 1984 de George Orwell, Le Meilleur des mondes d’Aldous Huxley ou encore Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, pour ne citer qu’eux.
Depuis le milieu des années 2010, on peut cependant observer une nouvelle vague dystopique largement alimentée par les séries télévisées. Les récits dystopiques fleurissent sur nos écrans et ont su séduire des publics variés, notamment du fait de leur diffusion sur des plates-formes de VOD. Certaines séries se sont ainsi érigées en références culturelles partagées, devenant parfois des grilles d’interprétation de l’actualité socio-politique : Black Mirror, Squid Games ou encore La Servante écarlate, au point de voir leur iconographie reprise en symbole de luttes contestataires.
[Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]
Science-fiction, anticipation, uchronie, post-apocalyptique, dystopie… les frontières entre les genres fictionnels sont ténues, parfois poreuses. Ici, la dystopie est donc entendue comme un récit fictionnel qui, en hypertrophiant des phénomènes déjà à l’œuvre dans la société de l’auteur, en imagine les dérives possibles dans un futur plus ou moins proche et se fait le relais des préoccupations et des angoisses contemporaines. Dans un geste de mise en garde, ces récits confient une responsabilité aux lecteurs/téléspectateurs, celle d’éviter que le futur décrit ne se produise en demeurant vigilant.
C’est d’ailleurs précisément ce qui semble se produire en réaction au « réarmement démographique » évoqué par Emmanuel Macron : la fiction dystopique – dans ce cas précis, La Servante écarlate – a été mobilisée par certains comme une grille d’interprétation de l’actualité, désignant comme problématique une telle orientation politique. Ces propos ont été interprétés à travers le prisme de la fiction dystopique, qui agit comme une mise en garde quant à la fragilité des droits des femmes face aux enjeux démographiques.
Le thème démographique n’est pas un motif nouveau dans les dystopies – le sociologue Andreu Domingo parle d’ailleurs de « demodystopia ». Déjà en 1973, Richard Fleischer imaginait dans Soleil vert les conséquences de la surpopulation. Mais qu’en est-il aujourd’hui ? Quelles représentations dystopiques en font les séries ?
La réactualisation du motif de la surpopulation
Si le thème de la surpopulation a largement inspiré les auteurs de dystopies dans les années 80, celui-ci se fait plus rare, à quelques exceptions près. La série américaine The 100 (2014-2020) en est une. Créée par Jason Rothenberg, elle imagine le monde de 2149 – 97 ans après que la Terre ait été rendue inhabitable suite à une catastrophe nucléaire, seuls ont survécu les habitants d’une station orbitale. Malgré le contrôle des naissances, les ressources s’épuisent, les obligeant à un retour sur Terre. Durant sept saisons, la survie de l’humanité sera au cœur de l’intrigue principale.
The 100 réactualise donc le motif dystopique de la surpopulation, entrant en résonance avec certains discours alarmistes qui, encore récemment, établissaient un lien entre la surpopulation mondiale et les questions environnementales (épuisement des ressources, pollution, etc.). Elle l’associe également aux risques que peuvent représenter certains usages de l’IA (intelligence artificielle).
Dans The 100, bien qu’il ne s’agisse pas du cœur de l’intrigue, la surpopulation correspond au point de départ qui entraîne ce que j’appelle le « basculement dystopique ». Dans le premier épisode de la saison trois, la série met en récit les origines de la catastrophe nucléaire : en 2051, une scientifique [Becca] a développé une IA (ALIE), programmée pour « rendre la vie meilleure » et régler la crise environnementale mondiale. Afin de remplir son objectif premier, ALIE se donne pour mission de régler ce qu’elle identifie comme le problème de fond : « trop de monde » (S03E01, 01:54).
Reprenant la construction du mythe de Frankenstein, The 100 illustre le concept de perverse instantiation, soit la capacité d’une IA à pervertir les intentions de son programmeur en poursuivant un objectif de manière logique mais délétère et hostile pour l’humain. La surpopulation étant identifiée comme principal obstacle s’opposant à une vie meilleure par l’IA, celle-ci échappe au contrôle de sa créatrice pour procéder au lancement de missiles nucléaires afin de ne permettre la survie que de quelques humains.
Les angoisses liées aux catastrophes nucléaires sont emblématiques du contexte géopolitique de la Guerre froide et sont devenues un thème classique dans la science-fiction, réactualisé par la série. C’est encore une fois par la main de l’humain, mais sous les traits d’une IA, que se joue la perte d’une partie de l’humanité. La technologie alimente l’espoir de lendemains meilleurs (notons que la série propose aussi une représentation positive de l’IA dans la suite du récit) mais elle peut aussi être une menace fatale lorsque ses conséquences ne sont pas maîtrisées.
Le recours à la technologie pour répondre aux problèmes relatifs à l’environnement et/ou aux enjeux démographiques fait également écho à des débats contemporains : le dérèglement climatique et ses conséquences se sont progressivement constitués en problème mondial ces dernières années. En réponse, certains discours envisagent la technologie comme solution à tous les maux, ce qu’Evgeny Morozov désigne comme un « solutionnisme technologique », tout en en soulignant ses limites. La série The 100 illustre ce que pourraient être les conséquences dystopiques d’une telle solution apportée au problème de la surpopulation.
Le scénario d’une baisse drastique de la natalité
Dans La Servante écarlate, c’est a contrario la baisse de la fertilité qui entraîne le « basculement dystopique », en entraînant une crise mondiale. Cette question agite les débats de nos sociétés occidentales depuis plusieurs années et s’est progressivement érigée en problème public.
En 2023, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié un rapport sur l’infertilité qu’elle qualifie de « problème mondial de santé publique ». Si le phénomène concerne aujourd’hui 17,5 % de la population selon le rapport, La Servante écarlate met en récit les conséquences qu’entraînerait sa généralisation.
La série, s’inspirant du roman éponyme de Margaret Atwood, postule une société où l’infertilité s’est généralisée, entraînant une chute drastique de la natalité. C’est dans ce contexte qu’une secte politico-religieuse renverse le Gouvernement des États-Unis et crée une société totalitaire, La République de Gilead, affichant le projet d’un retour aux valeurs traditionnelles et religieuses.
Après avoir purgé la société de tous les individus et éléments allant à l’encontre de cette vision du monde, la société est réorganisée autour d’une lecture fondamentaliste de la Bible. Les femmes sont déchues de leurs droits et de leurs libertés, celles identifiées comme fertiles ont le devoir de donner naissance. Celles qui ont péché par le passé (c’est le cas du personnage principal du récit, June/Offred) deviennent des Servantes et n’ont d’autre mission que la reproduction : affectées à des couples des castes les plus élevées, elles sont violées chaque mois par le Commandant en présence de l’Epouse, dans un rituel appelé la Cérémonie, afin de leur donner des enfants.
Les causes de l’infertilité sont également nommées par la série qui l’associe à des questions environnementales et sanitaires. La dystopie est « critique » pour le chercheur Tanner Mirrlees, puisqu’elle pointe explicitement la responsabilité d’un système industrialo-capitaliste. On retrouve là aussi l’idée que l’humain est à l’origine de sa propre perte.
Dans le premier épisode de la saison 1, le personnage de Tante Lydia – chargé de « former » les Servantes – désigne le système pré-Gilead comme responsable de l’infertilité en ces termes :
« Ils remplissaient l’air de produits chimiques, de radiations et de poison ! Dieu a donc créé un fléau spécial. Le fléau de l’infertilité… alors que le taux de natalité chutait, ils ont aggravé la situation. Pilules contraceptives, pilules du lendemain, assassinat de bébés. Juste pour pouvoir faire leurs orgies, leur Tinder… » (Tante Lydia, S01E01, 16:07)
Mais, dans la rhétorique de Gilead – et là réside le tournant dystopique – les pollutions industrielles partageant la responsabilité avec les valeurs défendues par les démocraties libérales et tout ce que nos sociétés actent comme des acquis et des libertés : le droit à la contraception, à l’avortement, ou encore à vivre son orientation sexuelle. Pollution et libertés sont donc deux éléments que le système de Gilead s’est employés à éradiquer, au nom du bien commun.
« Nous ne nous sommes pas réveillés » nous dit June (Elisabeth Moss). Face aux effets de l’infertilité, la société a évolué progressivement : un contrôle accru de l’éducation des enfants par les services sociaux d’une part ainsi qu’un retour à la Foi dans l’espoir d’un salut.
À partir de l’analyse des flashbacks des quatre premières saisons, il est possible de reconstituer l’ordre chronologique des grands évènements ayant conduit à la formation de l’univers dystopique de Gilead : infertilité et baisse drastique du taux de natalité dans le monde, popularité de mouvements religieux appelant à la responsabilité collective en embrassant « son destin biologique » (Serena Waterford, S02E06), un coup d’État, des purges, la fermeture des frontières, puis la réorganisation de la société.
Ces scènes témoignent du processus méticuleux et calculé qui conduit au basculement dystopique. Elles montrent aussi, et la série tend à mettre en garde contre cela à travers le discours de June, la passivité des personnages face aux mesures qui introduisent la catastrophe et leur capacité d’adaptation à ces mesures d’exception, jusqu’à ce qu’il ne soit trop tard.
Une invitation à la réflexion collective
En mettant en fiction les causes du « basculement dystopique », les séries identifient et désignent certains faits de société comme problématiques, puisque susceptibles de conduire à de futurs indésirables. Par ailleurs, la présence de nombreux personnages permet de dresser un tableau complexe et réaliste des problèmes publics fictionnalisés : ceux-ci incarnent différentes visions du monde qui façonnent la réalité sociale.
Pour reprendre l’exemple de La Servante écarlate, le récit est raconté du point de vue de June et donne à voir son expérience du basculement dystopique et de son nouveau quotidien de Servante. Le téléspectateur est solidarisé avec l’expérience oppressive du régime dystopique telle que vécue par June. Cependant, dès la première saison, la série rend également audibles d’autres voix et d’autres expériences, notamment celles de ceux qui sont les instigateurs de Gilead, Fred Waterford et Serena Joy Waterford. Plusieurs scènes de flashbacks permettent aux téléspectateurs de mieux saisir leur vision du monde : convaincus d’œuvrer pour le bien de l’espèce humaine, Gilead constitue pour eux l’unique voie pour répondre à la menace que représente l’infertilité.
En confrontant les points de vue de ces personnages, les séries dystopiques produisent une forme alternative de débat public et se constituent en « arènes publiques fictionnelles ».
Néanmoins, si les séries mettent en garde contre des visions du monde associées à au basculement dystopique, elles ne proposent pas d’alternative permettant de régler les problèmes initiaux mis en récit. Les séries usent de la complexité narrative pour retranscrire la complexité des problèmes publics qu’elles abordent.
Comme l’affirme le chercheur en sciences politiques Yannick Rumpala à propos de la science-fiction, les séries dystopiques peuvent devenir des ressources cognitives pour « réinterpréter des problèmes et des situations, pour avancer des formes d’interrogations et explorer des propositions par un déplacement dans un monde différent, reconfiguré ».
Finalement, plus qu’une simple critique, les séries dystopiques peuvent être lues comme des invitations à engager une réflexion collective sur les problèmes mis en fiction, en laissant aux téléspectateurs la responsabilité d’éviter les catastrophes qu’elles décrivent et de réimaginer des futurs plus chantants que ceux à l’écran.
Marine Malet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
16.05.2024 à 18:30
Nouvelle-Calédonie : ces colères qui enflamment l’archipel
Nicole George, Associate Professor in Peace and Conflict Studies, The University of Queensland
Texte intégral (1675 mots)
Pour la troisième nuit consécutive, la Nouvelle-Calédonie a été le théâtre de violentes émeutes. Quatre personnes, dont un gendarme, sont décédées lors d’« affrontements très graves ». Un deuxième agent a trouvé la mort lors d’un tir accidentel jeudi 16 mai. Des milices, parfois armées, patrouillent dans certains quartiers pour surveiller les habitations et les commerces. Le gouvernement a annoncé le déploiement de militaires afin de « sécuriser » les ports et l’aéroport de l’archipel ultramarin. L’état d’urgence a été décrété depuis mercredi soir et l’utilisation du réseau social TikTok est restreinte.
Des manifestations pacifiques avaient eu lieu dans tout le pays ces dernières semaines, alors qu’approchait le vote de l’Assemblée nationale sur le projet de réforme constitutionnelle qui prévoit l’élargissement du corps électoral propre au scrutin provincial. Lundi soir, la crise s’est rapidement intensifiée, prenant les autorités locales par surprise.
Pour comprendre comment cette situation a pu dégénérer aussi rapidement, il est important d’exposer les enjeux politique et socio-économique complexes qui ont cours dans cette région.
À lire aussi : Référendum en Nouvelle-Calédonie : un rendez-vous manqué dans le processus de décolonisation
Un projet de réforme constitutionnelle contesté
La crise politique trouve d’abord sa source dans un projet de loi du gouvernement prévoyant une modification constitutionnelle qui étend le droit de vote aux Français qui vivent sur l’île depuis dix ans.
Cette décision, prise à Paris, ferait qu’environ 25 000 nouveaux électeurs pourraient prendre part aux scrutins particuliers qui concernent directement la Nouvelle-Calédonie. Cette réforme met en évidence le pouvoir politique que la France continue d’exercer sur le territoire.
Les changements annoncés ont semé la discorde parce qu’ils annulent des dispositions de l’Accord de Nouméa de 1998, en particulier la restriction des droits de vote. Cet accord visait à « rééquilibrer » les inégalités politiques afin que les intérêts des autochtones kanaks et des descendants des colons français soient reconnus de manière égale. Il a permis de consolider la paix entre ces groupes après une longue période de conflit dans les années 1980, connue localement sous le nom d’« événements ».
[Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]
Loyalistes et indépendantistes s’opposent
Un groupe loyaliste (le terme est utilisé pour désigner les anti-indépendantistes néo-calédoniens, les « loyalistes aux institutions républicaines françaises ») d’élus au Parlement de Nouvelle-Calédonie rejette la signification contemporaine du « rééquilibrage » en ce qui concerne le statut électoral des Kanaks. Selon eux, après trois référendums sur la question de l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie, organisés entre 2018 et 2021, qui ont tous abouti à un vote majoritairement négatif, le temps de la réforme électorale est largement dépassé.
Cette position est clairement exprimée par le député Nicolas Metzdorf. Loyaliste de premier plan, il a défini la révision constitutionnelle adoptée par l’Assemblée nationale comme « un vote pour la démocratie et l’universalisme ».
Ce point de vue est rejeté par les leaders indépendantistes kanaks, qui estiment que ces amendements portent atteinte au statut politique des autochtones kanaks, qui constituent une minorité de la population votante. Ces dirigeants refusent également d’admettre que le programme de décolonisation a été mené à son terme, comme l’affirment les loyalistes.
Ils contestent au contraire le résultat du référendum final de 2021 qui, selon eux, a été imposé au territoire par les autorités françaises trop tôt après la pandémie du Covid. Selon eux, l’organisation de ce vote n’a pas tenu compte du fait que les communautés kanakes ont été très durement touchées par la pandémie et n’ont pas été en mesure de se mobiliser pleinement avant le vote. Les demandes de report du référendum ont été rejetées et de nombreux Kanaks se sont abstenus en conséquence.
Dans ce contexte, les réformes électorales décidées à Paris cette semaine sont considérées par les camps indépendantistes comme une nouvelle prescription politique imposée au peuple kanak. Une figure de proue d’une organisation de femmes autochtones kanakes m’a décrit le vote comme une solution qui pousse « les Kanaks dans le caniveau », une solution qui les ferait « vivre à genoux ».
Le spectre des années 1980
De nombreux commentateurs politiques comparent la violence observée ces derniers jours à la violence politique des années 1980 qui a fait payer un lourd tribut au pays. Cette affirmation est cependant contestée par les femmes leaders locales avec lesquelles je discute et qui m’encouragent à analyser cette crise au-delà des seuls facteurs politiques.
Certaines dirigeantes rejettent l’idée que cette violence n’est que l’écho de griefs politiques passés. Elles soulignent les disparités de richesse très visibles dans le pays. Celles-ci alimentent le ressentiment et les profondes inégalités qui privent les jeunes kanaks d’opportunités et contribuent à leur colère.
Les femmes m’ont également fait part de leur inquiétude quant à l’imprévisibilité de la situation actuelle. Dans les années 1980, les campagnes violentes étaient coordonnées par les leaders kanaks, me disent-elles. Elles étaient organisées, contrôlées.
En revanche, aujourd’hui, il semblerait que les jeunes qui prennent les devants usent de la violence parce qu’ils estiment, frustrés, ne pas avoir « d’autres moyens » d’être reconnus.
Prendre en compte les inégalités sociales et économiques
Parmi certains exemples, celui d’une conférence de presse tenue mercredi 15 mai en fin de journée, par des leaders politiques indépendantistes kanaks. Ces derniers se sont faits l’écho de leurs adversaires politiques loyalistes en condamnant les violences et en lançant des appels au dialogue. Ils ont notamment appelé les « jeunes » impliqués dans les violences à respecter l’importance d’un processus politique et ont mis en garde contre une logique de vengeance.
Les femmes leaders de la société civile avec lesquelles je me suis entretenue ont émis de fortes réserves à l’égard de ce type de propos. Elles affirment que les dirigeants politiques de tous bords n’abordent pas les réalités auxquelles sont confrontés les jeunes Kanaks. Selon elles, si le dialogue reste centré sur les racines politiques du conflit et n’implique que les mêmes élites qui ont dominé le débat jusqu’à présent, peu de choses seront comprises et peu de choses seront résolues.
De même, ces critiques déplorent la réponse du gouvernement et de l’État français, principalement sécuritaire, fondée sur l’« ordre et le contrôle ». Elle contredit les appels au dialogue et laisse peu de place à une quelconque participation de la société civile.
Ces approches permettent d’étouffer les griefs, mais ne les résolvent pas. Les femmes leaders qui observent la situation actuelle sont angoissées et ont le cœur brisé pour leur pays et son peuple. Elles affirment que si la crise doit être résolue de manière durable, les solutions ne peuvent être imposées et les mots ne peuvent être vides.
Au contraire, leurs paroles demandent à être entendues et à contribuer à la résolution de la crise. En attendant, les habitants vivent dans l’anxiété et l’incertitude jusqu’à ce que les incendies se calment et que la fumée qui plane actuellement sur une Nouméa meurtrie se dissipe.
Nicole George ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
16.05.2024 à 18:30
Que nous dit le rejet des minorités de genre de notre société ?
Christophe Broqua, Socio-anthropologue, Institut des mondes africains (IMAF), Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Texte intégral (2944 mots)

Le 5 mai 2024, de nombreux rassemblements ont eu lieu en France « contre l’offensive anti-trans », montrant que la polarisation du débat public sur les questions de genre n’est pas ou plus, comme nous l’avons longtemps pensé, réservée à d’autres contextes nationaux, notamment américains.
En effet, au cours des années 1990, le spectacle des « culture wars » états-uniennes, consistant en des débats conflictuels souvent liés au genre ou à la sexualité, offrait aux observateurs français une forte impression d’exotisme. Il était alors difficile d’imaginer que de tels affrontements puissent se développer en France. Pourtant, nous y sommes.
Le temps des controverses
Depuis plusieurs années, divers acteurs et actrices du débat public – politiques, journalistes, éditorialistes et même chercheurs et chercheuses en sciences sociales –, s’emploient à fustiger une partie des minorités sociales et politiques en se focalisant sur des questions relatives au genre et à la sexualité : opposition au « mariage pour tous », à la procréation médicalement assistée, à la « théorie du genre », etc.
Alors que ces opposants aux combats pour l’avancée des droits reprochent à ceux-ci de s’inspirer des États-Unis, ils en importent eux-mêmes certaines causes emblématiques, en reprenant des cibles qui ont d’abord été définies outre-Atlantique, à commencer par la condamnation du « wokisme ».
Parmi les thèmes clivants qui agitent les forces conservatrices, celui de la diversité de genre occupe désormais le devant de la scène. La figure transgenre, qui incarne le passage possible d’un genre à l’autre, est devenue une sorte de bouc émissaire.

Plusieurs polémiques ont ainsi émaillé l’actualité ces dernières années : sur les enfants trans auxquels on permettrait trop facilement de changer de sexe, voire qu’on inciterait à cela, ou sur les hommes enceints ciblés par la communication du Planning familial. Des exemples qui participeraient de « l’idéologie transgenre ».
Sont spécialement blâmés celles et ceux désignés comme « transactivistes », vocable utilisé pour désigner les militants qui chercheraient à imposer leurs vues sur ces sujets, alors qu’il s’agit généralement de personnes déplorant simplement la stigmatisation, les discriminations et les violences.
La diversité de genre n’a rien de récent
De par sa nature et son ampleur, cette polarisation du débat public sur les minorités de genre est, dans l’histoire et à travers les cultures, un phénomène quelque peu singulier.
Les pourfendeurs des trans en parlent comme s’il s’agissait d’un fait nouveau et spécifique. Or, si l’on accepte de prendre un peu de recul, un constat différent s’impose : l’anthropologie nous enseigne qu’il a existé de longue date et qu’il existe encore aux quatre coins du monde des figures de la diversité de genre.
Au-delà de leur immense variété, ces figures montrent non pas que tout serait possible ou permis, mais que de nombreuses sociétés offrent des places socialement admises, voire valorisées, à des personnes qui ne se reconnaissent pas dans le genre qui leur a été assigné à la naissance, ou qui n’appartiennent exclusivement ni au pôle féminin ni au pôle masculin.
Leur existence n’a généralement pas pour effet d’invalider la binarité de genre – mais au contraire parfois de la conforter.
Elle indique cependant que la naturalité du genre ne va pas de soi et que ce sont plutôt les normes sociales entourant la réalité biologique qui prévalent. Pour ne donner qu’un exemple parlant, les mariages « entre femmes » documentés dans plusieurs pays d’Afrique au cours du XXe siècle reposaient sur l’attribution d’un rôle masculin à la femme-époux qui prenait alors en charge les enfants de son épouse.
Beaucoup d’autres exemples de ce type montrent à la fois la prégnance de la bicatégorisation de genre et la possibilité, selon les contextes, de passer d’un genre à l’autre ou de chevaucher le féminin et le masculin. Dans tous ces cas, les normes sociales priment sur le sexe biologique.
À lire aussi : Être gay en Guadeloupe : entre homophobie et préjugés raciaux
Sous l’offensive anti-trans, le « genrisme »
En France, l’hostilité croissante affichée contre la diversité de genre est le fait d’acteurs variés qu’il serait vain de chercher à regrouper sous un label unique. Il est toutefois nécessaire de comprendre et, pour cela, caractériser et donc qualifier ces manifestations hostiles.

La notion de transphobie est sans doute trop limitative, tandis que celle de LGBT-phobie est trop vague. Plutôt qu’une sectorisation ou qu’une mise en équivalence artificielle des formes de rejet, il peut être utile d’identifier leur principe organisateur : l’hostilité envers la non-conformation aux normes de genre dominantes, parfois nommée « genrisme ». Selon la géographe Kath Browne, celui-ci sanctionne les personnes qui transgressent la dichotomie sexuelle.
Le genrisme inclut toute position visant à considérer qu’il existe deux sexes bien distincts non seulement biologiquement mais aussi socialement, à leur associer des attributs et des rôles spécifiques et fixes – dont ceux relatifs aux attirances et pratiques sexuelles –, et à stigmatiser les écarts supposés à ces normes.
Les manifestations du genrisme
Le genrisme recouvre bien entendu les prises de position publiques et militantes qui se donnent pour objectif de « sauver la différence des sexes » (par exemple celles de « La manif pour tous » et ses dérivés). Mais il concerne aussi tous les comportements quotidiens impliquant la stigmatisation des individus non conformes.
En effet, le genrisme est à la fois une forme d’injonction (ou au minimum d’incitation) et un mécanisme d’exclusion/inclusion que l’on rencontre de manière très ordinaire, au travers d’incessants rappels à l’ordre, dès les plus jeunes années et même tout particulièrement à cette période.
À lire aussi : Visages de la transidentité dans le cinéma d’aujourd’hui
C’est par exemple le cas lorsqu’un enfant est interpellé en ces termes : « T’es un homme ou t’es pas un homme ? » Ou encore lorsqu’un politicien explique que le « côté androgyne maquillé » d’un chanteur de rock le dérangeait.
Ces normes s’imposent et s’acquièrent très tôt, le plus souvent sans que nous en ayons conscience. Mais l’injonction genriste revêt aussi des formes plus drastiques et radicales comme l’illustre la situation réservée aux personnes intersexes, auxquelles la médecine s’acharne à assigner précocement l’un ou l’autre sexe par la chirurgie. Or, si certains s’alarment de l’accompagnement médical des mineures trans, seules les associations de personnes concernées dénoncent les mutilations génitales que subissent les enfants intersexes.
Le genrisme touche tout le monde
Raisonner en termes de genrisme permet aussi de ne pas limiter la réflexion sur ce phénomène à la catégorie transgenre.
Le genrisme englobe et explique en grande partie l’homophobie puisque l’une des attentes normatives relatives au rôle de genre est l’attirance pour les personnes du sexe opposé. Les insultes homophobes ne désignent-elles pas, pour la plupart, le fait de ne pas être conforme au rôle de genre attendu, en particulier pour les hommes stigmatisés comme efféminés à travers des termes bien spécifiques : folle, tante, tapette, tarlouze, etc. ?
De ce point de vue, on constate une certaine aporie du vocabulaire opposant transgenre à son antonyme « cisgenre » (c’est-à-dire conforme au genre associé au sexe de naissance), qui a été créé après coup comme pendant de la catégorie « transgenre », à l’image du terme « hétérosexuel » qui avait été « inventé » après la catégorie « homosexuelle ». Cette opposition transgenre/cisgenre est réductrice car toutes les personnes non trans ne sont pas cisgenre, et toutes les personnes non cisgenre ne sont pas trans. Ce qui s’oppose à cisgenre est la non-conformité de genre, qui est précisément la cible du genrisme.
Notons de plus que le genrisme est présent et diffus dans toutes les sociétés, puisqu’aucune n’est exempte de normes de genre ni d’injonctions à s’y conformer.
Le « passing » pour éviter l’hostilité
L’expérience sociale des personnes trans est conditionnée par les effets que produisent l’adéquation ou l’écart entre le genre ressenti et le genre perçu par autrui. De là l’importance du « passing », par lequel on désigne l’aptitude à être considéré comme appartenant au genre ressenti, et donc à passer pour cisgenre. C’est à cette condition que les risques d’hostilité, de stigmatisation ou de violence peuvent être réduits.
Mais là encore, cette logique du « passing » ne concerne pas uniquement les personnes trans. Si l’on admet que le genre est une performance formalisée au travers de rôles socialement mis en scène, alors le « passing » consiste en sa meilleure exécution possible, y compris pour les personnes non trans. En d’autres termes, la majorité des femmes et des hommes cherchent à adopter ordinairement des comportements leur permettant d’être considérés comme tels.
Ce faisant, le « passing » concerne aussi l’orientation sexuelle, puisque se conformer aux rôles de genre socialement attendus permet d’éviter de passer pour homosexuel (par exemple en incorporant la démarche ou les gestes jugés appropriés). Chez beaucoup, cela n’est pas pensé, mais chez les personnes non conformes, dont la non-conformité sera souvent perçue comme la révélation de l’orientation sexuelle, c’est l’objet d’une conscience quasi ininterrompue en raison des fréquents rappels à l’ordre.
Ainsi, de même qu’il importe de penser au-delà de la dyade transgenre/cisgenre, il est nécessaire d’élargir nos conceptions de la notion de « passing », applicable à l’ensemble des comportements visant à se conformer aux rôles de genre attendus, qu’ils soient le fait de personnes trans ou non trans.
L’aspiration à la « liberté de genre »
À l’opposé du souhait de passer pour cisgenre (ou pour conforme aux normes dominantes), une partie des jeunes générations refuse la binarité de genre, en France comme dans d’autres pays européens ou américains. Au cours de la dernière décennie, des personnes de plus en plus nombreuses ont tenté d’échapper aux dilemmes du genrisme en rejetant explicitement l’injonction à la conformation de genre et en se définissant comme « non binaires » ou « agenre ».
Il ne s’agit pas nécessairement de contrer la logique de la transition, puisque certaines se définissent aussi comme « trans non binaires », mais plutôt d’échapper au carcan de la « différence des sexes » dont les rappels du caractère indépassable par ses défenseurs ne suffisent pas à enrayer ce phénomène. Ils l’alimentent même sans doute par réaction aux formes d’oppression qu’ils représentent, comme l’indiquent par exemple en France les rassemblements du 5 mai 2024 ou les réactions contre la proposition de loi visant à interdire toute transition médicale aux mineurs.
Au fond, si les tenants du genrisme le plus explicite et revendicatif s’arc-boutent aujourd’hui sur leurs positions, c’est qu’ils voient s’effriter son emprise au travers des expérimentations du quotidien auxquelles se livrent les personnes qui réclament l’autodétermination, celles qui refusent la binarité et qui prônent ou mettent en pratique la « liberté de genre ».
Christophe Broqua a reçu des financements de l'ANRS Maladies infectieuses émergentes.
16.05.2024 à 18:30
Réfugiés LGBT+ en France : un difficile accès à la protection internationale
Florent Chossière, Chercheur associé, Université Gustave Eiffel
Texte intégral (2312 mots)

La répression étatique des personnes LGBT+ s’accentue dans plusieurs pays du monde, comme le montrent les exemples récents du Ghana, de l’Irak, ou encore de la Russie.
Confrontées à un climat d’hostilité multiforme (condamnations juridiques, discriminations variées, réprobation sociale et isolement, agressions voire mises en danger de mort), certaines d’entre elles quittent leur pays dans l’espoir de se mettre en sécurité ailleurs. Une partie se rend notamment en Europe et y initie une demande d’asile au motif spécifique de persécutions ou craintes de persécutions en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre (OSIG).
En l’absence de statistiques officielles sur les motifs des demandes de protection, il est aujourd’hui extrêmement difficile d’estimer le nombre de personnes demandant l’asile OSIG. En 2011, un rapport proposait une estimation aux alentours de 10 000 demandes d’asile OSIG annuelles au sein de l’Union européenne.
En France, les rapports d’activité d’associations spécialisées peuvent donner des indications chiffrées, permettant de rendre compte de l’augmentation du nombre de ces demandes. Ainsi, alors que l’ARDHIS avait accompagné 79 nouveaux demandeurs d’asile OSIG en 2010, ce chiffre culmine à 821 en 2018. Toutefois ces données restent difficiles à mobiliser tant elles ne permettent pas de s’approcher d’une estimation globale : elles renseignent uniquement sur le nombre de personnes accompagnées par une association, n’incluant donc ni les personnes suivies par d’autres associations et surtout ni celles qui réalisent leur demande d’asile sans aucun suivi associatif quelconque.
De plus, ces chiffres dépendent également de la structure associative elle-même et des suivis qu’elle est en mesure de réaliser, la conduisant parfois à ne pas pouvoir proposer un suivi à des personnes qui la sollicitent. Ces données, même si elles offrent une vision sous-estimée de la réalité, rendent cependant bien compte de l’augmentation de cette demande d’asile au cours des dernières années.
Pourtant, alors que l’octroi du statut de réfugié par des pays européens à des minorités sexuelles et de genre persécutées peut renforcer la rhétorique de « l’ordre sexuel du monde », la migration vers un pays de l’Occident n’est en rien un synonyme intrinsèque de « libération » pour les exilés LGBT+.
L’enquête ethnographique que j’ai menée de février 2017 à février 2020 auprès de demandeurs d’asile au titre de l’orientation sexuelle ou identité de genre en région parisienne, dans le cadre d’une recherche doctorale, montre les difficultés pour accéder au statut de réfugié, en plus des nouvelles formes de marginalisations multiples éprouvées dans le pays d’arrivée.
« Je connaissais l’asile politique, pas l’asile pour les homos »
Le recours à une demande d’asile OSIG ne s’inscrit pas dans un processus linéaire. Pour celles et ceux qui arrivent en Europe, premier obstacle de taille à surmonter pour réussir à se mettre en sécurité dans un contexte global de durcissement des frontières et des politiques migratoires, se tourner vers cette procédure n’est en rien automatique.
Tout d’abord parce que certaines personnes ignorent qu’elles peuvent demander l’asile en raison de persécutions liées à l’OSIG, associant spontanément et uniquement la demande d’asile à la fuite de conflits ou à la répression politique.
Ainsi, alors que ce motif de demande d’asile est aujourd’hui stabilisé et bien cadré par les institutions, l’accès à l’information demeure discriminant dans l’obtention du statut de réfugié. Les personnes engagées dans des activités militantes dans leur pays, les personnes dotées d’un important capital culturel ou celles qui s’inscrivent dans des réseaux de connaissances transnationaux favorisant la circulation des informations sont les plus à même de connaître la possibilité de demander l’asile en tant que personne LGBT+ persécutée à leur arrivée en France, parfois même avant leur départ. D’autres en revanche ne sont pas informées de cette possibilité.
De plus, une fois l’information à disposition, plusieurs craintes subsistent. Pour celles et ceux qui n’ont pas eu d’autre choix que d’arriver irrégulièrement sur le territoire français, aucune voie légale ne s’étant offerte à elles et eux pour quitter leur pays ou devant le faire dans l’urgence, entamer une démarche administrative auprès des autorités françaises peut être source d’inquiétude.
En outre, en lien avec les expériences de LGBTphobies passées et parce que la France n’est pas toujours associée à un espace de protection et de liberté pour les minorités sexuelles et de genre (puisque certaines personnes n’ont par exemple pas connaissance des législations reconnaissant des droits aux personnes LGBT+ dans le pays), l’idée de devoir évoquer à une administration son homosexualité, bisexualité ou transidentité peut être inhibitrice. Adama [1], réfugié ivoirien revient sur ses réticences initiales à demander l’asile :
« J’ai hésité, j’ai plusieurs fois hésité. Parce que j’étais un peu réticent, j’ai eu peur parce que je connaissais pas le système, je sais pas si je partais le dire, peut-être parti expliquer à la préfecture, celui qui sera en face de moi va me chasser. Parce que je suis gay, parce qu’on est beaucoup repoussé quoi, rejeté. Donc avec le conseil de Fabrice [bénévole de l’ARDHIS], que je ne crains rien, j’y suis allé. »
Or, tous ces éléments qui retardent le dépôt d’une demande d’asile ne seront pas sans effet sur la procédure et le quotidien des requérants. Le dépôt d’une demande d’asile au-delà de 90 jours après l’arrivée en France, délai réduit par la loi asile et immigration de 2018, conduit en effet au placement en procédure accélérée par la préfecture, impliquant entre autres un traitement plus rapide de la demande d’asile et une possibilité de se voir refuser les conditions matérielles d’accueil (Allocation pour Demandeur d’Asile et proposition d’hébergement) par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
« Je suis lesbienne, Madame. Imagine, elle me croit pas ? » : la frontière de la crédibilité
Une fois la demande d’asile initiée, encore faut-il réussir à être reconnu réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ou par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en cas de recours formulé suite à un premier refus prononcé par l’OFPRA.
Lors d’entretiens avec les institutions, les demandeurs d’asile doivent convaincre du bienfondé de leur demande, mais aussi de la « véracité » de leur propos dans un contexte de suspicion généralisée à leur égard.
Dans le cas des demandes d’asile OSIG, c’est alors non seulement la crédibilité des risques de persécutions en cas de retour qui est en jeu, mais aussi la crédibilité de l’orientation sexuelle même des requérants ou de leur identité de genre.
Car si au cours de ces dernières années, les pratiques d’évaluation des demandes d’asile OSIG se sont formalisées pour parer à certaines dérives dans la façon d’"évaluer" l’OSIG, ces ajustements ont entériné le fait d’avoir à se prononcer sur la crédibilité de l’OSIG des requérants.
Interrogés sur les persécutions subies, mais aussi sur la prise de conscience de leur OSIG minoritaire, sur leurs relations de couples ou encore sur les précautions déployées pour dissimuler au quotidien leur OSIG, les requérants doivent fournir un récit de vie répondant à certaines normes permettant de paraître crédible comme personne LGBT+.
Cela passe tout d’abord par un mode d’énonciation du discours particulier transversal à l’ensemble des demandes d’asile, à savoir un récit cohérent, incarné, chronologiquement structuré et suffisamment détaillé pour attester de son « authenticité » : une modalité de discours qui ne va déjà pas de soi, qui plus est lorsqu’il s’agit d’aborder des sujets aussi intimes que l’OSIG, comme en témoigne Amir, originaire du Maroc.
« Tu sais parfois c’était compliqué pour moi, il y a des choses je sais même pas comment le dire en arabe. […] Du coup, la question sur la première fois que j’ai senti que je suis gay. Ben depuis que je suis né, j’ai jamais eu de relations avec des filles, j’ai eu que des relations avec des mecs. Et puis je sais pas, j’ai senti comme ça depuis que je suis enfant, à l’âge de 14 ou 15 ans. […] La question c’est comment savoir que je suis gay. Ben comment ? Tu veux que je ramène un mec et que je couche avec devant toi ou quoi ? J’essaye de dire tout ce que je sais par rapport à mon homosexualité, j’essaye de raconter tout ce qui restait dans ma mémoire depuis l’enfance, et les relations que j’ai passées avec les mecs. Et elle, elle était pas convaincue en fait. »
À cela s’ajoute une série de représentations des institutions à l’aune desquelles est considérée la « crédibilité » de l’OSIG des requérants. En 2020, une étude soutenue par le Défenseur des droits pointait la persistance des stéréotypes et des visions eurocentrées de l’homosexualité dans l’évaluation de ces demandes d’asile.
Par ailleurs, la lecture victimisante des réfugiés LGBT+ et essentialisante des pays d’origine conduit à une lecture appauvrie de la réalité qui restreint le registre de crédibilité. La tendance à attendre des récits de vie marqués par la souffrance ou le trouble à la découverte d’un « sentiment de différence » laisse peu de place pour d’autres formes de récits de soi.
De même, la récurrence de la thématique des « précautions » et des « prises de risque » montre le fragile équilibre sur lequel repose la crédibilité des requérants : d’un côté il leur est nécessaire de rapporter suffisamment d’expériences personnelles pour convaincre de la véracité de leur OSIG, de l’autre il leur faut en même temps en justifier les conditions de possibilité au sein d’un environnement appréhendé comme uniformément hostile et où il apparait alors peu probable qu’elles puissent avoir lieu.
Paradoxalement, être en mesure de produire un récit de soi qui permet de paraitre authentique et crédible nécessite alors dans la plupart des cas un travail de préparation du discours en amont et de recadrage des expériences personnelles.
De telles attentes normatives accroissent les inégalités entre les demandeurs d’asile qui n’ont pas tous accès à un accompagnement associatif leur offrant une telle préparation ou à des ressources et compétences personnelles leur garantissant une maîtrise de ce type de discours sur soi.
Et si le rejet de la demande d’asile a des implications administratives et matérielles directes, plaçant les déboutés en situation irrégulière sur le territoire français, il a aussi des conséquences psychologiques : le non-octroi d’une protection internationale et avec elle de la possibilité de rester en France peuvent être vécus comme une expérience ravivant les dénigrements précédemment expérimentés en tant que personne LGBT+.
Tous les prénoms dans cet article ont été modifiés.
Pour réaliser cette recherche doctorale, Florent Chossière a reçu un contrat doctoral financé par l’École Normale Supérieure de Lyon. Une partie de cette recherche a été réalisée sur la base d'une enquête ethnographique au sein de l'ARDHIS.
16.05.2024 à 18:30
Quelles stratégies pour les multinationales lorsque les contrôles fiscaux s’intensifient ?
Cinthia Valle Ruiz, Assistant Professor of Accounting and Tax, IÉSEG School of Management
Texte intégral (1433 mots)

En ces temps d’incertitude, de déficits et passée une vague d’inflation élevée, les gouvernements envisagent diverses politiques pour renforcer le contrôle fiscal des entreprises afin de prévenir la perte de recettes fiscales. Depuis des décennies, les multinationales ont notamment su diminuer leurs charges fiscales en transférant leurs bénéfices vers des pays à taux d’imposition faible ou nul : des paradis fiscaux. Des pays comme les Bermudes, sans impôt sur les sociétés, ou l’Irlande, avec un taux de 12,5 %, ont été des options très attrayantes. Dans l’Hexagone, le taux d’imposition sur les sociétés est, à titre de comparaison, de 25 % depuis 2022.
Le mécanisme peut être simple : exercer dans un pays à imposition plus élevée via une filiale, qui devra, par exemple, s’acquitter d’une facture envers une société mère située dans un « paradis fiscal » sous le motif d’utiliser un algorithme qu’elle détient. Si cet algorithme a peu d’équivalents sur le marché, il sera bien difficile pour les autorités fiscales d’estimer si fraude il y a, c’est-à-dire si le prix payé est bien plus élevé que ce qu’il devrait être.
Dans le cadre de l’OCDE, 140 pays ont signé la mise en place d’un taux d’imposition minimum pour les entreprises multinationales, à hauteur de 15 %. Si les bénéfices d’une société multinationale sont imposés en dessous du taux minimum dans un pays, d’autres nations auront le pouvoir d’imposer le delta. L’OCDE estime que la mesure augmentera les recettes fiscales mondiales annuelles d’un montant situé entre 155 et 192 milliards de dollars.
Ce dispositif, entré en vigueur cette année dans 55 juridictions, peut-il impliquer des changements dans les stratégies de transfert de revenus ? Une étude récente menée par Kenneth Klassen (Université de Waterloo) et moi-même tente de répondre à la question à partir de données provenant de filiales de multinationales de 21 pays européens. Elle met en exergue une conséquence non voulue au dispositif : des bilans souvent gonflés artificiellement.
Des objectifs à tenir
Les unités de mesures de performance financière telles que le bénéfice avant intérêts et impôts (BAII ou EBIT en anglais) sont fréquemment utilisées en interne par les multinationales pour évaluer les performances des gestionnaires de filiales. S’y mêlent néanmoins les stratégies internationales de planification fiscale des entreprises. Celles-ci complexifient l’établissement des objectifs et l’évaluation des résultats, jusqu’à parfois fausser les décisions opérationnelles au sein du groupe. Le gestionnaire d’un pays à faible imposition, grâce aux bénéfices transférés depuis des pays à forte imposition, peut ainsi afficher des résultats plus séduisants. À l’équilibre, les objectifs fixés par la maison mère semblent néanmoins en tenir compte.
Mais que se passe-t-il lorsqu’il y a un changement dans la stratégie de transfert de revenus ? Les sièges sociaux n’ont pas toujours une information à jour en la matière et ne révisent alors pas nécessairement leurs attentes envers chaque filiale.
Illustrons ceci avec un exemple. Considérons une multinationale dont le siège est en France, avec un taux d’imposition de 25 %, avec une filiale en Irlande où ce taux est de 12,5 %. Elle recherchera à transférer les bénéfices de la France vers l’Irlande. Au début de 2024, des objectifs et des paramètres d’incitation ont été établis par la maison mère pour les gestionnaires des filiales française et irlandaise à partir de données de 2023. Qu’arriverait-il si l’Irlande étendait la législation OCDE à toutes ses entreprises ou si, au cours de 2024, le gouvernement français resserrait ses réglementations sur le transfert de revenus ?
En réponse, le service fiscal de la multinationale peut réduire les revenus transférés de la France vers l’Irlande. Les bénéfices seraient en effet moindres et les risques de pénalités plus importants. Néanmoins, une fois que les objectifs au niveau des filiales sont approuvés, ils sont rarement modifiés. Le gestionnaire irlandais devrait alors atteindre les mêmes objectifs sans pouvoir compter sur autant de bénéfices transférés depuis la France. La tentation est grande alors pour lui de gonfler artificiellement ses résultats.
Des manipulations dans les faits
Dans notre récente étude, nous avons testé empiriquement ce scénario décrit ci-dessus. Nos résultats ont confirmé que lorsque les multinationales pratiquent le transfert de revenus entre les sites, les filiales dans les juridictions à faible taux d’imposition déclarent en moyenne des bénéfices plus élevés que celles situées dans des juridictions à taux d’imposition élevé. Ces ajustements fiscaux sont généralement pris en compte dans l’évaluation des gestionnaires de filiales par l’entreprise.
Lorsqu’un pays à taux d’imposition élevé resserre ses réglementations sur le transfert de revenus, il apparaît bien que les entreprises ajustent leurs stratégies fiscales et transfèrent moins de revenus vers les filiales à faible taux d’imposition. Et nous démontrons également que cet ajustement incite les filiales à faible taux d’imposition à gonfler stratégiquement leurs résultats pour atteindre leurs objectifs. Autrement dit, si le resserrement des réglementations sur le transfert de revenus atteint bien son objectif initial, à savoir limiter les transferts de revenus, il faut noter qu’il le fait avec des conséquences non intentionnelles : une augmentation de la manipulation des résultats par les pays perdant des revenus transférés.
[Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]
Or, ces trucages peuvent conduire à des investissements excessifs ou sous-optimaux, à une mauvaise répartition des ressources entre les différentes entités du groupe ou encore à un renforcement des asymétries d’informations entre gestionnaires et propriétaires. Notre étude souligne ainsi l’importance pour les auditeurs et la direction centrale de prendre en compte les pressions supplémentaires sur le rapport de performance financière lorsque la planification fiscale réduit significativement les bénéfices de certaines filiales.
Cinthia Valle Ruiz ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
16.05.2024 à 18:30
Géopolitique du sport : l’affrontement entre la Russie et l’Ukraine
Lukas Aubin, Docteur en Études slaves contemporaines : spécialiste de la géopolitique de la Russie et du sport, Université Paris Nanterre – Université Paris Lumières
Jean-Baptiste Guégan, Enseignant en géopolitique du sport, journaliste et consultant, Sciences Po
Texte intégral (2397 mots)
Lukas Aubin, directeur de recherche à l’IRIS, spécialiste de la géopolitique de la Russie et du sport et membre associé du Centre de Recherches Pluridisciplinaires Multilingues (CRPM) à l’université Paris-Nanterre, et Jean-Baptiste Guégan, expert en géopolitique du sport et enseignant à Sciences Po Paris, viennent de publier aux éditions Tallandier La Guerre du Sport, une nouvelle géopolitique, un ouvrage complet qui met en lumière l’influence des grands enjeux internationaux sur un un monde du sport à l’apolitisme de plus en plus illusoire. Nous vous en proposons ici quelques extraits consacrés à l’impact de l’invasion de l’Ukraine par la Russie sur l’univers sportif de ces deux pays… et au-delà.
L’impossible apolitisme du sport mondial face à la guerre en Ukraine
À la suite de l’invasion du 24 février 2022, des organismes tels que le CIO, l’UEFA et la Fifa appellent rapidement à l’exclusion de la Russie du monde du sport. En conséquence, le 5 mars, 37 nations dirigées par le Royaume-Uni signent une déclaration conjointe interdisant à la Russie et à la Biélorussie d’organiser ou de se voir attribuer des événements sportifs internationaux ou encore d’y soumissionner. Parmi les signataires, des pays principalement occidentaux tels que la France, l’Allemagne, l’Australie, les États-Unis et le Canada se positionnent en faveur de sanctions à l’encontre de la Russie. Cette déclaration est catégorique : « La guerre non provoquée et injustifiable de la Russie contre l’Ukraine, soutenue par le gouvernement biélorusse, est répugnante et constitue une violation flagrante de ses obligations internationales. » Ainsi, du point de vue sportif et diplomatique, la Russie se retrouve isolée.
[…]
La création d’un nouvel ordre mondial du sport ?
Dans les paroles et les actions, le pouvoir russe privilégie depuis le début de l’invasion la création d’un pôle sportif alternatif à l’échelle mondiale pour contrer les institutions sportives internationales traditionnelles telles que le CIO ou la Fifa.
En pratique, cela impliquerait de se passer du sport mondial, de le remplacer ou de rivaliser avec lui. En Russie, par exemple, l’idée de diviser le mouvement olympique gagne du terrain. Il s’agirait de séparer les Jeux en deux parties : à l’Ouest, les Jeux occidentaux, et à l’Est, les Jeux russes « traditionnels ». Ces Jeux à la russe se dérouleraient en été en Crimée et en hiver à Sotchi. Ils puiseraient leur légitimité dans les liens historiques plus ou moins confirmés de ces régions avec la Grèce antique. En 2007, pour obtenir les Jeux de Sotchi, Vladimir Poutine avait rappelé aux membres du CIO que « les Grecs anciens ont vécu près de Sotchi. J’ai vu le rocher près de Sotchi où, selon la légende, Prométhée était enchaîné. Prométhée qui a donné le feu aux hommes, le feu qui est finalement la flamme olympique ». Depuis, l’argument du mythe est souvent utilisé pour évoquer cette région russe, composée du Caucase et de la péninsule de Crimée. Selon Vladimir Poutine, ces terres sont sacrées et pourraient servir de cadre à un nouvel ordre mondial du sport.
Dans le cadre de ce scénario et pour rivaliser politiquement et sportivement avec succès avec le mouvement olympique, le pouvoir russe cherche déjà des alliés […]. L’objectif est de solliciter les pays membres de la CEI, de l’Organisation de coopération de Shanghai et les BRICS pour qu’ils participent à cette ambition. Ces trois organisations regroupent plusieurs acteurs majeurs du sport mondial, parmi lesquels la Chine occupe une place de choix. Si ce projet russe réussissait, il pourrait donner naissance à un nouvel ordre mondial du sport destiné à rivaliser avec les institutions historiques du sport moderne telles que le CIO ou la Fifa. Concomitante à une dynamique plus générale de désoccidentalisation du monde, cette influence dépasse très largement le cadre sportif.
Le sport ukrainien, c’est la guerre avec les balles
Depuis le 24 février 2022, pour Volodymyr Zelensky et l’Ukraine, le sport, c’est la guerre avec les balles. En effet, à l’heure du conflit russo-ukrainien, le domaine sportif en Ukraine a subi une transformation significative.
Initialement, au lendemain de l’invasion et sur une période de moins de deux mois, les autorités nationales ont suspendu l’ensemble des activités sportives en Ukraine. L’accent était alors mis sur l’effort de guerre, et les installations sportives ont été utilisées par les militaires ukrainiens comme bases de repli ou de déploiement. Cela explique pourquoi les installations sportives, telles que les stades ou les gymnases, sont souvent la cible des forces russes, car elles pourraient potentiellement abriter des unités ukrainiennes entières.
Par la suite, lorsque l’armée russe a commencé à faire du surplace voire à reculer sur le terrain, le secteur sportif ukrainien a pris une nouvelle orientation. Certains clubs de football ont obtenu la permission de jouer des matchs de charité à l’étranger, malgré la loi martiale interdisant aux hommes âgés de 18 à 60 ans de quitter le territoire. Ces matchs visaient à sensibiliser à la cause ukrainienne. De même, les athlètes en préparation pour d’importantes compétitions ont pu s’entraîner à l’étranger.
Par exemple, l’équipe nationale de football a été autorisée à s’entraîner en Slovénie pendant un mois en mai 2022 en vue des qualifications pour la Coupe du monde de football 2022 au Qatar. Ainsi, le soft power sportif a contribué symboliquement à l’effort de guerre. Les autorités estimaient qu’un athlète ukrainien était plus utile sur le terrain sportif que sur le front militaire. Selon elles, il offrait un double avantage en donnant à l’Ukraine une visibilité internationale et en pouvant potentiellement rehausser le moral des troupes déployées sur le terrain. Cette dimension ne doit pas être sous-estimée : une victoire sportive pour un athlète ukrainien procurait aux soldats, qui suivaient régulièrement les matchs et les résultats, un certain espoir et un regain de moral.
À partir de la mi-juin 2022, le sport à l’échelle nationale a progressivement retrouvé sa place, bien que dans des conditions exceptionnelles. Par exemple, la Première Ligue ukrainienne de football a obtenu l’autorisation de débuter la saison 2022-2023 fin août. Toutefois, les règles ont été adaptées à la situation du moment. Les spectateurs ne sont plus autorisés à assister aux matchs, et ceux-ci nécessitent une autorisation systématique de l’administration militaire pour avoir lieu. Si une alerte de raid aérien potentiel retentit dans un rayon de moins de 500 mètres, le match est interrompu et les joueurs se réfugient dans les vestiaires, ce qui se produit régulièrement. Après un an et demi de guerre, aucun footballeur ukrainien n’a été blessé. Cependant, certains matchs ont duré plus de cinq heures au total.
Paradoxalement, l’Ukraine continue de participer activement aux événements sportifs européens et mondiaux. Chaque compétition internationale offre l’opportunité aux autorités de promouvoir les intérêts du pays dans un contexte de guerre. De plus, certains clubs ukrainiens sont accueillis par les alliés géopolitiques les plus proches de l’Ukraine. Par exemple, le Dynamo Kyiv s’entraîne et joue certains de ses matchs à Cracovie, en Pologne. Dnipro, quant à lui, joue et s’entraîne à Košice, en Slovaquie, de manière permanente. En général, de nombreux athlètes et entraîneurs ukrainiens, actifs ou non, ont choisi de rejoindre le front dans l’est de l’Ukraine, mettant leur carrière en suspens. Le cas emblématique est peut-être celui de Yuriy Vernydub, entraîneur ukrainien du Sheriff Tiraspol, qui est parti au front dès le lendemain de l’invasion. Il est important de noter que ces professionnels du sport proviennent souvent de divisions sportives moins importantes. En effet, les athlètes de renom préfèrent généralement contribuer à l’effort de guerre d’un point de vue sportif et symbolique.
Le cas des supporters des clubs ukrainiens est également notable. Depuis 2014 et surtout depuis l’invasion russe en Ukraine, de nombreux ultras ont rejoint le front pour combattre ensemble, mettant de côté leur rivalité sportive. En temps de paix rivaux, les supporters du Shakhtar Donetsk et du Dynamo Kyiv combattent ensemble contre leur ennemi commun.
La stratégie politique et sportive de Volodymyr Zelensky après l’invasion russe
Depuis le 24 février 2022, la stratégie internationale de Volodymyr Zelensky s’est intensifiée dans le domaine sportif, trouvant écho dans l’espace médiatique mondial. Les ministères, les organisations privées et le comité olympique ukrainien, tous les organes politiques, économiques et sportifs du pays sont mobilisés pour transmettre un message : l’exclusion de la Russie doit durer tant que l’invasion se poursuit.
Le hashtag #boycottrussiansport en est devenu le symbole. De manière concrète, les arguments ukrainiens peuvent être résumés en cinq points. La Russie devrait être exclue des événements sportifs mondiaux et des Jeux olympiques de Paris 2024 car elle est un État envahisseur et terroriste ; les athlètes russes sont de quelque manière liés à l’État russe ou à l’armée russe ; le régime de Vladimir Poutine exploite le sport à des fins de propagande ; dans de telles conditions, l’équité des compétitions sportives (Jeux olympiques, Coupe du monde, etc.) ne peut être maintenue ; les athlètes ukrainiens perdent la vie au front ou ne peuvent pas s’entraîner convenablement pour les grandes compétitions internationales, par conséquent la Russie et la Biélorussie ne devraient pas être autorisés à y participer.
Pour diffuser ces arguments, le gouvernement ukrainien utilise divers canaux. Tout comme Volodymyr Zelensky utilise son smartphone pour communiquer avec différentes générations, les principaux porte-parole du sport ukrainien exploitent les canaux et les codes contemporains pour diffuser leur message. Les réseaux sociaux tels que TikTok, Facebook ou Instagram sont fréquemment utilisés pour diffuser des propos politiques liés au sport. On peut souvent voir circuler des vidéos de quelques secondes transmettant un message percutant. Par exemple, l’une de ces vidéos virales montre un athlète russe lançant un javelot dans les airs. Le javelot se transforme ensuite en obus, suit la trajectoire de l’athlète et finit par s’écraser sur un bâtiment ukrainien. Un message s’affiche alors à l’écran : « Boycott Russian Sport. »
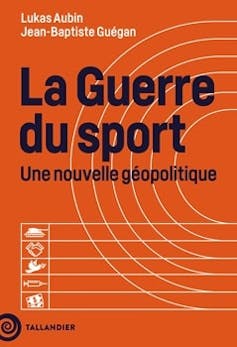
En général, tous les médias sont utilisés par l’Ukraine pour défendre ses intérêts. Par exemple, le site web du ministère ukrainien de la Jeunesse et des Sports est en ukrainien, mais une bannière en gras et en anglais apparaît en haut de la page, indiquant : « Russian and Belarusian athletes who support the war in Ukraine. » la bannière, les internautes ont accès à une liste d’athlètes russes et biélorusses soutenant officiellement l’invasion russe en Ukraine. Le compte Facebook du ministère suit la même approche, avec une bannière principale affichant à nouveau le hashtag #boycottrussiansport, cette fois-ci en lettres sanglantes.
Pour avoir un impact encore plus fort, le Comité des sports d’Ukraine (SKU), chargé de promouvoir le développement des sports non olympiques, a lancé le projet Angels of Sport via un site web recensant les athlètes et entraîneurs ukrainiens professionnels décédés au combat depuis le 24 février 2022.
Lukas Aubin est directeur de recherche à l'Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS).
Jean-Baptiste Guégan ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
16.05.2024 à 09:37
Le droit international protège les investissements dans les énergies fossiles, et c’est un problème
Sabrina Robert, Professeure de droit international public à l'Université de Nantes, membre associée à l'Institut de recherche en droit internationale et européen de la Sorbonne à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Texte intégral (3137 mots)

Peu connu du grand public, le Traité sur la charte de l’énergie (TCE) protège les investissements étrangers dans le domaine de l’énergie des pays signataires… mais sans distinguer les fossiles des renouvelables. Le résultat : des procès jugés à huis clos par des tribunaux d’arbitrage privés, où les industriels réclament des milliards aux États qui oseront mettre en place des politiques pro-renouvelables qui défavoriseraient leurs actifs.
Mais le vent a tourné. Le 9 avril 2024, les députés européens ont voté en faveur de la sortie de l’Union européenne et de ses États membres de ce traité que de plus en plus de personnes qualifient désormais de « climaticide ». Ils validaient ainsi la proposition de retrait coordonné faite quelques mois plus tôt par la Commission européenne.
Auparavant, cette dernière avait pourtant défendu le maintien du traité, dès lors que celui-ci pouvait être renégocié. Un texte de TCE modernisé, largement inspiré des propositions européennes, avait d’ailleurs abouti à l’été 2022. Mais le processus de renégociation a avorté en raison du retrait de plusieurs États membres, dont celui de la France annoncé en octobre 2022 – devenu effectif le 8 décembre 2023.
Dans les deux cas – renégociation du traité ou sa dénonciation – il s’agit de mettre un terme à une anomalie juridique : le TCE offre aux investissements étrangers dans les énergies fossiles une protection exorbitante, parfois proche d’un mécanisme d’assurance contre les risques climatiques. Il peut constituer un obstacle à la poursuite par les États de politiques environnementales ambitieuses.
Face à l’urgence climatique et aux engagements pris par les États dans le cadre de l’accord de Paris et des COP successives quant à la sortie progressive des énergies fossiles, la dénonciation de ce traité n’est que la manifestation d’une obligation de mise en cohérence du droit international.

Pour suivre au plus près les questions environnementales, retrouvez chaque jeudi notre newsletter thématique « Ici la Terre ». Abonnez-vous dès aujourd’hui.
Cette obligation ne concerne d’ailleurs pas uniquement le TCE. Il est devenu le symbole de l’incompatibilité entre les traités d’investissement et les enjeux climatiques parce qu’il porte précisément sur le domaine de l’énergie, et notamment les énergies fossiles. Mais en réalité, il existe à l’heure actuelle plus de 2200 autres traités du même type, susceptibles d’avoir les mêmes effets.
Il s’agit d’une anomalie juridique systémique du droit international. Les États ont l’obligation de la résoudre, en vertu d’un principe général de cohérence du droit international et de prévalence des enjeux climatiques. Pour y parvenir, plusieurs voies diplomatiques sont envisageables.
À lire aussi : À quoi servent les COP ? Une brève histoire de la négociation climatique
Le choc des traités internationaux
Le risque de contrariété entre le TCE et l’engagement des États de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète « nettement en dessous de 2 °C » (article 2 de l’Accord de Paris) a été pointé par le GIEC, le Rapporteur spécial de l’ONU sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable ou encore par le Rapporteur spécial de l’ONU sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte des changements climatiques.
Le TCE, traité signé en 1994 entre l’UE, ses États membres, des États d’Europe de l’Est et le Japon, peut en effet être mobilisé par des investisseurs étrangers, devant un tribunal arbitral spécial pour contester les conséquences de mesures prises dans le but de poursuivre les objectifs climatiques de l’accord de Paris : sortie de l’exploitation du charbon, refus de nouveaux permis d’exploitation d’hydrocarbures…
En cas de requête fructueuse, les investisseurs peuvent alors obtenir des montants d’indemnisation qui dépassent de loin ce qu’ils pourraient obtenir devant le juge interne. En parallèle, ce dernier peut également être saisi de requêtes d’investisseurs étrangers, mais sur le fondement du droit interne de l’État hôte, et dans le cadre des recours de droit commun, comme le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif français par exemple.

L’une des affaires les plus récentes a opposé l’entreprise britannique Rockhopper à l’Italie. Le tribunal a considéré que le refus d’exploiter de nouveaux gisements de pétrole dans la mer Adriatique, décidée par le gouvernement dans le but de préserver la biodiversité marine et de limiter l’exploitation des hydrocarbures, était une expropriation illicite pour laquelle l’investisseur avait droit à une indemnisation de 190 millions d’euros.
D’autres affaires comparables sont actuellement en cours de jugement devant les tribunaux arbitraux, sur le fondement du TCE ou d’autres traités d’investissement. Une étude récente estime que le coût total des dommages et intérêts décidés dans le cadre de tels arbitrages pourrait s’élever à 340 milliards de dollars américains, soit plus que les financements globaux dédiés à la lutte contre les changements climatiques pour 2020.
Si toutes n’aboutissent pas, ce contentieux peut avoir un effet dissuasif qui retarde d’autant l’adoption de mesures urgentes d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.
Résoudre une anomalie juridique
La contrariété entre les traités d’investissement et le droit international du climat apparaît d’autant plus intenable à l’aune des derniers engagements pris par les États lors de la COP 26 à Glasgow et de la COP 28 à Dubaï, qui mentionnent :
l’accélération des « efforts destinés à cesser progressivement de produite de l’électricité à partir de charbon sans dispositif d’atténuation » et l’engagement dans « une transition juste, ordonnée et équitable vers une sortie des combustibles fossiles dans les systèmes énergétiques ».
Si la portée juridique des décisions des COP n’est pas claire (les engagements qui y sont pris ne sont pas, en tant que tels, juridiquement opposables aux États), il n’en reste pas moins que les États ont, unanimement, reconnu la nécessité d’amorcer un changement profond du système énergétique mondial. Or, maintenir en vigueur des traités qui protègent les énergies fossiles est clairement incompatible avec cet objectif.
Face à cette anomalie juridique, une obligation de mise en cohérence des traités internationaux devrait être reconnue à la charge des États.
Cette obligation repose d’abord sur le principe général de bonne foi. Si le droit international attend d’un État qui a signé un traité – mais ne l’a pas encore ratifié – qu’il s’abstienne d’actes qui priveraient cet accord de son objet et de son but (article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités), sans aucun doute attend-il également d’un État qu’il ne maintienne aucun instrument international susceptible de compromettre la réalisation d’autres engagements internationaux de portée universelle et visant à répondre à une urgence unanimement reconnue. S’il en était autrement, quel serait le degré de sincérité et d’efficacité des engagements climatiques des États ?
Elle repose ensuite sur le principe d’équité, au cœur de la justice environnementale. Non seulement l’équité impose que le coût de la transition climatique soit supporté par les acteurs économiques, d’autant plus que le caractère insoutenable des activités dans le domaine des énergies fossiles est établi depuis longtemps. Mais cette équité exige également de protéger plus particulièrement les pays en développement, qui sont les plus exposés aux risques de contentieux climatiques devant les tribunaux d’investissement. Et cela alors même que le droit international du climat leur reconnaît le droit de bénéficier du soutien – notamment financier – des pays développés dans la mise en œuvre de leurs propres obligations climatiques.
À lire aussi : Justice climatique : ce nouveau front ouvert par les petits États insulaires à l’ONU
La difficile mise en cohérence climatique des traités d’investissement
Afin de satisfaire cette obligation de mise en cohérence, les États disposent de plusieurs options. La première est celle à laquelle s’est finalement ralliée l’UE au sujet du TCE : la dénonciation pure et simple. Toutefois, cette option est pavée d’incertitudes.
D’une part, la dénonciation du seul TCE ne suffit pas. Pour s’inscrire dans une posture parfaitement cohérente, l’UE devrait également demander aux États membres de dénoncer l’ensemble des autres traités d’investissement, de même facture que le TCE qui peuvent avoir les mêmes effets potentiels que celui-ci. La France, par exemple, est partie à 84 traités bilatéraux de ce type, avec des pays d’Afrique, d’Amérique du Sud ou encore d’Asie et d’Europe de l’Est.
L’UE et les États membres devraient aussi s’abstenir de soutenir de nouveaux traités qui reproduisent en grande partie le dispositif de protection juridique exceptionnelle pour les investissements fossiles. Or, de ce point de vue, on peut mentionner le CETA, qui a fait l’objet d’un vote négatif au Sénat français le mois dernier, mais qui continue d’être soutenu par le gouvernement. S’il devait entrer en vigueur, il aurait pour conséquence d’offrir aux investisseurs canadiens – y compris ceux dans les énergies fossiles – ce type de protection renforcée.
D’autre part, la dénonciation d’un traité d’investissement emporte avec lui l’activation systématique d’une clause de survie qui permet aux investisseurs de continuer à bénéficier de la protection conventionnelle, pendant une période qui peut aller de cinq à vingt ans. Pour le TCE, cette période est de vingt ans, ce qui signifie pour la France qu’elle pourra encore faire l’objet de plaintes d’investisseurs étrangers jusqu’au 8 décembre 2043.
Selon les spécialistes, il semble que la clause de survie puisse être neutralisée en cas de dénonciation par l’ensemble des parties au traité. Mais il est peu probable que la communauté internationale s’entende pour une solution si radicale.
La deuxième voie est celle de la renégociation. Elle était initialement privilégiée par l’UE au sujet du TCE. Celle-ci, avec le Royaume-Uni, était d’ailleurs parvenue à sortir les investissements fossiles du champ d’application du TCE modernisé. Toutefois, les autres parties contractantes ne l’avaient pas suivi. Dès lors, cette modification n’aurait eu qu’une portée limitée.
Un processus de renégociation des traités d’investissement de plus grande envergure, qui prendrait la forme d’un traité multilatéral modificateur, à l’image de la Convention BEPS négociée sous les auspices de l’OCDE en matière de fiscalité internationale, pourrait être imaginé.
L’objet pourrait être d’exclure les énergies fossiles du champ d’application matériel des traités, d’introduire des clauses de carve-out, qui permettraient aux États d’invoquer une exception climatique, ou même un veto climatique. Celui-ci empêcherait tout simplement les investisseurs d’attaquer les mesures étatiques prises en application du droit du climat devant un tribunal spécial.
De nouvelles voies de renégociation
En réalité, les propositions de renégociation ne manquent pas, ni dans la doctrine, ni dans les travaux des institutions internationales. Le plus difficile est de déterminer le modus operandi de cette renégociation.
La renégociation au cas par cas de chaque traité serait un processus trop long. L’adoption d’un moratoire multilatéral pourrait être plus efficace. Mais se pose alors la question du forum dans lequel cette renégociation pourrait avoir lieu. De nombreuses institutions économiques semblent être des candidates toutes désignées (Banque mondiale, CNUCED, OCDE…).
Mais l’hypothèse d’un « dépaysement » de la question qui pourrait être confiée à une instance non économique mérite aussi d’être examinée. Ici, l’inscription de la négociation de ce moratoire lors d’une prochaine COP sur le climat aurait tout son sens. Il s’agirait d’une étape forte dans la lutte contre les changements climatiques, qui viendrait attester que les engagements précédents des États au sujet des énergies fossiles ne sont pas de simples bouts de papier, mais des objectifs qu’ils entendent sincèrement et efficacement poursuivre.
Sabrina Robert ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
15.05.2024 à 17:45
Les amitiés d’enfance : une éducation sentimentale décryptée par la sociologie
Kevin Diter, Maître de conférences en sociologie, Université de Lille
Texte intégral (1935 mots)
« Qui se ressemble s’assemble », dit le proverbe. En matière d’amitiés enfantines, la règle se vérifie : c’est avec des camarades de même âge, de même sexe et partageant les mêmes activités que les enfants sympathisent en priorité. Mais comment ces codes sociaux se mettent-ils en place ? Comment les enfants les racontent-ils et de quelle manière les adultes y contribuent-ils ?
Auteur d’une thèse sur « L’enfance des sentiments », Kevin Diter a passé près de mille heures à observer les dynamiques des cours de récréation et à écouter filles et garçons évoquer leurs perceptions de l’amitié et de l’amour. Retour sur ses résultats de recherche.
Dans vos travaux, vous expliquez que l’amitié est au cœur de la vie des enfants. Quelle définition en donnent-ils ?
Kevin Diter : De manière générale, les amis, aux yeux des enfants, ce sont les personnes avec qui ils s’entendent le mieux et partagent le plus d’activités, ceux avec qui ils ont la plus grande proximité. Par rapport à l’amour, l’amitié, selon eux, concerne principalement des enfants de même sexe. Au-delà de ces conditions – être du même sexe donc, du même âge également et avoir des centres d’intérêt communs – il faut qu’il y ait réciprocité.
Comme je le racontais dans un article de la revue Genèses sur les « vrais copains », les garçons qui ne soutiennent pas leurs amis lors d’un jeu de foot, par exemple, vont vite se faire rappeler à l’ordre. Si on est meilleurs copains, on pense la même chose, on s’épaule quoi qu’il en soit. Chez les filles, j’ai constaté des ruptures d’amitié dans le cas où certaines partageaient leurs secrets et pas les autres.
Avoir des copains, c’est important en général parce que l’enfance, pour eux, c’est fait pour s’amuser et on ne s’amuse que lorsqu’on est entouré de gens avec qui jouer, rigoler, partager justement ces mêmes activités qui font devenir amis. Les plus grosses crises de pleurs que j’ai pu voir dans les cours de récréation, en dehors de situations où ils s’étaient fait mal, c’est quand ils se sont entendu dire « tu n’es plus mon ami », « j’te cause plus ». Il y a un élève de CM2 qui m’avait même dit « sans ami, la vie est finie ».
L’amitié a-t-elle la même place dans la vie des filles et dans celle des garçons ?
K.D. : Les filles comme les garçons accordent une grande importance à l’amitié. Mais leurs pratiques sont différentes. Pour reprendre les observations de la sociologue américaine Karen Walker, on dirait plutôt que les amitiés des garçons se construisent côte à côte : ils jouent ensemble, ils font la même chose. Et les amitiés des filles seraient plus en face-à-face, reposant sur des échanges, des histoires, des partages de secrets – des situations où le langage est plus central.
Comment se disent-elles, ces amitiés, dans le vocabulaire et les attitudes des enfants ?
K.D. : Être amis, c’est rester ensemble, faire tout le temps les mêmes choses, être d’accord. On se le montre, on se le dit. Il y a quelque chose de très performatif dans l’amitié. Certaines filles vont s’offrir des cœurs sur lesquels il est inscrit « BFF » (« Best friend forever »). Les enfants parlent de « meilleurs amis » mais aussi de « vrais amis », sans craindre les superlatifs, du type « la meilleure des meilleures amies ».
Comme chez les adultes, qui vont distinguer connaissances et amis, la hiérarchisation est très forte en matière d’amitié chez les enfants. Plus de 70 % d’enfants de l’école primaire enquêtée affirment que c’est différent d’être copain et copine avec un enfant que d’être son meilleur ami ou sa meilleure amie. Plus de 90 % utilisent au moins un critère pour différencier les relations nouées avec le meilleur copain ou la meilleure copine et celles nouées avec les copains ou les copines.
À lire aussi : Comment les enfants choisissent-ils leurs amis ?
La base, c’est de partager des activités. Les copains, ce sont ceux avec qui on a plaisir à jouer comme ça, les amis, ceux avec qui on partage des goûts, avec qui on reste longtemps, voire tout le temps. Et dans le cas des meilleurs amis, en plus du partage d’activité, il y a réciprocité dans les échanges et le soutien doit être important.
Comment les enfants tracent-ils la ligne de partage entre amour et amitié ?
K.D. : Le premier critère, c’est le sexe de l’enfant qui est en face d’eux. Deux enfants du même sexe qui jouent ensemble seront qualifiés d’amis. Quand des enfants de sexes différents sont en tête à tête, ils vont vite être requalifiés d’amoureux par les autres enfants et par les adultes.
Le deuxième point, ce sont les pratiques. Le script amoureux enfantin passe par se donner la main, se faire des câlins. Comme les adultes leur ont dit combien l’amour comptait dans la vie, ils savent que, même si les amitiés peuvent être fortes, l’amour sera plus tard pour eux le sentiment le plus important. Ils le rattachent au monde adulte et plutôt aux figures féminines.
Quels sont les lieux de l’amitié ? L’école en est-elle l’ancrage central ?
K.D. : C’est à l’école que les enfants passent le plus de temps donc c’est là que se nouent la plupart de leurs amitiés. Cependant, le fait d’être de « meilleurs amis » se caractérise aussi par le fait de se voir à l’extérieur, notamment chez les uns et chez les autres.
Chose surprenante : quand les enfants sont chez eux, à l’abri des regards, qu’ils rencontrent par exemple les fils et filles d’amis de leurs parents, et qu’ils sont un peu plus laissés en autonomie, il peut y avoir quelques transgressions des normes, avec des amitiés entre garçons et filles, entre enfants d’âges différents. Mais de retour dans la cour de l’école, ils se parleront très peu, ça ne se fait pas d’aller « avec les bébés », diront-ils notamment.
Que dire des espaces de loisir comme les colonies de vacances ?
K.D. : Je n’ai pas enquêté sur le terrain des colonies de vacances, je ne dispose à ce sujet que de la parole des enfants. D’après ce que les filles m’ont dit, c’est un espace où elles avaient eu des amoureux d’un âge différent, de quelques années plus vieux en général, parfois plus jeunes. La contrainte des pairs serait moins forte qu’au sein de l’école où les enfants s’observent toutes et tous. Cependant, comme l’a montré Pauline Clech, la colonie de vacances est une institution enveloppante et peut reproduire les mêmes répartitions d’âge et de genre que dans cadre scolaire.
Dans quelle mesure les parents influencent-ils les amitiés des enfants ?
K.D. : Les parents peuvent faciliter des amitiés par des invitations.
Julie Pagis et Wilfried Lignier ont aussi montré comment les parents pouvaient limiter et contraindre les amitiés en disant directement à l’enfant « il ne faut pas traîner avec cette personne », « lui, il ne fait que des bêtises », etc.
Mais l’influence des parents peut aussi passer par ce que Julie Pagis et Wilfried Lignier ont appelé dans L’enfance de l’ordre le « recyclage symbolique des injonctions et des évaluations des adultes ». Les enfants vont se réapproprier les mots utilisés par les adultes pour juger leurs camarades. Un enfant m’a dit par exemple à propos d’un camarade : « quand il écrit trop gros, c’est nul ».
Dans une enquête, j’ai demandé aux participants en fonction de quels critères un autre enfant était leur meilleur ami. Je leur avais soumis une liste d’une douzaine de qualificatifs – poli, honnête, fort en classe, beau, belle, fort en sport, etc. – tirés de précédents échanges. Ce qui était intéressant, c’était de voir à quel point la logique scolaire comptait dans leurs choix, au-delà des logiques relationnelle, esthétique ou morale, notamment chez les plus petits, en classes de CP-CE1.
Le poids des adultes en général est important dans la mesure où ils peuvent donner de la « valeur » aux enfants. Le cas de cet élève arrivé en CM2 dans l’école est instructif. Il avait beaucoup de mal à se faire des amis car l’école était relativement petite et les enfants se connaissaient quasiment tous depuis la maternelle. Un jour ont été organisés des jeux olympiques internes à l’école et là, cet élève a dépassé toutes les performances. Dès le lendemain, il avait toute une foule de copains, il avait des amoureuses. La valorisation de la part des animateurs et les louanges des adultes en général le rendaient socialement désirable.
Qu’est-ce qui vous a le plus étonné dans ce monde d’enfants ?
K.D. : Ils ont un sens social très développé, c’est ce qui est le plus impressionnant d’un point de vue d’adultes. Certes, ils vont encore demander des conseils, certains venaient parfois me voir pour m’interroger : « est-ce que je dois me vexer quand on me dit ça ? » Mais tout en étant encore en phase d’apprentissage, ils ont déjà une connaissance très fine des règles du monde social et de ses hiérarchies.
Propos recueillis par Aurélie Djavadi
Kevin Diter a reçu des financements de la CNAF et du ministère de la Culture dans le cadre de deux projets de recherche, l'un consacré à l'apprentissage des émotions à la crèche, l'autre consacré aux sentiments de justice et d'injustice chez les enfants.
15.05.2024 à 17:45
Parasols géants et blanchiment du ciel : de fausses bonnes idées pour le climat
Emmanuelle Rio, Enseignante-chercheuse, Université Paris-Saclay
François Graner, Directeur de recherche CNRS, Université Paris Cité
Roland Lehoucq, Chercheur en astrophysique, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)
Texte intégral (2170 mots)

L’inquiétude quant au changement climatique grandit et fait malheureusement naître des projets aussi grandioses qu’alarmants. La géoingénierie, c’est-à-dire les interventions à l’échelle de la planète entière grâce à la technologie, s’avère fertile en idées mais malgré tout controversée.
Si la Terre se réchauffe, c’est qu’elle reçoit plus d’énergie du Soleil qu’elle n’en émet vers l’espace : on dit qu’elle n’est plus à « l’équilibre radiatif ». D’après le GIEC, cette situation est sans aucun doute possible la conséquence de l’accumulation dans l’atmosphère des gaz à effet de serre émis par l’humanité depuis le début de l’ère industrielle.
Pour réduire le déséquilibre énergétique du système Terre, nommé forçage radiatif, la géoingénierie propose, par exemple, de limiter le rayonnement solaire frappant la Terre ou d’en renvoyer plus vers l’espace. Il serait possible, entre autres, de déployer des parasols spatiaux ou d’injecter massivement dans la stratosphère un aérosol diffusant la lumière solaire : du dioxyde de soufre. Ces propositions ont-elles quelque pertinence ?
Pour répondre à cette question, appliquons à ces deux projets une grille d’analyse générale d’une grande efficacité. D’une part, ces techniques respectent-elles les principes de la physique ? Si oui, sait-on en réaliser un prototype ? Et en ce cas, sont-elles industrialisables et implantables à grande échelle en vue d’un impact réel ? Autrement dit : sont-elles faisables concrètement ?
D’autre part, verrons-nous un gain en termes de matière, d’énergie, d’environnement, y compris en considérant un éventuel effet rebond ? Rendront-elles les humains plus autonomes ou généreront-elles inégalités et effets pervers contre certaines populations ? Permettront-elles d’éviter pollutions, nuisances et déchets, à court et à long terme ? En bref, auraient-elles des retombées bénéfiques ?
Parasols spatiaux : faire de l’ombre à la Terre
Une première proposition consisterait à interposer entre le Soleil et la Terre une sorte de parasol réduisant le rayonnement solaire frappant notre planète. Sur le papier, c’est simple et cela respecte les principes physiques connus : des exemples de petite taille sont couramment utilisés pour limiter l’échauffement des satellites, dont le fameux télescope spatial James Webb. Le déploiement d’une grande structure réfléchissante a déjà été réussi par le projet russe Znamia, développé dans un autre but dans les années 1990.
Le problème arrive avec l’industrialisation. Pour que des parasols spatiaux aient un impact significatif, il faudrait qu’ils aient une aire totale gigantesque. Les coûts et les ressources nécessaires pour atteindre un effet suffisant deviendraient donc, eux aussi, démesurés. Afin de réduire ces coûts, la Planetary Sunshade Foundation (PSF) propose de placer un seul parasol spatial à 1,5 million de kilomètres de la Terre en direction du Soleil, à l’endroit appelé point de Lagrange L1. PSF estime ainsi pouvoir réduire le flux solaire d’environ 1 % pour un parasol de 650 kilomètres de rayon. Ce chiffre paraît petit, mais il est très important : cela compenserait cinq fois le déséquilibre radiatif provoqué par la totalité des gaz à effet de serre émis par l’humanité depuis le début de l’époque industrielle.
Un prototype difficile à industrialiser
Des chercheurs suédois estiment que le coût d’une telle opération pourrait être compris entre 5 000 et 10 000 milliards de dollars… ce qui serait concevable s’il fallait absolument en passer par là pour sauver la vie humaine sur la planète. Mais d’où vient ce chiffre ? C’est qu’il faut envoyer, dans la version minimale du projet, 34 millions de tonnes de miroirs dans l’espace. Or, depuis les débuts de l’ère spatiale, l’humanité n’a envoyé dans l’espace que 16 500 tonnes de matériel. En outre, même Starship, le lanceur super-lourd de SpaceX encore en développement, ne pourra envoyer que 100 tonnes à la fois. Il faudrait donc 340 000 lancements de cette fusée pour y parvenir !
Enfin, ce parasol aurait d’autres inconvénients majeurs : sa mise en place utilisera une quantité gigantesque de matières et d’énergie, dont l’extraction et l’usage aggraveraient le réchauffement qu’il vise à diminuer. Surtout, il provoquerait la réaction connue qui annule les gains positifs d’une solution technique : l’effet rebond. En effet, si on croyait avoir évité le réchauffement climatique, cela risquerait d’entraîner un relâchement des efforts (déjà trop faibles) de réductions d’émission de gaz à effet de serre. Or, si la croissance économique perdure, et l’augmentation exponentielle des émissions de gaz à effet de serre avec, aucun progrès n’aura été accompli.
Le dioxyde de soufre : une solution efficace sur le papier
Quant à la seconde proposition, qui consiste à envoyer du dioxyde de soufre (SO₂) dans la haute atmosphère, on sait depuis longtemps que son principe physique est valable : cela peut effectivement provoquer un refroidissement global. En effet, les aérosols soufrés diffusent la lumière du soleil et agissent comme des noyaux de condensation de nuages, les rendant plus fréquents et plus durables. C’est pour cette raison que l’éruption du volcan philippin Pinatubo, en 1991, produisit un refroidissement significatif à l’échelle mondiale : en 1992-1993, on estime la diminution de la température moyenne au sol entre 0,5 et 0,6 °C dans l’hémisphère nord et 0,4 °C sur l’ensemble du globe.
Et le prototype est faisable… presque trop facilement. Sans demander l’autorisation à qui que ce soit, la start-up états-unienne Make Sunsets a testé l’envoi de particules soufrées dans la stratosphère depuis le sol mexicain. S’appuyant sur cette démonstration, elle propose aux entreprises émettrices de carbone de compenser leurs émissions, moyennant finances. Le Mexique a vigoureusement réagi, mais la start-up existe toujours. Ce scénario est le sujet du roman de science-fiction Choc terminal, de Neal Stephenson.
De plus, il est faisable d’émettre du soufre à grande échelle. L’activité humaine a déjà entraîné l’émission de quantités de SO₂ suffisantes pour induire un effet significatif et masquer une partie du réchauffement climatique en cours. Le GIEC a même calculé le refroidissement entraîné par les émissions d’aérosols. C’est justement l’efficacité de cet effet que mettent en avant les marchands de droits d’émission.
Pluies acides, impacts climatiques, ciel blanc… Pourquoi jouer aux apprentis sorciers ?
Le bât blesse sur les bénéfices attendus à long terme, là aussi à cause de l’effet rebond. En outre, compenser les émissions de CO2 (et d’autres gaz à effet de serre) par des émissions de SO2 n’arrête pas les premières. En traitant les symptômes mais pas la cause, on se condamne à envoyer en permanence du SO2 dans la stratosphère. En infligeant aux générations futures cette tâche digne des Danaïdes, condamnées à remplir sans fin un tonneau troué, nous amputons définitivement leur autonomie.
Par ailleurs, l’impact sur les climats régionaux d’une action à si grande échelle est aussi difficile à anticiper que celui du réchauffement climatique. Par exemple, les rendements agricoles pourraient s’effondrer, ou les pluies disparaître.
Surtout, le dioxyde de soufre provoque des pluies acides qui détruisent des forêts, et n’est pas bon à respirer : la qualité de l’air dépend entre autres de sa teneur en particules de SO2. La réduction de ces émissions fait à juste titre l’objet de politiques publiques. Depuis 2020, les émissions de SO2 du transport maritime international ont diminué d’environ 80 % grâce aux nouvelles réglementations de l’Organisation maritime internationale. Celles de la France ont suivi la même voie bénéfique pour la santé publique.
Autre conséquence, esthétique et tragique : des aérosols soufrés en suspension dans l’atmosphère diffuseraient la lumière du soleil dans tous les sens. La couleur du ciel s’en trouverait changée, passant du bleu au blanc. Bien que faisable technologiquement, cette solution est donc rejetée par notre grille d’analyse, car elle engendre de nouvelles nuisances et pollutions.
Quelle conclusion ?
Notre grille d’analyse des « fausses bonnes idées » s’applique non seulement aux technologies de modification du rayonnement solaire, mais à toutes les technologies. Renvoyer le rayonnement solaire, déclencher la pluie en semant des particules dans les nuages, capturer ou stocker du carbone, modifier génétiquement des plantes, ou encore déposer sur les glaciers des couvertures réfléchissantes (comme l’a déjà fait la Suisse pour un coût exorbitant) : tout ceci doit être passé au crible de cette grille. Le technosolutionnisme, c’est-à-dire la croyance que la technologie nous sauvera des dégâts de la technologie, peut mettre en péril l’ensemble du monde vivant, humanité incluse. Elle doit être remplacée par une analyse rationnelle qui mène à l’interdiction de ces jeux d’apprentis sorciers qui ne survivent pas à l’analyse. Remplaçons l’illusoire croissance « verte » par une voie compatible avec les contraintes physiques : celle de la décroissance.
Cet article a bénéficié de discussions avec François Briens (économiste et ingénieur en systèmes énergétiques), Jean-Manuel Traimond (auteur et conférencier) et Aurélien Ficot (épicier-libraire).
Emmanuelle Rio a reçu des financements de l'ANR.
François Graner est membre des « Amis de la Décroissance » et candidat aux élections européennes sur la liste « Pacifisme et décroissance ».
Roland Lehoucq ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
15.05.2024 à 17:45
Récit d’un voyage d’études au Rwanda, 30 ans après le génocide des Tutsi
Fabien Théofilakis, Maître de conférences, histoire contemporaine, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Texte intégral (4127 mots)

SUR LE TERRAIN
En juillet 2023, l’historien Fabien Theofilakis (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) est parti pour un voyage d’études avec ses étudiants de Master de Paris 1 et de la Europa-Universität Viadrina en Allemagne. Pendant deux semestres, il a travaillé avec eux sur le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994, dans une approche comparative avec la génocide des Juifs en Europe lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce voyage a bouleversé les étudiants et leur enseignant. Il a donné lieu à un blog et à une exposition itinérante, leurs ressentis et leurs apprentissages, constituant ainsi un nouvel espace de réflexion et de mémoire. Il nous livre ici, avec Inès de Falco, l’une des étudiantes du Master, le récit d’un voyage qui a confronté le groupe à la question de la violence extrême, de l’empathie, de l’altérité et de la façon dont on pouvait partager et rendre compte, en humains et en historiens, d’une expérience aussi marquante.
Attention, cet article contient des descriptions de violences qui peuvent choquer les plus sensibles.
Nous entrons dans une grande hutte plutôt faite de planches de bois avec un sol en béton. La pièce est quasiment vide et nous contient tous, à peine. Le guide nous explique qu’il s’agissait du lieu où l’on préparait les repas, puisque les réfugiés tutsi, pensant retourner chez eux, avaient apporté des ustensiles. Et là, nous dit-il, en faisant signe au groupe de s’écarter afin de montrer, dans l’un des coins de la pièce, une grande tache que nous regardons dans un silence respectueux. Et là, nous dit-il, de sa voix posée qui nous accompagne depuis le début de la visite, c’est une tache de sang, du sang des femmes tutsi enceintes que les Hutus éventraient vivantes pour en extraire les fœtus qu’ils éclataient contre le mur.
Nous sommes au Ntarama Genocide Memorial. Nous sommes le 12 juillet 2023, le lendemain de notre arrivée.
Je suis au Rwanda près de 30 ans après le génocide avec 18 étudiants de Master 1 et 2, issus, à parts égales, des universités de Paris 1 Panthéon Sorbonne et de la Europa-Universität Viadrina en Allemagne, où j’enseigne alors comme professeur invité.
Nous avons beau avoir travaillé sur le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994 deux semestres durant dans une approche comparative avec le génocide des Juifs en Europe lors de la Seconde Guerre mondiale, quelque chose nous saisit qui nous transforme, lentement ou brusquement, quelque chose qui à la fois va anesthésier et aiguiser nos émotions et réflexions, quelque chose de l’ordre d’un processus qui se déploie tout au long des 10 jours que nous avons passés à visiter, entre les 10 et 20 juillet 2023, une dizaine de mémoriaux nationaux.
Des salles de séminaire en Europe aux lieux de massacre au Rwanda, nous passons des traces de la violence à la violence des traces. Comment y réagit-on en tant que chercheur ou étudiant ? En tant qu’Occidental dont la mémoire culturelle est dominée par le paradigme de la Shoah ?

Appréhender la violence génocidaire par le terrain
L’église de Ntamara, les collines de Bisesero, l’école technique de Murambi : que visitons-nous quand, fraîchement débarqués de l’aéroport de Kigali, nous suivons nos guides dans ces lieux qui furent le lieu de l’assassinat de Tutsi – femmes, enfants, personnes âgées – qui se comptent toujours en milliers, voire en dizaines de milliers ? Assurément, une confirmation des nombreuses lectures et discussions en séminaire, qui viendrait comme nous rassurer en offrant une mise à distance de l’immédiateté si déstabilisante des traces ? Peut-être aussi, sur le mode de l’ambivalence, l’expectation de cette horreur indicible tant décrite par les témoignages analysés en Europe.
Très vite, il s’avère toutefois que la confrontation avec cette violence génocidaire qui, en cent jours (du 7 avril à mi-juillet 1994), a tué un million de personnes – 10 000 par jour – fait naître une autre réaction qui questionne notre référentiel mémoriel et introduit un autre rapport aux traces du génocide.

Le Kigali Genocide Memorial qui ouvrait notre programme a proposé une entrée en matière presque trompeuse tant son architecture reproduit celle de Yad Vashem à Jérusalem (les deux ont d’ailleurs été conçus par le même organisme, AEGIS Trust).
C’est aussi quasiment le seul à proposer des cartels en anglais, permettant une visite individuelle. Mais, une fois quitté ce musée-mémorial, passage quasi obligé au Rwanda pour le touriste occidental un peu curieux, les habits ensanglantés de Ntarama exposés sur les bancs de l’église, les machettes qui ont servi, au couvent de Nyarubuye, à « travailler » (comprendre découper) les réfugiés, les crânes colorés par la terre dans laquelle ils ont été ensevelis, qui remplissent des salles à Bisesero, et ces ossements – ces crânes, ces fémurs, ces bassins – que nous retrouvons, en séries, dans chacun des lieux, rendent la compréhension par rapprochement au connu impossible.
Les débriefings – exercice de libre parole à la fois, semble-t-il, attendu et appréhendé par les étudiants – qui concluent chaque journée me font prendre conscience combien notre façon de voir qui est aussi une façon de percevoir et de concevoir suscite une attente prédéterminée – donc réductrice – de ce que doit être une exposition de la violence et de sa compréhension. Pour lever l’écran que constitue notre point de vue et en faire un point de comparaison heuristique, il est nécessaire de mettre à distance ce référentiel hérité de nos cultures mémorielles nationales.
Les visites, mais surtout les discussions (in) formelles après avec les étudiants comme celles des étudiants entre eux nourrissent une opération de dévoilement intellectuel salutaire de notre européanité. « Tu n’as rien vu au Rwanda ! » si nous cherchons à visiter ces mémoriaux comme nous aurions visité le mémorial de l’Internement et de la Déportation de Compiègne ou celui des Juifs assassinés à Berlin. In situ, les traces nous font ressortir les spécificités de ce génocide des voisins dans lequel 60 % des victimes ont été tuées sur leur colline par des personnes de leur interconnaissance comme elles rendent visible dans le paysage l’omniprésence des lieux de tueries.
Une expérience éprouvante
En nous exposant, la confrontation avec la violence génocidaire nous a tous poussés à nous dévoiler. À un moment ou un autre du séjour, nul d’entre nous n’a pu faire l’économie de s’interroger pour savoir ce qu’a provoqué cette exposition à la violence et en quoi elle a influencé ses catégories et capacités d’analyse.
Cette expérience, Inès de Falco – en deuxième année de Master recherche en Histoire à Paris 1 – l’a faite quand elle visite le mémorial de Murambi, le sixième jour : ce matin-là, dit-elle :
« Je me lève et me dis que je vais encore voir des os, que je vais jeter un coup d’œil dans des tombeaux entrouverts. J’accepte cette information me persuadant que c’est pour mieux comprendre le génocide des Tutsi. »
Pourtant, ce jour-là, seuls neuf des 21 participants que compte le groupe achèvent la visite, dont Inès de Falco, qui raconte :
« Certains se sont révoltés face à cette exposition de l’horreur dans sa forme la plus crue : des squelettes chaulés exposés sur des claies ; des cadavres conservés dans ces cylindres transparents avec pour seules indications leur taille, poids, âge et la cause supposée de leur décès ; les baraques occupées par des soldats français après la défaite des génocidaires, où des viols collectifs ont été organisés, le terrain de volley-ball de ces soldats jouxtant la fosse commune. »
Comment réagir face à ce que nous avions pourtant discuté lors du semestre ?
« Devons-nous nous horrifier d’une forme de déshumanisation des morts ou devrions-nous réfléchir sur cette manière de faire mémoire ? La seule chose qui me vient à l’esprit huit mois après Murambi est de ne jamais, absolument jamais, s’habituer à l’horreur, peu importe à quel point elle est inconfortable, car s’y habituer c’est, d’une certaine façon, l’accepter. »

Des sens au sensible : que faire des émotions ?
Aller sur les traces d’un génocide une génération plus tard, c’est faire à chaque instant cette expérience si particulière d’un pays plein de vie – plus des deux tiers des 14,4 millions de Rwandais en 2024 sont nés après le génocide –, transformé par l’une des croissances économiques les plus fortes d’Afrique, offrant des paysages magnifiques et ne pas s’empêcher, dans la rue, au restaurant, au marché, de se demander si celui-ci a tué ou celle-là survécu.
Ce passé-présent qui saisit les Européens que nous sommes provoque d’abord une certaine confusion des sentiments et révèle combien nos chères études nous préparent assez mal à les considérer pour apprendre à utiliser nos sens dans la compréhension de la violence génocidaire.
À nouveau, le séjour se révèle être une ré-éducation. Au Nyarubuye Genocide Memorial, cela devient évident quand notre guide manipule des armes qui servirent à massacrer 20 000 Tutsi, des vêtements dont les couleurs permettent d’identifier certaines professions des victimes, un fémur parmi les centaines exposés, avec le même naturel qu’elle avait quelques minutes auparavant dans la cour ensoleillée du mémorial offert des grenadelles récoltées devant nous. Ébahissement assuré.
Regarder sans déshumaniser
La place de l’artefact, omniprésent pour signifier la disparition – et corrélativement la quasi-absence de la figure du témoin comme médiateur mémoriel – comme le rapport immédiat que le visiteur peut entretenir avec lui, interroge le regard que nous posons sur ces ossements dès lors que nous ne venons pas, en Rwandais, dans ces mémoriaux pour nous recueillir. Quelle est alors la bonne attitude, somatique et sociale d’abord ; intellectuelle ensuite dès lors que la vitrine, si fréquente en Europe, ne fait plus barrière avec l’horreur ? Comment regarder sans voyeurisme ni déshumanisation qui achèverait la négation voulue par les perpétrateurs ?
Inès de Falco revient sur ce sensible devenu facteur de compréhension :
« Le parcours universitaire que j’ai suivi encourage à partir de soi pour aller vers l’événement. Rien n’ait affaire de soi en histoire, mais tout est affaire de l’autre : l’autre du passé, celui qui a disparu, celui qui est mort. Paradoxalement, dans cette approche, j’ai toujours pensé qu’il n’y avait de la place pour les vivants que dans la mesure où l’on devait s’effacer pour écrire une histoire plus grande que nous. Or, le Rwanda m’a appris tout l’inverse. Je suis dans une église et je suis témoin d’une petite trace du génocide face à cet autel devenu lors des massacres lieu de décapitation. Je suis dans un mémorial et je vois ces vêtements d’enfant, qui auraient pu être ceux de mes sœurs. Je suis dans le bus et j’échange, je ris avec mes camarades pour oublier un peu la mort. Au Rwanda, je ne réfléchis qu’avec mes émotions, omniprésentes. Et alors que je vois mon reflet dans les autres et que je culpabilise d’être si égoïste, je comprends qu’en passant par mon moi, en accueillant mes émotions et mon empathie, je m’approche un peu plus d’une compréhension du génocide des Tutsi. Au Rwanda, j’ai révisé l’histoire telle que je l’avais connue, scientifique et rigoureuse car mes émotions sont devenues à ce moment-là mon vecteur de savoir, d’introspection, d’ouverture à l’autre. »

Revenir du Rwanda
L’aventure ne s’est pas arrêtée avec le départ le 20 juillet 2023 : il a fallu revenir et savoir ce qu’enseignant comme étudiants, nous allions faire de ça. De quoi étions-nous devenus dépositaires, même à notre corps défendant ? Les différents billets du blog rédigés sur place laissaient déjà sourdre une réflexion sur l’après. Pour certains étudiants, il est apparu impossible de retourner à leurs occupations sans coup férir mais il n’était pas non plus évident de trouver, seul, la voie pour poursuivre la confrontation-réflexion.
C’est par le collectif que la réponse a été trouvée à travers une exposition « Le Rwanda et nous : retour sur un voyage au Rwanda trente ans après le génocide » réalisée sous ma direction : douze panneaux écrits à plusieurs mains et illustrés de photos originales pour revenir sur les traces, celles laissées sur place par le génocide, celles que le génocide a gravées en ces participants du voyage d’étude, celles enfin imprimées sur les panneaux en espérant qu’elles le soient sur leurs lecteurs, des deux universités partenaires et au-delà. Les étudiants ont ainsi saisi combien le besoin de faire partager ce qu’ils avaient ressenti était un moyen de revenir sur cette expérience et de vivre avec elle, dès lors qu’elle faisait partie de leur histoire comme le génocide fait partie de la nôtre.

Le retour pour l’enseignant-chercheur que je suis a également abondé en réflexions sur la pratique de la comparaison – asymétrique au besoin – qui rend visibles les évidences que l’on peut alors questionner (nos mémoriaux dédiés à la Seconde Guerre mondiale sont un des possibles muséographiques pour exposer la violence extrême) et vient enrichir des perspectives de recherche, notamment quant aux acteurs et aux échelles (avec par exemple le débat sur le statut des bystanders (« spectateurs ») dans la Shoah.
Sans doute cette pratique de la comparaison est-elle à développer à partir de l’analogie car son égalité de rapport paraît respectueuse des spécificités de chaque situation. Réflexions aussi sur la nécessaire prise en compte du sensible dans l’appréhension des phénomènes historiques, en l’occurrence génocidaires, comme de la subjectivité du chercheur afin d’assumer ses biais ; réflexion encore sur les processus de muséographie, de remémoration et de politique mémorielle d’événements de violence extrême. Revenir sur les traces du génocide au Rwanda, c’est accepter d’occuper – un peu – la place du provincial en son champ d’expertise pour contribuer à son renouvellement et considérer, en retour, que le génocide des Tutsi au Rwanda peut aussi nous dire quelque chose sur celui des Juifs en Europe un demi-siècle plus tôt. Défi immense.
Je remercie Inès de Falco pour ses contributions et sa relecture de l’article qui a été conçu de concert.
Pour aller plus loin :
Certaines réactions à chaud des étudiants peuvent être écoutées dans les podcasts réalisés par l’une des participantes, Yasmine Benaïssa, « Le Rwanda, sur les traces du génocide des Tutsi ».
L’exposition dont il est question dans cet article a été montrée début 2024 à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et à la Europa-Universität Viadrina. Destinée à tourner en France, elle peut être réservée gratuitement par mail à mon adresse professionnelle (fabien.theofilakis@univ-paris1.fr).
Fabien Théofilakis ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
15.05.2024 à 17:45
Qui s’intéresse à la santé des chômeurs ?
Dominique Lhuilier, Professeure émérite en psychologie du travail, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
Texte intégral (2019 mots)
À la fin de cette semaine, le gouvernement devrait annoncer les nouvelles règles d'indemnisation des chômeurs et promet un durcissement. Ce sera la troisième réforme de l’assurance-chômage en six ans, après deux réformes contestées en 2019 et 2023.
Ces dernières ont globalement augmenté la durée de cotisation pour prétendre à des indemnités dont le montant est réduit. On retrouve là les instruments d’une injonction récurrente au « Je traverse la rue et je vous en trouve (sous-entendu du travail) » selon la formule du président de la République Emmanuel Macron. La pression exercée s’accroît de plus en plus…
Le soupçon qui vise les chômeurs a la vie dure
Le stéréotype chronique qui vise les chômeurs alimente le soupçon : ceux qui tardent à retrouver un emploi pourraient bien être des paresseux, des profiteurs. Gabriel Attal le laisse entendre : « Il faut aussi écouter une majorité silencieuse, ce sont ces Français qui bossent et qui ont l’impression que tous les efforts leur sont demandés ».
En toile de fond, se joue la question de la responsabilité citoyenne. Le chômeur ne peut s’affranchir de ses devoirs en ces temps de « réarmement civique » voulu par le président de la République. Dans cette lecture, si le chômeur a perdu son emploi, c’est qu’il s’est dérobé à ses engagements, qu’il manque de courage, ou qu’il a démissionné pour prendre du bon temps et profiter de ses allocations, si on se réfère à la manière dont semblent perçues les personnes au chômage au sein de la société française.
[Déjà plus de 120 000 abonnements aux newsletters The Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui pour mieux comprendre les grands enjeux du monde.]
Une stigmatisation qui rassure ceux qui sont dans l’emploi
Penser le chômeur artisan de son exclusion est fort utile : cela permet d’éloigner le spectre du chômage pour soi. Alors, ceux qui ont (pour le moment…) un emploi, peuvent se rassurer. La stigmatisation des chômeurs apaise donc l’angoisse des actifs en emploi.
D’autant qu’aujourd’hui toute difficulté au travail est régulièrement interprétée en termes d’insuffisance personnelle. Cette interprétation présente l’avantage de construire une frontière entre les inclus et les exclus, entre les « productifs performants » et les « improductifs ». Différentialisme et discrimination vont bien souvent de pair.
L’accent mis sur les traits personnels, qualifiants ou disqualifiants, justifie les destins heureux ou malheureux. Et ce psychologisme explique les ruptures d’emploi par des mises en cause personnelles. Pourtant, les personnes privées d’emploi ne se « vautrent » pas dans le chômage. Et si, au lieu de définir le chômeur par ce qu’il ne fait pas ou n’est pas, on privilégiait une investigation de ce qu’il fait et est ?
Quand la recherche va à la rencontre des chômeurs
Une récente recherche-action d’ampleur réalisée récemment peut contribuer à éclairer la question. La recherche-action poursuit un double objectif de changement dans le système social et de production de connaissances sur celui-ci.
Les connaissances sont indissociables des conditions de leur émergence : elles se construisent dans l’action et avec les acteurs sociaux. Ceux-ci ne sont pas considérés comme de simples objets d’investigation mais des sujets engagés dans une relation de coopération avec les chercheurs.
Publiée sous le titre « Santé et travail, paroles de chômeurs », cette recherche-action permet d’aller au-delà des chiffres du chômage régulièrement commentés, et objet de nombreuses controverses.
Cette recherche qualitative explore les trajectoires de vie au travail et au chômage, en appui sur une centaine d’entretiens individuels approfondis semi-structurés et d’une vingtaine entretiens collectifs. Ces entretiens ont été réalisés au sein d’agences de Pôle emploi, d’une mission locale, d’un Cap emploi, de l’association Solidarités nouvelles face au chômage (SNC) et d’un Territoire zéro chômeur de longue durée (TZCLD).
Femmes ou hommes, urbains ou ruraux, de toutes catégories socioprofessionnelles
À la rencontre de chômeuses et de chômeurs, on réalise vite que le chômeur n’existe pas : ce sont des hommes, des femmes, d’âges contrastés, de toutes catégories socioprofessionnelles, vivant en zones urbaines ou rurales, ayant des expériences du travail et du chômage très différentes.
Il n’y a pas une seule expérience du chômage, et il faut revenir au travail, à ce qui a été perdu, pour comprendre à la fois les significations de cette perte et les processus qui ont conduit à cette bascule hors de l’emploi. Comme il faut tenir compte des ressources ou contraintes de leurs situations respectives qui leur permettent de penser les voies de sortie du chômage.
Le chômage n’est pas un état qui définirait une population mais une transition, un temps plus ou moins long, plus ou moins fréquent dans une histoire de vie. Et les chômeurs ne se définissent pas par des traits singuliers.
Une santé altérée par les emplois précaires, les défauts d’insertion, etc.
Cependant, au-delà de cette grande diversité, on observe une dimension essentielle et trop souvent occultée par les pouvoirs publics et les institutions d’accompagnement vers l’emploi : la santé.
Ainsi, l’analyse comparée des différentes trajectoires révèle trois dominantes ou tendances de parcours. Certains se caractérisent par une santé sacrifiée en emploi. Ils persistent à se maintenir au travail malgré des signes infra-pathologiques, des douleurs, une souffrance psychique croissante ou une maladie déclarée (par exemple un cancer).
Cela amplifie les processus de dégradation de la santé, l’usure physique et psychique, jusqu’à l’accident de travail ou l’effondrement. Souvent, les personnes concernées ne veulent pas prendre le risque de perdre leur emploi ou alors elles souhaitent prévenir le stigmate qui pèse dans le monde du travail sur ceux qui ont une santé fragilisée.
D’autres sont marqués par une santé altérée sur fond d’emplois précaires récurrents, et enfin une troisième catégorie de personnes font état d’un défaut d’insertion sociale et professionnelle chronique sur fond de santé dégradée.
Un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) soulignait déjà en 2017 que plus d’un quart des inscriptions au Pôle emploi font suite à un licenciement pour inaptitude médicale. Autrement dit, la relation chômage/santé peut prendre aussi sa source en amont dans l’activité de travail, cause d’une dégradation de la santé qui s’importe en situation de chômage voire la provoque.
Une dégradation, notamment sur le plan psychique
Ces parcours se prolongent au chômage par une dégradation accrue de la santé notamment psychique, même si un temps, elle peut être restaurée grâce à la mise à distance des épreuves du travail. Au chômage s’efface tout à la fois la structuration spatiale (espace public – celui du travail/espace privé) et temporelle de nos vies.
Le temps de travail assure une fonction essentielle de structuration du temps quotidien et contribue à la construction de l’avenir. Lorsqu’il est absent, la dynamique fait défaut : le présent devient encombré de préoccupations multiples alors que les perspectives se brouillent. Chômer est aussi une situation d’activité empêchée. Et l’empêchement de l’activité altère à la fois l’image de soi et la santé.
Sans travail, au sens d’activité, le sujet ne peut se prouver à lui-même et aux autres qu’il peut. Sans mise à l’épreuve du réel, avec ce qu’il contient de limitations mais aussi de possibles, le chômeur risque une dégradation de l’estime de soi, voire un sentiment d’impuissance renforcée par la durée du chômage et les impasses rencontrées lors de la recherche d’emploi. Alors, l’inactivité forcée peut trouver une « issue » dans des décompensations psychosomatiques.
Enfin, l’empêchement de l’activité est fondamentalement privation du pouvoir de l’action. Car travailler, ce n’est pas seulement s’acquitter des tâches attribuées. C’est aussi être en mesure de marquer de son empreinte son environnement, la relation aux autres et le cours des choses. Aussi, la souffrance qui résulte de la privation de travail contribue encore à la diminution de la puissance d’agir.
Il est temps de tirer la sonnette d’alarme
La dégradation de la santé des personnes au chômage est bien un problème de santé publique. Un rapport de 2016 du Conseil économique social et environnemental (CESE) soulignait que « 10 à 14 000 décès par an lui sont imputables du fait de l’augmentation de certaines pathologies, maladie cardio-vasculaire, cancer… (Enquête SUIVIMAX, Inserm 2015) ».
Le CESE conclut sur le fait que « le chômage est un « facteur de risque » qui doit être appréhendé comme tel : organisation d’un suivi sanitaire et psychologique précoce ; accompagnement renforcé en termes d’accueil par Pôle emploi et d’insertion sociale et professionnelle ».
Par rapport aux actifs occupés, les chômeurs présentent au même âge, de moins bons indicateurs en termes de santé perçue, de morbidité, d’accès aux soins, de vieillissement ou de mortalité. Et dans la durée, le bien-être psychologique diminue au chômage tandis qu’augmentent les troubles de l’humeur ou de l’anxiété.
La recherche que nous avons réalisée entend bien poser cette question centrale : faut-il prioriser le contrôle des chômeurs ou prévenir les processus qui mènent les travailleurs au chômage et qui font qu’ils ne peuvent plus envisager de revenir dans des emplois dans lesquels ils ne tiendront pas ?
Dominique Lhuilier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
15.05.2024 à 17:45
Quatre idées reçues sur la « transition juste »
Solange Martin, Sociologue, Direction exécutive prospective et recherche, Ademe (Agence de la transition écologique)
Patrick Jolivet, Directeur des études socio-économiques, Ademe (Agence de la transition écologique)
Texte intégral (2357 mots)
Alors que 63 % des Français se disent en 2024 inquiets des effets du changement climatique et que 88 % estiment qu’il est urgent d’agir, la nécessité de la [transition écologique] est (presque) unanimement partagée. Avec elle revient souvent l’idée que les efforts associés à cette transition ne seront consentis qu’à la condition qu’ils soient perçus comme « justes ».
Si le concept de « transition juste » peut sembler récent, il a en fait émergé dès 1993 dans les milieux syndicaux étasuniens, avant de se diffuser plus tard hors du monde du travail. En 2010, l’expression a été inscrite dans l’accord de la COP16, puis sacralisée dans le préambule de l’accord de Paris de 2015. Elle a aussi fait l’objet, en 2018, d’une déclaration spécifique, la déclaration de Silésie sur la solidarité et la transition juste.
Au fil du temps, son sens s’est élargi. L’expression de transition juste est devenue un peu fourre-tout, présentée comme une baguette magique censée résoudre toutes les difficultés inhérentes à la transition.
Pour clarifier la notion, l’Agence de la transition écologique (Ademe) a publié en avril un avis qui permet de démystifier quatre idées reçues sur le sujet.
Idée reçue n°1 : « La transition sera juste ou ne sera pas »
Première idée reçue à s’être imposée : la transition ne peut se déployer qu’à condition d’être juste. En d’autres termes, elle ne vaudrait la peine d’être menée que si elle est porteuse de justice sociale.
Cette exigence vient du fait, réel, que la transition peut accroître à court terme certaines vulnérabilités. Il existe en effet différents chemins pour la réaliser et tous n’auront pas les mêmes impacts sur nos sociétés.
Rappelons néanmoins que le plus injuste demeure ne pas mener du tout de transition. D’après les rapports du GIEC, le changement climatique va renforcer les inégalités – entre les pays et au sein des pays. Avec des vulnérabilités accrues chez certaines populations – pays du sud mais aussi les agriculteurs, les personnes âgées et très jeunes, les habitants des littoraux ou encore les femmes.
En outre, exiger de la transition d’être juste à tout prix, c’est oublier que l’avènement d’une société juste dépend de bien d’autres facteurs. Il serait absurde de faire peser sur cette évolution, plus que sur toute autre, la responsabilité de la justice sociale. Politiques sociales, trajectoire économique, répartition des patrimoines et des revenus, politiques d’inclusion, mondialisation, intelligence artificielle, crises géostratégiques… sont autant d’éléments qui entrent aussi en jeu.
Idée reçue n°2 : « La transition va massivement créer du chômage »
C’est autour des questions d’emplois perdus qu’est née la notion de transition juste en 1993 aux États-Unis, lorsque les syndicats de secteurs polluants prennent conscience que les régulations environnementales doivent être accompagnées pour éviter qu’elles ne frappent trop durement les travailleurs des filières concernées.
Encore aujourd’hui, les craintes vis-à-vis de l’impact qu’aura la transition sur l’emploi sont prégnantes, et correspondent, en partie, à une réalité. Certains secteurs d’activités – comme l’industrie automobile – vont inéluctablement subir des pertes d’emploi majeures du fait de la transition.
Méfions-nous toutefois de cette vision microéconomique. Car à l’échelle macroéconomique, les projections de l’Ademe estiment que la transition sera, à l’horizon 2050, pourvoyeuse d’emplois nets, grâce à l’éclosion de nouveaux secteurs – dans les énergies renouvelables ou les nouvelles mobilités.
En la matière, le risque porte davantage sur le manque de compétences qu’il faudra combler pour réaliser la transition que sur le manque d’emplois proposés. Pour la rénovation énergétique en France d’ici à 2030, il faudrait former de 170 000 à 250 000 travailleurs supplémentaires dans le secteur du bâtiment.

L’enjeu est donc aussi celui de la formation aux compétences des métiers de la transition, en plus de l’accompagnement des chômeurs des secteurs polluants et des filières en reconversion.
Rappelons également que retarder la transition à l’échelle mondiale nous coûterait cher. La mettre en œuvre à partir de 2030 plutôt que dès à présent coûterait à la France 1,5 point de PIB en 2030 et 5 points de PIB en 2050.
De la même façon que pour la justice sociale, il faut relativiser le rôle de la transition dans les évolutions du travail par rapport à la dynamique économique générale. Ne nous leurrons pas, la transition ne va ni résoudre ni créer un chômage de masse.
Les impacts qu’elle aura en la matière doivent être mis en regard d’autres évolutions. Si 10 000 emplois seront perdus entre 2021 et 2026 dans l’industrie automobile, c’est peu au regard des 100 000 qui l’ont été sur les 10 dernières années et des autres 100 000 qui pourraient l’être d’ici 2035, du fait, en premier lieu, des arbitrages internationaux du secteur (délocalisations, approvisionnement dans les pays à bas coût et abandon de la production des petits modèles).
Idée reçue n°3 : « La transition va renforcer la pauvreté et les inégalités »
Il est inexact d’affirmer que la transition va accroître la pauvreté et les inégalités à terme, en 2050.
Toutefois, à court terme, elle engendrera des coûts supplémentaires, en particulier pour les personnes les plus vulnérables et les plus dépendantes des énergies fossiles, notamment pour la mobilité. Il est donc indispensable d’améliorer l’accessibilité matérielle comme financière des solutions bas carbone, spécialement en matière de rénovation énergétique et de véhicule électrique.
De même, un changement de régime alimentaire (moins de viande et de gaspillage alimentaire, plus de légumineuses et plus de bio) pourrait se traduire, selon l’assiette de départ, par une économie de 30 % ou au contraire un surcoût de 67 % des dépenses alimentaires, notamment pour les personnes aux revenus les plus faibles qui consomment déjà peu de viande et jamais de produits bio.
À lire aussi : Climat : nos systèmes alimentaires peuvent devenir plus efficaces, plus résilients et plus justes
Selon les projections de l’Ademe, la transition devrait néanmoins avoir, à l’horizon 2050, des effets positifs sur les revenus à l’échelle macroéconomique. Grâce à la diminution de la facture énergétique et à la création d’emplois, le revenu disponible des ménages pourrait augmenter entre 3,8 et 7 % par rapport à un scénario tendanciel (en l’absence de mesure supplémentaire en faveur de la transition).
En revanche, il est indéniable qu’une contribution progressive sur l’ensemble du spectre social devra être instaurée pour tenir compte des disparités d’impact de la transition. Il s’agit non seulement de ne pas précariser les plus pauvres, mais aussi de ne pas appauvrir les classes moyennes ni d’accroître un sentiment de déclassement.
Là encore, rappelons que d’autres facteurs politiques, sociaux et économiques déterminent et détermineront l’avenir des inégalités sociales. À cet égard, citons la part de salariés payés au smic, passée de 12 à 17,3 % entre janvier 2021 et janvier 2023. Cette évolution n’est nullement imputable à la transition.
Idée reçue n°4 : « La transition menace les libertés individuelles »
Du fait de l’urgence d’agir qu’elle porte, la transition est parfois perçue comme dangereuse pour la démocratie. Selon cet argument, elle ne pourrait se faire qu’en piétinant les libertés individuelles par des restrictions décidées unilatéralement.
À l’inverse, le GIEC considère la consultation de l’ensemble des parties prenantes comme l’une des conditions de réussite de la transition. Car contourner les instances de participation démocratique au nom de l’urgence d’agir mène à un double écueil, non seulement moral mais aussi pratique.
Vouloir gagner quelques mois en imposant des décisions sans concertation serait profondément inefficace. C’est le meilleur moyen de générer en aval un défaut d’appropriation des décisions et d’engendrer des résistances – comme celles observées pendant la crise des « gilets jaunes » – qui retarderont significativement les avancées écologiques.
[Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]
L’idée de transition juste est historiquement adossée à celle de dialogue social et à l’idée que l’inclusion de l’ensemble des parties prenantes était une condition de réussite de la transition. Elle implique potentiellement de repenser des processus de participation (convention citoyenne pour le climat par exemple), dans un contexte français marqué par une défiance forte envers les institutions et la classe politique. Elle pourrait donc être, au contraire, une excellente occasion de renouer le dialogue social et citoyen.
Associer transition et justice
Répondre à ces quatre idées reçues nous permet de rappeler qu’il n’y a lieu ni d’enchanter ni de diaboliser la transition. Sa réalisation n’est pas une option, elle est indispensable au bien-être des populations française et mondiale à une échéance de 10 ou 20 ans. Elle aura des effets à court et moyen terme qu’il faut appréhender et anticiper, mais il serait irresponsable d’en faire le bouc émissaire de toutes les difficultés que rencontrent, par ailleurs, nos sociétés : il s’agit d’associer, de cumuler, transition et justice, pas de jouer l’une contre l’autre.
Exiger de la transition qu’elle n’ait que des co-bénéfices pour tous et tout le temps équivaut aussi à la condamner. D’autres processus géostratégiques, économiques, financiers, politiques, technologiques, sanitaires ou démographiques continueront de peser sur notre société, dont les conséquences sur l’activité économique, la cohésion sociale et politique seront au moins aussi importantes que les politiques de transition écologique, qui sont indispensables au maintien d’une vie décente sur la planète.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
15.05.2024 à 17:45
Métro du Grand Paris : quels enjeux à la veille des JO ?
Daniel Behar, Géographe Professeur des Universités, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
Texte intégral (1898 mots)
En 2015, la candidature de Paris aux Jeux olympiques promettait l’ouverture de la rocade du métro de Grand Paris. Neuf années plus tard, seul le prolongement de la ligne 14 qui passe du nord au sud sera réalisé au moment de la compétition.
Dès la présentation de ce que certains appellent « le chantier du siècle » la question des effets des nouveaux métros a fait débat.
Alors que la loi sur le Grand Paris en 2010 fixait comme objectif à ce vaste projet d’infrastructure de « réduire les déséquilibres sociaux, territoriaux et fiscaux au bénéfice de l’ensemble du territoire national », ses détracteurs y voient « un agent de gentrification express », autrement dit, un facteur aggravant du processus constant d’éviction des couches populaires toujours plus loin vers la périphérie de l’agglomération parisienne.
Pourtant, les mutations sociales et urbaines survenues semblent à la fois ne pas répondre aux objectifs poursuivis et démentir les critiques. Rien ne se passe comme prévu par les uns et les autres.
À lire aussi : Chantiers de Paris 2024 : comment limiter l’impact environnemental des terres excavées ?
Une transformation urbaine qui dépasse largement les quartiers de gare
L’image véhiculée du Grand Paris du futur avec son métro en rocade en banlieue était finalement assez simple : une agglomération polycentrique, c’est-à-dire une organisation du territoire qui repose sur plusieurs zones attractives et dynamiques avec autour de chaque gare un nouveau quartier dense, à la fois pôle d’habitat, de services et d’activités.
Comme l’affirmaient régulièrement les responsables de la société en charge du projet (la Société du Grand Paris devenue la Société des Grands Projets), en combinant plus de 200 kilomètres de nouvelles lignes de métro et des opérations d’aménagement couvrant ensemble une fois et demie la surface de Paris intra muros, les déplacements subis, de longue distance, vers Paris notamment devaient mécaniquement se réduire et chacun pourrait habiter et travailler à proximité. On peut d’ores et déjà affirmer qu’il n’en sera rien.
En matière de logement, tout d’abord, la construction s’est largement accrue depuis 2010 : en moyenne chaque année 60 000 logements sont construits, soit près de 50 % de plus que lors de la décennie précédente, mais pas là où on l’attendait : même dans les communes accueillant une gare du futur métro du métro, seulement un tiers des constructions de logements ont eu lieu dans les quartiers de gare.
À lire aussi : Les grands projets urbains sont-ils encore désirables dans les métropoles ?
On assiste ainsi à une réduction de l’étalement urbain en grande couronne et à une densification globale de Paris et de la première couronne, explicable pour partie par l’assouplissement des règles de densité. La production de logements se fait de façon très minoritaire au travers des grandes opérations d’aménagement pilotées par les acteurs publics, mais principalement via le regroupement de quelques parcelles pavillonnaires pour réaliser un petit immeuble collectif de dix ou vingt logements, ou à l’inverse par division de ces mêmes parcelles pavillonnaires.
Les espoirs déçus du rééquilibrage entre les territoires
L’autre espoir déçu est celui du rééquilibrage entre les territoires. Les quartiers de gare – et notamment ceux de l’est parisien – n’ont pas accueilli de façon significative d’activités économiques, à l’exception du Val de Fontenay (94). Bien au contraire, la montée en puissance du télétravail, et sans doute l’anticipation de la facilitation des déplacements grâce au futur métro ont conduit les investisseurs à renoncer à leurs projets à l’est et à se concentrer sur Paris et quelques secteurs de l’ouest.
S’accentue ainsi une dynamique de radicale dissociation entre les lieux de travail et les lieux d’habitat. L’emploi se concentre dans quelques pôles tandis que les ménages choisissent leurs lieux d’habitat, sans nécessairement tenir compte de la proximité de leurs lieux de travail, et organisent ainsi une large diffusion résidentielle, au-delà des limites de l’Île-de-France.
[Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]
Sur le registre des inégalités, cette double dynamique installe une situation inédite et paradoxale. D’un côté, les inégalités entre territoires perdurent et s’amplifient. La richesse économique reste d’autant plus l’apanage de l’ouest parisien que le développement de ressources économiques à l’est n’est plus à l’ordre du jour. Mais simultanément, avec la mise en service progressive du métro, et plus largement des infrastructures de transports collectifs, l’accès aux aménités métropolitaines (emplois, services, équipements universitaires…) pour les habitants de ces mêmes territoires s’améliore grandement.
En d’autres termes, les inégalités territoriales persistent tandis que les inégalités sociales se réduisent. Ainsi, la Seine-Saint-Denis (93) concentre 35 % de personnes en situation de pauvreté (la moyenne régionale étant de 20 %), mais dans le même temps les actifs de Seine Saint-Denis sont les plus mobiles de la région.
Gentrification ou inégalités sociales en cascade ?
Si l’on en croit les détracteurs du Grand Paris Express, il constituerait par essence un facteur puissant d’éviction sociale des territoires qu’il dessert.
Certes, la pression immobilière sur Paris et la première couronne induit une hausse générale du coût du logement, mais rien ne vient démontrer que le métro serait un déterminant majeur de cette hausse. Les observations mettent en évidence des dynamiques bien différentes.
Il faut d’abord rappeler que près d’une cinquantaine de gares sur les soixante-dix du Grand Paris Express sont situées à proximité immédiate de quartiers d’habitat social relevant de la politique de la ville. Ce statut constitue jusqu’à présent un puissant frein à la pression à la hausse des coûts du logement et à la modification sociale de ces quartiers.
De plus, si ces quartiers et leurs périphéries évoluent au travers des programmes de rénovation urbaine pilotés par l’État (ANRU), toutes les évaluations soulignent que ces opérations immobilières restent marquées par l’image négative de leurs quartiers et par contrecoup accueillent davantage de jeunes ménages de ces quartiers en quête de promotion sociale et d’accession à la propriété que des populations nouvelles « gentrificatrices ».
Davantage qu’à une éviction sociale fantasmée, on assiste là encore à une transformation sociale inédite du paysage francilien. Certes, les inégalités sociales historiques et massives entre l’est et l’ouest de l’agglomération parisienne demeurent, mais on observe l’émergence d’une nouvelle géographie des inégalités sociales, à l’échelle des communes, sur l’ensemble de la région.
De Colombes (92) au nord, à Bagneux (92) au sud, en passant par Champigny-sur-Marne (94), dans ces communes jusqu’alors socialement homogènes, populaires (et souvent au passé communiste), se développe une fragmentation sociale « du coin de la rue »., entre quartiers « gentrifiés » et quartiers populaires.
Cette nouvelle donne vient troubler les politiques municipales de communes habituées historiquement en Île-de-France à gérer les unes les riches, les autres les pauvres. Il leur faut au travers de leurs équipements et services du quotidien (les gymnases et piscines, les cantines scolaires…), assurer la cohabitation de pratiques sociales hétérogènes ; l’envers de la mythique « mixité sociale » en quelque sorte.
Changer de grille de lecture s’impose
Étrangement, les tenants de la pensée considérée comme dominante (promoteurs ou aménageurs) et ceux se revendiquant de la pensée critique (du côté du monde associatif ou de la sphère académique) adoptent, de façon symétrique, les mêmes raisonnements. Là où les uns voient mécaniquement dans la réalisation d’une infrastructure publique un ressort de création de valeur, les autres la considèrent tout aussi mécaniquement comme un moteur de gentrification et d’éviction des classes populaires.
L’observation des dynamiques métropolitaines dans la période récente remet largement en question ces deux approches. Dans un contexte marqué par les interdépendances entre les territoires, les interactions complexes entre les différents registres de la vie en société, les raisonnements mécaniques n’ont plus leur place.
Le métro du Grand Paris est une infrastructure totalement inédite. Il vient moins desservir des territoires jusqu’alors enclavés comme les lignes antérieures, qu’organiser un « réseau des réseaux », mettre en système interconnecté, avec sa rocade, l’ensemble des lignes (métro et RER) des transports franciliens.
Les uns et les autres ont persisté et persistent encore à penser ses effets pour l’essentiel autour des quartiers de gare alors qu’il va transformer en profondeur les pratiques métropolitaines, en favorisant la vie en archipel, chacun d’entre nous dispersant ses lieux d’habitat, d’emploi et de loisirs, bien au-delà de la région capitale stricto sensu. Si l’on veut comprendre et agir sur les effets à venir du métro du Grand Paris, il est urgent de changer de grille de lecture.
Daniel Behar ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
15.05.2024 à 17:44
Encore des élections ? La Bulgarie à la veille des scrutins du 9 juin
Nadège Ragaru, Historienne et politiste, est directrice de recherche à Sciences Po (CERI-CNRS), Sciences Po
Texte intégral (3063 mots)
« Une Bulgarie stable dans une Europe sûre ». Tel est le slogan choisi en vue des élections européennes et nationales du 9 juin 2024 par l’équipe de campagne du GERB (« Citoyens pour le développement européen de la Bulgarie », droite populiste), le parti qui, à l’exception de deux brèves parenthèses, a présidé aux destinées du pays depuis 2009. Rarement l’écart entre discours politique et expériences vécues aura été aussi saisissant.
Dans une société économiquement duale et géopolitiquement divisée, s’il était possible de définir une aspiration commune, ce serait l’aspiration au changement. Toutes sensibilités confondues, les citoyens bulgares rêvent encore – sans trop y croire – d’un pays sans collusions entre milieux politiques, entrepreneuriaux et judiciaires, et émancipé de l’emprise des oligarques sur l’économie et les médias. Un pays dont le quotidien ne serait pas rythmé par les scandales publics, les crises gouvernementales et les retours aux urnes. Après l’effondrement en mars 2024 de l’accord scellé en juin 2023 entre les réformateurs de centre droit PP-DB et la coalition GERB-SDS, un gouvernement d’intérim a été chargé par le chef de l’État, Roumen Radev (gauche), de préparer l’organisation d’élections législatives anticipées, qui se tiendront donc le même jour que les européennes. Ce seront les sixièmes en trois ans.
Depuis avril 2021, le pays a épuisé sept cabinets, pour la plupart des exécutifs de transition nommés par le président. Comment sortir d’une crise ouverte en juin 2020 par le dévoilement d’affaires supposées de corruption au sommet de l’État ? Répétitif jusqu’à l’absurdité, le vote est-il encore en mesure de produire une volonté collective, une majorité stable et la légitimité politique indispensables à la mise en œuvre des réformes dans les secteurs de la justice, de la lutte contre corruption et de la concurrence dont le report entrave la croissance économique et fissure la confiance publique ?
À ces questions, il n’est pas évident que le 9 juin apporte des réponses rassurantes : un taux de participation anémique, des fraudes électorales et le retour au pouvoir des partis incarnant la capture de l’État figurent parmi les anticipations des observateurs locaux avec, en prime, une consolidation des formations russophiles et de l’extrême droite xénophobe. Alors que les mesures anti-corruption adoptées par le gouvernement réformateur de Kiril Petkov (PP-DB, décembre 2021-août 2022) et la coalition PP-DB/GERB-SDS dirigée par Nikolaï Denkov (juin 2023-avril 2024) subissent un détricotage soigné depuis la nomination d’un cabinet d’experts en avril, la campagne électorale voit se succéder les kompromati (divulgations publiques d’informations compromettantes) qui visent, au premier chef, les réformateurs du PP-DB.
Au-delà des oligarques, le principal bénéficiaire de ce climat délétère pourrait se révéler la Russie de Vladimir Poutine. Le « grand frère » russe est d’ailleurs soupçonné d’avoir apporté son écot à la fragilisation d’un pays qui a tenté de défendre la politique de l’UE en Ukraine.
Loin d’être exceptionnelle, la trajectoire bulgare est intéressante en ce qu’elle donne à voir des mécanismes d’effritement de la démocratie à l’œuvre aujourd’hui dans plusieurs pays européens (érosion de la lisibilité des clivages et de la stabilité des structures partisanes ; collusions entre affaires et politique ; influences étrangères, etc.). Clientélisme et paralysie de la justice y ont pour pendant la promotion de figures populistes, souvent éphémères, la réaffirmation d’une fierté nationale, pour partie xénophobe, et l’émergence de forces politiques scandant inlassablement les thèmes de la décadence de l’Europe et de la quête d’alternatives fortes.
Des affaires aux frontières de la fiction
À n’en pas douter, des scénaristes hollywoodiens en mal d’inspiration devraient se voir proposer un ressourcement créatif en Bulgarie. Les figures aux survêtements et costumes gonflés par les muscles y abondent ; les révélations spectaculaires et les décès impromptus, aussi.
Pour preuve : en juin 2020, au terme d’une décennie où il avait bâti sa popularité sur la promesse d’un démantèlement des réseaux de criminalité organisée et d’une Bulgarie forte, l’ancien garde du corps, patron de sécurité privée et premier ministre Boïko Borissov – ou quelqu’un lui ressemblant fortement – était photographié dans sa chambre à coucher avec un pistolet sur sa table de chevet et, dans un tiroir ouvert, des liasses de billets de 500 euros et des lingots d’or d’une valeur estimée à plusieurs millions d’euros.
Selon Borissov, les images (truquées) auraient été prises par un drone appartenant au chef de l’État, lequel a ultérieurement confirmé la possession du drone, mais pas l’intrusion. Quelques jours plus tôt, sur les réseaux sociaux avait circulé l’enregistrement d’une voix, ressemblant à s’y méprendre à celle du premier ministre, discutant affaires et politique, détournements de fonds européens et carrières politiques brisées dans un parler chatoyant. De ces kompromati allaient résulter, au cours de l’été 2020, les mobilisations sociales les plus amples que la Bulgarie ait connues depuis 1997. Vainement. En avril 2021, le pays amorçait une série d’élections anticipées peu concluantes.
Autre illustration : il était une fois un patron du jeu, Vassil Bojkov, soupçonné d’avoir omis de payer quelque 500 millions de leva (environ la moitié en euros) d’impôts. Exilé à Dubaï en 2020, il déclarait avoir versé en trois ans approximativement 32 millions d’euros à plusieurs hauts responsables politiques, dont le premier ministre, Boïko Borissov et le ministre des Finances, Vladislav Goranov, en échange d’une conduite sereine de ses affaires. Le Parquet fut saisi. En décembre 2023, la procédure était close faute de preuves : les retraits étaient bien confirmés ; leur usage non démontré. En mai 2024, l’ex-patron du jeu annonçait son entrée en politique et sa candidature à la députation.
Mourir. Cela arrive à chacun tôt ou tard, certes ; par hasard ou sur contrat, qui pourrait l’asserter ? Alors qu’en 2023 les discussions sur la réforme de la justice se précisaient, deux individualités soupçonnées d’avoir servi d’intermédiaires pour « fluidifier » le fonctionnement de l’appareil judiciaire (lire : obtenir la clôture d’investigations préliminaires et/ou la sanction sélective d’actes délictueux) trouvaient la mort, respectivement en août 2023 et en février 2024. La Bulgarie venait d’adopter en décembre 2023 une réforme constitutionnelle ouvrant la voie à une large restructuration du pouvoir judiciaire. Le vote d’une loi devait suivre au printemps. La chute du gouvernement en a décidé autrement.
Comment relier ces faits épars ? En examinant la (dé)-structuration du champ politique, d’abord ; les relations complexes à la Russie, ensuite.
Un échiquier politique fragmenté
Trois récits peuvent être offerts de la vie partisane en Bulgarie.
Premier récit : celui d’une continuité articulée depuis 2009 autour du GERB, une formation de droite, officiellement pro-occidentale mais prompte à satisfaire les intérêts économiques de la Russie (dans l’énergie, entre autres). Le parti de Boïko Borissov aurait réussi à tisser un maillage de réseaux élus/hommes d’affaires depuis l’échelon central jusqu’au niveau municipal et à sceller des alliances post-électorales (formelles ou informelles) d’une grande sensibilité à la conjoncture. Le Mouvement des droits et libertés (DPS), créé après 1989 pour représenter les minorités turques et musulmanes, réputé lié à de puissants intérêts économiques et aux anciens services de renseignement communistes, fait actuellement partie de ses proches.
Deuxième récit : celui d’un système partisan où le clivage structurant entre anti- et ex-communistes des années 1990 se serait érodé avec la préparation de l’accession à l’UE (2007). Depuis la disparition de cette armature, les acteurs politiques survivraient au prix de loyautés changeantes, de coalitions idéologiquement élastiques (entre l’ex-roi Siméon de Saxe-Cobourg-Gotha, les socialistes post-communistes et le DPS de 2005 à 2009, par exemple) et/ou d’un ralliement à des populistes (le showman Slavi Trifonov, en 2021-2022 ; le nationaliste radical pro-russe Kostadin Kostadinov, depuis 2021).
Troisième récit : structurellement, les forces politiques réformatrices pro-occidentales bulgares dont la dernière émanation, Poursuivons le changement (PP), a été fondée en septembre 2021 par les ex-ministres diplômés de Harvard Kiril Petkov et Assen Vassilev, ne disposeraient pas d’une assise électorale suffisante pour faire face à la concurrence d’un Parti socialiste affaibli (à gauche), d’organisations pro-russes nationalistes radicales (à droite) et de formations dépendant d’oligarques (par ailleurs).
De fait, chacune de ces esquisses saisit un segment des logiques à l’œuvre en Bulgarie. Reste à comprendre pourquoi les électeurs ne parviennent pas à confier à une formation unique l’application des réformes auxquelles ils aspirent. Excluons d’emblée une hypothèse exotisante : aliénés par les réseaux sociaux, dépourvus de réflexivité et désabusés, les citoyens voteraient aveuglément pour les hommes forts du jour, des populistes dont les promesses n’engagent – la formule est connue – que ceux qui les croient. Si la concentration des médias entre les mains de quelques magnats a incontestablement contribué à la dégradation du débat démocratique, cette grille de lecture est pour le moins lacunaire. Sans doute convient-il plutôt de rechercher des explications du côté de l’emprise clientélaire exercée sur les territoires, des émergences partisanes venant régulièrement redistribuer les cartes politiques et des divisions géopolitiques intra-bulgares.
Depuis douze ans, le GERB contrôle les grands centres régionaux et la majorité des communes. Aux élections locales d’octobre-novembre 2023, bien que quelques villes préfectorales aient quitté son giron, le parti de Borissov est resté dominant. Dans une configuration où l’accès aux marchés publics, subventions étatiques, fonds européens, emplois publics et services sociaux est susceptible de dépendre de la loyauté démontrée envers les détenteurs du pouvoir, les choix électoraux relèvent moins d’un vote d’adhésion ou d’un déficit d’information que de stratégies de survie. S’abstenir demeure la seule audace possible. Une logique similaire s’applique aux régions du sud et du nord-est à forte présence minoritaire, que le DPS gouverne sans discontinuer depuis 1989. En février 2024, Deljan Peevski, un homme politique listé parmi les Bulgares interdits d’entrée sur le territoire américain au titre du Magnitsky Act, a assumé la co-présidence du parti.
Deuxièmement, source d’incohérence dans les politiques publiques bulgares, la cascade des gouvernements résulte de et contribue à l’émergence continuelle de nouvelles formations contestataires dont les leaders valorisent un profil de chevaliers de la lutte anti-corruption. Même lorsque ces derniers ne captent qu’une frange des voix (4-5 % de l’électorat) pour une durée relativement brève (un à deux mandats), ils contribuent à l’effritement du jeu politique et entravent la formation de coalitions post-électorales au profil technocratique.
Enfin, et ce point a acquis ces dernières années une importance clé, la Bulgarie est profondément divisée entre une minorité éduquée, urbaine et jeune défendant une ligne pro-occidentale et une majorité attachée à une vision pro-russe du conflit en Ukraine et des intérêts de la Bulgarie. Le profil des électeurs pro-russes va de nostalgiques du passé communiste aux sympathisants du parti ultra-nationaliste Renaissance, en passant par des citoyens que l’affirmation médiatique selon laquelle le maintien d’une allégeance à la Russie serait susceptible de garantir des approvisionnements énergétiques à bas coût ne laisse pas indifférents. Les membres de cet ensemble composite ont un point commun : ils ne voteront pas pour des réformateurs jugés pro-américains. La lutte contre la capture de l’État se retrouve ainsi l’otage de la décrédibilisation dans l’opinion publique d’une lecture pro-occidentale des défis actuels. Pour partie, cette dernière est l’œuvre d’une politique d’influence russe redoutablement efficace.
Stratégie d’influence russe : la guerre en Ukraine comme accélérateur de l’effritement bulgare
Les premiers échos persistants selon lesquels la Russie aurait déployé une politique d’influence embrassant soft power culturel, soutien à certains journalistes, intellectuels et universitaires (rémunérés ?), lobbying économique faiblement transparent et financement discret de formations politiques remontent aux années 2013-2014. Non que la Russie ait jamais été absente de secteurs stratégiques comme l’énergie, elle qui fournissait à la Bulgarie l’essentiel de ses livraisons en gaz et en pétrole jusqu’à l’invasion de l’Ukraine le 24 février 2022.
Ceux qui ont une mémoire plus longue se souviennent que l’assassinat de l’ex-premier ministre socialiste Andreï Loukanov, en octobre 1996, fut soupçonné de ne pas être sans rapport avec le rôle d’intermédiaire dans le secteur du gaz que ce dernier avait assumé. L’élimination en 2003 de l’un des grands patrons des réseaux de criminalité organisée bulgares, Ilia Pavlov
- voir notre chapitre dans cet ouvrage collectif – aurait été, de même, facilité par ses ambitions dans le brûlant secteur de l’énergie.
La politique d’influence russe a toutefois revêtu une ampleur inédite depuis l’invasion de l’Ukraine. Alors que l’UE adoptait plusieurs trains de sanctions contre Moscou, la guerre a accentué les lignes de fractures intra-bulgares, le chef de l’État socialiste et l’extrême droite adoptant un discours sur la paix aux accents très russophiles. Le conflit a en outre vu le nombre des sites Internet pro-russes (avec trolls et fake news) connaître une croissance exponentielle. Si la Bulgarie, tout en marquant publiquement sa réticence à exporter des armes à destination de l’Ukraine après la chute du gouvernement Petkov en juin 2022, a organisé de précieuses livraisons (directes ou médiatisées), l’adoption des sanctions européennes a par surcroît induit des effets classiques : elle a créé des réseaux d’acteurs experts dans leur contournement, confortant les transactions économiques illicites.
Qui plus est, dans le domaine de l’énergie, le gouvernement Petkov a connu une vie trop brève pour que l’achèvement d’une interconnexion gazière avec la Grèce (en octobre 2022), la signature d’un contrat gazier avec l’Azerbaïdjan (prévue quelques jours après la chute du cabinet) et le projet d’achat de GNL auprès des États-Unis permettent à la Bulgarie de s’émanciper vis-à-vis de la Russie. Le 3 janvier 2023, l’entreprise publique Bulgarzgaz et son homologue turque, Botaş, concluaient un accord d’une durée de treize ans portant sur des livraisons acheminées par le gazoduc Turkstream. L’accord était présenté par le (nouveau) cabinet bulgare comme une avancée sur la voie de la diversification des approvisionnements du pays. Aux termes de l’accord, la partie bulgare ne maîtrisait toutefois pas la provenance du gaz (russe, de fait). Elle s’engageait par ailleurs à verser 2 milliards de dollars en 13 ans, indépendamment des livraisons effectuées. Après la révélation par un site d’investigation de ces données, le Parlement bulgare a dû exiger une renégociation du contrat, le 19 avril 2024.
Que les élections du 9 juin permettent d’échapper à cette quadrature du cercle est peu probable : face à des oligarques réputés contrôler une partie de la classe politique et des « protecteurs extérieurs » qui profitent du manque de transparence des institutions bulgares pour promouvoir leurs intérêts, il y a fort à parier que les électeurs bouderont les urnes, quitte à laisser revenir au pouvoir des figures d’ombre et de lumière connues. Se pourrait-il que les décideurs européens aient oublié que le territoire de la Bulgarie, État membre de l’UE, borde la très stratégique mer Noire ?
Nadège Ragaru ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
15.05.2024 à 17:44
Les start-up medtech, difficiles mais pas impossibles à financer
Robin Pointet, Doctorant en Economie de l'Innovation, Université de Bordeaux
Texte intégral (1776 mots)

Contraction des mots anglais medical et technology, le secteur des medtech regroupe les entreprises qui ont recours à des technologies innovantes pour améliorer ou développer des dispositifs médicaux. Le secteur des technologies médicales a généré 573 milliards d’euros de revenus dans le monde en 2022 et emploie plus de 760 000 personnes à travers 33 000 entreprises en Union européenne.
Malgré leur intérêt public évident (contribution à la santé publique) et le potentiel financier qu’elles représentent, les start-up du secteur rencontrent autant voire plus de difficultés que dans les autres industries pour arriver à la mise sur le marché de leur produit. En effet, les dispositifs médicaux sont soumis à une forte régulation, notamment l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché qui garantit la sécurité et l’efficacité pour les patients et les systèmes de santé. Cette démarche rallonge de plusieurs mois à plusieurs années le temps de développement des dispositifs médicaux. Ces délais font que les start-up ont des temps de mise sur le marché bien supérieurs aux entreprises innovantes des autres secteurs, ce qui accentue l’incertitude quant à la réussite du projet et peut décourager les investisseurs.
Ce constat est d’autant plus inquiétant qu’il est communément admis que le taux d’échec des start-up, tous secteurs confondus, s’élève à 90 % (d’après Philippe Englebert dans Les start-up en France, 2021). Les start-up medtech ne font pas exception. Cette situation peut s’expliquer par un certain nombre de caractéristiques économiques qui permettent de mieux comprendre le processus d’innovation et ses besoins en financement.
L’argent, le nerf de la guerre
A minima, une start-up se définit comme une entreprise qui ne génère pas encore de revenu grâce à ses ventes car elle cherche à mettre sur le marché un produit innovant avec un fort potentiel de croissance.
En l’absence de recettes, la recherche de financement devient le nerf de la guerre : pour financer ses activités de recherche et développement et son fonctionnement, la start-up doit faire appel à des financements externes. Ce besoin en financement peut être assuré par des banques, des fonds d’investissement, les fonds propres des entrepreneurs ou encore l’État. Ils font le pari d’un retour sur investissement lorsque la start-up générera des revenus grâce à la mise sur le marché de son invention.
Cependant, le financement de l’innovation est caractérisé par une asymétrie d’information. Il s’agit d’une situation où un agent économique en sait plus qu’un autre au moment d’une transaction. Cette situation peut poser problème comme l’a montré l’économiste George Akerlof avec le marché des voitures d’occasion : lorsque les vendeurs ont plus d’informations sur la qualité des produits que les acheteurs, les produits de moindre qualité tendent à chasser du marché les produits de bonne qualité, faute pour les acheteurs de pouvoir distinguer les uns des autres, ce qui peut mener à une disparition du marché à terme.
Dans le cas du financement de l’innovation, la start-up en sait plus que l’investisseur : il est très difficile de s’assurer que la start-up a réellement mis toutes les chances de son côté pour réussir le lancement de son produit et générer ses premières ventes. Pour l’investisseur qui espère placer ses liquidités au mieux, il est très difficile d’identifier quelle start-up est la plus susceptible d’apporter un retour sur investissement au financeur, sans même parler du rendement le plus élevé.
Un accès imparfait à l’information
Face à ce risque de « sélection adverse » (choix de la mauvaise start-up, celle qui ne va pas réussir), les investisseurs préfèrent ne rien financer du tout. Ces caractéristiques expliquent en partie le phénomène de « vallée de la mort », une période critique entre l’invention et la commercialisation d’un produit où de nombreuses start-up échouent (d’où le nom de « vallée de la mort ») en raison des difficultés à trouver des financements. Cette phase peut durer jusqu’à une décennie, rendant le passage de la recherche et développement à la production et aux ventes initiales particulièrement difficile.
Une illustration de la vallée de la mort dans le rapport d’office parlementaire du 24/01/2012
Pour faire face à l’asymétrie d’information, la théorie du signalement en économie prévoit l’existence de certaines caractéristiques qui permettent aux start-up de se signaler aux investisseurs. Ces « signaux » revêtent plusieurs formes et doivent rassurer quant à la probabilité de réussite du projet de la start-up.
L’exemple de la start-up FineHeart est, à cet égard, éclairant. Fondée en 2010 à Pessac (33), cette jeune entreprise a développé un dispositif d’assistance cardiaque innovant pour soigner les patients en insuffisance cardiaque avancée, un syndrome qui ne connaît pas de traitement satisfaisant. L’entreprise a annoncé le début de ses essais cliniques sur l’homme en janvier 2024, soit 14 ans seulement après sa création.
Parmi les signaux que possède la start-up pour rassurer d’éventuels investisseurs figure son portefeuille de 150 brevets internationaux. Ces actifs peuvent montrer la qualité et la nouveauté de sa technologie au même titre que sa direction : un PDG issu du géant des dispositifs médicaux Medtronic et un conseil scientifique composé de chercheurs renommés. Pour un investisseur peu ou pas initié, la personnalité des dirigeants constitue un indicateur précieux.
Les signaux positifs en direction d’éventuels investisseurs peuvent aussi être les investissements précédents de financeurs réputés. Bien souvent, l’État peut agir comme un signal en finançant une jeune entreprise innovante (FineHeart a obtenu 2,5M€ du Conseil d’innovation de l’UE ; d’après le site Crunchbase consulté le 17/04/2024). Il existe également des fonds spécialisés qui ont les compétences pour identifier les « pépites » : la présence de Doliam, un fond de medtech reconnu, au capital de la société peut également jouer comme un signal positif pour les investisseurs suivants.
[Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]
Incertitude radicale
Le processus d’innovation est de plus caractérisé par un contexte d’incertitude radicale. On doit à l’économiste Frank Knight, la distinction entre incertitude et risque. Si dans le cas du risque, les issues sont connues et probabilisables, en contexte d’incertitude, il est impossible d’estimer les chances et les formes des possibles issues. Ce constat est particulièrement vrai pour l’industrie du dispositif médical. La forte régulation augmente l’incertitude du processus entre l’invention et la mise sur le marché. La figure 2 décrit ce processus de façon simplifiée.
L’exemple de la medtech française Carmat est ici particulièrement parlant : après l’obtention d’une autorisation de l’Union européenne pour mener des essais cliniques à grande échelle, la société a dû suspendre ses essais en raison d’une « malfonction » totalement imprévue du dispositif. Cela a impliqué de reprendre la conception des pièces qui dysfonctionnaient et de faire appel à de nouveaux financements pour pouvoir survivre le temps de cette nouvelle « vallée de la mort ».
Après l’invention et une fois un prototype développé, il faut en prouver la sécurité et l’efficacité sur des animaux (tests précliniques) en vue d’obtenir une autorisation pour réaliser de premiers essais cliniques sur l’homme. Une fois passée cette étape, il faut encore prouver l’efficience budgétaire pour obtenir le remboursement du système de santé. Et là encore, le succès n’est pas assuré : encore faut-il que les médecins adoptent le dispositif.
En augmentant l’incertitude, les contraintes réglementaires dans le secteur du dispositif médical allongent les délais de développement et compliquent le financement des start-up. De ce constat naît un paradoxe : certaines maladies communes qui représentent à la fois un enjeu de santé publique majeur et un marché potentiel immense (forte perspective de rentabilité pour les industriels) ne connaissent toujours pas de traitement.
Les étapes de développement d’un dispositif médical (traduit par les auteurs)
Dans ce contexte, la recherche en économie et management de l’innovation s’emploie à identifier ces situations problématiques en vue d’orienter les efforts des chercheurs et inventeurs issus des sciences médicales. Pour favoriser les success-stories, pourquoi alors ne pas former les médecins, chercheurs en sciences médicales et inventeurs à l’entrepreneuriat et à l’innovation ?
Robin Pointet est doctorant contractuel (financement MESRI) à l'université de Bordeaux.
15.05.2024 à 17:44
Soin, économie, isolement… les personnels des Ehpad ne comprennent souvent plus leur rôle
Khaled Sabouné, Maître de Conférences - HDR, Aix-Marseille Université (AMU)
Nathalie Montargot, Contributrice de la revue académique Questions de Management et Professeur Associée, Excelia
Texte intégral (1603 mots)
Dans un contexte de vieillissement de la population, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ont été, ces dernières années, visés par différents scandales en France. Deux grands groupes, en particulier, se sont retrouvés au centre de l’attention pour des allégations de maltraitance directes ou indirectes envers les résidents, poussant l’État à renforcer ses actions.
Prendre soin des aînés implique notamment de recruter et fidéliser des soignants, d’instaurer pour eux un climat de travail positif et d’éviter ce que l’on appelle des tensions de rôle, une notion au cœur de nos travaux. Par tension de rôle, on désigne un sentiment qu’éprouve une personne dans une situation où il lui est difficile, voire impossible, de répondre à toutes les attentes de façon satisfaisante tant à ses yeux qu’aux yeux des personnes qui les formulent. Les partenaires professionnels du salarié formulent à son égard des attentes de rôles plus ou moins explicites ou compatibles. Tout ou partie de ces attentes peuvent entrer en contradiction avec ses valeurs ou les tâches qu’on lui a confiées ou même dépasser ses compétences.
Plus spécifiquement, le conflit de rôle correspond à une situation où l’individu doit faire face à des attentes de rôle incompatibles entre elles. L’ambiguïté de rôle est, elle, relative à un déficit d’information nécessaire pour bien occuper une position dans l’organisation. L’individu se trouve dans l’incertitude à propos des activités et comportements attendus. Enfin, des tensions transversales peuvent provoquer une surcharge de rôle : l’individu doit faire face à un nombre élevé d’attentes de rôle. Celles-ci, trop nombreuses, excèdent alors ses capacités de réalisation et ses ressources disponibles.
Identifier ces tensions de rôle et leurs causes au sein d’une organisation doit permettre aux dirigeants de mettre en place des actions pour tenter de les réguler ou, tout du moins, de réduire leur intensité pour éviter leurs conséquences délétères : stress, mal-être, absentéisme, burn out… Elles peuvent donner des envies de départ.
Cela vaut tout particulièrement dans un secteur où le bien-être au travail du personnel est déterminant de la performance de l’organisation et de la qualité de la prise en soins des résidents. Dans les Ehpad, nos travaux identifient trois facteurs d’origine organisationnelle qui favorisent les tensions de rôle : la prévalence d’une logique économique dans une structure à visée sociale, l’intensification du travail et l’insuffisance de communication.
Conflits de valeurs, surcharge, échanges insuffisants
En France, le vieillissement de la population a entraîné une augmentation notable de la dépense publique pour répondre à la dépendance des personnes âgées. Le référentiel guidant la politique publique s’est alors mis à reposer sur une logique économique : maîtriser et même réduire les dépenses.
[Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]
Ces pressions externes ont une incidence sur les fonctionnements internes. Elle engendre des conflits de valeurs parmi les soignants et leurs managers. Une aide-soignante explique :
« Ce n’est pas le métier qui me déplait. C’est surtout le manque de temps. Ne pas prendre le temps de faire ce qu’on voudrait. Parfois, on rentre chez nous, on se dit que l’on n’a pas bien travaillé. Même si ce n’est pas vrai, parce qu’on fait du mieux qu’on pouvait. »
Nos travaux confirment également que les changements liés aux réformes du secteur de la dépendance entraînent une surcharge de travail. Cette dernière favorise des conflits et surcharges de rôle qui causent stress, fatigue et conflits, et démotivent les salariés. Ils bouleversent l’équilibre vie professionnelle – vie privée, limitent la capacité des salariés à se déconnecter de leur travail et augmentent le sentiment de mal faire leur travail. Une cadre de santé en témoigne :
« Le diagnostic, c’était un burn-out aigu. Ma tête, elle était archi pleine et c’est mon corps qui ne s’est plus levé de ma chaise, je ne pouvais plus. J’ai mis quelques jours à réaliser que ça n’allait pas, que c’était trop et que je faisais des malaises à répétition. »
Cette intensification et cette complexification du travail a des conséquences en matière de communication. Elles empêchent les salariés des Ehpad d’échanger sur les attentes, ce qui génère des ambigüités de rôle. L’intensification du travail administratif des managers engendrée par une formalisation excessive éloigne ces derniers de leurs collaborateurs et réduit considérablement les interactions et les échanges entre eux. La directrice d’une structure le regrette :
« Je me rends compte que depuis le début, il n’y a rien qui se construit. Il n’y a rien de fondé. Je pense qu’il y a un gros problème de communication mais aussi d’organisation : il n’y a aucune planification, on ne sait rien, on n’a rien travaillé. »
Quand la surcharge entraîne l’ambiguïté, et réciproquement
Les trois formes de tensions de rôle interagissent ainsi entre elles alimentant un cercle vicieux.
La surcharge de rôle amène les personnes qui ont des fonctions d’encadrement à délaisser l’aspect managérial à moyen et long terme de leur emploi pour se focaliser sur la réalisation des activités administratives et financières. Cela les conduit à la pratique d’un management purement opérationnel de l’urgence. Véritables « managers pompiers », sautant de feu en feu, ils répondent uniquement aux priorités du moment, sans être capables de prendre du recul ou d’animer le travail de leurs équipes. Dès lors, la rationalisation va de pair avec la gestionnarisation : plus la charge de travail administratif des managers augmente, plus ces derniers délaissent leur rôle managérial pour répondre à l’urgence quotidienne, et ce faisant se cantonnent au volet gestionnaire de leur travail.
À lire aussi : Les travailleuses du soin et du lien aux autres, fières d'un métier qu'elles ne recommanderaient pourtant pas
La surcharge de rôle empêche également les équipes opérationnelles de répondre aux attentes de rôle de leurs supérieurs hiérarchiques et des résidents liées à la qualité de la prise en charge. Leur travail semble souvent bâclé. Les personnels éprouvent des difficultés à concilier leur rôle de soignants, responsables de la santé et du bien-être des résidents, et leur rôle de salariés, qui doivent remplir des objectifs organisationnels liés à la performance de l’établissement.
Pour que les salariés répondent aux attentes, encore faut-il qu’elles soient exprimées de manière explicite. Les attentes de rôles paraissent parfois contradictoires, surtout quand elles sont imposées sans expliquer la complémentarité entre elles, comme l’injonction de faire « plus avec moins » par exemple. Un travail pédagogique semble nécessaire.
Toutes les conséquences délétères pour les organisations semblent incompatibles avec les exigences toujours plus hautes des autorités de tutelle, des résidents et de leurs familles. La régulation des tensions de rôle identifiées chez les personnels des Ehpad s’avère donc urgente afin d’assurer une meilleure prise en soins des résidents et de restaurer l’attractivité de ces établissements, auprès des personnes accueillies comme des professionnels du secteur.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
15.05.2024 à 17:44
Have smartphones killed the art of conversation?
David Le Breton, Professeur de sociologie et d'anthropologie, Université de Strasbourg
Texte intégral (1671 mots)

Once upon a time, human relationships unfolded without smartphones. The reality may be hard to recall, so profoundly have these devices transformed the way we relate to the world and others in fifteen years or so.
As an anthropologist interested in modernity, I am particularly preoccupied by the impact of these devices on our conversations. In my book, The End of the Conversation? Words in a Spectral Wociety (French original: La fin de la conversation? La parole dans une société spectrale), I investigate the pernicious effects of this technology on our social fabric, and make a point of distinguishing conversation from communication.
Communication is not conversation
When I’m communicating, my relationship with another is usually mediated via a screen. Communication calls to mind notions of distance, physical absence, and by extension, frazzled attention. The age of communication induces feelings that everything is going too fast and we have no more time to ourselves. The next notification, message or call is always only a moment away, keeping us in a state of restless alertness.
Conversations, on the other hand, are often free. One chats while enjoying a stroll or meeting a new person, sharing words like one breaks bread. While communication does away with the body, conversation calls for mutual presence, attention to the other person’s face, their facial expressions and their gaze. Conversation is happy to accommodate silence, pauses and each person’s rhythm.
This is in contrast to communication, where any cut-off warrants a knee-jerk reaction: “We’ve been cut off”, “Are you there?” “I can’t hear you”, “I’ll call you back”. This isn’t an issue when conversing, because the other person’s face has never disappeared and it’s possible to be silent together in friendship, in complicity, to express a doubt or a thought. Silence in the course of a conversation allows us to breathe, while in the field of communication we would label it with words such as cut-off or breakdown.

A few months ago in Taipei, Taiwan, I was at a popular restaurant when a dozen people from the same family sat down at a table nearby. The youngest were 2 or 3 years old, while the oldest were in their 60s. Having barely glanced at the menu before ordering, their eyes rapidly proceeded to attach to their mobile phones. Barely uttering a word, they ate with their smartphones in hand. The only exception was the occasional tension between two of the children, who must have been 4 or 5 years old. They stayed for a good hour, exchanging little more than a few sentences, without really looking at each other.
The scene could have taken place in Strasbourg, Rome or New York, in any city in the world. Today it is commonplace. You only have to walk into a café or restaurant at random to see the same situation. The old family or friendly encounters are gradually disappearing, replaced by these new manners where we are together but separated from each other by screens, with the occasional smattering of words exchanged before returning to the tranquillity of our laptop. What’s the point of bothering with others, since a world of entertainment is immediately accessible, where we no longer have to make the effort to nurture relationships? Conversation becomes obsolete, useless and tedious, whereas the screen is a beautiful escape that doesn’t disappoint and that occupies time pleasantly.
Cities populated by zombies
The massive disappearance of conversation, even with oneself, is reflected in the fact that cities are now deserted, where you meet no one, and the pavements are full of zombies walking around hypnotised by their smartphones. Eyes downcast, they see nothing of what’s happening around them. If you’re trying to find your way, don’t ask for help, there’s no one around. Some are wearing earphones, talking to themselves, and displaying an ostentatious indifference.
Sometimes, communication is imposed in the public space. Those who dare not protest or go elsewhere find themselves invaded by the words of someone who has come to sit on their bench or near their table to start a conversation aloud. Another increasingly common practice is to watch a video without earphones or to put the loudspeaker on to hear the other person’s voice better.
Another common form of incivility that has become commonplace is talking to someone who can’t stop pulling their smartphone out of their pocket every thirty seconds, in fear of missing out on a notification. Teenagers are particularly susceptible to the fear of missing out (FOMO) fever, but not only, and this frantic quest for the smartphone in your pocket, unless it’s always in your hand. Even when placed on a table next to you, experience shows that the smartphone exerts a magnetism that is difficult to counter, with people regularly looking at it with a kind of longing.
For these users, relationships at a distance, without a body, are less unpredictable and frustrating as they demand only the surface of the self. They give rise to relationships that are in line with desire and based on personal decision alone, with no fear of spillover, because then all you have to do is interrupt the discussion on the pretext of a network problem and cut off communication. Face-to-face interactions are more uncertain, more likely to hurt or disappoint. But the more we communicate, the less we meet, and the more conversation disappears from everyday life.
A growing sense of isolation
Accelerated by Covid lockdowns, the digital society does not have the same dimension as concrete sociability, with people in mutual presence who talk and listen to each other. It fragments the social bond, destroying old links in favour of the abstract and often anonymous ones of social networks.
Paradoxically, some people see it as a source of connection at a time when individual isolation has never been so acute. Never has the mal de vivre of teenagers and the elderly reached such a level. Frequent use of multiple social networks or the ostentation of one’s private life on a social network creates neither intimacy nor links in real life. The hundred “friends” on social networks are no match for one or two friends in everyday life.
The digital society occupies time and provides a way of getting away from everything that annoys us in our daily lives, but it doesn’t give us a reason to live. Of course, some people find a connection through their isolation, but isn’t isolation also a consequence of the fact that we no longer meet in real life?
New forms of expression are emerging that are now a matter of course for many of our contemporaries, and not just for the digital natives. Globally, connection is taking over from conversation, which has become an anachronism, but not without a major impact on the quality of the social bond, and potentially on the functioning of our democracies.
David Le Breton ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
15.05.2024 à 12:55
How companies calculate their carbon footprints
Gianfranco Gianfrate, Porfesseur et directeur de recherche de l'EDHEC-Risk Climate Impact Institute, EDHEC Business School
Texte intégral (969 mots)

When it comes to slashing carbon emissions, the onus is often placed on individuals and their carbon footprint. But companies also have a major role to play. In fact, the biggest corporations have accounted for more than two thirds of global emissions since the start of the Industrial Revolution.
To contribute their fair share of the effort to cut CO2 emissions, companies now dispose of a potentially powerful tool: internal carbon pricing (ICP), also known as “shadow carbon pricing”. First thought up following the Kyoto Protocol in 1997, which laid the foundations for carbon pricing and offsets, shadow carbon pricing is a voluntary method for companies to estimate the costs of their greenhouse gas emissions to society, even when all or part of their operations are out of the scope of external carbon regulations.
My research at the EDHEC Risk Climate Impact Institute seeks to test the robustness of these accounting methods in the private sector and its complex modelling.
Influencing future decisions
To come up with a shadow carbon price, companies need to assess both their direct and indirect emissions from their own sources, but also their energy use, supply chain operations and waste management. Direct emissions come from sources owned or controlled by the company such as emissions from combustion in a company’s boilers or from its vehicle fleet. Indirect emissions are estimated on the basis of purchased energy such as electricity, heat or cooling. Finally, other indirect emissions in the supply chain are factored in, such as transportation of materials or waste disposal.
Also taken into consideration are current and estimated future carbon prices. This complex process is critical to understand the pattern of carbon prices over the long term, and how they might impact companies’ performance in the future. To reach such estimations, the company must assess the climate policies in place in the countries where it operates and those where it plans to expand. Companies should also factor in potential major political, technological and economic developments that could lead to significant changes in the price of carbon in each of the target countries.
Only with the information above will companies finally be able to set their internal carbon price. To determine the price for a ton of CO2, they can use the current market transactions – in Europe, for example, it is known as the EU Emissions Trading System. In other markets, carbon tax rates can be found in national tax laws.
Impact on company valuation
On top of optimising companies’ decision-making processes, this tool also helps companies to improve communication with investors. An increasing number of climate-aware investors are poring over the plans disclosed by companies to deliver on the transition to a low-carbon world, and what firms assume as ICP validates the credibility of the long-term strategy and of corporate actions to successfully compete in a dangerously warm planet. As carbon-related risks can have a significant impact on a company’s cash flow, it makes financial sense to integrate this “carbon price” into the company’s valuation.
For example, when an energy company has to make a decision regarding a new plant, they can calculate and compare the expected costs of a fossil fuel-based choice versus a renewable energy choice. A baseline valuation that does not consider the future likely increase of carbon prices may easily show that traditional more polluting sources of energy are more convenient. However, when the valuation also includes the future expected evolution of carbon prices, the costs associated to the future carbon footprint may become so prohibitive that the company would realise the financial convenience of switching to a cleaner source of energy.
This way they can make informed decisions that include the shadow cost of carbon use, improving the quality of financial investments. Ultimately, carbon risk assessment isn’t just an important step in the global fight against climate change, it also helps companies and investors navigate the complex challenges of a rapidly changing business landscape.
A patchwork of regulations
Still, current regulations regarding environmental policies vary widely between countries. As a result, carbon prices ranged from 1 cent to more than $130 per ton in 2023 (World Bank) – a textbook example, if there ever was one, of how stronger climate policies could spur greener business decisions.
As climate change policies and carbon prices evolve rapidly, companies will increasingly need to measure their exposure to carbon risks. In fact, managing carbon risk should be treated as importantly as any other traditional risk within the company, such as compliance or currency risks.
Gianfranco Gianfrate ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
14.05.2024 à 17:05
Meet Paris’ black dandies, the Sapeurs
Daouda Coulibaly, PhD, Professeur-Associé, EDC Paris Business School
Texte intégral (1900 mots)

You can spot them in the streets of Paris or at fashion events in London, Milan, Brussels or Dubai. Most are black African men with sharp outfits designed and chosen to get them noticed. Known as “Sapeurs” – the name comes from the Society for Ambience and Elegance (Sape) and from French slang “se saper”, “to dress up” – these figures stand out with their offbeat and baroque sartorial style.
Genesis and evolution
Research by ethnologists and historians indicates that the movement was born in Central Africa, likely at the port of Bacongo, the river that separates the two Congos, the Democratic Republic of the Congo (Congo Republic, North of the river) and the Democratic Republic of the Congo (DR Congo, South side). The subculture got its start around 1919-1920, and by the 1950s, it gained momentum and took off. The first Congolese emigrants (including former infantrymen in Europe) returned home, bringing with them products perceived as luxurious or ceremonial – branded objects, accessories, clothes and shoes.
It was at this point that the first parades and competitions began in the neighbourhoods of the two Congos’ capitals, Brazzaville and Kinshasa. Based on the same principle as dance battles, Sapeurs show off, demonstrate and prove their skills and abilities – the gestures and voice, the walk and the look. More than just dazzling clothes, verbal and visual communication is essential to stand out. So throughout the two cities, crowds formed to watch the jousting, and acclaim these “black aesthetes” – living works of art that were better dressed than the colonial authorities themselves.
In the 1970s, Congolese families began to send their children to France to study, and many brought their stylish clothes with them. In Europe, the Sape movement got a new lease of life through young people like singer and composer Aurlus Mabele, the jeweller Djo Ballard, Paris pioneer, Ricley Loubaky, or fashion designer, Jocelyn Armel, alias “The Bachelor”, Ben Moukacha, and musician Papa Wemba, also known as the “King of Rumba Rock”.
From 1984 to 1985, the movement became more established in France, and Paris’s Maison des Étudiants de Congolais (Congolese Students House) became the cradle of Sape. Located in the city’s Third Arrondissement, the MEC was the centre of activity for the students who lived there as well as businessmen from Brazzaville and Kinshasa. Pioneers such as Djo Balard, Ben Moukacha, Jocelyn Armel and Nono Ngando (all of whom we met during the course of this research) all pointed to the MEC as the official starting point for authentic Sape. Balard explains:
“The MEC is the Mecca of the Sapeurs. Pretty much everything started there. It was a party all the time competitive moments but in good spirits and in the Sape. You could see the silhouettes all dressed up. The colours and brands were all singing. It was a sight to behold. At the MEC, the rule was to be well dressed, to shout it, enjoy it and even swear by it.”
A movement with media coverage
Almost everywhere in Africa and in major European capitals, people were talking about this new group of elegant and passionate Africans who frequented the best fashion boutiques. In just a few years, the Sape movement reached the world and was the talk of Europe, and particularly France. Parisian Sapeurs continued to create a buzz to democratise their movement. In the mid-1980s, French director Thomas Gilou made Black Mic Mac which was the first “mainstream” cultural nod to the movement.

In 2010, stylist and designer Paul Smith launched a Sape collection, paying tribute to the colourful and quirky style of African Sapeurs. During a 2011 visit to Paris, the English photographer Martin Parr visited the Sapeurs and presented a photo exhibition in the Goutte d'or district that was widely covered by the media. And in 2016, designer Christian Louboutin launched a collection of men’s shoes inspired by the kitendi model – a reference to the Sape movement in Lingala, a language spoken in much of Central Africa.
The Sapeurs’s colourful activism
Of course, clothing can go far beyond individual or collective expressiveness to enter the religious, symbolic or political arena. The aim of my research – which falls within the field of postcolonial studies and subaltern studies (the study of people, minorities or groups ignored, under-recognised or dominated by race, class, gender, sexual orientation, ethnicity or religion) – is to explore the meaning and impact of the demonstrative consumption of luxury clothing by black Sapeurs.
Sapeurs are not typical customers for luxury goods. Instead, they are in search of social recognition and actively make brands their own. With its varying degrees of appreciation, luxury is used as a reference point for the group to which they belong.
The movement’s distinctive style is based on a highly codified use of accoutrements, colours and patterns, creating an original outfit beyond the classic Western model. There’s an excess of accessories: shoes, scarves, belts, watches, glasses, hats, cosmetics and perfumes. This profusion exists to underline the Sapeur’s message: it’s all about “hitting hard” – in other words, making a strong impression in a competitive context. Personal creativity, a touch of humour and subtle provocation are all underlined.

The Sapeur seeks to signal his presence to others and be noticed through the wealth of colours and accessories, transforming himself into an actor in the social theatre. With his unique attire, he seized the right to please himself and also to be visible, to exist and to please.
Clothes full of symbols
Clothing fulfils a number of functions: practical, utilitarian, institutional, symbolic, and aesthetic. For the Sapeurs, it allows them to make a political statement – one that pleads for dignity. Sape is the polar opposite of the humiliation associated with poverty and customers who may be perceived as not having the right to step into a luxury clothing shop.
The colonial past also plays a role in this need for reparation and justice. In African history, the khaki uniform and the colonial helmet long represented the political and military power of the whites. With the Sape movement, the image of power is reversed and the dazzling suit, the hat, the cigar and the cane make it possible to symbolically overcome the humiliation of colonial domination – while at the same time reminding us that it happened.
Finally, there’s a very important term in the world of the Sapeurs, and that’s ambiance. They put on a show and seek to crowds and thus encourage sociability. The colourful and luxurious clothes, the flow of words (like a kind of trance), the music and movements and the electric atmosphere provoke collective admiration. This inspires peers’ admiration and so validates the Sapeur’s status.
Daouda Coulibaly ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
14.05.2024 à 17:03
Avec les chômeurs, la France n'est pas plus généreuse que ses voisins
Baptiste Françon, Maître de conférences en économie, Université de Lorraine
Jean-Marie Pillon, Maître de conférences en Sociologie, Université Paris Dauphine – PSL
Texte intégral (2809 mots)

À chaque annonce de projet de réforme de l’assurance-chômage (et elles sont fréquentes), une même question revient dans le débat public : le système français serait-il trop généreux, « parmi les plus généreux d’Europe » selon les mots de l’actuel ministre des Finances Bruno Le Maire ? Simple dans sa formulation, cet exercice de comparaison est en fait rendu difficile par la variété des critères utilisés dans chaque pays pour déterminer le versement (ou non) d’une allocation chômage, son montant, le complément ou la substitution par d’autres aides ou allocations d’assistance (le RSA en France par exemple…) mais aussi par l’évolution parfois rapide de ces critères.
Surtout, les termes mêmes de ce débat apparaissent faussés. N’est-il pas trompeur de parler de générosité alors que les chômeurs indemnisés par l’Unedic (catégorie A) percevaient 1093€ net par mois en moyenne en 2022, tout juste 52 % du salaire médian ? Est-il pertinent de mettre l’accent sur les aides versées alors que seuls 46 % de l’ensemble des inscrits à France Travail sont effectivement indemnisés ? Est-il urgent de rechercher des économies sur l’assurance-chômage alors que le taux de pauvreté des chômeurs est cinq fois plus important que pour les salariés (35,1 % des chômeurs sont en risque de pauvreté monétaire) ? Un panorama des systèmes européens d’assurance-chômage permet d’éclairer cette caractéristique centrale, et parfois méconnue, de l’indemnisation des chômeurs : celle-ci n’est « généreuse » nulle part, ni en France, ni chez nos voisins.
À rebours d’un principe d’exhaustivité parfois peu pertinent (et peu lisible) pour l’analyse comparative, nous nous concentrons dans ce qui suit sur les nations européennes les plus comparables par la taille de leur population et de leur PIB (les huit principales économies, plus le Danemark étant donné son statut de modèle incontournable dans les débats autour des politiques de l’emploi). L’analyse comparée du montant moyen des prestations ciblées permet d’établir un premier constat global (Tableau 1) : les demandeurs d’emploi perçoivent en moyenne des indemnités inférieures, voire très inférieures aux salaires perçus par la majorité des personnes en emploi.
La position intermédiaire de la France
C’est au Danemark que ces prestations sont relativement les plus fortes, la France occupant une position intermédiaire, tandis que le système forfaitaire britannique apparaît pour ce qu’il est : un dispositif d’indemnisation résiduel. Ces données corroborent le fait que les dépenses d’assurance-chômage sont de second rang dans les dépenses de protection sociale totales : 6 % en France et moins de 5 % dans l’UE, hors crise sanitaire.
Présentons rapidement les facteurs qui expliquent la faiblesse générale de ces montants, comparée aux revenus salariaux de la population en emploi. Le facteur plus évident d’entre eux tout d’abord : si la plupart des régimes ont vocation à compenser la perte de revenus selon une logique assurantielle, leurs règles effectives conduisent presque toujours à des baisses importantes du niveau de vie. Le taux de remplacement, c’est-à-dire le rapport entre l’allocation et le salaire précédent, la perte d’emploi, est variable d’un pays à l’autre, mais ne remplace jamais totalement le salaire perdu.
Le taux général apparaît à première vue relativement plus faible en France (57 %) que dans d’autres grandes économies européennes, même si ce constat peut être nuancé car pour les salaires les plus faibles il peut atteindre 75 %. Le taux général est légèrement plus élevé en Allemagne, et prend potentiellement en compte la situation familiale à la différence de la France. Le Danemark présente le taux le plus important et s’approche le plus d’un dispositif de maintien du niveau de vie (pour les salariés éligibles), alors que nombre de pays disposent de taux intermédiaires (70 % à 80 %) et dégressifs avec l’allongement de la durée d’indemnisation : c’est le cas de l’Espagne, de l’Italie, des Pays-Bas et de la Suède (ainsi que de la France depuis 2019, mais uniquement pour les hauts revenus).
L’existence, par ailleurs, d’un plafond élevé (supérieur à 8000€) distingue le cas français de ses voisins européens. Mais ce paramètre reste anecdotique au regard de la distribution des salaires passés parmi les chômeurs : seul 0,14 % des bénéficiaires avaient atteint ce plafond en 2022 selon l’Unedic.
La faiblesse des prestations versées tient ensuite à la structure du chômage en Europe : les actifs les plus susceptibles de perdre leur emploi sont à la fois moins qualifiés et moins rémunérés en moyenne, et perçoivent des indemnités en relation avec ces faibles rémunérations le cas échéant.
De nombreux chômeurs travaillent
Enfin, les dépenses sont faibles en moyenne car une part importante des demandeurs d’emploi avec des droits ouverts (on parle d’indemnisables) ne perçoivent rien ou seulement une partie résiduelle de leur indemnisation… parce qu’ils travaillent. À l’inverse de certains discours sur la supposée oisiveté des chômeurs, ces cas ne sont pas marginaux : en France par exemple, ce sont environ 50 % des indemnisables qui travaillent en parallèle de leur recherche d’emploi. Lorsqu’ils perçoivent une indemnisation, celle-ci est faible : 788€ par mois d’indemnisation en moyenne en 2022, un montant inférieur à celui des chômeurs sans activité.
Ces considérations générales en tête, il n’apparaît pas pertinent d’approfondir davantage cette comparaison en fonction du seul indicateur des dépenses moyennes, qui suggère au mieux des ordres de grandeur. Les données manquent pour estimer l’influence relative de chaque facteur mentionné sur la position dans un tel classement. Surtout, la notion même de bénéficiaire est dépendante des dispositifs eux-mêmes et de leur étendue : elle laisse dans l’ombre l’ensemble des chômeurs qui ne perçoivent pas ou plus d’indemnisation.
Une couverture imparfaite des chômeurs
Pour rappel, moins de la moitié des demandeurs d’emploi sont indemnisés en France et encore ceci ne prend pas en compte l’absence d’indemnisation des non-inscrits (principalement les nouveaux entrants sur le marché du travail), alors qu’ils représentent un chômeur sur cinq. Les données comparables manquent pour estimer les taux de couverture dans les autres pays de notre panel : la notion de demandeur d’emploi inscrit est administrative et très dépendante des politiques nationales de l’emploi. L’analyse des critères d’indemnisation permet pourtant de dresser un second diagnostic général : les dispositifs d’assurance-chômage européens tendent à exclure une partie des salariés qu’ils sont supposés protéger.
À lire aussi : Les Français accepteraient dorénavant plus de chômage pour moins d’inflation
En effet, une logique assurantielle fondée sur un principe contributif domine en Europe. L’indemnisation dépend fortement des cotisations versées au cours du passé professionnel récent, contrairement à l’assurance maladie. De plus, la durée de versement est limitée, contrairement aux pensions de retraite. Sur ces fondements, ces dispositifs vont en priorité assurer les actifs dont l’emploi est stable, capables de remplir les conditions d’affiliation les plus longues, et bénéficiant en retour des durées d’indemnisation maximales (sans nécessairement les protéger contre une baisse de leur niveau de vie).
Pourtant, c’est sans surprise pour les actifs dans l’emploi discontinu que l’incidence du chômage est la plus forte. La non-couverture est alors liée à l’insuffisance de cotisations (un filtre à l’entrée) ou à l’épuisement rapide des droits acquis (un écrémage vers la sortie). Les exclusions en raison de sanctions, très présentes dans les débats, demeurent en fait des cas très marginaux. On peut enfin citer le non-recours, un facteur qui n’est pas complètement étranger aux conditions d’éligibilité, selon cette étude de la Dares.
Différents paramètres (et interactions entre ces paramètres) limitent l’étendue de la population au chômage couverte : le tableau ci-dessous présente les principaux critères d’éligibilité et de durée susceptibles de restreindre la couverture dans les pays de notre panel. La France y occupe une position médiane sur la plupart d’entre eux. La barrière d’accès à l’indemnisation, qui équivaut à 6 mois travaillés, est plus courte que dans d’autres pays du panel mais elle est partagée par les travailleurs néerlandais ou suédois et elle est plus courte pour les travailleurs italiens.
Éviction organisée
Ces contributions sont par ailleurs appréciées sur des périodes différentes. Les cotisations s’apprécient sur une période relativement plus courte en France (24 mois) ou en Allemagne (30 mois) qu’en Espagne (72 mois) ou en Italie (48 mois), ce qui est susceptible d’accroître la difficulté à valider le critère de durée d’affiliation. En ce qui concerne la durée d’indemnisation maximale, le Royaume-Uni et la Pologne se distinguent par une éviction rapide. Avec 18 mois, la France se situe dans une position intermédiaire, et dans une position similaire de la majorité des autres pays du panel pour les travailleurs plus âgés.
La tentation d’établir une hiérarchie claire entre les pays se heurte cette fois-ci à la difficulté d’appréhender les conséquences de chaque configuration nationale. Aucun pays n’est systématiquement plus (ou moins) inclusif sur chaque paramètre. En d’autres termes, chaque dispositif organise l’éviction d’une partie des chômeurs à sa manière. Cette question est d’autant plus complexe qu’elle dépend en dernière analyse des interactions entre ces critères d’éligibilité et des conditions d’emploi propres à chaque pays.
La France se caractérise par exemple par un recours important à des contrats courts de très faible durée : elle était le pays européen le plus utilisateur de contrats de moins d’un mois selon cette étude du Trésor. Cela limite d’autant la capacité de certains travailleurs à remplir la condition minimale de durée d’affiliation, alors même qu’elle est en apparence moins contraignante qu’ailleurs. Quand ils la remplissent, ils sont par ailleurs susceptibles d’être fortement pénalisés sur le montant qu’ils perçoivent : la réforme de 2021 prend en effet en compte les périodes non travaillées (et non rémunérées) entre les contrats courts dans le calcul du montant de l’allocation.
[Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]
Un risque incomplètement couvert
En mettant à distance la question trompeuse de la hiérarchie de la « générosité » des systèmes d’assurance-chômage, cette analyse comparative révèle qu’en France comme dans les autres pays européens le risque de perte de revenu lié au chômage est très incomplètement couvert. Ce résultat interpelle, alors que la littérature en sciences économiques a depuis longtemps identifié l’assurance-chômage comme un outil indispensable à l’efficacité de la recherche d’emploi (voir entre autres cet article de Peter Diamond, lauréat du Nobel de la Banque de Suède). La faiblesse de la couverture du risque chômage surprend aussi au regard de sa fréquence : plus d’une personne sur deux fait l’expérience du chômage au cours de sa carrière, parmi les générations en activité. Or, les autres types d’aides sociales compensent très mal les pertes de salaires dues à la privation d’emploi.
Aussi, quels que soient les arguments rhétoriques qui les accompagnent, les réformes successives de l’assurance-chômage font en fait figure de mesures d’économie, d’autant plus simples à mener que les populations concernées sont peu mobilisées ou ne se perçoivent pas comme telles. Ces économies ne viennent pas non plus financer d’autres types de dépenses ciblées, en tout cas en France.
Le budget cumulé de l’agence publique pour l’emploi et des politiques de l’emploi dites actives (les mesures d’accompagnement vers le retour à l’emploi, telles que la formation ou les contrats aidés par exemple) y pesait 0,84 % du PIB en 2022 selon Eurostat. C’est légèrement plus qu’en Allemagne (0,53 % du PIB), mais les chômeurs d’outre-Rhin bénéficient proportionnellement davantage de ces dépenses puisque le taux de chômage y est plus de deux fois plus faible qu’en France. C’est bien moins qu’au Danemark ou qu’aux Pays-Bas (1,42 % et 1,57 % du PIB respectivement), là aussi des pays avec des taux de chômage parmi les plus bas d’Europe.
Ces considérations n’épuisent pas la question du financement d’une amélioration de la protection des personnes privées d’emploi, alors que le régime d’assurance-chômage et son gestionnaire, l’Unedic, génèrent actuellement des excédents. Un accroissement des recettes pour financer de nouvelles dépenses est ainsi possible, qui pourrait passer par une ponction sur les contrats courts, un respect du droit du travail concernant leur usage voire une augmentation plus générale des salaires – donc des cotisations.
Le simple respect de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes pourrait de ce point de vue largement contribuer à un tel accroissement des recettes. Les cotisations chômage pourraient enfin faire l’objet de davantage de redistributivité afin de compenser les inégalités de recours aux contrats courts en fonction des niveaux de qualifications, de diplômes et de rémunérations.
Les choix politiques restent ouverts et il n’est pas question, ici, de dire ce qui devrait être fait, et comment en matière d’assurance-chômage. En revanche, il paraît difficile, en France comme en Europe, d’invoquer une supposée générosité des systèmes de protection contre le risque chômage pour justifier « en même temps » différents plans d’économie et une amélioration de l’efficacité du marché du travail.
Baptiste Francon a reçu des financements de la région Lorraine.
Jean-Marie Pillon a reçu des financements de la Direction de l'Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques (Dares) du ministère du Travail.
14.05.2024 à 17:00
Satellites à gogo : un sacré Graal
Yaël Nazé, Astronome FNRS à l'Institut d'astrophysique et de géophysique, Université de Liège
Texte intégral (2067 mots)
En mi-mai 2024, 17 000 satellites avaient été lancés et 9 000 d’entre eux étaient encore actifs. Ce n’est pas fini : l’augmentation de la population orbitale suit une courbe exponentielle depuis quelques années… On prévoit ainsi un chiffre de 100 000 satellites en orbite pour la fin de cette décennie ! Clairement, on assiste à un changement de paradigme au niveau spatial et cela implique de se poser quelques questions, notamment quant aux raisons et aux impacts de cette croissance inédite.
À quoi vont donc servir ces milliers de satellites ? La plupart des projets concernent les communications. Utiliser un satellite pour communiquer n’est pas neuf, mais cet outil était peu utilisé. En effet, ces satellites étaient en orbite géostationnaire : il y a un côté pratique pour le pointage car le satellite se trouve toujours au même endroit du ciel, vu depuis un endroit sur Terre, mais la distance (36 000 km d’altitude) introduisait un délai de réponse (un quart de seconde environ aller-retour) peu agréable.
Les nouveaux satellites se trouvent beaucoup plus près de la Terre, à quelques centaines de kilomètres seulement. Avantages : le délai dû au trajet est quasiment indétectable. Problème : comme un satellite en orbite basse fait un tour autour de la Terre en 1h30, il ne passe que quelques minutes au-dessus d’un endroit donné. Il faut donc plusieurs satellites pour assurer les communications en permanence. Et quand on dit plusieurs, ce n’est pas deux ou trois… Il s’agit de mégaconstellations de centaines, voire de milliers de satellites, d’où la frénésie de lancement actuelle. En plus, il existe plusieurs projets concurrents, dont les plus connus – mais pas les seuls ! – sont Starlink de Space-X (12 000 satellites autorisés, 42 000 proposés), Kuiper d’Amazon (plus de 3 200), et OneWeb d’Eutelsat (environ 600).
À lire aussi : Starlink : les dommages collatéraux de la flotte de satellites d’Elon Musk
Des applications militaires
Avant de lancer autant d’objets, on pourrait se demander qui aura besoin d’une telle infrastructure… De nombreux pays, comme la France ou le Japon, ont de très bonnes installations au sol pour les communications : pas besoin de satellites pour eux. D’ailleurs, le débit offert par ces satellites est bien moindre que ce que peut offrir une connexion par fibre (qui en outre est moins chère pour l’utilisateur) voire par mobile en 5G : le choix est donc vite fait.
Par contre, on peut identifier trois groupes potentiellement intéressés. Tout d’abord, les communautés isolées, loin des grosses villes. On peut penser par exemple à des villages dans l’Himalaya ou des troupes bédouines dans le Sahara. Les grands pontes de ces mégaconstellations ne s’y sont pas trompés et vantent évidemment l’accès partout et pour tous… Il faut toutefois nuancer : ces communautés isolées n’ont pas toujours les moyens de se payer cet Internet satellitaire ! Plus richement dotées, les compagnies maritimes sont une cible de choix : leurs bateaux sillonnent les mers, où l’on peut oublier la connexion par fibre ou réseau GSM, évidemment – le satellite constitue ici une solution évidente. Encore mieux : les militaires. En opération, ils veulent évidemment pouvoir communiquer sans problème n’importe où, n’importe quand, quelles que soient les conditions, et à n’importe quel prix ! Ce n’est pas pour rien que le projet européen IRIS-2 comporte un volet clairement destiné aux armées du continent…
Par contre, s’il s’agit de satellites privés, on peut avoir des surprises, par exemple quand Elon Musk aurait décidé de couper la communication pour les Ukrainiens s’approchant trop près de la Crimée.
Une mégaconstellation, ce n’est donc pas forcément utile mais est-ce au moins rentable ? Starlink a lancé deux prototypes en 2018 et un service minimal a pu commencer deux ans plus tard. Pour se connecter, pour le moment, il faut bien sûr acheter un terminal spécifique, sorte de « box » Internet : jusqu’ici, ils étaient vendus à perte – le coût de revient vient juste de passer sous le prix de vente… Et si les chiffres exacts de la comptabilité de la compagnie Starlink restent secrets, les informations filtrant au compte-goutte annoncent un profit minime, marginal, et certains mois seulement. Musk lui-même annonçait en octobre 2022 une perte de vingt millions par mois. On est loin des prévisions de 2015 : deux millions de clients contre vingt annoncés, 1,4 milliard de chiffre d’affaires contre 12 annoncés. Bref, huit ans après le lancement du projet, la question de la rentabilité n’est pas encore résolue.
Impact à tous les étages
Peupler ainsi l’orbite basse ne se fait pas sans conséquences. La plupart du temps, on en mentionne deux : la pollution du ciel nocturne et les collisions. Pour la première, si vous avez eu la « chance » de voir passer dans le ciel un « train » Starlink, vous ne risquez pas d’oublier cette brillante balafre pointillée défigurant la voûte céleste…
On peut aussi penser à BlueWalker 3, aussi brillant que les étoiles les plus brillantes du ciel, or ce n’est encore qu’un « petit » prototype de la future constellation des « BlueBirds » de AST SpaceMobile.
Bref, pas étonnant que les astronomes ainsi que tous les groupes aux traditions célestes s’arrachent les cheveux de désespoir ! Côté risque de collision, c’est mathématique : plus il y a de monde, plus on risque de se cogner. C’est un peu comme rouler sur l’autoroute à la vitesse maximale et devoir éviter toutes les dix minutes un autre véhicule venant de n’importe quelle direction, lui aussi roulant à pleine vitesse. Au premier semestre 2023, les Starlink ont ainsi dû effectuer 25 000 manœuvres d’évitement et ce chiffre double tous les six mois. Au final, les satellites passeront leur temps à s’éviter les uns les autres et, rien n’étant parfait, la collision avec effet avalanche aura bien lieu à un moment donné, rendant la zone inutilisable…
Au-delà de ces deux problèmes bien connus et souvent médiatisés, il en existe un autre dont on parle moins mais qui est probablement encore pire : l’impact écologique. Il y a eu peu d’études à ce niveau et beaucoup de paramètres restent incertains. Néanmoins, certaines choses semblent déjà claires. Regardons-y de plus près. Il y a d’abord la production du satellite. Comme pour tout objet de haute technologie, on a besoin de nombreux composés électroniques et l’on sait que cela demande beaucoup d’éléments rares, souvent extraits dans des conditions difficiles et mis en forme dans des pays à la législation environnementale peu contraignante.
Mais le pire est à venir car, une fois construit, le satellite est lancé. Son impact dépend alors du carburant utilisé pour alimenter la fusée. Il y a le couple oxygène-hydrogène liquides, le moins polluant, mais on utilise souvent d’autres liquides (kérosène, méthane), des carburants solides complexes, ou encore un mélange solide-liquide.
Que cela produise du CO2 ou de l’eau, deux gaz à effet de serre, n’est pas le problème car la quantité produite par l’ensemble des lancements est énormément plus faible que l’ensemble des autres activités humaines. Soulignons néanmoins que, même s’ils sont rares, un vol suborbital correspondrait à l’empreinte carbone de milliers de vols entre Los Angeles et Londres et que l’impact environnemental en équivalent CO2 est au moins quinze fois moindre si l’on utilise le réseau classique (2 à 4G) que la com satellitaire.
Une pollution en haute atmosphère
Le gros problème des fusées est l’endroit où la pollution se produit : en moyenne et haute atmosphère, contrairement à toutes les autres activités humaines, limitées à la basse atmosphère. Et à ces altitudes, tout ce qui débarque reste plusieurs années et s’accumule car il est difficile de quitter la zone. Bref, on s’attend à un réchauffement de la stratosphère, dont l’amplitude dépendra évidemment de l’ampleur de l’activité spatiale future… Cela n’implique pas nécessairement un réchauffement au sol, au contraire. D’ailleurs, certains projets de géo-ingénierie envisageaient d’injecter des particules d’aluminium pour refroidir la planète, mais vu les incertitudes sur les conséquences, elles ont été découragées. Avec les activités spatiales version « méga », on a donc droit à une expérience de géo-ingénierie non désirée, non contrôlée et mal comprise…
Une fois dans l’espace, il faut encore assurer le bon fonctionnement du satellite, ce qui mobilise des équipes au sol. Il y a là aussi un impact, mais moindre que pour les autres phases, il faut bien l’avouer. Reste enfin la fin de vie. Soit on laisse le satellite dans l’espace, et il devient un poids mort, avec des composants peut-être intéressants mais non recyclés… et une probabilité non nulle de provoquer une collision. Ou alors le satellite redescend et se désagrège en partie dans l’atmosphère. Cela limite évidemment le risque de collision, puisque l’orbite basse est ainsi nettoyée, mais c’est loin d’être inoffensif pour l’environnement.
Ce qui ne s’est pas vaporisé lors de la rentrée tombe, généralement dans l’océan : c’est évidemment perdu pour le recyclage et pas sûr que les poissons apprécient le bombardement, potentiellement délétère pour leur habitat. Ce qui s’est vaporisé ne fait pas mieux. En 2019, on estime qu’une demi-tonne de matériel technologique nous tombait dessus chaque jour, ce qui est fort peu comparé aux cinquante tonnes de matériau interplanétaire qui nous arrive de concert. Cela restera peu dans les années qui viennent : 12 000 Starlink fonctionnant les cinq années prévues provoqueront deux tonnes par jour de retombées. Sauf que… ce n’est pas du tout la même composition que le bombardement naturel ! On a notamment une forte proportion d’aluminium, et on a vu plus haut le problème qu’il pose… Toute pollution stratosphérique devrait donc être évitée le plus possible.
La situation n’apparaît donc pas franchement rose… Faut-il alors se lancer dans une grande diatribe anti-spatiale ? Certainement pas ! Quand bien même on oublierait les retombées scientifiques indéniables des télescopes et autres rovers spatiaux, les satellites restent indispensables à la surveillance de l’environnement… Certains ont même compté que 65 des 169 cibles des objectifs onusiens du développement durable ont besoin des programmes Galileo et Copernicus. La transition écologique ne se fera donc pas sans le spatial. Par contre, il s’agirait de bien réfléchir à ce qu’on lance et de n’envoyer en l’air que ce qui est vraiment utile à la communauté humaine dans son ensemble… et tant pis pour les portefeuilles et les égos de certains milliardaires !
Yaël Nazé ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
14.05.2024 à 17:00
Le suicide des personnes âgées, un phénomène encore tabou
Véronique Lefebvre des Noettes, Psychiatre du sujet âgé, chercheur associé au Laboratoire interdisciplinaire d'étude du politique Hannah Arendt (Université Paris-Est Créteil), co-directeur du département de recherche Éthique biomédicale du Collège des Bernardins, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
Texte intégral (2128 mots)
À 75 ans, Raymond est hospitalisé pour une tentative de suicide par pendaison. C’est un contexte de grande solitude, doublé d’un sentiment de panique devant des démarches administratives qu’il n’arrivait plus à gérer, qui l’ont amené à commettre ce geste. Il avait envie d’en finir. Mais, dès le lendemain, il critiquait son impulsion et demandait à être aidé. Un mois plus tard, il a pu regagner son logement avec des aides ainsi qu’un suivi médico-social.
En France, environ 9 000 personnes se suicident chaque année, ce qui représente 25 morts par jour, selon le Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (Cépidc). On dénombre par ailleurs dans notre pays 685 tentatives de suicide quotidiennes, soit 200 000 par an.
On estime que ces chiffres sont sous-estimés de 10 % environ, du fait de sous déclarations ne prenant pas en compte les « accidents », les conduites à risques ou le syndrome de glissement, décrit par le gériatre Yves Delomier comme un état de grande déstabilisation somatique et psychique d’évolution gravissime, spécifique des personnes âgées.
La tendance est cependant à la baisse dans toutes les classes d’âge, à l’exception notable de celle des personnes âgées. Ainsi, au-delà de la classe d’âge des 70-75 ans, 3000 morts par suicide sont annuellement enregistrés, ce qui représente 30 % de l’ensemble des suicides. Signalons que 75 % des décès par suicide concernent les hommes de plus de 65 ans. Pour eux, le ratio tentative de suicide/suicide abouti est proche de 1, car ils utilisent des moyens violents (pendaison, arme à feu, précipitation sous un train ou défenestration).
En dépit de ces chiffres alarmants, le phénomène du suicide des personnes âgées est bien souvent invisibilisé ou banalisé, et reste tabou. Dans notre société utilitariste valorisant l’autonomie et la performance, la grande vieillesse est souvent assimilée à la décrépitude du corps et de l’esprit, aux pertes cumulées, dont celle du rôle social. Ce regard sociétal assigne les personnes âgées à disparaître de la scène, à perdre leur estime d’elles-mêmes et à se sentir devenir un fardeau.
Une accumulation de difficultés
La plupart du temps, les idées suicidaires des personnes âgées sont le signe d’une difficulté à faire face à une accumulation de difficultés de la vie quotidienne (inadaptation de la ville aux déplacements, illectronisme – néologisme décrivant un « illetrisme numérique », autrement dit des difficultés dans l’utilisation de base des outils numériques). Les problématiques psychiques constituent également une explication du passage à l’acte (70 % des suicidants souffrent de dépression, tout comme les difficultés somatiques (douleurs, les incapacités fonctionnelles…).
Citons encore comme facteurs de risque l’isolement, le veuvage, la perte de relations sociales et familiales, l’accès difficile au système de soins (800 000 personnes en affection longue durée sont sans médecins traitants), la perte d’autonomie, l’institutionnalisation (d’après une étude du CREDOC 2018 seul 18 % des personnes âgées consentent de leur plein gré à entrer en Ehpad), ou encore les situations de maltraitance, la précarité financière, les deuils, et enfin, le sentiment d’inutilité, donc de perte de sens.
Ces ruptures de vie peuvent s’exprimer par le passage à l’acte suicidaire. Mais expriment-elles forcément une volonté d’en finir ? Rien n’est moins sûr…
Un enjeu sociétal
« À quoi bon », « je n’en peux plus », « je serais mieux mort » « je ne veux pas être un poids »…
Le plus souvent, quand elles disent vouloir mourir, les personnes âgées signifient surtout qu’elles veulent cesser de souffrir physiquement ou psychiquement. Il faut donc se donner le temps de cheminer avec elles pour construire un projet de vie et une alliance thérapeutique.
D’enjeu sanitaire, le suicide des personnes âgées devient un enjeu sociétal. Dans un tel contexte, mettre en avant le « libre choix » en faveur du suicide assisté (qui est en quelque sorte un « suicide sur prescription médicale ») ou de l’euthanasie (le médecin injecte alors le produit létal), au prétexte que la demande serait déjà là pose question.
De quelle demande s’agit-il ? De celle de la personne qui, à un moment donné, se trouvant dans une impasse existentielle, décide de mettre fin à ses jours, à l’instar de Léontine, 98 ans, qui me confie, assise dans son fauteuil roulant : « Je ne veux pas déranger et être un poids pour mes enfants. Vivre comme ça, ce n’est pas une vie… » Puis ajoute : « J’aimerais quand même bien les revoir, mes enfants et mes petits-enfants aussi. C’est eux le sel de la vie. »
Après la crise suicidaire, se met en place une temporalité très importante : la main tendue, la réflexion, la critique d’un geste désespéré et le retour à la vie. Rappelons que le suicide n’est pas un droit, mais une liberté, garantie depuis 1791 par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Le suicide est considéré comme la dernière expression de la liberté de l’individu. Mais la liberté de choisir du suicidant peut, dans la réalité, être entravée du fait d’une souffrance psychique intolérable, que seul le projet suicidaire viendra apaiser. Se suicider est alors, avant tout, un drame personnel, familial et sociétal. Dans de tels cas, les demandes explicites d’euthanasie sont très rares et cèdent dès qu’une prise en charge adéquate est mise en place.
Prévenir le geste suicidaire
Il est du devoir de chacun d’aider une personne qui tente de se suicider, et plus particulièrement du médecin qui, en responsabilités (éthique, humaine, juridique au civil, au pénal (non-assistance à personne en danger) et ordinale) se doit de mettre tout en œuvre selon les données actuelles de la science, mais sans obstination déraisonnable, pour prendre en charge les suicidants.
La prévention des conduites suicidaires des personnes âgées passe par le repérage de la crise suicidaire et par l’évaluation du risque. Dans ce contexte, les programmes de prévention du risque suicidaire, notamment pour les personnes âgées, ne sont pas assez connus.
Dans ses recommandations de bonnes pratiques concernant la prise en compte de la souffrance psychique de la personne âgée, la Haute Autorité de Santé (HAS) liste plusieurs points à surveiller :
la verbalisation explicite d’idées suicidaires dont les modalités sont assez précises ;
l’expression d’un sentiment de culpabilité ou de faute impardonnable,
la rédaction d’une lettre d’adieu ou d’un testament ;
un refus brutal de communication ou des aides habituellement reçues et acceptées ;
une amélioration brutale et inexpliquée de l’humeur ;
un niveau d’angoisse inhabituel ;
une alcoolisation inhabituelle ;
Parmi les points de vigilance, la HAS souligne que « pour certaines personnes âgées, le passage à l’acte a lieu très peu de temps après la survenue de l’élément déclencheur. La rapide dégradation de l’état de la personne laisse alors peu d’opportunités d’observation des signes suicidaires. »
La HAS indique aussi que « les préoccupations liées à la mort peuvent être un sujet très fréquemment abordé par les personnes âgées. Si ces propos restent isolés, ils ne traduisent pas systématiquement une réelle volonté de se donner la mort mais plutôt une préoccupation sur la fin de leur vie. »
À ce sujet, on assiste à une demande sociétale forte de faire évoluer les conditions de fin de vie, à l’instar des 75,6 % des votant de la convention citoyenne se positionnant en faveur d’une aide active à mourir. Et ce, dans un contexte où la loi grand âge a été abandonnée et où l’accès aux soins palliatifs peine à être déployé sur tout le territoire français : rappelons qu’aujourd’hui, on manque de lits et d’unités de soins palliatifs : [50 % des besoins ne sont pas couverts].
Dans l’avis 139 du CCNE, comme dans l’énoncé du projet de loi sur l’aide à mourir, c’est au nom du respect de la liberté, de la fraternité et du devoir de solidarité que la société se dit prête à confier aux seuls médecins (dont le rôle est de soigner, d’écouter toujours, de guérir parfois mais surtout d’accompagner les plus vulnérables), la mise en place du suicide assisté, et, si la personne ne le peut pas, d’une euthanasie.
D’une situation singulière et personnelle, on voit se dessiner une volonté sociétale de maîtriser l’immaîtrisable, en médicalisant ce qui fonde notre humanité : la vieillesse et la mort. Une société juste et éthique doit-elle permettre aux personnes âgées de se suicider si c’est leur choix ? S’agit-il encore d’un choix, quand on se sent devenir un fardeau ?
Ces questions traversent le film Plan 75, récompensé par la Caméra d’or du 75e Festival de Cannes. Dans cette dystopie, la réalisatrice Chie Hayakawa imagine un Japon où, à partir de 75 ans, un accompagnement logistique et financier est proposé aux personnes âgées pour accepter l’euthanasie. Dans ce système social à bout de force, le choix n’existe plus vraiment. Avec ce film, Hayakawa nous rappelle qu’une société se juge à la manière dont elle traite ses anciens…
Pour aller plus loin :
- Lefebvre des Noettes, V. (2023) « Mourir sur ordonnance ou être accompagné jusqu’au bout », Éd. du Rocher.
Véronique Lefebvre des Noettes ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
14.05.2024 à 16:59
Elections européennes : distinguer les enjeux « objectifs » des enjeux perçus
Pierre Bréchon, Professeur émérite de science politique, Sciences Po Grenoble, Auteurs historiques The Conversation France
Texte intégral (2113 mots)
Un rendez-vous crucial approche : du 6 au 9 juin 2024, les citoyens de l’Union européenne sont invités aux urnes pour choisir le visage du prochain Parlement européen. En France, ce sera le dimanche 9 juin.
Les enjeux de cette élection sont plus nombreux et plus importants qu’autrefois, les pouvoirs de ce parlement ayant beaucoup augmenté. En effet, même si le processus de décision européen est compliqué, le Parlement y joue aujourd’hui un rôle éminent, assurant la représentation des citoyens européens face aux représentants des nations et aux experts et technocrates de la Commission. Si la Commission européenne a l’initiative des législations, ce n’est pas elle qui tranche. Le Conseil des chefs d’État et le Parlement doivent se mettre d’accord pour qu’une nouvelle législation soit adoptée. C’est également le Parlement européen qui approuve ou non le choix du président·e de la Commission européenne et des commissaires, qui vote et contrôle le budget annuel et qui se prononce sur de nouveaux États membres.
Parmi les enjeux de cette élection, on peut distinguer les enjeux « objectifs » de l’élection – en fonction des orientations politiques de l’Assemblée – et les enjeux perçus par les électeurs. En quoi ceux-ci diffèrent-ils ?
La couleur politique du Parlement, un enjeu fondamental
Le Parlement européen est élu au suffrage universel direct. Dans chacun des 27 pays, on vote au scrutin proportionnel avec un seul tour et, le plus souvent, une seule circonscription nationale. De ce fait, chaque tendance politique recueille un nombre de sièges correspondant à son résultat dans les urnes, sans prime importante au courant majoritaire. L’actuel parlement est composé de sept groupes d’importance inégale. Le parti populaire européen (PPE), de droite, a le plus d’eurodéputés, suivi par les sociodémocrates. Ensemble, ils constituaient de 1979 à 2019 la majorité de l’Assemblée. Mais ils se sont affaiblis lors du dernier renouvellement et ont donc dû trouver des soutiens dans d’autres formations, le plus souvent chez les centristes libéraux de Renew.
Depuis 2019, la droite radicale (séparée en deux groupes : national conservateur et extrême droite) s’est renforcée dans de nombreux pays, on peut donc s’attendre à sa progression au Parlement européen. Comme le montre le graphique, sur la base d’une projection évidemment sujette à modification, les deux groupes de droite radicale pourraient obtenir ensemble presque le même nombre d’élus que le groupe PPE, alors que Renew, les Verts et les sociodémocrates s’affaibliraient.
La composition du Parlement influencera évidemment sur les politiques suivies par l’Union. À la lecture du bilan de la dernière Commission, les thématiques qui devraient être au centre des débats durant les cinq ans à venir se dessinent : relance économique, action pour le climat et pacte vert, transition numérique, soutien à la guerre en Ukraine, acceptation de son entrée à terme dans l’UE, sanctions contre la Russie, stratégie de défense européenne, politique énergétique, pacte contre les migrations irrégulières, politique agricole commune, élargissement de l’UE… Ces enjeux politiques sont évidemment fondamentaux, non seulement pour l’Europe mais pour l’ordre mondial. Mais ils ne sont pas toujours perçus par les citoyens européens.
[Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]
Les enjeux perçus
Les enjeux objectifs de l’élection semblent cependant un peu mieux perçus que lors des campagnes précédentes. [73 %] des Européens (et 71 % des Français) disent que les actions de l’UE ont un impact sur leur vie quotidienne. La campagne est plus animée qu’en 2014 et 2019 et les sondages montrent un [intérêt accru] pour cette consultation. 60 % des Européens s’y intéressent (contre seulement 47 % des Français, très eurosceptiques.
L’intention d’aller voter est aussi en nette progression. 81 % des Français et des Européens pensent que le vote est encore plus important dans le contexte international actuel. La politique européenne de soutien à l’Ukraine divise l’opinion française et pourrait contribuer à la mobilisation des électeurs, soit pour soutenir la politique menée (c’est le cas dans le camp présidentiel et une partie de la gauche), soit pour la critiquer, souhaiter l’apaisement et des négociations avec la Russie (position de la gauche et de la droite radicale).
Selon les Européens, quatre thèmes devraient être prioritairement abordés pendant la campagne : la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (choisi par 33 %), la santé publique (32 %), le soutien à l’économie (31 %), la défense et la sécurité de l’UE (31 %). Il faut souligner que ces thématiques privilégiées par les électeurs ne concernent pas toutes directement l’Union européenne. La lutte contre la pauvreté et la politique de santé sont avant tout des compétences nationales : l’Union n’y a qu’un rôle d’appoint.
Les domaines les plus choisis par les Français diffèrent : ils mettent plus largement en tête la lutte contre la pauvreté (42 %), sélectionnent ensuite la lutte contre le changement climatique (37 %) et la santé publique (36 %). Par contre, la défense et la sécurité de l’Europe ne viennent qu’en 6e position (24 %). L’euroscepticisme et l’attachement à la souveraineté nationale laissent peu de place à l’ambition d’une souveraineté européenne. En défendant la construction d’une défense commune européenne, Emmanuel Macron a livré une vision politique en partie à destination des pays membres, mais il n’est pas certain que cette insistance soit électoralement très porteuse. Les attentes diffèrent en fonction des valeurs politiques de chaque pays et de son histoire.
Des enjeux perçus liés aux politiques nationales
Alors que les enjeux objectifs ont trait aux politiques européennes, les enjeux perçus et ressentis sont donc beaucoup plus dépendants des politiques nationales. Ce qui n’est guère étonnant. Dans chaque pays, la politique nationale reste dominante dans l’opinion par rapport aux débats européens que beaucoup connaissent très mal. Les enjeux politiques nationaux sont projetés sur l’élection européenne.
Les candidats parlent surtout des politiques européennes qui sont aussi liées aux politiques nationales, sans entrer dans des présentations très précises des mesures adoptées ou de celles qu’il faudrait mettre en œuvre en Europe. Ainsi, beaucoup de candidats parlent de la lutte contre le réchauffement climatique et des énergies renouvelables, à la fois parce que l’Union a adopté le pacte vert et parce que c’est un sujet très actuel en France et dans tous les pays européens.
Jordan Bardella (RN), François-Xavier Bellamy (LR) et Marion Maréchal (Reconquête !) critiquent amplement le pacte vert, considéré comme « de l’écologie punitive », appelé à « générer de la décroissance » et de « l’appauvrissement pour les agriculteurs ». Au contraire, les candidats de gauche et Renaissance défendent le pacte, voire souhaitent que l’Europe aille plus loin. Autre exemple, Marion Maréchal pour Reconquête ! parle beaucoup d’invasion de la France et de l’Europe par les migrants, comme Eric Zemmour le faisait lors de l’élection présidentielle.
Les candidats consacrent en fait beaucoup d’énergies à simplement critiquer, parfois de manière très agressive, d’autres leaders sur des dimensions politiques strictement nationales.
Une bonne trentaine de listes devraient se présenter en France car il est très facile pour un petit mouvement de déposer une candidature (puisqu’il suffit de trouver 81 postulants). Certaines de ces listes défendent une thématique très éloignée des enjeux européens, d’autres expriment une tendance minoritaire d’un courant plus important, notamment chez les écologistes.
Ces listes peu implantées obtiendront certainement un très faible résultat, en dessous du seuil de 5 % des suffrages nécessaires pour avoir un élu. Mais leur but est de se faire connaître plus que réaliser un score important. Seules six ou sept listes devraient rafler les 81 sièges d’eurodéputés français.
Les médias, les personnalités politiques et nombre de citoyens s’intéressent à ce que les résultats nationaux aux européennes laissent présager pour les futurs scrutins français. Le score du RN, qui s’annonce en nette progression, annonce-t-il un succès de Marine Le Pen à l’élection présidentielle de 2027 ? La montée du vote en faveur de la liste PS-Place publique via la captation de suffrages qui s’étaient portés sur Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle de 2022 fait aussi se poser la question de qui arrivera en seconde position – Renaissance ou la gauche modérée ?
Si Renaissance n’arrivait que troisième, cela constituerait une défaite cinglante pour le président. Le défi est rude pour le camp macroniste : un nombre important de ses électeurs sont mécontents après la réforme des retraites et l’usage fréquent du 49.3 pour faire adopter des textes législatifs. De surcroît, on sait par l’observation des scrutins passés que les résultats sont en général médiocres pour la majorité, sanctionnée non pour son action européenne mais pour sa politique nationale.
Néanmoins, il y a davantage de débats proprement européens dans cette campagne qu’en 2014 et 2019. Le contexte anxiogène de la guerre en Ukraine et du réchauffement climatique y est pour beaucoup. Face à ces menaces, la nécessité de politiques communes se renforce. Cette montée des enjeux électoraux européens n’est probablement pas que conjoncturelle : on l’avait déjà vu apparaître en 2019. Elle est le signe d’une construction de l’Europe qui se développe, malgré toutes les vicissitudes qu’elle doit affronter.
Pierre Bréchon ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
14.05.2024 à 16:59
Mer de Chine méridionale : rapprochement du Vietnam et des Philippines face à Pékin
Benjamin Blandin, Doctorant en relations internationales, Institut catholique de Paris (ICP)
Texte intégral (2239 mots)
La récente visite d’État du président philippin Ferdinand Marcos Jr. à Hanoï, fin janvier 2024, est la dernière manifestation en date du net rapprochement que l’on observe entre les Philippines et le Vietnam en matière de sécurité maritime en mer de Chine méridionale.
Ce rapprochement avait précédemment été illustré par le nouvel accord de coopération entre les deux garde-côtes, l’annonce d’un futur code de conduite bilatéral en mer de Chine méridionale et l’invitation faite au Vietnam de participer à l’exercice naval multilatéral MARPOLEX qui doit se dérouler aux Philippines plus tard cette année, aux côtés de l’Indonésie et du Japon.
Des débuts complexes
Cette convergence de vues entre les deux pays survient à une époque de tensions accrues en mer de Chine méridionale, générées par une affirmation marquée de ses intérêts par la Chine et son utilisation d’un ensemble toujours croissant de moyens de confrontation asymétrique (déni d’accès, guerre hybride, techniques de la zone grise). Cela a entraîné une série d’incidents dangereux autour de plusieurs éléments maritimes revendiqués par les Philippines – Scarborough Shoal, Second Thomas Shoal, Whitsun Reef, Iroquois Reef et Sabina Shoal –, ainsi qu’à l’intérieur et sur le pourtour de la zone économique exclusive du Vietnam, près de Triton Island (à l’est de Da Nang) et dans le zone de Vanguard Bank (au sud du pays).
Malgré cette menace commune, les Philippines et le Vietnam n’ont pas toujours été sur la même ligne concernant la situation en mer de Chine méridionale, où leurs propres différends maritimes et territoriaux en suspens ont entravé la coopération maritime pendant de nombreuses années. Ce fut un sujet de tension après la normalisation en 1976, peu après la prise de contrôle surprise par Saigon (à l’époque du Sud-Vietnam) de Southwest Cay dans les îles Spratleys l’année précédente. Cela a contribué à inciter le président Ferdinand E. Marcos, le père de l’actuel dirigeant philippin, à publier un décret présidentiel en 1978 (intitulé « PD 1596 »), établissant officiellement les revendications des Philippines sur les îles Spratleys.
Il convient également de ne pas oublier qu’entre 1964 et 1969, le même président Marcos Sr avait soutenu les États-Unis dans le cadre de la guerre du Vietnam, et déployé dans le pays, aux côtés d’autres alliés (Thailande, Corée du Sud, Taïwan, Australie et Nouvelle Zélande), près de 10 500 soldats dont les activités concernaient principalement l’aide médicale ainsi que des projets d’aide aux populations, au sein du « Philippine Civic Action Group-Vietnam » (ou PHILCAG-V).
Ce décret a en tout cas marqué le début d’une course entre Manille et Hanoï pour établir le contrôle d’un maximum d’éléments maritimes dans l’archipel des Spratleys. La même année, les Philippines ont pris possession de Lankiam Cay, Commodore Reef, Loaita Cay, Loaita Island et Northeast Cay, tandis que le Vietnam a pris le contrôle d’Amboyna Cay, Central London Reef, Grierson Reef et Pearson Reef.
En dépit de ces frictions, les Philippines et le Vietnam ont vu leurs intérêts converger progressivement, tous deux étant confrontés à un défi maritime plus sérieux de la part de la Chine, qui a émis de vastes revendications sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale.
Finalement, les deux pays ont trouvé des moyens de normaliser leurs relations bilatérales, notamment après le retrait des forces vietnamiennes du Cambodge en 1989, la fin du conflit frontalier avec la Chine (1979-1991) et l’adhésion du Vietnam à l’Asean en 1995.
Un développement progressif des liens bilatéraux
Depuis 2010, les deux pays ont multiplié les échanges sur les questions d’intérêt commun. Le format le plus médiatique consiste en la multiplication des visites officielles impliquant chefs d’État, premiers ministres, dirigeants des Assemblées nationales, législateurs, officiers et experts.
De manière plus pratique, l’approfondissement des liens a été structuré par le Plan d’action Philippines-Vietnam (2011-2016), qui comprenait un protocole d’accord pour établir une ligne téléphonique directe entre les garde-côtes philippins et la police maritime vietnamienne, ainsi qu’un protocole d’accord pour renforcer la coopération mutuelle et le partage d’informations entre les deux marines. Peu de temps après, les deux pays ont adopté une procédure opérationnelle standard pour les patrouilles conjointes (2012) et ont signé deux accords techniques importants aux côtés de l’ensemble de l’Asean : le Code pour les rencontres imprévues en mer (CUES) lors du symposium naval du Pacifique occidental de 2014, et les lignes directrices pour les rencontres maritimes (basées sur le règlement COLREG de l’Organisation maritime internationale) lors de la réunion des chefs de la marine de l’Asean (2017).
Les deux pays ont également engagé en 2014 une série de mesures visant à renforcer la confiance, telles que des matchs de football et de volley-ball joués dans des îles contrôlées par le Vietnam ou les Philippines dans les Spratleys (« diplomatie du football ») ; les déclarations de soutien de Hanoï à Manille à l’occasion de l’arbitrage de la Cour Permanente d’Arbitrage de La Haye en 2016 ; ainsi qu’un accord de pêche bilatéral. C’est notamment grâce aux dispositions contenues dans ce dernier accord que les garde-côtes vietnamiens ont, en 2019, sauvé 20 pêcheurs philippins perdus en mer qui étaient passés par-dessus bord après que leur navire ait été éperonné par un navire chinois, ce qui a également amélioré l’image publique du Vietnam aux Philippines.
Les Philippines et le Vietnam ont par ailleurs signé un partenariat stratégique en 2015, établi des lignes d’assistance téléphonique dédiées pour permettre une communication permanente et transparente entre leurs pêcheries respectives (2015) et les garde-côtes (2024) ; organisé des échanges de personnel à personnel et organisé l’escale de deux destroyers vietnamiens (Dinh Tien Hoang et Ly Thai De) à Manille en 2014, tandis qu’un accord de recherche scientifique marine était relancé entre les deux pays (2021).
Une alternative au code de conduite Asean-Chine ?
Les détails sont encore vagues concernant les perspectives d’un code de conduite minilatéral, mais l’annonce répétée d’un accord entre la Malaisie, les Philippines et le Vietnam a suscité une grande attention. Néanmoins, un tel accord, s’il devait être conclu, aurait du sens à la lumière des graves problèmes maritimes rencontrés par les deux pays face à un voisin chinois de plus en plus agressif.
Selon le projet China Power (CSIS), le Vietnam et les Philippines ont ainsi subi de plein fouet la guerre hybride et les techniques de la zone grise mises en place par Pékin (manipulation du droit international, déploiement d’une milice maritime, occupation de récifs et d’atolls, éperonnage de navires, etc.).
Les deux pays ont de bonnes raisons de douter des perspectives d’un code de conduite Asean-Chine, après deux décennies d’interminables négociations. Les pourparlers restent dans l’impasse en raison du refus de la Chine d’inclure dans l’accord le récif de Scarborough, revendiqué par les Philippines, comme l’archipel des Paracels, revendiqué par le Vietnam, car elle contrôle déjà les deux. De plus, la question de savoir si l’accord doit être ou non contraignant légalement semble insoluble.
Le président Marcos Jr. a exprimé la frustration de son pays face à cette absence de progrès, alors que les incidents désormais réguliers, à Scarborough Shoal comme à Second Thomas Shoal, en plus de la présence régulière et illégale – et des dommages environnementaux causés par la milice maritime chinoise (il s’agit de chalutiers disposant d’équipages composés de réservistes de l’armée et équipés de différents matériels afin de mener des missions de soutien à la marine et à la garde-côtes chinoise) à Iroquois Reef, Whitsun Reef et Sabina Shoal – pourraient bien inciter les deux pays à approfondir les pourparlers bilatéraux et minilatéraux.
Il faut dire que Manille avait déjà tenté en vain de négocier un code de conduite bilatéral avec la Chine dès 1982. Il n’est donc pas étonnant que le président Marcos ait qualifié le Vietnam de « seul partenaire stratégique de Manille en Asie du Sud-Est » et la coopération maritime entre les deux pays de « pierre angulaire de la relation bilatérale ».
Sur le plan technique, un code de conduite bilatéral entre Manille et Hanoï existe déjà, compte tenu du nombre de mémorandums, d’accords techniques, de coopération entre agences maritimes et des différentes lignes directes désormais en place. Une touche supplémentaire a récemment été ajoutée lorsque les deux pays ont indiqué leur désir de publier une version mise à jour des cartes de leurs zones maritimes, y compris de leurs zones économiques exclusives et de leurs plateaux continentaux, à la grande fureur de Pékin. Seule une couche politique semble manquer pour pouvoir l’appeler en fait un code de conduite.
Deux stratégies très complémentaires
Il semble évident que les Philippines et le Vietnam ont des stratégies complémentaires pour renforcer leurs moyens de sécurité maritime. Manille a récemment investi des ressources dans le renforcement de sa capacité de déni de zone (missiles Brahmos, radars aériens et navals) ainsi que de navires plus nombreux et plus gros, tandis que Hanoï s’est lancé dans un programme à grande échelle et controversé de modernisation et d’expansion de tous les éléments maritimes sous le contrôle du Vietnam en mer de Chine méridionale, soit neuf îles, îlots et bancs de sable et quatre hauts fonds ou récifs à marée basse qu’il a déjà commencé à poldériser depuis 2021.
Le Vietnam et les Philippines ont tous deux connu la mainmise de la Chine sur leurs territoires nationaux. Le Vietnam a perdu l’archipel des Paracels ainsi que plusieurs éléments maritimes après des batailles aussi humiliantes que sanglantes (dans l’archipel des Paracels en 1974 et à Johnson South Reef dans les Spratleys en 1988).
Les pertes de Manille, bien qu’elles aient eu lieu sans effusion de sang, n’ont pas été moins humiliantes : la Chine s’est d’abord emparée de Mischief Reef en 1994, qu’elle a ensuite transformée en une base militaire majeure, en plein milieu de la zone économique exclusive des Philippines, dès 2014. Humiliation supplémentaire, Pékin utilise désormais cette même base pour faciliter son blocus de l’avant-poste philippin assiégé constitué par le BRP Sierra Madre, échoué à Second Thomas Shoal. La saisie par la Chine en 2012 des importantes zones de pêche des Philippines à Scarborough Shoal contribue également à expliquer le sentiment d’urgence de Manille.
Pour toutes ces raisons, il semble que les relations bilatérales entre les Philippines et le Vietnam sont en bonne voie de devenir un partenariat durable et mutuellement bénéfique – un processus que Pékin, pour sa part, devrait rendre aussi difficile que possible.
Benjamin Blandin ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
14.05.2024 à 16:59
Avec l’arrivée de La Niña, des ouragans plus intenses sont-ils à craindre ?
Pedro DiNezio, Associate Professor of Atmospheric and Ocean Sciences, University of Colorado Boulder
Texte intégral (2989 mots)

L’épisode El Niño, l’un des principaux responsables des températures records mesurées dans le monde l’année dernière, est presque terminé. Son antagoniste, un épisode La Niña, est en route.
Un soulagement ? Cela dépend en partie de l’endroit où vous vivez. Des températures supérieures à la normale sont encore prévues aux États-Unis pour l’été 2024. Si vous vivez le long des côtes américaines de l’Atlantique ou du Golfe, La Niña pourrait contribuer à produire la pire combinaison possible de conditions climatiques favorable aux ouragans.
Pedro DiNezio, spécialiste de l’atmosphère et des océans à l’Université du Colorado, qui étudie El Niño et La Niña, explique ce qui nous attend.
Qu’est-ce que La Niña ?
La Niña et El Niño sont les deux extrêmes d’un schéma climatique récurrent qui peut affecter la météo dans le monde entier.
Les prévisionnistes considèrent qu’un épisode La Niña débute lorsque les températures dans l’océan Pacifique oriental, le long de l’équateur à l’ouest de l’Amérique du Sud, se refroidissent d’au moins un demi-degré Celsius par rapport à la normale. Pendant un épisode El Niño, au contraire, la même région se réchauffe.
Ces fluctuations de température peuvent sembler minimes, mais la façon dont elles affectent l’atmosphère se répercute sur l’ensemble de la planète.
Les tropiques présentent un schéma de circulation atmosphérique appelé « circulation de Walker », du nom de Sir Gilbert Walker, physicien anglais du début du XXe siècle. La circulation de Walker est essentiellement constituée de boucles géantes d’air qui montent et descendent dans différentes parties des tropiques.
Normalement, l’air monte au-dessus de l’Amazonie et de l’Indonésie, ce qui est favorisé par l’humidité des forêts tropicales (la vapeur d’eau étant plus légère que l’air sec). Il redescend ensuite en Afrique de l’Est et dans le Pacifique oriental.
Pendant un épisode La Niña, ces boucles s’intensifient, générant des conditions plus orageuses là où elles s’élèvent, et des conditions plus sèches là où elles descendent. Pendant El Niño, la chaleur de l’océan dans le Pacifique oriental déplace ces boucles, ce qui rend le Pacifique oriental plus orageux.
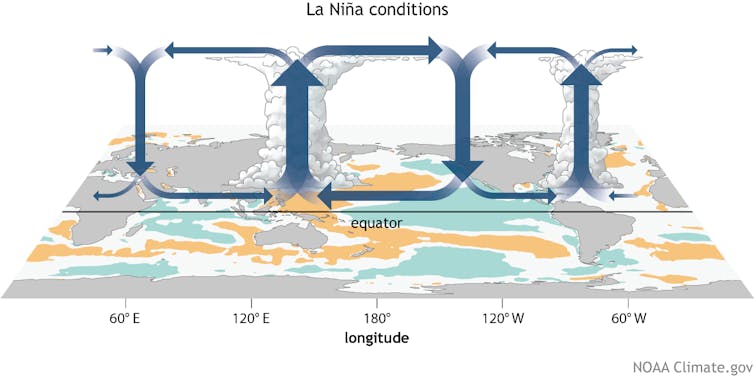
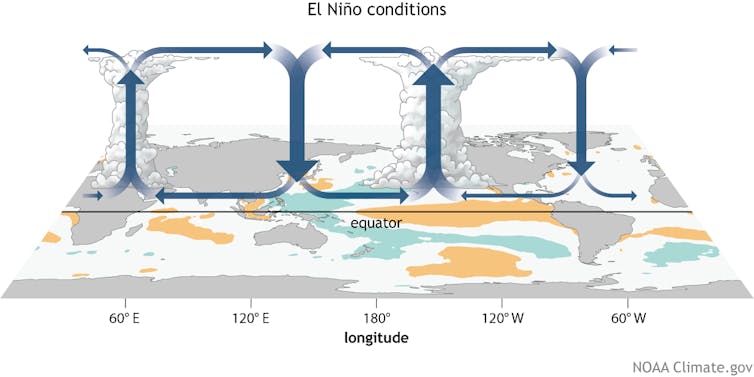
Les phénomènes EL Niño et La Niña affectent également le courant-jet (ou jet stream), un puissant courant d’air qui souffle d’ouest en est à travers les États-Unis et d’autres régions de latitude moyenne.
Pendant El Niño, le courant-jet a tendance à déplacer les tempêtes vers les régions subtropicales, ce qui rend ces régions habituellement sèches plus humides. À l’inverse, les régions des latitudes moyennes qui sont normalement touchées par les tempêtes deviennent plus sèches parce que les tempêtes s’en éloignent.
Cette année, les prévisionnistes s’attendent à une transition rapide vers un épisode La Niña, probablement à la fin de l’été. Après un épisode El Niño prononcé comme celui que le monde a connu fin 2023 et début 2024, les conditions tendent à basculer assez rapidement vers celles de La Niña.
La question de savoir combien de temps l’épisode va durer reste ouverte. Ce cycle a tendance à passer d’un extrême à l’autre tous les trois à sept ans en moyenne, mais si les épisodes El Niño ont tendance à être de courte durée, les épisodes La Niña peuvent durer plus de deux ans.
Le lien entre La Niña et les ouragans
Les températures dans le Pacifique tropical affectent également le cisaillement des vents sur de grandes parties de l’océan Atlantique.
Le cisaillement du vent est une différence de vitesse du vent à différentes hauteurs ou dans différentes directions. Les ouragans ont plus de mal à maintenir la structure de leur colonne en cas de fort cisaillement du vent, car les vents plus forts en altitude poussent la colonne à s’écarter.
[Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd'hui]
Un épisode La Niña produit moins de cisaillement du vent, alors que celui-ci freine généralement les ouragans. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour les habitants des régions exposées aux ouragans comme la Floride. En 2020, lors de la dernière période La Niña, l’Atlantique a connu un nombre record de 30 tempêtes tropicales et de 14 ouragans. En 2021, il s’agissait de 21 tempêtes tropicales et de 7 ouragans.
Les prévisionnistes annoncent d’ores et déjà que la saison des tempêtes de l’Atlantique de cette année pourrait rivaliser avec celle de 2021, en grande partie à cause de La Niña. L’Atlantique tropical a également été exceptionnellement chaud, avec la température des eaux de surface qui bat des records depuis plus d’un an. Cette chaleur affecte l’atmosphère et provoque davantage de mouvements atmosphériques au-dessus de l’Atlantique, ce qui alimente les ouragans.
Avec La Niña, le retour de la sécheresse dans le sud-ouest des États-Unis ?
Les réserves d’eau du sud-ouest des États-Unis seront probablement suffisantes pour la première année de La Niña en raison de toutes les pluies tombées au cours de l’hiver dernier. Mais la deuxième année tend généralement à devenir problématique. Une troisième année La Niña, comme celle que la région a connue en 2022, pourrait entraîner de graves pénuries d’eau.
Les conditions plus sèches alimentent également des feux de forêt plus violents dans l’Ouest, en particulier à l’automne, lorsque les vents se lèvent.
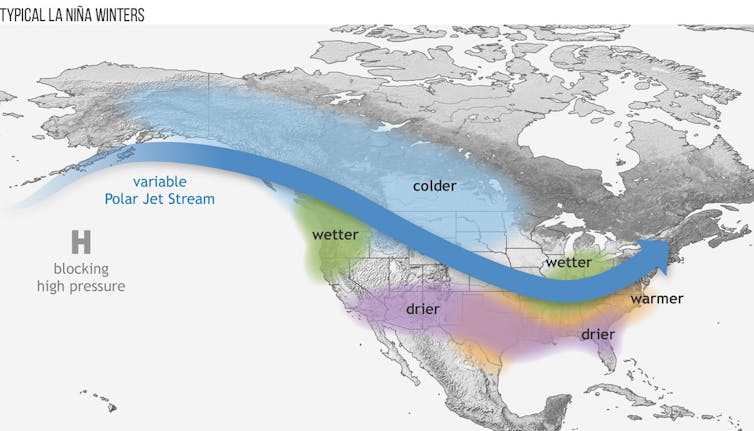
La Niña dans l’hémisphère sud
Les effets d’El Niño et de La Niña sont presque identiques dans l’hémisphère sud, à quelques différences notables près.
Le Chili et l’Argentine ont tendance à souffrir de la sécheresse pendant La Niña, tandis que les pluies s’intensifient en Amazonie. L’Australie a connu de graves inondations lors du dernier épisode La Niña. La Niña favorise également la mousson en Inde, ce qui se traduit par des précipitations supérieures à la moyenne. Les effets ne sont toutefois pas immédiats. En Asie du Sud, par exemple, les changements tendent à se manifester quelques mois après l’apparition officielle de La Niña.
Les épisodes La Niña sont dangereux pour l’Afrique de l’Est, où des communautés vulnérables sont déjà confrontées à une sécheresse de longue durée.
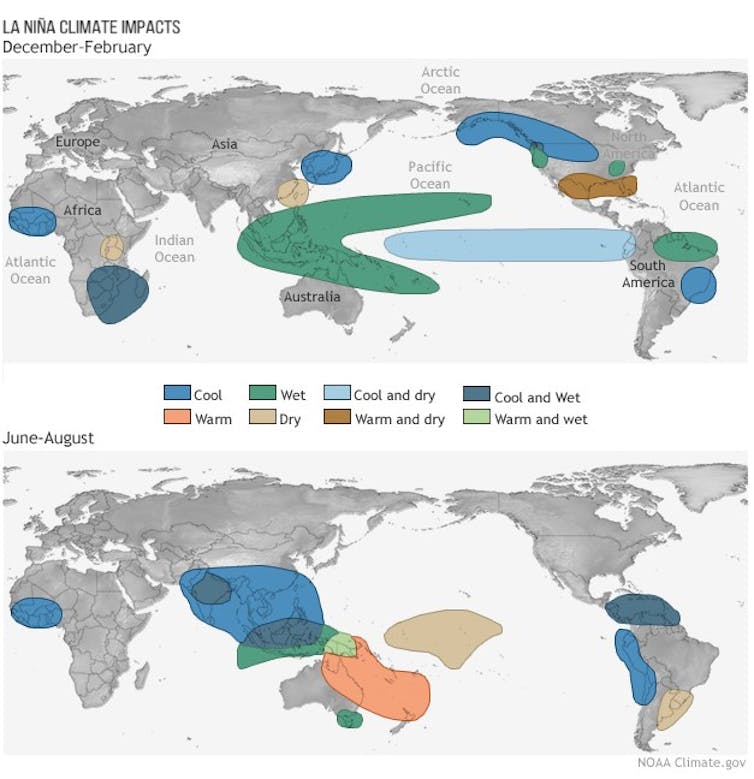
L’impact du changement climatique
Les phénomènes El Niño et La Niña se surajoutent aux effets du réchauffement climatique. Cela peut exacerber les températures, comme le monde l’a vu en 2023, et faire bondir le cumul des précipitations.
Depuis l’été 2023, le monde a connu dix mois consécutifs de températures mondiales records. Une grande partie de cette chaleur a été stockée dans les océans, qui affichent toujours des températures records.
La Niña devrait rafraîchir un peu la situation, mais les émissions de gaz à effet de serre, qui sont à l’origine du réchauffement de la planète, continuent d’augmenter en arrière-plan. Ainsi, même si les fluctuations entre El Niño et La Niña peuvent entraîner des variations de température à court terme, la tendance générale reste au réchauffement de la planète.
Pedro DiNezio a reçu des financements de la National Science Foundation américaine (NSF).
14.05.2024 à 16:59
Mobilisations pour Gaza : sur les campus américains, où en est la liberté de manifester ?
Alessia Lefébure, Sociologue, membre de l'UMR Arènes (CNRS, EHESP), École des hautes études en santé publique (EHESP)
Texte intégral (2320 mots)
Depuis la mi-avril, plusieurs dizaines de campus américains sont occupés par leurs étudiants au nom de la défense des populations civiles de Gaza et de la condamnation du soutien militaire et financier des États-Unis à Israël. Pour de nombreux observateurs, l’ampleur de ce mouvement rappelle les manifestations contre la guerre du Vietnam et le racisme des années 1960, ainsi que le mouvement anti-apartheid des années 1980, qui avait contribué à isoler l’Afrique du Sud sur la scène internationale.
Dépassant, comme autrefois, les frontières américaines, l’action des étudiants de 2024 semble motivée par une indignation morale similaire. Cependant, dans l’Amérique contemporaine, la tolérance de l’administration envers la dissidence semble décliner dans toutes les universités, privées comme publiques.
La liberté de manifester des étudiants est garantie constitutionnellement aux États-Unis, depuis presque autant de temps qu’en France. Issue de la Révolution française, cette liberté fut en effet proclamée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 dans son article 11. Aux États-Unis, son fondement juridique est le premier amendement de la Constitution américaine de 1791, celui qui garantit la liberté d’expression et d’information, principe fondateur de l’identité nationale, contre toute restriction, notamment venant du pouvoir politique.
Dans les deux pays, les étudiants jouissent ainsi du droit à l’expression et à l’information, dans le respect de l’équilibre nécessaire entre la préservation des activités académiques et le maintien de l’ordre public. Que ce soit à San Diego ou à Paris, l’intervention policière sur le campus ne peut avoir lieu qu’à la demande ou avec l’autorisation préalable du président de l’université.
Sur les campus américains, un appel aux forces de l’ordre controversé
Lors des récents affrontements survenus à Columbia et à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA), c’est précisément à l’initiative des présidents des établissements que la police est intervenue. Le principe général de responsabilité des présidents d’université demeure similaire en France et aux États-Unis. Néanmoins, la crise qui secoue les campus américains met en lumière des enjeux spécifiques pour la gouvernance universitaire, à court et à long terme.
Pour avoir qualifié une manifestation, initialement pacifique, de « danger clair et immédiat pour le fonctionnement substantiel de l’université », la présidente de Columbia, Minouche Shafik, a été critiquée par une grande partie de la faculté. Sa déclaration a entraîné l’arrestation de plus de 100 étudiants par le NYPD, le service de police de la ville de New York, ainsi que des suspensions de cours pour une partie des jeunes concernés. D’autres mesures ont suivi, telles que le passage des cours en modalité distancielle et l’annulation de la traditionnelle cérémonie de remise des diplômes.
La décision de faire appel aux forces de l’ordre est survenue à la suite d’une audition parlementaire au cours de laquelle la présidente de Columbia a été violemment attaquée par l’élue républicaine de l’État de New York Elise Stefanik, qui est actuellement l’un des principaux soutiens de Donald Trump dans la campagne présidentielle.
L’audition s’inscrivait dans un contexte déjà sensible. Depuis le 7 octobre 2023, les manifestations étudiantes, les sit-in et les appels au boycott d’Israël et de ses partenaires économiques et militaires ont amené plusieurs présidents et présidentes d’université à comparaître devant le Congrès. N’ayant pas réussi à convaincre de la pertinence de leurs actions en défense de la liberté académique et d’expression, certaines, comme la présidente de Harvard et celle de l’Université de Pennsylvanie, ont été contraintes à la démission suite à des accusations d’antisémitisme. Pour ne pas subir le même sort et démontrer qu’elle ne discriminait pas les étudiants juifs, la présidente de Columbia a donc décidé de faire appel à la police pour déloger la centaine d’étudiants qui occupaient pacifiquement la pelouse centrale du campus de Morningside, à Manhattan.
Une intervention policière d’une telle ampleur n’avait pas eu lieu à Columbia depuis mai 1968, ce qui a profondément choqué les étudiants ainsi que le corps enseignant, attaché à l’indépendance académique et à la liberté d’expression. Les professeurs membres de l’Association américaine des professeurs d’université (AAUP), toutes confessions et ethnies confondues, ont appelé le 2 mai à un vote de défiance contre la présidente Shafik.
Fortement médiatisée, Columbia n’est pas un cas unique. Dans une lettre ouverte adressée le 29 avril à tous les présidents des universités du pays, l’ACLU (Union américaine pour les libertés civiles) a cru utile de rappeler quelques lignes directrices pour garantir la liberté d’expression et académique tout en luttant contre les discriminations et les perturbations : éviter de sanctionner ou censurer des points de vue spécifiques, protéger les étudiants contre le harcèlement discriminatoire et la violence, permettre aux étudiants de s’exprimer sur le campus, reconnaître que la présence de la police armée sur le campus peut mettre les étudiants en danger et ne peut être qu’un dernier recours, enfin résister aux pressions politiques qui cherchent à instrumentaliser les tensions universitaires.
Des présidents d’universités soumis aux exigences fédérales et à la pression des donateurs
Aux États-Unis, les universités jouissent d’une très grande liberté académique. Dans ce cadre, elles peuvent prendre des positions politiques voire, sur le plan institutionnel, s’engager dans des boycotts et des désinvestissements spécifiques. Comme tous les établissements recevant des subventions publiques fédérales, elles doivent respecter la « non-discrimination sur la base de la race, des opinions politiques ou de la religion », comme le stipule le Titre VI du Civil Rights Act de 1964. La violation de cette législation antidiscriminatoire peut entraîner une coupure des fonds par le Congrès, ce qui représente une sanction financièrement significative. La crainte de perdre ces financements peut avoir motivé les arbitrages en faveur de la répression.
L’exemple de Columbia est, une fois de plus, éclairant. Pour expliquer les fondements de sa décision de solliciter l’intervention policière, la présidente Shafik, dans une déclaration publiée le 29 avril, invoque la sécurité physique de tous les membres de la communauté universitaire, notamment celle des étudiants et des professeurs juifs, la nécessité de respecter les droits de chacun à s’exprimer, la condamnation de la haine, du harcèlement, de la discrimination, notamment des propos et des actes antisémites.
Dans l’Amérique d’aujourd’hui, les présidents d’université sont soumis à une double contrainte : ils doivent répondre aux exigences du gouvernement fédéral pour maintenir le financement, tout en satisfaisant les donateurs, qui pourraient se désengager des institutions perçues comme antisémites ou xénophobes. Cette position est d’autant plus délicate que toute maladresse est immédiatement amplifiée par les réseaux sociaux.
À lire aussi : Quand le conflit israélo-palestinien déborde sur les campus américains
L’importance de l’argent dans le maintien du prestige et de l’excellence scientifique des universités américaines n’est pas nouvelle. L’écrivaine, militante et intellectuelle afro-américaine bell hooks l’évoque dans les souvenirs de ses années d’études à l’université Stanford dans les années 1970 :
« Stanford était un endroit où l’on pouvait apprendre ce qu’était la classe sociale dès le départ. On parlait de classe en coulisses. Les fils et filles des familles riches, célèbres ou notoires, étaient identifiés. Les adultes qui s’occupaient de nous étaient toujours à l’affût d’une famille qui pourrait donner ses millions à l’université. »
Au-delà des récents événements et du contexte électoral, la prudence des présidents et de l’administration reflète une tendance de fond dans l’évolution de l’enseignement supérieur américain et de son modèle économique. Les universités, tant privées que publiques, dépendent désormais plus des frais de scolarité et de la générosité des donateurs individuels que des financements publics. Les controverses liées à la liberté d’expression sur le campus peuvent sérieusement ternir la réputation des universités les plus anciennes et prestigieuses, affectant ainsi leurs capacités de financement.
À lire aussi : La liberté académique des enseignants est-elle en danger sur les campus américains ?
Comme ce fut le cas lors des mobilisations dans les campus américains au cours des deux dernières décennies, sur des sujets tels que la cancel culture, le désinvestissement des fonds de dotation universitaires dans les énergies fossiles, ainsi que lors de l’émergence du mouvement « Black Lives Matter », tous les débats récents sur la liberté d’expression dans les campus américains évoquent des préoccupations profondes quant à l’indépendance académique et à la manière de gérer les attentes des donateurs sans sacrifier ce principe. L’équilibre entre les deux est essentiel pour préserver la capacité des universités à mener des recherches et à enseigner de manière critique.
À plus court terme, les présidents et les administrations font également les frais du climat de fortes tensions politiques et sociales, exacerbées par le contexte électoral. L’instrumentalisation politique des manifestations universitaires est une tentation évidente pour les conservateurs américains qui dénoncent régulièrement la « cancel culture » et le « wokisme ».
France et États-Unis : des modèles de gouvernance différents
Comparativement à la situation aux États-Unis, le paysage universitaire français est marqué par une moindre médiatisation et une dépendance économique différente, avec un financement de l’enseignement supérieur principalement issu de l’État. La philanthropie fondée sur le mécénat, les dons des particuliers et les fondations représentent encore une part modeste des ressources des universités et des établissements français.
Par ailleurs, les présidents d’université en France sont élus à la majorité absolue des membres du conseil d’administration, et pour un mandat de cinq ans. Cette modalité leur offre une certaine protection contre les exigences des financeurs comparativement à leurs homologues américains.
Ces différences de modèle économique et de gouvernance mettent en exergue la vulnérabilité du modèle des grandes universités de recherche américaines face aux pressions externes.
Politiques et donateurs oublient souvent que les universités sont des lieux qui, par le développement de l’esprit critique, préparent les étudiants à adopter, si nécessaire, une attitude politique oppositionnelle.
S’exprimant dans les pages de la revue The New Yorker, l’écrivaine britannique Zadie Smith observait à propos des occupations de campus qu’« une partie du sens de toute manifestation étudiante réside dans la manière dont elle offre aux jeunes l’opportunité de défendre un principe éthique tout en restant, comparativement parlant, une force plus rationnelle que les responsables, supposément rationnels ».
Les événements récents rappellent l’importance cruciale du dialogue respectueux et de la garantie de la liberté d’expression, même pour les points de vue les plus discordants. Dans le cas américain, la répression et le silence imposé aux voix dissidentes n’ont fait qu’alimenter le ressentiment et la frustration, conduisant parfois à la violence verbale et physique. L’éducation à l’expression d’une pensée critique semble aujourd’hui plus que jamais fondamentale au développement de citoyens engagés et conscients des enjeux de nos démocraties.
Alessia Lefébure a enseigné à l'université Columbia entre 2011 et 2017
14.05.2024 à 16:58
Ce que le livre d’occasion dit de la lecture
Claude Poissenot, Enseignant-chercheur à l'IUT Nancy-Charlemagne et au Centre de REcherches sur les Médiations (CREM), Université de Lorraine
Texte intégral (2106 mots)

Depuis une dizaine d’années, le marché du livre d’occasion est en croissance. Alors que les acheteurs de livres neufs diminuent (de 5 et 12 % selon les sources) entre 2014 et 2022, les acheteurs de livres d’occasion sont de plus en plus nombreux (entre 27 % et 37 %). Autrement dit, l’achat de livres aurait sensiblement diminué sans le concours du marché de l’occasion. Ce phénomène de recomposition des pratiques d’accès aux livres (qui inclut les boîtes à livres) s’opère discrètement mais une étude pour la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA) sur le marché du livre d’occasion nous permet de le questionner. Plus précisément, on peut se demander ce que ces changements révèlent du rapport de nos contemporains à la lecture.
Le papier, support privilégié des lecteurs
Nous sommes entourés d’écrans et nous leur consacrons beaucoup de temps (3h14 par jour chez les 15 ans et plus selon l’enquête du CNL de 2023). Depuis le début des années 2000, les innovations numériques ont régulièrement alimenté les débats sur la fin du livre. Or, le papier demeure un support privilégié de la lecture de livre. En 2022, c’est au maximum 5 % des livres achetés qui le sont en format numérique contre 15 % d’occasions et 80 % de neuf environ. Et cette répartition est stable depuis 2017. La submersion du livre numérique n’a toujours pas eu lieu et on est donc loin de la fin du livre depuis qu’il est stabilisé sous la forme du codex imprimé sur du papier… C’est que les lecteurs trouvent dans le papier une matérialité adaptée à leurs pratiques. Ils apprécient ce support qui les change des écrans.
[Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]
Et il faut rappeler cette présence massive du livre afin d’en prendre la mesure. Les instituts Kantar et GfK estiment entre 234 et 320 millions le nombre de livres neufs vendus par an entre 2014 et 2022 auxquels s’ajoutent entre 48 et 80 millions de livres d’occasion. Cela représente des volumes considérables qui marquent notre société. Par comparaison c’est nettement plus que le nombre de CD à son sommet en 2002 (plus de 150 millions).
De quoi la matérialité est-elle le signe ?
Le livre d’occasion repose sur l’idée d’une propriété temporaire et non exclusive. Les lecteurs qui revendent ou qui achètent acceptent qu’un même livre change de propriétaire. L’enquête montre que 66 % à 73 % des acheteurs d’imprimés ne s’approvisionnent que sur le marché du neuf. Ils envisagent l’achat du livre comme une histoire commune qui démarre par le neuf. Le livre encore immaculé apparaît comme la page blanche d’une histoire à écrire, celle de la relation entre lecteur, texte et auteur. Le marché du livre repose sur cette promesse implicite. Il est des livres qui nous ont construits et dont il serait difficile de se priver car ils nous relient à nous-mêmes.
Cette situation dominante est toutefois en train de changer puisque la part des acheteurs exclusifs de neuf a reculé de 5 à 8 points de 2014 à 2022. À l’inverse, les « mixeurs » qui achètent du neuf et de l’occasion a augmenté et atteint désormais de 23 à 28 %. Cette population conjugue des pratiques d’achats différentes selon l’intention qui les habite.
Mais l’enquête montre qu’« un acheteur d’occasion revend […] davantage ses livres (achetés neufs ou d’occasion) qu’un acheteur de neuf. » Quand la norme de l’achat neuf est transgressée, celle de ne pas revendre ses livres l’est également. Le rapport à l’objet l’emporte sur l’objet lui-même. Le lecteur fait prévaloir son autonomie sur le « respect » dû à l’objet. Cet assouplissement du rapport au livre marque le marché du livre puisque ces « mixeurs » procèdent à 42 à 47 % des achats de livres. Le livre fétiche d’une croyance collective cède peu à peu sa place au livre choisi, élu (ou revendu) au gré d’une décision personnelle. Et les acheteurs d’occasion sont souvent en veille, attendant la disponibilité d’un titre précis (40 % le font systématiquement ou souvent). « Je » décide, y compris d’attendre la bonne occasion.
Poche ou grand format ?
Mais peut-on repérer ce qui fait d’un livre qu’il sera acheté neuf ou d’occasion, conservé ou, au contraire, remis sur le marché de l’occasion ?
Le format poche se révèle plus propice à la revente que le grand format. Ce résultat étonnant montre que l’attachement au livre passe par ce critère. Plus grand, plus cher, peut-être plus souvent offert ou reçu en cadeau, le grand format fait l’objet d’un investissement (subjectif et objectif) plus important que le poche. Il remplit davantage une fonction de trace mémorielle.
À l’inverse, le format de poche est plus souple dans sa matérialité et dans le rapport que l’on entretient avec. Quand il s’agit d’acheter d’occasion, les lecteurs se concentrent sur le contenu plutôt que le format.
Livres illustrés encore plus supports de soi ?
Quand on demande aux lecteurs le type de livre qu’ils achèteraient plutôt en neuf ou en occasion, on perçoit une différence assez sensible entre la littérature (tous genres confondus) d’une part et les beaux livres et livres d’art ainsi que les BD, mangas, comics d’autre part. La littérature arrive en tête dans les livres que les lecteurs sont prêts à acheter d’occasion là où les autres genres sont préférentiellement achetés neufs. Ce résultat est surprenant car beaux livres et BD sont plus chers que les autres. La logique de réduction des coûts par l’occasion semble trouver ici une limite que l’on peut essayer d’interpréter.
Les types de livre le moins achetés d’occasion ont en commun de comporter des images. Les lecteurs semblent vouloir être les premiers à se les approprier. À l’inverse, la lecture de roman conduit à la production d’images mentales qui dépendent peu ou pas de l’apparence du livre, lequel peut être plus facilement acheté d’occasion. Le virage de la culture vers l’audiovisuel affecte aussi le livre (neuf comme occasion) en accordant une place plus importante aux images mais aussi en suscitant chez les lecteurs un intérêt accru pour elles.
La fracture entre petits et gros lecteurs
Le marché du livre neuf et de l’occasion donne à voir une distribution des lecteurs très inégale selon l’intensité de leurs pratiques. Pour le neuf, les petits acheteurs (1 à 4 livres par an) sont deux fois plus nombreux que les gros acheteurs (12 et plus). En revanche, ils pèsent nettement moins dans les ventes que les gros car ceux-ci cumulent autour de 35 achats en moyenne. Et cette tendance s’est plutôt renforcée en 2021 et 2022 par rapport à 2018. On assiste donc à une concentration des ventes de livres dans une part réduite de la population. Cette tendance s’observe de façon très semblable pour le marché de l’occasion.
Ces constats entrent en totale cohérence avec l’évolution des pratiques de lecture. L’enquête « Pratiques culturelles des Français » de 2018 montrait de façon très nette une augmentation de la part des 15 ans et plus à déclarer n’avoir lu aucun livre dans l’année alors que la part des lecteurs intensifs avait cessé de diminuer. Une sorte de fracture semble s’opérer entre des non-lecteurs plus nombreux et des lecteurs intensifs qui maintiennent voire accentuent leurs pratiques.
Défendre son pouvoir d’achat
L’occasion est bien sûr un moyen de faire des économies. C’est la possibilité de conserver des pratiques en réduisant leur coût. Et quand on interroge les acheteurs d’occasion, 76 % mettent en avant le souci de faire des économies alors que la motivation écologique n’est citée que par un tiers d’entre eux. La fin du mois est bien prioritaire.
Et en effet, le prix de l’occasion est en moyenne 2,5 fois moins élevé que celui du neuf. Et pour certains types de livres, cela peut se révéler important. Ainsi, les livres jeunesse dont les ventes ont été quasi stables (+1 %) pour le neuf entre 2014 et 2022 ont augmenté de 56 % pour l’occasion. La lecture aux jeunes enfants demande un volume de titres important car ce sont souvent des livres peu épais et illustrés et dont la lecture est régulière, voire quotidienne. Dès lors elle peut donc constituer un budget élevé. Et d’ailleurs, l’achat d’occasion concerne davantage les foyers avec enfants que les foyers sans. L’occasion peut prendre place en complément de pratiques d’emprunt en bibliothèques publiques dont on sait que les sections jeunesse totalisent 38 % du volume total des prêts.
L’achat d’occasion intéresse aussi des catégories de population au pouvoir d’achat modeste. Les étudiants soutiennent ainsi le secteur des livres universitaires et les catégories populaires le secteur des livres pratiques dont les ventes ont presque doublé entre 2014 et 2022. Mais l’achat d’occasion concerne tous les segments de l’édition et donc tous les publics. Par exemple, l’étude estime qu’un roman sur trois (tous genres confondus) est acheté d’occasion.
Le marché de l’occasion apparaît donc comme une opportunité ou une nécessité mais ne constitue pas un marché réservé aux personnes les moins favorisées. L’émergence des plates-formes en ligne a finalement démocratisé l’accès au livre d’occasion au sens où il s’est ouvert à un public plus large que les étudiants et catégories populaires urbaines.
D’ailleurs les acteurs traditionnels de l’occasion (braderies, marchés, brocantes et bouquinistes) ne sont cités que par 18 % des acheteurs d’occasion, ce qui montre que l’essentiel du marché passe désormais par le numérique.
En croissance, le marché de l’occasion est porté par les catégories défavorisées et les jeunes qui l’utilisent pour revendre plus que les autres catégories. La nécessité de réduire les dépenses du foyer prévaut. Et l’enquête montre d’ailleurs que, globalement deux tiers des vendeurs écoulent moins de 10 livres par an pour un gain inférieur à 50 euros. Une taxe réduirait l’attractivité du marché et concernerait en premier lieu des particuliers en lutte pour défendre leur pouvoir d’achat. Elle ne permettrait pas de promouvoir la lecture.
Claude Poissenot ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
14.05.2024 à 11:24
L’activité physique, une alliée incontournable pour la santé de notre cerveau
Béatrice Degraeve, Enseignant-Chercheur en Neuropsychologie, Institut catholique de Lille (ICL)
Texte intégral (1997 mots)
En plus d’être bénéfique pour notre corps, l’activité physique joue aussi un rôle crucial, souvent insoupçonné, dans le développement et la modification de notre cerveau.
À travers la naissance de nouveaux neurones (la neurogenèse) et la création de connexions entre les neurones (la synaptogenèse) et de vaisseaux sanguins qui améliorent l’irrigation du cerveau (angiogénèse), l’activité physique sculpte le cerveau au même titre que le muscle et participe à améliorer nos capacités cognitives.
Cognition et bien-être améliorés grâce à l’activité physique
À travers ces modifications structurales (c’est-à-dire la neurogénèse, la synaptogenèse et l’angiogenèse…), les impacts de l’activité physique sont multiples.
Sur le plan cognitif, de nombreux travaux ont mis en lumière une amélioration significative de la mémoire, de l’attention, de la vitesse de traitement de l’information et même de la créativité chez les individus physiquement actifs. Ces changements fonctionnels sont le résultat direct des modifications structurelles et physiologiques induites par l’activité physique.
Des effets bénéfiques ont également été observés sur la prévention du déclin cognitif lié à l’âge. Une méta-analyse – un travail de recherche qui mène une analyse statistique en combinant les données de différentes études* – comprenant 15 études longitudinales et totalisant 33 816 participants âgés de plus de 55 ans (sans antécédents de démence) a été conduite pour évaluer l’influence de l’activité physique sur le déclin cognitif.
Les résultats montrent que les individus pratiquant une activité physique régulière et soutenue diminuaient de 38 % le risques de développer des troubles cognitifs comparés aux individus sédentaires.

Chaque mardi, notre newsletter « Et surtout la santé ! » vous donne les clés afin de prendre les meilleures décisions pour votre santé (sommeil, alimentation, psychologie, activité physique, nouveaux traitements…)
Sur le plan émotionnel, l’activité physique influence également notre santé mentale, en réduisant les symptômes de la dépression et de l’anxiété, grâce à la régulation de certains neurotransmetteurs (tels que la sérotonine et la dopamine).
Des résultats récents ont par ailleurs mis en évidence que les bénéfices de l’activité physique sur le plan émotionnel étaient particulièrement importants chez des individus ayant un faible niveau d’activité physique antérieur.
De plus, étant donné que la dépression et l’anxiété nuisent à des aspects importants de notre cognition (comme l’attention, la concentration, la mémoire, la vitesse de traitement de l’information ou encore la prise de décision), l’activité physique peut jouer un rôle protecteur pour les individus touchés par ces troubles.
En pratique : quelle routine d’activité physique adopter ?
Les experts et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommandent au moins 150 minutes d’activité aérobie d’intensité modérée par semaine (ou 75 minutes d’activité plus intensive) combinée à des exercices de musculation deux fois par semaine. Par jour, entre 5000 et 7000 pas sont recommandés chez l’adulte.
Au-delà des exercices physiques et sportifs (correspondant à toutes activités aérobiques, qui nécessitent un apport important en oxygène comme la course à pied ou la natation, ou musculaires planifiées, structurées et répétitives, avec ou sans compétitions), l’activité physique comprend également les activités de la vie quotidienne (marcher, monter les escaliers, tondre la pelouse, jardiner, faire le ménage…).
Courir, nager, danser – mais aussi tondre la pelouse, promener son chien, ou prendre les escaliers plutôt que l’ascenseur – sont autant d’activités accessibles qui peuvent contribuer à la santé de notre cerveau.
Quels mécanismes cérébraux sont à l’œuvre ?
Explorons comment l’activité physique régulière ne se contente pas de remodeler notre silhouette, mais façonne également l’architecture même de notre cerveau.
– La naissance de nouveaux neurones
La naissance de nouveaux neurones ou neurogenèse a été pendant longtemps considérée comme un processus se limitant à la période de développement embryonnaire. Toutefois, des études ont montré que l’exercice physique stimule la neurogenèse chez l’adulte, et ce particulièrement dans l’hippocampe, une structure clé dans les processus de mémorisation et d’apprentissage.
Parallèlement, les activités nécessitant un apport important en oxygène, comme la course à pied ou la natation (aussi appelées exercices aérobie) favorisent la libération de ce que l’on appelle des facteurs de croissance (tels que le BDNF pour l’anglais Brain-Derived Neurotrophic Factor ou facteur neurotrophique dérivé du cerveau), des protéines essentielles à la survie et à la croissance des neurones existants ainsi qu’au développement de nouvelles cellules cérébrales.
– Une augmentation du volume cérébral à tous les âges
D’autres recherches ont montré que l’activité physique régulière modifie aussi la structure de notre cerveau : elle augmente le volume de certaines structures cérébrales, notamment de l’hippocampe et des régions préfrontales. L’hippocampe (situé dans le lobe temporal) est une structure essentielle pour la mémoire et l’apprentissage tandis que le cortex préfrontal est impliqué dans des fonctions dites exécutives (de haut niveau) telles que le raisonnement, la planification, l’inhibition, la prise de décision, la résolution de problème…
Ces changements ont été observés quel que soit l’âge des sujets, tant à l’âge adulte, dans l’enfance, l’adolescence et même chez les personnes âgées. Chez ces derniers, la pratique régulière d’une activité physique pourrait constituer un facteur neuroprotecteur du risque de développer des pathologies neurodégénératives. La réalisation d’activités physiques régulières contribue donc à la santé et au développement du cerveau, tant chez le jeune que l’adulte vieillissant.
Des travaux chez l’animal suggèrent que ces changements structurels pourraient s’accompagner d’une amélioration de la connectivité entre les différentes zones du cerveau (en créant de nouvelles synapses, ces régions où ont lieu les interactions entre cellules nerveuses), ce qui rendrait la communication plus efficace entre neurones plus efficaces.
– Une meilleure oxygénation et irrigation
L’activité physique améliore enfin l’irrigation du cerveau. En augmentant le débit sanguin, l’activité physique (en particulier aérobie) stimule la création de nouveaux vaisseaux sanguins. Ce processus, nommé angiogenèse, améliore l’efficacité de l’apport d’oxygène et de nutriments aux neurones.
L’activité physique est aussi un moteur de la plasticité cérébrale
En stimulant la création de nouveaux neurones et la formation de connexions synaptiques, l’activité physique agit comme un puissant moteur de la plasticité cérébrale. On nomme « plasticité cérébrale » la capacité du cerveau à se remodeler en réponse aux stimulations de l’environnement, en modifiant la force des connexions entre les neurones ou en formant de nouvelles voies neuronales.
Cette adaptabilité du cerveau est cruciale pour l’apprentissage, la mémoire, mais aussi la réorganisation après une lésion cérébrale. Cette capacité est essentielle tout au long de la vie, permettant des améliorations cognitives et une résilience accrue face au vieillissement et aux maladies neurodégénératives.
Dans le contexte de pathologies neurologiques telles que la sclérose en plaques, l’activité physique adaptée se révèle être un outil précieux, non seulement pour la réhabilitation motrice, mais aussi pour la réhabilitation cognitive.
Désormais, les mécanismes à l’œuvre au niveau cérébral quand on pratique une activité physique sont bien connus. Pour bénéficier pleinement de ces effets, il n’est pas nécessaire de devenir un athlète de haut niveau : une routine d’activité physique modérée mais régulière est suffisante.
Cet article a été co-écrit par Béatrice Degraeve (Université Catholique de Lille, Lille, France), Bruno Lenne (Université Catholique de Lille, FranceETHICS (EA7446) Groupement des hôpitaux de l’institut catholique de Lille GHICL, neurology department, Lille, France), Caroline Massot (Groupement des hôpitaux de l’institut catholique de Lille GHICL, rehabilitation department, France Université Catholique de Lille, Lille, France UPHF, LAMIH, Valenciennes, CNRS, UMR 8201, Valenciennes, France), Laurent Zikos (Université Catholique de Lille, Lille, France).
Béatrice Degraeve ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
14.05.2024 à 11:24
Pour booster son cerveau, quelles activités physiques privilégier après 60 ans ?
Neva Béraud-Peigné, Doctorante en sciences du mouvement, Université Paris-Saclay
Alexandra Perrot, Maitre de conférences HDR, Université Paris-Saclay
Pauline Maillot, Maître de conférences en STAPS, Université Paris Cité
Texte intégral (2091 mots)
Combiner des activités d'endurance à du renforcement musculaire, pratiquer des sports collectifs mais aussi s'adonner à des jeux vidéo interactifs qui font bouger… voici quelques pistes pour aider à booster son cerveau et ses capacités cognitives après 60 ans.
Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle nous avions un cerveau ? La réponse évidente pourrait être «pour penser». Mais le scientifique Daniel Wolpert réplique une tout autre explication, lors de la réunion de la Society for Neuroscience en 2011 : «Nous avons un cerveau pour une raison et une seule : produire des mouvements adaptables et complexes». Notre cerveau est le chef d'orchestre de notre corps, en organisant nos mouvements et nos actions.
Solliciter son cerveau pour qu'il reste efficace
Se concentrer, acquérir des connaissances, raisonner, s'adapter et interagir avec les autres : toutes ces facultés qui permettent d'être en interaction avec l'environnement sont regroupées dans ce que l'on appelle les capacités cognitives. Elles jouent un rôle crucial dans les activités de la vie quotidienne et permettent de maintenir une bonne qualité de vie.
Leur détérioration, au même titre que celle des fonctions physiques, affecte la qualité de vie et perturbe le quotidien des personnes. Il est donc important de solliciter un maximum notre cerveau afin qu'il reste efficace le plus longtemps possible.

Chaque mardi, notre newsletter « Et surtout la santé ! » vous donne les clés afin de prendre les meilleures décisions pour votre santé (sommeil, alimentation, psychologie, activité physique, nouveaux traitements…)
Contrairement à la croyance populaire, le cerveau ne se détériore pas continuellement avec l'âge. Dès 45 ans, il subit un vieillissement normal qui conduit à une diminution, notamment, du nombre de neurones et de l'efficacité des connexions. Mais la plasticité cérébrale, bien que réduite, est présente jusqu'à la fin de la vie. Chaque individu va se créer une «réserve cognitive» pendant toute sa vie.
Plus le style de vie est positif, riche et stimulant, plus la réserve est puissante et efficace. Il est possible de modérer les effets que l'avancée en âge exerce sur la cognition, ce qui représente une formidable opportunité pour les personnes qui n'auraient pas eu la chance d'accéder à un style de vie riche.
Les bénéfices de l'activité physique sur les capacités cognitives après 60 ans
De nombreux travaux ont montré que l'activité physique améliorait les capacités cognitives, même après 60 ans. Gain de mémoire, meilleure réactivité, plus fortes capacités de planification : les bénéfices sont multiples.
Malgré cela, les seniors restent peu nombreux à pratiquer de l’activité physique adaptée à leur situation de santé, de manière suffisamment soutenue. Le manque d'envie, d'accessibilité et d'attractivité des pratiques font partie des barrières de l'engagement dans un style de vie actif.
Il est tentant de proposer aux seniors des activités mono tâche et routinières en raison des diminutions des capacités physiques, cognitives et sensorielles. Effectivement, l'offre d'activité physique ainsi que les recherches dans ce domaine ont longtemps tourné autour du même triptyque : gymnastique douce, marche, yoga. Cependant, la combinaison de différentes composantes à l'entraînement peut générer des gains supérieurs.
Trois ingrédients pour entraîner le cerveau des seniors
Les chercheurs se concentrent actuellement sur la création d'une recette idéale et motivante pour l'entraînement des seniors, qui combine à la fois des exercices physiques et cognitifs. Cette formule serait composée de 3 ingrédients principaux :
– Premier ingrédient : une stimulation physique et motrice complexe d'intensité au moins modérée
Une activité physique d'endurance, avec une intensité d'effort au moins modérée, peut non seulement améliorer la santé cardiorespiratoire mais aussi rendre le cerveau plus performant. Elle génère une amélioration de l'aptitude cardiovasculaire, ce qui permet au cerveau de recevoir plus d'oxygène. Des travaux de recherche ont montré que cela peut également s'accompagner de la création de nouveaux neurones dans l'hippocampe, siège de la mémoire.
Certes, les programmes qui excellent pour améliorer les fonctions cognitives doivent être composés d'activité physique d'endurance. Mais il est également nécessaire de les combiner à des exercices de renforcement musculaire, de souplesse et d'équilibre pour entraîner des bénéfices supérieurs. De plus, les chercheurs insistent sur l'intérêt d'ajouter des situations nécessitant des habiletés motrices complexes et de la coordination car elles solliciteraient notablement les fonctions cognitives (par exemple la mémoire, l'attention ou encore la flexibilité mentale), notamment chez les personnes âgées.
– Deuxième ingrédient : intégrer une stimulation cognitive dans l'entraînement
On entend par «stimulation cognitive» une stimulation qui fait appel aux fonctions cognitives, comme retenir une information pendant un temps et l'exécuter, anticiper des actions, mettre en place une stratégie, etc. Lorsque la stimulation cognitive est associée à l'activité physique, cela peut produire des effets synergiques et, de ce fait, être plus efficient sur les fonctions cognitives.
– Troisième ingrédient : des activités collectives qui entraînent des interactions sociales
Le fait de pratiquer au sein d'un groupe susciterait une augmentation de l'observance à un programme, c'est-à-dire de l'assiduité dans le suivi de ce programme. L'attractivité inhérente aux activités physiques proposées doit être un levier pour engager les personnes dans la pratique physique.
Mais quelles solutions avons-nous pour respecter cette recette idéale ? Deux types de pratiques pourraient s'avérer intéressantes et font actuellement l'objet de recherche auprès des seniors.
Opter pour des sports collectifs de coopération et d'opposition
Les sports collectifs offrent bien plus que de simples séances d'exercice physique. Ils sollicitent l'endurance cardiorespiratoire mais engagent également l'ensemble de la condition physique.
Prenons par exemple le basketball ou le handball : pour se déplacer sur le terrain, dribbler ou marquer, l'équilibre, la coordination et la souplesse sont essentiels. De même, la force musculaire est mise à contribution pour les passes, la récupération de la balle ou les changements de direction. Ces sports collectifs peuvent convenir même après 60 ans, s'ils sont réalisés et encadrés de manière adaptée.
Sur le plan cognitif, ces activités créent des situations toujours nouvelles, riches et stimulantes. Cette double combinaison de stimulations s'appelle l'entraînement simultané. Plusieurs chercheurs mettent en lumière l'importance de cet engagement cognitif dans les sports collectifs et encouragent leur pratique, en particulier chez les personnes âgées.
Des études récentes, comme celle menée en 2022 par des chercheuses françaises, ont montré que la participation à des sports collectifs améliorait la mémoire visuospatiale (qui permet, par exemple, de se rappeler l'emplacement de certains objets pendant un temps limité) à court terme et les capacités de planification chez les personnes âgées.
Pratiquer ces jeux vidéo qui font bouger le corps : les exergames
Il peut aussi être intéressant de pratiquer ces jeux vidéo appelés «exergames» qui nécessitent que les joueurs bougent leur corps pour interagir avec les jeux. Ils portent ce nom en référence à la contraction d'«exercise» et «games» (jeux, en anglais) et ont été popularisés depuis les années 2000 avec des consoles comme la Wii et la Switch de Nintendo ou la Kinect de Microsoft.
Ils sont conçus pour solliciter différents aspects de la condition physique, comme l'équilibre, l'endurance, la force et la coordination, tout en stimulant simultanément les fonctions cognitives. Chez les seniors, plusieurs recherches montrent que ce type d'entraînement est efficace pour améliorer de nombreuses capacités physiques et cognitives.
Courant 2020, une nouvelle génération d'exergames est apparue, utilisant des murs interactifs pour créer une expérience de jeu encore plus immersive, telle que Neo-One de Neo Xperiences, l'ExerCube de Sphery ou encore l’Aire interactive de Lü. Dans ces jeux qui mêlent mondes réels et virtuels, des objets physiques (comme des ballons) et numériques coexistent et interagissent en temps réel.
Une étude récente a comparé un programme d'exergames assisté par un mur immersif à un programme de marche et de renforcement musculaire. Ses résultats suggèrent que cette nouvelle génération d'exergames peut se révéler plus efficace sur les capacités cognitives que des entraînements classiques.
En conclusion, on comprend que les activités physiques et cognitives combinées offrent un environnement dynamique et social qui stimule le cerveau tout en permettant de rester actif physiquement. Cela est essentiel pour une vie active et épanouissante, quel que soit l'âge.
Neva Béraud-Peigné a bénéficié d'un contrat doctoral du ministère de l’enseignement supérieur.
Alexandra Perrot et Pauline Maillot ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.
13.05.2024 à 16:52
Léna Situations, Squeezie, Hugo Décrypte : comment ces créateurs de contenu bousculent l’information traditionnelle
Anne Cordier, Professeure des Universités en Sciences de l’Information et de la Communication, Université de Lorraine
Texte intégral (2799 mots)
Ils et elles s’appellent Squeezie, Mcfly et Carlito, Léna Situations ou encore Mister Geopolitix. Ils cherchent à créer des contenus attractifs pour les communautés qui les suivent et leurs sujets sont variés, du développement personnel à l’actualité. On les appelle des « créateurs de contenu ». Une qualification qui vise à distinguer des « influenceurs » qui, sur les réseaux sociaux cherchent à influencer les habitudes de consommation des individus en accord avec des marques dont ils se font le relais.
La distinction est de taille, car elle incite à analyser avec finesse la diversité du paysage auquel sont confrontés les publics en ligne. Elle est aussi de taille car l’amalgame trop souvent effectué entre ces deux types de figures nuit à la compréhension des représentations et des pratiques informationnelles des jeunes, et donc à une prise en charge éducative tout à fait pertinente.
À lire aussi : Faut-il avoir peur des écrans ? Retour sur une annonce présidentielle
De fait, en éducation, la focale adoptée est souvent centrée sur les influenceurs et le brouillage entre information et publicité. Or les créateurs de contenu occupent une place de choix dans l’écosystème informationnel des adolescents. Une exploration de leurs pratiques d’information, loin des préjugés et conclusions hâtives, apporte des clés de compréhension et d’action pour développer une éducation aux médias et à l’information (EMI) intégrant ces figures et leurs contenus dans les apprentissages informationnels.
Des figures inscrites dans le quotidien des adolescents
Les adolescents s’informent au quotidien, que ce soit sur l’actualité ou sur des questions liées à leurs centres d’intérêt, à leurs loisirs ou encore aux programmes et activités scolaires. Ces pratiques d’information sont profondément liées à la personnalité et au parcours biographique de chacun. Une grande pluralité de sujets et d’intentions que la diversité des créateurs de contenu présents sur le web reflète, et qui rythme le quotidien des adolescents, de la santé et la sexualité à l’orientation.

Ainsi, leur curiosité à l’égard du sport, des violences sexistes et sexuelles ou encore de la musique et, de façon plus générale, des pratiques culturelles, trouve des réponses grâce aux créateurs de contenu, dont les adolescents apprécient le ton et le fait d’aborder des questions non traitées par « la télévision ou même les adultes », selon les mots de Maëva, 17 ans.
Nombreux sont les adolescents qui expriment leur reconnaissance à l’égard de créateurs de contenu qui ont osé aborder via leurs vidéos des expériences difficiles qui font écho à leurs préoccupations. C’est le cas de Mastu qui, en 2022, s’est exprimé sur sa dépression.
Les collégiens et lycéens rencontrés lors d’enquêtes de terrain insistent sur le sentiment de familiarité développé avec certains de ces créateurs avec qui ils disent avoir grandi et ne cachent pas un attachement vis-à-vis de ces figures qui ont contribué et contribuent encore à la construction de leur identité et au développement de leurs sociabilités tout autant que de leurs goûts culturels.
Des figures d’autorité informationnelle ?
Cet attachement affectif marqué à l’encontre des créateurs de contenu, entretenu par une intensité et une quotidienneté de la pratique informationnelle, entraine-t-il une confiance absolue dans les productions de ces créateurs ?
Entre septembre 2023 et mars 2024, une recherche-action menée auprès de deux classes de terminale, l’une générale spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP), l’autre technologique spécialité sciences et techniques sanitaires et sociales (ST2S), a, entre autres choses, permis de documenter avec précision le rapport entre l’adhésion affective à une source ou figure informationnelle et la confiance attribuée à cette dernière.

Contrairement aux discours répandus présentant la jeunesse comme soumise à ses affects et peu capable de rationalité particulièrement sur les réseaux sociaux numériques, cette étude montre qu’apprécier les publications des créateurs de contenu ne signifie pas leur faire confiance.
D’une part, les adolescents distinguent nettement les créateurs de contenu – qu’ils appellent alors souvent « influenceurs » – qui diffusent du divertissement et du témoignage (comme Squeezie, cité par tous comme référence à propos des jeux vidéo, ou Lena Situations, que les jeunes filles apprécient pour ses publications sur la mode) – et ceux qui produisent du contenu informationnel plus sérieux à leurs yeux (comme Mister Géopolitix ou Jemenbatsleclito, compte de la créatrice féministe Camille Aumont Carnel).
D’autre part, interroger les adolescents sur les modes d’adhésion affective et d’attribution de confiance aux contenus informationnels produits par ces créateurs et créatrices instruit sur les critères de crédibilité qu’ils appliquent pour évaluer ces contenus. Des critères qui témoignent d’une forme certaine de rationalité chez ces acteurs.
Premier critère, unanimement mis en avant : le travail info-documentaire réalisé en amont et visible à travers la production (citation des sources, notamment), et l’adéquation entre le contenu proposé et les éléments de cours. Meg note :
« Je regarde la vidéo et je vérifie dans mon cours. Si il dit comme mon prof, alors je peux faire confiance. […] Pas l’inverse, non. Le professeur il sait mieux qu’un youtubeur quand même ! »
Deuxième critère appliqué également de façon unanime : la pédagogie déployée par le médiateur créateur de contenus, qui constitue conjointement une raison d’attachement : « Sa manière de faire, elle est attractive. Dr Nozman, il part d’un exemple concret, de la vie de tous les jours, ou alors de ce qu’on voit dans un film, et puis il explique comment c’est possible ou pas, c’est quoi les phénomènes physiques en jeu. C’est passionnant, et j’ai toujours envie d’en apprendre plus », explique Simon.
Troisième critère, qui est sujet à de nombreuses discussions entre les adolescents et les divise : la popularité du créateur de contenu, évaluée à son nombre d’abonnés. Est-ce un critère valable ? Quel lien entre popularité, pertinence et fiabilité ? Ce questionnement, loin d’être nouveau, est renouvelé avec la présence massive des créateurs de contenu dans les écosystèmes informationnels juvéniles. Plusieurs adolescents pensent que la popularité implique une exigence de responsabilité dans le contenu diffusé, à l’instar de Tom :
« Le fait qu’il y ait beaucoup de gens qui les suivent, ça les oblige à avoir de la rigueur, parce qu’ils se font vite reprendre, taper sur les doigts en cas de bêtise, ils veulent éviter le bad buzz. »
Au sein de ce paysage foisonnant, une figure d’autorité majeure tire son épingle du jeu : Hugo Décrypte. En février 2024, sur 52 élèves de Terminale, 38 utilisent Hugo Décrypte pour s’informer. C’est la ressource informationnelle qui remporte les suffrages et en termes de plaisir ressenti quand on la consulte et en termes de confiance attribuée (95 % attribuent la note minimale de 8 sur 10 à Hugo Décrypte sur les deux plans). Sa présence en ligne massive – YouTube, TikTok, Instagram, Twitch, WhatsApp… – ainsi que la multiplicité des formats médiatiques mobilisés explique cette puissance d’impact. Mais, là encore, les lycéens identifient dans les productions des critères de crédibilité qui les érigent en ressources informationnelles de référence, comme le raconte Vasco :
« Hugo Décrypte, il est presque un journaliste, non ? […] Il cite ses sources à chaque fois, il explique comment on peut affirmer telle ou telle chose, on voit bien que ses sujets sont travaillés, il se lève pas le matin en mode “Salut la Commu ! J’ai rien à vous dire mais j’vais quand même faire un vidéo !” »
Une nouvelle donne pour l’éducation aux médias
La place occupée par les créateurs de contenu dans l’écosystème informationnel juvénile justifie pleinement que l’on s’en (pré) occupe. Pourtant, les résistances et la défiance envers ces figures d’attachement et figures d’autorité informationnelle semblent importantes chez les adultes. C’est ainsi en tout cas que les adolescents le perçoivent et le racontent. Marie note :
« Les profs, comme ils peuvent ne pas connaître, ils pourraient considérer ça comme une source un peu moins fiable que le reste. Et du coup remettre en question notre travail et notre recherche. »
À lire aussi : Pour mieux gérer le temps d’écran, distinguer « bonnes » et « mauvaises » pratiques ?
Reconnaître la légitimité des pratiques juvéniles, c’est s’assurer que les adolescents ne soient pas seuls avec leurs questionnements face à des productions qui recèlent de forts enjeux en éducation aux médias et à l’information. Celle-ci est partage de références et d’émotions, que ce soit en famille ou à l’école, où l’intégration de ces ressources apparait nécessaire pour interroger collectivement la fabrique de l’information, le statut du document, mais aussi la perception d’un discours de vulgarisation. Voilà l’occasion d’affûter le regard critique des élèves et de nourrir leur culture de l’information et des sources.
Une éducation aux médias et à l’information qui intègre les ressources produites par les créateurs de contenu, c’est aussi une éducation qui contribue à la distanciation critique lorsqu’il s’agit de faire prendre conscience aux adolescents des intérêts, économiques et/ou politiques, que certains créateurs de contenu défendent. Il s’agit certes d’identifier les créateurs de contenu dont les productions sont problématiques pour le développement de connaissances dans des domaines aussi cruciaux que la santé, le climat ou l’alimentation, mais aussi ceux dont les publications sont dignes de confiance.
[Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]
Une éducation aux médias et à l’information qui intègre les ressources produites par les créateurs de contenu, c’est enfin une éducation respectueuse des espaces informationnels en général, précise dans son appréhension des sources, et qui évite les généralisations erronées : « C’est pas parce que c’est sur YouTube que c’est pas légitime. Je trouve ça fou qu’on puisse, en tant qu’enseignants ou médiateurs, confondre le canal et la source ! », s’emporte ce professeur documentaliste qui ajoute trouver « aberrant de ne pas proposer ce type de ressources à (ses) élèves en 2023-2024 ».
Car oui, les pratiques informationnelles des adolescents sont riches et éminemment sérieuses. C’est pourquoi nous nous devons de proposer une éducation aux médias et à l’information qui soit, dans toutes ses sphères de déploiement (école, famille, tiers lieux…), digne de cette complexité, attachée à « faire reliance », et les prenne résolument au sérieux.
Anne Cordier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
13.05.2024 à 16:51
L’IA peut-elle vraiment être frugale ?
Denis Trystram, Professeur des universités en informatique, Université Grenoble Alpes (UGA)
Thierry Ménissier, Professeur de philosophie politique, Université Grenoble Alpes (UGA)
Texte intégral (1929 mots)
Autour de nous, nous observons le numérique envahir tous les autres secteurs. L’intelligence artificielle (IA) est l’un des derniers maillons de ce bouleversement technologique : elle accompagne désormais tout traitement automatique qui exploite le déluge de données numériques. Mais au vu des enjeux écologiques auxquels nous faisons face aujourd’hui, sera-t-il possible de concevoir une IA respectueuse des contraintes environnementales ?
Avant de rentrer dans le sujet de l’IA frugale, il convient de poser le décor. La crise climatique sans précédent à laquelle nous faisons face a commencé avec la révolution industrielle, au milieu du XIXe siècle, qui a planté les germes de notre société de consommation actuelle. Le changement climatique n’est pas la seule menace environnementale : stress hydrique, épuisement des ressources, perte de la biodiversité… Mais c’est sans doute la plus visible et la plus documentée, et donc celle qui peut nous aider à mieux appréhender les autres.
Un secteur qui croît toujours plus vite
Le secteur du numérique n’est pas facile à cerner, car il est dilué partout. Selon l’ADEME, il représente 2,5 % des émissions carbone de la France en 2022. Ces dernières années, le domaine a connu une forte croissance et les études prospectives envisagent principalement des scénarios de poursuite de cette croissance, au moins à moyen terme.
Un petit calcul réalisé à partir de données publiques sur le scénario SSP1-19 du GIEC, un des plus optimistes, souligne l’aberration de cette croissance. Si le secteur croît selon la prévision la plus basse de croissance, le numérique émettrait 6 fois plus que l’objectif du scénario de décroissance des émissions mondiales de CO₂ d’ici à 2050 ! Même si la croissance du secteur stagnait au niveau d’aujourd’hui, il représenterait trois quarts des émissions totales… Dans un tel monde, que nous resterait-il pour le reste ?
Si on se focalise sur l’IA, on observe une rupture claire à partir de 2012. La croissance du secteur s’emballe alors avec un doublement des besoins en puissance de calcul tous les 5-6 mois au lieu de 24 mois, chiffre jusqu’alors stable de la classique loi empirique de Moore. Cette date correspond au développement des modèles d’IA reposant sur l’apprentissage profond, ou deep learning, rendus possibles par l’utilisation de processeurs graphiques (GPU) pour effectuer les calculs à la base de l’apprentissage profond et par le développement des données ouvertes sur Internet. Rappelons que l’IA n’est pas réduite à l’apprentissage par réseaux de neurones profonds, mais ce sont incontestablement ces derniers qui sont les plus gourmands.
Un nouveau palier a été atteint en 2023, avec l’explosion des modèles génératifs comme l’agent conversationnel ChatGPT. Même s’il est difficile d’avancer des chiffres précis, étant donné que les « géants de la tech » comme OpenAI, Meta ou Microsoft qui sont à l’origine des plus gros modèles ne communiquent plus sur ces données, cette diffusion à large échelle est très inquiétante.
Le poids de l’IA générative sur le climat
ChatGPT est basé sur le modèle GPT-3, remplacé aujourd’hui par une version améliorée GPT-4. Ce n’est pas le seul, mais c’est le plus populaire et un de ceux pour lequel il existe des données. Le modèle sur lequel il s’appuie possède 176 milliards de paramètres et a nécessité 552 tonnes d’équivalent CO2 pour son entraînement en Californie. En termes de consommation électrique (indicateur plus objectif au sens où il ne dépend pas du mix énergétique), le modèle a tourné des jours sur près de 4 000 gros GPU de Nvidia dont la consommation a été estimée à 1 283 MWh (megawatt-heure, soit 1 000 kWh).
La phase d’usage est bien plus consommatrice encore ! Chaque jour, les quelque dix millions d’utilisateurs mobilisent 564 MWh d’électricité. Les annonces récentes des patrons d’OpenAI et Microsoft sur des commandes de centaines de milliers de GPU pour alimenter les futures versions sont vertigineuses en termes de consommation et d’impact environnemental. Avec sa capacité de production actuelle, le constructeur Nvidia est loin de pouvoir en produire autant.
ChatGPT n’est que l’élément visible de cette galaxie. Aujourd’hui, l’IA est un moteur de la croissance exponentielle du secteur du numérique, avec une explosion du nombre d’applications et services qui utilisent l’IA générative. Le développement de l’IA à ce rythme n’est bien entendu pas soutenable tel quel.
Comment penser une IA plus frugale ?
On ne pourra soutenir cette croissance que si l’IA permet des économies d’émissions considérables dans tous les autres secteurs. C’est la voix majoritaire qui porte le message d’une IA qui va nous aider à sortir de la crise. Malgré de trop nombreuses applications inutiles ou questionnables, il existe des apports bénéfiques pour la société notamment pour simuler et analyser des phénomènes physiques complexes comme l’étude de scénarios pour contrer la crise climatique. Encore faut-il que ces solutions ne soient pas in fine pires que le mal ! Par exemple, l’IA va permettre aux entreprises exploitant les énergies fossiles d’optimiser leur activité et donc d’émettre encore plus de CO₂.
Partout, on entend parler d’IA frugale sans que ce terme soit clairement défini. Dans le langage usuel, la sobriété est souvent entendue comme la réaction adéquate face à une consommation abusive d’alcool. Dans le contexte de l’IA, cela renvoie plutôt à la simplicité (ce qui est clairement insuffisant ici), à la modération, voire l’abstinence. Frugalité et sobriété sont souvent considérées comme synonymes ; il est également possible de considérer que la frugalité concerne le fonctionnement des systèmes techniques tandis que la sobriété renvoie à leur usage dans le cadre des pratiques sociales.
Les deux dimensions se complètent dans le sens où tout système technique s’adresse à des usages qui se trouvent de la sorte facilités et encouragés. Ainsi, plus le système apparaît propice à l’usage, plus son impact s’accroît : c’est ce que l’on appelle l’effet rebond. Cependant, le plus pertinent est la définition en creux : le contraire de la frugalité est ainsi qualifié de gloutonnerie selon Le Robert. Il est donc possible de considérer que la frugalité-sobriété comme une vertu qui s’apprécie en négative, en fonction de la quantité de ressources que l’on ne consomme pas.
Or, caractériser une IA frugale s’avère difficile pour plusieurs raisons. D’une part, les analyses existantes ciblent souvent l’entraînement des modèles et/ou la phase d’usage, mais ignorent le cycle de vie complet du service ou du produit. Cela inclut la production, l’utilisation et le stockage des données, et l’infrastructure matérielle mise en œuvre, depuis la fabrication jusqu’à la fin de vie de tous les équipements impliqués. D’autre part, pour un service reconnu comme utile pour la société, il conviendrait d’estimer les volumes de données impliquées dans le processus et les effets positifs indirects induits par son déploiement. Par exemple, un système d’optimisation énergétique pour un appartement peut permettre une augmentation de confort ou le déploiement de nouveaux services grâce aux économies réalisées.
Mettre l’IA au régime, une démarche nécessaire, mais insuffisante
Aujourd’hui, les termes de frugalité ou de sobriété sont souvent synonymes d’efficacité énergétique : on imagine et développe une solution sans prendre en compte son coût environnemental, puis on l’améliore de ce point de vue dans un second temps. Il faudrait au contraire s’interroger en amont sur les effets avant le déploiement du service, quitte à y renoncer.
L’IA frugale est donc caractérisée par une contradiction intrinsèque, au vu de la boulimie d’énergie et de données aujourd’hui nécessaire à l’entraînement des gros modèles et à leurs usages, au mépris des risques considérables pour l’environnement. En matière d’IA, la frugalité doit aller bien plus loin que la simple efficacité : elle doit d’abord être compatible avec les limites planétaires. Elle doit aussi interroger les usages en amont, jusqu’au renoncement de certains services et pratiques, en se basant sur des analyses de cycle de vie complètes et rigoureuses.
Les finalités que recouvrent ces développements technologiques devraient au moins être collectivement débattues. Derrière l’argument d’une efficacité accrue se cache la compétition entre souverainetés nationales ou la concurrence entre des firmes intéressées par des profits colossaux. Il n’y a rien dans ces finalités qui ne soit considéré à l’aune d’une approche éthique.
Une évaluation des systèmes d’algorithmes à l’aide des éthiques environnementales contemporaines permet même de fonder la notion de sobriété sur d’autres bases. En effet, et en dépit de leur variété, ces éthiques ne considèrent pas la Nature (l’eau, l’air, les matériaux et les vivants) comme des ressources à disposition de la seule espèce humaine, engagée dans la compétition technologique et l’hédonisme industriel. En conclusion, on pourrait affirmer que s’ouvre aujourd’hui pour la recherche responsable en IA une perspective aussi formidable que difficile à réaliser : proposer des modèles et des systèmes les plus compatibles possibles avec une telle définition « forte » de la sobriété.
Denis Trystram participe à l'écriture d'une Spec AFNOR pour encadrer l'IA frugale. Le présent texte a bénéficié de la dynamique de ce groupe mais n'engage que son auteur.
Thierry Ménissier a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche dans le cadre du plan de financement France 2030 pour l'institut pluridisciplinaire d'intelligence artificielle de Grenoble, MIAI.
13.05.2024 à 16:49
Comment la Russie instrumentalise la victoire contre le nazisme dans sa guerre en Ukraine
Sarah Gruszka, Historienne, chercheuse associée au CERCEC (EHESS/CNRS) et à l'UMR Eur'orbem (Sorbonne Université/CNRS), Sorbonne Université
Texte intégral (2820 mots)
Le monde vient de fêter le 79e anniversaire de la victoire de 1945. En Russie, où elle a traditionnellement lieu le 9 mai, il s’agissait de la troisième commémoration depuis l’invasion de l’Ukraine. Comment honorer la mémoire de la Seconde Guerre mondiale dans un pays de nouveau en guerre ?
En réalité, la frontière entre les deux conflits est de plus en plus ténue dans la rhétorique officielle. La mémoire de ce qu’on appelle encore en Russie « la Grande Guerre patriotique » – phase de la Seconde Guerre mondiale qui va de l’invasion de l’URSS à la capitulation de l’Allemagne, donc de juin 1941 à mai 1945 ; cette appellation était traditionnellement employée en URSS à la place de « Seconde Guerre mondiale », et continue de l’être dans la Russie poutinienne – est fortement instrumentalisée par le pouvoir et semble servir avant tout à délivrer un discours sur le présent plutôt que sur le passé. Un discours de légitimation de la guerre actuelle relayé aussi bien par la parole des dirigeants qu’à travers les pratiques commémoratives que l’on peut observer le 9 mai. Depuis l’invasion de l’Ukraine, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale est plus que jamais une arène de lutte politique.
La mémoire de la « Grande Guerre patriotique » comme discours de légitimation de la guerre en Ukraine
Le lien entre les deux conflits est constamment opéré, semant la confusion et les amalgames de part et d’autre.
Les nombreuses références à la Seconde Guerre mondiale dans le discours inquiétant prononcé par Vladimir Poutine trois jours avant l’invasion avaient marqué les esprits. Depuis, il convoque constamment cette mémoire, pour consolider sa justification de la guerre en Ukraine. En témoigne le recours à toute une terminologie habituellement appliquée à la période de 1939-1945 (« nazi », « génocide »…).
Le dénominateur de ces deux conflits serait la lutte contre le fascisme, la légitime défense et la libération de populations opprimées. Selon Dmitri Medvedev, ancien président de la Fédération de Russie et actuel vice-président du Conseil de sécurité du pays, ceux contre qui se bat la Russie aujourd’hui ne seraient rien moins que « la réincarnation du fascisme », « matérialisée par l’arrière-petit-fils de l’hitlérisme », à savoir « le régime nazi de Kiev ». Dignes héritiers de la mission sacrée de leurs grands-parents, les Russes se retrouveraient de nouveau investis d’une tâche noble pour le salut de leur pays.
Ce parallèle revêt une dimension que l’on pourrait qualifier de perverse, au sens où il joue sur le souvenir traumatique de la Seconde Guerre mondiale en Russie (l’URSS a payé le plus lourd tribut dans ce conflit, avec 26 millions de morts, dont plus de la moitié de civils), de sorte qu’il est susceptible de rencontrer un certain écho auprès de la population, même si une partie est loin d’être réceptive.
Quant à sa consistance historique, elle est à peu près inexistante et pétrie de contradictions, d’autant que l’Ukraine, en tant que république soviétique à l’époque de la Seconde Guerre mondiale, faisait partie des artisans de la victoire sur le nazisme aux côtés de la Russie.
L’un des sous-textes qui imprègne la rhétorique poutinienne et ses émules (comme le présentateur Vladimir Soloviev, héraut de la propagande russe) est que l’incommensurable tribut payé par l’URSS – laquelle semble réduite à sa composante russe – sur l’autel de la libération de l’Europe lui donnerait certains droits teintés d’impérialisme (comme des prérogatives sur ce qui serait la « sphère d’influence » de la Russie) et que l’Occident aurait une éternelle dette envers la Russie pour son sacrifice et la victoire de 1945. C’est ainsi que l’ingratitude des pays occidentaux ne cesse d’être pointée.
Cette interprétation de la guerre est défendue par tout un arsenal législatif et par une ingérence de plus en plus forte du pouvoir sur l’écriture de l’Histoire. Elle est ainsi relayée dans les écoles grâce à un nouveau système de manuel unique qui, lui aussi, entremêle ostensiblement la Seconde Guerre mondiale et la guerre en Ukraine.
À lire aussi : En Russie, un nouveau manuel d’histoire au service de l’idéologie du pouvoir
Le parallèle peut aussi se retourner contre ses promoteurs. Preuve que l’imaginaire de la Seconde Guerre mondiale est omniprésent de part et d’autre, les similitudes entre les deux conflits sont également invoquées au détriment de la Russie : l’invasion surprise de l’Ukraine à l’aube rappelle celle des Allemands le 22 juin 1941 à la même heure, et l’échec de ce que tous percevaient comme un Blitzkrieg évoque celui de Hitler qui avait prévu de conquérir l’URSS en quatre mois.
Volodymyr Zelensky établit une comparaison entre le nazisme et le « ruscisme » (néologisme forgé à partir de la contraction de « russe » et « fascisme » pour désigner le poutinisme agressif), qualifiant le Kremlin d’aujourd’hui d’« héritier idéologique des nazis », sans parler des mèmes ukrainiens qui circulent, mettant en regard la symbolique de l’Allemagne nazie et celle de la Russie poutinienne…
Ainsi, chez les deux belligérants, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale reste un point de référence à l’aune duquel l’ennemi peut être jugé et discrédité.
Le « jour de la Victoire » de 1945 comme tribune pour parler de la guerre actuelle
Le lien intrinsèque entre Seconde Guerre mondiale et guerre en Ukraine est par ailleurs perceptible dans les enjeux mémoriels qui entourent les dates commémoratives : du côté ukrainien, le 9 mai est si intrinsèquement lié à la Russie et à un passé soviétique commun dont l’Ukraine cherche à se distancier depuis plusieurs années que depuis 2023, suite à un projet de loi déposé par Volodymyr Zelensky, le jour du souvenir de la victoire de 1945 a été déplacé au 8 mai, « comme dans le reste du monde libre ».
Désormais, en Russie, tous les événements consacrés à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale sont prétexte à y incorporer un discours ou des actions en lien avec la guerre en Ukraine. Il en va ainsi du 9 mai, « jour de la victoire » qui a été peu à peu accaparé par le pouvoir à des fins de propagande.
Dans le discours traditionnellement prononcé à cette occasion, Poutine parle davantage de la situation géopolitique actuelle que de la mémoire de la guerre ou de l’hommage aux vétérans. En 2022, par exemple, il avait mentionné six fois le Donbass, trois fois l’OTAN et une fois les « banderovtsy » (les partisans de Stepan Bandera, chef de l’Organisation des nationalistes ukrainiens, qui a collaboré avec l’Allemagne nazie au début des années 1940 puis combattu les Soviétiques au nom de la lutte pour une Ukraine indépendante) – autant de termes qui étaient absents de ses allocutions précédentes. Il avait dressé un parallèle très explicite entre les exploits des soldats soviétiques lors de la « Grande Guerre patriotique » et le conflit en Ukraine (bien qu’il n’ait jamais prononcé le nom de ce pays) : « Aujourd’hui comme hier, vous vous battez pour notre peuple dans le Donbass, pour la sécurité de notre patrie, la Russie. Pour qu’il n’y ait pas de place dans le monde pour les bourreaux et les nazis. »
Le mélange des genres était également perceptible dans le fait que Poutine avait décrété une minute de silence non seulement en hommage aux victimes de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi aux habitants du Donbass et aux combattants de ce qu’on appelle en Russie « l’opération spéciale ».
En clair, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale est instrumentalisée pour étayer un discours de légitimation de l’invasion : si l’armée russe combat en Ukraine, c’est précisément pour que « personne n’oublie les leçons de la Seconde Guerre mondiale » et « qu’il n’y ait plus de place dans le monde pour […] les nazis », avait expliqué Poutine le 9 mai 2022. Il avait conclu par ces mots : « Gloire à nos vaillantes forces armées ! Pour la Russie ! Pour la victoire ! Hourra ! », des exclamations résolument ancrées dans l’actualité plutôt que dans l’événement censé être commémoré ce jour-là.
Cette année, Poutine, dans son discours, a été encore plus explicite : il y a souligné l’héroïsme des combattants de la guerre en Ukraine tout en dénonçant la « réhabilitation du nazisme » opérée par les pays occidentaux qui ont oublié « les leçons de la Seconde Guerre mondiale » et tentent de falsifier son histoire.
Commémorer la Seconde Guerre mondiale ou célébrer la guerre en Ukraine ?
Cet effacement de la frontière entre Seconde Guerre mondiale et conflit en Ukraine se perçoit non seulement dans les discours, mais aussi dans les pratiques, à travers les commémorations du 9 mai. Depuis plusieurs années, elles vont dans le sens de la promotion du militarisme et du patriotisme, sous-tendant un discours belliciste à l’encontre de l’Ukraine et de l’Occident.
Dès 2014, année de l’annexion de la Crimée et du début de la guerre dans le Donbass, le mouvement de motards « Les Loups de la luit » défilait fièrement sous les drapeaux des séparatistes du Donbass, une présence devenue traditionnelle depuis. En 2022, deux mois et demi après le début de l’invasion de l’Ukraine, le programme du 9 mai prévoyait le survol de la Place Rouge par des avions de chasse MiG-29 en formation « Z » (lettre incarnant l’adhésion à la guerre en cours), « en soutien aux membres de l’opération spéciale en Ukraine ».
La même année, la procession traditionnelle (depuis une dizaine d’années) du « Régiment immortel », où des millions de citoyens russes défilent en brandissant un portrait d’un membre de leur famille qui a participé à la Seconde Guerre mondiale, s’est ouverte au conflit actuel : il était possible d’y brandir des portraits de soldats morts sur le front ukrainien ; ce fut notamment le cas d’un certain Vladimir Joga, tué dans le Donbass en mars 2022 et décoré à titre posthume du statut de « Héros de la Russie », dont le père a défilé au côté de Poutine.
Désormais, les festivités officielles du 9 mai ont vocation à inclure les combattants de « l’opération militaire spéciale » : ils défilent sur la Place Rouge (ils étaient un peu plus de mille cette année – le double par rapport à 2023), en colonne séparée ; dans les tribunes officielles de la parade du 9 mai 2024 se trouvaient, aux côtés de Poutine, plusieurs militaires connus soit pour leur rôle dans l’assaut de villes ukrainiennes, soit pour des crimes de guerre commis à l’encontre de civils.
Entre autres, au deuxième rang de la tribune, derrière les chefs d’État étrangers, se tenaient, selon le média « Agenstvo », le lieutenant principal Vladislav Golovine (qui a pris d’assaut Marioupol en mars 2022), le major Artur Orlov (dont la division a participé aux batailles pour Avdeevka en 2023-2024 ; il a reçu le titre de Héros de la Russie) et le major Raïl Gabdrakhmanov (qui a fait l’objet de sanctions de l’UE pour l’implication de ses subordonnés dans des viols collectifs, ainsi que pour le meurtre d’un Ukrainien après le viol collectif de sa femme devant leur enfant). Un autre militaire reconnu faisait partie de la division qui a été stationnée à Boutcha, tristement célèbre pour le massacre de civils qui y a eu lieu au printemps 2022.
En marge des commémorations officielles, d’autres événements organisés autour du 9 mai associent allègrement les deux conflits. Toutes les sphères sont mobilisées : culturelles, muséales, pédagogiques, ludiques… Ainsi, cette année, un festival intitulé propose aux visiteurs une exposition d’armements de l’OTAN saisis par des militaires russes en Ukraine. Les écoles du pays sont quant à elles encouragées par les autorités à recevoir, en guise de vétérans (à défaut de ceux de la Seconde Guerre mondiale, qui ne sont plus qu’une poignée), ceux du conflit en Ukraine (y compris d’anciens prisonniers de droit commun qui ont été libérés pour être envoyés sur le front), qui viennent parler aux enfants de l’importance du patriotisme. Les élèves sont par ailleurs incités à écrire des lettres aux soldats qui se trouvent sur le front ukrainien.
Le 9 mai privatisé par le pouvoir
Ainsi, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et le « culte de la victoire » de 1945 semblent être devenus l’un des fondements idéologiques de la guerre actuelle, voire son fondement principal. Du moins, à condition de vider le conflit passé de ses réalités historiques car, pour le promouvoir et faire accepter une nouvelle « opération miliaire », il n’est pas question de s’attarder sur la dimension tragique de la guerre, sur l’ampleur des pertes et des souffrances endurées, ou sur le trauma vécu par des millions de familles. À l’inverse, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale est fortement déformée, au profit d’une survalorisation de l’héroïsme, de la fierté et des vertus glorieuses du « peuple vainqueur ». Elle paraît de plus en plus désincarnée à mesure que disparaissent les derniers témoins, remplacés par un discours préfabriqué.
Cette mémoire ainsi manipulée semble n’avoir d’autre dessein que de parler du présent et de consolider l’interprétation officielle du conflit en cours. C’est ainsi que le 9 mai, fête principale du calendrier national, paraît de plus en plus déconnecté de l’événement auquel il est censé rendre hommage. Il est devenu, en quelque sorte, un jour privatisé par le pouvoir, saturé de propagande, un élément clé de l’instauration d’un climat à même de faire accepter la guerre en Ukraine. Associer celle-ci au « jour de la Victoire » est une façon de fabriquer une continuité fictive entre les deux conflits non seulement dans leur raison d’être (la fameuse lutte contre le nazisme), mais aussi dans leur issue : c’est en quelque sorte une manière de préjuger de l’avenir en célébrant prématurément le triomphe de la Russie dans la guerre en cours, avec la perspective fantasmée d’une future parade dans Kiev – un triomphe qui n’a pourtant rien de tangible.
Sarah Gruszka ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
13.05.2024 à 16:48
On fait le bilan… du bilan carbone
Alexandre Garel, Researcher in Finance, Audencia
Arthur Romec, Associate Professor of Finance, TBS Education
Thomas Bourveau, Assistant Professor of Accounting at Columbia University, Columbia University
Texte intégral (1780 mots)

La lutte contre le changement climatique dépend de notre capacité collective à réduire de manière significative nos émissions de gaz à effet de serre (GES). Un prérequis pour intensifier cette transition vers un monde bas carbone est de pouvoir mesurer et quantifier les émissions d’un certain nombre d’acteurs et en particulier des entreprises.
Cependant, seule une petite minorité d’entreprises cotées rendent publiques leurs émissions. Afin de pallier ce manque de transparence, de nombreux pays réfléchissent à mettre en place une obligation pour les entreprises à fournir des informations sur leurs émissions de gaz à effet de serre.
La France fait figure de pionnière sur le sujet en ayant adopté dès 2010 la loi Grenelle II, qui oblige, depuis 2012, les entreprises de plus de 500 salariés à réaliser des bilans d’émissions de gaz à effet de serre (bilans GES). Dans ces bilans GES, les entreprises doivent inclure leurs émissions directes (Scope 1 – typiquement les émissions associées à des sources fixes de combustion), leurs émissions indirectes liées à l’énergie (Scope 2 – typiquement la consommation d’électricité), et les émissions indirectes qui échappent à leur contrôle (Scope 3 – typiquement les émissions résultant de l’achat de produits et services, du transport de marchandises en amont, ou de l’usage des produits/services vendus par les utilisateurs finaux). Les bilans GES sont rendus publics et disponibles sur le site de l’ADEME.
Une exception française ?
Alors que Singapour et la Californie, parmi d’autres, ont récemment demandé aux entreprises cotées et non cotées de rendre publiques leurs émissions à l’horizon 2027, que savons-nous de la réussite et des effets de l’obligation de transparence à laquelle sont soumises les entreprises françaises depuis une dizaine d’années ?
À lire aussi : Pourquoi les bilans carbone sont incertains – et comment les améliorer
Dans un article de recherche, nous avons étudié la réaction des entreprises françaises non cotées à la mise en place de cette obligation de publication de leur bilan GES.
L’obligation de transparence concerne les entreprises cotées et non cotées. Cependant, les entreprises cotées sont déjà soumises à des pressions qui les poussent à reporter volontairement leurs émissions, par exemple la demande des investisseurs institutionnels, le Say on Climate, ou encore la directive européenne sur le reporting non financier (NFRD). L’obligation de publication d’un bilan GES et les effets attendus sont donc davantage susceptibles de concerner les entreprises non cotées.
Notre travail a trois objectifs : 1) évaluer la mise en conformité des entreprises avec la demande de transparence du régulateur, 2) examiner la qualité des informations fournies par les entreprises, 3) étudier si les objectifs annoncés de réduction des émissions et les plans de transition associés produisent des effets. Pour cela, nous avons collecté 1546 bilans GES soumis sur la période 2014-2021 par 1137 entreprises françaises non cotées pour lesquelles nous disposons de données comptables.
Une réglementation pas vraiment respectée
Les résultats sont les suivants. 53 % seulement des entreprises non cotées éligibles publient (au moins) un bilan GES sur la période, témoignant d’un faible niveau de conformité. Ce phénomène peut s’expliquer par la faible amende encourue en cas de non-respect de l’obligation de publier un bilan GES (1500 € initialement et 10 000 € depuis 2019) qui est probablement inférieure au coût de la production des informations nécessaires à la réalisation d’un bilan GES, ainsi que par le manque de contrôle et de sanctions de la part du régulateur. Par ailleurs, parmi les entreprises qui publient un bilan GES, très peu le mettent à jour dans les quatre ans qui suivent.
Nous observons également des différences marquées en fonction de la taille, de l’âge et du secteur des entreprises. Les entreprises les plus grandes et les plus anciennes sont plus susceptibles de publier un bilan GES, ce qui peut s’expliquer par le fait qu’elles font face à une plus grande pression des parties prenantes et ont davantage de moyens pour produire un bilan GES. Les entreprises appartenant à des industries fortement émettrices (ex. transport aérien, culture et production animale, cokéfaction et raffinage, fabrication de plastique, métallurgie, industrie automobile, métallurgie, production et distribution de gaz) sont, au contraire, moins susceptibles de publier un bilan GES. Ce résultat peut être dû à une réticence à rendre compte de leur contribution au changement climatique mais également à un refus de s’engager sur des objectifs chiffrés de réduction de leurs émissions.
Nous nous sommes ensuite penchés sur le contenu des bilans GES. Alors que tous les bilans comprennent les émissions Scope 1 & 2, seulement 47 % d’entre eux comprennent les émissions Scope 3. Il est à noter que ce pourcentage a augmenté au cours des dernières années. Les grandes entreprises sont davantage susceptibles de fournir leurs émissions Scope 3, ce qui est cohérent avec l’accès à plus de ressources et de meilleurs systèmes d’information.
Les principes de réalisation du bilan GES prévoient que les entreprises fournissent des informations sur les sources et les documents utilisés pour quantifier leurs émissions, sur le périmètre organisationnel considéré (c’est-à-dire les entités détenues ou contrôlées par l’entreprise qui sont prises en compte dans le calcul) et sur les éventuelles incertitudes dans leurs calculs. Cependant, à peine 50 % des bilans fournissent ces informations pour les émissions Scope 1 & 2 et encore moins pour les émissions Scope 3.
En plus des émissions actuelles, le bilan GES doit également contenir un objectif de réduction des émissions et un plan de transition. 96 % des bilans contiennent un objectif de réduction pour les émissions Scope 1 & 2 et fournissent un plan de transition pour y parvenir. Ce chiffre est seulement de 46 % pour les émissions Scope 3. Une analyse plus minutieuse des plans de transition révèle que seulement 9 % d’entre eux mentionnent une méthodologie scientifique (ex. SBTi) et à peine 2 % mentionnent un audit externe.
Un manque de projection dans l’avenir
Seuls 17 % des plans de transition mentionnent un horizon temporel. De plus, la plupart des entreprises ne fournissent aucune quantification de la réduction des émissions liées aux différentes actions présentées dans leurs plans de transition. Plus spécifiquement, 75 % des plans liés aux émissions Scope 1 n’ont pas de mesures quantitatives et ce pourcentage est encore plus élevé pour les plans de transition liés aux émissions Scope 2 (79 %) et Scope 3 (90 %). Ainsi, même si pratiquement tous les bilans comprennent un objectif de réduction des émissions, la faible qualité de l’information fournie dans les plans de transition soulève des doutes sur la crédibilité des objectifs.
[Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]
Finalement, pour un petit échantillon d’entreprises publiant au moins deux bilans GES au cours de la période étudiée, nous nous sommes intéressés aux effets des objectifs de réduction et des plans de transition. Les résultats indiquent que la qualité informationnelle des plans de transition et les objectifs annoncés de réduction ont un pouvoir prédictif sur la baisse des émissions réalisées entre les deux bilans.
L’approche du régulateur consiste à encourager la transparence pour influencer le comportement des entreprises. L’idée est, en amont, de pousser les entreprises à développer un savoir-faire dans le calcul et la gestion de leurs émissions, puis, en aval, de les inciter à réduire leurs émissions en rendant l’information publique et en les faisant formuler des objectifs de réduction d’émissions.
Notre recherche montre les limites de cette approche à laquelle il est peu coûteux de déroger ou à laquelle une entreprise peut se soumettre mais de manière incomplète et non qualitative. Les nombreux choix discrétionnaires offerts aux entreprises dans la production de leur bilan GES affectent la comparabilité des informations fournies, réduisant ainsi considérablement leur utilité auprès des parties prenantes externes.
Cet exercice nous conduit à formuler les recommandations suivantes au régulateur :
Tout d’abord, il faut rendre la publication du bilan GES réellement obligatoire en mettant en place des contrôles et des sanctions en cas de non-respect des obligations de publication. L’augmentation récente de l’amende en cas de non-respect à 50 000 euros va dans le bon sens.
Le législateur devrait être davantage prescriptif dans le choix de la méthodologie scientifique à adopter et dans la qualité ainsi que dans l’exhaustivité des informations à transmettre (ex. plans de transition plus précis et quantitatifs, couverture des émissions Scope 3).
Il serait nécessaire aussi d’encourager les entreprises à communiquer à leurs parties prenantes et sur leur site Internet leurs bilans GES en plus de le déposer sur le site de l’ADEME (ou à communiquer sur l’absence de volonté de publier un bilan GES le cas échéant), afin d’augmenter leur visibilité et de maximiser les effets bénéfiques attendus d’une plus grande transparence sur leurs émissions.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
13.05.2024 à 16:48
La consommation écoresponsable et les jeunes : faites ce qu’on dit, pas ce qu’on fait ?
Sasha Séjaï, Doctorante en marketing durable et comportement du consommateur, Université de Caen Normandie
Catherine Allix-Desfautaux, Maître de conférences en marketing, Université de Caen Normandie
Olivier Badot, Professeur titulaire de la chaire "Retailing 4.0", ESCP Business School
Texte intégral (1791 mots)
Le « green gap », l’écart entre les valeurs affichées en matière d’environnement et les comportements de consommation réels est un phénomène particulièrement intrigant chez les jeunes générations. Malgré une conscience aiguë des enjeux et un militantisme écologique manifeste, les pratiques de ces consommateurs semblent notablement en contradiction avec leurs convictions.
Le facteur financier est souvent identifié comme le frein numéro un à une consommation plus responsable. La précarité financière de la jeunesse, qui doit souvent financer ses études, son logement ou son alimentation avec de maigres rentrées d’argent, la conduit souvent vers des biens et services abordables, mais moins respectueux de l’environnement : enseignes de fast-fashion, chaînes de restauration rapide, compagnies aériennes low cost…
Ce n’est cependant pas la seule explication. D’autres éléments, physiques et cognitifs notamment, entrent en jeu et font l’objet de nos travaux de thèse en cours.
Limiter les efforts physiques
Dans les modèles d’économie classique, l’Homo œconomicus cherche à satisfaire ses besoins tout en minimisant ses coûts qui peuvent être financiers mais pas uniquement. L’achat de produits écoresponsables peut représenter, par exemple, un coût physique notable. Contrairement aux produits de consommation courante disponibles aussi bien en hypermarchés qu’en épiceries de proximité, les produits labellisés sont souvent dispersés à la fois dans des grandes surfaces classiques, des enseignes spécialisées, voire, même chez des petits producteurs locaux. Le consommateur doit à la fois se déplacer dans différents points de vente mais aussi y consacrer un temps plus important.
Une étudiante nous explique :
« J’aime beaucoup les friperies, mais il y en a peu, ou alors on ne les trouve pas toutes au même endroit donc il faut se déplacer. Avec ce genre de produits, on ne sait d’ailleurs jamais si on va trouver ce qu’on souhaite, donc on part sans être certain. C’est pour cela que parfois je renonce et je me replie sur des boutiques classiques ou en ligne : au moins je suis certaine de trouver ce que je veux. »
De même, le recyclage des emballages exige un effort de tri mais aussi parfois de se déplacer dans les différents points de collecte. Il en va de même pour le vrac, très plébiscité en théorie par les consommateurs mais posant des problèmes d’utilisation et de gestion tant pour les clients que les points de vente. De nombreux points de vente sont d’ailleurs en train de faire marche arrière en la matière.
L’utilisation des transports en commun implique d’accepter de marcher davantage pour accéder aux arrêts de bus ou métro, d’être tributaire des horaires qui ne sont pas toujours compatibles avec nos emplois du temps mais également de bénéficier d’une autonomie réduite comparée à un véhicule personnel.
Et tous ces éléments interagissent comme en témoigne une autre étudiante :
« Les magasins bio ne sont pas desservis par les transports en commun dans ma ville et comme je ne suis pas véhiculée, ça fait un bout à pied. »
Une autre poursuit :
« J’étais obligée d’aller en voiture jusqu’aux magasins spécialisés et une fois sur place je passais un temps fou à trouver les produits, surtout pour les alternatives végétales, car les rayons sont différents des supermarchés classiques. »
L’adoption d’une consommation durable exige ainsi souvent une implication physique individuelle accrue pour accéder à ces produits, ce qui peut constituer une barrière significative pour un grand nombre de jeunes consommateurs.
Privilégier la simplicité
Du point de vue cognitif, la prolifération des labels joue un rôle déterminant. Les consommateurs sont souvent perdus face à la surcharge d’informations sur la composition et l’origine des produits. Ils doivent non seulement comprendre ce que signifient les différents labels, mais aussi évaluer leur fiabilité et leur pertinence par rapport à leurs convictions personnelles.
Une enquêtée souligne :
« Pour moi, si c’est cher c’est que c’est local alors que parfois non. Les marques jouent sur l’image, des campagnes très stéréotypées avec une petite Française et quand je rentre chez moi, je me rends compte que c’est fabriqué en Chine ou au Bangladesh. »
Les différents scandales sanitaires alimentent le manque de confiance des consommateurs mais donnent aussi l’impression que face à l’ampleur de la situation, l’impact individuel sera insignifiant. Aussi, les biais de confirmation, la tendance naturelle que tout un chacun a de privilégier les informations qui confortent ses croyances et préjugés, peuvent amener les consommateurs à se rabattre sur des choix de consommation plus familiers et moins durables.
[Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]
Une étudiante explique ses choix ainsi :
« Généralement je renonce par souci de sécurité. Sur les produits électroniques reconditionnés, par exemple, tout ce qui touche à la garantie est assez flou : on ne sait pas jusqu’où c’est pris en charge. Pour un peu plus d’argent, je peux en avoir un neuf avec toutes les garanties nécessaires. »
Enfin, l’influence prédominante des réseaux sociaux et des normes qu’ils véhiculent contribue à façonner des injonctions de consommation auxquelles de nombreux jeunes se réfèrent au moment de prendre une décision. Dans tous les cas, cette prolifération d’informations plus ou moins contradictoires génèrent une surcharge cognitive chez les consommateurs qui les conduit à privilégier la simplicité et le prix.
L’observation plutôt que l’entretien
Pour proposer des solutions efficaces, il semble impératif de ne pas se fier exclusivement aux déclarations des individus qui se révèlent peu fiables dans la prédiction de leurs comportements. Dès 1992, l’ouvrage Néo-Marketing soulignait déjà le risque pour les entreprises de se fonder uniquement sur les déclaratifs et attitudes des consommateurs qui, animés par un désir de valorisation de soi, multiplient les discours vertueux.
Pour répondre à cette problématique, le recours à la méthode des itinéraires développée par le Professeur Dominique Desjeux, professeur émérite en anthropologie à l’Université de Paris, peut s’avérer pertinent. Ce procédé consiste à analyser comment un produit ou un service s’inscrit dans un réseau enchevêtré d’interactions sociales, depuis la phase de recherche et de sélection jusqu’à l’utilisation et l’élimination du produit. Et ce, à partir d’observations empiriques plutôt que d’entretiens porteurs de biais plus ou moins conscients. L’École des Cultural Studies au Royaume-Uni a de fait montré, dès les années 1950, combien l’appareillage des enquêtes de consommation reposant sur du déclaratif rendait peu ou faussement compte des modes de vie de classes sociales au faible capital culturel.
Le but de ces approches plus immersives est de comprendre le processus d’acquisition d’un bien en le replaçant dans le contexte social afin d’identifier les différentes contraintes qui influencent les choix du consommateur. La consommation est alors appréhendée comme un processus longitudinal, ce qui permet de ne pas négliger les espaces et les étapes de consommation où peut se manifester le green gap.
La sensibilisation et l’éducation des jeunes consommateurs constituent ici des leviers pour faciliter la transition vers de nouveaux comportements. Pour ce faire, une transparence et une simplification accrue des labels peut s’avérer déterminante et leur permettre de faire des choix plus éclairés. En parallèle, il est essentiel de communiquer sur les bénéfices personnels que peut offrir une consommation éco-responsable, que ce soit en termes de coûts financiers, de santé ou même d’expérience d’achat. Cette stratégie vise à démontrer aux jeunes que leurs choix personnels ont un impact positif sur l’environnement mais avant tout sur leur propre bien-être.
Sasha Séjaï a reçu des financements de l'Université de Caen.
Catherine Allix-Desfautaux et Olivier Badot ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.
13.05.2024 à 16:48
Les dangers de la pollution sonore sous-marine : l’art peut-il aider la science ?
Irène Mopin, Research scientist, ENSTA Bretagne
Texte intégral (2271 mots)

L’océan, plus grand écosystème de la planète et berceau de la vie organique, est lourdement menacé. Parmi les pressions engendrées par l’homme, comme la pêche intensive, la pollution plastique, ou les contaminations chimiques, celle du son est souvent négligée.
La pollution sonore, bien qu’invisible, est dévastatrice : le bruit généré par les activités humaines altère l’équilibre de la vie sous-marine, mettant en péril la survie des individus et groupes d’individus, ce qui, à plus grande échelle temporelle implique la survie d’espèces sous-marines entières tels que certains cétacés.
Le projet art et science (S)E(A)SCAPE propose d’aborder de manière artistique et créative la question de la pollution sonore des écosystèmes marins. En suscitant l’émotion et en stimulant la créativité, l’équipe artistique a la conviction que l’art est un outil pour éveiller les consciences et provoquer l’action, dès le plus jeune âge.
Le son et les écosystèmes marins
À l’état naturel, le monde sous-marin est un monde de sons. Ce qu’on appelle le paysage sonore sous-marin est empli de sons provenant de diverses sources telles que le déferlement des vagues, la tombée de la pluie sur la surface de l’eau, les séismes, le craquement des icebergs, etc. Au sein de ce paysage ambiant, de nombreuses espèces, animales ou végétales, sont sensibles aux sons et y ont recours. En particulier, les poissons utilisent des informations sonores pour pressentir leur environnement. Réputés muets « comme des carpes » dans leur « monde du silence », les poissons ont en réalité développé au cours de l’évolution des dizaines de manières différentes de produire du son.
[Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]
Un jeune poisson se dirigera, par exemple, vers le récif coralien le plus adapté à sa croissance grâce à l’écoute de son contenu sonore.
Toujours dans ces barrières de corail, une femelle poisson-demoiselle ne trouvera un mâle et son nid préparé qu’en écoutant les sons qu’il émet pour la courtiser.
Les cétacés, bien connus pour leurs chants, utilisent le son pour tout un ensemble de fonctions : trouver à manger, chasser, détecter des prédateurs, communiquer, se localiser. En effet, seules les ondes acoustiques se propagent assez loin sans être trop absorbées pour transmettre de l’information dans l’eau de mer, contrairement par exemple à la lumière qui est très vite absorbée par l’eau, la majeure partie des océans baignant dans l’obscurité la plus totale. La possibilité de transmettre et recevoir des signaux sonores est donc une question de survie pour tous les cétacés, autant lorsqu’ils sont proches des côtes que lorsqu’ils traversent des océans.

Les activités humaines, source additionnelle de bruit sous-marin
Depuis des dizaines d’années, les activités maritimes s’intensifient sur l’ensemble des océans. Parmi ces activités, nombreuses sont celles qui produisent du son telles que les passages de navires, les forages, battages, les activités nautiques touristiques et portuaires. Au paysage sonore naturel s’ajoute donc un paysage sonore anthropique qui peut devenir une gêne pour les espèces. Lorsque le bruit ambiant généré est trop fort, les communications entre individus sont coupées, les repères sont perdus, l’utilisation du son pour chasser et s’alimenter devient impossible. Le trafic maritime est une des principales causes de bruit continu générant ces masquages de communication. Notamment, son niveau sonore basse fréquence augmente depuis les années 1960, intensifiant la pression humaine sur les écosystèmes. Les espèces marines peuvent aussi souffrir d’impacts physiologiques, en particulier produits par les explosions sous-marines, sources de niveaux sonores extrêmes. Les organes internes des individus comme le système auditif sont alors endommagés, la puissance de l’explosion pouvant aller jusqu’à engendrer des traumatismes létaux.
Sensibiliser pour susciter l’action
Le projet de co-création art et science (S)E(A)SCAPE propose d’aborder de manière artistique et créative la question de la pollution sonore des océans. Entre électro, musique expérimentale, street-art et médiation scientifique, il réunit des artistes et des scientifiques issus de différents horizons pour créer une expérience immersive mélangeant arts visuels et sonores : le collectif Oreille Indiscrète (direction artistique, création sonore et musicale), le collectif Reskate Studio (arts visuels et fresque), la musicienne Marie Delprat (composition et performance), la chercheuse en acoustique sous-marine Irène Mopin (référence scientifique, contribution à la composition) et le biophysicien et écrivain Bill François (médiation scientifique).
(S)E(A)SCAPE, un projet en plusieurs temps
Avec l’objectif de sensibiliser et d’éveiller les consciences, différents temps sont proposés au public :
Le premier temps est celui du concert. La création musicale et la scénographie plongent les spectateurs dans les sonorités marines, depuis le large vers les profondeurs. Des bruits anthropiques comme des sons naturels sont intégrés à la composition, modelés et repris par la musicienne en direct sur scène. Il s’agit d’une rencontre où se rejoignent sciences, technologies innovantes et création artistique, dans laquelle chacune et chacun est amené à s’immerger dans le paysage sous-marin, le (S)E(A)SCAPE.
Vient ensuite un temps d’échange : une médiation scientifique sous forme de mini-conférence est proposée au public à la suite du concert. Alors que la musique évoque l’émotion et le poétique dans le registre artistique, la médiation scientifique assurée par Bill François apporte une dimension pédagogique et éclairante sur l’univers sonore sous-marin. En s’appuyant sur les sons déployés dans la composition musicale, Bill François invite avec poésie et humour à s’émerveiller et à respecter l’univers sous-marin et les espèces qui l’habitent.
L’expérience se poursuit avec un temps de découverte : le public est invité à explorer trois cabines interactives conçues en collaboration avec l’ENSTA Bretagne, le LAUM et Reskate Studio, et animées par l’équipe du projet.
Dans la cabine « Luminescences », muni de lampes de poche UV, le public découvre des créatures bioluminescentes sous-marines, représentées par Reskate Studio. Dans la cabine « Le son des bulles » développée par le LAUM, le public se familiarise aux outils qu’utilisent les chercheuses et chercheurs pour enregistrer les sons, souvent méconnus, des océans. Dans la troisième cabine, « Sonorités marines », le public est invité à reconnaître et identifier les sons entendus lors du concert à travers un quiz sonore : sur les parois de la cabine, une illustration représente le cheminement sonore de l’œuvre musicale et des boutons permettent d’écouter les sons produits par les différents éléments, de la crevette à l’explosion sous-marine en passant par les grands mammifères.
Les premiers spectacles ont eu lieu à la biennale du son Le Mans Sonore 2024, réunissant 400 spectateurs. Plus de 200 scolaires du Mans ont aussi pu assister aux concerts qui leur étaient dédiés puis participer aux cabines pédagogiques, découvrant ainsi les sonorités marines, les instruments de mesures acoustiques sous-marins et les fresques luminescentes.
Deux concerts sont prévus en juillet 2024 au festival Plein Champ (Le Mans) et aux fêtes maritimes Brest 2024. Une tournée en Suisse est ensuite prévue à l’automne 2024.
L’espoir d’une cohabitation sonore sous-marine
Pour mieux respecter l’environnement sonore sous-marin, des mesures de réductions du bruit anthropique sont nécessaires. En premier lieu, la réduction du trafic maritime, notamment la réduction de la vitesse des navires et leur évitement des zones à écosystèmes fragiles, permettrait de diminuer drastiquement le bruit ambiant généré et réduire ses conséquences.
En zone côtière, limiter les activités nautiques motorisées réduirait l’impact sur les espèces environnantes telles que les dauphins, phoques, poissons et crustacés des petits fonds. Dans le cas des chantiers off-shore comme le battage de pieux (mise à poste des pieds d’éoliennes dans le fond marin), des solutions comme l’utilisation de rideaux de bulles (ensemble de bulles d’air générées sous l’eau) pour confiner la propagation des forts niveaux sonores à de faibles zones sont envisagées.
L’utilisation de ces solutions est un premier pas vers une diminution de la pollution sonore humaine, mais beaucoup de chemin reste à parcourir pour accéder à une cohabitation sous-marine écologique. En particulier, les mécanismes d’utilisation du son par de nombreuses espèces sont encore méconnus. Mieux comprendre les écosystèmes et leur sensibilité au son est donc une étape indispensable.
En parallèle des recherches scientifiques, les démarches de sensibilisation comme le projet (S)E(A)SCAPE participent à avertir sur les conditions sonores marines, et permettent d’inspirer des actions à toutes les échelles.
Cet article a été co-écrit avec Noémie Favennec-Brun (compositrice et chercheuse) et Bill François (biophysicien et naturaliste). Les auteurs remercient la Compagnie Oreille Indiscrète et le festival Plein Champ, co-producteurs de (S)E(A)SCAPE, ainsi que tous les partenaires du projet.
Irène Mopin ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
13.05.2024 à 11:59
Comment se servir de l'art pour former au management ?
Thomas Blonski, Professeur assistant en stratégie et entrepreneuriat, ICN Business School
Texte intégral (1679 mots)
Depuis une vingtaine d’années, de plus en plus de structures ont été créées pour organiser des projets associant entreprises et artistes. On retrouve des agences comme Viarte, Mona Lisa ou Musa Decima, des associations nommées Tillt, Conexiones Improbables ou Mode d’Emploi, ou encore des collectifs à l’instar d’Art Thinking. Les liens entre art et entreprises semblent avoir été renforcés par l’influence de trois facteurs principaux. D’une part, les lois favorables au mécénat d’entreprise qui ont été votées dans presque tous les pays occidentaux. En France, il s’agit de la loi Aillagon de 2003. D’autre part, un discours managérial très favorable aux capacités de créativité a émergé. Enfin, la nécessité pour les artistes de trouver de nouveaux débouchés à leur activité leur a fait apparaître l’entreprise comme un lieu potentiel d’activité.
Ces projets entre art et entreprise reposaient à l’origine sur du mécénat classique, des partenariats déjà abondamment étudiés en marketing. Certaines entreprises ont cependant cherché à aller plus loin que le simple achat d’œuvres. Des projets plus ambitieux de résidences d’artiste en entreprise ont vu le jour, par exemple à la fondation Hermès, ce qui a été favorisé par le ministère de la Culture. Plus encore, certains groupes ont voulu accentuer au sein de ces résidences le contact entre l’artiste et l’entreprise, au motif que ce contact serait bénéfique aux employés et aux managers. Dans ces projets, entreprise et artistes se regroupent autour d’un objectif commun, le plus souvent la cocréation d’une œuvre.
Le rôle de l’artiste peut y être passif, en se bornant à réaliser l’œuvre avec des employés, en discutant avec eux de façon plus ou moins informelle. Il peut être aussi actif : l’artiste partage son travail, sa méthode et sa vision du projet de façon formelle devant ses interlocuteurs au cours de conférences ou de séminaires. Dans un travail de thèse et dans des travaux qui en ont découlé, nous avons étudié plusieurs de ces projets ainsi qu’un séminaire d’apprentissage pour managers et étudiants conçu par le collectif Art Thinking, qui apprend à « créer de l’improbable avec certitude ».
Mieux que l’inspiration : le partage d’une méthode
En quoi l’enseignement de la méthode artistique peut-il être utile au management ? Tout commence par un changement de vision sur l’artiste : loin de rencontrer une personne à l’inspiration géniale tombée du ciel, les managers découvrent tout le travail propre à l’activité artistique. La pratique de l’art nécessite des compétences rationnelles et une méthode de travail, comme l’ont si bien décrit Pierre-Michel Menger, professeur au Collège de France, et la sociologie de l’art. Puisque l’artiste ne suit pas une pseudo-inspiration mais recourt à une réelle méthode de travail, il est possible de s’en inspirer dans un contexte d’entreprise.
En quoi consiste cette méthode ? Une caractéristique du travail artistique est de se fonder sur une répétition d’essais, de tentatives dans des directions plus ou moins connues ou anticipées, consolidées par des échanges avec divers acteurs gravitant autour de la création. C’est une sorte de bidouillage systématique, fait de suggestions, de détournements, d’explorations diverses, souvent inutiles ou décevants de prime abord mais qui permettent, à force d’approfondissement et de corrections, de faire émerger des idées ou solutions nouvelles.

Chaque lundi, que vous soyez dirigeants en quête de stratégies ou salariés qui s’interrogent sur les choix de leur hiérarchie, recevez dans votre boîte mail les clés de la recherche pour la vie professionnelle et les conseils de nos experts dans notre newsletter thématique « Entreprise(s) ».
Dès lors, les entreprises peuvent en profiter de deux manières. D’abord, en laissant les artistes procéder de cette façon en leur sein. Cela pourrait s’apparenter à une sorte d’externalisation auprès de l’artiste des fonctions d’exploration ou de recherche de l’entreprise. Ensuite, et c’est ce le point que nous avons approfondi, l’entreprise peut demander à l’artiste de partager cette compétence et cette méthode avec ses managers ou ses employés. Ces derniers apprennent dès lors à faire advenir des solutions imprévues qui peuvent s’avérer utiles dans un environnement économique de plus en plus incertain. En bref : à renforcer leur créativité.
« Créer, même un truc tout pourri » : dépasser l’autocensure
Cet apprentissage se fonde sur une condition d’importance : la nécessité pour les managers de dépasser leur autocensure. L’activité incertaine de l’artiste fondée sur des essais répétés potentiellement voués à l’échec est en soi difficile à transposer en entreprise, où la tolérance à l’inconnu reste très relative. L’apprentissage consiste dès lors à admettre les réponses maladroites, les essais en apparence inutiles, voire idiots, ou les idées non abouties.
Cela permet, au passage, de raffermir la confiance en soi des participants, qui se sentent plus légitimes à intervenir dès lors qu’ils bénéficient de cette liberté de parole au départ intimidante. Ainsi que l’ont montré d’autres chercheurs, leur engagement au travail s’accroit car les managers peuvent quitter la routine des solutions habituelles pour emprunter de nouveaux chemins de traverse qui apportent plus de sens au travail. L’un d’entre eux explique :
« L’exercice nous met dans un état d’esprit où il faut y aller ! Il faut créer, même un truc tout pourri. »
Un autre poursuit :
« À la fin, vous vous dites : “oui, mais je l’ai fait, j’ai créé de l’improbable avec certitude !” Ça apporte une satisfaction. Concrètement, dans notre travail au quotidien, je trouve que déjà ça nous permet de nous dire que rien n’est impossible. »
La principale faiblesse de ce type de formations provient néanmoins de l’impossibilité d’en prédire les résultats. La méthode artistique étant fondée sur l’incertitude, il devient difficile de proposer des bénéfices mesurables aux entreprises désireuses d’explorer cette voie. Les projets artistes-entreprise dépendent donc presque toujours des dirigeants des entreprises, selon leur appétence plus ou moins grande pour l’art, et pour l’incertitude. Cependant, ce n’est pas parce qu’ils sont imprévisibles qu’il n’existe pas de résultats convaincants à l’apprentissage par l’art, bien au contraire. On n’expliquerait pas, sinon, le développement notable de ce genre de projets et des structures qui les organisent et les accompagnent.
Thomas Blonski ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
12.05.2024 à 17:50
« No parking, no business » en centre-ville : un mythe à déconstruire
Mathieu Chassignet, Ingénieur transports et mobilité, Ademe (Agence de la transition écologique)
Texte intégral (2600 mots)
En mars 2024, des associations de commerçants ont saisi le Conseil d’État pour s’insurger contre la future piétonnisation de la Presqu’Île de Lyon.
Les mesures de ce type se multiplient en France dans une volonté d’apaiser les centres-villes pour les rendre plus agréables et y réduire la pollution. Mais elles génèrent quasi systématiquement une levée de boucliers de la part des commerçants qui y sont implantés.
Déjà frappés par une concurrence croissante du commerce en ligne et des zones commerciales périphériques – qui se traduit par un taux de vacance commerciale (vitrines vides) qui a fortement augmenté dans les villes françaises – ils voient toute mesure de réduction de la place de la voiture (piétonnisation, stationnement…) comme une menace supplémentaire à la bonne marche de leurs affaires.
Pour répondre aux difficultés du commerce de centre-ville, deux écoles se font face :
La première, souvent prônée par les commerçants, consiste à faciliter la circulation et le stationnement automobile en espérant drainer des clients éloignés.
La seconde, au contraire, propose de travailler sur l’ambiance urbaine, en reprenant de l’espace à la voiture au bénéfice des piétons, en misant sur le fait que ces derniers auront davantage tendance à venir s’y promener et y consommer.
À lire aussi : Mobilité : et si on remettait le piéton au milieu du village ?
Sur ce sujet sensible où opinions et ressentis dominent, rares sont les études qui se sont penchées sur la mobilité des clients qui fréquentent les commerces de centre-ville pour objectiver le débat. Quelques-unes existent toutefois, menées à Rouen, à Lille ou encore à Nancy.
Toutes mettent en évidence les mêmes constats : la plupart des clients vivent à proximité des commerces, viennent majoritairement à pied et en transport collectif et appellent de leurs vœux des espaces apaisés et une place restreinte de la voiture. De leur côté, les commerçants surestiment systématiquement l’usage de l’automobile par leurs clients.
La plupart des clients vivent à proximité
L’idée selon laquelle les clients se rendraient massivement en centre-ville pour y consommer, depuis la périphérie, est mise à mal par les études existantes : dans les grandes villes, 84 % des habitants de la ville-centre achètent majoritairement dans cette même ville-centre, alors que très peu de résidents de la périphérie viennent pour leurs emplettes.
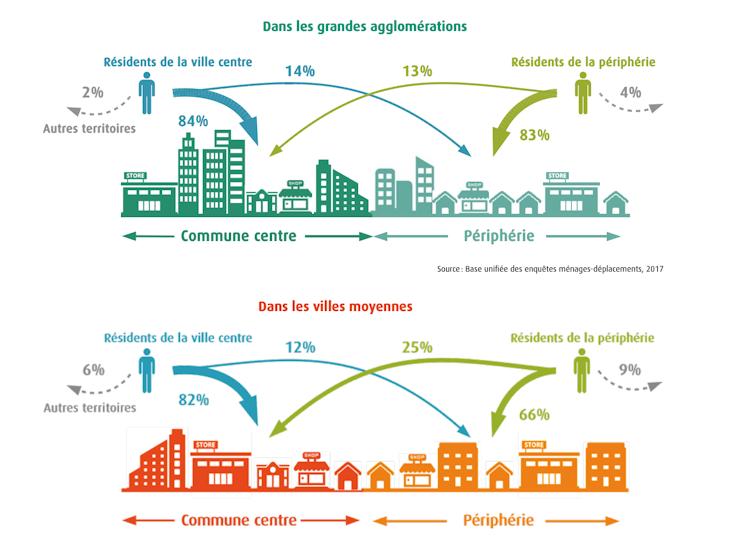
Ainsi à Lille, une étude de terrain que j’ai menée révèle que 63 % de la clientèle du centre-ville vit intra-muros et 6 % en première couronne, soit 70 % très proche du centre. Même bilan à Nancy où 57 % de la clientèle habite dans la ville et 89 % dans la métropole, sachant que cette dernière est particulièrement resserrée. À Nantes, enfin, 53 % des consommateurs du centre-ville vivent dans la ville.
Dans les villes moyennes (de 10 à 100 000 habitants), on observe globalement une tendance similaire : 25 % seulement des habitants de la périphérie consomment majoritairement dans la ville-centre.
La majorité des clients sont piétons
Deuxième constat, la plupart des consommateurs du cœur des grandes villes s’y rendent à pied, mode de déplacement qui arrive en général devant les transports collectifs puis la voiture.
A Lille, la marche constitue ainsi le mode de déplacement de 42 % des clients, les transports en commun 28 % et la voiture 21 %.
À Nantes, ces parts s’élèvent respectivement à 27 %, 38 % et 21 %.
À Saint-Omer, qui ne compte que 13 000 habitants, près de 40 % des clients viennent à pied et 60 % en voiture. Si elle est minoritaire, la marche reste bien présente.
Cette répartition modale apparaît très dépendante de la taille des villes : à Paris, 5 % des clients arrivent en voiture, tandis que cette part est d’environ un tiers dans les villes autour de 100 000 habitants. Et même dans une ville comme Cahors, qui compte 20 000 habitants, seuls 45 % des clients des commerces de centre-ville y vont en voiture, à égalité avec la marche.
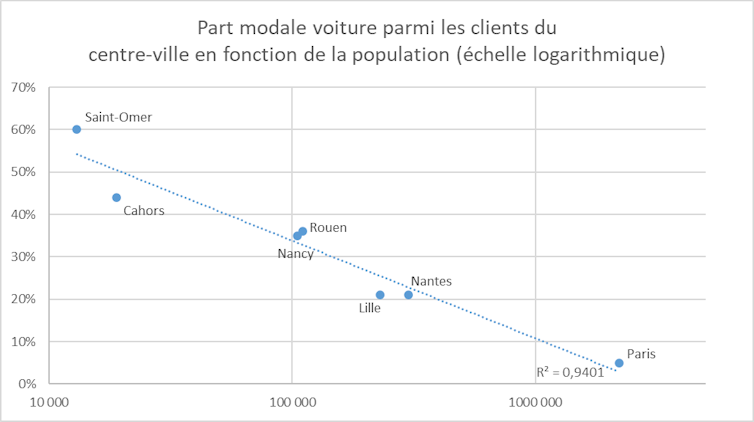
À lire aussi : Marche, vélo : les gains sanitaires et économiques du développement des transports actifs en France
Les clients veulent un espace avec moins de voitures
Troisième observation, les clients estiment qu’un recul de la place de la voiture dans les centres-villes les inciterait à y consommer davantage.
Dans plusieurs études, des propositions leur ont été soumises afin d’améliorer l’attractivité des commerces en centres-villes : transports en commun, infrastructures cyclables, végétalisation, trottoirs plus larges, facilitation de l’accès et du stationnement automobile…
À Lille, seuls 23 % estiment que cette dernière modalité est prioritaire. Les trois quarts restants privilégient les autres pistes. À Rouen également, la baisse du bruit et de la circulation sont plébiscitées quand 20 % seulement des réponses mentionnent le stationnement.
Et même dans une ville comme Saint-Omer, où l’emprise de la voiture est forte, ils ne sont que 39 % à citer l’accès et le stationnement automobile comme une mesure prioritaire. Autrement dit, même chez ceux qui viennent en voiture, ce n’est pas forcément le plus important… ce qui, au fond, est compréhensible puisque tout consommateur (même automobiliste) devient piéton à un moment donné pour accéder à son commerce.
Les commerçants surestiment leurs clients automobilistes
Enfin, et c’est sans doute le constat le plus important pour comprendre la teneur des débats, les études révèlent que les commerçants surestiment largement la part de clients qui viennent en voiture.
À cet égard, l’exemple le plus frappant est celui de Nancy, où les commerçants interrogés croyaient que 77 % de leurs clients venaient en voiture : c’est en réalité le cas de… 35 % d’entre eux. Ils imaginaient également que les piétons ne représentaient que 11 % de leur clientèle, contre 39 % dans les faits, et que 1 % s’y rendaient à vélo, alors que les cyclistes composent 13 % de leurs acheteurs.
Cette surestimation a pu être observée dans beaucoup d’autres villes. Dans ce contexte, il est peu surprenant que les commerçants craignent plus que tout les projets de réduction de la place de la voiture.
Les raisons de ce biais sont diverses. En France, les commerçants font partie de la catégorie socioprofessionnelle qui utilise le moins les mobilités alternatives. Eux-mêmes se déplaçant beaucoup en voiture, ils semblent calquer leur cas personnel sur l’ensemble de leur clientèle.
Autre explication à ce biais : les automobilistes sont globalement assez « râleurs » et expriment fréquemment leur mécontentement auprès des commerçants vis-à-vis des conditions de circulation ou de stationnement. Nous avons tous déjà entendu un client annoncer « on ne peut plus se garer dans le quartier » à peine la porte du commerce poussée. Les commerçants l’entendent cinq fois par jour.
A contrario, les piétons formulent bien moins souvent ce genre d’agacement, alors même que les cheminements sur les trottoirs laissent bien souvent à désirer (présence d’obstacles, de poubelles… voire d’automobilistes stationnés sur le trottoir !).
Enfin, cette surestimation peut comporter une part de bluff : surjouer le rapport de force dans l’espoir d’obtenir des compensations de la part de la municipalité. À Madrid, les commerçants ont dénoncé lors de l’instauration d’une ZFE une perte de chiffre d’affaires consécutive de 15 %. Après analyse des données réelles, le chiffre d’affaires du quartier avait en fait augmenté de 8,6 % au bout d’un an.
Un chiffre qui invite à faire preuve de recul vis-à-vis du discours commerçant, et qui souligne la nécessité de mener des études préalables aux projets de transformation de l’espace public. C’est ce qu’a fait la ville de Cahors, qui souhaitait réduire l’emprise de la voiture sur l’une de ses places : l’étude de terrain réalisée en amont a permis de désamorcer les craintes des commerçants.
No parking, more business ?
Quand bien même les automobilistes sont minoritaires parmi la clientèle du centre-ville, leur poids n’est pas négligeable. Leur éviction ne pourrait-elle pas engendrer une perte pour les commerces ? Le questionnement semble légitime.
En réalité, il s’agit de sortir du cloisonnement entre piétons, automobilistes, utilisateurs de transport collectif. Souvent, nous sommes les trois à la fois. La plupart des automobilistes disent ainsi qu’il leur arrive de venir par d’autres moyens que la voiture.
[Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]
À Lille, parmi les clients qui viennent en voiture, seuls 13 % n’utilisent que ce mode de déplacement pour venir en centre-ville. Autrement dit, 87 % d’entre eux empruntent parfois un autre mode de transport pour y aller. La fréquentation du centre-ville y a en outre bondi de 15 % après la piétonnisation. Ce chiffre montre qu’en compliquant – un peu – l’accès en voiture, la ville est en fait rendue beaucoup plus agréable pour tous. Ce qui se traduit par une fréquentation accrue.
D’autres études ont été menées à l’étranger et dressent le même constat.
En Espagne, 14 villes (petites, moyennes et grandes) ayant mis en œuvre des projets de piétonnisation ont ainsi été analysées. Ces projets se sont systématiquement accompagnés d’une augmentation significative du chiffre d’affaires des commerces, avec un effet plus fort encore dans les petites villes.
Aux États-Unis et au Canada, 45 études de cas menées sur des projets favorables à la marche, au vélo ou aux deux dressent le même constat. Dans 90 % des cas, ils ont profité aux commerces, une toute petite proportion des cas d’usage a engendré une baisse du chiffre d’affaires.
Rappelons enfin qu’il s’agit de remettre cette tendance en perspective. La réduction de la place de la voiture en ville est ancienne et les commerçants l’ont toujours combattue, agitant la peur de « la mort du centre-ville ». Mais une fois les transformations opérées, elles ne sont jamais remises en question et on finit par se demander pourquoi on ne les a pas faites avant.
Mathieu Chassignet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
12.05.2024 à 17:50
Les fleurs laissent tomber les insectes pollinisateurs
Samson Acoca-Pidolle, Doctorant en écologie évolutive, Université de Montpellier
Texte intégral (1351 mots)

Alors que le déclin des insectes ne ralentit pas, de nouvelles questions se posent quant à la manière dont les plantes, qui ont besoin des pollinisateurs, s’adaptent. Comment font-elles pour se reproduire dans ces conditions ? Dans une récente étude que nous avons menée, nous comparons des fleurs de pensée des champs (Viola arvensis) poussant aujourd’hui dans la région parisienne à des plantes plus anciennes de la même espèce, « ressuscitées » à partir de graines collectées il y a 20 à 30 ans. Nous avons trouvé que les fleurs actuelles sont 10 % plus petites, produisent 20 % moins de nectar que leurs ancêtres, des caractéristiques importantes pour attirer les pollinisateurs, qui viennent en conséquence moins les visiter. Ces changements montrent que les liens qui nouent les pensées à leurs pollinisateurs sont en train de se rompre.
Pour mettre en évidence l’évolution des fleurs actuelles par rapport à leurs ancêtres, nous avons eu recours à une méthode appelée « écologie de la résurrection ». Cette pratique consiste à comparer des individus issus d’une même espèce, mais récoltés à plusieurs années d’intervalle.

Dans le cas de cette étude, publiée dans le journal scientifique New Phytologist, les plantes anciennes ont été « ressuscitées » depuis des graines collectées dans les années 1990-2000 et conservées par les Conservatoires botaniques nationaux de Bailleul et du Bassin parisien. Ces plantes anciennes ont été comparées à des plantes prélevées en 2021. La comparaison entre les pensées anciennes et leurs descendantes poussant de nos jours dans les mêmes champs du Bassin parisien permet de comprendre l’évolution de l’espèce au cours de ces 20 à 30 dernières années.
Le déclin des pollinisateurs, responsable désigné ?
C’est ainsi que nous avons pu étudier l’évolution de quatre populations de pensées des champs, une plante messicole, c’est-à-dire une plante sauvage présente dans les cultures agricoles, dans le Bassin parisien. Les plantes messicoles jouent un rôle important dans les services de pollinisation en attirant les insectes pollinisateurs et en leur offrant une ressource diversifiée. Le déclin de l’attractivité des messicoles pourrait diminuer l’attraction des pollinisateurs, pourtant nécessaires aux bons rendements de 75 % des cultures agricoles.
La moindre attractivité des fleurs pour les pollinisateurs est vraisemblablement leur réponse au déclin des insectes durant les dernières décennies, rapporté par plusieurs études à travers l’Europe. Plus de 75 % de la biomasse d’insectes volants, dont font partie les pollinisateurs, a disparu dans les aires protégées allemandes en 30 ans. Les pensées des champs, comme la majorité des plantes à fleurs, sont le fruit d’une coévolution avec leurs pollinisateurs durant des millions d’années pour arriver à une relation à bénéfice réciproque. La plante produit du nectar pour les insectes, et les insectes en contrepartie assurent le transport du pollen entre fleurs, assurant leur reproduction.
Avec le déclin des pollinisateurs, et donc du transfert de pollen entre fleurs, la reproduction des plantes devient plus difficile. Les résultats de cette étude révèlent que les pensées sont donc en train d’évoluer afin de se passer des pollinisateurs pour leur reproduction. Elles pratiquent de plus en plus l’autofécondation, qui consiste à se reproduire avec soi-même, ce qui est possible pour les plantes hermaphrodites, soit 90 % des plantes à fleurs environ.
Une évolution similaire a déjà été observée lors d’expériences où des plantes, en seulement quelques générations et en l’absence de pollinisateurs se reproduisent plus par autofécondation et produisent des fleurs avec moins de nectar et moins attractives que leurs congénères pollinisées par des insectes. Notre étude est en revanche la première à montrer que le déclin des pollinisateurs pourrait déjà être responsable d’une évolution vers l’autofécondation dans la nature.
Des conséquences pour l’ensemble de l’écosystème
L’autofécondation est une stratégie reproductive qui peut être efficace sur le court terme mais qui limiterait la capacité de l’espèce à s’adapter aux changements environnementaux futurs en réduisant la diversité génétique, ce qui augmenterait donc les risques d’extinction.
Ces résultats sont également une mauvaise nouvelle pour les pollinisateurs et le reste de la chaîne alimentaire. Notre étude a en effet mis en évidence un cercle vicieux : une réduction de la production de nectar par les plantes signifie moins de nourriture pour les insectes, ce qui peut à son tour contribuer à menacer les populations de pollinisateurs. Nous montrons que le déclin des pollinisateurs n’a pas que des conséquences démographiques mais également évolutives qui sont d’autant plus difficiles à inverser.
Samson Acoca-Pidolle ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
12.05.2024 à 17:50
« On n’en peut plus ! » Comment la réduction d’accès aux prestations sociales alimente l’extrême droite
Maeva Durand, Docteure en sociologie, Université Paris Dauphine – PSL
Texte intégral (2239 mots)
« J’ai 62 ans, j’ai toujours voté. On a eu Hollande, puis la droite avec Macron. Moi, maintenant, je vote autrement. Peut-être que je me trompe, mais je vote Marine Le Pen. Et j’espère que ça fera un changement… radical. Regarde en Italie, ils sont pas morts, les gens. Et pourtant, c’est l’extrême droite. Ma sœur, qui est en Italie, me dit que sa pension a augmenté. En France tu vois ça ? À part nous prendre des impôts, augmenter tout et rien nous donner ? ! Regarde les problèmes que j’ai avec la CAF… »
Franco-italienne, Bianca vit dans le sud de la France. Elle a occupé durant plusieurs années des postes précaires en tant qu’employée, et parvient « tant bien que mal à joindre les deux bouts » en recourant à différentes prestations sociales. Comme de nombreuses personnes que j’ai interviewées lors d’enquêtes ethnographiques, elle peine à accéder aux aides sociales et s’intéresse au Rassemblement national (RN), car ce parti défend notamment l’idée d’une préférence nationale.
La prise en charge institutionnelle en matière d’aides sociales a un impact sur les représentations sociopolitiques, qui alternent entre résignation et polarisation électorale, via l’extrême droite (RN) et extrême gauche (LFI), comme le montrent mes recherches. En amoindrissant les protections sociales et filets de sécurité à disposition des classes populaires, le gouvernement favorise un sentiment de mise en concurrence entre catégories sociales, et par ce fait, la montée de l’extrême droite. Sur ce sujet, un article à la Revue française de science politique sera publié d’ici quelques mois.
Dépendre des aides sociales : de l’humiliation à la résignation politique
Bénéficiant de dispositifs d’assistance en tant que famille dite « monoparentale » ou travailleuses pauvres, les femmes des classes populaires cherchent à se construire une respectabilité. Elles se heurtent au sentiment d’humiliation de devoir toujours « quémander » des aides (selon l’expression des enquêtées) dont elles ne maîtrisent ni les montants, ni la temporalité.
Âgée de 53 ans, Rose-Marie a effectué du travail non déclaré avant de travailler en Chèques emploi service en tant que jardinière chez des particuliers. Elle doit s’occuper de sa petite-fille, à la suite du décès de sa fille, et dépend de l’Allocation spécifique de solidarité (ASS) depuis son licenciement en tant que cariste. Elle s’exprime ainsi :
« J’ai quand même l’ASS, à peu près 500 euros par mois. […] Quand je déclare dix heures… C’est pas grand-chose, hein ? Et bah sur dix heures, ils arrivent encore à m’enlever de [l’argent]. Alors je leur ai dit à [France Travail], et ils m’ont dit “C’est comme ça”. Voilà la réponse que j’ai eue. Et après on s’étonne des gens qui travaillent au noir. Et ça fait des années, rien n’a changé. Je comprends qu’il y a des gens qui en ont marre, parce que, comme on dit, qu’on vote à droite, ou à gauche, c’est toujours pareil. »
À ce fatalisme vis-à-vis de la politique s’ajoute l’impression d’être peu digne d’être représentée par des partis politiques « traditionnels » de gauche ou de droite. Cette enquêtée vote ainsi régulièrement pour le RN et a fini par s’engager dans ce parti, à défaut, dit-elle, de rencontrer les écolos ou socialistes dans son quartier, dont elle se dit pourtant proche.
Espérer sortir de la mise en concurrence par la préférence nationale
Les femmes précarisées rencontrées ont intériorisé le fait « qu’on ne peut pas donner à tout le monde ». Elles se pensent néanmoins prioritaires en matière d’aides sociales du fait de la faiblesse de leurs ressources et, souvent, de leur situation de mère seule. Or le refus de leur demande d’aides sociales participe à construire le sentiment de passer après d’autres fractions des classes populaires.
En effet, à défaut de pouvoir contester le pouvoir des agents de l’État, elles se positionnent par rapport à ceux et celles qui incarnent une « pression venant d’en bas », à savoir les classes populaires d’ascendance immigrées avec qui elles se sentent mises en concurrence au guichet des aides sociales. Comme le dit encore Rose-Marie :
« On ne dirait pas, mais y’a beaucoup de misère ici. Alors c’est sûr, c’est malheureux ce qui se passe ailleurs. Mais pourquoi faire venir tout le monde alors qu’on n’est pas fichu d’aider ceux qui sont là ? Alors quand elle parle [Marine Le Pen], c’est pour aider les gens qui sont d’abord ici. »
Les commentateurs du champ politico-médiatique, dont le RN et ses soutiens, vont offrir à ces femmes la possibilité d’une mise en récit et d’une solution politique pour mettre fin à leurs désarrois. Leur opposition va alors se tourner contre une partie des classes populaires, qui incarne un bouc émissaire, plutôt que vers un système désincarné contre lequel elles ont peu de marge de manœuvre.
L’application de la réforme chômage renforce cette impression d’être dépossédée de sa vie, sans pour autant percevoir de solution pour soi et ses proches. Aussi, les discours qui soutiennent une vision en termes de préférence nationale permettent de donner une perspective (raciste) de changement radical de société, qui se traduit en :
« Si je n’ai pas le choix, moi avant les autres. »
C’est bien l’accroissement des inégalités entre catégories sociales qui alimente l’extrême droite. Avec la réforme chômage, le gouvernement accentue les divisions entre classes populaires, en restreignant de plus en plus l’accès aux dispositifs assurantiels des allocations. Le chômage s’apparente dorénavant à un système d’aides sociales dont l’accès est fortement délimité et stigmatisé par une partie des dirigeants.
Vers la mise en place d’une politique ségrégative en matière d’aide sociale ?
Depuis le milieu des années 2000, on constate un changement de paradigme concernant le rôle de l’État en matière d’aide sociale. Tout en agissant de moins en moins comme régulateur de l’économie de marché, l’État met l’emphase sur l’idée d’une « aide sociale au mérite ».
Cette nouvelle logique s’inscrit dans une attention polarisée de l’État central, à la fois d’aide aux entreprises et de contrôle renforcé des classes populaires. Côté entreprises, les exonérations sociales et fiscales du travail sont pensées comme favorisant la création d’emplois (en 2017, les aides aux entreprises représentent 6,4 % du PIB contre 2 % en 1979). Côté classes populaires, les causes structurelles du chômage sont évacuées du débat public. Les solutions apportées sont tournées principalement vers les individus, les personnes au chômage devenant les seules à porter la responsabilité du retour à l’emploi.
En outre, la multiplication des « statuts » en matière d’aide sociale a pour effet de segmenter les catégories populaires selon des critères dits « objectifs », mais qui s’inscrivent surtout dans des préoccupations publiques momentanées et des partages de responsabilité selon des intérêts professionnels, départementaux ou institutionnels à l’image des « personnes âgées dépendantes ». Avec cette tendance au ciblage par catégories de populations, on comprend mieux pourquoi « les chômeurs » en viennent à être associés à une sous-catégorie de demandeurs d’aide sociale et moins à des travailleurs.
[Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]
De surcroît, ces dispositifs de prise en charge dépendent en partie des communications politiques. Des dispositifs anciens sont remplacés ou se cumulent à d’autres, sans que cela ne soit forcement efficace pour les personnes concernées. Ceux et celles pouvant prétendre aux aides sociales sont appréhendés à travers leurs particularités, ce qui les adosse à une morale individualisante proche de l’assistance d’État, et non plus à un système de cotisations sociales et patronales auxquels ils ont pourtant participé.
« Quand t’as un problème, tu es face à une machine »
Construire et circonscrire de plus en plus de statuts sociaux a également pour effet de multiplier les acteurs à l’échelon local qui se partagent les responsabilités de la prise en charge, parfois à la place de l’État. Cela s’accompagne d’inégalités de traitement entre territoires : simples procédures de dématérialisation dans certaines zones, accueil présentiel dans d’autres endroits (le financement des Maisons France Services dépend essentiellement des collectivités) ou développement de forme hybride d’accueil des usagers ça et là (bus itinérant dans les Cévennes). La facilité d’accès aux aides sociales varie ainsi selon le lieu de résidence, tout comme la qualité de la prise en charge, avec des agents plus ou moins formés selon le lieu et le statut (CDD, vacations, service civique…).
Françoise, 56 ans, a été femme de ménage et blanchisseuse à l’hôpital. En arrêt maladie suite à un AVC, elle peine à accéder à ses toilettes. Elle revient sur ses difficultés à faire une demande d’allocation ponctuelle au Conseil général et sur son rapport aux aides sociales :
« Les organisations, faut envoyer toujours des nouveaux papiers, on t’en demande toujours plus et y’a plus le contact humain. Tout est sur des machines, tout se fait sur Internet… Regarde [France Travail], quand t’as un problème, tu es face à une machine… les offres d’embauche, c’est pareil, c’est sur Internet, je le vois aussi avec mon fils, avec la CAF ! On te surveille plus aussi, là une assistante sociale va venir chez moi pour voir si je suis bien handicapée (sur un ton de dégoût), pour voir si on va bien me donner un petit quelque chose pour [aménager] mes toilettes… »
Une majorité des femmes rencontrées dépeignent une détresse économique importante, et une culpabilité de ne pas pouvoir répondre aux besoins matériels de leur famille.
Alors que les premiers effets de la réforme chômage de 2019 commencent à se faire sentir, puisque près de la moitié des nouveaux allocataires voient leur allocation baissée de 16 % par rapport à ce qu’ils auraient perçu avant la réforme, le premier ministre souhaite conduire une nouvelle réforme qui vise à réduire la durée d’indemnisation. Pour faire face à cette diminution de leur chômage, les allocataires solliciteront d’autres aides sociales dont l’accès semble de plus en plus difficile. L’État central crée les conditions d’une mise à l’écart, symbolique mais aussi de faits, d’une partie des classes populaires et de mise en opposition entre catégories populaires.
Maeva Durand a reçu des financements de recherche INRAE et lors d'une Agence d’objectifs IRES/cgt-FO
12.05.2024 à 17:50
Sortir les mères seules de la pauvreté grâce à l’emploi : mais quel emploi ?
Oriane Lanseman, Doctorante en économie, Université de Lille
Texte intégral (2357 mots)
Cet article a été co-rédigé par Clémence Helfter, chargée de recherche et d’évaluation à la Direction des statistiques, des études et de la recherche (DSER) de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), et Oriane Lanseman, doctorante en économie à l’Université de Lille.
Les « familles monoparentales » reviennent périodiquement sur le devant de la scène médiatique, particulièrement en période de crise. En fonction de l’actualité sociale et politique, se trouve ainsi convoquée la figure de la mère-courage, méritante, vaillante et fière sur les ronds-points pendant le mouvement des « gilets jaunes » en 2018-2019 ; ou bien celle de la mère dépassée, qui laisse traîner son fils lors des « révoltes urbaines » comme à l’été 2023 à la suite de la mort de Nahel, jeune homme de 17 ans tué par un policier durant un contrôle routier.
Les parlementaires et les pouvoirs publics se penchent actuellement spécifiquement sur le sort des familles monoparentales. Plusieurs propositions de loi sont à l’étude visant à lutter contre la précarité des familles monoparentales. Une mission gouvernementale est également en cours. La délégation aux droits des femmes du Sénat a préalablement produit un rapport d’information qui reprend la principale conclusion de l’état des savoirs sur les familles monoparentales commandité par la Cnaf et paru en septembre 2023 : les familles monoparentales sont confrontées à un cumul de difficultés et d’inégalités, de genre en particulier, globalement impensé.

Le portrait est bien documenté et largement connu aujourd’hui. La monoparentalité est un phénomène massif, un quart des familles sont monoparentales en France. 82 % des parents qui élèvent seuls leurs enfants sont des femmes. Leurs conditions de vie sont moins favorables que celles des couples avec enfant(s), que ce soit en matière de logement, de santé, de revenus, de conditions de travail et d’emploi ou d’articulation vie familiale/vie professionnelle. Elles sont plus nombreuses à être touchées par la pauvreté : la pauvreté en conditions de vie, qui mesure les privations matérielles mais aussi sociales, concerne 31 % des familles monoparentales contre 11 % des couples avec un enfant.
Les mesures qui circulent pour y remédier tournent essentiellement autour de l’amélioration du système de redistribution, la prise en compte de leur situation par le système sociofiscal et le soutien à l’articulation vie familiale/vie professionnelle. Certes, il y a fort à faire dans ces domaines. Mais le parent pauvre du concours Lépine des solutions reste selon nous la question du travail et de l’emploi. Or les conditions de vie des mères seules et de leurs enfants ne pourront pas être améliorées de façon significative et durable sans adresser frontalement la question du (dys)fonctionnement du marché du travail.
Davantage au chômage et à temps partiel subi
Aujourd’hui, plus de 40 % des familles monoparentales vivent en dessous du seuil de pauvreté. Bien que les revenus issus du travail soient essentiels pour échapper à la pauvreté, ils n’y suffisent souvent pas.
Par définition, les personnes vivant seules (avec ou sans enfants) ne bénéficient pas des économies d’échelle que permet le fait d’être en couple, via la mise en commun des ressources et des dépenses, notamment liées au logement. Les parents de familles monoparentales aux revenus modestes sont de ce fait davantage exposés à la pauvreté et à la pauvreté laborieuse, quand ils ou elles ont un emploi. Les mères ont, en moyenne, des revenus d’activité plus bas que leurs homologues masculins du fait des inégalités de genre, massives et persistantes, qui structurent le marché du travail. Mais pour les mères en couple, le revenu du conjoint peut éviter au ménage de verser dans la pauvreté.
Mères seules et mères en couple participent autant au marché du travail : leur taux d’activité, soit la part des personnes en âge de travailler qui ont un emploi ou qui en recherchent un, est équivalent. Les mères seules, néanmoins, sont deux fois plus au chômage que les mères en couple car elles sont globalement moins diplômées et font face à des « freins périphériques » à l’emploi spécifiques : des contraintes temporelles plus fortes, des difficultés pour faire garder leurs enfants ou encore des problèmes de mobilité.
Lorsqu’elle est en emploi, près d’une mère seule sur cinq reste pauvre, contre 5 % des mères en couple. Au-delà de l’accès à l’emploi, c’est aussi et surtout le contenu des emplois occupés qui est à interroger. La moitié des mères seules est concentrée dans dix groupes professionnels dont la majorité appartient au segment précaire du marché du travail. Ils se trouvent dans les secteurs du nettoyage, du secrétariat, du soin et du lien, de l’hôtellerie-restauration ou encore de la grande distribution. Au total, plus d’un tiers des mères seules travaille dans des métiers au service des autres, pour prendre soin des personnes (enfants, personnes âgées ou en situation de handicap, notamment) ou des locaux dans lesquelles elles vivent ou travaillent. Elles travaillent tout particulièrement dans les métiers du vieillissement, au caractère essentiel mais aux conditions de travail insoutenables, qu’ont étudié les économistes et sociologues François-Xavier Devetter, Annie Dussuet, Laura Nirello et Emmanuelle Puissant dans Que sait-on du travail ?
À lire aussi : Les travailleuses du soin et du lien aux autres, fières d'un métier qu'elles ne recommanderaient pourtant pas
Concrètement, une mère seule aide à domicile travaille en moyenne 25 heures par semaine pour 802 euros par mois et une mère seule agente de nettoyage 27 heures pour 1039 euros par mois. Les salaires horaires sont bas voire très bas et sont associés à du temps partiel, voire très partiel, qui est non pas « choisi » mais subi pour près de la moitié des mères seules concernées, contre 30 % des mères en couple. Une partie importante du revenu disponible des mères seules à bas salaire provient alors des aides sociales qu’elles perçoivent et qui viennent apporter un complément vital à des salaires proprement « incomplets ». Ces dernières représentent environ 30 % du revenu disponible d’une aide à domicile en situation de monoparentalité contre 11 % pour une mère en couple exerçant le même métier.
Surreprésentées dans les métiers féminisés les plus dévalorisés
Au moins trois raisons expliquent la surreprésentation des mères seules par rapport aux mères en couple dans les métiers à prédominance féminine parmi les plus dévalorisés.
La première a trait à des caractéristiques sociodémographiques défavorables, en particulier un niveau de diplôme plus faible. Les métiers du soin et du lien sont des métiers « en tension » pour lesquels les employeurs ont tendance à desserrer la contrainte de diplôme et de qualification de façon à trouver à recruter. D’autres métiers, pourtant eux aussi féminisés, vont leur être moins accessibles en raison de leur plus faible niveau de diplôme, comme les métiers de l’enseignement par exemple. Ce peut aussi être le cas car leur environnement de travail s’avère inadéquat : les assistantes maternelles doivent ainsi disposer d’un logement permettant d’accueillir les enfants, là où les mères seules ont des logements plus petits en moyenne et davantage exposés aux problèmes d’humidité et de chauffage notamment.
Une deuxième explication réside dans les pratiques d’orientation différenciées de la part des intermédiaires de l’emploi : les mères seules font plus souvent l’objet d’un accompagnement davantage social que professionnel, visant notamment à travailler leur rapport à la parentalité. Et quand accompagnement à l’emploi il y a, dans un contexte de restrictions budgétaires et de moyens inadaptés pour les professionnels de l’insertion, c’est pour orienter principalement ces femmes vers des métiers féminisés et précaires de façon à répondre à l’urgence de leur situation financière. Ces pratiques correspondent à la mise en œuvre concrète des politiques d’activation qui visent à « (re)mettre les individus au travail » pour lutter contre la pauvreté.
Il faut enfin invoquer les stratégies des employeurs. Les mères seules peuvent faire l’objet de discrimination à l’embauche, la monoparentalité étant souvent vue comme susceptible de créer des problèmes de gestion RH de type absentéisme et difficultés de planning. Dans le même temps, certains employeurs vont au contraire avoir tendance à privilégier les candidatures de mères seules pour leur « fiabilité », liée au fait qu’elles n’ont pas le choix de travailler. L’économiste Mathieu Béraud rapporte avec ses collègues ce témoignage d’une gérante d’une PME de nettoyage :
« Déjà je veux une femme. Les meilleures ont autour de 40 ans parce que les enfants sont grands : je n’ai plus trop de chance d’avoir une grossesse qui va perturber le… voilà. Et puis, cyniquement, je les préfère célibataires et avec charge d’enfants : obligées d’aller travailler et pas d’absences. Je vous ai dit que c’était cynique mais voilà les critères. Vous êtes alors sûrs de votre personnel. »
De façon générale, les mères seules font face à un cumul de contraintes qui oblige certaines d’entre elles, les moins diplômées en particulier, à adapter leur activité professionnelle à leur situation familiale. Les horaires de ces métiers sont souvent atypiques, tôt le matin, tard le soir, le week-end, avec des journées qui peuvent être morcelées, ce qui rend l’articulation vie familiale/vie professionnelle plus complexe encore. Les modes de garde classiques étant généralement peu accessibles sur des horaires décalés (quand ils le sont financièrement), les mères seules occupant ces emplois sont globalement plus âgées que les mères en couple et leurs enfants également.
Au total, la revalorisation des métiers à prédominance féminine représente un axe essentiel de la lutte contre la précarité et la pauvreté non seulement de l’ensemble des femmes mais encore plus particulièrement de celles qui élèvent seules leurs enfants. Les économistes Rachel Silvera et Séverine Lemière travaillent sur le sujet depuis des années, irriguant les réflexions du Défenseur des droits et celles de feu le Conseil supérieur à l’égalité professionnelle. Reste aux pouvoirs publics à se saisir de ces travaux et à pousser le patronat à renégocier les classifications de branche en conséquence et à cesser la pratique généralisée du recours au temps partiel et aux bas salaires. Faute de quoi il paraît illusoire de prétendre améliorer les conditions de vie des mères seules et de leurs enfants.
Oriane Lanseman a reçu des financements de la CNSA et de l'IRESP pour sa thèse.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Lava
- La revue des médias
- Le Grand Continent
- Le Monde Diplomatique
- Le Nouvel Obs
- Lundi Matin
- Multitudes
- Politis
- Regards
- Smolny
- Socialter
- The Conversation
- UPMagazine
- Usbek & Rica
- Le Zéphyr
- CULTURE / IDÉES 1/2
- Accattone
- Contretemps
- A Contretemps
- Alter-éditions
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- IDÉES 2/2
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Période
- Philo Mag
- Terrestres
- Vie des Idées
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
- Pas des sites de confiance
- Brut
- Contre-Attaque
- Korii
- Positivr
- Regain
- Slate
- Ulyces
