24.02.2026 à 17:00
L’audition des Clinton peut-elle faire basculer l’affaire Epstein ?
Frédérique Sandretto, Adjunct assistant professor, Sciences Po
Texte intégral (1973 mots)
L’ancien président des États-Unis (1993-2001) et son épouse, ancienne secrétaire d’État (2009-2013) et candidate démocrate à la présidence en 2016, vont témoigner devant la Chambre des représentants dans le cadre de la commission d’enquête sur Jeffrey Epstein. Une audience choc qui pourrait se dérouler selon plusieurs scénarios différents.
Les auditions de Bill et Hillary Clinton devant la commission d’enquête de la Chambre des représentants sur l’affaire Epstein, les 26 et 27 février prochain, s’annoncent comme un moment politique et médiatique majeur aux États-Unis. Jeffrey Epstein, financier déchu condamné pour infractions sexuelles, est au cœur d’un vaste scandale mêlant exploitation de mineures, réseaux d’influence et complaisances au sommet de l’État, qui continue de produire des répliques bien après sa mort en détention en 2019.
Bill Clinton a effectué plusieurs vols à bord du jet privé d’Epstein et la publication de photos le montrant aux côtés de Ghislaine Maxwell a nourri soupçons et théories, faisant de son nom l’un des plus scrutés dans ce dossier. Hillary est, elle, convoquée car elle doit préciser ce qu’elle sait des relations entre son mari et Epstein.
Pourquoi les Clinton ont-ils fini par accepter de témoigner ?
Pendant des mois, le couple Clinton a opposé une résistance frontale à la commission de contrôle de la Chambre, arguant que les convocations étaient juridiquement contestables et politiquement motivées.
Rappelons que la « commission sur l’affaire Epstein » n’est pas une institution permanente ; elle a été créée spécialement pour le dossier Epstein. Il s’agit d’une enquête conduite par des commissions existantes, principalement la commission de contrôle (Oversight), qui disposent du pouvoir d’assigner des témoins et d’organiser des auditions.
Les Clinton estiment que la commission de la Chambre des représentants chargée d’enquêter sur l’affaire Epstein leur est hostile parce qu’elle est contrôlée par la majorité républicaine, politiquement opposée à leur camp, notamment sous la présidence du républicain James Comer, à la tête de la House Committee on Oversight and Accountability. Ils dénoncent une focalisation jugée excessive sur les relations passées entre Bill Clinton et Jeffrey Epstein, estimant que d’autres personnalités liées à Epstein ne font pas l’objet de la même attention, ce qui selon eux révèle un ciblage politique.
Ils critiquent également des méthodes d’enquête qu’ils jugent agressives, comme les assignations à comparaître, les auditions sous serment à huis clos et la menace de poursuites pour entrave en cas de refus de coopérer, considérant que ces procédés suggèrent une présomption de culpabilité. Enfin, ils affirment que la convocation de Hillary Clinton s’inscrit dans un contexte de polarisation politique intense aux États-Unis, où certaines commissions parlementaires sont utilisées pour affaiblir des adversaires médiatiquement, alors même qu’elle n’est pas inculpée dans cette affaire et qu’elle est entendue comme témoin.
Le ton des échanges s’est durci jusqu’à la menace explicite d’un vote pour outrage au Congrès, signe que le bras de fer dépassait le simple cadre procédural. Sous cette pression, Bill et Hillary Clinton ont finalement accepté de témoigner dans des dépositions distinctes mais coordonnées, transformant un affrontement institutionnel en événement national.
Ce basculement s’explique aussi par la déclassification progressive des dossiers Epstein par le département de la Justice. Des dizaines de milliers de pages mêlant dossiers judiciaires, relevés bancaires, photographies et notes internes ont été rendues publiques, sous forme partiellement caviardée pour protéger les victimes. Cette mise à nu d’un système de prédation et de connivences a intensifié la demande de transparence. Chaque publication a relancé spéculations et appels à rendre des comptes. Dans ce contexte, le refus persistant des Clinton de se présenter à une audition devenait politiquement intenable. Lors d’un vote au Congrès lié à leur refus initial de témoigner, plusieurs élus démocrates ont voté avec les républicains pour les sanctionner pour outrage au Congrès, affirmant privilégier la responsabilité et la justice pour les victimes plutôt que la loyauté partisane.
La déclassification a fourni à la commission des éléments documentaires et créé un climat où l’absence des témoins les plus exposés devenait toxique sur le plan politique.
Une audience ouverte
Au-delà du cas Epstein, la convocation d’un ancien président et d’une ancienne secrétaire d’État soulève une question historique. Des présidents ont déjà été confrontés à des enquêtes lourdes ou à des procédures de destitution, mais voir un ex-président appelé comme témoin dans une commission parlementaire focalisée sur un scandale d’abus sexuels et de compromission d’élites constitue une situation quasi inédite par sa charge symbolique. La combinaison d’un ancien couple présidentiel, d’une affaire criminelle devenue symbole de l’impunité des puissants et d’un climat politique polarisé confère à cette audition une dimension exceptionnelle.
Initialement, les discussions sur les modalités du témoignage relevaient d’une gestion classique des risques : huis clos, temps de parole encadré, protocole strict pour limiter les fuites. Les avocats des Clinton plaidaient pour une audition technique et non spectaculaire. La stratégie a toutefois connu une rupture lorsque Hillary Clinton a demandé publiquement que l’audience soit ouverte et retransmise. Ce choix vise à renverser l’accusation d’opacité et à empêcher la diffusion d’extraits partiels susceptibles d’être instrumentalisés. L’audition devient ainsi une scène politique autant qu’un exercice de reddition de comptes.
Cette revendication de transparence répond à la crainte d’une instrumentalisation partisane. Hillary Clinton cherche à apparaître comme une témoin volontaire, exposée à la lumière pour éviter toute manipulation. En rendant la séance publique, elle oblige ses interrogateurs à assumer leurs questions devant l’opinion et tente de déplacer l’attention vers les défaillances institutionnelles qui ont permis à Epstein d’agir. Elle ambitionne ainsi de transformer une position défensive en posture offensive, en se plaçant du côté des victimes et de la vérité.
Au cœur de cette stratégie figure la promesse de révélations importantes sur la manière dont l’État et certaines élites ont géré le cas Epstein. Hillary Clinton a évoqué des documents accablants et des défaillances systémiques, laissant entendre que le scandale dépasse la question des relations personnelles pour toucher à des choix institutionnels et à des signaux d’alerte ignorés. La question demeure de savoir jusqu’où elle est prête à aller dans la mise en cause d’un système dont elle a elle-même fait partie.
L’audition autour de l’affaire Epstein pourrait se dérouler selon quatre scénarios clés, chacun susceptible de produire un impact concret sur la perception publique et l’évolution judiciaire du dossier.
Quatre scénarios
Le premier scénario reste celui du choc maîtrisé. Les Clinton pourraient reconnaître certaines relations sociales ou financières jugées aujourd’hui discutables, tout en niant toute connaissance des crimes d’Epstein. Dans ce cadre, l’audition se transformerait en un exercice de clarification : le public et les enquêteurs obtiendraient quelques confirmations sur les fréquentations et les rendez-vous, mais aucune révélation explosive ne viendrait bouleverser les positions déjà établies. L’effet immédiat serait limité : la couverture médiatique serait intense mais essentiellement centrée sur les contradictions mineures ou sur la perception de sincérité des Clinton.
Le second scénario plausible serait celui de la mise en cause institutionnelle. L’audition pourrait révéler que certains manquements au sein des agences fédérales, des forces de l’ordre ou des structures judiciaires ont permis à Epstein de continuer ses activités sans véritable sanction. Ce scénario élargirait l’enquête au-delà des Clinton, mettant sous pression d’autres responsables politiques ou financiers et déclenchant des appels à des réformes structurelles. Les documents et témoignages mis en avant pourraient révéler un système de protection indirecte ou de négligence, redessinant la compréhension publique des défaillances institutionnelles.
Un troisième scénario envisageable serait l’audition comme affrontement politique. Dans ce cas, chaque camp chercherait à instrumentaliser les déclarations pour déstabiliser l’adversaire, transformant le moment judiciaire en bataille idéologique. Les Clinton, mais aussi leurs opposants, pourraient chercher à utiliser chaque mot à des fins de communication politique, détournant l’attention du cœur du dossier. Ce scénario risquerait de brouiller le récit central de l’affaire, mais pourrait aussi révéler des stratégies de manipulation et d’influence autour du scandale.
Enfin, un scénario complémentaire mais non négligeable serait celui de révélations inédites ou confirmations de défaillances systémiques. L’audition pourrait mettre au jour des documents jusque-là confidentiels ou des témoignages de victimes, donnant une dimension criminelle renouvelée au dossier. Dans ce cas, l’affaire Epstein ne se limiterait plus à un scandale médiatique ou à une controverse politique : elle deviendrait le symbole d’un échec généralisé des institutions à protéger les victimes et à sanctionner les auteurs.
Un grand moment de vérité ?
Dans tous ces scénarios, le point commun est la mise en lumière de la fragilité d’un système où le pouvoir et le réseau social peuvent, dans certains cas, prévaloir sur la justice. L’audition des Clinton, qu’elle soit prudente ou révélatrice, pourrait donc devenir un moment de vérité national : elle a le potentiel de transformer le scandale Epstein d’affaire privée en affaire systémique, exposant non seulement les acteurs directs mais aussi les complicités et défaillances qui ont permis à ces crimes de perdurer.
Dans la presse, cette audience sera scrutée comme un révélateur du fonctionnement réel du pouvoir, un moment où les lignes partisanes pourraient s’effacer devant l’urgence de la transparence et de la vérité judiciaire.
Frédérique Sandretto ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
24.02.2026 à 16:59
Le Mexique à feu et à sang après l’élimination par l’armée d’un baron de la drogue
Raul Zepeda Gil, Research Fellow in the War Studies Department, King's College London
Texte intégral (1638 mots)
« El Mencho », chef d’un puissant cartel, a été abattu pendant une opération militaire le 22 février. Immédiatement, son organisation a semé la terreur dans de nombreux États du pays. On dénombre déjà plusieurs dizaines de morts. Ce type d’épisode intervient fréquemment, notamment sous la pression de Washington, qui exige des autorités mexicaines qu’elles s’en prennent aux trafiquants locaux, dont la production est en large partie destinée aux États-Unis. Mais l’efficacité des éliminations physiques des parrains reste à démontrer.
Le chef du cartel Jalisco New Generation (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, plus connu sous le nom d’« El Mencho », a succombé à ses blessures le 22 février, peu après avoir été capturé par les autorités mexicaines dans l’État de Jalisco (ouest du pays) pendant une opération au cours de laquelle il avait été touché par des tirs. Cette opération, qui s’est déroulée sur fond d’exigences états-uniennes quant à des « résultats tangibles » du Mexique dans la lutte contre le trafic de fentanyl, semble avoir bénéficié du soutien des services de renseignement de Washington.
Il s’agit de l’intervention la plus importante des forces de l’ordre mexicaines contre les cartels depuis la capture de l’ancien baron de la drogue Joaquín « El Chapo » Guzmán en 2016. Le CJNG est l’une des organisations criminelles les plus puissantes du Mexique et est accusé par les États-Unis, de même que le cartel de Sinaloa, de jouer un rôle clé en matière de production et de trafic de fentanyl.
Éliminer des individus n’entraîne pas la disparition ni même l’amoindrissement du marché de la drogue
L’élimination d’« El Mencho » a peut-être permis aux autorités mexicaines de remporter une victoire politique auprès de Washington. Mais le pays paie déjà un tribut élevé pour cette opération. Lorsque l’État mexicain élimine une figure importante d’un cartel, s’ensuit souvent une longue période de violence et d’instabilité. Dès l’annonce du décès du trafiquant, une vague de violences commises par ses hommes a balayé le pays.
Dans mes recherches sur les conflits criminels dans la région de Tierra Caliente, dans l’ouest du Mexique, je retrace la façon dont les premières vagues d’arrestations et d’éliminations par l’État ont remodelé les groupes criminels locaux, brisé des alliances et ouvert la voie à de nouveaux acteurs et dirigeants. C’est grâce à ce cycle de répression étatique et de réorganisation des cartels qu’El Mencho s’est fait connaître.
El Mencho a démarré dans sa carrière de criminel en tant que membre opérationnel lié au cartel Valencia, une organisation basée dans l’État de Michoacán. Le groupe a perdu du terrain à la fin des années 2000 sous la pression soutenue des autorités. Après le démantèlement des éléments clés du réseau Valencia vers 2010, El Mencho et d’autres membres restants du groupe se sont déplacés vers Jalisco, plus au nord, et ont fondé le CJNG.
Les conditions qui ont permis l’ascension du CJNG proviennent du même répertoire de mesures répressives que les autorités déploient aujourd’hui contre lui. Ce schéma est important, car il remet en cause une hypothèse courante parmi les décideurs politiques, y compris au sein d’agences états-uniennes telles que la Drug Enforcement Administration, selon laquelle éliminer un « chef » équivaut à démanteler un marché criminel.
En réalité, l’élimination des parrains mexicains n’entraîne pas la disparition du marché de la drogue, ni celle des routes de trafic. Ce qui change, c’est l’équilibre des pouvoirs entre les groupes qui se disputent le territoire, la main-d’œuvre et l’accès aux ports, aux routes et aux autorités locales.
Des études de la stratégie dite « kingpin », qui consiste pour les forces de l’ordre à cibler délibérément les chefs de cartels, ont montré que les arrestations et les éliminations entraînent souvent une augmentation à court terme des homicides et de l’instabilité au Mexique. Certaines études suggèrent que la violence augmente pendant plusieurs mois après l’élimination d’un chef, tandis que d’autres recherches montrent que l’assassinat d’un parrain peut provoquer une augmentation des violences plus forte qu’une arrestation.
Cela s’explique par le fait qu’un cartel touché est confronté à une succession soudaine et recourt à la violence pour empêcher – ou contrer – ses rivaux qui testent la nouvelle direction et tentent de renégocier les zones de contrôle. Les groupes criminels ne pouvant pas recourir au système judiciaire officiel pour résoudre leurs différends, ils ont tendance à le faire par le biais de violences ouvertes ou de négociations imposées par la force.
Cette logique se manifeste une nouvelle fois après la mort d’El Mencho. Les rapports faisant état de membres armés du cartel bloquant les routes, commettant des incendies criminels et semant le chaos dans plusieurs États correspondent à un scénario familier : une organisation touchée signale que sa capacité demeure intacte, punit l’État et avertit ses rivaux locaux qu’ils n’ont pas intérêt à chercher à profiter de la situation.
Même si l’État parvient à contenir cette vague de violence, le risque le plus grave réside dans ce qui suivra. Un vide au niveau du leadership favorise les divisions internes et l’opportunisme externe de la part de rivaux qui attendaient une occasion pour tester les limites et régler leurs comptes.
Par exemple, en 2024, l’arrestation du chef du cartel de Sinaloa, Ismael « El Mayo » Zambada, a provoqué une vague de violence dans l’État de Sinaloa, les différentes factions de l’organisation se disputant le pouvoir.
La politique de lutte contre la drogue des États-Unis
Un autre cycle qui se répète sans cesse en Amérique latine : la politique états-unienne en matière de drogues façonne les programmes de sécurité dans toute la région. Une augmentation du nombre de décès par overdose aux États-Unis, par exemple, peut y provoquer une panique politique et inciter Washington à faire pression sur les gouvernements latino-américains pour qu’ils prennent des mesures, généralement par le biais d’une répression militarisée.
Ces gouvernements réagissent par des mesures répressives, des raids et des arrestations très médiatisées. S’ensuit alors une recrudescence de la violence à mesure que les organisations criminelles se fragmentent ; puis, après un certain temps, les gouvernements tentent de désamorcer la situation. Le cycle recommence un peu plus tard, lorsque les États-Unis placent de nouveau le trafic de drogue en tête de leurs priorités.
L’interdiction des drogues perpétue ce cycle en excluant toute réponse autre que la force ou le droit pénal, sans pour autant produire de résultats significatifs. La plupart des pays ont criminalisé les drogues. Mais malgré les rapports des gouvernements faisant état d’une augmentation des saisies de drogues chaque année, les décès liés à la consommation de drogues dans le monde continuent d’augmenter.
Mêmes causes, mêmes effets
Les forces de sécurité mexicaines ne peuvent mettre fin à un marché transnational largement financé par la demande états-unienne, quel que soit le nombre d’arrestations spectaculaires qu’elles effectuent. Les opérations qui aboutissent à l’élimination ou à la détention de figures importantes des cartels ne font que rediriger et réorganiser le trafic de drogue, tout en intensifiant souvent la violence.
Si le Mexique et les États-Unis veulent réduire le nombre de décès liés aux cartels, ils doivent cesser de considérer l’élimination des barons de la drogue comme le principal indicateur de réussite. Si une opération très médiatisée satisfait temporairement Washington, ce sont les citoyens mexicains qui doivent trop souvent en subir les conséquences.
Raul Zepeda Gil ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
23.02.2026 à 17:13
L’affaire Epstein et « la révolte des élites »
Frédérique Sandretto, Adjunct assistant professor, Sciences Po
Texte intégral (2101 mots)
Ce qui transparaît à tort ou à raison derrière les révélations liées à l’affaire Epstein, c’est une forme de solidarité interne propre à l’ensemble des « élites mondialisées », et leur conviction d’exister au-dessus de la loi commune. Chaque nouvel élément de preuve renforce le sentiment, auprès de très nombreux citoyens de divers pays, que ces élites se seraient révoltées contre les règles censées s’imposer à tout un chacun, et auraient ainsi trahi le contrat démocratique – ce qui souligne une fois de plus la justesse de l’analyse formulée par Christopher Lasch dans la Révolte des élites et la trahison de la démocratie, un ouvrage paru il y a déjà près de trente ans…
L’affaire Epstein apparaît aujourd’hui comme le révélateur d’une crise profonde de légitimité des élites occidentales. Au-delà de l’horreur des crimes commis et du système de prédation sexuelle mis au jour, ce scandale a surtout exposé l’existence d’un entre-soi où richesse extrême, influence politique et prestige social semblent avoir constitué, sinon une protection absolue, du moins un amortisseur face aux mécanismes ordinaires de la justice.
L’image qui en résulte est celle d’une élite mondialisée évoluant dans des espaces séparés, disposant de ressources juridiques, relationnelles et symboliques inaccessibles au commun des citoyens.
Des personnalités de premier plan citées dans les archives Epstein
La déclassification de nouvelles pièces judiciaires le 30 janvier 2026 a ravivé cette perception. Dans ces documents, largement commentés mais juridiquement hétérogènes – témoignages, dépositions, correspondances, carnets d’adresses –, sont mentionnées de nombreuses personnalités issues du monde politique, économique et culturel. Il convient de rappeler que la simple présence d’un nom dans ces archives ne constitue pas en soi une preuve de culpabilité ni même d’implication criminelle : il s’agit souvent de personnes ayant croisé Epstein dans des contextes mondains ou professionnels. Néanmoins, l’effet symbolique est considérable, car il renforce l’idée d’une proximité structurelle entre les sphères du pouvoir et un individu devenu l’incarnation de la corruption morale.
Parmi les figures dont l’évocation est le plus commentée figurent l’ancien président des États-Unis Bill Clinton, dont les contacts avec Epstein étaient déjà connus et documentés, ainsi que l’ex-prince britannique Andrew, dont les liens avec le pédocriminel ont donné lieu à une procédure civile conclue par un accord financier en 2022, ce qui ne l’a pas empêché d’être brièvement arrêté par la justice de son pays ce 19 février.
Le nom de Donald Trump apparaît également dans certains témoignages historiques relatifs à la sociabilité mondaine new-yorkaise des années 1990 et 2000, sans que ces mentions n’aient débouché sur des poursuites. D’autres personnalités du monde des affaires et de la technologie, telles que Bill Gates, ont été citées pour des rencontres ou échanges passés, déjà reconnus publiquement par les intéressés. La médiatisation de ces noms contribue à construire une cartographie imaginaire du pouvoir global, où se croiseraient dirigeants politiques, magnats financiers et figures de la philanthropie.
L’image d’un « État profond » mondial
C’est dans ce contexte que s’est imposée, dans certains segments de l’opinion, l’idée d’un « deep state », c’est-à-dire d’un État parallèle informel composé de réseaux politiques, administratifs, financiers et sécuritaires capables d’échapper au contrôle démocratique. L’affaire Epstein apparaît dans cette vision des choses comme la preuve de l’existence d’un système de protection mutuelle au sommet, où les élites se préserveraient collectivement des conséquences judiciaires de leurs actions.
Si cette lecture relève souvent d’une extrapolation conspirationniste, elle traduit néanmoins une défiance radicale envers la transparence des institutions. L’absence perçue de responsabilités clairement établies alimente l’hypothèse d’un pouvoir occulte plutôt que celle, plus prosaïque, de dysfonctionnements institutionnels et judiciaires.
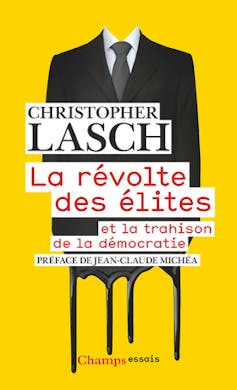
Ce phénomène illustre la thèse développée par l’historien américain Christopher Lasch en 1995 dans un ouvrage qui a eu un important retentissement, la Révolte des élites : la sécession progressive des classes dirigeantes vis-à-vis du reste de la société. Selon Lasch, les élites contemporaines ne se définissent plus par leur responsabilité envers la nation ou la communauté, mais par leur capacité à circuler dans des réseaux transnationaux fondés sur la richesse, l’éducation et l’influence.
L’affaire Epstein incarne cette mondialisation des élites, dont les liens personnels transcendent les frontières politiques et idéologiques. La fréquentation d’un même individu par des responsables issus de camps opposés alimente l’idée d’une homogénéité sociale au sommet, par-delà les clivages publics.
Un soupçon généralisé à l’égard des dominants
L’impact sur l’opinion est majeur. La publication des documents a renforcé la conviction d’un système à deux vitesses, où les puissants bénéficieraient d’une indulgence structurelle. Même en l’absence de preuves pénales contre la plupart des personnalités citées, la simple association symbolique suffit à nourrir la défiance. Dans un contexte déjà marqué par les inégalités économiques et la crise de la représentation démocratique, l’affaire agit comme un catalyseur du ressentiment populaire. Elle offre un récit simple et puissant : celui d’élites perçues comme moralement corrompues, protégées par leurs réseaux et déconnectées des normes qu’elles imposent au reste de la société.
Dans les discours politiques populistes et sur les réseaux sociaux, l’affaire est ainsi devenue la preuve narrative d’une collusion entre pouvoir économique, appareil d’État et sphères d’influence internationales. Le « deep state » y est décrit comme un mécanisme d’autoprotection des élites, capable d’étouffer des scandales, de ralentir les enquêtes ou de discréditer les accusations. Pourtant, aucune démonstration empirique solide n’est venue confirmer l’existence d’une structure coordonnée de cette nature. Ce décalage entre absence de preuve et persistance de la croyance révèle surtout l’ampleur de la défiance envers les institutions représentatives et judiciaires. Lorsque la confiance disparaît, l’explication conspirationniste devient psychologiquement plus satisfaisante que l’hypothèse de dysfonctionnements bureaucratiques, d’erreurs humaines ou de contraintes procédurales.
L’affaire Epstein illustre ainsi un phénomène plus large : la transformation du soupçon en grille de lecture dominante du pouvoir. Dans un contexte de polarisation politique et de circulation accélérée de l’information, chaque zone d’ombre tend à être interprétée comme la trace d’une intention cachée. Les élites apparaissent alors non seulement comme privilégiées, mais comme fondamentalement étrangères au corps social, évoluant dans un univers de règles implicites distinctes.
En définitive, l’invocation du « deep state » dans le contexte de l’affaire Epstein fonctionne moins comme une description empirique du réel que comme un symptôme politique et culturel. Elle exprime l’angoisse d’un monde perçu comme gouverné par des forces invisibles et irresponsables, ainsi que la conviction que les mécanismes démocratiques ne suffisent plus à garantir l’égalité devant la loi. L’affaire agit donc comme un miroir grossissant des fractures contemporaines : fracture de confiance, fracture sociale et fracture cognitive entre ceux qui adhèrent encore aux explications institutionnelles et ceux qui privilégient une lecture systémique du pouvoir.
Cette perception est amplifiée par la logique médiatique contemporaine, où la circulation fragmentée des informations favorise les interprétations maximalistes. Les documents judiciaires, complexes et souvent ambigus, sont réduits à des listes de noms, transformées en preuves supposées de l’existence d’un système occulte. Ainsi se construit une vision quasi mythologique du pouvoir, où l’idée d’une collusion généralisée remplace l’analyse des responsabilités individuelles et des défaillances institutionnelles concrètes.
Un moment de vérité
L’affaire Epstein révèle en définitive moins une conspiration structurée qu’une crise de confiance radicale envers les élites. Elle met en lumière la fragilité de leur légitimité dans des sociétés où l’exigence d’exemplarité est devenue centrale.
Lorsque ceux qui incarnent la réussite économique, politique ou culturelle apparaissent liés – même indirectement – à des scandales majeurs, c’est l’ensemble du pacte social qui vacille. La perception d’élites immorales protégées par un système opaque devient alors un prisme interprétatif global, susceptible d’alimenter le populisme, la défiance institutionnelle et les théories complotistes.
En ce sens, le scandale Epstein dépasse largement la chronique judiciaire. Il constitue un moment de vérité sur la relation entre pouvoir et responsabilité dans les démocraties contemporaines. La question centrale n’est plus seulement celle des crimes d’un individu, mais celle des conditions sociales et politiques qui ont rendu possible sa longévité au cœur des réseaux d’influence. Tant que cette interrogation demeurera sans réponse pleinement satisfaisante, l’affaire continuera d’alimenter l’idée d’une fracture irréversible entre les élites et le reste de la société.
Frédérique Sandretto ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Time [Fr]
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- L'Autre Quotidien
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- Gauche.Media
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
