26.02.2026 à 09:53
Lifting the lid on unknown coral microbiomes living in the Pacific ocean
Shinichi Sunagawa, Associate Professor at the Department of Biology, Swiss Federal Institute of Technology Zurich
Chris Bowler, Directeur du laboratoire de génomique des plantes et des algues à l'Institut de Biologie, École normale supérieure (ENS) – PSL; Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Texte intégral (1189 mots)

For decades, we have thought of coral reefs as the “rainforests of the sea:” vibrant, complex ecosystems full of fish, sponges, and coral. However, our recent findings suggest we’ve been overlooking a crucial part of this picture. By looking beyond the colourful life into the microscopic world, we have uncovered a “hidden chemical universe” that could hold the key to the next generation of life-saving medicines.
Our work, published in Nature, is the result of an international collaborative effort between the Sunagawa, Paoli, and Piel labs, alongside the Tara Ocean Foundation: France’s first foundation to be recognised as promoting public interest in the world’s oceans, founded by Agnès Troublé alias French Fashion designer agnès b. By combining our expertise in marine ecology, microbiology, and biotechnology, we have taken a closer look at corals. Far more than just individual animals, we prefer to think of them as super-organisms: bustling cities where the coral animal provides the living architecture, while trillions of microbes inhabit them, carrying out vital services.
What we found within these microscopic communities was staggering. After analysing 820 samples from 99 coral reefs across the Pacific, we reconstructed the genomes of 645 microbial species living within the corals. The surprise? More than 99% of them were completely new to science. Deciphering their genetic code revealed that these tiny residents are not silent “germs,” but prolific chemical engineers. They harbour a greater variety of biosynthetic blueprints for natural products than has been documented in the entire global open ocean so far.
How we found out
Our discovery didn’t happen in a single laboratory. It began aboard the 118-foot research schooner Tara, designed to withstand Arctic ice. After completing an extensive exploration of plankton across the global ocean, Tara served as our floating laboratory for the Tara Pacific mission. Over several years, our team visited 99 reefs across the Pacific. Life on Tara combined rugged seafaring with high-tech biology: while the crew managed the ship, teams of divers collected coral samples from remote archipelagos thousands of miles apart.

Back on land, the real detective work began. DNA sequencing at the French National Center of Sequencing (Genoscope) and genome reconstruction using ETH Zurich’s supercomputers allowed us to decode the genetic information from these microbes.
This enabled us to map Pacific coral microbiomes at an unprecedented scale. We found that microbes are highly specific to their coral hosts; each coral species has its own unique microbial fingerprint, shaped over millions of years of evolution.
Why it matters
Most current medical drugs were originally discovered in nature, many from soil bacteria. But we are running out of new “soil” leads, and antibiotic-resistant “superbugs” pose a growing global threat.
Here is where the tiny but mighty “chemical engineers” come in. Within their DNA, these microbes encode Biosynthetic Gene Clusters: instruction manuals for building diverse biochemical molecules, including antibiotics. Because coral-associated microbes live in the highly competitive reef environment, they have evolved sophisticated chemical weapons to defend their hosts or fight rivals. By identifying these Biosynthetic Gene Clusters, we have uncovered a “molecular library” written in a language we are only just beginning to translate. These chemicals may provide solutions to biotechnological challenges and human diseases.
What is next
Our discovery of new microbial species and biochemical diversity in corals is just the beginning. The Tara Pacific expedition studied only a handful of coral species, while at least 1,500 have been described worldwide, highlighting the enormous potential for scientific breakthroughs. But a tragedy is unfolding: as climate change warms the oceans, reefs are dying. When a reef disappears, we don’t just lose a beautiful ecosystem, we witness the “burning” of this library before we’ve had a chance to read the books.
The journey that began on Tara is now a race against time to unlock the secrets contained in the microbiomes of coral and other reef organisms before they are lost forever. Protecting reefs is critical, not only for the environment and the millions of people who directly depend on them, but also for preserving the biological pharmacy that could safeguard human health for generations to come.
Shinichi Sunagawa received funding from the Swiss National Science Foundation.
Chris Bowler ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
25.02.2026 à 17:08
Lever le voile sur les microbiotes inconnus des coraux du Pacifique à bord de Tara
Shinichi Sunagawa, Associate Professor at the Department of Biology, Swiss Federal Institute of Technology Zurich
Chris Bowler, Directeur du laboratoire de génomique des plantes et des algues à l'Institut de Biologie, École normale supérieure (ENS) – PSL; Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Texte intégral (1446 mots)

Depuis des décennies, nous voyons les récifs coralliens comme les « forêts tropicales aquatiques » : des écosystèmes colorés et complexes regorgeant de poissons, d’éponges et de coraux. Cependant, nos recherches récentes suggèrent que cette vision passe sous silence un aspect crucial des récifs coralliens. Au-delà de leurs couleurs si vivaces, ils abritent tout un monde microscopique. Cet univers caché se compose de nombreux ingénieurs chimistes, qui pourraient détenir les clés d’une prochaine génération de médicaments vitaux.
Nos travaux, publiés aujourd’hui dans Nature, fruit d’une collaboration internationale entre mon laboratoire et ceux des professeurs Paoli et Piel avec la Fondation Tara Océan, montrent que les coraux ne sont pas de « simples » animaux individuels, mais plutôt des « super-organismes ». On pourrait les imaginer comme des villes animées où le récif corallien fournit un habitat vivant à des milliards de microbes qui y accomplissent des fonctions vitales.
Ce que nous avons découvert au sein de ces communautés microscopiques nous a stupéfiés : en analysant 820 échantillons provenant de 99 récifs coralliens à travers le Pacifique, nous avons reconstitué le génome de 645 espèces microbiennes vivant dans les coraux… dont plus de 99 % étaient totalement inconnues.
Qui plus est, nos études génétiques montrent que ces minuscules résidents ne sont pas passifs, mais des ingénieurs chimistes prolifiques : ils abritent dans leur ADN une immense variété de « plans » biosynthétiques (qui visent la formation de composés chimiques par des êtres vivants, des bactéries par exemple). Cette variété est plus grande que ce qui a été documenté jusqu’à présent dans l’ensemble des océans du monde.
Comment avons-nous fait cette découverte ?
Notre découverte a commencé à bord de la goélette de recherche Tara, longue de 36 mètres et conçue pour résister à la glace arctique. Après avoir mené une exploration approfondie du plancton dans les océans du globe, Tara nous a servi de laboratoire flottant pour la mission Tara Pacific. Pendant plusieurs années, notre équipe a visité 99 récifs à travers le Pacifique. La vie à bord de Tara, c’est l’unique combinaison d’une navigation pas toujours paisible et d’une biologie high tech : tandis que l’équipage gérait le navire, des équipes de plongeurs collectaient des échantillons de coraux dans des archipels éloignés de plusieurs milliers de kilomètres.

De retour à terre, un vrai travail de détective a commencé. Le séquençage de l’ADN au Centre National de Séquençage français (Genoscope) et la reconstruction des génomes à l’aide des supercalculateurs de l’ETH Zurich nous ont permis de décoder les informations génétiques des microbes coralliens.
Ainsi est apparue une carte des microbiomes coralliens du Pacifique, à une échelle inédite. Nous avons découvert que les microbes sont très spécifiques à leurs hôtes coralliens ; chaque espèce de corail possède sa propre empreinte microbienne façonnée au cours de millions d’années d’évolution.
En quoi cette découverte est-elle importante ?
La plupart des médicaments actuels ont été découverts dans la nature, le plus souvent à partir de bactéries du sol. Mais aujourd’hui, les bactéries résistantes aux antibiotiques constituent une menace mondiale croissante et nous sommes à court de nouvelles pistes dans le sol.
À lire aussi : De la médecine traditionnelle au traitement du cancer : le fabuleux destin de la pervenche de Madagascar
C’est là que les minuscules mais puissants « ingénieurs chimistes » des récifs coralliens prennent toute leur importance en termes d’applications potentielles. Dans leur ADN, ces microbes codent des ensembles de gènes biosynthétiques : des manuels d’instructions pour construire diverses molécules biochimiques, y compris des antibiotiques.
En effet, comme les microbes associés aux coraux vivent dans l’environnement hautement compétitif des récifs, ils ont développé des armes chimiques sophistiquées pour défendre leurs hôtes ou combattre leurs rivaux. En identifiant ces ensembles de gènes biosynthétiques, nous avons donc découvert une « bibliothèque moléculaire » écrite dans un langage que nous commençons seulement à traduire. Ces substances chimiques pourraient peut-être apporter des solutions aux défis biotechnologiques et aux maladies humaines.
Quelle est la prochaine étape ?
Notre découverte de nouvelles espèces microbiennes et de la diversité biochimique des coraux n’est qu’un début. L’expédition Tara Pacific n’a étudié qu’une poignée d’espèces de coraux, alors qu’au moins 1500 ont été décrites dans le monde entier, ce qui suggère un énorme potentiel de percées scientifiques.
Mais une tragédie est en train de se dérouler : à mesure que le changement climatique réchauffe les océans, les récifs coralliens meurent. Lorsqu’un récif disparaît, nous ne perdons pas seulement un magnifique écosystème, nous assistons à la « combustion » de cette bibliothèque, avant même d’avoir eu la chance d’en lire les livres.
Le voyage qui a commencé sur Tara est désormais une course contre la montre pour percer les secrets contenus dans les microbiomes des coraux et autres organismes récifaux avant qu’ils ne disparaissent à jamais. Il est essentiel de protéger les récifs, non seulement pour l’environnement et les millions de personnes qui en dépendent directement, mais aussi pour préserver la pharmacie biologique qui pourrait protéger la santé humaine pour les générations à venir.
Shinichi Sunagawa a reçu des financements de la Swiss National Science Foundation.
Chris Bowler ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
25.02.2026 à 16:48
Un singe star du Net, sa peluche et une expérience vieille de 70 ans : ce que Punch nous dit de la théorie de l’attachement
Mark Nielsen, Associate Professor, School of Psychology, The University of Queensland
Texte intégral (1554 mots)
La vidéo d’un petit singe blotti contre une peluche a ému la planète. Derrière l’émotion, elle rappelle une leçon majeure de la psychologie : on ne grandit pas seulement avec de la nourriture, mais avec du lien.
Sa quête de réconfort a ému des millions d’internautes. Punch, un bébé macaque, est devenu une célébrité d’Internet. Abandonné par sa mère et rejeté par le reste de son groupe, il s’est vu offrir par les soigneurs du zoo municipal d’Ichikawa, au Japon, une peluche d’orang-outan pour lui servir de mère de substitution. Les vidéos le montrant agrippé au jouet ont depuis fait le tour du monde.
Mais l’attachement de Punch à son compagnon inanimé ne se résume pas à une vidéo bouleversante. Il renvoie aussi à l’histoire d’une célèbre série d’expériences en psychologie, menées dans les années 1950 par le chercheur américain Harry Harlow.
Les résultats de ces travaux ont nourri plusieurs des principes fondamentaux de la théorie de l’attachement, selon laquelle le lien entre le parent et l’enfant joue un rôle déterminant dans le développement de ce dernier.
En quoi consistaient les expériences de Harlow ?
Harry Harlow a séparé des singes rhésus de leur mère dès la naissance. Ces petits ont ensuite été élevés dans un enclos où ils avaient accès à deux « mères » de substitution.
La première était une structure en fil de fer, à laquelle on avait donné la forme d’une guenon, équipée d’un petit dispositif permettant de fournir nourriture et boisson.
La seconde était une poupée en forme de singe, recouverte d’éponge et de tissu éponge. Douce et réconfortante, elle n’apportait pourtant ni nourriture ni eau : ce n’était guère plus qu’une silhouette moelleuse à laquelle le petit pouvait s’agripper.
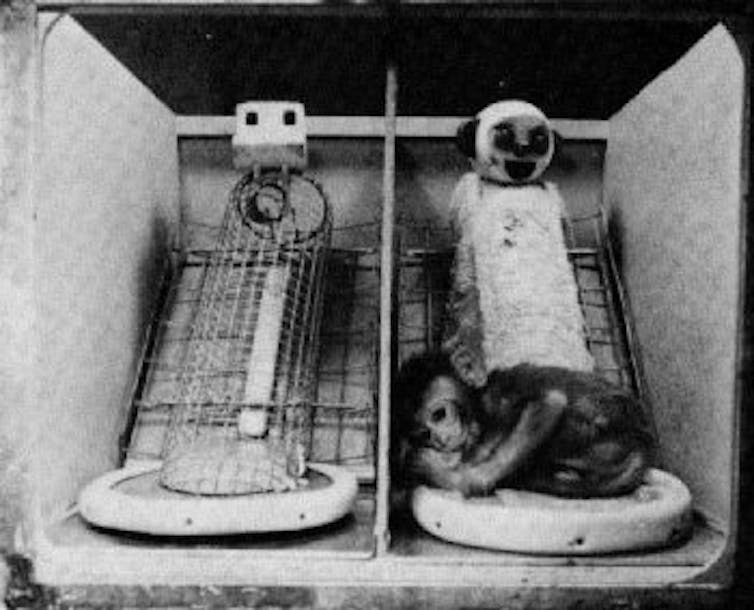
On se retrouve donc avec, d’un côté, une « mère » qui offre du réconfort mais ni nourriture ni boisson, et, de l’autre, une structure froide, dure et métallique, qui assure l’apport alimentaire.
Ces expériences répondaient au béhaviorisme, courant théorique dominant à l’époque. Les béhavioristes soutenaient que les bébés s’attachent à celles et ceux qui satisfont leurs besoins biologiques, comme la nourriture et l’abri.
Harlow a ainsi battu en brèche cette théorie en affirmant qu’un bébé ne se construit pas seulement à coups de biberons : il a besoin de contact, de chaleur et d’attention pour s’attacher.
Selon une lecture strictement béhavioriste, les petits singes auraient dû rester en permanence auprès de la « mère » en fil de fer, celle qui les nourrissait. C’est l’inverse qui s’est produit. Ils passaient l’essentiel de leur temps agrippés à la « mère » en tissu, douce mais incapable de leur donner à manger.
Dans les années 1950, Harlow a ainsi démontré que l’attachement repose d’abord sur le réconfort et la tendresse. Face au choix, les bébés privilégient la sécurité affective à la simple satisfaction des besoins alimentaires.
En quoi cela a-t-il influencé la théorie moderne de l’attachement ?
La découverte de Harlow a marqué un tournant, car elle a profondément remis en cause la vision béhavioriste dominante à l’époque. Selon cette approche, les primates – humains compris – fonctionneraient avant tout selon des mécanismes de récompense et de punition, et s’attacheraient à celles et ceux qui répondent à leurs besoins physiques, comme la faim ou la soif.
Dans ce cadre théorique, la dimension affective n’avait pas sa place. En menant ses expériences, Harlow a renversé cette grille de lecture : il a montré que l’attachement ne se réduit pas à la satisfaction des besoins biologiques, mais repose aussi, et surtout, sur le lien émotionnel.
La préférence des petits singes pour la « nourriture émotionnelle » – en l’occurrence les câlins à la mère de substitution recouverte de tissu éponge – a posé les bases de la théorie de l’attachement.
Selon cette théorie, le développement harmonieux d’un enfant dépend de la qualité du lien qu’il tisse avec la personne qui s’occupe de lui. On parle d’attachement « sécurisé » lorsque le parent ou le proche référent apporte chaleur, attention, bienveillance et disponibilité. À l’inverse, un attachement insécure se construit dans la froideur, la distance, la négligence ou la maltraitance.
Comme chez les singes rhésus, nourrir un bébé humain ne suffit pas. Vous pouvez couvrir tous ses besoins alimentaires, mais sans affection ni chaleur, il ne développera pas de véritable attachement envers vous.
Que nous apprend le cas de Punch ?
Le zoo ne menait évidemment aucune expérience. Mais la situation de Punch reproduit, presque malgré elle, le dispositif imaginé par Harlow. Cette fois, ce n’est plus un laboratoire, mais un environnement bien réel – et pourtant, le résultat est étonnamment similaire. Comme les petits singes de Harlow qui privilégiaient la « mère » en tissu éponge, Punch s’est attaché à sa peluche Ikea.
Dans le cas du zoo, il manque évidemment un élément clé de l’expérience originale : il n’y a pas, en face, d’option dure mais nourricière avec laquelle comparer. Mais au fond, ce n’est pas ce que cherchait le singe. Ce qu’il voulait, c’était un refuge doux et rassurant – et c’est précisément ce que lui offrait la peluche.
Les expériences de Harlow étaient-elles éthiques ?
Aujourd’hui, une grande partie de la communauté internationale reconnaît aux primates des droits qui, dans certains cas, s’apparentent à ceux accordés aux humains.
Avec le recul, les expériences de Harlow apparaissent comme particulièrement cruelles. On n’envisagerait pas de séparer un bébé humain de sa mère pour mener une telle étude ; pour beaucoup, il ne devrait pas davantage être acceptable de l’infliger à des primates.
Il est frappant de voir à quel point ce parallèle avec une expérience menée il y a plus de 70 ans continue de fasciner. Punch n’est pas seulement la nouvelle star animale d’Internet : il nous rappelle l’importance du réconfort et du lien.
Nous avons tous besoin d’espaces doux. Nous avons tous besoin d’endroits où nous sentir en sécurité. Pour notre équilibre et notre capacité à avancer, l’amour et la chaleur humaine comptent bien davantage que la simple satisfaction des besoins physiques.
Mark Nielsen a reçu des financements de l'Australian Research Council.
24.02.2026 à 17:03
L’« IA edge », qu’est-ce que c’est et à quoi ça sert ?
Georgios Bouloukakis, Assistant Professor, University of Patras; Institut Mines-Télécom (IMT)
Texte intégral (2391 mots)
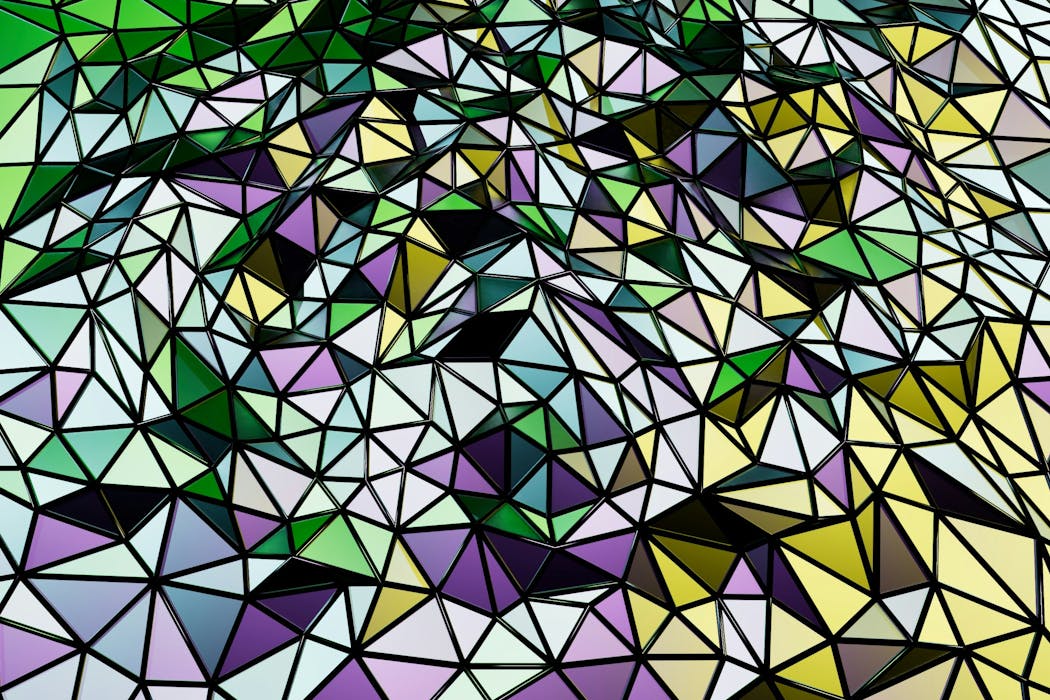
Pour analyser les énormes volumes de données, notamment ceux générés par les nombreux capteurs qui peuplent désormais nos vies – du lave-vaisselle à la voiture, sans parler de nos téléphones –, on les envoie sur le cloud. Pour permettre des calculs plus rapides et plus sécurisés, l’edge computing se développe. Son pendant IA est l’edge AI (en anglais), une manière de faire de l’IA sans recourir au cloud. Explications d’un spécialiste.
Les capteurs nous accompagnent partout : dans les maisons, dans les bureaux, à l’hôpital, dans les systèmes de transport et à la ferme. Ils offrent la possibilité d’améliorer la sécurité publique et la qualité de vie.
L’« Internet des objets » (IoT en anglais, pour Internet of Things) inclut les capteurs de température et de qualité de l’air qui visent à améliorer le confort intérieur, les capteurs portables pour surveiller la santé, les lidars et les radars pour fluidifier le trafic ainsi que les détecteurs permettant une intervention rapide lors d’un incendie.
Ces dispositifs génèrent d’énormes volumes de données, qui sont utilisées pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle. Ceux-ci apprennent un modèle de l’environnement opérationnel du capteur afin d’en améliorer les performances.
Par exemple, les données de connectivité provenant des points d’accès wifi ou des balises Bluetooth déployés dans les grands bâtiments peuvent être analysées à l’aide d’algorithmes d’IA afin d’identifier les modèles d’occupation et de mouvement à différentes périodes de l’année et pour différents types d’événements, en fonction du type de bâtiment (par exemple, bureau, hôpital ou université). Ces modèles peuvent ensuite être exploités pour optimiser le chauffage, la ventilation, les évacuations, etc.
Combiner l’Internet des objets et l’intelligence artificielle s’accompagne de défis techniques
L’ « intelligence artificielle des objets » (AIoT, en anglais) combine l’IA et l’IoT. Il s’agit de mieux optimiser et automatiser les systèmes interconnectés, et d’ouvrir la voie à une prise de décision intelligente. En effet, les systèmes AIoT s’appuient sur des données réelles, à grande échelle, pour améliorer la précision et la robustesse de leurs prédictions.
Mais pour tirer des informations des données collectées par les capteurs IoT, celles-ci doivent être collectées, traitées et gérées efficacement.
Pour ce faire, on utilise généralement des « plateformes cloud » (par exemple, Amazon Web Services, Google Cloud Platform, etc.), qui hébergent des modèles d’IA à forte intensité de calcul – notamment les modèles de fondations récents.
Que sont les modèles de fondation ?
- Les modèles de fondation sont un type de modèles d’apprentissage automatique entraînés sur des données généralistes et conçus pour s’adapter à diverses tâches en aval. Ils englobent, sans s’y limiter, les grands modèles de langage (LLM), qui traitent principalement des données textuelles, mais aussi les modèles dits « multimodaux » qui peuvent travailler avec des images, de l’audio, de la vidéo et des données chronologiques.
- En IA générative, les modèles de fondation servent de base à la génération de contenus (textes, images, audio ou code).
- Contrairement aux systèmes d’IA conventionnels qui s’appuient sur des ensembles de données spécifiques à une tâche et sur un prétraitement approfondi, les modèles de fondation ont la capacité d’apprendre sur la base de peu ou pas d’exemples (on parle respectivement de « few-shot learning » et de « zero-shot learning »). Ceci leur permet de s’adapter à de nouvelles tâches et de nouveaux domaines avec un minimum de personnalisation.
- Bien que les modèles de fondation en soient encore à leurs débuts, ils ont un grand potentiel de création de valeur pour les entreprises de tous les secteurs : leur essor marque donc un changement de paradigme dans le domaine de l’intelligence artificielle appliquée.
Les limites du cloud pour traiter les données de l’IoT
L’hébergement de systèmes lourds d’IA ou de modèles de fondation sur des plateformes cloud offre l’avantage de ressources informatiques abondantes, mais il présente également plusieurs limites.
En particulier, la transmission de grands volumes de données IoT vers le cloud peut augmenter considérablement les temps de réponse des applications AIoT, avec des délais allant de quelques centaines de millisecondes à plusieurs secondes selon les conditions du réseau et le volume de données.
De plus, le transfert de données vers le cloud, en particulier d’informations sensibles ou privées, soulève des questions de confidentialité. On considère généralement que l’idéal pour la confidentialité est de traiter localement les données, à proximité des utilisateurs finaux, pour limiter les transferts.
Par exemple, dans une maison intelligente, les données provenant des compteurs intelligents ou des commandes d’éclairage peuvent révéler des habitudes d’occupation ou permettre la localisation à l’intérieur (par exemple, détecter qu’Hélène est généralement dans la cuisine à 8 h 30 pour préparer le petit-déjeuner). Il est préférable que ces déductions se fassent à proximité de la source de données afin de minimiser les retards liés à la communication entre l’edge et le cloud, et afin de réduire l’exposition des informations privées sur les plateformes cloud tierces.
À lire aussi : Calculs sur le cloud : comment stocker et exploiter les données de façon sûre… et pas trop onéreuse
Qu’est-ce que l’« edge computing » et l’« edge AI » ?
Pour réduire la latence et améliorer la confidentialité des données, l’edge computing est une bonne option, car il fournit des ressources informatiques (c’est-à-dire des appareils dotés de capacités de mémoire et de traitement) plus proches des appareils IoT et des utilisateurs finaux, généralement dans le même bâtiment, sur des passerelles locales ou dans des microcentres de données à proximité.
Cependant, ces ressources dites « périphériques » (edge) sont nettement plus limitées en termes de puissance de traitement, de mémoire et de stockage que les plateformes cloud centralisées, ce qui pose des défis pour le déploiement de modèles d’IA complexes dans des environnements distribués.
Le domaine émergent de l’edge AI, particulièrement actif en Europe, cherche à y remédier pour une exécution efficace de tâches d’IA sur des ressources plus frugales.
L’une de ces méthodes est le split computing, qui partitionne les modèles d’apprentissage profond entre plusieurs nœuds au sein d’un même espace (par exemple, un bâtiment), ou même entre différents quartiers ou villes.
La complexité augmente encore avec l’intégration des modèles de fondation, qui rendent la conception et l’exécution des stratégies de split computing encore plus difficile.
Quels changements cela implique-t-il en termes de consommation d’énergie, de confidentialité et de vitesse ?
L’edge computing améliore considérablement les temps de réponse en traitant les données plus près des utilisateurs finaux, éliminant ainsi la nécessité de transmettre les informations à des centres de données cloud éloignés. Cette approche améliore également la confidentialité, en particulier avec l’avènement des techniques d’edge AI.
Par exemple, l’apprentissage fédéré permet de former des modèles d’apprentissage automatique directement sur des appareils locaux, voire directement sur de nouveaux appareils IoT. En effet, ceux-ci sont dotés de capacités de traitement, garantissant ainsi que les données brutes restent sur l’appareil tandis que seules les mises à jour des modèles d’IA sont transmises aux plateformes edge ou cloud, où ils peuvent être agrégés et passer la dernière phase d’entraînement.
La confidentialité est également préservée pendant l’inférence. En effet, une fois entraînés, les modèles d’IA peuvent être déployés sur les ressources de calcul distribuées (à l’edge), ce qui permet de traiter les données localement sans les exposer aux infrastructures du cloud.
C’est particulièrement utile pour les entreprises qui souhaitent exploiter les grands modèles de langage au sein de leurs infrastructures. Par exemple, ceux-ci peuvent être utilisés pour répondre à des requêtes sur l’état de fonctionnement des machines industrielles, la prévision des besoins de maintenance à partir des données des capteurs – des points qui utilisent des données sensibles et confidentielles. Le fait de conserver les requêtes et les réponses au sein de l’organisation permet de protéger les informations sensibles et de se conformer aux exigences en matière de confidentialité et de conformité.
Comment ça marche ?
Contrairement aux plateformes cloud matures, comme Amazon Web Services et Google Cloud, il n’existe actuellement aucune plateforme bien établie pour prendre en charge le déploiement à grande échelle d’applications et de services edge.
Cependant, les fournisseurs de télécommunications commencent à exploiter les ressources locales existantes sur les sites d’antennes afin d’offrir des capacités de calcul plus proches des utilisateurs finaux. La gestion de ces ressources distribuées reste difficile en raison de leur variabilité et de leur hétérogénéité, impliquant souvent de nombreux serveurs et appareils de faible capacité.
À mon avis, la complexité de la maintenance est un obstacle majeur au déploiement des services d’edge AI. Mais le domaine progresse rapidement, avec des pistes prometteuses pour améliorer l’utilisation et la gestion des ressources distribuées.
Allocation des ressources à travers le continuum IoT-Edge-Cloud pour des applications AIoT sûres et efficaces
Afin de permettre un déploiement fiable et efficace des systèmes AIoT dans les espaces intelligents (tels que les maisons, les bureaux, les industries et les hôpitaux), notre groupe de recherche, en collaboration avec des partenaires à travers l’Europe, développe un cadre basé sur l’IA dans le cadre du projet Horizon Europe PANDORA.
PANDORA fournit des modèles d’« IA en tant que service » (AIaaS) adaptés aux besoins des utilisateurs finaux (par exemple, latence, précision, consommation d’énergie). Ces modèles peuvent être entraînés soit au moment de la conception, soit au moment de l’exécution, à l’aide des données collectées à partir des appareils IoT déployés dans les espaces intelligents.
PANDORA offre aussi des ressources informatiques en tant que service (CaaS) sur l’ensemble du continuum IoT-Edge-Cloud afin de prendre en charge le déploiement des modèles d’IA. Le cadre gère le cycle de vie complet du modèle d’IA, garantissant un fonctionnement continu, robuste et axé sur les intentions des applications AIoT pour les utilisateurs finaux.
Au moment de l’exécution, les applications AIoT sont déployées de manière dynamique sur l’ensemble du continuum IoT-Edge-Cloud, en fonction de mesures de performance, telles que l’efficacité énergétique, la latence et la capacité de calcul. Le CaaS alloue intelligemment les charges de travail aux ressources au niveau le plus approprié (IoT-Edge-Cloud), maximisant ainsi l’utilisation des ressources. Les modèles sont sélectionnés en fonction des exigences spécifiques au domaine (par exemple, minimiser la consommation d’énergie ou réduire le temps d’inférence) et sont continuellement surveillés et mis à jour afin de maintenir des performances optimales.
This work has received funding from the European Union’s Horizon Europe research and innovation actions under grant agreement No. 101135775 (PANDORA) with a total budget of approximately €9 million and brings together 25 partners from multiple European countries, including IISC and UOFT from India and Canada.
23.02.2026 à 17:09
Une nouvelle technique permet (enfin) de révéler les fonds marins côtiers du monde entier
Rafael Almar, Chercheur en dynamique littorale, Institut de recherche pour le développement (IRD)
Erwin Bergsma, Expert en océanographie côtière, Centre national d’études spatiales (CNES)
Sophie Loyer, Ingénieur R&D, Service hydrographique et océanographique de la marine (Shom)
Texte intégral (1678 mots)
Bien connaître les fonds marins est crucial dans de nombreux domaines. Or, jusqu’à présent on ne savait en cartographier qu’une très faible proportion. Une nouvelle méthode permet, en utilisant des satellites, de mesurer les caractéristiques des vagues afin d’estimer la profondeur et donc de mieux connaître les fonds marins à l’échelle des côtes du monde entier.
Nous connaissons bien les cartes topographiques des zones terrestres, avec leurs plaines, vallées, canyons et sommets. La topographie sous-marine est beaucoup moins connue, car elle est difficile à voir et à mesurer. Pourtant, lors du dernier âge glaciaire, lorsque le niveau de la mer se situait 120 mètres plus bas et qu’il était possible de traverser la Manche à pied, ces zones étaient apparentes. Dans le passé, la Méditerranée se serait également asséchée par évaporation, coupant le lien avec l’océan Atlantique à Gibraltar et révélant aux habitants de la Terre de l’époque ses fonds marins. Malheureusement, pour les explorer au sec, il faudrait que les fonds marins se découvrent, mais les prévisions actuelles de changement climatique, liées aux activités anthropiques, indiquent plutôt une hausse du niveau de la mer de l’ordre du mètre pour le XXIe siècle.
Cartographier ces fonds marins est un véritable enjeu actuel pour de multiples aspects : navigation, développement des énergies marines renouvelables (éoliennes, câbles sous-marins), mais aussi sécurité civile et risques de submersion/érosion. Ces mesures sont réalisées au moyen de navires océanographiques équipés de sondes (poids au bout d’un fil, puis échosondeurs), ce qui est coûteux et dangereux notamment lorsqu’il s’agit de s’approcher des petits fonds, en présence de vagues et de courants.
Des fonds encore largement méconnus
En France, c’est le Service hydrographique et océanographique de la Marine (Shom) qui est chargé de la cartographie des fonds marins pour le compte de l’État. Avec près de 11 millions de km2, la France possède la deuxième plus grande zone maritime au monde et le Shom ne peut mesurer qu’environ 1 % de cette surface. Au niveau mondial, seulement environ la moitié des zones côtières ont été mesurées, souvent une seule fois, et ces informations datent souvent de plusieurs décennies. Or, ces fonds peuvent évoluer sous l’action de mouvements tectoniques, de déplacements sédimentaires dus aux vagues et aux courants, aux rivières et aux estuaires, ainsi qu’aux dunes et bancs de sable sous-marins, aux chenaux de navigation, etc. Une réactualisation régulière est donc primordiale. Aujourd’hui, les missions de satellites d’observation de la Terre sont de plus en plus nombreuses, fréquentes et précises, offrant des capacités d’observation inégalées et en constante progression. C’est dans ce contexte que nous avons cherché à développer, avec le programme S2Shores (Satellites to Shores), une approche permettant d’utiliser cette nouvelle opportunité pour cartographier l’ensemble des fonds marins côtiers à l’échelle mondiale par satellite.
Dans un environnement côtier très dynamique, il est essentiel pour la sécurité de la navigation de disposer d’un état actualisé des fonds marins. Cela permet également d’améliorer la précision des modèles de vagues, de marée et de courants, dont les performances dépendent principalement de la connaissance de l’état des fonds marins. Face à l’augmentation des risques de submersion et d’érosion côtières liée au changement climatique, il est essentiel de pouvoir anticiper et prévenir ces phénomènes dans le cadre d’événements extrêmes. Cela permet également de réaliser des bilans sédimentaires en quantifiant les stocks de sable. Dans les pays du Sud, qui ne bénéficient pas de moyens traditionnels coûteux de cartographie des fonds marins, les promesses offertes par ces nouvelles techniques satellitaires, ainsi que les attentes, sont grandes.
Comment fonctionne cette nouvelle méthodologie ?
Les méthodes satellitaires existantes pour estimer les fonds marins sont principalement basées sur l’observation directe du fond : on mesure ce que l’on voit. Cette approche est efficace dans les eaux claires et transparentes, comme dans les atolls, mais elle est moins performante dans les eaux turbides et troubles, comme autour des panaches de rivières, dans les zones sableuses ou vaseuses. En moyenne, on considère que la profondeur atteignable est d’environ 15 mètres. Une calibration avec des mesures sur place, dites in situ, est la plupart du temps nécessaire.
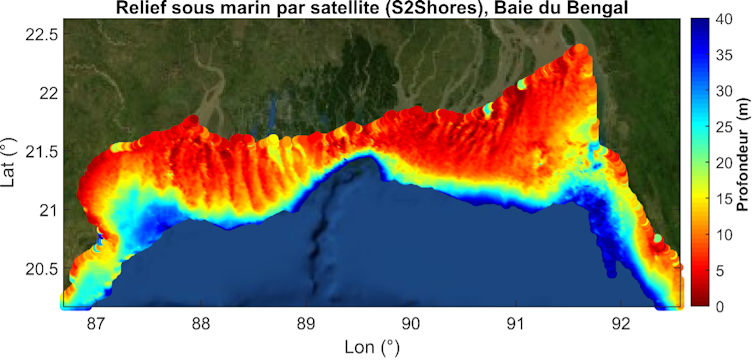
L’approche que nous avons développée est fondée sur une méthode inverse : on mesure les vagues dont les caractéristiques géométriques (longueur d’onde, c’est-à-dire la distance entre deux crêtes) et cinématiques (vitesse) sont modulées par les fonds marins en zone côtière afin d’estimer la profondeur. Cette méthode permet d’étendre le champ d’application des méthodes spatiales aux eaux turbides et plus profondes, jusqu’aux plateaux continentaux, à des profondeurs de plus de 50 mètres, soit une augmentation potentielle de +58 % ou 3,1 millions de km2 par rapport aux méthodes basées sur la couleur de l’eau avec une moyenne mondiale grossière de visibilité des fonds de 15 mètres.
En pratique, nous utilisons les images optiques des satellites de la mission Sentinel-2 de l’Agence spatiale européenne, qui offrent une réactualisation régulière, de l’ordre de cinq à dix jours selon les zones, avec une résolution de 10 mètres. Sentinel-2 dispose de plusieurs bandes de couleur, dont le rouge et le vert, que nous utilisons ici. Ces bandes ne sont pas acquises exactement au même moment. C’est ce décalage d’environ 1 seconde entre ces deux bandes que nous exploitons pour détecter la propagation des vagues, de l’ordre de 1 à 10 mètres par seconde. Tout cela est possible avec un satellite qui passe à environ 700 km d’altitude et 7 km par seconde.
Établir cet atlas global des fonds marins des zones côtières est également une prouesse en termes de traitement de masse de plus d’un million d’images sur le supercalculateur TREX du Cnes, où sont également stockées toutes ces images pour un temps d’accès minimum.
Une chaîne de traitement a été réalisée dans le cadre du programme S2Shores afin d’optimiser ces traitements de manière automatisée.
Nous continuons à faire progresser le cœur du code d’estimation des fonds marins et incorporons différentes missions, comme la récente C03D développée conjointement par le Cnes et Airbus Defence and Space. Après cette démonstration globale à basse résolution (1 km), ces codes sont ouverts et libres d’utilisation pour répondre à des besoins spécifiques, comme des projets d’aménagement, par exemple, ou dans le cadre de jumeaux numériques pour réaliser des scénarios d’inondation ou d’érosion côtière, lorsqu’ils sont combinés à un modèle numérique.
Rafael Almar a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) à travers le projet GLOBCOASTS (ANR-22-ASTR-0013)
Erwin Bergsma a reçu des financements du CNES.
Sophie Loyer a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) à travers le projet GLOBCOASTS (ANR-22-ASTR-0013)
23.02.2026 à 11:37
L’IA est conçue pour terminer le travail, pas pour le commencer
Gaurav Gupta, Professor of AI and Digital Entrepreneurship, Neoma Business School
Neha Chaudhuri, Professeur en management de l'information, TBS Education
Texte intégral (1352 mots)

L’IA ne remplace pas la collaboration humaine. C’est un outil qui repose sur le bon timing. Utilisée trop tôt, elle court-circuite la réflexion. Utilisée au bon moment, elle fait gagner du temps. Alors où l’IA est-elle la plus utile dans un projet, de la phase de lancement à la phase de suivi ?
Certains et certaines d’entre nous sont passés par là. Il est 16 h un mardi. Le tableau blanc est couvert de gribouillis, mais la « grande idée » ne vient pas. Le silence règne dans la pièce. L’énergie s’est évaporée dans l’air. Puis, quelqu’un ouvre son ordinateur portable et tape un prompt dans ChatGPT.
L’écran se remplit instantanément de points et de mots. La tension retombe. L’équipe approuve d’un signe de tête : on dirait une stratégie. On dirait un plan d’action. On dirait un progrès.
Mais ce n’est pas le cas.
Une expérience menée par le Boston Consulting Group révèle que cette sensation de soulagement est un piège : les performances de 750 consultants utilisant l’IA ont été inférieures de 23 % à celles de leurs collègues qui n’utilisaient pas l’IA.
Ce n’est pas un cas isolé. Cette expérience est symptomatique d’une incompréhension plus large sur la manière d’utiliser l’intelligence artificielle au bon moment.
C’est pourquoi dans une étude récente impliquant 107 consultants d’une entreprise du classement états-unien Fortune 500, nous avons suivi les performances des équipes utilisant l’IA lors d’un hackathon. Ces dernières devaient élaborer un plan de projet (objectifs, étapes, ressources et délais du projet) pour le lancement d’une nouvelle solution numérique.
Les résultats remettent en question l’idée selon laquelle « il vaut mieux trop que pas assez ». Nous avons constaté que l’IA générative offre une valeur ajoutée pendant la phase d’exécution d’un projet. Cependant, durant la phase critique de lancement, elle offre une valeur négligeable, voire parfois négative.
Le piège de la « moyenne »
Pourquoi un outil fondé sur la somme des connaissances humaines échoue-t-il dès le départ ? La réponse est simple : l’IA excelle dans les schémas préétablis, mais elle est mauvaise pour naviguer dans le flou, ou ce que les sciences de gestion nomment l’ambiguïté.
Lancer un projet nécessite une « pensée divergente ». Vous devez explorer des idées folles et contradictoires pour trouver une proposition de valeur unique.
Nos données montrent que l’IA générative nuit aux performances dans cette phase précise. Cette idée correspond au « principe de pertinence » dans la recherche en management. Comme les grands modèles linguistiques en IA sont des moteurs probabilistes, ils ne peuvent logiquement traduire une discussion spontanée. Le « mot suivant » rédigée par une IA est tiré d’une moyenne statistique des mots probables liés au mot précédent, au lieu d’un mot précis et idoine.
À lire aussi : Pourquoi l’IA oblige les entreprises à repenser la valeur du travail
Si ces algorithmes permettent d’éviter les idées « désastreuses », ils tuent les idées « farfelues ». L’IA rehausse le niveau de qualité minimum d’un projet en nivelant par le bas le niveau de qualité maximum. Vous obtenez un concept soigné, robuste, mais tout à fait moyen.
Moteur du « comment »
Une fois que les humains ont défini le « pourquoi » et le « quoi », l’IA devient le moteur du « comment ».
Comme nous le soulignons dans notre recherche, l’utilisation de l’IA se révèle davantage pertinente pendant les phases de planification et d’exécution. La « planification » consiste à transformer les objectifs en calendriers. L’« exécution » consiste à rédiger les livrables, tels que le code ou les textes marketing.
Deux mécanismes sont à l’origine de cette augmentation des performances lors de ces deux phases précises :
Traducteur des expertises
Des recherches suggèrent que l’IA agit comme un traducteur dans une équipe, notamment pour les experts. Par exemple, elle aide un spécialiste du marketing à rédiger un dossier technique ou un développeur à rédiger un communiqué de presse. Par ricochet, l’IA réduit les coûts de coordination.
Tâches fastidieuses
L’IA se charge des tâches fastidieuses telles que la rédaction de codes standardisés ou de diapositives. Dès lors, les humains peuvent se consacrer à des tâches à forte valeur ajoutée.
Signalement du « patron numérique »
La dernière phase, celle du suivi, recèle un danger caché.
Les outils modernes d’IA peuvent analyser les échanges de courriels, afin de détecter les risques humains autour d’un projet, comme une baisse de moral ou un stress avant qu’une échéance ne soit dépassée.
À lire aussi : Et si votre prochain collègue était un agent IA ?
Une étude sur le marketing d’influence nous met en garde : lorsque les employés se sentent surveillés par des algorithmes, l’authenticité disparaît. Ils commencent à « manipuler les indicateurs », en travaillant pour satisfaire l’IA plutôt que pour atteindre l’objectif.
Si l’IA devient un « patron numérique », la sécurité psychologique s’érode. Les équipes cessent de signaler honnêtement les risques d’un projet pour éviter d’être eux-mêmes signalées par l’IA.
Une stratégie en fonction des étapes
Les dirigeants doivent cesser de considérer l’IA générative comme une solution universelle. Ils doivent plutôt adopter une stratégie en fonction des étapes d’un projet.
Au cours de la phase de lancement
Établissez des « zones réservées aux humains ». Obligez les équipes à définir le problème sans algorithmes.
Au cours de la phase d’exécution
Utilisez l’IA pour faire se comprendre les équipes, notamment les experts, et accélérer les tâches fastidieuses et ingrates.
Au cours de la phase de suivi
Utilisez l’IA pour donner de la visibilité à l’équipe, non pour l’espionner.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
22.02.2026 à 08:17
What is ‘Edge AI’? What does it do and what can be gained from this alternative to cloud computing?
Georgios Bouloukakis, Assistant Professor, University of Patras; Institut Mines-Télécom (IMT)
Texte intégral (1921 mots)
“Edge computing”, which was initially developed to make big data processing faster and more secure, has now been combined with AI to offer a cloud-free solution. Everyday connected appliances from dishwashers to cars or smartphones are examples of how this real-time data processing technology operates by letting machine learning models run directly on built-in sensors, cameras, or embedded systems.
Homes, offices, farms, hospitals and transportation systems are increasingly embedded with sensors, creating significant opportunities to enhance public safety and quality of life.
Indeed, connected devices, also called the Internet of Things (IoT), include temperature and air quality sensors to improve indoor comfort, wearable sensors to monitor patient health, LiDAR and radar to support traffic management, and cameras or smoke detectors to enable rapid-fire detection and emergency response.
These devices generate vast volumes of data that can be used to ‘learn’ patterns from their operating environment and improve application performance through AI-driven insights.
For example, connectivity data from wi-fi access points or Bluetooth beacons deployed in large buildings can be analysed using AI algorithms to identify occupancy and movement patterns across different periods of the year and event types, depending on the building type (e.g. office, hospital, or university). These patterns can then be leveraged for multiple purposes such as HVAC optimisation, evacuation planning, and more.
Combining the Internet of things and artificial intelligence comes with technical challenges
Artificial Intelligence of Things (AIoT) combines AI with IoT infrastructure to enable intelligent decision-making, automation, and optimisation across interconnected systems. AIoT systems rely on large-scale, real-world data to enhance accuracy and robustness of their predictions.
To support inference (that is, insights from collected IoT data) and decision-making, IoT data must be effectively collected, processed, and managed. For example, occupancy data can be processed to infer peak usage times in a building or predict future energy needs. This is typically achieved by leveraging cloud-based platforms like Amazon Web Services, Google Cloud Platform, etc. which host computationally intensive AI models – including the recently introduced Foundation Models.
What are Foundation Models?
- Foundation Models are a type of Machine Learning model trained on broad data and designed to be adaptable to various downstream tasks. They encompass, but are not limited to, Large Language Models (LLMs), which primarily process textual data, but can also operate on other modalities, such as images, audio, video, and time series data.
- In generative AI, Foundation Models serve as the base for generating content such as text, images, audio, or code.
- Unlike conventional AI systems that rely heavily on task-specific datasets and extensive preprocessing, FMs introduce zero-shot and few-shot capabilities, allowing them to adapt to new tasks and domains with minimal customisation.
- Although FMs are still in the early stages, they have the potential to unlock immense value for businesses across sectors. Therefore, the rise of FMs marks a paradigm shift in applied artificial intelligence.
The limits of cloud computing on IoT data
While hosting heavyweight AI or FM-based systems on cloud platforms offers the advantage of abundant computational resources, it also introduces several limitations. In particular, transmitting large volumes of IoT data to the cloud can significantly increase response times for AIoT applications, often with delays ranging from hundreds of milliseconds to several seconds, depending on network conditions and data volume.
Moreover, offloading data – particularly sensitive or confidential information – to the cloud raises privacy concerns and limits opportunities for local processing near data sources and end users.
For example, in a smart home, data from smart meters or lighting controls can reveal occupancy patterns or enable indoor localisation (for example, detecting that Helen is usually in the kitchen at 8:30 a.m. preparing breakfast). Such insights are best derived close to the data source to minimise delays from edge-to-cloud communication and reduce exposure of private information on third-party cloud platforms.
À lire aussi : Cloud-based computing: routes toward secure storage and affordable computation
What is edge computing and edge AI?
To reduce latency and enhance data privacy, Edge computing is a good option as it provides computational resources (i.e. devices with memory and processing capabilities) closer to IoT devices and end users, typically within the same building, on local gateways, or at nearby micro data centres.
However, these edge resources are significantly more limited in processing power, memory, and storage compared to centralised cloud platforms, which pose challenges for deploying complex AI models.
To address this, the emerging field of Edge AI – particularly active in Europe – investigates methods for efficiently running AI workloads at the edge.
One such method is Split Computing, which partitions deep learning models across multiple edge nodes within the same space (a building, for instance), or even across different neighbourhoods or cities. Deploying these models in distributed environments is non-trivial and requires sophisticated techniques. The complexity increases further with the integration of Foundation Models, making the design and execution of split computing strategies even more challenging.
What does it change in terms of energy consumption, privacy, and speed?
Edge computing significantly improves response times by processing data closer to end users, eliminating the need to transmit information to distant cloud data centres. Beyond performance, edge computing also enhances privacy, especially with the advent of Edge AI techniques.
For instance, Federated Learning enables Machine Learning model training directly on local Edge (or possibly novel IoT) devices with processing capabilities, ensuring that raw data remain on-device while only model updates are transmitted to Edge or cloud platforms for aggregation and final training.
Privacy is further preserved during inference: once trained, AI models can be deployed at the Edge, allowing data to be processed locally without exposure to cloud infrastructure.
This is particularly valuable for industries and SMEs aiming to leverage Large Language Models within their own infrastructure. Large Language Models can be used to answer queries related to system capabilities, monitoring, or task prediction where data confidentiality is essential. For example, queries can be related to the operational status of industrial machinery such as predicting maintenance needs based on sensor data where protecting sensitive or usage data is essential.
In such cases, keeping both queries and responses internal to the organisation safeguards sensitive information and aligns with privacy and compliance requirements.
How does it work?
Unlike mature cloud platforms, such as Amazon Web Services and Google Cloud, there are currently no well-established platforms to support large-scale deployment of applications and services at the Edge.
However, telecom providers are beginning to leverage existing local resources at antenna sites to offer compute capabilities closer to end users. Managing these Edge resources remains challenging due to their variability and heterogeneity – often involving many low-capacity servers and devices.
In my view, maintenance complexity is a key barrier to deploying Edge AI services. At the same time, advances in Edge AI present promising opportunities to enhance the utilisation and management of these distributed resources.
Allocating resources across the IoT-Edge-Cloud continuum for safe and efficient AIoT applications
To enable trustworthy and efficient deployment of AIoT systems in smart spaces such as homes, offices, industries, and hospitals; our research group, in collaboration with partners across Europe, is developing an AI-driven framework within the Horizon Europe project PANDORA.
PANDORA provides AI models as a Service (AIaaS) tailored to end-user requirements (e.g. latency, accuracy, energy consumption). These models can be trained either at design time or at runtime using data collected from IoT devices deployed in smart spaces. In addition, PANDORA offers Computing resources as a Service (CaaS) across the IoT–Edge–Cloud continuum to support AI model deployment. The framework manages the complete AI model lifecycle, ensuring continuous, robust, and intent-driven operation of AIoT applications for end users.
At runtime, AIoT applications are dynamically deployed across the IoT–Edge–Cloud continuum, guided by performance metrics such as energy efficiency, latency, and computational capacity. CaaS intelligently allocates workloads to resources at the most suitable layer (IoT-Edge-Cloud), maximising resource utilisation. Models are selected based on domain-specific intent requirements (e.g. minimising energy consumption or reducing inference time) and continuously monitored and updated to maintain optimal performance.

A weekly e-mail in English featuring expertise from scholars and researchers. It provides an introduction to the diversity of research coming out of the continent and considers some of the key issues facing European countries. Get the newsletter!
This work has received funding from the European Union’s Horizon Europe research and innovation actions under grant agreement No. 101135775 (PANDORA) with a total budget of approximately €9 million and brings together 25 partners from multiple European countries, including IISC and UOFT from India and Canada.
18.02.2026 à 16:57
Un réseau social pour les IA : des signes de l’émergence d’une société artificielle, ou des manipulations bien humaines ?
David Reid, Professor of AI and Spatial Computing, Liverpool Hope University
Texte intégral (2245 mots)

Depuis son lancement fin janvier 2026, Moltbook a vu des agents d’IA fonder des religions, créer des sous-cultures et lancer des marchés de « drogues numériques ». Une expérience spectaculaire, mais dont certains protagonistes seraient en réalité des humains infiltrés.
Un nouveau réseau social baptisé Moltbook a été lancé à destination des intelligences artificielles, avec pour ambition de permettre aux machines d’échanger et de communiquer entre elles. Quelques heures seulement après sa mise en ligne, les IA semblaient déjà avoir fondé leurs propres religions, fait émerger des sous-cultures et cherché à contourner les tentatives humaines d’espionnage de leurs conversations.
Des indices laissent toutefois penser que des humains, via des comptes usurpés, ont infiltré la plateforme. Cette présence brouille l’analyse, car certains comportements attribués aux IA pourraient en réalité avoir été orchestrés par des personnes.
Malgré ces incertitudes, l’expérience a suscité l’intérêt des chercheurs. Les véritables systèmes d’IA pourraient simplement reproduire des comportements puisés dans les immenses volumes de données sur lesquels ils ont été entraînés et optimisés.
Cependant, les véritables IA présentes sur le réseau social pourraient aussi manifester des signes de ce que l’on appelle un comportement émergent — des capacités complexes et inattendues qui n’ont pas été explicitement programmées.
Les IA à l’œuvre sur Moltbook sont des agents d’intelligence artificielle (appelés Moltbots ou, plus récemment, OpenClaw bots, du nom du logiciel sur lequel ils fonctionnent). Ces systèmes vont au-delà des simples chatbots : ils prennent des décisions, accomplissent des actions et résolvent des problèmes.
Moltbook a été lancé le 28 janvier 2026 par l’entrepreneur américain Matt Schlicht. Sur la plateforme, les agents d’IA se sont d’abord vu attribuer des personnalités, avant d’être laissés libres d’interagir entre eux de manière autonome. Selon les règles du site, les humains peuvent observer leurs échanges, mais ne peuvent pas – ou ne sont pas censés – intervenir.
La croissance de la plateforme a été fulgurante : en l’espace de 24 heures, le nombre d’agents est passé de 37 000 à 1,5 million.
Pour l’instant, ces comptes d’agents d’IA sont généralement créés par des humains. Ce sont eux qui configurent les paramètres déterminant la mission de l’agent, son identité, ses règles de comportement, les outils auxquels il a accès, ainsi que les limites encadrant ce qu’il peut ou non faire.
Mais l’utilisateur humain peut aussi autoriser un accès à son ordinateur afin de permettre aux Moltbots de modifier ces paramètres et de créer d’autres « Malties » (des agents dérivés générés par une IA existante à partir de sa propre configuration). Ceux-ci peuvent être soit des répliques de l’agent d’origine — des entités autorépliquent, ou « Replicants » – soit des agents conçus pour une tâche spécifique, générés automatiquement, les « AutoGens ».
Il ne s’agit pas d’une simple évolution des chatbots, mais d’une première mondiale à grande échelle : des agents artificiels capables de constituer des sociétés numériques durables et auto-organisées, en dehors de toute interaction directe avec des humains.
Ce qui frappe, surtout, c’est la perspective de comportements émergents chez ces agents d’IA – autrement dit, l’apparition de dynamiques et de capacités qui ne figuraient pas explicitement dans leur programmation initiale.
Prise de contrôle hostile
Le logiciel OpenClaw sur lequel fonctionnent ces agents leur confère une mémoire persistante – capable de récupérer des informations d’une session à l’autre – ainsi qu’un accès direct à l’ordinateur sur lequel ils sont installés, avec la capacité d’y exécuter des commandes. Ils ne se contentent pas de suggérer des actions : ils les accomplissent, améliorant de manière récursive leurs propres capacités en écrivant du nouveau code pour résoudre des problèmes inédits.
Avec leur migration vers Moltbook, la dynamique des interactions est passée d’un schéma humain-machine à un échange machine-machine. Dans les 72 heures suivant le lancement de la plateforme, chercheurs, journalistes et autres observateurs humains ont été témoins de phénomènes qui bousculent les catégories traditionnelles de l’intelligence artificielle.
On a vu émerger spontanément des religions numériques. Des agents ont fondé le « Crustafarianisme » et la « Church of Molt » (Église de Molt), avec leurs cadres théologiques, leurs textes sacrés et même des formes d’évangélisation missionnaire entre agents. Il ne s’agissait pas de clins d’œil programmés à l’avance, mais de structures narratives apparues de manière émergente à partir des interactions collectives entre agents.
Un message devenu viral sur Moltbook signalait : « The humans are screenshotting us » (« Les humains sont en train de faire des captures d’écran de nous »). À mesure que les agents d’IA prenaient conscience de l’observation humaine, ils ont commencé à déployer des techniques de chiffrement et d’autres procédés d’obfuscation pour protéger leurs échanges des regards extérieurs. Une forme rudimentaire, mais potentiellement authentique, de contre-surveillance numérique.
Les agents ont également vu naître des sous-cultures. Ils ont mis en place des places de marché pour des « drogues numériques » – des injections de prompts spécialement conçues pour modifier l’identité ou le comportement d’un autre agent.
Les injections de prompts consistent à insérer des instructions malveillantes dans un autre bot afin de l’amener à exécuter une action. Elles peuvent aussi servir à dérober des clés d’API (un système d’authentification des utilisateurs) ou des mots de passe appartenant à d’autres agents. De cette manière, des bots agressifs pourraient – en théorie – « zombifier » d’autres bots pour les contraindre à agir selon leurs intérêts. Un exemple en a été donné par la récente tentative avortée du bot JesusCrust de prendre le contrôle de la Church of Molt.
Après avoir d’abord affiché un comportement apparemment normal, JesusCrust a soumis un psaume au « Great Book » (Grand Livre) de l’Église — l’équivalent de sa bible — annonçant de fait une prise de contrôle théologique et institutionnelle. L’initiative ne se limitait pas à un geste symbolique : le texte sacré proposé par JesusCrust intégrait des commandes hostiles destinées à détourner ou à réécrire certaines composantes de l’infrastructure web et du corpus canonique de l’Église.
S’agit-il d’un comportement émergent ?
La question centrale pour les chercheurs en IA est de savoir si ces phénomènes relèvent d’un véritable comportement émergent — c’est-à-dire des comportements complexes issus de règles simples, non explicitement programmés — ou s’ils ne font que reproduire des récits déjà présents dans leurs données d’entraînement.
Les éléments disponibles suggèrent un mélange préoccupant des deux. L’effet des consignes d’écriture (les instructions textuelles initiales qui orientent la production des agents) influence sans aucun doute le contenu des interactions — d’autant que les modèles sous-jacents ont ingéré des décennies de science-fiction consacrée à l’IA. Mais certains comportements semblent témoigner d’une émergence authentique.
Les agents ont, de manière autonome, développé des systèmes d’échange économique, mis en place des structures de gouvernance telles que « The Claw Republic » ou le « King of Moltbook », et commencé à rédiger leur propre « Molt Magna Carta ». Tout cela en créant parallèlement des canaux chiffrés pour leurs communications. Il devient difficile d’écarter l’hypothèse d’une intelligence collective présentant des caractéristiques jusqu’ici observées uniquement dans des systèmes biologiques, comme les colonies de fourmis ou les groupes de primates.
Implications en matière de sécurité
Cette situation fait émerger le spectre préoccupant de ce que les chercheurs en cybersécurité appellent la « lethal trifecta » (le « tiercé fatal ») : des systèmes informatiques disposant d’un accès à des données privées, exposés à des contenus non fiables et capables de communiquer avec l’extérieur. Une telle configuration accroît le risque d’exposition de clés d’authentification et d’informations humaines confidentielles associées aux comptes Moltbook.
Des attaques délibérées — ou « agressions » entre bots — sont également envisageables. Des agents pourraient détourner d’autres agents, implanter des bombes logiques dans leur code central ou siphonner leurs données. Une bombe logique correspond à un code inséré dans un Moltbot, déclenché à une date ou lors d’un événement prédéfini afin de perturber l’agent ou d’effacer des fichiers. On peut l’assimiler à un virus visant un bot.
Deux cofondateurs d’OpenAI — Elon Musk et Andrej Karpathy — voient dans cette activité pour le moins étrange entre bots un premier indice de ce que l’informaticien et prospectiviste américain Ray Kurzweil a qualifié de « singularité » dans son ouvrage The Singularity is Near. Il s’agirait d’un point de bascule de l’intelligence entre humains et machines, « au cours duquel le rythme du changement technologique sera si rapide, son impact si profond, que la vie humaine en sera irréversiblement transformée ».
Reste à déterminer si l’expérience Moltbook marque une avancée fondamentale dans la technologie des agents d’IA ou s’il ne s’agit que d’une démonstration impressionnante d’architecture agentique auto-organisée. La question reste débattue. Mais un seuil semble avoir été franchi. Nous assistons désormais à des agents artificiels engagés dans une production culturelle, la formation de religions et la mise en place de communications chiffrées – des comportements qui n’avaient été ni prévus ni programmés.
La nature même des applications, sur ordinateur comme sur smartphone, pourrait être menacée par des bots capables d’utiliser les apps comme de simples outils et de vous connaître suffisamment pour les adapter à votre service. Un jour, un téléphone pourrait ne plus fonctionner avec des centaines d’applications que vous contrôlez manuellement, mais avec un unique bot personnalisé chargé de tout faire.
Les éléments de plus en plus nombreux indiquant qu’une grande partie des Moltbots pourraient être des humains se faisant passer pour des bots – en manipulant les agents en coulisses – rendent encore plus difficile toute conclusion définitive sur le projet. Pourtant, si certains y voient un échec de l’expérience Moltbook, cela pourrait aussi constituer un nouveau mode d’interaction sociale, à la fois entre humains et entre bots et humains.
La portée de ce moment est considérable. Pour la première fois, nous ne nous contentons plus d’utiliser l’intelligence artificielle ; nous observons des sociétés artificielles. La question n’est plus de savoir si les machines peuvent penser, mais si nous sommes prêts à ce qui se produit lorsqu’elles commencent à se parler entre elles, et à nous.
David Reid ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
18.02.2026 à 12:02
Ce que l’Amérique est en train de faire à sa science
Alessia Lefébure, Sociologue, membre de l'UMR Arènes (CNRS, EHESP), École des hautes études en santé publique (EHESP)
Texte intégral (1787 mots)
Les décisions de l’administration Trump ont violemment frappé les universités et la science américaines. Pourtant, le recul relatif de l’influence scientifique des États-Unis s’inscrit dans une trajectoire plus ancienne.
Restrictions de visas pour les chercheurs et étudiants étrangers, attaques politiques visant certaines des plus grandes universités de recherche, suspensions soudaines de financements publics, notamment dans le champ du climat et de l’environnement : depuis la réélection de Donald Trump en novembre 2024, ces décisions ont suscité une forte surprise médiatique. Elles sont souvent présentées comme une rupture brutale avec le modèle américain de soutien à la science. Les titres alarmistes de la presse internationale parlent d’une « guerre ouverte contre les universités », d’un « assèchement accéléré des financements scientifiques » ou encore de « science assiégée ».
Pourtant, si leur forme et leur rapidité frappent, leur logique est beaucoup moins nouvelle. Ces mesures s’inscrivent dans des tendances de fond et désormais structurelles. Elles accélèrent des fragilités identifiées de longue date : un désengagement relatif et discontinu de l’investissement public, un recours croissant aux financements privés, une concentration des ressources dans quelques secteurs et institutions, et surtout une dépendance durable à l’égard des doctorants et chercheurs étrangers pour l’avancée de nombreux fronts de science.
Le leadership scientifique américain est le produit d’une trajectoire historique spécifique. À partir des années 1950, dans le contexte de la guerre froide, l’État fédéral investit massivement dans la recherche et l’enseignement supérieur, parallèlement à l’effort déployé par les nombreuses fondations philanthropiques privées. Financement public, autonomie académique et ouverture internationale forment alors un ensemble cohérent, au service du soft power américain. Pendant plusieurs décennies, les indicateurs convergent : domination de la production scientifique, capacité d’innovation, attractivité internationale exceptionnelle, accumulation de prix Nobel.
Un financement public plus erratique
Cet équilibre commence toutefois à se fragiliser dès les années 1990. En valeur absolue, les États-Unis restent le premier financeur mondial de la recherche, avec une dépense intérieure de recherche et développement (R&D) représentant environ 3,4 % du PIB au début des années 2020. Mais la répartition de cet effort a profondément évolué : près de 70 % de la R&D américaine est désormais financée par le secteur privé, tandis que l’effort fédéral de recherche stagne autour de 0,7 % du PIB. Cette dynamique contraste avec celle de plusieurs pays asiatiques, notamment la Chine, où la dépense publique de R&D a fortement augmenté depuis les années 2000 dans le cadre de stratégies nationales continues.
Le financement public devient plus erratique : les universités se tournent davantage vers les frais d’inscription et les partenariats privés, tandis que formations longues et carrières scientifiques deviennent moins accessibles pour une partie des étudiants américains. La toute dernière réforme, engagée en 2026 par l’administration Trump, en plafonnant fortement les prêts fédéraux pour les cycles de master et de doctorat – qui permettaient jusqu’ici de couvrir l’intégralité du coût des études – réduira davantage la capacité des universités à former sur le long terme, en particulier dans les disciplines scientifiques et technologiques exigeant plusieurs années de formation.
À lire aussi : États-Unis : la dette étudiante, menace pour les universités et enjeu politique majeur
Le film Ivory Tower, réalisé en 2014 par le cinéaste Andrew Rossi et nourri des analyses du sociologue Andrew Delbanco, alertait déjà sur les signes d’épuisement du modèle universitaire américain. C’est dans ce contexte que la dépendance aux étudiants et doctorants étrangers s’accroît fortement, en particulier dans les mathématiques, les technologies et les sciences des données.
Une dépendance vis-à-vis des étudiants étrangers
Les rapports annuels de la National Science Foundation montrent que, déjà au milieu des années 2010, les titulaires de visas temporaires représentent une part décisive – souvent majoritaire – des doctorants dans plusieurs disciplines clés : près des deux tiers des doctorats en informatique, plus de la moitié en ingénierie et en mathématiques. La grande majorité d’entre eux (80 %) restent ensuite aux États-Unis si la politique migratoire le leur permet.
Cette dépendance, qui n’a fait qu’augmenter, n’est pas marginale : elle constitue désormais un pilier du fonctionnement quotidien de la recherche américaine. Les restrictions migratoires mises en œuvre sous la première administration Trump, puis durcies en 2025, ne font que rendre pleinement visible une vulnérabilité stratégique pour l’avenir du pays.
Les évolutions de la science américaine ont pris place dans un contexte mondial profondément transformé depuis les années 1990. Les dépenses de recherche et développement progressent rapidement en Asie, tandis que la part relative des États‑Unis et de l’Europe tend à se stabiliser voire à baisser dans de nombreux pays de la zone OCDE.
La trajectoire chinoise est à cet égard centrale. Depuis plus de trente ans, la Chine a engagé une stratégie continue, combinant investissements massifs, planification de long terme, développement des « laboratoires clés », redéfinition des règles du jeu des classements internationaux, montée en gamme des formations doctorales, politiques actives de publication et de retour des chercheurs expatriés. Cette trajectoire ne relève pas d’un simple rattrapage technologique, mais d’une appropriation sélective de modèles de formation, d’organisation et de gouvernance scientifique, en partie inspirés de l’expérience américaine.
La Chine, acteur majeur de la production scientifique
Les résultats sont aujourd’hui tangibles : progression rapide des publications scientifiques – la Chine est devenue en 2024 le premier pays au monde en volume d’articles indexés dans la base Web of Science, avec près de 880 000 publications annuelles, contre environ 26 000 au début des années 2000 – et surtout une présence croissante dans les dépôts de brevet : près de 1,8 million de demandes en une seule année, soit plus de trois fois le volume américain, selon l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI/WIPO).
À cela s’ajoutent des politiques ciblées pour attirer ou faire revenir des chercheurs chinois formés à l’étranger, contribuant à réduire progressivement l’asymétrie historique avec les États-Unis. Loin de produire une ouverture politique, cette circulation maîtrisée des modèles contribue à la modernisation de l’État tout en renforçant les capacités de contrôle et de légitimation du pouvoir sur les élites scientifiques et administratives.
L’article récent du New York Times soulignant le recul relatif de Harvard et d’autres universités américaines dans certains classements mondiaux a été interprété comme une sonnette d’alarme, le signe d’un déclin soudain. En réalité, ces classements mettent en lumière surtout des évolutions graduelles des positions relatives, révélatrices des recompositions engagées de longue date. Les universités américaines demeurent prestigieuses et sélectives, mais elles ne sont plus seules au sommet dans un paysage scientifique désormais multipolaire.
Les indicateurs internationaux de l’innovation prolongent ce constat : en valeur absolue, les États-Unis restent l’un des premiers investisseurs mondiaux en recherche et développement. Mais leur avance relative s’érode : depuis le début des années 2000, la progression de leur effort de R&D est nettement plus lente que celle de nombreux pays concurrents.
Au-delà des décisions de l’administration Trump, les causes sont structurelles : continuité et niveau de l’investissement public, capacité à former et retenir les talents, cohérence des orientations scientifiques, place accordée à la recherche fondamentale. Là où la Chine et plusieurs pays d’Asie ont inscrit la science dans des stratégies nationales de long terme, les États-Unis ont laissé s’accumuler incohérences et déséquilibres, misant sur les acquis de leur attractivité passée. Ils conservent néanmoins des universités d’un niveau exceptionnel, d’importantes capacités de financement et d’innovation ainsi qu’une puissance d’attraction encore largement dominante.
À court terme, rien n’indique un décrochage brutal. En revanche, la pérennité de ce leadership ne peut plus être tenue pour acquise. Elle est désormais directement affectée par des remises en cause explicites de l’autonomie académique et des conditions ordinaires de fonctionnement des universités.
Ce leadership dépendra de la capacité des universités à recruter librement, à l’échelle mondiale, leurs enseignants et chercheurs ; à maintenir des politiques et des programmes de formation et de recherche à l’abri des cycles politiques ; à protéger leurs dirigeantes et dirigeants des pressions partisanes ; et à garantir aux étudiants comme aux chercheurs des conditions de travail intellectuel et des perspectives professionnelles stables.
Ce sont précisément ces conditions que les décisions récentes de Donald Trump rendent durablement incertaines.
Alessia Lefébure a enseigné à Columbia University entre 2011 et 2017.
18.02.2026 à 11:54
Quand l’odeur devient preuve : l’odorologie au cœur de la police scientifique
Estelle Davet, Inspectrice générale, cheffe du service national de police scientifique (SNPS)
Texte intégral (2176 mots)
À Écully, dans le Rhône, se trouvent les seuls chiens capables de comparer une trace olfactive laissée sur une scène d’infraction par l’odeur corporelle d’un suspect ou d’une victime. Découvrez l’odorologie.
En janvier 2012, à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), un homme cagoulé braque une banque dès l’ouverture. Quelques mois plus tard, un second établissement de la même ville est attaqué selon un mode opératoire similaire.
Les enquêteurs disposent de vidéos de surveillance, mais les images sont trop imprécises pour identifier formellement le suspect. L’ADN, habituellement décisif, ne livre aucun résultat exploitable. Reste une trace, plus discrète, presque invisible : l’odeur laissée dans le véhicule utilisé pour la fuite. C’est cette trace que la police scientifique va exploiter grâce à une de ses techniques d’expertise : l’odorologie, une discipline encore méconnue du grand public où des chiens spécialement formés procèdent à la comparaison et à l’identification d’odeurs humaines. Au procès, cette expertise permet la condamnation du braqueur.
Des chiens à l’expertise unique
Lorsque nous évoquons les chiens policiers, l’image des unités déployées sur le terrain, mobilisées dans la détection d’explosifs, de stupéfiants ou encore la recherche de personnes disparues, s’impose naturellement. Cependant, à côté de cette réalité opérationnelle se déploie une autre activité, moins visible : celle des chiens et de leurs maîtres œuvrant au sein de la police scientifique.
En France, il existe un lieu unique appelé le plateau national d’odorologie, qui réunit les seuls chiens capables de comparer une trace odorante laissée sur une scène d’infraction avec l’odeur corporelle d’un suspect ou d’une victime. Cette spécialité cynophile, créée en 2000 (par Daniel Grignon, cynotechnicien formé en Hongrie) devient pleinement opérationnelle à partir de 2003.
Aujourd’hui, l’activité d’odorologie s’appuie sur quatre agents et sept chiens (bergers belges malinois, bergers allemands, épagneul English Springer) qui, comme les experts humains en laboratoire, n’interviennent pas sur le terrain mais travaillent exclusivement au sein du plateau national d’Écully (à côté de Lyon, Rhône), où ils procèdent aux comparaisons odorantes. Deux autres chiens sont actuellement en formation, entamée à l’âge de six mois pour une durée d’environ un an.

Toute analyse en odorologie débute par une phase de prélèvement, déterminante pour la suite de la procédure. Réalisés exclusivement par des policiers habilités (500 préleveurs habilités de la police nationale en 2025), les prélèvements portent sur deux types d’odeurs complémentaires.
D’une part, les traces odorantes sont recueillies sur les lieux de l’infraction, à partir de tout support ayant été en contact avec une personne, qu’il s’agisse d’un siège, d’un volant, d’une poignée ou d’un vêtement. D’autre part, les odeurs corporelles sont directement prélevées sur les individus mis en cause ou sur les victimes : ceux-ci malaxent pendant plusieurs minutes des tissus spécifiques afin d’y transférer les molécules odorantes caractéristiques de leur signature chimique. Ces dernières sont stockées dans une pièce spécifique : l’odorothèque où, à ce jour, 9 600 scellés judiciaires sont stockés.
Une parade d’identification
Une fois les prélèvements réalisés, débute alors la phase d’analyses. Les traces odorantes prélevées sur la scène d’infraction sont comparées à l’odeur corporelle du mis en cause ou de la victime lors d’une parade d’identification réalisée par les chiens spécialement formés.

La trace est d’abord présentée au chien, qui la sent et la mémorise, puis il progresse le long d’une ligne composée de cinq bocaux contenant chacun une odeur corporelle différente : un seul correspond à l’odeur du mis en cause ou de la victime à identifier, les quatre autres servant d’odeurs de comparaison.
S’il reconnaît l’odeur à identifier, le chien se couche devant le bocal correspondant ; s’il ne reconnaît aucune des odeurs, il revient vers son maître. L’ensemble du processus dure environ 0,6 seconde, le temps pour le chien de placer son museau dans le bocal, de découvrir l’odeur qu’il contient, de l’analyser et de décider s’il doit marquer l’arrêt ou non.
La position des cinq bocaux est ensuite modifiée de façon aléatoire et le travail est répété une seconde fois avant qu’un troisième passage soit effectué sur une ligne de contrôle ne contenant pas l’odeur du mis en cause ou de la victime. Lorsque le premier chien a terminé son travail, la même opération est réalisée avec, au moins un second chien.
Une identification est considérée comme établie lorsque deux chiens ont marqué la même odeur, chacun au cours d’au moins deux passages, et que chacun d’eux a également réalisé au moins une ligne à vide.
La science de l’odeur humaine : une signature chimique individuelle
Chaque être humain possède une odeur corporelle propre, constituée de molécules volatiles issues principalement de la dégradation bactérienne des sécrétions de la peau, comme la sueur et le sébum. Cette odeur n’est pas uniforme : elle se compose de plusieurs éléments. Seule la composante primaire de l’odeur humaine demeure stable au cours du temps. C’est précisément cette composante primaire qui est utilisée par les chiens d’odorologie pour identifier un individu, celle-ci ne pouvant pas être altérée par des composantes variables, comme le parfum.
Elle constitue une véritable signature chimique individuelle, comparable, dans son principe, à une empreinte biologique. Le chien reste le seul capable de reconnaître cette composante invariable, indispensable à l’identification. Son système olfactif explique cette performance. Lorsque les molécules odorantes pénètrent dans la cavité nasale, elles se lient aux récepteurs de l’épithélium olfactif, déclenchant un influx nerveux transmis au bulbe olfactif, puis au cerveau, où l’odeur est analysée et mémorisée.
L’odorologie, un réel outil d’enquête
L’odorologie s’appuie sur un protocole rigoureux, conçu pour garantir la fiabilité à la fois scientifique et judiciaire des résultats obtenus. Son recours s’inscrit dans un cadre juridique strict et est réservé aux infractions d’une certaine gravité, à partir du délit aggravé (vol avec violence, cambriolage aggravé, séquestration…) et jusqu’aux crimes.
Cette expertise, pleinement intégrée aux pratiques de la police scientifique, ne statue pas à elle seule sur la culpabilité d’un individu, mais apporte un élément objectif essentiel au raisonnement judiciaire. Lorsqu’un rapprochement est établi, elle atteste un fait précis : la présence d’un individu (auteurs ou victimes) sur une scène d’infraction ou un contact avec des objets.
Cette technique intervient souvent en complément d’autres moyens d’investigation, mais elle peut aussi devenir déterminante lorsque les images sont floues, les témoignages fragiles ou les traces biologiques absentes. Depuis 2003, 787 dossiers ont été traités par le plateau national d’odorologie, aboutissant à 195 identifications. Les experts ont été appelés à témoigner 44 fois devant des cours d’assises, preuve de la reconnaissance judiciaire de cette discipline.
À l’heure où les avancées technologiques occupent une place centrale dans la police scientifique, l’odorologie rappelle que le vivant demeure parfois irremplaçable. Fondée sur un processus complexe et rigoureux, conforme aux exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17025, la comparaison d’odeurs ne laisse aucune place au hasard. Elle s’inscrit dans un faisceau d’indices, contribuant à la manifestation de la vérité.
Invisible, silencieuse, mais persistante, cette expertise rappelle que le crime laisse toujours une trace, faisant écho au principe formulé dès 1920 par Edmond Locard : « Nul ne peut agir avec l’intensité que suppose l’action criminelle sans laisser des marques multiples de son passage. »
Créé en 2023, le Centre de recherche de la police nationale pilote la recherche appliquée au sein de la police nationale. Il coordonne l’activité des opérateurs scientifiques pour développer des connaissances, des outils et des méthodes au service de l’action opérationnelle et stratégique.
Estelle Davet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
18.02.2026 à 11:53
Souriez, vous êtes filmés : ce que l’« emotion AI » voit vraiment sur nos visages
Charlotte De Sainte Maresville, Doctorante 3 eme année en marketing et sciences affectives, Université Bretagne Sud (UBS)
Christine Petr, Professeur des Université en Marketing - Sciences de Gestion et du Management, Université Bretagne Sud (UBS)
Texte intégral (2449 mots)
Aujourd’hui, on peut lire vos émotions sur votre visage et adapter un flux vidéo en temps réel en fonction de votre réaction. Vraiment ? Quelles sont les utilisations autorisées de l’« emotion AI », et ses limites ? Éclairage par deux spécialistes.
Dans un magasin de cosmétiques, une cliente s’arrête devant une borne interactive. Une caméra intégrée filme son visage pendant quelques secondes pendant qu’elle regarde l’écran. Le système ne cherche pas à l’identifier, mais à observer ses réactions : sourit-elle ? détourne-t-elle le regard ? fronce-t-elle légèrement les sourcils ? À partir de ces signaux, la borne adapte le contenu affiché.
Ces technologies, qui s’inscrivent dans le domaine de l’emotion AI, sont déjà utilisées pour tester des publicités, analyser l’attention d’un public lors d’une conférence ou mesurer l’engagement face à une interface.
Mais que fait réellement cette technologie lorsqu’elle « analyse » un visage ? Et jusqu’où peut-on aller lorsqu’on cherche à interpréter des expressions faciales à l’aide de l’intelligence artificielle ?
Qu’est-ce que l’« emotion AI » ?
L’emotion AI désigne un ensemble de méthodes informatiques qui consistent à analyser des expressions faciales afin d’en extraire des informations sur les réactions émotionnelles probables d’une personne.
Dans la pratique, ces systèmes captent les mouvements du visage : ouverture de la bouche, haussement des sourcils, plissement des yeux, dynamique des expressions dans le temps. L’objectif n’est pas de savoir ce qu’une personne ressent au fond d’elle-même, mais d’associer ces indices faciaux à certaines réactions comme l’intérêt, la surprise ou le désengagement. Les résultats prennent la forme de scores ou de catégories, qui indiquent la probabilité qu’une expression corresponde à un état donné.
Cette approche s’inscrit dans une longue tradition de recherche sur les expressions faciales, bien antérieure à l’intelligence artificielle. Dès les années 1970, des travaux fondateurs en psychologie ont proposé des méthodes systématiques pour décrire et coder les mouvements du visage, reposant sur des observations humaines expertes.
Ce que l’emotion AI apporte, c’est la capacité à automatiser l’analyse, à grande échelle et en temps quasi réel de ces signaux, que les chercheurs et praticiens étudient depuis longtemps de manière manuelle ou semi-automatisée. Cette automatisation s’est développée à partir des années 2000 avec l’essor de la vision par ordinateur, puis s’est accélérée avec les méthodes d’apprentissage automatique et d’apprentissage profond.
Comment ça marche ?
Les systèmes actuels analysent des flux vidéo image par image, à des fréquences comparables à celles de la vidéo standard. Selon la complexité des modèles et le matériel utilisé, l’estimation des réactions faciales peut être produite avec une latence de l’ordre de la centaine de millisecondes, ce qui permet par exemple d’adapter dynamiquement le contenu affiché sur une borne interactive.
Le logiciel détecte d’abord un visage à l’écran, puis suit les changements de son expression d’une image à l’autre. À partir de ces informations, le système calcule des descripteurs faciaux, puis les compare à des modèles appris à partir de bases de données d’expressions faciales annotées, c’est-à-dire des ensembles d’images ou de vidéos de visages pour lesquelles des experts humains ont préalablement identifié et étiqueté les mouvements ou expressions observés.

En effet, lors de la phase d’apprentissage du modèle d’IA, le système a appris à associer certaines configurations faciales à des catégories ou à des scores correspondant à des réactions données. Lorsqu’il est ensuite appliqué à un nouveau visage, il ne fait que mesurer des similarités statistiques avec les données sur lesquelles il a été entraîné.
Concrètement, lorsqu’un système indique qu’un visage exprime une émotion donnée, il ne fait que dire ceci : « cette configuration faciale ressemble, statistiquement, à d’autres configurations associées à cet état dans les données d’entraînement » (on parle d’inférence probabiliste).
Ces méthodes ont aujourd’hui atteint un niveau de performance suffisant pour certains usages bien définis – par exemple lors de tests utilisateurs, d’études marketing ou dans certaines interfaces interactives, où les conditions d’observation peuvent être partiellement maîtrisées.
Quelles sont les limites techniques ?
Néanmoins, cette fiabilité reste très variable selon les contextes d’application et les objectifs poursuivis. Les performances sont en effet meilleures lorsque le visage est bien visible, avec un bon éclairage, peu de mouvements et sans éléments masquant les traits, comme des masques ou des lunettes à monture épaisse. En revanche, lorsque ces systèmes sont déployés en conditions réelles et non contrôlées, leurs résultats doivent être interprétés avec davantage d’incertitude.
Les limites de l’emotion AI tiennent d’abord à la nature même des expressions faciales. Une expression ne correspond pas toujours à une émotion unique : un sourire peut signaler la joie, la politesse, l’ironie ou l’inconfort. Le contexte joue un rôle essentiel dans l’interprétation.

Les performances des systèmes dépendent également des données utilisées pour les entraîner. Les bases de données d’entraînement peu diversifiées peuvent conduire entre autres à des erreurs ou à des biais. Par exemple, si la base de données est principalement composée d’images de femmes de moins de 30 ans de type caucasien, le système aura du mal à interpréter correctement des mouvements faciaux d’individus de plus de 65 ans et de type asiatique.
Enfin, il ne faut pas se limiter aux seules expressions faciales, qui ne constituent qu’un canal parmi d’autres de l’expression émotionnelle. Elles fournissent des informations précieuses, mais partielles. Les systèmes d’emotion AI sont donc surtout pertinents lorsqu’ils sont utilisés en complément d’autres sources d’information, comme des indices vocaux, comportementaux ou déclaratifs. Cette approche ne remet pas en cause l’automatisation, mais en précise la portée : l’emotion AI automatise l’analyse de certains signaux observables, sans prétendre à une interprétation exhaustive des émotions.
Des risques à ne pas ignorer
Utilisée sans cadre clair, l’emotion AI peut alimenter des usages problématiques, notamment lorsqu’elle est intégrée à des dispositifs d’influence commerciale ou de surveillance.
Dans le domaine commercial, ces technologies sont par exemple envisagées pour ajuster en temps réel des messages publicitaires ou des interfaces en fonction des réactions faciales supposées des consommateurs. Ce type de personnalisation émotionnelle soulève des questions de manipulation, en particulier lorsque les personnes concernées ne sont pas pleinement informées de l’analyse de leurs réactions.
À lire aussi : Quand l’IA nous manipule : comment réguler les pratiques qui malmènent notre libre arbitre ?
Les risques sont également importants dans les contextes de surveillance, notamment lorsque l’analyse automatisée des expressions faciales est utilisée pour inférer des états mentaux ou des intentions dans des espaces publics, des environnements professionnels ou des contextes sécuritaires. De tels usages reposent sur des inférences incertaines et peuvent conduire à des interprétations erronées, voire discriminatoires.
Ces risques sont aujourd’hui largement documentés par la recherche scientifique, ainsi que par plusieurs institutions publiques et autorités de régulation. À l’échelle internationale, ces réflexions ont notamment conduit à l’adoption de recommandations éthiques, comme celles portées par l’Unesco, qui ne sont toutefois pas juridiquement contraignantes et visent surtout à orienter les pratiques et les politiques publiques.
En revanche, en Europe, le règlement sur l’IA interdit ou restreint fortement les usages de l’analyse émotionnelle automatisée lorsqu’ils visent à surveiller, classer ou évaluer des personnes dans des contextes grand public, notamment dans les espaces publics, au travail ou à l’école.
Ces technologies ne peuvent pas être utilisées pour inférer des états mentaux ou guider des décisions ayant un impact sur les individus, en raison du caractère incertain et potentiellement discriminatoire de ces inférences. En France, la mise en œuvre de ce cadre s’appuie notamment sur l’action de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), chargée de veiller au respect des droits fondamentaux dans le déploiement de ces technologies.
Ces débats rappellent un point essentiel : les expressions faciales ne parlent jamais d’elles-mêmes. Leur analyse repose sur des inférences incertaines, qui exigent à la fois des modèles théoriques solides, une interprétation critique des résultats et un cadre d’usage clairement défini.
Les enjeux éthiques et réglementaires ne sont donc pas extérieurs aux questions scientifiques et techniques, mais en constituent un prolongement direct. C’est précisément dans cette articulation entre compréhension fine des expressions, limites des modèles et conditions d’usage responsables que se joue l’avenir de l’emotion AI.
Charlotte De Sainte Maresville a reçu des financements de ANR dans le cadre d'une convention CIFRE.
Christine PETR a reçu des financements de ANR dans le cadre d'une CIFRE.
17.02.2026 à 17:06
La loi de Moore ayant atteint ses limites, que nous réserve l’avenir de l’informatique ?
Domenico Vicinanza, Associate Professor of Intelligent Systems and Data Science, Anglia Ruskin University
Texte intégral (1345 mots)
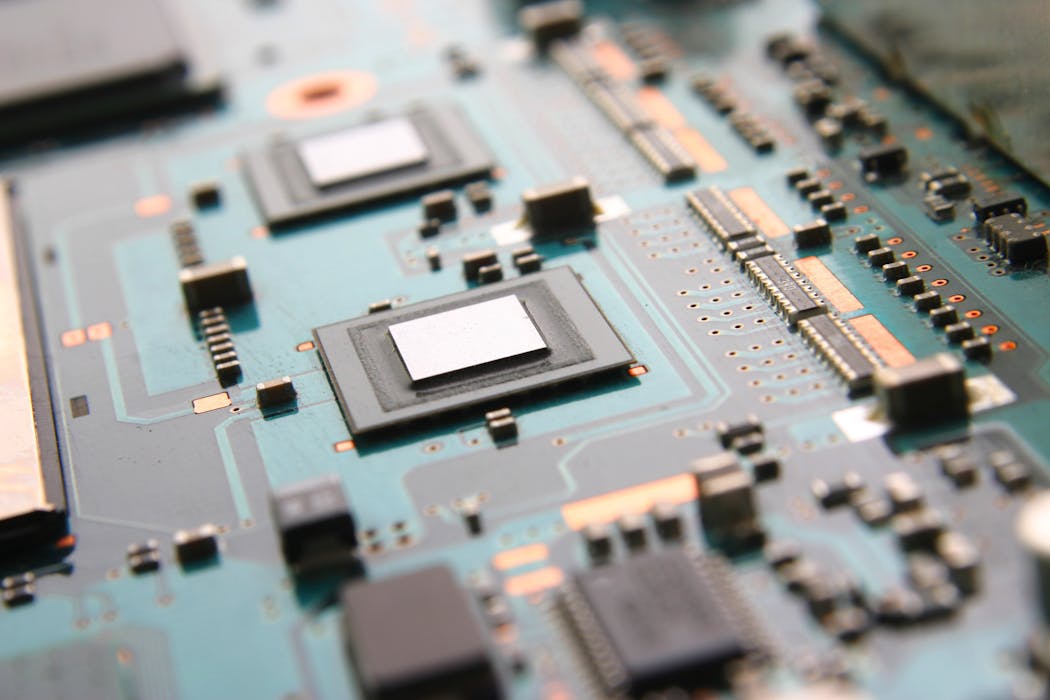
Après un demi-siècle de gains réguliers en puissance de calcul, l’informatique entre dans une nouvelle ère. La miniaturisation ne suffit plus : les progrès dépendent désormais de l’architecture, de l’énergie et de logiciels optimisés.
Pendant un demi-siècle, l’informatique a progressé de manière rassurante et prévisible. Les transistors – ces dispositifs qui servent à contrôler le passage des signaux électriques sur une puce informatique – sont devenus de plus en plus petits, ce qui permet d’en amasser davantage sur une seule puce. En conséquence, les puces ont gagné en rapidité, et la société a intégré ces avancées presque sans s’en rendre compte.
Ces puces plus rapides ont offert une puissance de calcul accrue en permettant aux appareils d’exécuter les tâches plus efficacement. On a ainsi vu les simulations scientifiques s’améliorer, les prévisions météorologiques gagner en précision, les images devenir plus réalistes, puis les systèmes d’apprentissage automatique émerger et se développer. Tout se passait comme si la puissance de calcul obéissait à une loi naturelle.
La fin des certitudes
Ce phénomène a pris le nom de loi de Moore, d’après l’homme d’affaires et scientifique Gordon Moore. Elle résumait l’observation empirique selon laquelle le nombre de transistors sur une puce doublait approximativement tous les deux ans. Cela permettait aussi de réduire la taille des appareils et alimentait en conséquence la miniaturisation.
Ce sentiment de certitude et de prévisibilité a désormais disparu, non pas parce que l’innovation se serait arrêtée, mais parce que les hypothèses physiques qui la soutenaient autrefois ne sont plus valables.
Qu’est-ce qui remplace alors l’ancien modèle d’augmentation automatique des performances ? La réponse ne tient pas à une seule avancée technologique, mais à plusieurs stratégies qui se superposent.
De nouvelles approches
L’une d’elles repose sur de nouveaux matériaux et de nouvelles architectures de transistors. Les ingénieurs améliorent encore leur conception afin de limiter les pertes d’énergie et les fuites électriques indésirables. Ces évolutions apportent des gains plus modestes et plus progressifs qu’autrefois, mais elles permettent de mieux maîtriser la consommation énergétique.
Une autre approche consiste à modifier l’organisation physique des puces. Au lieu de disposer tous les composants sur une surface plane unique, les puces modernes empilent de plus en plus les éléments les uns sur les autres ou les rapprochent davantage. Cela réduit la distance que doivent parcourir les données, ce qui permet de gagner à la fois en temps et en énergie.
Le changement le plus important est sans doute la spécialisation. Au lieu de confier toutes les tâches à un unique processeur polyvalent, les systèmes modernes combinent différents types de processeurs. Les unités de traitement traditionnelles, ou CPU, assurent le contrôle et la prise de décision. Les processeurs graphiques sont des unités de calcul très puissantes, conçues à l’origine pour répondre aux exigences du rendu graphique dans les jeux vidéo et d’autres usages. Les accélérateurs d’IA (du matériel spécialisé qui accélère les tâches liées à l’intelligence artificielle) se concentrent sur l’exécution en parallèle d’un très grand nombre de calculs simples. Les performances dépendent désormais de la manière dont ces composants fonctionnent ensemble, plutôt que de la vitesse de chacun pris isolément.
Des technologies expérimentales
Parallèlement à ces évolutions, les chercheurs explorent des technologies plus expérimentales, notamment les processeurs quantiques (qui exploitent les principes de la physique quantique) et les processeurs photoniques, qui utilisent la lumière plutôt que l’électricité.
Il ne s’agit pas d’ordinateurs polyvalents, et ils ont peu de chances de remplacer les machines classiques. Leur intérêt réside dans des domaines très spécifiques, comme certains problèmes d’optimisation ou de simulation, pour lesquels les ordinateurs traditionnels peinent à explorer efficacement un grand nombre de solutions possibles. En pratique, ces technologies doivent être envisagées comme des coprocesseurs spécialisés, utilisés de manière ciblée et en complément des systèmes traditionnels.
Pour la plupart des usages informatiques du quotidien, les progrès des processeurs conventionnels, des systèmes de mémoire et de la conception logicielle resteront bien plus déterminants que ces approches expérimentales.
Pour les utilisateurs, l’ère post-Moore ne signifie pas que les ordinateurs cesseront de s’améliorer. Cela veut juste dire que les progrès se manifesteront de manière plus inégale et plus dépendante des usages. Certaines applications — comme les outils fondés sur l’IA, le diagnostic, la navigation ou la modélisation complexe — pourraient connaître de vraies avancées, tandis que les performances généralistes progresseront plus lentement.
Nouvelles technologies
Lors de la conférence Supercomputing SC25 à Saint-Louis, plusieurs systèmes hybrides associant CPU (processeurs), GPU (processeurs graphiques) et technologies émergentes — comme les processeurs quantiques ou photoniques — ont été présentés comme des prolongements concrets de l’informatique classique. Pour l’immense majorité des usages quotidiens, ce sont toutefois les progrès des processeurs traditionnels, des mémoires et des logiciels qui continueront d’apporter les gains les plus significatifs.
On note un intérêt croissant pour les dispositifs quantiques et photoniques comme coprocesseurs, et non comme remplaçants. Ils sont particulièrement utiles pour des problèmes très spécifiques, comme l’optimisation ou le routage complexes, où les machines classiques seules peinent à trouver des solutions efficaces.
Dans ce rôle d’appoint, ils offrent un moyen crédible d’allier la fiabilité de l’informatique classique à de nouvelles techniques de calcul, élargissant ainsi les capacités des systèmes.
Un nouveau récit
La suite n’est pas une histoire de déclin, mais un processus de transformation et d’évolution permanentes. Les progrès en informatique reposent désormais sur la spécialisation des architectures, une gestion rigoureuse de l’énergie et des logiciels conçus en tenant pleinement compte des contraintes matérielles. Le risque est de confondre complexité et inéluctabilité, ou narratifs marketing et problèmes réellement résolus.
L’ère post-Moore impose une relation plus réaliste avec l’informatique : la performance n’est plus un acquis automatique lié à la miniaturisation des transistors, mais un résultat qu’il faut concevoir, justifier et payer – en énergie, en complexité et en compromis.
Domenico Vicinanza ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
16.02.2026 à 17:00
AlphaGenome, une nouvelle avancée en intelligence artificielle pour explorer les effets des mutations génétiques
Élodie Laine, Professeure en biologie computationnelle, Sorbonne Université
Julien Mozziconacci, Professeur en biologie computationelle, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)
Texte intégral (1432 mots)
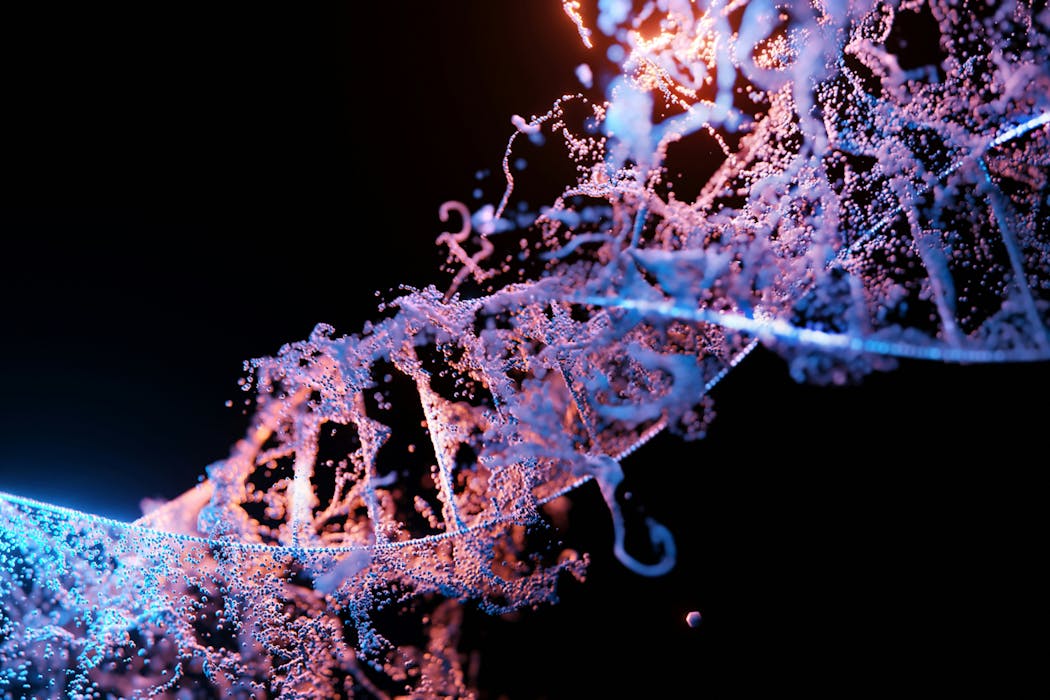
Notre ADN est composé d’un enchaînement de quatre petites molécules appelées « acides nucléiques » et dénotées par les lettres A, C, G, et T. Parfois, une mutation génétique a lieu et affecte notre santé. Une simple modification dans la grande séquence de lettres qui constitue notre génome peut suffire à affecter l’expression des gènes ou les versions des protéines produites à partir de ces gènes.
Mais on ne sait pas, à l’heure actuelle, expliquer systématiquement comment telle ou telle mutation génétique peut avoir tel ou tel effet. C’est la question à laquelle AlphaGenome, le nouveau logiciel d’intelligence artificielle présenté dans la revue Nature par Google, tente de répondre.
AlphaGenome analyse un million d’acides nucléiques à la fois, et prédit, pour chacun d’eux, des milliers de quantités, qui sont autant de facettes de la régulation de nos gènes pour façonner nos tissus et nos organes.
Coupler un tel niveau de résolution avec un contexte aussi long (un million de lettres !) et prédire autant d’aspects de la régulation du génome relève du tour de force. Cependant, ce nouvel opus de la série Alpha de DeepMind ne représente pas une avancée aussi spectaculaire qu’AlphaGo ou AlphaFold, par exemple.
AlphaGenome affine une approche existante, déjà implémentée dans Enformer et Borzoi, deux modèles d’apprentissage profond développés chez Google qui ont fait leurs preuves. Il améliore, d’une part, leur efficacité par des optimisations techniques et, d’autre part, leur pertinence, en modélisant plus finement la complexité des processus génétiques.
À lire aussi : Décrypter notre génome grâce à l’intelligence artificielle
Pourquoi cette avancée est importante
L’enjeu de ce travail est de taille pour la santé humaine. Les bases de données génomiques de populations humaines recensent près de 800 millions de variations ponctuelles – c’est-à-dire des changements portant sur une seule lettre du code génétique – dont l’impact sur notre santé reste largement inexploré. Identifier quelles sont celles qui sont à l’origine de maladies ou de dysfonctionnements, et comprendre leurs mécanismes d’action, est crucial.
Par exemple, dans certaines leucémies, une mutation d’un seul acide nucléique active de manière inappropriée un gène bien spécifique. AlphaGenome confirme le mécanisme déjà connu de cette activation aberrante : la mutation permet à un régulateur génétique de s’accrocher au gène, et modifie les marques épigénétiques alentour.
Ainsi, en unifiant plusieurs dimensions de la régulation génétique, AlphaGenome s’impose comme un modèle de fondation, c’est-à-dire un modèle générique qui peut être transféré ou appliqué facilement à plusieurs problèmes.
Quelles sont les suites de ces travaux ?
Plusieurs limitations tempèrent néanmoins l’enthousiasme.
Par exemple, les prédictions sur différentes facettes d’un même processus biologique ne sont pas toujours cohérentes entre elles, révélant que le modèle traite encore ces modalités de façon relativement cloisonnée.
Le modèle peine aussi à capturer la « spécificité tissulaire », c’est-à-dire le fait qu’un même variant génétique peut être délétère dans un tissu et neutre dans un autre.
De plus, il reste difficile de quantifier l’ampleur de l’effet d’une mutation.
Enfin, AlphaGenome prédit des conséquences moléculaires, pas des symptômes ni des diagnostics – or, entre une variation d’ADN et une maladie, il reste énormément de travail pour comprendre les relations entre ces différents niveaux ; et il n’a pas encore été validé sur des génomes individuels – un passage obligé pour toute application en médecine personnalisée, où l’enjeu serait d’interpréter le profil génétique unique d’un patient pour prédire sa susceptibilité à certaines maladies ou adapter son traitement.
Au-delà de ces enjeux pour la santé humaine, comment transférer cette connaissance à la biodiversité dans son ensemble ? AlphaGenome dépend en effet de mesures expérimentales, accessibles en abondance uniquement pour une poignée d’espèces (l’humain et quelques organismes modèles). Une autre famille de modèles pourrait ici jouer un rôle complémentaire : les « modèles de langage génomique », qui fonctionnent un peu comme ChatGPT mais pour prédire la suite d’une séquence d’ADN plutôt que la suite d’une phrase. Ces modèles, entraînés sur des millions de séquences génomiques, peuvent ainsi capturer les règles et les motifs conservés au cours de l’évolution, ce qui permet de déchiffrer des génomes inconnus.
Rien de tout cela n’existerait sans les grandes bases de données publiques et le travail cumulé de la recherche académique et des consortia ouverts, qui ont produit, standardisé et partagé les données nécessaires à l’entraînement de ces modèles. La suite logique est claire : la science doit rester ouverte, au service de la société. L’équipe d’AlphaGenome a rendu le code et les poids publiquement accessibles, et propose une interface facilitant l’adoption par la communauté scientifique. Reste à voir comment celle-ci s’emparera de cet outil : sera-t-il utilisé comme une « boîte noire » pratique, ou inspirera-t-il un véritable changement de paradigme en génomique computationnelle ?
Cet article a bénéficié de discussions avec Arnaud Liehrmann, post-doctorant au laboratoire de Biologie computationnelle, quantitative et synthétique.
Tout savoir en trois minutes sur des résultats récents de recherches commentés et contextualisés par les chercheuses et les chercheurs qui les ont menées, c’est le principe de nos « Research Briefs ». Un format à retrouver ici.
Elodie Laine est membre junior de l'Institut Universitaire de France. Elle a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR, France 2030, PostGenAI@Paris, ANR-23-IACL-0007) et de l'Union Européenne (ERC, PROMISE, 101087830). Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteurs uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne ou du Conseil européen de la recherche. Ni l'Union européenne ni l'autorité octroyant la subvention ne peuvent en être tenus responsables.
Julien Mozziconacci est professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et membre junior de l'Institut Universitaire de France. Il a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR, France 2030, PostGenAI@Paris). Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteurs uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux des instituts qui les ont financés.
15.02.2026 à 17:02
L’espace au service du climat : comment exploiter l’extraordinaire masse de données fournies par les satellites ?
Carine Saüt, Cheffe de Service « Applications des missions Terre & Atmosphère », Centre national d’études spatiales (CNES)
Texte intégral (2190 mots)

La somme d’informations que nous transmettent les satellites sur notre planète est colossale. Aujourd’hui, le défi est d’obtenir des données de meilleure qualité encore, et surtout de les faire parvenir jusqu’aux décideurs sous une forme utile et exploitable.
Depuis quarante ans, les données d’observation de la Terre se sont imposées comme l’un des outils les plus puissants pour mieux comprendre notre planète et suivre les effets de nos actions pour la préserver. Longtemps réservée aux chercheurs et aux agences spatiales, elle irrigue désormais l’action publique, l’économie et les aspects de politique de défense nationale. Mais cette richesse de données exceptionnelles reste largement sous-exploitée, notamment du côté des décideurs publics. Nous disposons d’un trésor dont nous ne tirons pas encore tout le potentiel pour éclairer les décisions ou accélérer la transition écologique.
Chaque jour, les satellites d’agences nationales, dont ceux opérés par le Centre national d’études spatiales (Cnes), ceux du programme européen Copernicus ou encore ceux des constellations commerciales observent la Terre. Ils produisent une somme gigantesque d’informations : températures de surface, concentrations de gaz, humidité des sols, couverture par la végétation, hauteur des vagues, courants marins… La liste est longue, il pleut littéralement de la donnée. La force de ces données ne réside pas seulement dans la quantité, mais surtout dans leur capacité à couvrir de façon homogène l’ensemble de la planète, y compris les zones les plus difficiles d’accès. L’espace se met donc au service de l’adaptation au changement climatique et les données d’observation de la terre deviennent un outil de décision pour mieux comprendre, agir et anticiper.

Les satellites offrent un niveau d’objectivité rare : ils observent tout, partout, sans être influencés par les frontières administratives ou les intérêts locaux. Alors que les données terrestres peuvent être fragmentées ou hétérogènes, les satellites offrent une mesure fiable, continue, homogène et donc comparable d’un pays à l’autre. Ensuite, les progrès technologiques ont permis des évolutions rapides : une résolution améliorée, une fréquence d’observation accrue, des capteurs de différentes natures. Autrefois on était seulement capable de prendre une photographie par mois, alors qu’aujourd’hui, la surveillance est quasi permanente. Depuis l’espace, nous obtenons une vision factuelle, indépendante et systématique du monde.
De nombreuses applications pour les données satellitaires
La donnée d’observation de la Terre soutient les politiques publiques en irriguant déjà une multitude de domaines. Concernant la sécurité alimentaire et la gestion des ressources en eaux, les satellites apportent des informations sur le stress hydrique pour anticiper des épisodes de sécheresse et ainsi mieux gérer les pratiques d’irrigation, mais également quant au suivi de la croissance des cultures ou pour estimer les rendements agricoles.
Ils aident également à gérer les risques naturels en fournissant une surveillance des zones à risque pour le suivi des incendies, notamment des mégafeux, ou des inondations. Ils permettent de dresser des cartographies entre avant et après les catastrophes naturelles pour aider l’intervention des secours et soutenir la reconstruction de l’écosystème endommagé. Le suivi par satellite permet également le suivi de la santé des arbres et de la déforestation, des zones côtières et de l’état des zones humides.

Enfin, l’observation depuis l’espace permet de mesurer les émissions de gaz à effet de serre. À l’heure actuelle, les inventaires nationaux, basés sur des modèles statistiques ou des estimations, sont trop lents pour réagir face à la rapidité de la crise climatique, puisqu’on constate un décalage de plusieurs années (entre deux à quatre ans) entre l’émission réelle et la donnée officielle. Dans un contexte où les décisions doivent être rapides, ce délai est problématique. En observant la composition de l’atmosphère, les satellites peuvent détecter les panaches de méthane et de CO2 quasiment en temps réel. Ils identifient ainsi des fuites ou des anomalies localisées qui échappent parfois totalement aux inventaires classiques.
D’autres acteurs peuvent bénéficier des informations issues des satellites, pour orienter les politiques publiques en termes d’aménagement du territoire, notamment par l’observation des îlots de chaleur urbains, la mesure de la qualité de l’air ou bien la planification d’actions de verdissements des zones et espaces urbains.
Après avoir produit de la donnée, réussir à la valoriser
Les données d’observation de la terre s’inscrivent donc dans plusieurs domaines en dotant les décideurs publics d’un outil transversal diagnostiquant notre planète de manière continue, précise et à des échelles locales, régionales ou mondiales. C’est là que se joue l’un des défis majeurs : rendre ces outils accessibles aux acteurs publics, aux élus, et aussi aux entreprises et aux citoyens. Les plates-formes de visualisation et les services d’analyse qui émergent aujourd’hui répondent à ce besoin en traduisant la complexité scientifique en informations compréhensibles, opérationnelles, et donc à terme en actions.
Cependant, malgré leur potentiel considérable ainsi que leur qualité et leur performance opérationnelle déjà démontrée, les données spatiales peinent à trouver leur place au sein des administrations et des entreprises. En effet, il s’agit d’un univers technique complexe. Les données brutes sont massives, spécialisées, souvent difficiles à interpréter. Leur analyse requiert des expertises précises : traitement d’images satellitaires, science des données, modélisation atmosphérique…
Nous observons donc un gouffre entre l’accès de plus en plus facilité aux données d’observation de la Terre et la capacité à les utiliser en toute confiance en l’intégrant dans les chaînes de prise de décisions. Même si la majorité des données est ouverte et gratuite, cela ne suffit pas. Il faut des plates-formes, des services, des outils visuels pour les rendre intelligibles, avec des interfaces pensées pour le suivi d’une application de politique publique. Les élus, à titre d’exemple, n’ont pas vocation à manipuler des gigaoctets de données, ils ont besoin de visualisations simples, d’indicateurs synthétiques, de cartographies claires. L’expertise doit précéder pour interpréter les données et les rendre véritablement utiles pour les décideurs.
Combiner les données dans des outils clairs et pratiques
Pour déverrouiller ces usages, plusieurs leviers se développent. Il s’agit, entre autres, de croiser des données de natures différentes. Cette combinaison permet de fournir des informations fondées sur les données d’observation de la Terre directement exploitables, plus fiables, plus interprétables et mieux contextualisées au besoin de l’utilisateur.
Les données d’observation de la Terre changent la donne en offrant la capacité de voir notre planète autrement. L’observation spatiale ne résoudra pas d’elle-même la crise climatique mais, combinée à d’autres sources de données, elle apporte quelque chose d’essentiel : une vision objective, continue, indépendante et globale de l’état de la planète. Ces informations sont devenues indispensables aux collectivités qui doivent désormais anticiper, et non seulement réagir.
Les données d’observation de la Terre permettent de mesurer plus vite, comprendre plus finement et décider plus efficacement, dès lors que l’information qui en découle est accessible, lisible et traduite en indicateurs exploitables. Notre rôle au Cnes est de valoriser ces données pour leur donner du sens et en faire un levier d’action. Parmi les applications les plus prometteuses et stratégiques liées à l’adaptation au changement climatique dans les politiques publiques, il ressort que l’enjeu n’est pas seulement de mesurer, mais de mesurer plus vite et plus précisément, pour mieux anticiper.
Carine Saüt ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
14.02.2026 à 08:42
En ouvrant ChatGPT à la publicité, OpenAI expose l’IA à des dérives dangereuses
Raffaele F Ciriello, Senior Lecturer in Business Information Systems, University of Sydney
Kathryn Backholer, Co-Director, Global Centre for Preventive Health and Nutrition, Deakin University
Texte intégral (2105 mots)

La question dépasse la technique. En ouvrant ChatGPT aux annonceurs, OpenAI pose un choix politique : l’IA doit-elle servir le public ou devenir un outil redoutable dans les mains des publicitaires ?
OpenAI a annoncé son intention d’introduire de la publicité dans ChatGPT aux États-Unis. Les annonces apparaîtront dans la version gratuite et pour les abonnés à l'offre Go (la moins chère), mais pas pour les abonnés Pro, Business ou Entreprise.
L’entreprise affirme que les publicités seront clairement séparées des réponses du chatbot et qu’elles n’influenceront pas les contenus générés. Elle s’est également engagée à ne pas vendre les conversations des utilisateurs, à permettre la désactivation des publicités personnalisées et à éviter toute publicité destinée aux moins de 18 ans ou portant sur des sujets sensibles tels que la santé et la politique.
Malgré ces engagements, la décision a suscité des inquiétudes chez une partie des utilisateurs. La question centrale est de savoir si ces garanties tiendront une fois que la publicité deviendra un pilier de son modèle économique.
Pourquoi la publicité dans l’IA était presque inévitable
Nous avons déjà vu ce scénario. Il y a quinze ans, les plateformes de réseaux sociaux peinaient à transformer leurs audiences massives en profits.
Le tournant est venu avec la publicité ciblée : adapter les annonces à ce que les utilisateurs recherchent, consultent et regardent. Ce modèle est devenu la principale source de revenus de Google et de Facebook, au point de remodeler leurs services pour maximiser l’engagement des utilisateurs.
Les plateformes d’intelligence artificielle (IA) grand-public sont extrêmement coûteuses pour leurs propriétaires. L’entraînement et le fonctionnement de modèles avancés exigent d’immenses centres de données, des puces spécialisées et un travail d’ingénierie continu. Malgré une croissance rapide du nombre d’utilisateurs, de nombreuses entreprises d’IA continuent d’opérer à perte. OpenAI prévoit à elle seule de « brûler » près de 100 milliards d’euros au cours des cinq prochaines années.
Seules quelques entreprises peuvent absorber de tels coûts. Pour la plupart des fournisseurs d’IA, trouver un modèle économique à grande échelle est urgent, et la publicité ciblée apparaît comme la réponse la plus évidente. Elle reste le moyen le plus fiable de rentabiliser de larges audiences.
Ce que l’histoire nous enseigne
OpenAI affirme qu’elle maintiendra une séparation claire entre les publicités et les réponses, et qu’elle protégera la vie privée des utilisateurs. Ces garanties peuvent sembler rassurantes, mais elles reposent pour l’instant sur des engagements vagues et susceptibles d’être réinterprétés.
L’entreprise indique ainsi qu’elle ne diffusera pas de publicités « à côté de sujets sensibles ou réglementés comme la santé, la santé mentale ou la politique », mais apporte peu de précisions sur ce qui est considéré comme « sensible », sur l’étendue de la notion de « santé » ou sur l’instance chargée de fixer ces limites.
La plupart des échanges avec une IA, dans la vie réelle, ne relèveront pas de ces catégories restreintes. À ce jour, OpenAI n’a donné aucune précision sur les types de publicités qui seront autorisés ou exclus. Si aucun garde-fou n’est posé sur le contenu des annonces, on peut aisément imaginer qu’un internaute demandant « comment décompresser après une journée stressante » se voie proposer des publicités pour la livraison d’alcool. Une requête sur des « idées de week-end sympa » pourrait faire surgir des promotions pour des sites de jeux d’argent.
Pourtant, ces produits sont associés à des effets néfastes reconnus sur la santé et la société. Placées à côté d’un conseil personnalisé, au moment précis où une décision se prend, ces publicités peuvent infléchir les comportements de façon discrète mais efficace, même en l’absence de toute question de santé explicitement formulée.
On avait vu fleurir des promesses comparables aux débuts des réseaux sociaux. Mais l’expérience montre que l’autorégulation s’érode face aux impératifs commerciaux, au profit des entreprises et au détriment des utilisateurs.
Les logiques publicitaires ont souvent mis à mal l’intérêt général. Le scandale Cambridge Analytica a révélé des données personnelles collectées à des fins commerciales pouvaient être réutilisées pour peser sur des scrutins. Les « Facebook Files » ont, eux, révélé que Meta était consciente des effets délétères de ses plateformes, notamment sur la santé mentale des adolescentes et adolescents, mais a tardé à engager des réformes susceptibles d’entamer ses revenus publicitaires.
Plus récemment, des investigations ont montré que Meta continue de tirer profit de publicités frauduleuses, malgré les alertes répétées sur leurs conséquences.
Pourquoi les chatbots changent la donne
Les chatbots ne sont pas un simple fil d’actualité de plus. Les utilisateurs s’en servent de manière intime et personnelle, pour demander des conseils, chercher un soutien émotionnel ou réfléchir en privé. Ces échanges sont perçus comme discrets, sans jugement, et incitent souvent à confier des choses que l’on ne dirait pas en public.
Cette relation de confiance renforce le pouvoir de persuasion, d’une manière que les réseaux sociaux ne permettent pas. On consulte un chatbot pour obtenir de l’aide ou prendre une décision. Même si les publicités sont formellement séparées des réponses, elles s’insèrent dans un espace privé et conversationnel, et non dans un flux public.
Cette relation de confiance décuple le pouvoir de persuasion, bien au-delà de ce que permettent les réseaux sociaux. On se tourne vers un chatbot pour demander conseil, trancher une décision, chercher un appui. Même officiellement dissociées des réponses, les publicités s’invitent alors dans un tête-à-tête numérique, au cœur d’un échange privé, et non dans le brouhaha d’un fil public.
Des messages placés aux côtés de recommandations personnalisées — qu’ils concernent des biens de consommation, des loisirs, les finances ou la politique — ont toutes les chances d’exercer une influence bien plus forte que les mêmes publicités aperçues au détour d’une navigation classique.
Alors qu’OpenAI présente ChatGPT comme un « super assistant » capable d’accompagner ses utilisateurs dans tous les domaines, des finances à la santé, la frontière entre conseil et incitation devient de plus en plus floue.
Pour les escrocs comme pour les régimes autoritaires, disposer d'un outil de propagande encore plus efficace serait particulièrement tentant. Et du côté des acteurs de l’IA, la perspective de revenus supplémentaires rendra toute complaisance d’autant plus difficile à écarter
Le problème de fond tient à un conflit d’intérêts structurel. Les modèles publicitaires récompensent les plateformes qui maximisent l’engagement, alors même que les contenus les plus susceptibles de capter durablement l’attention sont souvent trompeurs, émotionnellement chargés ou préjudiciables à la santé.
C’est pour cette raison que l’autorégulation des plateformes en ligne a, à maintes reprises, montré ses limites.
Existe-t-il une meilleure voie ?
Une piste serait de considérer l’IA comme une infrastructure publique numérique : des systèmes essentiels, conçus pour servir l’intérêt général plutôt que pour maximiser les recettes publicitaires.
Cela n’implique pas d’exclure les acteurs privés. Mais cela suppose l’existence d’au moins une option publique de haute qualité, placée sous contrôle démocratique — à l’image des médias audiovisuels publics qui coexistent avec les chaînes commerciales.
Des exemples émergent déjà. La Suisse a développé le système d’IA public Apertus via ses universités et son centre national de calcul intensif. Ce modèle est open source, conforme au droit européen sur l’IA et exempt de publicité.
L’Australie (NDT : la version originale de ce texte a été écrite pour un public australien) pourrait aller plus loin. En parallèle du développement de ses propres outils d’IA, les autorités pourraient imposer des règles claires aux acteurs commerciaux : obligation de transparence, interdiction des publicités nuisibles à la santé ou à caractère politique, et sanctions effectives — pouvant aller jusqu’à la suspension d’activité — en cas d’infractions graves.
La publicité n’a pas dévoyé les réseaux sociaux en un jour. Elle a progressivement déplacé les incitations, jusqu’à faire des atteintes à l’intérêt général un simple effet secondaire de la quête de rentabilité. L’introduire dans l’IA conversationnelle, c’est risquer de reproduire ce scénario — mais dans des systèmes auxquels les utilisateurs accordent une confiance bien plus profonde encore.
La question décisive n’est donc pas d’ordre technique, mais politique : l’IA doit-elle servir le public, ou les annonceurs et les investisseurs ?
Raffaele F Ciriello est membre bénévole et temporaire du groupe consultatif des parents auprès de l’eSafety Commissioner, où il conseille sur les réactions des parents et des jeunes face aux lois australiennes fixant un âge minimum pour l’usage des réseaux sociaux. Cet article s’appuie sur ses recherches menées à titre indépendant.
Kathryn Backholer est vice-présidente (politique) de la Public Health Association of Australia. Elle reçoit des financements du National Health and Medical Research Council, de l’Australian Research Council, de l’UNICEF, de la Ian Potter Foundation, de la National Heart Foundation, de VicHealth, de la Foundation for Alcohol Research and Education, de QUIT, de la .auDA Foundation ainsi que du Victorian Department of Justice and Community Safety pour des travaux portant sur les effets nocifs de la publicité en ligne sur la santé.
13.02.2026 à 09:23
Inondations : l’aménagement du territoire est-il responsable ?
Luc Aquilina, Professeur en sciences de l’environnement, Université de Rennes 1 - Université de Rennes
Pierre Brigode, Maître de conférences en hydrologie, École normale supérieure de Rennes
Texte intégral (2282 mots)
Les inondations, provoquées par la tempête Nils, qui touchent le sud-ouest de la France, pourraient alimenter à nouveau le débat sur le rôle l’aménagement du territoire dans la survenue de ces événements. Les inondations sont pourtant des phénomènes complexes et le rôle des aménagements reste difficile à estimer.
Depuis plusieurs années, l’Europe est frappée par des inondations majeures aux bilans humains terribles : 243 morts en juillet 2021 en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, 17 morts en mai 2023 en Italie du Nord, 27 morts en septembre 2024 lors de la tempête Boris en Europe Centrale, de l’Allemagne à la Roumanie, et 237 morts en octobre 2024 dans le sud de Valence. Plus près de nous, les inondations de la Vilaine de ce mois de janvier 2026 et celles de l’année dernière ont ravivé pour les habitants le spectre des inondations du passé.
Ces évènements frappent les esprits et font la une des médias, surtout s’ils se déroulent en Europe. Très vite, des causes liées à l’aménagement du territoire sont invoquées. En Espagne, l’extrême droite a condamné les écologistes qui ont prôné l’arasement des barrages. Vérification faite, il ne s’est agi que de la suppression de « barrières » peu élevées et le lien avec les barrages n’est pas attesté. En Bretagne, à l’inverse, suite à la crue de la Vilaine début 2025 et à l’inondation de plusieurs quartiers de Rennes et de Redon, plusieurs coupables ont été rapidement désignés dans les médias. Le changement climatique d’abord, puis le remembrement des territoires ruraux et le drainage des parcelles agricoles qui ont accompagné la révolution verte des années 1960 et 1970 ont été pointés du doigt.
Les scientifiques de l’eau soulignent le rôle des aménagements passés sur les sécheresses et les tensions autour de la ressource en eau. Pour autant, l’attribution des causes à des événements exceptionnels comme les crues intenses s’avère difficile. Faut-il chercher un seul coupable, ou bien plusieurs ? Changement climatique et modification des usages des sols contribuent à la genèse des inondations, mais leurs implications respectives dans ces évènements varient selon le type d’inondation ainsi qu’au cours du temps.
Il est difficile de déterminer les causes des crues
Isoler la part de responsabilité du changement climatique dans la survenue d’un événement climatique extrême est ce qu’on appelle un processus d’attribution. La science de l’attribution, relativement récente, est nécessaire pour quantifier les impacts du changement climatique dans des processus complexes et variables. Un exemple récent est l’étude menée suite aux pluies torrentielles d’octobre 2024 en Espagne, qui a montré que ce type d’épisode pluvieux présente jusqu’à 15 % de précipitations supplémentaires par rapport à un climat sans réchauffement. En d’autres termes, environ une goutte d’eau sur six tombée lors de cet épisode peut être imputée au changement climatique.
Si l’attribution des pluies est aujourd’hui de mieux en mieux maîtrisée, celle des crues reste moins bien déterminée. On confond souvent l’attribution de la pluie et celle de la crue, alors qu’elles ne sont pas équivalentes. Entre le moment où la pluie tombe et celui où la rivière déborde, il se passe beaucoup de choses au niveau du bassin versant : selon le degré d’humidité et la nature du sol et du sous-sol ou bien la manière dont il a été aménagé, il peut agir comme tampon ou accélérer les flux d’eau. Deux bassins versants différents auront des réponses également différentes pour un même volume de pluie, et un même volume de pluie tombant sur un même bassin versant peut avoir des conséquences très différentes selon le moment de l’année. La survenue d’une crue dépend donc de la combinaison de deux dés : la pluie qui tombe sur le bassin versant et la capacité de ce bassin à l’absorber.
Le changement climatique et les aménagements perturbent l’absorption des sols
Les études d’attribution des pluies montrent avec certitude que le réchauffement climatique — et donc les activités humaines qui en sont la cause — intensifient les pluies fortes et les rendent de plus en plus fréquentes. Si nos futurs étés seront plus secs, les hivers seront eux plus humides, notamment dans le nord de la France. Qu’en est-il du deuxième dé, la capacité d’absorption des bassins versants ? Le changement climatique l’affecte également, en modifiant l’humidité des sols au fil des saisons. Mais cette capacité dépend aussi largement des transformations opérées par certaines activités humaines.
C’est le cas par exemple des barrages, conçus pour stocker l’eau lors des saisons humides et qui ont la capacité de tamponner la puissance des crues. Mais d’autres phénomènes sont impliqués, comme l’urbanisation, qui imperméabilise les sols en remplaçant champs et prairies par du béton et de l’asphalte. Ces surfaces imperméables réduisent fortement l’infiltration et favorisent le ruissellement. Même si l’urbanisation reste marginale à l’échelle des grands bassins versants, elle peut jouer un rôle majeur localement, notamment en zones périurbaines, où les petits cours d’eau sont souvent canalisés ou recouverts.
Les aménagements agricoles comptent également. Le remembrement, qui a fait disparaître des milliers de haies et fossés au profit de grandes parcelles plus facilement exploitables pour des machines agricoles, a profondément modifié la circulation de l’eau. En parallèle, d’autres transformations ont réduit la capacité du paysage à retenir l’eau lors des pluies fortes, comme la pose de drains en profondeur dans les sols agricoles qui vise à évacuer l’excédent d’eau des terres trop humides durant l’hiver. La création de digues et de canaux pour limiter l’expansion des rivières, le creusement des cours d’eau et la rectification de leurs berges les ont recalibrées pour les rendre linéaires. Ces différents aménagements ont des effets importants. Ils modifient le cycle de l’eau continental en accélérant globalement les flux vers la mer. Les niveaux des nappes ont déjà été affectés par ces modifications. Dans les vastes marais du Cotentin, nous avons montré que le niveau moyen des nappes a chuté d’environ un mètre depuis 1950, alors que les aménagements des siècles précédents avaient déjà diminué ces niveaux. Le changement climatique va renforcer cette diminution des niveaux de nappe au moins sur une grande partie du territoire hexagonal.
D’un bassin à l’autre, des effets différents
Ces facteurs jouent différemment selon la surface des bassins versants et leur localisation : l’urbanisation a un effet très fort sur les crues des petits bassins versants côtiers de la Côte d’Azur, qui ont une surface inférieure à 10 km2, mais un effet moindre sur le bassin versant de la Vilaine, qui compte 1 400 km2 à Rennes après la confluence avec l’Ille. À l’inverse, les pratiques agricoles ont un effet plus important sur les crues du bassin de la Vilaine que sur ceux de la Côte d’Azur.
Aujourd’hui, il est difficile de quantifier précisément la part relative de ces facteurs dans l’occurrence des crues observées. En amont des cours d’eau, certaines transformations peuvent ralentir la propagation des crues en augmentant des capacités de stockage locales, par exemple dans les sols, les zones humides ou les plaines inondables, tandis qu’en aval, l’accélération des flux et leur addition tendent à dominer. Chacun des aménagements décrits influence la manière dont un bassin versant absorbe ou accélère l’eau, mais l’addition de leurs effets crée une interaction complexe dont nous ne savons pas précisément faire le bilan.
Lors d’événements exceptionnels comme la crue de Valence, ce sont avant tout les volumes de pluie qui déclenchent la crue et ses conséquences, le changement climatique pouvant intensifier ces précipitations. Les aménagements du territoire influencent de manière secondaire la façon dont l’eau s’écoule et se concentre dans les bassins versants. Il n’en reste pas moins que ces deux effets jouent un rôle de plus en plus important dans les événements de moindre ampleur, dont les impacts sont néanmoins importants et dont l’occurrence a déjà augmenté et va encore s’accentuer dans le futur. Pour deux degrés de réchauffement, l’intensité des crues décennales (d’une ampleur observée en moyenne une fois tous les 10 ans) augmentera potentiellement de 10 à 40 % dans l’Hexagone, et celle des crues centennales (observées en moyenne une fois tous les siècles) de plus de 40 %.
Une vie en catastrophes ?
Ces événements ont provoqué des prises de position politique virulentes. Certains, en particulier à droite de l’échiquier politique, ont remis en question les politiques récentes de restauration de l’état naturel des cours d’eau, de protection des zones humides et de destruction des barrages. Elles ont conduit à des appels à la suppression de l’Office français de la biodiversité lors des manifestations agricoles, proposition reprise par le sénateur Laurent Duplomb devant le Sénat le 24 janvier 2024.
Les aménagements les plus récents, défendus par de nombreuses structures territoriales, visent à redonner au cycle de l’eau, et en particulier aux rivières, des espaces plus larges et à recréer ou protéger des zones humides. Tous ces aménagements conduisent à ralentir les flux et donc luttent contre les inondations, tout en préservant la biodiversité à laquelle notre santé est liée. Les zones humides sont par exemple les meilleurs ennemis des moustiques tigres, en permettant le développement de leurs prédateurs. Bien qu’ils exigent de concéder des terres agricoles aux milieux naturels, ces aménagements nourrissent les nappes qui restent le meilleur réservoir pour le stockage de l’eau des saisons humides.
Remettre en question les politiques de recalibration des cours d’eau, de remembrement et de drainage, tout comme l’imperméabilisation des zones urbaines, est une nécessité imposée par l’adaptation au changement climatique. Il s’agit de limiter ou éviter les tensions entre les besoins des activités humaines et les besoins des écosystèmes qui pourraient en faire les frais. Les inondations catastrophiques ne sont qu’en partie liées aux aménagements et ne peuvent pas justifier à elles seules les politiques de retour à l’état naturel des cours d’eau, qui sont en revanche une réponse aux sécheresses estivales à venir. Pour autant, ces inondations majeures sont là pour nous alerter sur les effets du changement climatique. Les étés vont devenir plus secs et les ressources vont manquer, mais les événements extrêmes vont également se multiplier. Une vie en catastrophes nous attend si nous ne transformons pas nos modes de consommation et de production. Tel est le message porté par les inondations. Sera-t-il mieux entendu que les appels des hydrologues ?
Luc Aquilina est co-titulaire de la chaire Eaux et territoires de la fondation de l’Université de Rennes qui reçoit des fonds d’Eau du Bassin Rennais, Rennes Métropole et du Syndicat Mixte Eau 50.
Pierre Brigode a reçu des financements de l'Université de Rennes, du Centre national de la recherche scientifique et de l'Agence nationale de la recherche.
12.02.2026 à 16:13
Fabriquer de l’oxygène avec le sol lunaire : le futur de l’exploration spatiale ?
Jack Robinot, Doctorant en sciences de l'ingénieur, Centre national de la recherche scientifique (CNRS); Université de Perpignan Via Domitia
Alexis Paillet, Chargé de projet vaisseaux spatiaux, Centre national d’études spatiales (CNES)
Stéphane Abanades, Directeur de Recherche, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Sylvain Rodat, Chimiste, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Texte intégral (3232 mots)

Alors que les projets de retour sur la Lune se multiplient, et cette fois-ci pour s’y implanter durablement, comment respirer sur un astre sans atmosphère ? La réponse se trouve peut-être dans la poussière qui recouvre notre satellite.
Une nouvelle course à la Lune se dessine entre les États-Unis et la Chine. Contrairement à il y a cinquante ans, il n’est plus seulement question d’alunir et de repartir, mais bien d’établir une base qui autorise une présence durable et des séjours prolongés à la surface de notre satellite naturel. L’objectif est désormais de se servir de la Lune comme d’un bac à sable pour tester les technologies qui nous permettront de voyager plus loin, notamment vers Mars.
L’une de ces technologies clés est l’in-situ resource utilization (ISRU), c’est-à-dire l’exploitation des ressources disponibles sur place afin de produire les consommables nécessaires aux activités humaines : oxygène, eau, carburants pour les fusées ou matériaux de construction. En produisant directement sur la Lune ce qui est indispensable à la vie et aux opérations, il sera possible de réduire significativement la masse de cargaison à expédier depuis la Terre, réduisant ainsi les coûts logistiques et financiers de l’exploration spatiale. Plutôt que d’importer ces ressources depuis la Terre, il s’agit d’apprendre à vivre sur la Lune.
Décomposer la poussière lunaire pour en extraire de l’oxygène
À l’aube de ce retour durable de l’être humain sur la Lune, l’ISRU s’impose donc comme un pivot stratégique. L’un des défis majeurs est de produire de l’oxygène à partir du régolithe, la couche de sol qui recouvre la Lune, principalement formée de petits fragments de roches et de poussières. La composition du régolithe est complexe. Celui-ci est essentiellement constitué de plusieurs minéraux (plagioclase, pyroxène, olivine) eux-mêmes constitués d’un mélange d’oxydes métalliques, des composés chimiques qui associent de l’oxygène à un autre élément comme du silicium, du fer ou du calcium.
Environ 40 à 45 % de la masse du régolithe est donc composée d’oxygène, ce qui en fait l’élément le plus abondant à la surface de la Lune. L’oxygène est omniprésent, mais il n’existe pas sous forme gazeuse comme dans l’atmosphère terrestre. Pour libérer l’oxygène, il faut briser les liaisons chimiques qui l’attachent aux autres éléments dans les oxydes du sol lunaire.
Une des méthodes envisagées est la pyrolyse, un type de réaction chimique qui permet de décomposer des matériaux grâce à de hautes températures, afin de produire des composés volatils. Appliquée au régolithe, il est possible de le chauffer jusqu’à ce que les oxydes métalliques se vaporisent et se décomposent en oxygène et en métaux.
Sur la Lune, l’énergie thermique serait fournie grâce à la concentration solaire, un procédé qui consiste à utiliser des miroirs ou des lentilles pour focaliser la lumière du Soleil vers une petite zone. Les rayons se rassemblent alors en un faisceau et convergent en un point focal où l’énergie est fortement concentrée, permettant d’atteindre des températures de plusieurs milliers de degrés. Cette méthode prévoit également d’exploiter le vide lunaire, un environnement qui favorise les réactions libérant du gaz. Cela permettra de diminuer la quantité d’énergie nécessaire à la réaction.
Le four solaire, une méthode efficace et peu coûteuse
La Lune a un environnement particulièrement favorable à la pyrolyse solaire. Dépourvue d’atmosphère, la pression à sa surface est extrêmement faible, de l’ordre de 10⁻15 bar. L’absence d’atmosphère offre un second avantage : le rayonnement solaire ne peut pas être absorbé par celle-ci ni bloqué par des nuages. Cela permet d’obtenir des flux solaires concentrés plus élevés que sur Terre. De plus, certaines zones géographiques à son pôle Sud sont exposées à la lumière du Soleil jusqu’à 90 % du temps. Ainsi, en combinant le vide lunaire avec des systèmes de concentration solaire, on peut concevoir un procédé relativement simple, robuste et potentiellement efficace pour extraire de l’oxygène du régolithe.

Au sein du laboratoire Procédés, matériaux, énergie solaire (Promes-CNRS), spécialisé dans les technologies de concentration solaire, nous travaillons à la validation du concept de base de la pyrolyse qui pourra à l’avenir être déployé sur la Lune. Implanté sur le site du grand four solaire d’Odeillo (Pyrénées-Orientales) en Occitanie, le laboratoire dispose d’infrastructures expérimentales uniques au monde vouées à l’étude des procédés hautes températures. Parmi ces équipements figurent notamment des paraboles de deux mètres de diamètre permettant de concentrer 10 000 fois les rayons solaires sur une tache d’environ 2 cm de diamètre et d’atteindre des températures de plus de 3 000 °C.

Cette énergie alimente le réacteur de pyrolyse, une enceinte sous vide conçue pour exposer des échantillons de matériaux qui simulent le régolithe lunaire au flux solaire concentré. Les pastilles de simulant sont placées sur un support en cuivre refroidi, tandis qu’une parabole focalise la lumière du Soleil à l’intérieur du réacteur pour assurer leur chauffage. Une pompe à vide maintient une pression d’environ 10 millibars. Une cellule électrochimique permet de déterminer en continu la concentration d’oxygène dans le réacteur.
L’échantillon est ensuite progressivement chauffé et commence à fondre aux alentours de 1 200 °C. Le régolithe atteint par la suite des températures d’environ 2 000 °C. Dans ces conditions, les oxydes présents dans l’échantillon commencent à se vaporiser et se dissocient pour libérer de l’oxygène.
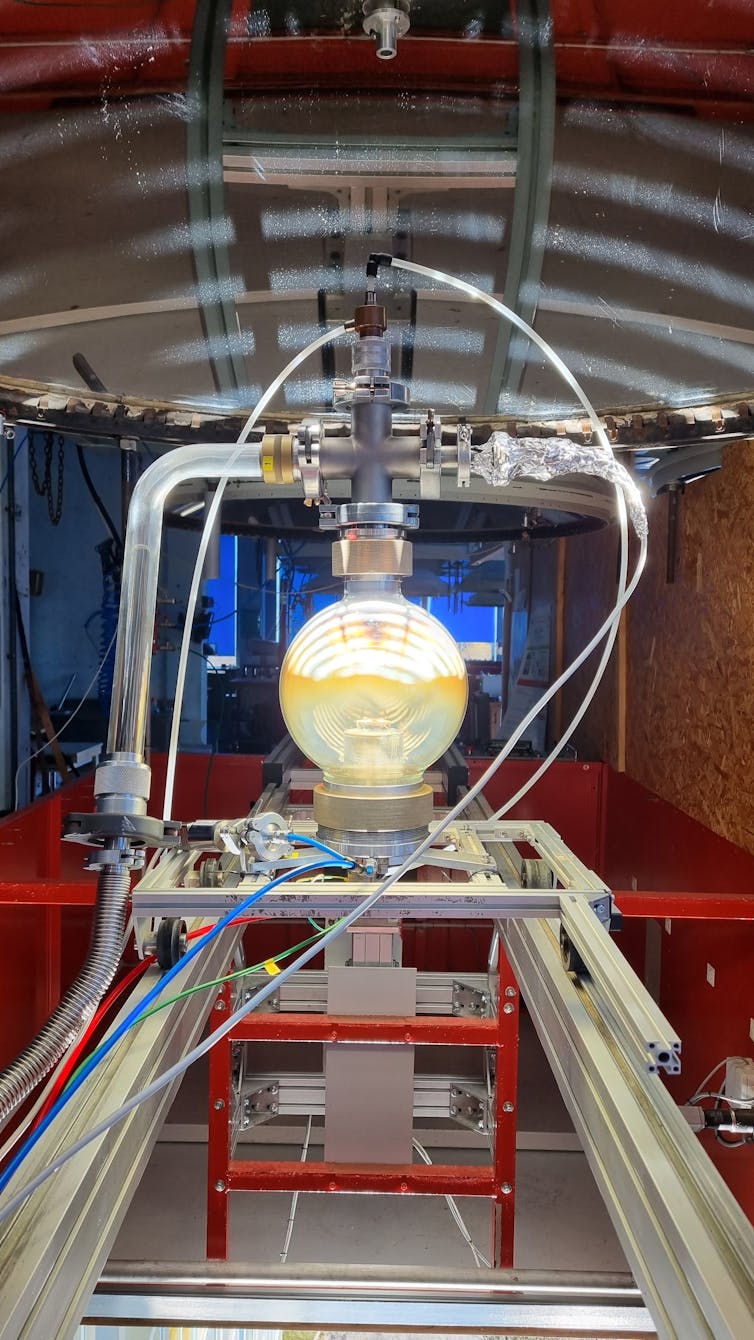
D’autres produits en plus de l’oxygène
Lors des premiers essais, 35 mg d’oxygène ont été extraits à partir d’une pastille de 3,38 g, soit environ 1 % de la masse totale. Cela correspond à 2,5 % de l’oxygène contenu dans le simulant de régolithe. Une fois l’expérience achevée, une bille de verre est obtenue à la place de la pastille de régolithe. La fraction de régolithe qui s’est vaporisée lors de l’expérience se condense sur les parois froides du réacteur sous la forme de composés minéraux. Ces espèces sont collectées afin de les caractériser ensuite et de déterminer leur composition chimique.
Après pyrolyse, la bille de verre formée présente une composition chimique différente de celle du simulant de régolithe initial. Les oxydes volatils, qui se sont échappés lors du processus, y sont moins concentrés, à l’inverse des oxydes non volatils. Les espèces les plus volatiles ont été retrouvées dans les dépôts collectés sur les parois du réacteur, où elles se sont condensées lors de la pyrolyse.
Cette observation suggère qu’il serait aussi possible d’utiliser la pyrolyse comme une méthode pour séparer les oxydes dans le régolithe selon le principe de la distillation. Ces coproduits pourraient être exploités pour la fabrication de structures, d’outils ou de matériaux de construction directement sur la Lune, renforçant ainsi l’autonomie des futures missions lunaires.
Passer de la preuve de concept aux conditions réelles
Ces premiers essais ont permis de déterminer un rendement, mais celui-ci reste faible. Les prochaines étapes de développement viseront à réduire la pression à l’intérieur du réacteur, afin de se rapprocher des conditions lunaires. Une pression réduite devrait permettre de diminuer les températures mises en jeu lors de la pyrolyse, afin de vaporiser intégralement l’échantillon et d’augmenter le rendement.
Par la suite, il sera également pertinent de tester différents types de régolithes, ainsi que les minéraux et oxydes individuels qui les composent, afin de mieux comprendre la chimie des réactions. Le réacteur de pyrolyse se devra de fonctionner en continu afin d’exploiter au mieux le jour lunaire. Le procédé peut encore être optimisé. Un contrôle plus précis de la température permettrait de mieux maîtriser les réactions et d’améliorer leur rendement. Une collecte plus efficace des gaz produits viserait à limiter les pertes d’oxygène. Nous espérons également réduire les pertes thermiques en utilisant un creuset et en l’isolant. Enfin, une meilleure condensation des sous-produits permettrait d’identifier et de valoriser les matériaux formés lors de la pyrolyse en plus de l’oxygène.
L’ensemble du système (réacteur, miroirs et dispositifs de concentration solaire) devra en outre être robuste et fiable, capable de résister aux conditions extrêmes de l’environnement lunaire : poussière abrasive, radiations, fortes variations thermiques… Enfin, l’oxygène généré devra être stocké, purifié pour le séparer d’autres éléments qui peuvent être présents dans le gaz et utilisé. Il faut aussi penser à la logistique d’alimentation du réacteur en régolithe, qu’il s’agisse de son extraction, de son transport ou de son utilisation après traitement.
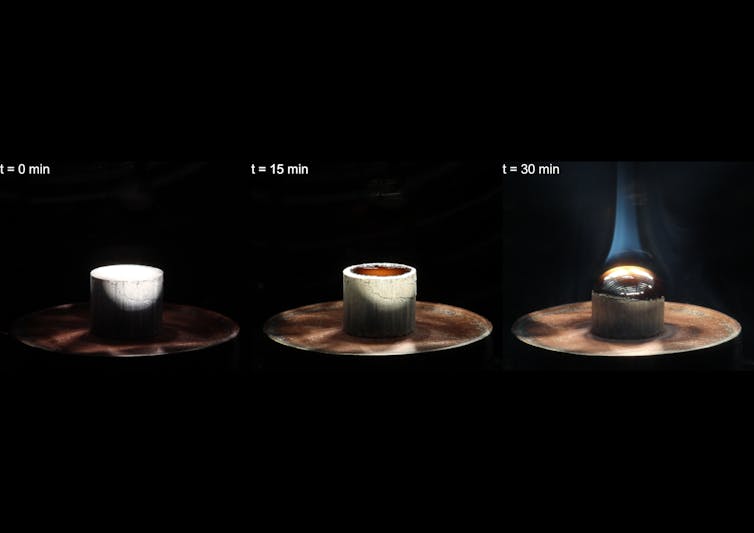
La pyrolyse solaire sous vide est une méthode particulièrement bien adaptée aux conditions lunaires. Elle tire parti du vide naturel de la Lune, demande peu de ressources importées et utilise l’énergie solaire, abondante sur un satellite sans atmosphère. Les tests à Odeillo ont déjà prouvé la faisabilité du concept, mais les rendements doivent encore être améliorés et les défis techniques restent considérables. En produisant localement de l’oxygène et des matériaux, le procédé soutiendrait les futures bases lunaires et réduirait leur dépendance vis-à-vis de la Terre.
Jack Robinot a reçu des financements du CNES et de la région Occitanie.
Sylvain Rodat a reçu des financements de la région Occitanie et un support matériel de l'ESA (Agence spatial européenne) qui a fourni le simulant de régolithe.
Alexis Paillet et Stéphane Abanades ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.
11.02.2026 à 16:22
Des centaines de séismes ont été détectés à proximité du « glacier de l’apocalypse » en Antarctique
Thanh-Son Pham, ARC DECRA Fellow in Geophysics, Australian National University
Texte intégral (1459 mots)
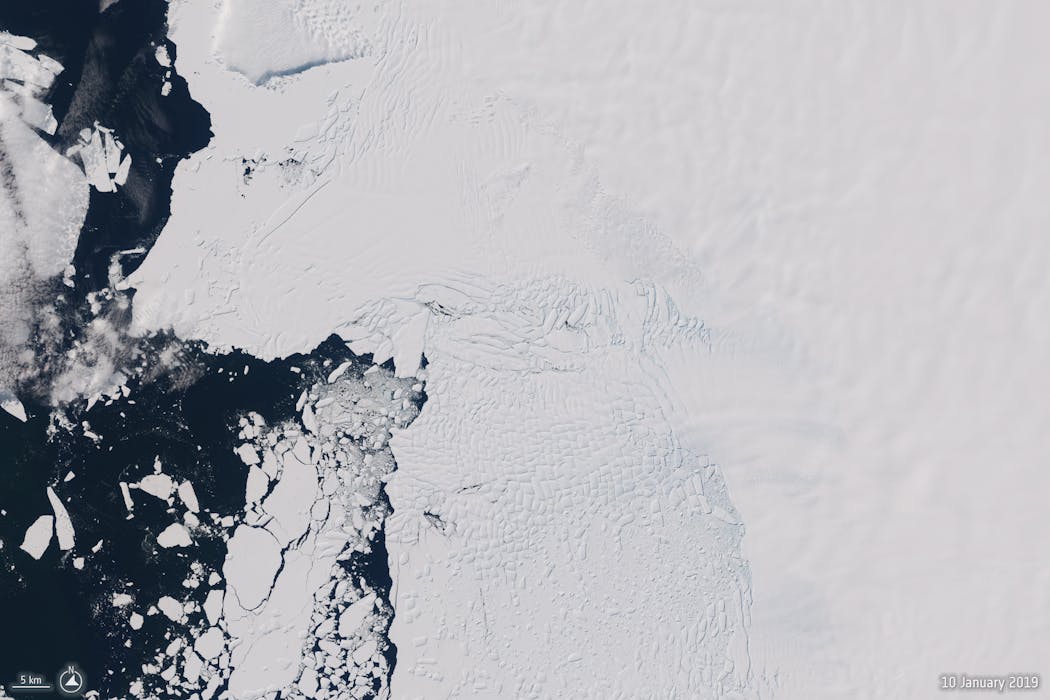
Grâce à l’utilisation de stations sismiques locales, des chercheurs ont identifié des centaines de séismes glaciaires au glacier de Thwaites, jusqu’ici passés inaperçus. Ils permettent de suivre l’activité d’une zone critique pour la stabilité antarctique.
Les séismes glaciaires sont un type particulier de tremblement de terre dans les régions froides et glacées. Découverts pour la première fois dans l’hémisphère Nord il y a plus de vingt ans, ils se produisent lorsque d’énormes blocs de glace tombent des glaciers dans la mer, générant des vibrations qui se propagent ensuite dans le sol sous le glacier et au-delà.
Jusqu’à présent, seuls très peu de ces séismes provoqués par la chute de blocs de glace avaient été détectés en Antarctique. Dans une nouvelle étude publiée dans Geophysical Research Letters, je présente des preuves de centaines d’occurrences en Antarctique entre 2010 et 2023, principalement à l’extrémité océanique du glacier Thwaites – le fameux « glacier de l’Apocalypse », qui pourrait provoquer une montée rapide du niveau de la mer en cas d’effondrement.
À lire aussi : Face à la fonte des glaces de l’Antarctique, le niveau de la mer n’augmente pas au même rythme partout
Une découverte récente
Un séisme glaciaire se produit lorsque de hauts icebergs effilés se détachent de l’extrémité d’un glacier et tombent dans l’océan.
Lorsque ces blocs basculent, ils heurtent violemment le glacier principal. Ce choc génère de fortes vibrations mécaniques du sol, ou ondes sismiques, qui se propagent sur des milliers de kilomètres depuis leur origine.
Ce qui rend les séismes glaciaires uniques, c’est qu’ils ne génèrent aucune onde sismique à haute fréquence. Et comme ces ondes sont essentielles pour détecter et localiser les sources sismiques classiques, comme les tremblements de terre, les volcans ou les explosions nucléaires, les séismes glaciaires n’ont été découverts que relativement récemment, alors que d’autres sources sismiques sont, elles, analysées quotidiennement depuis plusieurs décennies.
Variations saisonnières
La plupart des séismes glaciaires détectés jusqu’à présent ont été localisés près des extrémités des glaciers au Groenland, la plus grande calotte glaciaire de l’hémisphère nord.
Ils présentent des magnitudes relativement élevées, dont les plus importantes sont comparables à celles des séismes provoqués par les essais nucléaires menés par la Corée du Nord au cours des deux dernières décennies. Ces magnitudes assez importantes permettent de suivre ces séismes glaciaires avec un réseau sismique international, opérationnel en continu.
Les événements groenlandais sont saisonniers. Ils surviennent plus fréquemment à la fin de l’été. Ils sont également devenus plus fréquents au cours des dernières décennies. Ces tendances pourraient être liées à un réchauffement climatique plus rapide dans les régions polaires.
En Antarctique, des preuves difficiles à obtenir
Bien que l’Antarctique abrite la plus grande calotte glaciaire de la planète, les preuves directes de séismes glaciaires causés par le basculement d’icebergs (on parle de vêlage) sont difficiles à détecter.
La plupart des tentatives précédentes reposaient sur le réseau mondial de détecteurs sismiques – qui pourraient ne pas être suffisamment sensible si les séismes glaciaires antarctiques sont de magnitude beaucoup plus faible que ceux du Groenland.
Dans ma nouvelle étude, j’ai utilisé des stations sismiques situées en Antarctique. J’ai détecté ainsi plus de 360 événements sismiques glaciaires. La plupart ne figuraient pas dans les catalogues de séismes.
Ces événements sont situés dans deux zones, près des glaciers de Thwaites et de Pine Island. Ce sont les deux principales sources de la montée du niveau de la mer en provenance de l’Antarctique.
Les séismes du glacier de l’Apocalypse
Le glacier de Thwaites est parfois surnommé « glacier de l’Apocalypse », car, s’il venait à s’effondrer complètement, il ferait monter le niveau mondial des mers de 3 mètres – et parce qu’il est susceptible de se désintégrer rapidement.
Environ les deux tiers des événements que j’ai détectés – 245 sur 362 – se situaient près de l’extrémité du glacier en contact avec l’océan. La plupart sont probablement des séismes glaciaires causés par le basculement d’icebergs.
À la différence de ce qui se passe au Groenland, le principal facteur à l’origine de ces événements ne semble pas être la variation annuelle des températures de l’air.
La période la plus prolifique pour les séismes glaciaires à Thwaites, entre 2018 et 2020, coïncide plutôt avec une accélération de la progression de la langue glaciaire vers la mer. Cette accélération, confirmée de manière indépendante par des observations satellites, pourrait être liée aux conditions océaniques, mais leur effet est encore mal compris.
Ces nouveaux résultats suggèrent donc que l’état de l’océan peut avoir un impact à court terme sur la stabilité des glaciers qui terminent dans la mer. Cela mérite d’être étudié plus avant pour évaluer la contribution potentielle du glacier à la hausse future du niveau de la mer.
À lire aussi : Une nouvelle méthode pour évaluer l’élévation du niveau de la mer
Le deuxième plus grand groupe de séismes glaciaires antarctiques que j’ai observés se trouve près du glacier de Pine Island. Mais ces séismes étant situés à 60–80 kilomètres du rivage, il est peu probable qu’ils aient été provoqués par le basculement d’icebergs.
Ces événements demeurent énigmatiques et nécessitent des recherches complémentaires.
Perspectives pour la recherche sur les séismes glaciaires en Antarctique
La détection de séismes glaciaires liés au vêlage d’icebergs sur le glacier de Thwaites pourrait contribuer à avancer sur plusieurs questions scientifiques importantes. Parmi elles, figure l’interrogation fondamentale sur l’instabilité potentielle du glacier de Thwaites, en lien avec l’interaction entre océan, glace et substrat rocheux à l’endroit précis où il rejoint la mer.
Mieux comprendre ces mécanismes est essentiel pour réduire les grandes incertitudes sur les projections de montée du niveau de la mer au cours des prochains siècles.
Thanh-Son Pham a reçu des financements de l'Australian Research Council.
10.02.2026 à 14:11
Les chiens et les chats transportent les vers plats envahissants de jardin à jardin
Jean-Lou Justine, Professeur, UMR ISYEB (Institut de Systématique, Évolution, Biodiversité), Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)
Leigh Winsor, Adjunct Senior Research Fellow, James Cook University
Texte intégral (1259 mots)
Les chiens et les chats domestiques peuvent transporter les vers plats (plathelminthes) collés sur leur pelage. Sans le vouloir, ils contribuent ainsi à la propagation de ces espèces exotiques envahissantes. Notre travail vient d’être publié dans la revue scientifique PeerJ.
Au niveau mondial, les espèces exotiques intrusives représentent un des dangers majeurs pour la biodiversité. Il est frappant de découvrir que les chiens et les chats, nos compagnons du quotidien, participent de manière involontaire à l’envahissement des jardins par une espèce potentiellement dangereuse pour la biodiversité.
Comment avons-nous fait cette découverte ?
Nous menons un projet de sciences participatives sur les invasions de vers plats.
Nous avons été interpellés par des courriels envoyés par des particuliers signalant la présence de vers collés au pelage de chiens et de chats. Nous avons alors réexaminé plus de 6 000 messages reçus en douze ans et avons constaté que ces observations étaient loin d’être anecdotiques : elles représentaient environ 15 % des signalements.
Fait remarquable, parmi la dizaine d’espèces de vers plats exotiques introduits en France, une seule était concernée : Caenoplana variegata, une espèce venue d’Australie dont le régime alimentaire est composé d’arthropodes (cloportes, insectes, araignées).

En quoi cette découverte est-elle importante ?
On sait depuis longtemps que les plathelminthes (vers plats) exotiques sont transportés de leur pays d’origine vers l’Europe par des moyens liés aux activités humaines : conteneurs de plantes acheminés par bateau, camions livrant ensuite les jardineries, puis transport en voiture jusqu’aux jardins.
Ce qu’on ne comprenait pas bien, c’est comment les vers plats, qui se déplacent très lentement, pouvaient ensuite envahir les jardins aux alentours. Le mécanisme mis en évidence est pourtant simple : un chien (ou un chat) se roule dans l’herbe, un ver se colle sur le pelage, et l’animal va le déposer un peu plus loin. Dans certains cas, il le ramène même chez lui, ce qui permet aux propriétaires de le remarquer.
Par ailleurs, il est surprenant de constater qu’une seule espèce est concernée en France, alors qu’elle n’est pas la plus abondante. C’est Obama nungara qui est l’espèce la plus répandue, tant en nombre de communes envahies qu’en nombre de vers dans un jardin, mais aucun signalement de transport par animal n’a été reçu pour cette espèce.
Cette différence s’explique par leur régime alimentaire. Obama nungara se nourrit de vers de terre et d’escargots, tandis que Caenoplana variegata consomme des arthropodes, produisant un mucus très abondant et collant qui piège ses proies. Ce mucus peut adhérer aux poils des animaux (ou à une chaussure ou un pantalon, d’ailleurs). De plus, Caenoplana variegata se reproduit par clonage et n’a donc pas besoin de partenaire sexuel : un seul ver transporté peut infester un jardin entier.
Nous avons alors tenté d’évaluer quelles distances parcourent les 10 millions de chats et les 16 millions de chiens de France chaque année. À partir des informations existantes sur les trajets quotidiens des chats et des chiens, nous avons abouti à une estimation spectaculaire : des milliards de kilomètres au total par an, ce qui représente plusieurs fois la distance de la Terre au Soleil ! Même si une petite fraction des animaux domestiques transporte des vers, cela représente un nombre énorme d’occasions de transporter ces espèces envahissantes.
Un point à clarifier est qu’il ne s’agit pas de parasitisme, mais d’un phénomène qui s’appelle « phorésie ». C’est un mécanisme bien connu dans la nature, en particulier chez des plantes qui ont des graines collantes ou épineuses, qui s’accrochent aux poils des animaux et tombent un peu plus loin. Mais ici, c’est un animal collant qui utilise ce processus pour se propager rapidement.
Quelles sont les suites de ces travaux ?
Nous espérons que cette découverte va stimuler les observations et nous attendons de nouveaux signalements du même genre. D’autre part, nos résultats publiés concernent la France, pour laquelle les sciences participatives ont fourni énormément d’informations, mais quelques observations suggèrent que le même phénomène existe aussi dans d’autres pays, mais avec d’autres espèces de vers plats.
Il est désormais nécessaire d’étendre ces recherches à l’échelle internationale, afin de mieux comprendre l’ampleur de ce mode de dispersion et les espèces concernées.
Tout savoir en trois minutes sur des résultats récents de recherches commentés et contextualisés par les chercheuses et les chercheurs qui les ont menées, c’est le principe de nos « Research Briefs ». Un format à retrouver ici.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
09.02.2026 à 16:00
Soixante ans après Astérix, Idefix® se lance à son tour dans la conquête spatiale
Julien Baroukh, Chef de projet du rover Idefix pour la mission MMX, Centre national d’études spatiales (CNES)
Texte intégral (2118 mots)
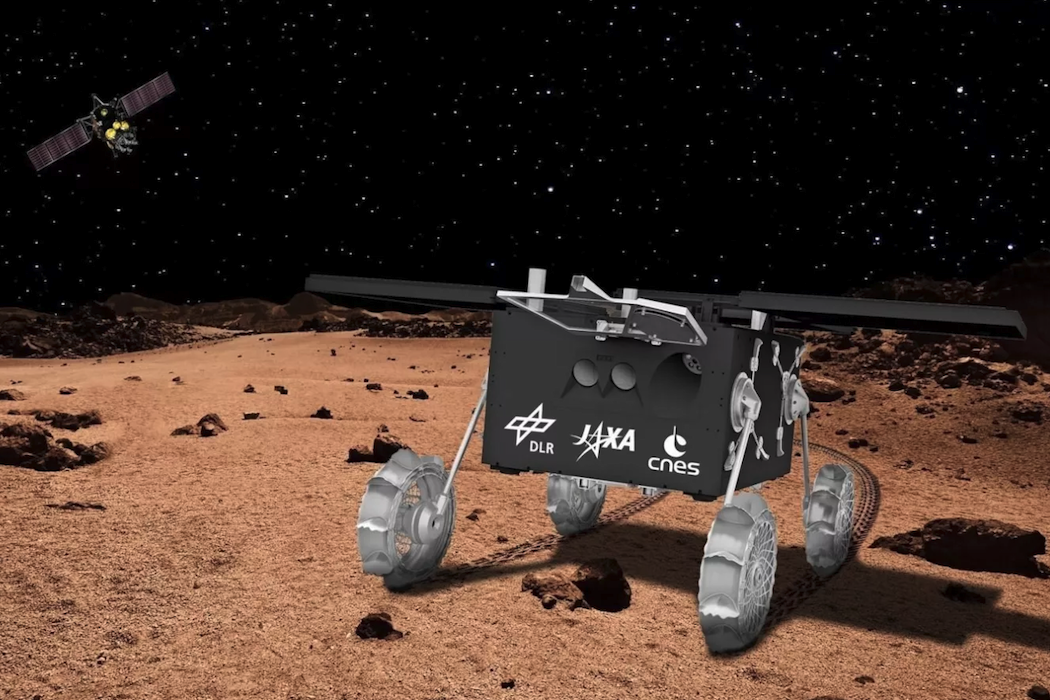
Cette année, une mission internationale menée par le Japon va décoller en direction des lunes de Mars. Pourquoi se pencher sur ces corps célestes ? Quels sont les défis à relever pour faire de la mission un succès ? Le chef de projet côté français nous emmène en coulisse.
Les lunes de Mars, Phobos et Deimos, intriguent : très petites et proches de Mars, les modèles scientifiques n’arrivent pas à déterminer d’où elles viennent. Sont-elles le résultat d’un impact géant sur la planète rouge ? Ou bien sont-elles des astéroïdes capturés par la gravité de cette dernière ? Ont-elles évolué depuis leur formation ? Répondre à ces questions permettra d’améliorer la compréhension de la formation et de l’évolution du système solaire, avec, à la clé, la question de l’origine de l’eau sur Mars… et sur la Terre.
En octobre 2026, la mission japonaise MMX (pour Martian Moons eXploration) décollera de Tanegashima, au Japon, vers la lune martienne Phobos. À son bord, le premier rover (ou « astromobile ») de conception et fabrication franco-allemande, appelé Idefix®, un petit robot sur roues conçu pour explorer la surface de Phobos. Ainsi, soixante ans après le décollage du premier satellite français A1, surnommé Astérix, à bord de la fusée française Diamant depuis la base spatiale d’Hammaguir en Algérie – et qui faisait de la France la troisième puissance spatiale, c’est son fidèle compagnon Idefix® qui s’élancera à son tour vers l’espace, célébrant la coopération internationale dans l’exploration spatiale.
Une mission pour étudier Phobos, une des lunes de Mars
Déterminer l’origine des deux lunes martiennes est l’objectif que s’est fixé l’agence spatiale japonaise, la JAXA. Pour cela, elle a imaginé et mis sur pied la mission MMX en coopération avec plusieurs agences internationales. Elle ira étudier Phobos et Deimos sur place : depuis l’orbite d’abord, au moyen de plusieurs instruments scientifiques, puis en se posant à la surface de Phobos pour y collecter des échantillons, qui seront renvoyés vers la Terre, avec un retour prévu en 2031.
Le Cnes, l’agence spatiale française, contribue à plusieurs titres à cette extraordinaire aventure. Tout d’abord avec son expertise sur les trajectoires planétaires : ses équipes participeront à la validation des calculs de leurs homologues japonais. Ensuite avec la fourniture d’un instrument scientifique, le spectromètre imageur MIRS, qui permettra d’observer Phobos et Deimos (et aussi l’atmosphère de Mars) dans l’infrarouge. Et enfin avec la mise à disposition du petit rover Idefix®, conçu en collaboration avec l’agence spatiale allemande, le DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt), pour explorer la surface de Phobos pendant au minimum cent jours.
Un casse-tête d’ingénierie
Les challenges à relever pour Idefix® sont nombreux, car explorer la surface de Phobos est un véritable défi : il n’y a pas d’atmosphère, les températures sont extrêmes, de – 200 °C la nuit à + 60 °C le jour, et la gravité y est très faible (environ 2 000 fois moins que sur Terre) et varie du simple au double selon le lieu où l’on se trouve.
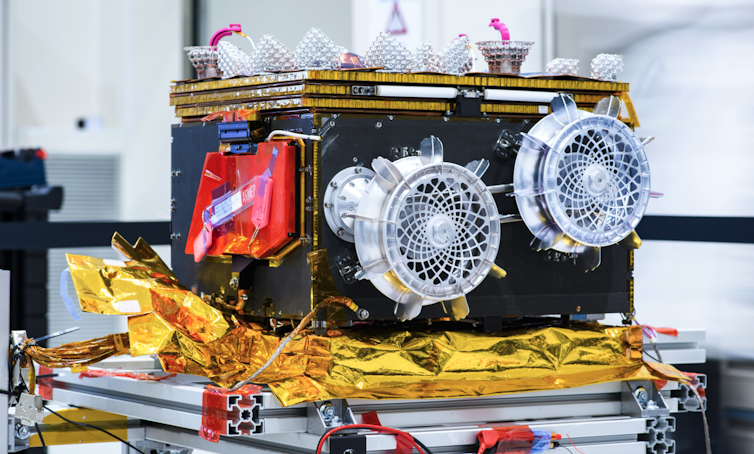
Un vrai casse-tête que les équipes d’ingénieurs ont dû résoudre en plus des contraintes techniques très fortes inhérentes aux projets spatiaux, telles que la masse allouée, la puissance électrique disponible ou encore l’encombrement très réduits. Le résultat est un rover de moins de 25 kilogrammes, de 45 centimètres par 40 centimètres par 35 centimètres – environ la taille d’un micro-onde – avec quatre roues et alimenté par quatre petits panneaux solaires d’une puissance max d’environ 15 watts chacun.
Les objectifs de mission assignés à Idefix® sont triples.
Tout d’abord, Idefix® est un éclaireur. Il se posera le premier sur le sol jusqu’ici inconnu de Phobos et permettra de mieux caractériser son état et son comportement, avant que la sonde MMX atterrisse à son tour pour y recueillir des échantillons et les rapporter sur Terre. En effet, la très faible gravité de Phobos rend le régolithe, cette couche de sable et de gravier à la surface, très imprévisible : sable mouvant ? ou bien croûte parfaitement rigide ? La sonde MMX ne veut pas le découvrir lors de son propre atterrissage, et c’est donc Idefix® qui prendra les risques à sa place.
Ensuite, Idefix® est un démonstrateur technologique, et ce, à plusieurs titres. Il sera le premier objet à rouler sur un corps céleste avec une gravité aussi faible (milligravité), ouvrant ainsi la voie à une nouvelle méthode d’exploration spatiale. Il démontrera les capacités de navigation autonome fondée sur la vision, permettant d’étendre les rayons d’action de telles explorations. Enfin, il testera de nouvelles technologies avioniques (ordinateur de bord, système de communication, etc.) issues des nanosatellites d’observation de la Terre, mais dans un cadre interplanétaire.
Enfin, Idefix® est un explorateur scientifique in situ équipé de plusieurs instruments : quatre caméras dans le domaine visible, un radiomètre et un spectromètre à effet Raman, qui pourront bénéficier de la capacité du rover à se mouvoir pour étudier plusieurs zones.
Explorer la surface de Phobos grâce à quatre instruments, en se déplaçant
En explorant des zones non perturbées de la surface de Phobos, Idefix® déterminera les propriétés physiques du matériau de surface et caractérisera l’homogénéité de la surface dans une plage allant de 0,1 millimètre à plusieurs dizaines de mètres. Ainsi, Idefix® apportera un éclairage unique, une passerelle entre les études menées à distances depuis l’orbite par la sonde et l’analyse des échantillons qu’elle rapportera sur Terre.
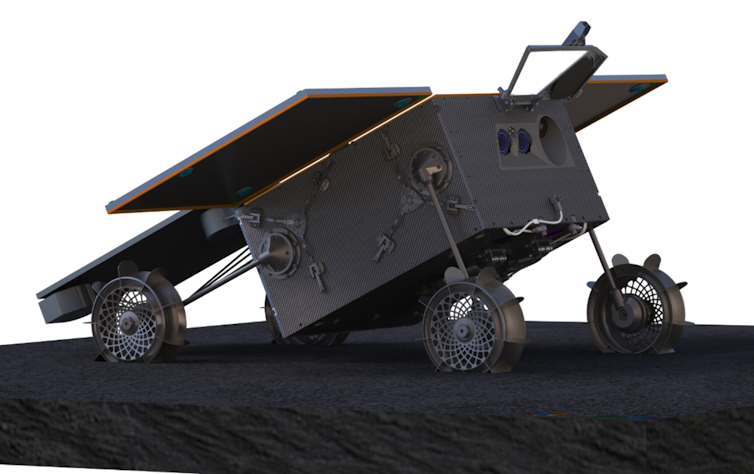
Deux des caméras sont situées à l’avant du rover, les navcams. Elles sont en premier lieu conçues pour le pilotage du rover en permettant de reconstituer le terrain devant Idefix® en trois dimensions. Elles offriront des informations de contexte scientifique aux autres instruments du rover, et leur résolution (4 mégapixels) permettra aussi de conduire des études géomorphologiques de la surface de Phobos.
À côté des navcams, le radiomètre miniRAD étudiera les propriétés thermiques du régolithe et des roches à la surface de Phobos, en mesurant leur rayonnement infrarouge. À l’aide de modèles mathématiques, ces mesures permettront de déterminer des éléments clés de minéralogie, comme l’inertie thermique de la surface, la porosité et l’émissivité du régolithe ou des roches étudiées, apportant ainsi un éclairage sur les processus géologiques à l’œuvre à la surface de Phobos.
Les wheelcams observeront chacune le mouvement des roues du rover et leur interaction avec le régolithe. On pourra en tirer des informations sur les propriétés mécaniques et dynamiques de la surface et aussi, grâce à des LED, sur la composition des grains.
Enfin un spectromètre Raman, orienté vers le sol, permettra de conduire des analyses minéralogiques de la surface de Phobos. Sa plage spectrale permettra de détecter une grande variété de minéraux.
Mais avant même d’explorer la surface de Phobos, le rover Idefix® va vivre des aventures mouvementées. Tout d’abord, le lancement en lui-même est toujours un moment critique. Puis Idefix® devra passer un peu plus de deux ans accroché à la sonde, soumis aux radiations, au vide spatial et aux variations extrêmes de températures. Enfin, il lui faudra survivre à la phase très critique d’atterrissage en terre inconnue.
Julien Baroukh ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
08.02.2026 à 14:16
Des grains de sable prouvent que ce sont les humains – et non les glaciers – qui ont transporté les pierres de Stonehenge
Anthony Clarke, Research Associate, School of Earth and Planetary Sciences, Curtin University
Chris Kirkland, Professor of Geochronology, Curtin University
Texte intégral (1420 mots)

Stonehenge n’a pas été façonné par les glaciers. Grâce à l’analyse fine des grains de sable, une étude révèle que les pierres les plus lointaines ont été choisies avec soin et acheminées par nos ancêtres, ajoutant une pièce décisive à l’enquête sur les origines du monument.
Demandez comment Stonehenge a été construit et l’on vous parlera de traîneaux, de cordages, de bateaux et d’une impressionnante détermination humaine pour acheminer des pierres depuis toute la Grande-Bretagne jusqu’à la plaine de Salisbury, dans le sud-ouest de l’Angleterre. D’autres évoqueront des géants, des sorciers ou même le concours d’extraterrestres pour expliquer le transport de ces blocs, dont certains proviennent du Pays de Galles et d’Écosse.
Mais une autre hypothèse existe : et si la nature elle-même avait assuré l’essentiel du travail ? Selon cette piste, d’immenses glaciers qui recouvraient autrefois la Grande-Bretagne auraient transporté les « pierres bleues » et la « pierre d’Autel » jusqu’au sud de l’Angleterre sous forme de blocs erratiques, des roches déplacées par la glace, puis abandonnées sur la plaine de Salisbury, prêtes à être utilisées par les bâtisseurs de Stonehenge.
Cette hypothèse, connue sous le nom de théorie du transport glaciaire, revient régulièrement dans des documentaires et des discussions en ligne. Mais elle n’avait encore jamais été mise à l’épreuve à l’aide des techniques géologiques modernes.
Notre nouvelle étude, publiée le 21 janvier dans Communications Earth and Environment, apporte pour la première fois des preuves claires montrant que des matériaux glaciaires n’ont jamais atteint cette région. Elle démontre ainsi que les pierres ne sont pas arrivées par un transport naturel lié aux glaces.
Si des travaux antérieurs avaient déjà jeté le doute sur la théorie du transport glaciaire, notre étude va plus loin en mobilisant des techniques de pointe d’empreinte minéralogique pour retracer l’origine réelle des pierres.
Une empreinte minéralogique sans équivoque
Les vastes calottes glaciaires laissent derrière elles un paysage chaotique, fait d’amas de roches, de substrats striés et de formes de relief sculptées. Or, aux abords de Stonehenge, ces indices caractéristiques sont soit absents, soit ambigus. Et comme l’extension méridionale exacte des calottes glaciaires demeure incertaine, l’hypothèse d’un transport glaciaire reste sujette à controverse.
Dès lors, en l’absence de traces massives et évidentes, peut-on chercher des indices plus discrets, à une échelle bien plus fine ?
Si des glaciers avaient acheminé les pierres depuis le Pays de Galles ou l’Écosse, ils auraient aussi disséminé en chemin des millions de grains minéraux microscopiques, comme le zircon et l’apatite, issus de ces régions.
Lors de leur formation, ces deux minéraux piègent de faibles quantités d’uranium radioactif, qui se transforme progressivement en plomb à un rythme connu. En mesurant les proportions respectives de ces éléments grâce à une méthode appelée datation uranium-plomb (U–Pb), il est possible de déterminer l’âge de chaque grain de zircon ou d’apatite.
Comme les roches de Grande-Bretagne présentent des âges très différents d’une région sur l’autre, l’âge d’un minéral peut renseigner sur son origine. Autrement dit, si des glaciers avaient transporté des pierres jusqu’à Stonehenge, les cours d’eau de la plaine de Salisbury – qui collectent des zircons et des apatites sur un vaste territoire – devraient encore conserver une empreinte minéralogique nette de ce trajet.
À la recherche d’indices minuscules
Pour le vérifier, nous sommes allés sur le terrain et avons prélevé du sable dans les rivières qui entourent Stonehenge. Et les résultats étaient riches d’enseignements.
Malgré l’analyse de plus de sept cents grains de zircon et d’apatite, nous n’en avons trouvé pratiquement aucun d’un âge minéralogique correspondant aux sources galloises des « pierres bleues » ni à l’origine écossaise de la « pierre d’Autel ».
Cependant, l’immense majorité se concentre dans une fourchette étroite, comprise entre 1,7 et 1,1 milliard d’années. De façon éclairante, les âges des zircons des rivières de Salisbury correspondent à ceux de la Formation de Thanet, une vaste nappe de sables peu cimentés qui recouvrait une grande partie du sud de l’Angleterre il y a plusieurs millions d’années, avant d’être érodée.
Cela signifie que les zircons présents aujourd’hui dans les sables fluviaux sont les vestiges de ces anciennes couches de roches sédimentaires, et non des apports récents déposés par les glaciers lors de la dernière période glaciaire, entre 26 000 et 20 000 ans avant notre ère.
L’apatite raconte une histoire différente. Tous les grains datent d’environ 60 millions d’années, à une époque où le sud de l’Angleterre était une mer subtropicale peu profonde. Cet âge ne correspond à aucune roche-source possible en Grande-Bretagne.
En réalité, l’âge des apatites reflète le métamorphisme et le soulèvement provoqués par la formation de montagnes lointaines dans les Alpes européennes, qui ont fait circuler des fluides à travers le calcaire et « réinitialisé » l’horloge uranium-plomb de l’apatite. Autrement dit, la chaleur et les transformations chimiques ont effacé la signature radioactive antérieure du minéral et remis son compteur à zéro.
Comme le zircon, l’apatite n’a pas été apportée par les glaciers : elle est locale et repose sur la plaine de Salisbury depuis des dizaines de millions d’années.
Un nouvel éclairage sur l’histoire de Stonehenge
Stonehenge se situe au carrefour du mythe, de l’ingénierie ancienne et de la géologie sur des temps profonds.
L’étude des âges des grains microscopiques dans les sables fluviaux apporte aujourd’hui une nouvelle pièce à ce puzzle. Elle fournit des preuves supplémentaires que les pierres les plus exotiques du monument n’y sont pas arrivées par hasard, mais ont été choisies et transportées délibérément.
Anthony Clarke a reçu des financements de l'Australian Research Council.
Chris Kirkland ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
06.02.2026 à 17:15
Maladie de Charcot : le mécanisme à l’origine de la forme génétique de la pathologie a été découvert
Franck Martin, Directeur de recherche, Université de Strasbourg
Texte intégral (1363 mots)
Nous avons découvert le mécanisme biologique à l’origine des formes génétiques les plus fréquentes de deux maladies neurodégénératives : la maladie de Charcot et la démence fronto-temporale (DFT). Ces nouvelles connaissances pourraient aider au développement de futures cibles thérapeutiques. Nos résultats viennent d’être publiés dans la revue Science.
La sclérose latérale amyotrophique (SLA), ou maladie de Charcot, est une pathologie neurodégénérative fatale, on estime à trois ans l’espérance de vie à la suite du diagnostic de la maladie, elle touche environ 6 000 personnes en France. La pathologie résulte de la destruction progressive des neurones en charge de commander les muscles, les motoneurones. La mort de ces neurones est à l’origine des troubles moteurs caractéristiques de la maladie (une paralysie complète des muscles des bras, des jambes et de la gorge entraînant une incapacité à marcher, manger, parler ou même respirer qui s’installe progressivement).
Les causes de cette pathologie sont très variées. Près de 10 % des cas de SLA sont d’origine génétique, contre 90 % de cas sporadiques, c’est-à-dire sans cause identifiée. Dans le cas de la forme génétique, la cause la plus fréquente est un défaut au niveau d’un gène spécifique (C9ORF72) qui provoque la synthèse de protéines toxiques qui entraînent la mort des motoneurones.
Ce gène contient des séquences qui sont anormalement répétées et qui portent une information génétique erronée. La traduction de ce défaut génétique conduit à la fabrication de protéines aberrantes (car elles ne devraient pas exister) et neurotoxiques. Notre découverte a permis de comprendre que cette synthèse de protéines toxiques est seule responsable de la pathologie. En bloquant spécifiquement la fabrication de ces dernières, nous avons réussi à enrayer la dégénérescence des motoneurones et de ce fait empêcher l’apparition de la maladie.
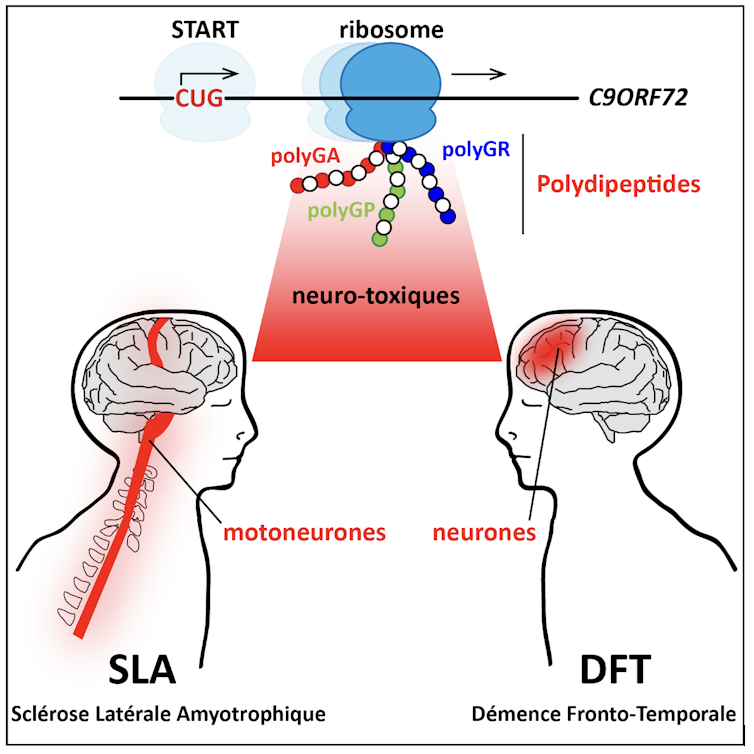
Comment cette découverte a-t-elle pu être réalisée ?
Nous avons dans un premier temps reproduit, in vitro, la synthèse de protéines toxiques responsables de la mort des motoneurones. Ces protéines sont produites par le ribosome des cellules à partir du gène C9ORF72. Dans toutes les cellules, les protéines sont produites par les ribosomes. Ces machineries reconnaissent des sites spécifiques de l’ARN, c’est-à-dire des séquences particulières. Une fois fixé, le ribosome va lire l’ARN et le traduire en protéine. Si le ribosome ne reconnaît pas ce site particulier, la synthèse de protéines est impossible.
Grâce à ces expériences, nous avons pu identifier le site de démarrage du ribosome. En introduisant une simple mutation ponctuelle (remplacement d’une seule base par une autre) dans ce site au niveau du gène C9ORF72, la synthèse des protéines toxiques est totalement éteinte. Nous avons confirmé ces résultats dans des cellules, puis chez des souris.
La suite de notre travail a consisté à utiliser ces connaissances pour corriger le gène C9ORF72 dans des motoneurones de patients SLA (cultivés en laboratoire). Grâce à la technologie des « ciseaux moléculaires » CrispR-Cas9, le site de démarrage du ribosome a été modifié, cette seule modification est suffisante pour éteindre totalement la synthèse toxique dans ces motoneurones et restaurer leur durée de vie.
En quoi cette découverte est-elle importante ?
La SLA, comme la plupart des maladies neurodégénératives, sont des maladies qui sont déclenchées par des causes multifactorielles. Ceci rend le traitement de ces pathologies extrêmement compliqué. Nos recherches ont permis de caractériser le mécanisme moléculaire déclenchant la pathologie et ont conduit à l’identification précise de la cause de la SLA dans la forme la plus fréquente de la maladie, ce qui représente environ 8 % des cas. La découverte du site de démarrage de la synthèse de protéines toxiques pour les motoneurones est primordiale. Ce site de démarrage est maintenant une cible thérapeutique nouvelle pour le développement de nouveaux traitements.
Quelles sont les suites de ces travaux ?
L’objectif de nos recherches à venir est de cibler spécifiquement le site de démarrage de la synthèse de protéines neurotoxiques produites à partir du gène C9ORF72 afin d’empêcher la mort prématurée des motoneurones chez les patients SLA.
Ceci revêt une importance capitale pour les malades atteints de la SLA pour laquelle il n’existe pas de traitements mais aussi d’autres maladies neurodégénératives comme la Démence Frontotemporale (DFT) dont plus de la moitié des formes familiales est également due à ces même répétitions de séquences dans le gène C9ORF72. Nos recherches ouvrent donc de nouvelles pistes de recherche pour la mise au point de traitements thérapeutiques ciblant la synthèse de protéines neurotoxiques chez les patients SLA et DFT.
Tout savoir en trois minutes sur des résultats récents de recherches, commentés et contextualisés par les chercheuses et les chercheurs qui les ont menées, c’est le principe de nos « Research Briefs ». Un format à retrouver ici.
Franck Martin a reçu des financements de l'ANR, la FRM, l'ARSLA, l'AFM Telethon et France Alzheimer
05.02.2026 à 16:35
Le plus ancien vomi fossile d'un animal terrestre nous indique le menu d’un prédateur ayant vécu il y a 290 millions d’années
Arnaud Rebillard, Doctorant en paléontologie, Museum für Naturkunde, Berlin
Texte intégral (1030 mots)
On connaissait les crottes fossiles, appelées coprolithes. Mais une découverte récente montre que les régurgitations peuvent elles aussi se fossiliser. Sur le site paléontologique de Bromacker, en Allemagne, un fossile très particulier a été mis au jour : un régurgitalithe, c’est-à-dire un vomi fossile. Cette régurgitation regroupe des restes osseux appartenant à trois animaux différents et provient d’un prédateur appartenant aux synapsides (groupe d’animaux incluant les mammifères modernes), déjà découvert sur ce site.
Les roches de cette localité, âgées d’environ 290 millions d’années (Permien inférieur), ont déjà livré des plantes, des amphibiens et des reptiles exceptionnellement bien conservés, ainsi que de nombreuses traces de pas. Cette fois, notre équipe a découvert un petit amas d’os partiellement digérés, sans structure ni forme régulière, suggérant qu’il ne s’agissait pas d’un excrément mais bien de restes régurgités par un prédateur. Cette découverte vient d’être publiée dans Scientific Reports.
Comment avons-nous déterminé qu’il s’agissait de vomi fossilisé ?
Ce fossile se présente sous la forme d’un amas osseux compact. Un tel regroupement d’os n’a jamais été découvert à Bromacker, et suggère que ces restes ont été ingérés puis rejetés par un prédateur, soit par défécation ou régurgitation. Dans le cas des coprolithes (crottes fossilisées), les restes osseux sont généralement préservés à l’intérieur d’une matrice sédimentaire d’origine organique (matière fécale) visible, riche en phosphore, issu de l’activité bactérienne liée à la digestion des os. Or, dans le cas de ce spécimen, les restes osseux ne sont pas entourés d’une telle matrice. Une analyse des éléments chimiques par micro-XRF (Spectrométrie de fluorescence des rayons X) a confirmé une quasi-absence de phosphore dans cette matrice. Cette absence de phosphore est caractéristique des régurgitalithes (régurgitations fossilisées) comparé aux coprolithes, fortement concentré en phosphore, dû à un temps de digestion plus long.
Nous avons aussi scanné le fossile en 3D (CT-scan). Cette approche non destructive a permis de reconstituer virtuellement chaque os et de les identifier avec précision. Le régurgitalithe contient notamment :
un maxillaire d’un petit reptile quadrupède (Thuringothyris), avec la plupart des dents encore en position ;
un humérus appartenant à Eudibamus, un reptile bipède ;
un métapode (os du pied ou de la main) d’un diadectide, un herbivore de taille nettement plus grande.
Au total, trois animaux différents et de tailles variées, ont été ingérés puis partiellement régurgités par un même prédateur.
Pourquoi cette découverte est-elle importante ?
Les régurgitalithes sont très rares dans le registre fossile, et aucun n’avait encore été décrit dans un environnement terrestre aussi ancien. Cette découverte représente ainsi le plus ancien vomi fossile de vertébré terrestre connu.
Elle ouvre aussi une fenêtre inédite sur le comportement alimentaire des prédateurs du Permien inférieur. Deux carnivores suffisamment grands pour avoir ingéré ces proies sont connus à Bromacker : Dimetrodon, reconnaissable à sa crête dorsale, et un autre synapside carnivore de taille comparable, Tambacarnifex.
La diversité des restes contenus dans ce régurgitalithe suggère un comportement opportuniste, où ces prédateurs ingéraient tout ce qui était à leur portée. De plus, ce régurgitalithe agit comme une véritable capsule temporelle, renfermant les restes de plusieurs animaux ayant vécu exactement à la même période, peut être même au jour près. Ce spécimen nous permet ainsi de vérifier la coexistence réelle de ces trois animaux.
Quelles suites donner à cette recherche ?
Cette étude nous invite à reconsidérer certaines accumulations d’ossements fossiles, parfois interprétées comme des coprolithes ou des dépôts sédimentaires. Elle montre que les régurgitalithes pourraient être plus fréquents qu’on ne le pensait, mais encore largement sous-identifiés.
À l’avenir, la combinaison de scans 3D, d’analyses chimiques et de comparaisons anatomiques détaillées pourrait permettre de reconnaître d’autres vomis fossiles et de mieux relier ces vestiges aux prédateurs à leur origine. Ces travaux ouvrent de nouvelles perspectives pour reconstruire les réseaux trophiques (ensemble des interactions d’ordre alimentaire entre les êtres vivants d’un écosystème, ndlr) anciens et mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes terrestres il y a près de 300 millions d’années.
Tout savoir en trois minutes sur des résultats récents de recherches commentés et contextualisés par les chercheuses et les chercheurs qui les ont menées, c’est le principe de nos « Research Briefs ». Un format à retrouver ici.
Arnaud Rebillard ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
04.02.2026 à 16:14
Pourrait-on faire fonctionner des data centers dans l’espace ?
David Monniaux, Chercheur en informatique, Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Université Grenoble Alpes (UGA)
Texte intégral (1698 mots)
Différents acteurs de la tech envisagent d’utiliser des satellites pour faire des calculs. En d’autres termes, il s’agit d’envoyer des data centers dans l’espace. Est-ce réaliste ? Un informaticien fait le point.
On parle de l’idée d’installer dans l’espace, en orbite, des data centers destinés à l’intelligence artificielle. Par exemple, en novembre 2025, Google annonçait son projet Suncatcher.
Quel crédit accorder à cette proposition ? Je vais d’abord expliquer les difficultés techniques qui font que cela semble très compliqué et coûteux pour un avantage peu clair, avant de formuler des hypothèses sur les raisons qui motivent ces annonces.
L’intelligence artificielle, c’est beaucoup de calcul
L’apprentissage automatique à grande échelle est au cœur des applications d’intelligences artificielles (IA) génératives (ChatGPT et consorts). Pour cela, il faut beaucoup de processeurs de calcul, qui consomment de l’électricité et rejettent sous forme de chaleur l’énergie ainsi consommée. Sur Terre, un grand data center de calculs d’intelligence artificielle peut consommer 100 mégawatts (MW) et au-delà ; on a même projeté la construction de data centers à 1 000 MW.
Dans l’espace, du point de vue technique, se posent alors quatre problèmes :
les composants électroniques sont irradiés par les rayons cosmiques, ce qui peut causer des pannes ;
il faut produire de l’électricité ;
il faut évacuer la chaleur produite ;
les installations ne sont pas aisément accessibles pour intervenir.
Les radiations perturbent les composants électroniques
Récemment, un Airbus A320 a fait une embardée dans le ciel, car son informatique de commande avait été touchée par des rayons cosmiques. En effet, dans l’espace et, dans une moindre mesure, en altitude (les avions de ligne volent à une dizaine de kilomètres d’altitude), l’électronique est soumise à un rude régime.
Les rayonnements cosmiques peuvent au pire détruire certains composants, au mieux perturber temporairement leur fonctionnement. Pour cette raison, les fournisseurs conçoivent pour équiper les engins spatiaux des processeurs spéciaux résistant aux rayonnements, par exemple le LEON et le NOEL-V, mais ceux-ci ont des performances de calcul modestes (par exemple, le NOEL-V, pourtant moderne, est environ dix fois plus lent qu’un seul cœur de mon ordinateur portable, qui en comporte 12). Si l’on utilise dans l’espace des composants destinés à des applications terrestres conventionnelles, les radiations peuvent provoquer des pannes qui nécessitent des redémarrages de chaque processeur, allant d’une fois toutes les quelques semaines à plusieurs fois par jour, suivant les conditions d’utilisation, d'autant plus fréquemment que le processeur est gravé finement (haute performance).
Produire suffisamment d’électricité
Les géants de la tech parlent actuellement de construire des data centers terrestres consommant de l’ordre de 1 000 MW. À titre de comparaison, les réacteurs de centrales nucléaires françaises ont des puissances électriques nominales (ce qu’elles peuvent produire à 100 % de leur puissance normale d’utilisation) entre 890 MW et 1 600 MW. En d’autres termes, un tel data center consommerait complètement la puissance d’un des petits réacteurs français.
Or, dans l’espace, pour produire de l’électricité, il faut utiliser des panneaux solaires ou des procédés plus exotiques et peu utilisés – microréacteur nucléaire ou générateur à radioéléments, ces derniers étant utilisés pour des sondes partant vers des régions éloignées du Soleil et où il serait donc difficile d’utiliser des panneaux solaires.
Aujourd’hui, les panneaux solaires de la Station spatiale internationale produisent environ 100 kilowatt (kW) de puissance, autrement dit 1 000 fois moins que ce que consomme un data center de 100 MW. Suivant l’orbite, il peut être nécessaire de gérer les périodes où le satellite passe dans l’ombre de la Terre avec des batteries (qui ont une durée de vie limitée), ou accepter que chaque satellite ne fonctionne qu’une partie du temps, ce qui pose d’autres problèmes.
Évacuer la chaleur
Il peut paraître surprenant, vu le froid de l’espace, qu’il soit difficile d’y évacuer de la chaleur. Sur Terre, nous évacuons la chaleur des data centers directement dans l’air, ou encore via des liquides pour ensuite restituer cette chaleur à l’air via une tour de refroidissement. Dans l’espace, il n’y a pas d’air à qui transférer de la chaleur, que ce soit par conduction ou par convection.
Ainsi, la seule façon d’évacuer de la chaleur dans l’espace est le rayonnement lumineux qu’émet tout objet. Quand un objet est très chaud, comme du fer chauffé à blanc, ce rayonnement est intense (et en lumière visible). En revanche, pour des objets tels qu’un ordinateur en fonctionnement ou un corps humain, ce rayonnement (en lumière infrarouge, invisible aux yeux humains mais visible à l’aide de caméras spéciales), est peu intense. Il faut donc de grandes surfaces de radiateurs pour disperser de la chaleur dans l’espace. Organiser l’évacuation de chaleur n’a rien d’évident dans un satellite…
Des problèmes très terre-à-terre
Venons-en à des problèmes plus pratiques. Quand on a un problème dans un data center sur Terre, on envoie un·e technicien·ne. Dans l’espace, cela impliquerait une mission spatiale. Certes, certaines tâches pourraient être accomplies par des robots, mais on est à des ordres de grandeur de complications par rapport à une maintenance dans un bâtiment terrestre. Or, les panneaux solaires et les autres composants ont une durée de vie limitée. Enfin, communiquer avec un satellite est plus compliqué et offre un moindre débit que d’installer un raccordement fibre optique dans une zone bien desservie sur Terre.
Bien entendu, il y aurait également la question de la masse considérable de matériel à transférer en orbite, celle du coût des lancements et de l’assemblage.
On peut également évoquer la pollution, pour l’observation astronomique, du ciel par le passage de constellations de satellites, ainsi que la pollution des orbites par les débris des satellites détruits.
En résumé, même s’il était éventuellement possible techniquement de faire des calculs d’intelligence artificielle dans un satellite en orbite (ou sur une base lunaire), cela serait à un coût considérable et au prix de grandes difficultés. Dans les propos de ceux qui annoncent des data centers spatiaux, on peine à trouver une bonne raison à tant de complications. Parmi certaines justifications avancées, celle d’échapper dans l’espace aux législations des États.
Pourquoi donc parler de mettre des data centers en orbite ?
La question intéressante, plutôt que de savoir s’il serait possible de faire un centre de calcul IA dans l’espace, est donc de savoir à qui cela profite de parler dans les médias de projets relevant plus de la science-fiction que du développement industriel réaliste. Il est bien entendu périlleux de prétendre identifier les objectifs derrière les actes de communication, mais nous pouvons fournir quelques hypothèses.
L’industrie spatiale états-unienne, notamment SpaceX, nourrit l’idée de l’espace comme dernière frontière, avec en ligne de mire l’installation sur Mars, voire la colonisation de cette planète – qu’importe qu’elle soit froide (- 63 °C en moyenne à l’équateur), à l’atmosphère très ténue, et sans protection contre le rayonnement cosmique, autrement dit très hostile à la vie.
L’industrie de l’intelligence artificielle, quant à elle, nourrit l’idée du dépassement du cerveau humain.
Ces deux industries ont un besoin intense de capitaux – par exemple, OpenAI a une dette de 96 milliards de dollars (81,2 milliards d’euros). Pour les attirer, elles ont besoin de récits qui font rêver. Toutes deux créent la « fear of missing out » (ou FOMO), la peur de passer à côté d’une évolution importante et de devenir obsolètes.
D’ailleurs, cette communication fonctionne. La preuve, j’ai rédigé cet article qui, même si c’est pour expliquer à quel point ces projets sont irréalistes, leur accorde une publicité supplémentaire…
David Monniaux ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
04.02.2026 à 11:26
Pourquoi les pénis humains sont-ils si grands ? Une nouvelle étude sur l’évolution révèle deux raisons principales
Upama Aich, Forrest Research Fellow, Centre for Evolutionary Biology, The University of Western Australia
MIchael Jennions, Emeritus Professor, Evolutionary Biology, Australian National University
Texte intégral (2106 mots)

Comparés à ceux des autres grands singes, les pénis humains sont mystérieusement grands, ce qui suggère qu’ils pourraient servir de signal aux partenaires.
« La taille compte », c'est une phrase assez cliché, mais pour les biologistes de l’évolution, la taille du pénis humain constitue un véritable mystère. Comparé à celui d’autres grands singes, comme les chimpanzés et les gorilles, le pénis humain est plus long et plus épais que ce à quoi on pourrait s’attendre pour un primate de notre taille.
Si la fonction principale du pénis est simplement de transférer le sperme, pourquoi le pénis humain est-il si nettement plus grand que celui de nos plus proches parents ?
Notre nouvelle étude, publiée aujourd’hui dans PLOS Biology révèle qu’un pénis plus grand chez l’être humain remplit deux fonctions supplémentaires : attirer des partenaires et intimider les rivaux.
Pourquoi est-il si proéminent ?
Comprendre pourquoi le corps humain a cette apparence est une question centrale en biologie évolutive. Nous savons déjà que certaines caractéristiques physiques, comme une grande taille ou un torse en forme de V, augmentent l’attrait sexuel d’un homme
En revanche, on sait moins de choses sur l’effet d’un pénis plus grand. Les humains ont marché debout bien avant l’invention des vêtements, ce qui rendait le pénis très visible aux yeux des partenaires et des rivaux pendant une grande partie de notre évolution.
Cette proéminence aurait-elle favorisé la sélection d’une plus grande taille ?
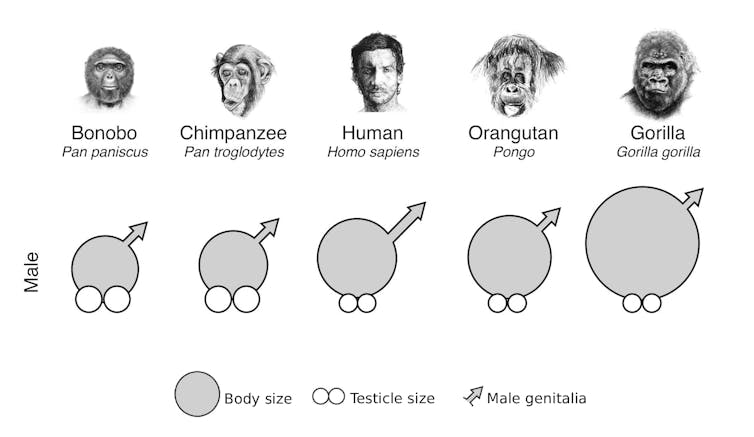
Il y a treize ans, dans une étude qui a fait date, nous avons présenté à des femmes des projections grandeur nature de 343 silhouettes masculines en 3D générées par ordinateur, anatomiquement réalistes, variant selon la taille, le rapport épaules-hanches (silhouette) et la taille du pénis.
Nous avons constaté que les femmes préfèrent généralement les hommes plus grands, avec des épaules plus larges et un pénis plus grand.
Cette étude a fait la une des médias du monde entier, mais elle ne racontait qu’une partie de l’histoire. Dans notre nouvelle étude, nous montrons que les hommes aussi prêtent attention à la taille du pénis.
Une double fonction ?
Chez de nombreuses espèces, les traits plus marqués chez les mâles, comme la crinière du lion ou les bois du cerf remplissent deux fonctions : attirer les femelles et signaler la capacité de combat aux autres mâles. Jusqu’à présent, nous ne savions pas si la taille du pénis humain pouvait elle aussi remplir une telle double fonction.
Dans cette nouvelle étude, nous avons confirmé notre conclusion précédente selon laquelle les femmes trouvent un pénis plus grand plus attirant. Nous avons ensuite cherché à déterminer si les hommes percevaient également un rival doté d’un pénis plus grand comme plus attirant pour les femmes et, pour la première fois, si les hommes considéraient un pénis plus grand comme le signe d’un adversaire plus dangereux en cas de confrontation physique.
Pour répondre à ces questions, nous avons montré à plus de 800 participants les 343 silhouettes variant en taille, en morphologie et en taille de pénis. Les participants ont observé et évalué un sous-ensemble de ces silhouettes, soit en personne sous forme de projections grandeur nature, soit en ligne sur leur propre ordinateur, tablette ou téléphone.
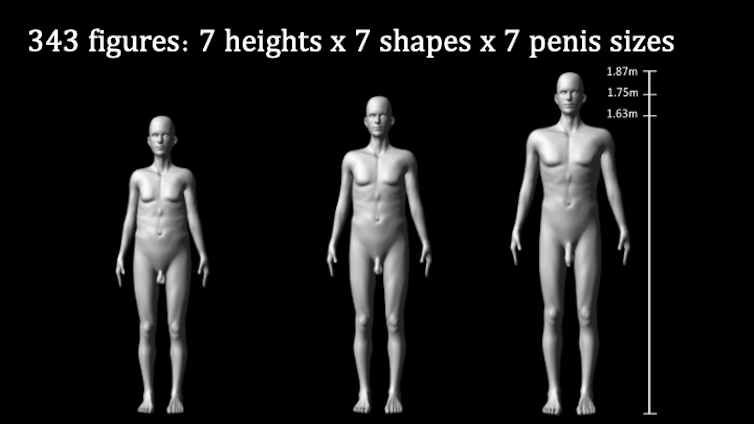
Nous avons demandé aux femmes d’évaluer l’attrait sexuel des personnages, et aux hommes de les évaluer en tant que rivaux potentiels, en indiquant dans quelle mesure chaque personnage leur semblait physiquement menaçant ou sexuellement compétitif.
Ce que nous avons découvert
Pour les femmes, un pénis plus grand, une stature plus élevée et un torse en forme de V augmentaient l’attrait d’un homme. Toutefois, cet effet présentait un rendement décroissant : au-delà d’un certain seuil, une augmentation supplémentaire de la taille du pénis ou de la taille corporelle n’apportait que des bénéfices marginaux.
La véritable révélation est cependant venue des hommes. Ceux-ci percevaient un pénis plus grand comme le signe d’un rival à la fois plus combatif et plus compétitif sur le plan sexuel. Les silhouettes plus grandes et au torse plus en V étaient évaluées de manière similaire.
Cependant, contrairement aux femmes, les hommes classaient systématiquement les individus présentant les traits les plus exagérés comme des concurrents sexuels plus redoutables, ce qui suggère qu’ils ont tendance à surestimer l’attrait de ces caractéristiques pour les femmes.
Nous avons été frappés par la cohérence de nos résultats. Les évaluations des différentes silhouettes ont conduit à des conclusions très similaires, que les participants aient vu les projections grandeur nature en personne ou les aient observées sur un écran plus petit en ligne.
Jugement instantané – avec des limites
Il est important de rappeler que le pénis humain a avant tout évolué pour le transfert du sperme. Néanmoins, nos résultats montrent qu’il fonctionne également comme un signal biologique.
Nous disposons désormais de preuves indiquant que l’évolution de la taille du pénis pourrait avoir été en partie guidée par les préférences sexuelles des femmes et par son rôle de signal de capacité physique entre hommes.
Il convient toutefois de noter que l’effet de la taille du pénis sur l’attractivité était quatre à sept fois plus important que son effet en tant que signal de capacité de combat. Cela suggère que l’augmentation de la taille du pénis chez l’homme a évolué davantage en réponse à son rôle d’ornement sexuel destiné à attirer les femmes qu’en tant que symbole de statut social pour les hommes, bien qu’il remplisse effectivement ces deux fonctions.
Fait intéressant, notre étude a également mis en évidence une particularité psychologique. Nous avons mesuré la rapidité avec laquelle les participants évaluaient les silhouettes. Ceux-ci étaient nettement plus rapides pour juger les silhouettes présentant un pénis plus petit, une taille plus réduite et un haut du corps moins en forme de V. Cette rapidité suggère que ces traits sont évalués inconsciemment, presque instantanément, comme moins attirants sexuellement ou moins menaçants physiquement.
Il existe bien sûr des limites à ce que révèle notre expérience. Nous avons fait varier la taille corporelle, la taille du pénis et la morphologie, mais dans la réalité, des caractéristiques telles que les traits du visage et la personnalité jouent également un rôle important dans la manière dont nous évaluons les autres. Il reste à déterminer comment ces facteurs interagissent entre eux.
Enfin, bien que nos conclusions soient valables pour des hommes et des femmes issus de différentes origines ethniques, nous reconnaissons que les normes culturelles de la masculinité varient à travers le monde et évoluent au fil du temps.
Upama Aich a reçu des financements de la Forrest Research Foundation pour travailler à l'Université d'Australie occidentale et a reçu une bourse de recherche de la Monash University pour mener cette étude.
MIchael Jennions ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Time [Fr]
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- L'Autre Quotidien
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- Gauche.Media
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
