14.02.2026 à 14:57
La Chine se réarme à marche forcée, mais peut-elle vraiment rivaliser ?
Laurent Vilaine, Docteur en sciences de gestion, ancien officier, enseignant en géopolitique à ESDES Business School, ESDES - UCLy (Lyon Catholic University)
Texte intégral (2378 mots)
La Chine se réarme massivement pour réduire son écart avec les États-Unis et consolider son statut de grande puissance. Son budget de défense augmente régulièrement, finance une modernisation rapide (marine, missiles, nucléaire) et place déjà les dépenses militaires de Pékin au rang des toutes premières mondiales, même si Washington demeure loin en tête de classement. Reste que l’Armée populaire de libération n’a plus mené de guerre majeure depuis le conflit sino‑vietnamien de 1979, si bien que l’on ignore comment elle encaisserait, en conditions réelles, une confrontation longue et coûteuse, par exemple autour de Taïwan.
Le réarmement chinois répond à une logique assez claire : il s’agit de rattraper les États-Unis dans la course au statut de première puissance mondiale et de se doter des moyens de reconquérir Taïwan dans les années à venir. Pékin veut dissuader, contraindre et se hisser au rang de superpuissance complète, non seulement économique et normative, mais également militaire. La montée en puissance est impressionnante. Les usines chinoises produisent avions, véhicules, bâtiments de guerre et missiles, entre autres, de manière massive. Reste à savoir si cette montée en puissance, impressionnante, réelle, traduit déjà un avantage face aux États-Unis en cas de confrontation militaire.
Le budget officiel de la défense de la République populaire de Chine (RPC) fait l’objet d’une hausse continue, et ses forces sont modernisées de manière accélérée, notamment en matière navale, nucléaire et de missiles. Le réarmement chinois n’est plus une perspective lointaine, c’est une réalité documentée. Si l’on se réfère aux bases de données internationales, la Chine est désormais parmi les tout premiers acteurs mondiaux en matière de dépenses militaires.
Néanmoins, la puissance militaire ne se réduit ni à la qualité ni à la quantité dde troupes et de matériels qu’un pays peut accumuler. Elle se juge également au travers de l’expérience opérationnelle réelle, de la qualité du commandement et de la capacité à durer en guerre moderne. Un parallèle peut être trouvé en Europe. La Pologne et l’Allemagne ont entamé un processus de réarmement réel. Mais ces armées mettront encore longtemps à devenir aussi performantes que l’armée française, habituée aux interventions extérieures et n’ayant pas la crainte des inévitables pertes humaines.
Un réarmement visible, chiffrable, assumé
Le mouvement se lit d’abord dans les budgets. Le budget de la défense chinoise se situe autour de 250 milliards de dollars (210,7 milliards d’euros), soit environ quatre fois le budget français, même si la RPC est encore loin du budget des États-Unis (autour de 962 milliards de dollars, soit plus de 810 milliards d’euros).
Le montant officiel des dépenses chinoises n’est pas toujours strictement comparable à celui d’autres pays en raison de périmètres budgétaires différents, mais il est l’expression d’une tendance : des hausses régulières, sur la durée, qui financent équipements, entraînement, recherche et développement (R&D) et transformation organisationnelle.
Certes, l’augmentation des dépenses militaires est un phénomène perceptible à l’échelle mondiale ; mais l’effort chinois est particulièrement vigoureux. La zone Indo-Pacifique, qui est la zone directe d’intérêt des Chinois, est devenue un centre de gravité de la compétition stratégique.
Pourquoi maintenant : rattrapage, modernisation, obsession du « retard » à combler
Dans le narratif chinois, la modernisation de l’armée n’est pas qu’un symbole de l’aspiration à devenir la première puissance mondiale en 2049 (année du centième anniversaire de l’avènement de la Chine communiste). La Chine ne veut plus « subir » et a donc décidé de combler, avant tout vis-à-vis des États-Unis, son écart technologique, capacitaire et organisationnel. Il s’agit de passer d’une armée principalement terrestre, très nombreuse en hommes, à un outil capable d’opérations conjointes.
Comme l’indique explicitement le dernier livre blanc officiel chinois, l’interopérabilité des différentes armées (terre, air, mer, espace, cyber) n’est pas totalement achevée et la numérisation du champ de bataille doit être accélérée, afin d’obtenir une force « de classe mondiale » au milieu du siècle. Pour les Chinois, cette modernisation reflète une obsession de crédibilité. En effet, exister comme superpuissance implique, aux yeux de Pékin, d’avoir une armée capable de dissuader, de contraindre et, si nécessaire, de vaincre.
Une logique de compétition avec Washington, mais pas le même type de puissance
La rivalité sino-américaine est centrale dans le réarmement chinois. Il ne s’agit pas seulement d’une course aux budgets mais d’une course aux capacités. Les États-Unis financent une posture mondiale, en rapport avec la superpuissance dominante qu’ils demeurent. Leur armée est structurée dans certaines parties du monde dans le cadre d’alliances, est capable de déploiements multi-théâtres et possède une expérience des opérations extérieures. Autant de capacités dont la Chine n’a pas encore fait la démonstration.
Mais la Chine cherche d’abord à réduire la liberté d’action américaine dans sa zone d’intérêt immédiat. Pour cela, elle aspire à rendre toute intervention de Washington plus risquée et plus coûteuse. Dans ce cadre, Pékin effectue d’importants efforts en matière de missiles, de défense aérienne, de capteurs, de guerre électronique, de capacités cyber et spatiales, tout en développant, comme nous venons de le voir, ses moyens navals et aériens.
L’objectif n’est donc pas nécessairement de « copier » la puissance américaine. Il s’agit de compliquer sa projection de puissance, en saturant les défenses des États- Unis et de leurs alliés (principalement Taïwan, la Corée du Sud et le Japon).
Taïwan en ligne de mire : dissuader l’intervention, crédibiliser l’option militaire
Taïwan est une obsession chinoise de longue date et justifie en partie la montée en puissance de l’armée de la RPC.
Pékin peut conquérir l’île par divers moyens : la contraindre à se rendre à travers un blocus naval ou l’envahir militairement. Dans tous les cas, la Chine veut pouvoir imposer un fait accompli ou, si l’intervention armée est décidée, décourager l’aide extérieure à Taipei en tablant sur la crainte que pourraient inspirer ses nouvelles capacités.
À lire aussi : Comment la Chine s’y prendrait-elle pour envahir Taïwan ?
La gesticulation régulière à laquelle procède la RPC autour de Taïwan (pression aérienne et navale, exercices, démonstrations de lancements de missiles) a pour fonction de montrer à Washington et à alliés que, sur ce dossier, la détermination de Pékin est absolue. Dans l’optique chinoise, l’objectif demeure de lui faire comprendre que le coût de l’escalade pourrait être très élevé. En rendant l’environnement opérationnel plus contesté, elle rend tout engagement des États-Unis plus coûteux.
Le nucléaire, accélérateur de statut – et de méfiance
Le nucléaire est l’expression parfaite de la bascule chinoise vers la puissance totale souhaitée à l’horizon 2049, parce qu’il touche au cœur de la dissuasion.
Les estimations publiques concluent à une expansion et à une modernisation de l’arsenal chinois, avec l’objectif d’atteindre 1 000 têtes à l’horizon 2030. Une telle progression de l’arsenal chinois modifie les calculs de stabilité stratégique et alimente les inquiétudes régionales.
Certes, les chiffres exacts restent incertains. Mais l’augmentation de l’arsenal nucléaire est une certitude. Ce phénomène change de facto la posture chinoise qui s’éloigne d’une posture de dissuasion minimale – l’équivalent de la « stricte suffisance » française – pour évoluer vers des capacités intimidantes et donc, par définition, plus agressives et démonstratives. L’augmentation de l’arsenal nucléaire chinois renforce le statut du pays, mais accroît aussi la méfiance qu’il suscite et durcit la compétition.
« Puissante sur le papier » : l’angle mort du « combat proven »
C’est ici que la prudence s’impose et doit être répétée. Les matériels, les budgets et les exercices ne remplacent pas l’épreuve du conflit. Or la Chine n’a pas, sur la période récente, l’expérience opérationnelle d’une guerre comparable à celle qui a forgé les réflexes de plusieurs armées, notamment américaine, française, britannique ou russe (même si cette dernière offre plutôt un contre-exemple en termes d’efficacité).
Le fait que la Chine n’ait plus combattu depuis 1979 ne prouve pas une faiblesse intrinsèque, mais questionne l’efficacité réelle de son armée le jour où elle se retrouvera sous stress, face à la surprise. Quelle sera son endurance morale ? Saura-t-elle supporter des pertes et s’adapter quand le plan initial devra être modifié sous la pression de la réponse adverse ? Une partie de la littérature stratégique rappelle au demeurant que moderniser une armée n’est pas qu’un processus technique et industriel, mais relève aussi d’une transformation humaine et organisationnelle.
Guerre moderne : ce que les chiffres ne mesurent pas (coordination, logistique, commandement, attrition)
Le grand public mesure souvent la qualité d’une armée à ses capacités létales. Pour autant, l’efficacité d’une armée se joue également au regard de qualités plus discrètes, telles la logistique, la maintenance, la capacité à durer, la formation des cadres, la circulation de l’information ou encore la résilience des communications sous attaque, comme la guerre entre la Russie et l’Ukraine l’a encore bien démontré, le plus souvent au détriment des Russes.
Un scénario militaire autour de Taïwan, objectif permanent de Pékin, serait un test majeur pour l’armée chinoise. En effet, l’invasion de l’île s’opérerait sous contraintes sévères : opérations maritimes et aériennes complexes ; distances maritimes importantes à parcourir (ce qui implique une grande vulnérabilité des flux) ; intensité de la guerre électronique ; et, probablement, une attrition rapide. Le matériel compte, c’est une affaire entendue. Mais la « capacité système », c’est-à-dire la capacité de planifier, de coordonner, de ravitailler, de réparer ou de remplacer, compte au moins tout autant. La qualité du haut commandement sera également vite testée dans sa capacité à réagir justement et vite dans l’incertitude.
La Chine est-elle capable de rivaliser avec les États-Unis ? Assurément. Est-elle capable de les dominer ? Non, à brève échéance. Mais la question reste ouverte pour les décennies à venir. La Chine a su construire, et continue de le faire, un outil militaire redoutable, surtout dans sa zone d’intérêt immédiat. Son plan de réarmement est cohérent, réel et fait l’objet d’une volonté politique assumée. Pour autant, l’écart est encore grand entre une armée chinoise en construction et sans expérience du combat et une armée américaine, elle aussi en cours de modernisation mais expérimentée. La maîtrise éprouvée d’opérations complexes sous le feu, sur la durée, avec des pertes et des imprévus est ce qui fait d’une armée moderne une armée moderne et efficace. C’est la réduction de cet écart, pas seulement en volume et en budget mais en qualité opérationnelle, qui seule permettra à la Chine de peut-être, un jour, supplanter la domination des États-Unis.
Laurent Vilaine ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
14.02.2026 à 12:28
Faut-il recourir à l’immigration pour lutter contre les déserts médicaux ?
Iñaki Blanco-Cazeaux, Post-doctorant en économie de la santé, Université Bourgogne Europe
Texte intégral (1756 mots)
La pénurie globale de médecins en France et leur inégale répartition selon les territoires représentent l’un des enjeux des élections municipales de mars 2026. Pour lutter contre les déserts médicaux dans les zones où l’offre de soin est insuffisante, le système de santé fait appel à un contingent de praticiennes et praticiens étrangers issus de pays non membres de l’Union européenne. Avec quelle efficacité et quels sont les écueils à court et à long terme ?
La lutte contre les déserts médicaux est un enjeu international. En France, les inégalités d’accès aux soins, notamment pour des raisons territoriales, constituent une priorité des politiques de santé. Améliorer l’offre de soins à disposition de la population est également un des sujets de la campagne des prochaines élections municipales, particulièrement dans les territoires ruraux, même si, en périphérie des grandes agglomérations, des départements comme la Seine-Saint-Denis, présentée comme « le premier désert médical de France », ne sont pas non plus épargnés. Cette préoccupation repose sur un double constat : la pénurie globale de praticiens et leur répartition territoriale déséquilibrée.
Une des réponses politiques à ce problème est le recours aux médecins étrangers. Par exemple, en 2025, les décrets n°2025-467 et 468 ont ainsi visé à simplifier la régularisation des praticiens à diplôme hors Union européenne (Padhue).
À lire aussi : À l’hôpital, ces praticiens non européens qui pallient les pénuries de médecins
Qu’en est-il des résultats de ces politiques en France et ailleurs ? Quelle est leur utilité à court terme ? Quels en sont les défis à long terme ? Un ensemble de travaux de recherche permettent de répondre à ces questions.
Combler les pénuries à court terme
Différents contextes ont montré que le recours aux médecins étrangers a permis de combler le manque d’offre médicale dans les zones rurales et/ou sous-desservies. Effectivement, cela permet une croissance rapide de l’offre de soins, contrairement à l’augmentation du nombre d’étudiants pour lesquels une décennie de formation est nécessaire, ce qui coûte en temps et en argent. Ainsi, lorsque des politiques publiques visent à orienter ces médecins vers les zones qui en ont le plus besoin, cela y réduit les pénuries à court terme.
De son côté, la France a connu une nette progression des effectifs de médecins diplômés à l’étranger depuis 2007, notamment grâce à la directive européenne de 2005 qui reconnaît automatiquement les qualifications professionnelles des praticien·nes ayant des diplômes européens. Une étude de l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (Irdes) a montré que l’arrivée des médecins généralistes libéraux diplômés à l’étranger renforce l’offre de soins dans les zones sous-dotées, comme les marges rurales et les espaces périurbains.
Des politiques coercitives ou incitatives
Dans le cadre de ces politiques, deux stratégies sont possibles. L’une est coercitive, comme le programme de dérogation Conrad 30 aux États-Unis ou la section 19 AB du Health Insurance Act en Australie, dans la mesure où les médecins étrangers doivent travailler un certain temps en désert médical pour pouvoir exercer. L’autre est incitative, comme les programmes provinciaux d’immigration au Canada ou la liste des compétences en pénurie à long terme en Nouvelle-Zélande, mettant en place des ressources pour attirer les travailleurs qualifiés étrangers (y compris des médecins).
En France, la liberté d’installation est un principe fondamental de la médecine libérale, même si elle est de plus en plus contestée. Il n’y a donc pas de mécanisme coercitif pour que les médecins diplômés au sein de l’Union européenne s’installent en zone de sous-densité médicale.
En revanche, jusqu’à récemment, les praticiens à diplôme hors Union européenne (Padhue) devaient effectuer un « parcours de consolidation des compétences » durant lequel ils étaient affectés dans des structures de santé où les besoins sont les plus importants. Ce dispositif a cependant été assoupli en 2025 afin de faciliter l’installation pérenne des Padhue en France. Toutefois, leur orientation (par les agences régionales de santé, ou ARS), avant d’être pleinement autorisés à exercer en France, est supposée se faire selon les besoins locaux.
Bien que l’on puisse penser que les politiques coercitives luttent mieux contre les déserts médicaux que les politiques incitatives, cela n’a a priori pas été démontré. Un cadre coercitif, comme aux États-Unis, subit d’ailleurs ses propres limites puisque, là-bas, les déserts médicaux urbains bénéficient davantage des médecins étrangers que les déserts médicaux ruraux.
Des difficultés de rétention et d’intégration
Si ces politiques sont efficaces à court terme, on note cependant que les médecins étrangers ont tendance à être plus mobiles et à rester moins longtemps dans les déserts médicaux que les diplômés nationaux. En effet, l’intégration culturelle, linguistique, sociale et les conditions de travail sont des obstacles pour les médecins étrangers et leurs familles dans les communautés rurales.
Ces problèmes d’intégration peuvent également se manifester par des discriminations à l’encontre des médecins étrangers, certains subissant de la xénophobie ou du racisme. De même, les systèmes de santé dans lesquels ils sont impliqués ne les considèrent pas nécessairement a priori comme des médecins équivalents aux autres, ce qui peut induire un sentiment de déconsidération.
Un préjudice pour les systèmes de santé fragiles des pays d’origine
De plus, le recours aux médecins étrangers met en évidence un manque d’autosuffisance des pays développés pour gérer leurs propres pénuries médicales. Une telle dépendance rend l’accès aux soins vulnérable aux changements dans les politiques d’immigration et dans le contexte international. Si les médecins étrangers devaient se retirer, il y aurait sur l’accès aux soins une incidence négative aussi rapide que l’effet positif de l’immigration.
C’est de surcroît un processus préjudiciable aux pays en développement, contribuant à la fuite des cerveaux, notamment en Afrique et en Asie du Sud-Est. Ce phénomène affaiblit les systèmes de santé déjà fragiles des pays en développement, exacerbant les pénuries de médecins dans leurs propres zones mal desservies et créant des inégalités mondiales en matière d’accès aux soins.
Le recours à l’immigration de médecins est donc une politique qui tend à perpétuer, si ce n’est à amplifier, les inégalités Nord-Sud en matière de développement humain.
Une politique d’immigration qui ne peut pas tout
Les difficultés posées par le recours aux médecins étrangers supposent de ne pas s’en contenter.
Assurer la viabilité de l’accès aux soins pour tous sur le long terme suppose :
des investissements importants pour atteindre un nombre de praticiens suffisants dans chaque spécialité,
d’améliorer les conditions de travail et de vie dans les zones sous-dotées en personnel soignant, notamment dans les territoires ruraux, afin de les rendre plus attractives,
et de mettre en œuvre une planification efficace de l’offre de soin dans les déserts médicaux.
Iñaki Blanco-Cazeaux ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
14.02.2026 à 10:05
Quelle taxe foncière pour les prochains élus municipaux ?
Thomas Eisinger, Professeur associé en droit, gestion financière et management des collectivités, Aix-Marseille Université (AMU)
Texte intégral (2157 mots)
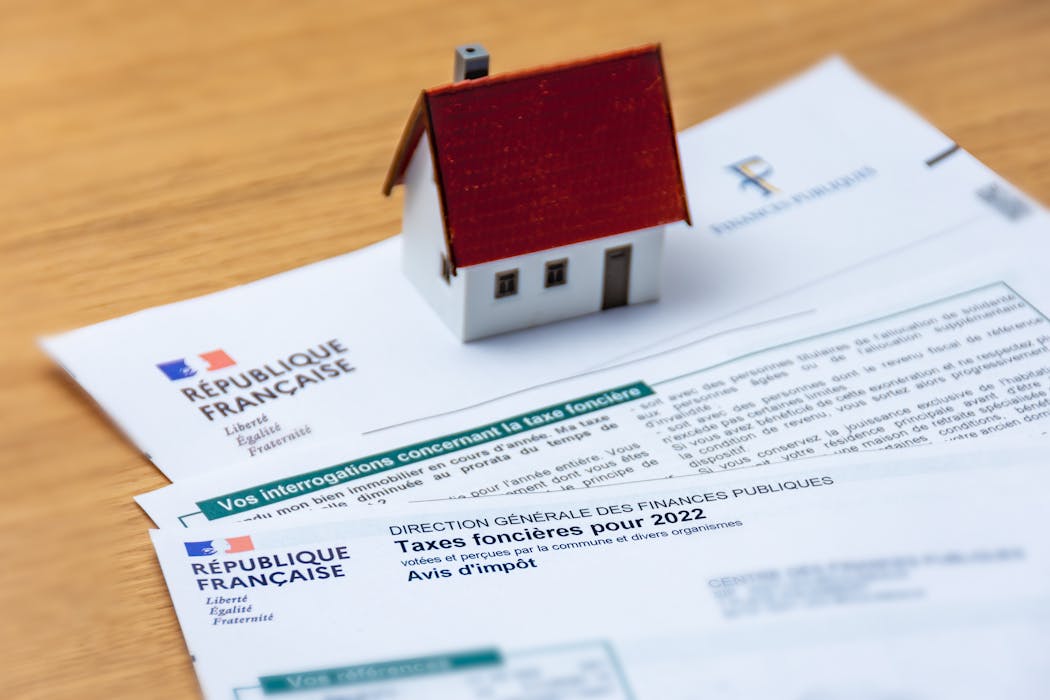
En vue des élections municipales, de nombreux candidates et candidats proposent de créer de nouveaux services pour leurs électeurs. Une solution évidente pour financer ces nouvelles dépenses : la taxe foncière sur les propriétés bâties, pourtant déjà en hausse de 19 % entre 2020 et 2024. Décryptage de cette taxe locale incontournable.
Cet article est une version mise à jour et enrichie d’un article publié le 13 septembre 2023 : « Hausse de la taxe foncière : vers l’infini et au-delà ? »
La campagne pour les élections municipales des 15 et 22 mars prochain bat son plein. Une chose est sûre, quel que soit le résultat des urnes, il va falloir trouver de l’argent. Les candidats de tous bords ne manquent pas d’idées qui, quels que soient leurs mérites sociaux ou économiques (c’est un autre débat), ont pour dénominateur commun de mettre sous pression les fragiles équilibres budgétaires communaux.
La gratuité de certains services publics est une proposition à la mode, que ce soit pour les transports ou pour l’école primaire – kits de rentrée, cantine scolaire. Des augmentations d’effectifs sont annoncées, de préférence pour des agents bien visibles sur le terrain comme les policiers municipaux. Il faudra bien trouver des ressources pour financer toutes ces mesures. Le volontaire tout trouvé, comme sur la précédente mandature, ce serait la taxe foncière sur les propriétés bâties, première recette fiscale de nos communes.
Mais pourra-t-elle, sur les six prochaines années, être aussi sollicitée que sur les six dernières ? Divulgachie : a priori non.
Comment est déterminée votre taxe foncière
Attention, nous ne parlerons ici que de votre seule taxe foncière sur les propriétés bâties, qui ne représente, aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, qu’une partie de la somme à payer figurant sur la première page de votre avis d’imposition. D’autres prélèvements sont effectués avec la taxe foncière sur les propriétés bâties : la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (à l’objet éponyme), la taxe dite GEMAPI (visant à financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations), certaines taxes spéciales d’équipement, etc.
Concernant votre taxe foncière sur les propriétés bâties, son mode de calcul est assez simple : elle est le résultat du produit d’une assiette, en l’espèce l’estimation de la valeur de votre bien immobilier, par un taux d’imposition. La responsabilité de l’évolution annuelle de ces deux composantes est partagée.
La valeur locative cadastrale – l’estimation évoquée plus haut dans son appellation administrative – fluctue chaque année en fonction d’un indice de révision. Jusqu’à récemment (on y reviendra), ce dernier était voté par les parlementaires dans le cadre de la loi de finances. Le taux lui relève, depuis le début des années 1980, des collectivités locales récipiendaires de l’impôt (aujourd’hui, les communes et les intercommunalités), qui le votent chaque année en parallèle de l’adoption de leur budget primitif.
Hausse incontrôlée de l’assiette, à l’insu de notre plein gré
En 2025, l’indexation générale des bases de votre taxe foncière a augmenté de 1,7 %. En 2026, ce devrait être de 0,8 %. Une séquence de relative modération, qui fait suite une augmentation beaucoup plus significative – 3,4 % en 2022 et 7,1 % en 2023. Pour mémoire, la hausse annuelle était en moyenne de 1,6 % entre 2005 et 2015. La mandature 2020-2026 aura ainsi été marquée par une forte hausse de l’assiette de cet impôt.
Comment expliquer une telle augmentation, alors que l’on pourrait imaginer les députés et sénateurs soucieux de préserver le pouvoir d’achat de nos concitoyens ? Depuis le début des années 1980, ce sont bien les parlementaires qui déterminaient l’indexation annuelle de cette assiette. Officiellement, ils tenaient « compte de la variation des loyers ». En réalité, ils étaient toujours attentifs au contexte économique et social.
Dans le cadre de la loi de finances pour 2017, dans une démarche positiviste qui collait bien à l’esprit (initial) de la législature, ces mêmes parlementaires ont fait le choix d’automatiser et donc de dépolitiser cette hausse. Elle se fera désormais sur la base de l’indice des prix à la consommation. S’il était impossible à l’époque d’anticiper le retour de l’inflation que nous avons connu par la mandature 2020-2026, on peut reconnaître que les parlementaires ont été bien malheureux de renoncer à l’époque à cette prérogative (discutable certes) qui était historiquement la leur.
Entre 2020 et 2024, une hausse déjà significative du taux voté par certaines communes
On pourrait légitimement se dire que, si l’assiette augmente au niveau de l’inflation comme nous venons de le voir, le taux de la taxe foncière aurait pu justement lui rester stable. Il n’en a rien été, pour plusieurs raisons.
D’une part, parce que les autres recettes de fonctionnement des communes et de leurs intercommunalités augmentent elles bien moins vite que l’inflation. Les dotations versées par l’État, qui rappelons-le augmentaient il y a encore une quinzaine d’années du niveau de l’inflation et d’une partie de la croissance, se stabilisent après avoir connu quelques années de baisse (contribution du secteur local à la maîtrise des finances publiques).
D’autre part, parce que la taxe d’habitation a disparu, comme une décennie avant elle la taxe professionnelle. Bien qu’elle ait été compensée à l’euro près dans les budgets locaux, aucun nouveau levier fiscal n’est venu combler le vide qu’elle laissait. Résultat, quand il s’agit d’augmenter les ressources budgétaires, les exécutifs locaux ne peuvent plus mettre en œuvre de réelle stratégie fiscale (quelle catégorie de contribuables solliciter davantage cette année ?) et n’ont presque plus qu’une seule option : augmenter la taxe foncière.
Et ce ne sont là que les principales explications. Restaurer les équilibres budgétaires après quelques années de « quoi qu’il en coûte » à la sauce locale, absorber les hausses budgétaires imposées par l’État comme la hausse de la rémunération des fonctionnaires, trouver les moyens de contribuer à la transition écologique… Autant de raisons, plus ou moins légitimes, que les élus locaux ont mobilisées pour justifier la hausse des taux qu’ils ont décidé.
Certes, lorsque l'on regarde les chiffres globaux, la mandature qui s'achève ne se caractérise pas par une hausse générale et massive des taux de taxe foncière (+7 % « seulement » entre 2020 et 2024). Mais certaines des plus grandes villes de France ont effectivement fait le choix d'utiliser ce levier fiscal dans des proportions inédites et largement relayées à l'époque par le presse quotidienne régionale et nationale. Autant de marges de manoeuvre qu'il sera, sur les territoires concernés, inenvisageagbles de remobiliser après 2026.
Un levier fiscal injuste… donc en théorie moins légitime à mobiliser ?
Au-delà de l’explosion constatée sur la mandature qui s’achève de l’assiette indexée et des taux votés, la taxe foncière sur les propriétés bâties porte en elle, dans la configuration actuelle, plusieurs problématiques significatives de justice fiscale.
Un, la valeur de votre habitation n’est structurellement pas le meilleur moyen d’appréhender votre capacité contributive, vos « facultés » sur la base desquelles les impôts sont sensés être levés. S’il n’est pas illégitime d’avoir une assiette autre que les revenus pour certains impôts, cela devient plus problématique lorsque cette assiette concerne un prélèvement significatif en termes de volume. C’est le cas pour la taxe foncière aujourd’hui pour bon nombre de ménages. Selon l’Insee, la taxe foncière représente plus de 4 % du revenu disponible pour les 20 % des propriétaires aux revenus les plus modestes.
Deux, l’appréciation par l’administration de la valeur de votre habitation n’est même pas bonne. Calculée au début des années 1970, elle est aujourd’hui largement déconnectée de la réalité du marché immobilier. Malheureusement, et c’est un des paradoxes informels de la légistique fiscale, plus une situation est injuste et plus il est difficile d’y remédier. La séquence de l’automne dernier peut laisser songeur quant à notre capacité collective à réaliser un jour cet exercice de réforme.
Trois, avec la suppression de la taxe d’habitation, l’augmentation de la pression fiscale, désormais concentrée sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, soulève une véritable question de démocratie locale. En effet, une partie des financeurs de la dynamique budgétaire communale sont les propriétaires non-résidents (non-électeurs, serait-on tentés de souligner), alors que dans le même temps les locataires (électeurs) sont eux dispensés de presque tout effort fiscal. Taxation without representation + representation without taxation : tout cela ne semble pas tenable sur le temps long.
Au regard de la double dynamique inédite de l’assiette et des taux constatés sur la mandature 2020-2026 et de ces questionnements afférents à la justice fiscale (un sujet désormais majeur dans le débat public), la modération fiscale devrait en théorie être de rigueur en 2026-2022. Elle aurait même pu être une proposition de campagne majeure. Cependant, il est peu probable que la facture ne s’alourdisse pas dans les prochaines années, au regard des ambitions affichées par les candidats de tout bord. Reste à voir ce qu’en seront les répercussions, sur les finances publiques comme (et c’est peut-être plus problématique) sur la démocratie locale.
Thomas Eisinger est administrateur de l'AFIGESE (association des financiers, contrôleurs de gestion et évaluateurs du secteur public local)
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Time [Fr]
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- L'Autre Quotidien
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- Gauche.Media
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
