RÉSEAU ÉCOLOGISTE DES PROFESSIONNEL·LE·S DE L'ACTION PUBLIQUE
Le Lierre rassemble plus de 1 700 fonctionnaires, agents publics, contractuels, experts, consultants, acteurs et actrices des politiques publiques, convaincus que la transformation de l'action publique est indispensable pour répondre aux urgences écologique, sociale et démocratique.☘️ Rencontre avec Gaspard Koenig
Le Lierre
Dans le cadre du cycle « Ecologie et Action publique », Le Lierre, la Fondation pour l’Ecologie Politique et le média Socialter ont l’honneur de recevoir Gaspard Koenig, auteur d' »Agrophilosophie : réconcilier nature et liberté » (2023). 📅 Le jeudi 6 novembre de 18h30 à 20h30 📍À la Fondation Charles Léopold Mayer (Paris 11) Cette conférence sera animée par Céline Marty, docteure en philosophie. Comment penser une écologie politique et des politiques environnementales émancipatrices pour tou.tes et émancipées des carcans autoritaires du marché capitaliste comme de la bureaucratie ? 💭 Dans Agrophilosophie (2023), Gaspard Koenig parcourt l’histoire des idées philosophiques et politiques pour réconcilier la liberté d’agir avec le respect écologique, le progrès humain avec la décroissance. Il défend un libéralisme politique bien compris – plutôt que le néolibéralisme économique – et la simplification des règles pour laisser de l’autonomie à chacun.e pour s’adapter à la complexité des situations et des territoires. Il s’oppose ainsi à la bureaucratie comme au jardin à la française, promouvant le municipalisme libertaire et des formes de capitalisme non productiviste, ayant « une main sur la calculette, l’autre dans la terre ». 🌱 Dans ses tribunes pour Les Echos, il détonne par des critiques de l’avion comme de l’IA et par la défense d’une décroissance bien sensée, fondée sur une sobriété émancipatrice. Texte intégral (570 mots)

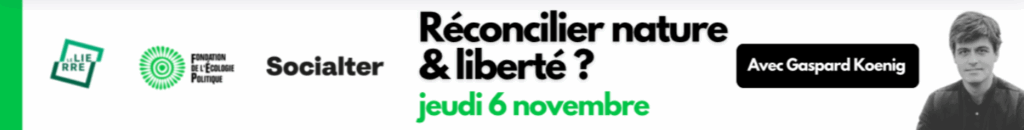
🌱 Agroécologie : comment avancer ? (événement)
Le Lierre
🌿 Afin d’accompagner les acteurs publics dans une meilleure compréhension des controverses autour de l’agroécologie, Le Lierre publie un recueil de 16 contributions réalisées par des scientifiques et expert.e.s sur différentes controverses ayant été au coeur de nombreux débats ces dernières années. Venez le découvrir lors de cet événement ! 💡Ce recueil vise à : 1️⃣ Clarifier les controverses entourant le développement des systèmes agroécologiques, via des contributions d’expert.e.s sur ces questions, 2️⃣ Apporter des outils pour contribuer au débat public. À cette occasion, Le Lierre organise une conférence pour présenter le livrable, discuter collectivement de la situation actuelle sur les questions agricoles et alimentaires, et identifier des pistes pour avancer ! Avec : 🌱 Thierry Brunelle, Directeur adjoint, Chercheur en économie au Centre international de recherche sur l’environnement et le développement (CIRED), 🌱 Eve Fouilleux, Directrice de recherche au CNRS en science politique, 🌱 Lucile Rogissart, Chercheuse à l’Institut de l’économie pour le climat (I4CE), 🌱 Sylvain Brunier, Chargé de recherche CNRS en sociologie. 📅 Rendez-vous le jeudi 16 octobre, à 19h, 📍À la Fondation Charles Léopold Mayer, au 38 rue Saint-Sabin (75011). Et ne manquez pas l’apéro de clôture de l’événement ! Texte intégral (504 mots)


Une coalition inédite qui fait parler d’elle
Le Lierre
À six mois des élections municipales, le Lierre réunit une coalition inédite d’acteurs pour lancer Solutions Transitions. A quelques mois des élections municipales de mars 2026, l’alliance nouée entre les partenaires du projet Solutions Transitions entend faciliter et simplifier l’action des acteurs locaux, en réunissant le meilleur de l’ingénierie territoriale proposée par la puissance publique et la société civile. Solutions Transitions est le fruit d’un diagnostic partagé entre Le Lierre et ses partenaires : administrations, réseaux professionnels, chercheurs et experts, opérateurs, fondations et ONG. La démarche de Solutions Transitions s’inscrit sur une année entière (automne 2025-automne 2026) et autour de 3 piliers : Une vaste dynamique partenariale qui ne fait que commencer Voici les premiers partenaires au moment du lancement, le 18 septembre 2025 : Retrouvez ici l’article consacré au lancement du projet : Lancement officiel de Solutions Transitions Solutions Transitions dans la presse à son lancement Revue de presse après le lancement en septembre 2025 : Acteurs Publics : Les professionnels de l’action publique écologique lancent une plateforme pour outiller agents et élus La Gazette : Transition écologique : du grain à moudre pour les futurs élus Actu Environnement : Une nouvelle plateforme en ligne pour mobiliser les élus en faveur de la transition écologique Texte intégral (1698 mots)

Tous constatent que la réalité des besoins locaux et des objectifs nationaux de planification de la transition écologique renforcent la nécessité et la pertinence de l’action des collectivités territoriales, malgré leurs contraintes financières.






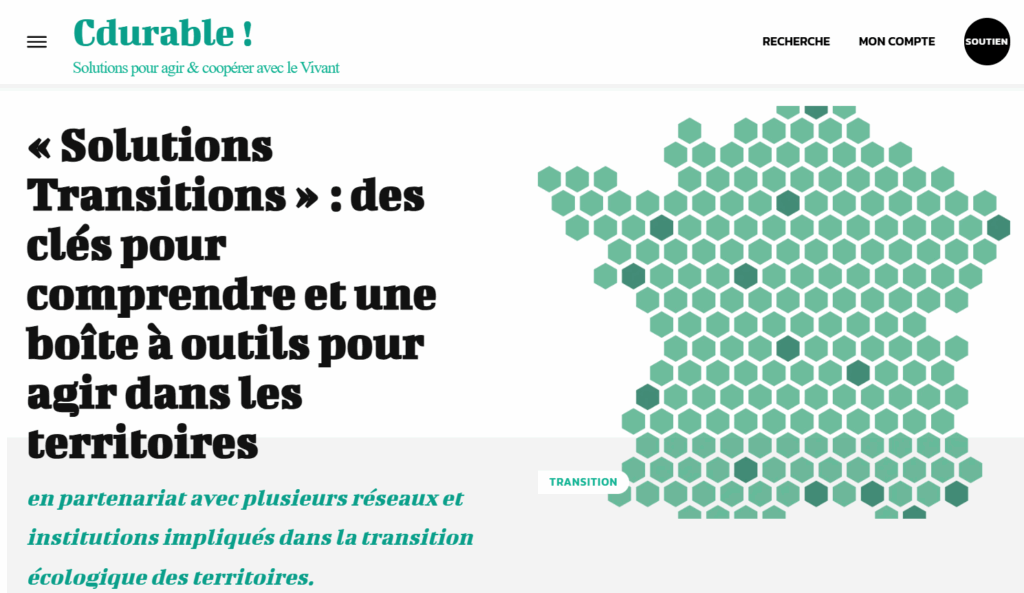
Lancement officiel de Solutions Transitions
Le Lierre
Solutions Transitions, c’est parti ! A 6 mois des élections municipales de 2026, Le Lierre et ses partenaires dévoilent la démarche Solutions Transitions. Solutions Transitions fait le pari de l’action locale pour répondre à l’urgence écologique. Ce projet est le fruit d’un diagnostic partagé entre Le Lierre et ses partenaires : administrations, réseaux professionnels, chercheurs et experts, opérateurs, fondations et ONG. Tous constatent que la réalité des besoins locaux et des objectifs nationaux de planification de la transition écologique renforcent la nécessité et la pertinence de l’action des collectivités territoriales, malgré leurs contraintes financières. A partir de la plateforme Solutions Transitions nous proposons aujourd’hui et pour les prochains mois : La démarche Solutions Transitions c’est : Etaient réunis autour Wandrille Jumeaux, co-fondateur du Lierre, et de l’équipe salarié du Lierre pour ce lancement : Nous remercions l’ensemble des partenaires qui nous accompagnent dans cette démarche : RDV sur notre site https://solutionstransitions.fr/ Retrouvez l’article et la revue de presse consacrés à la coalition inédite d’acteurs réunis pour porter cette démarche : Une coalition inédite qui fait parler d’elle Retrouver ici le communiqué de presse annonçant le lancement de la démarche Texte intégral (973 mots)

L’alliance nouée entre les partenaires du projet Solutions Transitions entend faciliter et simplifier l’action des acteurs locaux, en réunissant le meilleur de l’ingénierie territoriale proposée par la puissance publique et la société civile.

– Stéphanie Clément-Grandcourt (DG de Fondation pour la Nature et l’Homme),
– Sébastien Maire (DG de France Villes et Territoires Durables),
– Belkacem Mehaddi (DG du CNFPT),
– Marion Fetet (I4CE),
– Sébastien Flores (Office Français de la Biodiversité)
– et Simon Luck (Comité 21)
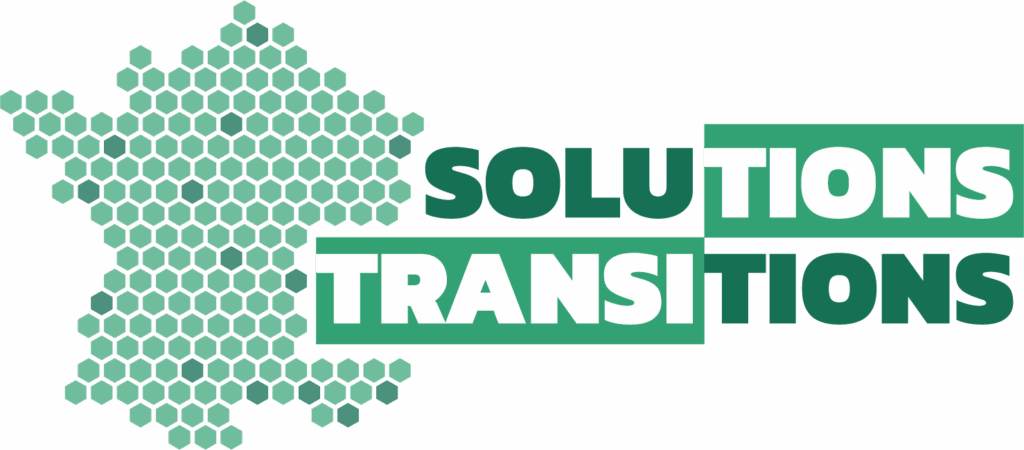
Bon Pote
Actu-Environnement
Amis de la Terre
Aspas
Biodiversité-sous-nos-pieds
Bloom
Canopée
Décroissance (la)
Deep Green Resistance
Déroute des routes
Faîte et Racines
Fracas
F.N.E (AURA)
Greenpeace Fr
JNE
La Relève et la Peste
La Terre
Le Lierre
Le Sauvage
Low-Tech Mag.
Motus & Langue pendue
Mountain Wilderness
Negawatt
Observatoire de l'Anthropocène
