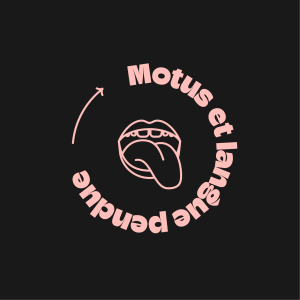Motus & Langue Pendue - Un journal intime de la société, avec des contenus situés quelque part entre l’art, la discussion entre potes et le journalisme.
[ÉVÈNEMENT] Motus vous invite aux Etats Généraux du Seum le 10 septembre prochain!
La rédac
Ces derniers temps, dans les milieux militants de gauche desquels nous sommes, on a beaucoup parlé de “joie militante”. Cette euphorie collective, destinée à nous faire nous déhancher tout en dénonçant les ultra-riches ou les gros nazis, est sur toutes les bouches. Pas la nôtre. Parce que dans un élan ultime de mauvaise foi, notre média de dépressifs dégénérés revendique sa mauvaise humeur. S’en amuse. S’en contente. Pour notre anniversaire, les cadeaux sont empoisonnés Le 10 septembre 2025, le média Motus & Langue Pendue appelle les sales gosses, organisations marginales, associations microscopiques, les trop bruyants, les trop de gauche, toute persona non grata du mouvement social respectable ou autres médias sans le sou, à venir mettre du poil à gratter dans l’entre-soi mondain des progressistes pour le faire progresser vraiment. Les secousses doivent venir de nous, et quoi de mieux pour swinguer toute une soirée Au programme : Bref, les seumards contre-attaquent. Ils le font le temps d’une soirée par ironie, par malice, par sarcasme, mais aussi pour alerter notre propre camp idéologique, la gôche : nous avons besoin de remises en question, de nouveaux venus pinailleurs, de grains de sel et de cailloux dans les chaussures, plus que d’entre-soi souriants et de grandes tapes dans le dos entre des personnes qui se paraphrasent quand elles ne s’applaudissent pas. Nous avons besoin que ceux qui barbotent, installés dans le paysage institutionnel de gauche, nous tiennent la porte ouverte pour qu’on y sème un peu de pagaille saine. Ça nous fera autant de bien que la joie militante, c’est promis. Peut-être même les deux se rejoignent-ils… Rendez-vous est donc donné le 10 septembre 2025 au Point Éphémère, à Paris. Des médias, des orga, mais aussi des gens et des trajectoires hors des clous s’y rejoindront pour célébrer les paroles biscornues et piquantes, dans l’irrévérence plus que l’humour poli et lisse. Nos rires gras et vexés disent quelque chose des entre-soi desquels nous sommes exclus. Et pour l’anniversaire de notre média, nous voulons faire des marges le centre du jeu. La contre-soirée devient the place to be, les Etats Généraux du Seum peuvent commencer. L’article [ÉVÈNEMENT] Motus vous invite aux Etats Généraux du Seum le 10 septembre prochain! est apparu en premier sur Motus & Langue Pendue. Texte intégral (992 mots)
LES INFOS

 le Point Éphémère, 200 quai de Valmy, Paris 10e
le Point Éphémère, 200 quai de Valmy, Paris 10e mercredi 10 septembre 2025, de 18h30 à 1h
mercredi 10 septembre 2025, de 18h30 à 1h par Motus & Langue Pendue et consorts
par Motus & Langue Pendue et consorts  Entrée gratuite : réservez votre place ici
Entrée gratuite : réservez votre place iciLes Etats Généraux du Seum : kézaco ?
 . Nous avons décidé de réunir les frustrés de l’époque pour de pompeux Etats Généraux du Seum. Exit, les fachos réactionnaires tout sourire d’avoir déjà gagné. Mais! Exit aussi, les grandes leçons de morale inefficaces de notre camp. Ici les vilains petits canards de la gauche only.
. Nous avons décidé de réunir les frustrés de l’époque pour de pompeux Etats Généraux du Seum. Exit, les fachos réactionnaires tout sourire d’avoir déjà gagné. Mais! Exit aussi, les grandes leçons de morale inefficaces de notre camp. Ici les vilains petits canards de la gauche only. 
Une soirée festive et politique

Pour que la piraterie ne soit jamais finie.
La rédac
Par Charlotte Giorgi “Ça y est. J’ai déménagé. Je ne vous écris plus depuis mes mythiques 9m2 de meuf instable. (Nota bene : je suis toujours une meuf instable, mais j’exerce désormais dans autre chose qu’un placard) Me voilà de retour extramuros. Pas très loin, juste au bord du périph’. Mais en banlieue quand même. Celle que je fuyais. Il faut croire que la pollution me va mieux. Que je me fonds mieux dans son décor, gris, en chantier, où quelques herbes s’évertuent à pousser au milieu du béton. Où la vie est ratatinée par les voitures et les éléments. Mais mon appartement a plus que doublé de taille. En banlieue, aussi bien ici que là où j’ai grandi, je fais l’expérience de ce que veut dire vivre une vie à peu près normale. Et depuis, un mot me trotte dans la tête pour qualifier tout ça : me déplier. Pour moi donc, la liberté, la joie, la vie, se construit ici. Dans ces lieux qu’on est censés fuir pour travailler, monter, avancer vers le centre. Et de penser ça, m’a rappelé mes profs du lycée : « pour trouver une problématique intéressante pour vos dissertations, cherchez un paradoxe. » Se déplier est un des plus gros paradoxes que permet notre époque faites de petits tiroirs où se ranger, qui donnent d’autant plus l’envie de vivre un peu de ce désordre, de ces tâtonnements, et de ces chaos de liberté des temps où il faut se réinventer.” J’aime l’écologie et les chemins bétonnés. Les livres de bell hooks et les hommes un peu macho sur les bords. Je raffole de conversations mesquines avec de bonnes personnes, d’humour noir et de sarcasmes légers, de jolies voix truffées d’insultes et d’énormités dites doucement, de rires gras et d’engueulades où l’on pleure quand on voudrait crier. Les endroits qui me plaisent, même si ça ne plaisait pas forcément en y grandissant, ce sont les endroits où l’on ne lisse pas, où l’on ne conforme pas, où l’on ne s’excuse pas d’être plusieurs choses à la fois. Je viens des endroits où la liberté prend forme humaine et où l’on me rirait peut-être au nez d’écrire ça. Je viens des paradoxes, et je compte y rester, malgré toute la force que notre société met à les combattre. “J’viens de là où ça sent la pisse, même si c’est repeint” rappe SCH. En septembre dernier, j’ouvrais cette 5e saison sur le média avec cet édito. Essorée par l’année qui vient de s’écouler (sur moi, j’ai l’impression – genre comme un gros seau d’eau glacée qu’on m’aurait retourné dessus), je le trouve sacrément bien écrit. On voit que j’avais les yeux en face des trous. Peut-être plus que maintenant. À tort ou à raison. Être à côté de la plaque, ça a parfois du bon pour embrasser ses paradoxes. Quelques mois plus tard, j’ai retrouvé ma relation toxique et cabossée qui n’en finit pas de ne pas commencer, fait un tour aux urgences psy pour constater que ce n’est pas moi la malade mais la SocIeTeR et perdu mon grand-père sur de la musique classique toute douce dont le mot “deuil” n’arrive pas à absorber l’absurdité. Quelques mois plus tard, beaucoup de choses ont changé dans ma tête, et dehors le même paysage : Israël qui joue à “c’est celui qui le dit qui y est” pendant que tout meurt sous ses bombes ; des demi-tours prévisibles mais tout aussi lamentables de nos pouvoirs publics sur à peu près tout ce qui concerne le social et l’écologie (A69, taxe Zucman, loi Duplomb,…) ; la presse indé qui galère. Pour les paradoxes on repassera. Bon, on notera quand même un nouveau pape pas facho, l’émergence d’une Theodora superstar plus subversive que l’ensemble des politiciens de gauche, et la résilience de l’équipe de ce petit média alors que la préparation des dossiers de subventions et la refonte de ce site internet nous aura aspiré une bonne partie de nos âmes. Cette saison 5 nous a donné du fil à retordre, et de plus en plus il faut s’armer d’imagination et de folie pour trouver des paradoxes intéressants dans la logique implacable et déprimante du monde. Cette année m’a semblé lisse, conforme aux pires attentes et léthargies, et pour beaucoup, elle aura été l’occasion de s’engoncer dans des postures morales inefficaces, signe d’impuissance politique, de fatigue militante ou – plus souvent, si on est honnête, de lâcheté. Je m’accroche pourtant toujours à cette idée qu’il faut persévérer à chercher l’endroit de frottement dans tout ce que l’on vit, et lui faire cracher ce qu’il a à poser comme questions utiles. Je suis en train de lire à ce sujet le dernier livre de Claire Touzard, Folie et Résistance et il fait écho à mon propre diagnostic de bipolarité, qui vient de me tomber sur le nez comme une évidence. Plus qu’une collection d’étiquettes, il me semble assez logique que les hérétiques de notre temps se retrouvent sous les loupes de la psychiatrie. Ce que Claire Touzard propose en revanche, c’est d’utiliser ces labels agaçants comme autre chose qu’une pathologie. Comme une force subversive. Comme une résistance intrinsèque, qui se travaille pour ne pas la laisser nous ramollir et nous rendre malades, mais au contraire nous redonner la vitalité que l’époque est en train de nous arracher. Un enseignement majeur de cette année : le réel est complexe, toujours subjectif, et souvent inextricable pour les gens qui portent un poil de profondeur politique en eux. Un autre : ce n’est pas parce que les faits sont graves qu’ils sortent de l’ordinaire. Ça n’est pas parce qu’on s’empresse de choisir son camp et ses mots magiques qu’on réfléchit. On utilise le mot “conflictualité” à toutes les sauces, et on se vautre dans la binarité dès qu’on sent les questions inconfortables arriver. Le champ politique n’a pas besoin de notre embarras dégoulinant de bonnes pensées. Il a besoin qu’on tangue, qu’on creuse, qu’on le nourrisse. Et si ces réflexions manquent de concret, c’est aussi parce que l’année en a manqué. Pour avancer, il va donc falloir laisser derrière nous toute une tripotée d’abrutis qui jouent aux profs et ne vivent rien. Par exemple, ceux qui pensent que tout est simple. Ceux qui prétendent être très au clair sur des questions qui se répètent en partie parce que ces gens-là font semblant qu’elles sont limpides. Nier la complexité d’un monde violent autant que prévisible c’est aussi en être profondément et bêtement complices. Cela dit, l’époque a aussi fait tomber les masques, et on ne va pas se mentir, certaines choses sont limpides : le soutien à un génocide ou les 40° qu’on subit pendant que Jeff Bezos invite ses amis en jet pour le marier en grande pompe à Venise. Paradoxes, encore. Il faut savoir naviguer entre les choses simples qu’on complique et les imbroglio qu’on voudrait lire sans profondeur. Depuis que j’écris sur Internet et ce média que j’aime tant, je connais bien ces endroits border, où tu flirtes avec le danger d’une pensée libre et qui gratte, et le plaisir autant que l’inconfort de rencontrer tes propres contradictions. Je connais ces moments où te sentant couler, tu découvres de nouvelles portes par lesquelles laisser la vie s’engouffrer. Je connais ces conflits, ces ruptures, ces douleurs autant que ces euphories qui élargissent le monde et lui donnent le reflet de plusieurs vérités qui cohabitent. Prétendre porter une parole politique, c’est aussi s’abandonner au contradictoire, tenir grandes ouvertes les portes qui font des courants d’air désagréables, être complet et entier, et surtout assez solide pour gratter derrière la saleté de l’ordinaire. Il faut mettre les mains dans le camboui plus que des mots dans un confessionnal, voilà ce que je retiens de cette année militante à couvrir une actualité qui se délabre autant que le monde. Et puis, si je dois me confesser de manière absolue (et vous refiler la patate chaude), j’avoue que je prends une certaine jouissance à ne prêter allégeance à rien ici ; ni au bien ni au mal, à aucune victime ni aucun bourreau, ni à la morale ni même à ma propre vision des choses. Mais je prends aussi mon pied paradoxal dans la loyauté aux miens, à ceux qui me ressemblent, ceux qui marchent sur le fil et dont les gros rires d’équilibristes font trembler de peur tous les bien-pensants. Je crois qu’un jour on se rendra compte que tout ça peut cohabiter, et que même, ça doit. Il suffit de penser. Je me suis demandé pendant longtemps ce qui faisait que je me retrouvais toujours à compagnonner dans les zones d’ombres, avec les tordus. Tous mes plus chers traînent trente casseroles à leurs jolies fesses, et j’ai pris plaisir à décortiquer ces frontières difficiles entre l’acceptable et l’inacceptable, mais aussi entre la folie et le réel dans des textes et des podcasts. Je ne me suis pas épargnée, j’ai tout raconté, des manigances du contrôle aux sincérités des explosions. De l’intimité de ma chambre aux marches vers Gaza. Je me suis accroché à ce média pour penser, de toutes mes forces. Pour écrire ces folies, ces idées, ces illuminations. S’il faut avoir l’air de se rouler dans la boue pour toucher du doigt l’essentiel des choses à dire, nous serons les vilains petits canards qui laissent des traces de gadoue sur la moquette. À bientôt sur l’internet pirate ! L’article Pour que la piraterie ne soit jamais finie. est apparu en premier sur Motus & Langue Pendue. Texte intégral (1982 mots)
Une année sur un média minus avec un ego énorme.

[vidéo 🎥] Pourquoi on a le seum (la gauche, les médias, les idiots utiles…)
La rédac
Par Marius Uhl et Charlotte Giorgi Un épisode de fin d’année hautement politique dans lequel on vous explique la vie et on rage en faisant la leçon à tout le monde. L’occasion de revenir sur ce manifeste de seumards, et de vous annoncer une très chouette nouvelle! L’article [vidéo 🎥] Pourquoi on a le seum (la gauche, les médias, les idiots utiles…) est apparu en premier sur Motus & Langue Pendue. (131 mots)

Un podcast pour apprendre la révolte : péter un calme, un an après la dissolution
La rédac
Par Charlotte Giorgi Il y a un an, la folie des législatives anticipées, déclenchées par la dissolution de l’Assemblée Nationale par notre fou du bus en chef, Emmanuel Macron, prenait place. Et balayait sur son passage la sidération et l’apathie. Contrairement à l’année d’avant, 2023, qui fut celle de soulèvements populaires massifs (soulèvements de la terre, réforme des retraites, révoltes des banlieues après la mort de Nahel,…), la campagne fut une révolte tactique, mécanique, jouant le jeu des institutions. Un an après, les dynamiques importantes soulevées par le Nouveau Front Populaire semblent loin. La sidération poursuit son chemin, et notre seuil de tolérance envers un calme qui est en fait un statu quo violent s’accroît de jour en jour. En face, des milliers, si ce n’est des millions, de jeunes qui errent dans ce monde chaotique et les questions qu’il soulève : qu’est-ce qui est politique ? À quoi se joue mon impuissance ? Quand devrions-nous arrêter d’être calmes ? Il y a un an, aussi – hasard du calendrier, paraissait un podcast sur lequel nous travaillions depuis des mois si ce n’est des années. Un podcast pour rendre ces questions existentielles aussi sexy que les questions qu’on se pose autour de nos histoires d’amour (ce à quoi nous avions déjà travaillé avec succès autour de notre podcast Disparaître). Alors faire un Disparaître de la politique, c’était le plan. Car les contenus qui partent de l’intime sont des portes d’entrée dans la politique, et qu’il n’y a rien de plus intime que les questions que l’époque contemporaine fait s’élever. Alors à travers le décorticage intime de la trajectoire politique de l’une d’entre nous, nous espérions attraper l’attention des jeunes qui nous ressemblent, créer des chambres d’écho et des caisses de résonance, en partageant nos expériences de rupture avec l’ordre établi mais aussi nos impasses et nos contradictions : c’est ainsi que nous pourrions, peut-être, (ré)apprendre collectivement apprendre la révolte. S’il y a un podcast qui peut représenter la ligne édito de notre média dans ce monde qui chavire, c’est bien celui-ci. Comme depuis toujours, nous concentrons nos forces sur des contenus qui peuvent briser l’entre-soi des milieux engagés, et permettre à chacun·e de se réapproprier les combats de notre temps. Parce qu’on n’en peut plus du jargon militant et de ne parler qu’à des convaincu·es. Du mépris social et des leçons de morale. Alors on vous invite fort à (ré)écouter ce podcast pensé sur le temps long, à vous l’approprier, et à vous outiller pour mener votre propre trajectoire politique. A nos côtés ? J’ai grandi dans une banlieue décrépie que j’ai toujours rêvé de quitter. Contre toute attente, j’ai aussi côtoyé les bancs d’une école qui fabrique nos élites politiques. Des actions de désobéissance civile écolo aux manifs des gilets jaunes, de la création d’un média indépendant jusqu’aux recours devant le conseil d’Etat, la trajectoire de ma vie a fait de moi un témoin privilégié du fonctionnement politique des choses, du monde, de nos vies. J’ai appris beaucoup, d’espoirs en désillusions, et ça ne sert à rien si ce n’est pas partagé. « Diam’s a sorti son premier album l’année où je suis née, en 1999 », commence la narratrice. « La chanson dans laquelle elle parle des jeunes de l’an 2000, donc de moi, ne figure pas sur celui-ci mais sur son 3e album, sorti en 2006. J’avais sept ans et pas encore de MP3. Mon MP3, c’est l’année de mes 10 ans. Diam’s, je comprends pas tout ce qu’elle dit. Mais je chante, machinalement. Comme une bonne partie de ma génération. La génération nan-nan. Diam’s et les refrains entêtants qu’on fredonne dans la cour d’école en étant ravis du pouvoir de provocation que le rap nous offre, c’est notre premier lien avec la politique. Nous, les gens dont les parents veulent faire le bien mais sont ni de droite ni de gauche et s’en foutent d’ailleurs pas mal. Nous, classe moyenne qui s’en fout et qui va devenir populaire, nous que tout encercle et que rien n’intéresse suffisamment. Trop à faire, et rien à faire du reste. Diam’s c’est mon premier contact avec la politique. 2007, dix ans avant que j’ose dire : ça m’intéresse. Ça m’intéresse, qu’on me dise que j’ai raison d’être en colère, qu’on m’explique pourquoi j’ai une boule dans le bide quand mon père cherche du travail et que ma mère en a marre d’être prof, pourquoi c’est tout le temps la crise et comment on fait pour échapper au pire. Si tu travailles mal à l’école, si tu crois ce que tu lis sur Internet, si tu jettes ton chewing-gum par terre, si tu dis « putain », si tu regardes trop la télé, si tu respectes pas les règles que tu comprends pas encore : le pire. Personne sait exactement ce que c’est le pire. Mais ça aussi, c’est un premier contact avec la politique. Ce qui m’intéresse : échapper au pire. Pour le meilleur, on verra plus tard. Ça fait plusieurs années que sur le média, on produit un podcast autour de l’amour. Ça s’appelle Disparaître, et ça marche super bien. C’est facile parler d’amour, parce qu’on dirait pas qu’on parle de politique. Et la politique, même si c’est ce qui m’intéresse, tout le monde sait qu’il faut pas en parler. C’est malvenu. « Tu votes pour qui toi? ». Personne dit ça. Ou bien « ce serait bien que les hommes arrête de violer », en plein repas, bah non. Alors que l’amour, ça intéresse tout le monde. L’amour, j’avais pu en parler avec n’importe qui. Personne ne serait senti en position de dire à l’une de mes meilleures amies enregistrées pour l’occasion : « tu n’es pas assez experte ». « Pas assez spécialiste ». On est toustes spécialistes de notre propre vie. Ce que j’ai fait pour l’amour, je veux le faire pour la politique. Faire parler nos vies, faire raconter nos tripes. Me permettre d’interroger. Faire en sorte que l’étincelle que la vie a allumé chez moi, par tout un tas de mécanismes qui me prédestinait plus ou moins à parler d’où je parle aujourd’hui, embrase d’autres feux. On a besoin de feux. Qui réchauffe qui a besoin, et qui brûle ce dont on n’a pas besoin. De la banlieue décrépie où j’ai grandi, aux couloirs de Sciences Po Paris, des actions de désobéissance civile écolo aux manifs des gilets jaunes, de la création d’un média indépendant jusqu’aux recours devant le conseil d’Etat, mes propres privilèges, ma chance, la trajectoire de ma vie ont fait de moi un témoin privilégié du fonctionnement politique des choses, du monde, de nos vies. J’ai appris beaucoup, d’espoirs en désillusions, et ça ne sert à rien si ce n’est pas partagé. Difficile de vous dire que je compte vous partager ma vie, aussi jeune que je sois, en un podcast de six épisodes. Il s’agit plutôt de retracer un chemin qui pourra faire écho aux vôtres, le chemin d’une vérité, la mienne, à propos d’une époque, la nôtre, et comment elle pourrait faire écho plutôt que de rester ratatinée à l’arrière de ma tête. Je crois que quand les échos sont assez nombreux et solides et touchants pour constituer un brouhaha, ça s’appelle une révolution. Et j’aspire à rien de moins ambitieux que ça : une révolution. Commençons par faire les présentations. Y’a quelques personnages important dans mon histoire, dans la nôtre. Le premier, c’est l’époque. La sale époque. Je suis une enfant des années 2000, je n’ai jamais vécu autre chose que la crise. Tout est moins bien qu’avant, à ce qu’il paraît. Et plus tard ça pue. Je ne pourrai probablement jamais m’acheter une maison, ni vivre un printemps qui ne soit ni l’hiver ni l’été mais un vrai entre-deux. En politique non plus, il n’y a plus d’entre-deux, à supposer qu’il y en ait jamais eu. Je n’ai pas connu d’élections où l’extrême-droite ne menaçait pas et j’ai grandi avec des plateaux télé qui mettaient l’extrême-gauche dans le même sac. Droite ou gauche, pour moi ça ne veut rien dire. » https://anchor.fm/s/f7bd42f8/podcast/rss L’article Un podcast pour apprendre la révolte : péter un calme, un an après la dissolution est apparu en premier sur Motus & Langue Pendue. Texte intégral (1854 mots)

Créer des portes d’entrée accessibles dans les questions politiques : un défi en pleine dissolution de l’Assemblée Nationale

Péter un calme, et aussi péter l’entre-soi
La génération nan-nan se raconte au micro
 ÉCOUTER LA SUITE
ÉCOUTER LA SUITE 
Bon Pote
Actu-Environnement
Amis de la Terre
Aspas
Biodiversité-sous-nos-pieds
Bloom
Canopée
Décroissance (la)
Deep Green Resistance
Déroute des routes
Faîte et Racines
Fracas
F.N.E (AURA)
Greenpeace Fr
JNE
La Relève et la Peste
La Terre
Le Lierre
Le Sauvage
Low-Tech Mag.
Motus & Langue pendue
Mountain Wilderness
Negawatt
Observatoire de l'Anthropocène