11.05.2020 à 02:00
Revue articles et communications autour de Stop-Covid
Afin de garder une trace (!) des débats qui enflamèrent l’opinion publique lors de la crise sanitaire du printemps 2020, voici une revue partielle d’articles parus dans la presse et quelques communications officielles autour de l’application Stop-Covid, entre discours réalistes et solutionnisme technologique (cette liste est mise à jour régulièrement, autant que possible).
Presse écrite et en ligne
Numerama (18/06/2020), « StopCovid a été lancé alors que même la Cnil ne savait pas comment l’app fonctionnait »
Un chercheur a montré que le fonctionnement technique de StopCovid n’était pas similaire à ce qui était annoncé par le gouvernement, ce qui est écrit dans le décret d’application et même ce qui a été validé par la Cnil. … En résumé, la Cnil a validé un dispositif qui n’est pas celui qui est utilisé aujourd’hui dans l’application que tous les Français et Françaises sont fortement invités à utiliser, par le gouvernement et à grands coups de campagnes de communication. Comme on peut le voir au point numéro 37 qui était abordé dans l’avis du 25 mai, la Commission avait d’ailleurs elle-même « [pris] acte de ce que l’algorithme permettant de déterminer la distance entre les utilisateurs de l’application reste à ce stade en développement et pourra subir des évolutions futures ».
Le Monde - Pixel (16/06/2020), « L’application StopCovid collecte plus de données qu’annoncé »
Un chercheur a découvert que l’application collectait les identifiants de toutes les personnes croisées par un utilisateur, pas seulement celles croisées à moins d’un mètre pendant quinze minutes.
Mediapart (15/06/2020), « StopCovid, l’appli qui en savait trop »
Loin de se limiter au recensement des contacts « à moins d’un mètre pendant au moins quinze minutes », l’application mise en place par le gouvernement collecte, et transfère le cas échéant au serveur central, les identifiants de toutes les personnes qui se sont « croisées » via l’appli. De près ou de loin.
L’Usine Digitale (12/06/2020), « L’application StopCovid n’a été activée que par 2 % des Français »
Échec pour StopCovid. Du 2 au 9 juin, seuls 2 % des Français ont téléchargé et activé l’application. Un chiffre beaucoup trop bas pour qu’elle soit utile. Au moins 60 % de la population d’un pays doit utiliser un outil de pistage numérique de ce type pour que celui-ci puisse détecter des chaînes de contamination du virus.
Dossier Familial (12/06/2020), « Le flop de l’application StopCovid »
Alors même que son efficacité dépend de son succès, l’application StopCovid n’est utilisée effectivement que par environ 350 000 personnes.
France Inter (11/06/2020), « Coût et soupçon de favoritisme : l’appli StopCovid dans le collimateur d’Anticor »
L’association Anticor, qui lutte contre la corruption, a déposé un signalement auprès du Procureur de la République. Le coût de l’application StopCovid est en cause. L’inquiétude ne porte pas sur l’utilisation de nos données, mais sur son coût et… un soupçon de favoritisme.
Liberation (11/06/2020), « L’application StopCovid utilise-t-elle des services des Gafam ? »
Le logiciel développé par le gouvernement français a bien recours au «Captcha» de Google mais n’est pas hébergé sur des serveurs Microsoft (contrairement au projet, distinct, de Health Data Hub).
Le Monde (10/06/2020) « L’application StopCovid, activée seulement par 2 % de la population, connaît des débuts décevants »
Le coût de l’application de suivi de contacts, désormais supportée par l’Etat, pose question, une semaine après son lancement.
Slate.fr (03/06/2020), « Les trois erreurs qui plombent l’application StopCovid »
Ce projet tout à fait louable s’est écrasé en rase campagne en quelques semaines alors que tous les feux étaient au vert.
Nouvel Observateur (02/06/2020), « StopCovid, une application au coût salé »
L’application de lutte contre le Covid-19 a été développée gratuitement par des chercheurs et partenaires privés. Toutefois, depuis son lancement mardi 2 juin, sa maintenance et son hébergement sont bel et bien facturés, entre 200 000 et 300 000 euros par mois.
TV5 Monde (01/06/2020), StopCovid : « C’est le signe d’une société qui va très mal et qui est en train de devenir totalement paranoïaque »
A partir de ce mardi 2 juin, l’application StopCovid débarque en France. Son but : pister le Covid-19 pour éviter sa propagation. Alors cette application est-elle vraiment efficace ? Nos données personnelles sont-elles menacées ? Entretien avec Benjamin Bayart, ingénieur français, ancien président de French Data Network et co-fondateur de la Quadrature du Net.
The Conversation (25/05/2020) « Données de santé : l’arbre StopCovid qui cache la forêt Health Data Hub »
Le projet de traçage socialement « acceptable » à l’aide des smartphones dit StopCovid, dont le lancement était initialement prévu pour le 2 juin, a focalisé l’intérêt de tous. Apple et Google se réjouissaient déjà de la mise en place d’un protocole API (interface de programmation d’application) qui serait commun pour de nombreux pays et qui confirmerait ainsi leur monopole.
Mais la forte controverse qu’a suscitée le projet en France, cumulée au fait que l’Allemagne s’en est retirée et à l’échec constaté de l’application à Singapour, où seulement 20 % des utilisateurs s’en servent, annoncent l’abandon prochain de StopCovid.
« Ce n’est pas prêt et ce sera sûrement doucement enterré. À la française », estimait un député LREM le 27 avril auprès de l’AFP.
Pendant ce temps-là, un projet bien plus large continue à marche forcée : celui de la plate-forme des données de santé Health Data Hub (HDHub).
The Guardian (23/05/2020), « How did the Covidsafe app go from being vital to almost irrelevant? »
The PM told Australians in April the contact tracing app was key to getting back to normal but just one person has been identified using its data (En avril, le Premier ministre a déclaré aux Australiens que l’application de recherche des contacts était la clé du retour à la normale, mais seule une personne a été identifiée grâce à ses données)
Politico (20/05/2020) « Meet the Dutchman who cried foul on Europe’s tracking technology »
The national privacy watchdog has repeatedly broken ranks with EU peers over tracing technology. His approach seems to be winning.
(…) Alors que les gouvernements européens s’empressent d’adopter la technologie pour lutter contre le coronavirus, un Néerlandais au franc-parler est apparu comme une épine dans leur pied.
Le message d’Aleid Wolfsen : Ne prétendez pas que vos solutions sont respectueuses de la vie privée.
“Nous devons éviter de déployer une solution dont on ne sait pas si elle fonctionne réellement, avec le risque qu’elle cause principalement d’autres problèmes”, a déclaré en avril le responsable de l’autorité néerlandaise chargée de la protection de la vie privée, en référence aux applications de suivi des coronavirus pour smartphones en cours de développement dans la plupart des pays de l’UE.
Le Monde (18/05/2020), Tribune – Coronavirus : « Sur l’application StopCovid, il convient de sortir des postures dogmatiques »
Chercheurs à l’Inria et travaillant sur l’application StopCovid, Claude Castelluccia et Daniel Le Métayer mettent en garde, dans une tribune au « Monde », contre les oppositions de principe, notamment à un système centralisé, qui ne reposent pas sur une analyse précise des risques potentiels et des bénéfices attendus. (…)
(…) Même si la valeur ajoutée d’une application comme StopCovid dans le processus plus global de traçage (qui repose sur des enquêtes menées par des humains) reste à déterminer et à évaluer précisément…
The Economist (16/05/2020) « Don’t rely on contact-tracing apps »
Governments are pinning their hopes on a technology that could prove ineffective — and dangerous
Wired (13/05/2020), « Secret NHS files reveal plans for coronavirus contact tracing app »
Documents left unsecured on Google Drive reveal the NHS could in the future ask people to post their health status to its Covid-19 contact tracing app
Numerama (13/05/2020), « ‘Il n’y a rien du tout’ : la première publication du code source de StopCovid est inutile »
(…) les critiques et les moqueries ont fusé immédiatement sur ce qui a été publié le 12 mai. En effet, de l’avis de diverses personnes habituées à travailler avec du code informatique, ce qui est proposé ressemble surtout à une coquille vide. Impossible donc pour les spécialistes de passer aux travaux pratiques en analysant les instructions du logiciel.
Dalloz Actualité (12/05/2020) – par Caroline Zorn – « État d’urgence pour les données de santé (I) : l’application StopCovid »
À travers deux exemples d’actualité que sont l’application StopCovid (première partie) et le Service intégré de dépistage et de prévention (SIDEP) (seconde partie), la question de la protection des données de santé à l’aune du pistage est confrontée à une analyse juridique (et parfois technique) incitant à une réflexion sur nos convictions en période d’état d’urgence sanitaire. Cette étude a été séparée en deux parties, la première consacrée à StopCovid est publiée aujourd’hui.
Revue politique et parlementaire (11/05/2020), « Stopcovid : une application problématique sur le plan éthique et politique »
Pierre-Antoine Chardel, Valérie Charolles et Eric Guichard font le point sur les risques engendrés par la mise en œuvre d’une solution de type Stopcovid, solution techniciste de court terme qui viendrait renforcer une défiance des citoyens envers l’État et ses représentants, ou à l’inverse un excès de confiance dans le numérique, au détriment de projets technologiques soucieux de l’éthique et susceptibles de faire honneur à un État démocratique.
MIT Technology Review (11/05/2020) « Nearly 40% of Icelanders are using a covid app — and it hasn’t helped much »
The country has the highest penetration of any automated contact tracing app in the world, but one senior figure says it “wasn’t a game changer.”
Newstatesman – NSTech (11/05/2020), « The NHSX tracing app source code was released but privacy fears remain »
In a move designed to create the impression of radical transparency, NHSX finally released the source code for the UK’s Covid-19 tracing app last week. However, among experts, the reception was mixed.
Aral Balkan, software developer at Small Technology Foundation, expressed criticism that the source code for the server hadn’t been released, only that of the iOS and Android clients. “Without that, it’s a meaningless gesture,” he wrote on Twitter. “Without the server source you have no idea what they’re doing with the data.”
In further analysis, Balkan said the iOS app was “littered with Google tracking” and the app was using Firebase (a Google mobile and web application development platform) to build the app. He pointed out that Microsoft analytics also tracked what information the person has provided, such as partial postcode and collected contact events.
France info, (09/05/2020) – Nouveau monde. Refuser l’application StopCovid revient à remettre en question notre système de santé, selon le directeur du comité d’éthique du CNRS
« Déjà, nous sommes tracés tous les jours par notre téléphone qui enregistre énormément d’informations. Surtout, nous sommes tous satisfaits de notre système étatique de santé et, avec un système étatique, contrairement aux États-Unis, l’État est nécessairement au courant de tout. L’État sait chez quels médecins nous allons, quels médicaments nous sont prescrits, quels hôpitaux nous fréquentons, etc. Bien sûr, cela doit se faire avec une certaine confidentialité mais si l’on prenait au sérieux certains discours actuels, cela remettrait en cause le système de santé tel qu’il existe aujourd’hui. Et ça, je pense que ce n’est pas légitime. »
Le Monde (08/05/2020), « Suivi des « cas contacts » : ce que contiendront les deux nouveaux fichiers sanitaires prévus par l’Etat Par Martin Untersinger »
La stratégie du gouvernement pour lutter contre une reprise de l’épidémie repose sur un suivi des « cas contacts ». Les autorités prévoient un « système d’information », reposant sur deux bases de données médicales : Sidep et Contact Covid.
Acteurs Publics, (07/05/2020) « Aymeril Hoang, l’architecte discret du projet d’application StopCovid »
Membre du Conseil scientifique Covid-19 en tant qu’expert du numérique, l’ancien directeur de cabinet de Mounir Mahjoubi au secrétariat d’État au Numérique a eu en réalité un rôle central, en coulisses, dans l’élaboration du projet d’application de traçage numérique StopCovid. Récit.
Les Echos (07/05/2020), « La Réunion lance sa propre appli de traçage… sans attendre StopCovid »
Des entrepreneurs réunionnais ont mis au point Alertanoo, une application mobile permettant aux habitants de l’île testés positifs au coronavirus d’alerter les personnes qu’elles ont croisées récemment.
Le Temps (06/05/2020), « A Singapour, le traçage par app dégénère en surveillance de masse »
Premier pays à avoir lancé le pistage du virus par smartphone de manière volontaire, Singapour lance un nouveau service liberticide, baptisé SafeEntry. La Suisse peut en tirer des leçons
(…) Ainsi, le système central obtiendra les coordonnées complètes – du nom au numéro de téléphone – des Singapouriens qui fréquentent ces lieux. SafeEntry diffère ainsi de TraceTogether sur deux points majeurs: d’abord, son caractère obligatoire, comme on vient de le voir – même si un haut responsable de la Santé vient de demander que TraceTogether devienne obligatoire. Ensuite, la qualité des données récoltées diffère: la première application lancée fonctionne de manière anonyme – ni le nom, ni la localisation des personnes n’étant révélés. SafeEntry ne semble pas avoir suscité, pour l’heure, de critiques.
Wired (05/06/2020), « India’s Covid-19 Contact Tracing App Could Leak Patient Locations »
The system’s use of GPS data could let hackers pinpoint who reports a positive diagnosis.
As countries around the world rush to build smartphone apps that can help track the spread of Covid-19, privacy advocates have cautioned that those systems could, if implemented badly, result in a dangerous mix of health data and digital surveillance. India’s new contact tracing app may serve as a lesson in those privacy pitfalls: Security researchers say it could reveal the location of Covid-19 patients not only to government authorities but to any hacker clever enough to exploit its flaws.
Nextinpact (04/05/2020), « SIDEP et Contact Covid, les deux fichiers du « contact tracing »
Le Conseil d’État estime que les conditions de mise en œuvre des fichiers, qui reposeront notamment sur le traitement de données de santé non anonymisées, « le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées », « ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ». Le projet de loi est examiné aujourd’hui au Sénat.
Numerama (04/05/2020), « Après l’échec du StopCovid local, Singapour passe à une solution beaucoup plus radicale »
À Singapour, l’application TraceTogether non fonctionnelle est accompagnée d’un nouveau mode de traçage des contacts numérique : le scan d’un QR Code. Et, dans les grandes lignes, il est obligatoire.
Medium (03/05/2020), par Cedric O. « StopCovid ou encore ? »
Le secrétaire d’Etat chargé du numérique Cedric O. se fend d’un long article sur Medium pour faire le point sur l’application Stop-Covid.
Liberation (02/05/2020), « Fichiers médicaux, isolement, traçage… Le gouvernement précise son état d’urgence sanitaire »
A l’issue du Conseil des ministres de samedi, Olivier Véran a justifié l’utilisation prochaine de «systèmes d’information» pour «tracer» les personnes infectées par le nouveau coronavirus et la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’à juillet.
France Info Tv/2 (02/05/2020), « Déconfinement : le travail controversé des “brigades d’anges gardiens” »
Protéger, isoler, tester, pour mettre en place ce triptyque, la mise en place d’un nouvel outil, avec le suivi des patients, et la récolte des données personnelles est prônée par le gouvernement.
Allons-nous tous être fichés, et faut-il s’inquiéter ? Le gouvernement a dévoilé sa politique de traçage. Lorsqu’une personne est testée positive au Covid-19, elle apparaitra dans un fichier, appelé Sidep, les personnes qu’elle a côtoyé seront fichées dans un deuxième fichier nommé Contact Covid, afin d’être testées et si besoin isolées pour empêcher la propagation du virus. 3 à 4 000 personnes seront affectées à cette mission.
France Info (02/05/2020), « Application StopCovid : “Nous avons absolument besoin de ce regard”, affirme le président du syndicat de médecins généralistes MG France »
Selon Jacques Battistoni, les généralistes effectuent déjà une forme de surveillance en mentionnant les contaminations au coronavirus sur les arrêts de travail. Pour lui, l’application envisagé par le gouvernement donnera une “vision d’ensemble”.
Numerama (02/05/2020), « StopCovid : Olivier Véran confirme les incertitudes autour de l’application de contact tracing »
L’application StopCovid ne sera pas prête pour le 11 mai. Le ministre de la Santé Olivier Véran prépare déjà la France à ce qu’elle ne voit jamais le jour.
Reuters (02/05/2020), « India orders coronavirus tracing app for all workers »
NEW DELHI (Reuters) - India has ordered all public and private sector employees use a government-backed contact tracing app and maintain social distancing in offices as it begins easing some of its lockdown measures in districts less affected by the coronavirus. (…) “Such a move should be backed by a dedicated law which provides strong data protection cover and is under the oversight of an independent body,” said Udbhav Tiwari, Public Policy Advisor for internet browser company Mozilla. Critics also note that about 400 million of India’s population do not possess smartphones and would not be covered.
Capital (01/05/2020), « L’application “Stop Covid” dans le top de l’AppStore, sauf que ce n’est pas la bonne »
Des milliers de personnes ont téléchargé cette application sur Google Play ou l’AppStore, sauf qu’il s’agit de celle lancée par le gouvernement géorgien.
Charlie Hebdo (30/04/2020), « Stop Covid est un danger pour nos libertés »
Le Covid-19 va-t-il nous faire basculer vers une société de surveillance ? Bernard E. Harcourt, professeur de droit à Columbia University et directeur d’études à l’EHESS nous alerte notamment sur les risques de l’application Stop Covid. Il avait publié en janvier dernier un ouvrage intitulé « La société d’exposition », (Ed Seuil), dans lequel il montrait de manière saisissante comment les nouvelles technologies exploitent notre désir d’exhibition et de mise en avant de soi.
Buzzfeed (29/04/2020) « We Need An “Army” Of Contact Tracers To Safely Reopen The Country. We Might Get Apps Instead »
Without enough human contact tracers to identify infected people, the US is barreling toward a digital solution, and possible disaster.
(…) “My problem with contact tracing apps is that they have absolutely no value,” Bruce Schneier, a privacy expert and fellow at the Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard University, told BuzzFeed News. “I’m not even talking about the privacy concerns, I mean the efficacy. Does anybody think this will do something useful? … This is just something governments want to do for the hell of it. To me, it’s just techies doing techie things because they don’t know what else to do.”
Dalloz Actualités (28/04/2020) « Coronavirus : StopCovid, les avis de la CNIL et du CNNum »
Quoi que favorables à l’application de traçage StopCovid telle qu’elle est actuellement présentée, la Commission nationale informatique et libertés et le Conseil national du numérique relèvent cependant les risques et les garanties qui devront être discutées par le législateur.
Mediapart (28/04/2020) « Le gouvernement s’embourbe dans son projet d’application «StopCovid» »
Édouard Philippe a reconnu « les incertitudes » pesant sur le projet d’application de traçage des contacts des personnes contaminées. Celui-ci suscite l’opposition de défenseurs des libertés publiques comme de chercheurs.
Numerama (27/04/2020), « Application StopCovid : que sait-on du projet de contact tracing du gouvernement ? »
StopCovid est un projet d’application servant à suivre la propagation de la maladie dans la population. Présentée début avril, elle doit être prête lorsque la phase de déconfinement débutera. Mais cette stratégie est l’objet d’un intense débat. Que sait-on d’elle ? Numerama fait le point.
Le Monde (27/04/2020) « Coronavirus : « Substituons temporairement au terme “liberté” de notre devise française celui de “responsabilité” »
Trois spécialistes en épidémiologie de l’université de Toulouse, associée à l’Inserm, présentent dans une tribune au « Monde » un éclairage éthique sur le traçage numérique de la propagation du Covid-19, entre intérêt public et libertés individuelles.
France Culture (27/04/2020), « Traçage : “Ce n’est pas le numérique qui pose question, mais notre capacité à penser le bien commun”
Entretien | À travers le monde, les différentes solutions technologiques imaginées pour répondre à la pandémie via les applications de traçage “StopCovid” dessinent une carte assez précise de la façon dont le politique se saisit - ou pas - des questions numériques. Analyse avec Stéphane Grumbach, de l’INRIA.
Numerama (27/04/2020), « StopCovid dans l’impasse : Cédric O confirme que la France se lance dans un bras de fer avec Apple »
Cédric O a confirmé que la France choisissait le bras de fer avec Apple pour obtenir un passe-droit sur le Bluetooth, au risque de mettre en danger la vie privée des utilisatrices et utilisateurs d’iPhone. Sans cela, StopCovid ne fonctionnera pas.
Libération (26/04/2020). Tribune par Didier Sicard et al. « Pour faire la guerre au virus, armons numériquement les enquêteurs sanitaires »
Pourquoi se focaliser sur une application qu’il faudra discuter à l’Assemblée nationale et qui risque de ne jamais voir le jour, alors que nous devrions déjà nous concentrer sur la constitution et l’outillage numérique d’une véritable armée d’enquêteurs en épidémiologie ?
Le Figaro (26/04/2020). « Mobilisation générale pour développer l’application StopCovid »
Les récents avis rendus par la Cnil, le CNNum et le Conseil scientifique ont sonné le top départ pour les équipes de développement d’une application de «contact tracing».
Les Echos (26/04/2020), « StopCovid : le gouvernement passe en force et supprime le débat à l’Assemblée »
En intégrant le débat sur le projet d’application StopCovid à celui, général, sur le déconfinement, l’exécutif est accusé de passer en force. Une situation dénoncée à gauche comme au sein même de la majorité, où les réticences contre cette application sont fortes.
Politis (26/04/2020). « Covid-19 : la solution ne sera pas technologique »
Les débats autour de l’application StopCovid, souhaitée par le gouvernement français, révèlent la grande obsession de notre temps. Face aux périls qui nous menacent, nous devrions nous jeter à corps perdu dans la technologie. Surtout, ne rien remettre en cause, mais opter pour un monde encore et toujours plus numérisé. Au mépris de nos libertés, de l’environnement, de l’humain et, au final, de notre avenir.
Reuters (26/04/2020), « Germany flips to Apple-Google approach on smartphone contact tracing »
Germany changed course on Sunday over which type of smartphone technology it wanted to use to trace coronavirus infections, backing an approach supported by Apple and Google along with a growing number of other European countries.
Le Monde (26/04/2020), « Application StopCovid : la CNIL appelle le gouvernement « à une grande prudence » »
Dans son avis, la Commission nationale de l’informatique et des libertés donne un satisfecit au gouvernement tout en pointant les « risques » liés à ce projet d’application.
Le Monde (25/04/2020). Tribune par Antonio Casilli et al. « StopCovid est un projet désastreux piloté par des apprentis sorciers »
Il faut renoncer à la mise en place d’un outil de surveillance enregistrant toutes nos interactions humaines et sur lequel pèse l’ombre d’intérêts privés et politiques, à l’instar du scandale Cambridge Analytica, plaide un collectif de spécialistes du numérique dans une tribune au « Monde ».
La Dépêche du Midi (25/04/2020), « Coronavirus : la société toulousaine Sigfox propose des bracelets électroniques pour gérer le déconfinement »
Tracer les malades du Covid-19 via une application pour alerter tous ceux qui les ont croisés et qui ont été touchés par le nouveau coronavirus, c’est l’une des options étudiées par le gouvernement pour le déconfinement. La société toulousaine Sigfox a proposé ses services : un bracelet électronique au lieu d’une application. Plus sûr selon son patron.
Le Monde (24/04/2020), Tribune de Thierry Klein, entrepreneur du numérique, « Déconfinement : « Nous nous sommes encore tiré une balle dans le pied avec le RGPD »
L’entrepreneur Thierry Klein estime, dans une tribune au « Monde », que le Règlement général sur la protection des données est un monstre juridique dont la France subira les conséquences quand il s’agira de mettre en place des outils numériques de suivi de la contagion.
Extrait :
Le pompon de la bêtise, celle qui tue, est en passe d’être atteint avec le traitement du coronavirus. Au moment où nous déconfinerons, il devrait être possible de mettre une application traceuse sur chaque smartphone (« devrait », car il ne faut pas préjuger des capacités techniques d’un pays qui n’a su procurer ni gel ni masques à ses citoyens). Cette application, si vous êtes testé positif, va être capable de voir quels amis vous avez croisés et ils pourront être eux-mêmes testés. Ainsi utilisée, une telle application réduit significativement la contagion, sauve des vies (par exemple en Corée du Sud), mais réduirait selon certains nos libertés et, drame national, enfreindrait le RGPD.
Une telle interprétation est un détournement de la notion de citoyenneté, au bénéfice d’une liberté individuelle mal comprise – de fait, la liberté de tuer.
NextInpact (24/04/2020), « « Contact tracing » : la nécessité (oubliée) de milliers d’enquêteurs » (Par Jean-Marc Manach )
La focalisation du débat autour des seules applications Bluetooth de « contact tracing » fait complètement l’impasse sur le fait que, en termes de santé publique, le « contact tracing » repose d’abord et avant tout sur le facteur humain. Et qu’il va falloir en déployer des centaines de milliers, dans le monde entier.
Numerama (21/04/2020), « »StopCovid vs Apple : pourquoi la France s’est mise dans une impasse »
D’après Cédric O, secrétaire d’État au Numérique, l’application StopCovid ne sortira pas dans les temps à cause d’Apple. Cette politisation simpliste du discours autour de l’app de contact tracing cache un désaccord technique entre la méthode nationale de l’Inria et le développement international de la solution de Google et Apple. Résultat : la France est dans l’impasse.
Corriere Della Sera (21/04/2020), « Coronavirus, l’App (quasi) obbligatoria e l’ipotesi braccialetto per gli anziani »
Une idée pour l’incitation pourrait être de laisser la possibilité de télécharger l’application, ou de porter le bracelet, rester volontaire. Comme le gouvernement l’a déjà indiqué clairement. Mais prévoir que pour ceux qui choisissent de ne pas le télécharger, des restrictions de mobilité subsistent. Il reste à préciser ce que l’on entend exactement par restrictions à la liberté de circulation. Pas l’obligation de rester à la maison, ce ne serait pas possible. Mais il pourrait y avoir un resserrement du mouvement qui, pour tous les autres, dans la phase 2, sera autorisé progressivement. La proposition, encore en phase d’élaboration, pourrait être formalisée dans les prochains jours par la commission technico-scientifique, en accord avec Domenico Arcuri, le commissaire extraordinaire qui a signé l’ordre précisément pour l’application, et en accord également avec le groupe de travail dirigé par Vittorio Colao. La décision finale, bien sûr, appartient au gouvernement.
Korii-slate (20/04/2020), « Peut-on déjà se fier à une app de passeport immunitaire? » (voir original sur Quartz paru le 15/04/2020)
Une start-up propose déjà son CoronaPass aux États, sur des bases scientifiques pourtant balbutiantes.
Le Temps (18/04/2020), « L’EPFL se distancie du projet européen de traçage du virus via les téléphones »
L’EPFL, mais aussi l’EPFZ se distancient du projet européen de traçage des smartphones pour lutter contre le coronavirus. A l’origine, les deux établissements faisaient partie de l’ambitieux projet de recherche européen Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT), regroupant 130 organismes de huit pays. Mais vendredi, les deux partenaires suisses ont décidé d’explorer une autre solution, davantage respectueuse de la vie privée.
Le Figaro (17/04/2020). Interview de Shoshana Zuboff « Shoshana Zuboff: «Les applications de contrôle de la pandémie doivent être obligatoires, comme les vaccins» » Traduction d’une interview parue originellement dans La Repubblica «Shoshana Zuboff: ‘Le app per il controllo della pandemia possono essere obbligatorie come i vaccini’ »
VU D’AILLEURS - L’auteure du livre L’ère du capitalisme de surveillance nous explique pourquoi les systèmes numériques de contrôle de la pandémie devraient relever du secteur public et donc devenir obligatoires.
L’Usine Nouvelle (16/04/2020) « Sanofi et Luminostics s’associent pour développer un autotest du Covid-19 sur smartphone »
Le français Sanofi et la start-up californienne Luminostics font alliance pour le développement d’un test de dépistage du Covid-19 à faire soi-même sur son smartphone. Les travaux doivent débuter dans quelques semaines et la solution pourra voir le jour d’ici à la fin 2020 sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires.
WIRED (14/04/2020), « The Apple-Google Contact Tracing Plan Won’t Stop Covid Alone »
Putting the privacy of these smartphone apps aside, few Americans have been tested—and there’s a risk of false positives.
Apple and Google are offering a bold plan using signals from more than 3 billion smartphones to help stem the spread of the deadly coronavirus while protecting users’ privacy. But epidemiologists caution that—privacy concerns aside—the scheme will be of limited use in combating Covid-19 because of the technology’s constraints, inadequate testing for the disease, and users’ reluctance to participate.
Le Monde (10/04/2020), « Coronavirus : Apple et Google proposent un outil commun pour les applications de traçage des malades »
Les deux géants de la téléphonie vont mettre en place une solution technique mise à disposition des gouvernements.
Wired (05/04/2020), « Google and Apple Reveal How Covid-19 Alert Apps Might Look »
As contact tracing plans firm up, the tech giants are sharing new details for their framework—and a potential app interface.
Finding out that you’ve been exposed to a serious disease through a push notification may still seem like something out of dystopian science fiction. But the ingredients for that exact scenario will be baked into Google and Apple’s operating system in as soon as a matter of days. Now the two companies have shown not only how it will work, but how it could look—and how it’ll let you know if you’re at risk.
France Inter (04/04/2020) « Google et le Covid-19 ou le Big data au service des gouvernement »
Google a mis en ligne vendredi l’ensemble des données de déplacements des utilisateurs (qui ont activé l’option localisation) de son outil de cartographie, Google Maps. Des données qui doivent, selon le géant du web américain, permettre d’aider les dirigeants à améliorer l’efficacité de leur politique de confinement.
La Tribune (24/03/2020), « Covid-19 et contagion : vers une géolocalisation des smartphones en France ? »
Un comité de douze chercheurs et médecins va être mis en place à l’Élysée à partir de ce mardi pour conseiller le gouvernement sur les moyens d’endiguer la propagation du coronavirus. Le numérique figure parmi les thèmes à l’étude, notamment pour identifier des personnes ayant été potentiellement exposées au virus. De nombreux pays ont déjà opté pour la géolocalisation des smartphones afin de traquer les déplacements des individus.
Avis et infos experts
CNIL (25/05/2020) – Délibération n° 2020-056 du 25 mai 2020 portant avis sur un projet de décret relatif à l’application mobile dénommée «StopCovid» (demande d’avis n° 20008032)
Feu vert de la CNIL.
SI Lex (01/05/2020), par Calimaq : StopCovid, la subordination sociale et les limites au « Consent Washing »
J’ai déjà eu l’occasion dans un précédent billet de dire tout le mal que je pensais de StopCovid et je ne vais pas en rajouter à nouveau dans ce registre. Je voudrais par contre prendre un moment sur la délibération que la CNIL a rendue en fin de semaine dernière à propos du projet d’application, car elle contient à mon sens des éléments extrêmement intéressants, en particulier sur la place du consentement en matière de protection des données personnelles.
CNIL (26/04/2020), Publication de l’avis de la CNIL sur le projet d’application mobile « StopCovid »
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19, et plus particulièrement de la stratégie globale de « déconfinement », la CNIL a été saisie d’une demande d’avis par le secrétaire d’État chargé du numérique. Celle-ci concerne l’éventuelle mise en œuvre de « StopCovid » : une application de suivi de contacts dont le téléchargement et l’utilisation reposeraient sur une démarche volontaire. Les membres du collège de la CNIL se sont prononcés le 24 avril 2020.
Dans le contexte exceptionnel de gestion de crise, la CNIL estime le dispositif conforme au Règlement général sur la protection des données (RGPD) si certaines conditions sont respectées. Elle relève qu’un certain nombre de garanties sont apportées par le projet du gouvernement, notamment l’utilisation de pseudonymes.
La CNIL appelle cependant à la vigilance et souligne que l’application ne peut être déployée que si son utilité est suffisamment avérée et si elle est intégrée dans une stratégie sanitaire globale. Elle demande certaines garanties supplémentaires. Elle insiste sur la nécessaire sécurité du dispositif, et fait des préconisations techniques.
Elle demande à pouvoir se prononcer à nouveau après la tenue du débat au Parlement, afin d’examiner les modalités définitives de mise en œuvre du dispositif, s’il était décidé d’y recourir.
Conseil National du Numérique (24/04/2020), « Stop-Covid. Avis du Conseil National du Numérique »
Dans le cadre de la réponse à la crise du COVID-19, le secrétaire d’État chargé du Numérique a saisi le Conseil national du numérique pour émettre un avis sur les modalités de fonctionnement et de déploiement de l’application pour téléphones mobiles StopCOVID, dont le développement a été annoncé le 8 avril 2020.
Ligue des Droits de l’Homme (24/04/2020), « Lettre ouverte concernant le vote sur la mise en œuvre de l’application StopCovid »
Les risques d’atteinte au respect de la vie privée et au secret médical, les risques de surveillance généralisée au regard d’une efficacité tout à fait incertaine conduisent la Ligue des droits de l’Homme (LDH) à vous demander instamment de vous opposer au projet StopCovid.
Washington Post (23/04/2020). Tribune de Bill Gates (24/04/2020) « Here are the innovations we need to reopen the economy. Version lisible aussi sur son blog en [version courte](The first modern pandemic (short read) ) et en version longue. On peut voir qu’un informaticien devient « spécialiste » en épidémiologie et comment il promeut du solutionnisme technologique (tout en affirmant que ce n’est pas non plus la panacée). Il propose le contact tracing (tracage de contact)
Le deuxième domaine dans lequel nous avons besoin d’innovation est le contact tracing. Lorsqu’une personne est testée positive, les professionnels de santé publique doivent savoir qui d’autre cette personne pourrait avoir été infectée.
Pour l’instant, les États-Unis peuvent suivre l’exemple de l’Allemagne : interroger toutes les personnes dont le test est positif et utiliser une base de données pour s’assurer que quelqu’un assure le suivi de tous leurs contacts. Cette approche est loin d’être parfaite, car elle repose sur la déclaration exacte des contacts par la personne infectée et nécessite un suivi personnel important. Mais ce serait une amélioration par rapport à la manière sporadique dont le contact tracing se fait actuellement aux États-Unis.
Une solution encore meilleure serait l’adoption généralisée et volontaire d’outils numériques. Par exemple, il existe des applications qui vous aideront à vous rappeler où vous avez été ; si jamais vous êtes déclaré positif, vous pouvez revoir l’historique ou choisir de le partager avec la personne qui vient vous interroger sur vos contacts. Et certaines personnes ont proposé de permettre aux téléphones de détecter d’autres téléphones qui se trouvent à proximité en utilisant le Bluetooth et en émettant des sons que les humains ne peuvent pas entendre. Si une personne était testée positive, son téléphone enverrait un message aux autres téléphones, et son propriétaire pourrait se faire tester. Si la plupart des gens choisissaient d’installer ce genre d’application, cela en aiderait probablement certains.
Risque-tracage.fr (21/04/2020). Le traçage anonyme, dangereux oxymore. Analyse de risques à destination des non-spécialistes.
Des chercheurs de l’INRIA, du LORIA etc. se regroupent pour diffuser un note de vulgarisation sur les risques liés au traçage par téléphone. Ils produisent un PDF qui circule beaucoup.
Privacy International (20/04/2020) « There’s an app for that: Coronavirus apps »
Increased trust makes every response to COVID-19 stronger. Lack of trust and confidence can undermine everything. Should we trust governments and industry with their app solutions at this moment of global crisis?
Key findings:
- There are many apps across the world with many different uses.
- Some apps won’t work in the real world; the ones that do work best with more virus testing.
- They all require trust, and that has yet to be built after years of abuses and exploitation.
- Apple and Google’s contributions are essential to making contact-tracing work for their users; these are positive steps into privacy-by-design, but strict governance is required for making, maintaining and removing this capability.
La Quadrature du Net (14/04/2020), « Nos arguments pour rejeter StopCovid Posted »
Utilisation trop faible, résultats vagues, contre-efficacité sanitaire, discriminations, surveillance, acclimatation sécuritaire…
Ross Anderson (chercheur Univ. Cambridge), (12/04/2020) « Contact Tracing in the Real World »
Voici le véritable compromis entre la surveillance et la santé publique. Pendant des années, une pandémie a figuré en tête du registre des risques de la Grande-Bretagne, mais on a beaucoup moins dépensé pour s’y préparer que pour prendre des mesures antiterroristes, dont beaucoup étaient plus ostentatoires qu’efficaces. Pire encore, la rhétorique de la terreur a gonflé les agences de sécurité au détriment de la santé publique, prédisposant les gouvernements américain et britannique à ignorer la leçon du SRAS en 2003 et du MERS en 2015 - contrairement aux gouvernements de la Chine, de Singapour, de Taïwan et de la Corée du Sud, qui y ont prêté au moins quelque attention. Ce dont nous avons besoin, c’est d’une redistribution radicale des ressources du complexe industriel de surveillance vers la santé publique.
Nos efforts devraient porter sur l’extension des tests, la fabrication de ventilateurs, le recyclage de tous ceux qui ont une formation clinique, des infirmières vétérinaires aux physiothérapeutes, et la construction d’hôpitaux de campagne. Nous devons dénoncer des conneries quand nous en voyons et ne pas donner aux décideurs politiques le faux espoir que la techno-magie pourrait leur permettre d’éviter les décisions difficiles. Sinon, nous pouvons mieux être utiles en nous tenant à l’écart. La réponse ne doit pas être dictée par les cryptographes mais par les épidémiologistes, et nous devons apprendre ce que nous pouvons des pays qui ont le mieux réussi jusqu’à présent, comme la Corée du Sud et Taïwan.
Union Européenne (08/04/2020) - Rapport technique sur le contact tracing. European Centre for Disease Prevention and Control . « Contact tracing: public health management of persons, including healthcare workers, having had contact with COVID-19cases in the European Union. » Lien vers le pdf , Lien vers la page.
This document aims to helpEU/EEA public health authorities in the tracing and management of persons,including healthcare workers, who had contact with COVID-19 cases. It should be implemented in combination with non-pharmaceutical measures as appropriate.
The purpose of identifying and managing the contacts ofprobable or confirmedCOVID-19casesisto rapidly identify secondary cases that may arise after transmission from the primary known cases in order tointervene andinterruptfurther onward transmission. This is achieved through:
- the prompt identification of contacts of a probable or confirmedcase of COVID-19;
- providing contacts withinformation on self-quarantine, proper hand hygiene and respiratory etiquette measures,and advice around what to do if they develop symptoms;
- timely laboratory testingfor all those withsymptoms.
CEVIPOF (01/04/2020), Martial Foucault « Note 3 - Opinons sur l’usage du téléphone portable en période de crise du Coronavirus »
En France, aucune décision n’a encore été prise. Comme le démontrent les exemples étrangers précédents, plusieurs modalités d’usage des données cellulaires sont envisageables, allant d’une politique de santé publique partagée (Singapour) à une politique de surveillance sans consentement (Iran). Dans le cadre de l’enquête comparée «Attitudes sur le COVID-19», nous avons interrogé un échantillon représentatif de Français sur «la possibilité de mobiliser les opérateurs téléphoniques à des fins de contrôle des déplacements». Àcette question, une majorité de personnes exprime une opinion fortement défavorable (48%). Seules 33% des personnes interrogées (échantillon de 2000 personnes) y sont favorables. Le niveau d’indécision sesitue à 18,4%.L’évolution des réponses à cette question posée dans les mêmes termes entre les 16-17 mars et les 24-25 mars montre une dynamique fortement positive. Les raisons de cette progression sont à rechercher autour de l’aggravation réelle de la pandémie et de la perception par l’opinion de l’urgence de l’ensemble des politiques sanitaires, technologiques et maintenant numériques. Le cadrage médiatique, fondé sur des expériences étrangères, du possible recours aux téléphones ne précise pas la position que pourraient prendre les autorités françaises en la matière. C’est pourquoi, ici, la question posée dans les deux enquêtesporte volontairement sur la dimension la plus intrusive sur la vie privée et la plus liberticide (la formulation insiste sur une politique de surveillance).
Chaos Computer Club (06/04/2020), « 10 requirements for the evaluation of “Contact Tracing” apps »
Loin d’être fermé à la mise en oeuvre d’application mobile de contact tracing le CCC émet 10 recommandation hautement exigeantes pour rendre ces applications acceptables.
Facebook (06/04/2020), « De nouveaux outils pour aider les chercheurs en santé à suivre et à combattre le COVID-19 »
Dans le cadre du programme Data for Good de Facebook, nous proposons des cartes sur les mouvements de population que les chercheurs et les organisations à but non lucratif utilisent déjà pour comprendre la crise du coronavirus, en utilisant des données agrégées pour protéger la vie privée des personnes. Ils nous ont dit combien ces informations peuvent être précieuses pour répondre au COVID-19, et aujourd’hui nous annonçons de nouveaux outils pour soutenir leur travail :…
Google (blog), (03/04/2020), « Helping public health officials combat COVID-19 »
Starting today we’re publishing an early release of our COVID-19 Community Mobility Reports to provide insights into what has changed in response to work from home, shelter in place, and other policies aimed at flattening the curve of this pandemic. These reports have been developed to be helpful while adhering to our stringent privacy protocols and policies.
Officiel
Anti Cor (12/11/2020) « Application StopCovid : Anticor saisit le parquet national financier »
Anticor a déposé un signalement auprès du Procureur de la République, mercredi 10 juin, ayant pour objet l’attribution du contrat de maintenance de l’application StopCovid, qui n’aurait été soumis à aucune procédure de passation de marché public.
FRA (European Union Agency For Fundamentals Rights) - 28/05/2020 « Les réponses technologiques à la pandémie de COVID-19 doivent également préserver les droits fondamentaux »
Protection des données, respect de la vie privée et nouvelles technologiesAsile, migration et frontièresAccès à l’asileProtection des donnéesEnfants, jeunes et personnes âgéesPersonnes handicapéesOrigine raciale et ethniqueRomsDroits des victimes
De nombreux gouvernements sont à la recherche de technologies susceptibles de les aider à suivre et tracer la diffusion de la COVID-19, comme le montre un nouveau rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’UE (FRA). Les gouvernements qui utilisent la technologie pour protéger la santé publique et surmonter la pandémie se doivent de respecter les droits fondamentaux de chacun.
Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, 12/05/2020. Audition de M. Guillaume Poupard, directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) – Vidéos Sénat.
Explications sur Stop-Covid, nécessité de conserver la souveraineté de l’Etat dans ce domaine, inquiétudes au sujet de la progression des GAFAM dans le secteur de la santé. Inquiétudes au sujet de la montée en puissance du tracage de contacts dans les dispositifs Apple / Google, et l’éventualité d’un futur développement d’une économie dans ce secteur avec tous les biais que cela suppose.
ANSSI (27/04/2020), « Application StopCovid –L‘ANSSI apporte à Inria son expertise technique sur le volet sécurité numérique du projet »
Pilote du projet d’application StopCovid, à la demande du Secrétaire d’Etat chargé du numérique, Cédric O, l’Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria) est accompagné par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) sur les aspects de sécurité numérique.
INRIA (26/04/2020). Communiqué de presse annonçant officiellement l’équipe-projet de l’application Stop-Covid.
Inria, ANSSI, Capgemini, Dassault Systèmes, Inserm, Lunabee Studio, Orange, Santé Publique France et Withings (et Beta.gouv a été débarqué du projet, qui contiendra finalement peu de briques open-source).
Protocoles
Les protocoles et applications suivants, développés dans le cadre de la lutte contre Covid-19 utilisent en particulier le Bluetooth.
BlueTrace est le protocole open source inventé au sein du gouvernement de Singapour dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19. Le protocole est utilisé dans l’application TraceTogether. À son tour le gouvernemetn Australien implémente ce protocole dans l’application COVIDSafe distribuée en Australie.
En Europe, le protocole ouvert Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT/PEPP) utilise le bluetooth pour rechercher des contacts mais centralise des rapports sur un serveur centralisé. Son concurrent open source Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing ne permet pas au serveur central de signalement d’accéder aux journaux de contacts.
Pour la France, le protocole ROBERT (ROBust and privacy-presERving proximity Tracing) a été publié par l’INRIA le 18 avril 2020
Listes d’applications Covid-19 : fr.wikipedia.org/wiki/Applications_Covid-19
10.04.2020 à 02:00
Prophètes et technologistes à l’ère de la suspicion généralisée
Ha ! Le sacro-saint « révélateur ». À écouter et lire les médias, la pandémie Covid-19 que nous traversons aujourd’hui est censée « révéler » quelque chose, un message, un état d’esprit, l’avènement d’une prophétie. Et on voit proliférer les experts toutologues, devins des temps modernes, avatars des prédicateurs de l’An Mille, les charlatans de fin du monde. Je voudrais partager ici quelques réflexions au sujet des discours actuels sur la surveillance en situation de crise sanitaire.
(Note : ce billet a été publié sur le Framablog le 10 avril 2020)
Les prophètes
Faire une révélation, nous dit le dictionnaire, c’est porter à la connaissance quelque chose qui était auparavant caché, inconnu. Et le pas est vite franchi : pour nos prêtres médiatiques, il est très commode de parler de révélation parce que si le divin à travers eux manifeste ce qu’eux seuls peuvent dévoiler au public (eux seuls connaissent les voies divines), il leur reste le pouvoir de décider soit de ce qui était auparavant caché et doit être dévoilé, soit de ce qui était caché et n’est pas censé être dévoilé. Bref, on refait l’histoire au fil des événements présents : la sous-dotation financière des hôpitaux et les logiques de coupes budgétaires au nom de la rigueur ? voilà ce que révèle le Covid-19, enfin la vérité éclate ! Comment, tout le monde le savait ? Impossible, car nous avions tous bien affirmé que la rigueur budgétaire était nécessaire à la compétitivité du pays et maintenant il faut se tourner vers l’avenir avec ce nouveau paramètre selon lequel la rigueur doit prendre en compte le risque pandémique. Et là le prêtre devient le prophète de jours meilleurs ou de l’apocalypse qui vient.
Pourquoi je raconte tout cela ? Je travaille dans un CHU, les politiques de santé publiques me sont quotidiennes ainsi que la manière dont elles sont décidées et appliquées. Mais vous le savez, ce n’est pas le sujet de mes études. Je m’intéresse à la surveillance. Et encore, d’un point de vue historique et un peu philosophique, pour faire large. Je m’intéresse au capitalisme de surveillance et j’essaie de trouver les concepts qui permettent de le penser, si possible au regard de notre rapport à l’économie et au politique.
J’ai appris très tôt à me méfier des discours à tendance technologiste, et cela me vient surtout de ma formation initiale en philosophie, vous savez ce genre de sujet de dissertation où l’on planche sur le rapport technologie / politique / morale. Et à propos, sans pour autant faire de la philo, je ne saurais que conseiller d’aller lire le livre de Fred Turner qui, déjà en 2006 (la traduction est tardive), grattait assez profondément le vernis de la cyberculture californienne. Mais au fil des années de mon implication dans le logiciel libre et la culture libre, j’ai développé une autre sorte de sensibilité : lorsque les libertés numériques sont brandies par trop de prophètes d’un coup, c’est qu’il faut aller chercher encore ailleurs le discours qui nous est servi.
Pour exemple de l’effet rhétorique de la révélation, on peut lire cet article du géographe Boris Beaude, paru le 07 avril 2020 dans Libération, intitulé « Avec votre consentement ». L’auteur passe un long moment à faire remarquer au lecteur à quel point nous sommes vendus corps et âmes aux GAFAM et que la pandémie ne fait que révéler notre vulnérabilité :
Lorsque nous acceptons que de telles entreprises collectent les moindres détails de nos existences pour le compte de leurs clients et que nous doutons conjointement des régimes politiques qui nous gouvernent, nous réalisons que les effets de la propagation du Sars-Cov-2 ne sont qu’un révélateur de l’ampleur de notre vulnérabilité.
Il est important de comprendre la logique de ce discours : d’un côté on pose un diagnostic que seul un sage est capable de révéler et de l’autre on élève la pandémie et ses effet délétères au rang des sept plaies d’Égypte, qui sert de porte à une nouvelle perception des choses, en l’occurrence notre vulnérabilité face aux pratiques d’invasion de la vie privée par les GAFAM, et par extension, les pratiques des États qui se dotent des moyens technologiques pour surveiller et contrôler la population. Évidemment, entre la population assujettie et l’État-GAFAM, il y a la posture du prophète, par définition enviable puisqu’il fait partie d’une poignée d’élus livrant un testament aux pauvres pêcheurs que nous sommes. Reste plus qu’à ouvrir la Mer Rouge…
Arrêtons là si vous le voulez bien la comparaison avec la religion. Je l’affirme : non la crise COVID-19 ne révèle rien à propos du capitalisme de surveillance. Elle ne révèle rien en soi et encore moins à travers les prophètes auto-proclamés. Et la première des raisons est que ces derniers arrivent bien tard dans une bataille qui les dépasse.
Pendant la crise sanitaire que nous traversons il ne faut pas se demander ce qu’elle peut révéler mais interroger les discours qui se servent de cette crise pour justifier et mettre en œuvre des pratiques de surveillance et limiter encore davantage nos libertés. Penser les choses en termes de révélation n’a pour autre effet que de limiter toujours plus notre pouvoir d’action : que peut-on à l’encontre d’une révélation ?
Les amis de la Quadrature du Net (comme beaucoup d’autres, heureusement) préfèrent une approche bien plus structurée. Ils affirment par exemple dans un récent communiqué que, au regard de la surveillance, la crise sanitaire Covid-19 est un évènement dont l’ampleur sert d’argument pour une stratégie de surveillance de masse, au même titre que les attentats terroristes. Ceci n’est pas une révélation, ni même une mise en garde. C’est l’exposé des faits, ni plus ni moins. Tout comme dire que notre ministre de l’intérieur C. Castaner a d’abord affirmé que l’État Français n’avait pas pour intention de copier la Corée du Sud et la Chine en matière de traçage de téléphones portables, avant de revenir sur ses propos et affirmer que les services gouvernementaux planchent sur une application censée tracer les chaînes de transmission. Qui s’est offusqué de ce mensonge d’État ? C’est devenu tellement banal. Pire, une telle application permettrait d’informer les utilisateurs s’ils ont « été dans les jours précédents en contact avec quelqu’un identifié positif au SARS-CoV-2 », comme l’affirment les deux ministres Castaner et Véran dans un entretien au Monde. C’est parfait comme technique de surveillance : la Stasi pratiquait déjà ce genre de chose en organisant une surveillance de masse basée sur la suspicion au quotidien.
Le smartphone n’est qu’un support moderne pour de vieilles recettes. Le Covid-19 est devenu un prétexte, tout comme les attentats terroristes, pour adopter ou faire adopter une représentation d’un État puissant (ce qu’il n’est pas) et faire accepter un État autoritaire (ce qu’il est). Cette représentation passe par un solutionnisme technologique, celui prôné par la doctrine de la « start-up nation » chère à notre président Macron, c’est-à-dire chercher à traduire l’absence d’alternative politique, et donc l’immobilisme politique (celui de la rigueur budgétaire prôné depuis 2008 et même avant) en automatisant la décision et la sanction grâce à l’adoption de recettes technologiques dont l’efficacité réside dans le discours et non dans les faits.
Techno-flop
Le solutionnisme technologique, ainsi que le fait remarquer E. Morozov, est une idéologie qui justifie des pratiques de surveillance et d’immenses gains. Non seulement ces pratiques ne réussissent presque jamais à réaliser ce pourquoi elles sont prétendues servir, mais elles sont le support d’une économie d’État qui non seulement dévoie les technologies afin de maîtriser les alternatives sociales, voire la contestation, mais entre aussi dans le jeu financier qui limite volontairement l’appropriation sociale des technologies. Ainsi, par exemple, l’illectronisme des enfants et de leurs enseignants livrés à une Éducation Nationale numériquement sous-dotée, est le fruit d’une volonté politique. Comment pourrait-il en être autrement ? Afin d’assurer la « continuité pédagogique » imposée par leur ministre, les enseignants n’ont eu d’autres choix que de se jeter littéralement sur des services privateurs. Cette débandade est le produit mécanique d’une politique de limitation volontaire de toute initiative libriste au sein de l’Éducation Nationale et qui serait menée par des enseignants pour des enseignants. Car de telles initiatives remettraient immanquablement en question la structure hiérarchique de diffusion et de valorisation des connaissances. Un tel gouvernement ne saurait supporter quelque forme de subsidiarité que ce soit.
La centralisation de la décision et donc de l’information… et donc des procédés de surveillance est un rêve de technocrates et ce rêve est bien vieux. Déjà il fut décrié dès les années 1970 en France (voir la première partie de mon livre, Affaires Privées) où la « dérive française » en matière de « grands fichiers informatisés » fut largement critiquée pour son inefficacité coûteuse. Qu’importe, puisque l’important n’est pas de faire mais de montrer qu’on fait. Ainsi l’application pour smartphone Stop Covid (ou n’importe quel nom qu’on pourra lui donner) peut d’ores et déjà figurer au rang des grands flops informatiques pour ce qui concerne son efficacité dans les objectifs annoncés. Il suffit de lire pour cela le récent cahier blanc de l’ACLU (Union Américaine pour les libertés civiles), une institution fondée en 1920 et qu’on ne saurait taxer de repère de dangereux gauchistes.
Dans ce livre blanc tout est dit, ou presque sur les attentes d’une application de tracing dont l’objectif, tel qu’il est annoncé par nos ministres (et tel qu’il est mentionné par les pays qui ont déjà mis en œuvre de telles applications comme la Chine ou Israël), serait de déterminer si telle personne a été exposée au virus en fréquentant une autre personne définie comme contagieuse. C’est simple :
- Il faut avoir un smartphone avec soi et cette application en fonction : cela paraît basique, mais d’une part tout le monde n’a pas de smartphone, et d’autre part tout le monde n’est pas censé l’avoir sur soi en permanence, surtout si on se contente de se rendre au bureau de tabac ou chez le boulanger…
- aucune technologie n’est à ce jour assez fiable pour le faire. Il est impossible de déterminer précisément (c’est-à-dire à moins de deux mètres) si deux personnes sont assez proches pour se contaminer que ce soit avec les données de localisation des tours de téléphonie (triangulation), le GPS (5 à 20 mètres) ou les données Wifi (même croisées avec GPS on n’a guère que les informations sur la localisation de l’émetteur Wifi). Même avec le bluetooth (technologie plébiscitée par le gouvernement Français aux dernières nouvelles) on voit mal comment on pourrait assurer un suivi complet. Ce qui est visé c’est en fait le signalement mutuel. Cependant, insister sur le bluetooth n’est pas innocent. Améliorer le tracing dans cette voie implique un changement dans nos relations sociales : nous ne sommes plus des individus mais des machines qui s’approchent ou s’éloignent mutuellement en fonction d’un système d’alerte et d’un historique. Qui pourra avoir accès à cet historique ? Pourra-t-on être condamné plus tard pour avoir contaminé d’autres personnes ? Nos assurances santé autoriseront-elles la prise en charge des soins s’il est démontré que nous avons fréquenté un groupe à risque ? Un projet européen existe déjà (PEPP-PT), impliquant entre autres l’INRIA, et il serait important de surveiller de très près ce qui sera fait dans ce projet (idem pour ce projet de l’École Polytechnique de Lausanne).
- Ajoutons les contraintes environnementales : vous saluez une personne depuis le second étage de votre immeuble et les données de localisation ne prennent pas forcément en compte l’altitude, vous longez un mur, une vitrine, une plaque de plexiglas…
Bref l’UCLA montre aimablement que la tentation solutionniste fait perdre tout bon sens et rappelle un principe simple :
Des projets ambitieux d’enregistrement et d’analyse automatisés de la vie humaine existent partout de nos jours, mais de ces efforts, peu sont fiables car la vie humaine est désordonnée, complexe et pleine d’anomalies.
Les auteurs du rapport écrivent aussi :
Un système de suivi de localisation dans le temps peut être suffisamment précis pour placer une personne à proximité d’une banque, d’un bar, d’une mosquée, d’une clinique ou de tout autre lieu sensible à la protection de la vie privée. Mais le fait est que les bases de données de localisation commerciales sont compilées à des fins publicitaires et autres et ne sont tout simplement pas assez précises pour déterminer de manière fiable qui était en contact étroit avec qui.
En somme tout cela n’est pas sans rappeler un ouvrage dont je conseille la lecture attentive, celui de Cathy O’Neil, Algorithmes: la bombe à retardement (2018). Cet ouvrage montre à quel point la croyance en la toute puissance des algorithmes et autres traitements automatisés d’informations dans le cadre de processus décisionnels et de politiques publiques est la porte ouverte à tous les biais (racisme, inégalités, tri social, etc.). Il n’en faudrait pas beaucoup plus si l’on se souvient des débuts de la crise Covid-19 et la suspicion dans nos rues où les personnes présentant des caractères asiatiques étaient stigmatisées, insultées, voire violentées…
Ajoutons à cela les effets d’annonce des GAFAM et des fournisseurs d’accès (Orange, SFR…) qui communiquaient il y a peu, les uns après les autres, au sujet de la mise à disposition de leurs données de localisation auprès des gouvernements. Une manière de justifier leur utilité sociale. Aucun d’entre eux n’a de données de localisations sur l’ensemble de leurs utilisateurs. Et heureusement. En réalité, les GAFAM tout comme les entreprises moins connues de courtage de données (comme Acxiom), paient pour cela. Elles paient des entreprises, souvent douteuses, pour créer des applications qui implémentent un pompage systématique de données. L’ensemble de ces pratiques crée des jeux de données vendues, traitées, passées à la moulinette. Et si quiconque souhaite obtenir des données fiables permettant de tracer effectivement une proportion acceptable de la population, il lui faut accéder à ces jeux… et c’est une denrée farouchement protégée par leurs détenteurs puisque c’est un gagne-pain.
De la méthode
À l’heure où les efforts devraient se concentrer essentiellement sur les moyens médicaux, les analyses biologiques, les techniques éprouvées en santé publique en épidémiologie (ce qui est fait, heureusement), nous voilà en train de gloser sur la couleur de l’abri à vélo. C’est parce que le solutionnisme est une idéologie confortable qui permet d’évacuer la complexité au profit d’une vision du monde simpliste et inefficace pour laquelle on imagine des technologies extrêmement complexes pour résoudre « les grands problèmes ». Ce n’est pas une révélation, simplement le symptôme de l’impuissance à décider correctement. Surtout cela fait oublier l’impréparation des décideurs, les stratégies budgétaires néfastes, pour livrer une mythologie technologiste à grand renfort de communication officielle.
Et l’arme ultime sera le sondage. Déjà victorieux, nos ministères brandissent une enquête d’opinion du département d’économie de l’Université d’Oxford, menée dans plusieurs pays et qui montre pour la France comme pour les autres pays, une large acceptation quant à l’installation d’une application permettant le tracing, que cette installation soit volontaire ou qu’elle soit imposée1. Est-ce étonnant ? Oui, effectivement, alors même que nous traversons une évidente crise de confiance envers le gouvernement, la population est prête à jouer le jeu dangereux d’une surveillance intrusive dont tout laisse supposer que cette surveillance se perpétuera dans le temps, virus ou pas virus. Mais cela ne signifie pas pour autant que la confiance envers les dirigeants soit rétablie. En effet le même sondage signale que les retombées politiques en cas d’imposition d’un tel système sont incertaines. Pour autant, c’est aussi un signal envoyé aux politiques qui vont alors se lancer dans une quête frénétique du consentement, quitte à exagérer l’assentiment pressenti lors de cette enquête. C’est déjà en cours.
À mon avis, il faut rapprocher le résultat de cette enquête d’une autre enquête récente portant le plébiscite de l’autoritarisme en France. C’est une enquête du CEVIPOF parue en mars 2020 qui montre « l’emprise du libéralisme autoritaire en France », c’est-à-dire que le manque de confiance dans l’efficacité du gouvernement ne cherche pas son remède dans une éventuelle augmentation des initiatives démocratiques, voire alternativistes, mais dans le refuge vers des valeurs de droite et d’extrême droite sacrifiant la démocratie à l’efficacité. Et ce qui est intéressant, c’est que ceux qui se vantaient d’apporter plus de société civile à la République sont aussi ceux qui sont prêts à dévoyer la démocratie. Mais qu’on y prenne garde, ce n’est pas vraiment une affaire de classe sociale, puisque cette orientation autoritaire est aussi valable dans les tranches basses et moyennes. On rejoint un peu les propos d’Emmanuel Todd dans la première partie de son ouvrage Les Luttes de classes en France au XXIe siècle, données sérieuses à l’appui (y compris celles de l’Insee).
Alors quoi ? les Français sont-ils définitivement des veaux heureux d’aller à l’abattoir ? Honnêtement, parfois on peut le penser. Mais pas là. Non. L’enquête d’opinion d’Oxford a été menée dans un climat général extrêmement angoissant, et inédit. Pour retrouver un tel degré de panique dans la population, il faudrait par exemple se souvenir de la crise des missiles cubains et de la manière dont elle a été mise en scène dans les médias américains. Même l’épisode Tchernobyl en France n’a pas eu cet impact (ok, on a largement minimisé le problème). Et là dedans, avec un gouvernement à la fois empêtré et sidéré (avec la chargée de comm' S. Ndiaye alignant ad nauseam sottises et âneries), on fait un sondage dont les tenants et aboutissants techniques sont loin d’être évidents et qui pose la question : êtes-vous prêt à installer une application de tracing sur votre mobile qui permettrait de lutter contre l’épidémie ? Sérieux, on attend quoi comme réponse ? Sur plusieurs pays qui ont connu les mêmes valses-hésitations politiques, le fait que les réponses soient à peu près les mêmes devrait mettre la puce à l’oreille, non ? Bien sûr, allez demandez ce qu’elles pensent de la vidéosurveillance à des personnes qui se sont fait agresser dans la rue, pensez-vous que nous aurions les mêmes réponses si le panel était plus large ? Ce que je veux dire, c’est que le panel des 1.000 personnes interrogées en pleine crise sanitaire n’est représentatif que de la population touchée par la crise sanitaire, c’est-à-dire un panel absolument homogène. Évidemment que les tendances politiques ne viennent donc qu’en second plan et ne jouent qu’un rôle négligeable dans les réponses données.
Je ne suis pas statisticien, je ne peux donner mon sentiment qu’avec mes mots à moi. Mais, n’est-ce pas, nous sommes déjà habitués au techniques d’extorsion (fabrique ?) de consentement. À celui-ci s’ajoute une certaine pauvreté dans la manière d’appréhender cette fuite en avant vers la surveillance. Avec l’expression « Big Brother », on a l’impression d’avoir tout dit. Mais c’est faux. On ne passe pas si facilement d’un libéralisme autoritaire à une dystopie orwellienne, il y a des étapes, et à chaque étape nous prenons une direction. Scander « Big Brother » (comme la récente Une de l’Obs le 02 avril 2020 « Big Brother peut-il nous sauver ? »), c’est un peu comme si on cherchait à donner une théorie sans d’abord la démontrer. « Big Brother » impose une grille de lecture des événements tout en prédisant déjà la fin. Ce n’est pas une bonne méthode.
Y-a-t’il une bonne méthode ? Étudier la surveillance, c’est d’abord faire appel à un ensemble de concepts que l’on met à l’épreuve. Il faut signaler sur ce point l’excellent édito de Martin French et Torin Monahan dans le dernier numéro de la revue canadienne Surveillance & Society, intitulé « Dis-ease Surveillance: How Might Surveillance Studies Address COVID-19? ». C’est tout un programme de recherche qui est développé ici, à titre prospectif. La première chose que s’empressent de signaler les auteurs, c’est que surveiller le Covid-19, ce n’est pas surveiller la population. Ce sont deux choses bien différentes que les politiques feraient mieux de ne pas perdre de vue. Surveiller le Covid-19 c’est faire de l’épidémiologie, et identifier des cas (suspects, déclarés, etc.). Et là où on peut s’interroger, c’est sur la complexité des situations qu’une approche scientifique réduit à des éléments plus simples et pertinents. Si, pour les besoins d’une étude, il faut faire un tri social, il importe de savoir ce que l’étude révélera finalement : y-a-t’il plus de patients Covid-19 dans les couches pauvres de la population ? Comment l’information sur la surveillance circule et est reçue par les populations ? Et plus généralement qu’est-ce que la surveillance des populations en situation de pandémie, quelles sont les contraintes éthiques, comment les respecter ?
Ensuite vient tout un ensemble de concepts et notions qu’il faut interroger au regard des comportements, des groupes de pression, des classes sociales et tous autres facteurs sociaux. Par exemple la vigilance : est-elle encouragée au risque de la délation, est-elle définie par les autorités comme une vigilance face à la maladie et donc une forme d’auto-surveillance ? Il en est de même au sujet de l’anticipation, la stigmatisation, la marginalisation, la prévention, la victimisation, l’exclusion, la confiance, autant d’idées qui permettent de définir ce qu’est la surveillance en situation de pandémie. Puis vient la question des conséquences de la surveillance en situation de pandémie. Là on peut se référer à la littérature existante à propos d’autres pandémies. Je ne résiste pas à citer les auteurs :
L’écologie informationnelle contemporaine se caractérise par une forme de postmodernisme populiste où la confiance dans les institutions est érodée, ne laissant aucun mécanisme convenu pour statuer sur les demandes de vérité. Dans un tel espace, la peur et la xénophobie remplissent facilement le vide laissé par l’autorité institutionnelle. En attendant, si les gens ont perdu confiance dans l’autorité institutionnelle, cela ne les protégera pas de la colère des institutions si l’on pense qu’ils ont négligemment contribué à la propagation de COVID-19. Déjà, des poursuites pénales sont en cours contre la secte chrétienne qui a contribué à l’épidémie en Corée du Sud, et les autorités canadiennes affirment qu’elles n’excluent pas des sanctions pénales pour « propagation délibérée de COVID-19 ». Comme nous l’avons vu en ce qui concerne le VIH, la réponse de la justice pénale a connu un regain d’intérêt au cours de la dernière décennie, ce qui laisse entrevoir la montée d’une approche de plus en plus punitive des maladies infectieuses. Dans le cas du VIH, cette évolution s’est produite sans qu’il soit prouvé qu’une réponse de la justice pénale contribue à la prévention du VIH. À la lumière de ces développements, les chercheurs devraient s’attendre — et s’interroger sur les implications des flux de données sanitaires dans les systèmes de justice pénale.
Effectivement, dans un monde où le droit a perdu sa fonction anthropologique et où l’automatisation de la justice répond à l’automatisation de nos vies (leur gafamisation et leur réduction à des données numériques absconses) on peut se demander si l’autoritarisme libéral ne cherchera pas à passer justement par le droit, la sanction (la punition) pour affirmer son efficacité, c’est-à-dire se concentrer sur les effets au détriment de la cause. Qu’importe si l’application pour smartphone Covid-19 dit le vrai ou pas, elle ne saurait être remise en cause parce que, de manière statistique, elle donne une représentation de la réalité que l’on doit accepter comme fidèle. Ce serait sans doute l’une des plus grandes leçons de cette épidémie : la consécration du capitalisme de surveillance comme la seule voie possible. Cela, ce n’est pas une prophétie, ce n’est pas une révélation, c’est le modèle dans lequel nous vivons et contre lequel nous ne cessons de résister (même inconsciemment).
Crédit image d’en-tête : Le Triomphe de la Mort, Pieter Brueghel l’Ancien (1562) – Wikipédia.
-
Un sondage réalisé à une semaine d’intervalle dément complètement les résultats de celui de l’université d’Oxford. Il a été réalisé sur la population française par l’IFOP suite à une demande de la Fondation Jean-Jaurès. Il apparaît qu’une majorité de français est en fait opposée à une application de type Stop-Covid. Voir Maxime des Gayets, « Tracking et Covid : extension du domaine de l’absurde », Fondation Jean-Jaurès, 12/04/2020 ↩︎
24.03.2020 à 01:00
Culture de la surveillance : résistances
« Lutte pour les libertés numériques », « droits et libertés sur Internet », liberté, liberté, j’écris ton nom… Sauf qu’il n’a jamais été autant question de liberté dans le monde numérique sans qu’elle finisse invariablement à se retrouver comme réduite à une simple revendication d’auto-détermination individuelle. Nous revendiquons un « droit à la connexion », nous exigeons de pouvoir rester maîtres des données que nous transmettons (et nous ne le sommes pas). Mais ces droits et ces libertés, nous les réclamons en tant que sujets de pouvoir ou plutôt d’une couche de pouvoirs, impérialisme économique et concentration de technologies. Par ces incessantes réclamations, n’est-ce pas plus simplement que nous réaffirmons sans cesse notre soumission au capitalisme de surveillance ?
J’ignore encore, à l’heure où j’écris ces lignes, où je veux en venir exactement. Pas banal direz-vous, car j’ai habitué les lecteurs de ce blog à d’autres stratégies, mais baste ! En ces instants de confinement généralisé, j’ai bien envie de me laisser aller à quelques détours réflexifs. Je voudrais vous parler de Michel Foucault, de Michel de Certeau, des surveillance studies1, et d’autres enjeux que je ne développe pas dans mon récent bouquin (Affaires Privées) parce que la réflexion n’est pas encore assez mûre.
Je feuilletais récemment un ouvrage collectif intitulé Data Politics. Worlds, Subjects, Rights2, un de ces nombreux ouvrages qui fleurissent depuis une dizaine d’années (et plus encore depuis les révélations d’E. Snowden) dans le monde de la recherche en politique et sociologie du côté anglo-saxon. Me sont venues alors quelques réflexions. Ce n’est pas que dans la vieille Europe nous soyons démunis de ce côté-là, et en France encore moins, mais nous avons un gros défaut : une tendance à l’auto-centrisme.
C’est peut-être en réponse à cette limitation intellectuelle que récemment la « littérature » scientifique (et journalistique) en France a commencé par cesser la complainte du « ils nous surveillent, regardez comment », pour se pencher sur l’analyse des causes et des processus de ce qu’on a encore bien du mal à appeler le capitalisme de surveillance. Cette dernière expression est employée un peu partout, mais il est bien rare de trouver une publication académique en France qui l’utilise vraiment. Lorsque c’est le cas, on se tourne généralement vers une seule autrice, Shoshana Zuboff, qui propose effectivement une lecture du capitalisme de surveillance très pertinente puisqu’elle donne une analyse systématique des pratiques des entreprises, la répartition du pouvoir et de la décision que cela induit et l’impact sur la vie privée. Ainsi on a assisté depuis 2014 à la publication de nombreux articles de S. Zuboff en Allemagne (en particulier dans les versions allemandes et anglaises du Frankfurter Allgemeine Zeitung ) et aux États-Unis, avec le point culminant de son ouvrage monumental The Age of Surveillance Capitalism (publié d’abord en Allemagne puis aux États-Unis, et bientôt en France). On prévoit alors la « déferlante Zuboff » dans les prochaines publications ici et là : le Monde Diplomatique à son tour, puis la revue Esprit… Les colonnes sont ouvertes, on bouffera du Zuboff en 2020.
Tout cela est bon. Vraiment. Déjà parce que Zuboff est plus digeste que Masutti (cf. AffairesPrivées), mais surtout parce qu’il est très important d’avoir une base solide sur laquelle on peut commencer à discuter. Je l’ai déjà dit sur d’autres billets de ce blog, mais j’admire vraiment S. Zuboff parce qu’elle fourni dans son travail une analyse globale des pratiques de surveillance de l’économie numérique. C’est un travail essentiel aujourd’hui. Plus encore en ces jours de confinement « Covid 19 » où le solutionnisme technologique bat son plein dans les tentatives pathétiques de contrôle des populations. Il est vrai que la « start-up nation » tant vantée ces deux dernières années est encore attendue au tournant alors que c’est bien du côté de l’Économie Sociale et Solidaire que nous voyons émerger créativité et solidarité numériques pour palier les manquements de l’État-Gafam. S. Zuboff ne montre pas autre chose que le grignotage néolibéral des fonctions publiques et des libertés individuelles, ce qu’elle voit à la fois comme une injustice et une menace pour la démocratie.
Cependant (vous le reconnaissez cet adverbe assassin et jubilatoire des pédants qui critiquent le travail des autres ?), cependant, dis-je, cette analyse de S. Zuboff repose presque exclusivement sur l’idée que le capitalisme de surveillance est une dépossession de l’expérience individuelle, au sens d’un contrôle des masses consommatrices et productives, afin d’imposer un modèle économique qui ne crée pas autre chose qu’un déséquilibre dans la dynamique normale du capitalisme (concurrence, égalité, choix, etc.). Elle en vient même à déclarer que l’atteinte à la vie privée, moteur du capitalisme de surveillance est la marque d’une appropriation de savoirs (qui possède l’information et qui décide ?) d’ordre « pathologique ». En d’autres termes nous parlons donc d’un capitalisme malade qu’il faudrait soigner. Et, de là, S. Zuboff plaide pour une prise de conscience générale des décideurs afin de ré-organiser la régulation et rétablir l’équilibre économique.
Bon. Là-dessus, je ne suis pas d’accord (et je ne suis pas le seul). D’abord, d’un point de vue méthodologique il y a comme un (gros) problème : cette économie de la surveillance ne commence pas avec les géants de la Silicon Valley, elle s’inscrit dans une histoire que S. Zuboff élude complètement. Et si elle l’élude, c’est parce que vouloir influencer les comportements de consommation de masse, c’est déjà vieux (le marketing, c’est les années 1920), mais surtout la critique consistant à dénoncer les atteintes à la vie privée en s’appuyant sur des procédures informatisées et des formules prédictives, c’est un processus normal du capitalisme moderne dans une société informatisée, c’est-à-dire au moins depuis les années 1960 — et ça c’est ce que j’écris dans mon bouquin, entre autre. Si bien que S. Zuboff s’inscrit en fait dans une tradition déjà bien ancienne des contempteurs d’une économie de l’atteinte à la vie privée, qui dénonçaient déjà les pratiques à l’œuvre et dont les ouvrages furent de véritables best-seller dans les années 1960 et 1970 (Arthur Miller, James B. Rule, Alan Westin, etc.).
Mais S. Zuboff apporte bien des nouvelles choses. Elle contextualise son analyse en se concentrant sur l’idéologie de la Silicon Valley dont elle démontre comment, de manière réfléchie, cette idéologie grignote petit à petit nos libertés. S. Zuboff fait tout cela de manière excessivement renseignée, pointant, démontrant avec exactitude (et de nombreux exemples) comment les stratégies des « capitalistes de la surveillance » organisent la confusion entre marché et individu, nient la société pour nous assujettir à leurs modèles. Ce que des gens comme Fred Turner avaient déjà pointé en montrant que les utopies soi-disant contre-culturelles à l’origine de ce « nouveau monde numérique », n’étaient finalement qu’un échafaudage en carton-pâte, S. Zuboff l’intègre davantage dans une confrontation entre une nouvelle idéologie néfaste de la dérégulation et un capitalisme bien régulé où l’État reprendrait ses prérogatives et les individus leur pouvoir d’autodétermination de soi.
Oui, mais… non. Car si ce capitalisme de surveillance apporte des nouvelles règles, elles sont fatalement à l’épreuve de la société et de la culture. Et ce travail d’analyse manque cruellement à S. Zuboff. La réalité de l’idéologie de la Silicon Valley, c’est une augmentation délirante du chômage et de la précarisation, des exploitations nationales et mondiales de la pauvreté, de l’environnement et du climat, mais aussi les luttes solidaires contre l’ubérisation de l’économie, et tout un ensemble de résistances sociales qui font que non, décidément non, nous ne sommes pas que des sujets soumis aux pouvoirs. Si le capitalisme de surveillance impose ses jeux de pouvoir par le biais des États qui, sous couvert de solutionnisme technologique usent et abusent des contrôle des populations, ou par le jeu plus direct de la captation des données et de la prédictions des comportements de consommation, il reste que concrètement, aux bas niveaux des interactions sociales et des comportements collectifs, tout ne se passe pas de manière aussi mécanique qu’on voudrait le croire.
S. Zuboff reprend (sans le dire) l’expression de capitalisme de surveillance des auteurs de la Monthly Review. J’ai déjà eu l’occasion de disserter sur cette usurpation ici et là, et j’en parle aussi dans mon ouvrage, aussi je ne vais pas y revenir. En fait, le capitalisme de surveillance est surtout un projet d’étude, une approche du capitalisme. Au lieu d’en faire un objet qui serait le résultat d’une distorsion d’un capitalisme idéal, c’est au contraire une lecture historique (matérialiste) du capitalisme qui est proposée et que S. Zuboff ne peut pas voir. Il est en effet primordial d’envisager le capitalisme de surveillance dans l’histoire, dans une histoire de la surveillance. Par conséquent il est tout aussi important de confronter la lecture de S. Zuboff aux faits sociaux et historiques. C’est ce que j’ai fait dans mon livre avec l’informatisation de la société depuis les années 1960, mais on peut aussi bien le faire avec une approche sociologique.
Maintenant j’en reviens à la référence que je citais en tout début de ce billet, Data Politics. Worlds, Subjects, Rights. Reconnu depuis des années dans le milieu des surveillance studies, le sociologue David Lyon, publie dans ce livre un chapitre (num. 4) que j’ai trouvé tout particulièrement pertinent. Il s’intitule « Surveillance Capitalism, Surveillance Culture and Data Politics ». Ces derniers temps, D. Lyon a beaucoup œuvré autour du livre de S. Zuboff et de la question du capitalisme de surveillance, notamment par des communications dans des colloques (comme ici) ou en interview (comme ici)3. Cela m’avait un peu étonné qu’il ne choisisse pas d’avoir un peu plus de recul par rapport à ces travaux, mais en réalité, j’avais mal lu. Dans le chapitre en question, D. Lyon propose de sortir du dilemme « zubovien » (pour le coup je ne suis pas fort en néologismes) en confrontant d’un côté le point de vue de S. Zuboff et, de l’autre côté, l’idée qu’il existe une « culture de la surveillance », c’est-à-dire en fait une porte de sortie que S. Zuboff ne parvient pas à entr’ouvrir mais qui existe bel et bien, celle des résistances aux capitalisme de surveillance. Des résistances qui ne sont pas de simples revendications pour un capitalisme mieux régulé. En fait, sans trop le dire, D. Lyon voit bien que l’analyse de S. Zuboff, aussi complète soit-elle du côté des pratiques, ne va guère plus loin en raison d’une croyance tout aussi idéologique en la démocratie libérale (et ça c’est moi qui l’ajoute, mais c’est pourtant vrai).
Après avoir rapidement mentionné l’existence de poches de résistances importantes autour du libre accès aux connaissances et les luttes collectives d’activistes, D. Lyon en vient à montrer que les contours d’une culture de la surveillance sont justement dessinés par les résistances et les pratiques de contournement dans la société. Autant, selon moi, le salut réside dans des résistances affirmées comme telles et qui s’imposent aux pouvoirs économiques et politiques (j’y reviendrai plus loin), autant il est vrai que ces résistances plus affirmées ne seraient rien si elles ne prenaient pas leurs racines sociales dans quelque chose de beaucoup plus diffus et que D. Lyon va chercher chez un penseur bien français-de-chez-nous (mais avec une carrière internationale), Michel de Certeau.
Bon alors, là c’est un gros morceau, je vais essayer de faire court, surtout que je ne suis pas sûr de viser juste car je rappelle que ceci n’est qu’un billet de blog prospectif.
Penchons-nous un instant sur des sujets qui gravitent autour de la théorie de l’action. On parle d’action individuelle ou collective, et de la manière dont elle se « déploie ». Par exemple, on peut penser l’action selon plusieurs angles de vue : la décision, le choix, les déterminant cognitifs, la rationalité, mais aussi la manière dont l’action peut être contrainte, normée, obéissant à une éthique, consciente ou inconsciente, etc. En sociologie ou en anthropologie, on peut dire que l’action est le plus souvent vue comme soumise à des contraintes (les institutions, les organisations sociales, les traditions).
Parmi les élément rationnels qui guident l’action, on peut mentionner les savoirs, mais aussi les éléments culturels qui ne sont pas vraiment des savoirs (au sens de connaissances ou de savoir-faire) mais sont de l’ordre des éléments de construction des représentations. Une vue de l’extérieur de l’environnement social contraint. Pour David Lyon, il y a les utopies (ou les dystopies) qui, comme œuvres artistiques constituent autant d’accroches à une éthique de l’action. De mon côté, j’ai pu voir à quel point, effectivement, depuis 50 ans, l’œuvre 1984 d’Orwell est systématiquement utilisée, presque de manière méthodologique, pour justifier des réflexions sur la société de surveillance. Ce faisant, on peut alors effectivement penser la société en fonction de ces représentations et orienter des actions de résistance, par exemple en fonction de valeurs que l’on confronte aux normes imposées. C’est tout l’objet de cette conférence d’Alain Damasio au Festival de la CNT en 2015.
Par exemple, je reprendrai uniquement cette citation d’Arthur R. Miller, écrite dans son célèbre ouvrage Assault on Privacy: Computers, Data Banks and Dossiers en 1971, et qui donne immédiatement la saveur des débats qui avaient lieu à ce moment-là :
Il y a à peine dix ans, on aurait pu considérer avec suffisance Le meilleur des mondes de Huxley ou 1984 d’Orwell comme des ouvrages de science-fiction excessifs qui ne nous concerneraient pas et encore moins ce pays. Mais les révélations publiques répandues au cours des dernières années au sujet des nouvelles formes de pratiques d’information ont fait s’envoler ce manteau réconfortant mais illusoire.
L’informatisation de la société a provoqué des changements évidents dans les contraintes sociales. Institutions, organisations, cadres juridiques, hiérarchies, tout s’est en quelque sorte enrichi d’une puissance calculatoire et combinatoire qu’est l’informatique. C’est dans ce contexte (et le terme contexte est important ici) qu’il faut penser la théorie de l’action. Et j’estime que les penseurs post-modernes, à l’époque même de l’informatisation de la société, n’ont pas vraiment pris la mesure du problème de la captation des données et de la transformation de l’économie. Certes, il y a toujours Deleuze et sa fameuse « société de contrôle », mais comme d’autres il ne pouvait pas penser qu’allait émerger une culture de la surveillance car il pensait d’abord en termes de contraintes sociales imposées (par les institutions, d’abord, ou par les organisations comme les banques) et, dans tout cela, l’individu en recherche impossible d’émancipation parce que tout est bouclé par le discours, une impossibilité d’énoncer l’alternative.
Revenons alors à la théorie de l’action. L’individu (doté d’un capital de savoirs spécifique à chacun) serait toujours sujet soumis aux forces, aux contraintes de l’environnement (géographie, économie, politique, anthropologie…) dans lequel il se situe. C’est en quelque sorte l’héritage de la sociologie de Bourdieu, celle de la reproduction des hiérarchies sociales mais aussi celle d’une théorie de l’action selon laquelle les stratégies des individus sont des habitus adaptés au monde social dans lequel il évoluent dans les contraintes de compétitions, de structures et de violence symbolique. En somme, l’individu est fondamentalement soumis aux règles dictées par les hiérarchies sociales et l’environnement social construit pour lui dans lequel il doit lui aussi essayer d’exister socialement. Mais dans ce contexte, l’individu n’est pas pleinement conscient de ses pratiques. Elles lui sont soit naturelles soit subies, mais elles sont aussi ce qui le structure comme un individu. À la nécessité de déployer ces pratiques correspond comme une sorte de prolétarisation de l’être : ce savoir-être qu’il n’a pas (dont on le prive) et qui se résout à n’être qu’un ploiement face aux normes.
Un peu dans le même ordre d’idée, l’individu chez Michel Foucault est soumis aux pratiques de décisions des institutions. C’est flagrant dans Surveiller et Punir, toutes ces procédures, administrations et techniques forment un ordre du pouvoir. Il peut être la tentative de rétablir un système de relations sociales normées (dans l'Histoire de la Folie), ou une force disciplinaire qui circonscrit l’espace à un espace cellulaire universel (le même pour tous) et permet le contrôle social.
Mais n’y a-t-il pas d’autre méthode que de réduire tout le fonctionnement social à une procédure dominante qui serait le contrôle et la surveillance ?
Chez Michel de Certeau, l’ordre des choses est loin d’être aussi simple, et ce n’est pas vraiment un ordre (au sens d’ordonnancement ou au sens du pouvoir donneur d’ordres). C’est la question du rapport entre pensée et action. D’abord, son point de vue sur le sujet est beaucoup plus optimiste puisqu’il le dote d’une certaine puissance. Cette puissance se traduit par le fait qu’il est tout à fait conscient de sa résistance à l’ordre imposé et même, M. de Certeau décompose l’ordre et la résistance en distinguant deux démarches différentes : stratégies et tactiques. Dans L’invention du quotidien, M. de Certeau analyse cela sous l’angle d’une réflexion sur le quotidien et s’oppose en quelque sorte à la seule logique du discours qui, chez Foucault est quasiment la seule logique qui explique les rapports de pouvoir. Pour M. de Certeau, le discours, c’est le contexte, c’est-à-dire que l’énonciation d’un état de choses, d’un ordre, est toujours relative au contexte, un temps et un espace, dans lequel on exprime. L’énonciation peut alors avoir deux niveaux. Le premier est la représentation, c’est un calcul, une stratégie où le sujet fait de volonté et de pouvoir (intention, délibération, exécution, etc.) observe de l’extérieur et détermine les choix rationnels : le sujet en question peut être aussi bien un individu qu’une institution ou une entreprise, peu importe. Par l’ingéniosité, la stratégie permet alors de saisir des occasions (avec une prudence toute aristotélicienne) qui font basculer les choix dans l’intérêt du sujet (ou pas…). Déjà, là, nous sommes loin de Bourdieu et sa théorie dispositionnelle où c’est à l’intérieur de l’individu, dans sa structure cognitive, qu’entrent en jeu les dispositions qui orientent son action dans un contexte donné. Avec M. de Certeau, ce n’est pas qu’on réfute l’idée que la cognition ne joue pas un rôle, mais on ajoute quelque chose de très pertinent : l’occasion, qui au fond est la mesure de la pertinence de l’action. La stratégie est d’ordre topologique, elle exprime un rapport essentiellement à l’espace, qu’elle cherche non seulement à mesurer et calculer mais aussi contrôler sous les trois piliers que sont la prospective (prévoir), la théorie (savoir) et la domination (pouvoir).
Le second niveau de l’énonciation, ce sont les tactiques. Elles sont propres aux individus mais ne sont en aucun lieu déterminé puisqu’elles s’expriment selon les occasions sur le terrain ou la loi imposés par le stratège, celui qui a décidé (voir paragraphe précédent), qui a pu envisager l’ordre de l’extérieur et le designer. Ces tactiques relèvent d’une pratique du temps, ce sont des actes et des usages. Elles n’organisent pas de discours, elles sont « purement » pratiques et surtout créatrices. Elles explorent le territoire, mais sont autant de résistances à la loi imposée. Ce sont des « manières de faire », des « ruses ». En d’autre termes, là où le commandement implique une stabilité et une identification précise et fixe des lieux (par exemple l’institution Républicaine qui a des lieux précis, préfectures, et administrations), résistance et tactiques jouent des circonstances et créent des usages qui ne sont pas forcément raccord avec l’ordre déterminé stratégiquement. En fait, c’est même tout leur objet, de ne pas être raccord, puisqu’elles sont un art de vivre, des savoir-vivre.
Pour illustrer cela on peut se reporter au rapport entre lecture et écriture. C’est un exemple de M. de Certeau. La lecture déstabilise toujours l’écrit là où on l’on pensait au contraire que la réception de l’écrit est universelle et balisée, au contraire une lecture diffère toujours d’une autre, elle « déterritorialise » l’écrit. On peut encore illustrer en reprenant la manière dont la chercheuse Anne Cordier fait référence à Michel de Certeau dans son livre Grandir connectés, les adolescents et la recherche d’information en mentionnant la manière dont les élèves élaborent des tactiques dans l’environnement contraint du CDI ou de l’institution pour satisfaire l’enseignant lors de la recherche d’information (montrer ostensiblement qu’on ne va pas sur Wikipédia tout en contournant la règle pour y récupérer des informations).
On comprend peut-être mieux à quel point les utopies (ou les dystopies) sont en soit des actes de résistance. Puisqu’elles détournent les stratégies pour être des matrices créatrices de nouveaux usages. Le détour du tacticien par l’utopie lui permet d’imaginer un autre ordre possible que le territoire qui lui est donné. Et de cette occasion-là, il peut se servir pour changer le quotidien.
Cette manière de penser l’action est un peu le contre-pied du point de vue de Bernard Stiegler. Pour ce dernier, les GAFAM ont entrepris un vaste projet de prolétarisation des savoirs (savoir-être et savoir-vivre) et il nous appartient de chercher à se déprolétariser en fondant une économie de la contribution, qui soit le contraire d’une économie de la consommation-extraction-des-données où nous sommes les produits et les agents consommateurs. Mais dans ce point de vue, on en reste à l’idée que la résistance ne peut se faire qu’un revendiquant, de manière révolutionnaire, notre libération de ces contraintes. Cela me fait penser à Jean Baudrillard qui oppose société de consommation (où notre objectif consiste à satisfaire nos egos et nous distinguer des autres) et société de non consommation (la Chine de Mao ?). Faire cette distinction revient à penser que le consumérisme, pilier du libéralisme, est une affaire de choix individuels (au pluriel, les agents rationnels de l’économie) et s’oppose au choix collectif qui pourrait nous mener vers une société meilleure (le choix social communiste ?). Mais, selon moi, c’est oublier que le choix consumériste, libéral ou néolibéral, est d’abord et avant tout un choix politique, donc collectif ! Penser l’individu en tant qu’un éternel sujet soumis aux contraintes, aux normes ou à ses appétences non maîtrisées de petit élève consommateur… cela implique que des sachants viennent enfin lui expliquer comment sortir de son état prolétaire. Mais il y a déjà des tactiques à l’œuvre et nous sommes tous individuellement des résistants conscients de leurs résistances. En tout cas au moins depuis les Lumières où nous nous sommes sortis des carcans et des prescriptions… cf. Kant. Je ne veux pas opposer ici la philosophie kantienne mais, tout de même, l’anthropologie et la sociologie nous montrent bien tout cela. Si on prend le simple exemple de Wikipédia, c’est sur ce genre de tactique que s’est monté l’un des plus vastes mouvements d’émancipation de savoirs au monde (hors du cadre académique).
La culture de la surveillance, ce n’est pas seulement être habitué à être surveillé et même à y trouver des avantages (les gens se rendent sur Facebook par envie et par plaisir) ou contourner la surveillance pour son propre avantage (piratage de films contre le cadre Hadopi). La culture de la surveillance, c’est aussi la mise en pratique de toutes ces tactiques qui sont rendues possibles avec Internet parce qu’Internet fourni aussi les outils de résistance et de formulation de contre-ordre, de contre-culture.
Si nous en revenons au capitalisme de surveillance, finalement de quoi s’agit-il ? s’il s’agit d’un ordre économique et politique qui nous est imposé, et il est imposé parce que les données avec lesquelles il élabore la stratégie sont en grande partie des données issues non pas de notre quotidien (qui est la dynamique de nos tactiques, nous inventons notre quotidien) mais une extraction de notre quotidienneté, c’est à dire, comme le disait Henri Lefevre dans sa Critique de la vie quotidienne4, la banalité inconsciente et inconséquente de nos actions (tout le monde chez Mac Do, tout le monde regarde Netflix, tout le monde achète sur Amazon…) l’insignifiance de nos gestes… Une insignifiance dans le sens ou, pour reprendre M. de Certeau, il s’agit de la part non tacticienne de soumission au stratège : notre obéissance à l’ordre. Et donc la captation de nos données consiste à une extrapolation de ce que nous sommes, en tant qu’individus, une re-construction théorique. Nos doubles numériques sont eux-mêmes doublement construits : re-construction des données (par inférence, recoupement, calcul, combinaisons et algorithme), et re-construction théorique de notre quotidienneté. Mais tout cela n’est pas notre quotidien.
Nous sommes des résistants.
Le problème est de savoir si nos tactiques, nos résistances à l’ordre du capitalisme de surveillance doivent se résoudre à n’être qu’individuelles. Ce serait là une grossière erreur. D’abord parce que, comme le montre l’exemple de Wikipédia, mais aussi tous les mouvements ouverts, les collectifs, les zads, les libristes (et j’en passe) sont bien des actions collectives qui détournent, contournent l’ordre des institutions et créent de nouvelles structures, repensent la démocratie, et le tout dans une dynamique où la méthode est presque aussi importante que les actes. On peut difficilement faire plus conscient que cela. Et si ces mouvements se créent par des logiques tacticiennes, souvent par spontanéité, c’est parce que les cadres et les institutions n’emportent plus l’adhésion générale. Si bien que l’ensemble des tactiques fait monter la pression entre le cadre et le désir, et se créent alors des espaces de violence.
Le souhait le plus ardent des stratèges, en faisant la bonne figure d’un capitalisme régulé (régulé par la loi, donc la politique, donc soi-disant par tous) est donc de réduire les tactiques à la seule dimension individuelle. L’individu responsable, donc libre de disposer de soi dans les limites de la loi et du contrat social. Un contrat qui ne fait qu’imposer la logique d’un modèle unique de démocratie élective (parfois pas) et libérale. Donc lutter contre le capitalisme de surveillance par la revendication des libertés individuelles, en prônant l’idée que la vie privée est d’abord un concept qui garanti les choix individuels, c’est en quelque sorte conforter le cadre stratégique de l’aliénation et revenir à définir la résistance sociale à la somme des résistances individuelles. C’est l’échec, à mon avis.
Menons encore une petite prospective. Comme on parle de Michel de Certeau, généralement, la théologie et le mysticisme ne sont pas loin. Je pense à la théologie de la libération, ce courant christiano-marxiste porté notamment en Amérique du Sud dans les années 1970 puis à travers tout ce qu’on a appelé le « Tiers monde ». Ce qui me plaît là-dedans, ce n’est pas le message théologique, mais l’idée que dans le mouvement de résistance, en particulier face aux dictatures, c’est à la base des hiérarchies sociales, donc les plus pauvres généralement, que se situe l’appropriation des savoirs (ici la parole divine, les évangiles, etc.), à la fois pour se libérer des conditions sociales imposées, mais aussi des conditions religieuses imposées par les colonisateurs et classes dominantes pour se créer leur propre cadre religieux chrétien. On dépasse le cadre de la charité pour permettre aux pauvres d’agir eux-mêmes pour améliorer leur condition. Et si la théologie de la libération a pu trouver un échos dans les classes sociales, c’est parce qu’elle cristallisait au bon moment les tactiques de contournement des masses à l’ordre social imposé. Des tactiques que d’aucun aurait pu juger qu’il s’agissait de l’effacement de la personnalité au profit de l’humilité face aux blancs colonisateurs… jusqu’au jour où le colonisateur se prenant une balle perdue au milieu de la pampa, l’illumination sur la réalité sociale se fait.
Évidemment, on parle ici de guérillas et de répressions. Mais le plus important pour mon propos est de constater qu’il s’agit bien d’une réflexion sur l’action. Ce que certains, à la même époque d’ailleurs, on appelé l’action directe. L’action directe n’est pas d’emblée une action violente (elle est même souhaitable, c’est ce que je dis ci-dessous) mais elle contribue fatalement à augmenter la pression entre les tactiques et le cadre imposé. Et souvent la violence ne vient pas « d’en-bas ».
Alors comment ? Comment faire pour favoriser la résistance collective ? Déjà il faut comprendre qu’elle est déjà-là. Il faut surtout la comprendre et formuler ses formes idéales qui, selon moi, doivent prendre deux aspects : la préfiguration et l’archipélisation.
Pour ce qui concerne la préfiguration, j’ai déjà écrit ce billet. Je répéterai simplement qu’il s’agit d’une voie de l’avènement de pratiques collectives, non uniformisées, dont la diversité dans les organisations et les actions fait la force, en lutte contre les oppressions et de manière générale contre les cadres imposés qui n’emportent plus l’adhésion ou la supposée adhésion. Dès lors, ces pratiques sont toujours en mode préfiguratif : elles n’attendent ni validation ni autorisation des institutions. C’est l’idée du faire, faire sans eux, faire contre eux. À mon sens c’est une attitude résolument anarchiste.
Quant à l’achipélisation, c’est un concept qui revient à Édouard Glissant. Elle permet d’inclure ce qui manque dans la réflexion précédente (même si en affirmant qu’il s’agit d’anarchie, je l’inclus évidemment) : le rôle de l’autre, notre relation à l’autre. C’est en cela que la préfiguration, comme action de tactique collective, est d’abord un mouvement altruiste. Je copie ici un paragraphe de la conclusion de Affaires Privées :
Si le mouvement d’émancipation est d’essence anarchique, la cartographie des initiatives est celle d’un archipel. Cette métaphore insulaire, nous la reprenons du philosophe Edouard Glissant. On peut en effet prendre exemple sur l’imprévisible pluralité créole chère à ce grand penseur antillais (martiniquais). Elle montre que la richesse langagière, culturelle, sociale et sans doute politique ne réside ni dans le pouvoir et l’ordre ni dans la centralisation (continentale) mais dans le jeu de l’échange et du partage, au point que chaque individu possède en lui une pensée-archipel qui permet d’entrer en relation avec l’autre. L’archipélisation permet d’englober cela de manière à voir une cohérence dans l’insularité des imaginaires et des initiatives, et les regrouper dans une inter-insularité coopérative. La démarche préfigurative peut donc être anarchique, mais la concevoir dans un monde-archipel permet de penser l’inattendu de l’expérimentation, l’indétermination des alternatives au monde-continent. Ainsi, toutes les initiatives ne sont pas censées adhérer à des principes anarchistes, se reconnaître comme telles, ou même seulement penser à l’être. On ne compte plus les mouvements qui se revendiquent de l’autogestion, de la gestion collective, de l’initiative libre, de la participation ouverte, ou qui se présentent comme des collectifs, d’associations pluri-représentatives, des groupes informels, des groupes anonymes… en somme tout cela est finalement très cohérent puisque les normes structurelles existantes n’emportent plus l’adhésion.
Pour conclure ce billet un peu foutraque, tout cela mérite d’être amplement retravaillé, révisé, et sans doute mieux compris. Car je ne cache pas que les pensées de tous les auteurs cités ici sont loin de me mettre à l’aise. Je pense néanmoins ne pas être si éloigné que cela des problématiques actuelles que pose le capitalisme de surveillance et auxquelles je souhaiterais répondre par une forme de théorie de l’émancipation, histoire de sortir un peu de la sempiternelle plainte à l’encontre des pratiques des GAFAM et des États à la sauce start-up-nation-de-contrôle. Une plainte qui, sans être accompagnée de la recherche au moins théorique d’une porte de sortie, ne fait que tourner en rond depuis les premiers âges de l’informatisation de la société.
-
Voir « La » revue de référence en la matière : Surveillance & Society. ↩︎
-
Didier Bigo, Engin Isin, Evelyn Ruppert, Data Politics. Worlds, Subjects, Rights, London : Routledge, 2019. ↩︎
-
Zuboff, Shoshana & Möllers, Norma & Murakami Wood, David & Lyon, David. (2019). « Surveillance Capitalism: An Interview with Shoshana Zuboff », Surveillance & Society, 17, 2019, p. 257-266. ↩︎
-
Henri Lefebvre, Critique de la vie quotidienne, Paris, L’Arche, 1958. ↩︎
20.03.2020 à 01:00
Affaires Privées
Au quotidien, nos échanges numériques et nos comportements de consommateurs sont enregistrés, mesurés, calculés afin de construire des profils qui s’achètent et se vendent. Des débuts de la cybernétique aux big data, la surveillance a constitué un levier économique autant qu’idéologique.
Dans Affaires privées, Christophe Masutti retrace l’histoire technique et culturelle de soixante années de controverses, de discours, de réalisations ou d’échecs. Ce retour aux sources offre un éclairage passionnant sur le capitalisme de surveillance et sur le rôle joué par le marketing dans l’informatisation de la société.Il décrit la part prise par les révolutions informatiques et le marché des données dans les transformations sociales et politiques.
La surveillance est utilisée par les administrations à des fins de contrôle, et par les entreprises pour renforcer leurs capacités commerciales. Si les pratiques de renseignement des États ont souvent été dénoncées, la surveillance venue du monde des affaires n’a longtemps suscité qu’indifférence. Le business des données en a profité pour bousculer les cadres juridiques et réglementaires de la vie privée.
Comment développer une économie numérique qui respecterait la vie privée des individus ? Comment permettre à la vie privée d’échapper au pouvoir des affaires ? Christophe Masutti propose une réflexion historique et politique sur les conditions d’émancipation face à l’économie de la surveillance.
Masutti, Christophe. Affaires Privées. Aux sources du capitalisme de surveillance. C&F éditions, 2020.
Lien vers le site de l’éditeur : https://cfeditions.com/masutti/
17.03.2020 à 01:00
Affaires Privées : en attendant
En raison de l’épidémie qui touche notre pays actuellement, l’éditeur C&F éditions n’est pas encore en mesure d’effectuer les envois des exemplaires précommandés de mon ouvrage Affaires Privées. Aux sources du capitalisme de surveillance. En attendant, voici quelques éléments pour vous mettre en bouche…
Tout d’abord, je voudrais remercier ceux qui comptent précommander l’ouvrage avant même sa sortie et toutes les critiques qui ne manqueront pas de le dézinguer (ou pas !). C’est important pour moi parce que cela montre dans quelle mesure le livre est attendu (histoire de me rassurer un peu), et c’est important pour l’éditeur qui joue tout de même sa réputation en publiant un livre qui ne soit pas totalement hors de propos.
Sachez aussi qu’en raison de la situation sanitaire Covid-19, l’éditeur C&F éditions a choisi d’allonger la durée de souscription (donc avec une petite remise sur le prix final). Allez-y, n’hésitez plus !
C’est presque Noël ! l’éditeur a aussi décidé d’accélérer la fabrication de la version epub de l’ouvrage. Elle sera garantie sans DRM (on dirait une publicité pour légumes bio quand on dit des choses pareilles !). Donc ceux qui ont choisi la souscription, et n’auront pas la joie de découvrir l’ouvrage dans leur boîte à lettres dans un délai raisonnable, pourront toujours se réconforter avec la version électronique.
Pour terminer, et si vous avez les crocs, voici ci-dessous quelques liens vers des billets de ce blog qui concernent Affaires Privées. Ils sont loin (très loin) de présenter un aperçu général de l’ouvrage (475 pages, tout de même, c’est pas si cher au kilo… pour suivre la métaphore des légumes bio). Par ailleurs il y a eu des modifications substantielles entre le moment où j’ai écrit ces billets et la publication du livre, alors ne soyez pas sévères…
Dans un premier temps voici deux billets qui transcrivent des passages complets du livre. Le premier concerne le projet Cybersyn, à une époque où le fait qu’un gouvernement puisse posséder un pouvoir de surveillance « total » n’était pas si mal vu. Le second est un point de vue plus théorique sur notre modernité à l’ère de la surveillance et qui reprend un passage où j’expose comment je vais chercher chez Anthony Giddens quelques clés de lecture.
Les deux billets suivants font partie de l’argumentation qui me situe par rapport au récent livre de Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism qui a fait l’objet d’une grande couverture médiatique. Attention : il ne s’agit absolument pas d’une argumentation complète, mais le format « billet » pourra peut-être aider à une meilleure compréhension lorsque vous accrocherez la dernière partie de l’ouvrage.
Alors, je vous souhaite bonne lecture en attendant le pavé dans la mare…
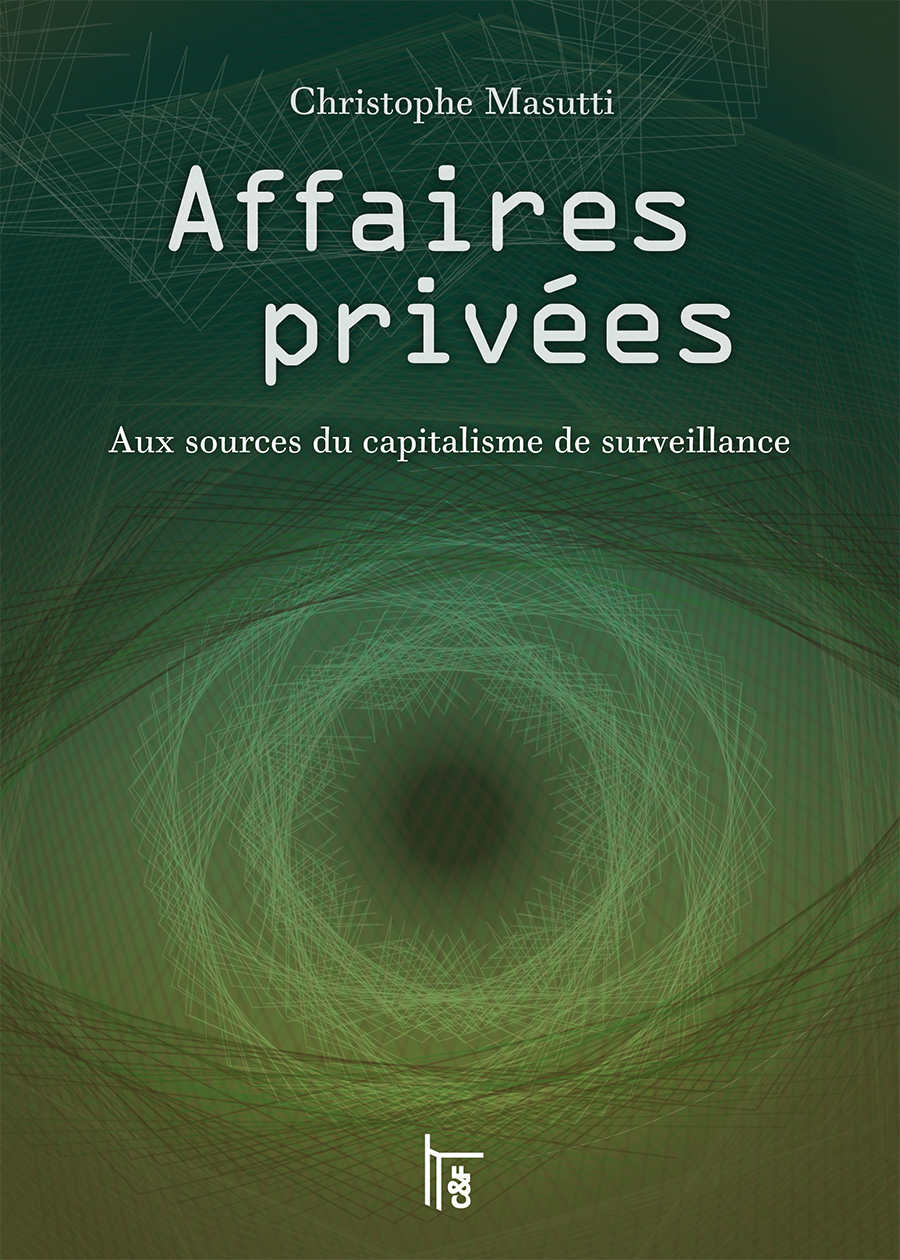
Christophe Masutti, Affaires Privées. Aux sources du capitalisme de surveillance (couverture)
Commander sur le site de l’éditeur : C&F éditions
02.03.2020 à 01:00
Parution : Affaires Privées
Au quotidien, nos échanges numériques et nos comportements de consommateurs sont enregistrés, mesurés, calculés afin de construire des profils qui s’achètent et se vendent. Des débuts de la cybernétique aux big data, la surveillance a constitué un levier économique autant qu’idéologique.
Table des matières
Descriptif
Titre : AFFAIRES PRIVÉES. Aux sources du capitalisme de surveillance
Auteur : Christophe Masutti
Préface de Francesca Musiani
Édition : C&F éditions, Collection Société numérique, 5
Date de parution : mars 2020
Nombre de pages : 475
ISBN : 978-2-37662-004-4
Dimensions : 15 x 21 cm
Commander sur le site de l’éditeur : C&F éditions
Télécharger un descriptif de l’ouvrage (PDF)
Couverture
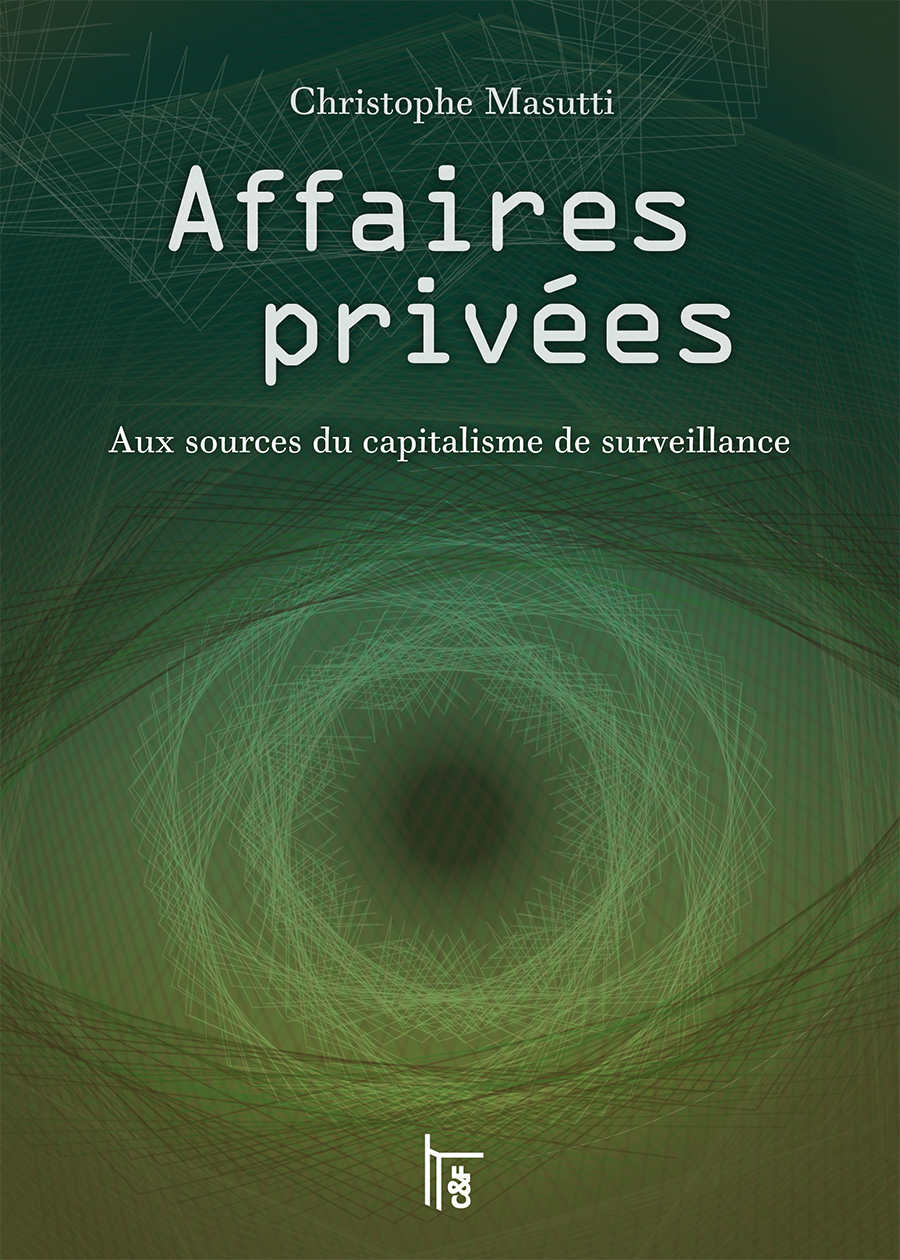
Christophe Masutti, Affaires Privées. Aux sources du capitalisme de surveillance (couverture)
4e couverture
Au quotidien, nos échanges numériques et nos comportements de consommateurs sont enregistrés, mesurés, calculés afin de construire des profils qui s’achètent et se vendent. Des débuts de la cybernétique aux big data, la surveillance a constitué un levier économique autant qu’idéologique.
Dans Affaires privées, Christophe Masutti retrace l’histoire technique et culturelle de soixante années de controverses, de discours, de réalisations ou d’échecs. Ce retour aux sources offre un éclairage passionnant sur le capitalisme de surveillance et sur le rôle joué par le marketing dans l’informatisation de la société. Il décrit les transformations sociales et politiques provoquées par les révolutions informatiques et le marché des données.
La surveillance est utilisée par les administrations à des fins de contrôle, et par les entreprises pour renforcer leurs capacités commerciales. Si les pratiques de renseignement des États ont souvent été dénoncées, la surveillance venue du monde des affaires n’a longtemps suscité qu’indifférence. Le business des données en a profité pour bousculer les cadres juridiques et réglementaires de la vie privée.
Comment développer une économie numérique qui respecterait la vie privée des individus ? Comment permettre à la vie privée d’échapper au pouvoir des affaires ? Christophe Masutti propose une réflexion historique et politique sur les conditions d’émancipation face à l’économie de la surveillance.
Une citation
Cité dans l’ouvrage :
Ces grandes banques de données permettront au citoyen, lorsqu’il est confronté à un nouvel environnement, d’établir « qui il est » et d’acquérir rapidement les avantages qui découlent d’une évaluation de solvabilité (bancaire) fiable et d’un caractère social acceptable aux yeux de sa nouvelle communauté. En même temps, les établissements commerciaux ou gouvernementaux en sauront beaucoup plus sur la personne avec laquelle ils traitent. Nous pouvons nous attendre à ce qu’un grand nombre de renseignements sur les caractéristiques sociales, personnelles et économiques soient fournis volontairement – souvent avec empressement – afin de profiter des bienfaits de l’économie et du gouvernement.
Lance J. Hoffman, « Computer and Privacy : a survey » (1969).
Argumentaire
« Envahisseurs de la vie privée », « homme informatisé », « société du dossier », « surveillance publique », « contrôle social »… toutes ces expressions sont nées à la fin des années 1960. Le processus d’informatisation de la société occidentale s’est fait sur le fond d’une crainte de l’évènement de la dystopie de 1984. Et pourtant, lorsqu’on raconte l’histoire de la révolution informatique, on retient surtout l’épopée des innovations technologiques et le storytelling californien.
Les pratiques de surveillance sont les procédés les plus automatisés possible qui consistent à récolter et stocker, à partir des individus, de leurs comportements et de leurs environnements, des données individuelles ou collectives à des fins d’analyse, d’inférence, de quantification, de prévision et d’influence. Des années 1960 à nos jours, elles se révèlent être les outils précieux des administrations publiques et répondent aux besoins concurrentiels et organisationnels des entreprises. On les appréhende d’autant mieux que l’on comprend, grâce à de nombreux exemples, qu’elles dépendent à la fois des infrastructures informatiques et de leur acceptation sociale. Ainsi, le marché de la donnée s’est progressivement étendu, économique, idéologique, culturel. Fruit de rapports sociaux, le capitalisme de la surveillance n’est pas un nouveau système économique, il est le résultat de l’adjonction aux affaires économiques de la surveillance électronique des individus et de la société.
Faire l’histoire (critique) du capitalisme de surveillance, c’est analyser les transformations sociales que l’informatisation a rendu possibles depuis les années 1960 en créant des modèles économiques basés sur le traitement et la valorisation des données personnelles. La prégnance de ces modèles ajoutée à une croissance de l’industrie et des services informatiques a fini par créer un marché hégémonique de la surveillance. Cette hégémonie associée à une culture consumériste se traduit dans plusieurs contextes : l’influence des consommateurs par le marketing, l’automatisation de la décision, la réduction de la vie privée, la segmentation sociale, un affaiblissement des politiques, un assujettissement du droit, une tendance idéologique au solutionnisme technologique. Il fait finalement entrer en crise les institutions et le contrat social.
Du point de vue de ses mécanismes, le capitalisme de surveillance mobilise les pratiques d’appropriation et de capitalisation des informations pour mettre en œuvre le régime disciplinaire de son développement industriel et l’ordonnancement de la consommation. Des bases de données d’hier aux big data d’aujourd’hui, il permet la concentration de l’information, des capitaux financiers et des technologies par un petit nombre d’acteurs tout en procédant à l’expropriation mercantile de la vie privée du plus grand nombre d’individus et de leurs savoirs. Et parce que nous sommes capables aujourd’hui d’énoncer cette surveillance aux multiples conséquences, il importe de proposer quelques solutions collectives d’émancipation.
- Persos A à L
- Carmine
- Mona CHOLLET
- Anna COLIN-LEBEDEV
- Julien DEVAUREIX
- Cory DOCTOROW
- Lionel DRICOT (PLOUM)
- EDUC.POP.FR
- Marc ENDEWELD
- Michel GOYA
- Hubert GUILLAUD
- Gérard FILOCHE
- Alain GRANDJEAN
- Hacking-Social
- Samuel HAYAT
- Dana HILLIOT
- François HOUSTE
- Tagrawla INEQQIQI
- Infiltrés (les)
- Clément JEANNEAU
- Paul JORION
- Michel LEPESANT
- Persos M à Z
- Henri MALER
- Christophe MASUTTI
- Jean-Luc MÉLENCHON
- MONDE DIPLO (Blogs persos)
- Richard MONVOISIN
- Corinne MOREL-DARLEUX
- Timothée PARRIQUE
- Thomas PIKETTY
- VisionsCarto
- Yannis YOULOUNTAS
- Michaël ZEMMOUR
- LePartisan.info
- Numérique
- Blog Binaire
- Christophe DESCHAMPS
- Louis DERRAC
- Olivier ERTZSCHEID
- Olivier EZRATY
- Framablog
- Romain LECLAIRE
- Tristan NITOT
- Francis PISANI
- Irénée RÉGNAULD
- Nicolas VIVANT
- Collectifs
- Arguments
- Bondy Blog
- Dérivation
- Économistes Atterrés
- Dissidences
- Mr Mondialisation
- Palim Psao
- Paris-Luttes.info
- ROJAVA Info
- Créatifs / Art / Fiction
- Nicole ESTEROLLE
- Julien HERVIEUX
- Alessandro PIGNOCCHI
- Laura VAZQUEZ
- XKCD