04.09.2025 à 15:22
20 ans après, retours sur le référendum de 2005
Antoine Schwartz, Henri Maler
Introduction de Médias en campagne. Retours sur le référendum de 2005, publié aux éditions Syllepse en 2005.
- Sur les médiasTexte intégral (2835 mots)

Le 29 mai 2005, le traité établissant une Constitution pour l'Europe était rejeté par référendum. À l'occasion de ce vingtième anniversaire, Acrimed a publié au fil de l'été les différents chapitres de Médias en campagne. Retours sur le référendum de 2005 (Henri Maler et Antoine Schwartz, Syllepse, 2005).
Je publie ici l'introduction, suivie des liens aux chapitres publiés par Acrimed
Depuis plusieurs années, la construction européenne, puis le projet de « Traité établissant une Constitution pour l'Europe » (TCE) ont bénéficié d'un traitement « exemplaire » dans les médias dominants : à plusieurs voix, certes, mais (presque) à sens unique.
Quand vint le 29 mai 2005 : avec près de 55% des suffrages exprimés, une nette majorité des Français rejetait le projet. Vu du côté de la minorité des patrons de presse, éditorialistes, et « experts » qui occupent le devant de la scène médiatique, le bilan est rapidement tiré : non seulement l'échec de leur engagement forcené en faveur de l'adoption du Traité n'aurait pas infirmé l'excellence de leur travail, mais il aurait confirmé son innocuité. La preuve, disent-ils, devenus soudainement modestes, que notre pouvoir est limité, c'est qu'il s'est révélé apparemment sans effet.Apparemment… Car, parmi d'autres « pouvoirs » sur lesquels nous reviendrons, les médias disposent de celui de se faire oublier ou, plus exactement, d'entretenir l'amnésie sur leurs œuvres passées quand celles-ci ne coïncident pas avec les contes et légendes du « quatrième pouvoir » [1].
Le premier objet de ce livre est donc de proposer un aide-mémoire : pour que celles et ceux qui, journalistes inclus, ont eu à subir l'omniprésence et l'arrogance de l'oligarchie qui trône au sommet de l'espace médiatique, n'oublient pas. Et ne négligent pas, s'ils sont tentés de le faire, d'en tirer quelques conséquences.
C'est pourquoi le 6 juin 2005, l'association Acrimed (Action-Critique-Médias) adressait une « Lettre ouverte à la gauche de gauche » [2]. Sous le titre « Les médias désavoués ? Et maintenant ? », on pouvait lire ceci :
Les enjeux sont d'importance. Certes, le pouvoir que les médias dominants s'attribuent est moins grand qu'ils le prétendent ou qu'ils le voudraient : les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs ne sont pas des éponges qui absorbent n'importe quoi ou des chiots que l'on peut dresser à volonté. Le résultat du référendum vient de le confirmer. Mais le pouvoir des grands médias reste exorbitant lorsqu'il s'exerce sans partage (ou si peu). Le pluralisme est une question de principe et non d'opportunité. C'est pourquoi s'il ne faut pas leur reconnaître plus de puissance qu'ils n'en ont, il ne faut pas la mésestimer et accepter les abus de pouvoir dont ils sont responsables.La critique du rôle des “grands médias” pendant et après le vote du 29 mai 2005 ne devrait pas rester sans suites. […]
Rarement (du moins dans un passé récent) la contestation de l'ordre médiatique dominant aura été aussi forte qu'elle le fut à l'occasion de la campagne du référendum sur le Traité constitutionnel européen.Rarement (mais beaucoup moins...), le pluralisme démocratique aura été aussi ouvertement et cyniquement bafoué par les grand médias, publics ou privés, que leurs chefferies éditoriales ont tenté de mobiliser en faveur du Traité Constitutionnel. Au mépris non seulement des électeurs, mais aussi de journalistes enrôlés, bon gré mal gré (et non sans fortes résistances comme en témoigne l'appel lancé par des personnels du secteur public), dans une campagne qui n'est pas la leur et, en tout cas, pas digne des métiers de l'information.
L'arrogance des éditorialistes et chroniqueurs multicartes, des présentateurs d'émission et des contrôleurs d'antenne, des experts en tous genres et des tenanciers toutes catégories qui occupent l'espace médiatique et en contrôlent l'accès s'est exprimée sans aucune retenue. Se réservant le monopole de « la raison », face à des opposants auxquels ils n'accordent que des passions, de préférence, les plus basses et les desseins les plus inavouables, ils se sont attribués du même coup le monopole de la « pédagogie ». Aveuglés par leur propre domination, ils se tiennent pour légitimes parce qu'ils proclament qu'ils le sont. Peu leur importe le désaveu massif dont ils ont fait l'objet. Après le vote, ils continuent, cyniquement, sans vergogne et toute hargne dehors.
Chacun a pu vérifier tout cela et le dossier réuni par Acrimed le confirme amplement.
Mais cette situation n'est pas nouvelle. En 1995, pour ne pas remonter plus loin, les mêmes s'étaient mobilisés contre des grévistes « irresponsables », « incultes » et « dangereux ». En 2003, les mêmes ont récidivé, exhibant leur morgue et leur mépris. Faut-il une fois passés les moments fort de la mobilisation, remiser notre révolte et n'avoir pour seule ambition que de tenter, non sans cynisme nous aussi, de nous servir des médias dominants sans contester leur domination ?
Il n'est que trop évident qu'une telle domination, parce qu'elle s'exerce en permanence, doit faire l'objet d'une vigilance, d'une critique et d'une action permanentes. […]
Qu'ils se rassurent : nul ne conteste la liberté d'expression des prescripteurs d'opinion pris un à un, bien que les nuances qui les distinguent n'affectent guère leur consensus. Mais comment ne pas constater que, pris dans leur grande majorité, ils détiennent un quasi-monopole qui s'exerce au mépris du débat démocratique dont ils se croient les gérants ou les propriétaires ? Quand les médias, pris dans leur ensemble, s'expriment à plusieurs voix certes, mais dans le même sens, ils sont les acteurs d'un pluralisme anémié et d'une démocratie mutilée.
C'est le même le « déficit démocratique », comme on dit, qui à la fois affecte la représentation politique et s'étend aux médias dominants, notamment parce que leurs formes d'appropriation et de financement, leurs hiérarchies rédactionnelles et leurs orientations éditoriales contribuent à les transformer en instruments de campagnes politiques à sens unique. Si le secteur public de l'audiovisuel est le premier concerné, il n'est pas le seul : le « décalage » (pour utiliser un terme pudique) entre, d'une part, un espace médiatique livré à une domination pratiquement sans partage des tenants du libéralisme, plus ou moins social, et, d'autre part, la diversité sociale, culturelle et politique de leurs publics, est devenu patent.
C'est donc l'ordre médiatique existant lui-même qui doit être transformé.
L'appel qui, au printemps 1996, a donné naissance à notre association et demeure au fondement de son action, déclarait déjà :
« Persuadés que la démocratie court un grand risque quand la population est privée de la possibilité de se faire entendre et comprendre dans les grands médias, en particulier lorsque la situation sociale est tendue et la nécessité du débat plus vive ; Persuadés que l'exigence de démocratie dans les médias est déterminante dans la lutte pour instaurer une société respectueuse de l'égalité effective des droits de toutes et de tous ; Nous dénonçons :
– l'appropriation de la plupart des grands médias par les puissances financières et politiques qui s'en servent sans compter pour permettre à "ceux d'en haut" d'imposer leurs valeurs et leurs décisions à "ceux d'en bas" ;
– l'hégémonie des discours convenus et conformes, parfois à plusieurs voix mais toujours à sens unique (sur Maastricht, la monnaie unique, les grèves, les plans Juppé, etc.) ;
– les multiples dérives de l'information que nombre de journalistes sont les premiers à constater et à condamner (transformation de l'information en spectacle et du spectacle en information) ;
– la subordination fréquente des journalistes à une logique qui les prive peu à peu de leur indépendance rédactionnelle et les transforme en simples auxiliaires d'une machine dont les priorités échappent aux exigences de l'information. »
Rien n'a changé depuis, bien au contraire. L'appel concluait : « Une population en état d'ex-communication permanente, un pays qui ne peut plus (se) communiquer par le moyen des médias, et c'est la démocratie qui dépérit. » Cela demeure aujourd'hui, s'agissant des « grands médias », notre conclusion.
C'est assez dire que la question des médias est une question politique, ne serait-ce que pour cette raison : leurs échecs n'empêchent pas ces médias de rester dominants.
Le pouvoir dont ils disposent, certes, n'est ni uniforme, ni écrasant : il diffère selon les médias et ne s'exerce pas mécaniquement sur des « consommateurs » passifs. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'UN « pouvoir », mais de plusieurs : pouvoir de consécration ou de stigmatisation (des individus ou des groupes sociaux), pouvoir de révélation ou d'occultation (des faits et des analyses dissimulés à la connaissance publique), pouvoir de problématisation (des questions et des solutions légitimes), etc.
De surcroît, ces pouvoirs multiples dont les effets varient selon les médias et leurs publics ne s'exercent pas isolément et sans partage. Le « pouvoir des médias » n'est pas autonome, mais dépend de leurs relations à d'autres pouvoirs, économiques et politiques, dont le microcosme médiatique est plus ou moins dépendant. Les réseaux des prétendues « élites » économiques, politiques et médiatiques ne sont que la forme la plus apparente de proximités sociales et d'interdépendances structurelles dont les configurations et l'intensité peuvent varier sans être remises en cause. En raison, notamment, de leurs origines sociales, de leurs parcours scolaires et des conditions de leur recrutement, les journalistes les plus influents peuvent bien ne pas obéir immédiatement aux ordres d'un gouvernement ou de leurs employeurs et pourtant être spontanément ajustés à leurs exigences.
La faible autonomie du champ journalistique à l'égard des pouvoirs établis permet de comprendre pourquoi, en dépit de quelques conflits, la connivence des journalistes politiques dominants avec les représentants politiques majoritaires s'impose « naturellement » sans être toujours intentionnelle (et il importe finalement assez peu de savoir si elle l'est vraiment). L'ingérence directe peut être l'exception (et laisser le champ libre aux discours sur l'indépendance des journalistes) et la subordination sociale et culturelle demeurer néanmoins la règle. Sans être mécanique, la soumission des médias aux puissances financières et aux logiques économiques peut s'exercer d'autant plus efficacement qu'elle demeure souvent peu visible. C'est pourquoi les liens étroits qu'entretiennent les médias tels qu'ils sont avec le monde social tel qu'il est rendent solidaires la question politique de leur nécessaire transformation et la question politique plus globale des nécessaires transformations économiques, sociales et politiques de nos sociétés.
Pour saisir les obstacles qu'ils dressent, plutôt que de spéculer sur les effets de persuasion unilatéraux et indifférenciés que l'ordre médiatique existant produirait par sa seule action, mieux vaut s'arrêter deux des influences majeures qu'exercent ces médias tout à la fois dominants et assujettis.
La première repose sur leur pouvoir d'accréditation de leur propre rôle et donc d'intimidation de celles et ceux qui, croyant à la puissance que les médias s'attribuent, contribuent à la conforter : pouvoir d'intimidation des écrivains, des créateurs, des chercheurs qui quémandent la faveur des médias dans l'espoir de faire connaître leurs œuvres ; et surtout des forces collectives, des militants et de leurs porte-parole qui préfèrent trop souvent ne pas trop importuner les médias et leurs tenanciers, dans l'espoir qu'ils se fassent l'écho de leurs propositions et de leurs les actions et favoriser ainsi leur popularisation. Pourtant, la campagne référendaire de 2005 l'a montré, des avancées et des victoires sont possibles sans les médias et malgré eux.
La deuxième influence exercée par les médias consiste dans leur pouvoir de légitimation de certaines visions du monde qui pèse en conséquence sur la manière dont sont construits les débats publics et les enjeux politiques. Au point que, à les entendre, les seules lunettes adaptées à la compréhension et aux transformations souhaitables de la société devraient être néo-libérales, avec, il est vrai, diverses moutures et montures.
Ainsi, bien que les médias exercent donc pas un, mais des pouvoirs, ceux-ci participent, pour la plupart, d'une même domination : une domination idéologique ou, mieux, symbolique qui s'exerce souvent à l'insu de ceux qui la subissent, même quand ils lui résistent. Et même quand ils la battent en brèche comme on a pu le voir, précisément, à l'occasion de la campagne référendaire sur le Traité constitutionnel européen. Personne n'est a priori et définitivement immunisé contre cette domination, dont notre « mémento » se propose moins d'en analyser les « mécanismes » que d'en parcourir quelques figures : les simulacres d' « équité », de « pédagogie » et de « démocratie ».
La suite, sur le site d'Acrimed.
II. Vous avez dit « pédagogie » ?
III. Vous avez dit « démocratie » ?
Et après ? D'autres médias pour un autre monde
***
Le dossier que nous présentons ici a été coordonné et mis en forme par Henri Maler et Antoine Schwartz. Composé pour l'essentiel à partir d'extraits remaniés des quelques 60 articles publiés sur le site d'Acrimed pendant la campagne référendaire, il n'existerait pas sans l'activité collective de notre association et les contributions individuelles de ses membres, ainsi que celles de nos correspondants et de l'équipe du journal Pour Lire Pas Lu. Sauf précision, tous les articles mentionnés sont disponibles dans leur version intégrale sur notre site où ils sont parus au cours même de la campagne et quelques jours après le vote. Se reporter à leur présentation : « Le Traité constitutionnel européen, les médias et le débat démocratique » (http://www.acrimed.org/article1950.html)
[1] Qui se souvient par exemple de la campagne du référendum de Maastricht, qui avait donné lieu aux mêmes déséquilibres, aux mêmes excès ? Déjà à l'époque pourtant, le CSA devait admettre qu'au cours de l'été 1992, « le ‘‘oui'' avait disposé d'un temps d'antenne supérieur au ‘‘non'' : 46 % de plus sur TF1, 53 % sur Antenne 2, 191 % sur France 3 » (Le Monde, 08.09.92).
[2] Signée, pour le Collectif d'Animation d' Acrimed,, par Patrick Champagne, Henri Maler et Aline Pailler.
10.08.2025 à 14:48
Niuta
Henri Maler
Ma mère
- Sur ma vieTexte intégral (7238 mots)

Longtemps, très longtemps, c'est par bribes que j'ai appris de ta vie ce qui t'avait menée jusqu'à moi.
Longtemps, très longtemps, j'ai attendu de mon père le récit dont il ne m'a livré que quelques détails, arrachés, un à un et de loin en loin, à son silence. Accablant.
Dans l'appartement de deux pièces où je vivais alors avec lui, rien ne signalait ton existence, pas même une photo. Mais mon père croyait sans doute me protéger de ma douleur, en me protégeant de la sienne. Ses mots, s'il avait été moins parcimonieux, m'auraient été plus précieux que les papiers déclassés que j'ai découverts alors que j'avais dix ans quand j'ai trouvé, dans le grenier, une petite valise marron, désajustée, désarticulée. Elle gisait sous un amas de matériel électrique, témoin lui aussi de la fin d'une histoire : celle de l'atelier d'artisan que mon père avait ouvert avant la guerre. Je n'invente pas la banalité vraie de cette découverte : une petite valise marron perdue dans un grenier, enfermant des imprimés administratifs et des photographies, des reliquats visibles de ton existence, des auxiliaires potentiels de ma mémoire, des substituts à celle dont j'étais privé.
Ce que je n'avais pas appris de la vive voix de mon père attendait là, sans que je le sache. Longtemps, trop longtemps et à plusieurs reprises, j'ai parcouru ces archives sans les lire et entrevu ces photographies sans les regarder. À de rares exceptions près.
Dans cette boîte à souvenirs, reposaient deux exemplaires de la Dépêche du Midi. Le premier, daté du 11 juillet 1933, le second daté du 31 octobre 1951. Entre ces deux dates, l'histoire française de mes parents. En page 6 du numéro de juillet 1933, cette annonce : « Université de Toulouse. Institut électrotechnique de Toulouse. Ont obtenu le diplôme d'ingénieur électricien de l'Université de Toulouse (session juin-juillet 1933) ». Suit une liste et, dans cette liste, un nom : Maler (mention passable). En page 4 du second exemplaire de La Dépêche du Midi, le récit d'un fait divers qui m'a laissé orphelin.
Plusieurs fois, au fil des ans, j'ai ouvert et refermé la petite valise, déclassé et reclassé les pièces de ce dossier qui ne me rappelaient rien d'autre qu'une irrémédiable absence. En dépit de quelques secousses velléitaires, séparées par de longues années, je n'ai jamais osé les exhumer vraiment. Je romps aujourd'hui soixante ans d'esquives et de pudeur défensives.
En 2014, j'ai décidé de me rendre en Pologne, ton pays natal. Et il a fallu les préparatifs de ce voyage pour que je m'arrête vraiment sur les traces déposées dans la boîte à souvenirs et que ces traces murmurent enfin ce qu'aucun récit ne m'avait transmis. C'est alors seulement que j'ai tenté de revenir sur mes souvenirs morcelés et désordonnés : ces fragments de ma mémoire que le temps avait disjoints. C'est alors seulement que j'ai tenté de classer dans leur ordre chronologique les papiers et les photographies, ces dépouilles de ton histoire, et d'agencer ainsi une biographie. La voici.
Une moindre biographie que je dois au moins à mes enfants : Matthieu et Isabel, nés de deux mamans différentes. Mes descendants ont en commun une grand-mère qu'ils n'ont pas connue. Ils m'ont fait comprendre, chacun à sa façon, que je devais interrompre la transmission du silence, de mon silence.
Laisse-moi te dire, Niuta, comment je t'ai cherchée en feuilletant les reliques réunies dans la petite valise, te faire entendre le bruissement des papiers froissés et te montrer ces photos que n'anime pour moi aucun souvenir de toi.
Si j'en crois la photocopie de la déclaration de ta naissance, enregistrée par un rabbin, la fille de Chaskiel et Ruchla Szternfinkiel est née en 1914 à Lublin, 34 rue Foska (aujourd'hui rue du 1er mai). Tu te prénommes Fradla - prénom que j'ai longtemps retenu sans l'avoir jamais prononcé quand j'étais un tout jeune enfant - Fradla-Serla, précisément, si j'en crois l'état civil. Parfois, mon père, t'appelait par ton surnom : « Niuta ». Je l'adopte désormais, sans l'avoir jamais prononcé : tardive intimité.
Une attestation, obtenue quand Fradla Szternfinkiel est déjà en France, indique, Niuta, que tu as obtenu le baccalauréat en 1930 à Lublin. La boite à souvenirs n'a recueilli aucun autre document administratif sur ta scolarité, avant une nouvelle attestation fournie six ans plus tard : âgée alors de vingt-deux ans seulement, tu as obtenu, certifié le 30 juin 1936, un diplôme de littérature à l'Université de Varsovie. Le sujet de ton mémoire de licence a pour titre : « Alfred de Vigny, œuvre en prose ». Je déteste Alfred de Vigny. Mais ce n'est pas sans naïve fierté que je me dis : « Peu de femmes alors devaient obtenir, en Pologne, une licence ».
De ta jeunesse polonaise, il ne reste qu'un petit carnet de minuscules photographies que tu as emportées avec toi ou que tu as peut être reçues après ton départ de Pologne. Quel est ce lac où, rieurs, des jeunes gens, agglutinés sur une barque, posent pour la photo ? Qui sont-ils ? Des étudiants sans doute. Je me plais à imaginer que l'un d'eux fut le bénéficiaire de tes premiers émois amoureux.
Un an après avoir obtenu ton diplôme, tu viens à Paris, munie d'un passeport établi le 28 juillet 1937 à Lublin. Le visa, délivré de 30 juillet 1937 par le consul de France à Varsovie, stipule : « Visa délivré pour un seul voyage en France et retour délivré pour l'Exposition internationale de 1937 et ne pouvant être ni prolongé ni renouvelé ». Le document précise : « Le titulaire ne pourra occuper aucun emploi en France ». Il n'en sera rien et ton passeport sera plusieurs fois renouvelé, avec pour dernière date de validité le 15 juillet 1940.
Manifestement, tu n'es pas venue à Paris pour visiter l'Exposition universelle et tu as déjà songé à prolonger ton séjour. À peine arrivée, en août 1937, tu suis des cours de vacances à l'Alliance française. En septembre, tu t'inscris à l'École pratique de langue française de l'Alliance. Un livret universitaire établit ton inscription à la Faculté de lettres de Paris pendant deux ans, en 1937-1938 et 1938-1939, ainsi que la liste des cours que tu as suivis. Tu es alors domiciliée 13, Rue Rollin.
Près de quarante ans plus tard, en parcourant, une nouvelle fois, ce livret, je me suis souvenu que cette adresse m'avait frappé alors que je vivais dans un petit studio, au deuxième étage du 76 rue du Cardinal Lemoine, à deux enjambées de la Place de la Contrescarpe. À quelques mètres près, la porte de l'immeuble où je logeais faisait face à la rue Rollin. Un jour, je me suis rendu au numéro 13, m'arrêtant devant la porte et contemplant les fenêtres dans le vain espoir que les lieux me parlent de toi.
Je n'y avais pas songé alors, mais je t'imagine aujourd'hui quittant ton logement et descendant la rue du Cardinal Lemoine pour te rendre à la Sorbonne. Tu t'engages dans la rue Clovis et, après avoir négligé l'entrée du Lycée Henri IV, tu débouches sur la place du Panthéon et tu longes la Bibliothèque Sainte Geneviève. Par la rue Cujas, tu rejoins la rue Saint Jacques que tu traverses, avant d'emprunter la rue Victor Cousin que tu descends pour atteindre la Place de la Sorbonne. Puis, franchissant le porche de la faculté, tu te rends à tes cours. Au terme d'un trajet qui fut le mien pendant plusieurs années. Sans doute as-tu été plus studieuse que je ne le fus moi-même et plus sérieuse que l'étudiant dépenaillé qui passait plus de temps au café de la Sorbonne ou dans les cinémas du quartier que dans les amphithéâtres. Et peu m'importe si cette complicité tardive est illusoire.
À Paris, tu ne te bornes pas à étudier la littérature française. En 1938, tu suis les cours de « L'École pratique des soins de beauté », 19 rue Auber, Paris 9ème. Peut-être prenais-tu le métro Place Monge directement jusqu'au métro Opéra à proximité de l'École. Tu obtiens le 15 juillet un « Diplôme de capacité en massage facial, massage général du corps et tous soins esthétiques » signé par le Docteur Peytoureau, auteur - je l'ai appris depuis - d'un Manuel de face-massage et de massage capillaire, publié en 1936.
Que représentaient pour toi ces soins esthétiques ? Par quel concours de circonstances as-tu suivi ces enseignements ? Qu'attendais-tu de ton diplôme ? Qu'il te donne des moyens d'existence ?
Quelles étaient tes ressources ? Comment vivais-tu ? Quels furent tes amours, s'il y en eut ? Quelle jeune femme étais-tu, avant que l'histoire ne rende incertaines tes études de littérature et frivoles tes apprentissages de soins de beauté ?
1er septembre 1939, La Wehrmacht envahit la Pologne. Le 3 septembre, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Et dès le lendemain, le 4 septembre 1939, comme l'établit le document d'adhésion que j'ai sous les yeux, Fradla-Serla Szternfinkiel, « s'est inscrite comme volontaire dans l'Armée Polonaise en France », avant même qu'un accord conclu entre l'Ambassade de Pologne et le gouvernement français n'officialise cette armée et que les Polonais de France ne la rejoignent massivement.
La jeune esthéticienne que tu es devenue change alors de formation ! Le 19 septembre 1939, la « Croix Rouge Française - Association des Dames Françaises » atteste que Fradla-Serla « a suivi avec assiduité les cours de soins d'urgence » et a été « nommée comme auxiliaire de l'Association des Dames Françaises ». Le 9 février 1940, la « Croix Rouge Française – Union des femmes de France » te délivre un diplôme d'auxiliaire « Z » et, à la même date un « Diplôme simple d'infirmière ». Tu es alors domiciliée 19 rue Monge.
Qu'as-tu ainsi préparé ou accompli ? Une participation à la guerre ? Les documents imprimés, évidemment, ne le disent pas.
Comme ils ne disent pas à quelle assiduité correspond la carte d'étudiante qui, établie le 19 février 1940, confirme ton inscription en 1939-1940 à la Faculté de lettre de l'Université de Paris. Cette carte est-elle seulement un sauf-conduit, destiné à sauver les apparences ? Cherches-tu, à la fois, à protéger ta présence en France et à couvrir d'autres activités ? Rien pourtant ne semble désarmer ta volonté farouche de poursuivre tes études. C'est sans doute à ta demande que Ruchla, ta mère, fait établir par un notaire de Lublin une attestation, signée le 26 mars 1940, de conformité à l'original d'une copie de ton diplôme de Licence de littérature obtenu en Pologne. Et c'est à Toulouse que, le 4 décembre 1940, l'Office polonais de cette ville certifie la traduction en français de cette attestation.
Entre-temps, tu as quitté Paris.
Le 14 juin 1940, les Allemands sont entrés dans la capitale. Quatre jours plus tard, le 18 juin, c'est le consulat de Pologne à Toulouse qui valide la prolongation de ton passeport pour un an. Ainsi, tu as quitté Paris avant même que ne soit instituée la « Zone libre » par la convention d'armistice signée le 22 juin 1940. Sur les raisons et les conditions de ton départ précipité et de ton arrivée à Toulouse, les documents se taisent. Mais le 20 août 1940, sur un papier à en-tête du Ministère des communications », le receveur des PTT délivre à Szternfinkiel Fradla, « évacué (sic) de Paris 5e », un reçu de « 3 fiches A portant l'indication de son nouveau domicile », qui n'est pas mentionné.
Quatre mois plus tard, le 23 décembre 1940, signée de ta main, une déclaration sur l'honneur d'obtention du baccalauréat en 1930 est enregistrée par l'Office Polonais de Toulouse, celui-là même qui, le 4 décembre, a certifié la traduction de l'attestation notariale de ton diplôme de Licence. C'est sans doute munie de ces attestations que tu reprends rapidement tes études en t'inscrivant aux « Cours supérieur (sic) réservés aux étudiants étrangers » durant le 1er semestre 1941-1942. Bilan : le 19 juin 1942, tu obtiens un « Diplôme pour l'enseignement du français à l'étranger », délivré par l' « Institut normal d'études françaises » de la Faculté des lettres de l'Université de Toulouse.
Jusque-là, tu as échappé à la « Loi relative aux ressortissants étrangers de race juive », promulguée le 3 octobre 1940, qui prévoyait leur recensement et leur internement, alors que, pendant ces mêmes années, les juifs de Pologne, plus encore que les juifs en France, éprouvent la fureur nazie.
Mars 1941 : les Allemands regroupent les juifs de Lublin dans un ghetto. L'as-tu appris ? Et si oui, comment ? Quelles nouvelles te sont parvenues ? Est-ce à ton diplôme décerné par la Croix-Rouge que tu dois d'avoir obtenu de cette organisation qu'elle transmette le message que tu as envoyé, le 29 octobre 1941, à Ruchla, ta mère ?
Ton message est adressé au 24 rue Saint Nicolas [ulica Świętego Mikołaja] : une rue située au cœur du ghetto de Lublin. Le tampon de la Croix Rouge est daté du 10 novembre 1941. Tu as écrit :
> « Chers,
Heureusement, j'ai reçu un message de mon père. Chez moi tout va bien. Moniek [diminutif de Moshe, prénom de ton frère] envoie de l'argent, même si je n'en ai pas besoin. Est-ce que vous recevez quelque chose de vos proches ou de Monka ? Je vous embrasse, petite maman et papa. »
Qui est Monka ? Je ne sais pas. Quel est ce message « heureusement » reçu ? Rien ne l'indique. Mais plus de deux mois plus tard, le 23 janvier 1942, Chaskiel, ton père, te répond, au verso du message précédent, toujours par l'intermédiaire de la Croix Rouge qui transmet cette réponse le 9 avril 1942.
« Chère Niuto
Nous sommes tous en bonne santé. Nous avons reçu de Paris et de notre famille un paquet de nourriture et une chaussure. Nous avons des nouvelles de Mońka. Frymeta est avec nous. »
Adressée à Niuto (et non à Niuta), signée de Chaskiel (et non de Ruchla à qui était adressé ton message précédent), cette réponse est tapée à la machine, alors qu'il est improbable que Chaskiel en ait eu une en sa possession. Faute de langue ou confuse allusion, il mentionne la réception d'une chaussure : une seule ? Ne reste que de maigres informations sur les nouvelles que Mosche auraient données et sur la présence de Frymeta, la première épouse de Moshe. Comment ne pas penser que le message a été censuré et la vérité dissimulée ?
Le tampon de la Croix Rouge est daté du 9 avril 1942. À la date inconnue où tu reçois ce dernier message, tes parents, prétendument « en bonne santé », sont peut-être déjà décédés ou sont sur le point d'être envoyés à la mort. Quand ont-ils été conduits dans un camp d'extermination ? Et lequel ? À Belzec où, en dix mois, entre mars et décembre 1942, plus de 450 000 personnes, juives pour la plupart d'entre elles, ont été gazées ? Ou à Majdanek, à deux kilomètres environ du centre de Lublin ? Qu'as-tu appris, quand et comment ? De tout cela, je ne sais rien.
Et toi-même, que sais-tu quand, le 5 août 1942, un fonctionnaire de « L'État français », comme il se nomme, certifie que la traduction de ton acte de naissance, « extrait du registre du Rabbin de la ville de Lublin », est « véritable et conforme à l'original ». Cette certification de « L'État français » est frappée d'un tampon du « Bureau des affaires étrangères. Bureau des Polonais de Toulouse ». À quel usage est destiné cet acte qui authentifie une origine juive ?
Peut-être ne sais-tu rien encore sur le sort de tes parents quand tu reçois, daté du 10 septembre 1942 et établi à ton adresse, 5 rue Joubert, un extrait (vierge) de ton casier judiciaire établi par le ministère de la Justice. Mais pour quel usage, alors que l'étau de la collaboration se resserre sans doute autour toi ?
Quelle est la force de vie qui t'anime quand, après avoir obtenu, en juin 1942, ton « Diplôme pour l'enseignement du français à l'étranger », tu renouvelles, en 1942-1943, ton inscription, certifiée le 11 janvier 1943, à la Faculté des lettres de l'Université de Toulouse, désormais « en vue du Doctorat d'Université » ? Quel est cet acharnement inaltérable à poursuivre tes études ? La poursuite d'un rêve ou la conjuration d'un cauchemar : la mort de tes parents et des tes proches ? Et, avec elle, l'extermination des centaines de milliers de juifs de Lublin. Mais le sais-tu ?
Qu'as-tu appris, quand et dans quelles circonstances ? Quand et à quel point l'horreur a-t-elle bouleversé la jeune femme dont le sourire inonde les photos de ta jeunesse polonaise ? Je n'imagine rien. Je me défends de le faire. Inimaginable est la douleur que tu as affrontée.
Qu'es-tu devenue entre janvier 1943 et décembre 1944 ? Aucun document qui suggère ce que fut ta vie pendant ces deux ans. Il ne me reste que quelques mots arrachés au silence de mon père : il m'a seulement parlé, sans rien m'en dire vraiment, de ton engagement clandestin auprès des enfants juifs. C'est alors, probablement, que tu l'as rencontré. Dans quelles circonstances ? Silence de mon père. Étrangère et juive, tu étais menacée. Il t'a hébergée et protégée. Il avait, m'a-t-il dit, deux appartements. Quand, dans l'un d'entre eux, les miliciens l'ont cherché et t'ont cherchée, vous étiez dans l'autre. Et, dans un de ces sanglots que, parfois, il ne parvenait pas à réprimer, mon père a ajouté : « Elle n'a pas été emmenée à Drancy ».Quelques documents parlent à nouveau de toi à partir de décembre 1944. Entre cette date et novembre 1945, des bulletins de salaires, frappés du tampon SER, attestent que tu es employée comme « secrétaire » au « Service d'évacuation et de regroupement des enfants et familles juives », domicilié au numéro 4 de cette rue dont le nom grimace : « rue des Martyrs ».
Tu es, plus que jamais, devenue une résistante d'abord à Toulouse, puis à Moissac dans la Maison des enfants juifs où Isaac, mon père, a aussi travaillé en qualité d'enseignant d'électricité. Quelle est la force t'anime quand tu as contribué à la prise en charge l'accueil et la protection des enfants juifs ? Quelle était exactement ta responsabilité ? Quelle souffrance as-tu ainsi surmonté quand tu as fait face à la détresse des enfants juifs ? L'as-tu vraiment surmontée ?
Quelle force de vie t'anime encore quand tu t'inscris à la bibliothèque de la ville de Toulouse le 10 février 1945 ? La carte de la bibliothèque est d'abord établie à ton nom de jeune fille et à une adresse, 27 rue Bernard Mulé, puis elle est corrigée au nom de Françoise Maler, domiciliée 84 allée de Barcelone. Prénom : « Françoise ». Pour dissimuler ton véritable prénom, étrange et étranger ? Nom : « Maler ». Pourtant tu n'as pas encore changé d'état civil.
8 mars 1945 : l'Allemagne nazie a signé sa capitulation. Mais les enfants juifs, orphelins, doivent encore être secourus. Tu t'y emploies jusqu'en novembre 1945, date de ton dernier bulletin de salaire. Et sans doute plus tard. Longtemps, trop longtemps après, mon père m'a dit : « À Moissac, elle s'occupait des enfants juifs rescapés et orphelins. » Et il a ajouté : « Elle était… » - Quel mot a-t-il prononcé ? Je ne sais plus. « Perturbée », je crois. Ta résistance n' a pas aboli ta fragilité.
Un autre jour, après ma naissance, évoquant les deux villes entre lesquelles vous partagiez votre existence, mon père m'a dit : « Elle ne voyageait jamais entre Toulouse et Moissac sans emmener avec elle toutes tes affaires ». Et, dans un sourire : « même ton pot de chambre ». Tu étais déjà très dérangée, « presque folle », a-t-il ajouté. Je n'ai pas pris le mot au sérieux : c'était, je l'ai cru, une banale façon de parler. Mais dire que tu deviendras, plus tard, « folle de désespoir », est-ce encore une façon de parler ?
C'est le 29 décembre 1945 que tu as épousé mon père. Qu'étiez-vous « l'un pour l'autre », comme on dit ? Jamais je ne saurai ce qu'a été pour toi ce père que tu m'as laissé, ni ce que tu as été pour lui. Et dans ses silences, j'entendais et j'entends encore la terrible défaite dont il ne s'est jamais remis et son entêtement à tourner les pages quand elles sont déchirées.
Je voudrais te parler d'Isaac, mon père, qui fut ma seule famille pendant près de vingt ans. De sa tendresse et de ses rudesses. De ses silences et de cet accent indéchiffrable que je devais être le seul - je l'ai compris plus tard - à percer sans l'entendre vraiment..
Comment sa trajectoire a-t-il croisé la tienne ? Silence de mon père dont j'ai appris peu à peu ce que fut son parcours.Il est né en 1906 dans une famille juive de marchands de peau, à Soroki, une ville alors roumaine (devenue aujourd'hui Soroca en Moldavie). Les pillages – les pogroms - n'étaient pas rares et, dans les périodes de disette ou de famine, leurs victimes venaient voler les peaux qui séchaient en plein air pour tenter de leur arracher des lambeaux de viande. C'est cerné par cette violence et cette misère que mon père grandit. Il fait ses études à Odessa et se réclame du sionisme marxiste de Ber Bororov. Jeune étudiant, il manifeste, en 1923, contre le numerus clausus qui interdit aux juifs d'accéder à l'Université. Arrêté, il bénéficie d'un séjour de six mois en Sibérie où il rencontre des anarchistes qui font sur lui, me dit-il, une vive impression. Sur le bateau de son retour, il apprend la mort de Lénine : « J'ai compris alors, que c'était foutu pour nous. », me confie-t-il sans émotion apparente. Il décide alors avec son frère, Daniel, de se rendre en Palestine où ils rejoignent un Kibboutz et où, selon ses propres mots, ils « assèchent des marais ». Au début des années 30, les deux frères quittent la Palestine pour l'Allemagne où Daniel reste pendant quelques années : menacé par l'antisémitisme, il est exfiltré à temps vers l'Angleterre, puis au Chili par l'entreprise qui l'emploie. Isaac, lui, se rend à Toulouse où il reprend ses études et, en 1933, obtient son diplôme d'ingénieur électricien. Il travaille dans des barrages et obtient sa naturalisation en 1939. Il est aussitôt incorporé et rejoint le camp de Souge. Alors qu'il est allé chercher du bois, il se coupe le pouce avec une serpette. « Blessé de guerre », comme il me l'a répété ironiquement lui-même, il est démobilisé et rejoint Toulouse dès 1940.
Le 3 février 1941, Isaac, domicilié au 154 rue des Récollets, demande à être autorisé à exercer le métier d'artisan électricien. L'autorisation est accordée en mars. Le 14 juin, il reçoit un avis d'inscription au registre des médias et un certificat Artisanal Officiel. Il ouvre un « Atelier de constructions et réparations électriques », comme l'indique le papier à en-tête « Maler. Ingénieur I.E.T ». L'atelier est domicilié 5 rue Darquier.
Un jour, une lettre datée du 18 août 1943 est glissée dans la boîte à lettres. La voici, orthographe et ponctuation garanties d'origine.
« Monsieur Maller,
Nous Vous demandont de bien Vouloire debaracer la cour de touts les Juifs qui se trouve à Votre service et de les ranplacer par des Français nous vous feliciteron si non nous le feron nous même
Un ami
Ermeny »
Je ne sais pas exactement quand et dans quelles circonstances – expropriation ou dépôt de bilan ? – cet atelier a été fermé. Mais le grenier de mon enfance était encore encombré d'une partie du matériel que mon père avait sauvé : des carcasses de radiateurs, des rouleaux de fil électrique, des prises de courant et des interrupteurs.
Sans doute, Niuta, savais-tu tout cela quand, en décembre 1945, le fils d'un marchand de peaux a épousé la fille d'un marchand de bois de chauffage. L'équarisseur, sa femme et leurs enfants ont vécu en Roumanie. Le marchand de bois, sa femme et leurs enfants ont vécu en Pologne. Que dire de ces ascendants que je n'ai pas connus et que je n'ai donc pas perdus ? Je ne sais presque rien d'eux et rien ne m'attache à eux, si ce n'est les liens attestés d'une filiation.
Isaac, mon père, a rompu avec toute sa famille : ses parents et sa sœur qui étaient restés en Russie. Il a rompu avec son propre frère après ma naissance. Plusieurs fois, il m'a dit : « Ils étaient dans la misère et je ne pouvais rien faire pour eux : j'ai préféré qu'ils me croient mort. » Et puis, un jour, il a fini par me dire : « Ta mère n'avait plus de famille. Alors j'ai décidé et je lui ai dit que moi non plus je n'en avais plus ». Déclaration d'amour, déclaration d'amour douloureux. Ce n'était pas tout à fait exact : mon père a correspondu quelques temps encore avec son frère réfugié au Chili ; et ma mère a échangé une correspondance avec son frère, Moshe, exilé en Bolivie.
Mariée à un Français (naturalisé), tu es désormais française : le 17 février 1946, la Préfecture de la Haute-Garonne t'a délivré une carte nationale d'identité. Tu disposes d'une carte d'électrice : non signée et sans tampon sur le moindre scrutin. Le livret de caisse d'épargne que tu as ouvert le 12 juin 1945, précise désormais « femme Maler ». Tu es même titulaire d'une carte nationale de priorité valable du 15 juin au 30 novembre 1946, sans doute parce que tu es enceinte.
Onze mois après ton mariage, le 26 novembre 1946, tu donnes le jour à ton enfant. Ce jour-là, mon père t'offre une montre de marque « Genève », 18 karats (sic). La montre a disparu, le bulletin de garantie est entre mes mains.
La vie, ta vie, est de retour. Mais ce n'est pas impunément qu'elle a pris sa revanche sur le chagrin qui couve encore.
Dans la petite valise, j'ai découvert un jeu de photos. Sur quelques-unes d'entre elles, tu prends manifestement la pose pour que le moment soit solennellement fixé. Mais ces photos ne mentent pas : en les contemplant, je vois, j'ai vu souvent, tes sourires adoucis et ton regard triomphant. Je vois une femme attentive, penchée sur un berceau où sommeille un lardon, coiffé d'un bonnet ridicule : j'ai appris qu'il était moi. Je vois une mère portant fièrement dans ses bras un bambin joufflu qu'elle brandit comme un trophée. Je la vois accompagner l'enfant un peu plus âgé qui chevauche un tricycle. Je te vois avec mon père, marchant hardiment dans la rue. Je vous vois tous deux entourant cet enfant. Et je nous vois avec lui alors qu'il semble avoir environ quatre ans : comme si nous étions ensemble une dernière fois. Je me souviens de toutes ces photos, plusieurs fois contemplées, mais pas de cette femme. Ce n'est pourtant pas une étrangère : c'est ma mère.
Ces photos d'un album de famille interrompu que j'ai enfin regardées une à une m'accompagnent à Varsovie en 2014 quand je rejoins Wlodimierz (le fils de Moshe, ton frère) dont j'ai retrouvé la trace depuis peu. Et là, dans l'appartement de mon cousin, je découvre qu'il possède les mêmes. Mais ces vestiges ont un revers : au dos de chacune d'elles, tu avais écrit quelques mots avant de les envoyer à ton frère en Bolivie, les mots d'une mère comme tant d'autres, approximativement semblable aux autres, apparemment.
Je ne garde aucun souvenir de toi, alors que nous avons partagé les cinq premières années de ma vie, Aucun souvenir direct. Je te reconnais sur les photos, puisque j'ai appris à les connaître. Je me souviens de ces photos, mais d'aucune autre image. Parfois, je cherche encore le son de ta voix et l'accent polonais que ne pouvaient pas avoir effacé tes études de français. En vain, évidemment. Je ne sais rien que par ouï-dire : des lambeaux de récit arrachés aux silences de mon père et mis bout à bout au fil des ans. Je les dépose ici comme des fleurs sur ta tombe : une tombe imaginaire puisqu'il n'en existe aucune autre.
Nous avons été si violemment séparés que cette violence a englouti ma mémoire. Cette mémoire ne te connait pas. Comme si je ne t'avais jamais connue. Je me souviens de ton absence et non de l'absente. C'est de cette absence et d'elle seule que je porte le deuil. Et les mots que j'écris ici sont le seul mémorial que je peux t'offrir : les souvenirs dispersés, répartis sur plusieurs décennies, non d'une mère, mais de mes tentatives de faire sa connaissance et de reconstituer un puzzle auquel manquent à jamais les pièces principales.
Ce n'est pas seulement en fouinant dans la boîte à souvenirs et en traquant les mots de mon père que j'ai cherché à éventer les secrets de ta vie. Je les ai cherchés en d'autres lieux. Laisse-moi te dire où je les ai cherchés, où je t'ai cherchée, comment je t'ai cherchée.
En mars 2006 Je te cherche à Toulouse. Je suis 'Allée de Barcelone qui longe le canal de la Brienne. Aucun souvenir ne m'y rattache. Une péniche est à quai. Je m'approche : c'est une boîte de nuit sans doute, silencieuse et déserte en plein jour. Aucun flonflon n'échappe de sa cale et personne ne veille sur le bastingage. Ce havre de plaisirs me surprend comme une insulte. Pis : comme un viol de ce passé auquel s'arrête le récit de La Dépêche du midi.
Plus loin, le long du quai, au numéro 84, la façade blanche d'un immeuble de trois étages où nous avions vécu : je crois la reconnaître alors que je ne m'en souviens pas et que, du moins, je ne l'ai jamais revue depuis plus de soixante ans. Mon regard longe le canal et s'arrête face à la maison puis revient vers le canal. La façade a-t-elle changé ? Sinon, à quel étage vivions-nous ? Et que s'est-il passé entre la maison et le canal ? J'essaie d'imaginer, à l'affût d'une émotion douloureuse que, désemparé, je ne ressens pas.. L'eau du canal est calme : elle l'a sans doute toujours été. L'eau est trop verte pour délivrer son secret. Je reste là immobile, désolé de la minceur des mots. Ceux qui me viennent à l'esprit sont dérisoires, mais les débuts sont souvent maladroits. Je reste là un long moment, sans oser entrer dans l'immeuble. Pour demander quoi et à qui ? Mon chagrin, ce jour-là, est muet.
Autre temps, autres façades.
Quelques années plus tard, en 2014, je me rends en Pologne, à Varsovie, puis à Lublin.
En quittant la gare de Lublin, sur le chemin qui mène à l'hôtel où j'ai réservé une chambre, j'emprunte la rue Foska, aujourd'hui rue du 1er mai, et je m'arrête devant le 34. Est-ce le même numéro ? Je ne sais pas. Tu as vécu là après ta naissance dans cette maison à deux étages. Au premier étage sans doute. Je passe le porche, encadré par deux commerces (un minuscule supermarché et un énigmatique Super Cena) et je pénètre dans une courette noircie : par un dépôt de charbon, je crois. Je pense : « ils déposaient là ce qu'ils vendaient ». As-tu joué dans cette cour ? Le long de la façade côté cour, un escalier extérieur monte au premier étage. J'hésite longuement, et, finalement, je renonce à l'emprunter. C'était là-haut peut-être, il y a plus de quatre-vingt-dix ans. Je sors dans la rue : je regarde à nouveau. Tristesse.
Après un bref passage à l'hôtel, je me rends à la deuxième adresse en ma possession, 2 rue Browarna où tes parents, ton frère et toi, vous avez vécu plus tard. De petits bâtiments forment un quadrilatère : j'essaie d'en faire le tour. Sur l'une des façades, une plaque commémore Anna Langfus, ta cousine. Mais rien ne signale votre passage. J'entre dans la cour intérieure cherchant du regard d'improbables indices. Où avez-vous vécu exactement ? Je ne sais pas. Je parcours du regard les façades et je prends quelques photos. Tristesse. J'aperçois vaguement un autel au milieu de la cour : quelques fleurs autour d'une statuette de la Vierge Marie. Tout était juif, jadis ,à cet endroit. Sidéré, j'oublie de photographier cette indécente manifestation d'une expropriation.
Le lendemain, je me rends au mémorial des juifs de Lublin. Je suis reçu par sa responsable. Nous cherchons les souvenirs de mes grands-parents, notamment pour savoir quand et dans quel camp ils ont été gazés : à Belzec ou à Majdanek ? Aucune trace. J'enregistre en français un témoignage avant de partir vers la dernière adresse connue de tes parents, au cœur du ghetto : rue Saint-Nicolas (ulica Świętego Mikołaja).
À l'emplacement probable de ce dernier refuge, un pavillon récent a remplacé une maison disparue. Pas une trace de l'endroit où tes parents ont vécu quelques mois et qu'ils ont quitté de force pour le camp de la mort. En face, sur une petite colline, une église surveille le voisinage et nargue le territoire de l'anéantissement. Je suis saisi d'un mouvement de révolte et d'un sentiment d'impuissance. À quoi bon ?
À quoi bon me rendre à Belzec ou à Majdanek ? Les camps d'extermination ne m'apprendront rien sur la disparition des membres de cette famille que je n'ai pas connue. Ta disparition, Niuta, a rompu le dernier fil avec eux, absorbés par un peuple d'ombres. Sache au moins que je n'ai jamais oublié ni les tiens, ni ce peuple.
Le soir même je reprends le train vers Varsovie et je rejoins l'aéroport : retour à Paris.
Niuta et Isaac, mes parents, ont été des rescapés d'un désastre qui a détruit la plupart des membres de leurs familles, de mes familles, d'innombrables familles. Jusqu'au moment où un banal accident a précipité l'effondrement de Niuta et condamné mon père à un violent désespoir, puis à une sourde tristesse.
Fait divers. Le jeudi 18 juin 1951 à 12h15, dans une rue de Moissac, un enfant de quatre ans et demi échappe à la vigilance de sa mère. Il se cache devant un camion à l'arrêt. Le chauffeur ne le voit pas et démarre. L'enfant est sous une roue, grièvement blessé. Il est immédiatement hospitalisé à l'Hôpital-Hospice de Moissac où il est opéré par le docteur Joseph Gouzy. Le 18 juillet, il quitte cette clinique pour l'Hôpital Purpan de Toulouse, Salle Delpech. Il en sortira le 9 novembre pour achever sa convalescence au « Mas Catalan » à Font-Romeu qu'il quitte huit mois plus tard. Alors commence pour lui une autre histoire d'enfant.
Tu étais sa mère, ma mère.
Ce fait divers en a précipité un autre : une lointaine réplique d'un tremblement de terre, un dégât collatéral d'une entreprise d'extermination.
De l'hôpital, je suis sorti guéri, presque indemne. De l'accident, il ne me reste qu'une image et les sensations, sans doute rapportées, d'une terrifiante douleur. De toi, plus rien. De l'hôpital, il me reste quelques vagues souvenirs. De toi, plus rien. Ta mort elle-même est engloutie dans un trou de mémoire.
Mais dans la petite valise à souvenirs qui n'en sont pas pour moi, j'ai retrouvé daté du 4 juillet 1951, un reçu, délivré à Madame Maler, par la clinique de « Béthanie », 144, Chemin Roul, Talence pour la somme de 15000 francs. Quinze jours après l'accident, tu étais accueillie dans un hôpital psychiatrique. Un mois plus tard, le 3 août 1951, une nouvelle lettre à l'entête de « Béthanie », 144, Chemin Roul, Talence (près Bordeaux) (Gironde). La lettre est adressée à Monsieur Maler à Moissac. On peut y lire : « Elle se montre calme, mais conserve bien des idées morbides qu'elle répète longuement. État général excellent. Le traitement touche à sa fin et je ne pense pas obtenir davantage ».
Tu as donc quitté la clinique : ton état général était « excellent » puisque tu ne conservais que des idées morbides ! Le traitement touchait « à sa fin » sans espoir d' « obtenir davantage », si ce n'est, comme le réclame, un mois plus tard, une lettre de la clinique , le « paiement des arriérés ».
Quelle est cette douleur, venant après tant d'autres, qui s'est emparée de toi et t'a dévastée ? Tu n'es pas revenue, hagarde et décharnée, des camps de la mort. Tu as survécu sans être vraiment une survivante. Tu as connu tous les risques de la chasse aux Juifs de France. Tu as échappé au pire sans être une rescapée. La milice ne t'a pas atteinte. Mon père m'a confié que tu as cru - et on pouvait, semble-t-il, le croire - que je resterai invalide. Je le suis resté, mais seulement invalide de toi. Tu t'es crue coupable, je le suis devenu.
Est-ce avant ton départ à la clinique de Talence ? Est-ce à ton retour ? C'est encore mon père qui me l'a dit : tu as été tenue à l'écart de ma chambre à l'hôpital. Pourquoi ? Que te reproche-t-on ?
Que reproche-t-on, selon mon père, à cette mère qu'on éloigne de moi ? Elle veut voir son fils. Elle veut qu'on s'occupe bien de son fils. Elle harcèle les infirmières. Elle crie dans le couloir. Elle dérange le service. Elle perturbe les soins. Elle accable les malades et les blessés. La direction de l'hôpital décide alors de la priver de droit de visite. La nuit, mon père dort auprès de l'enfant. Le jour, il rend visite à sa femme. Jusqu'à ce mercredi d'octobre, deux mois après ton retour de « Béthanie », à peine dix jours avant ma sortie de l'hôpital.
Je ne me souviens pas de ce que j'ai su et comment je l'ai su. Mais, selon mon père, des infirmières ont bavardé devant moi et j'ai poussé un grand cri.
La Dépêche du Midi, « Journal de la démocratie », mercredi 31 octobre 1951, page 4 :
Depuis huit jours, une femme de 35 ans, Mme Fradla Maler, a disparu de son domicile, 84 allées (sic) de Barcelone, à Toulouse. D'après les déductions de M. Maler et les témoignages recueillis auprès des voisins, la jeune femme aurait quitté son appartement mercredi, entre 22 heures et 2h.30 du matin. Elle était vêtue seulement d'une robe de chambre et d'une chemise de nuit. Elle n'emportait pas d'argent. On suppose que Mme Maler s'est suicidée en se jetant dans le canal de la Brienne.
Depuis le jour, il y a plusieurs mois de cela, où son fils âgé de 7 ans [4 ans et demi, en vérité] a été victime d'un terrible accident de la circulation à Moissac (Tarn et Garonne), elle donnait en effet des signes de dérèglement mental. Le garçonnet, gravement touché aux jambes et au ventre, est en traitement à l'hôpital de Purpan. Sa vie n'est plus en danger. Mais la maman, extrêmement impressionnée par les souffrances de l'enfant et à l'idée qu'il resterait peut-être infirme, était inconsolable et avait presque perdu la raison.
Il est possible, de ce fait, qu'elle se soit livrée à un acte de désespoir. On a trouvé, près de l'eau, sur le bord du canal, en face la maison où Mme Maler habitait, la boîte à ordure du ménage.
M. Maler, qui passe toutes les nuits auprès de son fils à Purpan, n'a constaté la disparition de sa femme que le lendemain, jeudi, en venant déjeuner. Il l'a aussitôt signalée à la police. Toutes les recherches entreprises dans l'intérêt de la famille sont à ce jour restée vaines.
Quinze ans plus tard, bravant le silence de mon père, j'ai demandé à mon avocat d'intervenir auprès de la Police de Toulouse. À la suite de la démarche qu'il a effectuée, Maître Pierre Weill-Raynal, avocat à la cour de Paris, m'a écrit le 11 février 1966 que le commissariat du 2ème arrondissement de Toulouse a « fait savoir que le dossier de recherches ouvert à la suite de la disparition de votre mère a abouti à un rapport de recherches infructueuses, clos le 15 novembre 1951. » Quinze jours de recherches, pas plus. Des recherches infructueuses que moi je n'achèverai jamais.

26.12.2024 à 18:45
À propos d'un texte de Stéphane Beaud et Gérard Noiriel : critique des impasses ou impasses d'une critique ?
Henri Maler, Ugo Palheta
Où il est question d'un article publié par Le Monde diplomatique de janvier 2020 sous le titre « Impasses des politiques identitaires ».
- Interventions, altercationsTexte intégral (5011 mots)

La contribution qui suit a été publiée initialement sur le site de Contretemps le 6 février 2021.
Un article de Stéphane Beaud et Gérard Noiriel, publié par Le Monde diplomatique de janvier 2020 sous le titre « Impasses des politiques identitaires », a suscité d'intenses controverses et des appropriations intéressées, notamment de la part de médias (Marianne), d'idéologues (par exemple Laurent Bouvet) ou de collectifs (le Printemps républicain) qui se sont spécialisés depuis longtemps dans la disqualification des mouvements antiracistes au nom de la « République » et de sa sauvegarde.
Discuter la contribution de S. Beaud et G. Noiriel est nécessaire, non seulement en raison des enjeux, de la grande valeur de leurs travaux respectifs, [1] mais aussi de leur engagement tenace en faveur d'une science sociale critique des rapports de domination. Or, dans le cas présent, force nous est d'admettre, comme on dit, que le compte n'y est pas. On se bornera ici à se tenir au plus près de l'article publié pour en discuter la démarche et les présupposés, sans omettre que l'article en question est extrait d'un livre qui vient de paraître, plus précisément de son introduction et de sa conclusion.
Quelle est, présentée avec nuance, l'idée directrice de ce texte ? Que les revendications de minorités et des mouvements prétendant en défendre les intérêts (revendications et mouvements hâtivement qualifiés d' « identitaires ») menacent d'enfermer les acteurs qui les défendent, en les rendant prisonniers de prétendues « politiques identitaires », jamais définies en tant que telles et réduites à un dénominateur commun imaginaire.
Amalgames
Quels sont les acteurs des « politiques » mises en cause ? Faute de les distinguer, l'article amalgame des chercheurs et universitaires (auxquels est réservé le titre d'« intellectuels » [2]), des organisations et mouvements (qui ne sont jamais clairement identifiés alors qu'ils sont très divers [3]), ou encore des mobilisations et des actions (dont ne sont retenus que des « coups de forces ultraminoritaires » [4]). Cet amalgame permet de construire à peu de frais des « politiques identitaires » globalisées comme si elles prétendaient toutes à la définition de politiques globales et alors même que la quasi-totalité de celles et ceux qui sont (ou semblent) visés se réclament de l'égalité et non d'une quelconque « identité ».
On voit d'ailleurs à quel point le pari de S. Beaud et G. Noiriel de se tenir sur un plan purement scientifique ne tient pas puisqu'ils reprennent, là encore sans discussion, une expression – « identitaire » – extrêmement problématique et qui n'est nullement issue du champ scientifique mais de polémiques médiatiques et politiques. Ainsi parlent-ils de « politiques identitaires », ou dans leur livre de « gauche identitaire » (p. 17 de leur livre), sans s'interroger sur la valeur scientifique d'une telle notion, qui tend à amalgamer des courants qui revendiquent la défense d'une « identité » européenne qu'ils jugent menacée (en l'occurrence des mouvements d'extrême droite, bien souvent néofascistes), d'autres qui utilisent la notion d'« identité » pour critiquer les assignations identitaires, et d'autres encore qui usent d'une rhétorique de l'« identité » dans une perspective de revalorisation symbolique de groupes subalternes. Peut-on véritablement se débarrasser de ces différences d'usages en se contentant d'affirmer que tous « parlent le même langage » ?
Symptomatique de ce schématisme, S. Beaud et G. Noiriel renvoient dos-à-dos la pétition intitulée « Manifeste pour une République française antiraciste et décolonialisée » diffusée par Mediapart le 3 juillet 2020, et l'« Appel contre la racialisation de la question sociale », initialement publié par Marianne le 26 juillet 2020. Avec cette conséquence : attribuer aux signataires de la première pétition l'objectif de « défendre un projet politique focalisé sur les questions raciales et décoloniales occultant les facteurs sociaux ».
Ce disant, S. Beaud et G. Noiriel leur prêtent un projet politique global alors que les signataires interviennent ici exclusivement contre l'effacement de l'histoire coloniale et esclavagiste dont témoignent notamment les violences policières (dont les victimes sont très souvent issues de l'immigration postcoloniale). Comment peut-on négliger que nombre de ces signataires interviennent de longue date contre les politiques de classe qui accroissent les inégalités socio-économiques et dégradent les conditions de vie des classes populaires ? Et comment peut-on évoquer une prétendue occultation des facteurs sociaux en laissant ainsi entendre que la question raciale ne relèverait pas de mécanismes sociaux [5] ou ne serait pas une composante de la question sociale ?
En revanche, S. Beaud et G. Noiriel passent ici sous silence l'universalisme abstrait de l'appel publié par Marianne : un universalisme qui sous couvert de la proclamation d'une universalité de droits égaux dissimulent les oppressions et occultent des discriminations et ségrégations structurelles que sociologues, économistes ou démographes n'ont pourtant aucune peine à mettre en évidence quand on leur en donne les moyens statistiques [6]. Comme si l'universalité concrète n'était pas encore à conquérir et pouvait l'être sans mobilisations menées à partir de ces situations d'oppression.
Or cette mise en scène polémique permet à nos auteurs de déplorer, en des termes un tantinet méprisants, une supposée guéguerre entre deux « camps » qui menacerait la position de surplomb d'universitaires défendant l'indépendance de la recherche [7] : « Ces affrontements identitaires, où chaque camp mobilise sa petite troupe d'intellectuels, placent les chercheurs qui défendent l'autonomie de leur travail dans une position impossible » Sans nier la tension qui peut exister entre la recherche théorique et l'intervention politique, on voit mal en quoi la mobilisation politique de chercheurs menacerait l'indépendance de leur recherche, ou comment celle-ci serait garantie par le refus d'intervenir directement dans le débat politique [8].
Et on ne peut s'empêcher de relever cet étrange paradoxe : publier dans un mensuel journalistique un extrait (discutable) est le type même d'intervention politique que S. Beaud et G. Noiriel récusent, alors que le second, dans une note de son blog, attribue un malentendu au titre choisi par Le Monde diplomatique :
« Même si le titre qu'a choisi la rédaction du Monde Diplomatique (”Impasses des politiques identitaires”) a pu inciter une partie des lecteurs à penser que notre propos était politique, ce que je regrette pour ma part, il suffit de le lire sérieusement pour comprendre que notre but est justement d'échapper à ce genre de polémiques stériles. »
Comme si le « propos » de cet extrait n'avait rien de « politique », même en un sens minimal, dans la mesure où il renvoie à des options politiques et critique d'autres options politiques.
2. Qu'auraient donc en commun les acteurs qui, à des titres divers, rompent avec l'universalisme (abstrait) ? S. Beaud et G. Noiriel l'affirment : leur sous-estimation ou leur ignorance des déterminations de classe des discriminations et des oppressions subies par des minorités en raison de leurs origines, de leurs couleurs de peau et/ou de leur religion.
C'est évidemment inexact s'agissant des universitaires et chercheurs qui, en France, font plus ou moins référence à l'intersectionnalité sans négliger, bien au contraire, les déterminations de classe. C'est totalement réducteur s'agissant de nombre de militant·es, de mouvements et d'organisations en lutte contre le racisme qui n'ignorent pas que l'oppression raciale s'imbrique avec l'exploitation de classe. C'est unilatéral s'agissant des mobilisations de masse les plus récentes. C'est abusivement simplificateur s'agissant des revendications d'appartenance d'habitants des quartiers populaires, souvent parfaitement conscients de l'existence d'inégalités de classe dont ils sont les victimes ; même si cette conscience s'exprime parfois dans un langage davantage territorial (le « quartier ») qu'économique, cela sans doute en raison même du chômage qui sévit si fortement parmi les jeunes de ces quartiers.
Raccourcis
1. Mais d'où vient l'importance prise par les affrontements dont S. Beaud et G. Noiriel dénoncent le simplisme ? D'où viennent, en particulier, face à un universalisme proclamé mais largement démenti, l'adhésion d'inégale intensité de minorités opprimées à des appartenances particulières et leur participation à des mobilisations spécifiques ?
Une évocation du nouveau monde médiatique est mise au service d'une critique de la prétendue « américanisation du débat public ». Cette critique empruntée sans discernement au bavardage médiatique fait office d'explication de la centralité qu'aurait acquise la dénonciation du racisme dans le débat public, imputable de surcroît à des « émotions ». Alors que la contestation et les mobilisations correspondantes sont, en France, généralement minorées, marginalisées, déformées, voire traînées dans la boue dans les grands médias audiovisuels et par la presse de droite (qu'on pense à la marche contre l'islamophobie du 10 novembre 2019 ou des mobilisations contre les violences policières de l'été 2020), S. Beaud et S. Noiriel ne craignent pas d'affirmer :
« Le racisme étant aujourd'hui l'un des sujets politiques les plus aptes à mobiliser les émotions des citoyens, on comprend pourquoi sa dénonciation occupe une place de plus en plus centrale dans les médias. »
Quels médias, si l'on excepte la presse indépendante et les « réseaux sociaux » dont l'audience est minoritaire ? Quelle étude empirique, même sommaire, permet à des chercheurs attachés à de telles études d'affirmer cette prétendue centralité de la dénonciation du racisme dans les médias ? Cela d'autant plus que la plupart des travaux scientifiques sur la question des discriminations raciales sont à peu près inconnus de la plupart des journalistes comme des responsables politiques, que les chercheurs·ses travaillant sur ces questions sont rarement sollicité·es par les médias de grande écoute et que cette question est loin d'être au cœur de l'agenda politique.
Pour ne prendre qu'un exemple, a-t-on jamais vu les inégalités ethno-raciales constituer un point sur lequel on interroge les candidats à l'élection présidentielle au cours des vingt dernières années ? La dimension raciale des violences policières est-elle véritablement discutée dans les médias de grande écoute ? Au contraire, les polémiques médiatisées sont polarisées par une débauche de mots vides ou vidés de tout contenu précis mais sans cesse ânonnés par lesdits journalistes et responsables politiques : « communautarisme », « séparatisme », « racialisme » ou encore « indigénisme ».
Ces polémiques médiatisées sont même parvenues à s'emparer de la mobilisation mondiale de l'été 2020 contre les crimes racistes commis par la police et à s'enflammer autour d'un prétendu « racisme anti-blanc ». De même, on a vu un ancien joueur de foot, Lilian Thuram, être régulièrement accusé de « racisme anti-blanc » pour avoir pointé des formes de racisme profondément ancrées dans les sociétés européennes. Les associations et les mobilisations les plus incisives sont malmenées, tandis que les « débats vraiment faux » prolifèrent, sans impliquer ni atteindre les premiers concernés.
C'est pourtant à la médiatisation des « polémiques identitaires dans le débat public » que S. Beaud et G. Noiriel attribuent les revendications d'appartenance d'une partie des jeunes :
« Étant donné l'importance prise par les polémiques identitaires dans le débat public, il n'est pas surprenant qu'une partie de ces jeunes puissent exprimer leur rejet d'une société qui ne leur fait pas de place en privilégiant les éléments de leur identité personnelle que sont la religion, l'origine ou la race (définie par la couleur de peau). »
C'est là, à l'évidence, attribuer une importance disproportionnée au « débat public » dans la manière dont les individus se représentent le monde social. Sans doute les catégories produites et diffusées dans l'espace public par ses principaux tenanciers – les porte-voix journalistiques et politiques – n'ont-elles pas une influence négligeable. La référence aux catégories diffusées dans l'espace public est bien souvent négative et réactive : c'est généralement parce que les musulman·es sont pris·es à partie dans des médias de grande écoute qu'ils ou elles sont amené·es à se revendiquer comme tel·les. Mais surtout, on peut penser que c'est l'expérience directe des ségrégations ethno-raciales (dans les villes, à l'école ou au travail) par des groupes sociaux qui, généralement, n'ont pas accès aux médias qui est ici déterminante. Elle ne nourrit pas, ou pas seulement, des opinions mal fondées en attente de validation par des chercheurs forts d'une indépendance proclamée.
2. Cette « explication » par le rôle du débat public est confortée par une autre. S. Beaud et G. Noiriel connaissent fort bien – à la différence des indignés mobilisés par Marianne, Le Point et Valeurs actuelles – les discriminations subies par ces jeunes. Mais quand ils n'affirment pas qu'ils seraient d'autant plus émotifs qu'ils sont livrés à une médiatisation imaginaire, ils attribuent leurs revendications d'appartenance (dont ils présument parfois qu'elles seraient exclusives d'autres appartenances) à des déficits en capital économique et culturel :
« Malheureusement, les plus démunis d'entre eux sont privés, pour des raisons socio-économiques, des ressources qui leur permettraient de diversifier leurs appartenances et leurs affiliations. ».
Pourquoi ne pas dire plus clairement que ces « déficits » résultent des discriminations – où se mêlent une variété de facteurs et de mécanismes (de classe, de race, de territoires, de genre, etc.) – qu'ils subissent et qu'ils connaissent ?
Les risques d'isolement, voire d'enfermement, existent sans doute, mais ils résultent pour une part essentielle des discriminations elles-mêmes, si bien que lutter contre ces risques passe en premier lieu par une lutte pied à pied contre ces discriminations et contre l'ensemble des mécanismes d'infériorisation sociale subis par celles et ceux qui cumulent le fait d'être issu·es des classes populaires et de l'immigration postcoloniale. Or S. Beaud et G. Noiriel nous offrent, en guise d'analyse de ces risques, une longue citation de Michael Walzer sur des impasses rencontrées par le nationalisme noir des années 1960 aux États-Unis, qu'il étend (sans nuances) au mouvement « Black Lives Matters » pour déplorer l'incapacité à nouer des alliances avec d'autres minorités.
D'où il résulterait que les risques indéniables d'isolement sont attribués à la minorité concernée, alors cette longue citation n'évoque même pas l'implacable répression des mouvements noirs par le pouvoir politique états-unien (allant jusqu'au meurtre des principaux dirigeants de ces mouvements) mais aussi les politiques de cooptation des élites noires, notamment au sein du Parti Démocrate. En outre, il est pour le moins audacieux, notamment de la part de chercheurs qui prétendent s'élever au-dessus du sens commun et fonder leurs affirmations sur des enquêtes, de transposer sans examen (et sans enquête) l'explication de M. Walzer à la situation française ; d'autant plus que ce dernier ne saurait en aucun cas être considéré comme un spécialiste de ces questions...
Somme toute, S. Beaud et G. Noiriel inversent les rapports de causes à conséquences, comme si les « politiques identitaires », davantage postulées que constatées (en particulier dans le cas français), résultaient en premier lieu des limites des mobilisations antiracistes elles-mêmes, et non de l'incapacité ou du refus du mouvement syndical et des gauches politiques à s'emparer de revendications et d'aspirations légitimes [9]. Au détour d'une phrase, pourtant, on peut lire :
« En outre , ces générations sociales ont dû faire face politiquement à l'effondrement des espoirs collectifs portés au XXe siècle par le mouvement ouvrier et communiste. »
Quand le fondamental devient surplus…
Ce qui est décisif en effet, par-delà « l'effondrement des espoirs collectifs », c'est la capacité d'inscrire dans une perspective générale des combats qui menacent de rester morcelés sans que ce morcellement soit imputable aux prétendues « politiques identitaires » : un morcellement qui concerne en réalité toutes les luttes sociales, y compris celles portées par le mouvement ouvrier « traditionnel » et, notamment, par les syndicats. Les appartenances à des minorités opprimées qui se revendiquent et se mobilisent comme telles ne sont pas des substituts ou des dérivatifs par rapport à d'autres appartenances ou mobilisations qui seraient prioritaires. Ce sont les composantes – potentielles et réelles – d'un combat englobant ; mais il ne peut être englobant qu'à condition de les inclure à part entière dans une politique d'émancipation qui reste à inventer.
Henri Maler et Ugo Palheta
[1] Notamment sur l'histoire de l'immigration et de la xénophobie pour l'un, et sur les transformations de la classe ouvrière (avec M. Pialoux) ainsi que les trajectoires des jeunes issus des classes populaires pour l'autre. Voir notamment : G. Noiriel, Longwy, Immigrés et prolétaires (1880-1980), Paris, PUF, 1984 ; G. Noiriel, Le Creuset français, Paris, Seuil, 1988 ; G. Noiriel, Immigration, antisémitisme et racisme en France (XIXe-XXe siècle). Discours publics, humiliations privées, Paris, Fayard, 2007 ; S. Beaud et M. Pialoux, Retour sur la condition ouvrière, Paris, Fayard, 1999 ; S. Beaud, 80% au bac… et après ?, Paris, La Découverte, 2002 ; S. Beaud et M. Pialoux, Violences urbaines, violence sociale. Genèse des nouvelles classes dangereuses, Paris, Fayard, 2003.
[2] On notera à ce propos que, hormis Pascal Blanchard (mais qui n'est pas universitaire), le livre De la question sociale à la question raciale ? dirigé par Eric Fassin et Didier Fassin (mais qui date de 2006), Pap N'Diaye et Patrick Simon (mais dont les travaux ne sont pas discutés par S. Beaud et G. Noiriel), presque aucun travail empirique de chercheurs·ses en sciences sociales travaillant en France sur la question des inégalités et des ségrégations ethno-raciales n'est discuté ou même évoqué dans un livre pourtant intitulé Race et sciences sociales : pour ne prendre que quelques exemples ni Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed (sur la question de l'islamophobie notamment), ni Mirna Safi ou Edmond Préteceille (en particulier sur la question de la dimension ethno-raciale de la ségrégation urbaine), ni Georges Felouzis, Mathieu Ichou ou Yaël Brinbaum (sur la question des inégalités ethno-raciales à l'école), ni Romain Aeberhardt, Irène Fournier, Dominique Meurs, Ariane Pailhé, Roland Rathelot Roxane Silberman et Patrick Simon (sur la question des inégalités ethno-raciales dans l'accès à l'emploi), ni Nicolas Jounin ou Elisa Palomares (sur les assignations raciales au travail ou les résistances à ces assignations), ni Fabien Jobard et René Lévy (sur la question du profilage racial dans l'activité de la police), ni plus récemment Solène Brun (sur la question de la dimension ethno-raciale de la socialisation. Ces travaux menacent-ils l'autonomie du champ scientifique ? On peut en douter. Minorent-ils la dimension de classe des phénomènes sociaux ? Peut-être, mais il faudrait le démontrer et, pour cela, les discuter.
[3] La lecture du livre montre d'ailleurs que, à rebours de leur prétention à s'élever au-dessus du sens commun (et notamment du sens commun militant), les deux auteurs se contentent de reprendre sans examen (p. 172-173) une opposition binaire d'origine essentiellement militante entre des mouvements qui seraient centrés sur la question de la classe (le MIB par exemple, Mouvement de l'immigration et des banlieues) et d'autres qui seraient « identitaires » (le MIR devenu PIR, Parti des indigènes de la République). L'histoire des luttes de l'immigration et des mouvements antiracistes, des années 1970 à nos jours, montre que les choses sont certainement beaucoup plus complexes, le MIB par exemple reprenant à son compte la notion de « racisme institutionnel » dès la fin des années 1990, et le PIR de son côté n'ignorant pas la question de la classe. Par ailleurs, comment classer dans un tel schéma le Mouvement des Travailleurs Arabes (MTA) ou aujourd'hui le Front uni des immigrations et des quartiers populaires (FUIQP) : « classiste » ou « identitaire » ? Sur le MTA, voir : A. Hajjat, « L'expérience politique du Mouvement des travailleurs arabes », Contretemps, mai 2006, n°16.
[4] S. Beaud et G. Noiriel écrivent ainsi : « D'où la multiplication des actions spectaculaires, comme celles des militants qui interdisent des pièces de théâtre au nom du combat antiraciste. La complaisance des journalistes à l'égard de ce type d'action alimente des polémiques qui divisent constamment les forces progressistes. Alors que la liberté d'expression et l'antiracisme avaient toujours été associés jusqu'ici par la gauche, ces coups de force ultraminoritaires finissent par les opposer l'une à l'autre. Ce qui ouvre un véritable boulevard aux conservateurs ».
[5] Les deux auteurs affirment à de multiples reprises dans l'article et surtout dans leur ouvrage – mais sans jamais le démontrer ! – que nombre de chercheurs et mouvements succomberaient à un tropisme « identitaire » en se focalisant exclusivement sur la « race » ou la question raciale, au détriment de la classe (ou pour les mouvements en refusant des solidarités ou alliances de classe). Pour notre compte, nous ne connaissons pas de chercheurs·ses travaillant sur les inégalités ethno-raciales qui auraient affirmé que les propriétés ethno-raciales primeraient sur tout autre facteur, et notamment sur les propriétés de classe. En revanche S. Beaud et G. Noiriel ont affirmé à plusieurs reprises la primauté des propriétés de classe sur les propriétés ethno-raciales. Plutôt qu'une sorte de « match de variables », il s'agirait plutôt de se demander comment ces différentes propriétés agissent dans des contextes spécifiques, bien souvent de manière imbriquée d'ailleurs, aussi bien dans la formation des inégalités que des identités. On notera par ailleurs qu'il y a quelque chose d'étrange à refuser l'ingérence dans l'activité de recherche scientifique de considérations extérieures à la recherche et, dans le même temps, de refuser – comme ils le font dans le livre (p. 232-236) – les statistiques dites « ethniques », en fait des statistiques permettant de mesurer les inégalités ethno-raciales en prétendant que le fait de demander à des enquêté·es où sont né·es leurs parents ou grands-parents, ou encore comment ils ou elles se situent sur un plan ethno-racial, comporterait un risque d'assignation identitaire. Si l'on poussait jusqu'au bout un tel raisonnement, il faudrait sans doute aussi cesser de demander à des enquêté·es la profession ou le niveau de diplôme de leurs parents car on sait bien que ce type de question peut tout à fait aussi être vécue comme une forme d'assignation (de classe) et de violence symbolique..
[6] On pourra notamment lire la synthèse proposée par Mirna Safi : Les inégalités ethno-raciales, Paris, La Découverte, 2013. Ou encore le très riche ouvrage coordonné par des chercheurs·ses de l'INED : C. Beauchemin, C. Hamel et P. Simon, Trajectoires et origines : enquête sur la diversité des populations en France, Paris, INED Éditions, 2015.
[7] Il faut préciser que les « camps » qu'évoquent S. Beaud et G. Noiriel sont très largement construits médiatiquement (voir les sempiternels dossiers du Point, de l'Express, du Figaro ou de Valeurs actuelles sur les prétendus « réseaux indigénistes », ou encore les émissions de « débat » sur les chaînes d'information en continu) et politiquement (qu'on pense aux déclarations de Blanquer, Macron ou Darmanin rendant coupable la recherche scientifique d'une « racialisation »). Il faudrait en outre insister sur le fait que ces « camps » n'ont pas du tout les mêmes opportunités de se faire entendre dans les médias de grande écoute.
[8] Ce n'est d'ailleurs pas, semble-t-il, la position qu'avait adoptée le sociologue Pierre Bourdieu dont se réclament les deux auteurs, au moins à partir du mouvement de grève de l'hiver 1995, mais en réalité bien avant comme le montrent les textes choisis publiés par les éditions Agone en 2002 sous le titre Interventions,1961-2001. Science sociale et action politique. Qu'on lise également les deux volumes de Contre-feux, successivement publiés en 1998 et 2002, dans lesquels Bourdieu il n'aborde pas seulement, loin de là,, des questions qui entrent directement dans son champ de compétence scientifique.
[9] Il faudrait d'ailleurs aller plus loin et analyser le rôle qu'a joué la gauche française, au cours des années 1980-90, dans l'affadissement, la folklorisation et, finalement, l'affaiblissement des luttes antiracistes qui suivit la marche historique pour l'égalité et contre le racisme de 1983. Il est pour le moins contestable d'affirmer, comme le font S. Beaud et G. Noiriel après tant d'autres (important ici, à nouveau sans examen, un argument développé aux États-Unis, par Walter Ben Michaels ou encore Mark Lilla), que la gauche au pouvoir dans les années 1980 aurait substitué l'antiracisme à une politique de classe alors que les reculs du PS, sur la question des politiques économiques et sur les politiques d'immigration, sont quasi concomitants dans les années 1980 : c'est en fait presque au moment que le PS applique le « tournant de la rigueur » en matière économique et sociale, et une politique restrictive en matière d'immigration (la période 1981-1983, marquée par des régularisations massives, faisant figure de parenthèse).
26.12.2024 à 17:49
Pour Isaac Johsua
Henri Maler
« En souvenir d'une longue complicité »
- Des camaradesTexte intégral (1551 mots)
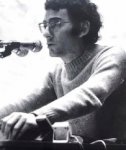
En 1988, vingt ans après notre première rencontre, Isaac Johsua m'envoyait son livre - La Face cachée du Moyen Age » [1] dédicacé ainsi : « En souvenir d'une longue complicité ». Une longue complicité que je veux sobrement évoquer.
Deux ans déjà. Né en 1939, Isaac Johsua (Isy) est décédé le 26 décembre 2022. Lors de la cérémonie organisée au Père-Lachaise, 9 janvier 2023, Florence, sa fille, a pris la parole pour prononcer un bel hommage dédié à la vie de son père : plus qu'un hommage, une déclaration d'amour [2]. Je n'avais alors, discrétion oblige, rien écrit pour dire mon émotion.
Isy fut pour moi, pour nombre d'entre nous, un camarade. Je sais : ce terme peut paraitre aujourd'hui désuet. Pourtant, il dit souvent une solidarité durable, plus profonde que bien des relations éphémères, surtout quand elle se traduit pas une complicité dont je souhaite déposer quelques souvenirs Quand je mentionne quelques repères politiques d'un combat commun, ce n'est pas pour en tirer le bilan. Un bilan ? Un jour peut-être. Mais pas ici.
Ma première rencontre avec Isy eut lieu en avril 1968 : une brève conversation suscitée par la parution d'un texte très critique sur la Révolution cubaine (son volontarisme économique, son involution autoritaire), publié au sein de la Jeunesse Communiste Révolutionnaire (JCR) à laquelle nous appartenions tous deux. Isy m'a alors fortement impressionné.
Puis, au cours du mouvement de mai (qui fut l'acte de naissance de ce que l'on nomme abusivement « la génération de mai 68 »), nous sommes cooptés tous deux au sein du Bureau national de la JCR : nouvelle rencontre, mais brève rencontre, une fois encore. En effet, le 12 juin 1968, un décret interdit les organisations d'extrême gauche, et Isy est arrêté dans une réunion avec d'autres camarades, pour reconstitution de Ligue dissoute. Présent lors de cette réunion, je suis épargné, tandis qu' Alain Krivine, Pierre Rousset, Issac Johsua et quelques autres sont embastillés à la prison de la santé. Les prisonniers sont bientôt libérés en septembre, Entretemps, la majorité du Bureau national de la JCR, maintenue malgré la dissolution, s'est engagée en faveur d'une adhésion à la Quatrième internationale. Lorsque je rencontre Isy en liberté, c'est pour sceller notre opposition à cette adhésion : ainsi naquit notre complicité.
À l'ouverture du débat préparatoire au Congrès qui devait fonder en 1969 la Ligue communiste révolutionnaire (LCR), nous impulsons une tendance. Les premières contributions sont signées « Rivière et Créach », du nom de nos pseudonymes respectifs : « Créach » pour Isy, « Rivière » pour moi. Je participe à leur élaboration, mais Isy en est le principal rédacteur. Dès avant le Congrès, mais surtout après, les divergences s'accumulent et font, plus ou moins, système. Au point que la scission de notre tendance avec la majorité constituée lors du Congrès devient inévitable. Et l'Organisation communiste Révolution (« Révolution ! » en abrégé, « Révo » par familiarité) est fondée en 1971.
Suivent alors, pour notre organisation (« l'orga » en abrégé, « un groupuscule », disait-on dans les gazettes), cinq années d'intense activité (d' »activisme », comme on dit). Notre tandem, constitué en 1968, est alors immergé dans le collectif. Bien sûr, Isy et moi, nous avons connu des dissensions : elles devaient être mineures, puisque elles ont quitté ma mémoire.
En 1976, Révolution ! fusionne avec l'Organisation communiste-Gauche ouvrière et paysanne (OC-GOP), et prend le nom d'Organisation communiste des travailleurs (OCT). Une crise interne s'ouvre au sein de l'organisation dès 1977. Deux tendances s'affrontent et deviennent rapidement inconciliables. La nôtre, à tort ou à raison, soutient que l'existence même de l'OCT est menacée. La virulence de la confrontation a laissé de profondes blessures parmi les protagonistes des deux courants en présence. Cible personnelle, particulièrement visée par cette virulence, j'ai pu compter sur le soutien d'Isy. Je ne l'ai pas oublié.
Cette crise se solde par une explosion de l'organisation et par un départ massif de militantes et de militants. L'OCT, très affaiblie, tente de survivre. Mais en juin 1978, épuisé par une guerre picrocholine (telle qu'elle m'apparait désormais), convaincu de l'absence de toute perspective, je quitte seul et brutalement l'OCT, sans recourir à une quelconque organisation partisane. Isy, lui, tente de sauver ce qui, pense-t-il alors, peut l'être encore, en impulsant une adhésion groupée à la Ligue communiste, avant de quitter celle-ci.
1968-1978 : dix ans de complicité. Peu importe, du moins ici, ce que fut l'histoire collective de Révolution puis de l'OCT. Tout n'est pas à jeter, loin de là, dans nos positions d'alors, mais nos aveuglements n'étaient pas exempts d'aberrations. Un bilan ? Un jour peut-être, ai-je déjà dit…
Dix ans. Notre engagement – comme celui de la plupart de nos camarades - absorbait largement nos existences. Celui d'Isy était total, exigeant, et chaleureux. Son exigence était tempérée par un solide sens de l'humour et par une certaine fantaisie
Isy vivait alors, me semble-t-il, une tension très vive entre le chercheur et le militant. Le militant contrariait le chercheur : la temporalité et le rythme du militantisme ne sont pas ceux de la recherche. Depuis, le chercheur a multiplié les travaux théoriques sans jamais neutraliser le militant.
Nous nous sommes longtemps perdus de vue. Dix ans ont passé après ma rupture avec l'OCT quand nous avons brièvement renoué en 1988 lors de la parution du livre qu'il m'a dédicacé (et dont j'ai rédigé un compte-rendu admiratif dans L'Autre journal, une revue fondée par Michel Butel). Depuis, nos rares rencontres dans un café proche de son logement parisien ont toujours été fraternelles : à mes yeux, nous avions tissé une fidélité élective.
Une dernière confrontation, par contributions interposées, mais restées sans traces, nous a opposé paisiblement – à chacun de juger si cela est important ou dérisoire – sur la conception marxienne du « dépérissement de l'État ». Nous l'avons tous deux abandonnée, mais sans en tirer les mêmes conséquences : Isy plaidait pour un abandon pur et simple, moi pour une profonde révision.
Au fil des ans, chacun à notre façon, nous avons revisité le communisme de Marx pour tenter de nous délivrer de quelques-unes de ses impasses.
En 2012, paraît le dernier ouvrage d'Isy : La révolution selon Karl Marx [3]. Je me prépare à le discuter avec lui. Avec lui… Discussion reportée pendant dix ans. Trop tard : Isy nous a quittés.
Je veux dire ici à Anne-Marie, son épouse, à Florence, sa fille, à Samy, son frère, et à tous ses proches, quelle chance ils ont eu de partager la vie d'Isaac Johsua. Et je veux dire aussi à tous nos anciens compagnons, parfois devenus des adversaires, quelle chance nous avons eu de partager ses combats. Quelle chance j'ai eue.
Henri Maler

[1] Isaac Johsua, La Face cachée du Moyen âge. Les premiers pas du capital, Éditions La Brèche 1988.
[2] Le texte de l'intervention de Florence a été publié sur le blog (hébergé chez Mediapart) de Samy, le frère d'Isy.
[3] Isaac Johsua, La révolution selon Karl Marx, éditions Page 2, novembre 2012.
22.11.2024 à 15:08
Petit lexique pour temps de grèves et de manifestations
Henri Maler, Yves Rebours
La langue automatique du journalisme officiel est une langue de bois officielle.
- Sur les médias / AcrimedTexte intégral (2146 mots)

Version initiale, publiée sur le site d'Acrimed, plusieurs fois enrichie et complétée [1]
La langue automatique du journalisme officiel est une langue de bois officielle.
« Réforme » : Quand une réforme proposée est imposée, cela s'appelle « LA réforme ». Et s'opposer à cette réforme devient : le « refus de la réforme ».
« Réformistes » : Désigne ou qualifie les personnes ou les syndicats qui soutiennent ouvertement les réformes gouvernementales ou se bornent à proposer de les aménager. Les partisans d'autres réformes constituent un « front du refus ».
« Modernisation » : Synonyme de « réforme » ou de l'effet attendu de « LA réforme ». La Modernisation est, par principe, aussi excellente que laréforme... puisque, comme l'avait fort bien compris, M. de La Palisse, fondateur du journalisme moderne, la modernisation permet d'être moderne. Et pour être moderne, il suffit de moderniser. Le modernisme s'oppose à l'archaïsme. Seuls des esprits archaïques peuvent s'opposer à la modernisation. Et seuls des esprits tout à la fois archaïques, réactionnaires et séditieux peuvent avoir l'audace et le mauvais goût de proposer de subordonner la modernisation au progrès social. D'ailleurs, la modernisation est indifférente à la justice sociale, que la modernité a remplacée par l'« équité ». Voir ce mot.
« Équité » : Désigne le souci (on parle de « souci d'équité »... qui permet de réduire des avantages (relatifs) de certains salariés au lieu de les faire partager à tous. Ce terme est sans emploi s'agissant des prétendues « élites », exemptées de quelque concession par leur naturel « souci d'équité ».
« Privilèges » : Désigne les avantages (relatifs) dont disposent certains salariés par comparaison à d'autres, mais non les avantages exorbitants dont disposent les tenanciers de tous les pouvoirs au détriment de ceux sur lesquels ces pouvoirs s'exercent. Les tenanciers des médias, par exemple, disposent de quelques avantages qu'ils doivent à leur seul mérite, tandis que les infirmières, les cheminots ou les enseignants, sont des privilégiés.
« Inégalités » : Ne désigne que les rapports entre les salariés du public et les salariés du privé. Tous les autres rapports sont « conformes à l'équité ».
« Concernés » : Se dit des secteurs ou des personnes qui sont immédiatement visés par « la réforme ». Sinon, dire : « les cheminots ne sont pas concernés par la réforme des retraites » ou « les enseignants ne sont pas concernés par la décentralisation ». Vous pouvez pousser le souci de la rigueur jusqu'à affirmer que « les cheminots ne sont pas directement concernés ». Dans les deux cas, vous pouvez même ajouter qu'ils « se sentent menacés ». D'où l'on peut déduire ceci : se sentir menacé, ce n'est pas être menacé, et, en tout cas, être ou se sentir menacé, ce n'est pas être concerné.
« Malaise » : Se dit du « trouble », plus ou moins profond, qui peut aller jusqu'au « mal-être », vécu ou ressenti par une profession. Au printemps 2003, le « malaise » affecte particulièrement les enseignants. Le « malaise » peut se traduire par des « revendications » qui sont alors que des « symptômes ». Le « malaise » et ses « symptômes », diagnostiqués par les éditorialistes et les experts, réclament un « traitement » approprié.
« Grogne » : Un des symptômes les plus graves du « malaise », un signe de l'animalité privée de mots des « grognons » [2]. Les grèves et les manifestations se traduisent par « un mouvement de grogne » (entendu sur LCI).
« Troupes » : Mode d'existence collective des grévistes et des manifestants, quand ils répondent (ou se dérobent) aux appels et aux consignes des syndicats. Parler de « troupes de manifestants », de « troupes syndicales », de syndicats qui mobilisent leurs « troupes » (ou qui « ne contrôlent pas leurs “ troupes” »).
« Troubles sociaux » : Se dit des effets de la mobilisation des « troupes ». Un journaliste rigoureux se garde généralement de les désigner comme des « soubresauts », ainsi que le fait au cours du journal télévisé de 20 h sur TF1 le mercredi 28 mai 2003, le bon M. Raffarin.
« Pagaille » : Se dit des encombrements un jour de grève des transports. Par opposition, sans doute, à l'harmonie qui règne en l'absence de grèves.
« Galère » : se disait (et peut se dire encore...) des conditions d'existence des salariés privés d'emploi et des jeunes privés d'avenir, vivotant avec des revenus misérables, de boulots précaires en stages de réinsertion, assignés à résidence dans des quartiers désertés par les services public, sans loisirs, et subissant des temps de transports en commun démesurés. Mais tout cela était (et restera sans doute...) invisible à la télévision et sans responsables facilement identifiables. En somme, tout ça ne constitue pas, pour les médias, une information bien "sexy". En revanche, « Galère » se dit désormais des difficultés de transports les jours de grève : on peut aisément les mettre en images (cf. les contre-plongées dans la gare de Lyon) et les imputer à un coupable désigné, le gréviste. C'est une information décisive, dont les télévisions ne se lassent pas.
« Noir » : Qualifie un mardi de grève. On parlera alors de « mardi noir ». Peut également se dire des autres jours de la semaine. « Rouge » est la couleur réservée aux embouteillages des week-end, des départs ou des retours de vacances.
« Surenchère » : Se dit, particulièrement au Figaro, de tout refus des mesures imposées par le gouvernement, dont l'attitude au contraire se caractérise par la « fermeté ».
« Durcissement » : Se dit de la résistance des grévistes et des manifestants quand elle répond à la « fermeté » du gouvernement, une « fermeté » qui n'est pas exempte, parfois d' « ouverture ».
« Ouverture » : Se dit des opérations de communication du gouvernement. L' « ouverture » se traduit par des « signes ». Les « signes d'ouverture » traduisent une « volonté d'apaisement ». Ne pas confondre avec cette autre ouverture : « l'ouverture de négociations », qui pourrait manifester un dommageable « recul ».
« Apaisement » : Se dit de la volonté que l'on prête au gouvernement. Par opposition au « durcissement » de la mobilisation. Voir « ouverture ».
« Concertation » : Se dit des réunions convoquées par un ministre pour exposer aux organisations syndicales ce qu'il va faire et pour écouter leurs doléances, de préférence sans en tenir aucun compte. Selon les besoins, la « concertation » sera présentée comme un équivalent de la « négociation » ou comme son substitut. Le gouvernement est toujours « ouvert » à la « concertation ». Voir « ouverture ».
« Négociations » : Selon les besoins, tantôt synonyme, tantôt antonyme de « concertation ». On est prié de ne pas indiquer que, à la différence de la « concertation », la « négociation » est généralement terminée avant d'avoir commencé. Inutile aussi de souligner ce miracle : au printemps 2003, dix heures de « négociation » ont suffi au gouvernement pour ne céder que sur les quelques points qu'il avait déjà prévu de concéder.
« Dialogue social » : Se dit des rencontres où un ministre parle aux syndicats, par opposition au « conflit social », comme si le « dialogue » n'était pas généralement de pure forme : destiné à dissimuler ou à désamorcer le « conflit ».
« Pédagogie » : Devoir qui, pour les journalistes communicants, s'impose au gouvernement (plus encore qu'aux enseignants...). Ainsi, le gouvernement fait preuve (ou doit faire preuve...) de « pédagogie ». Tant il est vrai qu'il s'adresse, comme nos grands éditorialistes, à un peuple d'enfants qu'il faut instruire patiemment.
« Essoufflement » : Se dit de la mobilisation quand on souhaite qu'elle ressemble à ce que l'on en dit.
« Ultras » : Désigne, notamment au Figaro, les grévistes et les manifestants qui ne se conforment pas au diagnostic d' « essoufflement ». Vaguement synonyme d' « extrême gauche », lui-même synonyme de... au choix ! Autre synonyme : « Jusqu'au-boutistes ».
« Usagers » : Se dit de l'adversaire potentiel des grévistes. Peut également se nommer « élèves qui préparent le bac » et « parents d'élèves inquiets ».
« Otages » : Synonyme d' « usagers ». Terme particulièrement approprié pour attribuer les désagréments qu'ils subissent non à l'intransigeance du gouvernement, mais à l'obstination des grévistes. « Victimes » des grèves, les « otages » sont d'excellents « clients » pour les micros-trottoirs : tout reportage doit les présenter comme excédés ou résignés et, occasionnellement, solidaires.
« Opinion publique » : S'exprime dans les sondages et/ou par l'intermédiaire des « grands journalistes » qui lui donnent la parole en parlant à sa place. Quelques exemplaires de l'opinion publique sont appelés à « témoigner » dans les journaux télévisés. Les grévistes et les manifestants ne font pas partie de « l'opinion publique », qui risque de (ou devrait...) se retourner contre eux.
« Témoins » : Exemplaires de la foule des grévistes et manifestants, interrogés en quelques secondes à la télé ou en quelques lignes dans les journaux. Le « témoin » témoigne de ses affects, jamais de ses motifs ou du sens de son action. Seuls les gouvernants, les « experts » et l'élite du journalisme argumentent, connaissent les motifs, et maîtrisent le sens. L'élite pense, le témoin « grogne ». Voir ce mot.
« Expert » : Invité par les médias pour expliquer aux grévistes et manifestants que le gouvernement a pris les seules mesures possibles, dans l'intérêt général. Déplore que les « grognements » des « jusqu'auboutistes » (voire des « ultras « ), ces privilégiés égoïstes et irresponsables (voir « corporatisme « ), empêchent d'entendre le « discours de raison » des artisans du « dialogue social »)
« Contribuables » : Nom que porte l'opinion publique quand elle paie des impôts qui servent au service public. Quand l'argent public est dépensé pour consentir des avantages fiscaux aux entreprises, cet argent n'a plus d'origine identifiée. On dira : « les régimes de retraites du secteur public sont payées par les contribuables ». On ne dira pas : « les exonérations de charges consenties aux entreprises sont payées par les contribuables ».
« Corporatisme » : Mal qui menace n'importe quelle catégorie de salariés qui défend ses droits, à l'exclusion de tenanciers des médias.
Henri Maler et Yves Rebours
[1] Ce lexique, publié en 2003 sur le site d'Acrimed a connu plusieurs actualisations avec ma participation, disponibles sur ce site : version enrichie en 2010 (version republiée en 2018, puis à nouveau complétée en 2020, et à nouveau en 2023.
La version initiale a été également publiée en octobre 2010 sur le site « Les mots sont importants » (LMSI), sous le titre « Bréviaire de la haine (anti-gréviste) ».

[2] . Lire sur le site d'Acrimed :« La grogne » : manifestants et grévistes sont-ils des animaux ? ».
19.11.2024 à 15:00
À propos de la légende de l'indépendance des journalistes
Henri Maler
À l'occasion de la prise de contrôle d'Europe 1 par Bolloré. Entretien
- Sur les médias / Pluralisme, Critiquer les médiasTexte intégral (2876 mots)

À l'occasion de la prise de contrôle d'Europe 1 par Bolloré. Entretien publié par QG Quartier général sous le titre « La situation actuelle porte un rude coup à la légende de l'indépendance des journalistes ».
Présentation de l'entretien par QG : « La sphère des médias se concentre toujours plus entre les mains de milliardaires. Dernier exemple en date : la radio Europe 1, passée sous le contrôle de Vincent Bolloré, désireux de peser sur la présidentielle, après avoir été longtemps sous celui du groupe Lagardère. Une prise de contrôle ayant suscité plusieurs jours de grève de la part des salariés de la station. […] »
QG : Qu'est-ce que vous inspire la situation de la radio Europe 1, où une grève de cinq jours a été organisée par la société des rédacteurs et l'intersyndicale, face à l'emprise de Vincent Bolloré et la crainte d'une transformation en « radio d'opinion » ?
Henri Maler : Quand des journalistes défendent leur dignité, il n'y a aucune raison de bouder leur mobilisation, même si on peut émettre de nombreuses réserves sur la « radio d'opinion » qu'a toujours été Europe 1. C'est une affaire de dignité élémentaire pour les journalistes, et les salariés de la station. Cela met à jour un certain nombre de questions qui sont souvent passées sous silence.
Ce que démontrent la brutalité et la violence de Vincent Bolloré, c'est d'abord que les entreprises médiatiques sont des entreprises comme les autres, parfois pires que bien d'autres quand il s'agit des salariés des médias en général.
La deuxième leçon : la situation actuelle porte un rude coup à la légende de l'indépendance des journalistes. Comment cette légende s'est-elle bâtie ? C'est très simple. Comme chaque journaliste, pris individuellement, n'est pas placé sous le contrôle tatillon du propriétaire et que les milliardaires interviennent rarement directement (ils le font et dans le cas de Bolloré c'est systématique), ils s'imaginent que cela suffit à leur indépendance. En réalité, les journalistes ne vivent pas en état d'apesanteur sociale. Ils dépendent plus ou moins de leurs origines, de leur formation, de leurs conditions de travail. Mais surtout, ils sont dans une situation de dépendance collective. C'est-à-dire, à la merci des tycoons qui font ce qu'ils veulent dans les entreprises qu'ils contrôlent en nommant aux postes-clés pour diriger des rédactions des gens qui ne sont pas toujours des journalistes, mais avant tout des managers. Il faudrait, une fois pour toutes, arrêter de nous seriner en permanence que les journalistes sont indépendants tant que leur clavier électronique ou leur micro n'est pas placé sous le contrôle direct du milliardaire qui possède leur média.
Troisième leçon, à mon avis : dans la plupart des grands médias, même si pas tous, la quasi-absence de pouvoir des journalistes non seulement sur le financement de leur entreprise, mais même sur l'orientation éditoriale. Le seul pouvoir dont ils disposent, en dernière analyse, c'est la « clause de conscience ». La revendication des syndicats de journalistes, depuis des années, d'un statut juridique des rédactions pour qu'elles disposent d'un pouvoir collectif sur l'orientation du média, est encore une fois à l'ordre du jour.
La situation d'Europe 1 montre, une fois de plus, que le CSA est un organisme fantoche et impuissant, parce qu'il est nommé quasiment directement par le pouvoir politique et qu'il intervient dans un cadre législatif qui limite considérablement ses pouvoirs d'intervention car ses pouvoirs d'intervention sur la propriété des médias remontent à une loi qui date de 1986, c'est à dire d'avant la montée en puissance d'Internet, des chaînes en continu, etc. Depuis, du côté des forces politiques, c'est « silence radio », si j'ose dire !
J'aimerais ajouter plusieurs choses sur cette affaire. La quasi-fusion entre CNews et Europe 1 n'est pas finie ! Et il y a déjà d'autres proies dans le groupe Lagardère. Je ne garantis pas qu'elles finiront entre les mains de Bolloré, mais il y a aussi Paris Match et Le Journal du Dimanche.
Quand les journalistes se mobilisent contre les actions destructrices de Bolloré, on trouve parmi eux de sacrés personnages. Pascal Praud par exemple, qui déclare : « Quand vous êtes dans une entreprise, vous devez une fidélité sans faille à la direction. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Si vous n'êtes pas content, vous partez. » Pas mal non, comme éloge de la servilité ? Ce qui va de pair avec le cynisme et le carriérisme d'une Laurence Ferrari. Je rappelle qu'elle fut une des non-grévistes lors de la longue grève d'I-Télé en 2016. Et quand Adrien Quatennens lui dit que CNews est une chaîne qui promeut l'extrême-droite, elle lui répond : « Je ne vous laisserai pas dire ça. C'est entièrement faux ! C'est insulter tout le travail d'une rédaction, avec des choix équilibrés politiquement, qui travaille 24h sur 24, 7 jours sur 7. Je suis fière de travailler ainsi [1]. » En clair, pour se défausser, elle se déclare solidaire des gens qui se soumettent aux diktats de Bolloré ou de la direction (soit parce qu'ils intériorisent les prétendues valeurs de l'entreprise, soit parce qu'il faut bien qu'ils gagnent leur vie).
QG : En moins de deux ans on a vu la chaîne CNews changer entièrement de positionnement, et se radicaliser politiquement jusqu'à devenir un des principaux canaux de l'extrême-droite. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Avez-vous souvenir d'une pareille situation par le passé ?
Non. C'est la première fois que je vois une chaîne de télévision et une radio passer complètement sous la coupe de chefferies d'extrême-droite. Mais il faut comprendre pourquoi ça se passe ainsi. Ces chaînes vivent de leur audience. Par conséquent, s'il y a une audience qu'ils peuvent, à la fois, entretenir et créer pour des idées d'extrême-droite ; il y a un créneau à occuper et CNews l'occupe. On connaissait d'énormes inféodations de médias à des orientations politiques, « en toute indépendance », mais à ce point, dans l'audiovisuel, non. C'est assez original !
QG : À l'approche de la présidentielle de 2022 la situation dans l'actionnariat des médias est encore plus concentrée qu'en 2017. De quelle façon cela va peser une fois de plus sur la sincérité du scrutin ?
Il faut être nuancé. Est-ce que ça va peser sur la sincérité de la campagne électorale ? Ça ne fait aucun doute. Il y a eu des précédents et il y aura des suites. Est-ce que ça aura un impact sur les électeurs ? C'est une autre affaire. Les médias ne sont pas tout-puissants ! Ils sont parfois trop puissants mais les publics ne sont pas des éponges. Les médias usent et abusent de leur pouvoir mais leur pouvoir n'est pas absolu, comme le montre quelques épisodes particulièrement glorieux : par exemple, la quasi-totalité des médias avait fait campagne pour le « oui » lors du référendum constitutionnel de 2005 et les publics n'ont pas suivi, le « non » a été largement majoritaire.
Mais les médias ont un pouvoir redoutable, qui s'est vérifié récemment, qui est un pouvoir de cadrage des campagnes électorales. Les médias peuvent essayer de dire ce qu'il faut penser. Ce n'est pas sûr qu'ils aient le pouvoir de le prescrire autant qu'ils le souhaiteraient. En revanche, ils ont le pouvoir de prescrire ce à quoi il faut penser. Quand ils mènent campagne en expliquant, par exemple, que la sécurité et l'immigration sont les sujets majeurs, quasi uniques dans notre pays, ils créent une atmosphère qui est propice au développement des idées de droite et d'extrême-droite.
QG : Que pensez-vous des propos du journaliste de France 2 Laurent Delahousse au moment des résultats du premier tour des élections régionales et départementales, critiquant la recherche consumériste de l'audimat de la part des chaînes d'info en continu qui ne font plus, en réalité, de l'information ?
D'abord, c'est amusant venant de Laurent Delahousse, qui s'est plusieurs fois signalé par sa complaisance et son rôle de brosse à reluire quand il interroge des responsables politiques. Mais par contre, ça souligne à quel point, dans le bilan des élections régionales, les médias sont restés absolument silencieux sur leur propre rôle. C'est absolument fascinant. Les raisons de l'abstention sont multi-causales. On a tout invoqué. La météo ensoleillée, ; le divertissement consécutif à la fin du confinement ; l'opacité du rôle des départements et des régions ; la faiblesse des responsables politiques. Mais pour mettre en question le rôle qu'ont joué les médias, dont je redis qu'on ne sait pas à quel point il a été déterminant, silence ! Je n'ai repéré que trois occurrences : les déclarations de Laurent Delahousse, ce qui est en matière de critique des médias, je le rappelais à l'instant, une éminence bien connue ; un entretien, plus intéressant je l'avoue, avec Thomas Sotto, cet autre guerrier de l'audiovisuel, et un article de France info interrogeant des sociologues sur le rôle joué par les médias [2].
Or, ce n'est pas la première fois, ni la dernière, je le crains : la mise en scène de ces élections a eu pour particularité d'être politicienne, tacticienne et sondagière. De quoi a-t-on parlé ? En réalité, les yeux étaient fixés sur l'élection présidentielle de 2022, les probabilités de voir des forces politiques se positionner de façon intéressante pour le second tour de l'élection ; on a parlé du jeu des alliances dans la présentation des candidatures ; et commenté à n'en plus finir des sondages. Est-ce qu'on a parlé des projets en présence, des programmes, des propositions, etc. ? Pratiquement pas. Or, un journalisme un peu indépendant serait capable de laisser une place à la polyphonie des arguments. Cela ne devrait pas difficile, puisque les journalistes prétendent être pédagogues, de dire quels sont les projets en présence, d'expliquer ce qu'ils proposent dans les domaines qui relèvent des compétences des régions ou des départements. De l'exposer, sinon avec objectivité, du moins avec un minimum d'équilibre. Cela n'a pas été du tout fait. On a eu droit à quelques débats sur des chaînes de télévision, sur BFM et surtout sur LCI. Plus quelques débats sur des régionales de France 3. Mais ce sont des débats dans des formats où il est absolument impossible d'exposer clairement les propositions en présence.
On a eu, en guise de « décryptage » – c'est le mot à la mode -, le « décryptage » des sondages. Et là, on a atteint des sommets ! Énième fiasco des sondages. Réponse des sondeurs (je simplifie à peine) : « Si les sondages se sont trompés, c'est la faute des sondés. Ils ont menti, ils ont triché. ». Et si ce n'est pas la faute des sondés, « c'est de la faute des électeurs ». Mais il y a plus drôle et plus scandaleux encore. Les journalistes qui « décryptent » se sont intéressés à l'échec des sondages. Ils ont demandé aux sondeurs de donner des explications. Mais en omettant ce petit détail : c'est que les sondages sont commandés par les médias ! Autrement dit, ils ont interrogé les sondeurs sur les erreurs qu'ils ont commises, alors que ce sont les médias eux-mêmes qui commandent les sondages. Dans le genre grotesque, mais significatif, on peut difficilement faire mieux. Mais encore plus beau : c'est qu'une fois passées les élections, on recommence, avec toutes les hypothèses pour la présidentielle. Aucune leçon n'a été tirée de ce journalisme hippique, qui conçoit les échéances électorales comme des courses de petits chevaux.
Juin 2021 : CNews est mis en demeure par le CSA pour non-respect du pluralisme de prise de parole, 36% des intervenants politiques en plateau étant d'extrême-droite (Source : CSA)
QG : Dans les journaux Le Monde et Libération, les actionnaires ont annoncé la création de « fondations », dans le but de sanctuariser l'indépendance des rédactions. Est-ce une mesure efficace ou de la poudre aux yeux ?
Je pense que ça ressemble beaucoup à de la poudre de perlimpinpin si on ne donne pas un statut juridique aux rédactions, en les dotant d'un pouvoir qui soit un pouvoir sur l'orientation éditoriale, et des pouvoirs sur la nomination des actionnaires et des responsables de rédaction. Il y a des médias qui sont allés en ce sens, mais que peut faire une rédaction quand on lui met le couteau sous la gorge et qu'on lui dit : « Ou bien tu acceptes tel actionnaire, ou bien on va être obligé de mettre la clé sous la porte » ? Elle peut faire grève pendant un certain temps, mais d'une manière ou d'une autre, elle sera amenée à céder. Sans un pouvoir effectif, que ce soit « par le haut » avec une modification radicale de la législation encadrant la propriété des médias ; et « par le bas » avec un pouvoir conféré aux rédactions et aux salariés des médias (car dans un média, il n'y a pas que des journalistes). Sinon, la situation est sans issue. De toute façon, une indépendance totale est un rêve absolu. Ça n'existe pas. Cependant, il peut exister une indépendance relative, qui permet collectivement aux rédactions de ne pas être à la merci des conditions de financement de leur activité.
QG : Quelles pourraient être les trois premières mesures à instaurer pour garantir un paysage médiatique sain ?
Je vais répondre dans l'ordre où ça me vient à l'esprit. Premièrement, transformer radicalement le CSA en Conseil national des médias, de tous les médias ; et de le constitutionnaliser. Une telle institution serait composée, non pas par le pouvoir exécutif, mais par élection à la proportionnelle de journalistes et de salariés des médias, et d'autre part de représentants politiques. Elle serait dotée non pas d'un pouvoir croupion, mais d'un pouvoir étendu de contrôle à l'ensemble de l'univers médiatique. On ne peut pas faire comme si Internet n'existait pas.
Deuxièmement, la constitution d'un service public de l'information et de la culture ayant une absolue priorité en ce qui concerne son financement. Financer Valeurs poubelles, ce n'est pas ça qui garantit la démocratie dans le monde des médias. Troisièmement, limiter les concentrations dans les médias et ne pas attribuer de média à des propriétaires qui dépendent de marchés publics.
Et enfin, j'en ai déjà parlé, accorder un statut juridique aux rédactions et à tous salariés des médias.
Propos recueillis par Jonathan Baudoin
Sources : Pascal Praud, dans Le Parisien du 27 juin à propos du licenciement Sébastien Thoen pour une parodie de… Pascal Praud. Laurence Ferrari, lors de la « matinale » de CNews du 17 juin.
[1] . Sources : Pascal Praud, dans Le Parisien du 27 juin à propos du licenciement Sébastien Thoen pour une parodie de… Pascal Praud. Laurence Ferrari, lors de la « matinale » de CNews du 17 juin.
[2] . Sources : Laurent Delahousse, lors de la soirée électorale sur France 2. Entretien avec Thomas Sotto publié par Le Point le 1er juillet 2021. Sur France info « Abstention aux élections régionales : quelle est la responsabilité des médias ? », article publié le 28 juin 2021.
- Persos A à L
- Carmine
- Mona CHOLLET
- Anna COLIN-LEBEDEV
- Julien DEVAUREIX
- Cory DOCTOROW
- Lionel DRICOT (PLOUM)
- EDUC.POP.FR
- Marc ENDEWELD
- Michel GOYA
- Hubert GUILLAUD
- Gérard FILOCHE
- Alain GRANDJEAN
- Hacking-Social
- Samuel HAYAT
- Dana HILLIOT
- François HOUSTE
- Tagrawla INEQQIQI
- Infiltrés (les)
- Clément JEANNEAU
- Paul JORION
- Michel LEPESANT
- Persos M à Z
- Henri MALER
- Christophe MASUTTI
- Jean-Luc MÉLENCHON
- MONDE DIPLO (Blogs persos)
- Richard MONVOISIN
- Corinne MOREL-DARLEUX
- Timothée PARRIQUE
- Thomas PIKETTY
- VisionsCarto
- Yannis YOULOUNTAS
- Michaël ZEMMOUR
- LePartisan.info
- Numérique
- Blog Binaire
- Christophe DESCHAMPS
- Louis DERRAC
- Olivier ERTZSCHEID
- Olivier EZRATY
- Framablog
- Romain LECLAIRE
- Tristan NITOT
- Francis PISANI
- Irénée RÉGNAULD
- Nicolas VIVANT
- Collectifs
- Arguments
- Bondy Blog
- Dérivation
- Économistes Atterrés
- Dissidences
- Mr Mondialisation
- Palim Psao
- Paris-Luttes.info
- ROJAVA Info
- Créatifs / Art / Fiction
- Nicole ESTEROLLE
- Julien HERVIEUX
- Alessandro PIGNOCCHI
- Laura VAZQUEZ
- XKCD