30.06.2015 à 02:00
Partie carrée avec Pandoc, Markdown, HTML et LaTeX
Pour ceux qui en douteraient encore, les blagues graveleuses à propos de LaTeX n’ont pas cours ici. Il s’agit dans ce billet de proposer une mini chaîne éditoriale qui vous permettra de composer rapidement des documents en plusieurs formats tout en les écrivant avec le minimum de contraintes. Qu’il s’agisse de n’importe quel logiciel de traitement de texte ou d’un simple éditeur dans lequel on formate directement le document source, on passe bien trop de temps à cliquer ou entrer des commandes, toujours au détriment du contenu. Avoir une solution automatisée ne résoudra jamais toutes les situations, mais notre objectif est de tâcher de séparer le plus possible l’entrée de contenu et la mise en page. Pour cela nous allons utiliser deux outils, à savoir le formatage Markdown et le logiciel de conversion Pandoc.
Prérequis
Pour accomplir toutes les opérations mentionnées ci-dessous, quelques conditions doivent être réunies :
- Pour la plus grande partie de ce billet, il faut avoir compris (juste « compris ») ce qu’est un langage de balisage comme le HTML ou le LaTeX, et savoir se servir d’un terminal (entrer des lignes de commandes, au demeurant fort simples à comprendre) ;
- Avoir Pandoc installé sur sa machine ;
- Avoir un bon éditeur de texte, si possible capable d’afficher une coloration syntaxique propre au Markdown (voir capture d’écran) ;
- Pour obtenir un document LaTeX et produire un PDF, il faut avoir une distribution LaTeX installée, comme TeXlive.

Objectifs
À quel genre de situation sommes-nous censés faire face ?
Vous souhaitez rédiger rapidement un document, cependant, avec votre logiciel de traitement de texte, vous supportez de moins en moins d’avoir à cliquer sans cesse pour formater des styles de titres et de paragraphes et vous aimeriez pouvoir rédiger avec une interface d’éditeur de texte la moins chargée possible.
Il vous est peut-être arrivé de rédiger un document en LaTeX et, malgré les filtres disponibles, avoir toutes les peines du monde à le transformer en HTML parce qu’en fin de compte vous souhaitiez l’afficher en tant que page web ou réaliser un e-pub.
Vous avez essayé plusieurs systèmes de conversion automatisés, mais jamais vous n’avez fini par obtenir de document proprement formaté.
D’autres situations ont pu se produire et vous allez certainement trouver des failles à la méthode proposée ici. En revanche, en plus de la méthode, je propose un principe auquel on pense pas toujours : si vous voulez transformer un document, rédigez-le d’abord au format le plus simple. C’est depuis cette source qu’il faut tenter les conversions et éviter de le faire depuis un format complexe. Quoi que vous fassiez, pour être parfait, votre document final devra sans doute faire l’objet de retouches, mais elles seront un moindre mal car la majeure partie du document sera alors traitée proprement.
Qu’est-ce que j’entends par « proprement » ? C’est vraiment un conseil d’hygiène : certaines solutions de formatage ou de conversion utilisent des solutions plus ou moins adaptées à la complexité du code de départ. Cela se traduit souvent par l’adjonction de styles prédéfinis par le logiciel de conversion. Ainsi, si vous transformez un document LaTeX en HTML, la malléabilité du document final laissera toujours à désirer, en particulier si vous voulez adapter votre propre feuille de style, à moins de la définir auparavant ce qui nécessite en retour beaucoup d’efforts. Faire les choses simplement dès le départ vous permettra de complexifier par la suite à votre propre initiative, mais en aucun cas vous ne serez contraints d’adapter votre projet au format : c’est l’inverse qui doit se produire.
Les objectifs seront successivement :
- de produire un document au format Markdown adapté à Pandoc,
- le transformer en utilisant Pandoc, de manière à produire un document au format .odt (ou .docx), un document au format HTML,
- et un document .pdf (re)formaté LaTeX et compilé avec pdfTeX ou Xe(La)TeX.
Créer un document au format Markdown
Le format Markdown est tellement simple qu’il n’y a pas besoin de créer des macros pour pouvoir l’utiliser. En d’autres termes, tout ce dont vous avez besoin pour écrire dans ce format est d’un éditeur de texte et d’un peu de mémoire. Si, en plus, vous utilisez votre éditeur en plein écran, sans autre affichage que votre curseur pour entrer des caractères, vous pourrez vous concentrer pleinement sur votre contenu et écrire sans vous soucier d’autre chose.
L’entrée des éléments de formatage en Markdown s’effectue au long de la frappe. Ainsi, pour un titre de niveau 1, vous n’avez qu’à entrer un croisillon (# Titre 1) en début de ligne ; pour un titre de niveau 2, deux croisillons feront l’affaire (## Titre 2) ; pour mettre en valeur une partie de votre texte, par exemple en italique, il suffit d’entrer le caractère tiret bas (_italique_) ou une astérisque (*italique*) au début et à la fin de la partie ; etc.
Pour reconnaître votre document en markdown, vous pouvez lui ajouter l’extension .markdown, ou .md, par exemple.
Par ailleurs, il existe certains éditeurs de texte qui vous proposent d’afficher directement le rendu HTML de votre document. Ils utilisent parfois une double fenêtre. Voici trois éditeurs sympathiques : Ghostwriter, ReText, StackEdit (fonctionne dans votre navigateur). Ces éditeurs proposent aussi des filtres d’export vers odt, HTML et PDF.
La liste des commandes de formatage Markdown est très courte. Vous trouverez sur le site de son créateur, John Gruber, les éléments de syntaxe utilisables dans ce format. En revanche, comme nous allons le voir, Pandoc propose quelques fonctionnalités spécifiques, aussi il sera préférable de se référer à cette partie du manuel de Pandoc. En réalité, il suffit de quelques minutes de pratique pour en maîtriser l’essentiel. La seule difficulté du Markdown, c’est qu’il n’est pas (encore) standardisé, si bien que tout le monde s’accorde à reconnaître l’essentiel mais de petites variations peuvent apparaître ici et là.
Dans notre cas, il y a une manière d’utiliser le Markdown à la sauce Pandoc. En voici quelques exemples :
Les notes de bas de page
Le Markdown est si simple que des éléments pourtant essentiels à la rédaction en sont absents. C’est le cas de la gestion des notes de bas de page. Pandoc permet de gérer cela de manière très simple : il suffit d’entrer le numéro de la note à l’endroit de l’appel de note, puis, en fin de texte, rédiger la note en y faisant référence.
Ceci est un appel de note[^1]. (en fin de texte) [^1]: Ceci est le contenu de la note de bas de page.
La question des notes de bas de page est loin d’être triviale. Si vous devez convertir votre document à la fois en HTML et en LaTeX vous constaterez bien vite que les méthodes dont ces deux langages balisés gèrent les notes de bas de page n’ont quasiment rien à voir entre elles, si bien que convertir de l’un à l’autre un document contenant des notes de bas de page est souvent un vrai casse-tête, tout particulièrement si vous avez beaucoup de notes.
Les métadonnées
Les informations du document comme le titre, la date et l’auteur, pourront être entrées en début de document en les introduisant simplement avec le signe %.
% Titre % Auteur % Date
Là encore, c’est une fonctionnalité qui est proposée : vous verrez que, lorsque nous utiliseront un modèle de conversion, nous pourrons utiliser ces données rendues exploitables par Pandoc.
La table des matières
Pour créer une table des matières… hé bien, non, il n’y a rien à faire ! Il suffira, lors de la conversion, de demander gentiment à Pandoc de se charger de créer une table des matières selon le format de sortie désiré.
Autres aspects du Pandoc’s Markdown
Vous trouverez dans le manuel toutes les possibilités d’interprétation du Markdown par Pandoc, par exemple pour faire des tableaux, insérer des mathématiques, faire des listes spéciales, etc. Sachez toutefois que si vous voulez que votre document reste interprétable par d’autres convertisseurs que Pandoc, il faudra aussi faire un effort de simplification. L’autre solution est que, quoiqu’il arrive, selon le format de conversion visé, vous pouvez insérer directement des éléments de code dans votre document Markdown. Ainsi, si vous voulez transformer vers LaTeX, vous pouvez insérer directement du code LaTeX qui sera interprété tout à fait normalement. Idem pour le HTML. Et même mieux : vous pouvez insérer du code HTML dans du Markdown et interpréter le tout vers LaTeX !
À propos de Pandoc
Dans la suite de ce billet, je vais vous montrer comment utiliser certaines commandes de Pandoc. Mais les possibilités de ce dernier sont très vastes. Il est possible, par exemple, de lui faire traiter de la bibliographie en travaillant avec LaTeX et BibLaTeX, ou encore rédiger un script qui permettra d’automatiser certaines tâches avec Pandoc. Faisons simple pour commencer : Pandoc propose des options, utilisons-les.
Par ailleurs, Pandoc permet de transformer de multiples formats. Nous nous focaliserons ici sur le Markdown, mais sachez que les applications de Pandoc excèdent largement ce cadre.
Comment utiliser Pandoc ?
Pandoc s’utilise en ligne de commande. Non, attendez ! ne partez pas tout de suite. D’accord, il s’agit d’ouvrir un terminal mais il ne s’agit pas non plus d’incanter des formules réservées à un caste de moines guerriers initiés. Il faut passer outre vos appréhensions et vous allez voir, c’est vraiment simple.
Première chose à faire : ouvrir un terminal et vous rendre dans le dossier où vous avez stocké votre document en Markdown. Dans les commandes que je citerai plus bas, tout se passera dans ce dossier : la production de sortie sera enregistré à cet emplacement (mais vous pouvez toujours en choisir un autre, il suffit pour cela de spécifier à chaque fois le chemin).
Les commandes se rédigent toujours de manière logique. On « dit à la machine », quelque chose comme « Tu vas utiliser Pandoc sur ce document au format Bidule pour produire ce nouveau document au format Machin, en utilisant telle et telle option ». Les options sont toujours introduites avec un double tiret (--) ou leur diminutif par un tiret simple (-).
Voici un exemple simple que je commente :
pandoc mondocument.md -o masortie.html
Pandoc est lancé, il traitera un document au format markdown pour produire (-o, ou bien -output) un autre document au format HTML. À chaque fois j’aurais pu préciser un chemin différent pour chaque document, ainsi pour traiter un document d’un dossier à l’autre, on peut écrire :
pandoc chemin/redaction/mondocument.md -o chemin/production/masortie.html
Cerise sur le gâteau, si vous avez plusieurs document markdown que vous désirez convertir pour produire un document unique dans un autre format, il suffit de les entrer dans l’ordre :
pandoc doc1.md doc2.md doc3.md -o docfinal.odt
Ceci est d’autant plus pratique si vous rédigez un livre, par exemple, avec un fichier par chapitre.
Passons à la pratique
Vous avez donc rédigé un document au format Markdown. Qu’allez-vous en faire ?
Tel quel
Vous pouvez tout simplement utiliser votre document tel quel. Le markdown, c’est d’abord du texte. Par ailleurs, ce format a été conçu spécifiquement au départ pour envoyer des courriels en mode texte sans avoir à perdre du temps dans une mise en page dont le résultat est différent selon le paramétrage du client de courriel du destinataire.
De plus, vos documents en Markdown seront lisibles par tout éditeur de texte dans l’avenir. Vous pouvez être certain de leur pérennité. Si vous ouvrez vos documents Markdown avec un éditeur permettant le rendu HTML, vous avez en plus de cela une mise en page toute prête si l’aspect « texte » ne vous convient pas.
Vers un logiciel de traitement de texte
Si vous avez besoin d’éditer votre document avec un logiciel de traitement de texte comme LibreOffice Writer ou MSWord, en particulier si vous avez des modèles de mise en page à y appliquer, la syntaxe de la transformation est la plus simple :
pandoc source.md -o produitfinal.odt
ou bien
pandoc source.md -o produitfinal.doc
Le document produit sera mis en page avec les styles par défaut de votre logiciel de traitement de texte, il suffit ensuite d’y appliquer vos propres styles si besoin.
Vers le HTML
S’agissant d’un langage balisé, la conversion vers le HTML permet d’intégrer des exigences de mise en page directement au moment de le traiter avec Pandoc. Ainsi, vous pouvez préparer une feuille de style .css en vue de l’intégrer (ou pas) directement dans le document de sortie, ce dernier pouvant de même obéir à un modèle (template) préparé à l’avance.
pandoc -s -S --toc --template=modele.html -H monstyle.css --number-section source.md -o produitfinal.html
Cette ligne de commande permet de faire ces opérations (vous pouvez ôter celles qui nous intéressent pas) :
- Produire un document « standalone » (
-sou--standalone), c’est-à-dire qu’il intégrera toutes les informations pour qu’il s’affiche dans le navigateur sans faire appel à d’autres fichiers. - Le document aura une typographie acceptable, grâce à l’option
-S(ou--smart). Pandoc convertira par exemple les doubles tirets (--) par des demi-cadratins ou les triples tirets (---) par des cadratins - Il intégrera une table des matières au début, grâce à l’option
--toc(ou--table-of-contents), notez que la profondeur de la TOC peut se régler avec l’option--toc-depth=nombre. - l’option
--number-sectionpermet de numéroter les sections, sous-sections, etc. - Le template est défini à l’avance, on le renseigne dans la ligne de commande avec
--template=fichier. - Dans son en-tête (header,
-Hou en version longue--include-in-header=fichier), il intégrera la feuille de style que vous avez créée à cet effet, et que l’on renseigne en donnant le nom du fichier (mais on pourrait aussi bien intégrer le renvoi à la feuille de style dans le template lui-même ; ici vous avez la possibilité de choisir parmi plusieurs feuilles de style si besoin).
Le document final affichera, en plus du titre, de la date et de l’auteur, une table des matières et toutes les informations de mise en page que vous avez intégrées à votre document Markdown.
Vous noterez la gestion des notes de bas de page, par exemple, et la manière dont la table des matières s’affiche. Si vous aviez dû entrer toutes les références internes de la page, cela vous aurait certainement pris beaucoup plus de temps.
Vers LaTeX (pdf)
C’est vers ce format qu’on s’amuse le plus, à mon humble avis. Toutes les options sont applicables mais nous pouvons aller beaucoup plus loin. En effet, nous cherchons à automatiser la création du format de sortie le plus courant de LaTeX, à savoir un beau document PDF. Tout l’intérêt de la démarche consiste donc à créer un style comme nous l’avons fait pour le rendu HTML, mais beaucoup plus fin puisque nous pourrons paramétrer une mise en page destinée à l’impression. Il s’agira d’un document LaTeX contenant quelques éléments conditionnels, les packages que vous souhaitez utiliser et la configuration de ceux-ci. En somme, c’est de toute l’en-tête du document que nous avons besoin. Si bien qu’une fois celle-ci définie, il vous restera à l’avenir à rédiger vos documents en Markdown sans passer par LaTeX (ou alors pour quelques retouches si besoin), tout en utilisant les options de Pandoc. Ce qui produit finalement un double outil très puissant.
Dans l’exemple donné, il s’agit de créer un document au format A4, présenté comme un rapport avec un en-tête, etc. Mais ce n’est qu’un exemple : à vous de modifier le modèle pour le conformer à vos besoins.
Par défaut, c’est-à-dire si vous ne spécifiez aucun style, la sortie PDF se fera sous la simple classe [article] sans style particulier. Et n’oubliez pas : nous cherchons à produire directement un PDF en utilisant le moteur LaTeX, rien ne vous empêche de transformer votre document en LaTeX pour le travailler ensuite.
Pour notre exemple, la syntaxe est la suivante :
pandoc source.md -o produitfinal.pdf --toc --template=monstyle.latex --number-section
- l’option
--tocpermet l’insertion d’une table des matières - l’option
--number-sectionpermet de numéroter les sections, sous-sections, etc. - l’option
--template=xxxpermet de spécifier le style, c’est-à-dire l’en-tête du document LaTeX qui sera compilé pour produire le pdf final, cet en-tête se rédige dans un document LaTeX auquel on fait appel lors de la compilation.
Mais enfin, comment se construisent ces templates pour Pandoc?
Il s’agit en réalité de modèles de composition qui intègrent toute une série de variables. Par exemple, pour la date à intégrer dans un document LaTeX, on peut utiliser $if(date)$\date{$date$}$endif, c’est à dire « si la date est renseignée (dans les métadonnées), alors tu utilises cette valeur dans la commande indiquée ».
On peut construire ses propres modèles, dans la mesure où les valeurs peuvent être utilisées de cette manière. Mieux encore, certaines données peuvent aussi être entrées dans un fichier en YAML, mais cela fera l’un des objets d’un futur billet.
Pour commencer à bâtir des modèles, vous pouvez vous reporter à cette partie de la documentation et surtout regarder comment sont bâtis les templates par défaut de Pandoc, de manière à vous en inspirer.
La bibliographie (et production finale)
La bibliographie peut être traitée différemment selon votre format de sortie. Quoiqu’il en soit, pour commencer, vous devez produire un fichier de bibliographie au format bibtex (.bib).
Dans les commandes pandoc vous devrez renseigner ce fichier avec
--bibliography=nomdufichier.bib
Et dans votre document Markdown, vous passez les références ainsi, avec leurs identifiants :
Comme le dit Dupont [@dupont1950, p. 15]. Si nous marchons nous ne dormons pas [@Martin1985; @Dupont1950].
Si vous produisez un document LaTeX, le mieux sera d’utiliser l’option --biblatex ce qui aura pour effet de générer la commande biblatex pour traiter la bibliographie. Par exemple :
pandoc --bibliography=nomdufichier.bib --latex-engine=xelatex mondoc.md -o sortie.tex
Mais l’objet de cet article est de vous aider à produire des documents de manière automatisée. Voici comment procéder pour produire un document PDF ou HTML disposant d’une bibliographie (et donc d’une liste bibliographique).
Il faut pour cela utiliser l’interpréteur citeproc (à installer en plus de pandoc) et un fichier CSL (Citation Style Language). Le premier permet d’interpréter les fichiers CSL qui sont en fait des styles de bibliographie. Vous pouvez trouver un répertoire de ces fichiers CSL (prêts à l’emploi ou que vous pouvez modifier) dans le dépôt Zotero, un logiciel de gestion bibliographique.
Une fois votre fichier CSL prêt, vous pouvez produire :
pandoc --filter pandoc-citeproc --bibliography=mabiblio.bib --csl=monstylebiblio.csl -s --toc --number-section --template template.html --css template.css masource.md -o sortie.html
Ce qui permettra de produire un document HTML (standalone), avec une table des matières, des sections numérotées, basé sur un modèle HTML et un fichier de style CSS, une bibliographie traitée dans le texte et présente à la fin selon le fichier de style bibliographique choisi.
Astuce : pour introduire la bibliographie, laissez à la fin de votre document markdown un titre comme # Bibliographie.
pandoc --filter pandoc-citeproc --bibliography=mabiblio.bib --csl=monstylebiblio.csl -s --latex-engine=xelatex --toc --number-section -colorlinks masource.md -o sortie.pdf
Ce qui permettra de produire un document PDF, traité par XeLaTeX, avec une table des matières, des sections numérotées, des liens colorés, une bibliographie traitée dans le texte et présente à la fin selon le fichier de style bibliographique choisi.
Production finale
Si vous n’avez pas de bibliographie à gérer, vous pouvez vous lancer dans la production de documents différents à partir d’un seul fichier Markdown.
Produisez un fichier .ODT (ou Docx) puis appliquez vos styles avec LibreOffice (ou MSWord). C’est la solution la plus simple : en fait pandoc produit des styles que vous pouvez modifier ou carrément écraser avec un modèle (LibreOffice ou Word) par la suite.
pandoc masource.md -o sortie.odt
Produisez un fichier .tex prêt à l’emploi.
pandoc masource.md -o sortie.tex
Produisez un document HTML avec un modèle et un fichier de style, une table des matières, des sections numérotées.
pandoc -s --toc --number-section --template template.html --css template.css masource.md -o sortie.html
Produisez un beau PDF (travaillé avec LaTeX), avec un modèle préparé à l’avance (et dans lequel vous aurez pris le temps d’inclure les mackages à utiliser, et tout ce que vous voulez dans l’en-tête) :
pandoc -s --latex-engine=xelatex --template template.latex --toc --number-section -colorlinks masource.md -o sortie.pdf
En somme, il peut être particulièrement utile de vous préparer à l’avance quelques modèles (en partant des modèles par défaut de pandoc), même sans forcément y intégrer toutes les options. Selon les types de documents que vous produisez, vous pourrez les générer très vite.
Pour ce qui concerne les sorties destinées à un format comme ODT ou Docx, le mieux est encore de préparer un modèle qui écrasera les styles du fichier de sortie.
Conclusion
Même sans connaître toutes les possibilités offertes par Pandoc, vous voici désormais en mesure de produire un document censé être travaillé sous différents formats. Ceci est particulièrement utile si vous êtes censé récupérer des documents en provenance de différentes sources pour les mettre en page et les diffuser : il est plus facile de demander à vos contributeurs de rédiger en Markdown voire de rédiger un texte sans style quitte à ce que vous les repassiez vous-même en Markdown. De cette manière il vous sera ensuite très facile de publier différentes versions de ces textes adaptées aux mode de diffusions : pour le web, une version HTML, pour l’impression, une version PDF (LaTeX), etc.
Bien entendu, travailler à un bas niveau de mise en page, comme le veut l’usage du Markdown, nécessite de faire des choix, en particulier savoir à l’avance vers quel(s) format(s) vous voulez convertir vos documents. Si vous êtes amené à intégrer des éléments de HTML ou de LaTeX dans vos documents Markdown, faites-le en connaissance de cause.
En revanche les options de Pandoc étant nombreuses, et une fois affinées avec des fichiers de style, vos documents seront non seulement rapides à produire mais ils bénéficieront de multiples manières de les compiler pour des résultats différents.
De manière générale, le Markdown permet d’écrire très vite des contenus avec un minimum de commandes. À certains aspects, c’est sans doute le seul format qui permet d’écrire au kilomètre, avec un minimum d’informations de mise en page, ce qui permet de se concentrer exclusivement sur le contenu. Pandoc et l’art de créer des styles feront le reste.
24.06.2015 à 02:00
Révolutions informatiques : algorithmes et pouvoirs
Il y a 45 ans, avec l’arrivée en masse de l’informatique et du micro-ordinateur dans les entreprises, les foyers français, et à peu près tous les secteurs de l'économie, la notion de « Révolution Informatique » occupait le thème d’un des célèbres colloques de Cerisy-la-Salle du 10 au 20 juillet 1970.
Les actes de ce colloque, aujourd’hui indisponibles, méritent toutefois d'être lus aujourd’hui à bien des titres. Tout particulièrement à l’heure où notre gouvernement est en passe de voter un texte de surveillance de masse de nos outils de communication. En effet, en automatisant les tâches de surveillance par des algorithmes, ce qui revient à surveiller tout le monde pour faire un tri ensuite, il se développe actuellement une sorte d’accomplissement d’un pouvoir techniciste au prix d’une dépossession du peuple des instruments de la circulation de l’information, au fondement de la démocratie. Or, c’est étonnement un axe de lecture tout à fait intéressant des actes du colloque de ce mois de juillet 1970…
Deux textes en particulier méritent un détour. Le premier explique la notion d’algorithme. Un peu ardu à certains endroits, son auteur Jacques Riguet est néanmoins fort synthétique, et montre qu’en réalité ce qu’on appelle un algorithme est loin de mériter un traitement aussi désinvolte que celui que lui réservent nos responsables politiques du moment, puisqu’il s’agit de définir de l’imprécis par un choix d'éléments précis. Surveiller la population par des algorithmes suppose donc de manière systématique de l’imprécision et par conséquent nécessite d’expliquer précisément la classe des éléments choisis en fonction du but poursuivi. Si l’objectif est trop large, les algorithmes ne peuvent être précis : la Loi Renseignement ne peut donc pas concilier les deux, cqfd.
Le second texte est de la plume de Louis Pouzin, connu comme l’un des pionniers des recherches sur le temps partagé (voir sa fiche Wikipédia) aux sources de notre Internet d’aujourd’hui. Son texte porte sur les aspects technocratiques de l’informatique utilisée comme instrument décisionnaire. Loin de relayer des craintes infondées et anti-progressistes, ils soulève néanmoins quelques questions fort pertinentes sur le rapport qu’entretien le pouvoir avec le traitement informatique de l’information. Car en effet, déjà l’Internet balbutiant montrait qu’il pouvait être un extraordinaire outil de partage de l’information et par conséquent un outil majeur du dialogue démocratique. Si la génération des hommes politiques d’alors n'était pas encore prête à amortir cette révolution informatique naissante, il était tout à fait pertinent de s’interroger un peu sur l’avenir. Et ce n’est pas innocemment que l’auteur conclu en ces termes : « L’invocation de l’ordinateur est un camouflage commode pour l’accomplissement de politiques occultes. »
Je livre donc ces deux textes ci-dessous. J’espère que les responsables des publications du Centre Culturel International de Cerisy ne m’en voudront pas d’outrepasser ici le droit de citation pour aller un peu plus loin : le livre n'étant plus édité, je donne en quelque sorte une seconde vie à ces deux textes :
- La notion d'algorithme (Jacques Riguet)
- Intervention de L. Pouzin

Titre : Révolutions informatiques
Direction : François Le Lionnais
Éditeur : Union Générale d'Éditions
Collection : 10/18
Année de publication : 1972
Année du colloque : 1970
Table des matières
Section : Naissance et développement de l’informatique
Dimanche 12 juillet 1970 (après-midi), intervention de Jacques Riguet, Professeur à l’Université de Limoges (pp. 89-97)
La notion d'algorithme
Le mot « algorithme » a une signification voisine de celle des mots « recette », « procédé », « méthode », « technique », « routine ».
La notion d’algorithme est une notion intuitive, donc essentiellement imprécise, tout comme l’est, par exemple, la notion de courbe en géométrie. Un thème fondamental de la recherche mathématique consiste à tenter de donner des définitions précises d’un concept imprécis, le succès de la tentative étant de plus en plus assuré au fur et à mesure que l’on parvient à prouver que les définitions proposées sont équivalentes. Un exemple célèbre de ce thème de recherche nous est fourni par le résultat obtenu par Hahn et Mazur-Kiewicz en 1914 : la notion d’espace métrique compact connexe localement connexe et la notion d’image par une application continue d’un segment dans un espace séparé sont équivalentes et constituent donc une définition précise de la notion intuitive de courbe.
Nous verrons plus loin que les logiciens contemporains sont parvenus à démontrer l'équivalence de diverses notions précises susceptibles de recouvrir la notion intuitive d’algorithme. Mais, pour le moment, il nous faut proposer une définition de celle-ci. La voici :
On appelle algorithme une méthode générale pour la résolution d'une classe de problèmes, fixée en tous ses détails par des règles dépourvues de sens, de façon à ce qu'on puisse l'appliquer sans avoir à la comprendre.
Il convient de donner de suite un exemple :
L’algorithme d’Euclide pour la recherche du P.G.C.D. La classe de problèmes auxquels il s’applique est définie ainsi : étant donné deux entiers positifs m et n, trouver leur plus grand commun diviseur (c’est-à-dire le plus grand entier positif qui divise à la fois m et n).
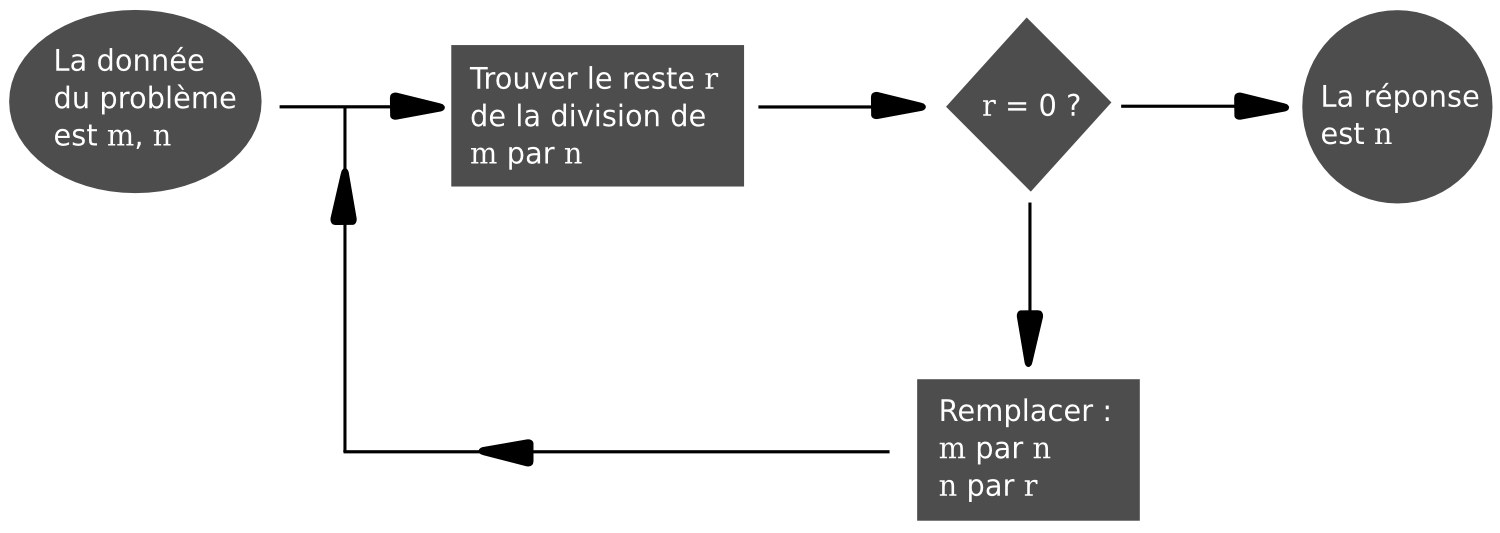
- Diviser m par n. Soit r le reste (on a 0≤r<n) ;
- Si r=0, l'algorithme est terminé, la réponse est n ;
- Si r≠0 remplacer m par n, n par r et opérer comme en 1.
Voir ci-dessous l’exemple d’application de l’algorithme aux nombres m=165 et n=616
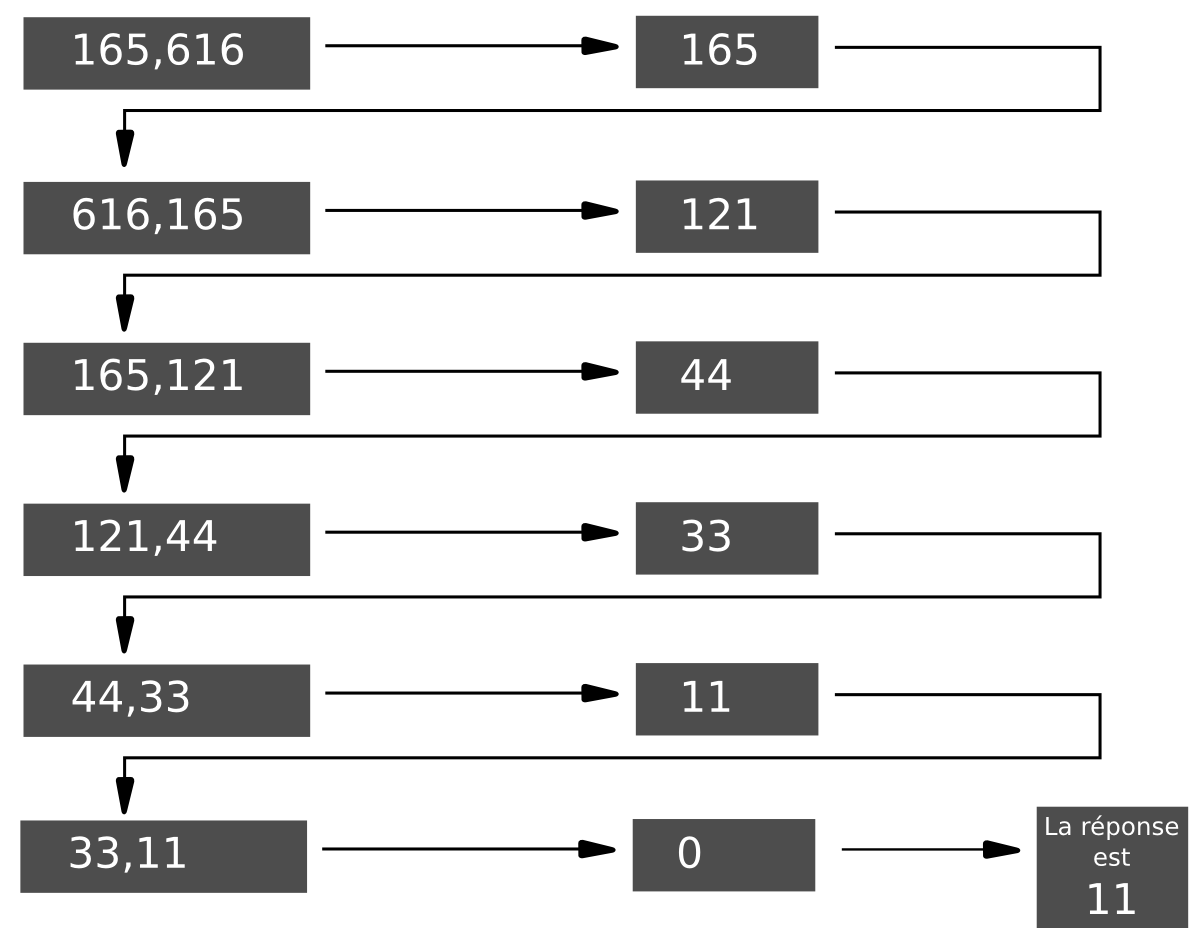
Déjà les arabes, sous l’influence des hindous, avaient développé des algorithmes.
Le mot « algorithme » lui-même est dérivé du nom de l’auteur d’un texte arabe : Abu Ja’far Mohammed ibn Mûsâ al-Khowârizmî (vers 825) (c’est-à-dire père de Ja’far, Mohammed, fils de Moïse, natif de Khowârîzm) (Khowârîzm est aujourd’hui la petite ville de Khiva en U.R.S.S.). Le mot algèbre lui-même est dérivé du titre de son livre « Kitab al jabr w’almuqabala » (Règles de restauration et de réduction) bien que le livre ne soit pas très algébrique.
Vers 1300, l’espagnol Raymond Lulle reprend les méthodes introduites par les arabes pour l'édification de son « Ars magna » qui devait être une méthode générale pour découvrir « toutes les vérités » à partir de combinaisons. Et c’est comme contribution à l'ars magna que Cardan publiera quelques deux cents ans plus tard ses formules et algorithmes algébriques. La « méthode » de Descartes a essentiellement pour but de permettre la résolution des problèmes de géométrie grâce à leur traduction algébrique et au traitement algorithmique de cette traduction (Descartes pensait manifestement que tous les problèmes algébriques pouvaient être traités algorithmiquement, ce qui s’est révélé faux par la suite). Leibniz a rêvé d’une « caractéristique universelle » permettant de résoudre tous les problèmes. Il est encore plus manifeste chez lui que chez Lulle que celle-ci doit être mise en œuvre par une machine. Il est l’un des premiers à construire une machine à calculer.
Reprenons maintenant la définition de la notion d’algorithme que nous avons posée au début et précisons-en quelques points.
- Un algorithme étant apte à la résolution d'une classe de problèmes, son énoncé doit comporter une description plus ou moins symbolique des données caractérisant cette classe (nous dirons que c'est son entrée ou sa source) et également une description plus ou moins symbolique des solutions de ces problèmes (nous dirons que c'est sa sortie ou son but). Par exemple, l'algorithme d'Euclide a pour source l'ensemble des couples d'entiers positifs non nuls (en écriture de base 10 par exemple) et pour but l'ensemble des entiers positifs non nuls.
- Un algorithme doit être fixé en tous ses détails. En particulier :
- les instructions doivent être d'une précision absolue. Une recette de cuisine bien qu'ayant une entrée (les « matières premières » : œufs, beurre, farine, etc.) et une sortie (gâteau d'anniversaire, etc.) ne peut être considérée comme un algorithme si elle comporte des instructions telles que « ajouter une pincée de sel » ;
- l'ordre d'application des règles doit être donné sans ambiguïté. Un organigramme constitué de boîtes d'instructions et d'aiguillages en rendra encore mieux compte que le langage ordinaire.
- Un algorithme doit être effectif : cela signifie que chacune de ses règles est suffisamment simple pour pouvoir être effectuée en un temps fini par un homme peut-être stupide et dépourvu de toute imagination mais parfaitement obéissant, muni d'un crayon (inusable) et d'un papier (indéfiniment prolongeable) et qui opère de façon purement mécanique sans réfléchir et sans se soucier du sens que pourraient avoir ces règles1.
On remarquera qu’en quelque sorte 3. implique 2. : si le conducteur de l’algorithme est dépourvu d’imagination, il sera incapable de suppléer au manque de précision ou à la défaillance d’une instruction.
On remarquera aussi que le conducteur de l’algorithme est censé effectuer ses calculs pas à pas, de manière discrète et déterministe sans avoir recours à des méthodes continues ou analogiques ou stochastiques.
Un algorithme ayant une source (classe de problèmes) et un but (énoncé de la solution) définit par là même une fonction que l’on dit calculable par l’algorithme. Par exemple, la fonction f définie par : « quels que soient les entiers positifs non nuls x,y:f(x,y)=P.G.C.D. de x et de y » est une fonction calculable par l’algorithme d’Euclide.
Il est très facile de se rendre compte que, si une fonction est calculable par un algorithme, il en existe d’autres grâce auxquels elle est également calculable. Et c’est un problème important que d’avoir des critères permettant de choisir, parmi ceux-ci, ceux qui réalisent les meilleures performances du point de vue économie de temps ou du point de vue d’autres critères tels que : facilité d’adaptation aux ordinateurs, simplicité, élégance… Il y a là un domaine nouveau à explorer : celui de l’optimalisation des algorithmes.
Il est moins facile de se rendre compte qu’il existe des fonctions qui ne sont pas calculables par un algorithme. Et c'était même là le sentiment erroné des mathématiciens des siècles précédents. Même la découverte de démonstration d’impossibilité de résolution de certains problèmes (par exemple : construction géométrique à l’aide de la règle et du compas, résolubilité des équations algébriques par radicaux) n’influença guère les mathématiciens dans cette croyance, car il s’agissait de la non résolubilité de problèmes grâce à des moyens déterminés mais non d’une impossibilité générale. La démonstration de l’existence de fonctions qui ne sont pas calculables par un algorithme suppose que l’on a défini de façon précise le concept d’algorithme puisqu’une telle démonstration fait appel à la classe de tous les algorithmes. En fait, le problème de la définition précise de la notion d’algorithme est lié étroitement à celui de la définition précise de fonction calculable : une fonction est calculable s’il existe un algorithme permettant de calculer f(n) quel que soit l’entier n. Réciproquement, la méthode d’arithmétisation de Gödel des mots d’une syntaxe permet de déduire le concept d’algorithme de celui de fonction calculable.
Et, historiquement, les recherches de définitions précises ont porté d’abord sur la notion de fonction calculable avec Skolem en 1923. L’idée de départ est de tenter de définir une fonction calculable comme une fonction qui puisse être obtenue à partir de fonctions très simples et manifestement calculables par un processus récursif, c’est-à-dire un processus où la valeur prise par la fonction, lorsqu’on donne à la variable la valeur n+1, est reliée à la valeur de cette même fonction lorsqu’on donne à la variable la valeur n. Précisons cela : désignons par ℱn l’ensemble des applications de ℕn dans ℕ, où ℕ désigne l’ensemble des entiers naturels, par ℱ l’union de tous les ℱn, par s et σ les deux éléments de ℱ1 définis par s(n)=n+1, σ(n)=0 et par Pn,1,…,Pn, n les éléments de ℱn définis par Pn,k(m1,…mn)=mk. Soient f1,…,fk∈ℱm et g∈ℱk. Nous désignerons par g(f1⇑…⇑fk) l'élément de ℱm défini par g(f1⇑…⇑fk) (x)= g(f1(x),…,fk(x)) pour tout x∈ℕm.
Enfin, soient f∈ℱm et g∈ℱm+2. Nous désignerons par frekg l'élément de ℱm+1 défini par :
frekg(0,x)=f(x)
frekg(n+1,x)=g(n,frekg(n,x),x)
pour tout x∈ℕm.
Nous désignerons par 𝒫 et nous appellerons ensemble des fonctions primitives récursives le plus petit sous-ensemble de ℱ contenant s,σ,Pn,1…Pn,m pour tout n et stable par composition et par récursion. Plus précisément, si 𝒫n=𝒫∩ℱn, 𝒫 est le plus petit sous-ensemble de ℱ satisfaisant aux trois conditions :
- s,σ∈𝒫1, pour tout n∈ℕ,Pn,1…,Pm,n∈𝒫n ;
- f1,…,fk∈𝒫m,g∈𝒫k→g(f1⇑…⇑fk)∈𝒫m ;
- f∈𝒫m,g∈𝒫m+2→frekg∈𝒫m+1.
Nous avons construit ainsi un ensemble 𝒫 de fonctions méritant d'être appelées calculables.
Mais, dès 1928, Ackermann donne un exemple très simple de fonction méritant d'être appelée calculable et n’appartenant pas à 𝒫. Il s’agit de la fonction f∈ℱ2 définie par :
f(0,n)=n+1 ;
f(n+1,0)=f(n,1) ;
f(n+1,m+1)=f(n,f(n+1,m)).
C’est Gödel qui va parvenir, en 1934, en utilisant un projet de Herbrand à « agrandir suffisamment 𝒫 » pour parvenir enfin à une définition satisfaisante de la notion de calculabilité. Ce 𝒫 agrandi que nous désignerons par R et que l’on appelle ensemble des fonctions récursives générales se définit en permettant la génération de fonctions nouvelles non seulement par composition et par récursion mais aussi par minimalisation. Voici quelles sont des définitions précises : soit f∈ℱm+1. On désignera par μ(f) et on appellera minimalisation de f l’application de D dans ℕ définie par :
μ(f)(x)=min(n∈ℕ/f(n,x)=0) pour tout x∈D, D désignant le sous-ensemble de ℕm constitué par les x∈ℕm pour lesquels il existe un n∈ℕ tel que f(n,x)=0.
Il est facile de montrer que la fonction de Ackermann appartient à R.
En 1936, Church et Kleene introduisent la notion de λ-définissabilité. Church et Rosser démontrent peu après qu’elle est équivalente à la notion de fonction récursive et Church formule alors sa célèbre thèse : toutes les fonctions réputées intuitivement calculables ou, selon ses propres termes, « effectivement calculables » sont λ-définissables ou, ce qui est équivalent, récursives générales.
Il s’agit bien d’une thèse et non d’un théorème puisque son énoncé propose d’identifier un concept intuitif imprécis à un concept précis. Elle ne peut être démontrée mais peut être étayée par de nouvelles démonstrations d'équivalence.
Le premier pas décisif dans le renforcement de la thèse est accompli par Turing, en 1936, qui introduit une notion de machine qui est le résultat d’une analyse des opérations élémentaires qu’accomplit le conducteur d’algorithmes, peut-être stupide, mais fort obéissant dont nous avons déjà parlé. Presqu’en même temps, et indépendamment, Post décrit, en 1937,une machine analogue. La thèse que Turing énonce alors : toutes les fonctions réputées intuitivement calculables sont celles calculables par la « machine de Turing », apparaît équivalente à celle de Church puisque Turing lui-même démontre l'équivalence de son concept de calculabilité avec la λ-définissabilité. Le concept de machine de Turing est important car il a permis de définir exactement le concept d’algorithme sans passer par la gödelisation et a permis d'étendre à toute une série de problèmes (en particulier au problème des mots en théorie des groupes et au problème de la décidabilité des prédicats) la démonstration de l’impossibilité de résoudre le problème de Thue pour les demi-groupes qui avait été donnée par Post et Markov en 1947.
C’est Markov en 1951 qui donne une première définition du concept d’algorithme sans passer par la gödelisation. La thèse qu’il formule alors : tout algorithme au sens intuitif du terme peut s'écrire sous forme d’algorithme de Markov, est renforcée par Detlovsk qui démontre, en 1958, l’identité de l’ensemble des fonctions récursives et des fonctions calculables par un algorithme de Markov.
Markov est parvenu à sa notion d’algorithme en s’apercevant que les démonstrations, les calculs, les transformations logiques consistent essentiellement à transformer certains mots en d’autres suivant diverses règles. C’est dire que sa formulation vient s’inscrire tout naturellement dans le cadre très général formulé par Post en 1943 et qu’on désigne maintenant sous le nom de « calcul de Post ».
- Les régions limitées par des traits pointillés sont censées représenter des concepts intuitifs plus ou moins vagues.
- Les régions limitées par des traits fermes sont censées représenter des concepts précis.
- Les traits doubles pointillés sont censés représenter des équivalences intuitives des « thèses ».
- Les traits doubles pleins sont censés représenter des équivalences précises, prouvées par des démonstrations mathématiques.
C’est également comme un cas très particulier de calcul de Post qu’apparaissent les grammaires de Chomsky en 1955. Elles fournissent un modèle fondamental pour l'étude non seulement des langues naturelles mais aussi des langages de programmation que d’autres conférenciers auront maintes fois l’occasion de définir et de développer dans leurs exposés.
1. Il est clair qu’il vaut mieux, pour la bonne conduite de l’algorithme, qu’un tel homme ne sache faire que cela et qu’un mathématicien aura quelque peine à oublier la signification des calculs qu’il effectue pour tenir convenablement un tel rôle pendant longtemps : le paysage le séduit trop. Ulysse se bouchait les oreilles pour ne pas entendre le chant des Sirènes !
Section : Informatique et technocratie
Dimanche 19 juillet 1970 (matin), intervention de Louis Pouzin, Délégation générale à l’informatique (pp. 429-435)
Intervention de Louis Pouzin
Peut-on être pour la technocratie ? Bien qu’il soit de bon ton d'être contre, n’est-ce pas un simple préjugé, d’autant plus mal fondé que l’on pourrait bien soi-même appartenir à une variété de technocrates retranchés dans l’informatique. Afin d’y voir plus clair, il paraît souhaitable de s’interroger sur ce que l’on entend par « technocrate ».
- La technocratie est-elle une forme d'existence contrôlée par des machines ? C'est un état de fait beaucoup plus fréquent que l'on ne se plaît à le reconnaître. La vie moderne est truffée de situations où le confort et la sécurité des personnes dépendent du bon fonctionnement de machines : air conditionné, ascenseurs, avions, etc., pour s'en tenir seulement à la lettre A. Les vols lunaires reposent totalement sur le bon fonctionnement d'un matériel extrêmement complexe. Mais alors on parle plutôt de science ou de technique, non de technocratie.
- La technocratie est-elle une forme de gouvernement par des techniciens ? En fait, il ne semble pas tellement que nous soyons gouvernés par des techniciens. L'inventaire des personnages ou institutions détenteurs de pouvoir ne révèle pas demodification radicale depuis plus d'un demi-siècle. On y retrouve traditionnellement les représentants du peuple, les chefs d'entreprise, les banquiers, les ministres, la police, l'église, les partis politiques, les syndicats… Rien de très nouveau.
- La technocratie est-elle une forme occulte de gouvernement par des techniciens derrière une façade de pouvoirs traditionnels ? Tous les pouvoirs ont toujours été plus ou moins assistés de conseillers divers, dont des techniciens. Il ne semble pas que le technicien ou le savant actuel soit beaucoup plus écouté ou respecté que son homologue des générations antérieures.
- Où trouve-t-on alors cette association de technique et de pouvoir ?
Peut-être pourrait-on déceler des traces du virus dans ces vocables nouveaux à effet certain tels que : techniques de la décision, préparation scientifique des décisions. Ce ne serait sans doute que colorations nouvelles plaquées sur des procédés anciens si le contexte n’impliquait le plus souvent l’utilisation d’ordinateurs. En d’autres termes, il y aurait là un phénomène nouveau dû à l'écrasante supériorité de la machine dans le domaine du traitement de l’information. Il semblerait, aux dires de certains, que l’on pourrait maintenant évaluer les conséquences des décisions de façon scientifique, quantifiée, objective, dénuée de tout facteur affectif, en compilant une masse suffisante d’information qu’aucun individu ne pourrait synthétiser par ses seuls moyens humains. Nous serions enfin bientôt débarrassés de ces décisions subjectives prises hâtivement sous la pression des circonstances. Mais pourquoi y aurait-il encore besoin de gens pour prendre ces décisions ? Si une machine est capable de produire le bilan quantitatif d’une alternative en traitant des masses considérables de données, on ne voit pas très bien ce qui empêcherait de pousser l’opération un pas plus avant et de produire la meilleure des alternatives. Si maintenant on prend une décision différente, c’est sans doute que la meilleure alternative était inapplicable, donc mal évaluée.
Est-ce là une attitude légitime de suspicion vis-à—vis du traitement mécanique de l’information ? Sert-il vraiment à quelque chose ? Ou bien ne jouons-nous pas la tragi-comédie de prendre des décisions dictées par des machines ?
De tout temps, les décisions ont été fondées notamment sur des « informations ». Tous les pouvoirs sécrètent des réseaux d’information, officiels ou non. Avec le temps et la conquête des libertés individuelles, les sociétés humaines ont développé des formes de pouvoir construites sur une collecte ouverte et organisée de l’information. C’est ce qu’on appelle une démocratie. Les opinions de chacun, recueillies au niveau le plus élémentaire, sont concentrées pour aboutir à une expression commune d’opinion générale. Sans être nécessairement partagée par tout le monde, elle devrait être au pire la moins mal partagée.
Il existe d’autres formes moins officielles de collecte d’information : les renseignements généraux, les services spéciaux, les études de marché, les sociétés de crédit, les gangs. Ces organisations collectent et traitent des informations par leurs moyens propres, afin de pouvoir prendre des décisions conformes à leurs intérêts particuliers. Une des techniques élémentaires du renseignement consiste à entourer de mystère ce que l’on sait réellement. La collecte d’information a donc le plus souvent lieu par des voies indirectes. Le processus n’est pas consultatif en ce sens que l’on n'éclaire pas 1e public sur les véritables facteurs que l’on désire connaître. Ceux-ci sont dissimulés soit par l’utilisation de moyens confidentiels, soit par des formes de collecte anonymes et peu explicatives. À quoi ou à qui servent, par exemple, les fiches de débarquement « obligatoires » que doit remplir tout passager français venant d’un aéroport étranger ? Le processus est également dénué d’aspect délibératif. Le public, n'étant pas informé de la véritable information recherchée, est encore moins convié à débattre du sujet.
On pourrait imaginer que tous ces réseaux d’information, occultes ou transparents, n’ont pour but que de rassembler le maximum d'éléments à partir desquels seraient évaluées des décisions judicieuses dans un environnement déterminé. Il n’est pas interdit de penser que cela se produise en effet. Mais il est différentes natures de décisions. Peut-on par exemple placer sur le même plan les mesures de dépannage d’un atelier après un incident technique, la fermeture d’une agence régionale d’une grande société, la fixation du taux d’intérêt de la Banque de France ou l’entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun ? La fermeture d’une agence régionale peut être la conséquence d’une opération de concentration de moyens. Elle peut aussi mettre en émoi des notables, des clients, des politiciens. Il est nécessaire de peser tous ces éléments avant d’en décider. Mais l’opération de concentration n’en est pas moins poursuivie, avec l’objectif de fermer un certain nombre d’agences. Les facteurs essentiels seraient très différents si l’agence était le seul établissement de la société.
Dans la pratique, les décisions sont prises à plusieurs niveaux, que l’on peut qualifier de stratégiques et tactiques. On pourrait dire aussi décision de pouvoir et de gestion, ou bien de politique et de logistique. Une décision prise à un niveau de pouvoir élevé ne peut être appliquée que par transformation en une cascade de décisions intermédiaires prises ultérieurement par un grand nombre de personnes. Traditionnellement, l’impossibilité pratique d'évaluer tous les facteurs pesant sur une décision de haut niveau conduit le plus souvent à décider d’abord, tenter d’appliquer ensuite. Si un réseau d’information est utile pour aider à prendre une décision de haut niveau, il est tout aussi apte à faciliter la prise des décisions subséquentes, qui sont les plus nombreuses, et d’autant plus ressenties par le public qu’elles atteignent un stade final d’application. Comme il existe souvent une multitude de voies pour aboutir à des objectifs généraux, les décisions intermédiaires ont surtout pour but de choisir des voies de moindre résistance. Un réseau d’information est alors un outil inséparable du pouvoir pour aboutir à la réalisation de ses objectifs.
L’information collectée et traitée par les seuls moyens humains est personnalisée. Les traits d’observation et de jugement des individus influent sur les résultats. La masse d’information est de plus limitée. En face de cela, un ordinateur peut absorber une quantité quasi-illimitée d’informations brutes. Il serait donc l’outil idéal pour remédier aux défauts inhérents aux moyens d’information humains, tant par sa puissance de synthèse que par son objectivité.
En réalité, une masse d’informations brutes est inutilisable, quelle que soit la manière d’additionner des faits élémentaires, car ils n’ont pas la même signification du point de vue de ce que l’on recherche. Pour obtenir des résultats utilisables, il faut traiter l’information, autrement dit utiliser des procédés d’analyse et de réduction des données qui les transforment selon des lois choisies avec plus ou moins de bonheur. Il peut apparaître à ce stade des distorsions involontaires ou non, conséquences d’erreurs techniques ou de coups de pouce délibérés. Il est courant de lire des résultats d'études donnant une pléthore de chiffres en apparence cohérente (la somme des pourcentages est 100) et qui ont la réputation de sortir des ordinateurs. On n’indique jamais de quelle manière ces résultats ont été obtenus. Ce serait d’ailleurs impraticable, car le traitement effectué peut être d’une telle complexité que sa compréhension est réservée aux seuls spécialistes.
L’ordinateur producteur d’information est communément crédité de cette neutralité qui fait tomber les passions et clôt les discussions. Or, le seul élément neutre se réduit à l’ordinateur. Les informations brutes ne sont pas neutres. Aussi nombreuses soient-elles, elles sont choisies parmi d’autres que l’on ne retient pas. Le traitement n’est pas neutre, c’est un programme qui reflète une méthode de certains experts. Les résultats ne sont pas neutres, car il est bien rare que l’on publie tout ce qu’il est possible d’obtenir. Mais l’ordinateur impavide sert de paravent commode. Il n’est plus possible de contester l’information dont personne n’est responsable. Tout au plus admet-on quelquefois une « erreur » d’ordinateur, autre paravent commode pour désigner une erreur humaine. Puisque les informations sont supposées neutres, cette qualité se transfère aussi aux décisions qui en découlent logiquement, disons fatalement. Il est humain d'être en désaccord avec des décisions prises par d’autres, et au besoin de s’en prendre aux auteurs. Si un pouvoir est jugé par trop contraignant, certaines personnes peuvent tenter de s’en saisir en en chassant d’autres. Prendre ou conserver le pouvoir sont des occupations qui impliquent nommément des individus. Faire passer l’ordinateur pour le véritable instrument de décision a pour effet de dépersonnaliser le pouvoir. C’est sans doute pour ceux qui le détiennent un moyen adroit de le conserver, car on ne voit pas très bien comment prendre un pouvoir qui n’est visiblement exercé par personne.
L’ordinateur paravent n’est pas seulement utile aux mains de ceux qui détiennent le pouvoir face à ceux qui ne l’ont pas. Habituellement, le pouvoir est en réalité un ensemble de clans, organismes, directions,… entre lesquels apparaissent des désaccords et des rivalités pour des positions plus dominantes. La connaissance des techniques informatiques est encore assez précaire dans les milieux dirigeants, dont la moyenne d'âge fait remonter la formation à une autre époque. Moyennant une présentation quelque peu différente, un homme de pouvoir est aussi neutralisé par des produits d’ordinateur qu’un homme sans pouvoir. À toutes fins utiles, il est prudent de s’entourer des meilleurs augures avant de prendre une décision comportant des risques. En cas d’ennui, la référence à l’ordinateur peut apporter des justifications ou échappatoires supplémentaires.
En résumé, l’informatique apporte de nouveaux instruments de pouvoir que nous ne savons pas encore bien utiliser ou neutraliser. Il se caractérisent par une présentation scientifique des informations et des décisions. La technicité et la dépersonnalisation apparentes des mécanismes utilisés les rend assez peu vulnérables à la contestation individuelle. La distinction entre les méthodes rigoureuses et les amalgames pseudo-scientifiques est encore assez peu perceptible dans la société actuelle, et le mythe de l’ordinateur se cultive aussi bien dans les milieux de pouvoir qu'à l’extérieur. L’invocation de l’ordinateur est un camouflage commode pour l’accomplissement de politiques occultes.
Sous la présidence de Mme Claudine Marenco, hormis les conférenciers, sont intervenus dans la discussion R. Cohen, F. Le Lionnais, R. Mesrine, J. Urvoy, J. Weinbach.
22.06.2015 à 02:00
TVL 2015 : attention, ça glisse !
Le Trail de la Vallée des Lacs est sans doute l’un des plus fun des trails du massif des Vosges, tant par son parcours que par les aléas climatiques qui caractérisent si bien nos vallées. Je ne pouvais repousser à une date ultérieure ma participation à ce trail. Pour cette première fois, je n’ai pas été déçu, ni par l’organisation ni par le parcours.
Descriptif
Ce fut un week-end assez particulier que ces 20 et 21 juin 2015. Le premier jour, dédié aux grands parcours des 55 et 85 km fut très difficile pour les coureurs, avec du vent et des pluies glaciales sur les crêtes vosgiennes. En les voyant redescendre, et même si la perspective de la ligne d’arrivée dessinait sur leurs visages un soulagement méritoire, on remarquait les stigmates que la course n’avait pas manqué d’imprimer sur les corps fatigués. Ce n’est pas tant la longueur ou les dénivelés qui sont les plus durs sur ce trail, mais bel et bien le terrain et le climat.
Le trail court du lendemain, avec ses 29 km (27 annoncés) et ses 1300 m D+ n’offrait qu’une petite partie des difficultés de la veille. Sous le portail du départ, avec la pluie et la fraîcheur revigorante du matin, tout le monde savait à quoi s’en tenir : des pistes glissantes et une boue bien grasse savamment préparées par les coureurs de la veille, ce qui ne devait pas aller en s’améliorant, surtout en fin de peloton. Ceux qui comme moi, avaient déjà reconnu le tracé, savaient aussi quels endroits plus techniques devaient retenir toute l’attention du traileur pour ne pas risquer la blessure.
L’organisation fut exemplaire : profitant chaque fois de l’expérience des sessions ultérieures, le balisage et les indications des bénévoles (forts courageux pour attendre des heures sous la pluie) furent largement appréciés. Aucune place à l’erreur.
Le départ fut donc donné avec les mises en garde de rigueur et la foule (plus de 500 coureurs) se mit en mouvement. Dans l’ensemble, le démarrage fut plutôt serein pour une mise en jambe profitable. Dès le premier single, le bouchonnage fut prévisible, avec presque aucune possibilité de dépassement. La situation devra se renouveler deux autres fois, dans les descentes vers le lac de Longemer, à la fois à cause du ravinage et de l’instabilité des sentiers. S’il fallait prendre de l’avance, c’est sur la première montée des pistes de la Mauselaine qu’il fallait le faire : un chemin bien large au dénivelé assez régulier permettait de prendre un rythme de croisière confortable.
Les montées les plus difficiles du parcours se situaient sur sa première moitié et juste un peu après le ravitaillement de mi-parcours. Des raidillons pas franchement longs mais assez éprouvants pour les jambes en particulier avec un terrain glissant. La difficulté principale de la seconde moitié du parcours tenait selon moi au terrain des chemins, avec à certains endroits des mares de boues qui mettent à l’épreuve nos capacités de saut en longueur. Au bout d’un moment, tout le monde abandonne l’idée de se salir le moins possible : on est là pour cela, après tout. Cependant, les rotules en prennent pour leur grade à chaque fois que, sous la boue, une pierre ou une racine fait perdre l’équilibre.
Les 5 derniers kilomètres ne furent toutefois pas aussi difficiles que prévu. Quelques rayons de soleil firent leur apparition à notre grande joie. Arrivés au camp de base, beaucoup de coureur ne résistèrent pas bien longtemps avant de plonger les jambes dans le lac pour ôter le plus gros des souvenirs forestiers incrustés sur les mollets… Vivement l’année prochaine !

Résultats et tracé
- Les résultats du trail sont consultables à cette adresse.
- Mon temps : 4:11:16
- Classement : Scratch 306/546 (90 V1H / 130 VEM)
Contrairement à ma reconnaissance du parcours, cette fois, le tracé est bel et bien exact. Vous pouvez aussi télécharger le fichier GPX (sur cette carte, cliquez sur « légende » puis « visualiser les données »).
30.05.2015 à 02:00
Entraînement trail, 6 châteaux
La sortie trail du jour m’a embarqué autour du Mont Sainte Odile, un des hauts lieux de l’identité alsacienne. Un parcours à éviter absolument le dimanche si vous ne voulez pas gêner les randonneurs. Côté repérage, la multitude de chemins balisés du Club Vogien a ceci de paradoxal qu’à la vitesse de course à pied, on en perd un peu le fil, donc carte obligatoire. Ce parcours me semble idéal si vous êtes de passage dans la région et si vous voulez visiter un maximum d’endroit en peu de temps. C’est parti, au rythme d’un car de touristes japonais frénétiques !
Description
L’objectif du jour était simple : cumuler un dénivelé positif d’au moins 1000 m tout en prenant plaisir à rallier différents points remarquables autour du Mont Sainte Odile. L’intérêt d’aligner sur un même parcours des monuments ou des rochers particuliers, c’est de rompre la monotonie. Ce fut plutôt réussi. Sans vouloir crâner, je pense que s’il y a un trail du côté de Barr, c’est ce parcours-là qu’il faudrait faire pour un trail court.
C’est donc à Barr qu’on est invité à laisser sa voiture, le cas échéant. Un emplacement intéressant est sur le parking de l’église St Martin, ce qui permet d’amorcer directement sur le GR 5 à la droite du cimetière. Pour lire la suite de ce billet, prenez une carte IGN, surtout si vous n’êtes pas un(e) habitué(e) des lieux.
Données du parcours : 28 km, 1285 m D+.
Le parcours en général est assez régulier et rapide. Les difficultés sont étalées tout au long du chemin. La première montée vers le Mont Ste Odile, est assez surprenante. On emprunte le GR pour rejoindre le château du Landsberg puis on est finalement assez vite rendu sur la Bloss puis le Maennelstein. Ensuite entre les replats et les descentes, on couvre très rapidement la distance jusqu’au Monastère, puis les ruines du Hagelschloss et le site du Dreistein (en réalité, à cet endroit, il y a trois châteaux, mais je n’en compte qu’un pour cette balade :) ). Jusqu’au Dreistein, honnêtement, je n’ai pas vu le temps passer. Par contre, la descente du Dreistein et la montée qui suit juste après pour rejoindre la maison forestière du Willerhof nécessite une petite préparation psychologique : le Saegmuehlrain marque la division du parcours en deux grandes parties : la première plutôt régulière et la seconde qui nécessite de bien jauger l’énergie disponible selon la difficulté.
Cette seconde partie est inaugurée par le château du Birkenfels puis, en passant par la Breitmatt, un très joli point de vue sur le rocher du Kienberg. Pour la faire courte, l’ascension du Kienberg (par la face sud) m’a fait apprécier mes bâtons ! Ensuite vient la grande descente, sur plusieurs kilomètres, jusque la Holtzplatz (fond de vallée). Méfiez-vous : repérez bien la nomenclature du Club Vosgien sinon il est très facile de se tromper et se retrouver directement à Barr. Ce serait dommage, puisque les deux derniers châteaux n’attendent que vous à condition d’accomplir la dernière montée NTM (Nique Tes Mollets, un groupe célèbre qui m’a trotté dans la tête tout le temps de cette montée). Cette montée débouche sur Hungerplatz, ce qui marque la fin des négociations de dénivelés, puisqu’entre le château du Spesbourg et celui d’Andlau, c’est une descente qui ne se terminera finalement qu’à Barr. La toute fin du parcours, au sortir de la forêt, surplombe les vignes côté sud.
Je récapitule rapidement les étapes du parcours :
- chateau du Landsberg,
- point de vue du Maennelstein,
- monastère de Ste Odile,
- chateau du Hagelschloss,
- château(x) du Dreistein,
- château du Birkenfels (en passant par Willerhof),
- Rocher du Kienberg,
- Carrefour du Luttenbach puis Holtzplatz et Hungerplatz,
- Chateau du Spesbourg,
- chateau d’Andlau,
- Les Trois Chênes puis retour à Barr par les vignes
Carte et profil altimétrique
La carte ci-dessous et son fichier GPX ne sont là qu’à titre indicatif. Cette précision est importante car à deux reprises, j’ai bricolé ma montre GPS et oublié de la remettre en route (!). Il y a donc deux lignes droites qui faussent un peu le parcours, mais à ces deux endroits, il suffit de suivre le sentier (suivre le sentier du Mur Païen, et le chemin forestier sur la commune de Barr).
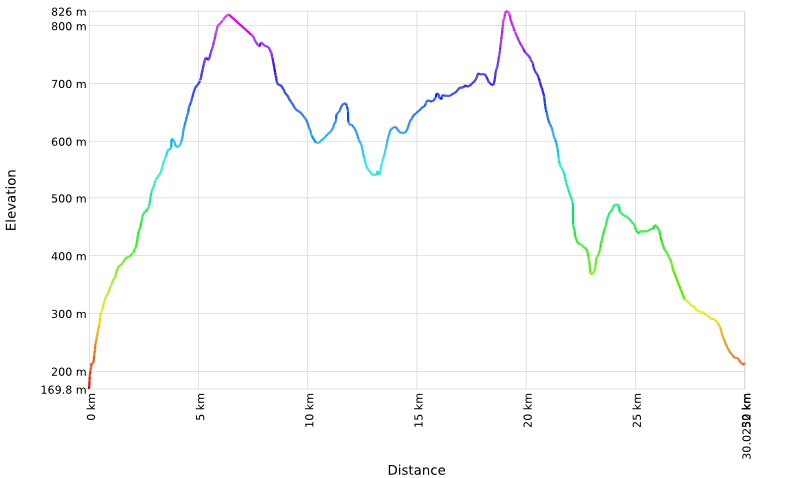
24.05.2015 à 02:00
Loi Renseignement. Totalitarisme ou désespérance
Le projet de loi Renseignement, après avoir été voté avec une écrasante majorité à l’Assemblée nationale passe actuellement par les grilles du Sénat et se retrouvera cet été devant le Conseil constitutionnel à la demande d’une soixantaine de députés. Ceux qui ont suivi les débats et constaté l’extraordinaire ténacité des initiateurs de ce projet de loi, ne peuvent qu’être horrifiés de la manière dont furent imposés les arguments et le texte de la loi dans un dialogue de sourds. Ce dernier confrontait non pas les idées politiques entre élus représentants du peuple et sa diversité, mais entre la société civile et la classe politique conçus comme des Atrée et Thyeste que rien ne peut plus concilier. La dialectique entre sécurité et liberté dans le domaine de la surveillance des communications est un sujet qui laissait supposer qu’un tel texte devait faire l’objet d’analyse et d’expertise autrement plus poussées, en prenant le temps, loin des passions suscitées par le terrorisme. Une telle loi laisse-t-elle désormais planer l’ombre du totalitarisme en réponse à la peur et aux tensions mondialisées ? Sommes-nous subrepticement en train d’abandonner nos idéaux démocratiques et républicains ?
Dangers de la loi Renseignement
Je n’ai jamais aimé les mots en « isme ». Ils ont tendance à classer tout et n’importe quoi dans des catégories le plus souvent inappropriées au sujet de la discussion. Le totalitarisme se défini comme un système politique qui impose par le contrôle systématique l’adhésion à une idéologie incarnée par un parti unique censé représenter la communauté. Il n’y a pas d’idéologie unique derrière le projet de loi Renseignement, il y a plutôt une convergence de volontés diverses, allant de la logique ultra-sécuritaire à la défense d’intérêts de classe, ou personnels ou encore lobbyistes (on pourrait aussi qualifier cette loi d'anti-zadiste, par exemple). Donc passer du projet de loi Renseignement à la prédiction d’un totalitarisme qui vient, même déguisé, est une démarche inappropriée qui tend à voiler les problématiques en jeu. Néanmoins je voudrais ici m’interroger et explorer diverses voies et, en mobilisant mes maigres connaissances des auteurs classiques, tracer les contours d’une situation bien désavantageuse pour la démocratie.
Et la dictature ? Là, par contre, on se rapproche davantage de la réalité des faits. La dictature se défini d’abord comme un régime politique, donc avec des institutions qui peuvent la précéder et lui survivre, avec la concentration de tous les pouvoirs sur une personne ou un groupe bien identifié. À l’époque Romaine, la dictature était conçue comme un remède possible à une période de crise, c’est à dire une exception légale à la règle républicaine (une magistrature exceptionnelle). Là où les institutions sont supposées assez fortes pour pouvoir se permettre ce genre d’exception temporaire, une dictature peut théoriquement résoudre une situation de trouble à condition d’un retour à la norme que l’on espère rapide. Là où les institutions sont faibles, la dictature peut perdurer indéfiniment. Elle peut bien évidemment se doubler d’un système totalitaire, fondé sur une idéologie plus ou moins claire.
Voilà pour les définitions. Disons pour simplifier à l’extrême que le totalitarisme est d’abord idéologique là où la dictature est d’abord juridique. Pour revenir à nos moutons à propos de la loi Renseignement, il nous faut maintenant analyser les raisons pour lesquelles une telle loi nous rapproche dangereusement des plus mauvais souvenirs de l’histoire des régimes politiques. Car il s’agit d’une loi qui, du moins dans ses premières moutures, a la prétention d’organiser une surveillance de masse de nos communications, pour défendre des intérêts volontairement englobants et généralistes (comme les « intérêts économique majeurs »), une loi justifiée par la « lutte contre le terrorisme » et qui a finalement pour conséquence de restreindre à grande échelle le droit à la vie privée, la liberté d’expression et en général les libertés individuelles.
À titre d’illustration par anticipation des répercutions de cette loi utilisée par une idéologie totalitaire, on peut se pencher sur une tentative d’amendement relatée par Marc Rees, rédacteur en chef de Next Inpact :
Enfin, il y a le superbe amendement Apprentis chimistes (COM-193), signé par trois sénateurs UDI, MM. Guerriau, Kern et Longeot, qui proposent d’autoriser l’espionnage non seulement dans le domaine du terrorisme ou industriel mais également à « d’autres valeurs essentielles à la République », à savoir les intérêts « sanitaires, énergétiques, scolaires, administratifs, culturels, cultuels, sportifs ». Heureusement, ses auteurs l’ont finalement supprimé après quelques coups de téléphones bien sentis. Ouf !
Cette tentative a en effet de quoi inquiéter. Il serait exagéré de la monter en épingle pour dénoncer tout le projet de loi, néanmoins, pourquoi avoir retiré cet amendement si, après tout, ils est censé être le fruit d’une intense et mûre réflexion (hum !) de la part de ces élus de la République ? N’aurait-il pas dû être discuté au Sénat, quitte à exposer les véritables intentions populistes de certains, et faire l’objet éventuellement d’une motion tout à fait officielle ?
(Màj du 27/05/2015 : ) On pourrait tout aussi bien s’inquiéter de cette autre tentative d’amendement au projet de loi sur le Dialogue Social et l’Emploi, selon laquelle il s’agissait de faire surveiller les communications et les données de millions de chômeurs, sans contrôle judiciaire, dans le cadre de la lutte contre la fraude aux allocations. Un amendement qui, lui aussi, a été retiré une fois pointé du doigt par les journalistes.
En réalité, certains amendements proposés par les élus agissent comme des révélateurs d’un mécanisme malsain et latent, qui n’attendrait finalement qu’une occasion pour se montrer au grand jour. Les générations nées après guerre en France ont tendance à croire que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la Constitution de la République ont créé un mode de gouvernance normal et éternel que rien ne saurait remettre en question. D’où une confiance généralement aveugle envers les bonnes intentions des élus. Or, visiblement, il n’en est rien, et certains élus forment une classe dont l’objectif est de remettre systématiquement en cause les principes qui ont fait d’eux des représentants du peuple. C’est là qu’une part de ce qui constitue le totalitarisme entre en jeu. Une sorte de « côté obscur de la Force » finalement toujours présent dans n’importe quelle démocratie : le fait que les idéologies totalitaires soient le fruit d’un mouvement. C’est ce qu’avait très justement analysé Hannah Arendt dans son approche des Origines du totalitarisme : la réaction classique face à la faute totalitaire, c’est de vouloir identifier des responsables, des porteurs de croix ; or, ce qui caractérise vraiment cette faute, c’est la dilution des responsabilités à tous les niveaux y compris dans le peuple. Les fautes sont en effet partagées : d’un côté un mouvement latent, une peste qui couve et qui doit faire l’objet d’une vigilance permanente et, de l’autre, l’irresponsabilité, l’abandon des idéaux, et une majorité écrasante de citoyens qui ne se sentent plus concernés (d’aucun pourront argumenter avec raison qu’une part de cet abandon est aussi le fruit des vicissitudes des partis et des promesses électorales non tenues).
Et là, nous touchons à la principale cause de la prétendue non-réception des enjeux de la loi Renseignement auprès du grand public, malgré tous les efforts des associations et autres groupements les plus concernés, de La Quadrature du Net au Syndicat des avocats de France en passant par la Ligue des droits de l’Homme et Reporters Sans Frontières.
L’acceptation
La surdité du grand public peut s’expliquer selon plusieurs points de vue.
Complexité et dénigrement
Le fait que, de manière générale et pas seulement pour ce qui touche aux libertés numériques, il est toujours plus difficile d’expliquer en masse des idées complexes que des idées simples, en particulier lorsqu’il s’agit de réagir à la volonté de l’État. La cause de cette difficulté a déjà été expliquée par La Boétie dans son Discours de la servitude volontaire : c’est parce que le peuple a oublié sa liberté qu’il se soumet à l’absolutisme. Dans le cas qui nous concerne, les promoteurs de la loi Renseignement ont eu beau jeu de dénigrer les représentants pertinents de la société civile (mentionnés ci-dessus) qui leur opposaient de solides arguments techniques et juridiques, en les qualifiant de « geeks » séditieux (rappelant trop bien les « 5 gus dans un garage » de la loi Hadopi) et de colporteurs de fantasmes. Ils savaient parfaitement que les discours techniques et juridiques qu’ils avaient eux-mêmes des difficultés à comprendre, ne seraient pas entendus par le grand public non seulement à cause de leur complexité mais aussi et surtout parce qu’un travail de soumission de la population à la peur du terrorisme a été effectué en profondeur auparavant. On peut donc reconnaître que le discrédit systématique des détracteurs a été efficace non seulement auprès du grand public (passage télévision, radios nationales, etc.) mais aussi auprès des députés qui hésitaient encore malgré les invectives de leurs partis respectifs.
Unité, sécurité
Le fameux « esprit du 11 janvier » répété ad nauseam en guise de contre-argument à toute contradiction du parti majoritaire de l’Assemblée a aussi entretenu un discours de servitude : toute manifestation qui ne serait pas le fruit d’une communion générale et compassionnelle du peuple envers les dangers qui guettent la démocratie — dangers que seul le gouvernement serait à même de définir —, est comprise comme une atteinte aux intérêts de l’État et par conséquent peut même tomber sous le coup de la loi Renseignement. C’est là l’effet pervers de la dialectique faussée entre sécurité et liberté : en déplaçant l’enjeu sur le thème de la défense des citoyens au nom de la sécurité, le seul discours qui était alors acceptable devenait celui d’un choix artificiel entre le risque terroriste et la grande braderie des libertés. Tel fut en tout cas l’objet de certains sondages qui posaient la question « Êtes-vous prêts à restreindre un peu de votre liberté pour plus de sécurité ? ». L’impact de ces sondages fut dévastateur puisqu’une idée communément partagée en démocratie consiste à être persuadé que les élus du peuple ne feraient jamais rien qui puisse restreindre outre-mesure les libertés. Et nous revoici chez La Boétie.
Internet, c’est Google
Du côté des élus, il ne faudrait tout de même pas croire qu’un bloc monolithique a été formé en faveur de la loi. Une petite cinquantaine de députés a tout de même voté contre le projet. Mais parmi les élus il y a aussi une grande part des individus soumis comme tout le monde à la logique de la centralisation des données et aux mutations de la vie privée qu’implique l’économie numérique noyautée par les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft). Contrairement à l’analogie commune, il ne s’agit pas d’un Big Brother à la manière d’Orwell, mais plutôt, pour reprendre l’expression d’Alain Damasio, d’un Big Mother. Le Big Brother d’Orwell reflète la soumission des esprits à un contrôle totalitaire, alors qu’on ne peut qu’accepter de confier ses données privées à Big Mother en échange du bien-être qu’octroient tous ses services et son amour incommensurable. Par conséquent, si d’un côté les individus sont prêts à sacrifier leur anonymat et leur vie privée en échange des biens et services mercantiles, que ne le seraient-ils pas en échange de la sécurité de l’État ? C’est en tout cas l’approche régulière de beaucoup de nos députés qui, par un extraordinaire manque de compétence et d’analyse sont convaincus qu’Internet n’est autre qu’une somme de services proposés par les GAFAM et nullement l’outil aujourd’hui majeur de la liberté d’expression, de la créativité et du partage des connaissances et des techniques. Eux-mêmes sont donc soumis à Big Mother et, aveuglés par leur stupidité (qui, comme le disait Kant, n’est pas un mal mais un vice sans remède), n’en voient pas les dangers. Leur soumission doit alors s’imposer de la même manière à tous dans une sorte de résignation et d’indifférence générale.
Enfin, c’est aussi du côté de l’architecture d’Internet et de ses écosystèmes qu’il faut aussi effectuer un travail introspectif. C’est ce qu’a fait Eben Moglen lors d’une conférence intitulée « Pourquoi la liberté de pensée exige des médias libres ? ». L’Internet que nous voulons construire doit absolument intégrer la notion d’anonymat comme paramètre par défaut, contre les tentatives de contrôle. Tristan Nitot a sur ce point tout à fait raison lorsqu’il explique, à l’instar de Michel Foucault dans Surveiller et punir, la logique panoptique à laquelle nous devons désormais faire face : sans anonymat et avec une surveillance de masse (même potentielle, c’est la caractéristique panoptique) de nos données contrôlées par l’État, nous ne sommes plus capables de penser.
Déni démocratique
Alors quoi ? Le réquisitoire semble sans appel. Pour reprendre encore les mots de Hannah Arendt qui désigne l’origine du totalitarisme comme le fruit d’une « faillite du jugement et la démission de la conscience morale », tous les ingrédients semblent être réunis : incompétence des élus, simplification des débats et sophismes outranciers, dénigrement des experts et déni de démocratie (on passe la loi en procédure d’urgence pour couper court aux débats). Pourtant les consciences sont alertes : les associations ont effectué de belles tentatives d’explication aux élus (par mail et par téléphone) de manière organisée et argumentée. Et pourtant cette participation Ô combien civique des citoyens au débat public a été qualifié de « pressions » par le premier ministre lui-même. Il était alors certainement oublieux des représentants de consortiums industriels, pharmaceutiques et agro-économiques qui hantent les alcôves des bâtiments officiels et qui, eux, ont des moyens bien plus conséquents pour exercer leurs pressions et modeler les lois. Le simple fait de qualifier de « pressions » l’implication des citoyens, et parmi eux les plus experts en matière de technologies numériques et de réseaux, montre à quel point un fossé de plus en plus grand s’est ouvert entre élus et citoyens. Poncif. Tout le monde en avait déjà conscience. Mais ce qui est beaucoup plus curieux, c’est que ce fossé s’est aussi creusé entre les élus eux-mêmes. En effet, à chaque proposition d’amendement qui n’allait pas dans le sens des promoteurs du projet de loi, les mots du ministre de l’Intérieur furent tantôt sévères tantôt désobligeants, prétendant que les protagonistes n’avaient pas lu le texte ou se laissaient berner par des fantasmes. Accusations graves sur les bancs des députés, mais les réactions furent négligeables. Que dire en effet, lorsque toute contradiction est à ce point refusée ?
Le philosophe Paul Ricœur affirmait qu’on reconnaît une démocratie à partir du moment où elle peut intégrer ses propres contradictions. L’outil principal des dialogues contradictoires est justement la liberté d’expression sur la place publique. Or, si tout dialogue est refusé, que peut-on attendre d’autre d’une loi qui vise à restreindre la liberté d’expression au nom de la sécurité ? Le comportement du ministre de l’Intérieur n’était donc pas surprenant.
Vision simpliste de l’État
Il semble qu’à défaut de penchant totalitaire, nous ayons affaire à une forme de démagogie réactionnaire combinée à un abandon des responsabilités. Il serait trop simple, en effet, de faire appel au néologisme de démocrature, repris ici et là. La démocrature, en effet, est une démocratie tronquée : elle présente tout l’appareillage législatif d’une démocratie mais en pratique la classe politique ne ferait que promouvoir les intérêts de quelques uns. Concernant la loi Renseignement, on ne peut pas réduire la tentative de surveillance de masse à la défense d’intérêts particuliers (même si pour d’autres lois, on peut en effet se poser la question) : le projet de loi n’obéit ici qu’à trois principes :
- Donner un nouveau cadre à la lutte anti-terroriste (un mobile qui n’a jamais été remis en question par les détracteurs de la loi), et élargir cette lutte à d’autres « intérêts de l’État »,
- Organiser une surveillance de masse en prétendant que la sécurité (dont on n’évalue jamais le niveau d’efficacité) doit être assurée au prix d’une liberté d’expression limitée, c’est à dire un discours réactionnaire et paternaliste justifié par la croyance en l’insécurité permanente (« c’était mieux avant », « les temps ont changé, il faut s’adapter », « la récréation est terminée », etc.),
- L’abandon des responsabilités : les gouvernants s’en réfèrent à l’expertise (forcément biaisée) pour justifier les décisions, ce qui a pour effet de déresponsabiliser leur discours et de circonscrire toujours plus le rôle de l’État à la maintenance de l’ordre (la crise économique aidant, toute mesure de gouvernance est imposée par d’autres États auprès desquels il faut chercher modèle ; la sécurité est donc l’un des rares créneaux où nous pouvons agir par nous-mêmes).
Le Conseil de l’Europe fait la leçon
À l’approche de l’examen du projet de loi par le Sénat, le Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe s’est fendu d’une lettre claire et concise adressée aux membres du Sénat français. En substance, Nils Muižnieks rappelle que les droits de l’homme « ont subit les répercussions des mesures prises par divers états afin de lutter contre le terrorisme ». Il ajoute à l’intention expresse du Sénat français :
(…) Le rapport adopté par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 21 avril dernier a ainsi mis en évidence les menaces que la surveillance de masse fait peser sur le droit au respect de la vie privée et familiale, le secret des sources journalistiques ou encore le secret professionnel des avocats.
À cet égard, le projet de loi relatif au renseignement suscite de nombreuses inquiétudes (…).
En premier lieu le champ d’application extrêmement vaste de ce projet de loi, qui dépasse largement la lutte contre le terrorisme, est insuffisamment clairement circonscrit et risque de viser des activités dont la nature ne justifie pas le recours aux moyens de surveillance prévus par ce texte. Ces moyens sont, en effet, particulièrement intrusifs (…)
La délivrance d’un simple avis par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la possibilité d’y déroger en cas d’urgence ainsi que l’absence d’intervention de l’autorité judiciaire dans le processus décisionnel visant à la mise en œuvre des mesures de surveillance confèrent à l’exécutif une marge de manœuvre insuffisamment contrebalancée.
Quelle gifle ! En d’autres temps, nous nous serions rendus sur le pré en échangeant des politesses et des coups de sabres. Comment se fait-il qu’une aussi haute institution que le Sénat français fasse à ce point l’objet d’un tel rappel à l’ordre ? Tout ce se passe exactement comme si les idéaux de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen, dont la France s’enorgueillit tellement, étaient dévoyés par nos élus. Serait-ce donc aussi has been que de s’assurer que les droits de l’homme soient respectés par les lois, alors même que notre Déclaration est le fruit de près d’un siècle de travail des philosophes les plus illustres des xviie xviiie siècles ? À moins que justement il s’agisse d’une conception de l’État pré-révolutionnaire, comme s’il n’y avait plus d’autre action possible que de sauvegarder un pouvoir qui s’étiole, en particulier face à la mondialisation des rapports économiques, belliqueux, ou technologiques. Une sorte de gesticulation motivée par la peur de l’impuissance et un retour à une conception hobbesienne de l’État.
Retour du Léviathan
Thomas Hobbes fut l’un des premiers à avoir théorisé le rôle de l’État. Ce dernier agit comme le mythique Léviathan, unique et absolu, détenteur du pouvoir ultime avec lequel les individus passent un contrat (social) en échangeant leur liberté naturelle, source de conflit et de chaos, contre l’ordre et la sécurité. Pourquoi une telle vision apocalyptique d’un monde sans État puissant ? Tout simplement parce que Hobbes pensait à la violente guerre civile dont l’Angleterre se remettait à peine. C’est la peur qui a guidé la plume de Hobbes, tout comme la peur de perdre leur autorité (donc celle de l’État) dicte le discours des promoteurs de la loi Renseignement. Dans ce contexte, il est donc très important peur eux de réduire au maximum le rôle de la loi Renseignement à la sauvegarde de l’ordre établi, comme une surcouche aux autres lois existantes. Ainsi furent déclinés les intérêts de l’État autres que la protection des citoyens contre le terrorisme, lui-même vu (érigé ?) comme un embryon de guerre civile. Le résultat est que les intérêts ainsi défendus au détriment des libertés sont bien trop englobants, et ne laissent plus de place aux contradictions démocratiques, ce que souligne justement le Commissaire au droits de l’Homme du Conseil de l’Europe.
Mais Hobbes n’a fait qu’initier une discussion qui s’est étalée sur plus d’un siècle. Quelques années après la parution du Leviathan, ce furent Jean-Jacques Rousseau et John Locke (pour ne citer qu’eux) qui eurent l’intelligence de s’intéresser à la connaissance et à la raison dont sont loin d’être dénués les individus. Si donc l’individu est doté de raison et de connaissance, et donc de jugement, l’État ne règne pas en maître sur des individus écervelés prêts à s’étriper pour une pomme tombée de l’arbre. Oui, les hommes sont capables d’auto-gouvernance et, en termes modernes, on traduit cela par la capacité de la société civile à à se faire entendre. La société civile est non seulement capable d’expertise mais les institutions démocratiques sont ainsi faites qu’il ressort même de l’obligation du citoyen de faire valoir ce droit à exercer ce civisme. La manière dont fut votée la loi Renseignement à l’Assemblée nationale a montré que nos élus n’en sont restés qu’à Hobbes, dans une surdité totale face aux arguments de ceux qui, pourtant, sont les mieux placés pour juger de la recevabilité ou non d’une telle loi. Retour aux classiques, au moins jusque 1789.
Conclusion
Pour le dire simplement, le discours paternaliste ambiant doublé d’une conception étriquée du rapport entre liberté et sécurité, est forcément source d’un schisme qui ne tardera pas à éclater entre le gouvernement et la société civile. Cette prédiction n’est pas forcément un bon signe dans la mesure où l’abandon et l’irresponsabilité des élus a provoqué autant de frustrations de tous ordres dans une société en crise. En d’autres termes le schisme en question risque de ne pas être révolutionnaire (et pacifique) mais conflictuel. Le processus de la loi Renseignement cristallise une partie des grands maux qui sclérosent la vie politique française. Les effets seront dévastateurs pour la démocratie. Parmi les détracteurs de ce projet de loi figurent ce qu’on appelle des leader d’opinion. Ceux-ci auront bien raison de souligner la manière dont l’État français considère les libertés et en particulier parce qu’une partie non négligeable de la liberté d’expression et la puissance fédératives des idées (démocratiques ou non) se concrétisent aujourd’hui par la voie numérique. L’Europe serait-elle une dernière niche où, malgré les lobbies, le dialogue démocratique reste possible ? Les voix y sont en tout cas entendues, comme l’ont déjà montré, bien qu’au prix d’énormes efforts, les mobilisations contre Acta et les atteintes à la neutralité d’Internet, et encore en ce moment même à propos de la réforme du droit d’auteur. L’avenir peut nous réserver de belle surprises. Concluons en tout cas sur cette note positive, à défaut d’un grand désarroi.
26.04.2015 à 02:00
Entraînement trail, Oberhaslach-Schneeberg
Dans ma recherche de parcours d’entraînement trail situés à une distance raisonable de Strasbourg et présentant néanmoins des dénivelés intéressants, j’ai testé ce tracé hier, par un temps quelque peu changeant mais qui n’a pas empêché le plaisir des yeux. Le tout pour 20 km de distance et environ 900 m D+.
Je vous propose donc cette petite virée du côté de Oberhaslach, une commune qui par ailleurs accueille le Trail de la Hasel dont la prochaine et troisième édition est prévue le 27 juin 2015. Cela dit, le parcours n’est pas du tout celui que je compte vous présenter ici.
Description
Depuis Strasbourg, se rendre à Oberhaslach est très simple. Il suffit de prendre l’autoroute direction Molsheim puis Schirmeck. Une fois sur la D1420, bifurquer vers Niederhaslach/Nideck par la D392 puis la D218, Dans le centre de Oberhaslach, prendre à droite juste avant la mairie et monter quelques 200 mètres en suivant l’indication du parking (voir plan ci-dessous). Il s’agit du parking de l’école du village où vous aurez l’embarras du choix pour vous garer. Notez au passage la présence de la fontaine près de la mairie, au cas où un coup de brosse devrait s’imposer pour vos chaussures au retour.
Pour le résumer simplement, le parcours consiste à longer la Hasel pour une mise en jambe agréable, puis monter au Nideck (par le Hirschfels), rejoindre le Schneeberg, puis retour par le Col des Pandours, le Petit et le Grand Ringenfels. La carte, le profil et les photos figurent en bas de ce billet.
En guise de préparation, pour une course de printemps, on pourra prévoir un coupe-vent pour contrer les effets du Schneeberg (culminant à 966 m). La totalité du parcours est plutôt à l’abri de la forêt. Il offre plusieurs points de vue et, en tout, le Hirschfels, le Nideck, le Schneeberg, les vestiges Gallo-Romains du Petit Ringelfels et les ruines du château du Grand Ringelfels.
Commentaires sur les sections
Le parcours peut se diviser en 5 sections :
- Après avoir quitté les rues bitumeuses d’Oberhaslach, on longe la Hasel avec un dénivelé très faible (quelques 50 m D+). Ce qui a pour effet de provoquer un échauffement dont on se félicitera dès la première montée.
- Au Café du Nideck, le parcours commence par une montée assez longue, pour moitié sur chemin forestier large qui se transformera ensuite en sentier ombragé. Mon conseil, sur cette section, est de vous dépenser le moins possible malgré les effets d’un sentier a priori facile par moments. La montée principale n’est pas celle-là !
- C’est la montée vers le Schneeberg, depuis la maison forestière du Nideck, qui fera sentir son dénivelé le plus important. Le sentier est fort agréable, pierreux par moments et relativement régulier.
- La descente du Schneeberg au Carrefours Anlagen (en passant par le Col des Pandours) débute sur sentier étroit mais est composé en majorité de chemin forestier large. Il ne présente aucune difficulté technique sauf un peu de longueur largement compensée par la section suivante.
- Les deux Ringelfels sont des petits sommets offrant les mêmes difficultés techniques de part et d’autre. Il s’agit d’un endroit très intéressant pour un entraînement à la descente. Ces dernières sont en effet assez raides, l’une pierreuse et l’autre moins, mais avec un rythme soutenu. La prudence est de mise ! Les deux montées n’ont rien de particulier, à ceci près qu’elles constituent d’excellents indicateurs sur votre capacité à doser vos efforts sur les sections précédentes (ha, ha, ha !).
Le balisage
Le parcours peut se faire presque sans carte (mais je conseille de vous y référer de temps en temps). Ceci grâce au balisage du Club Vosgien.
- On rejoint les rectangles rouges du GR53 dès le centre d’Oberhaslach (au niveau du gymnase, à la sortie du village, prendre à gauche et monter dans le petit quartier pour rejoindre le chemin qui longe la Hasel). Jusqu’au Schneeberg, vous ne quitterez presque pas le GR53 sauf au niveau du Nideck.
- Un éboulement est signalé aux chutes du Nideck dès le début du chemin au Café du Nideck. Dès lors, le GR effectue une déviation, dûment balisée, en passant par le Hirschfels. Aucune déception, ce détour ne rallonge guère en distance et des roches intéressantes jalonnent le chemin.
- Au Nideck, vous serez tenté de suivre le GR53. N’en faites rien. En effet, celui-ci vous mènerait sur la route (D218) et vous seriez obligé d’arpenter le bitume jusque la Maison Forestière du Nideck. Au lieu de cela, empruntez les cercles bleus, jusqu’à la maison forestière, puis rattrapez le GR53 pour monter au Schneeberg. Attention à rester attentif au balisage : dans une petite pépinière sombre, le chemin bifurque brusquement à votre droite.
- Au Schneeberg, redescendez vers le col des Pandours en suivant les croix rouges. Vous croiserez un refuge, et c’est devant sa porte que vous devrez passer pour trouver les indications et reprendre le chemin (sans quoi on est assez facilement tenté de poursuivre tout droit vers un très beau point de vue, mais non prévu). De même peu après le refuge, le chemin se sépare en une patte d’oie serrée : avec votre élan, n’allez pas embrasser un épicéa, mais contentez-vous de suivre les croix rouges.
- Au Col des Pandours, empruntez ensuite les rectangles jaunes et blancs jusqu’au Carrefour Anlagen. Légèrement sur votre droite, vous trouverez les cercles bleus qui vous mèneront sur les deux Ringelfels (la montée démarre aussitôt).
- Après le château du Grand Ringelfels, poursuivez sur les cercles bleus jusqu’à croiser un chemin forestier. Vous devrez alors emprunter les disques jaunes sur votre gauche en contrebas du chemin. Vous les suivrez jusqu’au village.
Conclusion
Il s’agit d’un parcours, comme d’habitude, assez touristique, mais qui permet de s’entraîner efficacement à la montée sur des sentiers. En général, le parcours compte moins de 30% de chemin forestier large et très peu de bitume (maximum 500 mètres), ce qui est plutôt appréciable dans les Vosges.
Carte, profil et photos
Voir en plein écran | Cliquer sur « Plus » à gauche puis l’icône d’export pour télécharger le fichier du tracé (gpx, kml, geojson).
- Persos A à L
- Carmine
- Mona CHOLLET
- Anna COLIN-LEBEDEV
- Julien DEVAUREIX
- Cory DOCTOROW
- Lionel DRICOT (PLOUM)
- EDUC.POP.FR
- Marc ENDEWELD
- Michel GOYA
- Hubert GUILLAUD
- Gérard FILOCHE
- Alain GRANDJEAN
- Hacking-Social
- Samuel HAYAT
- Dana HILLIOT
- François HOUSTE
- Tagrawla INEQQIQI
- Infiltrés (les)
- Clément JEANNEAU
- Paul JORION
- Michel LEPESANT
- Persos M à Z
- Henri MALER
- Christophe MASUTTI
- Jean-Luc MÉLENCHON
- MONDE DIPLO (Blogs persos)
- Richard MONVOISIN
- Corinne MOREL-DARLEUX
- Timothée PARRIQUE
- Thomas PIKETTY
- VisionsCarto
- Yannis YOULOUNTAS
- Michaël ZEMMOUR
- LePartisan.info
- Numérique
- Blog Binaire
- Christophe DESCHAMPS
- Louis DERRAC
- Olivier ERTZSCHEID
- Olivier EZRATY
- Framablog
- Romain LECLAIRE
- Tristan NITOT
- Francis PISANI
- Irénée RÉGNAULD
- Nicolas VIVANT
- Collectifs
- Arguments
- Bondy Blog
- Dérivation
- Économistes Atterrés
- Dissidences
- Mr Mondialisation
- Palim Psao
- Paris-Luttes.info
- ROJAVA Info
- Créatifs / Art / Fiction
- Nicole ESTEROLLE
- Julien HERVIEUX
- Alessandro PIGNOCCHI
- Laura VAZQUEZ
- XKCD

