12.10.2018 à 02:00
Archéologie du capitalisme de surveillance
Avec le temps, cela devait finalement arriver. Me voici embarqué dans l’écriture d’un ouvrage à paraître chez C&F Éditions au printemps prochain. Une archéologie du capitalisme de surveillance, rien que cela. Mais c’est garanti, je ne me prendrai pas pour un penseur post-moderne (ils avaient tort !).
De quoi cet ouvrage va-il parler? D’abord le titre est tout à fait provisoire, qu’on se le dise. C’était juste pour vous faire cliquer ici. Blague à part, voici un petit argumentaire qui, je l’espère pourra vous faire patienter les quelques mois qui nous séparent d’une publication…
Christophe Masutti, Archéologie du capitalisme de surveillance, Caen, C&F Éditions, 2019 (à paraître).
Argumentaire
L’expression « capitalisme de surveillance » est employée le plus souvent non comme un concept mais comme un dénominateur, c’est-à-dire de l’ordre de la perception des phénomènes, de ceux qui nous font tomber de nos chaises presque tous les jours lorsque nous apprenons à quels trafics sont mêlées nos données personnelles. Mais il n’a pas été défini pour cela : son ambition est surtout d’être un outil, une clé de lecture pour comprendre la configuration politique et sociale de l’économie de la surveillance. Il faut donc mettre à l’épreuve ce concept et voir dans quelle mesure il permet de comprendre si l’économie de la surveillance obéit ou non à une idéologie, au-delà des pratiques. Certes, il faut donner une définition du capitalisme de surveillance (idéologique, pratique, sociale, collective, culturelle, anthropologique ou politique), mais il faut surtout en comprendre l’avènement.
Je propose dans ce livre une approche historique qui commence par une lecture différente des révolutions informatiques depuis les années 1960. Comment vient la surveillance? comment devient-elle un levier économique ? Il faut contextualiser la critique du contrôle (en particulier par les philosophies post-modernes et les observateurs des années 1970) telle qu’elle s’est faite dans la continuité de la révolution informatique. On peut focaliser non pas sur l’évolution technologique mais sur le besoin d’information et de traitement de l’information, tout particulièrement à travers des exemples de projets publics et privés. L’informatisation est un mouvement de transformation des données en capital. Cet ouvrage sera parsemé d’études de cas et de beaucoup de citations troublantes, plus ou moins visionnaires, qui laissent penser que le capitalisme de surveillance, lui aussi, est germinal.
Qu’est-ce qui donne corps à la société de la surveillance ? c’est l’apparition de dispositifs institutionnels de vigilance et de régulation, poussés par un débat public, politique et juridique, sur fond de crainte de l’avènement de la société de 1984. C’est dans ce contexte qu’au sein de l’appareillage législatif germèrent les conditions des capacités de régulation des institutions. Néanmoins la valorisation des données, en tant que propriétés, capitaux et composantes stratégiques, fini par consacrer l’économie de la surveillance comme modèle unique. Le marketing, la modélisation des comportements, la valeur vie client : la surveillance devient une activité prédictive.
Le capitalisme de surveillance est-il une affaire culturelle ? On peut le concevoir comme une tendance en économie politique, ainsi que les premiers à avoir défini le capitalisme de surveillance proposent une lecture macro-politico-économique (John Bellamy Foster, Robert W. McChesney, 2014). On peut aussi se concentrer sur les pratiques des firmes comme Google et plus généralement sur les pratiques d’extraction et de concentration des big datas (Shoshana Zuboff, 2018). On peut aussi conclure à une forme de radicalité moderne des institutions dans l’acceptation sociale (collective ?) de ce capitalisme de surveillance (on se penchera notamment sur les travaux d'Anthony Giddens puis sur ceux de Bernard Stiegler). Que peut-on y opposer ? Quels choix ? À partir du constat extrêmement sombre que nous allons dresser dans cet ouvrage, peut-être que le temps est venu d’un mouvement réflexif et émancipateur.
03.08.2018 à 02:00
Algorithmes: la bombe à retardement
Qui choisit votre université ? Qui vous accorde un crédit, une assurance, et sélectionne vos professeurs ? Qui influence votre vote aux élections ? Ce sont des formules mathématiques. Ancienne analyste à Wall Street devenue une figure majeure de la lutte contre les dérives des algorithmes, Cathy O’Neil dévoile ces « armes de destruction mathématiques » qui se développent grâce à l’ultra-connexion et leur puissance de calcul exponentielle. Brillante mathématicienne, elle explique avec une simplicité percutante comment les algorithmes font le jeu du profit. Cet ouvrage fait le tour du monde depuis sa parution. Il explore des domaines aussi variés que l’emploi, l’éducation, la politique, nos habitudes de consommation. Nous ne pouvons plus ignorer les dérives croissantes d’une industrie des données qui favorise les inégalités et continue d’échapper à tout contrôle. Voulons-nous que ces formules mathématiques décident à notre place ? C’est un débat essentiel, au cœur de la démocratie.
O’Neil, Cathy. Algorithmes: la bombe à retardement, les Arènes, 2018.
Lien vers le site de l’éditeur : http://www.arenes.fr/livre/algorithmes-la-bombe-a-retardement/
31.07.2018 à 02:00
Cyberstructure
Les outils de communication ont d’emblée une dimension politique : ce sont les relations humaines, les idées, les échanges commerciaux ou les désirs qui s’y expriment. L’ouvrage de Stéphane Bortzmeyer montre les relations subtiles entre les décisions techniques concernant l’Internet et la réalisation — ou au contraire la mise en danger — des droits fondamentaux. Après une description précise du fonctionnement de l’Internet sous les aspects techniques, économiques et de la prise de décision, l’auteur évalue l’impact des choix informatiques sur l’espace politique du réseau. Un ouvrage pour appuyer une citoyenneté informée, adaptée aux techniques du XXIe siècle et en mesure de défendre les droits humains
Bortzmeyer, Stéphane. Cyberstructure: l’internet, un espace politique. C&F éditions, 2018.
Lien vers le site de l’éditeur : https://cyberstructure.fr/
24.06.2018 à 02:00
Capitalisme de surveillance ?
Dans une série d’article intitulée Les Léviathans, j’ai longuement présenté le concept de capitalisme de surveillance développé par Shoshana Zuboff. L’interprétation reste toujours prisonnière de l’objet, au moins en partie : en l’occurrence, il y a une chose que je n’ai pas précisé dans ces articles, c’est la provenance du concept.
Les premiers à avoir formulé et développé le capitalisme de surveillance sont John Bellamy Foster et Robert W. McChesney en juin 2014 dans un article paru dans la Monthly Review, dont le titre devrait toujours être donné in extenso : « Surveillance Capitalism Monopoly-Finance Capital, the Military-Industrial Complex, and the Digital Age ».
Les lecteurs de Shoshana Zuboff noteront que cette dernière ne fait pas mention, dans ses articles, à la paternité du concept par Foster et McChesney. Du moins, elle n’a pas publié (à ma connaissance) une approche critique et comparative de son approche par rapport à celle de Foster et McChesney. La conséquence est que, au fil des affaires relatives aux usages déloyaux des données personnelles durant ces 3 ou 4 dernières années, le concept de capitalisme de surveillance a été sur-employé, parfois même galvaudé et transformé en un mot-valise. Pour celles et ceux qui ont cependant fait un effort d’analyse (tel Aral Balkan) le concept renvoie systématiquement aux travaux de Shoshana Zuboff.
Oserait-on accuser Zuboff de l’avoir usurpé ? pas tout à fait. On peut parler plutôt d’un emprunt. Le capitalisme de surveillance tel que le défini Zuboff implique bien d’autres éléments de réflexion. Quant à citer les auteurs qui les premiers ont énoncé le capitalisme de surveillance, oui, elle aurait pu le faire. Mais qu’est-ce que cela aurait impliqué ? L'éditorial de la Monthly Review de ce mois de juin 2018 apporte quelques éléments de réponse en confrontant l’approche de Foster-McChesnay et de Zuboff :
Zuboff a défini le capitalisme de surveillance de manière plus restrictive comme un système dans lequel la surveillance de la population est utilisée pour acquérir des informations qui peuvent ensuite être monétisées et vendues. L’objet de ses recherches était donc d’étudier les interrelations entre les entreprises et le comportement individuel dans ce nouveau système d’espionnage marchandisé. Mais une telle vision a effectivement dissocié le capitalisme de surveillance de l’analyse de classe, ainsi que de la structure politico-économique globale du capitalisme – comme si la surveillance pouvait être abstraite du capital monopolistique et financier dans son ensemble. De plus, l’approche de Zuboff a largement éludé la question de la relation symbiotique entre les sociétés militaires et privées – principalement dans les domaines du marketing, de la finance, de la haute technologie et de la défense – qui était au centre de l’analyse de Foster et McChesney.
Pour ce qui me concerne, les lecteurs des Léviathans (et j’espère un peu plus tard d’un ouvrage actuellement en gestation) pourront constater que j’extrapole assez largement la pensée de Zuboff, sans toutefois rejoindre l’analyse américano-centrée de Foster-McChesnay. Le point de basculement est somme toute assez pragmatique.
Le besoin de surveillance est un besoin viscéral de l’économie des biens et services (j’ai montré qu’il relève d’une histoire bien plus ancienne que le web 2.0 et remonte aux années 1950). La concentration des entreprises répond à un besoin d’optimisation des systèmes d’informations autant qu’au besoin de maîtriser le marché en le rendant malléable selon des stratégies bien définies, à commencer par les pratiques de marketing. Comment est-il devenu malléable ? grâce aux big datas et à l’usage prédictif du traitement des données. La concentration des capitaux est donc à la fois une conséquence de ce nouveau mode de fonctionnement capitaliste (qui enclenche parallèlement une autre approche du (néo-) libéralisme), et une stratégie calculée de recherche de maximisation des profits tirés des données conçues elles-mêmes comme un capital.
À mon humble avis, nonobstant l’approche concernant le complexe militaro-industriel de Foster-McChesney qui nous fait remonter à la Guerre du Vietnam tout en étant parfaitement explicatif des stratégies de surveillance des institutions gouvernementales (auxquelles finirent par se prêter les gouvernements d’autres pays du monde, comme en France ces dernières années), l’approche de Zuboff détache effectivement la question du capitalisme de surveillance de ses racines politiques pour se concentrer surtout sur les organisations et les comportements individuels soumis à une idéologie presque exclusivement économique. Ma part modeste à cette réflexion n’est pas d’entamer une histoire totale comme le feraient Foster et McChesney, mais d’aller directement au cœur du problème : la capitalisation de l’information comme nouvelle forme du capitalisme. C’est peut-être une approche (pseudo-) marxiste qu’il manque selon moi à Foster-McChesney pour mieux comprendre cette mondialisation du capitalisme de surveillance.
21.05.2018 à 02:00
Capitalisme de plateforme
Google et Facebook, Apple et Microsoft, Siemens et GE, Uber et Airbnb : les entreprises qui adoptent et perfectionnent le modèle d’affaires dominant aujourd’hui, celui des plateformes pair-à-pair du capitalisme numérique, s’enrichissent principalement par la collecte de données et le statut d’intermédiaire qu’il leur confère. Si elles prospèrent, ces compagnies peuvent créer leur propre marché, voire finir par contrôler une économie entière, un potentiel monopolistique inusité qui, bien qu’il s’inscrive dans la logique du capitalisme dit « classique », présente un réel danger aux yeux de quiconque s’applique à imaginer un futur postcapitaliste. Dans ce texte bref et d’une rare clarté, Nick Srnicek retrace la genèse de ce phénomène, analyse celui-ci de manière limpide et aborde la question de son impact sur l’avenir. Un livre essentiel pour comprendre comment les GAFA et autres géants du numérique transforment l’économie mondiale, et pour envisager des pistes d’action susceptibles d’en contrer les effets délétères.
Srnicek, Nick. Capitalisme de plateforme. L’hégémonie de l’économie numérique, Lux Éditeur, 2018.
Lien vers le site de l’éditeur : https://www.luxediteur.com/catalogue/capitalisme-de-plateforme/
01.05.2018 à 02:00
LibreOffice Writer, c'est stylé!
En ce début de printemps 2018, voici une traduction et adaptation d’un manuel sur LibreOffice Writer et (surtout) les styles ! LibreOffice Writer, c’est stylé! est une publication Framabook. Il s’agit d’un projet de longue date, que j’ai le plaisir de voir aboutir, enfin !
Halte aux manuels bourrés de procédures qui transforment les logiciels en cliquodromes. Pour changer, laissez-vous guider vers la compréhension des règles de mise en page et de la typographie, à travers l’usage des styles dans LibreOffice Writer. L’objectif est de vous aider à vous concentrer sur le contenu de vos documents, gagner en rapidité et en précision, tout en vous formant à l’automatisation de la mise en forme.
Cet ouvrage s’adresse aux utilisateurs débutants mais ayant déjà fréquenté un logiciel de traitement de texte. Quels choix de polices et d’interlignage devez-vous faire ? Comment créer des styles et les enchaîner correctement ? À quoi servent les styles conditionnels ? Paragraphes, listes, tableaux, titres, et hiérarchie des styles, toutes ces notions n’auront plus de secret pour vous. Voici un aperçu unique de LibreOffice Writer, de ses fonctionnalités importantes et de ses capacités.
Vous pouvez acheter, télécharger, consulter librement cet ouvrage sur Framabook.org.
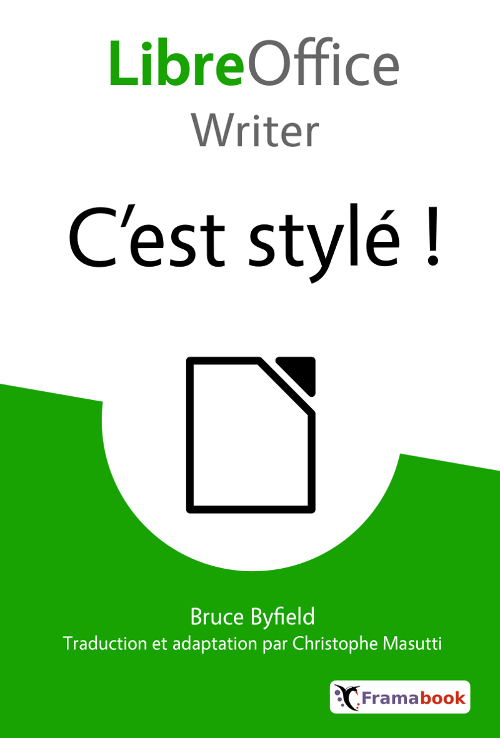
- Persos A à L
- Carmine
- Mona CHOLLET
- Anna COLIN-LEBEDEV
- Julien DEVAUREIX
- Cory DOCTOROW
- Lionel DRICOT (PLOUM)
- EDUC.POP.FR
- Marc ENDEWELD
- Michel GOYA
- Hubert GUILLAUD
- Gérard FILOCHE
- Alain GRANDJEAN
- Hacking-Social
- Samuel HAYAT
- Dana HILLIOT
- François HOUSTE
- Tagrawla INEQQIQI
- Infiltrés (les)
- Clément JEANNEAU
- Paul JORION
- Michel LEPESANT
- Persos M à Z
- Henri MALER
- Christophe MASUTTI
- Jean-Luc MÉLENCHON
- MONDE DIPLO (Blogs persos)
- Richard MONVOISIN
- Corinne MOREL-DARLEUX
- Timothée PARRIQUE
- Thomas PIKETTY
- VisionsCarto
- Yannis YOULOUNTAS
- Michaël ZEMMOUR
- LePartisan.info
- Numérique
- Blog Binaire
- Christophe DESCHAMPS
- Louis DERRAC
- Olivier ERTZSCHEID
- Olivier EZRATY
- Framablog
- Romain LECLAIRE
- Tristan NITOT
- Francis PISANI
- Irénée RÉGNAULD
- Nicolas VIVANT
- Collectifs
- Arguments
- Bondy Blog
- Dérivation
- Économistes Atterrés
- Dissidences
- Mr Mondialisation
- Palim Psao
- Paris-Luttes.info
- ROJAVA Info
- Créatifs / Art / Fiction
- Nicole ESTEROLLE
- Julien HERVIEUX
- Alessandro PIGNOCCHI
- Laura VAZQUEZ
- XKCD