
Abonnés Articles en accès libre Hebdo Articles
05.01.2025 à 11:47
Merde alors (puis, merde) – oser parler franchement de ce que nous faisons de nos inévitables merdes
L'Autre Quotidien

Texte intégral (3181 mots)

En octobre 2023, nous avons organisé une conférence internationale à SOAS qui a réuni des shitologues autoproclamés du monde entier. Intitulé avec goût « Merde Alors ! , notre conférence était organisée par le Centre d'études sur l'alimentation de l'école. Le programme était totalement interdisciplinaire et montrait clairement que la merde, dans toutes ses ramifications, était une question de préoccupation mondiale et de diplômes universitaires respectables.
Nous avions choisi le titre « Merde Alors ! parce que l’objet de nos études était littéralement inavouable dans une société polie. Pourtant, il était clair que nos interlocuteurs préféraient qu’on traite de merde. C'est pourquoi le lancement de ce volume à Londres a lieu en même temps qu'un événement festif spécial. Après discussion entre les participants à la conférence de 2023, la décision a été prise de créer une Journée mondiale de la merde, qui serait célébrée chaque année le 18 novembre. Le choix de la date est motivé. Elle arrive un jour avant la Journée mondiale de l'assainissement, désormais consolidée, instituée par les Nations Unies, le 19 novembre. Dès le premier jour, les problèmes sont identifiés ; le deuxième jour, les solutions sont explorées.
L’objectif de la Journée mondiale de la merde est avant tout de donner un nom à l’innommable et de le mettre en lumière comme un sujet propice au discours académique et activiste ; et deuxièmement, ouvrir toute la gamme des problèmes et des possibilités qui se posent à notre époque autour des questions excrémentives.
Des questions merdiques
Lorsque vous vous asseyez et commencez à cartographier la kagophobie dans notre société, toutes sortes d’histoires commencent à émerger. La collègue qui ne fait que chier dans sa propre salle de bain ou dans celle d'un ami très proche. L'autre, dont les fesses n'ont pas touché la lunette des toilettes depuis trois ans. Et l'amie qui a accompagné sa fille de cinq ans à son premier jour d'école. La petite fille a dit au professeur qu'elle voulait faire caca. La mère a été appelée après l'école et lui a dit que ce mot ne devait pas être utilisé et que l'enfant devait dire « caca » ou « numéro deux ».
Mais le capitalisme n’a pas peur des conneries. Depuis deux ans, les usagers du métro de Londres sont quotidiennement assaillis par des affiches à la con. La première était la campagne « Poonami » créée par Pampers Diapers, une figure bleue macabre géante d'une crotte entassée avec des yeux effrayants et fixes. Grand-mère ne fait plus de baby-sitting car la couche du bébé n'était pas étanche. La seconde, plus récente, exploite le fait que les Anglais sont une nation d’amoureux des chiens. La société Fresh commercialise à grande échelle une nouvelle marque de nourriture pour chiens à base de légume citrouille. Présentant le dos d'un chien, les publicités appellent le produit « The Poo-Improver » et constituent une solution contre la constipation du chien. Les clients se voient même proposer une version canine de la célèbre « Bristol Tabouret Table » pour surveiller le comportement de leurs chiens au quotidien. Il s'agit d'un tableau graphique montrant les différentes formes et consistances des crottes humaines, développé spécifiquement pour les médecins par l'hôpital universitaire de Bristol.
Même les grandes entreprises s’intéressent à la façon dont vous vous essuyez les fesses. Les experts en études de marché se souviennent de la psychose du papier toilette – achat de masse en panique – qui s’est produite au début du confinement dû au Covid. La société australienne « Who Gives a Crap » a lancé une grande campagne de vente de rouleaux de papier toilette au Royaume-Uni, une partie des bénéfices étant censée être reversée à des œuvres caritatives de développement du tiers monde. Et pendant un certain temps, les magnats ont commercialisé des lingettes humides, conçues sur mesure pour les musulmans britanniques soucieux de se conformer aux préceptes islamiques concernant le lavage à l'eau. (Les lingettes humides ont ensuite été interdites par le gouvernement parce qu'elles obstruaient les égouts du pays.)
La guerre à Gaza nous a donné l’occasion de transformer la merde en arme : le premier objectif de l’assaut israélien sur les territoires palestiniens était de toucher les installations d’égouts et d’assainissement, créant ainsi une crise de défécation devenue depuis horrible, avec des maladies de toutes sortes. Même dans les relations internationales, la merde suscite des inquiétudes. Au cours de l’été 2023, les journaux regorgeaient d’histoires sur la façon dont les compagnies d’eau privatisées de Grande-Bretagne déversaient des eaux usées brutes dans nos rivières, empoisonnant ainsi la faune et les baigneurs. Cela menaçait de déclencher une guerre transmanche, les ostréiculteurs du nord de la France affirmant que leurs parcs à huîtres soigneusement préservés étaient menacés par la pollution.
Les Français aiment le faire au sens figuré. Lors des grèves générales de 2023 contre la politique des retraites du président Macron, des villes partout en France ont été placardées d'affiches indiquant « Nous sommes dans la merde ». Mais la question est également devenue matériellement urgente. A l’approche des Jeux olympiques de 2024, le président Macron a promis d’assainir la Seine, jusqu’ici impénétrable, pour que les compétitions de natation puissent s’y dérouler. Il a même proposé de se baigner lui-même dans la Seine, pour démontrer sa propreté. Mais il a dû abandonner son projet lorsque des militants ont lancé un site Internet appelant les Parisiens à faire caca dans la rivière en guise de protestation contre son gouvernement.
Toilettes publiques
Il est intéressant de noter que la dernière fois que la conscience de la merde s’est manifestée en Grande-Bretagne, c’était sous le régime Thatcher. À cette époque, la gauche était si complètement dépossédée de son pouvoir que les conversations au dîner se concentraient avec insistance sur le scandale des crottes de chiens dans les rues, la seule chose sur laquelle la gauche pouvait exercer son pouvoir.
En Inde cependant, la merde a été un enjeu électoral majeur, avec la campagne du Premier ministre Modi contre la « défécation à l'air libre ». Le manque de toilettes publiques oblige les pauvres à faire leurs besoins dans la rue. Une récente vidéo parodique montre un énorme réservoir d'eau, avec un canon monté et des opérateurs masqués, traversant les rues d'une grande ville. Dès qu'ils voient quelqu'un pisser contre un mur, ils le frappent avec le canon. L'intention est humoristique, mais elle pose une vraie question : si les gens pissent dans la rue, à qui la faute, les pauvres ou les pouvoirs publics qui n'agissent pas ?
A Londres, on déplore la disparition de ces temples de cuivre, de laiton et de marbre qui constituaient les services publics de la ville. À Cambridge, qui abrite l'université la plus grande et la plus riche du monde, si vous voulez vous soulager et ne pas faire partie de l'élite privilégiée du collège, vous devez endurer une série de trous de pisse minimalistes à la gare routière locale, où la puanteur est si puissant qu'il nécessite un masque à gaz. Et en Finlande, comme le rapporte notre amie shitologue Justyna :
« Toutes les toilettes publiques devraient être gratuites !!! J'ai remarqué que les chiens ont plus de liberté ! Ils peuvent faire pipi n'importe où ! Mais si je fais pipi dans le parc, je dois payer une amende ! Où est la justice ? Dans certains endroits, les toilettes coûtent une livre ! Et en Finlande, vous ne payez que par carte de crédit ! Je n'avais pas de carte de crédit, seulement du liquide, donc j'ai dû me faufiler pendant que quelqu'un sortait des toilettes !
Ce n'est pas drôle. C’est un sujet de grave préoccupation sociale. Les personnes âgées, les pauvres et les sans-abri de nos villes sont contraints de suivre des régimes de rétention d'urine nocifs pour le corps humain. Et – comme l’a documenté le projet OVERDUE en Afrique – les tabous liés aux toilettes sont profondément liés au genre. Ils touchent les femmes de manière disproportionnée par rapport aux hommes. Pour donner un petit exemple : en 2021, au Centre pour femmes de la « jungle » migrante de Dunkerque, dans le nord de la France, des bénévoles ont remarqué que des couches jetables gratuites étaient également demandées par les femmes qui n'avaient pas d'enfants. Il s’est avéré qu’elles voulaient des couches pour elles-mêmes parce qu’elles avaient trop peur d’aller aux toilettes la nuit par peur d’être attaquées ou violées.
Assez bon pour manger
Toutes les cultures ne se méfient pas de la merde. Comme le dit un proverbe marocain, « la merde des uns est la fabrique du bonheur des autres ». Alfred Jarry propose une perspective amusante sur ce sujet dans son Ubu Roi :
Père Ubu : Eh bien, capitaine, avez-vous bien dîné ?
Capitaine Bordure : Fort bien, monsieur, sauf la merdre.
Père Ubu : Eh ! la merdre n'était pas mauvaise.
Mère Ubu : Chacun son goût . [1]
Aristophane est tout aussi franc. Dans sa pièce Peace, deux serviteurs broient un grand bol de merde pour nourrir le bousier que leur maître a acheté pour voler vers le ciel et parler aux dieux. Il exhorte le public à ne pas chier ni péter pendant les trois prochains jours, au cas où le scarabée serait distrait de sa mission.
Gulliver, au cours de ses voyages, s'est retrouvé à rencontrer les corps sales et remplis d'excréments de Yahoos. A Lilliput, Gulliver chie sur le sol de sa maison lilliputienne et pisse sur le palais en feu des Lilliputiens. Jonathan Swift nous livre « Celia Caga » – quelle découverte littéraire ! Et les mignonnes de William Burroughs se balancent aux lustres et merdent sur les gens. De même et ibidem : « Un coprophage demande une assiette, chie dessus et mange la merde en s'écriant : 'Mmmm, c'est ma riche substance' ».
Selon un commentateur, c’est Martin Luther qui se faisait les intestins dans la tour des latrines du monastère qui nous a donné l’éthique protestante. Et puis, alors qu'il sentait la mort approcher, il dit : « Je suis comme une merde mature et le monde est une crotte géante. Nous allons probablement bientôt rompre tous les deux." Il se défend du péché en jetant de la merde au diable. Et bien sûr, nous devons nous rappeler les racines et les origines de notre civilisation actuelle dans l’interprétation freudienne : Argent – merde – accumulation – capitalisme.
La merde dans nos rivières
Je dois déclarer un intérêt personnel pour les questions merdiques. À Pâques, j'ai reçu une dose de la bactérie Escherichia coli en mangeant des huîtres crues dans une rivière du Devon. Le corps fait un travail remarquable pour évacuer les substances indésirables du dos. Trois jours qui méritaient une étude scientifique, pour ne pas dire philosophique. Cependant, le fait marquant était que j'avais mangé des choses qui sortaient des fesses de quelqu'un. Comme l'ancien rameur d'Oxbridge l'a découvert en pagayant sur le cours supérieur de cette rivière, c'est assez facile à faire ; il y avait, rapporta-t-il, des crottes humaines flottant dans l'eau. South West Water a pour politique de rejeter les eaux usées humaines brutes et non traitées dans la rivière en cas de fortes pluies.
En conséquence, les bancs de coquillages de la rivière ont été déclarés les plus pollués du pays et la South West Water a été mise en cause. Demandez à Barry Sessions, le dernier ostréiculteur de la rivière, ce qu'il pense de tout cela. L'Agence de l'Environnement vient de fermer son exploitation ostréicole (« mesure de précaution hivernale ») et il risque de perdre ses moyens de subsistance. Comme le souligne l’auteur, le problème ne vient pas des huîtres, mais des gens qui permettent que ces déchets soient déversés dans nos rivières.
En regardant les rivières anglaises – propriété de la Couronne – et les immondices dont elles regorgent, on pourrait réfléchir aux paroles du maître de la shitologie et du plus prolifique des scatologues, William Burroughs :
Que Dieu sauve la Reine et un régime fasciste… un fascisme flasque et édenté, bien sûr. La Reine stabilise l’ensemble des toilettes lavabos et maintient au sommet une petite élite de riches et de privilégiés. Les Anglais sont devenus mous dans les toilettes. L’Angleterre est comme une bête frappée, trop stupide pour savoir qu’elle est morte. Il s’enfonce sans gloire dans ses propres déchets, les réactions négatives et le karma négatif de l’empire .
Et pendant ce temps-là, nous nageons parmi les crottes flottantes...
Personne ne peut nous dire que la merde n'a pas d'importance. Et c'est pourquoi nous publions les actes du colloque [2] . Notre mission, en bref, est d'encourager nos lecteurs à un esprit d'audace, d'exploration et d'expérimentation sur ces questions.
Il a fallu 12 mois de travail pour préparer ce livre. Les objets ont été collectés assidûment, un processus qui impliquait quelques coups de fouet. Ils étaient introduits dans la machine de montage, où ils pénétraient dans l'intestin interne pour être rendus digestibles. Il est maintenant temps d'appuyer sur le bouton et d'envoyer le livre à l'imprimeur. Le sentiment et la satisfaction, si vous me pardonnez, sont ceux d'un grand vous savez quoi.
Pour conclure, nous pouvons seulement dire que nous espérons que ce volume vous apportera du plaisir et un certain intérêt académique. Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger ici des chapitres individuels de notre site Web .
Vous y trouverez également des détails sur notre prochaine SOAS Shit Conference. Il est prévu pour fin octobre 2025 et sera hébergé par le Food Studies Centre de SOAS et la Bartlett Development Planning Unit (DPU) de l’University College London (UCL). Nous espérons vous y voir.
PS : Une note supplémentaire. Pour ceux qui pensent que les questions sur la merde sont à distance de sécurité de notre vie personnelle, nous pourrions ajouter que lors de l’épidémie de Covid, les autorités de l’État ont découvert que la surveillance des merdes dans les réseaux d’égouts constituait un moyen utile d’identifier les agents pathogènes à la source. Puis ils se sont vite rendu compte que cette technique pouvait être appliquée à d’autres problématiques, par exemple la consommation de drogues chez les étudiants en résidence universitaire. En bref, le long bras de l’État s’étend, via le réseau d’égouts, jusqu’à vos toilettes personnelles.
Ed Emery
REMARQUES
[1] (trad.) Père Ubu : Alors, capitaine, avez-vous bien dîné ?
Capitaine Bordure : Très bien, monsieur, sauf la merde.
Père Ubu : Eh bien, cette merde n'était pas mauvaise.
Mère Ubu : À chacun son goût.
[2] Ed Emery (éd.), The SOAS Shit Reader : Actes de la conférence 'Merde Alors ! – Une conférence interdisciplinaire sur les excréments, passé, présent et futur , SOAS, Université de Londres, 21-22 octobre 2023, Red Notes, Londres, 2024
17.11.2024 à 18:52
Quand la langue déraille : Olivier Mannoni contre les langues brunes
L'Autre Quotidien

Texte intégral (948 mots)

La provocation n'est plus ce qu'elle était. Naguère, elle servait à faire sortir le loup du bois, à obliger des personnes ou des opinions à se sentir attaquées et donc à monter au front. La provocation appelait le dialogue sous forme de conflit. Elle aimait l'excès, voire la mauvaise foi, mais obéissait à une stratégie indéniable. Provoquer les extrêmes, provoquer les mous, bref, remuer/bousculer.
Cette période semble terminée. Désormais, la provocation ne cherche plus à faire sortir ses cibles de leurs gonds, car il n'y a plus de gonds; désormais, la provocation n'a plus qu'un seul objectif: vérifier que la réaction soit tarde, soit n'arrive pas, soit n'est pas à la hauteur, autrement dit, elle essaie de pousser toujours plus loin le bouchon. On comprend donc à quel point l'extrême droite en raffole. Aller toujours plus loin dans l'absurde, l'ignoble, le faux ou le stupide. Et se délecter de voir que plus c'est gros, plus ça passe. Ce qui compte ce n'est plus l'éventuelle (et médiocre réaction) mais la seule valeur de la provocation. La provocation prouve qu'elle peut provoquer, et ça suffit.
Prenez Onfray. Ayant appris que la SNCF refusait de faire la promo du livre de Bardella, il ose une analogie aussi bête que basse en disant que les syndicats ferroviaires de gauche n'avaient pas franchement sauvé les Juifs pendant la guerre. La provocation se loge ici dans un étrange étonnement: Pourquoi, nous dit-il, sincèrement stupéfait, les agents de la SNCF ont-ils sympathisé avec la machine de guerre nazie, mais refuse aujourd'hui de tapisser les murs des gares avec la tête de Bardella?
On ne sait plus si Onfray accuse Bardella d'être nazi ou s'il reproche aux agents (de gauche) de la SNCF d'avoir favorisé la Shoah. Ou alors il veut nous dire que Bardella est comme un train s'enfonçant dans la nuit et le brouillard. Ou alors il veut dire que puisqu'ils ont laissé faire les Nazis, il n'y a pas de raison pour qu'ils interdisent d'affichage Bardella? Onfray a visiblement un problème d'aiguillage dans ce qui lui sert de pensée. Il cherche sans doute juste à épater avec de la pâtée verbale. Reconnaissons que son raisonnement se mord une queue qui peine à se dresser bien haut. Son "propos" se présente comme un argument alors qu'il n'est qu'une insulte.
Le mieux, si on veut comprendre d'où viennent de telles déclarations fétides, c'est de lire l'essai d'Olivier Mannoni, Coulée brune, un ouvrage dans lequel le grand traducteur qu'est l'auteur s'attache à pointer la filiation entre la langue du Troisième Reich et ses avatars contemporains, en passant par Sarkozy, Macron, la dérive fasciste des Gilets jaunes, les délires des antivax et les culbutes des complotistes jusqu'à ces dangereux pitres que sont Hanouna, Soral et consorts. Vider le langage de toute substance, tordre la grammaire, vriller la logique, affirmer le faux, se lâcher dans l'odieux et l'ordure, faire passer une crasse provocation pour de l'antique indignation.
Que fleurissent mille couvertures du livre de Mannoni dans nos gares! Qu'on l'enseigne au lycée ! Et qu'on arrête de tendre des micros aux bouche-dégoût.
__________________________
Claro, le 18/11/2024
Olivier Mannoni, Coulée brune – comment le fascisme inonde notre langue, éd. Héloïse d'Ormesson, 16 euros
01.10.2024 à 19:34
Franco Bifo Berardi : Destin manifeste, effondrement de l’occident et guerre en vue
L'Autre Quotidien

Texte intégral (3934 mots)

Jull Takaliuang, coordinateur du groupe d'îles Save Sangihe, luttant contre la mine d'or © Save Sangihe island
Récemment, en parlant de la défaite de Kaboul, il m'est arrivé d'écrire que les USA sont finis, car le pays n'a pas de président, puisque Biden, s'il a jamais existé, a été anéanti par la gestion de la retraite d’Afghanistan. Car il n'y a pas un peuple mais deux et en guerre les uns contre les autres. Parce que les alliés fondent, parce que la Chine est en train de gagner la bataille diplomatique et aussi la compétition économique.
C'est vrai, mais j'ai oublié quelque chose qui n'est pas secondaire : l'Amérique est aussi un complexe techno-militaire doté d'un pouvoir destructeur capable de détruire la planète et d'éliminer l'humanité non pas une mais plusieurs fois. Et il se rend aussi capable d'initier l'évacuation d'une petite minorité d'humains de la planète Terre, pour aller là où personne ne sait.
La défaite afghane marque le tournant d'un processus de désintégration de l'Occident dont les signaux se sont accumulés au cours des deux dernières décennies.
Ici, j'utilise le mot Occident pour désigner une entité géopolitique qui correspond au monde culturel judéo-chrétien (et inclut donc la Russie elle-même).
Peut-être que le capitalisme est éternel, (hypothèse à vérifier si nous avons le temps mais je ne pense pas que nous le ferons). L'Occident ne l’est pas. Et malheureusement le complexe techno-militaire dont l'Occident dispose, et qui continue de s'alimenter malgré sa capacité à surexploiter, ne répond pas à la logique du politique, mais est un automatisme qui répond à la logique de la dissuasion qui avait autrefois un bipolaire et symétrique alors qu'après l'effondrement de l'URSS, elle a un caractère multipolaire, asymétrique et donc interminable. Par ailleurs, le complexe techno-militaire est aussi une puissance économique qui doit produire la guerre pour se reproduire.
C'est pourquoi l'effondrement de l'Occident ne doit pas nous mettre de bonne humeur, ou du moins pas tant : l'effondrement de l'Occident ne sera pas un processus (presque) pacifique comme le fut l'effondrement de l'empire soviétique entre 1989 et 1991. . . .
Avant de s'effondrer, l'Occident pourrait effacer le monde non pas parce que le cerveau politique atteint d'une nécrose évidente le décide, mais par automatisme. L'Italie, malgré l'article 11 de la Constitution, et bien qu'étant une puissance militaire de second rang, ne dispose que de 15 avions anti-incendie, alors qu'elle dispose de 716 avions de combat. Qu'est-ce qu'on en fait ? Pourquoi l'Italie investit-elle énormément dans un avion de chasse appelé Tempest, avec l'Allemagne et l'Angleterre ?
Ouais pourquoi?
Maintenant, après une nouvelle défaite que l'Occident (OTAN, USA, Europe) a subie dans une guerre conventionnelle, il est naïf de penser que l'Occident renonce à la guerre.
Par conséquent, l'Occident sera bientôt conduit dans une guerre non conventionnelle.
Le capitalisme n'est plus en mesure de permettre la reproduction de l'humanité, l'expansion a atteint son apogée et désormais la valorisation capitaliste se fait essentiellement par l'extraction de ressources physiques et nerveuses désormais au bord de l'épuisement, et par la destruction de l'environnement physique planétaire. À ce stade, deux perspectives s'ouvrent : celle de la dissolution du capitalisme et l'établissement progressif de communautés sécessionnistes autonomes, égalitaires et frugales. Ou la guerre. Ou plus probablement les deux points de vue en même temps.
Ce qui est certain, cependant, c'est l'incapacité de l'Occident à accepter ce qui est désormais son destin manifeste : déclin, dissolution, disparition.
Le suprématisme nazi-libéral
L'effondrement de l'Occident fait partie de certains processus que l'on peut désormais distinguer à l'œil nu : le premier est l'infertilité croissante des peuples du nord du monde (en 50 ans la fertilité des hommes s'est effondrée de 52%). Que cela soit dû, comme le soutient Sarah Swan dans son tout récent livre Count Down, à la diffusion des micro-plastiques dans la chaîne alimentaire, et aux troubles hormonaux causés par les micro-plastiques, ou que cela soit dû au choix plus ou moins conscient des femmes de ne pas donner naissance à des victimes d'un incendie mondial qui se propage rapidement n'a pas d'importance.
Le second processus est l'émergence de puissances capitalistes anti-occidentales (la Chine) qui pour des raisons inscrites dans la formation psycho-cognitive s'adaptent plus facilement à la dynamique de l'essaim avec laquelle l'individualisme occidental entre en conflit. (voir à ce propos le livre de Yuk Hui récemment publié en italien par Nero edizioni sous le titre Cosmotecnica ).
Le troisième est la crise mentale, le mépris de soi et la pulsion suicidaire de la population blanche, incapable de faire face à la grande migration qui est une conséquence de la colonisation à l'ère de la mondialisation, et qui par vagues successives sape l'ordre mondial. (Peut-être vaudrait-il la peine de relire et de mettre à jour certaines des considérations de Mao Tse Tung et Lin Piao sur les périphéries entourant et étranglant le centre).
La population européenne est incapable de faire face à la migration car elle défend bec et ongle le privilège des blancs et refuse de reconnaître la nécessité d'un retour des ressources volées et d'une acceptation inconditionnelle. Il est clair que ces deux conditions - restitution et acceptation - ne sont pas compatibles avec le maintien du privilège colonial qui, loin de se retirer, n'a cessé de se renforcer.
La gauche européenne a toujours refusé d'admettre le caractère radical de ce grand phénomène migratoire, elle en a minimisé la force perturbatrice, lorsqu'elle n'a pas embrassé les positions de la droite, comme dans le cas de la politique libyenne de Minniti et de la lâcheté du Parti Démocrate sur la question du doit du sol.
L'Occident résiste donc au déclin inévitable, et cette résistance se manifeste avec le renforcement des mouvements néo-réactionnaires, la réponse identitaire des peuples dominants que nous identifions comme l'Occident.
Achille Mbembe définit cette défense agressive du privilège blanc par l'expression "eurocentrisme tardif".
« À notre époque, il est clair que l'ultranationalisme et les idéologies de suprématie raciale connaissent une renaissance mondiale. Ce renouveau s'accompagne de la montée d'une extrême droite dure, xénophobe et ouvertement raciste, qui est au pouvoir dans de nombreuses institutions démocratiques occidentales et dont l'influence se fait aussi sentir au sein des différentes strates d'une même techno-structure. Dans un environnement marqué par la ségrégation des mémoires et leur privatisation, ainsi que par les discours sur l'incommensurabilité et l'incomparabilité de la souffrance, la conception éthique du prochain comme autre soi ne tient plus. L'idée d'une ressemblance humaine essentielle a été remplacée par la notion de différence, prise comme anathème et ban... Des concepts tels que l'humain, la race humaine, l'humanité ont peu de sens, même si les pandémies contemporaines et les conséquences des combustions en cours sur la planète continuent de leur donner du poids et du sens.
En Occident, mais aussi dans d'autres parties du monde, on assiste à la montée de nouvelles formes de racisme que l'on pourrait qualifier de paroxystiques. La nature du racisme paroxystique est que, de manière métabolique, il peut infiltrer le fonctionnement du pouvoir, de la technologie, de la culture, de la langue et même de l'air que nous respirons. Le double virage du racisme vers une variété techno-algorithmique et éco-atmosphérique en fait une arme de plus en plus meurtrière, un virus.
Cette forme de racisme est qualifiée de virale car elle va de pair avec l'exacerbation des peurs, dont et surtout la peur de l'extinction, qui semble être devenue l'un des moteurs de la suprématie blanche dans le monde.
( Notes d'Achille Mbembe sur l'eurocentrisme tardif )
Plutôt que l'eurocentrisme tardif, je préfère appeler le mouvement réactionnaire actuel : “suprématisme nazi-libéral”, car le privilège colonial est la jonction entre le darwinisme social libéral et les politiques d'extermination d'Hitler : la sélection naturelle.
Mission accomplie
Je suis curieux de voir les prochaines célébrations du vingtième anniversaire de l'attaque islamiste contre les tours de Manhattan, mais peut-être qu'il n'y aura pas de célébrations, ils feront comme si de rien n'était. Peut-être ne sera-t-il pas écrit dans les journaux "nous sommes tous américains" comme le jour où Bush a déclaré la guerre à l'Afghanistan, parce que l'Amérique a perdu.
La défaite au Vietnam a été un drame national, la défaite afghane n'égratigne pas la conscience américaine car la population américaine est incapable de voir l'échec en raison de l'épidémie de démence sénile qui la saisit.
Mais la défaite au Vietnam n'était pas terminale, la défaite en Afghanistan l'est. Alors qu'ils restent la plus grande puissance militaire de tous les temps, les États-Unis n'ont plus qu'une chose essentielle : eux-mêmes. Il n'y a plus les États-Unis d'Amérique. Ils sont au moins deux, en lutte acharnée. Ainsi, alors que l'incendie brûle une zone de plus en plus vaste du territoire et se rapproche des mégalopoles, tandis que les fusillades psychotiques se succèdent quotidiennement, le pays n'a plus de gouvernement au pouvoir et n'en aura plus jamais.
La victoire d'Oussama ben Laden est désormais définitive, et les victoires de tous les grands dirigeants de l'histoire passée sont pâles en comparaison, car Ben Laden a vaincu les deux plus grandes puissances de tous les temps : l'URSS et les États-Unis. Ce qui est arrivé à l'Union soviétique après la défaite afghane est bien connu. On attend maintenant ce qui va arriver aux Etats-Unis et il est légitime d'espérer que les effets seront tout aussi définitifs. La société américaine est irrémédiablement divisée, en route vers un processus de désintégration sociale, culturelle et psychique. La guerre civile n'est pas politique, mais quotidienne, moléculaire, omniprésente.
Peut-on alors espérer que l'effondrement de la puissance américaine restitue l'humain à l'humain ?
Je crains que non car cet effondrement est tardif : l'Amérique a déjà largement accompli sa mission, qui n'était pas d'établir le royaume de la démocratie, comme on nous l'a dit, mais de détruire l'humanité.
John Sullivan a forgé l'expression Manifest Destiny pour définir la mission civilisatrice des idéalistes américains (mais les chefs des SS n'étaient-ils pas les propagateurs de la joie de la race supérieure allemande ?). Cette mission était d'apporter la liberté dans le monde, ou plus réalistement de transformer la vie humaine en une simple articulation de la domination absolue du capital.
Les étapes de ce processus : accumulation primitive basée sur l'esclavage, et sur le génocide. Intensification constante de la productivité des exploités par la déshumanisation systématique des rapports sociaux.
Cette mission est accomplie.
Alors que certaines grandes entreprises (Big Pharma, Amazon, big finance) font aujourd'hui des profits sans précédent, augmentant leurs revenus chaque jour, la psychose s'empare de l'esprit collectif, la dépression sévit, les armes de guerre en vente libre tuent chaque jour des malheureux, les salaires sont diminue, les conditions de travail sont de plus en plus précaires, et pendant ce temps les forêts brûlent, et les villes sont des pièges sans plus d'espoir.
Le but des guerres américaines n'était pas de gagner. C'était détruire les conditions de vie, et réduire les vivants à des fantômes insensés comme ceux qui parcourent désormais les métropoles du monde.
En 1992, le premier sommet sur le changement climatique s'est tenu à Rio de Janeiro. A cette occasion, le président américain, George Bush père, a déclaré que "le niveau de vie des Américains n'est pas négociable".
Le niveau de vie des Américains consiste à consommer quatre fois plus d'énergie que la moyenne des habitants de la planète. Il s'agit d'une boulimie psychopathique qui produit l'obésité et l'agressivité acquisitive.
Elle consiste à consommer de la viande en quantités folles. Etc.
Le consumérisme et la publicité commerciale ont peut-être été la contribution la plus décisive du peuple terminal à la destruction des conditions d'habitabilité de l'environnement planétaire.
L'extermination de l'humain est intrinsèque au caractère néo-humain du protestantisme puritain dont est née l'idée du Destin Manifeste .
L'essaim chinois
Au XXIe siècle, le destin manifeste des USA est devenu l'annulation de l'impureté conjonctive, la pleine réalisation du projet de numérisation intégrale et de connexion du biologique au sein du flux néo-humain.
Maintenant que ce projet d'automatisation intégrale est en cours d'achèvement, mais à cause d'une blague inattendue (le destin est cynique et tricheur), les Occidentaux ne l'apprécieront pas (pour ainsi dire). Ce sera selon toute vraisemblance un peuple à la fois plus patient et moins individualiste, voire un peuple qui fonctionne comme un organisme cognitif unifié, et ne connaît pas dans son vocabulaire le mot le plus trompeur de tous, le mot « liberté ».
L'Occident est la sphère dans laquelle s'est établie la machine mondiale du capital, et cela est indissociable du changement de nature de la technologie.
Dans l'histoire précapitaliste, la technique s'est développée comme une modalité structurée et fonctionnelle de l'objet manipulé par l'homme. Mais au cours de l'évolution moderne du mode de production capitaliste technique, il devient le cadre opératoire à l'intérieur duquel l'homme est contraint d'agir et dont il n'est pas conscient de sortir.
A partir de Heidegger, le penseur chinois Yuk Hui désigne dans le mot Gestell la clef de voûte de la transformation de la technique en facteur de mutation de l'humanité en Automa cognitif. La technique établit une Gestalt au sein de laquelle l'action humaine est de plus en plus pré-ordonnée, au point de fonctionner comme un essaim.
La mutation technologique qu'a connue son laboratoire en Californie et son territoire d'expérimentation en Occident est venue asseoir le modèle « néo-humain », l'homme formaté, compatible, connecté, le modèle essaim dans lequel les mouvements des individus sont animés par un cerveau unique, dont dépendent les cerveaux individuels.
Mais l'expérimentation de l'automate en Occident ne fonctionne que partiellement, pour des raisons qui sont liées aux particularités culturelles et psychiques du processus d'individuation dans la sphère occidentale : la base cognitive commune, liée à l'apprentissage des langues, est mince et la résistance aux model -swarm est très élevé.
Il semble fonctionner beaucoup mieux dans le domaine des langues idéographiques, en premier lieu la Chine, où le processus d'individuation a des caractères différents, car la base cognitive commune est double : l'apprentissage de la langue parlée et de la transcription idéographique.
L'esprit chinois s'intègre plus facilement grâce aux différentes caractéristiques du processus d'identification (acquisition du langage, double moulage neuronal, adhésion facile au modèle de l'essaim).
Qu'est-ce que vous y gagnez ?
Sangihe est l'une des innombrables îles de l'archipel indonésien. L'île abritait autrefois un oiseau bleu. Ensuite, il semblait qu'il avait disparu, mais non, récemment, on a découvert que le moineau bleu sautille encore dans les forêts. Mais il n'y a pas que le moineau, il y a aussi quelques dizaines de milliers de personnes vivant sur l'île. Pêcheurs, cueilleurs, artisans, enseignants, étudiants.
Il y a quelque temps, une entreprise canadienne a obtenu une concession sur la moitié du sous-sol parce qu'on a récemment découvert qu'il y avait de l'or. Jusqu'à récemment, une loi de l'État indonésien interdisait l'extraction des îles du sous-sol, mais l'année dernière, les pressions internationales ont abouti à l'abolition de cette loi. Il peut être excavé. Il peut être extrait, et l'entreprise canadienne qui détient les droits d'exploitation se présente pour faire respecter ses droits.
Ce que la BBC documente dans une vidéo que vous pouvez retrouver en cliquant ici ce n'est en aucun cas une histoire originale. C'est ainsi depuis quelques centaines d'années : des prédateurs blancs arrivent n'importe où sur terre, ils découvrent qu'ils peuvent extraire un minéral qui a de la valeur pour l'économie blanche (peut-être un minéral inutile comme l'or, chargé d'une immense signification religieuse, au point de pouvoir la considérer comme le totem de la croyance superstitieuse dite « économique »). Les prédateurs blancs détruisent tout, soumettent les humains qui habitent le territoire à des cadences de travail exténuantes, et leur donnent en retour un salaire, une voiture, une maison avec les accessoires indispensables dans la souricière dans laquelle les blancs ont l'habitude de vivre. A présent, ils ont presque tout détruit, et maintenant le monde a commencé à brûler, et il brûlera certainement, jusqu'à ce que la race humaine soit terminée, sauf peut-être quelques spécimens qui parviendront à s'échapper à bord de navettes dans lesquelles ils passeront le reste de leurs tristes jours comme des rats dans des cages volant dans le néant. Mais certaines îles de la planète terre n'ont pas encore été totalement capturées par les exterminateurs, car elles sont trop éloignées. Par exemple Sangihe.
A la question : « Que gagnerez-vous à réaliser votre projet » (abattre les forêts, forer le sol, extraire le minerai que la superstition économique considère comme précieux) ? le représentant chauve et pacifique de la compagnie minière répond en riant : « Des millions et des millions de dollars. Quand nous serons à pleine capacité, nous prévoyons d'extraire des milliers d'onces par mois dans quelques années. »
Et il y aura du travail pour cinq mille personnes. Cinq mille personnes pourront arrêter de pêcher, construire des objets utiles à la communauté, étudier, et pourront enfin descendre quelques centaines de mètres sous terre huit heures par jour en échange d'un salaire qui leur permet d'avoir une voiture, pour remplacer leur maison avec une souricière et ainsi de suite.
La lecture de cette histoire m'a marqué car tout ce qu'il y a à savoir sur la modernité est ici condensé en quatre minutes et demie de film. La destruction de la vie, du plaisir, de la beauté, de l'affection, de la joie, du lever du soleil, du coucher du soleil, de la nourriture, du souffle, en échange d'un salaire de voiture, et du cancer du poumon ou de l'économie.
Après cinq siècles, il y a encore des endroits où la cure occidentale n'a pas été appliquée. Les forêts brûlent, les rivières débordent, les guerres se multiplient, la dépression sévit, mais quelque part le progrès n'est pas encore arrivé. Renvoyons-le nous de toute urgence, avant la fin du spectacle.
C'est une question d'années maintenant. L'extinction n'est plus une perspective lointaine, mais un problème qui concerne la génération actuelle, celle qui ne peut même pas aller à l'école parce qu'il existe un virus mystérieux. Avant d'être engloutis par l'apocalypse qui se répand rapidement, nous ne devons pas oublier d'y attirer aussi les pauvres habitants de Sangihe, qui n'ont pas encore profité des fruits du progrès occidental.
Qui a son avant-garde, son symbole aux Etats-Unis d'Amérique.
Franco Bifo Berardi
25 août 2021
Lire l’article original dans la revue italienne Effimera
Franco Berardi dit Bifo est un philosophe et militant politique italien issu de la mouvance opéraïste. Il rejoint le groupe Potere Operaio et s'implique dans le mouvement autonome italien dans les années 1970, notamment depuis la Faculté des Lettres et de Philosophie de l'Université de Bologne, où il enseigne l'esthétique.
27.09.2024 à 15:47
Le monde à travers les yeux des sourds
L'Autre Quotidien

Texte intégral (3177 mots)

Un programmeur sourd, gay et libertaire, résident d'Ukraine et de Suède parle de comment vivre sans entendre; sur les problèmes causés par la surdité et comment les résoudre ; sur la façon dont il entame et entretient des relations ; et aussi pourquoi il n'a pas besoin de l'aide de l'État.
Remarque : le monologue a été compilé par l'auteur de l'article sur la base d'une longue correspondance avec son héros et approuvé par ce dernier, puisque c'est, en fait, la seule façon d'interviewer une personne sourde.
Je suis sourd depuis ma naissance. Un jour après ma naissance, à cause d'apnée j'ai arrêté de respirer, j'ai dû me réanimer. Personne ne sait pourquoi cela se produit chez les bébés. Néanmoins, j'ai été pompé - mais certaines connexions nerveuses ont été endommagées en raison du manque d'oxygène. Depuis, je suis sourd.
Ce n'est pas offensant d'être traité de « sourd », mais je n'aime pas être traité de sourd-muet parce que je ne suis pas stupide. Ma mère a refusé de suivre les conseils des médecins et de certains proches pour m'envoyer dans un pensionnat ou une école spécialisée ; j'ai dû suivre des cours rémunérés auprès d'un enseignant pour sourds. J'ai donc appris à parler et à lire - puis je suis allé dans une école polyvalente ordinaire.
Je n'ai eu aucun problème à l'école. Eh bien, il y a eu quelques incidents désagréables avec quelques élèves et un enseignant, mais tout s'est bien passé - peut-être parce que mon meilleur ami était le principal "alpha" de la classe : c'est arrivé, nous avions les mêmes passe-temps. De plus, j'ai aidé tout le monde avec la grammaire et la dictée. La dictée pour moi était un peu différente de celle de mes camarades de classe : je pouvais regarder ce que mon camarade de bureau avait écrit, même si je ne pouvais pas corriger ses erreurs (sachant que dans de nombreux cas, il se trompe). J'ai aussi pris la présentation différemment : on m'a permis de ne pas écouter le texte source, mais de le lire, mais une seule fois. Sur d'autres sujets, à l'exception des langues, je n'avais aucune concession.
Cependant, avec un enseignant, cela s'est avéré désagréable. Elle refusait de croire que je n'entendais pas, répandait la pourriture, grondait, m'accusait de me montrer. Bien sûr, je me suis plaint et ils l'ont maîtrisée - et un mois après le scandale, elle est décédée. Karma. Au travail, je n'ai presque jamais eu à faire face à une telle attitude, puisque je travaille à distance, mais il y avait quelques professeurs fous à l'institut, eh bien, ils ont été impolis plusieurs fois dans les transports et à la banque.
Je dois dire que j'ai l'impression qu'il y a plus de gens dans la société qui sont prêts à aider que de rustres.
Par exemple, une fois, alors que j'étais dans un bus, ayant droit à la gratuité, le conducteur a refusé de l'accepter, disant que j'avais tout truqué et que je faisais semblant. Un autre passager s'est levé et a même payé pour moi. Ensuite, j'étais un écolier timide de 13-14 ans et je ne comprenais pas très bien ce qui s'était passé. Je ne sais même pas ce que j'aurais fait dans ce cas aujourd'hui - peut-être que j'aurais gardé le silence et payé cette fille, ou peut-être que j'aurais pris le conducteur au téléphone et l'aurais posté sur Facebook : le pays devrait connaître ses "héros" .
Je ne parle pas les langues des signes car je ne les ai jamais apprises. Quand je communique avec les gens, c'est soit par correspondance, soit je lis sur les lèvres et je parle du mieux que je peux. Je connais aussi d'autres personnes sourdes - mais seulement avec celles qui ont également suivi des cours et qui maintenant communiquent pleinement avec les autres, comme moi : en prononçant des mots et en lisant sur les lèvres.
Bien sûr, il n'est pas toujours facile de lire sur les lèvres. Chaque personne a sa propre articulation. Autrement dit, certaines personnes sont faciles à lire sur les lèvres, tandis que d'autres ne le sont pas. Ma famille et mes amis ont été spécialement formés, mais il peut être difficile de lire les étrangers. Par exemple, je me suis assis une fois avec ma famille dans le métro en Suède, et un voisin turc s'est intéressé à la façon dont je peux lire sur les lèvres et comment je suis devenu sourd. Il s'est avéré qu'il connaissait plusieurs langues. Il voulait tester ma capacité à lire sur les lèvres. J'attendais de lui l'anglais et le suédois, mais pendant longtemps je n'ai pas compris quelle langue il parlait encore - il s'est avéré qu'il parlait russe!
Les sons les plus difficiles à lire sur les lèvres sont les sifflements et les sons gutturaux. "s" et "z" peuvent être facilement confondus avec "et", et "k" et "x" sont généralement invisibles. En général, si vous voulez embrouiller une personne sourde, dites-lui un « catéchisme ».
Parmi les langues que je connais, l'anglais est la plus difficile à lire sur les lèvres. Là, beaucoup de mots se ressemblent, beaucoup de lettres sont avalées. "Hé. Hu e yu? Bien. Visez fin merci" est difficile à lire. Peut-être est-ce un manque de pratique, ou peut-être la prévalence des mouvements de la langue sur les mouvements des lèvres, qui sont inhérents à la langue dans son ensemble.
La lecture sur les lèvres n'est facile qu'en tête-à-tête. Lorsque l'interlocuteur s'adresse au groupe - lors d'une conférence, dans un discours présidentiel ou une vidéo sur YouTube - c'est très difficile. C'est particulièrement gênant lors des dîners de famille festifs - je ne comprends pas du tout qui dit quoi. Pire encore - dans la foule. Une fois, je suis allé au Maidan - quand j'étais à Kyiv, pour affaires, quelques jours avant la perpétration de l'anarchie par les flics, c'était encore calme et paisible. Dans la foule, vous ne comprenez pas ce qui se passe. C'est pourquoi je n'aime pas les grandes villes et les foules.
En Suède, où je me rends souvent, la surdité est généralement traitée différemment qu'en Ukraine. Si je montre au Suédois que je ne l'entends pas, presque tout le monde comprendra immédiatement et écrira ce qu'il veut me dire au téléphone. Le personnel des cafés et des musées en tient également compte.
Une fois, j'étais dans un musée suédois qui était sur le point de fermer parce que une journée de travail s'est écoulée et je n'ai pas entendu l'annonce à ce sujet, l'ouvrier a couru trois étages après moi avec une note indiquant que le musée fermait.
Et il y a beaucoup d'exemples de ce genre. Pourquoi? Je ne me souviens d'aucun cas de pénalité pour un discours de chapeau ici. Probablement, le point est dans la mentalité et dans la politique de tolérance et d'humanité. A en juger par les Suédois, c'est probablement surtout une question de mentalité. Les Suédois ont très peur de la condamnation publique et essaient toujours d'aider du mieux qu'ils peuvent tous ceux qui en ont besoin. Il semble qu'ils soient gênés de vivre beaucoup mieux que n'importe qui dans le monde.
Je ne pense pas que l'État ait joué un rôle significatif dans l'attitude envers moi en Suède. Je suis un libertaire, mais je ne pense pas qu'il y ait une contradiction entre mon attitude envers l'État et la société suédoise. Après tout, qui éduque les gens à la tolérance envers les handicapés ? Qui oblige l'État à cultiver la même tolérance ? Les personnes intéressées. Personnellement, je me fiche que les gens ne traitent pas les sourds comme ils le devraient - laissez-les exprimer leur haine comme ils le souhaitent, mais ne vous plaignez pas d'être considérés comme des idiots. Pourtant, il y aura ces gens qui intercéderont. Tout de même, ceux qui ont moins de droits et d'opportunités peuvent défendre leurs intérêts - d'abord en déclarant qu'ils ont aussi des droits et se défendent eux-mêmes, puis par le dialogue et l'éducation - non pas en introduisant des cours obligatoires dans les écoles, mais par des discussions, des blogs , srachi, médias, etc.
Je suis gay. Quand j'avais 13-14 ans, j'ai d'abord ressenti une attirance sexuelle pour les autres - c'était des camarades de classe, des acteurs, des super-héros. À cette époque, je n'avais aucune relation amoureuse - j'ai dit à mes proches que je rencontrais mon voisin sur le bureau, et le reste de mes connaissances n'a posé aucune question, attribuant tout à ma surdité. En fait, je respirais de manière inégale vers mon camarade de classe - vers le très «alfach» qui était un hooligan invétéré, un perdant et un favori des filles de notre classe. Ensuite, nous avons obtenu notre diplôme d'études secondaires et sommes entrés dans différentes universités. Néanmoins, nous avions des passe-temps communs, nous parlions et, entre autres, jouions à des jeux vidéo. Nous n'avons pas arrêté de parler. Une fois, quand je suis de nouveau resté chez lui, nous sommes sortis sur le balcon pour fumer un narguilé et avons commencé à nous battre pour le seul oreiller restant - il a gagné et j'ai dit : « Alors tu seras mon oreiller, salope ! et se coucha sur son épaule. J'ai constamment eu peur d'aller trop loin, de le perdre en tant que personne avec qui la relation était très importante pour moi, mais ce soir tout s'est terminé en sexe. Nous avons passé six ans ensemble - en même temps, il a rencontré des filles pour des raisons d'apparence et n'a pas déclaré publiquement qu'il était bi. En fin de compte, nous avons rompu pour cette raison, et maintenant ma vie est liée à d'autres personnes.
C'est très rageant quand une personne s'adresse à moi, je lui montre que je n'entends pas, et il parle plus fort. Je pointe mon index vers mon oreille et croise les bras en secouant la tête. C'est un geste ordinaire et compréhensible - mais beaucoup ne comprennent toujours pas et continuent encore plus fort. Un autre mythe ennuyeux est que les sourds ne peuvent pas apprendre les langues étrangères. En plus du russe et de l'ukrainien, je connais l'anglais et un peu le suédois. En anglais à l'école, j'étais généralement l'un des meilleurs de la classe.
Il est également exaspérant que de nombreux services sur Internet ne soient fournis que par téléphone. Tapez soumis une demande ou une commande : "Nous avons accepté, attendez, nous vous rappellerons." Quand ils m'appellent, je jure tranquillement et marque, ou, dans les cas extrêmes, je me tourne vers des parents ou un ami pour obtenir de l'aide. Parfois je déverse, mais il y a des pics persistants. Si l'appel provient d'un numéro inconnu, je raccrocherai très probablement ou je ne décrocherai pas jusqu'à ce qu'ils arrêtent d'appeler.
On ne peut pas dire que je n'entends pas de sons du tout - quelque chose est capté avec une aide auditive. Une aide auditive est, en fait, un amplificateur de son, réglé uniquement sur l'audition d'une personne en particulier. L'ajustement a lieu avec la participation d'un médecin et d'un programme spécial: il prononce quelques phrases, ferme les lèvres pour que je ne puisse pas les lire, demande ce que j'ai entendu et demande à répéter après lui. En fonction de mes réponses, il définit le gain de volume souhaité pour certaines fréquences. Mais encore, même avec l'appareil, il est difficile de distinguer les sons, beaucoup me semblent identiques.
Quand vous pensez à un concept - disons un bus - vous avez la combinaison sonore "bus" dans votre tête et une image d'un grand transport de passagers en même temps, et sur les lettres qui composent le mot "bus" ou " bus", vous et ne vous souvenez pas. Et quand je pense à un objet, je me concentre sur le nom de l'objet plutôt que sur l'objet lui-même. Quand j'étais petit, je ne pensais pas en mots, mais en images - mais avec l'éducation, j'ai complètement oublié comment penser et j'ai commencé à penser en mots. Maintenant, j'essaie de me recycler - ou plutôt d'apprendre à basculer entre les images, le russe et l'anglais. Parce que la pensée figurative est efficace dans de nombreux cas, elle permet d'économiser du temps et des efforts de réflexion. En fait, je n'arrête pas de l'oublier. Pour moi, penser avec des mots, c'est comme se parler à soi-même; pensez à la lettre, pas au sens. Mais figuratif - au contraire.
J'ai aussi écouté de la musique - dans une discothèque, à une fête, dans une boîte de nuit. Récemment, j'ai même essayé d'écouter de la musique sans appareil avec des écouteurs. Bien que je ne comprenne pas quel genre de sons, sans parler des mots, j'ai le plus aimé le jazz - c'est agréable de ressentir un tel rythme et une telle vibration. Je n'aime pas la poésie, ni écouter ni écrire. Mais je peux apprécier une bonne rime.
Un de mes amis a expérimenté avec moi et la guitare - il s'est avéré que je n'attrapais pas du tout les hautes fréquences, mais plus ou moins les basses, si j'y mettais l'oreille. Si un feu d'artifice retentit à l'extérieur de la fenêtre, je l'entendrai. Quand ils ouvrent une bouteille de champagne, j'entends un bang, mais je n'entends pas de sifflement. De plus, si une grosse voiture ou un train passe à côté de moi, j'entendrai alors un « whoosh », et je ne sentirai pas seulement un souffle de vent.
Mais le cri, la sirène, le bruit de la perceuse chez le dentiste - je ne ressens pas tout cela. À l'école, à cause du grincement d'une craie de mauvaise qualité sur le tableau, ce son a été entendu, à partir duquel les oreilles se sont enroulées dans un tube - j'ai vu comment les visages de mes camarades de classe se sont tordus, mais je n'ai rien entendu.
En général, tous les sons que j'entends sont effrayants : c'est comme si vous étiez assis seul dans votre propre chambre, profondément impliqué dans une sorte d'activité, n'attendant personne, et puis maman tapote soudainement dans le dos : "Ne t'affale pas ! ”
Enfant, j'avais une cloche avec un signal lumineux dans mon appartement pour savoir quand quelqu'un sonnait à la porte. Maintenant, je ne compte que sur le téléphone et Internet. Eh bien, pour un chat. Au fait, les chats comprennent que je ne peux pas entendre - ils ouvrent toujours la bouche avec défi et miaulent dans mes yeux quand ils ont besoin de quelque chose. Ils peuvent griffer avec leur patte ou sauter directement sur le clavier.
J'aimerais avoir un outil qui capture la langue parlée et la traduit en texte écrit. Ces solutions qui sont sur le marché sont complètement inefficaces. Mais, néanmoins, les innovations techniques m'aident beaucoup plus que l'État. Ce dernier aide franchement à se faire foutre : il paie des prestations en kopecks, environ 50 euros par mois, et c'est tout. J'en avais aussi marre de l'obligation de passer chaque année un examen à l'hôpital - heureusement, après ma majorité, cela est devenu facultatif. Et quand j'ai essayé d'obtenir un pass de bus gratuit, en tant que mineur, on m'a refusé: "Ton père gagne tellement." Ils ont juste regardé la déclaration de revenus et certains documents sur le revenu - et ils ont dit que nous pouvons subvenir à nos besoins et à ceux qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, même en enfer. On dirait que c'est dans la loi.
Gleb Strunnikov
26.09.2024 à 12:40
Hommage à Kropotkine et à l'entraide à venir ! Le dernier texte de David Graeber
L'Autre Quotidien

Texte intégral (4819 mots)

Pierre Kropotkine
Son essai sur l'entraide, conçu comme une préface au grand travail de Kropotkine sur le rôle déterminant de la solidarité est probablement le dernier que David Graeber aura pu écrire. Nous avons décidé de le publier et de le mettre à la disposition de tous, à la mémoire de notre ami, camarade et mentor. Il est particulièrement bienvenu à un moment où la société, échaudée par les ravages de plus en plus flagrants du choix de la compétition et de la lutte de tous contre tous, autrement dit du darwinisme social, redécouvre l’importance de la solidarité pour sa survie.
Andrej Grubačić

David Graeber au micro en 2015, en pleine occupation de l’université d’Amsterdam. CC BY 2.0 / Guido van Nispen
Introduction de l' entraide à venir : un facteur d'évolution éclairé par David Graeber et Andrej Grubačić
Parfois - pas très souvent - un argument particulièrement convaincant contre le bon sens politique dominant présente un tel choc pour le système qu'il devient nécessaire de créer tout un corps de théorie pour le réfuter. De telles interventions sont elles-mêmes des événements, au sens philosophique; c'est-à-dire qu'ils révèlent des aspects de la réalité qui avaient été largement invisibles mais, une fois révélés, semblent tellement évidents qu'ils ne peuvent jamais être invisibles. Une grande partie du travail de la droite intellectuelle consiste à identifier et à éviter ces défis.
Offrons trois exemples.
Dans les années 1680, un homme d'État huron-wendat du nom de Kondiaronk, qui était allé en Europe et qui connaissait intimement la société coloniale française et anglaise, s'engagea dans une série de débats avec le gouverneur français de Québec et l'un de ses principaux collaborateurs, un certain Lahontan. Il y présente l'argument selon lequel le droit punitif et tout l'appareil de l'État n'existent pas à cause d'un défaut fondamental de la nature humaine, mais en raison de l'existence d'un autre ensemble d'institutions - la propriété privée, l'argent - qui, de par leur nature même, poussent les gens à agir de manière à rendre nécessaires des mesures coercitives. L'égalité, a-t-il soutenu, est donc la condition de toute liberté significative. Ces débats ont ensuite été transformés en un livre de Lahontan, qui, dans les premières décennies du XVIIIe siècle, a connu un franc succès. C'est devenu une pièce de théâtre qui a duré vingt ans à Paris, et apparemment chaque penseur des Lumières a écrit une imitation. Finalement, ces arguments - et la critique indigène plus large de la société française - sont devenus si puissants que les défenseurs de l'ordre social existant tels que Turgot et Adam Smith ont effectivement dû inventer la notion d'évolution sociale comme une riposte directe. Ceux qui ont proposé pour la première fois l'argument selon lequel les sociétés humaines pouvaient être organisées selon des stades de développement, chacun avec leurs propres technologies et formes d'organisation caractéristiques, ont été assez explicites sur le fait que c'est de cela qu'ils étaient. «Tout le monde aime la liberté et l'égalité», a noté Turgot; la question est de savoir dans quelle mesure l'un ou l'autre est compatible avec une société commerciale avancée basée sur une division sophistiquée du travail. Les théories de l'évolution sociale qui en résultent ont dominé le dix-neuvième siècle et sont toujours très présentes,
À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, la critique anarchiste de l'État libéral - selon laquelle l'État de droit était finalement basé sur une violence arbitraire, et finalement, simplement sur une version sécularisée d'un Dieu tout-puissant qui pouvait créer la moralité parce qu'elle se tenait en dehors cela - a été pris si au sérieux par les défenseurs de l'État que des théoriciens du droit de droite comme Karl Schmitt ont finalement proposé l'armature intellectuelle du fascisme. Schmitt termine son œuvre la plus célèbre, la théologie politique, avec une diatribe contre Bakounine, dont le rejet du «décisionnisme» - l'autorité arbitraire de créer un ordre juridique, mais donc aussi de le mettre de côté - a finalement été, selon lui, tout aussi arbitraire que l'autorité que Bakounine prétendait s'opposer. La conception même de Schmitt de la théologie politique, fondamentale pour presque toute la pensée de droite contemporaine, était une tentative de répondre au Dieu et à l'État de Bakounine .
Le défi posé par l'entraide de Kropotkine : un facteur d'évolution éclairé est sans doute encore plus profond, car il ne s'agit pas seulement de la nature du gouvernement, mais de la nature de la nature - c'est-à-dire de la réalité - elle-même.
Les théories de l'évolution sociale, ce que Turgot a baptisé pour la première fois le «progrès», auraient pu commencer comme un moyen de désamorcer le défi de la critique indigène, mais elles ont rapidement commencé à prendre une forme plus virulente, alors que des libéraux purs et durs comme Herbert Spencer ont commencé à représenter l'évolution sociale non seulement comme une question de complexité croissante, de différenciation et d'intégration, mais comme une sorte de lutte hobbesienne pour la survie. L'expression «survie du plus apte» a en fait été inventée en 1852 par Spencer, pour décrire l'histoire humaine - et finalement, on suppose, pour justifier le génocide et le colonialisme européens. Il n'a été repris par Darwin qu'une dizaine d'années plus tard, lorsque, dans L'Origine des espèces, il s'en servit pour décrire les formes de sélection naturelle qu'il avait identifiées lors de sa célèbre expédition aux îles Galapagos. Au moment où Kropotkine écrivait, dans les années 1880 et 90, les idées de Darwin avaient été reprises par les libéraux du marché, le plus notoirement son «bulldog» Thomas Huxley, et le naturaliste anglais Alfred Russel Wallace, pour proposer ce que l'on appelle souvent une «vision gladiatoriale» de l'histoire naturelle. Les espèces se battent comme des boxeurs dans un ring ou des négociants en obligations sur un marché; le fort l'emporte.
La réponse de Kropotkine - que la coopération est un facteur tout aussi décisif de sélection naturelle que la concurrence - n'était pas entièrement originale. Il n'a jamais prétendu que c'était le cas. En fait, il ne s'appuyait pas seulement sur les meilleures connaissances biologiques, anthropologiques, archéologiques et historiques disponibles à son époque, y compris ses propres explorations de la Sibérie, mais aussi sur une école russe alternative de théorie de l'évolution qui soutenait que l'école hyperconcurrentielle anglaise était basée, comme il le disait, sur «un tissu d'absurdités» : des hommes comme «Kessler, Severtsov, Menzbir, Brandt - quatre grands zoologistes russes, et un cinquième moindre, Poliakov, et enfin moi-même, un simple voyageur».
Pourtant, nous devons donner du crédit à Kropotkine. Il était bien plus qu'un simple voyageur. Ces hommes avaient été ignorés avec succès par les Darwiniens anglais, à l'apogée de l'empire - et, en fait, par presque tout le monde. L’avertissement que leur adressait Kropotkine fut sans effet sur eux. Cela s'explique sans doute en partie par le fait qu'il présentait ses découvertes scientifiques dans un contexte politique plus large, sous une forme qui rendait impossible de nier à quel point la version régnante de la science darwinienne n'était pas elle-même le reflet inconscient de catégories libérales tenues pour acquises.(Comme Marx l'a si bien dit, «L'anatomie de l'homme est la clé de l'anatomie du singe.») C'était une tentative de catapulter les vues des classes commerçantes vers l'universalité. Le darwinisme à cette époque était encore une intervention politique consciente et militante visant à remodeler le bon sens ; une insurrection centriste, pourrait-on dire, ou peut-être mieux, une insurrection centriste en puissance, puisqu'elle visait à créer un nouveau centre. Ce n'était pas encore du bon sens ; c'était une tentative de créer un nouveau bon sens universel. Si elle n'a pas, en fin de compte, été totalement couronnée de succès, c'est dans une certaine mesure en raison de la puissance même du contre-argument de Kropotkine.
Il n'est pas difficile de voir ce qui rendait ces intellectuels libéraux si inquiets. Considérez le célèbre passage de Mutual Aid, qui mérite vraiment d'être cité en entier:
Ce n'est pas l'amour, ni même la sympathie (au sens propre) qui pousse un troupeau de ruminants ou de chevaux à former un anneau pour résister à une attaque de loups; pas l'amour qui pousse les loups à former une meute pour la chasse; pas l'amour qui pousse les chatons ou les agneaux à jouer, ou une douzaine d'espèces de jeunes oiseaux à passer leurs journées ensemble à l'automne; et ce n'est ni l'amour ni la sympathie personnelle qui font que plusieurs milliers de daims éparpillés sur un territoire aussi grand que la France se forment en une vingtaine de troupeaux séparés, tous marchant vers un endroit donné, pour y traverser une rivière. C'est un sentiment infiniment plus large que l'amour ou la sympathie personnelle - un instinct qui s'est lentement développé chez les animaux et les hommes au cours d'une évolution extrêmement longue, et qui a enseigné aux animaux comme aux hommes la force qu'ils peuvent emprunter à la pratique de l'entraide et du soutien, et les joies qu'ils peuvent trouver dans la vie sociale. . . . Ce n'est pas l'amour ni même la sympathie sur lesquels la société est basée dans l'humanité. C'est la conscience - ne serait-ce qu'au stade d'un instinct - de la solidarité humaine. C'est la reconnaissance inconsciente de la force qui est empruntée par chaque homme à la pratique de l'entraide; de la dépendance étroite du bonheur de chacun au bonheur de tous; et du sens de la justice, ou de l'équité, qui amène l'individu à considérer les droits de tout autre individu comme égaux aux siens. Sur cette base large et nécessaire se développent des sentiments moraux encore plus élevés.
Il suffit de considérer la virulence de la réaction. Au moins deux domaines d'étude (certes, qui se chevauchent), la sociobiologie et la psychologie évolutionniste, ont depuis été créés spécifiquement pour réconcilier les remarques de Kropotkine sur la coopération entre les animaux avec l'hypothèse que nous sommes tous finalement motivés par, comme Dawkins devait finalement le dire, nos «gènes égoïstes». Lorsque le biologiste britannique JBS Haldane aurait déclaré qu'il serait prêt à donner sa vie pour sauver «deux frères, quatre demi-frères ou huit cousins germains», il était simplement en train de répéter le genre de calcul «scientifique» qui a été introduit partout dans le monde. répond Kropotkine, de la même manière que le progrès a été inventé pour contrôler Kondiaronk, ou la doctrine de l'état d'exception, pour contrôler Bakounine. L'expression «gène égoïste» n'a pas été choisie par hasard.
Les efforts de la droite intellectuelle pour relever l'énormité du défi présenté par la théorie de Kropotkine sont compréhensibles. Comme nous l'avons déjà souligné, c'est précisément ce qu'ils sont censés faire. C'est pourquoi ils sont appelés «réactionnaires». Ils ne croient pas vraiment à la créativité politique en tant que valeur en soi - en fait, ils la trouvent profondément dangereuse. En conséquence, les intellectuels de droite sont principalement là pour réagir aux idées avancées par la gauche. Mais qu'en est-il de la gauche intellectuelle?
C'est là que les choses deviennent un peu déroutantes. Alors que les intellectuels de droite cherchaient à neutraliser le holisme évolutionniste de Kropotkine en développant des systèmes intellectuels entiers, la gauche marxiste prétendait que son intervention ne s'était jamais produite. On ne pourrait pas donner tort à quelqu’un qui avancerait que la réponse marxiste à l'accent mis par Kropotkine sur le fédéralisme coopératif a été de développer davantage les aspects de la propre théorie de Marx qui tiraient le plus nettement dans l'autre direction: c'est-à-dire ses aspects les plus productivistes et progressistes. Des informations riches de son livre ont été au mieux ignorées et, au pire, balayées avec un rire condescendant. Il y a eu une telle tendance persistante dans la recherche marxiste, et par extension, dans la recherche de gauche en général, à ridiculiser le «socialisme de sauvetage» et l '«utopisme naïf» de Kropotkine qu'un biologiste renommé, Stephen Jay Gould, s'est senti obligé d'insister, dans un essai célèbre, sur le fait que "Kropotkine n'était pas un cinglé."
Il y a deux explications possibles à ce choix stratégique de de débarrasser de Kropotkine. L'une est le pur et simple sectarisme. Comme déjà noté, l'intervention intellectuelle de Kropotkine faisait partie d'un projet politique plus large. La fin du XIXe siècle et le début du XXe ont vu les fondements de l'État-providence, dont les principales institutions étaient, en effet, en grande partie créées par des groupes d'entraide, totalement indépendants de l'État, puis progressivement cooptées par les États et les partis politiques. La plupart des intellectuels de droite et de gauche étaient parfaitement alignés sur celui-ci : Bismarck a pleinement admis qu'il avait créé les institutions allemandes de protection sociale comme un «pot-de-vin» à la classe ouvrière afin qu'elle ne devienne pas socialiste. Les socialistes ont insisté pour que tout, de l'assurance sociale aux bibliothèques publiques, soit géré non pas par le quartier et les groupes syndicaux qui les avaient réellement créés, mais d'en haut par des partis d'avant-garde. Dans ce contexte, aussi bien les sociaux-démocrates que Bismarck considéraient comme un impératif primordial de présenter les propositions socialistes éthiques de Kropotkine comme de la folie douce. Il convient également de rappeler que - en partie pour cette raison même - dans la période entre 1900 et 1917, les idées marxistes anarchistes et libertaires étaient beaucoup plus populaires parmi la classe ouvrière elle-même que le marxisme de Lénine et de Kautsky. Il a fallu la victoire de la branche de Lénine du parti bolchevique en Russie (à l'époque, considérée comme l'aile droite des bolcheviks), et la suppression des Soviets, du Proletkult et d'autres initiatives venues de la base de la société en Union soviétique elle-même, pour que les idées libertaires reculent.
Il y a cependant une autre explication possible, qui a plus à voir avec ce que l'on pourrait appeler la «positionnalité» à la fois du marxisme traditionnel et de la théorie sociale contemporaine. Quel est le rôle d'un intellectuel radical? La plupart des intellectuels prétendent encore être des radicaux d'une sorte ou d'une autre. En théorie, ils sont tous d'accord avec Marx pour dire qu'il ne suffit pas de comprendre le monde; le but est de le changer. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement dans la pratique?
Dans un paragraphe important de l'entraide, Kropotkine fait une suggestion : le rôle d'un érudit radical est de «restaurer la vraie proportion entre conflit et union». Cela peut sembler obscur, mais il clarifie. Les savants radicaux sont “tenus d'entrer dans une analyse minutieuse des milliers de faits et de faibles indications accidentellement conservés dans les reliques du passé; les interpréter à l'aide de l'ethnologie contemporaine; et après avoir tant entendu parler de ce qui divisait les hommes, reconstruire pierre par pierre les institutions qui les unissaient”.
L'auteur se souvient encore de son excitation juvénile après avoir lu ces lignes. Quelle différence avec la formation sans vie reçue dans les universités centrées sur la nation! Cette recommandation devrait être lue ensemble avec celle de Karl Marx, dont l'énergie est allée à la compréhension de l'organisation et du développement de la production marchande capitaliste. Dans son Capital, la seule véritable attention accordée à la coopération est l'examen des activités coopératives en tant que formes et conséquences de la production industrielle, où les travailleurs «forment simplement un mode particulier d'existence du capital». Il semblerait que ces deux projets se complètent très bien. Kropotkine avait pour objectif de comprendre précisément ce qu'un travailleur aliéné avait perdu. Mais intégrer les deux signifierait comprendre comment même le capitalisme est finalement fondé sur le communisme («entraide»), même si c'est un communisme qu'il ne reconnaît pas; comment le communisme n'est pas un idéal abstrait, lointain, impossible à maintenir, mais une réalité pratique vécue dans laquelle nous nous engageons tous quotidiennement, à des degrés divers, et que même les usines ne pourraient pas fonctionner sans lui - même si une grande partie opère en cachette, entre les fissures, ou les changements, ou informellement, ou dans ce qui n'est pas dit, ou entièrement subversivement. Il est devenu à la mode ces derniers temps de dire que le capitalisme est entré dans une nouvelle phase dans laquelle il est devenu parasitaire des formes de coopération créative, en grande partie sur Internet. Ça n'a pas de sens. Cela a toujours été le cas.
C'est un projet intellectuel digne d'intérêt. Mais il se trouve que presque personne ne trouve d’intérêt à le réaliser. Au lieu d'examiner comment les relations de hiérarchie et d'exploitation sont reproduites, refusées et empêtrées dans des relations d'entraide, comment les relations de soins deviennent continues avec les relations de violence, mais maintiennent néanmoins les systèmes de violence ensemble afin qu'ils ne s'effondrent pas entièrement, tant le marxisme traditionnel que la théorie sociale contemporaine ont obstinément écarté à peu près tout ce qui suggère la générosité, la coopération ou l'altruisme comme une sorte d'illusion bourgeoise. Le conflit et le calcul égoïste se sont avérés plus intéressants que l'"union". (De même, il est assez courant pour les universitaires de gauche d'écrire sur Carl Schmidt ou Turgot, alors qu'il est presque impossible de trouver ceux qui écrivent sur Bakounine et Kondiaronk). Comme Marx lui-même s'en est plaint, sous le mode de production capitaliste, exister c'est accumuler depuis quelques décennies ; nous n'avons guère entendu d'autres exhortations que des exhortations incessantes sur les stratégies cyniques utilisées pour augmenter notre capital (social, culturel ou matériel) respectif. Ces exhortations sont formulées sous forme de critiques. Mais si tout ce dont vous êtes prêt à parler est ce que vous prétendez combattre, si tout ce que vous pouvez imaginer est ce que vous prétendez combattre, alors dans quel sens vous y opposez-vous réellement ? Il semble parfois que la gauche académique ait fini par intérioriser et reproduire progressivement tous les aspects les plus affligeants de l'économisme néolibéral auquel elle prétend s'opposer, au point que, à la lecture de nombreuses analyses de ce type (on va être gentil et ne pas citer de noms), on se demande à quel point tout cela est vraiment différent de l'hypothèse sociobiologique selon laquelle notre comportement est régi par des "gènes égoïstes"!
Il est vrai que ce type d'intériorisation de l'ennemi a atteint son apogée dans les années 80 et 90, lorsque la gauche mondiale était en plein retrait. Les choses ont évolué. Kropotkine est-il à nouveau pertinent ? Eh bien, évidemment, Kropotkine a toujours été pertinent, mais ce livre est publié avec la conviction qu'il existe une nouvelle génération radicalisée, dont beaucoup n'ont jamais été exposés directement à ces idées, mais qui montrent tous les signes de pouvoir évaluer la situation mondiale avec plus de lucidité que leurs parents et leurs grands-parents, ne serait-ce que parce qu'ils savent que si ce n'est pas le cas, le monde qui leur est réservé deviendra bientôt un véritable enfer.
Cela commence déjà à se faire. La pertinence politique des idées d'abord épousées dans l'Entraide est redécouverte par les nouvelles générations de mouvements sociaux à travers la planète. La révolution sociale en cours dans la Fédération démocratique du nord-est de la Syrie (Rojava) a été profondément influencée par les écrits de Kropotkine sur l'écologie sociale et le fédéralisme coopératif, en partie grâce aux travaux de Murray Bookchin, en partie en remontant à la source, en grande partie aussi en s'appuyant sur leurs propres traditions kurdes et leur expérience révolutionnaire. Les révolutionnaires kurdes ont entrepris la tâche de construire une nouvelle science sociale antagoniste des structures de connaissance de la modernité capitaliste. Les personnes impliquées dans les projets collectifs de sociologie de la liberté et de jineoloji (féminisme kurde) ont en effet commencé à "reconstruire pierre par pierre les institutions qui unissaient" les peuples et les luttes. Dans le Nord global, partout, des divers mouvements d'occupation aux projets de solidarité face à la pandémie de Covid-19, l'entraide est apparue comme une phrase clé utilisée par les militants et les principaux journalistes. À l'heure actuelle, l'entraide est invoquée dans les mobilisations de solidarité des migrants en Grèce et dans l'organisation de la société zapatiste au Chiapas. La rumeur veut que même les universitaires l'utilisent occasionnellement.
Lorsque L'entraide a été publiée pour la première fois en 1902, peu de scientifiques étaient assez courageux pour contester l'idée que le capitalisme et le nationalisme étaient enracinés dans la nature humaine, ou que l'autorité des États était en fin de compte inviolable. La plupart d'entre eux étaient en effet considérés comme des fous ou, s'ils étaient trop manifestement importants pour être rejetés de cette manière, comme Albert Einstein, comme des "excentriques" dont les opinions politiques avaient à peu près autant d'importance que leurs coiffures inhabituelles. Mais le reste du monde avance. Les scientifiques - et même, peut-être, les spécialistes des sciences sociales - suivront-ils un jour ?
Nous écrivons cette introduction au cours d'une vague de révolte populaire mondiale contre le racisme et la violence d'État, alors que les autorités publiques répandent leur venin contre les "anarchistes" comme elles le faisaient à l'époque de Kropotkine. Le moment semble particulièrement bien choisi pour lever notre verre à ce vieux "méprisant de la loi et de la propriété privée" qui a changé le visage de la science d'une manière qui continue à nous toucher aujourd'hui. La thèse de Pyotr Kropotkine était minutieuse et colorée, perspicace et révolutionnaire. Elle a aussi exceptionnellement bien vieilli. Le rejet par Kropotkine du capitalisme et du socialisme bureaucratique, ses prédictions sur la direction que ce dernier pourrait prendre, ont été maintes fois justifiées. Si l'on considère la plupart des arguments qui ont fait rage à son époque, il n'y a pas vraiment de doute quant à savoir qui avait réellement raison.
Il est évident qu'il y a encore des personnes qui ne sont pas du tout d'accord sur ce point. Certains s'accrochent au rêve d'embarquer sur des navires depuis longtemps disparus. D'autres sont bien payés pour penser ce qu'ils font. Quant aux auteurs de cette modeste introduction, plusieurs décennies après avoir découvert ce charmant livre, nous sommes - une fois de plus - surpris de constater à quel point nous sommes d'accord avec son argument central. La seule alternative viable à la barbarie capitaliste est le socialisme apatride, un produit, comme le grand géographe ne cessait de nous le rappeler, "de tendances qui se manifestent maintenant dans la société" et qui étaient "toujours, en quelque sorte, imminentes dans le présent". Pour créer un monde nouveau, nous ne pouvons que commencer par redécouvrir ce qui est et ce qui a toujours été sous nos yeux.
David Graeber
Traduction et édition L’Autre Quotidien
Lire le texte original : https://truthout.org/articles/david-graeber-left-us-a-parting-gift-his-thoughts-on-kropotkins-mutual-aid/
28.08.2024 à 11:32
Le monde où les agresseurs se présentent comme des victimes
L'Autre Quotidien

Texte intégral (3706 mots)

Après La gentrification des esprits, les éditions B42 ont publié
l'essai de Sarah Schulmann Le conflit n'est pas une agression. C'est un livre à plusieurs égards dérangeant, qui bouscule là où il faut et qui permet de prendre de la distance et d'offrir des réflexions nouvelles sur des questions délicates. Comment en sommes-nous arrivés à déléguer à l'État la question de la justice ? Comment les agresseurs se font-ils passer pour des victimes ? Quel est le lien, dans la « surestimation du préjudice », à faire entre le niveau intime, étatique, et interétatique ? Ce sont autant de questions que ce livre, écrit sans langue de bois, permet d'aborder de front.
TN : En guise d'introduction à ton livre et pour donner au lecteur une perspective historique, peux-tu nous expliquer comment le mouvement contre les violences faites aux femmes s'est trouvé aux prises avec l'État et ses institutions ?
À son apparition dans les années 1970, le mouvement contre la violence faite aux femmes émergeait au sein d'un mouvement global de révolutions, d'indépendances coloniales, de mouvements de libération. En relation avec le changement global qui avait lieu, construit entre les relations personnelles et les relations globales, économiques, ce mouvement fut bouleversant, porteur d'énormes changements. C'était une époque où les femmes n'étaient pas dans le gouvernement, où elles n'étaient pas des juges, elles ne siégeaient pas au Congrès et n'étaient pas avocates. L'État était donc l'ennemi des femmes. Quand le mouvement a commencé, elles n'ont pas demandé à l'État de satisfaire leurs revendications, elles ont fait les choses par elles-mêmes. Par exemple, l'avortement était illégal. Les gens ont donc mis en place un service illégal dans lequel les femmes pouvaient se faire avorter clandestinement, ou encore si l'on avait été violé, on n'appelait pas les flics, on appelait un numéro de téléphone, un servit de soutien où une autre femme répondait et avec qui on pouvait discuter. Donc on a cherché des solutions à distance de l'État. On a créé des cliniques, on a créé des programmes, beaucoup de choses. Dans les années 1970, le gouvernement a mis en place un programme destiné à pourvoir aux salaires des dirigeants des différentes organisations et structure du mouvement. Mais en 1980, une fois élu, Reagan supprima ce financement. Sans argent, ces services furent totalement désorganisés et eurent du mal à continuer leur activité face à une demande toujours plus importante. Le gouvernement commença à contrôler les services, à promulguer des lois… Tout ce qui avait été mis en place par le mouvement contre les violences faites aux femmes tombait dans les mains du gouvernement. Celui-ci dirigeait et finançait les services. Il fallait en outre avoir les diplômes officiels reconnus par l'État pour y travailler. Il y avait là une contradiction évidente, car le gouvernement américain était l'une des grandes sources de violence du monde. Et c'est notre gouvernement qui disait être là pour en finir avec les violences. C'était bien évidemment impossible. Ils ont imposé un système exacerbant la vulnérabilité des pauvres. Les hommes mis en prison pour des faits de violences domestiques sont les pauvres, pas les riches. C'est donc une sorte de contrôle qui s'est mis en place, et ça n'a pas empêché les violences. Ça a remplacé les violences. Jusqu'à aujourd'hui ou le président Donald Trump est devenu le symbole de cette violence.
TN : Aujourd'hui, on peut ressentir une forme de dépossession de ces luttes liées à l'intégration forcée des services mis en place par le mouvement à l'appareil d'État…
C'est plus que ça. C'est le vocabulaire lui-même, qui a été construit, travaillé des années durant par le mouvement, qui se trouve approprié par ceux-là mêmes contre qui il s'était construit. Aujourd'hui, on a Trump, chef de l'État, qui met en scène un discours dans lequel il se dit être une victime, seule contre tous. C'est particulièrement patent concernant la politique d'Israël. Mais c'est aussi quelque chose que l'on retrouve dans les relations personnelles. Nous vivons une période dans laquelle il n'y a plus aucune empathie, plus aucune compassion. Le seul moyen maintenant pour attirer de la compassion serait d'être absolument irréprochable. Malheureusement, quand on est une personne, on est forcément plein de contradictions, et donc personne ne mérite d'empathie. Le problème c'est que si quelqu'un décide d'assumer sa responsabilité dans quelque chose qu'il a pu faire, il est exclu de toute forme de soutien, du fait de l'absence d'empathie générale.
TN : Entre le niveau des relations personnelles, celui de l'État et de sa politique et celui de la géopolitique internationale, tu montres qu'il existe un lien dans le rapport à la violence que l'on retrouve dans l'usage d'un certain vocabulaire présent pour chacune des trois dimensions (comme « agresseur » par exemple). Est-ce que tu peux préciser la différence que tu fais entre conflit et agression ?
Le conflit est une lutte d'intérêt et de pouvoir, alors que l'agression est le fait d'exercer du pouvoir sur une personne. Par exemple, la politique israélienne concernant les Palestiniens constitue un abus puisque ce sont les Israéliens qui décident de ce qui se passe en Palestine. De leur côté, les Israéliens retraduisent l'abus en conflit, mais c'est un mésusage de la langue qui leur permet de dissimuler leurs culpabilités. Dans mon livre je précise bien qu'il est indispensable de faire du cas par cas et de regarder précisément pour chacun d'eux quelle en est la configuration précise. Aujourd'hui l'agresseur, qui se fait passer pour une victime, est celui qui va avoir accès en priorité à l'appareil d'État répressif. Il va étatiser sa position de victime aux moyens des communications contemporaines.
TN : L'État sécuritaire a-t-il pour corollaire le statut « factice » de victime ?
Quand tu as été socialisé dans un groupe dominant, et quand on t'a toujours appris à te sentir supérieur, tu te sens en sécurité, « safe », quand tu n'as pas à te remettre en question. Quand un bourgeois ne se sent pas en sécurité, c'est simplement qu'il est remis en question. Le bourgeois considère comme un droit le fait de ne jamais être mal à l'aise, c'est-à-dire remis en question. Les gens confondent le malaise et le danger. Par exemple, une personne raciste va projeter un sentiment d'insécurité sur l'extérieur, alors qu'en fait c'est un malaise intérieur qui n'est pas un danger réel. Pour bien distinguer les deux, il faut revenir à la définition faite précédemment entre conflit et agression. Si un abus est caractérisé par le fait d'exercer un pouvoir sur une personne, on peut donc définir un danger comme le fait qu'indépendamment de toute action possible, tu es quand même en danger sans que ta responsabilité ne puisse rien y changer.
TN : Tu dis également que la surexploitation du terme « agression » est préjudiciable aux vraies victimes…
Quand quelqu'un, qui est en position de pouvoir, prétend subir un abus ou une agression, c'est une manière d'invisibiliser, de dissimuler son pouvoir réel et effectif.
TN : Penses-tu qu'il existe un lien entre la « surestimation du préjudice » et le fait d'être aveugle à la question de la race ?
Aujourd'hui en 2021 aux États-Unis la question de la race est une problématique centrale dans la culture américaine. Lorsque des nazis envahissent le Capitole, ils repartent chez eux sans encombre, alors qu'une personne noire peut se faire tuer dans la rue à cause de sa couleur de peau. Il y a une inversion de la hiérarchie des rôles entre l'agresseur et la victime. Par exemple, les blancs anxieux à propos des questions raciales vont se présenter comme des victimes alors qu'ils portent en réalité une forme de responsabilité.
Chez vous, en France, il existe une certaine islamophobie, y compris au sein des milieux féministes. Dès que la question de l'islamophobie est soulevée, les gens la repoussent et adoptent la position de victime venant d'être accusée à tort. J'espère que ce livre contribuera à apporter du changement dans ces attitudes.
TN : Et pour les queers ?
Les hommes gays blancs avec un certain statut social ont accès à presque toutes les positions de pouvoir. Les personnes réfugiées, les migrants, ce sont les personnes vraiment queer aujourd'hui. Le principe de division, c'est la race et la classe.
TN : Comment as-tu vécu le mouvement Black Lives Matter ?
Le monde entier a pu réaliser avec la prise du Capitole que la police américaine comptait beaucoup de suprématistes blancs, de racistes, d'antisémites… C'est une question globale qui a pour enjeu la refonte des institutions policières et judiciaires aux États-Unis. Et ce n'est pas Joe Biden qui le fera. Il y a une incarcération massive des noirs aux États-Unis et la prison fait partie intégrante des dispositifs construisant la suprématie blanche. Les gens qui ont pris le capitole, les groupes néonazis… prétendent être les victimes des personnes noires. Ce qui valide ma théorie !
TN : Tu prends en exemple un problème que tu as eu avec un élève. Comment cela a-t-il alimenté ta réflexion ?
C'était un élève qui était amoureux de moi et qui m'écrivait beaucoup sur internet. Des collègues m'ont alors dit que c'était du harcèlement, qu'il fallait que je prévienne le directeur de l'établissement, même si cela devait entrainer des conséquences et détruire la vie de cet étudiant. Ils m'enfermaient dans une position de victime ! Le problème, c'est qu'ils ne m'ont jamais dit d'aller voir l'élève et de lui parler ; lui demander pourquoi il faisait ça, tout simplement. Finalement je l'ai appelé, je lui ai dit que je ne pouvais plus être son professeur et qu'il devait changer de classe. Nous avons convenu de discuter pour résoudre ce conflit. Et en fait ça s'est résolu comme ça, au bout de trois discussions, il y avait des signaux qui avaient été mal interprétés de sa part, et puis voilà, ce sont des choses qui arrivent.
TN : Cela rejoint des critiques que tu émets à propos du “Call out” et du “Trigger Warning”.
Est-ce que c'est en France maintenant tout ça ? On ne peut pas contrôler l'état du monde. Si, dès que quelqu'un dit quelque chose qui te bouscule et que tu quittes la salle de classe, rien ne va pouvoir se passer puisqu'on ne peut pas parler. Un des principes de l'éducation, c'est quand même de pouvoir discuter des choses même si elles sont complexes.
TN : Ton livre semble entièrement traversé par ta position singulière de romancière même dans un écrit politique comme celui-ci…
Je ne suis pas une universitaire. Mes livres ne sont pas une somme de références et de notes de bas de page. Je me contente de partager des idées en invitant le lecteur au désaccord.
TN : Quelle réception a eu ce livre aux États-Unis ?
C'est très intéressant cette question de la réception. C'était mon dix-neuvième livre et j'ai été incapable de le publier aux États-Unis. Il a été rejeté de toute part, par toutes les maisons d'édition, les grandes comme les petites, celles de gauche… et je l'ai publié au Canada dans une toute petite maison d’édition queer à Vancouver, de l'autre côté du continent. Et je pensais que jamais personne n'allait lire ce livre et qu'il allait tomber dans l'oubli. Mais des gens l'ont trouvé – je ne sais pas comment – et ont commencé à en parler sur internet. Et ça a poussé, poussé, poussé… Le livre n'était pas « marchandisé » (ici ce mot prend le sens d'appartenir à un circuit commercial de distribution et de mise en valeur du produit, n.d.e) il n'y avait pas de publicité, rien. Et maintenant, j'ai vendu presque 40.000 exemplaires de ce petit livre. Je crois que les lecteurs sont en avance sur l'industrie du livre.
TN : Comment expliques-tu ce rejet ?
C'est compliqué. Aux États-Unis la question de la Palestine fait resurgir des angoisses très fortes. L'utiliser comme exemple majeur pour élargir la question de la violence à un problème plus général n'est tout simplement pas possible.
TN : Qu'est-ce qui t'a fait écrire ce livre ?
Ce livre est une déconstruction de la propagande que l'on m'a longtemps assénée à propos de la situation palestinienne. Je suis née 13 ans après la fin de l'holocauste, une grande partie de ma famille y est morte. Ma famille était persuadée que les juifs étaient les personnes les plus persécutées du monde, et donc ils ont pris la résistance palestinienne comme une énième attaque qui venait du dessus, comme une nouvelle attaque contre les juifs. Et du coup il fallait renverser la perspective, accepter de reconnaître que c'était eux qui étaient devenus les agresseurs. Les juifs qui soutiennent la fin de l'occupation sont vus comme des traitres. Ce qui est vraiment difficile, c'est d'être suffisamment autocritique pour se dire que ma position de victime est factice.
TN : Tu as des projets en cours ?
Je viens de publier Let the record show, a political history of Act Up New York 1987-1993 retraçant l'histoire d'Act Up. C'est un travail dense de 800 pages qui sortira au mois de mai. Et j'espère qu'il sera traduit en Français.
Entretien paru initialement sur TROU NOIR.ORG

LE CONFLIT N’EST PAS UNE AGRESSION
RHÉTORIQUE DE LA SOUFFRANCE, RESPONSABILITÉ COLLECTIVE ET DEVOIR DE RÉPARATION
Sarah Schulman Traduit de l’anglais par Julia Burtin Zortea et Joséphine Gross.
23.00€ B42-148

À PROPOS DE TROU NOIR
Pourquoi lancer un nouveau site sur la dissidence sexuelle ?
Il est toujours compliqué de prévoir à l’avance la suite des évènements. D’autant que la séquence temporelle dans laquelle nous sommes (des mouvements de révolte partout dans le monde, la montée en force d’un néoconservatisme fascistoïde, la catastrophe écologique qui devient sensible, etc.) semble échapper à nos vieilles catégories de pensée et d’analyse. Plutôt que de céder à la panique qui ne produit jamais rien de bon, plutôt que de se faire avoir par les discours apocalyptiques ambiants, il s’agit bien de se poser, de prendre le temps de penser, de farfouiller le passé, et de se demander à quoi pourrait ressembler un avenir désirable. Nous avons besoin de bien comprendre ce qui se passe actuellement, de mettre les bons mots dessus, pour ne plus mettre toute notre énergie à combattre des moulins à vent qui nous semblaient pourtant si menaçants.
Ce qui nous a donné envie d’agir, c’est de voir à quel point les luttes LGBT+ et féministes étaient les idiots utiles de la partition du monde entre « progressistes » et « conservateurs ». Mais voyant les « progressistes » devenir de plus en plus autoritaires, et les « conservateurs » se convertir au néolibéralisme, nous nous sommes rendu compte que la distinction ne tenait plus.
Notre démarche est donc celle de trouver de nouveaux mots, de nouvelles grilles d’analyses politiques pour comprendre les luttes dites « minoritaires » dans notre époque compliquée, comme de mettre en procès les anciens pour juger de leur pertinence.
Renouveler la critique ne veut pas dire oublier le passé, mais au contraire comprendre d’où vient la situation présente. Nous nous sommes rendu compte que nous connaissions mal notre propre histoire minoritaire. Nous pensons que cette mémoire des luttes est cruciale pour agir maintenant, et qu’archiver, c’est aussi lutter contre l’oubli et les réécritures de l’histoire. C’est une des missions que s’est donné Trou Noir.
Il s’agira de s’intéresser également à l’international, car, des révoltes féministes en Amérique du Sud au génocide des homosexuels en Tchétchénie, les évènements ne manquent pas. Ce qui se passe à l’étranger est trop peu connu, et mérite d’être bien raconté et expliqué, et nous essayerons tant bien que mal de le faire.
Enfin, notre dernier axe est proprement culturel, car il nous semble que cinéma, littérature et musique sont particulièrement liées à la dissidence sexuelle et aux luttes minoritaires. Ces arts ont formé un imaginaire qui alimente les luttes actuelles, et nous avons eu envie de les explorer.
http://trounoir.org/
16.08.2024 à 11:15
L'existence déployée ou l'existence éternellement créatrice
L'Autre Quotidien

Texte intégral (976 mots)

" Il est intéressant que les philosophes Hikmat (Ndt : la théosophie transcendante ou al-hikmat al-muta’li (حكمت متعالي) issue de Perse) en soient venus de cette manière à considérer la Réalité ultime comme " l'existence pure ", c'est-à-dire " l'existence " dans sa forme absolue. Ce fait est intéressant car dans d'autres traditions de la philosophie orientale, comme le taoïsme et le bouddhisme zen par exemple, précisément la même entité est conçue comme le Néant. À la base de cette conception négative se trouve la prise de conscience que l'Absolu, dans son absolu transcendant, se situe au-delà de l'opposition entre "existence" et "non-existence". De ce Néant métaphysique sans limite et sans commencement apparaît l'Existence, et à travers l'Existence, l'infinité d'existences concrètes s'épanouit pour constituer le monde de l'Être. Il est cependant facile d'observer que ce Néant absolu - le "Néant oriental" comme on l'appelle souvent - correspond exactement, même dans sa nature conceptuelle négative, à la conception d'Ibn 'Arabi du Mystère des mystères. Ainsi, l'Existence, qui dans les traditions non-islamiques n'apparaît que comme le stade qui suit immédiatement le Néant, correspond dans le système d'Ibn'Arabi au deuxième stade de l'"existence", le stade de la théophanie où se révèle l'"existence" du premier stade. Dans la philosophie Hikmat, ce deuxième stade de l'"existence" est conçu comme "l'existence déployée" ou "l'existence éternellement créatrice" (wujud munbasit), tandis que le premier stade de l'"existence" est appelé, comme nous venons de le voir, "existence pure", c'est-à-dire "l'existence" dans sa pureté absolue. "
Toshihiko Izutsu, La structure fondamentale de la métaphysique de Sabzawari.
Toshihiko Izutsu, né le 4 mai 1914 et mort le 1er juillet 1993, est un islamologue, linguiste et philosophe japonais, qui parlait une trentaine de langues. Spécialiste de l'islam et du bouddhisme, il a été professeur à l'Institut d'Études culturelles et de linguistique de l'Université Keio à Tokyo, à l'Iranian Research Institute of Philosophy de Téhéran et à l'Université McGill à Montréal.

Mulla Hadi Sabziwari
10.08.2024 à 18:18
Terra Forma et la géographie alternative
L'Autre Quotidien

Texte intégral (3762 mots)
Ce livre raconte l’exploration d’une terre inconnue, la nôtre. À la suite des voyageurs de la Renaissance partis cartographier les terra incognita du Nouveau Monde, nous entreprenons, cinq siècles plus tard, de découvrir une autre Terre, ou plutôt de redécouvrir autrement celle que nous croyons si bien connaître. Mais nous ne sommes plus au temps des Grandes Découvertes. Notre voyage se fera vers l’intérieur et non vers les lointains, en épaisseur plutôt qu’en étendue. Un formidable exercice à trois voix de géographie alternative, conceptuelle et visuelle, pour inventer une nouvelle manière de cartographier le monde, mobile et vivant.

Ce livre raconte l’exploration d’une terre inconnue, la nôtre. À la suite des voyageurs de la Renaissance partis cartographier les terra incognita du Nouveau Monde, nous entreprenons, cinq siècles plus tard, de découvrir une autre Terre, ou plutôt de redécouvrir autrement celle que nous croyons si bien connaître. Mais nous ne sommes plus au temps des Grandes Découvertes. Notre voyage se fera vers l’intérieur et non vers les lointains, en épaisseur plutôt qu’en étendue. S’il revient aux cosmographes d’avoir élargi l’horizon, fait de la cartographie un art associant le mouvement et la trace, notre quête s’est en quelque sorte inversée : nous avons changé de cap, passant de la ligne d’horizon à l’épaisseur du sol, du global au local. Nous avons aussi changé d’allure, de posture, de ton. Aux passions scientifiques de la curiosité et de la découverte se sont substituées la nécessité et l’urgence. Le sentiment d’un monde illimité à conquérir – le Plus Ultra de Charles Quint, des explorateurs et de Francis Bacon – est remplacé par la conscience croissante des « limites planétaires ». L’innocence des premiers voyageurs est perdue : nous savons désormais que les expéditions sont mortelles. Nous savons à quelles conquêtes et prises de terres elles ont conduit. Mais il ne s’agit pas de se complaire dans les ruines ou d’abandonner la tâche de découvrir. À lire les chercheurs, éthologues et ethnologues, géochimistes et biologistes qui ne cessent de repeupler notre monde, d’en mettre en lumière de nouvelles dimensions, il semble que nous soyons beaucoup plus nombreux et beaucoup plus divers que nous le pensions, et que les limites du monde ne soient pas celles que nous connaissions. Prenons par exemple le sol sur lequel nous habitons sans savoir de quoi il est fait, de quoi il est peuplé. Depuis quelques décennies, l’action des animés, des roches, des paysages interroge nos anciennes façons de considérer les territoires et d’agir sur eux ; on ne peut plus ignorer l’action de la Terre en réaction à nos propres activités, qui se manifeste avec de plus en plus de véhémence et de rapidité.
Comment habiter ce monde fait d’autres vies que les nôtres, cette Terre réactive ? Les cartes telles que nous les connaissons disent un rapport à l’espace vidé de ses vivants, un espace disponible, que l’on peut conquérir et coloniser. Il nous fallait donc pour commencer tenter de repeupler les cartes. Nous avons pour ce faire déplacé l’objet de la notation en tentant de dessiner non plus les sols sans les vivants, mais les vivants dans le sol, les vivants du sol, en tant qu’ils le constituent. Cette cartographie du vivant tente de noter les vivants et leurs traces, de générer des cartes à partir des corps plutôt qu’à partir des reliefs, frontières et limites d’un territoire.
Pour ce magnifique ouvrage finement et abondamment illustré, publié en 2019 aux éditions B42 (dont la passionnante aventure en matière d’urbanisme et d’architecturepolitiques nous enchante depuis de nombreuses années – souvenons-nous par exemple de leur magnifique « Lieux infinis – Construire des bâtiments ou des lieux ? » de 2018), la philosophe Frédérique Aït-Touati (qui se définit aussi, logiquement, comme historienne des sciences – on songera à son si précieux « Contes de la Lune – Essai sur la fiction et la science modernes » de 2011, par exemple – et comme metteure en scène de théâtre – on vous parlera prochainement sur ce même blog de sa « Trilogie terrestre » créée avec le si regretté Bruno Latour) a collaboré avec deux architectes dédiées au paysage et à la stratégie territoriale, Alexandra Arènes et Axelle Grégoire. Comme l’indique le sous-titre de l’ouvrage (« Manuel de cartographies potentielles »), elles sont ici « réunies autour d’une fascination commune pour la capacité des cartes à déployer des mondes », pour nous proposer une intense réflexion et un défrichage conceptuel, visuel (naturellement) et technique autour des possibilités désormais offertes, à qui voudrait enfin les saisir, de penser autrement nos cartographies d’un monde qui ne soit plus figé et offert au mieux capitalisé, mais mobile, vivant et radicalement soucieux d’altérité.

Depuis quelques années, un nouveau type de cartes semble réagir justement à l’activité des acteurs : les cartes GPS. Notre pensée de l’espace et du mouvement a été profondément modifiée par l’apparition de cet outil qui localise les positions d’un point sur un fond de carte fixe grâce à plusieurs satellites en orbite. Le GPS trace l’activité des acteurs, capte les déplacements des vivants sur une carte prédéfinie, leur permet de se repérer dans l’espace. Chacun peut ainsi générer son propre tracé, son propre chemin, naviguer à l’intérieur d’un espace dont les paramètres sont déterminés a priori. Ces cartes n’ont plus grand-chose à voir avec la fabrication des cartes anciennes qui se dessinaient essentiellement en parcourant soi-même le terrain ou bien en écoutant le récit des autres revenant de voyage. Les satellites offrent de la précision dans la géodésie, ils renseignent le contour des lignes, signalent les évolutions, révèlent les métamorphoses des territoires. Ils perdent cependant en récit, en assemblage d’histoires contées, en multiplicité des personnes et des narrateurs qui permettaient à la carte d’être une synthèse, d’être unique et multiple à la fois.
Pourrions-nous, tout en gardant cette formidable transformation dans l’appréhension des cartes – par le vivant et non plus par une situation fixe -, inventer l’outil qui nous permettrait non seulement de suivre les trajectoires des vivants, mais aussi de comprendre comment ceux-ci façonnent les espaces, les engendrent sans cesse ? Car les vivants font bien plus que se déplacer ; ils manipulent l’air et la matière pour créer les conditions de leur survie, parfois en coopération avec d’autres vivants qui ont besoin de conditions similaires ou complémentaires, parfois en désaccord avec d’autres collectifs, voire de façon contre-productive et autodestructrice dans le cas de l’homme et de la pollution qu’il génère. Dans ce GPS d’un nouveau genre, ce sont les points vivants qui créent l’espace, définissent leurs propres paramètres, engendrent la carte. Le statut de la carte en est modifié : elle n’est plus un dessin fixe mais un état provisoire du monde, un outil de travail en évolution, constamment fabriqué par les vivants. Le statut de l’espace en est modifié : il n’est plus simple contenant, mais milieu vivant, vibratile, composé des mille superpositions et actions qui nous entourent, constamment et indéfiniment produit par les mouvements et les perceptions de ceux qui le font.

Portées par le souffle des mutations de la cartographie, pas tant dans la technologie, finalement, que dans l’esprit et la substance (toujours plus systémique), il s’agit bien pour elles de porter les indispensables changements de référentiels et de systèmes de mesures. « C’est le point de vue qui terraforme les localités du globe, mais il ne le fait pas seul » : en passant minutieusement en revue (par une saisissante interaction du texte et du dessin) ces mutations en cours pouvant être étendues et généralisées, mobilisant aussi bien les travaux des géographes de métier, bien entendu, que ceux, plus hybrides et transversaux, d’Anna Tsing, de Donna Haraway ou de Francesco Careri, parmi bien d’autres, elles ouvrent aussi (ce qui ne nous surprend pas et nous réjouit) des espaces d’interaction avec la poésie et avec la fiction. « De la peau au territoire-monde, la carte est accompagnée d’une série de coupes qui établissent des liens directs et transversaux entre la physiologie biologique et la physiologie du territoire » : Philippe Vasset (avec son « Livre blanc » comme avec sa « Conjuration ») est fort logiquement directement cité, mais on pourrait aisément capter en filigrane les présences de Gary Snyder et de ses bassins versants (« Le sens des lieux »), d’Emmanuel Ruben et de ses frontières archipélagiques (avec « Sous les serpents du ciel » comme avec « Terminus Schengen »), d’Albert Sanchez Piñol et de ses frontières pyrénéennes à la brume fantasmagorique (« Fungus – Le roi des Pyrénées »), de Catherine Leroux et de ses espaces fluvio-sylvestres réinventés dans les friches et les déchetteries (« L’avenir »), de luvan et de ses « Splines » ultra-mémorielles, voire de Malvina Majoux et de ses taupes anarchisantes (on trouvera en effet ici, entre autres merveilles, un « synopsis de la création d’un paysage entre un agent commercial, une taupe et un micro-organisme »). On trouvera aussi, sous forme de cas d’école particulièrement savoureux d’une médication obsolète, la « ventouse », ou « mise sous cloche d’un territoire pour exploitation des ressources », et c’est ainsi que les trois autrices, avec rigueur et imagination, rendent aussi un formidable et paradoxal hommage à Yves Lacoste, en démontrant avec éclat que la géographie peut ne pas d’abord servir à faire la guerre (économique ou non).
Quel est ce nouveau centre configurateur ? Depuis quelle perspective, ou point de vue, définir notre territoire ? Après avoir abandonné le point de vue de Sirius, ce point de vue aérien, en surplomb et en apesanteur, globalisant une vision de la Terre, nous avons, avec le modèle Sol, tenté de retrouver la pesanteur et la matière de la Terre, identifié ses dynamiques activées par les organismes vivant ou ayant vécu jadis à sa surface, aujourd’hui enfouis dans ses profondeurs. Le modèle Sol a révélé un espace plein (d’organismes vivants, d’objets qui font sujets, de mémoire et d’histoire) plutôt que vide ; il a donné à voir une matière vibratile sans cesse recomposée par chaque mouvement plutôt qu’une surface dégagée à parcourir (ou à conquérir). Il ne nous reste donc plus qu’à réinvestir un point de vue terrien. Le deuxième modèle est une tentative pour représenter le monde à partir d’un corps animé, point vif ou « point de vie », selon la belle formule d’Emanuele Coccia, pour tenter d’esquisser une carte des espaces-corps actifs – pas d’espace sans corps ni de corps sans espace. Le point de vie se présente alors comme un questionnement du point GPS que l’on a désormais pris l’habitude de voir se déplacer sur la carte. Mais que cache ce point positionné à l’aide d’un système globalisé ? De quoi est-il en réalité composé ? Comment s’ancre-t-il au sol ? Comment se déplace-t-il ? Ces questions sont explorées dans ce modèle et le suivant, Paysages vivants.
De telles cartes supposent de dessiner ces animés, leurs mouvements, traces, rythmes, affects – autant de qualités que l’on nommait autrefois « secondes », ce qui permettait de les effacer de la carte, de les écarter du projet moderne de mathématisation du monde et de localisation par l’étendue. De fait, les entités du monde vivant qui sont représentées dans les cartes perdent un grand nombre de leurs caractéristiques, notamment le potentiel de croissance. Dans les cartes, les objets sont mesurés une fois pour toutes. Ainsi naît le standard : l’objet dessiné sur papier va être reproduit sans altération, avec les mêmes mesures. A contrario, l’approche choisie ici s’intéresse au vivant et lui donne priorité. Nous avons tenté dans les cartographies qui suivent de réimporter dans les représentations les dimensions potentielles supprimées.
Hugues Charybde le 17/01/2023
Frédérique Aït-Touati , Alexandra Arenes , Axelle Grégoire - Terra Forma, Manuel de cartographies potentielles - éditions B42
l’acheter chez Charybde ici

01.07.2024 à 14:45
Gaia et Chtonia. Par Giorgio Agamben
L'Autre Quotidien

Texte intégral (3303 mots)

Figueira. Denis Felix (voir son travail)
I.
En grec classique, la terre a deux noms, correspondant à deux réalités distinctes, voire opposées : ge (ou gaia) et chthon. Contrairement à une théorie populaire aujourd'hui, les hommes n'habitent pas seulement gaia, mais ont avant tout à voir avec chthon, qui dans certains récits mythiques prend la forme d'une déesse, dont le nom est Chthonìe, Ctonia. Ainsi, la théologie de Fécide de Syrus énumère au début trois dieux : Zeus, Chronos et Chthonìe et ajoute que "à Chthonìe a touché le nom de Ge, après que Zeus lui ait donné la terre (gen) en cadeau". Même si l'identité de la déesse reste indéfinie, Ge est ici comparée à elle une figure accessoire, presque un nom supplémentaire de Chtonii. Non moins significatif est le fait que chez Homère, les hommes sont définis avec l'adjectif epichtonioi (ctonii, debout sur chthon), alors que l'adjectif epigaios ou epigeios ne se réfère qu'aux plantes et aux animaux.
Le fait est que chton et ge désignent deux aspects géologiquement opposés de la terre : chton est la face extérieure du monde souterrain, la terre de la surface vers le bas, ge est la terre de la surface vers le haut, la face que la terre tourne vers le ciel. Cette diversité stratigraphique correspond à la dissimilitude des pratiques et des fonctions : chthon ne peut être cultivé ni nourri, il échappe à l'opposition ville/pays et n'est pas un bien que l'on peut posséder ; ge, en revanche, comme le rappelle avec force l'hymne homérique, "nourrit tout ce qui est chthon au-dessus" (epi chthoni) et produit des cultures et des biens qui enrichissent les hommes : pour ceux que ge honore de sa bienveillance, "les sillons vivifiants des serfs sont chargés de fruits, dans les champs le bétail prospère, et la maison est remplie de richesses, et ils gouvernent avec des lois justes les villes avec de belles femmes" (v. 9-11 ).
La théogonie de Fécide contient les plus anciennes preuves de la relation entre Ge et Chthon, entre Gaia et Chthonia. Un fragment conservé par Clément Alexandrinus, définit la nature de leur relation en précisant que Zeus s'unit en mariage avec Chthonìe, et, lorsque, selon le rite nuptial de l'anakalypteria, la mariée enlève son voile et apparaît nue au marié, Zeus la couvre d'"un grand et beau manteau", dans lequel "il a brodé de diverses couleurs Ge et Ogeno (Océan)". Chthon, le monde souterrain, est donc quelque chose d'abyssal, qui ne peut se montrer dans sa nudité, et la robe dont le dieu le couvre n'est autre que Gaïa, la terre céleste. Un passage de l'Antro des nymphes du Porphyre nous informe que Fécide a caractérisé la dimension chthonienne comme une profondeur, "parlant de recoins (mychous), de fossés (bothrous), de cavernes (antra)", conçus comme les portes (thyras, pylas) que les âmes franchissent à la naissance et à la mort. La terre est une double réalité : Chthonya est le fond informe et caché que Gaia recouvre de sa broderie bigarrée de collines, de campagnes fleuries, de villages, de bois et de troupeaux.
Dans la théogonie d'Hésiode, la terre a elle aussi deux visages. Gaia, "base ferme de toutes choses", est la première créature du Chaos, mais l'élément chthonos est évoqué immédiatement après et, comme dans Ferecide, défini avec le terme mychos : "le Tartare sombre dans les profondeurs de la terre avec les larges voies (mychoi chthonos eyryodeies)". La différence stratigraphique entre les deux aspects de la terre apparaît le plus clairement dans l'Hymne homérique à Déméter. Déjà au début, lorsque le poète décrit la scène de l'enlèvement de Perséphone alors qu'elle cueillait des fleurs, Gaïa est évoquée deux fois, dans les deux cas comme la surface fleurie que la terre tourne vers le ciel : "les roses, les crocus, les belles violettes dans une tendre prairie et les iris, les jacinthes et les jonquilles que Gaïa fait pousser selon la volonté du dieu" ... "à l'odeur de la fleur tout le ciel au-dessus et la terre a souri". Mais à cet instant précis, "chthon des vastes chemins s'est ouvert (chane) dans la plaine de Nisio et est sorti (orousen) avec ses chevaux immortels le seigneur des nombreux invités". Le fait qu'il s'agisse d'un mouvement du bas vers la surface est souligné par le verbe ornymi, qui signifie "s'élever, se lever", comme si du fond de la terre chthonienne le dieu émergeait sur Gaia, la face de la terre regardant vers le ciel. Plus tard, lorsque Perséphone elle-même raconte à Déméter son enlèvement, le mouvement est inversé et c'est plutôt Gaia (“gaia d'enerthe koresen”) qui s'ouvre, afin que "le seigneur des nombreux invités" puisse la traîner sous terre avec son char d'or (vv.429-31). C'est comme si la terre avait deux portes ou ouvertures, une qui s'ouvre des profondeurs vers Gaia, et une qui mène de Gaia dans l'abîme de Chthonia.
En réalité, il ne s'agit pas de deux portes, mais d'un seul seuil, qui appartient entièrement à Chthon. Le verbe auquel l'hymne fait référence, Gaia, n'est pas “chaino”, pour ouvrir grand, mais “choreo”, qui signifie simplement "faire de la place". Gaïa ne s'ouvre pas, mais fait place au transit de Proserpine ; l'idée même d'un passage entre haut et bas, d'une profondeur (profundus : altus et fundus) est intimement chthonique, et, comme le rappelle la Sibylle à Enée, la porte de Dite est d'abord tournée vers le monde souterrain (facilis descensus Avernus...). Le terme latin correspondant à chthon n'est pas tellus, qui désigne une extension horizontale, mais humus, qui implique une direction vers le bas (cf. humare, enterrement), et il est significatif que le nom de l'homme en ait été tiré (hominem appellari quia sit humo natus). Que l'homme soit "humain", c'est-à-dire terrestre, dans le monde classique n'implique pas un lien avec Gaïa, avec la surface de la terre regardant vers le ciel, mais avant tout un lien intime avec la sphère de profondeur chthonienne.
Que “chthon” évoque l'idée d'une lacune et d'un passage est évident dans l'adjectif qui, chez Homère et Hésiode, accompagne constamment le terme : “eyryodie”, qui ne peut être traduit "par la voie large" que si l'on n'oublie pas que “odos” implique l'idée d'un transit vers une destination, dans ce cas le monde des morts, un voyage que chacun est destiné à faire (il est possible que Virgile écrivant “facilitis descensus” se soit souvenu de la formule homérique).
A Rome, une ouverture circulaire appelée “mundus”, qui selon la légende aurait été creusée par Romulus lors de la fondation de la ville, mettait en communication le monde des vivants avec le monde chthonien des morts. L'ouverture, fermée par une pierre appelée “manalis lapis”, était ouverte trois fois par an, et ces jours-là, où l'on dit que le monde est ouvert, et que "les choses occultes et cachées de la religion des mains sont mises en lumière et révélées", presque toute activité publique était suspendue. Dans un article exemplaire, Vendryes a montré que la signification originale de notre terme "monde" n'est pas, comme on l'a toujours prétendu, une traduction du “kosmos” grec, mais découle précisément du seuil circulaire qui a révélé le "monde" des morts. La cité antique est fondée sur le "monde" parce que les hommes habitent dans l'ouverture qui unit la terre céleste et le sous-sol, le monde des vivants et le monde des morts, le présent et le passé, et c'est par la relation entre ces deux mondes qu'il leur devient possible d'orienter leurs actions et de trouver l'inspiration pour l'avenir.
Non seulement l'homme est lié en son nom même à la sphère chthonienne, mais son monde et l'horizon même de son existence frôlent les recoins de la Chthonie. L'homme est, au sens littéral du terme, un être des profondeurs.

Corylus. Denis Felix (voir son travail)
II.
Une culture chthonienne par excellence est celle des Étrusques. Ceux qui marchent avec consternation dans la nécropole éparpillée dans la campagne de Tuscia perçoivent immédiatement que les Étrusques vivaient à Chthonie et non à Gaia, non seulement parce que ce qui reste d'eux est essentiellement ce qui avait trait aux morts, mais aussi et surtout parce que les sites qu'ils ont choisis pour leurs habitations - les appeler villes est peut-être impropre - bien qu'ils soient apparemment à la surface de Gaia, sont en fait des “epichthonioi”, ils sont chez eux dans les profondeurs verticales de Chthon. D'où leur goût pour les cavernes et les recoins taillés dans la pierre, d'où leur préférence pour les hauts ravins et les gorges, ces parois abruptes en pierre de Peperino qui plongent vers une rivière ou un ruisseau. Ceux qui se sont soudain retrouvés devant la Cava Buia près de Blera ou dans les rues creusées dans la roche à S. Giuliano savent qu'ils ne sont plus à la surface de Gaia, mais certainement “ad portam inferi”, dans un des passages qui pénètrent les pentes de la Ctonia.
Ce caractère incontestablement souterrain des lieux étrusques, si on le compare à d'autres districts d'Italie, peut également s'exprimer en disant que ce que nous avons sous les yeux n'est pas vraiment un paysage. Le paysage affable et habituel qui est sereinement embrassé par le regard et les intrusions à l'horizon appartient à Gaia : dans la verticalité chthonienne, tout paysage se dilue, tout horizon disparaît et laisse sa place au visage brutal et invisible de la nature. Et ici, dans les fossés et les ravins rebelles, on ne saurait que faire du paysage, le pays est plus tenace et inflexible que n'importe quelle “pietas” de paysage - à la porte de Dis, le dieu est devenu si proche et inébranlable qu’il n’exige plus de religion.
C'est grâce à ce dévouement chthonien inébranlable que les Étrusques construisaient et surveillaient les habitations de leurs morts avec un soin assidu, et non, comme on pourrait le penser, l'inverse. Ils n'aimaient pas la mort plus que la vie, mais la vie était pour eux inséparable des profondeurs de la Chthonie ; ils ne pouvaient habiter les vallées de Gaia et cultiver la campagne que s'ils n'oubliaient jamais leur véritable demeure verticale. C'est pourquoi, dans les tombes creusées dans la roche ou dans les monticules, on ne s'occupe pas seulement des morts, on n'imagine pas seulement les corps gisant sur les sargophages vides, mais on perçoit aussi les mouvements, les gestes et les désirs des vivants qui les ont construits. Que la vie est d'autant plus aimable qu'elle porte en elle la mémoire de la Chthonie, qu'il est possible de construire une civilisation sans jamais exclure la sphère des morts, qu'il existe entre le présent et le passé et entre les vivants et les morts une communauté intense et une continuité ininterrompue, tel est l'héritage que ce peuple a transmis à l'humanité.

Davidlya. Denis Felix (voir son travail)
III.
En 1979, James E. Lovelock, un chimiste britannique qui avait participé activement aux programmes d'exploration spatiale de la NASA, a publié “Gaia : a New Look at Life on Earth”. Au cœur du livre se trouve une hypothèse qu'un article écrit avec Lynn Margulis cinq ans plus tôt dans la revue Tellus avait anticipée en ces termes : "l'ensemble des organismes vivants qui composent la biosphère peut agir comme une seule entité pour réguler sa composition chimique, le pH de surface et peut-être même le climat. Nous appelons l'hypothèse Gaia la conception de la biosphère comme un système actif de contrôle et d'adaptation, capable de maintenir la terre en homéostasie". Le choix du terme Gaia, qui a été suggéré à Lovelock par William Golding - un écrivain qui avait magistralement décrit la vocation perverse de l'humanité dans le roman “Lord of the Flies” - n'est certainement pas accidentel : comme le souligne l'article, les auteurs ont identifié les limites de la vie dans l'atmosphère et ne se sont "intéressés que dans une moindre mesure aux limites internes constituées par l'interface entre les parties internes de la terre, non soumises à l'influence des processus de surface" (p. 4). Non moins significatif, cependant, est un fait que les auteurs ne semblent pas - du moins à l'époque - prendre en considération, à savoir que la dévastation et la pollution de Gaia ont atteint leur plus haut niveau juste au moment où les habitants de Gaia ont décidé de puiser l'énergie nécessaire à leurs nouveaux besoins croissants dans les profondeurs de la Chthonie, sous la forme de ce résidu fossile de millions d'êtres vivants vivant dans un passé lointain que nous appelons pétrole.
Selon toute évidence, l'identification des limites de la biosphère avec la surface de la terre et l'atmosphère ne peut être maintenue : la biosphère ne peut exister sans l'échange et l'"interface" avec la tanatosphère chthonique, Gaia et Chthonia, les vivants et les morts doivent être pensés ensemble.
Ce qui s'est passé dans la modernité est, en fait, que les hommes ont oublié et supprimé leur relation avec la sphère chthonienne, ils n'habitent plus Chthon, mais seulement Gaia. Mais plus ils éloignaient la sphère de la mort de leur vie, plus leur existence devenait invivable ; plus ils perdaient toute familiarité avec les profondeurs de la Chthonie, réduite comme toute chose à un objet d'exploitation, plus l'aimable surface de Gaia était progressivement empoisonnée et détruite. Et ce que nous avons sous les yeux aujourd'hui, c'est la dérive extrême de cette suppression de la mort : pour sauver leur vie d'une menace supposée et déroutante, les hommes abandonnent tout ce qui fait qu'elle vaut la peine d'être vécue. Et finalement Gaia, la terre sans profondeur, qui a perdu tout souvenir de la demeure souterraine des morts, est maintenant entièrement à la merci de la peur et de la mort. Cette peur ne peut être guérie que par ceux qui retrouvent le souvenir de leur double demeure, qui se souviennent que l'humain n'est que cette vie dans laquelle Gaia et Chthonia restent inséparables et unies.
Giorgio Agamben
article original paru dans Quodlibet
05.06.2024 à 13:58
Le grand bluff des neurosciences, par Riccardo Manzotti
L'Autre Quotidien

Texte intégral (5867 mots)
Dogmes, impasses et controverses non résolues dans l'étude empirique de la conscience

Parfois, en science, on assiste à un phénomène semblable aux bulles spéculatives dans le domaine économique : pendant des décennies, un problème insoluble absorbe des ressources et des investissements, de plus en plus et sans réel progrès. Les chercheurs continuent de proposer des solutions infructueuses et d'en appeler à la politique du "premier pas": il faut commencer quelque part et c'est le mieux que l'on puisse faire. Mais on reste toujours dans la case de départ. Plus qu'un premier pas, c'est un pas sur place.
Cette situation décrit l'état de la recherche sur la conscience dans le domaine des neurosciences où, comme dans une guerre de position, au lieu de s'affronter en plein champ, on passe plus de temps à fortifier les tranchées et à demander des fonds. Un peu comme la forteresse Bastiani du roman de Dino Buzzati, la plupart ne semblent pas chercher le corps à corps avec le véritable ennemi, se limitant à des exercices au cours desquels ils décernent des médailles et des insignes qui ont pour seule fonction de justifier l'obtention de titres et de prix. Dans la recherche neuroscientifique sur la conscience, l’ennemi qui ne peut jamais être engagé dans un combat est le difficile problème de la conscience, et une armée de neuroscientifiques et de spécialistes des sciences cognitives, malgré ses manœuvres continues, ne l’affronte jamais directement.
Depuis les recherches pionnières des grands neurophysiologistes allemands et italiens du XIXe siècle, nous avons continué à rechercher quelque chose qui soit l’équivalent physique de notre conscience. Il a été trouvé ? Le niveau de (faibles) corrélations entre l’activité cérébrale et l’expérience n’a jamais été dépassé – une idée raisonnable qui circulait déjà au XVIe siècle, à l’époque d’André Vésale. À ce jour, il n'existe aucune théorie qui explique de manière compréhensible comment et pourquoi l'activité chimique et électrique d'un système nerveux doit ou peut devenir quelque chose de totalement différent, comme des sensations, des perceptions, des émotions et des pensées.
La conscience reste un miracle mystérieux comme la transformation de l'eau en vin ou l'apparition du génie lorsqu'on frottait la lampe d'Aladin.
La conscience reste un miracle mystérieux comme la transformation de l'eau en vin.
Une note personnelle pas tout à fait inutile : le soussigné est présent à toutes les conférences internationales sur la conscience depuis 1994, année fatidique où un grand groupe de scientifiques célèbres (de Gerard Edelmann à Francis Crick, de Roger Penrose à Daniel Dennett) ont mis l'accent sur sur la conscience comme problème scientifique. A-t-on avancé depuis ? Non. L’horizon de la conscience reste toujours inaccessible et, d’un point de vue empirique, aucun progrès réel n’a été réalisé. Pour corroborer cette affirmation, je me souviens qu'il y a vingt-cinq ans et au nom des neurosciences, Christoph Koch avait parié que le mécanisme par lequel le réseau dense de neurones de notre cerveau produit la conscience serait découvert d'ici 2023. Fin juin Année fatidique, sur la scène du 26e Congrès de l' Association pour l'étude scientifique de la conscience tenu à New York, Koch a admis qu'il avait perdu le pari.
Une démonstration encore plus convaincante est fournie (involontairement) par deux récents articles programmatiques des prestigieuses revues Science et Nature Review Neuroscience , que j'utiliserai comme représentation emblématique de l'état actuel des neurosciences en ce qui concerne l'étude empirique de la conscience. Mon objectif est de montrer comment les neurosciences se retrouvent dans une impasse déguisée en recherche scientifique pour soutenir une politique de recherche comme fin en soi. Les deux articles sont rédigés pour jeter un éclairage optimiste sur les progrès réalisés en neurosciences au cours de « décennies de recherche fructueuse » et pour justifier un financement supplémentaire en soulignant « de nouvelles lignes de recherche prometteuses ».
Dans le premier des deux articles, certains des neuroscientifiques les plus réputés au monde – Lucia Melloni, Liad Mudrik, Michael Pitts et Christof Koch – admettent que, malgré les prétendus progrès empiriques, « les hypothèses avancées par les différentes théories aboutissent à des déclarations divergentes ». et des prédictions qui ne peuvent pas toutes être vraies en même temps. » C’est une affirmation surprenante : d’un côté ces théories auraient supposé un soutien empirique et de l’autre elles ne seraient pas toutes vraies. La nature est-elle schizophrène ?
L’horizon de la conscience reste toujours inaccessible et, d’un point de vue empirique, aucun progrès réel n’a été réalisé.
D’un autre côté, comment tester une théorie neuroscientifique sur la conscience après avoir supposé qu’elle est inobservable ? La réaction des neurosciences est collective : seules « les théories qui s’expriment en termes neurobiologiques ou qui sont capables de formuler des énoncés exprimables en termes neurobiologiques » sont prises en considération, peut-on lire dans le deuxième des deux articles examinés ici. Il est singulier que les auteurs de ces articles invoquent comme méthode d'analyse une stratégie définie comme une collaboration contradictoire ou une « coopération compétitive » entre écoles de pensée : en pratique, un tournoi entre les bons.
Les auteurs sélectionnent des théories influentes qui, selon eux, mériteraient d’utiliser la majeure partie du financement. Par exemple, ils choisissent la théorie de l'espace de travail neuronal, ou GTNO, et la théorie de l'information intégrée, ou IIT. Ce sont sans aucun doute des théories intéressantes qui ont permis de formuler des expériences au cours des vingt dernières années. Mais que disaient-ils de la conscience ? Fondamentalement rien car, pour le véritable problème de la conscience, ils ont remplacé d’autres phénomènes plus traitables au sein des neurosciences.
À cet égard, il est instructif de voir comment se pose le problème de la conscience elle-même. Dans le premier des articles examinés, les auteurs demandent « où sont les empreintes anatomiques de la conscience dans le cerveau ? Sont-ils situés dans la zone chaude du cortex postérieur comme le prétend l’IIT ou sont-ils situés dans le cortex préfrontal comme le prédit le GTNO ? Notons que la conscience n'est jamais l'objet d'une observation directe, mais seulement de ses « empreintes anatomiques » qui, évidemment, sont décidées par les théories en jeu et ne prouvent donc, en elles-mêmes, rien. Le fait que certains processus neuronaux se produisent dans une zone du cerveau plutôt que dans une autre ne dit pas pourquoi de tels processus devraient devenir ou produire quelque chose d'aussi inattendu, voire incongru, que la conscience. C'est le jeu rhétorique habituel, une sorte de faux-fuyant : le vrai problème est échangé contre un problème alternatif qui retient toute l'attention même s'il n'explique rien. C'est encore une fois la « première étape », mais toujours sur place.
Comment tester une théorie neuroscientifique sur la conscience après avoir supposé qu’elle est inobservable ?
C'est une approche qui souffre de ce qu'on appelle le « sophisme de la marionnette » : au lieu du problème difficile, un autre problème est proposé, celui de la marionnette, qui est suffisamment difficile pour nécessiter des années de travail et pourtant suffisamment traitable pour être abordé en interne. méthodes disponibles aujourd’hui. Un peu comme dans la vieille blague où l'ivrogne cherchait la clé sous le réverbère où il savait qu'il ne l'avait pas perdue, mais où au moins il voyait très bien. Cependant, dans cette manière de raisonner, entre les processus neuronaux proposés comme explication et la manifestation de la conscience, il reste un écart qui n'est jamais comblé : les explications avancées sont un obscurum per obscurius .
Prenez, par exemple, l'IIT susmentionné qui propose une identité entre information intégrée et conscience. La théorie explique-t-elle pourquoi l’information intégrée correspond à la conscience ? Absolument pas, et cela n’explique pas non plus pourquoi le monde physique contient un ingrédient supplémentaire tel que l’information intégrée. Là où il y avait un mystère (la conscience), il y en a maintenant deux (la conscience et l'information intégrée). Cependant, en proposant quelque chose d'aussi difficile qu'une information intégrée dont la compréhension nécessitera des années de recherche, la cible se déplace vers la marionnette, qui s'inscrit dans le cadre conceptuel de référence et peut donc être proposée comme sujet de recherche. La conscience, qui serait le vrai problème à résoudre, reste à l'extérieur, mais en attendant nous travaillons et faisons de la science sur l'information intégrée.
Dans cet esprit, dans la première des deux études analysées, les auteurs déplacent l’accent sur les politiques de recherche, affirmant que les théories proposées « ont pour objectif de […] changer la sociologie de la pratique scientifique en général. La résolution de grandes questions peut nécessiter une grande science , car ces questions ont plus de chances d’être résolues collectivement plutôt que par des efforts isolés, parallèles et à petite échelle. L’approche de coopération compétitive s’appuie sur le succès d’institutions collaboratives à grande échelle. C'est une manière d'appréhender la politique de la science qui ressemble beaucoup aux manœuvres fictives des généraux de Buzzati : il ne s'agit pas de prendre conscience, mais de protéger les groupes de recherche en réorganisant la gestion des financements. Rien ne garantit que, travaillant dans des conditions scientifiques de grande envergure , les neuroscientifiques auront plus de chances d'avoir une intuition décisive.
Et le problème de la conscience ? Peu importe si cela ne sera pas réalisé aujourd’hui, demain ou jamais : « au regard des théories initiales soumises par ces approches », poursuivent les auteurs de la première étude, « il se pourrait que ni le GTNO ni l’IIT ne soient tout à fait exact. Quel que soit le résultat , le domaine de la recherche peut utiliser les résultats pour progresser dans la définition d’une nouvelle façon de penser la conscience et tester d’autres théories potentielles de la même manière. Le problème de la conscience restera certainement difficile, mais comprendre l’ancien problème corps-esprit deviendra un peu plus facile. Nous ne voyons pas pourquoi cet activisme devrait faciliter les choses à moins que nous n'avancions dans une nouvelle direction. Comme l'écrivait Robert Musil dans L' Homme sans qualités (1930), « quand quelque chose se produit continuellement, on a l'impression de produire quelque chose de réel » : impression qui, aussi encourageante soit-elle, n'a pas produit de résultats concrets en neurosciences.
De même, dans le deuxième des deux articles examinés ici, Anil Seth et Tim Bayne dressent un portrait positif de la recherche en suggérant de remplacer le problème réel par de nombreux problèmes plus petits mais plus gérables (thèse chère à Seth). Selon les deux auteurs, « on a assisté ces dernières années à une floraison de théories sur les bases biologiques et physiques de la conscience » et pourtant, « dans le cas de la conscience, on ne sait pas clairement comment les théories actuelles sont liées ni si elles peuvent être évalué empiriquement ». Une fois de plus, face à l’impasse scientifique, la solution avancée est une coopération compétitive entre les candidats vus ci-dessus, GWNT et IIT (plus deux autres, dans ce cas).
En suivant cette stratégie, les auteurs promettent qu’« il y a de bonnes raisons de penser que le développement, le test et la comparaison itératifs des théories de la conscience mèneront à une compréhension plus profonde du mystère des mystères ». Bref, selon les critiques, les neurosciences n'ont aucune idée de ce qu'elles font, mais émettent une lettre de change épistémique (pour reprendre la célèbre expression de Daniel Dennett) : de nombreux « je vais expliquer » garantis par l'autorité de la discipline dans son ensemble. Elle s'apparente à un grand établissement de crédit qui s'est distingué dans un certain secteur et convainc donc ses investisseurs de lui faire confiance dans un autre domaine.
Face à l’impasse scientifique, la solution avancée réside dans la coopération compétitive entre les principales théories.
Tout comme l’autre article, Seth et Bayne décrivent une discipline dans laquelle, étrangement, « au lieu d’éliminer les hypothèses concurrentes, à mesure que les données empiriques augmentent, [les hypothèses] semblent se multiplier ». Pour les deux auteurs, il ne s'agit pas d'un symptôme qui laisse soupçonner quelque chose d'erroné dans les prémisses, mais plutôt du signe que des théories différentes ont des « objectifs scientifiques différents », comme si cela était acceptable. Même si « la conscience reste scientifiquement controversée », écrivent les deux auteurs, « il y a tout lieu de penser que le développement de nouvelles théories et leur comparaison conduiront à une meilleure compréhension de ce profond mystère » ( ce plus profond des mystères ). Si ce n’est pas une lettre de change épistémique !
Dans les deux articles, il est clair que, ne sachant pas comment aborder directement le problème de la conscience, de nombreux neuroscientifiques essaient des stratégies alternatives pour le contourner. La plus populaire, comme nous l’avons vu, est la coopération compétitive permettant de comparer des théories alternatives sur la base de règles ad hoc . Un peu comme lors d’exercices militaires où, au lieu de vaincre un véritable ennemi, on s’affronte de manière rituelle pour établir un vainqueur. Or, en science, la comparaison doit se faire tôt ou tard avec la réalité empirique : la recherche ne doit pas seulement être une comparaison entre théories, mais aussi entre hypothèses et monde réel. Le scientifique soumet ses théories à l’épreuve de ses pairs, mais aussi de la nature.
La stratégie de coopération compétitive invoquée pour sortir de l’impasse actuelle des neurosciences rappelle un cas historique similaire : le problème de la genèse des continents au début du XXe siècle. Personne ne comprenait comment il était possible que des continents, même très éloignés et séparés par des océans, présentent une surprenante homogénéité tant en espèces animales qu'en séries lithologiques. Même alors, pendant des décennies, des théories non concluantes ont continué à être proposées, défendant des hypothèses ad hoc pour sauvegarder les hypothèses acceptées par la communauté scientifique (entre autres, la fixité des contenus).
Il semble qu’en neurosciences, à mesure que les données empiriques augmentent, les hypothèses contradictoires se multiplient plutôt que de diminuer.
Dans les années 1930, des géologues américains dirigés par Thomas Chamberlin consacraient des ressources et des financements à la méthode des « hypothèses de travail multiples » : chaque chercheur évaluait les observations géologiques selon des théories aussi différentes qu'inefficaces. Cette stratégie, note l'historien Greene Mott, n'était pas une méthode d'investigation, mais « un outil rhétorique pour attaquer quiconque osait proposer des idées différentes de celles admises par la communauté géologique dans le cadre de la liste acceptée des multiples hypothèses de travail ». La présence de multiples hypothèses donnait l’impression que les géologues envisageaient toutes les possibilités, alors qu’en pratique ces hypothèses ne remettaient pas en cause l’hypothèse de base de la fixité des continents. Ce n’est pas un hasard si la solution est venue d’un chercheur étranger à cette communauté et qui pouvait envisager quelque chose de véritablement révolutionnaire : la dérive des continents.
Il est facile de lire l’histoire passée de la science en connaissant le résultat final, il est difficile de faire la même chose en examinant la recherche actuelle. Pourtant, le cas de la conscience semble offrir un exemple classique. L'approche neuroscientifique de la conscience, bien représentée par les deux articles examinés, présente bon nombre des symptômes qui, selon Thomas Kuhn, annonceraient un changement de paradigme imminent : accumulation d'anomalies que la communauté scientifique a tendance à ignorer, perte de confiance dans une réalité réelle. solution, échecs répétés, politique du « premier pas ».
En ce qui concerne la perte de confiance, quelle meilleure démonstration que le choix du terme de problème difficile ? Mais il est également important de considérer le premier point - les anomalies - car il permet de découvrir qu'au fur et à mesure des progrès des techniques d'enquête, la liste des faits inexplicables s'est allongée . Ce sont des anomalies systématiquement ignorées ou mises de côté, dans l’attente de données complémentaires. Cette attitude est révélatrice : si les données expérimentales ne confirment pas les préjugés de la communauté scientifique, elles sont mises de côté dans l'espoir que de nouvelles observations les démentiront.
La stratégie de coopération compétitive invoquée par les neurosciences rappelle la problématique de la genèse des continents au début du XXe siècle.
Le paradigme dominant actuel dans la compréhension de la conscience par les neurosciences a accumulé, au fil des années, de nombreux faits apparemment inexplicables qui sont restés tels. J'en citerai quelques-uns : l'indépendance de l'expérience par rapport à la configuration neuronale dans le phénomène bien connu de dérive représentationnelle où les neurones associés à l'expérience d'une certaine odeur changent sans que l'expérience change ; l'absence de contenus expérientiels qui ne sont pas causés par un phénomène physique externe ; la stabilité de l'expérience perceptuelle à mesure que l'état interne des zones corticales et du cerveau varie ; la persistance d'images consécutives ou d'images rémanentes en l'absence de persistance d'une stimulation ; le caractère épiphénoménal de la conscience qui semble n'avoir aucun rôle causal et donc incompatible avec la théorie de l'évolution ; l'étonnante invariance de la perception des couleurs malgré l'extrême variabilité des photorécepteurs ; l'incroyable tolérance aux altérations anatomiques ; enfin la séparation anatomique, neuronale et fonctionnelle bien connue, mais non moins mystérieuse, entre les hémichamps visuels gauche et droit et la cohésion et l'homogénéité totales de notre expérience visuelle.
Certaines de ces anomalies sont si familières qu’elles sont devenues invisibles, comme le bout du nez, mais elles n’en sont pas moins problématiques. Il est instructif de mieux considérer la dernière : l’unité du champ visuel. Depuis le début du XXe siècle, on a compris que les signaux provenant des yeux étaient répartis de manière à renvoyer ceux relatifs à l'hémichamp droit vers l'hémisphère gauche et vice versa. Les parties du cerveau qui reçoivent ces signaux ne sont pas connectées et fonctionnent anatomiquement comme s’il s’agissait de deux organes différents. En théorie, l’hémisphère droit voit le monde à gauche et l’hémisphère gauche voit le monde à droite. Mais nous voyons tout le champ de vision sans interruptions, discontinuités ou chevauchements. Comment cela serait-il possible si le monde que nous voyons était généré, comme le supposent les neurosciences, dans le cerveau ? Qui voit le total ? C'est une anomalie inexplicable au moins pour les premières parties de la vision.
Comment serait-il possible de voir l’intégralité du champ visuel s’il était généré dans le cerveau ? Qui voit le total ?
Ces cas sont normalement ignorés comme s’il s’agissait d’exceptions en attente d’explication, mais ce n’est pas le cas. Au contraire, ils représentent la norme. Rien dans les données neuronales en tant que telles n'implique qu'en plus de l'activité électrochimique, il existe un phénomène supplémentaire tel que la conscience. La localisation présumée de la conscience au sein du cerveau ne découle d’aucun phénomène mesuré dans le système nerveux : il n’existe aucun fait neuronal mystérieux en attente d’explication. La recherche de la conscience au sein des replis corticaux dépend avant tout du paradigme que les chercheurs acceptent implicitement, mais rarement explicite, car il s'inscrit dans le cadre de ces préjugés qui, selon le philosophe Alfred N. Whitehead, « à chaque époque sont inconsciemment présupposés par tous ». adhérents à une communauté scientifique et sont si évidents que les gens ne savent pas qu'ils les possèdent parce qu'ils n'ont jamais formulé leurs problèmes autrement. Ce sont ces hypothèses que l'astronome Johannes Kepler a définies comme « les voleurs de mon temps » et qu'Albert Einstein a appelé « les hypothèses tacites qui, précisément parce qu'elles sont silencieuses, gouvernent secrètement notre pensée, nous empêchant de progresser ».
À la base de la recherche en neurosciences, il n’y a pas un seul dogme, mais deux, que l’on pourrait considérer comme le « credo » des neurosciences. Le premier postule que le sujet et le monde sont séparés, le second que la conscience est à l'intérieur du corps. Force est de constater que ces deux dogmes - que l'on pourrait appeler, avec un jeu de mots, le paradigme des neurosciences - ne sont ni le résultat d'observations empiriques ni de raisonnements théoriques, mais la glorification du sens commun qui imagine un sujet séparé du monde. et interne au corps. Il s’agit d’une idée populaire qui, dans le passé, a donné naissance au modèle discrédité de l’homonculus, et qui est aujourd’hui réactivée en termes de modèles de conscience ou d’esprit à l’intérieur du cerveau.
Mais si le dogme est si stérile et plein d’anomalies, pourquoi continue-t-il à dominer l’horizon de la recherche ? La raison principale est que les neuroscientifiques ne sont pas habitués à recevoir des questions d’experts d’autres domaines disciplinaires qui ne partagent pas leurs hypothèses. Les controverses , lorsqu'elles éclatent , ne remettent pas en cause le paradigme qui reste la base indispensable pour partir. Il y aurait bien d'autres aspects qui caractériseraient négativement l'état de la recherche sur la conscience en neurosciences : le caractère infalsifiable des méthodes proposées, le rejet dogmatique des alternatives sur la base de critères qui seraient fatals aux hypothèses admises en neurosciences, il s'agit de postulats qui ne répondent pas à des questions empiriques, d'avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle qui remettent en question des hypothèses consolidées. Nous ne pouvons pas tous les couvrir ici.
Existe-t-il une alternative à cette autarcie épistémique des neurosciences ?
Posons-nous plutôt une question positive : existe-t-il une alternative à cet état de fait ? Existe-t-il une alternative à cette autarcie épistémique des neurosciences ? Oui, il y en a, et c'est cette stratégie qu'avait déclarée le Galilée théâtral de Brecht et qu'avait appliquée le Galilée historique de Pise : identifier tous les préjugés qui conditionnent notre manière d'aborder un problème et de les remettre en question. Pour réussir cette entreprise, il faut être libre de sortir des limites des écoles de pensée et savoir regarder, comme l'homme de la gravure de Gustave Flammarion, hors du ciel des étoiles fixes du paradigme dominant.
Une question que les neuroscientifiques entendent rarement poser et qui devrait être au début de toute recherche sur la conscience est la suivante : rien n'a jamais été trouvé à l'intérieur du système nerveux central qui, si l'on ne supposait pas que la conscience y est générée, suggérerait-il son existence ? La réponse empiriquement honnête est négative. En d’autres termes, tout au long de l’histoire des neurosciences, la conscience n’a jamais été un objet de recherche interne ou quelque chose qui était suggéré ou impliqué par l’activité neuronale. Ce n’est pas un hasard si les neurophysiologistes n’en ont pas parlé pendant longtemps.
Le cas de la conscience dans le domaine des neurosciences, qui voit une discipline engagée dans la recherche d'un phénomène qui non seulement ne fait pas partie de ses données empiriques mais n'est même pas suggéré par la théorie, est peut-être un cas unique dans l'histoire des sciences. . Dans d'autres disciplines, nous traitons de circonstances qui émergent des observations : un exemple classique est celui où, dans la première moitié du XIXe siècle, Alexis Bouvard publia la première étude des paramètres orbitaux d'Uranus, réalisant à quel point la trajectoire observée s'écartait des prévisions. Le problème fut résolu d'abord théoriquement par Urbain Le Verrier puis expérimentalement par Johan Gottfried Galle qui, pointant le télescope de l'Observatoire de Berlin, découvrit une planète pas encore vue, Neptune. Le point pertinent ici est que le problème astronomique est apparu au sein des données astronomiques : il y avait une planète, Uranus, qui ne bougeait pas comme elle le devrait.
Le problème de la conscience ne se pose pas au sein des neurosciences, mais en dehors d’elles.
Un autre exemple est le boson de Higgs, initialement proposé comme mécanisme permettant de donner de la masse aux particules subatomiques. Le modèle standard des particules ne pouvait pas expliquer comment certaines particules pouvaient avoir une masse et le champ de Higgs (dont le fameux boson est la confirmation) a répondu à cette question qui se posait au sein du modèle standard des particules. Dans le cas des neurosciences, cependant, les données neuroscientifiques ne contiennent aucun phénomène qui nécessite une explication. Y a-t-il quelque chose dans le cerveau que les neurosciences ne peuvent pas expliquer ? La réponse est négative. Le problème de la conscience ne se pose pas au sein des neurosciences, mais en dehors d’elles . Comprendre pourquoi il faut s'adresser à la sociologie des sciences de Bruno Latour , sinon à la psychanalyse.
Einstein disait que la folie consiste à répéter les mêmes choses en espérant qu'elles conduisent à un résultat différent : qu'en est-il d'une discipline qui répète les mêmes approches depuis environ 150 ans ? Bien sûr, pour Nietzsche, la folie est la règle dans les organisations, mais ici l’impression est que la folie a sa propre finalité concrète. Les intérêts en jeu sont nombreux et il semble véritablement naïf de donner aux neurosciences une place centrale dans un jeu dont l’enjeu est notre nature. Les théories de la conscience touchent notre essence la plus intime et constituent la base des systèmes politiques, juridiques et économiques, comme cela s'est toujours produit de Platon à Hobbes, de Hegel à aujourd'hui. Évidemment, la recherche scientifique ne doit pas être conditionnée par nos attentes sociales, mais le monopole dogmatique d'une discipline qui, jusqu'à présent, n'a apporté aucune confirmation empirique à son "je vais expliquer", ne l'est pas non plus.
Les dogmes implicites des neurosciences, rattachant l'existence à des processus neuronaux caractérisés par une conscience épiphénoménale et inobservable, réduisent l'existence humaine à un fait sans valeur, au-delà des déclarations de principe régulièrement prononcées par de célèbres neuroscientifiques pour rendre cette réduction moins déprimante. La réduction de la conscience à une propriété épiphénoménale des processus neuronaux enlève de la valeur à notre existence parce que les processus neurophysiologiques, en tant que tels, n’ont aucune valeur (et ils n’en ont pas parce qu’ils sont des moyens d’existence, ni des fins ni des éléments constitutifs de celle-ci).
Les théories de la conscience touchent notre essence la plus intime et constituent la base des systèmes politiques, juridiques et économiques.
Si le bonheur n’était rien d’autre qu’une forte concentration de sérotonine, pourrions-nous le prendre au sérieux ? Le but de l’existence humaine pourrait-il être la prolifération de systèmes nerveux regorgeant de sérotonine ? Cela semble discutable. Les processus neuronaux sont sans aucun doute le moyen de notre existence, mais ils ne peuvent pas en être la fin.
La conscience est le problème crucial de notre existence et sa réduction, si elle est incorrecte, viderait notre vie de tout sens. Si notre existence n’était qu’une cascade de réactions électrochimiques, elle n’aurait plus aucune valeur, notamment parce que le système nerveux fait partie du monde physique et que le monde physique, comme le dit la vulgate scientifique, en est dépourvu. Le paradigme des neurosciences conduit à un relativisme vide où l’égoïsme s’effondre en un point sans dimension.
C’est là le grand bluff des neurosciences : proposer une pseudo-solution au problème de la conscience, justifier cet échange sur la base de sa propre autorité et de ses propres factures épistémiques sur la base du crédit scientifique accumulé dans d’autres domaines. Un crédit qui sert à défendre son double dogme, qui légitime à son tour un éternel premier pas, mais un pas qui reste en place. Faire semblant de bouger tout en restant immobile : un grand bluff.
Riccardo Manzotti
* Riccardo Manzotti est professeur ordinaire de philosophie théorique à l'Université IULM de Milan. Philosophe et ingénieur, docteur en robotique, a été Fulbright Visiting Scholar au MIT de Boston. Il a publié des articles et des livres sur les thèmes de la conscience, de la perception et de l'intelligence artificielle. Son dernier livre est « Io & IA » avec Simone Rossi (Rubbettino, 2023).
04.06.2024 à 16:02
Aaron Bastani : découvrez le manifeste du communisme de luxe
L'Autre Quotidien

Texte intégral (1786 mots)
Un manifeste provocateur et enlevé, pour montrer que seul le capitalisme contemporain et son avidité souvent machiavélique empêchent de réaliser à brève échéance une société d’abondance, écologique et sociale, sous le signe de la technologie triomphante, pour toutes et tous.

Activiste et journaliste infatigable, co-fondateur du petit groupe de médias alternatifs Novara et collaborateur occasionnel du Guardian, de la London Review of Books, de Vice ou de openDemocracy, Aaron Bastani, par ailleurs docteur en sciences politiques (spécialiste des mouvements collectifs sous le règne de Thatcher), proposait en 2019 cet élégant brûlot chez le grand éditeur anglo-saxon de la gauche radicale qu’est Verso Books.
Accueilli avec une certaine fraîcheur par de nombreux compagnons de route « intellectuels » des gauches se prétendant « gouvernementales » ou « raisonnables » un peu partout dans le monde, mais adopté souvent avec une certaine ferveur complice (ayant bien saisi l’aspect « manifeste » plutôt que « mode d’emploi » de l’ouvrage) par beaucoup de chroniqueurs plus radicaux et plus ambitieux, « Fully-Automated Luxury Communism » (souvent abrégé en « FALC » en cette époque si friande d’acronymes, joueurs ou non) recense tous azimuts, parmi l’ensemble des technologies déjà existantes ou en cours de développement, les impacts décisifs ainsi organisables sur le travail (automatisation volontariste et non subie), l’énergie (décarbonation totale et soutenabilité sans limites), les ressources naturelles (mutualisation mondiale de l’exploitation d’astéroïdes), la santé (mise à disposition totale des avancées sans considération de coût) et l’alimentation (nourriture sans animaux).

“Tous ces événements partagent un certain sens de l'avenir. Les énergies renouvelables, l'exploitation minière des astéroïdes, les fusées qui peuvent être utilisées plusieurs fois et même voler vers Mars, les chefs d'entreprise qui discutent ouvertement des implications de l'IA, les bricoleurs qui se plongent dans le génie génétique à faible coût.
Et pourtant, ce futur est déjà là. Il s'avère que ce n'est pas le monde de demain qui est trop complexe pour élaborer une politique significative, c'est celui d'aujourd'hui. En essayant de créer une politique progressiste qui s'adapte aux réalités actuelles, cela pose un problème car, alors que ces événements semblent sortir de la science-fiction, ils peuvent aussi sembler inévitables. Dans un sens, c'est comme si l'avenir était déjà écrit, et que malgré tous les discours sur une révolution technologique imminente, cette transformation vertigineuse est liée à une vision statique du monde où rien ne change vraiment.
Mais si tout pouvait changer ? Et si, au lieu de nous contenter de relever les grands défis de notre époque - du changement climatique aux inégalités en passant par le vieillissement - nous allions bien au-delà, en laissant les problèmes d'aujourd'hui derrière nous, comme nous l'avons fait auparavant avec les grands prédateurs et, pour la plupart, avec les maladies. Et si, plutôt que de n'avoir aucun sens d'un avenir différent, nous décidions que l'histoire n'a pas vraiment commencé ?”
Quoique légèrement minée par son aspect de pot-pourri journalistique (néanmoins de fort bonne tenue), cette partie centrale consacrée aux technologies dans cinq domaines devant concrétiser l’avènement du « communisme de luxe totalement automatisé » n’est au fond que le pivot des deux autres parties, la première montrant comment la confiscation capitaliste au profit de quelques-uns, tout occupés de renouveler des courts termes profitables, empêche cette évolution indispensable (rejoignant ainsi plusieurs des démonstrations fictives conduites par Kim Stanley Robinson dans certains de ses derniers ouvrages, « New York 2140 » (2017) et « The Ministry for the Future » (2020) tout particulièrement), et la troisième jalonnant les chemins politiques d’une appropriation le plus authentiquement populaire possible.
Surtout, avec une ferveur salutaire et un enthousiasme électrique (au risque évidemment d’apparaître pour beaucoup comme très exagérément technophile – mais il s’en justifie précisément tout au long de l’ouvrage, et se situe extrêmement loin des consumérismes high tech dépolitisés à la Wired), Aaron Bastani, en communion avec l’esprit critique ambitieux et nourri de science-fiction productive dont témoignent le Ariel Kyrou de « Dans les imaginaires du futur » (2020) et l’Alice Garabédian de « Utopie radicale » (2022), ne propose rien moins que de fonder en raison pratique le pont qui sépare nos sociétés présentes de la formidable utopie post-rareté, fondée sur une liberté réelle et une curiosité inextinguible, construite patiemment par Iain M. Banks de « Une forme de guerre » (1987) à « La sonate Hydrogène » (2012). Qu’un éditeur français ait cru bon de s’approprier les droits dans notre langue du texte théorique fondateur de l’ensemble, « A Few Notes on the Culture » (à lire ici en V.O.), que son auteur avait voulu entièrement libre dès l’origine de l’internet, n’enlève évidemment rien à la profonde pertinence de cet élan utopique joueur sans lequel rien de grand et de vraiment émancipateur ne se peut vraiment concevoir.
“FALC n'est pas un manifeste pour les poètes à l'esprit étoilé. Il est plutôt né de la reconnaissance d'une vérité de plus en plus évidente : au milieu des changements de la Troisième Perturbation, le "fait" de la pénurie passe de la certitude inévitable à l'imposition politique. Ce n'est pas un livre sur l'avenir mais sur un présent qui n'est pas reconnu. Les contours d'un monde incommensurablement meilleur que le nôtre, plus égalitaire, plus prospère et plus créatif, sont visibles si seulement nous osons regarder. Mais la perspicacité seule ne suffit pas. Nous devons avoir le courage - car c'est ce qu'il faut - d'argumenter, de persuader et de construire. Il y a un monde à gagner.”
Une lecture qu’il faudra nécessairement prendre avec des pincettes, tant son caractère évidemment provocateur est parfois violemment affirmé (largement tempéré toutefois par les 30 pages de bibliographie détaillée, passionnantes par elles-mêmes), mais qui nous pousse de manière ô combien salutaire à une réflexion réellement radicale et audacieuse sur les blocages structurels des sociétés du capitalisme tardif.
Hugues Robert
L’ouvrage a été traduit en juin 2021 par Hermine Hémon aux éditions Diateino, on peut se le procurer ici.
28.05.2024 à 15:38
La coquille de l'escargot, par Giorgio Agamben
L'Autre Quotidien

Texte intégral (919 mots)

Quelles que soient les raisons profondes du déclin de l’Occident, dont nous vivons la crise dans tous les sens, décisive, il est possible de résumer son aboutissement extrême dans ce que, reprenant une image emblématique d’Ivan Illich, on pourrait appeler le « théorème de l’escargot ». «Si l'escargot», affirme le théorème, «après avoir ajouté un certain nombre de tours à sa coquille, au lieu de s'arrêter, continuait sa croissance, un seul tour supplémentaire augmenterait de 16 fois le poids de sa maison et l'escargot resterait inexorablement écrasé. » C’est ce qui se passe chez l’espèce qui se définissait autrefois comme homo sapiens en ce qui concerne le développement technologique et, en général, l’hypertrophie des dispositifs juridiques, scientifiques et industriels qui caractérisent la société humaine.
Ceux-ci ont toujours été indispensables à la vie de ce mammifère particulier qu'est l'homme, dont la naissance prématurée implique une prolongation de la condition infantile, dans laquelle le petit n'est pas en mesure de pourvoir à sa survie. Mais, comme cela arrive souvent, un danger mortel se cache précisément dans ce qui assure leur salut. Les scientifiques qui, comme le brillant anatomiste hollandais Lodewjik Bolk, ont réfléchi sur la condition singulière de l’espèce humaine, en ont tiré des conséquences pour le moins pessimistes sur l’avenir de la civilisation.
Au fil du temps, le développement croissant des technologies et des structures sociales produit une véritable inhibition de la vitalité, annonciatrice d’une possible disparition de l’espèce. L'accès au stade adulte est en effet de plus en plus différé, la croissance de l'organisme est de plus en plus ralentie, la durée de vie - et donc la vieillesse - se prolonge. «Le progrès de cette inhibition du processus vital», écrit Bolk, «ne peut dépasser une certaine limite sans vitalité, sans force de résistance aux influences néfastes de l'extérieur, bref, sans que l'existence de l'homme ne soit compromise.» Plus l’humanité avance sur la voie de l’humanisation, plus elle se rapproche de ce point fatal où le progrès signifiera la destruction. Et il n’est certainement pas dans la nature de l’homme de s’arrêter face à cela. »
C’est cette situation extrême que nous vivons aujourd’hui. La multiplication sans limites des dispositifs technologiques, la soumission croissante aux contraintes et autorisations légales de toutes sortes et espèces et la soumission totale aux lois du marché rendent les individus de plus en plus dépendants de facteurs qui échappent totalement à leur contrôle. Gunther Anders a défini la nouvelle relation que la modernité a produite entre l'homme et ses outils avec l'expression : « différence prométhéenne » et a parlé d'une « honte » face à la supériorité humiliante des choses produites par la technologie, dont on ne peut plus considérer nous-mêmes maîtres en aucune façon. Il est possible qu'aujourd'hui cette différence de niveau ait atteint le point de tension maximale et que l'homme soit devenu complètement incapable d'assumer la gouvernance de la sphère des produits qu'il a créés.
À l’inhibition de la vitalité décrite par Bolk s’ajoute l’abdication de cette même intelligence qui pourrait en quelque sorte freiner ses conséquences négatives. L’abandon de ce dernier lien avec la nature, que la tradition philosophique appelle lumen naturae , produit une stupidité artificielle qui rend l’hypertrophie technologique encore plus incontrôlable.
Qu’adviendra-t-il de l’escargot écrasé par sa propre coquille ? Comment survivra-t-il aux décombres de sa maison ? Telles sont les questions que nous ne devons pas cesser de nous poser.
Giorgio Agamben
15.05.2024 à 12:33
Giorgio Agamben : la technique et le gouvernement
L'Autre Quotidien

Texte intégral (937 mots)

Certains des esprits les plus brillants du XXe siècle se sont accordés pour identifier le défi politique de notre époque comme étant la capacité à gouverner le développement technologique. La question décisive", a-t-on écrit, "est aujourd'hui de savoir comment un système politique, quel qu'il soit, peut être adapté à l'ère de la technologie. Je ne connais pas la réponse à cette question. Je ne suis pas convaincu qu'il s'agisse de la "démocratie". D'autres ont comparé la maîtrise de la technologie à l'entreprise d'un nouvel Hercule : "ceux qui parviendront à maîtriser une technologie qui a échappé à tout contrôle et à l'ordonner de manière concrète auront répondu aux problèmes du présent bien plus que ceux qui tenteront de se poser sur la lune ou sur Mars avec les moyens de la technologie".
Le fait est que les pouvoirs qui semblent guider et utiliser le développement technologique à leurs fins sont en fait plus ou moins inconsciemment guidés par celui-ci. Tant les régimes les plus totalitaires, comme le fascisme et le bolchevisme, que les régimes dits démocratiques partagent cette incapacité à gouverner la technologie à un point tel qu'ils finissent par se transformer presque par inadvertance dans le sens requis par les technologies mêmes qu'ils pensaient utiliser à leurs propres fins.
Un scientifique qui a donné une nouvelle formulation à la théorie de l'évolution, Lodewijk Bolk, voyait ainsi l'hypertrophie du développement technologique comme un danger mortel pour la survie de l'espèce humaine. Le développement croissant des technologies tant scientifiques que sociales produit, en effet, une véritable inhibition de la vitalité, de sorte que "plus l'humanité avance sur la voie de la technologie, plus elle se rapproche de ce point fatal où le progrès sera synonyme de destruction". Et il n'est certainement pas dans la nature de l'homme de s'arrêter face à cela". Un exemple instructif est fourni par la technologie des armes, qui a produit des dispositifs dont l'utilisation implique la destruction de la vie sur terre - donc aussi de ceux qui en disposent et qui, comme nous le voyons aujourd'hui, continuent néanmoins à menacer de les utiliser.
Il est donc possible que l'incapacité à gouverner la technologie soit inscrite dans le concept même de "gouvernement", c'est-à-dire dans l'idée que la politique est par nature cybernétique, c'est-à-dire l'art de "gouverner" (kybernes est en grec le pilote du navire) la vie des êtres humains et leurs biens. La technique ne peut être gouvernée car elle est la forme même de la gouvernementalité. Ce qui a été traditionnellement interprété - depuis la scolastique jusqu'à Spengler - comme la nature essentiellement instrumentale de la technologie trahit l'instrumentalité inhérente à notre conception de la politique. L'idée que l'instrument technologique est quelque chose qui, fonctionnant selon sa propre finalité, peut être utilisé pour les besoins d'un agent extérieur est ici décisive. Comme le montre l'exemple de la hache, qui coupe en vertu de son tranchant, mais qui est utilisée par le menuisier pour fabriquer une table, l'instrument technique ne peut servir la fin d'un autre que dans la mesure où il atteint la sienne. Cela signifie, en dernière instance - comme on le voit dans les dispositifs technologiques les plus avancés - que la technologie réalise sa propre fin en servant apparemment la fin d'autrui. Dans le même sens, la politique, comprise comme oikonomia et gouvernement, est cette opération qui réalise une fin qui semble la transcender, mais qui lui est en réalité immanente. La politique et la technique sont identifiées, c'est-à-dire sans résidu, et un contrôle politique de la technique ne sera possible que si nous abandonnons notre conception instrumentale, c'est-à-dire gouvernementale, de la politique.
Giorgio Agamben
14.05.2024 à 14:15
“Extinction Internet”, étirer le temps, revendiquer et squatter l’avenir d’Internet
L'Autre Quotidien
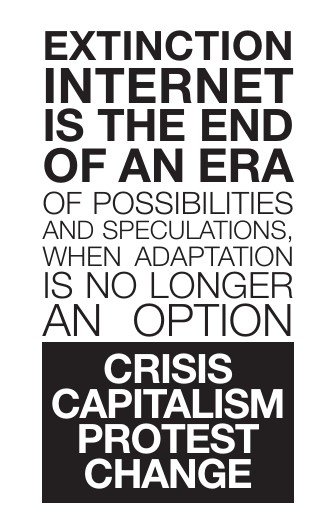
Texte intégral (10652 mots)
Extinction Internet n’est pas simplement un fantasme de technologie numérique de fin du monde qui sera un jour anéanti par une impulsion électromagnétique ou la coupure de câbles. Extinction Internet marque plutôt la fin d’une ère de possibilités et de spéculations, où l’adaptation n’est plus une option. Au cours de la décennie perdue d'Internet, nous avons réorganisé les transats du Titanic sous la direction inspirante de la classe de consultants. Que faire pour maintenir l’inévitable ? Nous avons besoin d’outils qui décolonisent, redistribuent la valeur, conspirent et organisent. Rejoignez l'exode de la plateforme. Il est temps de faire la grève de l'optimisation. Il y a de la beauté dans la panne.
Geert Lovink

La culture Internet, dans son état actuel, peut-elle résister à l’entropie et échapper à l’enregistrement infini tout en étant confrontée à sa propre disparition sans fin ? C'est la question que nous a léguée le philosophe français Bernard Stiegler, décédé en août 2020. Une anthologie sur ce sujet, intitulée Bifurquer : « Il n'y a pas d'alternative » , a été écrite durant les premiers mois du COVID-19 : Achevée peu avant sa mort, il est basé sur son travail et écrit en consultation avec la génération de Greta Thunberg. Bifurcate est aussi un projet de justice climatique et d'analyse philosophique, signé collectivement sous le pseudonyme Internation. « Bifurquer » signifie diviser ou diviser en deux branches. C’est un appel à se diversifier, à créer des alternatives et à cesser d’ignorer le problème de l’entropie, une question classique de la cybernétique. Nous connaissons le trouble dans le contexte de la critique d’Internet comme un problème dû à une surcharge cognitive, associée à des symptômes psychiques tels que la distraction, l’épuisement et l’anxiété, aggravés à leur tour par les architectures subliminales des médias sociaux extractivistes. Stiegler a appelé notre condition l'Entropocène par analogie avec l'Anthropocène : une ère caractérisée par «l'augmentation massive de l'entropie sous toutes ses formes (physiques, biologiques et informationnelles)». Comme le soulignaient déjà Deleuze et Guattari : « Nous ne manquons certainement pas de communication, nous en avons même trop ; nous manquons de création ». Notre tâche est donc de créer un nouveau langage pour comprendre le présent avec l’aspiration d’arrêter et de surmonter l’avènement de multiples catastrophes, illustré par le concept multiple d’Extinction Internet.
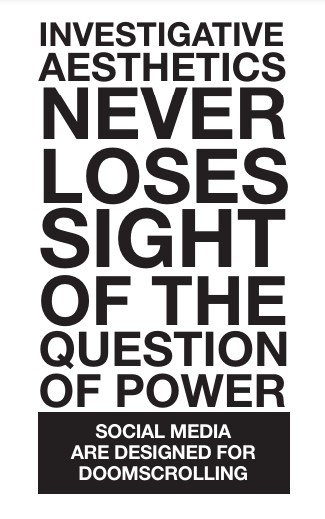
Alors que Bernard Stiegler et d’autres ont souligné combien le désastre écologique doit être théorisé à la fois sur le plan physique, biologique et psychologique, l’accent doit désormais être mis sur la réduction du savoir à l’information, aux conséquences sur les habitudes, les pratiques et les dispositions psychosociales. Dernièrement, je me suis intéressé à l’impact politique et esthétique du bruit et de l’inattention sur les états psychiques (et cela est particulièrement vrai pour les jeunes générations). Il reste encore à voir si ces études sur l’anxiété, la colère et la tristesse en ligne peuvent fournir des outils de départ pour créer des alternatives valables.
Récemment, j’ai commencé à douter de ma thèse selon laquelle une analyse critique de la désolation psychique des utilisateurs du numérique peut constituer un premier pas crucial vers l’organisation, la mobilisation et, à terme, le changement. Ma génération a rapidement découvert que – pour reprendre la terminologie de Derrida et Stiegler – Internet est un pharmakon : toxique et curatif. La critique des hypothèses implicites d’Internet, à commencer par l’idéologie californienne , est donc à la fois une répudiation et une affirmation. Alors, comment pouvons-nous rassembler l’analyse et la critique dans des réseaux de communication radicaux et fonctionnels pour faire la différence en termes de recherche, de politique et de développement d’alternatives ?

D'abord le diagnostic, puis la rééducation. Ce sont les deux étapes fondamentales pour entreprendre le processus de guérison. En ce qui me concerne, ces idées me ramènent à deux œuvres qui ont défini mon Werdegang intellectuel . Tout d'abord, les Fantasmes Virils de Klaus Theweleit , en relation avec les dommages psychiques de la classe ouvrière allemande et comment cela a rendu les travailleurs vulnérables aux promesses du parti nazi de retrouver leur dignité perdue. Et deuxièmement, Masse et Puissance d’Elias Canetti , un classique de la discipline aujourd’hui disparue de la « psychologie de masse » […]. Pour tous deux, la question antifasciste historique est, une fois de plus, la question d’aujourd’hui : comment démolir l’armure psychique du fascisme ? Pourquoi les gens sont-ils de plus en plus sensibles aux théories du complot, aux fausses nouvelles et aux mythes sur l’immigration ? Fournir des informations « objectives » et correctes n’induit pas la démystification. Le néopositivisme ne nous mène nulle part, mais se limite à reproduire les modes dominants de suprématie. Il y a une leçon amère qui vient du passé : le dialogue ne vaincra pas le fascisme.
Essayer de déchiffrer le code fasciste était l’une des nombreuses tâches de ma génération : la génération intermédiaire qui a grandi dans l’ombre de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre froide et de l’héritage de 1968. Le fascisme a peut-être été vaincu (à un coût élevé) militairement, mais ses racines demeurent. Lors de la reconstruction d’après-guerre, marquée par la guerre froide et l’entente entre les classes, les racines du fascisme n’ont pas été correctement nommées, encore moins éradiquées. Ce n’est pas un hasard si la question de savoir comment planifier et vivre une « vie antifasciste », comme l’a formulé Michel Foucault, a émergé dans les années 1970, lorsque la récession et l’austérité étaient de retour en Occident . Cinquante ans plus tard, la question peut être reformulée ainsi : quels types de « technologies numériques du soi » devront être conçues pour nous connaître nous-mêmes d’une manière antithétique aux régimes normatifs ? Comment vivre hors plateforme tout en bénéficiant des avantages des réseaux sociaux ?

L’un des éléments fondamentaux d’une critique de l’état techno-social actuel sera une version radicalement révisée de la psychanalyse du XXIe siècle. Dans Le Troisième Inconscient , le théoricien italien Franco Berardi propose une psychanalyse qui doit « prendre cet horizon de chaos et d’extinction comme point de départ d’une nouvelle réflexion ». Il écrit ensuite sur la découverte de l'inconscient aux XVIIIe et XIXe siècles et comment elle a conduit à la fondation de la psychanalyse en tant que thérapie et outil d'analyse culturelle. Contrairement à l’accent que ses pères fondateurs mettaient sur la négation et la sublimation, la deuxième version de l’inconscient associée à Lacan, et plus encore à Deleuze et Guattari, mettait l’accent sur l’élément de production : non pas la répression mais la surexpression. Pour ce dernier, en effet, l'inconscient n'était pas un théâtre mais une usine, lancée "à la poursuite d'une joie qui échappe continuellement, stimulant des tentatives frénétiques de vainqueur, généralement frustrées par la réalité".
Comment sauver le « techno-social » des mains de la Silicon Valley et du contrôle étatique sans nécessairement retomber dans un romantisme hors ligne ou dans un communautarisme défensif et replié sur lui-même ?
Cinquante ans après la libération du désir, Berardi propose de regarder les choses sous un nouvel angle : un troisième inconscient qui s'articule autour de l'analyse de la dimension techno-sociale du psychisme, dans un monde qui n'est plus centré sur la croissance et (schizo )productivité, mais sur l’extinction, l’anxiété et la décroissance. Kétamine mélangée à Instagram et punk live. L’esprit humain a atteint un état de saturation. Berardi analyse et approuve le développement de nouveaux outils critiques qui peuvent aider à comprendre le spectre actuel de la sensibilité mentale et de l'attention émotionnelle. Nous devons nous entraîner à « suivre la dynamique du désastre », qui, selon lui, est une description précise de « notre état mental pendant le tremblement de terre actuel, qui est aussi un tremblement de terre de l’âme et un tremblement de terre mental ». Selon Berardi, « le fascisme est une réaction psychotique à l'impuissance », comme Theweleit l'a déjà démontré dans son Männerphatasien . La transition en douceur du COVID à la guerre en Ukraine, l’inflation et la crise énergétique n’ont fait qu’exacerber l’effondrement du circuit bio-info-psychique sous le poids de la pile de crise. À chaque nouveau choc, nous montons et descendons, feuilletant « l’ atlas vertical » des conflits.
Dans ma lecture du Troisième Inconscient , les technologies médiatiques sont entrées dans le corps de telle manière que le corps et l’âme ne peuvent plus être séparés de l’infosphère sémiotique. Il n'y a pas que la physionomie qui a changé. Pensons par exemple aux neurones de notre cerveau qui réorganisent la possibilité même de notre façon de penser, ou encore à la fatigue que nous ressentons dans nos yeux, nos doigts et dans tout notre corps après une énième séance de Zoom. C’est ainsi que les technologies d’extinction fonctionnent d’une manière qui se répercute dans toute la société.
Franco Berardi reste l'un des rares intellectuels européens dotés d'une sensibilité sismographique phénoménale pour les états d'esprit sombres des dernières générations, collées à leurs appareils. Lire le pouls de cette manière, en phase avec la génération Z – la première génération à expérimenter Internet comme une sphère donnée et fixe – est une chose que Berardi partage avec Bernard Stiegler. Une stratégie mondiale commune est en jeu : une ferme conviction que la société doit avant tout faire face à l’abîme. C’est là que le mécontentement politique est destiné, au cœur de l’inconscient social. Il est certain que le déni accélérera encore les crises en cours – mais dans l’intérêt de qui ? L’optimisme du Nouvel Âge va de pair avec le contrôle de la perception du public. C’est pourquoi « pilule rouge ou pilule bleue » est le thème central de notre époque. Au lieu d’administrer à nouveau des procédures dysfonctionnelles, une issue pourrait être de représenter – et de mettre en pratique – l’acte grotesque de disparition et de réapparition (mais sans enregistrement).
Il est temps de vivre une procédure circulaire de début et de fin, par opposition au retour sans fin des tropes de l’optimisation et de l’austérité. Selon Berardi, le « circuit bio-info-psychique » doit être élaboré avant même de franchir le seuil dans lequel nous nous trouvons. Un traitement collectif est nécessaire qui traite « des signaux, des gestes linguistiques, des suggestions subliminales, des convergences subconscientes. C'est l'espace de la poésie, l'activité qui façonne les nouvelles dispositions de la sensibilité" exprimées dans des mèmes aux tons ironiques, des vidéos drôles, des danses et des gestes, reçus dans des moments d'ivresse extatique, qui nous entraînent toujours plus profondément dans le vortex de la musique et du visuel. expérience.
Quels types de pratiques artistiques font la différence dans ce contexte ? À mon avis, l'esthétique d'investigation, visant à cartographier les preuves recueillies, à inventer des concepts et des critiques à partir de la réorganisation de la réalité, ne peut exister qu'au début d'un processus de transformation radicale. Par la suite, tout cela contribuera à un mouvement plus large d’écriture et d’analyse de l’histoire de l’art dans les sciences humaines : un nouveau paradigme, si l’on veut, qui ne se limitera pas à répliquer le mouvement des Humanités numériques, mais se distinguera de la tendance de ce mouvement à se concentrer sur la numérisation des archives, en plus de l'analyse des données, amoureux des chiffres, des graphiques et des échelles de valeurs. Nous avons dépassé l’époque des « compétences numériques » au service des œuvres caritatives et nous sommes immergés dans la politique mondiale des besoins numériques. Dans cette phase, le projet d’esthétique d’investigation ne perd pas de vue la question du pouvoir : en réorientant le débat politique sur la vérité, en opposant les récits sur l’autorité et l’expédient hégémonique à la véracité des opprimés, il se matérialise finalement à travers une approche computationnelle. esthétique s’articulant autour d’axes spatiaux et temporels.

Il existe une esthétique de l’effondrement que la culture Internet transmet, représente et reproduit. Hâtons-nous d’écrire l’histoire de la culture en ligne labile : les autres ne le feront pas à notre place
Le « moi numérique » peut-il échapper au piège du vanity marketing ? Est-il possible de faire l’expérience d’une coopération libre et d’une action collective pour échapper à la cage de l’ego ? Comment sauver le « techno-social » des mains de la Silicon Valley et du contrôle étatique sans nécessairement retomber dans un romantisme hors ligne ou dans un communautarisme défensif et replié sur lui-même ? Il s'agit d'un projet politique et passionné de nombreux amis italiens avec lesquels j'ai le privilège de travailler, parmi lesquels Donatella Della Ratta, Tiziana Terranova et d'innombrables autres. Le point de départ est d’abord une inversion dialectique assez convaincante. Le social est considéré comme une force catalysatrice principale : un pouvoir souverain qui, à son tour, déclenche des inventions et de nouvelles formes de production et de reproduction, plutôt que d'être présenté comme le produit de mouvements historiques à grande échelle, tels que le capitalisme, l'industrialisation, l'impérialisme, le patriarcat ou le colonialisme. A partir de là, le réseau social peut être mieux défini comme le véritable moteur de technologies imaginaires – de temps en temps la cible d’expropriations capitalistes – par nature réactives, mais qui forcent finalement le social à se rendre. Ensemble, nous devons inverser cette tendance et restaurer l’autonomie et la détermination sociales. Malgré les batailles perdues, le techno-social conserve son pouvoir de transformation et est loin d’être une victime impuissante. C'est un point important si nous voulons freiner la société technologique lors de la mouvementée « deuxième crise pétrolière », par exemple en allant au-delà du désastre énergétique que sont les centres de données, en concevant de nouvelles architectures de redistribution informatique capables de compléter le droit exclusif de parcourir nos bibliothèques. hors ligne.
Les Italiens nous apprennent à prendre cette question très au sérieux : qu’est-ce qui est social aujourd’hui ? Il y a quarante ans, nous aurions répondu : les « mouvements sociaux autonomes ». Il y a trente ans, les communautés inspirées par les médias tactiques; il y a vingt ans, les réseaux sociaux et le Web 2.0; et il y a dix ans la plateforme. Qu’y a-t-il d’autre à offrir, sinon un appel bien intentionné au retour aux valeurs du logiciel libre ? Sur le plan relationnel, Franco Berardi propose une « conversion psycho-culturelle en faveur de la frugalité et de l'amitié ». Avec mon ami de Sydney, Ned Rossiter, j'ai réfléchi aux « réseaux organisés » ; nous étions certains que ces réseaux avaient des liens forts avec une esthétique distribuée et développée à travers de nombreux nœuds et emplacements, par opposition aux structures de réseau classiques qui ont des liens faibles et ont tendance à se désintégrer facilement. Les réseaux organisés restent encore une promesse, tout comme le potentiel non exploité d'une « critique d'Internet ». Un retour à l’adhésion à des organisations telles qu’un parti, comme moyen de reconquérir le pouvoir politique, semble encore plus improbable qu’il y a quarante ans, lorsque j’étudiais ce sujet. Comment transformer le mécontentement et la contre-hégémonie en une transition efficace du pouvoir à la fin de l’ère des plateformes ? La question de l’organisation reste toujours très actuelle, non seulement pour les différents mouvements de protestation, mais aussi, dans notre cas, pour les artistes et designers et autres travailleurs nomades et précaires.
« Convainquez-moi que nous ne sommes pas à l’âge des ténèbres du numérique », a commencé Regina Harsanyi sur Twitter en 2022. La perte d’espace privé semble réelle. Et c’est le cas à bien des égards. Nous avons été entraînés dans un trou noir virtuel. Pourtant, il y a de la beauté dans l’effondrement. La recherche sur les mèmes radicaux nous l’enseigne depuis des années. Il existe une esthétique de l’effondrement que la culture Internet transmet, représente et reproduit. Hâtons-nous d'écrire l'histoire de la culture en ligne labile : d'autres ne le feront pas à notre place. Après trois décennies, un sentiment encore plus pressant nous pèse, qui va au-delà des cartographies passées de régression et de stagnation, y compris leurs états sombres respectifs. Comme le disait Brecht : « Parce que les choses sont ce qu’elles sont, les choses ne resteront pas telles qu’elles sont. » La possibilité d’une disparition d’Internet est désormais envisageable. C’est le moment de notre vérité qui dérange. Non seulement des possibilités infinies ont implosé à cause du réalisme numérique, mais nous sommes également confrontés à l’horizon existentiel de la finitude. Mais ce n’est pas celui des protocoles TCP/IP ou de la commutation de paquets. Extinction Internet marque la fin d’une ère d’imagination collective qui, à bien des égards, a démontré à quel point les organisations technologiques verticales et horizontales constituaient des alternatives possibles. Pas une pile mais plusieurs étages.

La stagnation et la récession ont été cartographiées en détail ; il s’agit maintenant d’en théoriser la fin. La destruction succède à la déconstruction. L’optimisme institutionnel ne récompensera personne pour son alarmisme en cas de catastrophe, tout comme les critiques à l’égard d’Internet et de ses alternatives sont tombées dans l’oreille d’un sourd dans la période pré-apocalyptique. Il est temps d’insuffler à l’approche managériale froide de la gouvernementalité algorithmique la hantologie de Mark Fisher. Nous devons nous réveiller et comprendre que le black-out est devenu systémique. Les modes crypto-nihilistes de « l’argent facile » sont des technologies récentes. Mais que se passe-t-il une fois que l’invisible est devenu visible et que nous avons dépassé le vide de nos pensées ? L’odeur de l’extinction flotte dans l’air. Le réalisme darwinien dit que c’est votre choix de rester pauvre et déconnecté, dans le froid, la chaleur, la sécheresse ou les inondations. Il est temps de faire grève, une grève contre l'optimisation. Apportez simplement des améliorations. Arrêtons d'augmenter l'efficacité et d'augmenter la productivité. Il est temps d'enseigner la conception de problèmes . Il est temps d'inventer des provocateurs .
Consultons //substack.com/@cashedcobrazhousewriter " target="_blank" rel="noreferrer noopener">Angelicism01, ma nihiliste Greta Thunberg, e-girl poète, théoricienne et personnage virtuel à la fois, qui écrit : « Internet C'est impossible, je n'y pense pas parce que ça m'écrase. Je ne peux pas dire si Internet va finir. L'extinction elle-même est en train de changer. C'est ce que disent les machines de transformation. C'est ce que signifie vivre la mutation. Internet et l’extinction sont inextricablement liés. »
Qu’est-ce qui pourrait occuper le vide dans notre psychisme défragmenté une fois qu’Internet aura quitté la scène ? Et à quoi pourrait ressembler la vie une fois que nos esprits fragiles ne seront plus assaillis par les effets engourdissants et déprimants du défilement catastrophique ?
La technique en tant que telle n’exclut pas les questions. Ce n’est pas parce que nous sommes immergés dans ce système que nous sommes capturés par sa prétendue totalité. Les médias sociaux sont conçus pour faire défiler la catastrophe. La désautomatisation d’Internet dans ce contexte suffirait à briser les habitudes répétitives qui pénètrent dans les entrailles des corps connectés. Il y a quelque chose de libérateur à perdre son profil à cause d’un acte d’oubli. Qu’est-ce qui pourrait occuper le vide dans notre psychisme défragmenté une fois qu’Internet aura quitté la scène ? Et à quoi pourrait ressembler la vie une fois que nos esprits fragiles ne seront plus assaillis par les effets engourdissants et déprimants du défilement catastrophique ? Les neurones post-Internet constituent le domaine d’un nouveau réservoir durable d’imagination et de réinvention de la cognition, les éléments fondamentaux de la société. C'était la leçon de Stiegler.
Extinction Internet n’est pas simplement un fantasme apocalyptique selon lequel la technologie numérique serait un jour anéantie par une impulsion électromagnétique déclenchée par une arme de destruction massive en un bref instant. Extinction Internet marque la fin d’une ère de possibilités et de spéculations, où l’adaptation n’est plus une option. Le deuil de la disparition d’Internet a commencé bien avant, lorsque la plateforme a évincé l’imaginaire collectif. Il semble qu’un autre Internet ne soit plus possible. L'utilisateur-programmeur est condamné à vivre comme un zombie, swipant et scrollant sans réfléchir : il n'est plus maître de sa propre activité. Alors que dans un passé récent j'avais décrit ce comportement à un niveau subliminal ou subconscient, à l'étape suivante, l'intermédiaire est déclaré en état de mort cérébrale. Alors qu’un état de sommeil profond apparaît rapidement, nos gestes informatiques quotidiens fonctionnent toujours automatiquement.
Il s’agit d’étirer le temps, de revendiquer et de squatter l’avenir d’Internet, et de concevoir ensemble des configurations spatio-temporelles autonomes permettant de développer des réflexions et des activités inutiles. Le post-Internet sera vendu comme une technologie irréversible. En guise de contre-attaque, nous devons repenser les systèmes actuels qui provoquent un déficit de mémoire et de connaissances. Le projet n’est pas seulement d’affirmer l’extinction du protocole Internet, mais en même temps de surmonter la dépression programmée correspondante.
« Les crises, qu'elles soient celles du capitalisme ou de la protestation, écrit Matt Colquhuon, ne génèrent plus aucun changement ; la négativité détruit l’ancien mais ne produit plus le nouveau. » De même, j’ai dû prouver par moi-même que ni la critique du réseau ni la psychanalyse collective du moi numérique ne mèneront au changement. Notre tâche sera, pour reprendre les mots de Bernard Stiegler , de « mettre les automatismes au service d'une désautomatisation néguentropique ». La stratégie pour vaincre l’entropie peut inclure la désautomatisation de tout, de l’exode des médias sociaux à la démolition des centres de données, au réacheminement des câbles à fibre optique, jusqu’au retrait de Siri et Alexa.
Au lieu de rejeter la faute sur des disciplines académiques déjà établies, il faut aller plus loin et faire une analyse amorale de la situation actuelle, dans laquelle on aura préfiguré la disparition d’Internet. « Internet n'existe pas », écrit Angelicism01. « Peut-être que cela existait il y a peu de temps, comme il y a deux jours. Mais maintenant il ne reste que flou, miroir, doxa , expiration, redirection, 01. Si jamais il existait, nous ne pourrions pas le voir. Internet a disparu, personne ne peut nous emmener avec lui. Quand vous n’existez pas, l’espace en vous continue de faire semblant d’exister. »
Paul Virilio et Jean Baudrillard m'ont appris dès le début l'existence d'une esthétique de la disparition. Nous devons trouver comment organiser une extinction électronique alternative et radicale au lieu de nous précipiter pour déclarer : « Internet est mort, vive Internet » ! Une autre fin est possible. Cela ne se produira pas en prenant simplement d'assaut les générateurs d'électricité comme le font les envahisseurs russes en Ukraine ou en installant, supprimant et réinstallant l'une des connexions Star Link d'Elon Musk. Peut-être avons-nous déjà épuisé le temps qui nous restait pour effectuer des recherches essentielles ; la moindre des choses est d'apporter son soutien aux artistes, d'écouter attentivement leur imaginaire cosmotechnique et « cli-fi ».
Non seulement dans la biosphère, mais aussi dans l’infosphère, la perte de diversité est entropique, stérilisante et fragile : elle s’effondre sur elle-même. Les réseaux sociaux au service de la critique en ligne, l'informatique au service de la détox numérique et la conception d'applications alternatives au nom de la prévention des données, pas seulement de leur protection. Qu’est-ce que la décroissance d’Internet, le désapprentissage automatique, l’idiotie artificielle ? C’est ainsi que la pensée pharmacologique et les flux de réflexion peuvent être reconvertis en pratiques fonctionnelles de conception. Le défi, dans l’esprit de Stiegler, est donc d’introduire des bifurcations improbables et incalculables dans l’enseignement supérieur pour mettre en pratique les concepts, protocoles et prototypes de récupération. Avec Anaïs Nin, on peut dire que le canal de communication que nous aimons « doit être un hache pour briser la mer de glace qui est en nous ».
La proposition concerne une conception des réseaux sociaux mettant l'accent sur les soins, ainsi que des outils d'informatique intergénérationnelle qui sont à leur tour utiles pour résoudre des problèmes à chaque niveau de la pile de crise. C’est le genre de réflexion intégrée où la question n’est plus de savoir quoi faire avec le flux incessant d’applications téléchargeables qui vont et viennent, de TikTok, Ethereum, Dall-E, Zoom et Clubhouse à BeReal et leurs arrière-pensées informatiques liées à l’exploitation minière. . Arrêtons de construire des solutions Web3 pour des problèmes qui n'existent pas et promouvons des outils qui décolonisent, redistribuent les sens, conspirent et organisent. Comme Bogna Kronior l'a expliqué dans un tweet : « Je ne veux pas de liberté d'expression. Je veux un réseau qui ne soit pas connecté au Meatspace et qui ne fasse pas de tout un concours de popularité et un narcissisme accablé par la dépendance à la dopamine. Il faut dépersonnaliser, rendre maîtres nos yeux et notre système nerveux ; Assez avec l’économie identitaire. Ne dépend plus de plateformes, contrôlées par des autorités invisibles et distantes. »
Notre tâche en tant que théoriciens, artistes, activistes, designers, développeurs, critiques et autres irréguliers sera d’aller au-delà de la partition et de développer une modestie radicale quant au potentiel du numérique. Il faut bifurquer pour avancer vers de nouveaux horizons
Quel est le déclin d’Internet alors que le nombre de ses utilisateurs a dépassé les cinq milliards ? Jean Baudrillard nous a appris que l'explosion informationnelle est vécue comme une implosion. Que se passe-t-il lorsque les villes intelligentes s’effondrent dans le trou noir du métaverse ? Quand les sociétés post-Covid feront-elles face au refus de travailler ? Qu’est-ce que cela signifie lorsque nous rappons sur le thème « dire la vérité à la plateforme » et que nous partageons des vidéos de « propagande climatique » ? Que signifie la parrêsia dans le contexte d’Internet, au-delà de la liberté d’expression démocratique ? Quelles sont nos préoccupations environnementales au-delà de la consommation d’électricité des centres de données et des pratiques de crypto-minage extrêmement économes en énergie ?
Notre état cosmotechnique actuel, comme l’appelle Yuk Hui , est défini par un enchevêtrement inquiétant d’événements historiques accélérés et de stagnation sociale. La cosmotechnique a lieu alors qu’il n’y a pas de retour à la phase innocente de la mondialisation, et s’y ajoute l’incertitude sur la question de la résistance à l’isolationnisme géopolitique. Cet état de confusion conduit à des techno-monstruosités : de l’idéologie crypto de la droite libertaire, aux fausses nouvelles et deep fakes, en passant par les biais de l’intelligence artificielle. L’espoir que les décisions politiques guideront et maintiendront ces avancées technologiques à distance a été pratiquement abandonné. Les marchés non plus. Avec Pieter Lemmers, Yuk Hui écrit : « La vérité de notre époque est une vérité sur laquelle, selon Stiegler, pratiquement tout le monde préfère fermer les yeux parce qu'elle est trop traumatisante, inconcevable et effrayante. Cela parle non seulement de la fin possible, mais aussi de la fin plutôt probable et imminente de l’humanité, ou du moins de la civilisation humaine telle que nous la connaissons. Même les quelques riches « préparateurs » qui se réfugient dans des bunkers enterrés en Nouvelle-Zélande ou se préparent à un exode dans l’espace sont également condamnés. Personne n’échappe à l’effondrement de la civilisation combiné au désastre climatique. La nouvelle de l’extinction d’espèces est un fait incontestable.
La fin de l’Internet tel que nous le connaissons, ou plus précisément, la fin des cultures de réseau telles que nous les avons connues (et étudiées), sont de plus en plus proches. Au cours de la dernière décennie, Internet est rapidement passé d’un stade froid et positif à celui de partie intégrante du problème, incapable d’inverser ses tendances destructrices. Peut-être avons-nous déjà dépassé le point de non-retour. Faire taire les non-humains ne fonctionne plus comme avant. Comment répondre à la question rhétorique de Douglas Rushkoff (« programmer ou être programmé ») maintenant que l'open source et le logiciel libre sont moralement en faillite en raison de leur braderie et, par conséquent, ont perdu de leur attrait au fil des générations futures ? Que se passe-t-il lorsque même les Allemands ne peuvent pas faire face à leurs tempêtes de merde et que les Français ramènent les enseignements de la collapsologie ? Bref, qu’est-ce que cela veut dire quand on dit qu’Internet a pris une tournure catastrophique et est devenu irréparable ?
Pensons un instant à Infinite Detail de Tim Maughan , une histoire de science-fiction dans un futur proche développée autour du concept de kill switch. Une cyberattaque ferme définitivement Internet, entraînant la fin du monde tel que nous le connaissons . Les coupures de câbles océaniques et les attaques contre les télécommunications et les centres de données se produisent en ce moment même. Nous revenons aux origines militaires de la cybernétique et d'Internet, aux travaux de Paul Virilio et de Friedrich Kittler qui ont déterminé jusqu'à aujourd'hui mes fondements intellectuels. Si Internet promettait la résilience, l’effondrement est désormais réel.
Extinction Internet parle de décroissance, de fin de l'exploration de données et, oui, même de ces moments où les écrans deviennent noirs et où le défilement funeste s'arrête net. Mais c’est aussi une question de conception d’urgence, une promesse radicale qui affirme que la mise en œuvre des principes de prévention des données dans les appareils et les applications est encore possible si l’on suppose que nous atteindrons bientôt le « pic de données » et que des mesures en cours telles que l’intelligence artificielle « éthique » et les « bonnes données » ne pourront produire ni la justice sociale, ni la fin du capitalisme racial, ni l’aversion à la catastrophe climatique. Pour le dire en termes post-apocalyptiques et de science-fiction : pas du punk solaire mais du punk lunaire .
Au niveau des états psychiques, ces derniers temps, nous nous sommes principalement concentrés sur le déficit d'attention induit par la plate-forme, l'impuissance réflexive et l'hédonie dépressive, comme les a décrits Mark Fisher . Cette situation alarmante a trouvé son pendant dans la solastalgie , « une forme émergente de dépression et de détresse causée par des changements environnementaux, tels que le changement climatique, les catastrophes naturelles, les conditions météorologiques extrêmes et/ou d'autres altérations négatives ou bouleversantes de l'environnement ou de votre maison. » Avec des millions de réfugiés climatiques, nous sommes mis au défi de réfléchir ensemble à une « pile de crise » où la dépendance aux plateformes n’est qu’une de nos nombreuses préoccupations urgentes.
Le fait qu'Internet accélère les problèmes mondiaux et en fait de plus en plus partie intégrante fait l'objet d'un consensus général. Les soi-disant « bons » protocoles et la décentralisation par le biais de « réseaux de réseaux » se sont révélés incapables de résister aux plates-formes centralisées et au contrôle autoritaire. Au lieu de cela, ces approches se sont révélées susceptibles d’un examen plus approfondi, inadaptées pour « tourner autour » de la politique mondiale et « l’interpréter comme nuisible », comme on l’a autrefois scandé dans les années 1990. Alors que les organes directeurs sont administrés par des ingénieurs et des fonctionnaires bien intentionnés des ministères des télécommunications, il est triste de penser que, même si Facebook et Google occupent des positions de leader, les chances d'une révolution structurelle sont minimes. Il est donc de plus en plus nécessaire d’élaborer des feuilles de route comportant des initiatives concrètes sur la manière de reprendre Internet. Surtout ici, à Amsterdam, avec ses centres fintech, le stratégique Amsterdam Internet Exchange et ses bâtiments extravagants . Après tout, attendre Bruxelles, c’est comme attendre Godot. Par ailleurs, comment les universités peuvent-elles se libérer de leur dépendance à l’égard de Google et de Microsoft ? Comment les artistes peuvent-ils espérer s’affranchir d’Adobe et d’Instagram ?

Dans la conclusion de The Platform Marshes, j’ai décrit comment un exode hors de la plateforme pourrait être entrepris. À cette fin, j'ai utilisé le terme « stacktivisme », une forme d'activisme Internet qui prend conscience des dépendances interconnectées de ses propositions alternatives et de sa forme en couches, depuis les référentiels publics jusqu'aux infrastructures décentralisées et aux systèmes d'exploitation sur des logiciels libres et ouverts. . jusqu'aux interfaces non manipulatrices, aux filtres IA et aux forums avec des pratiques de prise de décision libres. Nous allongeons et ouvrons le temps, nous concevons des configurations spatio-temporelles autonomes capables de laisser place à la réflexion. Il est crucial que tout cela ne paraisse pas énigmatique ou utopique. En effet, je ne soutiens pas les fantasmes mondiaux de « calcul à l’échelle planétaire » et de « terraformation » promulgués par Benjamin Bratton, l’auteur de The Stack , et encore moins la métaphysique de ce qu’on appelle la « théorie numérique ».
La disparition de la possibilité de changement est en cours depuis une décennie ou plus : à sa place se trouvent des interfaces utilisateur faciles à naviguer et des vidéos de chatons.
Alors, comment pouvons-nous « déranger les fauteurs de troubles » ? Premièrement, nous devons nous assurer que nos concepts et nos conceptions peuvent réellement être mis à l’échelle et mis en pratique. C'est le cas de la transition d'un modèle économique extractiviste vers ce que Bernard Stiegler et ses collaborateurs ont défini comme « l'économie contributive ». Le modèle, par exemple, dans lequel les paiements peer-to-peer s’ajoutent à une économie circulaire, durable et mondiale qui œuvre à la redistribution des richesses et des ressources, tant au niveau local que mondial. Je suis convaincu que c'est là la dimension décoloniale du problème cyber, un domaine qui nécessite encore de travailler sur l'empreinte carbone, sur l'extraction de matières rares et sur la question des déchets électroniques produits par le monde numérique.
Comme le dit Michael Marder dans Philosophy for Passengers : « Après la fin du voyage dans le monde, le voyage de la compréhension commence. » Comprendre Internet . Notre tâche en tant que théoriciens, artistes, activistes, designers, développeurs, critiques et autres irréguliers sera d’aller au-delà de la partition et de développer une modestie radicale quant au potentiel du numérique. Nous devons bifurquer pour pouvoir avancer vers de nouveaux horizons, ouvrant la voie à ce que Stiegler appelle le Néganthropocène. Comparé au désastre climatique actuel et aux inégalités sociales croissantes, l’effort de calcul est relativement mineur. Après tout, le code peut être réécrit, de nouveaux systèmes d’exploitation construits, des câbles et des signaux réacheminés, des centres de données décentralisés et des infrastructures publiques installées.

Comme l’avait observé Walter Benjamin : « C’est une catastrophe que les choses continuent ainsi. » Le problème ici n’est pas qu’Internet s’effondrera à tout moment – et que la thèse sur son extinction sera réfutée d’une manière ou d’une autre. Il y a déjà suffisamment de pannes de courant dans le monde, comme me le rappellent mes amis ukrainiens . Aux « délestages automatiques » s’ajoutent les filtres, les paywalls, les algorithmes et l’intelligence artificielle, la censure d’État, les piratages, les correctifs défectueux et la modération du contenu, tout cela grâce à une main-d’œuvre bon marché. Nous serons confrontés à de plus en plus d’« événements improbables », au-delà de la cyberguerre des hackers du passé. Ce monde post-naturel est sur le point de faire d’étranges pas de géant. Le mystère cosmotechnique surprendra ceux qui croient en une connectivité fluide et stable. Mais ce qui est réellement en jeu, c'est l'effondrement de l'imagination collective d'un système technologique qui joue un rôle si crucial dans la vie quotidienne de milliards de personnes et qui peut néanmoins être façonné, gouverné, conçu et plié en vertu de fins non officielles. . La disparition de la possibilité de changement est en cours depuis une décennie ou plus : à sa place se trouvent des interfaces utilisateur faciles à naviguer et des vidéos de chatons.
Des progrès lents mais réguliers ont été réalisés dans le développement d’applications en ligne alternatives. En plus de Linux, Wikipedia et Firefox déjà consolidés, il y a DuckDuckGo, Signal, Telegram, Mastodon et Fediverse, deepl, OpenStreetMap, Jitsi et Cryptpad ; la liste s'allonge. Cependant, les outils de réseaux sociaux, plus que jamais nécessaires, se sont révélés extrêmement difficiles à déchiffrer. Au cours de la décennie perdue d’Internet, nous avons réorganisé les transats sur le Titanic sous la direction inspirante des entreprises. Malheureusement, l’optimisme systémique a pris le pas sur les critiques. C'est la véritable tragédie de la critique sur Internet, faite en Europe . Où est notre résilience maintenant que nous en avons besoin ? Alors que l’attention s’est tournée vers la cryptographie, la blockchain et les systèmes de paiement, le techno-social a été négligé. Est-il possible de revenir des plateformes aux protocoles ? Est-il encore temps d’écrire du code et de créer de nouveaux scripts de connexion ? Face à l’augmentation des niveaux de détresse et de colère, nombreux sont ceux qui estiment que trop peu sera fait, trop tard. Il ne reste plus beaucoup de patience pour les diverses cérémonies bureaucratiques de consensus, maintenant que les solutions ont été à nouveau déléguées aux responsables des relations publiques, aux « marchés » et aux ingénieurs (qui ne sont pas si « neutres ») qui étaient censés résoudre le problème. .
Je n’ai aucune ambition de devenir la Cassandre de la plateforme, et je ne meurs d’envie d’écrire l’éloge funèbre de mon médium bien-aimé. Pourtant, la peur liée à sa disparition semble si répandue que son nom même est rarement évoqué en signe de respect envers le défunt. « Nous utilisons les réseaux sociaux, plus les i-… ». En 1995, Bruce Sterling, écrivain cyberpunk, avait déjà préparé le terrain avec son Dead Media Project – comme on peut s'y attendre de la part d'un auteur de science-fiction de cette trempe. Le site Internet visait à rassembler les technologies de communication obsolètes et oubliées, annotées dans un guide des échecs, des effondrements et des erreurs désastreuses des médias. Sterling et ses collaborateurs ont désormais ajouté des fonctionnalités de texte telles que telnet, Gopher et groupes de discussion à leur nécrologie de médias disparus. Tôt ou tard, Internet pourrait également être ajouté à la liste ; il est fort probable que cette nouveauté nous soit vendue au nom du progrès et du confort des utilisateurs.

Augmenter l'entropie, renverser les mèmes, faire danser et défiler les écrans toute la nuit. À l’aube, l’humanité s’inquiétera de choses plus urgentes. Certains renégats se souviendront du « court été d’Internet », suivi d’un long règne des Titans, jusqu’à ce qu’une rupture recouvre les cultures en réseau d’une épaisse couche de cendres sémiotiques, étouffant le dialogue et les échanges restants. Comme nous le rappelle Walter Benjamin dans ses Thèses sur la philosophie de l’histoire , écrites peu avant sa mort fuyant les nazis, il est de notre devoir, en tant que reporters, de réciter les actes mineurs de cet épisode marquant de l’histoire de la communication. Il nous invite ainsi à « saisir un souvenir tel qu'il surgit à l'instant du danger ». Laisser derrière nous la brève période de liberté sur Internet, avec toutes ses bizarreries et ses défauts, n’est pas le signe d’un progrès irrépressible. Il y a des tas de déchets informatiques devant nous. Il est de notre devoir de refuser de nous ranger du côté des milliardaires et d'autres dirigeants autoritaires, de lutter contre la techno-nostalgie et de poursuivre une fois de plus « notre tâche de faire passer l'histoire par le contrepoint ».
En revendiquant la fin, l'énergie est libérée pour la création de nouveaux départs.
Geert Lovink

Télécharger le texte en .pdf (english)
Je tiens à remercier Ned Rossiter, David Berry, Patricia de Vries, Nadine Roestenburg, Niels ten Oever, Chloë Arkenbout et Sabine Niederer pour leurs précieuses corrections et commentaires. Publié initialement sur networkcultures.org .
Geert Lovink : Théoricien des médias et spécialiste d'Internet. Il est l'auteur, entre autres, de Uncanny Networks (2002), Dark Fiber (2002) et Digital Nihilism. L'autre côté des plateformes (2019). Co-créateur de la liste de diffusion Nettime et d'ADILKNO ( Fondation pour l'avancement des connaissances illégales ), il fonde en 2004 l'Institut des Cultures en Réseau à l'Université des Sciences Appliquées d'Amsterdam. Pour la série Not de NERO, il a publié Le paludi della platform. Reprenons Internet .
23.04.2024 à 19:06
S'éduquer avec les ignorants - et Jacques Rancière
L'Autre Quotidien
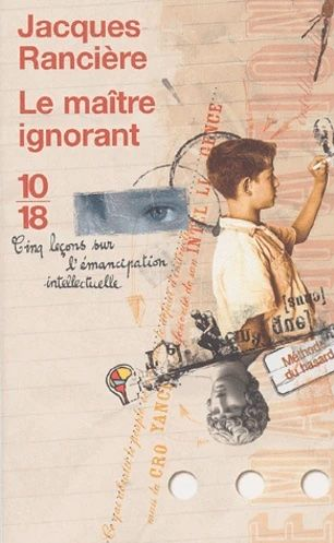
Texte intégral (2901 mots)
« Calypso ne pouvait se consoler du départ d’Ulysse » : la redécouverte par Jacques Rancière de la pédagogie révolutionnaire de Joseph Jacotot, et ses implications en termes d’émancipation intellectuelle.

Publié en 1987 chez Fayard, sous-titré « Cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle », « Le maître ignorant », principalement consacré à la redécouverte de l’approche bien particulière du pédagogue français Joseph Jacotot (1770-1840), joue un rôle-clé dans la construction de l’œuvre, toujours en cours, du philosophe Jacques Rancière.
Progressivement dégagé de l’influence envahissante de son maître Louis Althusser, Jacques Rancière s’est plongé, à partir de sa thèse de 1981 (« La Nuit des prolétaires – Archives du rêve ouvrier »), dans une vaste entreprise de compréhension de l’éducation populaire, tout particulièrement sous les angles de l’enseignement autodidacte, du partage des savoirs et de la possibilité d’échapper, historiquement comme de nos jours, à la malédiction de la « distinction » (l’ouvrage fondamental de Pierre Bourdieu, justement sous-titré « La critique sociale du jugement », est paru en 1978).
Étant alors l’un des rares philosophes contemporains à se préoccuper d’éducation au-delà d’une simple transmission des savoirs, et en y intégrant pleinement les rôles respectifs de l’esthétique et de la littérature (comme en témoigneront au fil de son œuvre les impressionnantes monographies orientées consacrées à Stéphane Mallarmé, à Jean-Luc Godard, à Béla Tarr ou à Philippe Beck, pour n’en citer que quelques-unes), Jacques Rancière conduit avec rigueur et passion cette investigation en forme de leçons de choses, où le savoir de celui qui occupe la position d’enseignant n’entre pas en ligne de compte. Comme il le confiait à Anne Lamalle dans un entretien pour Nouveaux Regards en 2005, il s’agissait de « faire passer dans notre présent l’actualité intempestive qu’il [Joseph Jacotot] avait eue dans un contexte intellectuel et politique très éloigné ».
En l’an 1818, Joseph Jacotot, lecteur de littérature française à l’université de Louvain, connut une aventure intellectuelle.
Une carrière longue et mouvementée aurait pourtant dû le mettre à l’abri des surprises : il avait fêté ses dix-neuf ans en 1789. Il enseignait alors la rhétorique à Dijon et se préparait au métier d’avocat. En 1792 il avait servi comme artilleur dans les armées de la République. Puis la Convention l’avait vu successivement instructeur au Bureau des poudres, secrétaire du ministre de la Guerre et substitut du directeur de l’Ecole polytechnique. Revenu à Dijon, il y avait enseigné l’analyse, l’idéologie et les langues anciennes, les mathématiques pures et transcendantes et le droit. En mars 1815 l’estime de ses compatriotes en avait fait malgré lui un député. Le retour des Bourbons l’avait contraint à l’exil et il avait obtenu de la libéralité du roi des Pays-Bas ce poste de professeur à demi-solde. Joseph Jacotot connaissait les lois de l’hospitalité et comptait passer à Louvain des jours calmes.
Le hasard en décida autrement. Les leçons du modeste lecteur furent en effet vite goûtées des étudiants. Parmi ceux qui voulurent en profiter, un bon nombre ignorait le français. Joseph Jacotot, de son côté, ignorait totalement le hollandais. Il n’existait donc point de langue dans laquelle il pût les instruire de ce qu’ils lui demandaient. Il voulut pourtant répondre à leur vœu. Pour cela, il fallait établir, entre eux et lui, le lien minimal d’une chose commune. Or il se publiait en ce temps-là à Bruxelles une édition bilingue de Télémaque. La chose commune était trouvée et Télémaque entra ainsi dans la vie de Joseph Jacotot. Il fit remettre le livre aux étudiants par un interprète et leur demanda d’apprendre le texte français en s’aidant de la traduction. Quand ils eurent atteint la moitié du premier livre, il leur fit dire de répéter sans cesse ce qu’ils avaient appris et de se contenter de lire le reste pour être à même de le raconter. C’était là une solution de fortune, mais aussi, à petite échelle, une expérience philosophique dans le goût de celles qu’on affectionnait au siècle des Lumières. Et Joseph Jacotot, en 1818, restait un homme du siècle passé.
L’expérience pourtant dépassa son attente. Il demanda aux étudiants ainsi préparés d’écrire en français ce qu’ils pensaient de tout ce qu’ils avaient lu. « Il s’attendait à d’affreux barbarismes, à une impuissance absolue peut-être. Comment en effet tous ces jeunes gens privés d’explications auraient-ils pu comprendre et résoudre les difficultés d’une langue nouvelle pour eux ? N’importe ! Il fallait voir où les avait conduits cette route ouverte au hasard, quels étaient les résultats de cet empirisme désespéré. Combien ne fut-il pas surpris de découvrir que ces élèves, livrés à eux-mêmes, s’étaient tirés de ce pas difficile aussi bien que l’auraient fait beaucoup de Français ? Ne fallait-il donc plus que vouloir pour pouvoir ? Tous les hommes étaient-ils donc virtuellement capables de comprendre ce que d’autres avaient fait et compris ? » (Félix et Victor Ratier, « Enseignement universel. Émancipation intellectuelle », Journal de philosophie panécastique, 1838, p. 155).

En parcourant minutieusement la biographie du pédagogue de l’Université de Louvain, Jacques Rancière nous décrit d’abord avec soin le (désormais légendaire mais à l’époque presque totalement oublié) enseignement de la langue française, pratiqué uniquement à partir des « Aventures de Télémaque » (1699) de Fénelon – dont l’illustre première phrase, « Calypso ne pouvait se consoler du départ d’Ulysse », est demeurée célèbre -, auprès d’étudiants néerlandophones ignorant totalement la langue française. Après ce premier chapitre (« Une aventure intellectuelle »), on passera tout naturellement à « La leçon de l’ignorant », à « La raison des égaux », à « La société du mépris », et enfin à « L’émancipateur et son singe », qui conclut l’ouvrage : en cinq étapes, voici démonté et généralisé subtilement, aux côtés de Joseph Jacotot, l’ensemble de la construction socio-politique de l’éducation et de la transmission du savoir, de la confiscation d’un élan et d’une hiérarchisation des intelligences valant hiérarchisation tout court – en toute légitimité trafiquée.
Affirmer et largement démontrer qu’il est possible à un ignorant d’enseigner ce qu’il ne connaît pas lui-même, voilà en effet une position hautement révolutionnaire – et qui jette un sérieux pavé dans la mare de ceux qui prétendent détenir un savoir – alors qu’ils ne parlent en réalité que de pouvoir. « Le maître ignorant » est une lecture sainement dérangeante, joliment savoureuse, et un palier indispensable pour accompagner Jacques Rancière sur les chemins de l’émancipation intellectuelle et populaire.
Ainsi la victoire en marche des lumineux sur les obscurants travaillait-elle à rajeunir la plus vieille cause défendue par les obscurants : l’inégalité des intelligences. Il n’y avait en fait nulle inconséquence dans ce partage des rôles. Ce qui fondait la distraction des progressifs, c’est la passion qui fonde toute distraction, l’opinion de l’inégalité. Il est bien vrai que l’ordre social n’oblige personne à croire à l’inégalité, n’empêche personne d’annoncer l’émancipation aux individus et aux familles. Mais cette simple annonce – qu’il n’y a jamais assez de gendarmes pour empêcher – est aussi celle qui rencontre la résistance la plus impénétrable : celle de la hiérarchie intellectuelle qui n’a pas d’autre pouvoir que la rationalisation de l’inégalité. Le progressisme est la forme moderne de ce pouvoir, purifiée de tout mélange avec les formes matérielles de l’autorité traditionnelle : les progressistes n’ont pas d’autre pouvoir que cette ignorance, cette incapacité du peuple qui fonde leur sacerdoce. Comment, sans ouvrir l’abîme sous leurs pieds, diraient-ils aux hommes du peuple qu’ils n’ont pas besoin d’eux pour être des hommes libres et instruits de tout ce qui convient à leur dignité d’hommes ? « Chacun de ces prétendus émancipateurs a son troupeau d’émancipés qu’il selle, bride et éperonne. » Aussi tous se retrouvent-ils unis pour repousser la seule mauvaise méthode, la méthode funeste, c’est-à-dire la méthode de la mauvaise émancipation, la méthode – l’anti-méthode – Jacotot.
Ceux qui taisent ce nom propre savent ce qu’ils font. Car c’est ce nom propre qui fait à lui seul toute la différence, qui dit égalité des intelligences et creuse l’abîme sous les pas de tous les donneurs d’instruction et de bonheur au peuple. Il importe que le nom soit tu, que l’annonce ne passe pas. Et que le charlatan se le tienne pour dit : « Tu as beau crier par écrit, ceux qui ne savent pas lire ne peuvent apprendre que de nous ce que tu as imprimé, et nous serions bien sots de leur annoncer qu’ils n’ont pas besoin de nos explications. Si nous donnons des leçons de lecture à quelques-uns, nous continuerons à employer toutes les bonnes méthodes, jamais celles qui pourraient donner l’idée de l’émancipation intellectuelle. » […]
Ce qu’il fallait surtout empêcher, c’était que les pauvres sachent qu’ils pouvaient s’instruire par leurs propres capacités, qu’ils avaient des capacités – ces capacités qui succédaient maintenant dans l’ordre social et politique aux anciens titres de noblesse. Et la meilleure chose à faire pour cela, c’était de les instruire, c’est-à-dire de leur donner la mesure de leur incapacité.
Hugues Charybde, le 24/04/2024
Jacques Rancière - Le maître ignorant - Cinq leçons sur l'émancipation intellectuelle - 10/18
l’acheter chez Charybde, ici

28.02.2024 à 17:58
Médecine et police : Tout diagnostic en psychiatrie est un mythe
L'Autre Quotidien

Texte intégral (4047 mots)
Psychiatre, narcologue avec trente ans d'expérience, auteur du livre «Addicted Person» et plusieurs autres, Alexander Gennadievich Danilin, explique comment, dans le système de la psychiatrie russe, l'amour pour un patient est remplacé par le pouvoir sur lui.

Bien qu’administrativement les systèmes de traitement psychiatrique et de traitement de la toxicomanie existent séparément l'un de l'autre, les deux (et pas seulement) sont essentiellement structurés de la même manière. Nous avons généralement un système qui, avec des variations mineures, régule divers domaines de notre vie. Ce n’est pas seulement le cas ici, mais dans notre pays, cela a toujours été ainsi. Ce système est basé sur le principe du non-amour.
La méthode de mise en œuvre de ce principe est la lutte de chacun contre tout le monde. Nous ne savons pas comment et ne voulons pas aider une personne, mais nous menons ou soutenons une lutte constante contre tout ce que nous considérons comme « anormal ».
Sans chercher à réfléchir à ce qu’est une « personne normale », nous considérons a priori comme « normal » exclusivement nous-mêmes et notre mode de vie. Certes, chacun de nous, y compris les psychiatres et les narcologues, doute fortement que sa « pensée rationnelle » et son mode de vie représentent une norme d'existence idéale. Nous avons peur que, sous couvert de « justesse », quelqu'un voie nos rêves secrets et nos passions « folles ».
Par conséquent, la psychanalyse et la psychologie en général sont impopulaires dans notre société : nous avons peur d'être manipulés, et une personne qui se considère « normale » veut manipuler les autres - les contrôler, « posséder » ses proches.
Le principe de non-amour - le désir de pouvoir, au lieu de la compréhension et de l'empathie, devient très souvent le principe principal de l'interaction dans une famille ou dans une relation de couple (et le plus souvent ces couples se séparent). Si le principe du pouvoir régit les institutions sociales conçues pour aider les gens, alors ces institutions sociales sont mauvaises : elles ne fonctionnent pas, elles ne remplissent pas leur fonction principale. La médecine a été créée et doit être façonnée par le principe de l’amour envers la personne qui souffre. La médecine est appelée à aider son patient, et c'est là sa seule tâche. La psychiatrie russe et bien plus tard la narcologie ont été créées sur les principes du pouvoir : stigmatisation, contrôle et supervision. La « stigmatisation » est, à proprement parler, l'établissement d'un « diagnostic définitif » : « schizophrénie » ou « toxicomanie ».
Pour confirmer leur propre « normalité », une personne et une société qui n'est pas sûre de sa propre normalité ont besoin d'un groupe marginal de « malades » - « complètement anormaux » - qui seront coupables de toutes les peurs et des troubles de la vie publique.
Même dans la vie de tous les jours, nous posons constamment des diagnostics. «Pourquoi mon mari m'a-t-il quitté?» - "Il est complètement malade." « Qui commet des crimes et des actes terroristes ? - « Les malades mentaux et les toxicomanes. » Dans notre pays, les personnes talentueuses (j'ai peur du mot « génie ») sont traitées à peu près de la même manière. Leurs propres parents considèrent souvent le désir d’un jeune homme d’écrire de la poésie ou de dessiner comme « anormal » – après tout, « cela ne fournit pas de moyens de subsistance ».
Que faire de tout ça ?
La majorité répond : « Des foules de fous et de toxicomanes encore non identifiés parcourent les rues ! » ; « Nous devons les contrôler plus strictement ! « Une détection et des tests précoces sont nécessaires ! »
Nous avons longtemps et fermement confondu médecine et police.
Le système de traitement de la toxicomanie a été créé en 1983 ; ce sont les derniers camps de travail de ce type en URSS.
Était-il nécessaire de mettre les alcooliques quelque part ?
Personne ne voulait penser au fait que l’ivresse massive est le résultat d’un sentiment d’absurdité – de « l’anomalie » de la vie humaine. Les alcooliques ont grandement gâché l’image du « paradis socialiste ».
Un nouveau domaine de la médecine – la narcologie – est devenu la dernière incarnation de la voie socialiste vers le bonheur. Un homme ivre dans la rue a été interpellé par la police, il a été amené aux urgences de l'hôpital, où un « diagnostic final » a été immédiatement posé : « Alcoolisme chronique, stade deux ». Dans le service de traitement de la toxicomanie, il a été dégrisé en quelques jours et sa gueule de bois a été éliminée, puis il a été envoyé en « ergothérapie » pendant six mois - les « patients » travaillaient en trois équipes à l'usine ZIL. Dans le service médical, où environ 40 personnes sont actuellement soignées, au milieu des années 80, il y avait jusqu'à 160 personnes à la fois, il y avait des lits superposés en prison.
C'est le bonheur, selon le modèle de traitement de la toxicomanie de la fin du socialisme : le matin, je me suis injecté, j'ai pris des pilules - et je suis allé travailler à la machine ; le soir après le travail, je me suis injecté, j'ai pris une pilule - et je suis tombé. dans un profond sommeil.
Depuis lors, beaucoup de choses ont changé, mais pas dans la partie qui concerne le principe de la relation entre le médecin et le patient - ici, les changements se produisent très lentement ou ne se produisent pas du tout. Le patient n'a toujours pas besoin de comprendre les raisons de son ivresse et de changer quoi que ce soit dans son attitude envers la vie. Ce n'est pas à celui qui boit de l'alcool d'oublier et de ne pas penser qu'il est responsable de la maladie ; du point de vue de notre narcologie, l'alcool est responsable de la maladie. Par conséquent, les médecins continuent de traiter « l’alcool » plutôt que d’aider une personne à comprendre quelque chose. Dieu pardonne! Après tout, la compréhension est le principe de l’amour. Un alcoolique doit se faire soigner. Il doit « se rendre » au médecin et prendre docilement les pilules, sans chercher à comprendre pourquoi elles sont nécessaires. Après traitement, il sera enregistré et il perdra une partie importante de ses droits et libertés. En fait, un alcoolique s'avère être quelque chose comme un criminel, seulement un criminel potentiel - il a un risque accru de commettre un crime, alors privons-le de ses droits, juste au cas où - à des fins préventives. Je ne parle même pas des toxicomanes, car la consommation de drogues est considérée comme un crime et dans ce cas, il devient totalement impossible de faire la distinction entre une maladie et un crime.
Prenons par exemple la « prévention » de la toxicomanie dans les écoles grâce au « testing », dont on parle tant. Je ne parlerai même pas du fait qu’il n’existe pas de méthodes adéquates, scientifiquement fondées et préservant la dignité humaine pour de tels « tests ». Imaginez : si soudainement votre enfant a une « propension » à consommer de la drogue, que se passera-t-il ensuite ? C'est vrai, un narcologue s'en chargera. Qu'est ce qu'il va faire?
Justement encore, il vous mettra en inscription préventive et vous prescrira... des médicaments psychoactifs.
Personne ne prétend que les toxicomanes ne commettent pas des crimes, les conducteurs ivres commettent des crimes - le problème est que la police doit s'occuper de ces crimes et que la médecine doit s'occuper d'aider une personne, quelle que soit la situation dans laquelle elle se trouve. Au 19ème siècle, en Russie, il y avait un médecin très célèbre, Fiodor Petrovich Gaaz (1780 - 1853), qui a créé un système de soins médicaux pour les prisonniers presque à partir de zéro, il a aidé les criminels à survivre et de nombreux contemporains l'ont considéré comme fou pour cela. Mais le médecin ne doit pas se soucier de savoir qui se trouve devant lui - un criminel ou non : il est appelé à aider la PERSONNE. Tout médecin devrait connaître par cœur le serment d’Hippocrate. Pourquoi le serment d’Hippocrate a-t-il une pertinence minime pour la médecine des addictions et la psychiatrie ?
Parce que l'inconscient social considère le pouvoir sur l'âme des autres, et non l'amour pour eux, comme la norme.
Contrairement à la psychologie, y compris la médecine domestique, la médecine ne veut pas comprendre que l'alcoolisme et la toxicomanie - le processus d'utilisation de substances psychoactives prises en elles-mêmes (sans tenir compte des effets toxiques sur le système nerveux qu'elles provoquent sans aucun doute) - n'ont presque rien. à voir avec la notion de « maladie ».
Après tout, nos patients sont plus susceptibles de consommer de l’alcool et des drogues pour guérir quelque chose qui leur fait mal à l’âme. Il ne faut pas oublier que presque toutes les substances qui appartiennent aujourd'hui au groupe des médicaments ont été utilisées assez récemment par la médecine officielle comme médicament, et certaines sont encore utilisées à ce titre. Le mot anglais «drogues dans le monde» désigne toutes les substances psychoactives, qu'elles soient interdites par la loi ou autorisées.
La consommation d'alcool et de drogues s'avère dans un premier temps être une manière d'automédication, une tentative d'une personne de se débarrasser, au moins temporairement, de problèmes psychologiques : des injections douloureuses d'orgueil, de solitude, d'un sentiment d'absurdité de sa propre existence, de l'alexithymie - l'incapacité d'exprimer ses sentiments avec des mots - du fait qu'il est incapable de s'exprimer et de se réaliser en tant qu'être socialement et politiquement significatif. Beaucoup de choses peuvent être ajoutées ici, par exemple la comparaison constante de soi-même avec les normes d'une « belle vie » sur l'écran de télévision. La consommation d’alcool et de drogues n’est pas une maladie, mais un phénomène socio-psychologique complexe. Il s’agit d’un phénomène de fuite loin de soi-même, de ses propres pensées et sentiments. Mais la narcologie domestique ne sait pas et ne va pas apprendre à ramener une personne à elle-même. Nous ne pouvons proposer qu'à la place de certains médicaments, d'autres, et malheureusement non moins dangereux.
Les narcologues semblent croire que ce n'est pas l'alcoolique qui s'efforce systématiquement de boire, mais la vodka elle-même qui lui court après. Hélas! La vodka est dépourvue d'esprit et de jambes.
Mais si vous blâmez ce principe déraisonnable pour le comportement volontaire d'une personne, alors « à partir de là », vous pouvez, par exemple, « introduire une torpille » (en fait, de tels médicaments n'existent pas - c'est une version de la psychothérapie) ou « coder » cela - le mettre à la place de la dépendance de la volonté et de la conscience du patient à l'égard de la peur ou des procédures répétées de « torpillage » et de « codage ».
Le concept à la mode de « dépendance » n’explique rien non plus. Le concept de « dépendance pathologique », comme un sortilège, remplace l'analyse psychologique des problèmes de la personnalité humaine. On oublie que chacun de nous a un grand nombre de « dépendances », et toutes ne sont pas chimiques : dépendance à un être cher, à un métier, à des loisirs (collectionner par exemple), à un mode de vie habituel, à Internet, au jeu...
Du point de vue de la fonction psychologique, ils ne sont pas différents les uns des autres. Toute « dépendance » n’est rien d’autre qu’un moyen d’auto-identification, l’un des mécanismes de défense mentale décrits par Sigmund Freud. Nous nous habituons à nos partenaires, et s'ils nous quittent, alors nous ressentons... le syndrome de sevrage (« syndrome de sevrage »), notre cœur nous fait mal, nos mains tremblent, nous cessons de dormir la nuit. Nous nous habituons à un certain style vestimentaire, et si nous sommes habillés différemment, nous ressentons un léger syndrome de sevrage : nous nous sentons mal à l'aise, anxieux et nous pouvons transpirer.
Avant de déclarer la « guerre » à l’addiction, il est utile de réfléchir à ce qu’est l’indépendance. Est-ce l’état d’un bodhisattva qui comprend que tout autour est une illusion ?
Ou est-ce l'état d'un véritable chrétien, capable « d'aimer son ennemi », de « tendre l'autre joue » - ces mêmes « schizophrènes » et « toxicomanes » ?
L’« autre joue » est la « joue » de la compréhension, du pardon et de l’amour.
Que faire... Nous n'avons pas encore appris comment la « piéger ».
Vers quel idéal d’« indépendance » ou de « normalité » aspirons-nous si nous n’avons pas encore atteint un tel niveau de perfection spirituelle ?
Apparemment, notre vie d'aujourd'hui est remplie exclusivement de valeurs de comportement addictif. La dépendance à l’égard de l’argent et le « syndrome de sevrage » dû à son absence ne sont-ils pas la principale valeur réelle de la société moderne ?
Peut-être que nous nous sentirons tous mal sans nos addictions, car sans elles, nous risquons de devenir... « anormaux » - de perdre tous les liens sociaux et toutes les valeurs matérielles avec lesquelles nous nous identifions habituellement.
Sans aucun doute, il existe une classe d'objets (y compris les produits chimiques) dont la dépendance est dangereuse pour l'homme. Le problème est que le système (pas seulement dans notre pays) cherche à marginaliser uniquement certains objets et à entamer la « lutte » habituelle contre eux, qui revient essentiellement à les remplacer par des analogues les plus proches possibles. Il suffit de lire attentivement les instructions jointes aux substances psychopharmacologiques autorisées - antipsychotiques et antidépresseurs - et de lire particulièrement attentivement la rubrique « complications ».
Le système peut être compris, car sinon il devra se déclarer marginal – lui-même !
Sans la tendance d’une personne à s’identifier aux objets du monde extérieur, aucun commerce n’est possible. Après tout, ces mêmes « objets », y compris les médicaments, sont aussi des marchandises. La tâche de toute publicité est de créer une dépendance d’une personne à l’égard d’un certain produit ou groupe de produits.
Si, au lieu de vendre des médicaments, le système aide une personne à rechercher des objets d'un ordre interne différent : vocation, sens de la vie, valeurs créatives ou spirituelles, alors il se détruira.
La seule façon normale de prévenir l’alcoolisme et la toxicomanie dans le monde s’appelle « l’éducation ». On peut argumenter autant que l'on veut, mais le pourcentage de toxicomanes parmi les personnes ayant fait des études supérieures est en moyenne cinq fois inférieur à celui des personnes ayant fait des études secondaires incomplètes. Il n’y a rien d’étonnant à cela. L’éducation donne à une personne plus d’options et de moyens de s’identifier et de trouver le sens de la vie.
Bien sûr, ce serait formidable si par le mot «éducation», nous entendions non seulement remplir l'âme humaine d'informations peu digestibles, mais aussi une pédagogie profonde et socialement active qui peut captiver et aider un individu à trouver une vocation et le sens de la vie, qui peut apprendre à résister aux difficultés et aux échecs, en attendant une personne INDÉPENDANTE sur son chemin de vie.
G. K. Chesterton a un roman « Le bal et la croix », le livre traite de la montée au pouvoir de l'Antéchrist. La première chose qu’il fait est de faire adopter au Parlement une loi créant une police psychiatrique, c’est-à-dire une police qui a le droit de déterminer qui est « normal » et qui ne l’est pas.
La recherche même d'une tendance cachée au crime s'avère criminelle, car elle prive une personne du droit de choisir sa propre voie, cette même indépendance.
Il semble qu’en nous considérant comme un « État orthodoxe », dans le domaine de l’attitude envers l’homme et son âme, nous avancions encore sur le chemin du personnage principal du roman de Chesterton.
A titre d'exemple illustratif, on peut rappeler l'histoire du concept d' état mental - c'est le nom donné à la description par un psychiatre de ses impressions lors d'une rencontre avec un patient. Lors de la rédaction d'un statut, vous ne pouvez pas utiliser de termes médicaux, il s'agit d'une description artistique de l'état du patient, qui est le principal (et unique) outil de diagnostic psychiatrique et toxicomane. Le diagnostic est établi précisément à l’aide d’une description artistique par le médecin de l’état mental du patient.
Le concept même de « statut mental » appartient à l’innocent existentialiste chrétien Karl Jaspers. Il voulait dire qu'en tant que psychiatre, vous devriez écrire un court article – une sorte d'essai – sur la personne assise en face de vous. Mais pour Jaspers, le diagnostic ne se limitait en aucun cas à cela. Le médecin a dû ranger la description sur son bureau et la relire quelques jours plus tard, en réfléchissant à ce qu'il avait en tête lorsqu'il avait rédigé son essai. Pour Jaspers, « l’état mental » était un moyen de développer l’empathie – la sympathie pour le patient, un moyen de comprendre son âme. Dans la psychiatrie soviétique, apparemment en raison de la difficulté de former l'empathie (et pourquoi la former - à cette époque, une personne n'était pas censée avoir une âme), seule la première étape a été préservée - l'écriture du statut lui-même, qui est devenu un idéal, un outil de pouvoir sur le patient. Vous n'avez plus besoin d'écrire un essai, puis de l'analyser et de le modifier vous-même ou avec l'aide de collègues, en comprenant de plus en plus profondément le patient, en sympathisant avec lui. C’est assez simple, sans utiliser de termes, pour décrire les symptômes de la maladie que le médecin a remarqués… à première vue. Ce tout premier regard devient le principal outil de diagnostic : la stigmatisation.
Faire un diagnostic « au premier coup d’œil » est facile. C'est particulièrement simple s'il n'y a que deux diagnostics de ce type : « schizophrénie » et « addiction » (il y en a un de plus, mais il est de moins en moins utilisé), et même ceux-là aujourd'hui s'efforcent de plus en plus de se confondre.
Tout dépend donc exactement de la manière dont le médecin «plisse les yeux», révélant des « symptômes » au lieu d'une âme vivante.
C'est la technologie du pouvoir.
Que notre monde devienne le monde de l'Antéchrist du roman de Chesterton, à mon avis, dépend de notre volonté de réfléchir à nouveau à ce que signifient les mots « aider une personne », à la façon dont le désir d'aimer diffère du désir de pouvoir.
Alexander Gennadievich Danilin
Danilin pratique la psychothérapie dans des cliniques de Moscou depuis plus de 20 ans. Il est membre de l' Association psychanalytique internationale et chef de l'unité de toxicomanie de l'hôpital pour toxicomanes n°17 de Moscou. Les médias Le livre de Danilin LSD : Hallucinogènes, Le phénomène psychédélique et de dépendance a été retiré du marché par les agents du Service fédéral de contrôle des drogues de Russie et du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie. Ses articles sur les problèmes de la psychiatrie russe ( Dead End , Tout diagnostic en psychiatrie est un mythe , ont souvent suscité de vives controverses.
L’article original a été publié dans la revue Discours, une excellente revue russe indépendante d'art et d'analyse avec une édition horizontale, dont le contenu est déterminé par le vote de la communauté ouverte d'auteurs. “nous écrivons sur la culture, la science et la société, parlons de nouvelles idées et d'art contemporain, publions des interviews de personnes dont le discours direct vaut la peine d'être entendu, et le travail d'artistes du monde entier - des films et de la musique à la peinture et à la photographie.” une belle découverte.
06.02.2024 à 18:51
Théâtre et politique, par Giorgio Agamben
L'Autre Quotidien

Texte intégral (1159 mots)

Il est pour le moins singulier qu'on ne s'interroge pas sur le fait, non moins inattendu qu'inquiétant, que le rôle de leader politique soit de plus en plus assumé par les acteurs à notre époque : c'est le cas de Zelensky en Ukraine, mais la même chose s'était produite en Italie avec Grillo (éminence grise du Mouvement 5 étoiles) et même avant aux Etats-Unis avec Reagan.
Il est certainement possible de voir dans ce phénomène une preuve du déclin de la figure de l'homme politique professionnel et de l'influence croissante des médias et de la propagande sur tous les aspects de la vie sociale. Mais il est clair en tout cas que ce qui se passe implique une transformation du rapport entre politique et vérité sur laquelle il faut réfléchir. Que la politique ait à voir avec le mensonge est en fait évident ; mais cela signifiait simplement que l'homme politique, pour atteindre des objectifs qu'il croyait vrais de son point de vue, pouvait dire des mensonges sans trop de scrupules.
Ce qui se passe sous nos yeux est quelque chose de différent : il n’y a plus d’utilisation du mensonge à des fins politiques, mais au contraire, le mensonge est devenu en soi le but de la politique. Autrement dit, la politique est purement et simplement l’articulation sociale du faux.
On comprend donc pourquoi l’acteur est aujourd’hui nécessairement le paradigme du leader politique. Selon un paradoxe qui nous est devenu familier de Diderot à Brecht, le bon acteur n'est pas en fait celui qui s'identifie passionnément à son rôle, mais celui qui, gardant son sang-froid, le tient à distance, pour ainsi parler. Il paraîtra d'autant plus vrai qu'il cachera moins son mensonge. La scène théâtrale est le lieu d'une opération sur la vérité et le mensonge, dans laquelle la vérité se produit en exhibant le faux. Le rideau se lève et se ferme précisément pour rappeler aux spectateurs l'irréalité de ce qu'ils voient.
Ce qui définit aujourd’hui la politique – devenue, comme on l’a dit, la forme extrême du spectacle – est un renversement sans précédent du rapport théâtral entre vérité et mensonge, qui vise à produire le mensonge par une opération particulière sur la vérité. La vérité, comme nous avons pu le constater au cours des trois dernières années, n’est en réalité pas cachée et reste en effet facilement accessible à quiconque veut la connaître ; mais si auparavant - et pas seulement au théâtre - la vérité était obtenue en montrant et en démasquant le mensonge ( veritas patefacit se ipsam et falsum ), désormais le mensonge est produit, pour ainsi dire, en exposant et en démasquant la vérité (d'où l’importance décisive du débat sur les fake news). Si le faux était autrefois un moment dans le mouvement du vrai, désormais la vérité ne vaut que comme un moment dans le mouvement du faux.
Dans cette situation, l'acteur est pour ainsi dire chez lui, même si, par rapport au paradoxe de Diderot, il doit en quelque sorte se dédoubler. Aucun rideau ne sépare plus la scène de la réalité, qui - selon un expédient que les metteurs en scène modernes nous ont rendu familier, en obligeant les spectateurs à participer à la pièce - devient le théâtre lui-même. Si l’acteur Zelensky est si convaincant en tant que leader politique, c’est précisément parce qu’il parvient à proférer toujours et partout des mensonges sans jamais cacher la vérité, comme si cela n’était qu’une partie incontournable de son acte. Lui - comme la majorité des dirigeants des pays de l'OTAN - ne nie pas que les Russes aient conquis et annexé 20 % du territoire ukrainien (qui a d'ailleurs été abandonné par plus de douze millions de ses habitants) ni que sa contre-offensive échoua complètement ; ni que, dans une situation où la survie de son pays dépend entièrement de financements étrangers qui peuvent cesser à tout moment, ni lui ni l'Ukraine n'ont de réelles chances devant eux. C’est pourquoi, en tant qu’acteur, Zelensky est issu de la comédie. Contrairement au héros tragique, qui doit succomber à la réalité de faits qu'il ne connaissait pas ou qu'il croyait irréels, le personnage comique nous fait rire car il ne cesse d'exhiber l'irréalité et l'absurdité de ses propres actions. Cependant, l'Ukraine, autrefois appelée Petite Russie, n'est pas une scène comique et la comédie de Zelensky ne se transformera finalement qu'en une tragédie amère et bien réelle.
Giorgio Agamben, 19 janvier 2024
Traduction LAQ. L’article d’origine est paru chez l’éditeur Quodlibet.
05.02.2024 à 20:58
Mario Tronti. Ce que le communisme a de chrétien, et pourquoi nous gagnerions à y revenir
L'Autre Quotidien

Texte intégral (2819 mots)

RIP Mario Tronti, communiste italien et théoricien de l’opéraïsme. 1931 / 2023.
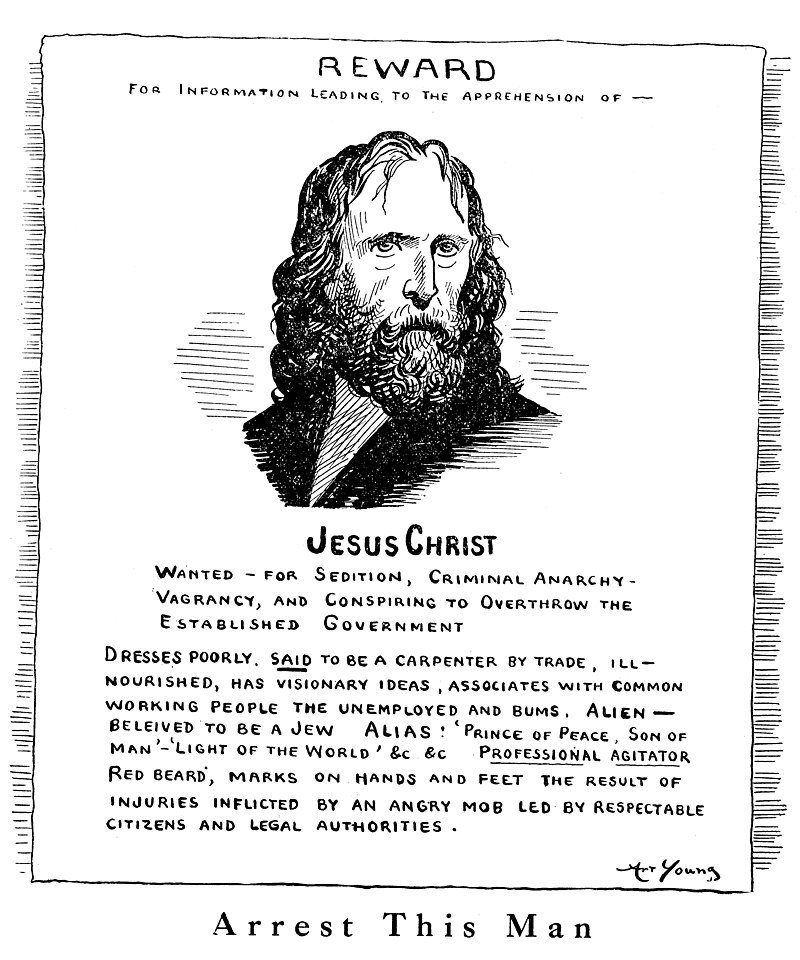
"Arrêtez cet homme", par Art Young. “Récompense. Pour toute information conduisant à l'arrestation de - Jésus-Christ. Recherché pour sédition, anarchie criminelle, vagabondage et conspiration en vue de renverser le gouvernement établi. Habillé pauvrement, on dit qu'il est charpentier de métier, mal nourri, qu'il a des idées visionnaires, qu'il fréquente des travailleurs ordinaires, des chômeurs et des clochards. Alien - on croit qu'il s'agit d'un juif. Alias : "Prince de la paix", "Fils de l'homme - Lumière du monde", &c &c. Agitateur professionnel - barbe lue, marques sur les mains et les pieds résultant de blessures infligées par une foule en colère menée par des citoyens respectables et des autorités légales.” 1921
Xeniteia. Contemplation et combat
Qu’elle est douteuse cette idée, désormais conforme au sens commun, selon laquelle nous serions en train de vivre des temps apocalyptiques ! L’impression dégagée par les différents discours qui se succèdent dans l’infosphère est celle d’une superficialité, d’un effondrement qui n’est que « spectacle » d’apocalypse, et non pas celle d’une assomption [1][assunzione] authentiquement prophétique. L’imaginaire de masse est davantage inspiré par les films et les séries TV hollywoodiennes que par le gros volume écrit par Jean dans son exil à Patmos.
“Que tout continue ainsi, voilà la véritable catastrophe.”
La nécessité — car il y a bien nécessité — d’introduire le discours inhabituel que nous proposons ici ne trouve pas sa source dans la pandémie du Covid, mais de plus loin et plus profond. Une voix prophétique du XXe siècle a dit, et nous partirons de là, que la véritable catastrophe est que les choses restent comme elles sont. Nous sommes aujourd’hui plus facilement et communément éblouis par un malaise civilisationnel qui investit toujours un peu plus nos existences et nos intimités, nous montrant le capitalisme comme il est devenu, s’il ne l’a pas toujours été, un « mode de destruction » plutôt qu’un mode de production. Disons alors que la pandémie globale a simplement révélé cet état du monde.
Pourtant, plutôt que d’assumer cette révélation de l’apocalypse comme contestation du monde ou, plus précisément, contestation de la « mondanité », comme il en a toujours été dans la tradition apocalyptique, le sens commun médiatique en fait paradoxalement une confirmation de cette même mondanité.
Nous sommes aujourd’hui tellement imprégnés de l’esprit mondain que les évidences deviennent invisibles et que les mensonges apparaissent comme des évidences. C’est aussi pour cette raison qu’adopter la posture de ces premiers moines de l’ère chrétienne, celle de la mise en retrait [2], [estraniamento] xeniteia en grec des pères de l’Église et peregrinatio en latin, par rapport à la société dominante et à sa propre identité sociale, nous semble aujourd’hui si nécessaire, si évident.
Se faire étranger, « dans le monde mais pas du monde »[3], pour essayer de subvertir le sens de la « distanciation sociale » qui, de mesure prophylactique, risque de rapidement muter en mesure d’intensification de l’atomisation, déjà extrême, des hommes et des femmes. Prendre au contraire comme un devoir ce « pathos de la distance » que Nietzsche plaçait dans les esprits libres, non seulement comme critique de l’atomisme, mais comme mode affirmatif par lequel chaque force vive se rapporte à une autre.
On sait ou devrait savoir que les relations entre histoire et théologie du communisme d’une part et christianisme des origines (le monachisme et la structure ecclésiastique) d’autre part sont structurantes des premières. Il est entendu qu’ici le communisme est compris comme mouvement de libération universel non réductible au seul marxisme.
Si Ernst Troeltsch parlait d’un « communisme d’amour » à propos des communautés chrétiennes apostoliques des premiers siècles, Walter Benjamin affirmait sans détour que la société sans classes, prédite par le communisme moderne, n’était qu’une sécularisation du règne messianique. En ce sens, nous devrions peut-être compléter la célèbre sentence schmittienne qui affirme que « tous les concepts de la doctrine de l’État sont des concepts théologiques sécularisés » avec la suivante : « tous les concepts de la doctrine révolutionnaire sont des concepts théologiques sécularisés ».
À bien y regarder, c’est comme si dans l’histoire du communisme les deux parties en présence (théorie de l’État et théorie de la révolution) s’étaient à un certain moment rencontrées, combattues et donc complétées, puis étaient enfin parvenues dans une impasse. Dans l’histoire de l’Église au contraire, institution et destitution apparaissent comme contenues dans un même cadre qui, au fil du temps, a oscillé alternativement d’un côté à l’autre sans jamais cependant qu’une des deux forces soit anéantie par l’autre et ne disparaisse. C’est un des « mystères »[4] qu’il nous plairait d’étudier. En fait, ni le christianisme ni le communisme ne sont réductibles à des doctrines et ne peuvent être intégralement identifiés à une institution : chaque fois que cela s’est produit, cela a toujours conduit à un désastre. Christianisme et communisme font avant tout partie d’une histoire, d’une tradition vivante qui dans les deux cas est à l’origine celle des opprimés, des exploités, des humiliés et des offensés.
Mais si à l’émergence dans la modernité d’un « christianisme sans religion », tel qu’habilement formulé par Dietrich Bonhoeffer, correspondra par suite un communisme sans dogmatique[5], il faut bien reconnaître que face à la vitalité bimillénaire, quoique vacillante, de l’Église, celle d’un État ou d’un parti ne dépasse guère quelques décennies.
L’évêque brésilien Helder Camara disait la chose suivante : quand je donne à manger aux pauvres, on me dit que je suis un saint, quand je demande pourquoi les pauvres n’ont pas à manger, on me dit que je suis un communiste. Face à ce discours, il est assez comique de voir les réactionnaires accuser certaines figures de l’Église, quand ces dernières prêchent ou agissent en faveur des pauvres et avec les pauvres, d’être des « communistes » alors que c’est d’évidence le communisme qui a un pied (mal assumé) dans la tradition judéo-chrétienne. Cet étiquetage [anotazione di costume] vaut aussi pour ce qui concerne le champ du communisme, quand ceux qui posent comme décisives des questions théologiques à partir de l’eschatologie sont traitées à leur tour comme des « hérétiques », des incompris, sont plaints ou encore tournés en dérision.
Ivan Illich a soutenu qu’à rebours de la croyance commune, l’époque contemporaine est la plus pleinement chrétienne qui ait jamais existé. Cela à la fois malgré et à cause de la supposée sécularisation, du fait que le christianisme est devenu une minorité dans le monde, et même du fait de sa perversion en tant que religion. Alors, au-delà de la supposée mort des idéologies et de l’échec historique des réalisations, peut-être pourrait-on et devrait-on dire que l’époque actuelle est une époque de plénitude pour le communisme lui aussi, si jamais l’on arrivait à voir au-delà de la brume médiatique.
L’histoire du monachisme nous intéresse tout particulièrement depuis sa forme la plus ancienne, celle des Pères du désert, jusqu’aux expériences aux marges et à l’extérieur de l’institution. Il suffit de penser au béguinage [6] et à la célèbre hérésie du Libre-Esprit pour arriver à aujourd’hui, aux si nombreuses expériences contemporaines de communautés invisibles dans lesquelles se pratique la vie érémitique ou cénobitique [7]. Le pari que nous voulons donc faire, avec toute la modestie et la prudence de rigueur, est de nous mettre au diapason presque comme des disciples de ce monachisme qui à travers les siècles s’est fait étranger au monde tel qu’il existait, pas seulement pour le récuser mais pour le combattre. Nous ne visons donc ni suggestion de la fuga mundi, ni mécanismes de défense, mais plutôt l’ouverture d’un nouveau front, qui ne délaisse pas les autres mais s’y additionne, une fois mesurée et vérifiée la nécessité spécifique du temps présent.
De cette manière nous pensons lire, dans ses diverses pratiques y compris interreligieuses, la possibilité de penser ce que signifie ou pourrait signifier pour nous aujourd’hui de concilier une dimension contemplative avec une dimension combative. Car la vocation, l’appel monacal ne consiste pas seulement à écouter et soigner sa propre intériorité, mais répond au cri de la réalité et lui obéit. Regarder uniquement à l’intérieur de soi ouvre inévitablement la porte au démon de la tristesse, tandis que le mot même de «contemplation» évoque un regard libre vers le ciel de l’action.
Le monachisme s’est ensuite fixé et a cherché à résoudre, de différentes manières qui sont toutes à examiner, les grandes questions du vivre-ensemble, d’habiter le soi et le monde, et du témoignage du « règne messianique ». Un règne nous a été annoncé qui est déjà entre nous, si nous le désirons. Ces questions ont toujours traversé les mouvements révolutionnaires et, au cours des années passées, nous ont beaucoup occupés sans que nous ne parvenions à une théorie et une pratique convaincantes. Cette question se propose à nouveau d’autant plus aujourd’hui, dans un temps de suspension radicale de la vie sociale qui nous interroge durablement non seulement sur les modes de production mais aussi sur les modes de vie.
Vie mondaine et règne, solitude et communauté, institution et destitution, force et grâce, esprit et loi, contemplation et combat, chacun de ces couples de mots nous ramène au mystère du monde, de l’histoire et de ce que nous appellerons la dimension de l’au-delà [oltre].
Un grand philosophe du dix-neuvième relativement tombé dans l’oubli, Brice Parain, qui était surtout un singulier communiste et un singulier chrétien, écrivait dans les années 1940 qu’avec les soviets en Russie était né le premier ordre monastique de l’âge contemporain et que c’est au communisme qu’appartenait la dimension contemplative du « silence », un silence militant dans l’attente de la Parole. En conséquent, réussir à comprendre ce que voulait dire Parain avec cette « bizarre » théorie et lui donner corps à notre tour pourrait constituer un thème de plus à affronter dans cet espace de réflexion et d’enquête qui, pour le moment, en explorateurs prudents, nous aborderons via une rubrique qui sera consultable simultanément sur deux sites : quieora.ink et dellospiritolibero.it.
Mario Tronti & Marcello Tarì
Traduction de Giulia Chamois & Virgile dall’Armellina pour https://entetement.com/
Lire aussi, dans L’Autre Quotidien, cet article : Hommage à Mario Tronti : le Royaume est là, si nous le voulons
Notes
[1] Le terme italien d’assunzione, littéralement “assomption” permet de jouer sur la forme nominale du verbe “assumere” (“assumer”) qui possède une signification théologique mais aussi plus usuellement celle de “prendre comme”.
[2] Le terme estraniamento contient l’idée de se rendre étranger, de prendre du recul, de se “désimpliquer”.
[3] Cette formule fait référence à Jean 15,18-21 :
« Si vous apparteniez au monde,
le monde aimerait ce qui est à lui.
Mais vous n’appartenez pas au monde,
puisque je vous ai choisis en vous prenant dans le monde »
[4] Il s’agit d’une allusion à la notion chrétienne de mystère, qui désigne ce que l’on a jamais fini de comprendre et qui n’est accessible qu’à travers la foi.
[5] Précisons que le mot “dogmatique” est ici utilisé comme nom, et non comme adjectif.
[6] Communautés religieuses laïques.
[7] Vie religieuse en communauté, par opposition à la vie érémitique.
01.02.2024 à 13:07
Comment dépasser victimisme, narcissisme et moralisme pour sortir de nos bulles sociales ?
L'Autre Quotidien

Texte intégral (4133 mots)

Des réseaux sociaux à la littérature, l'écriture "engagée" adopte un langage de plus en plus individualisant visant avant tout à rassurer ses lecteurs (c’est à dire sa propre "bulle sociale"). Au lieu de cela, nous avons besoin d'un vocabulaire capable de nous faire passer du “je” à un “nous”.
À l'heure de la fin des grands récits, le vocabulaire consolidé sur lequel le mouvement syndical s'est appuyé pendant des décennies s'est aminci, perdant sa crédibilité. Il s'agit d'un phénomène d'époque durable, qui a commencé au moins dans les années 1980, résultat de la défaite des mouvements et de l'alternative politique au capitalisme : l'ère néolibérale a lentement exproprié les langues des expropriés, dans un processus qui a connu une profonde accélération au cours des quinze dernières années. De nombreuses explosions sociales récentes - des Gilets jaunes aux mobilisations diverses et variées de style populiste - ont montré des caractéristiques "fallacieuses", souvent auto-décrites comme "ni de droite ni de gauche", devenant difficiles à identifier sans ambiguïté précisément parce qu'elles ne disposent pas du langage et de la mémoire historique des mouvements et des traditions politiques.
En présence d'un retour de l'activisme, même s'il se joue principalement sur les réseaux sociaux, cette discontinuité discursive pourrait également être l'occasion de se défaire de certains schémas préconstitués, mais aucun nouveau vocabulaire efficace ne semble émerger pour le moment.
L'hyper-politique des influenceurs
Anton Jäger, dans Jacobin, a décrit le courant comme une phase de transition "de la post-politique à l'hyper-politique". En d'autres termes, les organisations sociales et politiques continuent de s'enliser dans la crise profonde qui a débuté il y a plus de trente ans, mais nous assistons à des explosions sociales de masse soudaines, bien qu'éphémères - pensez aux manifestations de Black Lives Matter après le meurtre de George Floyd - et à un déluge de contenus politiques canalisés individuellement par divers réseaux sociaux.
Ces modes d'engagement et de militantisme sont plus compatibles avec l'atomisation générale de la société contemporaine et les conditions de vie précaires de ceux qui sont obligés d'errer d'un emploi temporaire à un autre. Un activisme qui interrompt la dépolitisation de la société mais qui ne se traduit pas par des formes capables de construire la dimension collective et durable de la bataille politique. Même les mouvements les plus clairement positionnés à gauche, comme celui contre la crise climatique ou la nouvelle vague féministe, entre une grande manifestation et la suivante produisent peu d'expériences d'enracinement social, peu de lieux collectifs de discussion et par conséquent peu de vocabulaire commun.
Les militants, mais aussi les "intellectuels engagés" eux-mêmes, deviennent ainsi, malgré eux, davantage des influenceurs que des "intellectuels organiques" comme on en voyait au XXe siècle, avec une tendance à s'adapter au langage récompensé par les algorithmes par la visibilité et les likes : celui qui jette de force les émotions, les sentiments, l'indignation morale, la culpabilité individuelle et la victimisation. Un langage qui s'avère efficace pour mobiliser sa "bulle sociale", beaucoup moins pour convaincre ceux qui ne le sont pas encore. Et surtout facilement absorbée par la culture individualiste de notre époque.
"L'hyperpolitique", écrit Anton Jäger, "est ce qui se passe lorsque la postpolitique prend fin, quelque chose qui ressemble à l'acte d'appuyer furieusement sur l'accélérateur alors que le réservoir est vide".

Romain Laurent
Le style littéraire du néo-engagement
Ce type de transformation du "langage engagé" non seulement fait fureur sur les réseaux sociaux, mais atteint jusqu’au monde littéraire.
Dans Contre l'engagement (Rizzoli, 2021), Walter Siti analyse de manière critique ce qu'il définit comme un "néo-engagement" dans la littérature, fournissant des pistes pour une réflexion plus complète sur le langage de l'activisme contemporain. Comme principaux exemples de cette tendance, Siti cite trois écrivains italiens à succès, protagonistes du débat politico-culturel des 10-15 dernières années, avec des positions différentes, parfois partagées : Roberto Saviano, Michela Murgia et Gianrico Carofiglio. Pour Siti, ils partagent tous un style d'exposé moraliste qui, plutôt que de concevoir une nouvelle société en "abolissant l'état actuel des choses", veut se confirmer du bon côté en rassurant ses lecteurs (ou sa propre "bulle sociale").
Saviano s'est explicitement éloigné de ce qu'il considère comme de la "littérature pure", renonçant à la profondeur de l'écriture littéraire au profit de l'efficacité immédiate du langage du témoignage, de la dénonciation, de la "dénonciation des noms". Mais " l'objectif majeur de la littérature, rétorque Siti, n'est pas le témoignage mais l'aventure cognitive ". Et ce n'est pas un problème de "pureté", mais presque le contraire, d'ambiguïté : seule la littérature, parmi les différents usages du mot, peut affirmer une chose et la nier en même temps ; parce que notre psyché est ambiguë, notre corps est ambigu - les ambiguïtés supprimées peuvent conduire à des résultats contre-productifs, à une fausse euphorie".
Un exemple de langage visant uniquement les personnes déjà convaincues est celui du livre de Michela Murgia, “Istruzioni per diventare fascisti” (Einaudi, 2018), dont l'intention explicite est de faire ressortir " combien de fascisme il y a chez ceux qui se croient antifascistes " : "On a l'impression, écrit Siti, que ce qu'on appelle en narratologie la "fonction de destinataire" du livre est quelqu'un qui est déjà d'accord avec l'auteur". Le fascisme lui-même finit donc par être analysé non pas comme un projet politico-économique, ni même comme un phénomène historique, mais comme une sorte de maladie linguistique latente qui peut se manifester à tout moment dans les discours que nous nous habituons à écouter puis à faire.
Gianrico Carofiglio est un autre auteur qui assigne à la littérature la tâche de "dire la vérité" et aux histoires celle de "cultiver l'empathie". Une attitude qui réduit le néo-engagement à une sorte de bon populisme à opposer au mauvais populisme, plein de messages exhortatifs et pédagogiques.
Au contraire, Siti est convaincue que "la littérature peut nous pousser à cultiver la haine, des autres et de nous-mêmes, et nous faire douter de toute vérité". Pour le démontrer, il cite “Chav”, le livre de D. Hunter (Alegre, 2020). Le deuxième livre de D. Hunter, “Suits, Trauma and Class Traitors” (Alegre, 2022), est encore plus axé sur l'importance de comprendre et d'agir dans l'ambiguïté. Il a été écrit en réponse à ceux qui avaient interprété son livre comme "l'histoire du "mauvais garçon qui devient un homme bon". Hunter se consacre précisément à déconstruire la vision des personnages de son récit autobiographique de manière binaire : bons ou mauvais, victimes ou violents. Et il se concentre sur les contradictions et les trahisons de classe, imputables non seulement aux choix individuels mais aussi au contexte structurel dans lequel ces choix s'inscrivent. L'exact opposé de l'éthique sous-jacente au néo-engagement qui, selon Siti : “peut se résumer en postulats discutables mais jamais discutés : l'amour et la brutalité sont exclus, le combat se suffit à lui-même, ce que l'on peut rêver pouvoir faire, ne jamais baisser les bras, la haine vient de l'ignorance, la violence est toujours condamnable, la beauté c'est vrai, les enfants sont innocents.”
Les militants et les écrivains de ce que Siti définit comme le néo-engagement semblent convaincus que l'utilisation des mots peut créer de la beauté et que "la beauté sauvera le monde". Tout semble être entre les mains des volontés individuelles, de la force des mots qui sont utilisés, perdant de vue la relation dialectique de la mémoire marxienne entre les conditions matérielles et la génération des idées et donc des mots eux-mêmes. Finissant ainsi par être capturés par le charme libéral selon lequel, après tout, "nous sommes le système". Mais, demande Siti, "ce ne sont pas les rapports de force et les besoins de l'économie, plutôt que la volonté de la population, qui décident du rythme de l'histoire ?".
Cette approche subjectiviste de la réalité est aussi devenue un style historiographique réussi, à tel point que dans son La tirannide dell'io (Laterza, 2022), l'historien Enzo Traverso s'interroge : « l'ère du selfie exerce son influence sur la manière d’écrire l'histoire ? ». En fait, les historiens eux-mêmes analysent de plus en plus les événements passés en mettant en lumière les émotions qu'ils suscitent en eux et leurs propres biographies. Une démarche qui, si elle a le mérite d'échapper aux pièges de l'objectivité positiviste, semble selon Traverso produire "non pas une historiographie 'néolibérale', mais certainement une historiographie de l'ère néolibérale".
Une autre pratique typique du néo-engagement est celle du debunking , c'est-à-dire la réfutation - analytique dans l'argumentation et polémique dans le ton - d'une fausse nouvelle ou d'un fantasme complotiste. C'est une pratique qui avec les réseaux sociaux a vu le nombre d'activistes augmenter de manière spectaculaire, une pratique souvent nécessaire mais qui, si elle est menée en niant les "noyaux de vérité", les ambiguïtés et les contradictions peuvent s'avérer contre-productives. Comme l'écrit Wu Ming 1 dans La Q de Qomplotto (Alegre, 2021)
“Les fantasmes complotistes déjà « démystifiés » ont continué à circuler, et entre-temps de nouveaux sont nés, qui se sont propagés de plus en plus rapidement. Et les charlatans démasqués par les démystificateurs ont continué à opérer, parfois avec plus de partisans qu'auparavant. A un moment on s'est demandé : à qui et à quoi sert le debunking ? Qui en profite ? C'est pour qui? Des études avaient conclu que, par essence, les démystificateurs étaient bons pour convaincre ceux qui pensaient déjà comme eux. Non seulement cela : la démystification risquait d'avoir l'effet inverse de celui souhaité, renforçant les croyances qu'elle visait.”
Victimisme, narcissisme et moralisme

Kristina Makeeva (voir notre article)
Selon Siti, l'écriture engagée, au lieu de construire une hégémonie culturelle dans la société, est ainsi devenue "une spécialisation de marchandises". De la même manière, l'activisme sur les réseaux sociaux s'adapte aux règles des gestionnaires des médias sociaux afin de vendre un produit. Là où chacun modèle le personnage de lui-même sur ses followers, tout est dominé par la recherche du plus grand nombre de likes possible dans le court temps de visibilité accordé par l'algorithme. Et en l'absence d'un langage politique reconnaissable, le langage des victimes vient à la rescousse pour assurer le plus grand succès dans les plus brefs délais. Comme l'affirme Daniele Giglioli dans sa “Critique de la victime” (Nottetempo, 2014), à une époque où toutes les identités sont en crise, une véritable idéologie victimaire remplace les grandes visions du monde :
“La victime est le héros de notre temps. Être une victime donne du prestige, impose l'écoute, promet et favorise la reconnaissance, active un puissant générateur d'identité, de droit, d'estime de soi. Il immunise contre la critique, il garantit l'innocence au-delà du doute raisonnable.”
Ce n'est pas un hasard si plusieurs figures importantes de l'engagement politique et intellectuel de ces dernières années se sont construites sur leur statut de victimes - réelles, potentielles ou même simplement "héritées".
"La centralité actuelle de la victime dans le discours public, écrit Siti, est un contrepoids au délire d'estime de soi qui fait rage sur les réseaux sociaux" ; en effet, narcissisme et victimisme se complètent, se coulant facilement dans le discours moralisateur qui individualise le débat politique de notre époque.
Jamais auparavant, comme lors du premier lockdown, nous n'avons assisté à de dures disputes morales sur les comportements individuels qui auraient pu faciliter la contagion, renforçant ainsi le discours de diversion qui présentait l'individu comme responsable de la guérison collective et occultait la nécessité de lutter contre les choix politiques qui ont produit et amplifié les effets de la pandémie elle-même : le financement et la privatisation des services de santé, l'insuffisance des transports publics, la surcharge des classes dans les écoles, la dévastation environnementale qui produit de nouveaux virus.
Ce mécanisme d'individualisation menace de pervertir la grande intuition du mouvement féministe selon laquelle "le personnel est politique" : la pratique collective qui a permis aux femmes de sortir du simple statut de victimes pour devenir une force politique, risque souvent aujourd'hui d'être renversée en une idée individualiste selon laquelle "le politique est le personnel", qui glisse vers une victimisation narcissique et la narration du soi comme juge moral. Avec un discours qui met davantage l'accent sur l'appel à la remise en question des comportements et des privilèges personnels que sur la recherche de pratiques d'alliance et de solidarité concrète entre exploités et exploités.
Il suffit de voir la facilité avec laquelle ils renversent la réalité de l'oppression en se dénonçant comme victimes d'une dictature fantôme de la "cancel culture" ou du "politiquement correct", afin de revendiquer exactement le droit de continuer à discriminer et à opprimer. Mais ce renversement du paradigme de la victime ne devrait pas être une surprise. En regardant de plus près, écrit Giglioli, “la prosopopée de la victime renforce le puissant et affaiblit le subordonné. [...] Il supprime et même rejette le conflit, il s'indigne de la contradiction. [La condition de la victime exige une réponse unanime ; mais une réponse unanime n'est qu'une fausse réponse, qui ne permet pas de voir quelles sont les véritables lignes de fracture, d'injustice et d'inégalité qui segmentent le terrain des relations de pouvoir.”
Tracer les lignes de fracture
Comme l'explique Francesca Coin, les exploités et les exploiteurs se heurtent de plus en plus à des " échecs intersectionnels " : "la conscience de classe est séduite par les logiques du nationalisme, l'antiracisme ne remet pas en cause les logiques du patriarcat ou le féminisme ne remet pas en cause l'exploitation de classe". Afin de reconnaître que différentes oppressions se croisent et se renforcent mutuellement, il faut alors chercher à nommer efficacement les plus petits dénominateurs communs capables de briser les alternatives infernales qui produisent "la classe contre soi". C'est pourquoi le moralisme de l'auto-récit des victimes est contre-productif car en se concentrant uniquement sur l'expérience individuelle, il renforce la ruse de la classe dominante qui consiste à faire croire qu'elle n'existe pas et que les divisions de la société sont celles entre les méritants et les non-méritants, la science et l'ignorance, le bien et le mal.
Pour reconstruire un vocabulaire commun alternatif à l'état actuel des choses, les bonnes mœurs ne suffisent pas. Ce qu'il faut, c'est la recherche de langages capables de retracer les lignes de fracture de classe et de reconstruire la dimension collective du changement.
Une expérience exemplaire non seulement d'auto-organisation sociale mais aussi de production linguistique capable de créer un imaginaire alternatif est celle du collectif de l'usine Gkn. Comme on peut le lire dans le volume “Insorgiamo” (Alegre, 2022), montage narratif des posts, communiqués et rassemblements du Collectif, le récit initial de la victime, qui jetait de l'empathie sur les " pauvres travailleurs " licenciés par e-mail, a été immédiatement rejeté parce qu'il empêchait de nommer l'ennemi commun :
“Si nous disons à quel point ils sont mauvais, nous avons déjà perdu. On ne conteste pas la nature d'un vautour. C'est un vautour, on en prend acte et on passe à autre chose [...] ceux qui ne s'attachent qu'à la manière dont nous avons été licenciés, s'attachent à la forme et non au fond [...] ce courriel est constitué de toutes les lois qui ont massacré le monde du travail ces vingt dernières années.”
La tendance consolatrice à se complaire dans le rôle de victime a ainsi été renversée en une véritable provocation à s'organiser collectivement pour améliorer les conditions de vie de chacun d'entre nous :
“Quand vous venez ici, vous nous demandez toujours comment nous allons. Tout le monde, du journaliste au militant du mouvement. Mais comment voulez-vous que nous soyons ? [...] Nous sommes comme ça et comment allez-vous ? Vous tous, comment allez-vous ? Parce que la chose est paradoxale. Parfois, ceux qui viennent nous voir et nous demandent comment nous allons sont plus mal lotis que nous.”
L'objectif est d'aller au-delà de l'auto-récit testimonial, qui tend à produire une individualisation des problèmes et une simple indignation morale, pour essayer de communiquer au-delà de sa propre "bulle" et d'affecter les relations de pouvoir globales :
“Nos histoires ne sont pas différentes de celles du million de personnes qui ont perdu leur emploi pendant la pandémie... vous n'avez pas à raconter nos histoires simplement parce que nous faisons du bruit, car cela produira une division entre nous et les autres travailleurs qui sont plutôt rentrés chez eux entourés de silence. Racontez nos histoires. Mais nous ne sommes pas ici pour raconter nos histoires mais pour écrire l'histoire.”
Pour retracer les véritables lignes de fracture, nous devons échapper au langage moralisateur et individualisant de l'époque néolibérale, expérimenter de nouvelles façons de nommer les ennemis communs, de nouveaux discours pour décrire les intersections structurelles de l'exploitation et de l'oppression, de nouveaux mots collectifs qui peuvent réenchanter le monde.
“Il n'a jamais été question de nous, mais il est question de nous tous", répète le collectif Gkn Factory. Et l'outil dont nous avons besoin est un langage avec lequel "là où était le je, nous faisons le nous".
Giulio Calella
* Giulio Calella, co-fondateur et président de la coopérative Edizioni Alegre, fait partie de la rédaction de Jacobin Italia .
Lire l’article en version originale.
17.12.2023 à 14:51
Hamas, Israël et la haine réciproque : la contagion psychique peut-elle être stoppée ? – par Franco Berardi Bifo
L'Autre Quotidien

Texte intégral (2657 mots)

“Les excès commis au nom du devoir de mémoire laisseraient penser à adopter un devoir d’oubli : la formule peut déplaire à certains, mais elle s’impose. Pensez au héros malheureux de Borges qui ne pouvait pas oublier et vivait donc dans un enfer incapable d’effacer quoi que ce soit du chaos qui envahissait sa pauvre tête. Il en va de même pour un groupe humain : à ne rien vouloir oublier, on s’expose au danger de confondre le présent vivant avec un faux présent hallucinatoire qui parasite le premier au nom des offenses non réparées du passé.”
J'ai vu le documentaire Né à Gaza de Hernan Zin (vous pouvez le retrouver sur Netflix) : il raconte l'histoire de dix enfants parmi les six et quatorze années, pendant la guerre de 2014, l’une des nombreuses guerres qu’Israël a menées contre les Palestiniens, et que les Palestiniens ont menées contre Israël. Ces enfants parlent des bombardements, des blessures qu'ils ont reçues, de la terreur qu'ils vivent au quotidien, de la faim dont ils souffrent. Ils disent que la vie ne leur appartient pas, que mourir serait mieux.
Il est probable que ces personnes, qui étaient enfants en 2014, soient désormais des militants du Hamas, et qu'ils aient participé à l'orgie terroriste du 7 octobre.
Comment peux-tu ne pas le comprendre ? Si j'étais à leur place, au lieu d'être moi, un vieil intellectuel qui meurt confortablement dans sa maison dans une ville italienne où pour le moment il n'y a pas de bombardements, si j'étais un de ceux qui ont été enfants sous les bombes de 2014, aujourd'hui, je serais un terroriste qui veut juste tuer un Israélien. Serais-je horrifié ?
Bien sûr, mais mon pacifisme serein n'est qu'un privilège dont je jouis parce que je n'ai pas vécu mon enfance à Gaza, ni dans de nombreux autres endroits comme Gaza.
Israël n’a donc qu’un seul moyen d’éradiquer le Hamas : tuer tous les Palestiniens vivant à Gaza, dans les territoires occupés et ailleurs aussi : tout le monde, tout le monde, tout le monde, en particulier les enfants.
Après tout, c'est ce qu'ils font, n'est-ce pas ? Cela s’appelle un génocide, mais c’est tout à fait rationnel, non?
En fait, les gouvernements européens très rationnels soutiennent le génocide, Macron a déclaré qu’il aimerait participer au génocide avec une coalition.
Scholz a déclaré que depuis que l'Allemagne a commis un génocide dans le passé, elle a désormais le devoir de soutenir ceux qui commettent le génocide aujourd'hui. C'est le seul moyen d'éradiquer le terrorisme, n'est-ce pas ?
Peut-être y aurait-il une autre manière de l’éradiquer : la paix inconditionnelle, le renoncement à la victoire, l’amitié, la désertion, l’alliance entre les victimes : les victimes d’Hitler, les victimes d’Hérode-Netanyahou. Mais les victimes, semble-t-il, n’aspirent qu’à devenir des bourreaux, et elles y parviennent souvent. La spirale ne s’arrêtera donc pas et nous ne savons pas quel vortex elle est destinée à alimenter.
Il y a quelque chose de monstrueux dans l’esprit des Palestiniens qui vivent dans la terreur. Et il y a quelque chose de tout aussi monstrueux dans l’esprit des Israéliens. Mais comment juger le comportement des peuples, comment juger les explosions de violence qui se multiplient dans la vie collective ? Pouvons-nous juger le comportement des militants du Hamas ou celui des Israéliens en termes éthiques ou en termes politiques ?
La raison éthique est hors jeu, car l’éthique est totalement effacée du panorama collectif de notre époque et de la conscience de la grande majorité.
L'éthique est l'évaluation de l'action du point de vue du bien de l'autre comme continuation de soi. Mais dans les conditions de guerre généralisée dans lesquelles évolue l’humanité qui a survécu à l’humain, l’autre n’est que l’ennemi : c’est l’effet de l’infection libérale-compétitive, et de l’infection nationaliste : la défense du territoire physique et imaginaire devient dans la guerre.
L'éthique est morte et la piété est morte. Il n'y a pas d'éthique dans le comportement des jeunes qui ont grandi dans la prison de Gaza, car leur esprit ne peut considérer l'autre (le soldat israélien qui vous attend l'arme dégainée à chaque carrefour) que comme un geôlier, un bourreau, un ennemi mortel. Chaque fragment (peuple, ethnie, mafia, organisation, parti, famille, individu) lutte désespérément pour sa propre survie, comme des loups luttant contre des loups. Le jeu vidéo nous demande de rivaliser dans les conditions d’une guerre ultra-rapide et omniprésente.
Comme la raison éthique, la raison politique n’a plus de pertinence dans une situation où la décision stratégique est remplacée par des micro-décisions de survie immédiate. Israël réagit à la violence brutale du Hamas d'une manière qui peut être ou non militairement efficace. Mais ce n’est certainement pas politiquement efficace.
Le groupe dirigeant d'Israël est un groupe de mafieux corrompus qui se donnent en spectacle depuis des années avec leur cynisme et leur opportunisme. Ils se trouvent désormais confrontés à une situation qu’ils n’avaient même pas imaginée et qui dépasse leurs facultés de compréhension politique. Le peuple d’Israël tout entier a perdu la tête. Tout dans le comportement des Israéliens prouve qu’une crise psychotique est en cours, cela fera beaucoup de mal aux Palestiniens, mais cela fera aussi beaucoup de mal aux Israéliens.
“Un juif n’a-t-il pas des yeux ? N’a-t-il pas des mains, des organes, des membres, des sens, des affections et des passions ?
Ne mange-t-il pas la même nourriture qu’un chrétien ?
N’est-il pas blessé par les mêmes armes ?
N’est-il pas sujet à ses propres maladies ?
N’est-il pas guéri et guéri par les mêmes remèdes ?
Et n’est-il pas finalement réchauffé et refroidi par le même hiver et le même été qu’un chrétien ?
Si vous nous piquez, nous ne verserons pas de sang, peut-être ?
Et si vous nous chatouillez, on ne se met pas à rire ?
Si vous nous empoisonnez, ne mourrons-nous pas ?”
D'un point de vue éthique, Israël a oublié depuis longtemps, voire depuis le début de son existence, que l'autre a la même humanité que vous, a la même sensibilité que vous, et a naturellement les mêmes droits que vous. Mais d’un point de vue politique également, les Israéliens prennent des mesures qui se retourneront horriblement contre eux.
J'ai lu les déclarations des hommes politiques et des soldats qui gouvernent Israël : ils parlent d'animaux humains à exterminer, ils parlent de couper l'électricité, le carburant, la nourriture et l'eau aux habitants de Gaza (deux millions et demi). Ils en parlent et le font.
Comment le peuvent-ils ? Il n’y a aucune explication éthique ou politique. La seule explication du comportement des deux est la psychopathie, la souffrance psychique, le désir de sang, l’horreur, la mort.
Il est donc nécessaire d'expliquer cette guerre en termes de psychopathogénèse, comme l'effet de l'incapacité des victimes à guérir leur douleur. Depuis un certain temps, je suis convaincu que la seule méthode cognitive capable de comprendre la chaîne de violence qui se déroule au Moyen-Orient, et dans une grande partie du monde, est celle de la psychanalyse, de la psychopatho-généalogie.
Ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient n'est que le dernier maillon d'une chaîne qui commence avec la Première Guerre mondiale, la défaite des Allemands et le châtiment infligé au peuple allemand par les Français et les Anglais, au Congrès de Versailles. en 1919. L’oppression et l’humiliation poussent le peuple allemand à se venger : ce désir de vengeance s’incarne en Adolf Hitler. Les Juifs furent la victime choisie, accusés sans aucune raison d’avoir provoqué la défaite de 1918.
La persécution et l'extermination des Juifs au cours des années de la Seconde Guerre mondiale ont provoqué des souffrances immenses et durables qui ont trouvé leur soulagement dans la création d'un État criminel qui, dans son premier acte, a déclenché une vengeance contre un peuple qui n'avait rien à voir avec l'Holocauste, mais qui était assez faible pour devenir la victime de la victime.
L’humiliation subie de la main des nazis nécessitait une compensation psychique, et cette compensation est la persécution et l’extermination du peuple palestinien. Je crois qu’Israël ne sortira pas de cette épreuve : le peuple d’Israël était déjà irrémédiablement divisé, Netanyahu devra rendre compte de la division provoquée et du manque de préparation qui a suivi. Mais cela ne suffira pas, car la droite ouvertement raciste d'Israël (Liberman, Ben Gvir, etc.) est vouée à se renforcer dans ce tsunami de haine.
Peut-on penser que même en cas de victoire militaire israélienne après des dizaines de milliers de morts palestiniens et israéliens, la dialectique politique pourra se poursuivre dans l’État d’Israël ? Je crois qu'Israël se dirige vers la désintégration. Combien d’Israéliens voudront rester dans ce désert, après ce qui se passe et après ce qui va se passer ? Seuls resteront, je crois, ceux qui possèdent des armes, ceux qui sont prêts à tuer et souhaitent tuer. Un vortex de haine se déchaîne désormais contre le Hamas, mais aussi un sentiment de culpabilité d'être devenu l'auteur d'un génocide certifié.
La politique ne sera pas capable de gouverner ou de comprendre ce vortex. Seul le regard clinique peut comprendre, mais je ne pense pas qu'il puisse guérir. Nous sommes confrontés à une psychose de masse au pouvoir de contagion très élevé. La première chose à faire est de ne pas subir la contagion, d'éviter de finir comme ce fou de Giuliano Ferrara qui crie des phrases ivres devant une foule de dérangés.
Mais nous avons aussi besoin de produire un vaccin culturel et psychique contre la contagion, et cette tâche que la psychanalyse n’a pas pu accomplir au siècle dernier est la tâche qui nous attend, s’il n’est pas trop tard.
Post Scriptum
Comment « traiter » une crise psychotique, surtout si elle est collective ? Je n'ai pas de réponse.
C'est la question que se posait Sándor Ferenczi en 1919. Il disait : « Nous, psychanalystes, pouvons peut-être guérir les névroses individuelles, mais pour les psychoses de masse, nous n'avons ni concepts ni remèdes. »
Je pense que nous en sommes toujours au même point.
Mais entre-temps, quelque chose d’inquiétant se produit. Regardez les images du stade de Glasgow hier. Cent mille personnes (je ne sais pas combien, beaucoup) brandissent des drapeaux palestiniens en criant continuellement... Cela me fait peur. Je n'aime pas les stades, je ne les ai jamais aimés. Je veux dire qu’une vague d’antisémitisme réel pourrait être déclenchée (pas le genre d’idiots israéliens qui crient au loup, puis le loup apparaît et plus personne n’y croit).
Regardez la session de l'ONU d'hier. Regardez les universités américaines. Écoutez le discours d'Erdogan, criant avec colère : « Le Hamas est un groupe de libération ». Partout, le groupe sioniste occidental au pouvoir est minoritaire et, à vrai dire, il me semble que les Blancs sont entourés d'un flot croissant de personnes aiguisant leurs couteaux.
Malheureusement, il n’y a ni internationalisme, ni stratégie commune. Il y a une vague de haine qui semble avoir les couleurs de la vengeance. Israël est dans une situation de panique et de confusion, cela est évident.
Ils ont perdu, il me semble, ils peuvent tuer autant de personnes qu'ils veulent, mais ils ont perdu.
Mais qui gagne ?
Franco Berardi Bifo
Traduction L’Autre Quotidien. L’article original est paru dans la revue en ligne italienne Effimera, Critique et Subversion du présent.
Franco Berardi dit Bifo est un philosophe et militant politique italien issu de la mouvance opéraïste. Il rejoint le groupe Potere Operaio et s'implique dans le mouvement autonome italien dans les années 1970, notamment depuis la Faculté des Lettres et de Philosophie de l'Université de Bologne, où il enseignait l'esthétique.
- GÉNÉRALISTES
- Basta
- Blast
- Le Canard Enchaîné
- L'Autre Quotidien
- Alternatives Eco.
- La Croix
- Le Figaro
- France 24
- France-Culture
- FTVI
- HuffPost
- L'Humanité
- LCP / Public Senat
- Le Media
- Le Monde
- Libération
- Mediapart
- La Tribune
- EUROPE ‧ RUSSIE
- Courrier Europe Centrale
- Desk-Russie
- Euractiv
- Euronews
- Toute l'Europe
- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient
- Haaretz
- Info Asie
- Inkyfada
- Jeune Afrique
- Kurdistan au féminin
- L'Orient - Le Jour
- Orient XXI
- Rojava I.C
- INTERNATIONAL
- CADTM
- Courrier International
- Equaltimes
- Global Voices
- I.R.I.S
- The New-York Times
- OSINT ‧ INVESTIGATION
- OFF Investigation
- OpenFacto°
- Bellingcat
- Disclose
- Global.Inv.Journalism
- MÉDIAS D'OPINION
- AOC
- Au Poste
- Cause Commune
- CrimethInc.
- L'Insoumission
- Les Jours
- LVSL
- Médias Libres
- Politis
- Quartier Général
- Rapports de force
- Reflets
- Reseau Bastille
- Rézo
- StreetPress
- OBSERVATOIRES
- Armements
- Acrimed
- Catastrophes naturelles
- Conspis
- Culture
- Curation IA
- Extrême-droite
- Human Rights
- Inégalités
- Information
- Internet actu ✝
- Justice fiscale
- Liberté de création
- Multinationales
- Situationnisme
- Sondages
- Street-Médics
- Routes de la Soie