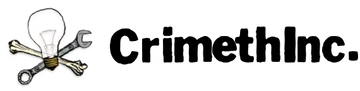
15.01.2026 à 18:50
Les réseaux d’intervention rapide dans la région de Minneapolis-Saint Paul : Comment s’organise l’auto-défense populaire contre l’ICE
CrimethInc. Ex-Workers Collective
Texte intégral (3976 mots)

Les réseaux d’intervention rapide, organisés par la population afin de protéger leurs communautés face aux agents fédéraux qui ont pour but de les enlever, de les brutaliser et de les terroriser, ont évolué très rapidement pour suivre l’évolution permanente des méthodes du Service de l’immigration et des douanes (ICE). Durant les six semaines d’occupation écoulées, les volontaires des Villes Jumelles (Minneapolis-Saint Paul) ont amélioré sans relâche leur méthode d’intervention, jusqu’à parvenir à une structure dynamique et robuste. Le présent rapport explore ce dispositif dans le but de soutenir d’autres groupes à travers le pays susceptibles d’être bientôt confrontés à des pressions comparables.
Le 2 décembre, une centaine d’agents de l’Immigration et des Douanes ont été envoyés dans les Villes Jumelles de Minneapolis et Saint Paul dans le cadre d’une opération d’arrestations et d’expulsions conduite dans plusieurs municipalités. Depuis, ces agglomérations ont été transformées en zones assiégées, irreconnaissables pour beaucoup de leurs habitants. La quantité d’agents fédéraux présents y a été multipliée par 30, atteignant près de 3 000. À titre de comparaison, le service de police de Minneapolis compte approximativement 600 policiers. La mort de Renee Nicole Good, membre d’un réseau d’intervention rapide, le 7 janvier, suivie, une semaine plus tard, le 14 janvier, par la fusillade d’une autre personne, a retenu toute l’attention nationale.
Pourtant, la majorité des personnes estiment que ce qui se déroule dans les Villes Jumelles s’inscrit dans la continuité des actions de l’ICE et des formes de résistance vues dans d’autres régions du pays. En réalité, l’étendue des arrestations, des détentions et des affrontements atteint un niveau sans précédent.
Pour découvrir la première version du modèle d’intervention rapide, développée à Los Angeles puis affinée à Chicago et ailleurs à l’automne, commencez ici. Pour apprendre à créer des groupes Signal réservés aux administrateurs, commencez ici.
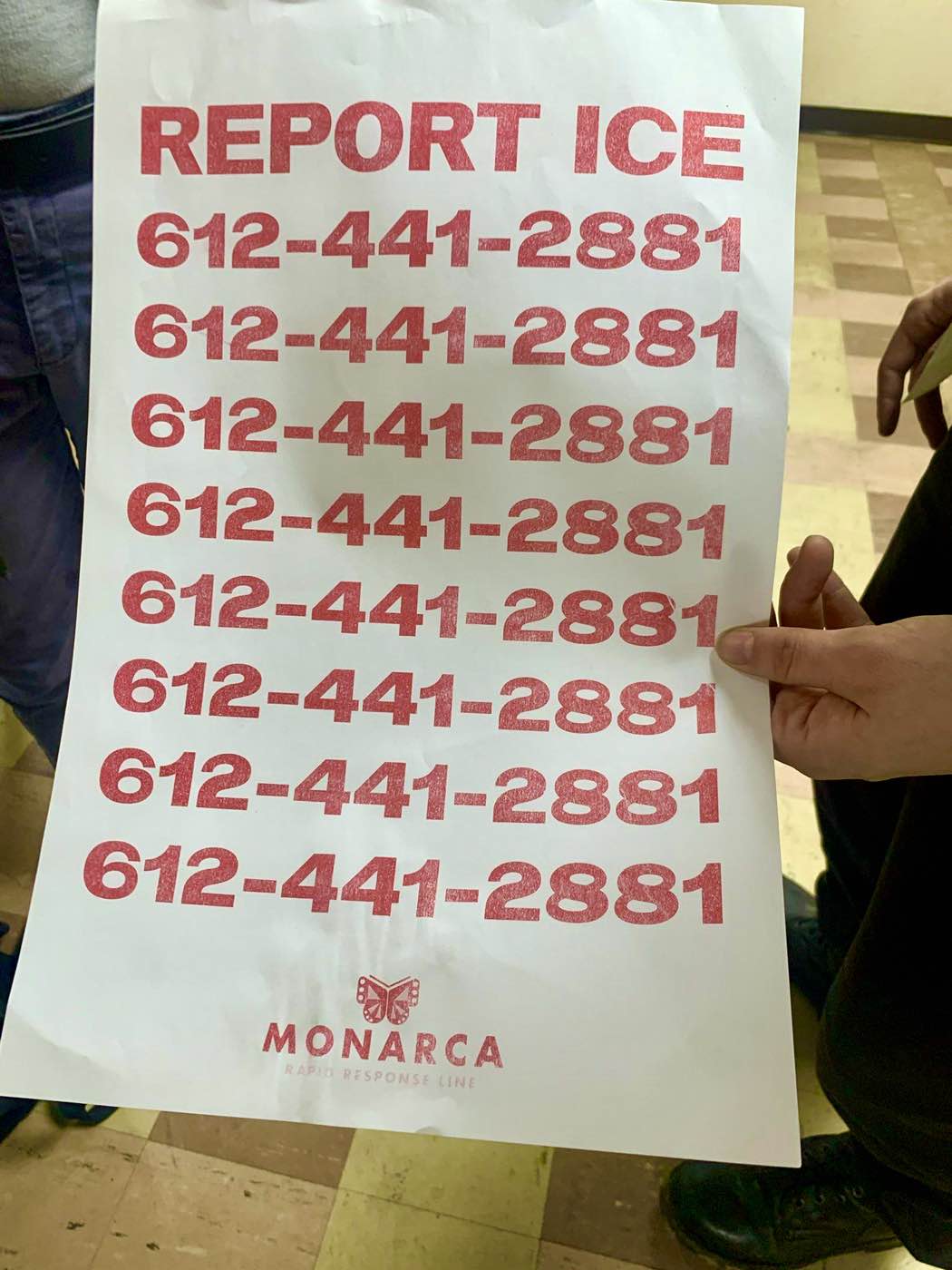
Le Déferlement
Pendant les mois qui ont précédé l’afflux important d’agents de l’ICE dans les Villes Jumelles, les habitants et les structures locales ont instauré un dispositif d’intervention rapide, assez centralisé. Les témoins pouvaient y transmettre leurs observations, avec différents niveaux de preuve, à un coordinateur via un système de messagerie instantanée. Une fois les signalements reçus, standardisés et contrôlés, les coordinateurs les relayaient massivement sur le système, ce qui entraînait le rassemblement des personnes situées à proximité. Ce système semblait efficace pour susciter une mobilisation lors d’opérations de grande ampleur, comme un raid dans un groupe d’appartements, mais il a commencé à montrer ses limites lorsque l’ICE a testé des interventions plus rapides et moins lourdes.
Puis, autour du 1er décembre, les descentes de police ont presque disparu et les agents, arrivés en masse, ont lancé une série de perquisition et d’arrestations musclées. L’ancien modèle s’est rapidement montré obsolète, le délai d’intervention se réduisant à quelques minutes. Les membres de la communauté, souhaitant une approche plus directe que le système actuel, caractérisé par des observateurs légaux et des procédures inefficaces, ont commencé à instaurer un système parallèle pour pallier leurs lacunes et gagner en réactivité.
Ce système a commencé avec un tchat à grande échelle pour les signalements concernant le Southside, où chacun pouvait diffuser n’importe quelle alerte. À mesure que les opérations de l’ICE s’intensifiaient et s’accéléraient, ce tchat, plus ouvert et réactif, a vu son nombre de membres augmenter et est devenu un espace attirant pour ceux qui souhaitaient aller de simplement consigner les opérations de l’ICE. Les participants ont commencé par utiliser le programme de signalement existant pour avertir les personnes visées de l’arrivée de l’ICE et harceler ses agents, puis ont peu à peu cherché à les mettre en échec : en bloquant les véhicules de l’ICE avec leurs propres voitures, en bloquant physiquement les agents, et en mobilisant des foules et des patrouilles pour intimider de petits groupes d’agents et les forcer à battre en retraite.
Au fur et à mesure que les tchats gagnaient en ampleur, de nouveaux tchats ont été ouverts pour subdiviser la ville en sections de plus en plus restreintes, certaines couvrant à peine un rayon de quatre pâtés de maisons. Cela permet aux utilisateurs de suivre les signalements qui les concernent directement et de répondre rapidement et efficacement aux observations proches.

Contre-surveillance
Ces réseaux ont largement tiré profit d’un dispositif de contre-surveillance instauré au bureau local de l’ICE. Le bâtiment Whipple, un édifice fédéral implanté à Fort Snelling, en périphérie de Minneapolis et de Saint Paul, accueille depuis longtemps un siège régional de l’ICE, après avoir hébergé d’autres administrations fédérales. Le complexe fait face à une garnison de la Garde nationale, se situe près d’une installation militaire et jouxte le fort lui-même, aujourd’hui conservé. Ce dernier se trouve sur le site sacré de la confluence de deux cours d’eau. Il fut l’un des premiers lieux de colonisation de la région et servit même, à une époque, de camp de détention pour les Amérindiens Dakota.
Le complexe Whipple englobe des locaux administratifs, des infrastructures de traitement et de détentions au sous-sol, ainsi qu’un grand parking. Les habitants ont identifié ce site comme un point stratégique durant l’été et y maintiennent une présence continue depuis le mois d’août.
Le bâtiment est entouré par deux autoroutes nationales, deux rivières et un aéroport. Avec seulement deux accès pour les véhicules, il est facile de suivre les entrées et sorties des véhicules de l’ICE. Le dispositif Whipple Watch, comme on l’appelle, mobilise depuis des mois des manifestants et des observateurs postés sur place. Ils collectent des informations sur les convois se dirigeant vers la ville ou transportant des détenus vers l’aéroport, identifient les schémas opérationnels, tout comme les jours et les heures de forte activité, et consignent minutieusement les plaques d’immatriculation des véhicules. Cette base de données est consultée quasiment en continu, permettant aux équipes d’intervention rapide, à pied ou motorisées, de confirmer en temps réel la présence des véhicules de l’ICE. L’ICE a commencé à changer régulièrement ses véhicules et plaques pour tenter de contrer ce système de contre-surveillance, mais le nombre de signalements reçus ne cesse d’augmenter.
Whipple Watch poursuit trois objectifs principaux :
- Fournir un système d’alerte anticipé concernant les afflux massifs de troupes et de convois aux réseaux locaux d’intervention rapide,
- Collecter des données, notamment via les registres des plaques d’immatriculation,
- S’assurer que l’ICE sache qu’elle est surveillée, y compris sur son propre territoire.
Whipple Watch a clairement atteint ces objectifs, malgré la présence d’une force militarisée plus qu’hostile.

Much of ICE watch consists of patrollers in cars or on foot, monitoring and reporting on the movements of federal agents.
Comment ça marche
Chaque quartier de la ville (Southside, Uptown, Whittier, etc.) possède des équipes de dispatchers, qui gèrent une conversation continue sur Signal pendant les heures opérationnelles. Il arrive que plusieurs dispatchers opèrent simultanément pour se partager les tâches supplémentaires telles que la surveillance de la conversation, la transmission des rapports vers d’autres canaux ou la vérification des plaques d’immatriculation. La répartition des patrouilles permet également une couverture homogène de tout le secteur, de prendre des notes et d’apporter son aide lors de confrontations. Tous les patrouilleurs, qu’ils soient en véhicule ou à pied, restent connectés pendant toute la durée de leur ronde. Le flux d’informations est constant, permettant aux autres véhicules de décider s’ils sont en mesure de rejoindre l’équipe, de prendre le relais d’une filature ou de poursuivre la recherche d’autres véhicules.
Depuis que l’organisation a été subdivisée en zones de quartier plus précises, les habitants de nombreux secteurs ont également mis en place un dispositif de messagerie instantanée quotidienne. Les conversations sont recréées et effacées chaque jour afin de rester lisibles et d’éviter la saturation (le nombre maximal de participants par groupe Signal étant limité à 1000). Divers quartiers des villes et des banlieues ont reproduit la structure de base de ce système, mais avec des modèles, des structures de discussion, des mécanismes de vérification et des méthodes de collecte de données plus ou moins différentes.
Une équipe chargée de la collecte de données rassemble les informations anonymisées transmises par Whipple Watch ainsi que par plusieurs groupes locaux d’intervention rapide, puis les organise sous des formats exploitables, comme des cartes interactives des zones à risque. Cette équipe gère également la base de données consultable des plaques d’immatriculation, classées selon les catégories : « membres de l’ICE confirmés », « membres de l’ICE présumés », « personnes non affiliées à l’ICE confirmées » et autres.
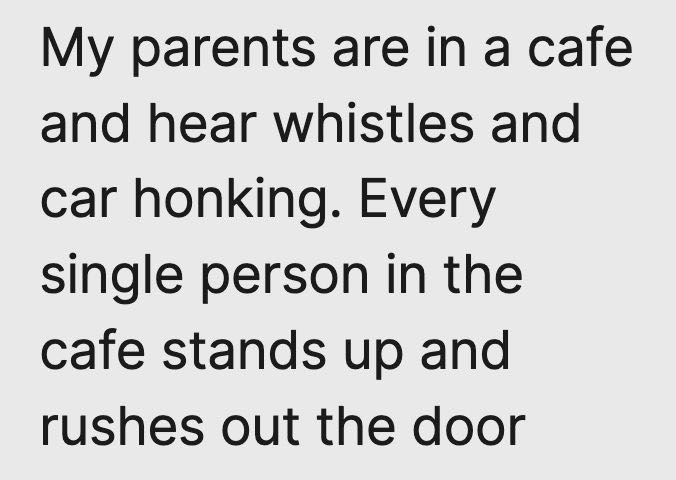
D’autres forums de discussion localisés ont été créés, notamment autour des établissements scolaires, des communautés religieuses et des services de livraison de courses solidaires. De plus, le forum d’accueil des Réseaux de quartier centralise les informations concernant les nouveaux bénévoles. Des personnes venant de l’ensemble de la ville – ou même du Minnesota – peuvent s’y inscrire et explorer les différents forums disponibles. Les administrateurs les ajoutent ensuite aux groupes ouverts ou les orientent vers les processus de sélection et de formation pour les groupes plus fermés.
Plus récemment, les dispatcheurs ont testé un système de relais permettant aux patrouilleurs qui suivent des véhicules jusqu’aux limites de leur secteur de patrouille de communiquer via messagerie instantanée afin de passer le relai à un patrouilleur de la zone voisine. Cela permet aux patrouilleurs la possibilité de se concentrer sur des itinéraires de plus en plus réduits, qu’ils peuvent rapidement maîtriser pleinement et parcourir ainsi mieux que n’importe quel agent de l’ICE.
Par ailleurs, des relais hispanophones copient les alertes ICE issues des appels de répartition et des tchats locaux, les traduisent, puis les diffusent à de vastes réseaux hispanophones sur Signal et WhatsApp.
Ce qui pourrait sembler, de l’extérieur, comme une formalisation excessive des échanges d’informations, ou au contraire comme un manque de structure dans les communications ouvertes auxquelles participent simultanément tous les patrouilleurs d’une même zone, se révèle en réalité être un dispositif de communication efficace, auto-organisé et bien coordonné.
L’information circule de manière fiable à tous les niveaux grâce aux tchats et aux dispatchers, et les patrouilleurs adoptent rapidement des méthodes qui leur permettent d’éviter de se couper la parole et de transmettre les messages de façon claire et structurée. Les volontaires définissent eux-mêmes leurs créneaux horaires, variables en durée, en fonction de leurs connaissances, de leurs compétences, de leurs centres d’intérêt et de leurs disponibilités.
Ce système est en perpétuelle évolution, très flexible, quelque peu difficile à expliquer aux personnes extérieures, mais étonnamment facile à intégrer – bon, une fois surmonté le choc de recevoir plus de 1500 messages par jour, bien sûr.

« Tu peux pas savoir à quel point c’est des trucs de dingue ici »
La réaction de l’ICE a été tangible. Ils ont modifié leur tactique. Ils ont été expulsés de certains quartiers lors d’opérations. On les a surpris en train de parler de leur peur et du fait que beaucoup d’entre eux avaient fui.
Ils ont aussi intensifié de façon constante et violente leurs agressions envers les observateurs. Les patrouilleurs qui suivent l’ICE de trop près ou trop longtemps se retrouvent souvent encerclés, permettant à quatre à dix agents d’encercler leur véhicule, de frapper aux portes, de crier, de filmer et de les menacer d’arrestation. Les patrouilleurs qui ont bloqué l’ICE avec leur voiture ont été percutés, leurs vitres brisées, ou ont été extraits de force pour être détenus ou arrêtés. Certaines personnes ont été embarquées de force dans des véhicules de l’ICE, transportées sur plusieurs kilomètres, puis balancés au bord de la route. Des agents ont arraché des personnes de leurs voitures, les ont trainés sur plusieurs pâtés de maisons, puis les ont laissées s’enfuir dans la rue. Récemment, des agents ont utilisé du gaz poivre contre les voitures – parfois en essayant de saturer l’intérieur pour contraindre les occupants à sortir, parfois simplement pour marquer les voitures de façon visible afin de les harceler et de les cibler davantage.
Récemment, des agents de l’ICE ont projeté une grenade lacrymogène depuis leur voiture sur l’autoroute afin de tenter de dissuader une personne de les suivre. Non seulement ces agents ont suivi des patrouilleurs jusqu’à leur domicile, mais ils ont également identifié le conducteur ou le véhicule qui les suivait et conduit ces derniers jusqu’à leur propre domicile, dans un but d’intimidation. Des patrouilleurs nous ont raconté avoir été frappés, avoir failli être fauchés, avoir vu leurs véhicules foncer sur eux, avoir été menacés par une arme, avoir eu leurs pneus crevés et avoir été extraits de force hors de véhicules en marche. Si l’assassinat de Renee Nicole Good a choqué le pays, il n’a surpris personne parmi ceux qui ont arpenté les rues des Villes Jumelles ces six dernières semaines.

Le modèle des Villes Jumelles : ne le copiez pas, inspirez-vous-en
Ce qui différencie le réseau d’intervention rapide des Villes Jumelles et tout son écosystème, ce n’est pas l’adhésion stricte à une structure particulière. C’est plutôt une analyse lucide de leur situation, une volonté d’adaptation et le courage de riposter face à l’escalade de la violence.
Les habitants de Minneapolis et Saint Paul observent attentivement leurs adversaires. Ils connaissent les modes de déploiement des agents de l’ICE, leurs positions, leur apparence, leurs comportements et leurs réactions. Ils vivent dans une agglomération relativement petite et densément peuplée, où de nombreux quartiers sont accessibles à pied et où le plan en damier facilite les déplacements en voiture. Les gens sont liés entre eux, s’appuyant sur des liens hérités des mouvements et des soulèvements antérieurs. Le maire de Minneapolis cherche à préserver l’image progressiste de son administration ; il est peu probable que la police soit déployée en renfort des opérations de l’ICE. Ce sont ces conditions concrètes et observables qui ont directement déterminé la conception et la mise en œuvre de la résistance locale.
Les personnes impliquées dans le modèle s’engagent à faire preuve de souplesse et de capacité d’adaptation face à l’évolution de la situation. La ville étant composée de quartiers aux caractéristiques et aux profils démographiques variés, le modèle a été conçu pour s’adapter à chaque quartier. Après l’arrêt des raids, l’ICE a conduit ses opérations presque exclusivement depuis un point central à accès restreints, ce qui a poussé les organisateurs à investir massivement dans la contre-surveillance à cet endroit. Lorsque les interventions de l’ICE ont évolué vers des arrestations de rue et des perquisitions rapides et aléatoires, la seule manière d’anticiper leurs déplacements consistait à identifier leurs véhicules en approche. La population s’est donc focalisée sur le repérage des véhicules de l’ICE sur les routes et sur leur suivi. L’ICE, contraint d’utiliser la surprise et les embuscades, les intervenants se sont servis du bruit – sifflets et klaxons – pour donner rapidement l’alerte à distance. Les agents de l’ICE n’apprécient guère d’agir en infériorité numérique ni d’être encerclés ; les patrouilles regroupent donc les véhicules et mettent en place des barrages routiers improvisés.
Peu de ces situations pouvaient être anticipées. La seule manière de s’adapter efficacement consistait à créer un environnement ouvert et inclusif, favorisant la prise d’initiative et l’auto-organisation.
Le courage des habitants des Villes Jumelles mérite une reconnaissance particulière. Il est facile de critiquer les réseaux d’intervention rapide, car filmer ou observer l’escalade de la violence ne suffit pas à la maîtriser. Dans de nombreuses régions du pays, ces réseaux se sont désengagés avant même de pouvoir agir, en tentant de contrôler de manière excessive les actions de leurs membres, malgré une volonté générale de participer activement au conflit. Les formateurs insistent souvent sur la non-ingérence ; certains intervenants se surveillent mutuellement dans la rue, réprimandant quiconque jette des projectiles ou crie. Dans certains cas, cela découle d’une peur instinctive de représailles envers les ONG impliquées. Dans d’autres, c’est une attention, bien intentionnée mais mal orientée, portée à la « sécurité », qui se traduit par un paternalisme consistant à déterminer pour autrui le niveau de risque jugé acceptable.
On observe cette même prudence excessive dans les Villes Jumelles. Certains instructeurs et coordinateurs, par habitude, incitent les gens à se retirer plutôt qu’à les accompagner dans leurs initiatives. D’autres, au lieu de contrecarrer l’ICE, entravent ceux qui passent à l’action.
Mais ici, le conflit est conduit par ceux qui repoussent les limites, qui se servent de leurs véhicules et de leurs corps pour immobiliser les agents et libérer les personnes détenues, qui jettent des boules de neige et des pierres, qui renvoient les grenades lacrymogènes, qui couvrent les voitures et les agents de peinture et brisent les vitres de leurs automobiles, qui continuent de hurler au visage des ravisseurs lorsqu’ils sont frappés, aspergés de gaz poivré ou touchés par des balles en caoutchouc, qui assistent aux enlèvements masqués, aux disparitions non-élucidées et au nombre sans précédent de morts perpétrés par cette nouvelle ICE enhardie, et ils sont prêts à prendre de véritables risques pour les arrêter. Ils subissent les représailles, et malgré cela, ils sont plus nombreux, plus forts et plus courageux.
Se préparer à l’arrivée massive des agents de l’ICE dans votre ville – et croyez-moi, leur arrivée est imminente – demande d’examiner le terrain et de faire preuve de créativité. La stratégie la plus adaptée à votre ville ne ressemblera probablement pas aux unités d’observation régulières stationnées dans leurs quartiers généraux ni aux patrouilles mobiles d’intervention rapide. Il faudra analyser en profondeur comment tirer le meilleur parti de vos atouts et exploiter vos faiblesses dans votre contexte spécifique. Commencez dès maintenant à étudier, planifier, collaborer et expérimenter.
Nous nous tournons vers les Villes Jumelles, non pas pour en reproduire les détails, mais pour leur clarté d’analyse, leur action rapide et décisive, leur expérimentation agile, leur profonde bienveillance mutuelle et leur courage contagieux.

Ce rapport a été rédigé par des visiteurs des Villes Jumelles, qui ont eu le plaisir d’être accueillis au sein du réseau pour quelques jours. Merci à tous ceux qui nous ont fait découvrir leur ville, nous ont expliqué le fonctionnement de leurs systèmes et nous ont emmenés patrouiller. Amour et rage.
Resources
- Eight Things You Can Do to Stop ICE
- Seven Steps to Stop ICE
- When the Feds Come to Your City: Standing Up to ICE—A Guide from Chicago Organizers
Further Reading
- Minneapolis Responds to the Murder of Alex Pretti: An Eyewitness Account
- Protesters Blockade ICE Headquarters in Fort Snelling, Minnesota: Report from an Action during the General Strike in the Twin Cities
- From Rapid Response to Revolutionary Social Change: The Potential of the Rapid Response Networks
- North Minneapolis Chases Out ICE: A Firsthand Account of the Response to Another ICE Shooting
- Minneapolis Responds to ICE Committing Murder: An Account from the Streets
- Protesters Clash with ICE Agents Again in the Twin Cities: A Firsthand Report
- Minneapolis to Feds: “Get the Fuck Out”: How People in the Twin Cities Responded to a Federal Raid
15.01.2026 à 10:27
Les quartiers nord de Minneapolis chassent l’ICE : Un témoignage direct sur la réaction à une nouvelle fusillade impliquant l’ICE
CrimethInc. Ex-Workers Collective
Texte intégral (2441 mots)

Après que des agents du Service de l’immigration et des douanes (ICE) aient tiré sur au moins une personne dans les quartiers nord de Minneapolis dans la nuit du 14 janvier, une foule s’est rassemblée et leur a fait face, les affrontant et arrachant le ruban jaune que les autorités avaient mis en place autour de la zone. La police est venue prêter main forte aux mercenaires fédéraux, se joignant à eux pour tirer une quantité considérable de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes sur les manifestant·e·s ainsi que sur les voitures qui passaient par là et les maisons du quartier résidentiel. Néanmoins, les agents ont perdu le contrôle de la zone et ont battu en retraite, cédant les rues à celles et ceux qui leur avaient tenu tête.
Au cours de cette opération, les agents de l’ICE ont abandonné plusieurs véhicules dans la zone. Les manifestant·e·s ont ouvert les véhicules et y ont trouvé des cartes d’identité, des documents administratifs, des plaques d’immatriculation, des plans opérationnels, du matériel tactique et d’autres objets. Des images de manifestant·e·s examinant ces documents ont été diffusées en direct sur Internet.
Cet événement fait suite au meurtre atroce de Renee Good survenu une semaine plus tôt et perpétré par l’agent Jonathan Ross en plein jour. Ce meurtre a été filmé par plusieurs personnes. Tu peux lire ici un compte rendu de la réaction des manifestant·e·s.
Au cours du dernier mois et demi, le régime Trump a envoyé de plus en plus de troupes dans les « Villes Jumelles », car il sait que ce qui s’y passe a des répercussions sur l’ensemble du pays – et parce qu’il est en train de perdre. Si la bataille de Minneapolis de l’hiver 2026 se déroule comme la bataille de Portland de l’été 2020, cela augure mal de la capacité de Trump à conserver le contrôle par la force pure et simple.
Il est important de noter le rôle joué par la police locale de Minneapolis dans les agressions commises ce soir contre les manifestant·e·s, alors qu’elle est officiellement sous l’autorité d’une municipalité démocrate qui s’est engagée verbalement à s’opposer à l’ICE. Partout dans le pays, la police a joué un rôle essentiel en permettant à l’ICE de terroriser les communautés. Sans l’aide et le soutien continus des services de police locaux, les agences fédérales auraient déjà été dépassées par les mouvements de protestation. Lorsque les politicien·ne·s démocrates affirment qu’iels doivent « maintenir l’ordre », iels tentent de se positionner comme des partenaires mineurs dans la consolidation du fascisme. Il est peut-être dans leur intérêt de « maintenir l’ordre » alors que des mercenaires kidnappent et tuent des personnes, mais ce n’est pas dans le nôtre.
Nous proposons ici un récit des manifestations qui ont suivi la fusillade dans le nord de Minneapolis. Ce récit nous a été envoyé anonymement.

Des manifestant·e·s qui ont inspecté les véhicules abandonnés de l’ICE ont apparemment récupéré ces « pièces de défi » que les mercenaires de l’ICE reçoivent lorsqu’ils kidnappent des personnes. Cette « pièce » est décorée d’un crâne coiffé d’une couronne. Les mercenaires de l’ICE servent le roi de la mort.
Il me restait deux heures à faire avant la fin de ma journée de travail lorsque mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. Plusieurs camarades ne savaient pas où j’étais et pensaient que j’étais peut-être dehors, dans les rues.
« Où es-tu ? »
« Ça va ???? »
« Coups de feu à l’intersection de la 24ème rue et de Lyndale. »
« Ils viennent tout juste de tirer sur autre personne »
Tous les fils de discussion des différents groupes d’intervention rapide parlaient de la même chose. Toutes sortes de rumeurs circulaient. Avaient-ils tiré sur une ou deux personnes ? Les victimes étaient-elles vivantes ou mortes ? Quelqu’un a dit que l’ICE avait tiré dans la jambe d’un garçon vénézuélien de 12 ans. Quelqu’un d’autre a dit que la victime se cachait chez elle par crainte d’être arrêtée et avait désespérément besoin de soins médicaux. Je ne savais pas quoi croire.
C’est toujours comme ça quand une nouvelle urgence survient. Au cours des 45 derniers jours d’occupation fédérale, se frayer un chemin dans le brouillard de la guerre pour découvrir ce qui vient de se passer est devenu une sensation familière. Quelqu’un m’a envoyé une vidéo en direct montrant une foule en train de s’enfuir alors que des agents de l’ICE leur lançaient des grenades lacrymogènes et assourdissantes.
Le temps s’est ralenti. Je me suis dépêché·e de terminer la tâche fastidieuse sur laquelle je travaillais aussi vite que possible. Quand j’ai senti que ce que j’avais fait été suffisamment correct pour ne pas avoir d’ennuis ultérieurement, j’ai dit à mes collègues que j’avais une urgence familiale et que je devais partir plus tôt. J’ai sauté dans ma voiture et j’ai brûlé tous les feux en direction de la 24ème rue et de North Lyndale.
J’ai croisé une équipe de street medics située à deux pâtés de maisons au nord de la foule. Iels m’ont raconté ce qu’iels avaient vu avant mon arrivée. L’ICE avait arrêté deux enfants soupçonnés d’avoir lancé un feu d’artifice dans leur direction – 20 voyous cagoulés s’étaient alors précipités pour les attraper, avant de les relâcher une demi-heure plus tard sous la pression intense du reste de la foule présente sur les lieux. Les street medics m’ont averti qu’iels allaient partir avant que les flics ne commencent à procéder à des arrestations massives. Selon elleux, je me dirigeais vers une nasse. L’air empestait déjà les gaz lacrymogènes.
Au niveau de la 24ème rue, j’ai retrouvé une foule composée d’une centaine de personnes faisant face à une ligne de flics anti-émeute du département de police de Minneapolis. Les fédéraux avaient déjà quitté les lieux et avaient laissé la situation aux mains des policiers locaux. Quelqu’un battait lentement la mesure sur un tambour. À ma droite, des enfants se tenaient debout sur une pelouse surélevée et criaient « Nique l’ICE ! » et « Nique le 12 ! » (une alternative à « Nique la police ! ») en direction de la police. Quelqu’un brandissait une grenade lacrymogène qui leur avait été tirée dessus, la montrant à ses ami·e·s. Une équipe de télévision était également présente. Ils ont essayé de me parler. Je me suis frayé·e un chemin à travers la foule pour m’éloigner des caméras. Au-delà de la ligne de front, à un pâté de maisons plus au sud au niveau de Lyndale et de la 23ème rue, j’ai entendu un bruit de verre brisé.
J’ai fait demi-tour et j’ai contourné le pâté de maisons. Je suis ressorti·e de l’autre côté de la ligne de front. De ce côté-là aussi, il y avait une foule de jeunes. Iels étaient en train de démolir deux SUVs que j’ai immédiatement reconnus comme étant des véhicules de l’ICE grâce à leurs vitres teintées et à leurs plaques d’immatriculation d’un autre État. Des gars donnaient des coups de pieds dans les vitres. Quelqu’un brandissait fièrement un drapeau mexicain. Une jeune fille a sauté sur le capot et a enfoncé le pare-brise avec son pied. Quelqu’un a tagué en rouge « HANG KRISTI NOEM » (« Pendez Kristi Noem », sécrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis) sur le côté de la voiture.

Une graffeuse ou un graffeur a désigné les mercenaires de l’ICE pour ce qu’ils sont : des nazis.
Quelques personnes ont sorti un coffre-fort pour armes à feu verrouillé du coffre d’une des voitures. Quelqu’un a jeté par terre un kit de prise d’empreintes digitales. Une autre personne parcourait frénétiquement un dossier contenant des documents officiels, les prenant un par un en photo avec son téléphone. Il y avait aussi une cagoule que porte les agents de l’ICE dans la portière côté conducteur du SUV le plus proche. Comme il se doit, un grattoir à glace se trouvait sur le plancher du véhicule.
Tout à coup, j’ai entendu un grand bruit d’explosion derrière moi. L’odeur âcre familière des gaz lacrymogènes m’a envahi les narines. J’ai commencé à courir vers le sud avec le reste de la foule. Cependant, lorsque nous sommes arrivé·e·s à l’intersection suivante, je me suis retourné·e et j’ai vu que les flics battaient en retraite, tirant des projectiles sur la foule tout en se déplaçant vers l’est sur la 24ème rue. La foule a repris ses esprits, nous avons fait demi-tour et avons couru vers la 24ème rue. Il y avait d’énormes nuages de gaz lacrymogène à l’est de notre position, à tel point que je ne voyais plus les flics.
J’ai entendu une personne crier avec enthousiasme « C’est celui-là ! C’est l’ICE ! ». Elle désignait un autre SUV argenté garé sur la 24ème rue. J’ai vérifié la plaque d’immatriculation dans la base de données des véhicules de l’ICE que les militant·e·s tiennent à jour, j’ai vu qu’elle avait raison et je me suis immédiatement senti·e ridicule d’avoir fait du travail administratif au milieu d’une émeute. Quelqu’un a commencé à frapper l’une des vitres latérales à l’aide du grattoir à glace qui se trouvait dans le véhicule précédent, en frappant aussi fort que possible. Après quelques coups, la vitre a cédé dans un craquement satisfaisant. Les gens autour de moi ont également commencé à donner des coups de pieds dans les autres vitres. Quelqu’un a ouvert la portière côté conducteur et a jeté un pétard à l’intérieur du véhicule.
Un caméraman trop zélé – je ne saurais dire s’il s’agissait du même que précédemment – s’est frayé un chemin à travers la foule pour filmer le véhicule de l’ICE en train de subir ce traitement. « Pas de vidéo ! » lui a crié quelqu’un. « Si vous le laissez prendre des images de ce bordel, quelqu’un va finir en prison ! » Plusieurs personnes ont vigoureusement encouragé le caméraman à faire demi-tour et à quitter les lieux de l’action.
Lorsque les gaz lacrymogènes se sont dissipés, j’ai vu que les flics avaient disparus. Cela semblait trop beau pour être vrai. J’ai couru sur quelques pâtés de maisons pour inspecter les environs. Ils étaient introuvables.
Je suis retourné·e là où se trouvaient les deux véhicules défoncés de l’ICE. Une ambiance festive de fête de quartier s’était installée. Les gens allumaient des feux d’artifice. Une personne essayait d’ouvrir la mallette sécurisée contenant les armes. Quelqu’un dansait à nouveau sur le toit d’un véhicule tandis qu’une autre personne passait à plein volume le morceau « I Don’t Fuck With You » de Big Sean. Des jeunes faisaient circuler une bouteille de Hennessy. Une voie de circulation s’était ouverte. Certain·e·s automobilistes qui passaient par là levaient le poing par la fenêtre et criaient « FUCK ICE! » (« Nique l’ICE ! »).
« Je suis tellement fier·ère de ma ville », me suis-je supris·e à murmurer à voix haute. Après sept semaines d’atrocités commises par ces fascistes, les gens ripostaient enfin. J’ai pensé aux libéraux qui, chez eux, se tordaient les mains en arguant que nous donnions soi-disant aux fédéraux une excuse pour réprimer (mais bon sang, qu’est-ce qu’ils croyaient qu’il se passait déjà ?) et publiaient sur Facebook des messages sur le « langage des sans-vois ». Les nouvelles et nouveaux camarades avec lesquel·le·s je faisais la fête autour des véhicules pillés me semblaient parfaitement éloquent·e·s.
Le soulèvement de 2020 lié au meurtre de George Floyd n’a jamais été très loin. Son spectre a hanté Minneapolis tout au long des événements qui se sont déroulés au cours du dernier mois et demi. Ce soir, le 14 janvier, il a finalement repris une forme tangible. Les gens se souviendront de cette soirée comme du coup d’envoi de la contre-attaque populaire contre une invasion fasciste.
Lorsque l’histoire sera écrite comme elle devrait l’être, ce n’est pas notre férocité, mais plutôt la modération et la longue patience des « Villes Jumelles » qui feront que les gens secoueront la tête avec étonnement.

08.01.2026 à 22:09
Minneapolis réagit au meurtre commis par l’ICE : Un récit depuis les rues
CrimethInc. Ex-Workers Collective
Texte intégral (2774 mots)

Le 7 janvier 2026, Jonathan Ross, agent des Services de l’immigration et des douanes des États-Unis (ICE), a abattu de sang-froid notre camarade Renee Good. Ce qui suit est un récit des événements qui ont immédiatement suivi son assassinat, vu par un·e anarchiste de Minneapolis. Ces mots sont dédiés à sa mémoire.
Renee Good a été assassinée à seulement six pâtés de maisons de l’endroit où George Floyd a été tué en mai 2020. Cela semble significatif pour deux raisons. Premièrement, le sud de Minneapolis a une histoire et un passé de résistance. Des milliers de personnes ici se souviennent encore des affrontements avec la police en 2020. Deuxièmement, une dynamique similaire pourrait se reproduire aujourd’hui, tout comme lors de l’été explosif de 2020, lorsque les troubles à Minneapolis ont été l’étincelle qui a déclenché un soulèvement à l’échelle nationale.
Cela fait maintenant 38 jours que le département de la Sécurité intérieure occupe les « Villes Jumelles » (les villes de Minneapolis et de Saint Paul) afin de terroriser nos voisin·e·s immigré·e·s. Ce lundi, il a déployé 2000 agents de l’ICE supplémentaires afin d’augmenter considérablement le nombre d’enlèvements. Il s’agit d’une escalade sans précédent. Aucune autre ville n’a encore connu une occupation de l’ICE à cette échelle.
Cette escalade est une réaction à la vague de résistance contre l’ICE que nos communautés ont menée au cours des dernières semaines. Plus de 4000 personnes ont participé à au moins 81 groupes d’intervention rapide : patrouilles, filatures et encerclement des véhicules de l’ICE, actions visant à alerter nos voisin·e·s, manifestations devant les hôtels hébergeant des agents de l’ICE et confrontations avec ces derniers lorsqu’ils tentent de mener à bien leurs activités ignobles. La recrudescence actuelle des attaques de l’ICE ne nous a pas plongé dans le désespoir ; nous pensons qu’elle indique que l’ICE est comme un animal sauvage acculé dans un coin. Son comportement erratique et violent commence à suggérer un certain désespoir de leur côté. C’est une agence en crise, une agence qui peut être vaincue.

Des personnes font une veillée en hommage à Renee Good après son assassinat par Jonathan Ross, agent de l’ICE.
Hier, le 7 janvier, je me suis rendu·e au bâtiment Bishop Henry Whipple à 8 heures du matin avec un·e ami·e. Le bâtiment Whipple est le siège des opérations de l’ICE pour toute la région du Haut-Midwest ; c’est là qu’ils se préparent avant de mener leurs raids. J’ai pris des photos de leurs plaques d’immatriculation pendant environ une heure. Un·e troisième ami·e avait prévu de se joindre à nous. Iel m’a ensuite envoyé un SMS pour me dire qu’iel ne pouvait pas venir parce que l’ICE avait tiré sur quelqu’un.
Mon ami·e et moi-même avons quitté Whipple et avons filé vers Portland Avenue et la 34ème rue, où la fusillade venait d’avoir lieu. À notre arrivée, nos téléphones ont cessé de fonctionner, plus aucun signal, comme s’ils étaient brouillés. Le périmètre était bouclé par un ruban jaune et des dizaines d’agents de la police municipale protégeaient des agents de l’ICE équipés de leur tenue tactique complète. Les policiers disposaient d’un véhicule Bearcat équipé d’un LRAD (pour long-range acoustic device plus communément connu sous le nom de « canon à son »). Greg Bovino lui-même, le « commandant en chef » de la police des frontières, se tenait là, lui aussi en tenue tactique. Une foule se formait, composée non seulement d’activistes reconnaissables, mais aussi de voisin·e·s ordinaires qui vivaient dans ce quartier et qui étaient sorti·e·s pour les insulter. Nous avons commencé à scander : « Flics ! Porcs ! Assassins ! »
La situation s’est envenimée lorsqu’un agent a plaqué au sol une manifestante à environ un pâté de maisons de là. Il l’a attrapé par ses vêtements et a tenté de lui mettre les mains dans le dos alors qu’elle était allongée dans un banc de neige. Quelqu’un d’autre a bousculé l’agent, le faisant tomber. Quelques personnes dans la foule se sont précipitées pour voir ce qui se passait. Un résident d’âge moyen a exigé de savoir pourquoi les agents arrêtaient cette personne en particulier.
« Elle était en train de crever des pneus » répondit l’agent de l’ICE.
L’homme lui répondit en criant : « Moi aussi je vais le faire, enfoiré ! »
Il y a eu quelques minutes de tension, jusqu’à ce que l’agent décide de laisser partir la personne arrêtée avant de se replier stratégiquement à son tour vers un groupe d’agents de l’ICE.
La foule a commencé à prendre confiance, s’approchant des agents de l’ICE et scandant des slogans de manière plus agressive. La police municipale a dégagé une sortie pour permettre à l’ICE de partir en direction du sud sur Portland Avenue ; ils ont commencé à quitter les lieux à bord de leurs véhicules. Certaines personnes ont commencé à crier pour que les gens sortent dans la rue afin de les bloquer. La foule a d’abord hésité, mais quelques personnes ont commencé à occuper la chaussée et ont réussi à bloquer un véhicule de l’ICE. Voyant cela, d’autres personnes ont fait de même. Les agents de la police municipale les ont repoussés. Les gens donnaient des coups de pieds aux véhicules de l’ICE alors qu’ils s’éloignaient à toute vitesse. Une personne a failli être renversée lors de cette action.
Alors que la foule bloquait de plus en plus Portland Avenue, les flics ont tenté de dégager une autre sortie pour leur permettre de se diriger vers l’ouest sur la 34ème rue. Les gens ont commencé à scander « Fists up, feds down, get the fuck out of town! » (« Les poings en l’air, les fédéraux à terre, cassez-vous de notre ville ! »). Des agents de l’ICE équipés de lanceurs soi-disant « moins létaux » et de fusils à pompe protégeaient un SUV qui tentait de partir. Les gens ont commencé à lancer des boules de neige dans leur direction. La foule s’est précipitée en avant et je me suis retrouvé·e face à face avec un agent de l’ICE qui m’a pointé le canon de son lanceur en direction de mon visage.
« Qu’est-ce que tu vas faire ? Tu vas aussi me tirer dessus ? », j’ai demandé.
Il a tiré avec le lanceur à bout portant sur mon visage. Ma première pensée a été : « Je viens de perdre un œil. » C’est ce que j’ai ressenti. Les street medics m’ont tiré en arrière et ont commencé à me rincer les yeux. À ma droite, je voyais des gens poursuivre des agents de l’ICE dans une ruelle derrière des maisons. J’ai vu le même homme d’âge moyen qui était intervenu en faveur de l’autre manifestante recevoir lui aussi une balle de poivre à bout portant en plein visage. Les agents ont tiré des gaz lacrymogènes et ont plaqué quelqu’un d’autre au sol.
Deux camarades qui s’occupaient de me soigner m’ont aidé à me déplacer et à me réfugier dans une maison située non loin de là pour que je puisse me nettoyer. J’ai pris une douche et j’ai mis de la gaze sur la blessure que j’avais au visage. Quand je suis sorti·e de la douche, j’ai vu qu’il y avait encore plus d’agitation dehors sur les trottoirs. Il était difficile de dire si l’ICE poursuivait les gens ou si ces les gens qui les poursuivaient.
Certaines personnes ont érigé une barricade à l’angle de Portland Avenue et de la 33ème rue, à un pâté de maison de l’endroit où Renee a été assassinée. La barricade est toujours là aujourd’hui, et des manifestant·e·s y campent, parmi lesquel·le·s certains visages familiers qui ont occupé pendant plus d’un an la zone autonome de George Floyd Square, située à un kilomètre de là.

La barricade à l’angle de Portland Avenue et de la 33ème rue, à un pâté de maisons de l’endroit où Renee a été assassinée.
Je suis rentré·e chez moi pour soigner mes blessures et nettoyer le spray au poivre dont été imprégné mes vêtements. Quelques heures plus tard, j’ai entendu dire que l’ICE avait fait une descente au lycée Roosevelt et avait percuté la voiture d’un observateur avec l’un de leurs véhicules, utilisant ce dernier comme une arme, comme nous les avons souvent vus le faire. Une bagarre a éclaté devant l’entrée principale de l’établissement. Ils ont arrêté un·e manifestant·e, mais n’ont pas réussi à attraper l’élève qu’ils tentaient d’enlever. Cela devrait rappeler à tout le monde qu’ils ne sont pas invincibles : lorsque nous nous engageons dans nos actions, nous pouvons les vaincre.
Vers 16h30, un groupe de 30 à 40 manifestant·e·s a forcé les portes du palais de justice fédéral situé dans le centre-ville. Alors que les agents de sécurité tentaient de repousser les portes tournantes pour empêcher les manifestant·e·s d’enter, quelqu’un a brisé une vitre. Personne n’a été arrêté sur place. La spontanéité du moment et le nombre impressionnant de petites manifestations qui ont éclaté partout dans les « Villes Jumelles » ont empêché les autorités de pouvoir réagir sur tous les fronts.
Cette nuit-là, une veillée funèbre massive a été organisée pour pleurer la mort de Renee. Quelque dix mille personnes se sont rassemblées, se pressant autour de braseros qui envahissaient Portland Avenue à perte de vue. On aurait dit que tous les habitant·e·s du Southside – les quartiers sud – étaient là.

Les gens se réunissent à la veillée funèbre pour Renee Good après son assassinat par Jonathan Ross, agent de l’ICE.
Depuis le début de l’invasion des « Villes Jumelles », des contradictions désordonnées et chaotiques ont abondé au sein du réseau de groupes d’intervention rapide qui s’est formé. Au début, il y a eu des affrontements majeurs avec l’ICE à l’usine de papier Bro-Tex et dans les quartiers est de Saint Paul. Quelques semaines plus tard, un affrontement a eu lieu à l’angle de la 29ème rue et de Pillsbury, où les agents de l’ICE ont plaqué au sol une femme enceinte. À la suite de ces événements, il y a eu beaucoup d’actions de maintien de la paix et de débats sur la non-violence. Les éléments libéraux ont gagné du terrain, et des choses que nous pouvions considérer comme acquises en 2020 ne sont plus établies aujourd’hui.
Beaucoup de membres des groupes d’intervention rapide sont issus des manifestations 50501 et No Kings et sont encore très novices et inexpérimenté·e·s. Cela peut être à la fois une bénédiction et une malédiction. Il existe une immense source d’énergie créative ; divers quartiers essaient toutes sortes de stratégies différentes pour mettre en place des systèmes d’alerte et d’entraide. Parfois, les libéraux qui dirigent les opérations ont mené une véritable contre-insurrection en disant aux gens de ne pas se rendre sur les lieux d’un enlèvement. Les formations très suivies pour prendre part aux patrouilles ont appris aux participant·e·s à rester à au moins 10 mètres de l’ICE à tout moment. Il existe une culture qui consiste à nous qualifier « d’observatrices et d’observateurs », une idée insidieuse pour celles et ceux d’entre nous qui veulent faire tout leur possible pour perturber et entraver les opérations de l’ICE. L’accent est fortement mis sur la collecte des plaques d’immatriculations de l’ICE, ce qui s’avère de moins en moins utile à mesure que les agents changent leurs plaques et que 2000 nouveaux véhiculent envahissent nos rues. Nous avons constaté que les patrouilles à pied autour des points chauds comme Lake et Bloomington sont de plus en plus efficaces depuis le début de la vague lundi dernier. Il ne faut pas longtemps pour trouver un agent de l’ICE qui rôde dans les parages.
À mon avis, nous devrons lutter sur deux fronts pour vaincre l’invasion de l’ICE. Nous devons devenir plus agiles et plus courageuses et courageux pour mettre fin rapidement et fermement aux enlèvements, et nous devons également les vaincre sur le plan politique en popularisant l’idée que l’ICE représente une attaque contre la société dans son ensemble. Les conditions d’un nouveau soulèvement comme celui de 2020 bouillonnent juste sous la surface. C’est un feu souterrain que les autorités fédérales ne peuvent éteindre.
Nous devons cela à Renee Good, notre sœur disparue. Nous devons faire pression sur ces tensions jusqu’à ce que nous parvenions à les dépasser et franchir le cap.
La barricade à l’angle de Portland et de la 33ème rue, à un pâté de maisons de l’endroit où Renee a été assassinée.
La barricade à l’angle de Portland et de la 33ème rue, à un pâté de maisons de l’endroit où Renee a été assassinée.
Nique l’ICE.


Further Reading
- Minneapolis Responds to the Murder of Alex Pretti: An Eyewitness Account
- Protesters Blockade ICE Headquarters in Fort Snelling, Minnesota: Report from an Action during the General Strike in the Twin Cities
- From Rapid Response to Revolutionary Social Change: The Potential of the Rapid Response Networks
- Les réseaux d’intervention rapide dans la région de Minneapolis-Saint Paul: Comment s’organise l’auto-défense populaire contre l’ICE
- Les quartiers nord de Minneapolis chassent l’ICE: Un témoignage direct sur la réaction à une nouvelle fusillade impliquant l’ICE
- Minneapolis réagit au meurtre commis par l’ICE: Un récit depuis les rues
- Protesters Clash with ICE Agents Again in the Twin Cities: A Firsthand Report
- Minneapolis to Feds: “Get the Fuck Out”: How People in the Twin Cities Responded to a Federal Raid
07.01.2026 à 06:33
Les protestations en Iran assiégées par les ennemis intérieurs et extérieurs : Un rapport sur le soulèvement populaire récent
CrimethInc. Ex-Workers Collective
Texte intégral (5345 mots)

Le texte suivant est une contribution du collectif Roja, un collectif indépendant, de gauche et féministe basé à Paris. Roja est né après le féminicide de Jina (Mahsa) Amini, au même moment que le début du soulèvement « Jin, Jiyan, Azadi » en septembre 2022. Le collectif est composé d’activistes politiques de diverses nationalités et géographies politiques au sein de l’Iran, notamment kurdes, hazaras, perses, et d’autres encore. Les activités de Roja ne sont pas seulement liées aux mouvements sociaux en Iran et au Moyen-Orient, mais aussi aux luttes locales à Paris, en lien avec des luttes internationalistes, notamment en soutien à la Palestine. Le nom « Roja » s’inspire de la résonance de plusieurs mots dans différentes langues : en espagnol, roja signifie « rouge » ; en kurde, roj signifie « lumière » et « jour » ; en mazandarani, roja signifie « étoile du matin » ou « Vénus », considérée comme le corps céleste le plus brillant la nuit.
Mise à jour, 9 janvier : Ce texte d’intervention a été rédigé par Roja le 4 janvier 2026, le sixième jour des manifestations nationales en Iran. Beaucoup de choses se sont produites depuis — surtout la nuit historique du 8 janvier, douzième jour du soulèvement. La journée a commencé par une grève générale des commerçants et de l’économie marchande, notamment au Kurdistan, appelée par des partis kurdes. La fermeture des boutiques s’est combinée à des mobilisations de rue et dans les universités à travers tout le pays. Les affrontements avec les forces de sécurité se sont étendus à des dizaines de villes, de la capitale aux provinces frontalières ; un rapport de surveillance des droits humains a comptabilisé des actions de protestation dans au moins 46 villes réparties sur 21 provinces ce jour-là. Au crépuscule, des images circulant montraient des foules d’une ampleur extrêmement choquante que la police habituelle ne pouvait contenir : des millions de personnes reprenant les rues comme leur bien propre et, dans de nombreux endroits, repoussant les forces de sécurité en retraite — une atmosphère qui, pour beaucoup, évoquait le souvenir des mois précédant la révolution de 1979.
Le soir du 8 janvier, alors que l’appareil répressif de la République islamique vacillait et que les rues lui échappaient, le régime a mis en place une coupure quasi totale d’internet. Le black-out se poursuit au moment où nous écrivons, dans une tentative de couper les circuits de coordination et d’empêcher la documentation des assassinats.
En même temps, Donald Trump a réitéré ses menaces de représailles si la République islamique intensifiait les tueries, tout en se distançant — seulement partiellement — de Reza Pahlavi, affirmant ne pas être sûr qu’une rencontre soit appropriée et que « nous devrions laisser tout le monde sortir là-bas et voir qui émerge ». L’obsession autour du « fils du Shah » occulte une autre tendance, tout aussi réelle, sur laquelle nous nous concentrons dans ce texte : la perspective d’une transition contrôlée par une reconfiguration interne — un changement sans rupture — à l’image de ce qui s’est récemment produit au Venezuela.
I. Le cinquième soulèvement depuis 2017
Depuis le 28 décembre 2025, l’Iran brûle de nouveau dans la fièvre de vastes manifestations. Des cris de « Mort au dictateur » et « Mort à Khamenei » ont retenti dans les rues de au moins 222 lieux répartis dans 78 villes de 26 provinces. Les protestations ne visent pas seulement la pauvreté, la vie chère, l’inflation et la dépossession, mais tout un système politique pourri jusqu’à la moelle. La vie est devenue invivable pour la majorité — en particulier pour la classe ouvrière, les femmes, les personnes queer et les minorités ethniques non persanes. Cela est dû non seulement à l’effondrement du rial iranien après la guerre de douze jours, mais aussi à la dégradation des services sociaux de base, notamment des coupures répétées d’électricité ; à une crise environnementale croissante (pollution de l’air, sécheresse, déforestation et mauvaise gestion des ressources en eau) ; et à des exécutions massives (au moins 2 063 personnes en 2025) — tout cela ayant combiné pour aggraver les conditions de vie.
La crise de la reproduction sociale est le point central des manifestations actuelles, et leur horizon ultime est la reconquête de la vie.
Ce soulèvement constitue la cinquième vague d’une chaîne de protestations commencée en décembre 2017 avec le soulèvement connu sous le nom de « Révolte du pain ». Elle s’est poursuivie avec le soulèvement sanglant de novembre 2019, une explosion de colère populaire contre la hausse du prix du carburant et l’injustice. La révolte de 2021 a été qualifiée de « soulèvement des assoiffés », initiée et menée par des minorités ethniques arabes. Cette vague a culminé avec le soulèvement « Femme, Vie, Liberté » en 2022, qui a mis en avant les luttes pour l’émancipation des femmes et les luttes anticoloniales des nations opprimées telles que les Kurdes et les Baloutches, ouvrant de nouveaux horizons. Le soulèvement actuel recentre à nouveau la crise de la reproduction sociale — cette fois, sur un terrain plus radical, post-guerre. Les protestations qui commencent par des revendications de subsistance, mais avec une rapidité frappante, s’attaquent aux structures du pouvoir et à l’oligarchie corrompue.
II. Un soulèvement assiégé par des menaces extérieures et intérieures
Les manifestations en cours en Iran sont assiégées de tous côtés par des menaces à la fois extérieures et intérieures. Un jour seulement avant l’assaut impérialiste des États-Unis sur le Venezuela, Donald Trump, drapé dans le langage du « soutien aux manifestants », a lancé un avertissement : si le gouvernement iranien « tue des manifestants pacifiques, ce qui est sa coutume, les États-Unis d’Amérique viendront à leur secours. Nous sommes prêts, armés et prêts à passer à l’action ». C’est le plus vieux scénario de l’impérialisme, utilisant le discours du « sauvetage de vies » pour légitimer la guerre — qu’il s’agisse de l’Irak ou de la Libye. Les États-Unis suivent encore ce scénario aujourd’hui : en 2025 seulement, ils ont lancé des attaques militaires directes contre sept pays.
Le gouvernement génocidaire israélien, ayant précédemment mené son assaut de douze jours contre l’Iran sous le nom de « Femme, Vie, Liberté », écrit désormais en persan sur les réseaux sociaux : « Nous sommes avec vous, manifestants ». Les monarchistes, bras local du sionisme, qui ont assumé la honte d’avoir soutenu Israël pendant la Guerre de douze jours, tentent désormais de se présenter à leurs maîtres occidentaux comme la seule alternative. Ils y parviennent par une représentation sélective et une manipulation de la réalité, lançant une campagne numérique pour s’approprier les manifestations, fabriquer, déformer et altérer le son des slogans de rue en faveur du monarchisme. Cela révèle leur duplicité, leurs ambitions monopolistiques, leur puissance médiatique, et surtout leur faiblesse à l’intérieur du pays, car ils manquent de pouvoir matériel en Iran. Avec le slogan « Make Iran Great Again », ce groupe a salué l’opération impérialiste de Trump au Venezuela et attend désormais l’enlèvement des dirigeants de la République islamique par des tueurs à gages américains et israéliens.
Et bien sûr, il y a les pseudo-gauchistes campistes — les soi-disant « anti-impérialistes » — qui blanchissent la dictature de la République islamique en lui collant un masque anti-impérialiste. Ils remettent en cause la légitimité des manifestations actuelles en répétant l’accusation éculée que « se soulever dans ces conditions, c’est jouer le jeu de l’impérialisme », car ils ne peuvent lire l’Iran qu’à travers le prisme du conflit géopolitique — comme si chaque révolte n’était qu’un projet déguisé des États-Unis et d’Israël. Ce faisant, ils nient la subjectivité politique du peuple iranien et accordent à la République islamique une immunité discursive et politique alors qu’elle massacre et réprime sa propre population.
« En colère contre l’impérialisme » mais « effrayés par la révolution » — pour reprendre la formulation fondatrice d’Amir Parviz Puyan — leur posture est une forme d’anti-réaction réactionnaire. On nous dit même de ne pas écrire sur les récentes manifestations, tueries et répressions en Iran dans une autre langue que le persan dans les espaces internationaux, de peur de fournir un « prétexte » aux impérialistes — comme s’il n’existait, au-delà du persan, aucun peuple dans la région ou dans le monde capable de destins partagés, d’expériences communes, de liens et de solidarité dans la lutte. Pour les campistes, il n’existe pas de sujet autre que les gouvernements occidentaux, et aucune réalité sociale autre que la géopolitique.
Face à ces ennemis, nous affirmons la légitimité de ces manifestations — sur l’intersection des oppressions, et sur le destin partagé des luttes. Le courant monarchiste réactionnaire s’étend au sein de l’opposition d’extrême droite iranienne, et la menace impérialiste contre les populations en Iran — y compris le danger d’intervention étrangère — est réelle. Mais tout aussi réelle est la fureur populaire, forgée à travers quatre décennies de répression brutale, d’exploitation et du « colonialisme interne » de l’État contre les communautés non persanes.
Nous n’avons pas le choix que d’affronter ces contradictions telles qu’elles sont. Ce que nous voyons aujourd’hui, c’est une force insurgée qui monte des profondeurs de l’enfer social iranien : des gens risquant leur vie pour survivre, confrontant de front la machine de répression.
Nous n’avons pas le droit d’utiliser la menace extérieure comme prétexte pour nier la violence infligée à des millions de personnes en Iran — ou de nier le droit de se lever contre elle.
Ceux qui descendent dans la rue sont fatigués des analyses abstraites, simplistes et paternalistes. Ils luttent au cœur des contradictions : ils vivent sous les sanctions tout en subissant le pillage d’une oligarchie nationale. Ils craignent la guerre, et ils craignent la dictature intérieure. Mais ils ne restent pas paralysés par la peur. Ils insistent pour être des sujets actifs de leur propre destin — et leur horizon, au moins depuis décembre 2017, n’est plus la réforme, mais la chute de la République islamique.
III. L’extension de la révolte
Les protestations ont été déclenchées par l’effondrement du rial — éclatant d’abord parmi les commerçants de la capitale, notamment dans les marchés de téléphones mobiles et d’ordinateurs — mais elles se sont rapidement étendues à un soulèvement large et hétérogène qui a entraîné les travailleurs salariés, les vendeurs ambulants, les porteurs et les employés de service dans l’économie marchande de Téhéran. La révolte s’est ensuite rapidement étendue des rues de Téhéran aux universités et à d’autres villes, notamment des plus petites, qui sont devenues l’épicentre de cette vague de protestation.
Dès le départ, les slogans visaient l’ensemble de la République islamique. Aujourd’hui, la révolte est portée avant tout par les pauvres et les dépossédés : jeunes, chômeurs, populations excédentaires, travailleurs précaires et étudiants.
Certains ont rejeté les protestations parce qu’elles ont commencé dans le Bazar (l’économie marchande de Téhéran), souvent perçu comme allié du régime et symbole du capitalisme commercial. Ils ont qualifié les protestations de « petite-bourgeoises » ou « liées au régime ». Ce réflexe rappelle les premières réactions au mouvement des Gilets jaunes en France en 2018 : parce que la révolte émergeait en dehors des « classes ouvrières traditionnelles » et des réseaux de gauche reconnus, et parce qu’elle portait des slogans contradictoires, beaucoup se sont empressés de la déclarer vouée à l’échec réactionnaire.
Mais le point de départ d’un soulèvement ne détermine pas où il va. Son origine ne prédétermine pas sa trajectoire. Les manifestations actuelles en Iran auraient pu être ravivées par n’importe quelle étincelle, pas seulement le Bazar. Ici aussi, ce qui a commencé dans le Bazar s’est rapidement propagé aux quartiers des classes populaires à travers tout le pays.

IV. La géographie de la révolte
Si le cœur battant du « Jin, Jiyan, Azadi » en 2022 battait dans les régions marginalisées — Kurdistan et Baloutchistan — aujourd’hui, les petites villes de l’ouest et du sud-ouest sont devenues les nœuds centraux de l’agitation : Hamadan, Lorestan, Kuhgilouyeh-et-Boyer-Ahmad, Kermanshah et Ilam. Les minorités Lor, Bakhtiari et Lak dans ces régions sont doublement broyées par les crises superposées de la République islamique : la pression des sanctions et l’ombre de la guerre, la répression ethnique et l’exploitation, et la destruction écologique qui menace leurs vies — surtout à travers le Zagros. C’est dans la même région que Mojahid Korkor (un manifestant lor pendant le soulèvement de Jina/Mahsa Amini) a été exécuté par la République islamique un jour avant l’assaut israélien, et où Kian Pirfalak, un enfant de neuf ans, a été tué par des tirs à balles réelles des forces de sécurité pendant le soulèvement de 2022.
Néanmoins, contrairement au soulèvement de Jina — qui dès le départ s’est étendu consciemment le long des lignes de fracture de genre/sexualité et ethniques — l’antagonisme de classe est plus explicite dans les manifestations récentes, et jusqu’à présent, leur diffusion suit une logique plus de masse.
Entre le 28 décembre et le 4 janvier 2025, au moins 17 personnes ont été tuées par les forces répressives de la République islamique à l’aide d’armes à feu et de fusils à plombs — la plupart étaient Lor (au sens large, surtout à Lorestan et à Chaharmahal-et-Bakhtiari) et Kurdes (surtout à Ilam et Kermanshah). Des centaines ont été arrêtées (au moins 580 personnes, dont au minimum 70 mineurs) ; des dizaines ont été blessées. Alors que les manifestations progressent, la violence policière s’intensifie : le septième jour à Ilam, les forces de sécurité ont fait irruption à l’hôpital Imam-Khomeini pour arrêter les blessés ; à Birjand, elles ont attaqué un dortoir d’étudiantes. Le bilan des morts continue d’augmenter à mesure que le soulèvement s’approfondit, et les chiffres réels sont certainement supérieurs à ceux annoncés.
La répartition de cette violence est bien sûr inégale : la répression est plus sévère dans les petites villes — surtout dans les communautés marginalisées et minoritaires poussées à la périphérie. Les tueries sanglantes à Malekshahi à Ilam et à Jafarabad à Kermanshah témoignent de cette disparité structurelle dans l’oppression et la répression.
Le quatrième jour de protestation, le gouvernement — coordonnant ses institutions — a annoncé des fermetures généralisées dans 23 provinces sous prétexte de « froid » ou de « pénurie d’énergie ». En réalité, il s’agissait d’une tentative de briser les circuits par lesquels la révolte se propage — Bazar, université, rue. Parallèlement, les universités ont de plus en plus déplacé les cours en ligne pour couper les liens horizontaux entre les espaces de résistance.
V. L’impact de la guerre de douze jours
Après la guerre de douze jours, le pouvoir dirigeant en Iran — cherchant à compenser son autorité effondrée — s’est tourné plus ouvertement vers la violence. Les attaques d’Israël contre les sites militaires et les civils iraniens ont encore plus militarisé et sécurisé l’espace politique et social, notamment via la campagne raciste d’expulsion massive des immigrants afghans. Et tandis que l’État parle sans cesse au nom de la « sécurité nationale », il est devenu lui-même un producteur central d’insécurité : une insécurité accrue de la vie à travers une augmentation sans précédent des exécutions, le traitement systématique des prisonniers, et une insécurité économique accrue à travers la réduction brutale des moyens de subsistance.
La guerre de douze jours — suivie de sanctions accrues des États-Unis et de l’UE et de l’activation du mécanisme de snapback du Conseil de sécurité des Nations unies — a accru la pression sur les revenus pétroliers, le secteur bancaire et financier, étouffant les entrées de devises étrangères et aggravant la crise budgétaire.
Du 24 juin 2025, date de la fin de la guerre, jusqu’au soir où les premières protestations ont éclaté dans le Bazar de Téhéran le 18 décembre, le rial a perdu environ 40 % de sa valeur. Ce n’était pas une « fluctuation naturelle » du marché. C’était le résultat combiné de sanctions croissantes et de l’effort délibéré de la République islamique de transférer les effets de la crise d’en haut vers le bas, par la dévaluation gérée de la monnaie nationale.
Les sanctions doivent être condamnées sans condition. Dans l’Iran d’aujourd’hui, cependant, elles fonctionnent aussi comme un instrument du pouvoir de classe interne. Les devises étrangères sont de plus en plus concentrées entre les mains d’une oligarchie militaro-sécuritaire qui profite de la contournement des sanctions et d’un courtage opaque du pétrole. Les revenus d’exportation sont en effet pris en otage, libérés dans l’économie formelle seulement à certains moments, à des taux manipulés. Même lorsque les ventes de pétrole augmentent, les recettes circulent au sein d’institutions quasi-étatiques et d’un « État parallèle » (surtout le Corps des gardiens de la révolution islamique), plutôt qu’elles n’entrent dans la vie quotidienne des gens.
Pour couvrir le déficit provoqué par la chute des revenus et le blocage des retours, l’État recourt à la suppression des subventions et à l’austérité. Dans ce cadre, la chute soudaine du rial devient un outil fiscal : elle force la remise en circulation de la devise « en otage » aux conditions de l’État et élargit rapidement les ressources en rials du gouvernement — puisque l’État lui-même est parmi les plus grands détenteurs de dollars. Le résultat est un prélèvement direct sur les revenus des classes inférieures et moyennes, et le transfert des profits du contournement des sanctions et de la rente monétaire vers une minorité étroite — creusant la division de classe, l’instabilité de subsistance et la colère sociale. En d’autres termes, le coût des sanctions est payé directement par les classes inférieures et les couches moyennes en voie de rétrécissement.
L’effondrement de la monnaie nationale doit donc être compris comme un pillage organisé par l’État dans une économie marquée par la guerre et étouffée par les sanctions : une manipulation délibérée du taux de change en faveur des réseaux de courtage liés à l’oligarchie dirigeante, au service d’un État qui a fait de la libéralisation néolibérale des prix une doctrine sacrée.
Les pseudo-gauchistes campistes réduisent la crise aux sanctions américaines et à l’hégémonie du dollar, effaçant le rôle de la classe dirigeante de la République islamique en tant qu’acteur actif de la dépossession et de l’accumulation financiarisée. Les campistes de droite, généralement alignés sur l’impérialisme occidental, blâment uniquement la République islamique et traitent les sanctions comme sans importance. Ces positions se reflètent l’une l’autre — et chaque camp a des intérêts clairs à les adopter. Contre les deux, nous insistons sur la reconnaissance de l’entrelacement du pillage et de l’exploitation globaux et locaux. Oui, les sanctions dévastent la vie des gens — par la pénurie de médicaments, la disparition de pièces industrielles, le chômage et l’érosion psychologique — mais le fardeau est socialisé sur le peuple, et non sur l’oligarchie militaro-sécuritaire qui amasse une richesse énorme en contrôlant les circuits informels de la monnaie et du pétrole.

VI. Les contradictions
Dans la rue, des slogans contradictoires sont entendus, allant des appels à renverser la République islamique à des appels nostalgiques en faveur de la monarchie. En même temps, les étudiants scandent des slogans ciblant à la fois le despotisme de la République islamique et l’autocratie monarchique. Les slogans pro-Shah et pro-Pahlavi reflètent de véritables contradictions sur le terrain — mais ils sont aussi amplifiés et fabriqués par des distorsions médiatiques de droite, y compris le remplacement honteux de la voix des manifestants par des slogans monarchistes. Le principal coupable de la manipulation médiatique est Iran International, devenu un porte-voix de la propagande sioniste et monarchiste. Son budget annuel est d’environ 250 millions de dollars, financé par des individus et institutions liés aux gouvernements d’Arabie saoudite et d’Israël.
Au cours de la dernière décennie, la géographie de l’Iran est devenue un champ de tension entre deux horizons socio-politiques, médiés par deux modèles différents d’organisation contre la République islamique. D’un côté se trouve l’organisation sociale concrète, ancrée le long des lignes de fracture de classe, genre/sexualité et ethnicité — le plus vivement illustré par les réseaux interconnectés forgés pendant le soulèvement de Jina en 2022, s’étendant de la prison d’Evin à la diaspora, et produisant une unité sans précédent entre des forces diverses, des femmes aux minorités ethniques kurdes et baloutches, opposées à la dictature tout en proposant des horizons féministes et anticoloniaux. De l’autre côté se trouve une mobilisation populiste mise en scène comme une « révolution nationale », visant à produire une masse homogène d’individus atomisés via des chaînes de télévision par satellite. Soutenue par Israël et l’Arabie Saoudite, cette entreprise cherche à assembler un corps dont la « tête » — le fils du Shah déchu — pourrait ensuite être insérée de l’extérieur, par une intervention étrangère, et greffée dessus. Au cours de la dernière décennie, les monarchistes, armés d’une puissante force médiatique, ont poussé l’opinion publique vers un nationalisme extrême et raciste — creusant les fractures ethniques et fragmentant l’imaginaire politique des peuples d’Iran.
La croissance de ce courant ces dernières années n’est pas un signe de « retard politique » du peuple, mais le résultat du manque d’organisation de gauche étendue et de puissance médiatique pour produire un discours contre-hégémonique alternatif — une absence et une faiblesse en partie causées par la répression et l’étouffement, qui ont ouvert la voie à ce populisme réactionnaire. En l’absence d’un récit puissant de la part des forces de gauche, démocratiques et non nationalistes, même des slogans et idéaux universels comme la liberté, la justice et les droits des femmes peuvent facilement être récupérés par les monarchistes et revendus au peuple dans une enveloppe apparemment progressiste qui cache un noyau autoritaire. Dans certains cas, cela est même emballé dans un vocabulaire socialiste — c’est précisément là que l’extrême droite dévore aussi le terrain de l’économie politique.
En même temps, à mesure que l’antagonisme avec la République islamique s’intensifie, les tensions entre ces deux horizons et modèles se sont également intensifiées ; aujourd’hui, la division entre eux peut être vue dans la répartition géographique des slogans de protestation. Puisque le projet de « retour de Pahlavi » représente un horizon patriarcal basé sur le nationalisme ethnique perse et une orientation profondément réactionnaire, dans les lieux où l’organisation ouvrière et féministe de base a émergé — dans les universités et dans les régions kurdes, arabes, baloutches, turkmènes, arabes et turques — les slogans pro-monarchie sont largement absents et provoquent souvent des réactions négatives. Cette situation contradictoire a conduit à diverses formes de malentendus du récent soulèvement.
VII. L’horizon
L’Iran se trouve à un moment historique décisif. La République islamique est à l’un de ses points les plus faibles de l’histoire — internationalement, après le 7 octobre 2023 et l’affaiblissement du soi-disant « axe de résistance », et intérieurement, après des années de soulèvements répétés. L’avenir de cette nouvelle vague reste incertain, mais l’ampleur de la crise et la profondeur du mécontentement populaire garantissent qu’une autre vague de protestation peut éclater à tout moment. Même si le soulèvement actuel est réprimé, il reviendra. Dans ce contexte, toute intervention militaire ou impérialiste ne pourrait qu’affaiblir la lutte d’en bas et renforcer la main de la République islamique pour mener des répressions.
Au cours de la dernière décennie, la société iranienne a réinventé l’action politique collective d’en bas. Du Baloutchistan et du Kurdistan lors du soulèvement de Jina aux petites villes de Lorestan et d’Ispahan dans la vague de protestation actuelle, l’agence politique — sans aucune représentation officielle d’en haut — s’est déplacée vers la rue, les comités de grève et les réseaux locaux informels. Malgré la répression brutale, ces capacités et connexions restent vivantes dans la société ; leur capacité à revenir et à se cristalliser en pouvoir politique persiste. Mais l’accumulation de colère n’est pas la seule chose qui déterminera leur continuité et leur orientation. La possibilité de construire un horizon politique indépendant et une véritable alternative s’avérera aussi décisive.
Cet horizon fait face à deux menaces parallèles. D’une part, il peut être récupéré ou marginalisé par des forces de droite basées à l’extérieur du pays — des forces qui instrumentaliseront la souffrance du peuple pour justifier des sanctions, la guerre ou une intervention militaire. D’autre part, des segments de la classe dirigeante — que ce soit des factions militaro-sécuritaires ou des courants réformistes — travaillent en coulisses pour se vendre à l’Occident comme une option « plus rationnelle », « à moindre coût », « plus fiable » : une alternative interne venant de l’intérieur de la République islamique, non pas pour rompre avec l’ordre existant de domination, mais pour le reconfigurer sous un visage différent. (Donald Trump vise à faire quelque chose de similaire au Venezuela, en pliant des éléments du gouvernement en place à sa volonté plutôt que de provoquer un changement de gouvernement.) C’est un calcul froid de gestion de crise : contenir la colère sociale, recalibrer les tensions avec les puissances mondiales, et reproduire un ordre dans lequel les peuples sont privés de leur autodétermination.
Face à ces deux courants, la renaissance d’une politique internationaliste de libération est plus nécessaire que jamais. Ce n’est pas une « troisième voie » abstraite, mais un engagement à placer les luttes des peuples au centre de l’analyse et de l’action : l’organisation d’en bas plutôt que des scénarios écrits d’en haut par des dirigeants autoproclamés, plutôt que des fausses oppositions fabriquées de l’extérieur. Aujourd’hui, l’internationalisme signifie tenir ensemble le droit des peuples à l’autodétermination et l’obligation de combattre toutes les formes de domination — intérieure et extérieure. Un véritable bloc internationaliste doit être construit à partir de l’expérience vécue, de solidarités concrètes et de capacités indépendantes.
Cela exige la participation active des forces de gauche, féministes, anticoloniales, écologiques et démocratiques pour construire une organisation large, de classe, au sein de la vague de protestation — à la fois pour reconquérir la vie et ouvrir des horizons alternatifs de reproduction sociale. En même temps, cette organisation doit s’inscrire dans la continuité de l’horizon libérateur des luttes précédentes, et spécifiquement du mouvement « Jin, Jiyan, Azadi » — dont l’énergie porte encore le potentiel de perturber, d’un seul coup, les discours de la République islamique, des monarchistes, du Corps des gardiens de la révolution, et de ces anciens réformistes qui rêvent désormais d’une transition contrôlée et d’une réintégration dans les cycles d’accumulation États-Unis-Israël dans la région.
C’est aussi un moment décisif pour la diaspora iranienne : elle peut contribuer à redéfinir une politique de libération, ou elle peut reproduire le binarisme épuisé de la « tyrannie intérieure » contre « l’intervention étrangère » et ainsi prolonger l’impasse politique. Dans ce contexte, il est nécessaire que les forces de la diaspora fassent des pas vers la formation d’un véritable bloc politique internationaliste — un bloc qui trace des lignes claires contre la tyrannie intérieure et la domination impérialiste. Cette position lie l’opposition à l’intervention impérialiste à une rupture explicite avec la République islamique, refusant toute justification de la répression au nom de la lutte contre un ennemi extérieur.

02.01.2026 à 04:06
Se battre c’est se souvenir : Le 18 janvier : journée des défenseur·e·s des forêts
CrimethInc. Ex-Workers Collective
Texte intégral (1262 mots)

Trois années se sont écoulées depuis que les policiers de l’État de Géorgie Jerry Parrish, Bryland Myers, Jonathan Salcedo, Ronaldo Kegel, Royce Zah, et Mark Jonathan Lamb sont entrés dans la forêt de Weelaunee, au sud-est d’Atlanta, armes à la main. Ils ont tué par balle Manuel Teran, connu par ses compagnes et compagnons défenseur·e·s de la forêt sous le nom de Tortuguita. Aujourd’hui, la lutte continue contre les mêmes formes d’oppression, animée par l’esprit de Tortuguita. Le passé ne passe pas.
Ceci est un appel à passer à l’action à l’occasion de l’anniversaire de cette tragédie.
Ce 18 janvier, passez à l’action en mémoire de Tortuguita et de toutes celles et ceux tombé·e·s pour la défense de la Terre. Organisez une marche, un rassemblement ou une veillée. Regroupez-vous avec des ami·e·s, des camarades, en famille pour faire votre deuil, guérir et devenir plus fort ensemble. Planifiez une session d’information pour celles et ceux qui vivent en cavale, assiégé·e·s ou sous surveillance. Animez une session de cartographie du pouvoir sur un commissariat local, un centre de détention ou un réseau de surveillance. Organisez une randonnée dans un parc public ou une forêt et engagez-vous à défendre ces endroits contre leur destruction.

Téléchargez cette image pour la partager largement.
Après le meurtre de Tortuguita, des milliers de personnes ont rejoint le mouvement pour lequel Tortuguita a donné sa vie — le mouvement pour arrêter Cop City et abolir la police. Les membres de la communauté se sont rassemblés pour pleurer, se soutenir l’un l’autre et faire leur deuil — mais aussi pour répliquer. Ils ont bloqué des routes, allumé des feux, brisé des vitres et incendié des véhicules de police. Au cours des mois suivants, le mouvement a porté des coups décisifs aux fournisseurs et donateurs de la Fondation pour la police d’Atlanta à un rythme quotidien. Le 5 mars 2023, des centaines de personnes ont envahi le chantier de construction de Cop City en chantant « Viva, Viva Tortuguita ». Ils ont lancé des feux d’artifice, des pierres et des cocktails Molotov sur la police et saccagé le chantier.
Un an plus tard, à travers tout le pays, des centaines de personnes se sont réunies pour des assemblées, des échanges ou des veillées afin de se souvenir de Tortuguita et des autres personnes tombées pour la défense de notre planète. Alors que le chaos climatique, engendré par la combustion d’énergies fossiles, continue de déséquilibrer les systèmes vitaux autour du globe, de plus en plus de gens sont forcés d’émigrer vers d’autres territoires plus sûrs, plus calmes. Au sein du noyau privilégié de cette société capitaliste mondiale, nous ne ressentons pas souvent directement l’effondrement des systèmes vitaux. À l’inverse, nous sommes témoins de l’inflation, de licenciements et des pénuries. Nous assistons à des guerres et des massacres causés par l’instabilité engendrée par l’effondrement du niveau de vie et une compétition accrue entre hommes forts pour contrôler les ressources rares.
Aujourd’hui, les USA et ses alliés sont de véritables nations policières. Flock Safety, une entreprise autrefois uniquement connue des activistes surveillant les alentours de la forêt de Weelaunee, a déployé dans le pays entier des scanners de plaques d’immatriculation dopés à l’IA. Ils se sont associés aux bigots et aux autorités fédérales pour pister des immigrants sans papiers, des femmes nécessitant un avortement et des dissidents.
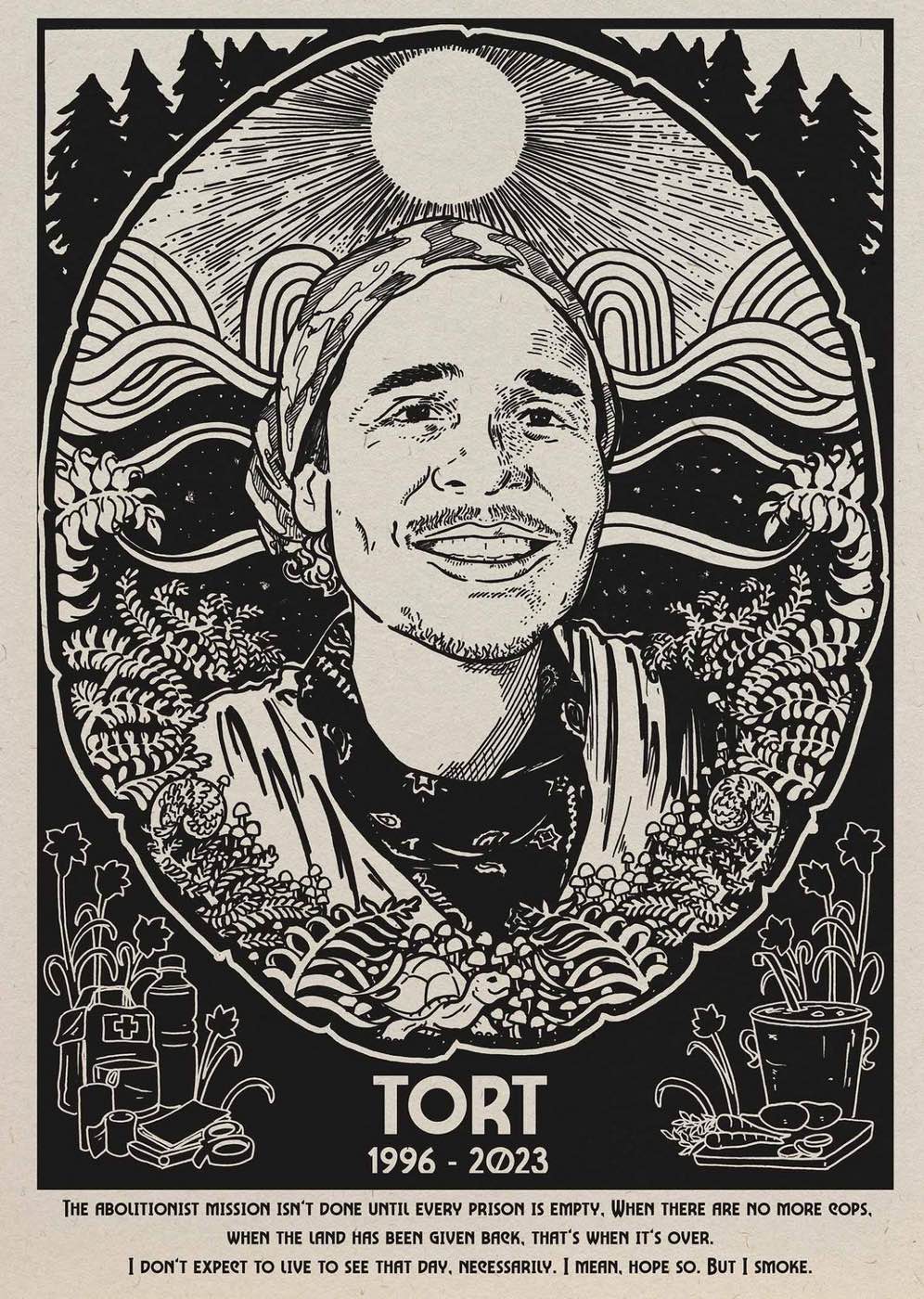
Tort 1996–2023
Celles et ceux qui agissent contre l’émergence d’un État autocratique font face aux mêmes mesures draconiennes et accusations criminelles que celles auxquelles ont été confrontées Tortuguita et les manifestant·e·s se battant contre Cop City. En témoignent les défenseur·e·s de la Prairie qui sont emprisonné·e·s depuis le 4 juillet, fouillé·e·s au corps tous les jours, en isolement et sans accès aux traitements médicaux, identifié·e·s comme terroristes par le FBI. Elles et ils sont accusé·e·s d’avoir manifesté devant un centre de détention pour migrants.
Nous pouvons arrêter cette spirale infernale dans l’autocratie. Pour ce faire, nous aurons besoin de puiser dans nos liens communautaires profonds, dans nos souvenirs et nos exemples de bravoure, de courage, et de grâce face à l’adversité et la tyrannie.
Se battre c’est se souvenir.

Téléchargez un PDF à imprimer et partager.
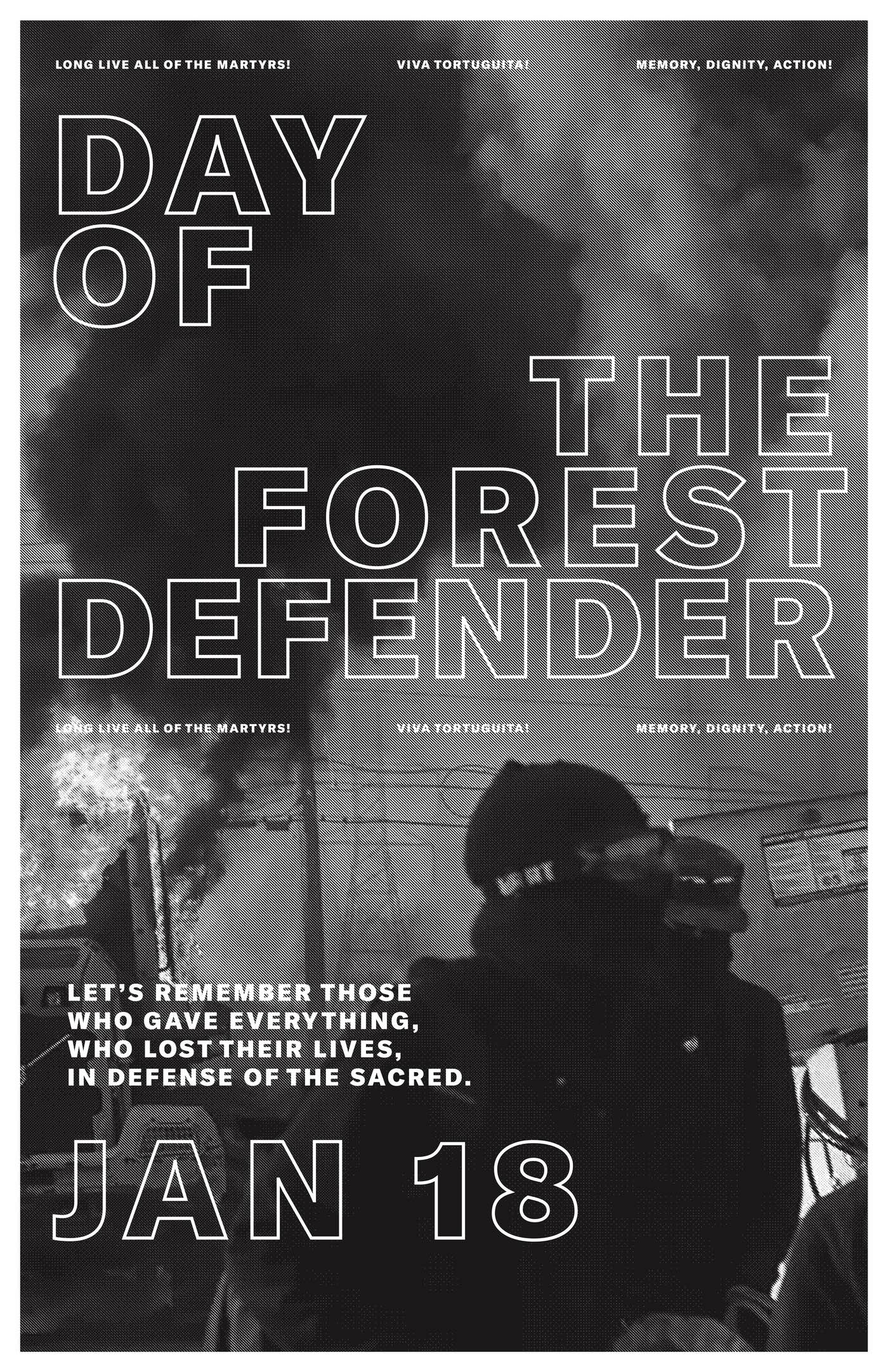
Téléchargez un PDF à imprimer et partager. |

|
Annexe : quelques événements annoncés

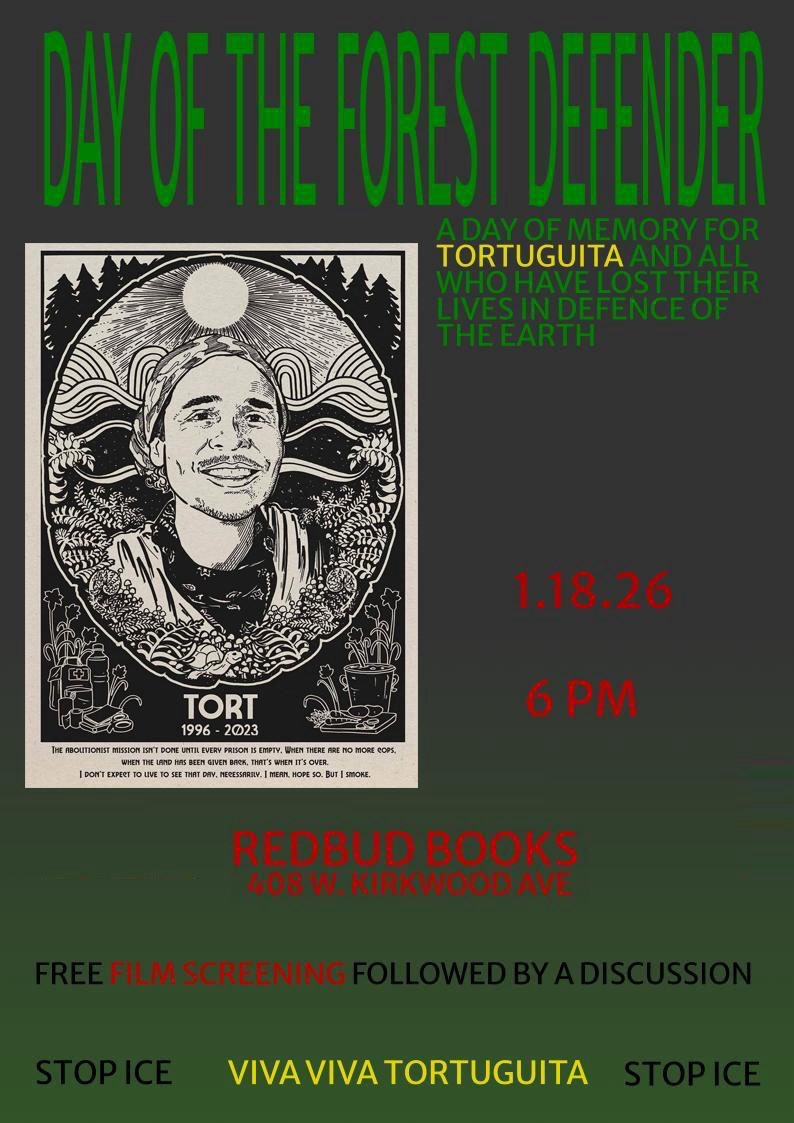
Bloomington, Indiana.


Oakland, Californie.

St. Paul, Minnesota.
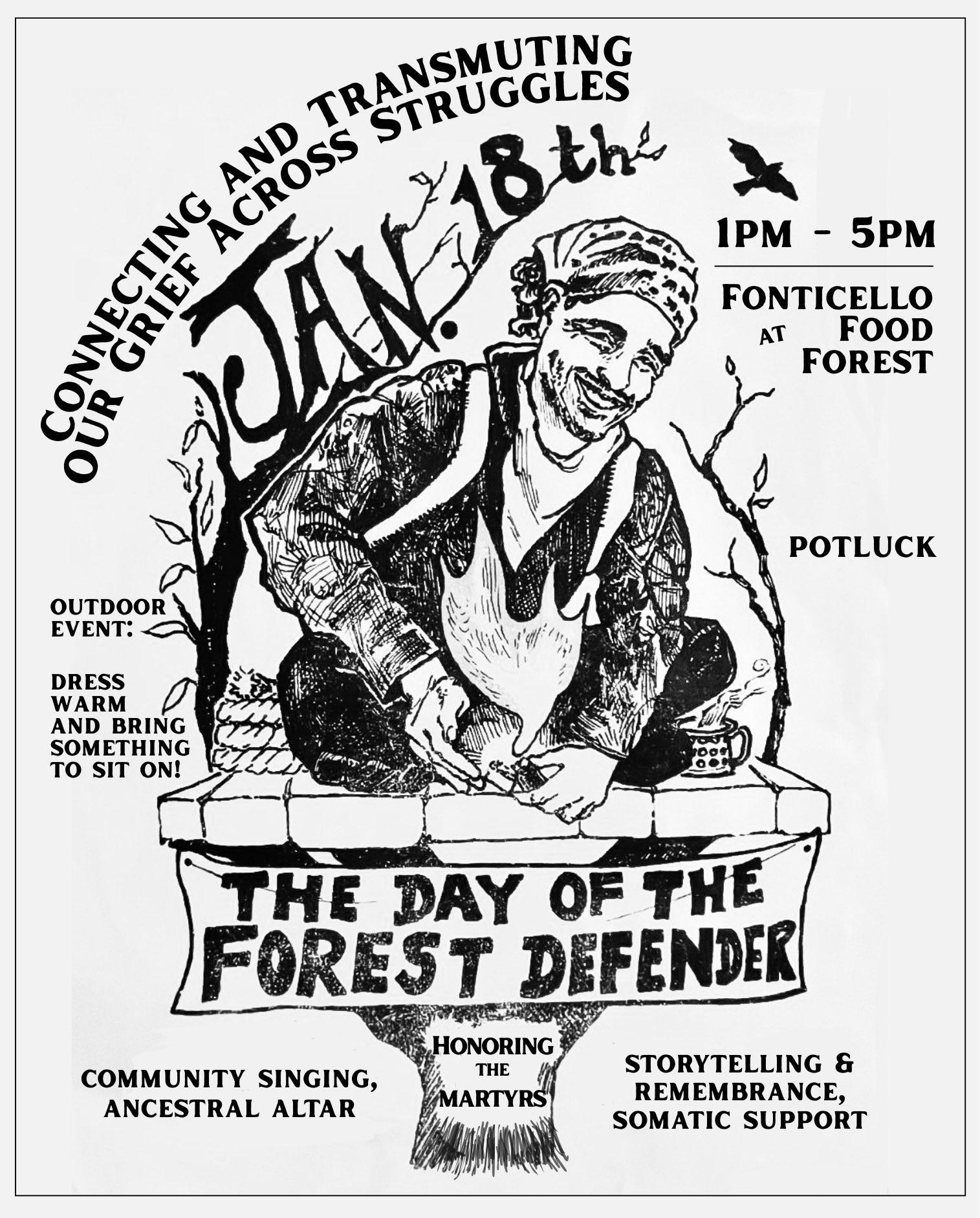
Richmond, Virginia. |

|
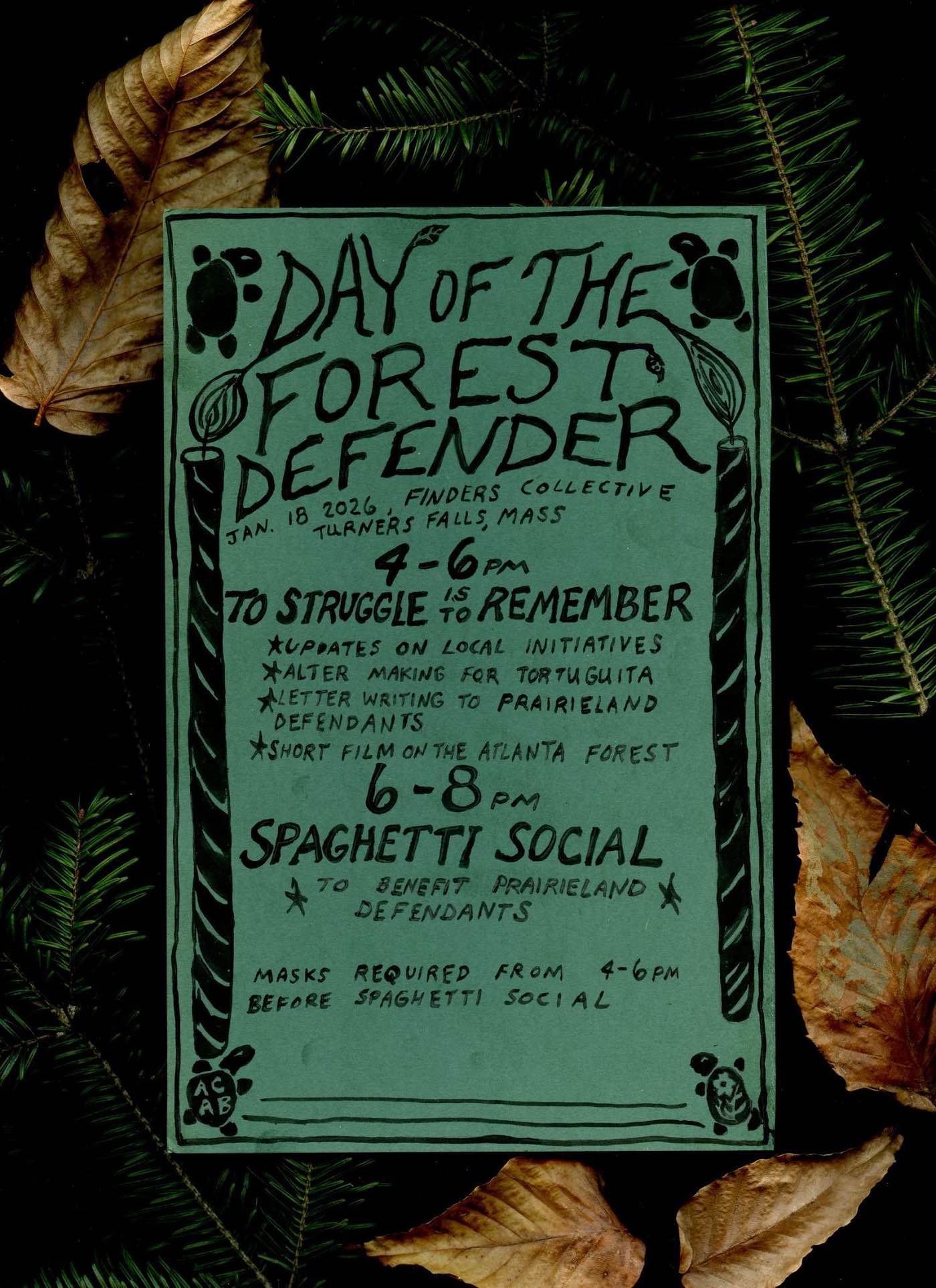
Turner Falls, Massachusetts.
13.10.2025 à 23:35
Maroc : le soulèvement de la Génération Z 212 : Une interview
CrimethInc. Ex-Workers Collective
Texte intégral (5824 mots)

Depuis la destitution du président du Sri Lanka en 2022 et le soulèvement de 2024 au Bangladesh, une nouvelle vague révolutionnaire a commencé à se propager à travers le monde, prenant de l’ampleur avec le soulèvement en Indonésie en août 2025 et l’insurrection au Népal en septembre. Depuis lors, d’intenses manifestations ont éclaté au Pérou, aux Philippines, à Madagascar, au Maroc et ailleurs. Pour mieux comprendre les diverses formes que prend cette vague d’activité dans différentes parties du monde, nous avons discuté avec deux participantes au mouvement Gen Z 212 au Maroc.
Tout d’abord, à qui nous adressons-nous ? Partagez avec nous tout ce que vous pouvez nous dire en toute sécurité sur qui vous êtes, ce que vous faites et quelle est votre place dans la société marocaine et au sein des mouvements sociaux.
Nous sommes Yousra et Qamar, des militantes féministes basées à Casablanca. Qamar commence également à enseigner à l’université et Yousra travaille comme employée de bureau à Kénitra. Nous sommes toutes deux impliquées dans un réseau féministe et queer qui couvre l’ensemble du pays. Ce réseau sert principalement de base pour la solidarité matérielle et l’entraide collective, de plateforme de politisation, de mobilisation et de défense des droits.
Alors que Qamar était active pendant le soulèvement de 2011, Yousra, elle, était encore un peu trop jeune pour cela. En plus de participer à la plateforme d’organisation et aux manifestations, nous travaillons actuellement pour pouvoir obtenir une aide juridique et médicale pendant l’insurrection en cours.
Avant de répondre au reste des questions, nous tenons à faire quelques mises en garde. Cette insurrection est très récente et quiconque prétend avoir une lecture ou une analyse claire de ce qui est en train de se passer ment et ce, même si nous sommes très proches des événements.
Comment comprenez-vous ce qui se passe actuellement au Maroc ? Pouvez-vous nous donner quelques informations sur le contexte de ce soulèvement ?
Ce qui se passe actuellement est la conséquence naturelle d’une série de décisions politiques catastrophiques prises par un système qui est fondamentalement contre le peuple. Pour replacer les choses dans leur contexte, le Maroc est un pays où les différences et les violences entre classes sociales sont très marquées, où le secteur public (hôpitaux, écoles et autres institutions similaires) est moribond et où la classe moyenne est appauvrie. De plus, la tranche d’âge la plus importante du pays est celle représentée par les jeunes, et plus d’un tiers d’entre nous est au chômage. Lorsque tu trouves un emploi en tant que jeune, il s’agit souvent d’un emploi non déclaré, qui ne te donne pas accès au système social qui est déjà très limité. Pourtant, ce pays, profondément en crise et dépourvu de services publics, est censé accueillir la Coupe d’Afrique des nations 2025 et la Coupe du monde 2030.
Comme le dit le chant : « Vous avez construit des stades et oublié les habitant.e.s d’Al-Haouz. »

Camps au Maroc.

Stade au Maroc.
Plusieurs éléments ont déclenché ce mouvement. Tout d’abord, comme cela a été dit à maintes reprises, huit femmes sont décédées à Agadir au cours de césariennes pratiquées dans le même hôpital en l’espace d’un mois seulement. Cela a donné lieu aux premières manifestations contre la Coupe du monde, manifestations réclamant de meilleurs services de santé. Ensuite, il y a eu l’inauguration et la mise en avant d’un nouveau stade de football dernier cri à l’occasion du deuxième anniversaire du tremblement de terre d’Al-Haouz, près de Marrakech, où de nombreuses victimes qui ont perdu leur maison vivent toujours sur place dans des tentes et des camps. C’est dire à quel point celles et ceux au pouvoir s’en moquent. Cela a clairement montré les priorités de l’État et, tandis que la population était choquée par ces décisions politiques, les machines de propagande jacassaient à propos de certains objets culturels qu’elles avaient réussi à classer comme étant marocains à l’UNESCO. Comme si cela nous intéressait ! Nous avons donc inventé un nouveau terme pour désigner ce nationalisme chauvin, fasciste et esthétique qui refuse de voir ce qui se passe dans notre pays : « Zlayji », en référence au zellige auquel ils accordaient tant d’importance.
Enfin, il y a eu la libération temporaire du leader du mouvement Rif Hirak de 2017, Nasser Zefzafi. Il est le leader du mouvement pacifiste Riffi (les Riffis sont les Amazighs de la région nord, nommés d’après les montagnes du Rif) qui réclamait moins d’exclusion et un meilleur accès aux hôpitaux, à l’éducation et à l’emploi. Nasser Zefzafi purge actuellement une peine de 20 ans de prison et refuse de signer les documents lui permettant d’accepter la grâce royale, ce qui lui accorderait la liberté en échange d’« excuses publiques pour avoir incité à un mouvement séparatiste ». Il a été temporairement libéré pour les funérailles de son père et son discours a beaucoup ému les gens. Celles et ceux d’entre nous qui appartiennent à la génération Z étaient très jeunes lorsque le mouvement Rif a éclaté. Lorsque des dizaines de vidéos du mouvement de 2017 ont circulé, nous avons compris qu’ils et elles se battaient pour la même cause que nous et avons décidé de nous inspirer de ce mouvement. Aujourd’hui, nous réclamons à grands cris la libération de Zefzafi et de tou.te.s les manifestant.e.s Riffi de toutes les villes du Maroc.

Le mouvement du Rif au Maroc.
Et alors que tout semblait sombre ici, nos écrans ont commencé à se remplir d’images, de vidéos et d’articles sur la révolution népalaise. On peut affirmer sans risque de se tromper que sans le Népal, la jeunesse marocaine ne se serait pas soulevée comme elle l’a fait. Ainsi, lorsque la première manifestation du corps médical a éclaté à Agadir, les individus ont commencé à s’organiser. C’était deux semaines avant les premières manifestations des 27 et 28 septembre derniers.
Nous avons commencé à nous organiser principalement via Discord, qui était auparavant utilisé en grande majorité pour les jeux vidéo ou pour travailler sur des projets de groupe pour l’école ou l’université. Nous avons également continué à créer des vidéos et du contenu sur d’autres plateformes telles que TikTok et Instagram afin d’inciter les personnes à rejoindre la plateforme d’organisation sur Discord. Celle-ci offrait anonymat et décentralisation. J’ai rejoint le mouvement à ses débuts, lorsque Discord ne comptait que 1 000 membres ; aujourd’hui, il en compte plus de 200 000. Il a été lancé principalement par des jeunes défavorisé.e.s, des étudiant.e.s, des jeunes adultes qui ne trouvent pas d’emploi, etc. afin d’organiser des manifestations simultanées dans toutes les villes du pays. Avant les manifestations, nous avons commencé à discuter ouvertement de la manière de nous organiser (centralisation ou décentralisation, pacifisme ou « violence », création ou non d’une organisation au sens strict du terme) et avons invité des journalistes marocain.e.s spécialisé.e.s dans le domaine de la corruption ainsi que des personnes ayant participé au 20 février (nom donné au soulèvement de 2011 au Maroc).
Quant aux revendications principales, elles ont toujours été claires : de meilleurs hôpitaux et une meilleure éducation, la fin de la corruption et de la Coupe du monde 2030, plus d’emplois, et la chute de notre gouvernement et des élites riches. Il est important de noter que l’actuel Premier ministre est l’un des hommes les plus riches du Maroc. Il est milliardaire (en dollars américains) et est responsable de l’aggravation de la crise de l’eau dans notre pays lorsqu’il a introduit un plan visant à… planter des pastèques et des avocats dans le désert. De nombreuses zones rurales n’ont pas accès à l’eau potable, mais le plan n’a pas été réformé et les lecteurs en France ou en Espagne peuvent manger ces pastèques et ces avocats quand bon leur semble.
Bien que la demande de chute du gouvernement ait toujours été présente, elle est devenue de plus en plus importante à mesure que la répression s’intensifiait. Dès les premiers jours, des dizaines puis des centaines de personnes innocentes et pacifistes ont été placées en détention préventive, y compris des parents avec leurs enfants. Nous avons été frappé.e.s avec une violence et une haine insensées ; certaines femmes ont été contraintes de retirer leur hijab. Le quatrième jour, la police a écrasé des personnes à Oujda, laissant un jeune homme dans un état critique. Le lendemain, à Agadir, des personnes ont été touchées par des balles réelles, y compris des mineurs. Il y a eu trois martyrs et une douzaine de blessés rien qu’à cause des balles. À Marrakech, ils sont venus avec des chars et ont placé près de la moitié des jeunes de la ville en détention provisoire. Certain.e.s ont été libéré.e.s, mais d’autres attendent toujours leur procès, risquant jusqu’à 20 ans de prison. Tout cela est justifié par la machine de propagande de l’État en l’absence d’une presse libre.

Photo de Yassine Toumi.
Quelles sont les différentes forces qui s’affrontent au sein du mouvement et qui s’opposent à celui-ci ?
Les forces au sein du mouvement sont variées. Il s’agit principalement de jeunes privé.e.s de leurs droits, mais aussi de personnes déçues non seulement par tous les partis politiques, mais aussi par toutes les organisations et associations. La mobilisation est principalement menée par des réseaux informels. Comme il s’agit d’un mouvement à grande échelle, ceux-ci sont en concurrence dans tous les domaines, par exemple en matière de conservatisme culturel ou de collaboration avec d’autres organisations ou partis, mais tout est discuté sur Discord. Pour l’instant, le camp le plus conservateur ne l’emporte pas, en raison des tentatives ridicules du gouvernement de détourner l’attention vers la « promotion de l’homosexualité », tentatives qui n’ont pas fonctionné.
Nous nous attendions à recevoir le soutien des ultras (les groupes de supporters de football souvent considérés comme la voix du peuple), mais malheureusement, ils ne se sont pas mobilisés en grand nombre. Quant aux partis politiques, plusieurs partis de gauche et islamistes ont tenté de surfer sur la vague en donnant des tonnes d’interviews et en attirant beaucoup d’attention sur eux pendant les manifestations. Cela a été très mal accueilli par le groupe Genz212, qui y a vu une tentative de détournement du mouvement, d’autant plus qu’après coup, ils en ont fait tonnes au sujet de quelques voitures incendiées et ont très peu parlé des victimes du côté des manifestant.e.s. Les jeunes d’Adl w al ihsan (un groupe salafiste pacifique très actif dans le soutien à la Palestine) ont également commencé à défiler avec nous (notamment à Marrakech et Tanger, par exemple), mais là encore, cela a effrayé beaucoup de personnes, car ils et elles sont en négociation avec l’État pour devenir un parti officiel, et nous avions toujours peur d’être utilisé.e.s. Les récentes manifestations nationales à l’occasion du deuxième anniversaire de l’opération « Al-Aqsa Flood » ont eu lieu avec le peuple et le collectif en tête de cortège ; elles ont été l’occasion de mieux faire comprendre notre mouvement aux autres groupes qui se sont mobilisés.

Les forces de l’ordre répriment les manifestations nationales organisées cette année en solidarité avec la Palestine.
Beaucoup de personnes se sont interrogées sur le rôle du roi du Maroc dans ces événements. L’une des raisons pouvant expliquer la violence immédiate et aveugle de l’État pourrait être que la transition royale aura lieu prochainement et qu’ils ont l’intention de couronner un prince qui n’a même pas 23 ans. Cette période est extrêmement effrayante et fragile pour le régime.
La devise nationale du Maroc est peut-être « Allah, la patrie, le roi », mais l’importance de ces termes aux yeux de l’État est inversée. Les plus grands tabous au Maroc sont 1) le roi, 2) le pays (c’est-à-dire la question du Sahara occidental) et 3) la religion. La plateforme organisatrice a offert un moyen de parler de toutes ces questions sans être expulsé.e. Le mouvement n’est pas contre la monarchie, mais se permet de critiquer et de ridiculiser le roi et ses pouvoirs, ce qui est inacceptable aux yeux de l’État.
Lorsque notre nombre a explosé et que nous avons été confronté.e.s à la répression policière, ces questions structurelles ont naturellement été reléguées en dehors des principaux groupes de discussion. Après la propagande massive à laquelle nous avons été confronté.e.s pour justifier les actions de la police, les individus se sont empressés de défendre le mouvement et de rappeler au public que nous étions descendu.e.s dans la rue pour revendiquer des droits fondamentaux, et non pour changer le régime. Par peur, notre nombre a diminué et certain.e.s manifestant.e.s ont demandé au roi d’intervenir pour se débarrasser du gouvernement et mettre fin à cette folie. Mais à ce moment-là, les personnes dans la rue ont continué à refuser de chanter des chants en son honneur ou de prier pour sa guérison, comme on nous l’avait demandé.
Vendredi dernier, le 10 octobre, le roi a prononcé un discours, mais il n’a pas limogé le gouvernement ni véritablement reconnu les manifestations. Cela est considéré comme un échec temporaire et nous sommes actuellement en train de nous regrouper pour trouver d’autres moyens de nous faire entendre.

Manifestation en solidarité avec la Palestine. Rabat, Maroc, le 5 octobre 2025. Photo : Issam Chorrib.
Pouvez-vous décrire la situation actuelle concernant l’occupation marocaine du Sahara occidental ?
La majorité des réfugié.e.s sahraoui.e.s vivent à Tindouf, dans le Sahara algérien, où elles et ils sont réparti.e.s dans des camps organisés en fonction de leur ville d’origine. C’est également là que se trouve la base du Front Polisario. Le Front Polisario est le principal acteur politique et militaire de la lutte sahraouie, mais il fait l’objet d’une opposition et de critiques de la part du peuple sahraoui depuis le début des années 2000. Il est important de noter qu’il n’a pas garanti la sécurité ni mis en place un cadre démocratique à Tindouf.
Le cessez-le-feu de 1991 qui avait mis fin à la guerre précédente a été déclaré rompu par le Front Polisario en novembre 2020 à la suite d’une opération militaire marocaine près de la ville de Guerguerat. Ce cessez-le-feu accordait au Maroc le contrôle de 80 % du territoire et 20 % au Polisario. Depuis 2020, le Front Polisario revendique occasionnellement avoir pris pour cible des positions marocaines le long du mur de sable. En réalité, les drones militaires marocains ciblent fréquemment les 20 % restants. Bien qu’ils prétendent viser les combattants du Polisario, ces drones frappent souvent des civils parmi la population qui a été contrainte de fuir vers Tindouf.
En ce qui concerne notre mouvement, l’un des premiers sujets que nous avons abordés était le fait que l’annexion du Sahara ne nous avait rien apporté, si ce n’est davantage de censure et de répression policière. La partie marocaine propose un plan d’autonomie dans le cadre de la Constitution pour le Sahara, mais de quelle loi ou Constitution parlons-nous si la police écrase les militant.e.s avec ses voitures ? Nous avons également discuté de la crainte croissante d’un conflit. S’ils nous frappent aujourd’hui, peuvent-ils vraiment s’attendre à ce que nous « défendions les frontières » si besoin ?
Les manifestations ont lieu au Sahara sous une surveillance policière intense. Cela a été applaudi par le Front Polisario sans aucun contact réel avec le mouvement. Certains médias nous ont également accusés d’être en contact avec eux, ce qui est évidemment faux.

Photo de Yassine Toumi.
Pouvez-vous raconter une anecdote tirée de votre expérience personnelle qui illustre bien l’esprit de ces manifestations ?
Les histoires ne sont pas réjouissantes. Nous manifestons principalement à Casablanca, et sommes allé.e.s une ou deux fois à Rabat ou à Kénitra.
Les premiers jours, nous avons surtout été confronté.e.s à la brutalité policière. J’utilise le mot « police » au sens large ; il inclut toutes les forces répressives présentes dans les rues, telles que la Gendarmerie royale et les Forces de sécurité de l’État. J’ai remarqué qu’elles utilisaient principalement deux techniques : la première consiste à charger pour disperser toute forme d’unité, puis elles s’en prennent à nous et commencent à nous combattre à deux contre un ou à quatre contre un, comme dans les bagarres de rue, mais en pire. Nous avons immédiatement pensé à nos ami.e.s et camarades qui avaient été emmené.e.s. Nous savions qu’il y aurait de la répression, mais pas comme ça. Certain.e.s camarades se sont rendu.e.s devant la Cour de justice pour essayer de voir les détenu.e.s et leur offrir une assistance juridique, mais ils et elles ont également été arrêté.e.s.
Puis, nous avons été choqué.e.s de voir des gens se faire écraser ou tirer dessus, et nous avons commencé à agir pour les aider. Après la mort des trois martyrs, le nombre des forces de police a été réduit, à l’exception des agents en civil. À la place, la police est désormais postée dans les quartiers riches et devant les banques. Les manifestant.e.s ont profité de cette occasion pour développer d’autres moyens d’action, comme le boycott et le piratage informatique.
Nous avons lu des articles sur le « collectif Gen Z 212 » dans la presse. Pourriez-vous nous parler de son histoire ? Quel a été son rôle dans les manifestations ?
Gen Z 212 est à la fois la plateforme et le nom de notre mouvement. C’est aussi le nom du profil Discord. Pour les manifestations, il sert de catalyseur : chaque ville ou village dispose de salons de discussion où nous décidons où les manifestations doivent avoir lieu. Récemment, nous nous sommes également organisé.e.s pour venir en aide aux détenu.e.s et aux blessé.e.s. Nous votons sur presque tout. Et il y a souvent des vérifications d’effectuées au sujet des administrateurs et administratrices.

Photo d’Issam Chorrib.
Dans quelle mesure les participant.e.s au mouvement au Maroc se considèrent-iels comme faisant partie d’un mouvement mondial ? Quelles tactiques, méthodes d’organisation et aspirations les Marocain.e.s ont-iels empruntées aux mouvements d’autres régions du monde ?
Le nom « Génération Z » et les tactiques utilisées (organisation numérique décentralisée, culture des mèmes, appels à l’action décentralisés, occupations et sit-in) placent délibérément le mouvement marocain dans le sillage des soulèvements mondiaux de la jeunesse (Indonésie, Pérou, Népal, Madagascar, etc.). À maintes reprises, nous avons fait référence à la solidarité mondiale et avons appris des tactiques telles que la coordination décentralisée rapide, les communications sécurisées et open source et l’action directe symbolique. Ce qui s’est passé au Népal a permis à de nombreux jeunes Marocain.e.s de prendre conscience de ce qui est possible. À ce jour, nous continuons à réaliser des clips vidéo reliant nos manifestations à celles du Népal. La comparaison mondiale aide à cadrer le récit et à renforcer la solidarité, mais les revendications concrètes du mouvement sont ancrées dans les services sociaux nationaux, la précarité économique et la responsabilité.
Avant ce mouvement (et encore aujourd’hui), nous étions quelque peu réticent.e.s à considérer les « jeunes » comme des acteurs et actrices politiques, car cela efface les différences de classe – c’est probablement la raison pour laquelle ce concept est si populaire parmi les ONG. Mais il n’en reste pas moins vrai que les conditions de vie se sont détériorées à l’échelle mondiale et que la liberté d’information et d’expression offerte par Internet – l’anonymat et les ressources qu’il met à disposition – est peut-être l’arme la plus puissante du siècle. Ce n’est pas comme si cela n’existait pas auparavant, notamment en 2011, mais aujourd’hui, notre relation avec Internet et notre façon de l’utiliser ont changé.
Enfin, en ce qui concerne le contexte marocain – bien que cela fasse écho à des événements survenus dans de nombreux pays après la décolonisation –, les années 1970 et 1980 ont été marquées par de très puissants mouvements de rue et de fortes organisations radicales de gauche, ainsi que par des émeutes dues à la famine. La réponse de l’État sous le règne du précédent roi, Hassan II, a été d’envoyer les personnes dans des fosses communes, des prisons secrètes à grande échelle et des chambres de torture. Cela a laissé la génération précédente dans une peur traumatisante, à tel point que le mot « manifestations » est pire qu’un blasphème contre Allah. Nous sommes la première génération à ne pas avoir vécu sous Hassan II ni pendant la période brutale appelée « les années de plomb ». Il est essentiel de comprendre cela pour commencer à analyser ce que ces manifestations signifient pour le peuple marocain.

Photo de Mosa’ab Elshamy.
Le Maroc a connu des manifestations en 2011 pendant le Printemps arabe. Contrairement à la Tunisie, à l’Égypte et à la Libye, cela n’a pas conduit à la chute du régime. En 2018 et 2019, une nouvelle vague de manifestations a balayé le monde arabe, commençant en Algérie et au Soudan. Comment les manifestations de 2011 et 2019 influencent-elles les événements actuels ? En quoi cette vague semble-t-elle différente ?
Le mouvement Genz212 se considère et se présente comme la continuation du mouvement Rif de 2017, du soulèvement du 20 février 2011, et fait même référence aux manifestations et émeutes sous Hassan II, ainsi qu’aux syndicats et organisations étudiantes tels que Ila al Amam (c’est-à-dire le marxisme-léninisme). L’une des principales raisons est que rien n’a vraiment changé depuis 2011 ; la liberté qui avait été acquise a été supprimée. Soit les participant.e.s ont accepté de travailler pour l’État, soit ils et elles ont fini par être emprisonné.e.s ou exilé.e.s.
Le Printemps arabe marocain a commencé par aborder les questions politiques d’un système répressif, tandis que le mouvement du Rif et notre mouvement ont commencé par formuler des revendications concernant les conditions matérielles ; aujourd’hui, nous essayons de formuler une critique politique des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas avoir d’hôpitaux et d’écoles. Certaines des principales différences résident également dans l’âge des participant.e.s et des catalyseurs du mouvement, qui sont beaucoup plus jeunes dans le mouvement Genz212, sans parler d’un mode d’organisation moins modéré/réglementé.
Ce que nous disons toujours, c’est que, contrairement aux soulèvements précédents et aux générations précédentes, nous ne reculerons pas.

Le Printemps arabe au Maroc.
Au début de l’année, des manifestations de masse ont eu lieu au Maroc en réponse au génocide perpétré à Gaza. Des manifestations ont également eu lieu dans des villages ruraux au début de l’été. Ont-elles contribué à créer la dynamique qui a conduit à ce soulèvement ? Comment influencent-elles la situation ?
Cette année, le Maroc a connu de nombreuses manifestations fragmentées et localisées concernant les conditions de travail, impliquant des agriculteur.rice.s, des enseignant.e.s et des médecins, qui ont été rapidement réprimées et dispersées. Mais celles-ci ont servi de catalyseur, de raison de se mobiliser et de force de mobilisation locale. Quant aux mobilisations de solidarité avec Gaza et aux actions telles que les blocages de ports ou les boycotts au début de l’année 2025, elles ont permis de développer les connaissances organisationnelles, les réseaux de mobilisateur.rice.s et la confiance entre les militant.e.s, les étudiant.e.s et certains syndicats. Par exemple, les dockers ont fait grève pendant quelques jours pendant notre mobilisation. Ces actions ont également normalisé les grands rassemblements, les actions directes et la documentation par le public des grandes manifestations ignorées par les médias officiels, tout en renforçant l’infrastructure d’aide juridique gratuite.
À quoi ressemblerait la victoire ?
À court terme, la victoire serait la chute de notre gouvernement, la mise en cause de la responsabilité de la police criminelle, des forces auxiliaires et de la gendarmerie royale, l’annulation de la Coupe du monde 2030 et l’affectation de son budget aux hôpitaux, aux écoles et aux salaires des travailleurs et travailleuses de ces institutions, et enfin, la rupture des relations de normalisation avec l’État sioniste. Telles sont nos revendications urgentes.
À long terme, car nous savons que ce n’est pas si simple, cela impliquerait de démanteler le système qui a engendré cette situation et contraint plus d’un quart de la population à fuir le pays, même en l’absence d’une guerre active.
Ce serait la fin d’une monarchie qui détient le droit de vie et de mort sur le peuple et le monopole sur des dizaines de secteurs de notre économie, tout en vivant dans les plus beaux palais du monde.
Ce serait l’autodétermination des peuples, à commencer par nos frères et sœurs du Sahara, et la fin de la rivalité manifestement artificielle avec l’Algérie, qui ne sert qu’à contrôler et opprimer deux peuples qui ont toujours été unis.
Ce serait la fin d’un système néocolonialiste raciste qui accorde tout aux étrangers blancs et soumet les peuples d’Afrique de l’Ouest au profilage racial et à la marginalisation. Cela signifierait la fin de la collaboration avec l’Occident et d’autres empires étrangers dans leurs crimes.
Ce serait la fin d’un système de surveillance qui sait tout sur tout le monde et nous fait vivre dans la peur.
Il s’agirait d’établir une responsabilité, une justice et une indemnisation réelles et transparentes concernant les crimes contre l’humanité commis sous ce régime et sous le règne du précédent roi, Hassan II.
Ce serait la fin d’un système économique fondé sur le favoritisme et les affinités entre les élites, dans lequel quelques-un.e.s détiennent d’énormes monopoles sur notre économie tandis que le reste d’entre nous travaille pour elles et eux et les rembourse chaque fois que nous achetons du lait, du sucre ou de l’essence.
Ce serait la fin de ce système que nous appelons « makhzen ». Ce serait un endroit où les gens auraient véritablement dignité et liberté.
Je suppose que ce serait un autre pays, celui que nous méritons.
Que peuvent faire les personnes vivant hors du Maroc pour soutenir les militant.e.s anti-autoritaires dans ce pays ?
Pour toute personne vivant en Europe, il est important de savoir que, historiquement, après chaque mouvement social ou insurrection au Maroc, d’énormes vagues d’exil ont eu lieu, quelle qu’en soit l’issue. L’État ouvre les frontières pour se débarrasser de celles et ceux qu’il considère comme indésirables et les individus fuient principalement vers l’Europe. C’est ce qui s’est passé après le mouvement du Rif en 2017, par exemple. Vous pouvez aider en luttant contre le fascisme là où vous vous trouvez et en vous organisant avec les personnes sans papiers qui arrivent afin qu’elles puissent arriver et s’installer en toute sécurité.
En outre :
BOYCOTTER LA COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS 2025 BOYCOTTER LA COUPE DU MONDE 2030
Ces événements sont entachés du sang de nos camarades.
BOYCOTTER LE TOURISME AU MAROC
Et donnez plus de poids aux voix des manifestant.e.s ici et de nos allié.e.s de la diaspora qui ont plus de liberté pour s’exprimer.
Merci ! ✊

Photo de Mosa’ab Elshamy.
Pour conclure, pouvez-vous recommander des sources permettant aux individus d’en savoir plus sur ce mouvement ?
Vous pouvez consulter le Discord Gen Z 212 ici.
Vous pouvez également consulter la chaîne YouTube de notre Discord pour écouter certaines de nos discussions précédentes et analyses de nos actions, ainsi que des conversations avec des journalistes indépendant.e.s sur la corruption, les révoltes passées dans notre pays et (le plus souvent) les séjours en prison ou en exil. Pour commencer, je vous recommande d’écouter nos discussions sans invité.e.s, et pour celles avec invité.e.s, commencez par visionner celle avec Aboubakr AlJamai.
Ici, vous pouvez écouter l’un des rares podcasts indépendants consacrés à l’activisme marocain, aux révoltes passées, à la politique autonome et populaire, etc., qui ne se contente pas de répéter la propagande du régime.
« Moroccan Youth » était un groupe Telegram qui souhaitait lancer un mouvement quelques semaines avant Gen Z 212, mais nous risquions la prison et n’avons pas donné suite. Beaucoup de ces jeunes ont rapidement rejoint le mouvement. Iels ont été un peu trop strict.e.s sur la question du pacifisme à mon goût ; idéologies mises à part, les émeutes peuvent légitimement être considérées comme de la légitime défense, tant dans le mouvement actuel que dans l’histoire des révoltes marocaines. Mais iels ont fait un excellent travail pour couvrir le mouvement avec quelques publications en anglais.
Cette page traite principalement des questions liées à l’eau et constitue l’une des meilleures sources d’information sur le sujet. Récemment, elle a également publié des articles sur le mouvement et les fondements socio-économiques de nos revendications. Très instructive, elle est disponible en arabe et en anglais. Vous trouverez une autre source d’information sur le même sujet ici.
Cette page a publié la vidéo et les photos de la fusillade policière qui a coûté la vie à trois jeunes Marocains innocents. Elle traite généralement de la question des Marocain.e.s et autres personnes qui fuient le pays.
Enfin, nous vous recommandons ce documentaire sur un chanteur sahraoui révolutionnaire.
10.10.2025 à 23:09
Nous avons fermé Elbit ! : Réflexions depuis Cambridge sur la campagne contre Elbit.
CrimethInc. Ex-Workers Collective
Texte intégral (8359 mots)

Elbit System est la plus grande entreprise d’armement israélienne. Le 8 septembre 2021, Elbit a annoncé vouloir ouvrir un « pôle innovation » à Cambridge, dans le Massachusetts, pour sa filiale KMC Systems. En moins de 3 ans, le Centre d’Innovation a dû fermer sous la pression d’activistes.
La résiliation anticipée du bail de l’année dernière pour le bureau de KMC est la première fois que des militant·es aux États-Unis ont contraint Elbit Systems à fermer une de ses installations. C’est aussi un des rares succès que compte le mouvement américain de solidarité avec la Palestine depuis le début du génocide à Gaza, en 2023. Cette analyse anonyme qui nous a été envoyée étudie la campagne d’actions directes ciblées menée pendant un an qui a réussi à expulser KMC Systems de la ville de Cambridge.
Pour commencer
Le 8 septembre 2021, la plus grande entreprise d’armement israélienne a annoncé que sa filiale KMC Systems avait ouvert un Centre d’Innovation au cœur de Cambridge. KMC Systems (ci-après dénommée du nom de sa compagnie-mère, Elbit) a justifié cette implantation par la croissance anticipée de l’entreprise. Le lancement de leur expansion à Cambridge met l’entreprise à distance des lieux de recrutement de ses « meilleurs talents », comme Harvard ou le Massachusetts Institute of Technology (MIT). Pendant que le maire de la ville coupait joyeusement le ruban, les activistes prenaient des notes. Mais iels n’ont pas frappé immédiatement.
Près de Somerville [située également dans le Massachusetts], plusieurs associations pro-Palestine étaient occupées à faire pression sur Puma pour que l’entreprise stoppe son partenariat avec l’équipe de football israélienne. D’autres préparaient discrètement la publication d’un projet de recherche interactif sur les soutiens du sionisme dans le Massachusetts, connu sous le nom de The Mappping Project. Plus d’un an s’est écoulé avant qu’une manifestation soit organisée contre Elbit, en réaction à l’attaque meurtrière perpétrée par Tsahal contre le camp de réfugiés de Jénine en janvier 2023.

En décembre 2021, les manifestant.es du BDS Boston ont contraint Puma à fermer temporairement son magasin d’usine.
Quelques jours plus tard, une foule d’environ 300 personnes s’est regroupée devant la mairie de Cambridge et s’est scindée en deux blocs pour aller perturber le Centre d’Innovation situé au 130 Bishop-Allen Drive. Comme le bâtiment de trois étages était cerné par une mer de drapeaux palestiniens, plusieurs douzaines de manifestant·es ont pris d’assaut le hall d’entrée. Toutefois, les accès verrouillés aux étages ont empêché les militant·es d’atteindre le second étage, là où Elbit louait ses bureaux. Qu’à cela ne tienne, les organisateur·rices ont pris la parole pour faire des discours contre l’entreprise d’armement, iels ont perturbé le travail des employé.es situé.es au premier étage, et ont quitté les lieux avant l’arrivée de la police pour éviter toute arrestation. La manifestation a continué sans problème vers le campus du MIT.
Plusieurs mois plus tard, en avril, des organisations ont appelé à un premier rassemblement spécifiquement contre Elbit. Quelques douzaines d’activistes ont répondu présent, ont marché jusqu’aux bureaux et ont crié des slogans dehors. Quelques semaines plus tard, le 15 mai, jour de la Nakba, un rassemblement s’est transformé en manifestation sauvage pour au final s’arrêter devant chez Elbit. Cette fois, quelqu’un·e a tagué « rendez les terres » [en référence à la colonisation] sur la façade de l’immeuble avant que la marche ne continue.
Sentant que quelque chose risquait de lui arriver, l’entreprise a tenté de dissimuler sa présence dans la ville. Après deux manifestations d’affilé devant ses locaux, elle a retiré le logo KMC Systems et teinté ses fenêtres. Trop tard.
Ce printemps-là, un groupe d’activistes nommé BDS Boston [Boston est dans le même État que Cambridge] a lancé une campagne pour virer Elbit de Cambridge. Iels ont commencé par quadriller les commerces alentour. Au bout de la troisième action, tous les commerces ont été prévenus. Beaucoup d’entre eux se sont montrés compréhensifs, quelques-uns ont même proposé d’afficher des tracts condamnant leur voisin. À deux pâtés de maison des bureaux, un café palestinien populaire a affiché les tracts bien en évidence au niveau de la caisse. On ne peut qu’espérer que cela ait gâché la pause déjeuner d’un employé d’Elbit.
D’avril à octobre 2023, BDS Boston a régulièrement tracté dans le quartier. Souvent quelques activistes, parfois jusqu’à une vingtaine, se rassemblaient devant les bureaux d’Elbit pendant la semaine pour distribuer aux passant.es des tracts contenant des informations sur l’entreprise d’armement implantée dans leur quartier. Ces premières actions n’étaient pas une confrontation directe, mais elles ont permis d’établir une présence visuelle et une routine qui se montrera importante dans les mois à venir.
Ces premiers tractages ont aussi été soutenus par le groupe philippins Malaya Movement. En août, le groupe a déposé une proposition de résolution au conseil municipal pour soutenir le Philippine Right Act [loi américaine qui vise à empêcher l’envoi d’armes aux Philippines tant que des mesures strictes d’encadrement et de respect des droits humains n’auront pas été prises]. Cette proposition incluait une clause condamnant les crimes de guerre d’Elbit aux Philippines. Le conseil municipal a voté pour retirer toute mention d’Elbit.
Au début de l’automne, des messages tels que « War criminals work at 130 Bishop-Allen Drive » (« Des criminel·les de guerre travaillent au 130 Bishop-Allen Drive ») et « Elbit out of Cambridge now! » (« Elbit, hors de Cambridge immédiatement ! ») ont été tagués sur les trottoirs des quartiers riches situés à proximité des bureaux, suscitant quelques discussions sur les forums Reddit locaux.

En octobre 2023, Elbit a supprimé de son site l’adresse de ses locaux à Cambridge. Ce sont les militant·es elleux-mêmes qui ont rendu cette information publique.
Le 7 octobre 2023
Le 7 octobre 2023, le blocus de Gaza a été momentanément brisé quand 3000 militant·es dirigé·es par les Brigades Al-Qassam ont vaincu l’occupation sioniste par la mer, les airs, mais aussi par leurs incursions terrestres et souterraines. Le monde a été choqué, beaucoup ont anticipé une escalade de violence de la part de Tsahal immédiatement après. Un élan de soutien a secoué le mouvement de solidarité avec la Palestine. Des manifestations ont eu lieu partout. À Boston, des centaines de personnes ont pris la rue pour soutenir la résistance. Un des premiers grands rassemblements à Boston s’est d’ailleurs focalisé sur Elbit.
En l’espace d’une semaine, un nouveau groupe inspiré du modèle du réseau d’action directe Palestine Action (et ayant brièvement le même nom) a empêché les employé·es d’Elbit d’entrer dans leurs bureaux. Avant l’ouverture des bureaux, trois activistes de Palestine Action US ont barricadé la porte de l’immeuble en s’attachant par le cou aux poignées de porte avec des antivols pour vélo. Un·e autre a aussi tagué à la peinture rouge sur le trottoir « Shut Elbit Down » (« Fermons Elbit »). Ayant successivement découragé les employé·es, les militant·es se sont libéré·es de leurs liens et sont rentré·es chez elleux sous le nez d’une police perplexe.
Quelques heures après, des activistes ont à nouveau vandalisé l’immeuble. Les murs ont été tagués de slogans anti-Elbit et les lecteurs de cartes d’accès ont été détruits. Quatre jours plus tard, des activistes anonymes ont de nouveau frappé le bâtiment, détruisant à nouveau les lecteurs de cartes et aspergeant les murs de peinture rouge, peinture qui a nécessité plusieurs semaines pour être effacée.
Intercontinental Real Estate, la société immobilière propriétaire des locaux rue Bihsop-Allen qui loue le deuxième étage à Elbit, a été visée la semaine suivante. Des activistes anonymes ont arrosé les bureaux de peinture rouge et détruit les lecteurs de carte d’accès. Une chaine d’information locale a également été visée lors de cette action « peinture ».
Pendant ce temps, BDS Boston est passé du simple tractage à des actions de protestations devant les bureaux et a annoncé l’organisation de manifestations bruyantes. Des foules petites ou moyennes selon les semaines ont répondu à l’appel et apportaient à présent banderoles et mégaphones.
Le 30 octobre, Palestine Action a appelé à un rassemblement devant les locaux d’Elbit. Plus de 200 personnes ont répondu présent. La police a mis en place un périmètre de protection à l’aide de barrières en métal autour des bureaux et a placé des agents derrière ces dernières pour sécuriser les accès. La foule a chanté des slogans contre la police qui protégeait une entreprise d’armement. Quelques personnes ont commencé à pousser les barrières pour se rapprocher du bâtiment. Mal préparée, la police a paniqué. Ils ont arrêté des individus, les ont plaqués et aspergés sauvagement de lacrymo. Un flic a glissé sur des feuilles d’arbres mouillées et s’est cassé la figure de manière caricaturale. Les officiers se disputaient ouvertement entre eux sur la marche à suivre. Les activistes se sont libéré·es mutuellement et ont repoussé la police, et certain·es ont lancé avec enthousiasme des œufs et des fumigènes.
Malgré tout, neuf personnes ont été arrêtées pour des accusations allant du « trouble à l’ordre public » à l’agression d’un policier. Toutes ont été libérées le soir même, et un juge a finalement levé toutes les charges qui pesaient contre elles.
Intercontinental Estate, vous ne pouvez pas vous cacher !
Après le rassemblement du 30 octobre, Palestine Action a relâché la pression sur la filiale d’Elbit à Cambridge. Le groupe appelait à une manifestation le 14 décembre, qui a été plus tard discrètement annulée. En ligne, iels promouvaient des actions contre Elbit Systems au niveau national, et poussaient les gens à s’organiser contre la machine de guerre, sous la forme de groupes affinitaires et d’utiliser l’action directe. En novembre, le groupe a organisé sa dernière action publique avant sa dissolution. Le 20 novembre, des activistes ont envahi une usine d’Elbit à Merrimack, dans le New Hampshire. Iels ont cadenassé les entrées, brisé des portes vitrées, couvert les bâtiments de peinture, cassé le système d’air conditionné, et tagué « Free Gaza, Fuck Elbit! » (« Libérez Gaza, Nique Elbit ! »). Quatre personnes ont été arrêtées, iels ont purgé 40 jours de prison et sont maintenant sous contrôle judiciaire pendant deux ans.
Autour de Boston, différentes ONGs et les Democratic Socialists of America ont appelé futilement Elizabeth Warren et d’autres membres du Congrès à soutenir et demander un cessez-le-feu. La section locale de Jewish Voice for Peace and If Not Now ont brièvement imité les actions de désobéissance civile d’activistes juif·ves survenues à New York et Washington et qui ont fait les gros titres. Le Party for Socialism and Liberation a épuisé des militant·es en marchant devant des bâtiments consulaires vides et lors de rassemblements dans des parcs les week-end. Occasionnellement, des militant·es autonomes ont mené des actions contre les entreprises Boeing, Raytheon et Boston trucking logistics.
Pendant ce temps, BDS Boston se creusait la tête pour trouver de nouvelles manières de faire pression sur Elbit. À la fin du mois d’octobre, le groupe a lancé une autre campagne contre l’entreprise propriétaire des bureaux, Intercontinental Real Estate. Sur les réseaux sociaux, BDS Boston a publié les noms, mails et numéros de téléphone de trois autres compagnies louant les locaux au 130 Bishop-Allen. Durant les dix mois suivants, l’espace de coworking du rez-de-chaussée et les cabinets d’architectes à l’étage recevaient des mails et des appels téléphoniques au sujet de leur voisin du deuxième étage.

Tract d’information de BDS Boston concernant Elbit Systems diffusé en novembre 2023.
Les militant·es de BDS mettaient à rude épreuve les relations au sein de l’immeuble tout en appelant elleux-mêmes la compagnie immobilière. Lorsque le ou la réceptionniste de l’entreprise propriétaire des bureaux a commencé à raccrocher, les militant·es ont essayé une nouvelle stratégie pour joindre la société. Un syndicat local de locataires a envoyé des organisateurs·rices dans un autre immeuble appartenant à Intercontinental, un complexe d’appartements de luxe situé au centre-ville. Les militant·es ont interpellé les résident·es irrité·es au sujet de leur propriétaire, le PDG d’Intercontinental Real Estate, « Peter “Genocide Profiteer” Palandjian » (« Peter Plandjian, le profiteur du génocide »). Les plaintes sont certainement remontées à la société. Lorsque le syndicat des locataires a organisé une deuxième campagne, des agents de sécurité privés les attendaient.
Votre banque tire-t-elle profit du génocide ?
Le 22 janvier, BDS Boston a élargi ses actions contre Elbit pour inclure la banque d’investissement JP Morgan Chase. Ce jour-là, plus de 200 personnes ont marché en direction de la branche locale de la banque. De leur propre chef, des individu·es autonomes ont pris la tête de la manifestation et ont perturbé les activités du bureau de la succursale, chanté des slogans anti-Elbit et jeté de faux billets tachés de sang. À l’extérieur, les activistes ont formé une chaîne humaine, bloquant ainsi le bâtiment. La succursale a fermé ses portes pour la journée.
Moins d’un mois plus tard, des centaines de militant·es ont fermé une succursale de la banque Chase à Jamaica Plain, un quartier de Boston. Une poignée de militant·es ont refait le coup des billets tachés de sang, d’autres ont apporté des gravats et des draps ensanglantés à mettre devant l’entrée, visibilisant ainsi les investissements de la banque dans les activités d’Elbit et donc sa participation au génocide. Une foule dense a bloqué l’entrée de la banque, la forçant à fermer pour la journée. L’intersection la plus proche a également été occupée, bloquant ainsi le trafic routier. Là, des prises de paroles du Palestinian Youth Movement ont eu lieu, prônant l’action directe. D’autres personnes ont parlé en soutien à la résistance armée du peuple palestinien.

Le formulaire 13F déposé par JP Morgan Chase auprès de la SEC en mai 2024 indiquait une réduction de 70 % des actions Elbit détenues, dont la valeur totale est passée de 54 millions de dollars à seulement 16 millions de dollars.
Des actions similaires ont eu lieu plusieurs fois. BDS Boston appellera à se rassembler devant des succursales de la banque, appels suivis habituellement par une centaine de personnes. Comme la foule empêchait physiquement les gens d’entrer, d’autres personnes ont agi comme iels l’entendaient, généralement en jetant des faux billets tachés de sang, en bloquant l’entrée avec des gravats, en taguant ou en déposant des draps ensanglantés devant la porte d’entrée. Chaque action a eu pour effet de faire fermer la succursale de la banque pour la journée. Seule une personne a été arrêtée, accusée d’avoir déposé des gravats, et les charges qui pesaient contre elle ont finalement été levées.
Les campements étudiants
Le 17 avril 2024, les étudiant·es de Colombia ont occupé le campus avec des campements étudiants pour Gaza. La police les a attaqués dans les jours qui ont suivi. Quand les étudiant·es sont revenu·es avec leurs tentes, iels n’étaient plus seul·es. En l’espace d’une semaine, des manifestations similaires ont éclot à travers le pays. À Boston, les étudiant·es ont dressé des camps à Harvard, au MIT, à Emerson, à l’Université de Boston et à Northeastern.
Dans les jours qui ont précédés cette « intifada étudiante », BDS Boston a simultanément prit pour cible quatre succursales de la banque Chase à travers la ville. Ce fut la dernière manifestation sur ce sujet avant le milieu de l’été, et l’avant-dernière de toute la campagne, la plupart des organisations pro-Palestine ayant décidé de concentrer leur énergie pour soutenir les campements dans toute la ville.
Les manifestations ciblant Elbit n’ont plus eu lieu jusqu’à la fin du mois de mai. Profitant de l’énergie dégagée par les campements étudiants et les perturbations de la banque Chase, de plus en plus de personnes ont rejoint le combat, avec la farouche volonté d’occuper le carrefour situé devant les bureaux d’Elbit. Au moins 50 personnes bloquaient régulièrement l’avenue Bishop-Allen, entraînant habituellement des affrontements de faible intensité avec la police de Cambridge, qui était impuissante. Les manifestant·es ont toujours réussi à tenir la rue.
La dernière ligne droite
En février, des organisateur·rices de BDS Boston ont appris que les employé·es d’Elbit avaient ordre de ne pas venir travailler dans les locaux quand il y avait des manifestations. Les rassemblements ont donc régulièrement repris. Au début du mois de mai, les actions contre les agences Chase ont décru. La banque Chase a baissé ses investissements dans les activités d’Elbit à hauteur de 70 %, passant de 56 à 16 millions de dollars. Les activistes ont continué à appeler les autres entreprises présentent dans le bâtiment d’Elbit tout au long du printemps et de l’été. Des secrétaires agacé·es ont parfois admis que l’entreprise propriétaire des locaux tentait de résilier le bail d’Elbit aussi vite que possible. Les associations l’ont pris comme un encouragement, mais l’ont traité comme rien de plus qu’une rumeur. Si c’était vrai, alors il fallait encore accroître la pression sur le propriétaire.
Fin juin, plus de 100 personnes se sont retrouvées au parc Harvard dans cet objectif. La foule a marché un mile (un peu plus 1,5 km) vers le nord, jusqu’à la maison à 15 millions de dollars du PDG d’Intercontinental Real Estate, Peter Palandjian. Iels se sont rassemblé·es devant la maison jaune, et les militant·es ont fustigé Paladjian d’avoir encaissé des « loyers sanglants » et ont demandé à ce qu’il expulse immédiatement Elbit. Des voisins ont râlé après cette perturbation bruyante en milieu de journée. Les manifestant·es ont placardé dans sa rue des photos de lui, avec écrit « Recherché pour avoir financé un génocide. Dites à votre voisin d’expulser ses locataires génocidaires ».

Fin juin 2024, des manifestant·es se sont rassemblé·es devant la maison de Peter Palandjian, PDG d’Intercontinental Real Estate Corporation, d’une valeur de 15 millions de dollars, pour exiger qu’il expulse KMC, la filiale médicale d’Elbit, de son « Centre d’Innovation de Cambridge ».
Au mois de juillet, BDS et le Palestinian Youth Movement (PYM) ont appelé à une semaine d’actions. Le but était d’augmenter l’implication de la population de Boston dans la campagne contre Elbit, avec quelque chose de prévu chaque jour. PYM a présenté à plus de 100 personnes un atelier pour comprendre les mécanismes de l’oppression et de la colonisation en Palestine. Le matin suivant, une foule d’individus a bloqué l’accès à la banque Chase située à Harvard Square et ce, de son ouverture jusqu’à sa fermeture. Plus tard, le PYM a organisé un atelier de broderie palestinienne (Tatreez), suivi d’une conférence du groupe No Tech for Apartheid.
Le lendemain, BDS Boston et le PYM avaient organisé un rassemblement de 18h devant les bureaux d’Elbit. Pendant la journée, les manifestant·es ont bloqué Elbit et chanté des slogans en soutien à la résistance. Une conférence de l’Université Populaire pour la Palestine s’est déroulée en plein milieu de la rue. Durant la nuit, la manifestation est devenue une veillée en mémoire des martyrs palestiniens. Une seule fois, un agitateur a tenté de perturber le rassemblement : une nuit, un homme seul muni d’une sono a interrompu la veillée en diffusant de la propagande sioniste en arabe. Les militant·es l’ont collectivement hué, l’ont encerclé avec leurs keffiehs et ont fini par le dégagé.
Plus tard, cet espace a encore été occupé. Les activistes ont monté des tentes et ont apportés des oreillers pour rendre l’occupation de la rue plus confortable. Iels ont projeté Tell Your Tale Little Bird, un film parlant de la résistance des femmes palestiniennes contre le mur de séparation. Durant toute la nuit, le carrefour devant les bureaux a été bloqué et appartenait aux manifestant·es.
Une autre nuit, quelques douzaines d’activistes sont retourné·es devant la maison du propriétaire des locaux dans le nord de Cambridge. Vers 2 heures du matin, devant son jardin, iels ont fait un boucan monstre et scandé des slogans appelant à virer Elbit. Alors que la sécurité privée a commencé à traquer les militant·es et à les filmer, Palandjian énervé et en sous-vêtement est sorti sur le porche de sa maison pour crier sur les manifestant·es.

La police surveille les manifestant·es solidaires de la Palestine le 2 septembre 2024.
Elbit hors de Cambridge
À la fin de l’été, la campagne avait gagné en ampleur. L’action directe contre Elbit était devenue une pierre angulaire des organisations pro-Palestine de Boston. BDS Boston organisait des rassemblements hebdomadaires devant les bureaux, occupant de plus en plus d’espace et s’habituant à résister face à la police. Peter Palandjian commençait à être de plus en plus irrité. Les locataires du dessus rapportaient des rumeurs selon lesquelles la plupart des employé·es d’Elbit avaient commencé à travailler à domicile. Les bureaux étaient presque toujours vides.
Le 18 août, le journal local Cambridge Day rapporta que les bureaux étaient déserts. Elbit le confirma publiquement : iels étaient parti·es. Quelques jours plus tard, des militant·es organisèrent une marche pour célébrer la nouvelle. Iels prirent possession de l’intersection en dessous des bureaux désormais vides, au deuxième étage, où des éclats de peinture rouge étaient encore visibles sous les stores tirés. Quelqu’un adapta le slogan habituel « Elbit n’est pas la bienvenue ici » en « Elbit n’est plus ici ! » La foule exulta. Les agent·es de police, énervé·es, menacèrent à plusieurs reprises d’arrêter les manifestant·es, brandissant des menottes en plastique, mais les militant·es ne se laissèrent pas intimider.
Quelqu’un·e a pris le mégaphone : « Vous n’entendrez pas le mot “victoire” dans la bouche de BDS Boston tant qu’Elbit Systems ne sera pas entièrement démantelée, tant que la Palestine ne sera pas complètement libérée. À la place, vous nous entendrez dire : en avant. »
Leçons et réflexions
La campagne, longue de plus d’un an, pour virer Elbit Systems a été menée par quatre groupes différents. Les activistes de BDS Boston, le réseau d’action directe Palestine Action, le groupe de la communauté palestinienne PYM, et de manière anonyme par des individus autonomes ou des groupes affinitaires.
Cette campagne est unique dans l’écosystème pro-Palestine de Boston. Au lieu de se focaliser sur la ville ou des politiques fédérales, elle s’est focalisée sur une unité spécifique de l’économie de guerre sioniste. La campagne était aussi différente de celles contre les sites de Boeing et Raytheon. Les actions contre Elbit étaient courantes, se produisant presque chaque semaine pendant la majeure partie de l’année. La location d’espaces de bureaux dans un bâtiment partagé constituait une vulnérabilité particulière que les militant·es ont eu raison d’exploiter.
La campagne a été menée de manière indépendante, par des groupes autonomes avec des lignes politique solides qui supportaient mutuellement leurs différentes tactiques. La campagne contre Elbit a refusé les arrestations symboliques et les actions pacifistes. Quand des personnes se rejoignaient, à 20 ou à 200, c’était pour faire quelque chose de concret et non une marche symbolique. Celles et ceux qui utilisaient des mégaphones félicitaient celles et ceux qui utilisaient des bombes de peinture. C’est une importante rupture avec l’habituelle timide contestation menée par les ONGs de Boston.
Et ça a marché.

Des militant·es ont bloqué Elbit Systems en octobre 2023.
Qu’est-ce qui a marché ?
Ici suivent quelques réflexions individuelles sur la campagne.
Des dégradations répétées, dès le départ.
Après le 7 octobre, les premières actions qui ont eu lieu aux bureaux d’Elbit étaient des actions de vandalisme. L’immeuble a été tagué et aspergé de peinture trois fois en quatre jours. Les lecteurs de cartes d’accès ont été détruits, comme ceux des bureaux de l’Intercontinental Real Estate. Une station d’info locale a été aspergée de peinture rouge. Ces actions étaient fréquentes – et la police n’a attrapé personne, sauf une qui s’était vantée en public d’une action (un juge l’a finalement relaxée). Toutes les dégradations anonymes ont été ouvertement célébrées par les organisations menant la campagne.
Le rassemblement du 30 octobre a immédiatement suivi cette série d’actions « peinture ». Prédisant de nouvelles dégradations, la police boucla le bâtiment avec des barrières métalliques et l’encercla. Les manifestant·es refusèrent cette tournure des événements, franchissant la ligne policière et lançant des œufs et des fumigènes sur la police. Ce fut une rupture majeure avec les rassemblements dociles auxquels la police de Cambridge s’était habituée – et cela se refléta dans sa réaction énervée et désordonnée.
Ensemble, les semaines de dégradations, suivies de cette manifestation plus offensive, marquaient une volonté d’intensifier les actions contre Elbit. Ce spectre hanta toutes les mobilisations suivantes. Il contribua probablement à la mise en place du télétravail qu’Elbit finit par accorder à ses employé·es en réponse aux manifestations. Cela constitua un levier utile pour les militant·es : même les actions moins frontales devenaient des moyens de dissuader les employé·es de venir travailler. Des manifestations fréquentes signifiaient moins de personnes au bureau – rendant celui-ci superflu et coûteux pour l’entreprise.
Les cibles tertiaires, attaquer le maillon faible
En octobre, BDS Boston lança une campagne visant des cibles tertiaires contre le « Centre d’Innovation » de Cambridge. Au cours des dix mois suivants, le groupe aller tester trois types de cibles tertiaires : le propriétaire du bâtiment, les investisseur·euses d’Elbit Systems, et les client·es de KMC Systems.
S’attaquer aux client·es de KMC Systems fut la moins exploitée des campagnes visant des cibles tertiaires. BDS Boston n’organisa que deux campagnes d’appels massifs demandant aux client·es de rompre leurs liens avec la filiale d’Elbit. Une fois, le groupe appela à manifester devant un sommet de recherche et développement où KMC et ses client·es étaient présent·es.
BDS Boston consacra davantage d’énergie à protester contre l’investisseur d’Elbit, la banque JP Morgan Chase. Le groupe organisa plusieurs actions réussies dans diverses agences bancaires de Boston et de ses alentours. L’impact direct de ces actions sur Elbit fut probablement limité, mais elles profitèrent largement à BDS Boston. Le groupe vit ses effectifs croître durant les manifestations contre la banque, rassemblant plus de cent personnes à chaque fois. Les actions se tenaient toujours le week-end, ce qui permettait à celles et ceux ne pouvant pas participer aux actions devant les bureaux d’Elbit en semaine de s’impliquer. Le succès répété des fermetures d’agences et de succursales, obtenu avec un effort minimal, renforça la dynamique et la confiance du collectif – un élan qui se manifesta ensuite dans les manifestations.
La cible tertiaire la plus efficace fut le propriétaire, Intercontinental Real Estate. C’était à la fois le maillon le plus faible et le plus décisif de la chaîne. Il était facile pour les manifestant·es de transformer Elbit en un fardeau économique pour Intercontinental sur plusieurs fronts.
Le fait qu’Elbit partage le bâtiment avec d’autres entreprises représentait une vulnérabilité. Les perturbations devant le bâtiment (dégradations, manifestations bruyantes, affrontements avec la police) irritaient les autres locataires. En usant leur patience, en menant des campagnes de porte-à-porte dans d’autres immeubles d’Intercontinental, et en se rendant au domicile de Palandjian à toute heure, les militant·es facilitèrent la non-reconduction du bail.
Organisation, dévouement, constance
Les groupes capables d’analyser leurs cibles, d’expérimenter de nouvelles tactiques et d’intégrer les leçons stratégiques sont essentiels à la réussite des campagnes. Palestine Action US s’est dissout après deux actions. En novembre 2023, les actes anonymes de vandalisme contre Elbit cessèrent. Le Palestinian Youth Movement s’impliqua en 2024, alors que la campagne de BDS Boston perdurait après la fin d’autres initiatives locales. Sans la détermination constante de BDS Boston et ses actions répétées contre Elbit pendant plus d’un an, le « Centre d’Innovation » n’aurait peut-être jamais fermé.
Il était facile de se laisser distraire après le 7 octobre 2023. L’opération Toufan al-Aqsa et la politique de terre brûlée d’Israël déclenchèrent un élan de soutien inédit à la Palestine. Des foules entières descendirent dans les rues, cherchant à agir. De nombreux groupes appelèrent à des manifestations à travers la ville – des actions multiples, mais souvent sans stratégie claire. BDS Boston, en revanche, offrait un cadre d’engagement structuré, avec une campagne active contre une cible cohérente ; cela donnait un sens concret à la mobilisation.
Les positions politiques de BDS Boston jouèrent également un rôle clé. Le groupe n’est pas une ONG, mais une organisation politique indépendante ; iels ne cherchent pas à plaire aux politicien·nes, mais privilégient l’action directe. Le collectif soutient la résistance palestinienne et se positionne fermement contre le sionisme. À Boston, BDS Boston se distingua en soutenant The Mapping Project, une ressource en ligne recensant les collaborations sionistes dans le Massachusetts ; le groupe résista à un conflit public avec le Comité national du BDS à Ramallah, qui avait dénoncé ce projet.
Ces divergences politiques ne sont pas anodines : elles constituent des garde-fous contre toute récupération institutionnelle. Ce n’est pas un hasard si BDS Boston a su créer un espace pour une campagne rompant avec les codes convenus des mobilisations d’ONG.

Une manifestation devant les bureaux d’Elbit à Cambridge, dans le Massachusetts, le 30 octobre 2023.
La dialectique action - répression
L’État réagit inévitablement face à une action efficace. Les campagnes les plus intelligentes cherchent à minimiser, détourner ou neutraliser les contre-mesures que les autorités mettent en place, sans céder à l’intimidation. Les militant·es doivent rester attentif·ves à l’évolution du terrain de la répression afin d’en limiter les effets.
À la suite de la série de dégradations visant le site d’Elbit, la sécurité du bâtiment fut renforcée : une surveillance permanente fut mise en place par la police de Cambridge et des agent·es de sécurité privé·es. En général, il n’y avait jamais plus d’un·e gardien·ne à la fois, tuant l’ennui des longues nuits grâce à la lumière bleue de son téléphone et aux fast-food. Ce petit ajustement sembla suffire à dissuader de nouvelles actions. Qui sait quels furent les calculs stratégiques des auteur·ices des dégradations ? Quoi qu’il en soit, il est important de rappeler que les militant·es n’ont pas toujours à subir la pression policière – iels peuvent aussi la retourner à leur avantage.
Cela fut particulièrement visible lors du rassemblement du 30 octobre, quand l’énergie de la foule prit la police au dépourvu. Qui sait ce que l’on aurait pu accomplir en plus à ce moment-là avec un peu plus de coordination ? En décembre, les forces de l’ordre arrivaient désormais mieux préparées.
Palestine Action prévoyait un nouveau rassemblement devant le site le 14 décembre, mais l’annula discrètement. Les seul·es à se présenter furent les policiers. Ce matin-là, des photos devinrent virales : on y voyait la police de Cambridge positionner deux tireur·euses d’élite sur le toit d’une entreprise située juste en face d’Elbit. Les militant·es eurent raison d’exploiter le scandale qui s’ensuivit. Tandis que certain·es opposant·es à la répression policière se rassemblaient devant la mairie pour dénoncer cette démonstration de force disproportionnée, les associations anti-Elbit accentuèrent la pression sur les autres locataires du bâtiment : pourquoi un·e architecte devrait-iel venir travailler sous le viseur d’un·e sniper ?
Les trois virages stratégiques décidés entre octobre et décembre face à la présence policière accrue furent : la fin complète des actes de vandalisme, l’exploitation du scandale des tireur·euses d’élite, et le passage aux cibles tertiaires. Ce dernier choix ouvrit de nouveaux espaces d’actions et permit aux organisateur·ices de gagner en confiance lorsque le site d’Elbit paraissait « trop chaud ».
À la suite du succès de cette campagne, la police élargit son arsenal de surveillance. À l’été 2024, trois caméras de lecture automatique de plaques d’immatriculation (technologie Flock AI) furent installées sur le bâtiment Bishop-Allen, et une autre à l’entrée du siège d’Intercontinental Real Estate. Pour l’instant, ce sont parmi les seules caméras Flock de tout l’État du Massachusetts. La police demanda également l’installation de nouvelles caméras de vidéosurveillance à Cambridge, en commençant par le quartier de Central Square.
Conclusion
Il ne s’agit pas ici d’une « recette » pour fermer définitivement les bureaux d’Elbit. Chaque campagne affronte une combinaison unique de rapports de force. En partageant cette histoire, nous souhaitons montrer comment certain·es organisateur·ices ont su analyser leur situation particulière et s’encourager mutuellement pour affiner leurs tactiques et obtenir des victoires.
Outre une solide analyse, les militant·es de Boston ont fait preuve de constance. Qu’il s’agisse d’une personne ou d’un petit groupe agissant de nuit, de quelques dizaines de manifestant·es présents devant Elbit pendant les heures de bureau, ou de centaines d’individus bloquant la banque Chase le week-end, des actions contre Elbit ont eu lieu presque chaque semaine pendant un an.
Si vous lisez ceci à l’est du Mississippi, vous êtes à quelques heures d’un site d’Elbit. Avec de la détermination, vous pouvez changer cela.

Des militant·es ont bloqué Elbit Systems en octobre 2023.
Annexe : Chronologie des actions
-
le 3 août 2023 : BDS Boston et le mouvement Malaya font du porte-à-porte devant Elbit.
-
le 21 août 2023 : BDS Boston manifeste devant Elbit.
-
le 7 septembre 2023 : BDS Boston manifeste devant Elbit.
-
le 12 octobre 2023 : Trois militant·es de Palestine Action se sont attaché.es par le cou aux portes des locaux d’Elbit, empêchant les employé·es d’entrer. Quelqu’un verse de la peinture rouge sur le trottoir. « Shut Elbit Down » (« Fermons Elbit ») est écrit à la bombe sur le bâtiment. Le soir, celui-ci est à nouveau vandalisé avec les graffitis « Elbit Makes Genocide » (« Elbit commet un génocide »), « Fuck Elbit » (« Nique Elbit ») et « Elbit Get Out » (« Elbit dégage »). Le lecteur de cartes d’accès est détruit.
-
le 16 octobre 2023 : Durant la nuit, des militant·es anonymes recouvrent le bâtiment d’Elbit de peinture rouge et y inscrivent « Elbit Arms Genocide » (« Elbit arme le génocide »). Le lecteur de cartes d’accès est également brisé. Il s’agit du troisième acte de vandalisme en quatre jours contre les bureaux d’Elbit.
-
le 18 octobre 2023 : Elbit retire les informations concernant les locaux de Cambridge de son site web.
-
le 24 octobre 2023 : Dans la nuit, des militant·es anonymes s’en prennent au bureau du propriétaire d’Elbit à Cambridge. Les locaux d’Intercontinental Real Estate sont aspergés de peinture rouge et leurs lecteurs de cartes détruits.
-
le 30 octobre 2023 : 200 militant·es manifestent devant le bureau d’Elbit. Beaucoup franchissent les barrières de police ; certain·es lancent des œufs et des fumigènes sur la police de Cambridge. Neuf personnes sont arrêtées, mais un juge lève ensuite toutes les accusations à leur encontre.
-
Début novembre 2023 : Des militant·es perturbent un salon de l’emploi à l’université Wentworth, parrainé par Elbit Systems, où KMC Systems tenait également un stand de recrutement.
-
le 2 novembre 2023 : BDS Boston manifeste devant Elbit.
-
le 5 novembre 2023 : Plusieurs rues de Central Square à Cambridge sont couvertes à la craie avec les noms de martyrs palestiniens.
-
le 17 novembre 2023 : Des étudiant·es de l’université Tufts bloquent le bâtiment administratif pendant plusieurs heures pour exiger le désinvestissement d’Israël. Certains étudiant·es identifient les policiers présents grâce au site du personnel de l’université et scandent leurs noms pendant l’action.
-
le 26 novembre 2023 : Des militant·es perturbent la zone de récupération des bagages à l’aéroport de Boston Logan pour protester contre Boeing. Un militant est arrêté. Plusieurs dizaines d’autres personnes poursuivent la manifestation à l’extérieur pendant plusieurs heures.
-
le 2 décembre 2023 : BDS Boston manifeste devant Elbit.
-
le 13 décembre 2023 : Puma annonce qu’il ne sponsorisera plus la Fédération israélienne de football (IFA).
-
le 14 décembre 2023 : La police de Cambridge est photographiée en train de positionner des tireurs d’élite sur le toit d’un immeuble en face d’Elbit, en prévision d’une manifestation.
-
le 16 décembre 2023 : Des militant·es se rassemblent pour une manifestation « familiale » à la mairie de Cambridge. De la nourriture gratuite est servie, plusieurs discours sont prononcés et les participants dansent le dabke sur la pelouse. Les militant·es peignent des pancartes avec « ELBIT OUT OF CAMBRIDGE » (« Elbit hors de Cambridge ») et écrivent des slogans anti-Elbit à la craie sur les marches de la mairie.
-
le 18 décembre 2023 : Plus de 50 militant·es bloquent des camions sous la pluie dans un terminal du port de Boston pour protester contre le blocage de l’aide à Rafah.
-
le 1er janvier 2024 : BDS Boston manifeste devant Elbit.
-
le 17 janvier 2024 : Des militant·es bloquent l’entrée d’une usine Raytheon à Tewksbury, dans le Massachusetts. De la peinture rouge est retrouvée sur le panneau Raytheon.
-
le 20 janvier 2024 : Plus de 100 personnes ferment une agence de la banque Chase à Harvard Square. Les militant·es jettent des faux billets maculés de sang, empêchent l’accès à la banque et manifestent à l’extérieur.
-
le 8 février 2024 : Des militant·es perturbent les bureaux de BNY Mellon, investisseur d’Elbit Systems, à Boston, en jetant des faux billets ensanglantés et en scandant des slogans anti-Elbit.
-
le 11 février 2024 : BDS Boston manifeste devant Elbit.
-
le 17 février 2024 : Plus de 100 personnes ferment une agence de la banque Chase dans le quartier Jamaica Plain de Boston. Les militant·es jettent de nouveau des faux billets ensanglantés, déposent des gravats et des draps tachés de sang à l’entrée, empêchent les gens d’entrer et manifestent à l’extérieur. Après la fermeture anticipée de la banque, les militant·es occupent l’intersection voisine pour prononcer des discours en soutien à la résistance armée palestinienne.
-
le 21 février 2024 : Les militant·es apprennent que les employés d’Elbit peuvent télétravailler les jours de manifestation. BDS Boston organise un rassemblement devant Elbit à 9h.
-
le 27 février 2024 : BDS Boston manifeste devant Elbit.
-
le 29 février 2024 : Des militant·es bloquent l’entrée de l’usine Elbit à Birdsboro, en Pennsylvanie. Six personnes sont arrêtées.
-
le 4 mars 2024 : Plus de 50 personnes bloquent des camions dans une zone portuaire de Boston pendant une heure pour protester contre le blocage de l’aide à Gaza.
-
le 7 mars 2024 : BDS Boston manifeste devant MassMEDIC, un sommet sur la fabrication de dispositifs médicaux, pour dénoncer la participation d’Elbit. Les militant·es demandent aux clients de KMC Systems de rompre leurs contrats.
-
le 9 mars 2024 : Plus de 100 personnes ferment une agence de la banque Chase au centre commercial Prudential Center de Boston. Les militant·es jettent de l’argent ensanglanté, déposent des gravats et des draps tachés de sang à l’entrée, bloquent l’accès et manifestent à l’extérieur.
-
le 19 mars 2024 : BDS Boston manifeste devant Elbit.
-
le 22 mars 2024 : Sept personnes bloquent l’entrée de l’usine Elbit à Merrimack, dans le New Hampshire, en utilisant des « lock boxes » (outil et pratique militante permettant de s’enchainer les uns aux autres).
-
le 26 mars 2024 : BDS Boston manifeste devant Elbit. Le même jour, Elbit publie ses résultats financiers 2023 à ses actionnaires.
-
le 30 mars 2024 : Des militant·es bloquent la circulation sur le pont Longfellow à l’occasion de la Journée de la Terre palestinienne, utilisant des chaînes et des antivols pour vélo.
-
le 6 avril 2024 : Le Mouvement de la jeunesse palestinienne et BDS Boston organisent une manifestation conjointe contre Elbit.
-
le 15 avril 2024 : Des militant·es ciblent simultanément quatre agences bancaires à Boston en jetant des billets ensanglantés et en scandant des slogans anti-Elbit.
-
le 17 avril 2024 : Des étudiant·es de l’université Columbia installent un campement pour Gaza, déclenchant une vague nationale d’occupations étudiantes. En une semaine, des campements apparaissent à Emerson, Northeastern, MIT, Harvard, Boston University et Tufts.
-
le 15 mai 2024 : Des militant·es solidaires de la Palestine manifestent dans la ville pour la Journée de la Nakba. Des graffitis anti-Elbit apparaissent à Boston. Les documents financiers de JP Morgan Chase montrent une réduction de 70 % des actions Elbit.
-
le 29 mai 2024 : BDS Boston manifeste devant Elbit. Des militant·es déploient une banderole « ELBIT KILLS » (« Elbit tue ») depuis le pont Charles.
-
le 5 juin 2024 : BDS Boston manifeste devant Elbit.
-
le 12 juin 2024 : Des militant·es occupent le hall d’entrée de Boeing. Iels se barricadent à l’intérieur, empêchant les employé·es et la police d’entrer. Après une heure, iels quittent les lieux tou·tes ensemble sans arrestation.
-
le 12 juin 2024 : BDS Boston manifeste devant Elbit.
-
le 26 juin 2024 : BDS Boston manifeste devant Elbit.
-
le 29 juin 2024 : 100 militant·es marchent jusqu’à la maison de Peter Palandjian pour une manifestation bruyante. Palandjian est le PDG d’Intercontinental Real Estate, le bailleur louant des bureaux à Elbit à Cambridge.
-
le 3 juillet 2024 : BDS Boston manifeste devant Elbit.
-
le 12 juillet 2024 : Début de la semaine d’action de BDS Boston et du Mouvement de la jeunesse palestinienne. Plus de 100 personnes participent au dîner d’accueil et à l’atelier « Palestine 101 ».
-
le 13 juillet 2024 : BDS Boston ferme l’agence de la banque Chase de Harvard Square pour toute la journée. Les militant·es bloquent les entrées avec des chaînes humaines et des cadenas.
-
le 15 juillet 2024 : BDS Boston manifeste devant Elbit pendant 18 heures. Des ateliers sont organisés toute la journée. Le soir, le rassemblement se transforme en veillée pour les martyrs, puis en projection de film. Les militant·es occupent l’intersection devant le bureau durant toute la durée de l’action.
-
Fin juillet 2024 : Des militant·es organisent une manifestation bruyante devant la maison de Peter Palandjian à 2 heure du matin.
-
le 24 juillet 2024 : BDS Boston manifeste devant Elbit.
-
le 31 juillet 2024 : BDS Boston manifeste devant Elbit.
-
le 7 août 2024 : BDS Boston manifeste devant Elbit.
-
le 14 août 2024 : BDS Boston manifeste devant Elbit.
-
le 21 août 2024 : BDS Boston manifeste devant Elbit.
-
le 26 août 2024 : BDS Boston manifeste devant Elbit.
-
le 2 septembre 2024 : BDS Boston appelle à une marche et un rassemblement devant le bureau d’Elbit pour célébrer la résiliation anticipée du bail.

Des manifestant·es solidaires avec la Palestine défilent devant le Massachusetts Institute of Technology le 2 septembre 2024.
29.09.2025 à 23:33
Dans le sillage de la révolution, un nouveau Népal émerge : En luttant contre la corruption, la « génération Z » développe une conscience politique
CrimethInc. Ex-Workers Collective
Texte intégral (4165 mots)

Exacerbée par les violences policières, une vague de protestations au Népal s’est transformée en une insurrection spontanée qui a culminé le 9 septembre 2025 avec le renversement du gouvernement. Pour faire suite à notre entretien avec Black Book Distro de Katmandou, nous avons cherché à mieux comprendre le contexte qui a conduit à la révolution et les formes qu’elle a prises auprès d’une journaliste népalaise actuellement basée au Portugal, Ira Regmi.
Le 8 septembre 2025, le Népal a connu une révolution lorsque des milliers de jeunes, principalement issus de la génération Z, sont descendu·es dans la rue pour manifester. Cette action collective a été réprimée brutalement par l’État, entraînant un massacre de manifestant·es et d’étudiant·es vêtu·es de leur uniforme scolaire et issu·es de la classe ouvrière. Le bilan actuel s’élève à 74 morts, dont trois policiers et environ 10 personnes incarcérées.
La cause plus large du mouvement trouvait ses racines dans l’opposition à la corruption ; elle peut être comprise comme l’aboutissement des mouvements « Enough is Enough » (Ça suffit / Trop c’est trop) menés par les jeunes en 2019. Le catalyseur immédiat de cette action est apparu quand des militant·es de la génération Z ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux dénonçant la consommation somptuaire des enfants des élites politiques, arguant que ce mode de vie était subventionné par les fonds publics. Le hashtag #Nepobaby a rapidement gagnée en popularité sur les plateformes numériques et la censure qui s’en est suivie de la part du gouvernement, en bloquant notamment 26 plateformes de réseaux sociaux, a provoqué des manifestations généralisées. Seules cinq plateformes autorisées sont restées accessibles : Viber, TikTok, Nimbuzz, WeTalk et Popo Live. Les créateurs et créatrices de contenu ont signalé que TikTok et d’autres plateformes supprimaient activement toutes critiques anti-gouvernementales. Cette répression a intensifié la prise de conscience, poussant les organisatrices et organisateurs à exploiter d’autres canaux de communication et à contourner la censure étatique en utilisant des VPN, accélérant ainsi la mobilisation au-delà de la capacité du régime à la réprimer.
Dans un acte solennel qui a marqué le début de la justice révolutionnaire, le gouvernement provisoire nouvellement formé, dirigé par le Premier ministre Sushila Karki, a officiellement déclaré que les manifestant·es tombé·es pendant les manifestations étaient à présent des martyrs de cette lutte. L’État a rendu hommage aux défunt·es lors d’une cérémonie officielle et nationale de crémation et a proclamé le 17 septembre comme étant une journée de deuil national. Leur sang a sanctionné la naissance d’un nouveau Népal, et leur mémoire inspirera à jamais les transformations révolutionnaires à travers le monde. Cependant, le peuple a clairement fait savoir que les commémorations à elles seules ne suffisaient pas et que la responsabilité de l’État dans les violences perpétrées restait non négociable.
Le mouvement de la génération Z au Népal représente d’une part une rupture fondamentale avec l’accord politique post-2006 qui gouvernait le pays depuis l’abolition officielle de la monarchie et d’autre part, incarne une opposition majeure face aux fondements structurels de la corruption institutionnelle au Népal.
Cet article examine les conditions matérielles qui ont conduit à cette mobilisation massive et s’interroge sur les questions constitutionnelles, politiques et sociales qu’elle a soulevées. Des explications détaillées sur le déroulement exact des événements sont également disponibles dans les récits de journalistes indépendant·es et de créatrices et créateurs de contenu sur les réseaux sociaux.

Photo de Sulav Shrestha
Violence d’État, réponse révolutionnaire et le capital pris pour cible
Comme toujours, la violence est venue de l’État. Le gouvernement a exacerbé les manifestations pacifiques par une répression brutale, tirant sans discernement sur la foule, tirant à balles réelles directement dans la tête ou la poitrine de jeunes vêtu·es de leur uniforme scolaire. Cette brutalité, qui a causé le plus grand nombre de morts en une seule journée de manifestation au Népal, n’était pas un cas isolé. Elle représentait la violence systématique par laquelle l’État népalais a maintenu son pouvoir ces dernières années, réprimant régulièrement toute forme de dissidence par la force létale.
Le lendemain, la colère accumulée par la population s’est manifestée sous la forme d’actions directes contre les symboles et les infrastructures du pouvoir et du capital. Les manifestant·es ont pris pour cible les institutions publiques, notamment le Parlement, les bâtiments administratifs du gouvernement, la Banque centrale et la Cour suprême. Les domiciles et entreprises des élites politiques et économiques ont également été visés de manière ciblée. La vallée de Katmandou s’est revêtue d’une épaisse fumée noire lorsque les manifestant·es ont donné libre cours à leur rage révolutionnaire, incarnant le slogan « brûlons tout » et transformant ainsi l’horizon de la capitale en une véritable carte postale aux allures de défi.
Parmi les entreprises visées, le groupe Choudhary, NCELL et la chaîne de supermarchés Bhatbhateni ont subi des dommages importants, avec notamment 12 des 24 magasins Bhatbhateni qui ont été entièrement détruits. Les magnats des affaires ont rapidement publié des déclarations soulignant leur résilience, mais il est à noter qu’ils n’ont fait preuve d’aucune introspection significative quant aux raisons pour lesquelles ils ont été spécifiquement pris pour cible par la colère populaire.
Le ciblage généralisé de la classe millionnaire népalaise, associé aux objections libérales contre la destruction de biens, montre l’importance d’une analyse anticapitaliste radicale dans le cadre de ce soulèvement historique. Les industriels pris pour cible par les masses d’individus sont clairement identifiés et exposés comme étant les ennemis de classe de la jeunesse révolutionnaire, car leur richesse repose sur l’exploitation et la corruption. La dynastie des Choudhary est accusée d’avoir dissimulé des actifs dans des paradis fiscaux au Panama, d’avoir orchestré des fraudes à l’assurance et d’avoir illégalement saisi des usines appartenant à l’État. De même, Min Bahadur Gurung, propriétaire de l’empire Bhatbhateni, a participé au vol de terres publiques et s’est rendu coupable d’une fraude à la TVA d’un montant total avoisinant les 1 milliard de roupies népalaises. NCELL a été impliqué dans le plus grand scandale de fraude fiscale et de blanchiment d’argent du pays. L’imbrication entre le capital privé et l’appareil politique corrompu du Népal, où la richesse achète la politique et la protection, exige un examen critique implacable, tout comme l’immoralité fondamentale d’une telle accumulation obscène de richesses.
Si des provocateurs contre-révolutionnaires ont sans aucun doute participé à ces événements et méritent une analyse et une enquête rigoureuses, une grande partie des destructions de biens publics et privés résultait d’une véritable indignation populaire. Les demandes urgentes d’apaisement après la démission du Premier ministre étaient critiques, d’autant plus que des preuves concluantes confirment désormais que des factions violentes pro-monarchistes et du parti traditionaliste ont délibérément provoqué la plupart des troubles pendant la seconde moitié de la journée du 9 septembre.
Cependant, nous avons également été témoins d’une inquiétude bourgeoise indéniable face aux dégâts matériels, ce qui témoigne du caractère classiste de ces critiques. La tendance libérale à assimiler la destruction de la propriété capitaliste à des violences contre les personnes constitue une profonde méconnaissance de la pratique révolutionnaire et masque le véritable nature des violences commises contre le peuple népalais.

Photo de Sulav Shrestha
Le spectre de la corruption
Comme l’écrit le journaliste indépendant Pranay Rana dans son bulletin d’information Kalam Weekly, « la campagne reflétait une frustration plus généralisée à l’égard du statu quo » et trouvait son origine dans la nature systémique de la corruption publique au Népal. Parmi les principaux exemples de scandales de corruption, on peut citer l’enregistrement frauduleux de citoyen·nes népalais·es en tant que réfugié·es bhoutanais pour leur réinstallation dans un pays tiers, les irrégularités dans l’attribution de contrats pour la construction de l’aéroport international de Pokhara, le transfert systématique de terres publiques à des entités privées et le scandale de la distribution d’électricité, dans le cadre duquel les autorités ont fourni une alimentation électrique ininterrompue à des intérêts commerciaux tout en soumettant le population à des coupures de courant pouvant aller jusqu’à 18 heures par jour.
Mais la question de la corruption ne se limitait pas seulement aux scandales impliquant des personnalités politiques de premier plan. La corruption imprègne la société civile à travers la normalisation des pots-de-vin dans tous les milieux professionnels et la distribution systématique des nominations institutionnelles, allant des postes ministériels aux postes au sein des rectorats d’université, sur la base de réseaux de favoritisme plutôt que du mérite. Ces conditions ont entraîné une profonde aliénation parmi les individus. Dans les sphères professionnelles, industrielles et bureaucratiques du Népal, la corruption érode la société comme la rouille ronge le métal.
L’ancienne administration dirigée par KP Oli a encore accéléré cette aliénation en affichant des tendances de plus en plus autoritaires, masquées par une rhétorique hypernationaliste. Pendant ce temps, les soi-disant partis d’opposition se sont entendus avec les partis au pouvoir pour mettre en place un système de gouvernance à présidence tournante, un arrangement cynique dans lequel ils ont convenu de se partager à tour de rôle le pouvoir exécutif du pays, vidant ainsi de son sens toute prétention à la démocratie.

Photo de Sulav Shrestha
La pratique révolutionnaire face à la crise constitutionnelle
La tension entre le constitutionnalisme bourgeois et la nécessité révolutionnaire est apparue comme la contradiction centrale de cette lutte. Une génération d’activistes, principalement composées d’adolescent·es et de jeunes adultes d’une vingtaine d’années, a été confrontée à de profondes questions constitutionnelles en l’espace de quelques jours, tandis que les juristes établis ont largement rejeté les impératifs révolutionnaires comme étant fondamentalement inconstitutionnels.
La Constitution népalaise, elle-même issue d’un mouvement de masse, bien que mené par des partis politiques, représente la cristallisation d’un compromis politique qui a établi un ordre démocratique formel. Cependant, ce cadre constitutionnel trahit l’imagination limitée de ses architectes, qui étaient pour la plupart des membres des partis politiques traditionnels ainsi qu’une élite intellectuelle qui n’avait peut-être jamais envisagé (ou avait bien imaginé et voulu éviter à tout prix) un scénario dans lequel la légitimité populaire pourrait se détourner de leur pouvoir. Par conséquent, le document ne prévoit pas de modalités pour la mise en place de gouvernements par intérim lorsque les conditions politiques l’exigent. Cette absence structurelle révèle que la fonction première de la Constitution était de réguler la concurrence entre les élites plutôt que de faciliter une véritable souveraineté populaire.
L’une des causes fondamentales de cette révolution a été l’érosion totale de la confiance dans les pouvoirs exécutif et législatif. Or, toute voie strictement constitutionnelle, telle que définie par les élites juridiques, impliquerait nécessairement le pouvoir législatif, c’est-à-dire l’institution même dont la dissolution était l’une des principales revendications révolutionnaires. Telle qu’elle est rédigée, la Constitution donne la priorité aux tentatives de formation d’un gouvernement au sein du Parlement existant, en combinant certaines des étapes suivantes : 1) Plus de 50% des parlementaires soutiennent la dissolution, 2) Soit une session parlementaire formelle, soit l’exécutif recommande la dissolution au président. La réalité empirique a toutefois rendu ces voies impossibles. Le pouvoir exécutif et la plupart des 275 membres du Parlement étaient impliqués dans des formes d’exploitation et de corruption systématique, liés par leur loyauté de classe à l’establishement politique parasitaire que les individus avaient renversé à juste titre.
En conséquence, le mouvement a avancé une interprétation de la légitimité constitutionnelle qui remettait en cause le monopole de la classe dirigeante sur sa signification, donnant aux individus les pouvoir de mettre en place un gouvernement intérimaire tout en dissolvant le Parlement. De jeunes juristes ont correctement identifié plusieurs voies d’interprétation permettant de mettre en place un gouvernement intérimaire sans abandonner complétement la Constitution. Ils et elles ont rappelé aux individus et aux avocat·es chevronné·es que la Constitution existe pour servir le peuple et non l’enfermer dans un système corrompu.
Le travail opportun d’éducation publique et de sensibilisation mené par l’avocat Ojjaswi Bhattarai, en collaboration avec un groupe d’autres jeunes universitaires et d’influenceuses et influenceurs sur Internet, a permis au mouvement de maintenir la continuité constitutionnelle. Ils et elles ont défendu ces interprétations en invoquant une doctrine qui permet de rendre temporairement inopérantes (ou « éclipsées ») certaines parties spécifiques d’une constitution lorsque des circonstances extraordinaires rendent leur application normale impossible. Ils et elles ont également fait valoir que, puisque la révolution reflétait sans ambiguïté la volonté collective des individus, cette volonté pouvait prévaloir sur d’autres impératifs juridiques formels. Il ne fait aucun doute que le mouvement a clairement démontré le mandat populaire en faveur de la formation d’un gouvernement intérimaire et de la dissolution du Parlement, fondant ainsi sa réinterprétation constitutionnelle sur une véritable légitimité démocratique.

Des écolier·ères passent devant les restes calcinés d’un bus à Katmandou le 15 septembre 2025, jour de la réouverture des écoles. Photo de Narendra Shrestha.
Expérimentations démocratiques et la lutte pour le contrôle du discours
Ces discussions juridiques et stratégiques se sont principalement déroulées dans des espaces numériques, donnant lieu à des formes sans précédent de pratique démocratique. Plus de 120 000 jeunes népalais se sont mobilisés via Discord pour désigner collectivement le candidat au poste de Premier ministre par intérim – une expérience radicale de démocratie directe dans laquelle les individus ont créé de nouvelles formes d’organisation au-delà des contraintes des structures politiques bourgeoises. Après la nomination de Sushila Karki, des collectifs de jeunes ont organisé des réunions publiques afin de tracer la voie à suivre.
À l’heure actuelle, plusieurs groupes s’unissent pour formuler un programme révolutionnaire officiel assorti de revendications concrètes et des moyens nécessaires pour mettre en place de nouvelles institutions responsables qui servent véritablement les intérêts des individus. Il existe également des groupes anarchistes qui s’efforcent de renforcer la solidarité au sein de la gauche népalaise et s’engagent à s’organiser en dehors des normes hiérarchiques traditionnelles.
Cette expérimentation démocratique via les plateformes numériques a posé des défis, même pour les révolutionnaires, notamment concernant la surveillance étatique, la répression numérique, l’infiltration et la tendance de ces plateformes à devenir des machines de propagande qui détournent la volonté exprimée par le peuple. Cet exercice a constitué une rupture si fondamentale avec les normes démocratiques libérales que les participant·es ont naturellement connu une certaine désorientation au départ.
De plus, comme le soulignent les rédacteurs et rédactrices de la newsletter Cold Takes by Boju Bajai, les médias traditionnels ont eu beaucoup de mal à interpréter ces événements, car de nombreux journalistes chevronné·es ne connaissaient même pas les bases de plateformes numériques telles que Discord. Alors que Kantipur TV continuait à diffuser ses programmes malgré l’incendie de son siège social, les conglomérats médiatiques ont également révélé leur caractère de classe en continuant à couvrir des formations politiques obsolètes, sans comprendre que les conditions matérielles du discours avaient fondamentalement changé du jour au lendemain.
Un contraste est apparu entre la conscience révolutionnaire qui se développait chez les jeunes sur Discord et Instagram et les tendances réformistes qui prévalaient sur des plateformes telles que Facebook et Twitter. La bourgeoisie et les générations plus âgées, qui avaient monopolisé le discours politique pendant des décennies, ont été déconcertées par cette transformation, incapables de comprendre que leur hégémonie sur l’expression politique avait été définitivement brisée.
Dans le même temps, si cette révolution numérique a amplifié les voix des jeunes, auparavant marginalisées, elle a également été source d’exclusion, laissant de côté les générations plus âgées et celles qui n’ont pas accès à la technologie.

Un garçon regarde une fresque murale réalisée par les artistes Riddhi Sagar et Somic Shrestha, représentant la chaussure blanche de Prakash Bohara, 28 ans, abattu lors des manifestations au Népal. Photo de Skanda Gautam et Sahana Vajracharya.
L’inclusion radicale signifie classe, caste et genre
Si ce mouvement révolutionnaire a représenté une rupture significative dans l’ordre politique, des éducatrices et éducateurs et autres militant·es tels qu’Ujjwala Maharjan, Anjali Shah et Tasha Lhozam ont souligné qu’il restait incomplet tant qu’il ne s’attaquait pas aux contradictions fondamentales liées à la caste, à la classe sociale et au genre qui structurent la société népalaise.
Critiquer la corruption sans remettre en question l’immoralité inhérente à l’accumulation du capital revient à confondre les symptômes avec la maladie. La classe politique actuellement critiquée pour son népotisme et sa corruption a inévitablement tenté de blanchir sa fortune obscène en la présentant comme légitimement acquise, avec l’aide de l’économie orthodoxe bourgeoise. Cette manœuvre contre-révolutionnaire ne peut réussir que si le mouvement révolutionnaire ne parvient pas à affronter la vérité dérangeante selon laquelle de nombreuses aspirations au sein de ses propres rangs restent contaminées par les fantasmes capitalistes d’avancement individuel dans les structures existantes. Sans une critique du capitalisme lui-même, ce moment révolutionnaire risque de sombrer dans un simple réformisme.
Une conscience véritablement révolutionnaire doit synthétiser l’anticapitalisme et l’opposition militante aux hiérarchies de castes et à l’asservissement patriarcal, tout en défendant une perspective abolitionniste. Nous ne devons jamais oublier que parmi les défunts figuraient des jeunes incarcérés dont la mort aux mains des forces de l’État alors qu’ils tentaient d’échapper à des conditions de détention brutales constitue un meurtre de classe. Le concept même de centres de détention pour mineurs représente l’individualisation des problèmes sociaux. Le crime lui-même doit être compris non pas comme un échec moral individuel, mais comme le résultat prévisible des conditions matérielles créées par les relations sociales. La volonté de réhabiliter les institutions de violence étatique – illustrée par celles et ceux qui se sont empressé·es de restaurer les infrastructures policières – révèle une contamination idéologique persistante issue de la politique de respectabilité. L’humanisme révolutionnaire exige l’abolition, et non la réforme, de ces institutions carcérales.
Enfin, la prolifération spontanée de drapeaux trans et queer sur le serveur Discord a révélé le caractère progressiste latent du mouvement. Ce mouvement, bien qu’il présente un front uni, contient en son sein des expériences matérielles diverses : peuples autochtones, communautés opprimées par le système des castes et minorités sexuelles dont les formes spécifiques d’exploitation doivent être articulées dans un programme révolutionnaire cohérent. Les éléments historiquement privilégiés du mouvement – les jeunes cisgenres, hétérosexuels, masculins et issus des castes supérieures – doivent s’engager dans une autocritique implacable concernant leurs privilèges accumulés. Ce n’est que grâce à ce processus qu’une avant-garde anticapitaliste intersectionnelle pourra émerger de ce moment historique de radicalisation massive.
Les prochaines élections exigent que le peuple népalais se rallie derrière un parti non traditionnel qui défend véritablement la vision révolutionnaire de la génération Z et s’oppose directement à l’appareil politique en place. Ce n’est qu’en obtenant la majorité parlementaire que les jeunes pourront se libérer d’un paysage politique corrompu. Si cette majorité n’est pas atteinte, le Népal risque de rester sous la domination de la même classe dirigeante pendant encore plusieurs décennies.
24.09.2025 à 00:08
ICE hors de l’Illinois, ICE hors de nos vies : Un compte-rendu sur les blocages au centre de détention de Broadview
CrimethInc. Ex-Workers Collective
Texte intégral (4977 mots)

Après des efforts désordonnés pour réprimer les immigrants à Los Angeles, l’administration Trump a annoncé que Chicago serait la prochaine cible des attaques concentrées de l’agence américaine de contrôle de l’immigration et des douanes (ICE). Cette opération dite « blitz » se heurte déjà à une résistance. En juin 2025, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Chicago en solidarité avec la résistance en cours à Los Angeles ; dans le même temps, des manifestant·es de Seattle à Chicago ont tenté de bloquer les agents de l’ICE lorsqu’ils se sont présentés pour kidnapper des personnes lors d’audiences au tribunal. Aujourd’hui, les habitant·es de la région de Chicago cherchent à mener des actions stratégiques aux différents points névralgiques des opérations de l’ICE. Dans ce compte-rendu, les participant·es aux blocages visant un centre de détention de l’ICE près de Chicago racontent leurs expériences et partagent leurs premières conclusions.
Aux premières heures du 19 septembre, des personnes se sont rassemblées devant le centre de détention de l’ICE de Broadview, dans l’État de l’Illinois, une banlieue située à l’ouest de Chicago. Nous nous sommes réuni·es bien avant les mobilisations annoncées publiquement pour 7h du matin et plus tard dans la soirée, dans l’espoir d’intercepter les agents fédéraux en train de transporter dans leurs véhicules des personnes arrêtées et enlevées dans tout le Midwest.
Le centre de détention de Broadview contient environ 150 prisonnier·ères constamment ; il sert de plaque tournante pour les activités de l’ICE dans toute la région du Midwest. Les centres de détention de l’ICE de plus grande capacité sont illégaux dans l’Illinois, ce qui fait de cet endroit un goulet d’étranglement logistique pour le transport des prisonnier·ères. Les ressources fédérales allouées à ce centre ayant explosé pour satisfaire le désire de violence xénophobe des politicien·nes d’extrême droite, Broadview est devenu rapidement une infrastructure de plus en plus importante et essentielle dans la région.
Lorsque les manifestations ont commencé à Broadview, les petits groupes d’individus avaient initialement tendance à se livrer à des actes spectaculaires et auto-sacrificiels, consistant généralement à s’asseoir devant les fourgons de l’ICE qui quittaient le centre de détention, pour être ensuite évacués de force par la police de Broadview. À mesure que les reportages et images de chaque action se diffusaient et que la confiance dans l’efficacité de la résistance non-violente s’estompait, les mobilisations ont changé de forme : l’objectif principal de l’action est passé du sacrifice à la résistance. L’ICE a commencé à brutaliser et arrêter les manifestant·es à sa guise et les tentatives de bloquer les fourgons ont échoué ; en réponse, les foules d’individus matinales ont troqué leurs masques N-95 contre des équipements et tenues de black bloc et ont choisi de suivre les agents plutôt que de simplement s’asseoir devant le centre.
Il est claire qu’une approche plus proactive était nécessaire. Les efforts déployés le vendredi 19 septembre en ont été le résultat.

« Les agents de l’ICE sont la véritable menace ! »
Vendredi matin
Depuis plus d’une dizaine d’années, tous les vendredis à 7h du matin, des bus transportent les détenu·es du centre de Broadview vers l’aéroport international Gary/Chicago dans l’Indiana et, plus récemment, vers d’autres centres de détention du Midwest. L’établissement a réagi aux premiers actes de désobéissance civile télévisés en transférant les détenu·es de plus en plus tôt.
Nous nous sommes donc, nous aussi, réveillé·es plus tôt. Le 19 septembre, vers 4h30, une vingtaine de manifestant·es se sont rassemblé·es près du centre. Certain·es étaient vêtu·es de noir, d’autres portaient des vêtements plus classiques. Contrairement à la désobéissance civile sacrificielle des semaines précédentes, la plupart des personnes (à l’exception d’une prétendante au Congrès et de son équipe de presse) ont décidé de focaliser leur action sur le fait de se tenir debout devant un véhicule lorsque ce dernier entrait ou sortait du centre de détention afin de le bloquer. Ce changement de stratégie a permis à la petite foule de se déplacer comme l’eau.

Un agent de l’ICE se rendant à son travail au petit matin s’éloigne rapidement des manifestant·es.
Le premier fourgon qui a tenté de quitter Broadview a dû rebrousser chemin, car la plupart des personnes présentes l’ont encerclé pendant que trois autres se sont assises dans l’allée. L’énergie ambiante était palpable, et les personnes présentes ont suivi de près tous les agents qui quittaient les lieux, interpellant ceux qui se rendaient dans un parking voisin où se trouvaient des fourgons sérigraphiés de l’ICE, des voitures banalisées et des véhicules personnels des agents.
Pris au dépourvu par les lève-tôt, les agents étaient affolés, certains sprintant du parking jusqu’aux portes d’entrée du centre de Broadview. En réponse aux hués, ils se sont regroupés par groupes de trois ou plus pour se rendre ensemble et à pied jusqu’au centre. Certains ont enfilé leur équipement avant d’entrer. Cette lâcheté mérite d’être soulignée.

Un groupe de mercenaires entre dans le centre de détention.
L’enthousiasme des participant·es mantinaux·ales a donné le ton pour le reste de la journée. Alors que le soleil commençait à se lever, les agents à l’intérieur du bâtiment ont repris là où ils s’étaient arrêtés la semaine précédente. Vêtus d’équipements tactiques, certains se sont regroupés sur le toit, d’autres derrière le portail d’entrée.
Bloqués par la foule, les agents de l’ICE ont commencé à conduire leurs véhicules sur le trottoir pour contourner les manifestant·es. Il n’y avait tout simplement pas assez de monde, ni assez de préparation technique, pour bloquer ou arrêter les voitures à ce moment-là. La première arrestation de la matinée a eu lieu vers 6h, lorsqu’un fourgon essayant de quitter le centre a de nouveau été bloqué par des manifestant·es. Cette fois-ci, six agents des forces spéciales équipés de pistolets lanceurs de balles au poivre et d’un lanceur de gaz lacrymogène se sont précipités hors de l’enceinte. Ils ont attrapé les personnes au sol et les ont traînées plus loin ; une femme a été violemment jetée au sol et une autre personne a été traînée sur l’asphalte par deux agents avant d’être attrapée et transportée à l’intérieur du centre.
Alors que les agents reculaient vers le portail, l’un d’eux a tiré plusieurs balles au poivre sur les personnes qui se trouvaient dans l’allée. Les agents de l’équipe d’intervention spéciale (SRT) ont continué tout au long de la matinée à se précipiter pour escorter les véhicules qui entraient et sortaient du centre de détention.
Vendredi après-midi
Entre 7h et midi, l’ambiance des deux côtés de la clôture du centre a changé. Alors que de plus en plus de gardes entraient dans l’enceinte avec leur équipement et des seaux remplis de munitions, des tendances distinctes se sont manifestées au sein de la foule présente devant le centre de détention. Certains groupes chantaient, tandis que d’autres s’énervaient de plus en plus en voyant les manifestant·es se faire tirer dessus à plusieurs reprises avec des balles au poivre ou en se faisant traîner de force à l’intérieur du bâtiment. D’autres encore aidaient des familles à prendre contact avec leurs proches détenus dans le centre.
Les agents du SRT ont lancé des gaz lacrymogènes sur la foule pour la première fois aux alentours de midi, lors d’un affrontement au sujet de la sortie de fourgons. Les agents ont tiré des grenades lacrymogènes et des balles au poivre sur la foule avant de ramener de force un homme avec eux dans le centre. Peu d’individus étaient préparé·es à ces munitions chimiques et la foule a fini par se disperser dans la rue, tandis que certain·es aidaient des manifestant·es à se rincer les yeux et mettaient leur·es camarades les plus touché·es en sécurité. Dans l’après-midi, la foule présente à l’extérieur du centre de détention a diminué en nombre, les personnes se regroupant plus loin et attendant le début de la deuxième manifestation annoncée publiquement.

Des agents fédéraux appréhendent un manifestant à Broadview dans l’après-midi.
Vendredi soir
Une deuxième manifestation était prévue à 19h. Les images d’individus arrêtés et visés par des gaz lacrymogènes avaient fait le tour des médias et galvanisé de nombreuses personnes qui ne s’étaient pas encore rendues à Broadview.
Vendredi soir, des personnes ont rejoint le petit groupe d’individus qui restait après les manifestations de la journée. Tout au long de la soirée, deux ou trois agents sont restés sur le toit du centre, tirant par intermittence des balles au poivre sur les manifestant·es présent·es dans la rue. Vers 19h, alors que les manifestant·es se rassemblaient, une trentaine d’agents du SRT se sont regroupés derrière les grilles du centre de détention. Les manifestant·es leur ont demandé de libérer les centaines de personnes détenues à l’intérieur, ainsi que les manifestant·es arrêté·es plus tôt dans la journée.

Après une confrontation avec des manifestant·es devant l’entrée du bâtiment, Gregory Bovino, qui a dirigé l’invasion de Los Angeles par l’ICE, intervient avec des agents et tente de repousser la foule.
Après 19h, des boucliers sont arrivés. Une douzaine de militant·es les ont récupérés, mais la majorité de la foule est restée à distance. Reflétant peut-être la tendance de la semaine précédente où des actes symboliques avaient été menés par un petit nombre de personnes, il y avait un vide important entre le petit groupe d’individus à l’avant et les personnes qui observaient à l’arrière en maintenant leur distance, et il n’y avait aucune réelle compréhension organique de la nécessité pour les individus de participer activement à l’action derrière la ligne de front. Les personnes formant la ligne de boucliers ont commencé à interpeller la foule et à lui faire des signes, demandant aux journalistes de s’écarter et à tou·tes les autres participant·es de se regrouper pour prêter main-forte.
Les agents sont sortis en force vers 19h30. Les individus constituant la première ligne ont repoussé les premières vagues de munitions, affrontant un barrage de gaz lacrymogène, de balles au poivre et de grenades assourdissantes. Mais ils et elles ont été contraint·es de battre en retraite en raison de la combinaison des munitions dites « moins létales » des agents et de la désintégration de la foule derrière eux. Cela était compréhensible : tout le monde ne dispose pas d’équipement de protection, et même celles et ceux d’entre nous qui portaient des masques à gaz ont ressenti les effets du gaz. La plupart des individus présents dans la foule ne se soutenaient pas mutuellement ni ne soutenaient la ligne de boucliers.

Un mur de boucliers bloque les munitions anti-émeutes dans la nuit du vendredi 19 septembre.
La ligne de front ne peut pas être seulement composée d’un groupe de « spécialistes » qui agit seul tandis que les autres se contentent de documenter ou d’observer l’action. La spécialisation des compétences pertinentes, allant des techniques pour se laver les yeux suite aux attaques liées au gaz lacrymogène au soutien envers les prisonnier·ères, isolent les militant·es lorsque la pression monte. Une ligne de front bien organisée intègre les rôles offensifs avec le soutien nécessaire pour maintenir la résistance et mener à bien les objectifs fixés.
Mais alors que le fossé entre les « militant·es » perçu·es comme tel·les qui composent les premières lignes de l’action et les autres individus situés à l’arrière continue d’entraver une défense efficace, la tendance croissante à la résistance se situe bien au-delà. Nous voulons fermer Broadview, pas seulement symboliquement, mais complètement. La stratégie du spectacle repose sur l’idée que la brutalité répétée envers nos camarades finira par persuader ceux qui enlèvent nos voisin·es de cesser leurs opérations. Mais à mesure que les individus sont témoins de ces enlèvements et font l’expérience de la brutalité des « forces de l’ordre », beaucoup abandonnent progressivement cette approche. Certain·es pour qui la violence d’État était auparavant un concept abstrait, se retournent contre les mercenaires qu’ils et elles voient debout sur le toit du centre de Broadview, mercenaires qui les regardent à travers la lunette d’une arme et choisissent d’appuyer sur la gâchette.

Contrôle des foules
Les agents de l’ICE se sont révélés brutaux mais peu intelligents. À plusieurs reprises, ils semblaient perdus, fonçant dans la foule de manifestant·es avant de battre en retraite tout aussi rapidement. Malgré des conditions favorables, ils ne savaient pas comment nasser les manifestant·es. Lorsque les agents s’approchaient des manifestant·es, ils rompaient souvent les rangs et ne formaient plus qu’une seule ligne peu compacte. Utilisant des pistolets lanceurs de balles au poivre, ils tiraient de manière sporadique et aléatoire, souvent sans cible précise.
Les agents ont souvent reculé face aux manifestant·es, semblant ébranlés même par des slogans et chants peu convaincants. De même, les agents du SRT ont généralement évité de s’approcher trop près des manifestant·es et ce, malgré leur avantage significatif. Que ce soit par flemme, par confusion ou les deux, ils ont même hésité à arrêter celles et ceux qui tentaient activement d’empêcher les véhicules de sortir du centre de détention.
Ce n’est qu’une hypothèse, mais il faut rappeler que le centre est relativement petit, qu’il est utilisé en permanence et qu’il ne peut accueillir qu’environ 150 prisonnier·ères à la fois. Compte tenu de l’opération Midway Blitz et d’autres activités de l’ICE à Chicago et ses environs, il est probable que l’établissement fonctionne déjà à pleine capacité. Ceci, ajouté à leur manque apparent d’expérience en matière de contrôle des foules, a peut-être influencé la manière dont les agents de l’ICE et du SRT ont interagi avec les manifestant·es.

Une grenade assourdissante explose alors que les agents fédéraux attaquent le mur de boucliers.
Devenir proactif·ive
Si le courage dont nous sommes témoins vise à échapper à des affrontements de « spécialistes » et répétitifs avec des forces étatiques toujours mieux équipées, il faudra renoncer au spectacle médiatique pour mener des actions plus proactives contre les infrastructures de déportation. Nous devons définir ce que signifierait une victoire sur les agents et les installations de l’État et articuler la lutte pour la libération qui sous-tend le passage à une confrontation plus généralisée avec les représentant·es de l’État et du capital. Agir à cette échelle nécessite d’aller au-delà d’un groupe d’activistes spécialistes (sans parler des politicien·nes en herbe moins louables et plus clairement carriéristes) pour établir des relations avec celles et ceux qui vivent autour du centre de détention et, plus largement, avec tou·tes celles et ceux dont l’instinct est déjà de protéger les personnes contre l’ICE.
Partout dans le pays, les individus ont spontanément pris des mesures intelligentes et opportunes contre les raids de l’ICE dans leurs quartiers, agissant avant même que les militant·es spécialistes et les ONG n’arrivent pour les exhorter à se limiter à documenter les événements ou à témoigner. Plutôt que de compter sur des réseaux d’intervention rapide qui arrivent rarement à temps, compte tenu de la rapidité des raids, des actions plus proactives pourraient consister à cibler localement les différents points de passage névralgiques de la machine à expulser tels que Broadview ou, comme à Los Angeles, à mettre en place des centres de défense communautaires dans les zones sensibles où l’activité fédérale est intense. Toute stratégie efficace anti-ICE dépendra des actions des habitant·es qui choisissent d’intervenir directement dans leur quartier. Bien que les médias aient minimisé bon nombre de ces événements, les affrontements à Broadview ne sont possibles que grâce au courage de celles et ceux qui ont chassé l’ICE hors de leurs quartiers à Los Angeles, Chicago et partout ailleurs dans le pays.

Une fois le mur de boucliers dispersé, les manifestant·es restant·es avancent pour affronter les agents devant le portail du centre de détention.
Nous avons également besoin d’un développement tactique rapide. Étant donné que la police de Chicago a régulièrement recours à la stratégie de nasse, à la collaboration avec les organisateur·rices d’événements politiques et, lorsqu’elle le juge nécessaire, aux matraques, les habitant·es de Chicago sont moins bien équipé·es pour faire face aux gaz lacrymogènes que ne l’étaient les manifestant·es de Los Angeles. La situation évolue rapidement mais nous en tirons des leçons très importantes.
Nous avons constaté une ouverture d’esprit croissante en termes de tactiques. Au cours de la première phase de luttes contre l’ICE, des barricades plus ou moins solides ont été utilisées pour bloquer les quais de chargement d’un tribunal de l’immigration du centre-ville, retardant ainsi les expulsions prévues de plusieurs années. Pendant les actions à Broadview, empêcher les arrestations est devenu la norme, les boucliers sont désormais largement acceptés, l’utilisation d’équipements de protection tels que des masques respiratoires et des lunettes de protection est devenue courante, et les manifestant·es commencent à renvoyer les grenades lacrymogènes en direction des agents de l’ICE. Ces évolutions ne sont pas nécessairement liées à des engagements politiques particuliers ; nous voyons encore des personnes qui sont prêtes à retenir des agents de l’ICE ou à bloquer des véhicules, mais qui qui continuent malgré cela d’appeler chimériquement la police pour signaler les activités de l’ICE.
Les ONG et autres organisations cherchant à recruter
L’émergence d’une activité autonome visant à mettre fin aux expulsions montre qu’il est possible de sortir du cadre classique des longues marches qui ne mènent à rien organisées par les organisations traditionnelles cherchant à recruter, mais aussi de l’accent mis par les ONG sur l’aide juridique après que les arrestations en vue d’expulser les personnes concernées aient déjà eu lieu. Cette activité autonome s’est développée en grande partie parce que les ONG ont abandonné des lieux et des luttes clés.
La Coalition de l’Illinois pour les droits des immigrants et des réfugiés et les Communautés organisées contre les expulsions, les deux principales organisations à but non lucratif qui dominent la lutte contre les expulsions à Chicago, n’ont pas pris de mesures contre les expulsions répétées qui ont eu lieu au tribunal de l’immigration au début de l’été 2025, tandis que des groupes autonomes sont intervenus pour monter des barricades sur les quais de chargement, coordonner des campagnes téléphoniques, interpeller la direction, distribuer des tracts aux autres occupants du bâtiment et apporter leur soutien aux personnes qui comparaissaient devant le tribunal. Ces actions ont entraîné la fermeture du tribunal à plusieurs reprises, repoussant les audiences de plusieurs années, et ont finalement contraint la direction du bâtiment à révoquer l’accès de l’ICE à ses quais de chargement, mettant ainsi fin aux kidnappings à cet endroit. Cela ne se serait pas produit si les manifestant·es autonomes n’avaient pas bloqué le flux commercial entrant et sortant du bâtiment.
Au-delà des appels et des pétitions, les ONG ont également renoncé à toute action autour de Broadview. C’est l’un des facteurs qui a permis aux actions des semaines précédentes d’avoir lieu.

Un parapluie sert de protection improvisée pendant les affrontements.
Tensions internes
Lorsque les individus se sont mobilisés pour la première fois contre le centre de détention de Broadview il y a quelques semaines de cela, celui-ci n’avait pratiquement pas attiré l’attention du public, et certain·es se sont donc concentré·es sur la stratégie médiatique. Cela a provoqué des tensions, entre les infuenceur·euses des réseaux sociaux qui conseillaient de disperser la foule et les nuées de journalistes qui empêchaient les libérations et isolaient celles et ceux qui tentaient de protéger les militant·es visé·es par les arrestations. Celles et ceux qui ont le plus impliqué la presse et l’opinion publique dans leur activité ont fini par laisser cette attention entraver leur approche stratégique. S’il est clair que nous devons tenir compte de l’attention de la presse et du public dans nos mouvements, nous ne devons jamais compromettre l’objectif le plus prometteur du moment : chasser l’ICE partout.
Si les manifestant·es ont prouvé qu’ils et elles pouvaient rassembler et constituer une masse critique, ils et elles ont parfois limité leur propre efficacité. Dans les semaines qui ont précédé le 19 septembre, les messages concernant les efforts visant à fermer Broadview ont été repris par toute une série de personnes et d’organisations qui, présumant qu’elles savaient mieux que quiconque, ont utilisé des notions telles que « sécurité » et « visibilité » pour discipliner les manifestant·es à leur propre avantage. En partant du principe que le seul objectif envisageable de ces manifestations était de dire la vérité au pouvoir, plutôt que de fermer Broadview, les individus n’étaient pas préparés aux affrontements qui ont suivi. Dans la nuit du 19 septembre, alors que « fermer le centre » signifiait prendre de sérieux risques, celait signifiait aussi qu’il n’y avait pas de deuxième ligne pour soutenir le mur de boucliers. Sans soutien, la ligne de front ne pouvait pas tenir, ce qui a donné aux unités SRT l’occasion de traquer les manifestant·es dispersé·es.
Néanmoins, grâce à des manifestations régulières et à la couverture médiatique, les habitant·es des zones voisines ont commencé à se mobiliser. Sans financement ni soutien d’aucune organisation ou coalition de renom, la lutte pour fermer le centre de détention de Braodview repose sur le courage de personnes ordinaires.

Le parapluie d’un·e manifestant·e montre les effets des balles au poivre.
Le fiasco de la fermeture
Au moment où cet article était rédigé, une série de fuites provenant du département de la sécurité intérieure (DHS) suggérait que le centre de détention de Broadview était temporairement fermé. Une situation similaire s’était produite auparavant au centre de détention de Delaney Hall, dans le New Jersey, après que des manifestant·es l’aient bloqué et finalement envahi, mais ce site avait repris ses activités quelques mois plus tard avec des mesures de sécurité renforcées.
Cependant, à la suite d’un scandale public impliquant une secrétaire adjointe du DHS et des déclarations enthousiastes de victoire de la part d’organisations qui n’avaient pas été particulièrement visibles sur le terrain, il a été officiellement confirmé que le centre de détention de Broadview resterait ouvert. Depuis le matin du 23 septembre, le centre de détention est bloqué par de hautes clôtures métalliques, vraisemblablement pour empêcher les manifestant·es d’accéder à ses portes d’entrée et de sortie, et les affrontements se poursuivent à l’extérieur. Les bus que nous avons vus quitter les lieux pour se rendre à l’aéroport de Gary/Chicago transportaient des détenu·es qui avaient été contraint·es de signer des documents d’auto-expulsion.
D’une part, nous savions depuis un certain temps que le centre de détention avait atteint sa capacité maximale. Il s’agit d’un bâtiment relativement petit avec un nombre limité de lits, ce qui en fait un point vulnérable pour l’ensemble du dispositif d’expulsion dans l’Illinois et les États voisins. D’autre part, la succession confuse d’événements qui a abouti au maintien de l’activité du centre de détention suggère un désordre interne. Cela correspond aux informations que nous avons recueilles à l’intérieur même du centre, selon lesquelles bon nombre des mercenaires impliqués travaillent ensemble pour la première fois, souvent dans des buts et objectifs contradictoires.
Il est possible qu’à un certain niveau de la bureaucratie de l’ICE et du DHS, la décision ait été prise d’éviter une situation du type Delaney Hall et d’améliorer la sécurité, mais les hauts responsables ont rejeté cette suggestion et insisté pour que le centre reste en service. Quoi qu’il en soit, il est clair que, d’une certaine manière, ce que nous faisons fonctionne. Cela crée des situations stressantes et chaotiques pour nos ennemis, ce qui conduit à des conflits internes. Le seuil d’efforts nécessaires pour réussir est peut-être plus bas que nous le pensions, et nos ennemis plus craintifs que nous l’avions prévu. Dans le même temps, la bureaucratie fédérale, lente et incompétente, est régulièrement confrontée à des conflits internes de ce type, et nous devrions chercher à en tirer parti.
ICE hors de nos vies !

Le combat n’est pas terminé ! Continuons d’avancer et abattons les murs !
23.09.2025 à 00:10
Des anarchistes népalais sur le renversement du gouvernement : Entretien avec Black Book Distro
CrimethInc. Ex-Workers Collective
Texte intégral (4103 mots)

Au Népal, un mouvement de protestation début septembre 2025 s’est transformé en une insurrection spontanée en réponse à la violence policière, aboutissant à l’incendie du parlement et d’une série de bureaux gouvernementaux, de commissariats, de sièges de partis et de manoirs de politiciens. En un jour et demi, le Premier ministre Khadga Prasad Oli a pris la fuite et le gouvernement s’est effondré. Mais renverser un gouvernement n’est que la première étape d’une lutte beaucoup plus longue ; dans cette agitation, les monarchistes, les néolibéraux et les antiautoritaires se disputent pour déterminer l’avenir du Népal. Pour mieux comprendre le contexte de l’insurrection et les dynamiques qui en découlent, nous avons interviewé Black Book Distro, un collectif anarchiste qui fait tourner une bibliothèque à Katmandou.
L’insurrection au Népal fait partie d’une série de soulèvements qui ont balayé l’Asie ces dernières années. Nous pouvons remonter la piste des événements à 2022, et le renversement du président du Sri Lanka, en a suivi le soulèvement de 2024 au Bangladesh et celui en Indonésie en août 2025, sans parler de la guerre civile en cours au Myanmar. Depuis la chute du gouvernement népalais, d’immenses manifestations ont également éclaté aux Philippines. Cette série d’actions et de mobilisations répondent aux difficultés économiques généralisées et à l’échec des promesses des politiciens.
La complicité des partis communistes institutionnels dans le massacre qui a catalysé le soulèvement devrait rappeler à tous les révolutionnaires en herbe qu’il est impossible de résoudre les problèmes du capitalisme simplement en utilisant la violence de l’État—même si vous avez « communiste » au nom de votre parti. Les impasses que le capitalisme crée pour les gens exigent des changements radicaux. On ne peut pas régler indifiniment les problèmes avec des flics et des réformes négociées dans les couloirs du pouvoir.
De même, cette insurrection devrait faire réfléchir les politicien-nes et les polices du monde entier qui imaginent qu’ils peuvent piller et terroriser en toute impunité. Aujourd’hui, l’argent qu’ils obtiennent peut les protéger des conséquences de leurs actes—mais demain, tout est possible.
Aucune de ces révoltes n’a encore atteint tous ses objectifs, mais alors que les gens du monde entier luttent contre l’oligarchie et la répression étatique, chacune d’elles offre des leçons.

Comme l’a dit un commentaire sur Bluesky : Juste un jeune homme portant la peau de l’ennemi.
Parlez-nous de vous. Qui êtes-vous et que faites-vous ?
Nous sommes Black Book Distro, un collectif et une bibliothèque anarchiste basé à Katmandou, au Népal, dédié à la politisation par l’éducation sur l’histoire de la gauche ainsi qu’un engagement actif dans les luttes et mouvements populaires qui nous semblent alignés avec nos objectifs (la protestation de Gen Z, le mouvement Meter Byaj,1 mouvement Guthi.2 Nous vous parlons en tant que mouvement anarchiste sous la répression d’un régime communiste défaillant et d’un Congrés corrompu.

La Black Book Distro propose des lectures et du matériel en anglais durant un festival anarchiste au Népal.
Pouvez-vous nous donner un bref aperçu des mouvements sociaux et des luttes au Népal au cours de la dernière décennie ou des deux dernières années. Quelles ont été les principales préoccupations à l’origine des soulevments populaires ?
Suite à la révolution maoïste,3 le Népal a connu des vagues de bouleversements sociaux, économiques, géographiques et politiques. Les principaux problèmes se situent autour de la discrimination rampante des castes, une épidémie mortelle de trafic de travailleurs migrants alimentée par le manque d’opportunités chez eux, des conflits frontaliers routiniers avec nos voisins dotés d’armes nucléaires, et une corruption politique si intense qu’elle a permis aux monarichistes partout dans le pays de faire un retour en force terrifiant.
Les mouvements populaires pour le changement ont inclus la lutte madhesh pour les droits et la dignité,4 des manifestations contre la corruption à l’époque du COVID sous la bannière « Enough Is Enough » , des belligérences nationalistes sur des zones frontalières comme Lipulekh,5 Des grèves de la faim du Docteur KC pour améliorer les infrastructures sanitaires,6 les résistances aux investisseurs parasites, et la défense des terres communales appartenant au peuple Newar. Ces luttes sont motivées par un tissu social complexe encore empreint par le patriarcat, la caste et la religion, au milieu des efforts constitutionnels vers la représentation, la liberté d’expression, la liberté économique et le fédéralisme.
Le Congrès, les partis maoïstes et marxistes-léninistes, ainsi que des factions royalistes sont les principales organisations politiques. En dessous de cela se trouvent des groupes de jeunes autonomes, des espaces gauchistes et des groupes communautaires autochtones. Historiquement parlant, la plupart des manifestations ont été dirigées ou influencées par les grands partis politiques, bien que les initiatives spontanées de la jeunesse et de la base aient agi de manière de plus en plus indépendante (y compris le récent « soulèvement de la génération Z »).

« Des balles réelles ont été utilisé aujoud’hui sur la foule. On était devant, on a vu des gens se faire tuer ».
Comment comprenez-vous les objectifs des participants de la base dans ce soulèvement ? Y a-t-il plusieurs courants avec des objectifs différents ou contradictoires ?
Le mouvement actuel « Gen Z » a ses racines dans le mouvement « Enough Is Enough » mené par des jeunes en 2019, qui se concentrait sur la justice sociale et les questions environnementales au milieu de la mauvaise gestion des revenus pendant la crise du COVID-19. Ce soulèvement initial consistait en plusieurs groupes autonomes soutenus par des citoyens ordinaires, des libéraux et des gens issus de l’extrême gauche, sans direction centrale. Depuis lors, le gouvernement n’a cessé d’intensifier sa surveillance en ligne et ses répressions totalitaires sur la jeunesse, alimentant le mouvement pour devenir ce qu’il est aujourd’hui. Leurs principales revendications sont plus de liberté d’expression, des mesures de lutte contre la corruption et la mise en place d’un gouvernement dont le rayon d’action sera hors de la main mise des différents partis corrompus.
La fusillade mortelle de manifestant-es pacifiques, y compris des étudiant-es inspirés par la philosophie de la série animée « One Piece », a déclenché une indignation générale.

Des manifestants au Népal exibent le drapeau pirate de « One Piece », devenu un symbole de la révolte indonésienne.
L’insurrection a été décentralisée et spontanée, culminant dans l’incendie du parlement et de la plupart des bureaux gouvernementaux, des maisons de politiciens, des commissariats de police et des sièges de partis, provoquant la chute du gouvernement en moins de 35 heures. Divers courants existent au sein du mouvement : les monarchistes cherchant à restaurer le roi sur le trône, les centristes visent quant à eux de à gagner en influence au sein d’un nouveau gouvernement néolibéral, et les radicaux d’extrême gauche poussent pour un fédéralisme authentique, la laïcité et la participation inclusive des communautés marginalisées. Cette multiplicité d’objectifs reflète les aspirations et tensions complexes au sein du mouvement.
Comme nous le comprenons ici de très loin, les communistes au Népal ont mené un mouvement de résistance pendant de nombreuses années avant de prendre le pouvoir en 2006. Nous avons l’impression que les conflits internes au sein du mouvement révolutionnaire dans son ensemble ont abouti à une série de compromis entre les communistes et la classe dirigeante népalaise. Comment ces compromis ont-ils affecté la société népalaise, en particulier les mouvements de la base plus radicale qui a participé à la lutte populaire, ainsi que les syndicats et d’autres groupes ?
Le succès de l’insurrection maoïste reposait sur son opposition aux vestiges du système « Panchayat », une structure agricole féodale d’oppression par des élites de la caste supérieure alliées à la monarchie sur l’ensemble de la population, qui avait été officiellement abolie en 1990. Cependant, une fois au pouvoir, de nombreux dirigeants maoïstes ont compromis leurs objectifs révolutionnaires pour maintenir le contrôle, en adoptant progressivement des pratiques capitalistes qui reflètent le même système d’oppression qu’ils prétendent avoir détruit. Ces compromis ont sapé leur crédibilité auprès des masses, et les maoïstes sont maintenant largement considérés comme des politiciens corrompus plutôt que comme des révolutionnaires.
Pendant ce temps, les violations des droits de l’homme par les forces militaires et policières ont été généralisées, et la justice reste insaisissable pour les victimes de toutes parts. L’image ternie des politiques de gauche a donné de l’espace au mouvement monarchiste ; même le récent mouvement Gen-Z a intentionnellement interdit aux partis politiques et aux syndicats de participer, craingant que ces entités imposent des programmes égoïstes. En même temps que ça a protégé l’intégrité du mouvement, cela a rendu plus difficile l’organisation pour les gauchistes plus anciens. Heureusement, le mouvement anarchiste émerge tranquillement, avec une acceptation croissante, malgré certaines idées fausses assimilant l’anarchisme au chaos.

Une voiture de police calcinée est abandonée sur la place Patan Durbar le 9 septembre 2025.
Comment la coalition au pouvoir a-t-elle émergé ? Comment comprenez-vous la différence entre les deux partis communistes, et quel est le rôle du Parti du Congrès dans la coalition au pouvoir ?
La coalition au pouvoir a émergé pour obtenir une majorité parlementaire dans un système multipartite fragmenté après la guerre. Les deux partis communistes ont adopté la corruption et les pratiques capitalistes, l’UML [le Parti communiste du Népal (Marxiste unifié–léniniste)] étant actuellement le plus organisé des deux. En raison de leur utilisation abusive des idéologies communistes et des histoires de corruption, le mouvement communiste perd rapidement du terrain, et les membres du parti sont souvent moqués lorsqu’ils revendiquent des identités communistes. Le Parti du Congrès, avec son rôle historique dans la « fin officielle » du régime Rana et du système Panchayat, reste la principale force néolibérale du gouvernement. En 2008, les maoïstes et les marxistes-léninistes se sont alliés pour voter contre le Parti du Congrès, et en 2024, le Congrès et les marxistes-léninistes se sont alliés pour voter contre les maoïstes. Bien que les différences idéologiques les aient autrefois divisés, ces distinctions ont presque complètement disparu aux yeux du peuple.
L’Inde et la Chine appartiennent toutes deux au puissant bloc industriel et commercial connu sous le nom de BRICS. Comment cela affecte-t-il les gens ordinaires au Népal ? Quels groupes aspirent à capitaliser sur le renversement du gouvernement népalais ?
L’impact de l’adhésion aux BRICS sur les Népalais n’est pas encore clair, avec des cercles politiques et intellectuels divisés. Certains considèrent les BRICS comme un moyen de réduire l’hégémonie américaine, tandis que d’autres y voient une extension de l’influence autoritaire chinoise. Le gouvernement népalais a suivi prudemment l’évolution de la relation entre l’Inde et la Chine et n’a pas encore décidé s’il devait participer aux BRICS.
Il reste incertain de savoir quels groupes bénéficieront finalement de la chute du gouvernement, mais aucune décision politique au Népal n’est prise sans l’implication de l’agence de renseignement indienne RAW [Research and Analysis Wing]. La CIA [Central Intelligence Agency] joue probablement aussi un rôle, conformément à son histoire dans les révolutions mondiales. Les principaux dangers incluent des factions royalistes susceptibles de prendre le pouvoir avec le soutien des Indiens, poussées par la politique nationaliste hindoue extrémiste, et la résurgence d’anciennes élites politiques sans changement substantiel. Alors qu’un coup d’État militaire était une menace réelle, il n’a heureusement pas eu lieu.

Le 9 septembre 2025, le parlement est en flammes.
Le Népal étant un pays enclavé avec une dépendance sociale et économique vis-à-vis de l’Inde, les investissements chinois ont quelque peu changé, avec l’ouverture d’autoroutes reliant le Népal. Pendant que la Chine et l’Inde aiguisent leur rivalité, le Népal, contrairement à d’autres nations partageant la frontière avec les géants géographiques, devient une arène de contrôle et d’équilibre…
Les deux puissances ont jusqu’à présent évité un conflit ouvert, transformant le Népal en une zone d’équilibrage géopolitique. Le Népal, géographiquement piégé entre ces deux géants nucléaires, a des options limitées pour résister à leur bras de fer sans fin. Le blocus du carburant imposé par l’Inde après le tremblement de terre de 2015 était clairement un coup de force lié au mouvement madhesi, que l’Inde a soutenu officieusement. La Chine exerce une influence en exhortant le gouvernement népalais à contrôler les manifestations liées au Tibet. Les liens culturels et l’ouverture des frontières renforcent l’influence de l’Inde, tandis que les investissements chinois, tels que les projets d’autoroutes dans le cadre de l’initiative « la Ceinture et la Route », sont largement accueillis par la population comme des opportunités d’indépendance économique vis-à-vis de l’Inde.
De nombreux obesrvateurs occidentaux examinent la relation du Népal avec la Chine et l’Inde—qui sont tous deux des partenaires commerciaux des États-Unis et d’Israël, bien que la Chine soit perçue comme un antagoniste géopolitique des États-Unis — et concluent que les insurrections au Népal et en Indonésie doivent être soutenues par la CIA et aboutir à des révolutions de couleur conçues pour installer des dictatures alignées sur l’Occident. Qu’est-ce que voud en pensez ?
Bien que l’influence étrangère de l’Inde, de la Chine et des États-Unis soit indéniable, réduire le soulèvement à une révolution de couleur soutenue par la CIA écarte la colère authentique et les sacrifices du peuple népalais. Des millions de personnes se sont mobilisées pour brûler les bâtiments du parlement, les bureaux gouvernementaux et les maisons des dirigeants politiques—non pas parce que des organisations étrangères ou nationales leur ont dit de le faire, mais à cause de décennies d’échec gouvernemental et de corruption. Étiqueter ce mouvement comme une révolution de couleur sape notre solidarité avec des mouvements populaires similaires à travers le monde. Des militants du Bangladesh, d’Indonésie et du Sri Lanka célèbrent les luttes de chacun sans les considérer comme des complots étrangers. C’est un soulèvement populaire né de l’injustice vécue. Si ces soulèvements sont des révolutions de couleur, alors des mouvements mondiaux puissants comme le Printemps arabe et Black Lives Matter le sont aussi. Il est temps pour les observateurs occidentaux de soutenir ces luttes plutôt que de les délégitimer.
Quels liens voyez-vous, le cas échéant, entre le soulèvement au Népal et les soulèvements précédents au Sri Lanka, au Bangladesh et en Indonésie ? De quelles manières ceux-ci ont-ils nourri l’imagination populaire qui a aidé à produire cette révolte ? Quelles sont les différences entre le contexte népalais et ces autres contextes ?
Les soulèvements partagent des points communs évidents, notamment la corruption généralisée, l’exclusion, le pouvoir enraciné détenu par des familles népotistes, la censure gouvernementale et une forte ingérence étrangère. Le Sri Lanka, l’Indonésie et le Népal ont chacun des histoires de mouvements communistes et d’éventuels échecs liés à ces histoires. Un lien intéressant entre le Népal et l’Indonésie est la présence de mouvements antiautoriatires actifs et l’influence culturelle de l’anime « One Piece », qui symbolise pour les jeunes des deux pays leur lutte contre l’autoritarisme.
La principale différence est que le mouvement communiste népalais a réussi à prendre le pouvoir mais s’est ensuite corrompu et a abandonné ses promesses, alimentant la désillusion populaire, alors qu’en Indonésie et au Sri Lanka, le gouvernement communiste n’a pas réussi à prendre le pouvoir.
Sur la base de votre expérience récente au Népal, avez-vous des conseils pour les personnes qui participent à la résistance populaire dans d’autres parties du monde ?
Une résistance efficace doit combiner l’éducation organisée, l’agitation et la préparation à une insurrection de masse spontanée. Préparer les gens à pousser les mouvements sociétaux dans la bonne direction est essentiel, en particulier pour gérer les vides de pouvoir créés lorsqu’un gouvernement s’effondre, qui sont souvent saisis par des forces capitalistes visant à restaurer l’ordre ancien. Les anciennes élites essaieront de reprendre le pouvoir, mais la population révolutionnaire au Népal a démontré un refus féroce, détruisant les infrastructures et affrontant physiquement les dirigeants.
Cependant, ce soulèvement n’était pas entièrement préparé pour ce qui se passera ensuite. Jusqu’à présent, nos efforts se sont concentrés principalement sur l’éducation et les manifestations, sans envisager de structures post-effondrement. Notre conseil aux camarades du monde entier est de se préparer non seulement à la révolte, mais aussi à des structures non hiérarchiques et à la reconstruction sociétale une fois que les régimes tombent.
Que font les anarchistes et les groupes anti-autoritaires au Népal ? Quelles choses concrètes pouvons-nous faire pour soutenir les efforts anarchistes et globalement anti-autoritaires au Népal ?
Des groupes au Népal organisent des ateliers, des discussions, des projections, des expositions, des soirée musicales, ainsi que des actions directes dans la rue. La majorité de nos collectifs anarchistes croient en une organisation sans hiérarchie, favorisant des conversations ouvertes même avec les communistes radicaux qui recherchent véritablement des sociétés égalitaires. Nous croyons que la solidarité au sein du mouvement de gauche est essentielle, donc nous jugeons par les actions plutôt que par l’idéologie seule. Pour soutenir ces efforts, nous exhortons à sensibiliser le public aux violations continues des droits humains, y compris la mort d’au moins 72 manifestants, dont beaucoup de jeunes, tués pour avoir exigé la fin de la corruption et du totalitarisme. Les responsables doivent être confrontés et la justice doit être faite sans délai.

Un message du 13 septembre 2025 : « Ceux qui collaborent avec la police. Vous oubliez qu’ils ont tué nos enfants. Ceux qui disent que le vandalisme, la destruction par le feu, le pillage sont injustes. Vous oubliez que c’est le résultat d’une colère collective qui était contre ce régime depuis plus de 40 ans. Que c’est le résultat de l’enfer capitaliste où les gens ne peuvent plus rếver tant ils sont bombardés par les publicités. Pensez-vous que l’élite de Katmandou était là pour piller à Bhatbhatani (la plus grande chaîne de magasins au Népal) ? Non, c’était des gens de la classe ouvrière et de la classe moyenne. Pensez-vous que Bhatbhatani ai perdu beaucoup d’argent ? Ils ont une assurance. L’hôtel Hilton a une assurance. Les parents des enfants décédés ont-ils une assurance de millions de roupies ?
Translation courtesy of la Grappe.
-
Meter-byaj est une forme de prêt avec des taux d’intérêt exorbitants. Un mouvement est né en opposition a cette mesure dans les années précédentes. ↩
-
En juin 2019, des milliers de personnes ont pris la rue pour protester contre la mise en place d’une taxe visant à nationaliser et capitaliser sur des fondations religieuses et communautaires. Connu comme “guthi,” ce système pour entrenir les temples, les services publics et l’organisation de festivals est enracinée dans la communauté Newar indigène de la vallée de Katmandou. ↩
-
La guerre civile a pris fin en 2006. ↩
-
Un mouvement pour les droits de Madhesis Tharus, les musulmans, et les groupes Janjati au Nepal, avec des vagues d’activités en 2007, 2008, et 2015. ↩
-
Lipulekh est un passsage dans l’Himalaya sur la frontière entre l’Inde et le Tibet sous contôle chinois. Le gouvernement népalais réclame des territoires au sud de ce passage, qui est sous le contrôle de l’Inde depuis la domination coloniale anglaise. ↩
-
Chirurgien et medecin activiste, le Dr. Govinda KC a mené 23 grèves de la faim pour demander des réformes. ↩
18.09.2025 à 21:36
Comment répondre aux menaces de Donald Trump sur le mouvement antifasciste
CrimethInc. Ex-Workers Collective
Texte intégral (3812 mots)

Le 17 septembre, dans un post publié sur Truth Social, Donald Trump a déclaré qu’il allait désigner « Antifa » comme « une organisation terroriste majeure ». Qu’est-ce que cela signifie ? Comment pouvons-nous nous préparer à affronter la tempête ?
Il est toujours difficile de savoir à quel point il faut prendre au sérieux les déclarations performatives de Trump. Il fait souvent des déclarations délirantes pour tester leur impact sur son public : il lance des idées en l’air pour voir ce qui fait mouche, et ensuite il s’acharne là où il n’y a pas de réaction en retour.
Mais cette fois, son administration suit à la lettre le manuel classique du fascisme. Un de ses partisans est même allé jusqu’à déclarer, sans ironie, que l’assassinat de Charlie Kirk était « l’incendie du Reichstag américain ».
L’étape suivante de ce manuel est évidente : élargir ses cibles, allant des immigré·es jusqu’aux anarchistes, aux gauchistes, et s’étendant au bout du compte à tous les opposant·es au régime.
Alors oui, par le passé, Trump a déjà fait des déclarations dans lesquelles il désignait « Antifa » comme une « organisation terroriste », notamment au début de la révolte qui a fait suite au meurtre de George Floyd.
Mais à l’époque, le reste du gouvernement fédéral jouait en grande partie un rôle de frein à son impulsivité1 alors qu’aujourd’hui, l’ensemble de l’exécutif fédéral est composé de serviteurs zélés qui sont incapables de distinguer leurs propres intérêts de ceux de Trump.
Certes, aucune loi ne permet au président de désigner des organisations terroristes intérieures. Mais même sans nouvelle législation ou nouveau décret, Trump a un contrôle direct sur le ministère de la Justice, le ministère de la Sécurité intérieure, le FBI et d’autres agences fédérales. Ce qu’il publie sur les réseaux sociaux indique probablement ce qu’il ordonnera bientôt à ses subordonnés.
Le fait que « Antifa » ne désigne pas une organisation en soi, mais plutôt une catégorie floue qui peut inclure à peu près n’importe quel opposition à son programme autoritaire, cela en fait un terme très pratique pour Trump 2. Cela signifie que peu importe qui vous êtes ou ce que vous faites, vous aussi pourriez devenir une cible.
Si aucune désignation d’« organisation terroriste intérieure » n’existe actuellement (et il n’existe aucun mécanisme évident pour en créer une), les procureurs d’extrême droite ont déjà l’habitude de porter des accusations infondées de terrorisme, pour intimider les militant·es et les participant·es aux mouvements sociaux. Trump a explicitement appelé à l’utilisation de la loi RICO3 pour réprimer ses détracteurs et détractrices. Certains sénateurs républicains soutiennent déjà un projet de loi qui ajouterait les émeutes à la liste des infractions poursuivies sous la loi RICO.
Il y a des précédents à ce qui pourraient se passer : ainsi, il y a deux ans, un grand nombre de personnes à Atlanta (Géorgie) ont été accusées au hasard sous la loi RICO pour leur implication dans le mouvement Stop Cop City.

Les procès ont été reportés sans cesse, et il y a moins d’une semaine, un juge a finalement rejeté la majorité des charges pour vice de procédure.4
Il reste à savoir dans quelle mesure l’administration mettra réellement à exécution les menaces de Trump, et si elle commencera par s’attaquer à des groupes de base ou agira de manière descendante, en ciblant de grandes institutions libérales et des plateformes de financement.
Dans tous les cas, notre avenir à long terme dépendra de notre capacité à permettre à un grand nombre de personnes d’agir solidairement, en adoptant des formes d’action directe à la base, qui peuvent être efficaces même si les personnes au pouvoir refusent d’écouter.

C’est pourquoi chacun devrait consulter les suggestions ci-dessous, que vous pensiez ou non qu’elles vous concernent directement. Plutôt que de céder à la panique, il s’agit de se préparer concrètement afin d’aborder cette situation calmement et efficacement.
Ne pas se laisser intimider.
Garder le moral est essentiel à la résistance. Ne nous rendons pas sans lutter ! Nos adversaires veulent nous soumettre par la peur, car ils savent qu’ils ne peuvent pas nous vaincre par la seule force brute. N’oubliez pas que la gestion des perceptions est au cœur du projet fasciste : ils cherchent à projeter leur force en permanence, précisément parce qu’ils ne sont pas invincibles. Même lorsque la situation semble désespérée, gardez espoir et continuez le combat ! Le défaitisme ne sert que l’ennemi.
Plusieurs exemples récents montrent qu’un mouvement déterminé peut vaincre la répression. Ainsi, le 20 janvier 2017, quelques heures après l’investiture de Trump, des centaines de personnes ont été arrêtées et chargé·es de huit chefs d’inculpation chacun·e (dont deux qui n’existaient même pas dans la loi). Plutôt que de plaider coupable ou de se battre individuellement, près de 200 personnes ont choisi de se défendre collectivement. Après un an et demi, toutes les charges ont été abandonnées.
L’affaire RICO de Stop Cop City a échoué jusqu’à présent pour les mêmes raisons, car ces affaires reposent souvent sur la capacité à effrayer certains accusé·es pour les pousser à coopérer. Si les accusé·es forment un front uni et sont soutenu·es avec force, les principaux atouts de l’État s’évanouissent. La solidarité, c’est le pouvoir !

Misez sur vos points forts.
Trump dirige des institutions centralisées, hiérarchiques, figées et axées sur le profit. Il préfèrerait affronter un adversaire qui leur ressemble. Or, à l’opposé, nos mouvements sont pour une très large part horizontaux, décentralisés, sans hiérarchie officielle ni dépendance financière. C’est une bonne chose, car cela rend moins crédibles les fables inventées par les procureurs, et les autorités ne savent pas qui cibler : si elles doivent se concentrer sur la population toute entière, si la résistance peut surgir de toutes parts, elles ne pourront pas concentrer leurs forces.
Les autocrates de tout poil ne sont pas en mesure de réprimer toutes celles et tous ceux qui s’opposent au fascisme. Le 14 juin 2025, ce sont plus de 5 millions de personnes qui sont descendues dans la rue lors de la manifestation « No King » pour défier Trump. La sécurité ne viendra pas de la clandestinité, mais bien de la diffusion massive de nos tactiques, au sein d’un élan de résistance le plus large possible.
Toutes celles et tous ceux qui s’opposent au fascisme sont antifascistes. En cherchant à cibler tous ceux qui s’opposent au fascisme, Trump ne peut pas digérer ce qu’il tente d’avaler, à condition de ne pas le laisser faire.

Préparez-vous à des perquisitions.
Apprenez quoi faire en cas de visite de la police ou d’agents fédéraux, que ce soit pour une demande d’information, une assignation à comparaître, ou une perquisition. Sauvegardez vos données informatiques et stockez-les en lieu sûr. Retirez de chez vous tout ce qui pourrait être compromettant entre de mauvaises mains. Mettez vous en lien dès maintenant avec un·e avocat·e.
Si une perquisition a lieu chez quelqu’un d’autre, filmez-la : plus l’attention sera portée sur chaque attaque de l’État, plus il y aura de monde en sécurité.
Informez vos ami·es à l’avance de la manière dont ils peuvent vous soutenir en cas de perquisition ou d’arrestation, qu’il s’agisse de nourrir votre chat, de vous occuper de vos enfants ou de contacter votre employeur ou des membres de votre famille. Faites connaître vos intentions à l’avance : par exemple, si vous êtes arrêté·e, préférez-vous être libéré·e sous caution immédiatement ou attendre de voir si votre caution est réduite ? Plus vous préciserez ce que vous souhaitez à l’avance, mieux ce sera. Dans le pire des cas, vous éviterez que des branches rivales de votre comité de soutien se disputent vos préférences sans pouvoir les trancher.
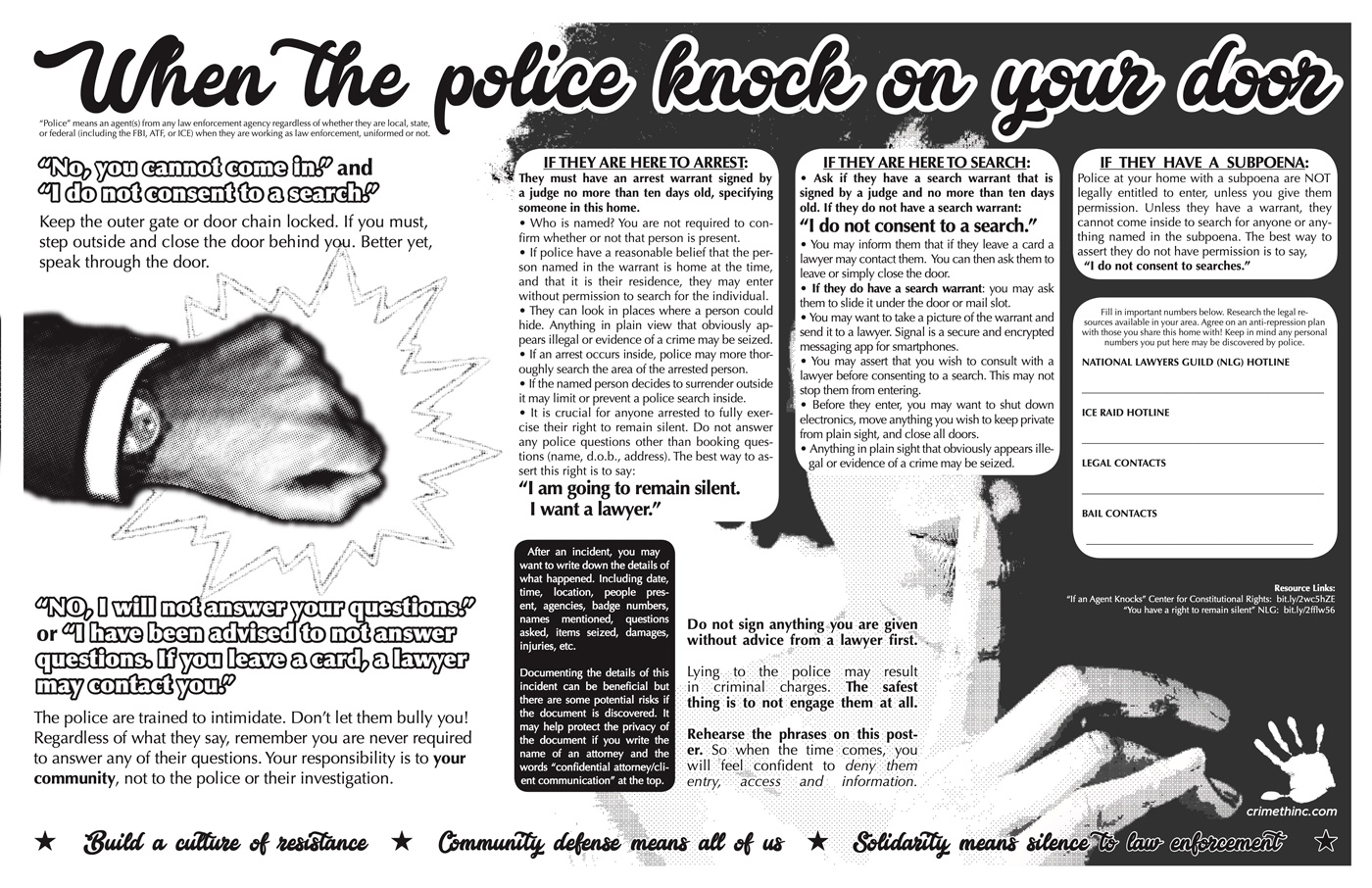
Soyez transparent·e face à la répression.
Si vous êtes ciblé·e par la répression, parlez-en ouvertement. Leur objectif est de vous isoler et de vous rendre paranoïaque. Si vous êtes déjà dans leur collimateur, vous n’avez aucun intérêt à essayer de cacher qu’ils vous ciblent. Ne leur facilitez pas la tâche, ne vous rendez pas inutilement facile à repérer, mais renforcez vos relations publiques. Si des agents fédéraux vous rendent visite ou vous assignent à comparaître, le meilleur moyen d’obtenir le soutien nécessaire et de conserver la confiance de votre communauté est de refuser de coopérer, de documenter toutes les rencontres et de les rendre publiques afin que tout le monde soit au courant.
Ne soyez pas irremplaçable.
Si vous participez à un projet formel ou informel, assurez-vous que les autres sachent comment faire la même chose que vous. Cela vaut pour vous, individuellement, comme pour tous les groupes auxquels vous participez. Diffusez vos compétences et vos connaissances à grande échelle. Faites une copie de la clé de la librairie, partagez les identifiants de votre compte de réseau social avec une personne de confiance, aidez les autres à organiser une distribution alimentaire ou fournir une aide juridique… Faciliter la tâche des autres pour vous remplacer peut diminuer le risque d’être ciblé·e.
De même, diffusez au plus grand nombre les informations sur la lutte contre la répression : organisez des formations dans votre communauté sur la sécurité et distribuez des documents à ce sujet. Expliquez aux gens comment réagir si des agents de l’État les poussent à devenir des informateurs ou les assignent à comparaître devant un grand jury. Plus les gens sont informés, mieux c’est, car les agents fédéraux commencent parfois par exercer des pressions sur celles et ceux qu’ils perçoivent comme étant en marge des mouvements sociaux.

Organisez un soutien collectif.
Tendez la main à celles et ceux qui sont dans la même situation : par exemple, si vous gérez une librairie ou un groupe étudiant, vous pouvez créer un réseau de projets similaires afin que chacun·e puisse agir dès que l’un·e d’entre vous est ciblé·e par la répression. Réfléchissez aux moyens de pression que vous pouvez utiliser pour vous assurer que toute attaque contre vous va mobiliser les gens au lieu de les intimider.
Préparez une liste de contacts et une liste de réponses adaptées à différents scénarios. Distribuez des copies de ces documents aux camarades sur lesquels vous pouvez compter pour vous soutenir en cas de répression, afin que, dès qu’un incident se produit, chacun·e soit informé·e et sache quoi faire. Exemple de message : « Si nous sommes arrêtés et non libérés immédiatement, [nom du groupe] tiendra une conférence de presse le lendemain, [nom de la personne] mènera une campagne de communication en ligne et [une autre personne] organisera une collecte de fonds. »
Discréditer la police et les tribunaux.
Alors que Donald Trump et ses hommes de main cherchent à plier le système juridique à leur volonté et à le contourner carrément quand ce n’est pas possible, cela comporte certains inconvénients, car cela délégitime les institutions desquelles ils dépendent malgré tout. De manière encourageante, plusieurs grands jurys ont refusé d’inculper des personnes accusées par les procureurs à la solde de Donald Trump. Nous devrions populariser la tactique de l’annulation du jury comme un moyen par lequel les jurés ordinaires peuvent gripper les engrenages de la répression fédérale. Dans la mesure du possible, nous devrions éroder la foi aveugle du public dans les institutions que Trump utilise pour mener ses actions répressives.
Malgré les fausses promesses des politiciens libéraux, la vague d’élan vers le définancement de la police qui a culminé en 2020 n’a pas assuré de changements majeurs dans la législation ou les budgets ; le seul effet durable du mouvement a été que, grâce à l’action populaire, de nombreuses personnes ont été contraintes de quitter les forces de police. Aujourd’hui, exercer une pression continue de basse intensité contre l’administration Trump et ses laquais diminuera le nombre de personnes qui sont prêtes à servir Trump en tant que traîtres à leurs communautés, que ce soit en tant qu’agents de l’ICE ou à un autre titre.

Fracturer la classe politique.
Nous avons besoin d’une stratégie pour obliger les politicien·nes de « l’opposition » à entraver réellement l’État policier plutôt que de simplement se tenir à distance. Sans pression, la plupart des politicien·nes vont simplement cultiver leur image plutôt que d’aider celles et ceux qui sont attaqué·es. Leur image dépend de la façon dont est perçue leur opposition à Trump : cela peut offrir des points d’appui pour les pousser à prendre position.
Identifiez chaque institution, groupe et individu influent auquel vous avez accès et qui n’est pas inextricablement investi dans la montée du fascisme. Voyez de quels moyens vous disposez pour faire pression sur chacun d’eux. Avec certain·es, une conversation suffira ; avec d’autres, cela pourra nécessiter d’autres moyens. Fixer des objectifs concrets : dissuader les demandeurs d’emploi de travailler pour l’ICE, obtenir de personnalités influentes qu’elles fassent des déclarations de solidarité ou contraindre des politiciens locaux à demander à la police de ne pas coopérer avec les opérations fédérales. L’État policier exige le bon fonctionnement de l’ensemble de l’appareil de pouvoir ; cela le rend vulnérable à de multiples niveaux.
Les libéraux qui ont contribué à créer une fracture entre Trump et Elon Musk simplement en tenant des pancartes chez les concessionnaires Tesla ont démontré comment diviser l’alliance qui soutient Trump. Cela devrait être reproduit encore et encore, en ciblant en particulier celles et ceux qui sont impliqué·es à la marge, plutôt que celles et ceux qui sont plus profondément engagé·es dans son projet autoritaire. Il faut saper les piliers de sa structure de soutien un par un.
Les États-Unis sont polarisés et divisés, tant au niveau régional que local. Si les communautés, les villes ou des régions entières peuvent éventuellement se mettre concrètement hors de portée de la répression fédérale, un modèle de véritable résistance émergera.

Passer à l’offensive.
Aux échecs, avec un jeu purement défensif, vous perdrez la partie. Pour faire face à la prise de pouvoir de Trump, nous avons besoin de stratégies proactives. Plutôt que de simplement réagir encore et encore, nous devons choisir l’heure et le lieu des conflits ; cela peut être un moyen de bloquer les ressources et les cycles de travail qui seraient autrement dirigés contre nous.
Les politiques oligarchiques de Trump appauvrissent des millions de personnes à travers le monde. Nous devons montrer comment répondre aux besoins urgents qu’il crée, en véhiculant une vision révolutionnaire de changement social. La meilleure défense, c’est l’attaque !

Refuser la division.
Lorsque la répression réussit, son effet le plus dommageable n’est pas son impact immédiat, mais les lignes de fracture qu’elle ouvre. L’objectif principal de Trump est de nous faire douter de nous-mêmes, et de nous monter les un·es contre les autres. Résoudre les malentendus et les conflits est un élément fondamental de la résistance.
Présentez des critiques de bonne foi, en ouvrant la porte à celles et ceux qui sont actuellement vos rivales et rivaux pour qu’iels deviennent éventuellement des allié·es, à condition qu’iels apprennent à se comporter de manière responsable. Ceux qui répandent la division et entretiennent des relations toxiques font le travail de l’État.
Thanks to La Horde for the translation.
-
Par exemple, le tweet de Trump à la fin du mois de mai 2020 a été suivi d’une déclaration similaire du procureur général William Barr, qui s’était déjà plaint publiquement de Trump et avait été contraint de démissionner quelques mois plus tard. Le directeur du FBI à l’époque, Christopher Wray, a reconnu lors d’une audition que « antifa » est une idéologie, pas une organisation. ↩
-
À noter qu’en Italie, les procureurs ont souvent traité des mouvements flous tels qu’Autonomia Operaia comme s’il s’agissait d’organisations formelles, et ont fabriqué de toutes pièces des organisations imaginaires là où il n’en existait pas, comme dans le cas de l’« Organisation révolutionnaire anarchiste insurrectionnelle ». ↩
-
NdT : le Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act est une loi fédérale américaine qui concerne les activités d’une organisation criminelle. ↩
-
Sous Donald Trump, de nombreuses agences fédérales sont désorganisées, ce qui expliquent les accusations RICO de manière chaotique en Géorgie il y a deux ans. Si l’évolution de l’affaire RICO liée au mouvement Stop Cop City peut servir d’indication sur la manière dont d’autres persécutions via la loi RICO contre des activistes pourraient se dérouler, la principale menace n’est peut-être pas que la répression voulue par Trump envoie des gens en prison, mais plutôt que ces accusations découragent et paralysent les personnes visées, créant ainsi les conditions pour que son administration remplace cette forme de répression par quelque chose de pire. ↩
04.09.2025 à 12:00
Depuis les soulèvements Indonésiens : « Affan Kurniawan est vivant dans nos rues. »
CrimethInc. Ex-Workers Collective
Texte intégral (4563 mots)

Fin août 2025, une vague de manifestations s’est propagée à travers l’Indonésie. Cet article compile une interview l’entretien d’un écrivain anarchiste indonésien emprisonné et des témoignages de différents groupes anarchistes ayant activement pris part à la révolte.
Après l’annonce de nouvelles mesures d’austérité, des manifestations se sont répandues pendant des semaines à travers l’Indonésie avant de culminer la semaine du 25 août pour dénoncer le mépris et la corruption de l’élite politique du pays.
Le gouvernement indonésien rémunère les représentants du parlement d’un salaire mensuel de 100 millions de roupies indonésiennes (environ 5 193,29 €) - soit à peu près trente fois le salaire minimum à Jakarta, où les salaires sont pourtant les plus élevés du pays. La colère a éclaté lorsque les gens ont appris que les députés s’apprêtaient à bénéficier d’une allocation de logement de 50 millions de roupies chaque mois, alors que le pays connait une grave inflation, que la pauvreté s’étend et que des mesures austéritaires sont mises en place.
En réaction, les syndicalistes, les anarchistes, les étudiants, les gauchistes et la jeunesse en générale ont envahi les rues la semaine du 25 août. La répression policière, aux ordres de l’ancien ministre de la défense et actuel président, Prabowo Subianto a été très dure. Le 28 août, un véhicule blindé de la police nationale a percuté et tué Arfan Kurniawan, un livreur de 21 ans qui passait par-là pour une course.

Un manifestant en Indonésie tient une pancarte où l’on peut lire : « Arfan Kurniawan- tué par la police ».
En réponse au meurtre d’Affan, les livreurs, les anarchistes et les jeunes de différents milieux se sont révoltés. Les manifestants ont saccagé plusieurs commissariats, brulé et pillé des maisons de politiciens, et mis le feu a plusieurs bâtiments du gouvernement.
La situation a forcé le premier ministre à annuler sa participation au sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai. Le gouvernement a suggéré qu’ils pourraient supprimer certains avantages accordés aux politiciens et certaines des mesures d’austérité qui ont déclenché le soulèvement.
Néanmoins, le président Prabowo Subianto a choisi d’intensifier la répression et fait appel à l’armée. Au moins 6 morts ont été recensés : un étudiant a été battu à mort par la police à Yogyakarta et un vélo-taxi est décédé des suites d’une exposition aux gaz lacrymogènes à Solo. Le nombre exact de morts est inconnu.
Gouverné par les colons hollandais jusqu’à 1949, l’Indonésie est un pays très divisé avec de grandes disparités de moyens et de pouvoir. Dans les années 1960, la répression des sympathisants présumés parti communiste d’Indonésie a fait des centaines de milliers de morts. Le mouvement anarchiste contemporain a émergé à la fin des années 80, grâce, notamment, à l’apparition de groupes de punk. En 2011, la police a créé une division « anti-anarchistes » et à de nombreuses occasions, celles et ceux perçus comme des punks anarchistes ont été enlevés et incarcérés dans des camps de rééducation de l’État. Malgré cela, le mouvement anarchiste a continué de prendre de l’ampleur.
Au vu du niveau de répression global à travers le monde, le courage de la révolte indonésienne a de quoi inspirer toutes celles et ceux qui rejettent l’ordre des choses capitaliste. Les manifestants en Indonésie ont rencontré des formes variées de répression et de blocage des moyens de communications numériques. Il est vraisemblable que ces mesures s’intensifient à mesure que le mouvement continue de croître. Nous espérons que ces premiers comptes rendus attireront l’intérêt et la solidarité que le soulèvement mérite et que chacun en tirera les enseignements nécessaires.
Affan Kurniawan ne sera pas oublié et ses tueurs ne seront pas pardonnés. Solidarité avec celles et ceux qui, dans la rue, s’en assurent.
-Des anarchistes solidaires du soulèvement indonésien

Des manifestants se rassemblent devant le quartier général de la police de la région de Jakarta.
Une conversation avec le prisonnier anarchiste et auteur, Bima
Bima est un écrivain anarchiste, traducteur et chercheur indépendant d’Indonésie emprisonné depuis 2021. Il reste actif derrière les barreaux en tant que membre de la fédération anarchiste.
Il est également le fondateur de la maison d’édition DIY Pustaka Catut et l’auteur du livre Anarchy in Alifuru : The History of Stateless Societies in the Maluku Islands, aux éditions Minor Compositons. Vous pouvez soutenir Bima via son Patreonet en savoir plus sur la campagne FireFund.
Cette interview a été menée dans les premiers jours de Septembre 2025.
Comment peut-on te présenter ?
Je suis un écrivain, un prisonnier et un membre d’une fédération anarchiste choisissant de rester anonyme pour des raisons de sécurité en ces temps effrayants.
Peux-tu nous éclairer sur le contexte du soulèvement en cours ?
Cette vague de rébellion d’août 2025 a été causée par une accumulation de colère concernant des problèmes politiques et économiques variés. Il n’y avait pas une seule et unique cause. Mais tout s’est aggravé en raison des augmentations conséquentes des impôts fonciers à travers la région, cela du fait du déficit du budget du gouvernement.
En même temps, les membres du parlement ont multiplié leurs salaires par dix. Tout a été exacerbé par les déclarations souvent facétieuses des politiciens. Par exemple, le régent de Pati (le politicien en charge de superviser le gouvernement local, les politiques et les services publics dans la régence de Pati, Central Java) a déclaré : « ces impôts ne vont pas baisser, même si une manifestation de masse de cinquante mille personnes a lieu. »
Pati a été la première ville a s’embraser avec un rassemblement d’environ cent mille personnes le 10 août 2025. Les manifestations contre l’augmentation des impôts se sont propagées jusqu’à Bone (dans la province de Sulawesi du Sud), puis dans d’autres villes. Pendant une manifestation le 28 août à Jakarta, un livreur d’une plateforme en ligne de livraison a été tué après avoir été percuté par un véhicule de police au milieu d’une manifestation. Le jour suivant, les manifestations se sont étendues à de nombreuses villes et elle continuent de s’étendre pendant que je vous écris.
Au moins six civils ont été tués directement par la répression policière jusqu’à présent, diverses maisons d’officiels ont été pillées et une demi douzaine de bureaux de représentants du conseil représentatif du peuple ont été partiellement ou entièrement brûlés. Nous étions convaincus que la rébellion allait se calmer, mais ce n’est pas le cas.

Des étudiants font face à la police durant une manifestation aux quartiers généraux régionaux de la police de Jakarta, Indonésie. 29 août 2025.
Quels types de groupes ont été impliqués dans le soulèvement ? Et dans quelle mesure s’organisent-ils ensemble ?
Il y a eu beaucoup d’organisations, de réseaux et de groupes qui ont formulé des revendications. On pourrait dire que chaque ville a ses propres revendications. De manière générale, il y a deux revendications « révolutionnaires » : la première vient du parti socialiste d’Indonésie, Perserikatan Sosialis (PS), et l’autre d’un réseau informel, décentralisé , qui a diffusé la Déclaration de la révolution fédéraliste indonésienne de 2025, qui appelle à la dissolution de l’État du système du DPR (chambre des représentants d’Indonésie) et à son remplacement par un confédéralisme démocratique. Ahmad Sahroni, un membre de la chambre des représentants (DPR) du parti démocrate national (NasDem), a qualifié ces revendications de « stupides ». Cela a entrainé l’attaque et le pillage de sa maison de Jakarta, le 30 août.
Les anarchistes insurrectionnels, individualistes, et post-gauchistes se concentrent sur les attaques et les affrontement urbains, ils appelant à la destruction de l’État et du capitalisme, mais ne se soucient pas des plate-formes et programmes qui appellent à réformer l’organisation sociale en place. De manière générale, il n’ya pas de front uni, mais nous évitons le sectarisme idéologique excessif.
Malheureusement, il y a aussi la gauche progressiste avec des revendications plus réformistes, comme la 17+8 demand (un slogan « pro-démocratie » appelant à des réformes avant le 5 septembre). Ce groupe est hautement influencé par les influenceurs libéraux en ligne qui appellent à la fin des manifestations. Ces influenceurs ont été jusqu’à déclarer que si la loi martiale était instaurée ce serait à cause de l’intensité de la résistance dans la rue et que les manifestants en seraient donc responsables. Soit une tentative de récupération centriste typique par le gaslighting et la diabolisation des organisations révolutionnaires.
Heureusement, tous les éléments de gauche et anarchistes sont d’accord sur le fait que les manifestations doivent s’intensifier. Nous ne savons pas ce qui va se passer pour l’instant, étant donné que cette guerre des discours est toujours en cours.
Pour être honnête, il y a trop de groupes impliqués dans le soulèvement pour offrir une réponse simple. La gauche entière et le mouvement anarchiste de différentes organisations a pris la rue, mais il n’y avait pas de front uni. Dans chaque ville, des progressistes, qu’ils soient des étudiants, des syndicats ou même des élèves, se rejoignent dans les actions. Certaines de ces actions, comme les attaques de commissariats, sont des initiatives spontanées sans réelle coordination.

Un poste de police de la circulation brûle, le 29 août 2025.
Comment les anarchistes contribuent-ils au soulèvement ?
Je suis un révolutionnaire pessimiste, influencé par les discours anarcho-nihilistes. Mais je plaide tout de même pour une révolution sociale parce qu’il n’y a pas d’espace social vide. l’Indonésie est l’archipel le plus multi-culturel du monde, avec de milliers de langues et d’ethnies. Un discours de séparatisme refait surface dans certaines régions. Certains nobles émanant de monarchies anciennes poussent pour leur renouveau. Il y a aussi des islamistes autoritaires, fondamentalistes et djihadistes qui veulent un califat dans le pays. Donc je pense qu’il est nécessaire pour les révolutionnaires de proposer leur programme comme alternative à toutes ces mauvaises possibilités. La vague de rébellion est le symptôme d’une grande division imminente et les anarchistes doivent assumer le rôle qu’ils ont à jouer. Sinon, les autres options sont mauvaises. Très mauvaises.
Que penses-tu qu’il va advenir de ce soulèvement ? Et comment vois-tu le futur du mouvement anarchiste en Indonésie ?
Je suis pessimiste a ce sujet. Nous nous sommes établis dans un certain nombre de villes, mais nous sommes relativement faibles de manière générale, même si nous sommes fondamentalement assez militants.
Nous sommes influencés par l’approche uruguayenne de Espesifismo qui implique deux aspects organisationnels. Cela veut dire qu’en plus que de rejoindre les organisations politiques, nous rejoignons aussi les mouvements populaires comme les syndicats, les organisations étudiantes, les organisations indigènes, etc.
Nous utilisons toujours la définition classique du mot révolution mais cela requiert une base organisationnelle solide pour qu’elle advienne. Malgré cela, les récents soulèvements se sont répétés, comme un cycle, depuis 2019. C’est excitant car cela signifie que nous devons nous pousser a tenir le rythme avec les soulèvements populaires et la volonté des masses. Mais nous devons croitre et augmenter notre militance pour rester pertinent vis-à-vis de la rage des gens.
Je ne crois pas qu’il y aura de réformes, a moins qu’il y ait un violent renversement du pouvoir et des réformes promises. La classe gouvernante a formé une coalition élargie qui contient tous ses anciens opposants et leur donne une part du gâteau. Pour l’instant, nous sommes les seuls membres de réseau informel, décentralisé et anti autoritaire a réclamer la départ du président et du vice président. Donc, la refonte va encore prendre du temps et une révolution anarchiste est impossible en raison de la faiblesse organisationnelle et l’absence de syndicats progressistes capables de mener une grève générale.
Toutefois, il y a eu des avancées qui seraient parues inimaginables il y a quelques décennies : la revendication populaire de dissolution du parlement avec le hashtag #bubarkanDPR [“dissoudre le DPR”], l’implication de masses plus diverses de gens dans les manifestations (l’Indonésie est connue pour romancer l’avant-gardisme des étudiant de 1965 et 1998) et l’usage généralisé de la violence. Les anarchistes ont joué un rôle crucial dans tout cela. Cependant, je ne pense personnellement pas que le mouvement anarchiste va mener a une révolution anarchiste, même si l’opportunité existe. Mais cela pourrait exercer une immense influence libertaire à travers un front uni travaillant à l’intérieur des groupes établis. Par exemple, la proposition d’un confédéralisme démocratique révolutionnaire, qui est en fait alignée sur les propositions anarchistes classiques, pourrait être acceptée par le spectre entier de la gauche existante et des mouvements séparatistes de libération nationale dans certaines régions. C’est en tous cas de l’ordre du possible.
Les manifestations de 2020 contre la loi Omnibus étaient elles aussi importantes mais celles de cette année sont les plus violentes (de nombreuses et considérables parties de la société se radicalisent). Pour l’instant, le soulèvement n’a pas dépassé en intensité la chute du gouvernement militaire de Suharto en 1998. Cependant, je crois que cela pourrait arriver bientôt.
Malheureusement, j’ai prévenu que le moment venu, nous ne serons pas prêts pour la révolution, même si nous prendrons activement part aux affrontements de rue.

Des anarchistes bloquent des rues et brûlent des choses pendant les émeutes de nuit à Bandung City, west Java, en portant le drapeau anarchiste rouge et noir et celui du Jolly roger, de One pièce.
D’autres voix d’Indonésie
En plus de l’interview de Bima, nous avons reçu le 2 septembre ce récit de Reza Rizkia à Jakarta :
La vague de manifestations qui a débuté le 25 août 2025 à travers l’Indonésie se poursuit, laissant derrière elle une traînée de tragédies et de troubles. Ce qui avait commencé comme une protestation contre la proposition d’une allocation mensuelle de 50 millions de roupies pour les membres du Parlement s’est transformé en un mouvement national avec des revendications plus larges : l’évaluation des actions du parlement, la réforme de la police et la fin de l’usage excessif de la force par les forces de sécurité.
Le 28 août, les tensions se sont intensifiées après qu’un chauffeur de taxi-moto, Affan Kurniawan, a été percuté et tué par un véhicule tactique de la Brigade mobile (Brimob) à Bendungan Hilir, Jakarta. La vidéo de l’incident s’est rapidement répandue sur les réseaux sociaux, déclenchant des manifestations de solidarité de la part des étudiants et des communautés de chauffeurs en ligne. Cette tragédie a marqué un tournant, amplifiant l’ampleur des manifestations dans la capitale et dans tout le pays.
La violence s’est rapidement propagée à d’autres grandes villes. À Makassar, des manifestants ont incendié le bâtiment du parlement régional (DPRD), tuant trois membres du personnel piégés à l’intérieur. À Solo, un conducteur de pousse-pousse nommé Sumari a trouvé la mort lors d’affrontements, tandis qu’à Yogyakarta, l’étudiant Rheza Sendy Pratama a été tué lors d’une manifestation devant le siège de la police régionale. Une autre victime, Rusmadiansyah, un chauffeur en ligne, a été battu à mort par une foule après avoir été accusé d’être un agent des services de renseignement. Certains rapports font également état d’autres victimes, notamment un élève d’une école professionnelle à Pati. Au total, au moins sept à huit personnes ont perdu la vie dans les troubles qui ont secoué le pays jusqu’à la fin du mois d’août.
Le gouvernement a réagi en présentant ses condoléances. Le président Prabowo Subianto a ordonné l’ouverture d’une enquête, tandis que le chef de la police nationale et le chef de la police de Jakarta ont présenté des excuses publiques pour les victimes. Sept agents de la Brimob liés à la mort d’Affan Kurniawan ont été placés en détention et font l’objet de poursuites judiciaires. Cependant, la colère populaire ne semble pas s’apaiser.
Au 2 septembre, les manifestations se poursuivent dans plusieurs régions avec une intensité soutenue. Des milliers de manifestants ont été arrêtés au cours de la semaine dernière, avec un pic le 29 août où plus de 1 300 personnes ont été arrêtées en une seule journée. Dans le même temps, l’Alliance des journalistes indépendants (AJI) a signalé des cas de violence et d’ingérence à l’encontre de journalistes couvrant les manifestations.
Les manifestations de fin août constituent l’une des plus grandes vagues de protestations de ces dernières années en Indonésie. Avec le nombre croissant de morts, les arrestations massives et les dégâts matériels généralisés, la population attend désormais de voir si le gouvernement et le parlement répondront aux demandes des citoyens par de véritables réformes, ou s’ils prendront le risque d’aggraver encore la crise.
Le drapeau national rouge et blanc a été abaissé, remplacé par le drapeau anarchiste rouge et noir et le drapeau Jolly Roger de One Piece (aujourd’hui symbole populaire de la résistance en Indonésie). Le bâtiment incendié était la Chambre des représentants de la ville de Pekalongan, Central Java.
Lorsque le soulèvement a commencé à faire la une des journaux internationaux, des anarchistes anonymes ont rédigé plusieurs déclarations signées L’archipel du feu. Nous avons souhaité relayer leurs voix également.
25 août 2025
« Jakarta n’appartient plus aux élites corrompues. Des milliers de personnes venues des quatre coins du pays ont pris d’assaut la capitale. Il ne s’agit pas seulement d’une manifestation, mais d’une explosion collective de rage contre la hausse des taxes foncières, la corruption sans fin et les chiens de garde militaires et policiers de l’État.
De l’aube jusqu’à minuit, les rues se transforment en champ de bataille de la défiance. Les cris, les incendies et les pierres deviennent le langage de la fureur du peuple.
Ce n’est pas un spectacle de marionnettes orchestré par les élites ; c’est une colère brute, sauvage, sans chef et impossible à contrôler. »
29 août 2025
« Les jeunes en colère se soulèvent, poussés par la hausse des impôts et une armée répressive. Il n’y a pas d’organisation ; l’insurrection est menée par de jeunes anarchistes, nihilistes et incontrôlables. De nombreux jeunes anarchistes issus d’associations d’élèves du secondaire sont arrêtés. Les lycéens sont notre source d’énergie. Selon les rapports, environ 400 d’entre eux ont été arrêtés le 25 août. La plupart des actions sont coordonnées en direct sur les réseaux sociaux.
« Habituellement, un syndicat libéral ou un parti d’opposition contrôle le discours, mais pas cette fois-ci. Même les médias traditionnels reconnaissent que les réseaux sociaux sont la source de l’information. Les politiciens ne peuvent plus contrôler le discours. Depuis des décennies, les instances étudiantes exécutives sont généralement les instigatrices de ce type de manifestations, mais chaque année, ces intermédiaires sont mis dehors. Par les étudiants eux-mêmes. C’est pourquoi les ONG, les syndicats, les « anarchistes civils » et les associations étudiantes de gauche et de droite détestent la faction anti-organisationnelle.
« Qu’ils aillent tous se faire foutre. Nous incitons les jeunes à agir par eux-mêmes.
Les individus ne sont plus effrayés par le devoir idéologique, les normes et toutes ces valeurs externes.
Hier soir (28 août 2025), la police a assassiné quelqu’un. Des émeutes contre la hausse des impôts ont éclaté dans tout le pays. Dans plusieurs villes, les émeutes étaient spontanées et auto-organisées. L’image publique de la police continue de s’effriter, car la population soutient les émeutiers. Des cellules ont coordonné d’autres actions, et la plupart des prises de paroles nihilistes et insurrectionnelles dominent le discours.
Des comptes anonymes sur les réseaux sociaux, suivis par des milliers d’abonnés, appellent à l’insurrection anti-politique. Chaque jour, ils lancent des appels et donnent des explications pertinentes.
Les négociateurs syndicaux ont annoncé qu’ils seraient dans la rue et qu’il n’y aurait « pas d’émeutes », mais les jeunes et les émeutiers se moquent immédiatement d’eux sur les réseaux sociaux. Nous laissons faire les jeunes. Nous ne pouvons que les encourager à être encore plus incontrôlables. La nuit, Internet est devenu ingérable. Alors que les « anarchistes civils » appellent à la création de conseils populaires, nous appelons à tout foutre en l’air. Nous fournissons uniquement une coordination en réseau et des informations techniques sur les actions de rue. Nous n’organisons jamais vraiment les gens.
« Depuis le vendredi 29 août, les anarchistes contrôlent essentiellement le discours. Partout dans le pays, les gens répondent à l’appel à attaquer les commissariats et les policiers eux-mêmes. Les médias de masse ont perdu le contrôle de l’information et de l’actualité.
« Notre réseau continue d’appeler à la vengeance depuis le meurtre commis par la police hier soir, et la situation s’envenime. Les cellules sont dans la rue.
« Vous pouvez voir le soulèvement sur diverses chaînes d’information, mais toutes les bonnes vidéos ne sont disponibles que sur les réseaux sociaux. »
-Archipel de feu
« Cela dépasse nos prévisions. Habituellement, lors d’une manifestation, les manifestants se contentent de jeter des pierres ou de brûler un pneu devant le bureau. Ils ne prennent jamais d’assaut le bâtiment et ne le brûlent jamais. »
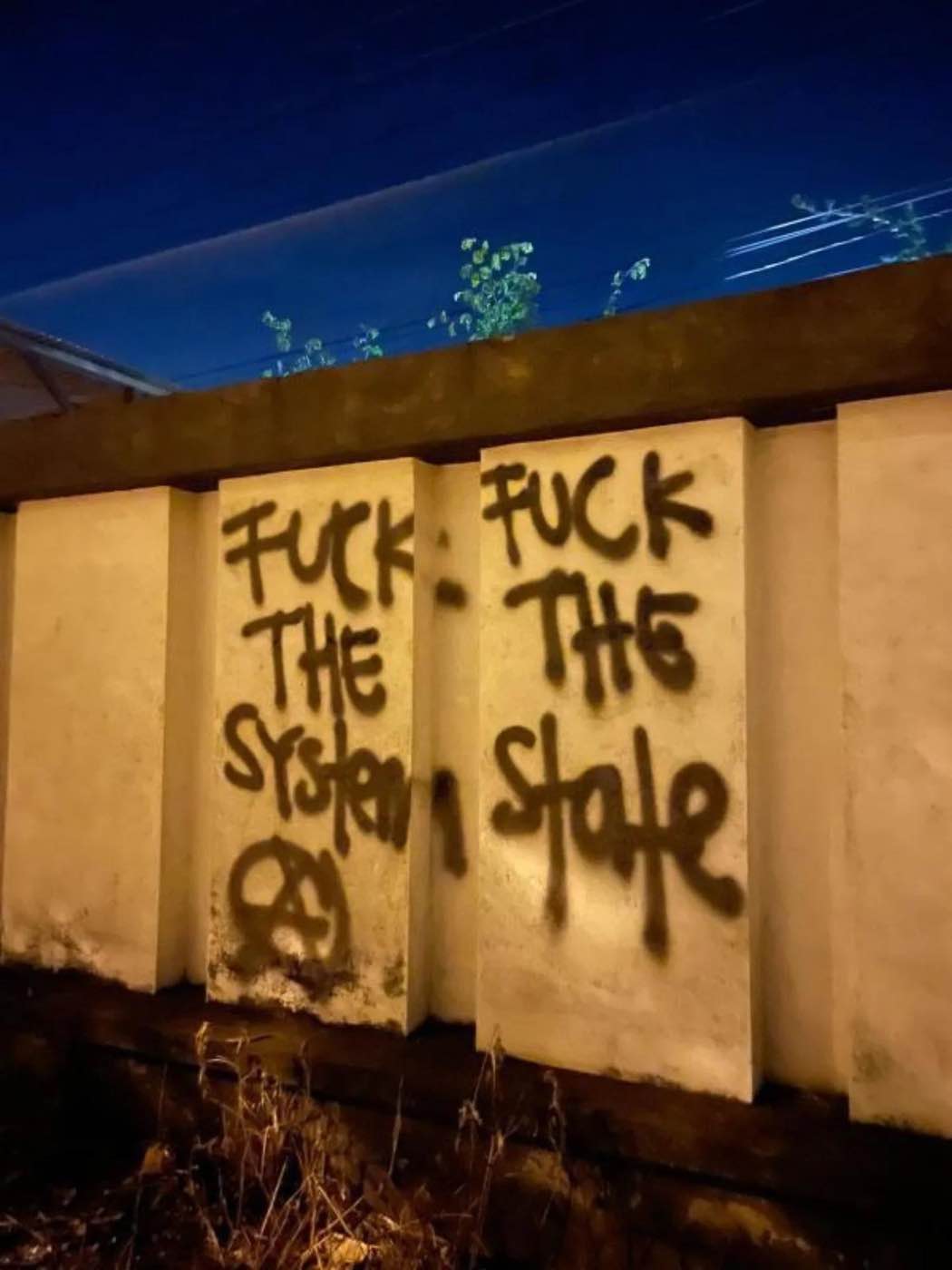
Graffiti anarchiste vu à Lamongan, en Indonésie, pendant les troubles actuels.
À lire aussi
- Interview with Comrades on the Situation in Indonesia [18 septembre 2025]
- Statement from Serikat Tahanan about Repression [17 septembre 2025]
- Indonesia Uprising: “A Collective Eruption of Rage” [1er septembre 2025]
- Anarchists on the Wave of Protest in Indonesia [2024]
- A Brief History of Anarchism in Indonesia [2022]
- Under the Radar? The Changing Face of Repression Against Anarchism and Punk in Indonesia [2021]
- Anarchism in Indonesia [2017]
- Serikat Tahanan
- Anti-Feminist Feminist Collective
Thanks to Lundimatin for the translation.
- GÉNÉRALISTES
- Le Canard Enchaîné
- La Croix
- Le Figaro
- France 24
- France-Culture
- FTVI
- HuffPost
- L'Humanité
- LCP / Public Senat
- Le Media
- La Tribune
- Time France
- EUROPE ‧ RUSSIE
- Courrier Europe Centrale
- Desk-Russie
- Euractiv
- Euronews
- Toute l'Europe
- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient
- Haaretz
- Info Asie
- Inkyfada
- Jeune Afrique
- Kurdistan au féminin
- L'Orient - Le Jour
- Orient XXI
- Rojava I.C
- INTERNATIONAL
- CADTM
- Courrier International
- Equaltimes
- Global Voices
- I.R.I.S
- The New-York Times
- OSINT ‧ INVESTIGATION
- OFF Investigation
- OpenFacto°
- Bellingcat
- Disclose
- Global.Inv.Journalism
- MÉDIAS D'OPINION
- Au Poste
- Cause Commune
- CrimethInc.
- Hors-Serie
- L'Insoumission
- Là-bas si j'y suis
- Les Jours
- LVSL
- Politis
- Quartier Général
- Rapports de force
- Reflets
- Reseau Bastille
- StreetPress
- OBSERVATOIRES
- Armements
- Acrimed
- Catastrophes naturelles
- Conspis
- Culture
- Curation IA
- Extrême-droite
- Human Rights Watch
- Inégalités
- Information
- Justice fiscale
- Liberté de création
- Multinationales
- Situationnisme
- Sondages
- Street-Médics
- Routes de la Soie