13.03.2025 à 18:26
[Fact-checking] Le Parlement européen n'a-t-il aucun pouvoir en comparaison de l'Assemblée nationale ?
Valentin Ledroit
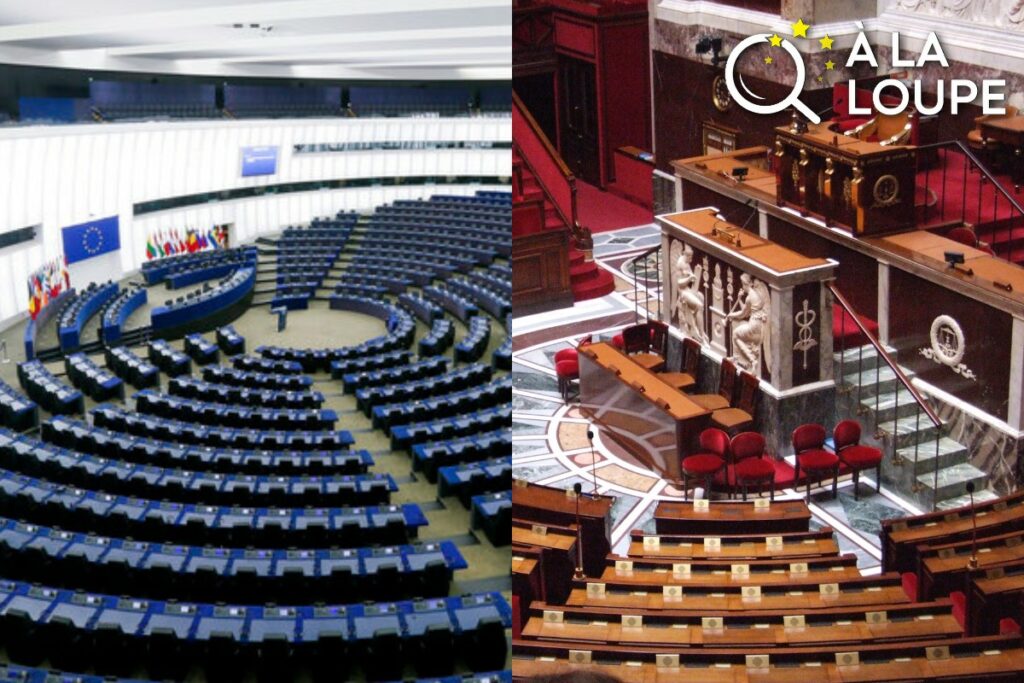
Seule institution de l'UE dont les membres sont élus au suffrage universel direct depuis 1979, le Parlement européen continue parfois de souffrir d’un manque de considération. A sa naissance en 1957, il n'est certes qu'une assemblée sans réel pouvoir. Il est d'ailleurs composé de parlementaires nationaux, délégués par leurs parlements respectifs. Mais au fil des […]
L’article [Fact-checking] Le Parlement européen n'a-t-il aucun pouvoir en comparaison de l'Assemblée nationale ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.
Texte intégral (2816 mots)
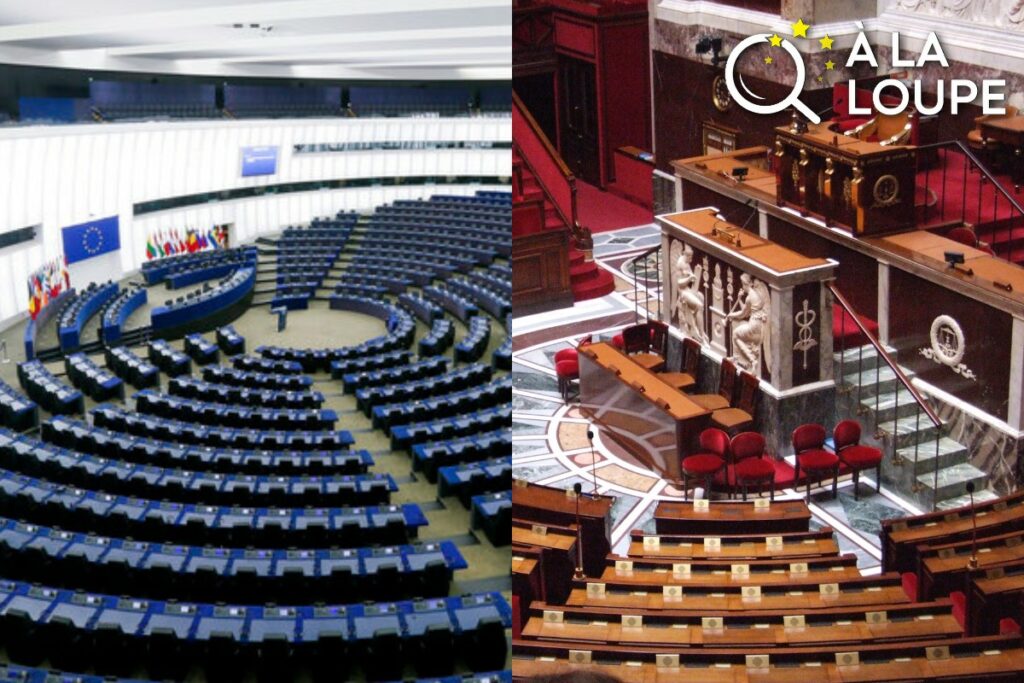
CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE DANS CET ARTICLE
- A la différence des députés nationaux, les députés européens ne peuvent pas proposer de lois.
- Ils partagent également plusieurs pouvoirs avec le Conseil.
- Ils jouent un rôle important et disposent d'une grande autonomie.
Seule institution de l'UE dont les membres sont élus au suffrage universel direct depuis 1979, le Parlement européen continue parfois de souffrir d’un manque de considération.
A sa naissance en 1957, il n'est certes qu'une assemblée sans réel pouvoir. Il est d'ailleurs composé de parlementaires nationaux, délégués par leurs parlements respectifs. Mais au fil des années, le Parlement européen va progressivement gagner en compétence et en autonomie. Il conserve toutefois un certain nombre de différences avec l'Assemblée nationale.
Pas d'initiative législative pour les eurodéputés
Une de ces différences souvent soulignée entre députés nationaux et européens est la capacité à proposer des textes de lois. Au sein de l’Union européenne, c’est la Commission européenne (l'exécutif européen) qui dispose de l'initiative législative. Et pour cela, celle-ci doit généralement suivre les orientations définies par le Conseil européen, qui rassemble les chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres. La Commission européenne soumet ensuite ses propositions de "lois" (directives ou règlements pour l'essentiel) au Conseil de l'UE et au Parlement européen en vue de leur adoption.
Côté français en revanche, les députés de l’Assemblée nationale, tout comme les sénateurs, peuvent déposer eux-mêmes des “propositions de lois” et ne s’en privent pas. Au cours de la XVIe législature (juin 2022-juin 2024), 1 260 textes ont ainsi été proposés par les parlementaires français (178 par les sénateurs).
Bien que les députés européens ne disposent pas sur le papier d'un tel pouvoir, la réalité est plus nuancée. D'une part, les députés nationaux partagent ce pouvoir avec le gouvernement. Or si ce dernier n'a déposé que 120 “projets de lois” pendant cette période, la majorité de la législation française est plutôt d'origine gouvernementale : 81 textes (57 %) arrivés à terme sont issus du gouvernement, contre 60 issus de parlementaires.
D'autre part, le Parlement européen peut tout de même inviter la Commission à élaborer une proposition sur un sujet particulier, en adoptant un rapport d’initiative législative (article 225 du traité sur le fonctionnement de l’UE). L'exécutif européen est alors libre de suivre ou non la proposition, mais s’engage à présenter “une proposition législative dans un délai d’un an” ou à inscrire celle-ci “dans son programme de travail de l’année suivante”. En cas de refus, il doit “en précise[r] les motifs circonstanciés au Parlement”, précise un accord-cadre entre les deux institutions. Et d’après une étude menée par le service de recherche du Parlement européen (EPRS) couvrant le mandat 2019 - 2024, la Commission a fait 23 propositions législatives, satisfaisant 33 des 58 demandes des eurodéputés.
Un vrai rôle de "colégislateur"…
Dans le cadre de la procédure législative ordinaire, qui concerne un grand nombre de domaines, le Parlement européen et le Conseil de l'UE sont sur un pied d’égalité pour amender et adopter des nouvelles mesures européennes. Toutes les lois doivent être votées par les deux institutions avant d'entrer en vigueur.
Le Parlement européen peut d'ailleurs être ambitieux et modifier en profondeur les textes proposés par la Commission européenne. Pour ne citer que quelques exemples, le Parlement européen a par exemple musclé certaines dispositions du règlement européen sur les services numériques (DSA), qui vise à combattre les produits et les contenus illicites en ligne. Les eurodéputés y ont ajouté par la voie d'amendements l'interdiction de la publicité ciblant les mineurs.
Le Parlement européen peut en revanche être considéré par certains comme un "purgatoire médiatique", où il est plus difficile de faire parler de soi. Ce qui n'empêche pas de nombreux parlementaires européens de considérer que leur rôle a une influence notable sur la vie des citoyens. Certains parviennent aussi à faire entendre leurs voix depuis Bruxelles ou Strasbourg, à l'image de Manon Aubry (La Gauche), Pascal Canfin (Renew) ou Raphaël Glucksmann (S&D).
… partagé avec les Etats
A l'inverse de l'Assemblée nationale, le Parlement européen n'a cependant pas le dernier mot pour adopter un texte seul. Une approbation du Conseil de l'Union européenne, qui représente les 27 Etats membres, est inévitable pour entériner un projet européen.
Dans les faits, le Conseil de l'UE peut d'ailleurs bloquer un tel projet sur une période indéterminée. Ce qui arrive notamment lorsque ses membres ne parviennent pas à s'accorder… Par exemple, un projet de directive visant à mettre fin au changement d'heure est entre les mains du Conseil de l'UE depuis 2019 et ne peut avancer tant que l'institution ne se prononce pas.
Dans plusieurs domaines par ailleurs, certaines décisions ne relèvent pas de la procédure ordinaire. Comme en matière de fiscalité ou de sécurité, où le Parlement européen n'a qu'un pouvoir de véto et ne peut pas amender les projets législatifs.
En matière budgétaire aussi, le pouvoir du Parlement européen connait quelques limites. Le budget annuel sur lequel il se prononce est plafonné par un cadre financier pluriannuel de sept ans, largement déterminé par les Etats membres. Contrairement à l'Assemblée nationale, qui de son côté se prononce sur un budget non contraint.
Plus d'autonomie
Contrairement aux députés français à Paris, les eurodéputés jouissent en revanche d'une totale autonomie vis-à-vis de l'exécutif. "Le parlementaire européen est un homme libre, maître de son bulletin de vote", écrivait en 2019 Jean-Louis Bourlanges, actuellement député MoDem des Hauts-de-Seine, après avoir été eurodéputé pendant près de 19 ans.
L'autonomie des députés européens peut également se faire sentir au sein de leur groupe politique, où se côtoient plusieurs nationalités et donc des sensibilités différentes. Malgré des consignes de vote communes au groupe, il est fréquent (et admis) de voir des voix dissidentes. En témoigne par exemple les vote sur le Pacte européen sur la migration et l’asile d'avril 2024. Les eurodéputés français des groupes S&D (socialistes et démocrates) et PPE (Parti populaire européen) ont tous voté contre une majorité des textes du paquet. A contre-courant de la plupart des autres membres de leurs groupes respectifs.
Du côté de l'Assemblée nationale, le groupe politique dont est issu le gouvernement a de plus grandes chances d'obtenir une majorité absolue. Le mode de scrutin de la Ve République favorise en effet l'émergence de telles majorité solides. L'opposition est donc généralement plus encline à s'opposer d'une seule et même voix aux textes.
L'argument semble toutefois moins valable depuis les deux derniers renouvellement de la chambre en 2022 puis en 2024, où aucun groupe ne détient non plus la majorité, rendant plus que jamais nécessaire la recherche de compromis sur chaque projet ou proposition de loi. Comme au Parlement européen donc, et comme dans beaucoup de parlements nationaux, où la culture du compromis est beaucoup plus présente.
Un pouvoir de contrôle de la Commission
La Constitution française prévoit que l’Assemblée nationale peut adopter une motion de censure ou “désapprouver le programme ou une déclaration de politique générale du gouvernement”. Deux situations qui entrainent sa démission. Sur la centaine de motions déposées sous la Ve République, deux ont été adoptées : en 1962, conduisant à la démission du gouvernement Pompidou, puis en décembre 2024 faisant chuter celui de Michel Barnier.
Le Parlement européen dispose d'un pouvoir similaire. Selon le traité sur l’Union européenne, il “exerce des fonctions de contrôle politique”. Les eurodéputés peuvent adopter une motion de censure pour obliger les membres de la Commission à “démissionner collectivement de leurs fonctions. Si aucune des huit motions de censure soumises n'a abouti, la menace d'un tel scénario en 1999 a poussé la Commission dirigée par Jacques Santer à démissionner.
En revanche, si l’Assemblée nationale peut être dissoute par le président de la République (ce qui s’est produit à 6 reprises sous la Ve République), le Parlement européen est à l’abri d’une telle menace.
Enfin, les eurodéputés se démarquent des parlementaires français d'une autre manière : ils sont chargés d'élire le président de la Commission européenne, sur proposition des chefs d'Etats et de gouvernement. Le Parlement européen procède également à des auditions de chaque commissaire désigné. Ce qui n'est pas une formalité, certains n'ayant effectivement pas franchi cette étape en 2019. Les eurodéputés procèdent enfin à un vote pour valider l'ensemble du collège.
L’article [Fact-checking] Le Parlement européen n'a-t-il aucun pouvoir en comparaison de l'Assemblée nationale ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.
10.03.2025 à 16:35
[Fact-checking] Quel rôle les Etats-Unis ont-ils joué dans la création de l'Union européenne ?
Florian Chaaban

Lors de la première réunion de son cabinet gouvernemental, mercredi 26 février 2025, Donald Trump a décrit l’intégration européenne, un projet encouragé depuis des décennies par Washington, comme étant enraciné dans une tentative de contrer le pays de l'Oncle Sam. "L’Union européenne a été conçue pour entuber les Etats-Unis. C’était l’objectif et ils y sont […]
L’article [Fact-checking] Quel rôle les Etats-Unis ont-ils joué dans la création de l'Union européenne ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.
Texte intégral (1928 mots)

Lors de la première réunion de son cabinet gouvernemental, mercredi 26 février 2025, Donald Trump a décrit l’intégration européenne, un projet encouragé depuis des décennies par Washington, comme étant enraciné dans une tentative de contrer le pays de l'Oncle Sam. "L’Union européenne a été conçue pour entuber les Etats-Unis. C’était l’objectif et ils y sont parvenus", a lancé le président républicain. Une phrase sans équivoque et une hostilité qui remet en cause les fondements mêmes de la relation transatlantique. Car dès l'origine, les deux parties ont entretenu des rapports étroits.
En d'autres termes, si la construction européenne est avant tout un projet porté par les Européens eux-mêmes, son histoire ne saurait être dissociée de l’influence, parfois bienveillante, parfois intéressée, des Etats-Unis.
Aux origines de la construction européenne, une influence américaine
L’implication américaine dans la construction européenne prend racine dans l’immédiat après-guerre. Confrontés à une Europe dévastée et divisée, les Etats-Unis voient le Vieux Continent comme un rempart stratégique contre le communisme et une opportunité économique pour asseoir son modèle libéral.
Sous la présidence du Démocrate Harry S. Truman, les Américains déploient en 1948 le Plan Marshall, officiellement appelé "Programme de rétablissement européen". 17 milliards de dollars sont alors injectés dans les économies européennes pour relancer des modèles particulièrement essoufflés après six ans de conflit. Mais cette aide financière n’est pas sans contrepartie : Washington conditionne son soutien à une coopération économique entre les Etats européens.
En imposant une logique de planification concertée, les Etats-Unis posent les premières pierres d’une Europe intégrée. Une vision alors partagée par Jean Monnet, considéré comme l’un des pères fondateurs de l’Europe. Admirateur de la Constitution fédérale américaine, il voyait dans ce modèle un exemple à suivre et plaidait pour la création d'"Etats-Unis d’Europe" sur cette base.
Cette intervention s’inscrit dans une volonté géopolitique claire : stabiliser un continent fragilisé, éviter le retour des nationalismes et surtout, contenir l’influence soviétique. "Il y avait un contexte qui a fait que les Etats-Unis avaient un rôle de 'protecteur', notamment en raison de l’existence, à l’Est de l’Europe, d’un Etat qui s’appelait l’Union soviétique. Ce danger commun, qui était perçu par beaucoup de responsables, a favorisé le rapprochement entre les Etats-Unis et l’Europe à cette époque", analyse le politologue et historien, Eric Roussel.
L’Europe unie devient ainsi un pilier des ambitions américaines, visant à créer une ligne de front politique et économique dans la guerre froide naissante.
L'américanisation de l'Europe : du fordisme à la CEE
L’influence américaine dépasse largement le cadre des relations diplomatiques ou de l’aide économique. Dès les années 1950, le modèle capitaliste américain s’exporte en Europe, porté par les échanges inter-entreprises et la diffusion des techniques de production initiées outre-Atlantique par Henry Ford quelques décennies plus tôt.
Son nom, associé à la naissance d'un désormais célèbre constructeur automobile, est aussi rattaché au "fordisme", une méthode industrielle alliant un mode de production en série fondé sur le principe de lignes d’assemblage, et un modèle économique ayant recours à des salaires élevés. En Italie par exemple, Fiat adapte son organisation industrielle aux standards américains après des séjours d’observation aux Etats-Unis.
Cette "américanisation" du tissu productif accompagne la naissance de la CECA (Communauté européenne du charbon et de l’acier) en avril 1951, dont l’esprit libéral doit beaucoup à la vision économique des Etats-Unis.
Ceux-ci voient dans l’intégration européenne l'occasion de structurer un vaste marché unique favorable à leurs intérêts économiques. Paul Hoffmann, administrateur de l’Economic Cooperation Administration qui gère le plan Marshall, plaide dès 1949 pour la formation d’un marché commun européen sans barrières douanières, un objectif parfaitement aligné avec les ambitions commerciales américaines. Celui-ci faciliterait alors la circulation des produits importés des Etats-Unis, tout en consolidant l'influence des technologies et des méthodes de production américaines en Europe.
Quelques années plus tard, le 25 mars 1957, les traités de Rome donnent notamment naissance à la Communauté économique européenne (CEE). Celle-ci a pour mission, par l'établissement d'un marché commun et le rapprochement progressif des politiques économiques des Etats membres, de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté. Elle encourage aussi une expansion continue et équilibrée, une stabilité accrue, un relèvement accéléré du niveau de vie, et des relations plus étroites entre les Etats qu'elle réunit. Moins sujet aux résistances nationales, le secteur économique apparaît alors comme un champ consensuel de coopération.
Ainsi, la construction européenne n’a jamais été pensée contre les Etats-Unis. Au contraire, elle repose sur des intérêts communs entre les deux parties. Après la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont soutenu l’unification politique de l’Europe pour assurer sa stabilité et limiter l’influence soviétique.
Le Vieux Continent a aussi adopté le modèle économique libéral américain, notamment à travers la CECA et la CEE, renforçant ainsi son alignement avec les idées diffusées outre-Atlantique. Loin d’être un rival, l'Europe se révèle être un partenaire clé des Etats-Unis, partageant une vision commune du monde occidental.
En savoir plus sur les relations entre l'Union européenne et les Etats-Unis
L’article [Fact-checking] Quel rôle les Etats-Unis ont-ils joué dans la création de l'Union européenne ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.
04.03.2025 à 10:43
[Fact-checking] Les Etats-Unis ont-ils apporté 350 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine depuis le début de la guerre ?
Hugo Palacin

300 à 350 milliards de dollars. C'est un montant que Donald Trump met régulièrement en avant lorsqu'il évoque les aides apportées par les Etats-Unis à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, en février 2022. Un argument qu'il utilise notamment pour faire pression sur Volodymyr Zelensky et lui arracher des concessions, tant sur les ressources […]
L’article [Fact-checking] Les Etats-Unis ont-ils apporté 350 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine depuis le début de la guerre ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.
Texte intégral (1437 mots)

300 à 350 milliards de dollars. C'est un montant que Donald Trump met régulièrement en avant lorsqu'il évoque les aides apportées par les Etats-Unis à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, en février 2022. Un argument qu'il utilise notamment pour faire pression sur Volodymyr Zelensky et lui arracher des concessions, tant sur les ressources minières ukrainiennes que sur un accord de paix avec la Russie de Vladimir Poutine. Mais ce chiffre de 350 milliards de dollars d'aides américaines à l'Ukraine est faux.
Une aide américaine essentiellement militaire, estimée à 120 milliards de dollars
Les Etats-Unis ont accordé 114,1 milliards d'euros d'aides à l'Ukraine entre le 22 février 2022, début de l'invasion russe, et le 31 décembre 2024. Ce chiffre est issu du Kiel Institute, un institut de recherche économique allemand spécialisé dans le suivi du soutien militaire, financier et humanitaire à l'Ukraine. Cela représente, selon le taux de change moyen établi début mars 2025, quasiment 120 milliards de dollars. Soit presque trois fois moins que le montant de 350 milliards de dollars (soit 333 milliards d'euros), régulièrement mis en avant par Donald Trump.
Dans le détail, toujours selon le Kiel Institute, Washington aurait fourni à Kiev 64,1 milliards d'euros d'aide militaire, 46,6 milliards d'euros d'aide financière et 3,4 milliards d'euros d'aide humanitaire. Ces montants placent les Etats-Unis au premier rang des pays fournisseurs d'aide à l'Ukraine. Mais si l'on compare ces chiffres avec l'ensemble de l'Europe, et même lorsqu'on les rapporte au PIB national, l'aide américaine ne se détache pas particulièrement de celle des Européens.
Les Etats-Unis ont moins aidé l'Ukraine que l'Europe
Selon les calculs du Kiel Institute, les aides à l'Ukraine venues d'Europe depuis le début de l'invasion russe atteignent 132,3 milliards d'euros. Un montant qui s'avère donc supérieur aux aides américaines. Dans le détail, 49 milliards d'euros ont été directement alloués par les institutions de l'Union européenne, essentiellement en aide financière, tandis que les 83,3 milliards d'euros restants proviennent d'aides militaires essentiellement fournies par des Etats membres de l'UE.
Par exemple, l'Allemagne, deuxième pays ayant le plus aidé l'Ukraine, a fourni pour 17,26 milliards d'euros d'aides depuis février 2022, contre 8,05 milliards pour le Danemark, 7,33 milliards pour les Pays-Bas, 5,4 milliards d'euros pour la Suède ou 4,89 milliards pour la France. Parmi les pays européens qui ne sont pas membres de l'UE, on retrouve le Royaume-Uni, troisième donateur mondial avec 14,8 milliards d'euros, ou encore la Norvège, qui a soutenu l'Ukraine à hauteur de 3,35 milliards d'euros depuis le début de la guerre.
Si l'écart reste faible entre l'aide apportée par les Etats-Unis d'une part et par l'ensemble de l'Europe d'autre part, il risque de s'agrandir considérablement dans les mois et années à venir. 115 milliards d'euros d'aides supplémentaires devraient être engagés par les pays européens dans un futur proche. Et c'est sans compter un potentiel accroissement du soutien suite au plan de défense de 800 milliards d'euros annoncé le 4 mars 2025 par Ursula von der Leyen. Quelques heures avant, le président américain décidait de couper les vannes de l'aide à Kiev. Selon les chiffres de l'institut Kiel de décembre 2024, 4,8 milliards d'euros d'aide étaient encore censés être versés prochainement par les Etats-Unis.
L'aide américaine à l'Ukraine représente 0,5 % de son PIB
En rapportant le montant de son aide à son PIB national, là aussi, l'engagement des Etats-Unis en faveur de l'Ukraine n'est pas le plus important parmi les alliés de Kiev. Cette aide représente ainsi 0,53 % du PIB américain, selon les données du Kiel Institute. A titre de comparaison, un certain nombre d'Etats européens font mieux, en incluant dans ce calcul leur participation de 0,2 à 0,3 % du PIB à l'aide commune de l'UE.
L'Estonie et le Danemark figurent en tête de ce classement : ils ont consacré l'équivalent de 2,5 % de leur PIB national pour soutenir l'Ukraine. Ils devancent la Lituanie (2,1 %), la Lettonie (1,8 %) ou encore la Finlande (1,3 %). Les "grands" pays européens, eux, se rapprochent des Etats-Unis : 0,72 % pour l'Allemagne, 0,52 % du PIB pour la France, 0,51 % pour le Royaume-Uni (qui n'est pas membre de l'UE).
L’article [Fact-checking] Les Etats-Unis ont-ils apporté 350 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine depuis le début de la guerre ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.
- GÉNÉRALISTES
- Le Canard Enchaîné
- La Croix
- Le Figaro
- France 24
- France-Culture
- FTVI
- HuffPost
- L'Humanité
- LCP / Public Senat
- Le Media
- La Tribune
- Time France
- EUROPE ‧ RUSSIE
- Courrier Europe Centrale
- Desk-Russie
- Euractiv
- Euronews
- Toute l'Europe
- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient
- Haaretz
- Info Asie
- Inkyfada
- Jeune Afrique
- Kurdistan au féminin
- L'Orient - Le Jour
- Orient XXI
- Rojava I.C
- INTERNATIONAL
- CADTM
- Courrier International
- Equaltimes
- Global Voices
- I.R.I.S
- The New-York Times
- OSINT ‧ INVESTIGATION
- OFF Investigation
- OpenFacto°
- Bellingcat
- Disclose
- Global.Inv.Journalism
- MÉDIAS D'OPINION
- Au Poste
- Cause Commune
- CrimethInc.
- Hors-Serie
- L'Insoumission
- Là-bas si j'y suis
- Les Jours
- LVSL
- Politis
- Quartier Général
- Rapports de force
- Reflets
- Reseau Bastille
- StreetPress
- OBSERVATOIRES
- Armements
- Acrimed
- Catastrophes naturelles
- Conspis
- Culture
- Curation IA
- Extrême-droite
- Human Rights Watch
- Inégalités
- Information
- Justice fiscale
- Liberté de création
- Multinationales
- Situationnisme
- Sondages
- Street-Médics
- Routes de la Soie


